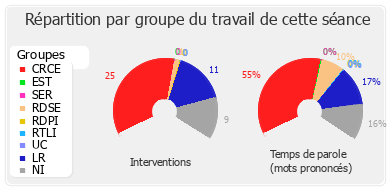Séance en hémicycle du 13 septembre 2013 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (proposition n° 817, texte de la commission n° 836, rapport n° 835).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi aujourd’hui soumise à votre examen touche d’abord les 50 000 personnes directement visées par une procédure de soins sans consentement. Mais elle intéresse également leur famille, leur entourage et concerne la société tout entière.
Le Conseil constitutionnel a censuré deux dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et a fixé au 1er octobre 2013 la date à laquelle le Parlement doit rendre ce texte conforme à notre Constitution. Cet impératif nous impose d’agir rapidement. Je tiens à vous assurer que j’ai parfaitement conscience des difficultés posées par ce calendrier resserré et je souhaite vous remercier, en particulier vous, madame la présidente de la commission, et vous, monsieur le rapporteur, de votre diligence.
Monsieur le rapporteur, je salue votre travail, notamment les nombreuses auditions que vous avez pu mener en un temps record. La commission des affaires sociales s’est appropriée ce texte en y apportant plusieurs modifications que j’aurai l’occasion d’évoquer au cours du débat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, revenons sur la genèse de ce texte.
La décision rendue par les Sages a incité les députés de la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie à travailler, dans un premier temps, sur le sujet majeur que constituent les soins sans consentement.
Au regard des demandes nombreuses des professionnels et des attentes fortes des malades, des familles et des associations, les députés ont fait le choix d’aller au-delà d’une simple mise en conformité. Le Gouvernement soutient pleinement cette démarche, car elle vise à faire progresser les soins sans consentement.
Trop souvent, dans notre société, les soins liés à la maladie mentale inquiètent, parce que la maladie mentale fait peur. Elle reste méconnue et nous avons du mal, disons-le, tous autant que nous sommes, à nous défaire des stéréotypes qui l’accompagnent. Les malades sont régulièrement associés à des personnes dangereuses, violentes, dépendantes des autres ou encore simples d’esprit. Ils sont fréquemment perçus comme un fardeau pour la collectivité. La réalité est bien différente : la maladie mentale recouvre en réalité des situations complexes, diverses, qui ne peuvent se réduire à quelques caricatures.
Le devoir des responsables politiques et du législateur est de rappeler que celles et ceux qui souffrent doivent d’abord être considérés comme des personnes malades. L’objectif premier de la loi est de prendre en compte leur vulnérabilité et d’y apporter les réponses adaptées.
La maladie mentale fragilise au quotidien des hommes et des femmes. La souffrance psychique et physique évolue tout au long de la vie. Des épisodes de crise se suivent, mais ils succèdent aussi à des périodes d’amélioration. C’est l’incertitude sur ce que sera leur lendemain qui caractérise le plus souvent ces personnes et qui les condamne à la précarité.
Par conséquent, nous ne pouvons oublier ou négliger la vulnérabilité sociale qui frappe les personnes en souffrance. Pour elles et pour leur famille, les entraves du quotidien sont nombreuses, et tout devient plus difficile : accéder à l’école, à un logement ou à un emploi relève, chaque fois, d’un véritable parcours du combattant.
Les soins dits « sans consentement » constituent une part réduite des soins en psychiatrie. Rappelons que leur objectif n’est pas de contraindre ceux qui les refusent. Ils ont pour objet de saisir la singularité de la maladie mentale, qui empêche parfois le patient d’adhérer d’emblée à la démarche de soins.
Ne pas ignorer la réalité, c’est également rappeler que le malade peut représenter un danger, pour lui, mais aussi pour les autres. Nous devons évidemment tenir compte de cette spécificité de la maladie mentale, même si elle ne peut oblitérer l’ensemble des réponses à apporter.
Il nous faut parvenir à un équilibre entre les libertés individuelles, la nécessité des soins et l’exigence d’ordre public.
C’est justement cet équilibre que la loi du 5 juillet 2011 n’a pas trouvé. Elle est marquée, chacun s’en souvient, notamment dans cet hémicycle, par une inspiration sécuritaire. Cette dérive s’illustre à travers plusieurs dispositions, comme le renforcement des conditions de levée des mesures pour les malades hospitalisés en unités pour malades difficiles, les UMD, ou encore l’instauration de ce que l’on a pu appeler « un casier psychiatrique ».
Ce ne sont ni la réflexion ni la concertation qui ont guidé l’élaboration de cette loi ; c’est bien plutôt la réaction, dans l’urgence, à une série de faits divers.
Le milieu psychiatrique a dénoncé, avec raison, la démarche de stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques.
Par ailleurs, la loi de 2011 n’est pas adaptée aux réalités du terrain. L’expérience que nous en avons depuis son entrée en vigueur voilà maintenant deux ans l’a montré. La complexité de ses dispositions a rendu difficile sa mise en œuvre concrète par les professionnels de santé. Comme élus, vous en avez souvent été les témoins directs.
Si le Gouvernement soutient cette proposition de loi, c’est d’abord parce qu’elle se fonde sur une philosophie nouvelle. Elle fait le choix de placer le patient au cœur de sa démarche.
Cette ambition s’illustre d’abord à travers la révision des deux dispositions qui ont été jugées contraires à la Constitution.
La première révision consiste à limiter l’application du régime plus strict de levée des soins sans consentement : celui-ci ne concernera désormais que les irresponsables pénaux encourant un certain niveau de peine.
Lorsqu’il s’agira d’atteintes aux biens, le régime plus strict s’appliquera aux personnes encourant une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement. Certains cas, parmi les plus graves, seront concernés par ce régime ; je pense notamment aux destructions par incendie.
Lorsqu’il s’agira d’atteintes aux personnes, le régime plus strict s’appliquera à ceux qui ont été concernés par une procédure pénale punie d’au moins cinq années. Les agressions sexuelles y seront intégrées.
La seconde révision concerne la volonté de replacer dans le droit commun les patients hospitalisés en unités pour malades difficiles.
Il s’agit là d’un point décisif de ce texte. La loi adoptée en 2011 entretient un amalgame difficilement acceptable. Elle assimile en effet les malades difficiles à des malades dangereux.
La question de l’ordre public ne peut être éludée et constitue une priorité du Gouvernement. Cependant, il est essentiel de rappeler que la prise en charge des personnes en souffrance relève d’abord d’une démarche de soins et d’un processus thérapeutique.
Les conditions de levée plus strictes pour des malades qui nécessitent avant tout des soins plus intensifs ne sont donc pas justifiables.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes qui sont directement confrontées, au quotidien, aux troubles psychiques. Régulièrement, je rencontre des professionnels de santé, des soignants, des psychiatres, des directeurs d’établissement. J’ai également souvent eu des échanges avec des associations représentant les patients, mais aussi les familles.
Que disent-ils ? Ils insistent chaque fois sur la nécessité d’accorder une place plus grande à celles et ceux qui sont les premiers concernés : les patients.
Pour y parvenir, il est décisif d’adapter la procédure judiciaire et le traitement aux spécificités des troubles psychiques.
Tel est l’objet de cette proposition de loi que le Gouvernement soutient.
D’abord, concernant la procédure judiciaire, des mesures très concrètes sont prévues.
Il s’agit de prendre en compte les besoins des malades dans la définition du lieu de l’audience.
L’audience du juge des libertés et de la détention doit pouvoir s’adapter aux personnes hospitalisées en psychiatrie, qui ne sont pas des justiciables comme les autres. Il faut donc que l’audience puisse se tenir au sein même de l’établissement de santé, sans compromettre les principes de la procédure judiciaire.
La commission a souhaité revenir sur le texte de l’Assemblée nationale qui prévoyait la possibilité pour les établissements de santé de mutualiser les salles d’audience sous certaines conditions.
En permettant une certaine souplesse, la rédaction précédente permettait aux acteurs de terrain de faciliter la mise en œuvre de cette grande avancée que constitue l’audience du juge au sein de l’établissement de santé. Celle-ci ne peut être remise ne cause : elle constitue même l’un des enjeux majeurs de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale.
Mesdames, Messieurs les sénateurs, je comprends votre objectif. Néanmoins, il est nécessaire de pouvoir dans certains cas faire preuve d’une certaine souplesse pour prendre en compte la réalité à laquelle sont confrontés les établissements de santé et les professionnels de la justice. Je compte sur la sagesse des parlementaires pour que, dans la suite des débats, il en soit tenu compte.
De la même manière, vous avez souhaité supprimer totalement la possibilité de recourir à la visioconférence. Nous savons tous que, dans la très grande majorité des cas, cette pratique est inadaptée, voire déconseillée. C’est pourquoi les députés ont prévu d’encadrer très strictement son utilisation. Il paraît toutefois difficile de se priver totalement de la possibilité d’y recourir, dans les rares cas où un déplacement du juge et du malade ne serait pas possible ou pour faire face à des situations d’urgence. Là encore, mesdames, messieurs les sénateurs, j’en appelle à votre sagesse.
Adapter la procédure judiciaire, c’est également rendre obligatoire la présence de l’avocat. Cette disposition est l’unique moyen de rendre pleinement effectif le droit pour le malade à être défendu.
Enfin, adapter la procédure judiciaire, c’est tout mettre en œuvre pour préserver et garantir le secret médical. La personne malade pourra ainsi être protégée en demandant que l’audience ne soit pas publique.
Sur le sujet de la procédure, le texte adopté par l’Assemblée nationale réduit le délai d’intervention du juge à douze jours. Nous ne pouvons accepter que des personnes soient maintenues à l’hôpital lorsque leur état ne le justifie pas.
Toutefois, il nous faut également faire face à la réalité et prendre en compte les contraintes de la procédure.
Pour statuer et pour organiser l’audience, le juge a besoin d’un délai. Il en a également besoin pour recueillir des avis médicaux et évaluer le mode de prise en charge. Un compromis a été trouvé sur un délai de douze jours, afin de réduire le délai actuel, qui est de quinze jours, tout en permettant à la procédure de se dérouler dans de bonnes conditions.
Le second impératif, c’est l’adaptation de la procédure de soins. Je pense d’abord aux sorties de courte durée. Elles sont partie intégrante du processus thérapeutique, lorsque l’état de santé des malades le permet.
La loi du 5 juillet 2011 a supprimé les sorties d’essai. Le Gouvernement ne souhaite pas réinstaurer des sorties qui duraient parfois plusieurs mois. Néanmoins, la loi doit permettre à une personne hospitalisée sans son consentement de pouvoir sortir un week-end, par exemple. Cela doit être rendu possible sans qu’il soit nécessaire d’établir un programme de soins, qui n’a pas de sens ici et génère des procédures administratives inutiles.
Adapter la procédure de soins, c’est également la simplifier, notamment en réduisant le nombre de certificats médicaux exigés. Leur multiplicité est souvent inutile, car elle n’est pas nécessairement une garantie pour le malade. La proposition de loi qui vous est présentée supprime le certificat du huitième jour, ainsi que l’avis conjoint exigé pour saisir le juge, qui devient un avis simple.
Vous proposez, pour votre part, de supprimer la double expertise psychiatrique exigée pour la levée des mesures de soins sans consentement des irresponsables pénaux. Il faut noter que ces expertises extérieures sont un apport indispensable pour les autorités qui ont la responsabilité de contrôler et de lever la mesure. L’analyse des psychiatres commis en qualité d’experts ne saurait en effet être assimilée à celle du collège, qui a une vocation différente. Ces expertises permettent également aux professionnels de santé d’avoir un appui pour des décisions lourdes de conséquences. J’entends votre volonté d’alléger la procédure, mais je crains que cette modification n’entrave son bon fonctionnement.
Enfin, cette proposition de loi œuvre pour le renforcement des droits des malades. D’abord, elle précise la notion de soins sans consentement, ce qui n’est pas un détail puisque l’amalgame est souvent fait avec les soins sous contrainte. La loi disposera ainsi qu’un patient faisant l’objet d’un programme de soins, et suivi en ambulatoire, ne peut être contraint, sauf à être à nouveau hospitalisé.
Cette proposition de loi réaffirme aussi un principe auquel chacun d’entre vous est profondément attaché : les personnes détenues peuvent évidemment faire l’objet de soins avec leur consentement. Cette précision n’apparaît nulle part dans la loi de 2011.
Le texte introduit enfin la possibilité pour les parlementaires de visiter les établissements autorisés à recevoir des patients soignés sans consentement, dans la mesure où ces établissements constituent alors des lieux de privation de liberté.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est important pour faire progresser encore les conditions dans lesquelles sont organisés les soins sans consentement. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de tout faire pour replacer le patient au cœur de cette procédure et de faire en sorte que personnes malades et personnes dangereuses ne soient pas assimilées. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous appelle à soutenir la proposition de loi issue des travaux de l’Assemblée nationale. §

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je commencerai par évoquer les sujets qui ne sont pas traités par la proposition de loi. Ce texte ne refonde pas la politique de secteur, qui reste en pratique le pilier des soins libres en psychiatrie, même si elle a été privée de base légale spécifique par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST ».
Ce texte ne règle pas la question de l’inégalité des moyens et de la diversité des pratiques de prise en charge en psychiatrie sur le territoire. Il ne remédie pas à l’absence parfois totale d’activités programmées lors du retour à son domicile d’un malade hospitalisé pendant une longue période. Il n’améliore pas le fonctionnement des commissions départementales des soins psychiatriques, qui ne sont pas constituées partout, ce qui est regrettable. Il ne traite ni de la prévention primaire ni de l’éducation thérapeutique des patients. Il ne développe pas le rôle des équipes mobiles de psychiatrie ni ne renforce la continuité de la prise en charge des malades par les équipes. Il ne met pas en place une personne de confiance adaptée à la situation spécifique de la maladie mentale et de sa prise en charge, alors même que cette mesure est réclamée par de nombreuses associations.
Ces sujets sont essentiels pour la prise en charge de l’ensemble des personnes souffrant de troubles mentaux, et il faut que des réponses soient apportées aux problèmes rencontrés au quotidien par les soignants et les malades. Nous prenons l’engagement que ces enjeux essentiels pour l’ensemble des personnes souffrant de troubles mentaux seront traités dans le cadre qui leur est adapté, à savoir le volet santé mentale de la loi de santé publique à venir. Nous n’esquivons donc pas le débat sur ces sujets. Mais la proposition de loi qui nous vient de l’Assemblée nationale n’a pas vocation à les aborder, car elle ne concerne pas la réalité de l’immense majorité de la prise en charge psychiatrique aujourd’hui. Son objectif est circonscrit, précis et nécessaire.
Les associations de patients nous l’ont rappelé fortement et nous en sommes nous-mêmes convaincus, la confiance est au fondement de la relation thérapeutique, que les soignants nomment « alliance thérapeutique ». La contrainte s’oppose généralement aux soins. De fait, c’est la confiance entre le malade et l’équipe soignante qui permet aujourd’hui la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux sous forme ambulatoire dans 85 % des cas. Même parmi les personnes hospitalisées, 80 % le sont avec leur consentement. Mais, pour 20 % d’entre elles, la contrainte a été le seul moyen de permettre l’accès aux soins.
Pour cette petite minorité de malades, la pathologie a aboli le discernement. Or, comme me l’a dit avec sagesse un des psychiatres que j’ai eu la possibilité d’auditionner, le discernement est la première des libertés, sans laquelle toutes les autres sont des leurres. Les soins sans consentement sont d’abord, il faut le rappeler, une mesure thérapeutique destinée à permettre aux équipes médicales qui se chargent de cette lourde tâche de tenter de rétablir le discernement des personnes atteintes des pathologies les plus lourdes.
Pour cette minorité, des dispositions spécifiques existent et doivent exister afin de permettre d’assurer l’équilibre entre la logique des soins et la protection des libertés publiques. Une mesure de contrainte qui excède ce qui est strictement nécessaire aux soins est une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne. Le juge constitutionnel a donc décidé un contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention, et la loi du 5 juillet 2011 l’a mis en œuvre.
Il existe également une autre dimension des soins sans consentement, qui vise la protection des tiers. Parmi les malades qui n’ont pas conscience de leur maladie, une minorité – peut-être huit cents personnes chaque année – peut présenter, à un moment donné, un danger pour autrui. Il y a donc un enjeu en matière de sécurité qui ne peut être ignoré.
La loi du 5 juillet 2011 avait fait, dans cet équilibre difficile entre soins, libertés et ordre public, des choix très contrastés.
D’une part, je l’ai dit, elle a mis en œuvre les exigences constitutionnelles de contrôle par le juge. Elle a en outre mis fin à l’obligation d’hospitalisation complète comme unique forme de prise en charge pour les personnes faisant l’objet d’une décision de soins sans consentement.
Mais, d’autre part, elle a désigné comme potentiellement dangereux, au point qu’un contrôle particulier doive être exercé sur leur sortie des soins sans consentement, les malades appartenant à une catégorie particulière : ceux qui séjournent ou ont séjourné dans une unité pour malades difficiles, ou UMD. Le Conseil constitutionnel a jugé que ce choix était insuffisamment fondé et a censuré les dispositions prévues par la loi pour sa mise en œuvre. Il a également donné raison à notre collègue Muguette Dini, premier rapporteur de la commission des affaires sociales en 2011, en précisant que les soins ambulatoires sans consentement ne peuvent donner lieu à des mesures de contrainte.
En réponse à la censure du Conseil constitutionnel, l’Assemblée nationale et le Gouvernement ont fait le choix de ne conserver des mesures plus strictes de sortie des soins sans consentement que pour les personnes déclarées irresponsables pénalement et ayant commis des actes contre les personnes passibles de cinq ans d’emprisonnement ou des actes contre les biens passibles d’une condamnation de dix ans. Nous partageons ce choix équilibré et médicalement fondé.
De même, la suppression du statut légal des UMD et leur retour dans le droit commun des services hospitaliers nous paraissent adaptés à la réalité qui est la leur. Les UMD ne peuvent plus être assimilées à des unités disciplinaires, comme ce fut le cas lors de leur création au début du XXe siècle. Ce sont des services de soins intensifs, qui doivent être également des services d’excellence permettant, avec un encadrement renforcé, la prise en charge de pathologies particulièrement lourdes. Leur fonctionnement garantit une meilleure prise en compte de la liberté des personnes, notamment au travers de la commission de suivi médical, à laquelle les soignants sont particulièrement attachés ; je le suis moi aussi. Certains s’inquiètent de leur éventuelle suppression. Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, qu’il n’en sera rien ?
L’Assemblée nationale a également fait le choix de réformer la loi de 2011 sur des points non censurés par le Conseil constitutionnel, mais faisant l’objet d’un large consensus. Je pense particulièrement au rétablissement de dispositions relatives aux sorties d’essai et à l’allègement des procédures et des certificats. Un principe important est posé par le texte, celui de la tenue des séances du juge des libertés et de la détention au sein de l’établissement d’accueil.
La commission des affaires sociales du Sénat partage pleinement l’objectif de cette proposition de loi et a souhaité, dans le temps très limité dont elle a disposé, se placer dans le prolongement du travail approfondi accompli par l’Assemblée nationale, mais aussi, dès 2011, par Muguette Dini et plusieurs sénateurs appartenant à tous les groupes. Les amendements adoptés en commission tendent à renforcer la prise en charge médicale dans le cadre des procédures de soins sans consentement, et spécialement pour les soins ambulatoires sans consentement, et à renforcer les garanties des droits.
Ce texte est nécessaire, attendu et urgent. Malgré son examen rapide, le Sénat aura pu, je le crois, jouer son rôle. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous nous félicitons de son examen et que nous vous proposons de l’adopter dans la rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales. §

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, comme cela vient d’être rappelé, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré, dans sa décision du 20 avril 2012, deux dispositions du code de la santé publique. Ces dispositions, issues de la loi du 5 juillet 2011, portaient sur les conditions de sortie de soins pour les malades psychiatriques séjournant ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Le Conseil constitutionnel a différé l’effet de sa décision au 1er octobre 2013, ce qui laissait quand même au Gouvernement dix-huit mois pour modifier les dispositions censurées. Ce laps de temps était largement suffisant pour se pencher sérieusement sur ce sujet complexe, intime, touchant à l’encadrement juridique des soins psychiatriques sans consentement, qui concernaient quelque 70 000 personnes en 2011.
Or le Gouvernement n’a pas profité de ce délai. Le texte n’a été déposé à l’Assemblée nationale que le 3 juillet et n’a été débattu en séance que le 25 juillet. Nous voilà donc obligés d’examiner cette proposition de loi en session extraordinaire, à marche forcée ! Ce faisant, le Gouvernement prive le Sénat d’un vrai débat sur la santé mentale. Il serait bon que le Gouvernement ne considère par la Haute Assemblée comme une simple chambre d’enregistrement.
Ce texte est pourtant d’une importance capitale, car les soins psychiatriques sans consentement s’articulent autour de trois exigences fortes liées à des enjeux majeurs : soigner les malades, garantir la sécurité des citoyens face à des comportements potentiellement dangereux et protéger les droits et libertés fondamentaux des patients hospitalisés sous contrainte.
La loi du 5 juillet 2011 a mis en place des avancées majeures en matière d’encadrement des patients potentiellement violents et de contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisation sans consentement. Elle a créé un régime spécifique plus strict que le précédent pour les sorties de soins prononcées par le juge ou par un représentant de l’État à l’égard des patients en UMD ou déclarés pénalement irresponsables. Elle a également introduit un contrôle systématique des mesures d’hospitalisation par le juge des libertés et de la détention dans les quinze jours suivant l’admission du patient.
Bien sûr, cette loi n’était pas parfaite et la Haute Assemblée avait déjà formulé des réserves sur certaines de ses mesures. Nous avions d’ailleurs largement modifié le texte initial.
Permettez-moi de rappeler quelques-unes de ces dispositions : il s’agissait d’offrir la possibilité au juge de statuer en chambre de conseil, de prévoir le recours à une « salle d’audience spécialement aménagée [...] pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement » et enfin d’encadrer le recours à la visioconférence, avec un aménagement spécifique de la salle d’audience et un avis médical attestant que l’état mental du patient n’y fait pas obstacle.
Le juge constitutionnel, pour sa part, a estimé que la loi ne présentait pas de garanties suffisantes justifiant l’existence d’un régime dérogatoire au droit commun. Pourtant, le texte qui nous est proposé aujourd’hui va bien plus loin que les modifications requises par la décision du Conseil constitutionnel. Plus encore, il revient sur certaines des avancées juridiques apportées par le législateur en 2011.
Madame la ministre, je tiens à vous dire que la position du groupe UMP n’est pas guidée par des calculs politiciens. Le sujet est trop important. La proposition de loi apporte au code de la santé publique certaines modifications appréciables et auxquelles nous sommes favorables.
Disant cela, je pense particulièrement à la simplification des démarches administratives à la charge des professionnels de santé, à la création de sorties thérapeutiques de courtes durées pour les patients hospitalisés ou encore à la tenue à l’hôpital des audiences devant le juge.
Mais le problème majeur de ce texte est qu’il rompt complètement l’équilibre qui prévalait dans la réforme de 2011 entre la protection des droits des malades et la protection de la sécurité des autres citoyens. Vous supprimez purement et simplement le suivi médical spécifique des patients placés dans des unités pour malades difficiles que permettait le régime dérogatoire de mainlevée des soins.
Or, le Conseil constitutionnel n’a jamais considéré que le législateur ne pouvait pas prévoir des dispositifs spécifiques, plus stricts, en matière de sortie de soins pour certaines catégories de patients psychiatriques jugés dangereux pour eux et pour les autres. Il s’est contenté de dire que certaines dispositions de la loi du 5 juillet 2011, en l’état actuel, n’encadraient pas avec une précision suffisante les conditions d’hospitalisation.
La présente proposition de loi réintègre les patients en unité pour malades difficiles dans le régime de droit commun de l’hospitalisation sans consentement. Ce faisant, elle supprime la définition légale de ces unités donnée par l’article L. 3222-3 du code de la santé publique. Il convient néanmoins de rappeler que les onze UMD existant en France s’occupent de patients aux troubles mentaux particulièrement lourds et aux comportements les plus violents.
Non seulement vous supprimez la référence législative aux UMD mais vous limitez également le régime applicable aux patients déclarés pénalement irresponsables aux seules personnes dont les infractions sont susceptibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour les atteintes à la personne et de dix ans pour les atteintes aux biens.
Votre dispositif ne s’appliquera donc qu’aux patients ayant commis des infractions particulièrement graves. Les autres patients pourront quitter leurs soins psychiatriques beaucoup plus facilement, ce qui peut être dangereux à la fois pour eux et pour les autres.
Le texte qui nous est aujourd’hui présenté se fait fort de renforcer les droits des patients et les garanties judiciaires entourant les mesures d’hospitalisation sous contrainte. Ces objectifs sont fort louables mais, faute de temps et faute de concertation, certaines mesures correspondantes apparaissent comme de « fausses bonnes idées ».
Ainsi la présence de l’avocat au moment des audiences devant le juge des libertés et de la détention, le JLD, rendue obligatoire par la proposition de loi, n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact alors même qu’elle va accroître les frais de justice à la charge de l’État.
Madame la ministre, comprenez-nous bien : nous ne sommes pas contre cette mesure sur le fond. D’ailleurs, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, et de la Cour de cassation sur la présence de l’avocat au cours des procédures judiciaires vont également dans ce sens. Nous regrettons néanmoins la précipitation qui a entouré cette proposition de loi et l’absence d’étude d’impact approfondie.
La diminution du délai à partir duquel le juge judiciaire contrôle la mesure d’hospitalisation sans consentement de quinze à douze jours inquiète fortement l’Union syndicale des magistrats ainsi qu’un grand nombre de professionnels psychiatriques. Une telle réduction aura vraisemblablement un effet relatif. Surtout, elle ne renforce en rien les garanties judiciaires apportées aux patients hospitalisés sous contrainte.
La judiciarisation du système de contrôle a déjà poussé les médecins à être plus vigilants dans le suivi des hospitalisations sans consentement. Le corps médical exerce déjà son propre contrôle donnant lieu à de nombreuses sorties d’hospitalisation.
Ainsi, avant la réforme de 2011, le nombre d’hospitalisations psychiatriques sans consentement atteignant une durée de quinze jours s’élevait à 65 000 contre à peine plus de 35 000 aujourd’hui. En d’autres termes, cette diminution des délais ne permettra pas une augmentation significative du taux de mainlevées judiciaires, ce qui est pourtant le but recherché de la proposition de loi.
Enfin et surtout, c’est moins la question du délai du premier contrôle du juge des libertés et de la détention que la fréquence des contrôles ultérieurs qui nous semble importante. N’aurait-il pas mieux valu, madame la ministre, se pencher d’abord sur la période de six mois entre le premier et le deuxième contrôle du juge ?
Bien que le Conseil constitutionnel l’ait déclarée conforme à notre loi fondamentale, cette disposition nous semble mériter un vrai débat. L’intervalle de six mois, pendant lequel seul un recours du patient ou d’un proche sera possible, peut poser problème au regard des libertés individuelles du malade.
Madame la ministre, vous le voyez, la position du groupe UMP sur la question éminemment délicate des soins psychiatriques se veut constructive, loin des clivages partisans. Il n’est pas question pour nous de tomber dans une opposition stérile entre, d’un côté, « plus de sécurité » et, de l’autre, « plus de liberté ».
La loi du 5 juillet 2011, aussi imparfaite et sans doute incomplète qu’elle soit, avait pourtant jeté des bases solides en matière de politique psychiatrique. Cette loi avait fait l’objet d’une longue préparation parlementaire et d’une vaste concertation avec tous les acteurs du secteur.
Aujourd’hui, nous regrettons vivement que cette proposition de loi soit examinée à la va-vite. Un sujet aussi important méritait mieux. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui aborde un sujet éminemment complexe, et dans des conditions que nous pouvons toutes et tous regretter.
Nous sommes en effet appelés à débattre sous injonction du Conseil constitutionnel, dans un calendrier en quelque sorte défini par lui, puisque la loi doit impérativement modifier avant le 1er octobre prochain les dispositions relatives tant aux fameuses « unités pour malades difficiles » qu’aux « irresponsables pénaux ».
Contrairement à ma collègue, Mme Deroche, je pense quant à moi que la responsabilité de cette situation est principalement à rechercher du côté du précédent gouvernement.

En 2011 – même si je n’étais pas encore sénatrice, je m’en souviens –, le Gouvernement, sourd aux mises en garde émanant de parlementaires de gauche, avait été contraint de revoir sa copie en cours de route, …

… une autre décision du Conseil constitutionnel l’obligeant à réduire la durée pendant laquelle l’intervention du juge des libertés et de la détention n’était pas obligatoire.

Si cette proposition de loi obéit comme la précédente à un calendrier contraint, nous ne pouvons que nous réjouir que, contrairement à la loi du 5 juillet 2011, elle tourne le dos – même si c’est de manière moins radicale que ce que le groupe CRC aurait souhaité – à l’approche sécuritaire de la psychiatrie, qui faisait d’abord et avant tout du malade un suspect en puissance.

La maladie mentale n’était abordée que sous l’aspect des troubles qu’elle générait et qu’il fallait endiguer. Souvenons-nous que la loi du 5 juillet 2011 répondait essentiellement à la volonté de Nicolas Sarkozy de faire la démonstration qu’il ne demeurait pas inactif face au crime de Grenoble.

Voilà comment nous nous sommes retrouvés face à une loi décriée par la quasi-unanimité des professionnels de santé, par la totalité des associations de patients, d’usagers et de proches de personnes atteintes de troubles mentaux ainsi que par les syndicats d’avocats et de magistrats.
Depuis la décision du 26 novembre 2010, nous savons aussi que cette proposition de loi n’est pas conforme à nos principes constitutionnels, et ce précisément parce que la volonté sécuritaire de Nicolas Sarkozy a conduit le gouvernement précédent à rédiger et à faire adopter une proposition de loi qui méconnaissait les principes fondamentaux et les libertés individuelles, que notre Constitution garantit.
Indiscutablement, cette nouvelle proposition de loi rompt avec cette logique, et nous ne pouvons que nous en réjouir, …

… même si nous regrettons qu’elle se focalise elle aussi sur la question des soins sous contrainte, laissant les professionnels et les patients dans l’attente d’une grande loi de santé mentale.
Le fait qu’une nouvelle fois la psychiatrie ne soit abordée que sous l’angle des soins sous contrainte constitue nécessairement une approche réductrice de la psychiatrie alors que notre pays a toujours été le fer de lance d’une psychiatrie humaine et bienveillante.
Disant cela, je pense particulièrement à l’apport du docteur Lucien Bonnafé qui voulait « détruire le système asilaire et bâtir son contraire sur ses ruines », ce qui a conduit à la « psychiatrie de secteur », fondée par la circulaire du 15 mars 1960, une approche résolument moderne des soins psychiatriques dans laquelle les infirmières et infirmiers jouent un rôle central. Ces derniers ne sont plus limités à un rôle de gardiens, mais deviennent de véritables acteurs de soins, permettant enfin, et pour la première fois, aux équipes de psychiatrie de sortir des murs de l’hôpital et de travailler dans la ville, sur le terrain, avec celles et ceux qui s’y trouvent. Bonnafé avait une volonté de désaliéner la folie afin de « restaurer le potentiel soignant existant dans le peuple ».
C’est pourquoi je suis convaincue que nous avons besoin d’une grande loi de santé mentale et qu’un tel débat nous aurait permis – et j’espère qu’il nous permettra –, ensemble, de renoncer à la notion même de soins ambulatoires sans consentement, rebaptisés ici « programmes de soins », qui reposent de mon point de vue sur une confusion entre soins et « prise de médicament » ; la contrainte continue à s’étendre dans la cité alors qu’elle était auparavant circonscrite à l’hôpital.
Pour nous, il est au contraire urgent de desserrer l’étau de la contrainte. Je dois d’ailleurs dire que nous nous réjouissons de l’amendement, présenté par notre collègue Jacky Le Menn, tendant à préciser que les programmes de soins ne peuvent en aucun cas être mis en œuvre sous la contrainte. Cela constitue une première étape, même si nous savons pertinemment qu’une contrainte indirecte existe, puisque le non-respect du programme de soins peut entraîner le retour à une hospitalisation complète.
Comme vous le savez, la décision du Conseil constitutionnel ne rendait pas obligatoire, d’un point de vue juridique, l’intervention du législateur sur cette question. Il nous aurait été possible de rester inactifs dans l’attente de la date butoir du 1er octobre 2013 pour que les dispositions concernant les UMD, déclarées non conformes à la constitution, tombent d’elles-mêmes.
Le député Denys Robiliard a fait le choix de légiférer ; cela n’est pas anodin, puisque cela a pour effet de repositionner les UMD, qui ne sont après tout que des services particuliers – notre collègue les a qualifiés d’ « intensifs » –, qui apportent une réponse particulière à l’état d’un patient à un moment donné. En effet, rien ne justifiait, outre la volonté de certains de stigmatiser les patients en UMD, de confier à ces services une dimension législative, quand les autres services hospitaliers ne font eux, généralement, que l’objet d’un traitement réglementaire. Aussi, en replaçant les UMD dans le droit commun de l’hospitalisation complète, la présente proposition de loi rompt avec l’amalgame, voulu par le précédent gouvernement, entre les malades difficiles, présentant des besoins particuliers auxquels il faut répondre, et les malades dangereux.
Il est un autre apport significatif de cette proposition de loi : les dispositions relatives aux personnes déclarées pénalement irresponsables. L’auteur de la proposition de loi a souhaité maintenir un régime juridique qui leur soit spécifique. Toutefois, il sera désormais limité aux seules personnes ayant commis des actes d’une particulière gravité, c’est-à-dire ceux pour lesquels les peines encourues sont d’au moins cinq ans d’emprisonnement s’agissant des atteintes à la personne et de dix ans d’emprisonnement s’agissant des atteintes aux biens.
Afin de mettre notre droit en conformité avec la Constitution, sur la base de la décision rendue le 20 avril dernier, ce texte modifie, comme pour les patients en UMD, le régime d’entrée et de sortie d’hospitalisation sans consentement. Cette mesure est positive. Elle a même été considérablement améliorée depuis que notre commission a adopté, sur l’initiative de M. le rapporteur, un amendement supprimant l’obligation d’une double expertise psychiatrique en complément de l’avis du collège prévu par la loi pour que le juge se prononce sur la mainlevée des soins sans consentement. Ce traitement discriminatoire nous paraissait injustifié et aurait fait courir le risque d’une nouvelle sanction du Conseil constitutionnel. Avec l’adoption de cet amendement, le texte est plus juste et écarte, sur ce point du moins, un tel risque.
De plus, l’intervention du juge des libertés et de la détention, dont je souhaite rappeler qu’il a pour mission de veiller à ce qu’aucune mesure privative de liberté ne soit décidée de manière arbitraire, est portée de quinze à douze jours. Cette réduction est bienvenue, même si, comme M. Robillard, nous aurions préféré que le JLD intervienne dans un délai n’excédant pas dix jours. Notre groupe a d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.
Enfin, je voudrais une nouvelle fois saluer l’apport significatif de M. le rapporteur, Jacky Le Menn, qui, par voie d’amendement en commission, a supprimé les dispositions relatives à la visioconférence ; à cet égard, je suis particulièrement satisfaite des propos tenus par Mme la ministre.
Vous l’aurez compris, d’une manière générale, l’analyse que mes collègues du groupe CRC et moi-même portons sur cette proposition de loi, notamment modifiée par M. le rapporteur en commission, est positive. J’espère d’ailleurs que ce texte sera enrichi par nos débats et par l’adoption d’un certain nombre de nos amendements.
En effet, à l’image de ma collègue Jacqueline Fraysse, députée, je regrette profondément que cette proposition de loi n’ait pas réduit, pour ne pas dire supprimer, le rôle du représentant de l’État dans le processus d’hospitalisation sans consentement.
Naturellement, les décisions prises par le préfet, singulièrement en matière d’hospitalisation sans consentement, sont encadrées. Il n’en demeure pas moins que nous sommes réticents à l’idée qu’il puisse, afin d’éviter un trouble à l’ordre public, décider de l’hospitalisation de l’un de nos concitoyens ou de nos concitoyennes. Nous avons déposé à ce sujet plusieurs amendements qui nous donneront l’occasion d’en débattre, même si je prends note de l’adoption de certains autres, présentés par M. le rapporteur, qui tendent, là encore, à réduire les prérogatives du représentant de l’État.
Pour notre part, nous plaidons pour la suppression de l’hospitalisation sans consentement en cas de troubles à l’ordre public et souhaitons qu’à terme, afin d’éviter les risques d’hospitalisations arbitraires, celle-ci ne soit possible que si la personne présente des troubles mentaux dont la nature même empêche son consentement et qui compromettent la sûreté d’autrui ou de la personne elle-même.
Conformément à ce que nous avions défendu en 2011, nous sommes favorables, comme bon nombre de professionnels et comme le propose le Syndicat de la magistrature, à une suppression de la dualité entre la procédure d’admission à la demande d’un tiers et la procédure d’admission à la demande du représentant de l’État, précisément dans le but de réduire les possibilités d’intervention de ce dernier.
Je regrette également que cette proposition de loi ait maintenu ce que toutes et tous à gauche, au Sénat, avions dénoncé comme étant une forme de garde à vue psychiatrique de soixante-douze heures, imposant aux personnes atteintes de troubles mentaux des mesures privatives de liberté particulièrement dérogatoires au droit commun.
De la même manière, la proposition de loi ne remet nullement en cause la possibilité offerte aux procureurs de la République de supprimer l’effet suspensif d’une délibération du juge des libertés et de la détention visant à procéder à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, contraignant ainsi le patient à rester hospitalisé sans son consentement, alors même qu’un juge des libertés et de la détention avait prononcé une décision de remise en liberté. Généralement, en droit commun, les mesures libératoires sont exécutoires. Pour nous, rien ne doit s’opposer à ce que ce principe s’applique aux personnes hospitalisées sans leur consentement.
Enfin, si nous saluons la réintroduction dans la loi d’un mécanisme de sortie d’essai, qui reposerait sur un principe d’autorisation sauf opposition, nous considérons que les durées demeurent trop courtes et qu’il aurait fallu dissocier le cas des sorties réalisées avec un proche de celles réalisées avec un membre de la communauté médicale.
Toutefois, malgré toutes ces réserves, vous l’aurez compris, le groupe CRC votera cette proposition de loi. Il s’agit d’une étape positive avant une loi globale concernant la santé mentale qui, je l’espère, ne devrait plus tarder à nous être soumise. §
Mme Catherine Deroche applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans un premier temps, je voudrais m’élever avec force contre les conditions dans lesquelles notre commission a été amenée à examiner ce texte.
La décision du Conseil constitutionnel datant du 20 avril 2012, le Gouvernement se devait de réagir plus rapidement. Cette manière de procéder n’est pas acceptable, car la question des soins psychiatriques est un sujet trop important pour le traiter à la légère, ce que nous ne ferons pas.
Nous avons tous longuement débattu de cette question en 2011, lors de l’examen au Sénat de la loi du 5 juillet 2011. Vous vous souvenez certainement, mes chers collègues, des incidents qui avaient émaillé cette discussion.
En tant que rapporteur de ce texte de loi, j’étais totalement hostile aux « soins sans consentement en ambulatoire », ce qui m’avait finalement amenée à démissionner de mon poste de rapporteur et à m’abstenir sur le texte. Je n’avais pas voulu voter contre, car j’approuvais toute la partie de la loi concernant le respect des libertés individuelles.
Je ne suis donc pas étonnée de la décision du Conseil constitutionnel. Il affirme en effet qu’« aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge en soins ambulatoires ne peut être mise en œuvre pour imposer des soins ou des séjours en établissement sans que la prise en charge du patient ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ».
Je ne suis pas non plus étonnée de la demande du Conseil constitutionnel de remettre les unités pour malades difficiles dans le droit commun des services hospitaliers. Il s’agit d’une unité de soins, d’un service spécifique, certes, mais au même titre qu’un service de soins de réanimation dans un autre hôpital.
Malgré tout, on ne peut pousser la comparaison plus loin. En effet, dans une UMD sont admis certains malades momentanément très agités et qui retourneront dans leur service initial, une fois la crise passée. Mais ces UMD accueillent aussi des malades déclarés irresponsables pénalement. Or ces malades ont quand même commis des infractions pénales.
C’est sur ce point que naît mon inquiétude. Comment se prémunir de la récidive d’une personne jugée pénalement irresponsable retrouvant la liberté comme tout autre malade ? On ne peut d’ailleurs pas parler de récidive, puisque cette personne n’a pas été jugée.
Je note que la proposition de loi que nous étudions aujourd’hui tente de concilier la liberté individuelle et la prévention des atteintes à l’ordre public. Je sais combien tout ce qui touche aux soins psychiatriques est sensible et je comprends l’embarras du rédacteur de cette proposition de loi.
Cependant, vous comprendrez notre inquiétude de savoir qu’un patient ayant commis des faits pour lesquels les peines encourues sont d’au moins cinq ans d’emprisonnement, s’agissant des atteintes à la personne, et d’au moins dix ans d’emprisonnement, s’agissant des atteintes aux biens, se retrouve à l’extérieur, sans garantie de la poursuite de ses soins.
La première partie de mon intervention a concerné spécifiquement les articles qui répondent à la décision du Conseil constitutionnel et qui doivent être adoptés avant le 1er octobre.
Je vais maintenant parcourir l’ensemble du texte et formuler certaines observations.
Je note que l’article 1er vise à préciser que les soins ambulatoires sans consentement ne peuvent entraîner de mesures de contrainte. Je me suis tellement battue pour faire comprendre cette évidence en 2011 que je n’en reviens pas qu’on y arrive deux ans après. C’est un bel exemple du bon sens des parlementaires de terrain confrontés aux rigidités des ministères !
J’approuve également le contenu de l’article 2 tendant à encadrer précisément les sorties d’essai.
Concernant l’article 5, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le raccourcissement du délai entre l’hospitalisation et la décision du juge va augmenter fortement la charge des juges des libertés et de la détention.
En effet, jusqu’ici, il était courant que les patients sortent avant les quinze jours précédemment requis. De l’avis d’un syndicat de magistrats que j’ai consulté, l’augmentation de la charge pourrait aller de 20 % à 40 %, ce qui ne va pas manquer de poser des questions de moyens et de personnels, tant pour les juges que pour les greffiers.
Je souhaite saluer le brillant travail de M. le rapporteur, Jacky Le Menn – mais cela ne m’a pas étonnée. Il a amélioré ce texte de loi sur des points importants, notamment sur la localisation de l’audience dans le cadre du contrôle juridictionnel. Il est indéniable que, dans l’état actuel du droit, l’organisation des audiences reste compliquée. La visioconférence n’est vraiment pas une bonne solution. Pourquoi accorder un nouveau droit tout en retenant des modalités qui le rendent inopérant, voire néfaste pour le bien-être du patient ?
Il convient de tenir compte à ce sujet des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui, dans son avis du 14 octobre 2011, mettait en exergue le fait que le développement inconsidéré d’une telle technique comportait le risque de porter atteinte aux droits de la défense s’agissant des soins psychiatriques sans consentement. Il indiquait notamment que, dans de nombreux cas, « la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu’elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d’expression. […] Elle suppose une facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité à cet égard selon les personnes qui sont loin d’être acquises, notamment pour celles souffrant d’affections mentales ».
Ces quelques améliorations au texte de loi de 2011 ne règlent en rien, ou seulement en petite partie, les problèmes posés par la santé mentale. Depuis de nombreuses années, on nous promet une vraie loi complète pour mieux prendre en charge les malades psychiatriques. J’espère, madame la ministre, que vous pourrez rapidement soumettre un projet de loi au Parlement.
En conclusion, j’apporterai mon soutien à cette proposition de loi, dans sa version modifiée par notre commission. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord, à l’instar des orateurs m’ayant précédé, à déplorer les conditions d’urgence dans lesquelles le Sénat examine ce texte qui a été ajouté tardivement à l’ordre du jour de la session extraordinaire et doit, si j’ai bien compris, être impérativement adopté avant la fin du mois. Le Gouvernement avait-il oublié ce texte ? Je n’ose le croire, compte tenu de l’importance du sujet, qui touche aux droits fondamentaux, ce qui rend d’ailleurs encore moins admissible cette précipitation.
Je ne mets bien entendu nullement en cause notre rapporteur, Jacky Le Menn, qui a effectué un travail sérieux dans un délai très contraint et dont nous partageons par ailleurs les conclusions.
La proposition de loi présentée aujourd’hui modifie la loi du 5 juillet 2011 qui a réformé de manière substantielle le régime de l’hospitalisation sous contrainte afin, notamment, de se conformer aux termes d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel, qui a exigé un contrôle juridictionnel.
Avant même l’adoption de la loi du 5 juillet 2011, il était écrit que nous aurions à y revenir ! Les ajustements, notamment par lettre rectificative du Gouvernement, auxquels elle a donné lieu au cours même de son élaboration, montraient déjà combien la réforme était mal préparée et mal ficelée. L’imbroglio qui a suivi au Sénat, avec notamment la démission du rapporteur, ce qui vient de nous être rappelé, laissait aussi percevoir un certain malaise dans la majorité d’alors.
De fait, nous avons abouti à un texte aussi alambiqué qu’inachevé : des procédures complexes, voire contradictoires, qui accordaient la prépondérance aux décisions administratives ; une réflexion loin d’être aboutie sur l’étendue du contrôle judiciaire et la gestion de la contrainte à l’extérieur de l’hôpital psychiatrique.
Enfin, comment ne pas relever l’inspiration sécuritaire de cette loi ? Personne, dans cet hémicycle, ne peut avoir oublié qu’elle fut décidée dans l’urgence et en réaction à une série de faits divers dramatiques largement médiatisés.
Déjà, en 2008, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, avait déploré que la question de la maladie mentale ait été évoquée dans le débat public à l’occasion de la discussion de textes dont la nature alimentait une confusion avec la délinquance, la violence et la dangerosité. Je pense notamment au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ou au projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental.
En instaurant une sorte de « garde à vue psychiatrique », période de soixante-douze heures au cours de laquelle les patients sont privés de tous droits, et un « casier psychiatrique » pour certains d’entre eux, la loi de 2011 confirmait tristement cette dérive populiste et sécuritaire.
Les troubles psychiques recouvrent certes des réalités complexes et diverses. Ceux qui en souffrent doivent avant tout être considérés comme des personnes malades : notre devoir est donc de prendre en compte leur vulnérabilité et de les accompagner.
Cependant, le malade peut représenter un danger, pour lui-même bien sûr, mais aussi pour les autres. Nous avons donc la responsabilité de trouver un juste équilibre entre les libertés individuelles, les soins et l’ordre public.
À la suite de l’adoption de cette loi de 2011, il a fallu la mobilisation exceptionnelle, au cœur de l’été, des juridictions comme des établissements psychiatriques pour éviter ce qui apparaissait alors comme une « catastrophe annoncée », selon les propres mots des députés Guy Lefrand et Serge Blisko, dans leur rapport de suivi rendu en février 2012.
À moyens constants, le monde médical et le monde judiciaire, alors qu’ils n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble, ont appliqué dès le 1er août 2011 des textes sur lesquels ils avaient de sérieuses réserves, dont ils ne voulaient pas et avec lesquels ils ont dû se familiariser en urgence.
Néanmoins, le rapport de nos collègues députés, de même que le rapport d’étape rendu en mai dernier par la mission d’information « Santé mentale et avenir de la psychiatrie » de l’Assemblée nationale, ont révélé des difficultés importantes dans la mise en œuvre de cette loi.
Ces difficultés ont été en partie rappelées au début de notre discussion d’aujourd’hui : lourdeur des procédures, notamment le nombre de certificats médicaux à produire, ce qui constitue une activité administrative chronophage pour les psychiatres et se heurte au faible nombre de médecins disponibles pour effectuer ces tâches ; inadaptation des conditions d’accueil des patients au tribunal et en même temps réticence de la hiérarchie judiciaire au principe même de la tenue d’audiences foraines ; conséquences mal anticipées de la suppression du dispositif de sortie de courte durée non accompagnée qui nécessite, à la fin de chaque sortie, de réinitialiser une procédure d’admission en soins.
Il est clair que le concept de « soins sans consentement hors de l’hôpital » portait en lui-même un risque sérieux de dérives et d’échecs : dérives, parce que l’on peut, par exemple, placer un malade sous ce régime pour échapper aux garanties prévues en cas d’hospitalisation complète, tout en organisant la plus grande part de sa prise en charge au sein de l’hôpital ; échecs, parce que l’offre de soins en ambulatoire n’est pas à même de répondre aux besoins réels et parce que les lourdeurs du passage d’une prise en charge à l’autre ne militent pas vraiment en faveur des soins hors les murs.
Indépendamment de ces difficultés, une réponse était attendue du législateur à la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 avril 2012.
Nous souscrivons largement à la philosophie du texte qui nous est présenté. Qu’il s’agisse de la suppression du régime dérogatoire de sortie des personnes ayant séjourné en UMD, de la définition d’un régime pour les personnes déclarées pénalement irresponsables prenant en compte le degré de gravité des faits commis, de la réduction du délai d’intervention du juge, du rétablissement des sorties d’essai, de l’assistance obligatoire d’un avocat ou encore de la réduction du nombre de certificats, de la suppression de la visioconférence : toutes ces dispositions vont dans le bon sens et correspondent, d’ailleurs, à des amendements défendus par le groupe du RDSE lors des débats sur la loi du 5 juillet 2011.
En ce qui concerne le déroulement des audiences du juge des libertés et de la détention au sein même de l’hôpital, nous avions émis des réserves à l’époque, mais j’admets volontiers que les patients gagneraient à être entendus par le juge dans un environnement qu’ils connaissent. À condition de doter les juridictions des moyens permettant aux juges de se déplacer, cette option semble justifiée : elle évite une promiscuité regrettable entre malades et délinquants dans les couloirs du palais de justice, respecte leur dignité et garantit l’effectivité du contrôle.
Par ailleurs, le rôle des avocats reste à consolider, car ils ont toute leur place dans le contrôle des conditions d’hospitalisation de la personne malade mentale ; pour autant, les questions de leur formation et de leur très faible rémunération lorsqu’ils sont commis d’office, ce qui est pratiquement toujours le cas, constituent des obstacles non négligeables qui devront être levés.
Enfin, je salue le travail de la commission des affaires sociales, qui a cherché à renforcer la dimension médicale des soins sans consentement et à mieux garantir le respect des droits fondamentaux des personnes malades.
D’autres questions auraient mérité d’être abordées dans ce débat, notamment le cadre territorial d’exercice de la psychiatrie. Nous attendons avec impatience que la santé mentale constitue un volet à part entière de notre politique nationale de santé. Dans cette attente, le groupe du RDSE votera sans hésiter cette proposition de loi qui se fonde sur une philosophie, une approche nouvelle, qui place clairement le patient au cœur de la démarche : il s’agit d’une rupture avec la loi précédente et nous nous félicitons !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur les travées de l’UDI-UC.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis en urgence pour examiner une proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Ce texte de 2011, nous sommes nombreux, au sein de la commission des affaires sociales, à en garder un souvenir amer ! À l’occasion de son examen lors de la séance du 10 mai 2011, dans ce même hémicycle, j’avais dénoncé un texte qui privilégiait le sécuritaire au détriment du sanitaire. J’avais également reproché au gouvernement de l’époque, représenté par Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé, de ne pas se soucier de la manière dont la loi serait appliquée et de chercher encore moins à améliorer la situation de ceux qui auraient à en subir les effets, tant il était flagrant que le projet de loi ne prévoyait pas de moyens adéquats.
La vraie histoire de la loi du 5 juillet 2011, nous la connaissons, et certains l’ont rappelée : c’était celle d’un projet de loi d’affichage ; celle d’un fait divers dramatique survenu à Grenoble et dont s’était emparé le chef de l’État dans son tristement célèbre discours d’Antony, en décembre 2008, pour mieux entretenir une logique sécuritaire et répressive des politiques publiques ; celle d’un texte qui se préoccupait peu des conditions d’accueil des malades, de la formation des professionnels et des moyens de la psychiatrie ; celle d’une conception étriquée de la psychiatrie qui désigne l’obligation de soins comme la seule réponse efficace et le médicament comme seul soin fiable.
L’idée, à l’époque, n’était pas de garantir la sûreté des malades, mais celle des non-malades, quitte à attiser la peur du malade et à rendre encore plus difficile le travail des équipes médicales et des magistrats.
Quelques mois plus tard, le juge constitutionnel a parlé. Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité – la quatrième en matière de soins psychiatriques sous contrainte en moins de deux ans –, il a déclaré contraires à la Constitution deux dispositions du code de la santé publique introduites par la loi du 5 juillet 2011 concernant le régime dérogatoire applicable à la sortie des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles, UMD, ou déclarées pénalement irresponsables.
Soyons clairs : le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le principe d’un régime plus strict de soins sans consentement pour certaines personnes, en l’occurrence celles ayant séjourné en UMD ou déclarées pénalement irresponsables, mais il a rappelé qu’il revient à la loi, et à la loi seulement, d’encadrer la mise en œuvre de ce régime particulier en prévoyant les garanties permettant de prévenir tout risque d’arbitraire. En effet, la privation de liberté est un sujet extrêmement sérieux et, en cette matière, seul le législateur est compétent pour préciser davantage les conditions de mise en œuvre de ce régime de soins sans consentement.
La proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui au Sénat est, pour toutes ces raisons, en elle-même une excellente chose. Elle permet au législateur de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et de répondre aux dispositions jugées inconstitutionnelles. Elle nous fournit également l’occasion de prendre en compte un certain nombre d’imperfections que deux années d’application de la loi du 5 juillet 2011 ont pu faire apparaître.
Cependant, un point me préoccupe particulièrement : il s’agit de la précipitation dans laquelle ce texte est étudié, qui ne nous laisse finalement que très peu de temps pour débattre de la question de la privation de liberté, sur laquelle le Conseil constitutionnel juge indispensable que nous nous attardions.
La proposition de loi est inscrite tardivement à l’ordre du jour de la session extraordinaire de juillet à l’Assemblée nationale. Puis c’est une étude rapide, dans les derniers jours de la session de juillet, alors que le Conseil constitutionnel nous avait donné dix-huit mois pour réfléchir à la question, et une arrivée précipitée au Sénat, alors que le texte ne figurait même pas dans le premier décret de convocation de cette deuxième session extraordinaire de septembre.
Cette précipitation me paraît contraire à la volonté du Conseil constitutionnel. La prévention des risques d’arbitraire aurait mérité le travail parlementaire puisse s’effectuer dans une plus grande sérénité.
Les conditions d’examen de ce texte, madame la ministre, ne peuvent donc nous satisfaire.
Il n’en demeure pas moins que le groupe écologiste du Sénat se réjouit du contenu de ce texte qui donne la priorité au traitement médical sur le traitement carcéral de la psychiatrie.
En effet, la proposition de loi réintroduit notamment la possibilité de sorties de courte durée, supprimée par la loi de 2011 ; elle crée des modalités d’organisation des audiences plus adaptées aux personnes souffrant de troubles mentaux ; elle prévoit que les unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, ne soient plus réservées aux détenus placés sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte, mais qu’elles puissent également accueillir des détenus atteints de troubles psychiatriques qui consentiraient à des soins ; elle revient sur l’emploi trop fréquent de la visioconférence pour l’audience réglementaire avec le juge des libertés et de la détention.
Enfin, grâce à un amendement de mes collègues députés écologistes, ce texte permet aux députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen de visiter tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, comme ils en ont d’ores et déjà la possibilité pour les établissements pénitentiaires, les locaux de garde à vue, les centres de rétention ou encore les zones d’attente. Ce droit est un moyen important d’information et de contrôle, par les parlementaires, des lieux de privation de liberté.
Mes collègues et moi-même tenons également à féliciter notre rapporteur, M. Jacky Le Menn, qui, dans des délais extrêmement brefs, n’a pas renoncé à mener une large concertation avec les acteurs concernés par ce texte.
Sourires.

Il en est ressorti dix-neuf amendements de bon sens dont nous partageons totalement l’esprit et les valeurs. Du renforcement de la dimension médicale des soins sans consentement à la suppression de la possibilité de visioconférence, en passant par la restriction des pouvoirs du préfet et la suppression du double avis de sortie, soyez assuré, cher collègue, de notre soutien le plus total.
Notre groupe a présenté deux amendements qui portent sur le contrôle du juge, afin de garantir un meilleur respect des droits des patients.
On lit dans le rapport rendu par Denys Robiliard à l’Assemblée nationale les déclarations unanimes et réitérées des psychiatres que notre collègue a entendus au cours de ses auditions, pour rappeler qu’ils sont en mesure de déterminer dans les soixante-douze heures de l’hospitalisation sous contrainte si son maintien ou non est nécessaire. Or la loi du 5 juillet 2011, si elle instaure un contrôle systématique des mesures de soins sous forme d’hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention, fixe des délais très larges : dans les quinze jours suivant l’admission ou la réadmission en soins – en cas d’échec du programme de soins –, puis tous les six mois.
La proposition de loi, au moment de son dépôt, tendait à ramener ce délai de quinze jours à dix jours, mais cette disposition a été amendée au cours de l’examen en séance par l’Assemblée nationale de manière à fixer le délai à douze jours.
Ce délai nous paraît encore trop long et, suivant les recommandations du rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, le groupe écologiste propose de le ramener à cinq jours. Ce serait aboutir ainsi à une véritable judiciarisation ab initio, permettant au juge des libertés et de la détention de ne pas prolonger l’hospitalisation sans consentement de personnes qui n’auraient rien à y faire !
Dans le même état d’esprit, notre second amendement vise à ramener de six mois à quatre mois le délai entre la première et la deuxième décision du juge des libertés et de la détention. Un délai de six mois entre les deux premières décisions nous semble en effet trop long, concernant une mesure privative de liberté.
Monsieur le président, je ne serai pas plus long !
Sourires.

En réaffirmant que les élus écologistes voteront cette proposition de loi, je forme le vœu que le débat soit à la hauteur des enjeux liés aux soins sous contrainte, à la croisée de trois exigences qui nous sont dictées tant par les valeurs de la République que par l’intérêt général : la santé des malades, le respect des libertés publiques et la sécurité publique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du RDSE, ainsi que sur les travées de l’UDI-UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est dans le cadre d’une procédure accélérée que nous débattons aujourd’hui de cette proposition de loi qui vise notamment à modifier certaines dispositions de la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Cette loi faisait suite au décès d’un étudiant poignardé par un malade en fuite, en novembre 2008, à Grenoble. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait annoncé, dans le discours prononcé à Antony, son intention de revoir les mesures de contrôle des malades dangereux.
Cette loi, qui mettait l’accent sur des mesures sécuritaires, avait été fort critiquée par les professionnels et les familles, qui déploraient la mise au second plan des mesures sanitaires, pourtant primordiales. Nous-mêmes, au groupe socialiste, avions dénoncé la dérive sécuritaire de la loi et mis en doute sa constitutionnalité ; mais nos alertes n’avaient pas été entendues !
Non seulement cette loi soulevait la contestation, mais elle se révélait également difficilement applicable dans sa complexité.
Comme on pouvait s’y attendre, le Conseil constitutionnel, pour sa part, a censuré deux dispositions portant sur le régime spécifique de sortie, ou mainlevée, des personnes placées en unité pour malades difficiles et celles jugées irresponsables pénalement.
Le Conseil constitutionnel pointait également le manque de garanties légales suffisantes contre le risque d’arbitraire dans le cadre de ce régime particulier.
Sans qu’il y ait, pour le Gouvernement, obligation de légiférer, cette occasion a aussi été saisie pour aménager certaines mesures et les assortir d’améliorations faisant l’objet d’un large consensus, comme le démontre le rapport d’étape rendu par la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie de l’Assemblée nationale dont une majorité de recommandations ont été reprises dans cette proposition de loi.
Je m’attacherai à n’évoquer que les mesures principales qui s’inscrivent dans une approche plus ouverte et plus constructive vis-à-vis de ces patients jugés difficiles de par leur pathologie mentale.
Il s’agit de poser un autre regard sur ces malades, de ne plus les considérer comme des fauteurs de trouble à l’ordre public mais avant tout comme des personnes souffrant physiquement et psychiquement, particulièrement vulnérables socialement.
Il est vrai que certains de ces malades atteints de troubles mentaux n’ont pas forcément conscience d’avoir besoin de soins, alors qu’ils peuvent représenter un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Nous savons tous qu’il n’est pas aisé de trouver un équilibre entre le respect des libertés individuelles et l’ordre public.
J’ouvre une parenthèse sur le respect des libertés individuelles et l’ordre public en pensant aux maires. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir été quelquefois appelés à décider d’une hospitalisation d’office. Je peux en témoigner, c’est un moment difficile.
C’est une bonne chose que l’article 1er redéfinisse les soins sans consentement – l’hospitalisation d’office d’autrefois – en rappelant que la seule forme de contrainte qu’il est possible d’exercer sur un patient est une contrainte « morale » de respecter le programme de soins défini par le psychiatre de l’établissement d’accueil ou d’accompagnement. Le cas échéant s’applique alors le retour en hospitalisation complète.
Outre le mérite de redéfinir les grands principes s’appliquant aux soins sans consentement, cette proposition de loi s’attache également, en son article 4, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, à redéfinir l’application du régime plus strict de « levée de soins sans consentement » pour la catégorie des personnes jugées irresponsables pénalement. Seuls ceux encourant une peine d’au moins cinq ans en cas d’agression à personne et dix ans en cas d’atteintes aux biens, sont désormais concernés par ce régime.
Les patients hospitalisés en unités de malades difficiles, quant à eux, réintègrent le dispositif de droit commun.
Cette mesure découle d’une réflexion menée à partir de la décision constitutionnelle, dans le cadre de la mission de l’Assemblée nationale, par le Gouvernement et le rapporteur, Denys Robiliard.
Les UMD sont assimilées à des services de soins intensifs répondant à des situations cliniques spécifiques sans rapport direct avec la dangerosité d’un patient. Il s’agit ainsi de redonner sa première place au processus thérapeutique et de lever la confusion entre malades difficiles et malades dangereux.
C’est bien pour cela que l’article 2 redonne la possibilité aux malades, avec toutes les précautions qui s’imposent, de bénéficier d’autorisations de sorties non accompagnées, de courte durée, dans un but thérapeutique reconnu, ce qui peut ainsi constituer une « étape » dans la perspective d’une autre forme de prise en charge que l’hospitalisation complète. Cette possibilité jugée, nous le savons, comme essentielle dans le bon déroulé du parcours des soins du patient. Et là, nous mesurons à la fois la responsabilité des médecins qui donnent cette autorisation et la forte attente des malades.
À ce propos, je voudrais citer Antonin Artaud écrivant au docteur Ferdière, à Rodez, en 1944: « N’oubliez pas de me signer cette autorisation de sortie que vous m’aviez promise jeudi dernier. Vous n’imaginez pas le bien que cela me fait de me promener en liberté ».
Par ailleurs, cette proposition de loi adapte, à juste titre, la procédure judiciaire aux spécificités de la maladie mentale, en réponse aux souhaits des professionnels de santé – soignants, psychiatres, directeurs d’établissements, associations, patients et familles Ainsi, elle améliore la procédure judiciaire en instaurant la possibilité du choix du lieu d’audience devant le juge des libertés et de la détention au sein même de l’établissement de santé.
Cette proposition de loi prévoit, en outre, la protection de la vie privée par le secret médical, avec la possibilité de demander que l’audience ne soit pas publique, l’assistance obligatoire d’un avocat et le recours limité à la visioconférence – supprimée par notre rapporteur. Autant de mesures, vous en jugerez, qui vont dans le sens d’une meilleure protection et d’une réelle prise en compte des personnes malades.
De même, l’article 5 ramènerait les délais d’intervention du juge des libertés et de la détention de quinze à douze jours dans le cadre du contrôle automatique des mesures d’hospitalisation complète en soins sans consentement. Ces nouveaux délais devraient permettre de trouver un équilibre entre les nécessités administratives, les nécessités judiciaires et les nécessités sanitaires – peut-être est-il encore possible d’ajuster cet équilibre.
Le titre II comprend un certain nombre de dispositions visant à rationaliser et à clarifier les mesures administratives requises en cas de soins sans consentement décidées par le représentant de l’État dans le département. Ainsi serait supprimé le « casier psychiatrique », tant décrié lors de l’examen de la loi de 2011. Nous verrons en détail ces mesures techniques dans l’examen des articles.
Je veux saluer l’article 10, seul article du titre III qui réaffirme le droit à une prise en charge psychiatrique adaptée des personnes détenues souffrant de troubles mentaux. C’est une avancée très nette d’amélioration des modalités de prise en charge en UHSA, des personnes détenues, y compris lorsqu’elles sont en soins libres, mais aussi une simplification qui permet de passer de soins sans consentement à des soins libres à la demande du détenu, sans retour en détention.
Dans ses grandes lignes, la proposition de loi de Bruno Le Roux et Denys Robiliard apporte une réponse au Conseil constitutionnel. De plus, elle corrige les imperfections et inadaptations de la loi de 2011
Elle introduit une prise en compte plus respectueuse des malades de troubles mentaux. Il était fortement souhaitable de revoir la philosophie de cette loi de 2011, dictée par des critères éminemment sécuritaires, élaborée précipitamment après un fait divers.
Le patient atteint de troubles mentaux doit redevenir avant tout une personne en souffrance, susceptible de bénéficier de soins spécifiques, une personne méritant protection et garantie de ses droits.
Mais je ne saurais achever mon propos sans remercier particulièrement la présidente de la commission des affaires sociales, les collaborateurs de la commission et notre rapporteur, Jacky Le Menn, qui a accompli un travail remarquable et qui a fait adopter par la commission 18 amendements de clarification et de précision dans la double ambition de renforcer la dimension médicale des soins sans consentement, mais aussi de garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens.
La commission a également abordé l’accueil des mineurs rentrant dans le cadre des soins sans consentement.
En conclusion, le groupe socialiste votera cette proposition de loi, tout en affirmant que ce texte doit être considéré comme une étape dans l’attente d’une grande loi sur la psychiatrie. §
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l’examen des amendements nous permettra d’aborder de façon plus approfondie les diverses questions évoquées. Je veux néanmoins à cet instant remercier l’ensemble des sénateurs pour le travail accompli dans des conditions dont j’ai bien conscience qu’elles ont été difficiles et particulièrement contraignantes. Je renouvelle mes remerciements en particulier à la commission des affaires sociales et à son rapporteur.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
TITRE IER
RENFORCEMENT DES DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS AUX PERSONNES EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Chapitre Ier
Amélioration de la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3211-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -2 -1 . – I. – Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
« La personne est prise en charge :
« 1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
« 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
« II. – Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
« Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211–3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211–11.
« III. – Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3211-3, la première occurrence de la référence : «, L. 3213-1 » est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3211-12-5, au 2° du I de l’article L. 3212-1 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3222-1-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I ».
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1. » ;
II. - Alinéa 11, première phrase
Après les mots :
charge mentionnée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
à l'article L. 3211-2-1
La parole est à Mme Laurence Cohen.

La décision rendue le 20 avril dernier par le Conseil constitutionnel portait notamment sur les soins ambulatoires sans consentement, dont il a rappelé qu’ils ne pouvaient pas être réalisés sous la contrainte. L’amendement de notre rapporteur est, à cet égard, particulièrement explicite, rappelant que la contrainte devait être strictement limitée à l’hospitalisation complète.
Pour autant, les soins ambulatoires, rebaptisés « programmes de soins », constituent en quelque sorte un contrat léonin, puisque la contrainte réside non pas dans la manière dont les soins sont pratiqués, mais dans le fait même que des soins obligatoires soient réalisés de manière ambulatoire. Il s’agit bien de soins obligatoires puisque le refus de la personne atteinte de trouble mental de suivre le programme, de l’abandonner ou de ne pas l’observer, aura pour effet mécanique d’entraîner l’hospitalisation complète, une hospitalisation complète qui, de prime abord, n’était pas apparue pertinente.
Les soins psychiatriques sont, par nature, très différents des soins somatiques en ce sens que, pour être efficaces et pour tendre à la guérison, les soins doivent être intégralement consentis. Or faire peser le risque d’une hospitalisation complète en cas de non-respect revient à imposer une forme de contrainte, incompatible avec la nécessaire confiance du patient, sa nécessaire adhésion aux soins. Or vous conviendrez qu’il est impossible de parler d’adhésion dès lors que la réalisation des soins ambulatoires est réalisée sous la menace d’une hospitalisation !
En ce sens, les programmes de soins constituent, contre toute apparence, une extension du champ de la contrainte.
Qui plus est, les programmes de soins dont il est question ici n’en restent pas moins un transfert de responsabilité des équipes soignantes vers les proches des patients. Si la mise en place de soins psychiatriques réalisés en ambulatoire peut apparaître, notamment pour les soins sans consentement, « bénéfique pour le patient » et respectueuse de « son autonomie », puisqu’elle se présente comme une alternative à l’enfermement des personnes atteintes de troubles mentaux, il ne s’agit, en réalité, que d’un trompe-l’œil. En effet, l’absence d’équipes médicales présentes au quotidien, à tout instant, auprès des patients nous éclaire sur la réalité de ces soins : ils risquent souvent ou sont principalement, pour ne pas dire exclusivement, de nature médicale et médicamenteuse, quand nous sommes convaincus qu’une psychiatrie moderne est avant tout fondée sur l’échange entre les équipes soignantes et les patients.
Or, en lieu et place des équipes médicales, les patients seront renvoyés à leur solitude ou à l’intervention de leurs proches, lesquels devront, outre les prendre en charge et veiller au respect de leur obligation de soins, également assumer seuls leur responsabilité civile.
Ces craintes, nous les avions déjà exprimées en 2011 et, malgré la nouvelle rédaction qui nous est proposée ici, nous demeurons persuadés que les dispositions ne constituent pas une solution adaptée.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter notre amendement.

L'amendement n° 2, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
des soins à domicile dispensés par
insérer les mots :
des centres médico-psychologiques, des centres d'accueil thérapeutique, des appartements thérapeutiques, ou à défaut par
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

La loi du 5 juillet 2011 a considérablement modifié la loi de 1990, en ce sens que les soins sans consentement peuvent désormais être réalisés à domicile quand, jusqu’alors, ils ne pouvaient être réalisés qu’au sein d’un établissement psychiatrique.
Toutefois, vous aurez compris que nous sommes réservés sur l’efficacité et le bien-fondé de ses programmes de soins, dont la dimension médicale excède largement l’accompagnement psychologique nécessaire à la guérison.
Croire que des soins ambulatoires avec une présence médicale réduite pourraient être efficaces et utiles à la guérison est une erreur fondamentale. C’est se contenter de l’effet des médicaments non pas sur la maladie et les patients, mais sur les seuls symptômes, c’est-à-dire les troubles.
C’est pourquoi, dans la mesure où ces programmes de soins sont conservés, nous proposons, par cet amendement, de préciser qu’ils doivent être réalisés prioritairement dans des structures dédiées, composées de professionnels formés et attentifs, plutôt qu’à domicile.
Les centres médico-psychologiques et les hôpitaux de jour, qui constituent le cœur de la politique de secteur, dont l’objectif est clairement de favoriser la sortie des patients des lieux d’enfermement, regroupent des médecins psychiatres, des psychologues cliniciens, des infirmières, des assistants sociaux, des psychomotriciens, des orthophonistes et des éducateurs spécialisés, soit des professionnels capables de garantir, dans un milieu ouvert, les actions de prévention, de diagnostic et de suivi. À cet égard, ils sont les mieux à mêmes d’accompagner les patients dans les programmes de soins ambulatoires dont il est question ici.
C’est pourquoi, comme nous l’avions fait en 2011, à l’image de notre collègue Catherine Demontès, nous proposons que ces espaces, lorsque l’état du patient le permet, soient ceux vers lesquels les patients sont prioritairement orientés.

L'amendement n° 3, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Seul le juge des libertés et de la détention peut, dans des conditions définies par décret, autoriser la poursuite ou le renouvellement des soins mentionnés au présent alinéa, au-delà d’une période de trois mois.
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Bien que notre commission ait aménagé les programmes de soins en précisant qu’ils ne peuvent en aucun cas être réalisés sous la contrainte, nous considérons que la menace d’un retour en hospitalisation complète ou d’une hospitalisation complète ab initio, en cas de non-respect des programmes de soins, constitue une menace permanente, une forme de contrainte indirecte.
En réalité, les patients demeurent sous le contrôle permanent des équipes médicales qui, au premier faux pas du patient, pourraient décider de son hospitalisation complète plutôt que de chercher à le convaincre de reprendre ou de poursuivre son traitement.
C’est pourquoi, afin de sécuriser ces derniers et d’offrir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux, nous proposons par cet amendement d’instaurer un contrôle judiciaire obligatoire de ces programmes, dès lors que leur durée initiale, ou après renouvellement, est supérieure à trois mois.
Ce dispositif s’inspire clairement de celui qui est actuellement mis en œuvre dans le cadre du suivi socio-judiciaire : il permet, sous le contrôle d’un juge, le suivi judiciaire mais aussi le suivi médical d’une personne.
Naturellement, chacun l’aura compris, il ne s’agit pas d’assimiler les personnes atteintes de troubles mentaux à des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Au contraire, il s’agit de transposer des dispositions permettant la réinsertion dans la société des personnes atteintes de troubles mentaux, ce qui semble être, d’après ce que nous avons entendu, l’un des objectifs de ces programmes de soins.
J’attire votre attention sur le fait que l’inobservation de ces programmes de soins peut avoir pour effet l’hospitalisation complète du patient. Or il n’est pas impossible que certains professionnels élaborent des programmes tellement contraignants que le patient pourrait, soit ne pas les observer, soit les abandonner en cours de route.
C’est pourquoi il nous semble important qu’une autorité judiciaire approuve ces programmes, afin de s’assurer qu’ils respectent les libertés fondamentales et essentielles des patients.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 1, le Conseil constitutionnel a confirmé, dans sa décision d’avril 2012, l’analyse faite par plusieurs sénateurs selon laquelle il ne peut y avoir de mesure de contrainte pour la mise en œuvre de soins ambulatoires. Cela figure désormais dans l’article du code de la santé publique, tel que l’Assemblée nationale propose de le rédiger.
Mais le Conseil constitutionnel, qui a étudié de près cette question, n’a pas jugé que des soins ambulatoires sans consentement étaient en eux-mêmes contraires à la Constitution. De fait, ces soins, auxquels j’ai pu constater que de nombreux psychiatres étaient attachés, permettent de prendre en charge les malades qui font l’objet de soins sans consentement hors hospitalisation complète. Les amendements adoptés en commission permettent de médicaliser encore plus ces programmes et, dans ces conditions, il paraît dommage de se priver d’un outil thérapeutique qui peut être utile.
L’avis est donc défavorable.
La rédaction de l’amendement n° 2 pose problème, même si nous en comprenons l’objectif. Je me demande, par ailleurs, s’il ne serait pas préférable de conserver une accréditation pour l’ensemble des structures participant à ce type de soins.
Je propose que nous nous en remettions, sur cet amendement, à l’avis du Gouvernement.
J’en viens à l’amendement n° 3. Les soins sans consentement en ambulatoire font l’objet, comme les soins sans consentement en hospitalisation complète, d’un contrôle par le juge au bout de douze jours, puis de six mois. Dans l’intervalle, c’est le psychiatre qui prend l’initiative de la décision de sortie des soins.
Prévoir un délai spécifique pour ce type de soins ne paraît pas justifié. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 1, j’exprimerai le même avis que le rapporteur. Il me paraît plutôt contre-productif de vouloir supprimer les modes de prise en charge autres que l’hospitalisation. L’enjeu est ici d’accompagner le malade en lui proposant une diversité de solutions.
Interdire l’évolution de la prise en charge tout au long de la maladie, en rendant possible le passage de l’hospitalisation à un accompagnement en milieu ouvert, pourrait aller à l’encontre des intérêts que vous défendez et de ceux du patient. C’est la raison pour laquelle les professionnels tiennent à ce que l’on puisse prendre en charge le patient autrement que dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’avis est donc défavorable.
Sur l’amendement n° 2, j’étais tentée de m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais, comme le rapporteur s’en remet, de son côté, à l’avis du Gouvernement, je vous propose, pour éviter de tourner en rond, d’aller plus loin.
Je vous demande donc, madame Pasquet, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, non pas sur le fond, mais à cause de sa forme. Je crains en effet qu’il n’entraîne des difficultés d’interprétation sur le plan juridique, comme c’est souvent le cas lorsque l’on veut établir une liste.
En l’occurrence, souhaitant préciser quelles sont les structures autorisées à dispenser les soins à domicile, vous dressez une liste dont nous ne sommes pas certains, actuellement, qu’elle soit complète et qu’elle réponde à l’ensemble des cas de figure. Des soins prodigués dans d’autres cadres risqueraient de ce fait de ne pouvoir être dispensés ou d’être jugés illégaux. Cela pose problème, notamment au regard des intérêts des patients, que vous souhaitez défendre.
Pour ce qui est de l’amendement n° 3, je partage l’avis du rapporteur. Le juge des libertés et de la détention est compétent pour contrôler de manière systématique les mesures de privation de liberté, dont ne font pas partie les mesures autres que l’hospitalisation complète.
De toute façon, quelle que soit sa forme, la prise en charge peut faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention, que le patient a donc toujours la possibilité de saisir s’il estime que la mesure d’hospitalisation qui lui est imposée n’est pas adaptée.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L’amendement n° 17, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° Le premier alinéa de l’article L. 3211-2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un examen doit être réalisé par un médecin au cours de cette période afin de connaitre les pathologies somatiques pouvant influer sur l’état de santé physique ou psychique du patient. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.

Cette reformulation supprime la notion de temporalité. Prévoir qu’un examen somatique doit être réalisé dans les vingt-quatre heures suivant l’admission nous semble en effet source d’ambiguïtés et d’insécurité juridique pour les établissements. La rédaction que nous proposons évite également les difficultés potentielles liées à l’obligation d’un examen « complet », celui-ci pouvant être apprécié différemment selon les structures.
Nous souhaitons donc que l’examen somatique soit réalisé au cours dans les soixante-douze heures suivant l’admission.

Je comprends l’objectif de simplification et de sécurisation, mais je m’interroge sur l’opportunité de cet amendement. Je m’étais d’ailleurs expliqué sur ce sujet auprès de la FEHAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, qui portait une proposition allant dans ce sens.
L’examen somatique complet rejoint l’une des propositions du rapport Milon sur la prise en charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat, mais, à titre personnel, je voterai contre cet amendement.
Une personne qui est hospitalisée sans avoir donné son consentement doit pouvoir faire l’objet d’un examen médical dans les vingt-quatre heures qui suivent son admission. Cela ne paraît pas une demande inconsidérée au regard tant des enjeux de la privation de liberté que de la nécessité de déterminer les modalités de la prise en charge médicale et de la mise en place d’un traitement.
Considérant que les établissements doivent pouvoir s’organiser afin de permettre la réalisation de cet examen dans un délai de vingt-quatre heures après l’hospitalisation, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L’amendement n° 5, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Nous proposons de réduire le délai pour réaliser l’examen somatique de soixante-douze heures à quarante-huit heures.
Nous considérons en effet, comme en 2011, que cette période excessive s’apparente à une véritable garde à vue psychiatrique, inutile pour mesurer l’état de santé réel du patient et profondément injuste, dans la mesure où elle prolonge la période durant laquelle une personne est privée de liberté, sans qu’un juge ait statué sur le bien-fondé de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Nous sommes d’autant plus réservés sur cette période de soixante-douze heures, qualifiée de « période d’observation », qu’elle fait suite à la décision du représentant de l’État dans le département d’hospitaliser sans consentement une personne au motif, flou, du « péril imminent ».
Vous le savez, notre groupe est favorable à une limitation notable du rôle du préfet en matière psychiatrique. Celui-ci ne constitue en rien, au regard du droit national comme du droit européen, une autorité indépendante. Or seule une telle autorité peut prononcer des mesures privatives de liberté. Cela nous renvoie indirectement au débat que nous avons régulièrement sur le rôle et le statut du Parquet.
C’est pourquoi, à défaut de pouvoir supprimer complètement l’intervention du préfet en la matière, nous proposons que l’intervention du juge des libertés et de la détention soit la plus rapide possible, ce qui passe, selon nous, par un raccourcissement notable de cette période d’observation.
Qui plus est, comparée au régime légal de la garde à vue, cette mesure apparaît tout à la fois dérogatoire et particulièrement sévère, alors même que cette période d’observation est aussi arbitraire et, par définition, aussi privative de liberté qu’une garde à vue. Or notre pays a, en 2010, réformé le régime légal de la garde à vue. Il serait étonnant, et décevant, que les personnes atteintes de troubles mentaux ne puissent pas bénéficier en 2013 d’un même élan réformateur que celui qu’avait initié, en matière de garde à vue, le précédent gouvernement.

Plus le délai est court, moins la situation du patient aura de chances de s’être stabilisée. Je parle d’expérience, car j’ai pu le constater dans les établissements que j’ai eu l’honneur de piloter. Dès lors, le deuxième certificat risque de conclure systématiquement au maintien de l’hospitalisation complète, ce qui serait contraire à l’intérêt du malade et à l’objectif que vous poursuivez.
La commission émet donc un avis défavorable.
C’est le même avis, pour les raisons excellemment présentées par le rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.

L’amendement n° 4, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique définit les droits dont bénéficient les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Il prévoit ainsi que ces personnes doivent être informées de la décision prononçant le maintien des soins, en application des articles L. 3212-4 et L. 3212-7, ainsi que des décisions relatives à l’élaboration des programmes de soins.
Cet article s’inscrit dans la continuité des lois adoptées en faveur de la reconnaissance des droits des patients, notamment de la loi du 4 mars 2002, droits qui font des patients et des usagers du système de santé des acteurs de leurs soins.
Bien entendu, pour les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, il est apporté une modification à la loi de 2002 : les soins étant réalisés sans leur consentement, elles ne peuvent pas, par principe, s’y opposer, du fait même que ces soins sont contraints.
Pour autant, il nous semble que, exception faite de la notion d’acceptation et de consentement aux soins, l’esprit de la loi de 2002 doit être respecté.
C’est pourquoi nous proposons que soit également informée, en plus de la personne faisant l’objet de soins sous contrainte, la personne de confiance qui aura été désignée, le cas échéant, par le patient.
Cette personne pourra naturellement contribuer à informer le patient et participer à l’acceptation des soins qui lui sont promulgués, dans la mesure où elle bénéficiera d’un « capital confiance » qui peut, d’ailleurs, constituer un « plus ».
Cet amendement s’inscrit totalement dans une double logique – une plus grande efficacité thérapeutique et un renforcement des droits des patients admis contre leur volonté en établissement psychiatrique –, en alignant le droit de ces personnes sur le droit commun des autres usagers des établissements de santé.

Je partage la préoccupation exprimée au travers de cet amendement, dont la commission a longuement débattu, mais je m’interroge sur les modalités pratiques.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement. Il est absolument nécessaire qu’un patient bénéficiant de soins psychiatriques et hospitalisé sans son consentement puisse être accompagné, y compris s’il le souhaite devant le médecin, de la personne de son choix, qui pourra jouer auprès de lui un rôle d’intermédiaire, de soutien et de garantie. Il faut absolument préserver cette possibilité.
Néanmoins, si, sur le principe, il n’y a absolument aucun doute, il n’en est pas du tout de même sur le point de savoir si votre rédaction est juridiquement satisfaisante et sécurisante.
Je tiens à préciser par ailleurs que la proposition de loi, dans la rédaction qui vous est soumise, satisfait largement votre souhait de permettre au patient de faire valoir ses observations. Cette disposition est en effet d’ores et déjà inscrite dans ce qui deviendra l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Je rappelle, au surplus, qu’une personne peut déjà, si le patient en soins psychiatriques le souhaite, assister aux entretiens entre le patient et le médecin.
Je le répète : la rédaction que vous proposez, par le flou qu’elle introduit, prend de front ce que prévoient déjà les textes et risque de susciter une forme d’insécurité juridique.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, d’autant que la réflexion pourra se poursuivre jusqu’à la réunion de la commission mixte paritaire.

La logique qui prévaut dans cet amendement semble avoir été comprise et nous ne voulons pas qu’une rédaction maladroite ne suscite le doute ni trahisse les idées que nous portons.
Par conséquent, si la rédaction que nous proposons pose problème et que l’on ne puisse la modifier, nous acceptons de retirer cet amendement.
L'article 1 er est adopté.

L'amendement n° 18, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, après les mots : « notamment du fait du comportement de la personne, », sont insérés les mots : « en cas d’inobservance du programme de soins, ou dans le cadre d’une demande urgente de la personne de confiance, ».
La parole est à Mme Catherine Deroche.

Il s’agit de préciser que la rupture du programme de soins par le patient - ou une demande urgente de la personne de confiance - peut justifier, dans certains cas, que le psychiatre demande rapidement un retour en hospitalisation complète.

L’article L. 3211-11 semble couvrir la situation visée. Cet amendement est donc satisfait par le droit existant et la commission en demande le retrait.
Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
La possibilité de réhospitalisation en cas de non-respect du programme de soins existe déjà. En outre, je tiens à rappeler qu’il incombe au seul médecin d’apprécier la nécessité éventuelle d’une réhospitalisation. Il n’appartient pas à la loi de déterminer précisément les cas dans lesquels cette procédure doit intervenir.
Si la possibilité de réhospitalisation est prévue par le texte, sa mise en œuvre relève de la seule compétence du médecin.

L’amendement n° 18 est retiré.
L'amendement n° 6, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique est supprimée.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Cet amendement a pour objet de supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, qui prévoit que « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
En commission des affaires sociales, le rapporteur a présenté un amendement procédant du même esprit, amendement que nous avons soutenu. En effet, nous ne pouvons accepter qu’une décision aussi importante que la modification de la base des soins sans consentement, c’est-à-dire le passage d’une hospitalisation sur demande d’un tiers à une hospitalisation à la demande du représentant de l’État dans le département, puisse s’opérer sur le seul fondement du dossier médical, c’est-à-dire, pour parler simplement, sans qu’un psychiatre rencontre personnellement le patient et établisse ainsi un certificat médical sur la base de ses propres observations.
Or il ne vous aura pas échappé que notre amendement ne porte pas sur le même article que celui que visait le rapporteur en commission. En effet, l'amendement qui a été adopté en commission modifie l’article L. 3213-6, qui, au sein du code de la santé publique, est intégré aux dispositions relatives aux seuls cas d’hospitalisation complète faisant suite à la demande du préfet.
Aussi, compte tenu de la division actuelle du code de la santé publique, il nous semble que cette disposition de principe ne concerne pas les hospitalisations complètes décidées à la suite d’une demande d’un tiers ni celles qui sont prononcées en cas de péril imminent.
C’est pourquoi nous souhaitons, comme l’a fait le rapporteur à l’article L. 3213-6, supprimer la possibilité pour le psychiatre de modifier la base des soins sans consentement sur simple avis médical dans l’article L. 3211-11 qui, pour sa part, établit le socle de droit des patients admis en hospitalisation complète, pour l’ensemble des formes d’admission.

Je réitère ici les explications que j’ai déjà fournies en commission : il y a une différence entre les avis médicaux de l’article L. 3213-6, que la commission a supprimés, et l’avis médical prévu à l’article L. 3211-11. Dans ce dernier cas, l’avis est celui du psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et qui le connaît donc mieux que quiconque.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Madame la sénatrice, vous demandez que le médecin qui suit le malade ne puisse pas proposer une réhospitalisation complète sans avoir vu le patient, en ne transmettant qu’un simple avis et non un certificat médical.
Mais il faut songer à des situations très particulières et très exceptionnelles. Que faire si un patient ne se rend pas au rendez-vous avec son médecin ? Comment apprécier la situation d’un malade dont on pense qu’il constitue un risque pour lui-même, son entourage ou la société et qui se soustrait, du fait peut-être d’ailleurs de sa pathologie, à l’entretien avec son médecin ?
Il faut bien que, dans des contextes exceptionnels qui peuvent déboucher sur des situations d’urgence, le médecin puisse proposer la réhospitalisation ou l’hospitalisation de son patient sans le voir, sur la base d’un avis et non en produisant un certificat médical en bonne et due forme.
L'amendement n'est pas adopté.
L’article L. 3211-11-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -11 -1 . – Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée :
« 1° Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un membre du personnel de l’établissement d’accueil, par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie. Plusieurs personnes malades peuvent être autorisées à effectuer une sortie groupée. Elles sont accompagnées par un nombre adéquat de personnels de l’établissement d’accueil ;
« 2° Sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures.
« L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
« Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite du représentant de l’État dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l’État ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
« Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement d’accueil informe celui-ci préalablement de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée. » –
Adopté.
Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3222-1-1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit les modalités de retour d’un patient en hospitalisation complète dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3211-11. » ;
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 3222-1-1 est ainsi rédigé :
« Les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être prises en charge et transportées dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 sans leur consentement selon des modalités et avec des moyens de contrainte nécessités par leur état de santé. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3222-1-2 est supprimé ;
3° Après l’article L. 3222-4, il est inséré un article L. 3222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222 -4 -1. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1. »

Le groupe UMP votera contre cet article, car il s’oppose à la proposition portée par M. Jean Desessard qui autorise les parlementaires à visiter les établissements de santé.
On ne peut pas prendre en compte la santé de ces patients et, dans le même temps, autoriser ce type de démarche. Les parlementaires n’ont pas à se rendre dans de tels lieux.

Je soutiens cet article et la disposition qui prévoit que les parlementaires peuvent avoir accès à des établissements où il y a privatisation de liberté. Il est en effet important qu’ils aient la possibilité de se rendre dans tous les lieux où il peut y avoir de l’arbitraire – bien sûr, on espère qu’il n’y en a pas –, pour vérifier si les conditions d’accueil de ces personnes sont garanties.
Je trouve donc cette mesure très opportune.
M. Joël Labbé applaudit.
L'article 3 est adopté.

Chapitre II
Amélioration du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement
Le II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège prévu au présent II doit être produit, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement. »

L'amendement n° 19, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le début du 6° du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La personne de confiance, ...
le reste sans changement

La personne de confiance, puisqu’elle a été désignée comme telle par le patient, doit pouvoir saisir le juge des libertés et de la détention, lorsqu’elle l’estime nécessaire, afin de remplir au mieux son rôle.

Nous partageons le souci exprimé par les auteurs de cet amendement. Nous nous interrogeons cependant sur sa rédaction et sa portée pratique, en particulier dans un contexte où la notion de « personne de confiance » est très peu développée en psychiatrie.
Nous sollicitons donc l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Il est proposé d’inclure la personne de confiance à la liste des personnes qui peuvent présenter un recours devant le juge des libertés et de la détention pour obtenir la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques. Cette demande, qui est légitime, me semble satisfaite en l’état actuel du texte, la loi ouvrant cette possibilité à toute « personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins », ce qui englobe à l’évidence la personne de confiance.
L'article 4 est adopté.
L’article L. 3211-12-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -12 -1 . – I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du présent code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
« 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise, soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis est motivé au regard de l’état de santé du patient.
« Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4, premières et secondes phrases
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
cinq
La parole est à M. Jean Desessard.

J’ai déjà largement évoqué l’objet de cet amendement au cours de la discussion générale, ce qui me permettra une présentation plus concise.
Nous souhaitons avancer le recours au juge de douze jours à cinq jours, suivant en cela les recommandations du rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie. Ce n’est donc pas une idée écologiste, même si, des idées, nous en avons d’excellentes et de fort brillantes
Sourires.

On aurait ainsi une véritable judiciarisation ab initio, permettant au juge des libertés et de la détention de ne pas prolonger l’hospitalisation sans consentement de personnes qui n’auraient absolument pas à faire l’objet d’une telle mesure.
M. Joël Labbé applaudit.

L'amendement n° 7, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
1°) Première phrase
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
dix
2°) Seconde phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Initialement, la proposition de loi du député Robiliard prévoyait de porter de quinze jours à dix jours la période durant laquelle une personne admise en hospitalisation complète sans consentement pouvait être maintenue hospitalisée, sans que le juge des libertés et de la détention intervienne.
Cette question est fondamentale à plus d’un titre. Elle l’est d’un point de vue judiciaire, voire constitutionnel, puisque la question du contrôle par le juge des libertés et de la détention de toute mesure privative de liberté constitue un impératif majeur. Il s’agit de vérifier que la décision prise sur le fondement soit d’une demande d’un tiers, soit d’une demande émanant du préfet ne constitue pas une mesure arbitraire.
Cependant, il s’agit également d’un impératif humain qu’il ne faut pas négliger. Les personnes qui font l’objet d’une mesure d’admission en établissements psychiatriques contre leur volonté sont, pour l’essentiel, en souffrance. Elles sont en attente d’une décision qu’elles espèrent autant qu’elles redoutent, et il est de notre responsabilité de législateur d’apporter une réponse qui tienne compte de ces deux éléments.
De la même manière, il nous faut tenir compte d’un autre élément, rappelé par le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie : un délai trop court, réduit par exemple à cinq jours, pourrait avoir pour effet de priver la personne hospitalisée de son droit légitime et, là aussi, constitutionnel à organiser sa défense. C’est donc pour nous une fausse bonne idée.
C’est pourquoi nous nous contentons, comme les auteurs de la proposition de loi initiale, de ramener de douze jours à dix jours la période durant laquelle le juge doit impérativement intervenir et se prononcer.
Qui plus est, afin que le juge puisse intervenir dans des délais convenables et éviter que son absence d’intervention n’entraîne une augmentation massive des décisions de mainlevée pour non-respect des règles procédurales, nous proposons que le directeur de l’établissement dans lequel une personne est admise sans son consentement en informe le juge des libertés et de la détention dans un délai non plus de huit jours à compter de l’admission, mais de six jours. Ainsi sera maintenu, comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de ce texte, un délai de quatre jours entre la date butoir à laquelle le juge doit être informé de l’admission et celle à laquelle il doit prononcer sa validité.

M. Jacky Le Menn, rapporteur. Certes, je ne doute pas que nos amis Verts aient des idées très intéressantes
Sourires

Sur l’amendement n° 7, le Conseil constitutionnel a considéré que le délai pouvait être de quinze jours. L’Assemblée nationale a trouvé une position moyenne et l’a fixé à douze jours. Il faut se rallier à cette solution. Lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a longuement expliqué pourquoi il fallait pouvoir organiser matériellement la défense.
Cette question des délais fut effectivement l’un des points importants de la discussion à l’Assemblée nationale, et on le comprend, la volonté d’apporter toutes les garanties en termes de liberté, d'écoute et de soutien du malade étant, je dois le dire, partagée. L’enjeu n’est donc pas simplement de fixer un délai qui donne davantage de confort aux structures existantes.
Je veux mettre en avant les deux raisons qui ont amené le Gouvernement à privilégier le maintien du délai de quinze jours, et à trouver une position de compromis avec les députés autour d’un délai de douze jours.
Tout d’abord, et même si ce n’est pas la raison majeure, nous avons dû tenir compte des contraintes d’organisation matérielle. Il ne faudrait pas que, fautes des moyens nécessaires, les juges ne soient pas en mesure de se prononcer ou que des décisions de principe soient rendues sans que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour le patient. Dans la mesure où une pression très forte s’exercerait sur eux, les juges risqueraient de rendre systématiquement leurs avis dans un sens, ou dans l’autre.
Mais la raison principale est d’ordre médical. Les professionnels considèrent qu’un temps de stabilisation du patient est nécessaire avant qu’ils puissent se prononcer. L’avis du juge doit pouvoir intervenir sur la base d’une appréciation médicale de l’évolution du malade.
Après l’examen des premiers jours, il est parfois nécessaire, dans certaines pathologies, de disposer de davantage de temps pour apprécier l’évolution de l’état du patient. De ce point de vue, un délai de cinq jours n’est pas raisonnable. Quant au délai de dix jours souhaité par les députés, il est apparu également insuffisant. Nous avons finalement trouvé un compromis sur un délai de douze jours.
La position initiale du Gouvernement, que je tiens à rappeler, était toutefois le maintien du délai de quinze jours, que le Conseil constitutionnel et l’ensemble des professionnels de santé avaient jugé acceptable.

Sans vouloir me livrer à une surenchère, je précise que je me suis appuyé sur les conclusions d’une mission parlementaire pour rédiger l’amendement n° 25. Toutefois, compte tenu des arguments avancés par Mme la ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.

Une fois n’est pas coutume, quel beau consensus ! Après avoir entendu les explications de Mme la ministre, nous retirons également cet amendement.

L'amendement n° 7 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quinze jours
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de six jours à compter de l’admission de cette demande.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Cet amendement a pour objet de porter de six mois à quinze jours le délai dont dispose le juge des libertés et de la détention pour contrôler et valider, ou non, la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, c’est-à-dire lorsqu’une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental se voit imposer une mesure de sûreté.
En l’état actuel du droit, ce délai est de six mois, ce que le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause, précisant même, dans sa décision du 20 avril 2012, que ces dispositions « [...] ne font pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ».
Toutefois, je tiens à faire observer que la décision du Conseil constitutionnel ne signifie en rien qu’un raccourcissement de ces délais ne serait pas conforme à la Constitution.
Ce n’est donc pas une question de droit. Le tout est de savoir si l’on peut accepter que des personnes déclarées irresponsables pénalement puissent être maintenues en hospitalisation complète sans consentement et sans intervention du juge, durant une période particulièrement longue, puisqu’il s’agit de six mois !
Le groupe CRC considère pour sa part que ce délai est beaucoup trop long.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter cet amendement.

L'amendement n° 26, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première et dernière phrases
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
La parole est à M. Jean Desessard.

Puisque la présente proposition de loi améliore et renforce l’accès au juge des personnes faisant l’objet de mesures de soins sans leur consentement, cet amendement vise à ramener le délai entre deux décisions du juge des libertés et de la détention de six à quatre mois.
Un délai de six mois pour le contrôle du juge nous semble en effet trop long concernant une mesure privative de liberté.

La commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le juge se prononce obligatoirement au bout de douze jours, puis de six mois. Dans l’intervalle, c’est le psychiatre qui prend l’initiative de faire réexaminer la situation, si elle a évolué sur le plan médical. Cet agencement paraît plus conforme aux besoins thérapeutiques et à la protection des droits.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission et, à défaut du retrait de l’amendement, émettrait un avis défavorable.
Je le rappelle, le patient peut, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la détention. Nous ne sommes pas dans une situation de non-droit.
Ce point est important : entre le premier avis donné à douze jours et celui qui intervient après six mois, des recours restent possibles, de la part du patient ou de la personne de confiance. De surcroît, au cours de cette période de soins, il arrive fréquemment que le médecin décide de la fin de l’hospitalisation du patient.

L’explication de Mme la ministre m’apparaissant lumineuse, je retire l’amendement, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 10, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
quatorze
par le mot :
cinq
La parole est à Mme Laurence Cohen.

L’alinéa 6 de cet article prévoit les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut, avant de se prononcer sur l’opportunité ou non de prolonger une mesure d’hospitalisation sans consentement, réunir un collège d’experts.
Selon les cas, c’est-à-dire s’il s’agit d’une mesure d’admission, de renouvellement d’admission ou d’admission prononcée à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable, le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention peut être prolongé de quatorze jours.
Comme en 2011, nous sommes opposés au fait que la désignation des experts puisse avoir pour effet de doubler la durée d’une mesure privative de liberté qui pourrait, au final, être considérée inopportune par le juge des libertés et de la détention. Concrètement, une telle procédure pourrait avoir pour effet de priver injustement de liberté une personne pendant une période allant jusqu’à vingt-neuf jours !
Ce délai est trop long et les personnes intéressées n’ont pas à subir les conséquences d’une désorganisation de notre système judiciaire, particulièrement lorsqu’elles prennent la forme d’une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale.
Pour toutes ces raisons, nous proposons un délai tout à la fois pragmatique et respectueux des droits et de l’intérêt des personnes, c’est-à-dire un délai de cinq jours.

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, auquel elle se rangera.
Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Madame la sénatrice, vous souhaitez que le délai global ne soit pas excessif en cas de recours à l’expertise. Je comprends votre préoccupation.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai qui ne peut excéder douze jours et, s’il s’estime insuffisamment éclairé pour prendre sa décision, il a la possibilité de demander une expertise juridique, qui doit intervenir dans un délai maximal de quatorze jours. C’est ce deuxième délai que vous souhaitez réduire.
Cette demande se heurte toutefois à des réalités concrètes : il est impossible d’obtenir les deux expertises qui sont requises dans un délai de cinq jours de la part de professionnels de santé engagés par ailleurs dans de multiples activités. Il paraît donc réaliste de maintenir ce délai de quatorze jours.
J’ajoute que le fait de ne pas maintenir ce délai risque d’aboutir à l’effet contraire de celui que vous recherchez : si le juge estime ne pas disposer d’éléments d’information suffisants, il risque de se prononcer systématiquement dans le même sens. Il est donc plus protecteur pour le patient de maintenir ce délai.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 8, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
S'il constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 tient dans la loi fondamentale un rôle particulier puisqu’il constitue l’un des piliers de notre droit positif. Il pose en effet le principe de l’interdiction de toute détention arbitraire et celui de la compétence de l’autorité judiciaire pour la protection de la liberté individuelle.
C’est ainsi que, dans une décision faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que le maintien au-delà de quinze jours d’une mesure d’hospitalisation fondé sur un simple certificat médical méconnaissait les termes de l’article 66 de la Constitution, raison pour laquelle il devait déclarer anticonstitutionnel un article du code de la santé publique.
L’article 5 de la présente proposition de loi organise précisément la procédure selon laquelle le juge des libertés et de la détention procède au contrôle de la mesure d’admission d’une personne sans son consentement.
Certes, son alinéa 10 dispose que « le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ». Pour autant, nous ne nous réjouissons pas de cette formulation, qui nous semble floue. Rien n’est clairement explicité pour le cas où la procédure n’aurait pas été respectée, par exemple si les délais n’ont pas été respectés et que la personne a été, en conséquence, arbitrairement privée de liberté.
Dans une telle situation, la Constitution nous impose de prévoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas d’autre solution que de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
À défaut, si la loi ne lui enjoint pas de prononcer une mainlevée, un juge des libertés et de la détention pourrait être amené à valider une mesure privative de liberté qui n’aurait pas respecté notre cadre légal et constitutionnel.
Afin d’éviter cette situation, il nous semble opportun de faire préciser dans la loi clairement que, si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique n’a pas été respectée, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement est automatique.
Le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur cet amendement s’il devait être maintenu.
Le juge ne peut pas s’immiscer dans le processus de soin. Si vous entendez, à travers votre amendement, signifier qu’il appartient au juge de vérifier le respect de la procédure, vous avez d’ores et déjà satisfaction.
Si le juge constate que la procédure n’a pas été respectée, il en tire des conséquences de droit. Mais l’on ne peut pas prévoir la levée automatique de processus médicaux qui ont été engagés.
Il y a là deux terrains différents, d’un côté celui du droit, de l’autre, celui du soin.
La protection juridique du patient est assurée par l’ensemble des dispositions qui prévoient les moments où le juge des libertés et de la détention peut ou doit être saisi, mais elle ne saurait intervenir dans le déroulement même du processus médical engagé. Or je crains que la rédaction que vous proposez n’aboutisse à conférer en quelque sorte au juge un pouvoir dans la définition du programme de soins.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 27, présenté par M. Le Menn, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
L’article L. 3211-12-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -12 -2 . – I. – Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
« À l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance.
« II. –
Supprimé
« III. – Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance. »

L'amendement n° 24, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
en cas de nécessité,
insérer les mots :
et dans la limite d’une période d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …
La parole est à Mme Catherine Deroche.

Je présente cet amendement, bien que j’aie déjà obtenu une réponse en commission.
Afin de ne pas déstabiliser l’organisation des établissements qui auraient adopté un fonctionnement mutualisé, cet amendement prévoit de laisser aux établissements un délai d’un an pour installer une salle d’audience en leur sein.

Je demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait : les dispositions de l’article 6 entrent en vigueur en septembre 2014. Cet amendement découle sans doute d’une mauvaise lecture, qui a conduit à une confusion. Nous avons le temps !
Le Gouvernement est du même avis.
Je comprends parfaitement la préoccupation exprimée ici : il faut faire en sorte que les établissements de santé dans lesquels il n’y a pas aujourd’hui de lieu adapté pour servir de salle d’audience ne soient pas confrontés à une situation impossible qui constituerait un vide juridique. L’entrée en vigueur de la disposition a été décalée précisément pour y répondre.
L'article 6 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, à l’exception du dernier alinéa du I » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. »

L'amendement n° 12, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme Laurence Cohen.

La loi du 5 juillet 2011, dans son esprit comme dans sa lettre, criminalise en quelque sorte la maladie mentale et dénature profondément la psychiatrie, réduite à une fonction de régulation des troubles sociaux, quand elle a, à l’évidence, une mission radicalement différente : aider à la guérison et permettre à tous nos concitoyens de trouver une place dans la société.
À titre d’exemple, alors que la logique juridique veut que les mesures libératoires soient exécutoires, puisqu’il peut, par exemple, s’agir de mettre fin à une mesure privative de liberté décidée de manière arbitraire, la loi de 2011 a introduit un droit d’appel suspensif, à l’initiative du procureur de la République, à l’encontre d’une décision de mainlevée de la mesure privative de liberté prononcée par le juge.
Pourtant, sauf erreur de ma part, l’effet non suspensif des recours est un principe de portée générale, il a un caractère fondamental, en liaison étroite avec la présomption de légalité des actes administratifs dont résulte leur force exécutoire immédiate.
Cette faculté offerte au procureur, qui demeure aujourd’hui encore, faute de réforme d’ampleur, sous l’autorité directe du procureur général, et donc du ministère de la justice, pourrait avoir pour conséquence de priver une personne de sa liberté pendant quatorze jours supplémentaires !t
On est loin, à mon sens, de la volonté exprimée par le juge constitutionnel. Ne s’agit-il pas, en réalité, de considérer les personnes atteintes de troubles mentaux comme potentiellement très dangereuses, en tout cas plus que la moyenne de nos concitoyens, pour que l’on en vienne à maintenir à leur encontre un régime dérogatoire du droit commun, et profondément défavorable ?
Je dois d’ailleurs dire que je fais miens les arguments avancés, à raison, par notre collègue Christiane Demontès, qui, défendant en 2011 un amendement en tout point similaire à celui-là, déclarait : « Nous continuons notre combat contre un texte sécuritaire […] Le mécanisme prévu ici est d’une énormité sans précédent. L’autorité administrative pourrait adresser injonction au Parquet ; voilà qui traduit la méfiance du Gouvernement envers les magistrats et crée un dangereux précédent, manifestement contraire au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et à l’article 64 de la Constitution ».
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter cet amendement.

Il ne vous aura pas échappé, madame Cohen, que, depuis l’intervention de notre collègue Christiane Demontès, le Conseil constitutionnel a tranché. À l’époque, en effet, un certain nombre de doutes avaient été formulés, mais le Conseil n’a pas jugé ces dispositions contraires à la Constitution.
La décision d’appel prise par le premier président de la cour d’appel n’est pas obligatoirement suspensive et la décision du procureur de la République doit être motivée au regard du danger pour le malade lui-même ou pour autrui. Cela est tout à fait équilibré.
La procédure paraît donc offrir suffisamment de garanties. Nous demandons donc le retrait de cet amendement. À défaut, notre avis serait défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Il est vrai, madame la sénatrice, que le caractère non suspensif d’un recours est un principe de portée générale. Cependant, comme tout principe de droit, il connaît des exceptions. En l’occurrence, le recours suspensif ne peut être demandé que dans des cas extrêmement précis : en cas de risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade ou, de la part du malade, envers son entourage ou autrui ; il n’est pas, de ce fait, systématique.
Le procureur dispose de six heures pour former appel, un délai très bref, donc, et la cour d’appel statue immédiatement sur son caractère suspensif ou non. Dans le cas où l’appel est déclaré suspensif, la cour statue ensuite dans un délai maximum de trois jours.
La procédure d’appel est donc extrêmement encadrée et ne peut intervenir que dans des situations précises ce qui, de ce point de vue, ne remet pas en cause les principes généraux du droit, dont le malade doit pouvoir bénéficier.
Je vous demande donc de retirer cet amendement, à défaut de quoi j’émettrais un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 bis est adopté.

TITRE II
CONSOLIDATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Chapitre Ier
Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits dans le cadre d’une mesure de soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent

L'amendement n° 20, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 7
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Soit s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° du présent II. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du présent II et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
« Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du présent II, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
« Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
II. - L’article L. 3212-3 du même code est supprimé.
La parole est à Mme Catherine Deroche.

Actuellement, la loi prévoit deux situations.
D’une part, en cas de « situation d’urgence », notion juridique très classique en droit de la santé, l’admission du patient peut se faire à la demande d’un tiers, mais selon une procédure simplifiée, au moyen d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin de l’établissement.
D’autre part, en « situation de péril imminent », situation faisant l’objet d’une définition par la Haute Autorité de santé, l’admission du patient se fait sur la base d’un seul certificat médical, qui doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement.
Il est donc proposé de rassembler ces deux notions, que la loi du 5 juillet 2011 distingue, ce qui peut être source de contentieux.

La commission est défavorable à cet amendement. Chaque procédure a sa logique propre, et il convient de maintenir la distinction.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission, monsieur le président.
Madame la sénatrice, s’il s’agit de dire que le droit applicable est en l’espèce fort complexe, je vous rejoins très volontiers. Ce sont là des situations diverses, auxquelles correspondent des procédures diverses, qui, toutes, prévoient des délais, des recours, différentes interventions du juge ou du malade. Cela peut aboutir à une certaine confusion pour le grand public et sans doute, également, pour un certain nombre d’élus.
Pour autant, ces procédures sont encadrées et identifiées.
Je vous rappelle que la première, qui existait avant la loi du 5 juillet 2011, permet de gérer des situations d’urgence en cas de risque d’atteinte à l’intégrité du malade. Dans ce cas, la seule dérogation tient au nombre de certificats requis pour prononcer l’hospitalisation.
La seconde procédure, créée par la loi de 2011, vise à permettre l’accès aux soins des personnes qui sont en situation de péril imminent lorsqu’aucun tiers ne fait la demande de soins.
Introduire la notion de « péril imminent » dans les deux cas reviendrait à fusionner deux procédures de nature différente. La clarté commande de maintenir la distinction entre elles, dont je conçois pourtant aisément qu’elle ne soit pas simple pour qui n’est pas directement impliqué.
L'amendement n'est pas adopté.

Madame la ministre, mes chers collègues, pour la suite de nos débats, je vous informe que je suspendrai la séance à douze heures trente, pour une reprise à quatorze heures trente.
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « pour une durée d’un mois, » ;
2° L’article L. 3212-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. » ;
b) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre…
le reste sans changement
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le mot : « médicale » ;
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation est renouvelée tous les ans. » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3°
Supprimé
4°
a)À la première phrase, les mots « ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.

L'amendement n° 13, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
le directeur de l’établissement
par les mots :
le juge des libertés saisi à la demande du directeur de l’établissement
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Cet amendement porte sur les conditions dans lesquelles les soins psychiatriques prononcés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, c’est-à-dire sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes de un mois, renouvelables.
Il nous semble que la prolongation ou le renouvellement d’une mesure de soins prenant la forme d’une hospitalisation complète sans consentement s’apparente à la reconduction d’une mesure privative de liberté.
Or une telle décision ne peut évidemment pas être le fait du directeur d’établissement, puisque les mesures privatives de liberté doivent, au regard de la Constitution, et plus particulièrement de son article 66, être décidées par une autorité judiciaire indépendante.
C’est pourquoi cet amendement, tout en conservant le cadre actuel, prévoit toutefois que la décision de continuer à priver le patient de sa liberté appartient non plus au directeur d’établissement, mais au juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur d’établissement.

La procédure actuelle garantit le contrôle du juge dans des délais suffisants. En outre, les décisions du chef d’établissement sont susceptibles d’appel. Je peux vous confirmer, par expérience, que cela s’est déjà produit.
Je demande l’avis du Gouvernement, mais l’avis de la commission me semble devoir être défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec un autre, que nous avions préalablement défendu.
En effet, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler au cours de nos échanges, notamment par nos amendements, le juge des libertés et de la détention est le gardien des libertés individuelles. Il lui appartient donc de statuer sur d’éventuelles violations de procédure privant injustement les patients de leur droit à la liberté.
Or la transformation d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en hospitalisation à la demande du préfet, dont il est question dans cet article, fait courir d’importants risques aux personnes admises en soins sans leur consentement, et ce malgré la rectification introduite par notre rapporteur en commission.
C’est pourquoi, à l’image de ce qui est prévu pour la procédure de renouvellement d’une mesure d’hospitalisation, nous proposons que le juge des libertés et de la détention puisse intervenir à ce stade de la procédure, afin de la contrôler et, le cas échéant, si toutes les conditions ne lui semblent pas réunies, de décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure d’admission.

S’agissant d’un cas où un psychiatre considère que la levée des soins entraîne un péril imminent pour le malade, le recours au préfet me paraît légitime. Si le préfet décide de demander des soins sans consentement, toutes les procédures de contrôle par le juge s’appliquent, entraînant la garantie des droits que vous défendez à juste titre.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Je ne souhaitais pas intervenir dans ce débat, dans la mesure où tout a déjà été dit durant la discussion générale. Nous avons cependant dû étudier ce texte très rapidement et nous n’avons disposé que d’un temps très restreint pour examiner l’ensemble de ces amendements.
Il serait donc souhaitable, madame la ministre, que, lorsque vous êtes défavorable à des amendements, vous nous fournissiez une explication plus étoffée, afin que nous puissions ensuite juger de votre argumentation.
Monsieur le président, j’ai bien entendu que nous devions terminer à douze heures trente. À mon sens, ces procédures d’urgence montrent leurs limites et ne sont pas sans incidence sur la qualité des débats que nous pouvons avoir dans cet hémicycle.
Bien que le temps soit contraint, je souhaite que nous prenions la peine de débattre au fond de chacun des amendements présentés.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'article.

Nous nous abstiendrons sur l’article 7, parce que l’intervention du préfet nous fait nous interroger, compte tenu de ce que nous avons lu et de ce que nous avons entendu au cours de nos échanges, évidemment très brefs, avec les professionnels des soins psychiatriques.
Comme Mme la présidente de la commission des affaires sociales vient de le signaler, il est compliqué pour nous, législateur, d’arriver à nous forger un jugement tout à fait éclairé. Je souhaite vraiment que, dans des délais assez rapides, mais néanmoins suffisants pour qu’une réflexion ait lieu, un projet de loi soit présenté qui soit consacré à toutes ces questions de santé mentale. De fait, il est nécessaire d’approfondir les débats.
En ce qui concerne, je le répète, l’intervention d’un préfet dans ce cas-là, les membres du groupe CRC s’interrogent.
L'article 7 est adopté.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique et du registre tenu pour les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ainsi que des certificats liés à cette prise en charge, examinant sa faisabilité technique et détaillant les modalités de consultation et de recueil des observations des autorités chargées du contrôle des établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement susceptibles d’être mises en œuvre ainsi que les adaptions législatives ou réglementaires qu’elle rendrait nécessaires. –
Adopté.
Chapitre II
Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits et clarification des procédures applicables dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3213-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213 -1. – I. – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
« 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
« Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
« III. – Le représentant de l’État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
« IV. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;
2° L’article L. 3213-3 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du I est ainsi rédigé : « Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite...
le reste sans changement
a bis) À la deuxième phrase du même alinéa, après la référence : « L. 3211-2-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) La seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis Après le mot : « mentionnées », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3213-4 est ainsi rédigée : « au II de l’article L. 3211-12. » ;
3° L’article L. 3213-5 est abrogé ;
4° L’article L. 3213-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’État dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
« L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8. » ;
5° L’article L. 3213-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3213 -8 . – I. – Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12, ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception de l’avis.
« II. – Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un psychiatre choisi dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’État, un avis sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
« III. – Lorsque l’avis du psychiatre prévu au II confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins psychiatrique ou décide d’une mesure de prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à l’avis mentionné au I.
« IV. – Lorsque l’avis du psychiatre prévu au II préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’État la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. »
6° L’article L. 3213-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213 -9 -1 . – I. – Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
« II. – Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’État, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
« III. – Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
« Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’État maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
« IV. –
Supprimé

L'amendement n° 15, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
1° Alinéa 4
Remplacer les mots :
au représentant de l'État dans le département
par les mots :
au juge des libertés et de l’application des peines
2° Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
le représentant de l'État dans le département
par les mots :
la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5
3° Alinéa 8
Remplacer les mots :
représentant de l'État
par les mots :
juge des libertés et de l’application des peines
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Monsieur le président, je souhaite défendre en même temps l’amendement n° 16.

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 16, également présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Alinéa 29
Remplacer les mots :
le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical
par les mots :
l’autorité administrative compétente procède à la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatriques
Veuillez poursuivre, ma chère collègue

Nous nous souvenons toutes et tous que l’adoption de la loi du 5 juillet 2011 a fait suite au drame de Grenoble et au discours d’Antony, dans lequel le Président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy, promettait de régler les problèmes de sécurité liés à la santé mentale, notamment en détournant la psychiatrie de sa mission médicale au profit d’une mission sécuritaire, au service d’une certaine conception de l’ordre social.
Dans ce cadre, les droits des personnes hospitalisées ont été considérablement réduits, au point que le Conseil constitutionnel a été obligé de déclarer non conforme à la Constitution deux des dispositions du projet de loi.
À l’inverse, les prérogatives des préfets ont été considérablement renforcées. En effet, la loi de 2011 a confié au représentant de l’État la possibilité de prolonger, parfois contre l’avis de l’équipe médicale, l’hospitalisation complète et sans consentement d’un malade hospitalisé d’office. En outre, le préfet reçoit communication d’un certain nombre d’informations sur l’état de santé des personnes admises en hospitalisation sans consentement, en violation manifeste du droit au secret médical.
Bien que, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi améliore nettement le régime des sorties d’essai, le préfet pourra continuer de s’opposer à ces sorties. Or, dans la mesure où elles ont une vocation thérapeutique, nous voyons mal sur quel fondement, si ce n’est celui d’une dangerosité redoutée, le préfet pourrait prendre une telle décision. S’il n’est pas illégitime que le préfet soit informé de ces sorties, il n’est pas acceptable, selon nous, qu’il puisse s’y opposer.
Ces quelques exemples démontrent l’importance du rôle que sont amenés à jouer les préfets dans le processus d’admission, dans le parcours de soins et dans les processus de sortie des personnes admises en hospitalisation complètes contre leur volonté, alors même que ces décisions devraient relever soit de la compétence médicale, soit du juge des libertés et de la détention, sur le fondement des observations des équipes médicales.
Ce pouvoir confié au représentant de l’État dans le département nous paraît démesuré ; nous considérons qu’il fait reposer sur le préfet une responsabilité que celui-ci n’a pas à assumer.
Pour le groupe CRC, il n’appartient pas au préfet de décider de l’hospitalisation d’office d’une personne : il s’agit d’une décision judiciaire, puisque privative de liberté. C’est pourquoi nous vous proposons, en adoptant l’amendement n° 15, de remplacer l’intervention du représentant de l’État dans le département par celle du juge des libertés et de la détention.
En outre, comme le souligne le syndicat de la magistrature, « la recommandation 2004-10 du Conseil de l’Europe prévoit que ″la décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente″, l’expression ″instance compétente″ désignant dans ladite recommandation ″une autorité ou une personne ou une instance […] qui peut prendre une décision indépendante″. Cette recommandation exclut donc de fait l’autorité préfectorale qui, par nature, n’est pas une autorité indépendante ».
Dans la même logique, l’amendement n° 16, qui porte sur l’alinéa 27 de l’article 8 de la proposition de loi, prévoit que, lorsque le psychiatre considère qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis du préfet. Nous considérons en effet que, dans l’intérêt des personnes hospitalisées comme de nos libertés fondamentales, l’avis médical doit nécessairement l’emporter sur une décision de nature administrative.

Cette question est extrêmement importante et il est vrai que l’on ne saurait l’esquiver d’une pirouette.
Pour ma part, je pense que la discussion devra avoir lieu ; le Syndicat de la magistrature a pris position, mais d’autres ont des avis différents, qu’il faudrait aussi pouvoir entendre.
En tant que rapporteur, je considère que le préfet conserve une légitimité du point de vue de la protection de l’ordre public. Savoir si son intervention est fondée ou non, on en débattra sans doute lors de l’examen des dispositions du futur projet de loi de santé publique relatives à la santé mentale, ou lors de la discussion d’un autre projet de loi, purement juridique.
Pour l’heure, je considère que, concernant la protection de l’ordre public, le préfet a une légitimité. Du reste, les amendements que nous avons adoptés en commission, d’ailleurs à l’unanimité, encadrent déjà strictement ses pouvoirs.
En ce qui concerne l’amendement n° 16, l’autorité administrative à laquelle il est fait référence n’offre pas, pour l’instant, de garanties supplémentaires.
Dans ces conditions, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur les amendements n° 15 et 16, qui sont complémentaires.
Comme M. le rapporteur vient de le faire remarquer, l’amendement n° 15 ouvre un débat majeur : il s’agit de savoir quelles doivent être les places respectives du pouvoir administratif et de l’autorité judiciaire.
La proposition de loi, qui s’intègre dans un ensemble plus vaste, repose sur une articulation entre, d’une part, le rôle et la responsabilité du préfet et, d’autre part, le rôle et la responsabilité du juge.
Très honnêtement, le débat peut avoir lieu ; au fond, il doit même avoir lieu dès lors que, il y a deux ans, nous avons introduit le juge dans une organisation qui reposait exclusivement sur la compétence et la responsabilité du préfet.
Comment devra évoluer l’articulation entre le juge et le préfet ? C’est tout le débat qui aura lieu. Pour l’heure, je ne crois pas que cette question, qui est tout sauf secondaire, puisse être tranchée à l’occasion de l’examen d’un amendement sur une proposition de loi qui s’intègre dans un ensemble plus vaste.
Madame Pasquet, je respecte tout à fait votre démarche, et j’y suis même assez sensible ; mais je ne crois absolument pas que nous puissions apporter une réponse dans le cadre de ce débat.
En revanche, je ne comprends pas l’amendement n° 16, y compris du point de vue qui est le vôtre. De deux choses l’une : soit l’on soutient le rôle unique du juge, et une autorité administrative indépendante n’est pas nécessaire, soit l’on considère qu’il y a place pour l’autorité administrative, et le préfet est le mieux placé pour assumer ces responsabilités, compte tenu de son expérience, de l’histoire et des compétences qu’il exerce par ailleurs.
Autant, donc, je comprends le débat d’ensemble, autant je ne comprends pas que l’on veuille substituer une autorité administrative à celle qui existe déjà, avec l’institution préfectorale.
Pour ces raisons, madame Pasquet, j’émets un avis défavorable sur vos deux amendements, en espérant que vous comprendrez le sens de ma réponse.

Nous continuons de soutenir nos amendements, d’abord parce qu’ils ouvrent un débat qui, je l’espère, aura lieu un jour, ensuite parce qu’ils mettent en évidence une contradiction.
En effet, on affirme, d’un côté, que le juge des libertés et de la détention ne doit pas jouer un rôle démesuré, et notamment qu’il ne peut pas intervenir en ce qui concerne les soins, et, de l’autre, on autorise le préfet à intervenir sur les sorties d’essai, qui relèvent précisément des soins. Preuve que nous ne marchons pas tout à fait sur nos deux pieds !
Il faut savoir à quelle autorité on confie la compétence, ce qui ouvre, en effet, un vaste débat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 21, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3213-1, il est inséré un article L. 3213-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3213 -1-... – Les certificats et avis médicaux établis en application du présent chapitre sont clairs, précis, compréhensibles et motivés.
« Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.

Cet amendement vise à rationaliser les obligations qui incombent aux médecins, en tenant compte des contraintes de terrain. L’obligation de dactylographier les certificats médicaux n’est pas adaptée s’agissant de médecins extérieurs à l’établissement, qui peuvent intervenir le week-end, par exemple.
Nous considérons donc que l’obligation de rédiger des certificats clairs, précis et compréhensibles est suffisante.

Les amendements adoptés en commission ont déjà grandement simplifié la procédure d’établissement du certificat.
Par ailleurs, nous savons que certains médecins, comme du reste les membres d’autres professions, ont une écriture extrêmement difficile à déchiffrer ; pour l’avoir subie pendant plus de trente ans, je ne peux pas dire que la réalité n’est pas celle-là, et les médecins parmi nous le savent bien…
Sourires.

Cela dit, en ce qui concerne l’amendement n° 21, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.
Madame Deroche, je suis défavorable à votre amendement, pour deux raisons.
Premièrement, il est partiellement satisfait, dans la mesure où les conditions d’établissement des certificats sont déjà encadrées par la loi.
Deuxièmement, si les aspects sur lesquels porte votre amendement ne sont pas encadrés par la loi, c’est parce qu’ils sont de nature réglementaire : ils relèvent d’un décret en Conseil d’État. Nous pouvons discuter du contenu de ce décret, mais ses dispositions n’ont pas à figurer dans la loi.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 8 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 3222-3 du code de la santé publique est abrogé.

L'amendement n° 22, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette décision est prise conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé sur l’admission dans une unité pour malades difficiles. »
II. - Après l'article L. 3222-3, il est inséré un article L. 3222-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-3-... - I. - L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité.
« Cet arrêté est transmis sans délais au juge des libertés et de la détention. Le juge peut exercer son contrôle sur l’admission dans une unité pour malades difficiles au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :
« 1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
« 2° L’avis du psychiatre responsable de l’unité ;
« 3° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;
« 4° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
« En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.
« II. - En cas de désaccord du juge des libertés et de la détention, lequel peut intervenir à tout moment, l’admission en unité pour malades difficiles ne peut être prononcée ou maintenue.
« III. - Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.

Cet amendement, dont j’ai peu d’espoir qu’il sera adopté, vise à rétablir un statut législatif pour les UMD, les unités pour malades difficiles, et à organiser les conditions d’une supervision par le juge des libertés et de la détention de l’admission dans ces unités.
Il n’existe en France que onze UMD, offrant au total une capacité de 450 lits. Une admission dans une telle unité peut donc impliquer le transfert du patient dans un autre département, voire dans une autre région. Dans ces conditions, compte tenu de l’altération substantielle des conditions du séjour hospitalier, et quand bien même le patient serait déjà en soins sans consentement, il est indispensable pour la sécurité et la pérennité juridiques du dispositif qu’un cadre législatif soit préservé.
En outre, nous considérons que l’absence de régime législatif pour les UMD peut être un point de fragilité constitutionnelle.
Par ailleurs, il nous semble difficilement compréhensible que les dispositions réglementaires relatives aux UMD soient dépourvues de base légale, comme c’est le cas aujourd’hui.

Cet amendement nous mène au cœur de la discussion sur le caractère spécifique ou non des UMD.
Nous avons déjà fait valoir que ces unités constituent un outil thérapeutique ; on compare même le placement de certains patients en UMD à des admissions dans le domaine somatique, par exemple en soins intensifs de cardiologie. Le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs tout à fait compris. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un statut spécifique pour ces unités.
Du reste, les amendements que nous avons adoptés en commission offrent une sécurité juridique suffisante, et même renforcée par rapport à celle qui résultait du texte adopté par l’Assemblée nationale.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement – madame Deroche, vous vous y attendiez. En effet, l’un des axes majeurs de la proposition de loi est de considérer les UMD comme une modalité des soins n’appelant pas de définition juridique spécifique.
Il n’y a pas lieu de prévoir un statut particulier pour certains malades : ce principe est au cœur du dispositif proposé, et constitue l’une des ruptures que la proposition de loi introduit par rapport à la loi du 5 juillet 2011.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté.

L'amendement n° 23, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation d’une durée de trois ans est mise en œuvre visant à évaluer la possibilité de déroger aux articles L. 3211-2-2, L. 3212-4 et L 3213-1 du code de la santé publique afin de réduire le nombre de certificats médicaux précédant l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
L’objectif de cette expérimentation est de déterminer, tout en préservant un haut niveau de qualité des prises en charge des patients et de garantie de leurs libertés individuelles, si les certificats médicaux, actuellement obligatoires, pourraient être supprimés ou le moment de leur élaboration modifié. Les conditions de l’expérimentation et de désignation des établissements de santé qui réalisent l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement au terme de cette expérimentation, présentant une analyse bénéfices-risques des modifications ayant fait l’objet de l’expérimentation.
La parole est à Mme Catherine Deroche.

Je souhaite évoquer le problème, délicat, des certificats médicaux.
Nous proposons une expérimentation afin d'ouvrir de nouvelles approches sur ce sujet eu égard à toutes les contraintes qui existent et à toutes les difficultés en présence.

La commission demande le retrait de cet amendement, même si l'idée est intéressante. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Ces questions relèvent, selon nous, et pour de nombreuses raisons que j’ai citées dans mon intervention, d'une grande loi de santé publique.
Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
La proposition de loi supprime déjà deux des certificats existants et elle répond donc à votre volonté de simplification, que je comprends.
Nous devons trouver le juste équilibre entre la simplification et, malgré tout, l'existence de documents permettant de contrôler la manière dont se définissent les procédures de soins. Or il me semble que, à ce stade en tout cas, nous sommes arrivés à cet équilibre.
L'amendement n'est pas adopté.

TITRE III
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214 -1. – I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
« II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
« III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d’une unité pour mineurs dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. » ;
2° L’article L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » sont remplacées par les références : « , L. 3211-12 à L. 3211-12-4 et L. 3211-12-6 » ;
a bis) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : «, sauf si la personne détenue est hospitalisée au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée en consentant à ses soins ». –
Adopté.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
I. –
Non modifié
II. – L’article L. 3844-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
2° Le 7°est ainsi modifié :
a) Au début, les références : « Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9, au 2° et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3211-12, au dernier alinéa des I et IV » sont remplacées par les références : « Au premier alinéa du II de l’article L. 3211-2-1, au dernier alinéa de l’article L. 3211-9, au dernier alinéa du II de l’article L. 3211-12, à la première phrase du dernier alinéa du I » ;
b) Les références : « à la première phrase du deuxième alinéa du I et au 2° du III de l’article L. 3213-1, » et «, deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 3213-8 » sont supprimées ;
3° Au 9°, les deux dernières occurrences des mots : « à la première phrase du » sont remplacées par le mot : « au » ;
4° Au b du 11°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I » ;
5° Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3214–1 . – I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée.
« “II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
« “III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.” ; ».
III. –
Non modifié
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au début du 5°, la référence : « À la fin du second alinéa de l’article L. 3222-3, » est supprimée. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Les I et IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, ainsi que les articles 6 et 6 bis de la même loi entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
II. – Les 1° et 2° du I et le IV du même article L. 3211-12-1, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, sont applicables aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.
Le 3° du I du même article L. 3211-12-1, dans sa rédaction résultant du même article 5, est applicable aux décisions judiciaires prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ainsi qu’aux décisions prises par le juge des libertés et de la détention en application du I de l’article L. 3211-12-1 ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique à compter du 15 mars 2014. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1er et le 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention est saisi huit jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au même 3°.
III. –
Suppression maintenue
IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. –
Adopté.
(Suppression maintenue)

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission modifié, je donne la parole à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Puisque nous devons achever nos travaux en cette fin de matinée, monsieur le président, je me contenterai d’une courte explication de vote : les élus écologistes voteront, sans surprise, cette proposition de loi, qui représente une avancée, et remercient encore une fois le rapporteur pour le travail effectué.
Cela étant, permettez-moi de revenir in fine sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés nos débats, et par là j’entends viser non pas la qualité de votre présidence, monsieur le président, comme toujours excellente et qui nous aura permis de réaliser un bon travail, mais la précipitation qui a prévalu d'une façon générale.
Cette précipitation montre bien que nous avons intérêt à renforcer le règlement intérieur des assemblées et la capacité de ces dernières à s'organiser elles-mêmes, parce que, quel que soit le pouvoir en place, de droite comme de gauche – là n’est pas la question -, le Gouvernement souhaite agir le plus vite possible, parfois au détriment de la qualité du débat parlementaire.
À l'évidence, selon que l'on appartienne ou non à la majorité, l'on aura plus ou moins tendance à accepter cette précipitation, on le comprend, mais, malgré tout, nous en souffrons. Et, quels que soient les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, le travail du Parlement doit être respecté, ce qui exige que l’on ménage le temps nécessaire aux auditions des commissions et aux débats.
Voilà le message que je souhaitais adresser au Gouvernement. Je l'exhorte à fournir un effort afin que nous puissions travailler dans de bonnes conditions.

Pour ma part, je me réjouis que ce texte soit venu compléter celui de 2011 en le réformant sur certains points. Toutefois, je ressens une grande frustration. S’agissant de textes toujours délicats parce qu’ils concernent l'être humain dans sa maladie et dans sa maladie mentale, difficile à soigner, on le sait, et non moins difficile à saisir pour les personnes extérieures, j’aurais souhaité que nous puissions aborder beaucoup plus de sujets. Nous aurions certainement un grand intérêt à examiner un texte plus complet.
Pour ma part, je vais voter cette proposition de loi, mais je reste pour autant tout à fait inquiète quant au sort des malades difficiles, en particulier de ceux qui sont déclarés pénalement irresponsables, que je crains de voir sortir d'hospitalisation sans faire l'objet de soins par la suite. Ils ne sont certes pas tous dangereux, mais ils ont tout de même commis, généralement, des actes graves et ils peuvent, effectivement, sortir sans mesure de soin, puisqu’il n’y aura pas de juge pour les leur imposer. Cela m'inquiète beaucoup et, à mon sens, nous n’avons pas vraiment réglé la question.

Je l'ai dit au cours de la discussion générale et je le confirme, je déplore, comme mes collègues, les conditions de ce débat. Ce texte opère des avancées, que nous saluons, mais des problèmes persistent, notamment le statut des unités pour malades difficiles.
Nous voterons donc contre ce texte.

Je serai très bref, car, m’exprimant au nom du groupe socialiste lors de la discussion générale, j’ai dit notre soutien au texte adopté par la commission. Celle-ci n’ayant pas changé de position, le groupe socialiste votera ce texte.

Je tiens à rappeler, après Jean Desessard et d'autres, les conditions dans lesquelles nous avons dû travailler sur ce texte et dont nous reconnaissons, les uns et les autres, qu’elles auront été assez difficiles. Dans ce contexte, je tiens à saluer M. le rapporteur ainsi que l'équipe d'administrateurs qui a œuvré à ses côtés, dans des circonstances tout de même compliquées, sur un texte qui n’était lui-même pas facile, nous l'avons tous constaté au cours de la discussion.
Notre collègue Jacky le Menn, déjà sénateur en 2011, avait participé aux débats qui ont présidé à l'adoption de la loi de 2011 et ne partait donc pas de rien. Il a réussi, malgré tout, à réaliser un grand nombre d'auditions, auxquelles, malheureusement, peu d'entre nous, sénateurs et sénatrices, ont pu participer, du fait de conditions d'organisation assez délicates.
En outre, nous l'avons ressenti au cours du débat, il nous a manqué la saisine de la commission des lois. Celle-ci aurait pu nous apporter les éclairages nécessaires pour pouvoir véritablement appréhender des sujets tels que la place du préfet dans cette procédure.
Si je me réjouis, au nom de la commission des affaires sociales, que nous nous apprêtions à adopter ce texte, je constate qu’il apporte une partie des réponses attendues mais, et nous l'avons tous dit, une partie seulement.
Comme d'autres, les membres de la commission des affaires sociales attendent donc avec d’autant plus d’impatience ce grand texte sur la santé mentale qui devrait nous être soumis.
À titre personnel, je fais partie de celles et de ceux qui plaident pour une solution rapide, celle d’un chapitre complet qui, au sein de la grande loi de santé publique, serait consacré à la santé mentale.
Une autre école - M. Jacky le Menn nous disait ce matin qu’il était, lui, de l'école buissonnière… §- rassemble les partisans d’un texte spécifique en la matière. Mais je redoute que si, ce choix-là était fait, nous n’arrivions pas à aboutir à un texte sur la santé mentale dans un délai suffisamment rapide.
Madame la ministre, je vous remercie d'avoir pu éclairer ce matin nos débats. La commission des affaires sociales aurait aimé disposer d'un peu plus de temps et je me joins à l'appel de Jean Desessard : quels que soient les gouvernements, les délais sont trop contraints.
Évidemment, nous soutenons le gouvernement actuel, au sein de la majorité, mais il est tout de même parfois difficile de travailler ensemble dans de bonnes conditions.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
La proposition de loi est adoptée.
Monsieur le président, je tiens à vous remercier de votre présidence, qui nous aura permis de mener à bien la discussion de cette proposition de loi dans des délais rapides.
Je veux également remercier l'ensemble des sénatrices et des sénateurs pour la part active qu’ils ont prise à l'élaboration de ce texte. Je ne méconnais pas les conditions dans lesquelles vous avez eu à travailler, que je suis la première à déplorer, croyez-le bien, mesdames, messieurs les sénateurs.
Ce travail a été engagé à l'Assemblée nationale. Il s’est poursuivi ici de manière tout à fait active et positive. Nous avons trouvé, sur la plupart des propositions, un large consensus.
Il ne s'agit pas de prétendre que ce texte marque l'achèvement de la réflexion engagée par le Gouvernement en matière de santé mentale ; nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises.
Sur la forme des mesures législatives qui devront être élaborées, je suis, pour ma part, plutôt favorable à ce que des dispositions en la matière soient présentées dans le cadre d'une grande loi de santé publique. Au-delà des raisons que Mme la présidente de la commission des affaires sociales a évoquées, nombre de professionnels sont sensibles à l'idée de ne pas isoler les enjeux de santé mentale des questions plus générales de santé publique.
Je renouvelle donc mes remerciements au Sénat et je salue tout particulièrement le travail de M. le rapporteur, qui prouve qu’au Sénat rien n’est impossible !
Sourires.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.