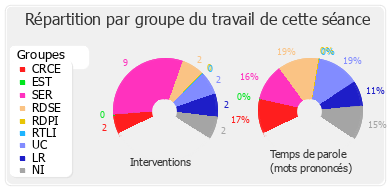Séance en hémicycle du 15 mai 2014 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Conventions internationales (voir le dossier)
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté (voir le dossier)
- Adoption définitive en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle l’examen de quatre projets de loi tendant à autoriser l’approbation de conventions internationales.
Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
Est autorisée l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (ensemble une annexe), signé à Paris le 12 juin 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (projet n° 499, texte de la commission n° 512, rapport n° 511).
Le projet de loi est adopté définitivement.
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à Ottawa le 14 mars 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (projet n° 500, texte de la commission n° 507, rapport n° 506).
Le projet de loi est adopté définitivement.
Est autorisée l’approbation de l’accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d’organisation internationale (ensemble un acte constitutif et trois annexes), signé à Montpellier le 13 septembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d’organisation internationale (projet n° 501, texte de la commission n° 509, rapport n° 508).
Le projet de loi est adopté définitivement.
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Montpellier le 4 mars 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (projet n° 502, texte de la commission n° 510, rapport n° 508).
Le projet de loi est adopté définitivement.

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à modifier la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (proposition n° 492, texte de la commission n° 498, rapport n° 497).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC . – M. le président de la commission des lois et Mme la rapporteur applaudissent également.

Il y a des raisons particulières d’applaudir Mme la garde des sceaux ces temps-ci !
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons pour l’examen en deuxième lecture d’une proposition de loi qui émane du Sénat, puisqu’elle a été déposée par Mme Catherine Tasca, membre de la commission des lois de cette assemblée. C’est donc un texte qui a été travaillé, étudié et adopté ici, faisant ensuite l’objet d’un examen poussé à l’Assemblée nationale, Mme la rapporteur, Laurence Dumont, s’étant très fortement impliquée.
Compte tenu de l’origine de ce texte, du travail produit aussi bien par Mme la rapporteur que par la commission des lois, et du fait qu’il s’agit d’une deuxième lecture, il ne me paraît pas nécessaire de revenir de façon exhaustive sur le contexte ou le contenu de la présente proposition de loi.
Je tiens simplement à faire droit à la constance avec laquelle le Sénat contribue aux libertés publiques et à l’amélioration des conditions de détention. Par sa culture du droit et par ses initiatives, le Sénat a en effet été la chambre qui a le plus amélioré, dans le temps, les conditions d’incarcération dans notre pays. Je pense notamment aux avancées réalisées sous la IIIe République : ainsi, MM. Hyest et Cabanel, dans le rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, créée en 2000, évoquent la commission d’enquête parlementaire créée en 1872 sur l’initiative du vicomte d’Haussonville – elle rassemblait de prestigieux sénateurs, comme Victor Schœlcher ou René Béranger – en vue d’étudier les établissements pénitentiaires, de faire un rapport à l’Assemblée sur l’état de ces établissements et de proposer les mesures en vue d’en améliorer le régime. Peu après, la loi de 1875 généralisait l’emprisonnement cellulaire dans les prisons départementales. En 1885, le sénateur Bérenger faisait voter les textes instituant la liberté conditionnelle et le sursis simple.
La continuité de cette politique s’est vérifiée à plusieurs reprises, notamment avec la commission d’enquête citée à l’instant constituée en 2000, dont le président était Jean-Jacques Hyest et le rapporteur Guy-Pierre Cabanel. Ce travail a abouti au dépôt d’une proposition de loi, votée en première lecture au Sénat, qui évoquait déjà la nécessité d’un contrôle général des lieux de privation de liberté.
Mais il y eut également une commission d’enquête mise en place à l’Assemblée nationale, avec pour président Louis Mermaz et pour rapporteur Jacques Floch, ainsi que toute une série d’éléments que j’ai évoqués lors de l’examen du texte en première lecture : je pense notamment à l’ouvrage du docteur Véronique Vasseur, qui, en frappant l’opinion publique, a créé les conditions de la réceptivité à la question des libertés publiques, de la prison en tant qu’espace de droit et du détenu en tant que sujet de droit.
Il est donc dans la logique, dans la trajectoire, mais aussi dans la dynamique de cette assemblée qu’une initiative parlementaire, ici prise par Catherine Tasca, nous conduise aujourd’hui à améliorer, à conforter et même à renforcer les missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 octobre 2007.
Fort logiquement, après les initiatives prises par le Sénat, cette évolution a également été permise, si ce n’est impulsée, par les juridictions aussi bien européennes que nationales. Pour ces dernières, ce fut le fait, d’abord, de la juridiction administrative, puis, progressivement, de la juridiction judiciaire.
Au milieu des années quatre-vingt-dix, la juridiction administrative a abandonné sa jurisprudence relative aux mesures d’ordre intérieur, qui conduisait les tribunaux administratifs et le Conseil d’État à considérer qu’ils n’avaient pas à se prononcer sur toute une série de mesures prises par l’administration pénitentiaire au motif qu’elles relevaient de l’ordre intérieur. La juridiction administrative a alors commencé à inclure dans son champ de compétences certains éléments relevant de la matière pénitentiaire. C’est ainsi qu’elle se prononce, par exemple, sur les mesures de transfert, sur les mesures d’isolement, ou encore sur la présence de l’avocat en détention ; elle se prononce, en somme, sur tout un ensemble de dispositions qui, jusqu’alors, étaient prises de façon quelque peu souveraine par l’administration pénitentiaire.
Cette évolution voit ensuite entrer en action la juridiction judiciaire. Cela se fait d’abord, bien entendu, par la loi Guigou de 2000, qui énoncera que certaines décisions prises par le juge d’application des peines sont non pas seulement des mesures d’administration judiciaire, mais également des ordonnances ou des jugements, par conséquent susceptibles de recours. La juridictionnalisation de l’application des peines est donc en marche depuis près d’une quinzaine d’années.
Au cœur de toutes ces dynamiques, la nécessité du contrôle général des lieux de privation de liberté paraît bien installée, même si je n’ose pas encore dire que le processus est achevé. L’institution a fait ses preuves, sous l’impulsion particulière de Jean-Marie Delarue, dont les mérites ont été cités avec force aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.
C’est sur la base de la réflexion conduite par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté que nous avons nourri notre propre pensée, et que vous avez pu, mesdames, messieurs les sénateurs, élaborer la présente proposition de loi.
Ce texte ajoute un élément supplémentaire de rupture avec la perception de l’ordre carcéral comme ordre très particulier : il reconnaît la prison comme espace de droit et le détenu comme sujet de droit. J’évoquais voilà un instant les mesures prises dans les années quatre-vingt ; je pense notamment à la mesure de suppression des dispositifs d’isolement dans les parloirs, que j’ai déjà mentionnée en ces lieux et qu’il me paraît significatif de rappeler afin de ne pas oublier ce qui existait alors : grâce à cette mesure, les familles venant rendre visite à un détenu peuvent désormais s’en approcher, le toucher, alors que c’était absolument impossible jusqu’alors.
Ce texte de loi vient en quelque sorte parachever cette évolution réelle, importante, même s’il restera sans doute encore des choses à faire. Mais c’est le propre de la vie humaine et de la vie en société, mesdames, messieurs les sénateurs, que de prévoir, sur la base de principes clairement établis, la façon dont les choses peuvent évoluer et de préparer l’opinion publique à accepter ces changements.
J’en viens aux principales dispositions désormais contenues dans la présente proposition de loi, ne citant que celles qui ont été modifiées par l’Assemblée nationale. Je pense tout d’abord à la possibilité pour les députés européens élus en France de saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, alors que cette compétence était jusqu’alors réservée au Premier ministre, aux membres du Gouvernement, aux membres du Parlement ou au Défenseur des droits. D’ailleurs, c’est très logique : la loi de 2000 les avait associés à la possibilité, reconnue aux parlementaires français, de visiter de manière inopinée nos établissements pénitentiaires.
Du fait de la présente proposition de loi, le Contrôleur général pourra désormais avoir accès aux procès-verbaux équivalents aux procès-verbaux de garde à vue, c'est-à-dire ceux qui sont dressés dans les autres lieux de privation de liberté, que la privation soit exercée sous la responsabilité de la police, de la gendarmerie ou de la douane. Je pense notamment aux lieux de retenue pour vérification du droit au séjour ou pour vérification d’identité.
Le Contrôleur général pourra également émettre un avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté.
En outre, l’Assemblée nationale a introduit une modification relative au délit d’entrave. Alors que vous aviez prévu à cet égard un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, les députés ont retenu les 15 000 euros d’amende et supprimé l’année d’emprisonnement. Ils ont cependant étendu le champ d’application du délit aux représailles. Nous avons donc, en amont, le délit d’entrave et, en aval, les éventuelles représailles. Ce sont les principales dispositions qui ont été amendées.
Je le disais, la proposition de loi parachève une dynamique, même si elle ne l’achève pas. C’est une dynamique importante, celle qui consiste à poser le principe de limitation aux droits fondamentaux. Le détenu fait l’objet d’une restriction, voire d’une suppression de liberté, prononcée par l’institution judiciaire. Mais, dans une décision du 25 avril 2014 sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a lui-même rappelé que les droits et libertés garantis constitutionnellement s’appliquaient également aux détenus, dans la limite évidemment des exigences liées à l’exercice des missions publiques de l’administration pénitentiaire.
Nous sommes donc totalement dans une logique d’équilibre entre le respect des droits fondamentaux des détenus, qui ne peuvent être limités que de manière strictement nécessaire, le besoin d’impliquer le détenu dans la préparation de sa sortie et, bien entendu, les exigences liées à l’exercice de la mission publique qui incombe à l’administration pénitentiaire.
Il importe de le rappeler, il y a là une évolution juridique absolument indispensable, non seulement pour nous conformer à notre État de droit, mais aussi pour faire de la prison une institution républicaine et un lieu où l’incarcération est utile.
Il ne sert à rien de reconnaître – les membres de la Haute Assemblée savent très bien le faire depuis plusieurs années, et nous le faisons également au sein du Gouvernement – l’importance et la qualité de l’action menée par les personnels pénitentiaires, mais aussi la difficulté de leurs conditions de travail à l’intérieur des établissements si, par la loi ou les politiques publiques, nous contribuons à rendre l’exercice de leurs missions encore plus compliqué !
Il faut que le temps d’incarcération soit utile. Il faut que le détenu soit acteur de l’exécution de sa peine. Il faut que le détenu soit fortement impliqué dans la préparation de sa sortie, afin de prévenir la récidive. Pour cela, il est indispensable de faire en sorte par la loi et les politiques publiques que la prison soit bien une institution républicaine et s’inscrive bien dans un État de droit.
L’action menée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté y contribue. Les dispositions nouvelles que vous allez accorder à l’institution sont de nature à améliorer encore l’exécution de sa tâche. §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture la proposition de loi que j’ai eu l’honneur de déposer voilà quelques semaines, avec nos collègues membres du groupe socialiste et apparentés. Ce texte vise à apporter plusieurs modifications à la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je vous remercie d’avoir si bien inscrit cette initiative dans la longue histoire parlementaire, madame la garde des sceaux.
Compte tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire et de l’interruption des travaux parlementaires due aux élections municipales, je me réjouis que cette proposition de loi nous revienne aussi vite, moins de quatre mois après un premier vote au Sénat acquis à l’unanimité. Je veux saluer ici l’engagement de l’Assemblée nationale, en particulier de la rapporteur de la commission des lois, Laurence Dumont, et celui du Gouvernement, qui a accepté d’inscrire ce texte sur son ordre du jour prioritaire.
Comme vous vous en souvenez, la présente proposition de loi vise à tirer les enseignements des six premières années d’existence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en répondant très concrètement à un certain nombre de difficultés ou de lacunes identifiées par Jean-Marie Delarue. Le texte renforcera les prérogatives du Contrôleur général, en donnant un cadre légal aux enquêtes que celui-ci mène actuellement sur le fondement de l’article 6 de la loi du 30 octobre 2007 et en lui permettant d’accéder à davantage d’informations, notamment, sous certaines conditions évidemment très encadrées, à des informations couvertes par le secret médical. L’institution disposera dorénavant à cet effet d’une possibilité de mise en demeure, sanctionnée le cas échéant par un délit d’entrave à l’action du Contrôleur. Cette dernière mesure permettra également de mieux protéger les interlocuteurs du Contrôleur général contre toute forme de sanctions ou de représailles visant aussi bien des personnes privées de liberté que des membres des personnels exerçant dans ces lieux.
Alors que le nombre de personnes détenues vient de franchir au 1er avril un nouveau seuil – 68 859 détenus pour 57 680 places, soit une augmentation de la population carcérale de 2 % sur un an –, l’existence d’une autorité indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et dotée des prérogatives nécessaires pour exercer pleinement sa mission est plus que jamais indispensable.
Sur l’initiative de sa commission des lois et de sa rapporteur, Laurence Dumont, l’Assemblée nationale a amélioré sur cinq points le texte voté par la Haute Assemblée en première lecture.
Premièrement, les députés ont d’abord apporté plusieurs clarifications, notamment pour que le Contrôleur général puisse disposer des mêmes prérogatives dans le cadre des vérifications sur place, dont les modalités sont détaillées dans le nouvel article 6-1 de la loi du 30 octobre 2007, que dans celui des visites de contrôle fondées sur l’article 8. Un nouvel article 8-1 détaille en ce sens les conditions communes dans lesquelles s’exercent ces vérifications et visites.
Plusieurs améliorations rédactionnelles ont également été apportées pour lever d’éventuelles ambiguïtés ou préciser le texte adopté, concernant en particulier la qualité des collaborateurs du Contrôleur général habilités à accéder à des informations couvertes par le secret médical.
Deuxièmement, alors que notre proposition de loi ouvrait au Contrôleur général la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux de déroulement de garde à vue – Mme la garde des sceaux vient de le rappeler –, l’Assemblée nationale a élargi ces dispositions à l’ensemble des procès-verbaux relatifs au déroulement d’une mesure privative de liberté mise en œuvre par la police, par la gendarmerie ou par la douane. Cela permettra d’inclure, outre les procès-verbaux de déroulement de garde à vue, les procès-verbaux de retenue pour vérification du droit au séjour d’une personne de nationalité étrangère ou les procès-verbaux de retenue douanière, par exemple.
Troisièmement, les députés ont complété la proposition de loi pour permettre expressément au Contrôleur général d’adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté.
Une telle précision n’est pas anodine. Les décisions, prises voilà quelques années dans le cadre du programme « 13 200 places », de construire des établissements pénitentiaires surdimensionnés ou d’implanter des centres de semi-liberté dans des lieux peu faciles d’accès montrent à quel point il aurait été pertinent d’avoir l’avis du Contrôleur général avant de procéder à de telles opérations, du reste fort coûteuses, comme l’a déjà souligné notre collègue Jean-René Lecerf dans ses différents avis budgétaires.

Quatrièmement, nos collègues députés ont modifié la rédaction du nouveau délit d’entrave, afin, d’une part, de supprimer la peine d’emprisonnement encourue, ne laissant ainsi subsister qu’une peine correctionnelle de 15 000 euros d’amende, et, d’autre part, d’inclure dans le champ de cette nouvelle infraction, en plus des comportements manifestant une opposition aux opérations de contrôle ou de vérifications, le fait de sanctionner une personne pour les liens qu’elle aurait établis avec le Contrôleur général ou pour les pièces ou les informations qu’elle lui aurait fournies.
Un tel élargissement permettra de donner plus de poids à l’article 2 de la proposition de loi, qui pose le principe de nullité de toute sanction prononcée à l’encontre d’une personne qui aurait établi des liens avec le Contrôleur général ou qui lui aurait fourni des informations ou des pièces.
En pratique, la suppression de la peine d’emprisonnement interdira le placement en garde à vue de l’intéressé, mais n’empêchera pas les poursuites devant le tribunal correctionnel. L’Assemblée nationale a jugé qu’une peine d’emprisonnement n’était pas justifiée en l’espèce. En effet, il est sans doute temps – et le travail accompli par Mme la garde des sceaux depuis plusieurs mois nous y invite – de cesser de considérer la peine d’emprisonnement comme la peine de référence pour toute infraction pénale.
Dans ce cas particulier, la suppression de la peine d’emprisonnement a toutefois fait réagir plusieurs membres de la commission, qui ont considéré nécessaire de marquer la gravité que revêt pour le législateur le fait de faire entrave aux missions du Contrôleur général. J’insiste également sur un point : la suppression pour ce délit particulier de la peine d’emprisonnement ne doit pas laisser penser que l’entrave à l’action du Contrôleur général des lieux de privation de liberté serait moins grave, par exemple, que l’entrave à l’action de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL. Aujourd’hui, les différents délits d’entrave prévus par notre droit sont punis de peines différentes. Par cohérence, il serait sans doute souhaitable de repenser dans un avenir proche ces peines et de les aligner sur un quantum commun.
Cinquièmement, sur l’initiative de notre collègue député Sergio Coronado, l’Assemblée nationale a modifié la loi du 30 octobre 2007 pour permettre expressément aux députés européens élus en France de saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté – vous l’avez souligné à juste titre, madame la garde des sceaux.
Sur ma proposition, la commission des lois a approuvé ce qui a été fait par l’Assemblée nationale pour compléter et pour renforcer le contenu du texte. Tout cela concourt en effet à consolider l’institution du Contrôleur général, qui, en six ans d’exercice, a apporté la preuve de son utilité et de sa légitimité en tant qu’autorité indépendante. De ce point de vue, l’expérience nous montre à quel point le Sénat a été bien inspiré en refusant l’intégration du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans l’institution qu’est le Défenseur des droits. Les missions de l’un et de l’autre sont non pas concurrentes, mais bien complémentaires. Elles mériteraient sans doute d’être mieux articulées. C’est le sens d’une convention signée en 2011 par les deux institutions.
Je tiens également, à mon tour, à rendre hommage à la manière dont Jean-Marie Delarue a contribué à façonner cette nouvelle institution, grâce à son sens du dialogue, à sa rigueur, à son attachement sans failles aux principes fondateurs de notre République et à son incontestable indépendance. Je forme le vœu que son successeur, dont la désignation devra être prochainement soumise à l’approbation des commissions des lois des deux assemblées, fasse preuve des mêmes qualités et inscrive ainsi dans la durée la légitimité de l’institution du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
À ce stade de l’examen parlementaire, nous avons estimé que cette proposition de loi comportait désormais l’ensemble des mesures nécessaires pour répondre aux difficultés ou lacunes identifiées au cours des six premières années de pratique. Le texte nous paraît parvenu à un équilibre satisfaisant. Il permettra de renforcer le dispositif de protection des droits des personnes privées de liberté, tout comme celui des conditions de travail des personnels qui en ont la charge et qui exercent trop souvent leur métier dans des conditions éprouvantes.
Compte tenu, en outre, de l’intérêt d’une entrée en vigueur rapide des dispositions de ce texte afin de permettre au successeur de Jean-Marie Delarue, dont le mandat arrive à expiration le 13 juin prochain, de s’en saisir pleinement, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d’adopter cette proposition de loi dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, ouvrant ainsi la voie à un vote conforme et à une promulgation rapide. §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la loi du 30 octobre 2007 a mis en place une autorité administrative indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, et plus spécifiquement de s’assurer du respect des droits fondamentaux de ces dernières.
Sur le principe, nous étions bien évidemment favorables à l’instauration d’un tel mécanisme national de prévention des traitements inhumains et dégradants, conformément à l’engagement pris par notre pays auprès des Nations unies le 16 septembre 2005.
Concernant cependant les modalités de sa mise en œuvre telles que décidées dans le projet de loi qui nous avait été soumis en 2007, nous avions formulé certaines critiques. Nous jugions en effet que l’on nous proposait un texte a minima et avions donc déposé un certain nombre d’amendements qui tendaient à faire de cette structure de contrôle une autorité incontestable, impartiale et indépendante, sur les plans tant politique que financier.
Depuis, les différents rapports de M. Jean-Marie Delarue ont également mis en exergue les faiblesses de cette institution. Leur présentation a été l’occasion de préconiser des mesures nécessaires pour conforter la place et le rôle du Contrôleur général, que personne ne songe aujourd’hui à remettre en cause.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui prévoit, comme l’a rappelé Mme Catherine Tasca, qui en est à la fois l’auteur et le rapporteur, de reprendre un certain nombre de ces recommandations, afin précisément de renforcer le cadre légal de l’action du Contrôleur général, de pallier les difficultés rencontrées par ce dernier dans l’exercice de ses missions, d’aligner un certain nombre de ses prérogatives sur celles qui ont été attribuées, postérieurement à sa création, à certaines autorités indépendantes, en particulier au Défenseur des droits, et de consacrer dans la loi un certain nombre de bonnes pratiques mises en place par M. Delarue depuis son entrée en fonctions, afin de les pérenniser.
L’Assemblée nationale a encore amélioré le texte voté voilà quelques semaines par notre assemblée. Outre qu’il aura la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux de garde à vue, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pourra aussi consulter les procès-verbaux de déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour d’une personne de nationalité étrangère ou encore les procès-verbaux de retenue douanière, ce que nous approuvons évidemment.
Avec le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pourra aussi s’adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté. Permettez-moi de le dire, son avis aurait été utile lors de l’examen en 2012 de la loi de programmation relative à l’exécution des peines. Ce texte a en effet permis la mise en place, sous forme de partenariat public-privé, d’un nouveau programme immobilier destiné à porter les capacités du parc pénitentiaire à 80 000 places, ce en totale contradiction avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et la priorité affirmée alors de l’aménagement des peines de prison, en particulier des plus courtes d’entre elles.
Je rappelle à ce sujet que nous avons déposé une proposition de loi visant à abroger cette loi de 2012, contre laquelle l’ensemble de la gauche s’était prononcée.
Nonobstant cette parenthèse, nous approuvons, je le redis, l’ensemble des dispositions figurant dans la présente proposition de loi.
L’action du Contrôleur général contribue à alerter sur la situation des personnes privées de liberté dans notre pays. La publication des nombreux avis et rapports nous rappelle que la situation des prisons françaises, qui a motivé la mise en place de cette nouvelle autorité en 2007, a finalement peu évolué. Malheureusement, les constats demeurent trop souvent les mêmes : surpopulation carcérale et situation alarmante dans le secteur psychiatrique, les centres de rétention ou les zones d’attente.
Pour que le travail du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne reste pas lettre morte, il relève de la compétence du législateur d’agir pour que la loi pénitentiaire soit appliquée réellement dans son intégralité.
Je souhaite ainsi que le Parlement puisse renforcer les dispositions de la réforme pénale, dont nous débattrons bientôt, afin qu’il soit définitivement mis fin, dans notre pays, à des conditions de détention trop souvent indignes. §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, rapidement inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, qui a à son tour apporté quelques précisions bienvenues – Mme Tasca vient de le rappeler à l’instant –, la proposition de loi modifiant la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté doit mettre fin aux distorsions parfois dommageables constatées entre la loi et la pratique.
Cette proposition de loi constitue une avancée démocratique, faite tout ensemble de précisions utiles, de la codification de pratiques déjà ancrées, mais aussi du renforcement nécessaire de certaines prérogatives, afin de permettre au Contrôleur général de ne jamais être entravé dans l’exercice de sa mission, ô combien essentielle : prévenir les atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté et s’assurer que les droits intangibles inhérents à la dignité humaine sont respectés, même au sein des lieux de privation de liberté.
Au cours de six années d’existence, le Contrôleur général, en la personne de M. Delarue auquel il faut de nouveau rendre hommage, et ses collaborateurs ont visité plus de 800 établissements, et même contre-visité certains d’entre eux, mesurant à cette occasion la réactivité des autorités responsables à la suite des recommandations faites précédemment.
Si le Contrôleur général a eu quelques occasions de se féliciter des mesures prises immédiatement par des chefs d’établissement et de la disponibilité de ces derniers à son égard, ainsi que des 69 réponses ministérielles qu’il a reçues en 2012, il a aussi souligné la difficulté de sa mission au regard des délais et des conséquences effectives sur la situation des détenus.
Il est ainsi significatif qu’au mois d’avril dernier le Contrôleur général ait reproché à l’administration de la prison pour mineurs de Villeneuve-lès-Maguelone de n’avoir pas tenu compte de recommandations formulées cinq ans auparavant et d’avoir laissé se développer un sentiment d’impunité des individus violents.
Alors que le mandat, non renouvelable, de M. Delarue touche à son terme, les modifications proposées aujourd’hui constituent des réponses adéquates et réfléchies aux difficultés techniques et juridiques issues de la pratique quotidienne de la mission du Contrôleur général dans les lieux de privation de liberté.
À ce titre, la création d’un délit d’entrave, l’extension de ce délit aux représailles, la protection des correspondances avec les personnes détenues, ainsi que celle du personnel entrant en contact avec le Contrôleur général, permettront de conforter de manière plus sereine la présence de cette institution dans notre paysage démocratique et d’aboutir, en quelque sorte, à sa normalisation.
Cela a été dit, les députés européens élus en France sont intégrés dans le dispositif juridique et pourront saisir l’institution.
Systématiquement, désormais, les ministres seront tenus de répondre dans un délai déterminé au Contrôleur général, qui sera informé des suites données à ses démarches par le procureur de la République ou l’autorité disciplinaire.
Par ailleurs, parce qu’il rencontre régulièrement des obstacles dans sa recherche de la véracité des faits, la proposition de loi lui permettra d’accéder aux procès-verbaux relatifs aux mesures privatives de liberté, de mettre en demeure les personnes intéressées de répondre à ses demandes d’informations ou de documents, mais aussi de lever dans certains cas le secret médical, avec l’autorisation de la personne privée de liberté, et ce dans le respect du droit à la vie privée de la personne concernée.
Enfin, si l’article 10 de la loi du 30 octobre 2007 prévoyait déjà la possibilité pour le Contrôleur général d’envoyer aux ministres compétents des conclusions et recommandations après chaque visite d’établissement, ainsi que des avis et propositions, désormais, la loi précisera également qu’il pourra « adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté ».
En conclusion, certaines recommandations du Contrôleur général sont restées lettre morte. Parmi elles, certaines sont peu coûteuses – je pense notamment au vouvoiement systématique des détenus –, d’autres doivent résulter d’une modification des pratiques administratives actuelles, et d’autres encore vont dans le sens d’une prise en charge plus attentive, qui est aussi la clé, comme l’a fait remarquer le Contrôleur général, d’une meilleure sécurité.
Mais alors que la sagesse nous conseille, selon la formule célèbre, de « ne légiférer qu’en tremblant », nous pensons pour notre part avoir résorbé les distorsions qui pouvaient exister entre la loi de 2007 et la pratique effective de la mission du Contrôleur général.
Dans ces conditions, nous pouvons, me semble-t-il, légiférer sans trembler ! En 2011, le Sénat s’était opposé à l’intégration du Contrôleur général au sein du Défenseur des droits ; en 2014, il participe au renforcement de cette autorité et réitère son soutien sans faille à une institution qui honore notre démocratie.
Le groupe du RDSE se félicite ainsi de l’initiative coordonnée de Mme le rapporteur Catherine Tasca, à laquelle je rends hommage, et votera cette proposition de loi avec une conviction réaffirmée. §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme j’ai eu l’occasion de le dire au cours de nos précédents débats, la nécessité d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est plus à démontrer.
Le franchissement d’un nouveau seuil, au 1er avril 2014, avec 68 859 personnes écrouées pour 57 680 places en établissement pénitentiaire, vient renforcer cette certitude. L’existence d’une autorité indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et dotée des prérogatives nécessaires pour exercer pleinement sa mission est plus que jamais indispensable.
Le groupe écologiste a voté ce texte avec conviction en première lecture, et nous ferons de même aujourd’hui.
Je veux saluer ici le travail des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale, qui ont largement contribué à enrichir la proposition de loi qui nous est soumise.
Ainsi, si le Sénat avait ouvert au Contrôleur général la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux de garde à vue, la commission des lois de l’Assemblée nationale est allée plus loin en élargissant cette disposition à l’ensemble des procès-verbaux relatifs au déroulement d’une mesure privative de liberté. Cela permettra notamment d’inclure les procès-verbaux de déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour d’une personne de nationalité étrangère.
Nous nous réjouissons également que, sur l’initiative des députés écologistes, la possibilité pour les députés européens élus en France de saisir le Contrôleur général ait été introduite dans la proposition de loi ; Mme la rapporteur a mentionné cette disposition. Je salue à cet égard mon collègue et ami du groupe écologiste de l’Assemblée nationale, Sergio Coronado. Il s’agit sans aucun doute, à quelques jours des élections européennes, d’une avancée importante.
Le travail accompli depuis six ans par le Contrôleur général et ses équipes est immense, et ce sont, en moyenne, 151 lieux de privation de liberté qui ont été visités chaque année.
Mais il me semble que, si l’hommage unanime est amplement mérité et que nous ne pouvons que nous réjouir de l’adoption prochaine de la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui, la défense des droits fondamentaux des personnes privées de liberté doit rester notre priorité.
Les derniers rapports du Contrôleur général sont édifiants, et il relève de notre responsabilité de législateurs de nous en saisir pour faire avancer le droit et les droits dans notre pays.
Ainsi, le 23 avril dernier, le Contrôleur général publiait-il en urgence des recommandations sur le quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. À la suite de signalements de violences entre mineurs, deux contrôleurs se sont rendus sur place en février dernier. Ils ont pu alors constater la gravité des violences qui se déroulent au quartier des mineurs.
Ce même 23 avril, le Contrôleur général publiait un avis relatif à l’encellulement individuel dans les établissements pénitentiaires. Ici encore, le constat est grave. L’encellulement individuel, réservé, sauf dérogation, aux prévenus en détention provisoire et aux condamnés, la nuit seulement, n’est pas mis œuvre dans les maisons d’arrêt en raison de la surpopulation.
Énumérant les « palliatifs » imaginés par le législateur pour repousser l’application de ce principe jusqu’à novembre 2014, le Contrôleur général propose de commencer par « rétablir l’encellulement individuel au bénéfice de certaines catégories de détenus », notamment les personnes handicapées, les personnes âgées de plus de 65 ans, les détenus souffrant d’affections mentales ou les étrangers ne comprenant pas le français.
Dans le même sens, Jean-Marie Delarue encourage à « redonner un sens plus restreint à l’usage du quartier d’isolement », qui, écrit-il en substance, ne doit être utilisé que pour des personnes dangereuses, et non pour des détenus menacés.
Je m’arrêterai ici, nul ne pouvant prétendre à l’exhaustivité en matière de mesures à mettre en œuvre pour défendre les droits fondamentaux des personnes privées de liberté...
Madame la ministre, mes chers collègues, les sénateurs du groupe écologiste voteront ce texte avec enthousiasme et conviction, mais seront attentifs, notamment lors de l’examen du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, à ce que l’ensemble de ces recommandations ne tombent pas dans l’oubli. §

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, à bien des égards, cette proposition de loi visant à modifier la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’avère exemplaire.
Elle est exemplaire quant au temps qui aura été nécessaire pour son adoption : elle nous revient de l’Assemblée nationale moins de quatre mois après le vote en première lecture du Sénat. J’ai connu tant de contre-exemples qu’il s’agit là d’un premier motif de satisfaction ; c’est aussi la preuve que le bicamérisme peut fonctionner efficacement lorsque chacun prend ses responsabilités.
Elle est exemplaire dans l’unanimité qui nous a rassemblés en première lecture et qui devrait se manifester à nouveau aujourd’hui.
Sur des questions de cette nature qui touchent à la dignité des personnes privées de liberté comme aux garanties accordées aux membres des personnels qui les entourent, cet accord, ce consensus, sur l’ensemble des travées et au-delà des orientations politiques de chacun, n’est-il pas révélateur de la capacité de rassemblement des différentes familles et courants que nous représentons lorsque sont en jeu des intérêts supérieurs de notre démocratie ?
Aux antipodes de ceux qui agitent le drapeau de l’infamie ou entonnent l’air de la calomnie lorsqu’il arrive aux formations républicaines de la gauche, de la droite ou du centre d’unir leurs efforts, je suis de ceux qui apprécient ces moments trop rares de notre vie politique, que j’aimerais davantage partager, notamment en matière de politique pénale et particulièrement face à l’univers carcéral.
Cette proposition de loi est exemplaire également dans la continuité républicaine qui a vu la majorité d’hier proposer l’institution du contrôle général des lieux de prévention de liberté, le président d’hier proposer le nom de Jean-Marie Delarue et les commissions des lois d’hier approuver ce choix, tandis que les majorités différentes d’aujourd’hui nous amènent à améliorer, au vu de l’expérience, la législation de 2007 pour donner au successeur de Jean-Marie Delarue des armes nouvelles afin d’améliorer la protection des droits et de la dignité des personnes privées de liberté.
Comment ne pas saluer aussi une fois encore la gouvernance de Jean-Marie Delarue ? Il était essentiel pour la crédibilité, le rayonnement et l’efficacité de cette autorité administrative indépendante et pour assurer sa pérennité que son premier titulaire lui donne toute sa dimension avec hauteur de vue, intelligence, compétence et discernement, pour reprendre les mots que vous avez utilisés, chère madame le rapporteur.
Cette proposition de loi est exemplaire enfin parce qu’il s’agit, dans le monde carcéral et au-delà, d’une des préoccupations majeures du Sénat. J’ai toujours considéré que notre assemblée était investie de deux responsabilités prioritaires, particulières, auxquelles nous étions tous indéfectiblement attachés : la représentation des collectivités territoriales de par la Constitution et la confiance de nos électeurs, mais aussi la défense des libertés de par toute notre histoire.
Le rôle essentiel joué par le Sénat dans la prise de conscience des drames de l’univers carcéral, du rapport intitulé Prisons : une humiliation pour la République de la commission d’enquête de 2000 sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, présidée par Jean-Jacques Hyest, à la loi pénitentiaire de 2009, pour rester dans la période récente, atteste de l’ardente obligation qui est la nôtre en ce domaine. Je ne reviendrai pas sur le rôle du Sénat sous la IIIe République, Mme le garde des sceaux l’ayant fait avec beaucoup plus de compétences que je ne pourrais en avoir.
J’ai aimé, madame le rapporteur, vous entendre dire hier, en commission des lois, que c’était une force pour l’actuelle réforme relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines que de s’adosser à la loi pénitentiaire.
L’expérience des six premières années d’activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a révélé un certain nombre de difficultés et de dysfonctionnements de nature à entraver l’efficacité de son action. Cette proposition de loi y porte largement remède.
D’autres autorités administratives indépendantes, comme le Défenseur des droits, ont été créées et dotées de prérogatives nouvelles qu’il convenait de transposer.
Sans l’intervention du Sénat – on l’a rappelé –, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté serait intégré au Défenseur des droits très prochainement – au 1er juillet 2014 –, à la fin du mandat de Jean-Marie Delarue.
Cela eût été une erreur tant les missions de ces deux autorités, pour être complémentaires, n’en sont pas moins profondément différentes :…

… « démarche de contrôle et de prévention, au moyen de nombreuses visites sur place », pour l’une, « autorité que peuvent saisir les personnes s’estimant lésées dans leurs droits », pour l’autre, comme l’a écrit notre collègue Patrice Gélard, dans son rapport sur le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs au Défenseur des droits.
Même si l’on peut penser – ce n’est d’ailleurs pas mon opinion – que cette fusion pourrait intervenir lorsque les problèmes liés à l’univers carcéral – surpopulation, maladies mentales, oisiveté, insécurité, caïdat, manque de moyens en personnel… – auront été surmontés, force est de constater que nous en sommes encore bien loin aujourd’hui !
Enfin, cette proposition de loi donne une assise législative aux pratiques mises en place au cours de son mandat par Jean-Marie Delarue, assurant ainsi leur pérennité et le maintien de ces avancées, demain, lorsqu’une ou un successeur qui ne pourra, par hypothèse – tout au moins au départ –, exercer la même autorité morale aura été nommé.
On pourrait bien sûr regretter que certaines évolutions n’aient pas été davantage approfondies, en matière d’accès à des informations couvertes par le secret médical, par exemple. La surpopulation carcérale, l’impossibilité totale d’assurer l’encellulement individuel dans les maisons d’arrêt, la dangerosité d’un certain nombre de malades mentaux et la vulnérabilité de beaucoup d’autres conduisent à s’interroger sur la possibilité d’accéder à de telles informations pour certaines personnes accusées ou suspectées de violences sur leur codétenu, sans le consentement de ces mêmes personnes.
On pourrait s’interroger aussi sur le bien-fondé de la suppression par l’Assemblée nationale de la peine d’emprisonnement pour le nouveau délit d’entrave, ne laissant subsister qu’une amende de 15 000 euros. Comme l’exprimait notre collègue Jean-Pierre Michel en commission des lois, « s’opposer à l’exécution de la loi mérite d’être sévèrement sanctionné ».
Mais soyons honnêtes, les députés ont également amélioré notre rédaction de première lecture sur de nombreux points : droit pour le Contrôleur général de donner son avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté, ce qui s’avère incontestablement plus utile que la seule possibilité de constater a posteriori les erreurs commises ; possibilité pour les députés européens élus en France – sujet d’actualité, s’il en est ! – de saisir le Contrôleur général ; élargissement à l’ensemble des mesures privatives de liberté, qu’elles soient mises en œuvre par la police, par la gendarmerie ou par la douane, de la possibilité donnée au Contrôleur général de prendre connaissance de l’ensemble des procès-verbaux qui s’y rapportent.
Et puis, ne dit-on pas que le mieux est l’ennemi du bien ? Le vote conforme qui devrait intervenir ce matin nous mettra à l’abri des vicissitudes liées à un ordre du jour parlementaire d’autant plus surchargé que nous avons depuis trop longtemps oublié de ne toucher aux lois que d’une main tremblante pour ne plus laisser parfois à l’encre du Journal officiel le temps de sécher et aux réformes votées le temps de s’appliquer. Éviter à l’Assemblée nationale d’avoir à examiner le texte en deuxième lecture relève donc de la sagesse.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission de lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous sommes tous conscients du caractère très préoccupant de la situation carcérale dans notre pays, laquelle ne va d’ailleurs pas en s’améliorant : le nombre de détenus est supérieur de 34 % à celui qui était constaté en 2002, 44 établissements ont une densité supérieure ou égale à 150 %, et 8 d’entre eux une densité supérieure à 200 %...
Dans ce contexte, l’existence d’un Contrôleur général doté de moyens supplémentaires est absolument primordiale. C’est l’objet du texte que nous examinons ce matin en deuxième lecture.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité protectrice des libertés qui a su trouver sa place dans nos institutions, même si, au quotidien, dans l’accomplissement de ses fonctions, il doit souvent jouer l’équilibriste entre le respect de la dignité de la personne humaine et les considérations d’ordre public.
Les débats sur le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits avaient permis de réaffirmer l’indépendance du Contrôleur général, puisque le Sénat avait rejeté son intégration dans le champ de compétences du Défenseur des droits. Cette position avait été portée par la commission des lois et son rapporteur de l’époque, le doyen Patrice Gélard.
Comme l’ensemble de mes collègues, je tiens ici à saluer la qualité du travail réalisé depuis 2008 par M. Delarue. Le bilan des six années d’activité du Contrôleur général est largement positif. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et c’est satisfaisant en termes d’efficacité des politiques publiques : plus de 800 établissements de privation de liberté ont été visités depuis 2008 – les locaux de garde à vue arrivent en tête et représentent plus du tiers des visites réalisées –, 4 000 lettres ont été traitées en 2013 et suivies pour près d’un tiers d’entre elles par une enquête, et, toujours pour l’année 2013, la situation de 1 683 personnes a été portée pour la première fois à la connaissance du Contrôleur général, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2012.
Dans un contexte inédit de surpopulation carcérale et de détérioration des conditions de détention qui ne sera jamais assez rappelé à cette tribune, le Contrôleur général a donc su, au fil des années, trouver sa place au sein de nos institutions et devenir le porte-parole et le défenseur des personnes privées de liberté.
Les mentalités et les pratiques ont évolué ces dernières années, grâce aux visites et aux observations qui ont été réalisées. Mais beaucoup reste à faire dans nos prisons, le débat que nous avons aujourd’hui est l’occasion de le rappeler. J’aimerais dire un mot notamment sur la pénibilité du travail des gardiens de prison, souvent soumis à des violences physiques ou psychologiques du fait de leurs fonctions. Le récent mouvement social des surveillants pénitentiaires est là pour nous le rappeler.
Pour le groupe UDI-UC, il est nécessaire de réaffirmer, voire de renforcer l’une des missions importantes du Contrôleur général, qui est d’alerter les services compétents lorsque les conditions de travail des surveillants deviennent trop difficiles, voire dangereuses.
Après plusieurs années d’exercice, il est possible de faire le bilan des activités du Contrôleur général et de s’interroger sur les éventuels aménagements à apporter à la loi du 30 octobre 2007.
Plusieurs des aménagements ici proposés visent à pérenniser certaines pratiques mises en place par M. Delarue avant la fin de son mandat, en juin prochain, afin de s’assurer que son successeur continue dans la même voie.
C’est notamment le cas de l’article 4 de la proposition de loi, qui prévoit de rendre systématiquement publics les recommandations, propositions ou avis émis par le Contrôleur général, ainsi que les observations des autorités publiques. Il s’agit pour le moment d’une simple possibilité. Rappelons qu’il n’est pas ici question des observations formulées à l’issue de chaque visite qui, elles, n’ont pas vocation à être publiées.
Dans le prolongement de la position exprimée par mon collègue Arnaud Richard à l’Assemblée nationale, je tiens malgré tout à formuler une réserve sur l’article 1er A du texte, qui a malheureusement été adopté conforme : il prévoit l’extension du champ de compétences du Contrôleur général aux mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers. Il semblait préférable d’étudier en amont ce que cet élargissement des compétences impliquait avant de l’adopter.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avec un budget de 4, 2 millions d’euros, dispose-t-il vraiment des moyens et des ressources nécessaires pour cette nouvelle mission ? Je me permettrai de rappeler que l’actuel Contrôleur général, Jean-Marie Delarue, s’est lui-même déclaré défavorable à l’extension de ses compétences. Cette mesure nous semble donc être une fausse bonne idée.
Lors de l’examen en première lecture, nos collègues députés ont souscrit à l’initiative de Catherine Tasca. Respectant l’esprit du texte adopté par le Sénat, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs aménagements qui améliorent le dispositif.
Je tiens à saluer encore une fois notre collègue Catherine Tasca pour le dépôt opportun de ce texte législatif et pour la qualité de son travail de rapporteur. Comme elle, nous pensons qu’il est essentiel de continuer à mieux faire connaître les fonctions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en particulier auprès des auxiliaires de justice, notamment les avocats. Ces acteurs pourraient sans doute faire parvenir au Contrôleur général des éléments d’information utiles à l’exercice de sa mission.
Conscients de l’importance de voir les dispositions de cette proposition de loi entrer rapidement en vigueur et considérant que le texte adopté par les députés est équilibré, nous soutiendrons l’adoption de cette proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, intervenir la dernière est un exercice périlleux parce que j’ai clairement l’impression que tout a été dit, tout sauf peut-être cette expérience que j’ai vécue et que j’ai envie de vous faire partager.
Exemplarité, rayonnement, valeurs, République, éthique, liberté et respect sont des termes qui sont en effet revenus très fréquemment ce matin à cette tribune : belle unanimité aujourd'hui au Sénat !
Depuis une semaine, je me suis interrogée sur les raisons de cette unanimité. Elle s’explique peut-être tout simplement par la façon de fonctionner du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, que j’ai pu comprendre lors d’une visite inopinée que j’ai faite avec une de ses équipes dans des locaux parisiens de garde à vue.
Manifestement, notre visite était une surprise totale. Le secret avait été parfaitement gardé. Je dois avouer que, moi-même, j’ignorais où nous allions ; je savais simplement qu’il s’agissait de locaux de garde à vue situés en région parisienne, et ils sont nombreux.
L’équipe du Contrôleur général travaille, si nécessaire, dans la confidentialité la plus parfaite, ce qui a permis cette visite réellement inopinée. Pour autant, il n’était ni question de tendre un piège ni de venir en inquisiteurs. Nous venions voir comment les choses fonctionnaient au jour le jour, tant pour les personnes privées de liberté, et uniquement de liberté, que pour celles chargées de surveiller cette privation de liberté.
Quand vous dites que vous venez au nom du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, vous êtes accueilli avec surprise, crainte – c’est normal, personne n’aime se faire inspecter ! –, mais aussi respect par des personnes qui ont une parfaite connaissance de l’institution et de ses droits.
Là encore, cela montre l’efficacité de l’équipe du Contrôleur général, qui n’a besoin ni de se présenter plus avant ni d’affirmer ce à quoi elle a droit : en l’occurrence, tout cela était parfaitement connu et a été parfaitement respecté.
Les premiers contrôles portent sur ce qu’il est facile de rectifier ou de modifier. L’équipe est professionnelle : elle sait parfaitement ce qu’il faut immédiatement aller voir. Là encore, le but était non pas de chercher à punir ou de faire de l’inquisition, mais de comprendre comment les choses se passaient dans ces locaux de garde à vue.
La visite a donc été menée avec professionnalisme, mais avec simplicité, aussi, toujours dans le respect de ceux qui étaient en face de nous – les gardés à vue comme le personnel qui œuvrait dans ces locaux – et le souci du détail : chaque élément recueilli était analysé et vérifié. Les entretiens avec le personnel et les gardés à vue étaient de réels dialogues : la personne qui posait des questions écoutait les réponses sans a priori, les notait, faisait préciser certains points, soulevait d’autres questions et manifestait sa curiosité - une curiosité non pas malsaine, mais bien au contraire très saine -, en vue de savoir, comprendre et enregistrer.
Grâce à la sincérité de ces échanges, le personnel, au début réticent et qui exprimait une certaine crainte– c'est, je le redis, tout à fait normal –, s’est peu à peu laissé « apprivoisé », et s’est de plus en plus livré, comprenant que l’équipe était là non pour le juger, mais pour entendre, noter et analyser, peut-être proposer des pistes d’amélioration et de nouvelles voies à explorer.
Le dialogue a aussi eu lieu avec les gardés à vue. Ils savaient parfaitement qui était le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et étaient heureux de lui parler. Là encore, il n’y avait pas de jugement a priori sur la sincérité des uns et des autres. Les informations qu’ils nous ont apportées ont également fait l’objet de vérifications, dans un échange toujours empreint de respect et marqué du souci de l’écoute.
Le professionnalisme, le souci du détail, l’écoute permanente, le respect de l’autre ont sans doute été pour moi les éléments les plus marquants de cette visite de locaux de garde à vue.
Ensuite, chacun des collaborateurs de l’équipe a rédigé un compte rendu à partir d’un questionnaire, en faisant sa propre analyse de la situation. Ces documents ont été mis en commun. Tout a été de nouveau discuté entre les collaborateurs, qui forment véritablement une équipe, au sens le plus profond du terme. Chacun des détails a été pesé, soupesé, certains remis en perspective, d’autres relativisés. Le rapport final a bien évidemment été soumis, selon le principe du contradictoire, à ceux qui ont été inspectés.
Voilà comment j’ai compris pourquoi on peut faire l’unanimité sur les travées de notre Haute Assemblée lorsque l’on parle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Tous les qualificatifs qui ont été employés, j’en ai éprouvé la pertinence, à un moment ou à un autre, lors de ces quelques jours passés avec une équipe de Jean-Marie Delarue dans des locaux de privation de liberté.
C’est pourquoi je remercie encore le rapporteur et coauteur de cette proposition de loi, Mme Catherine Tasca, d’avoir compris la nécessité d’inscrire aujourd’hui dans la loi ces améliorations relatives aux modes d’enquête et de fonctionnement de l’institution – je pense notamment au secret médical et aux sanctions en cas d’entrave à l’activité du Contrôleur général.
N’oublions jamais que c’est l’honneur de la République française d’avoir créé cette institution, qui permet à la démocratie de garder tout son sens dans ces enclaves, nécessaires, que sont les lieux de privation de liberté.
N’oublions jamais que, dans ces enclaves, les relations interhumaines sont évidemment affectées par le fait que certains sont privés de liberté tandis que d’autres sont chargés de surveiller cette privation de liberté. Les relations naturelles d’autorité et de hiérarchie sont forcément beaucoup plus difficiles à assumer dans ces enclaves de notre République.
C’est tout à l’honneur de Jean-Marie Delarue et de son institution de veiller à ce que ces enclaves restent des lieux de droit, des parties intégrantes de la République française.
Pour l’ensemble de ces raisons, vous l’aurez compris, mes chers collègues, avec l’ensemble de mon groupe, loin de m’inscrire en faux contre ce qui a été dit par les orateurs précédents, je voterai bien évidemment cette proposition de loi, avec enthousiasme et conviction.
Applaudissements.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
(Non modifié)
À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : «, les représentants au Parlement européen élus en France ».

L'amendement n° 1, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après le mot :
France
insérer les mots :
, les membres représentant la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 1er B.
L'article 1 er B est adopté.
(Non modifié)
I et II. –
Supprimés
III. – Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Lorsqu’une personne physique ou morale porte à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté est constitué.
« Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place.
« À l’issue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans préjudice des dispositions de l’article 5. »
IV. – Les quatre derniers alinéas de l’article 8 de la même loi sont supprimés.
V. – Après le même article 8, il est inséré un article 8-1 A ainsi rédigé :
« Art. 8-1 A. – Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer aux vérifications sur place prévues à l’article 6-1 ou aux visites prévues à l’article 8 que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors le report de ces vérifications sur place ou de ces visites. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté ou de toute personne susceptible de l’éclairer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, dans les délais qu’il fixe. Lors des vérifications sur place et des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et recueillir toute information qui lui paraît utile.
« Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
« Les procès-verbaux relatifs aux conditions dans lesquelles une personne est ou a été retenue, quel qu’en soit le motif, dans des locaux de police, de gendarmerie ou de douane sont communicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sauf lorsqu’ils sont relatifs aux auditions des personnes.
« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article.
« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après le même article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l’exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application éventuelle de l’article 226-10 du code pénal. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, en tenant compte de l’évolution de la situation depuis sa visite » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« À l’exception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu’il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article 10 de la même loi, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Lorsque ses demandes d’informations, de pièces ou d’observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 A et 9, ne sont pas suivies d’effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
« 1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à l’article 6-1 et des visites prévues à l’article 8 ;
« 2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications prévues à l’article 6-1 ou aux visites prévues à l’article 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;
« 3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ;
« 4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données. » –
Adopté.

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. le président de la commission des lois.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je ne souhaite pas allonger nos débats, mais traduisant, me semble-t-il, la position de l’ensemble des membres de la commission des lois, je tiens à dire notre grande estime pour la manière dont Jean-Marie Delarue a exercé sa mission, avec modestie – je tiens à le souligner -, réalisme, écoute, sérieux et très grande exigence.
Chacun le voit, pour tout gouvernement, les rapports du Contrôleur général ne relèvent ni de la complaisance ni de la connivence ; ils sont, au contraire, un appel à une grande exigence.
Je tiens maintenant à remercier Mme la garde des sceaux d’avoir soutenu la proposition de loi, et Mme Catherine Tasca d’avoir pris l’initiative de ce texte nécessaire, qu’elle a défendu avec une grande conviction et un grand sens du travail en commun, en particulier, comme l’a souligné M. Lecerf, avec l’ensemble de ses collègues de la commission des lois.
Pour terminer, je veux dire combien le Sénat a eu raison d’affirmer haut et fort son opposition à l’inclusion du Contrôleur général des lieux de privation de libertés dans l’institution du Défenseur des droits. Son indépendance, son autonomie donnent une grande force à l’institution du Contrôleur général. On le voit aujourd'hui !
Le Contrôleur général est un bien très précieux pour la République : de la manière dont les prisons fonctionnent, sont gérées et vivent au quotidien dépend aussi une certaine idée de la République !
Applaudissements.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Je veux simplement remercier l’ensemble des groupes de notre assemblée d’avoir apporté leur entier soutien à ce texte, situation qui n’est pas si courante dans le quotidien parlementaire !
Sourires.

Ainsi, le Sénat contribue à faire prendre conscience à notre pays que le sujet de la condition carcérale et de la défense des droits fondamentaux pour tous, indépendamment des accidents de la vie, peut et doit absolument se placer au-dessus de certains débats partisans, par ailleurs légitimes.
Par son unanimité, le Sénat sert profondément notre démocratie. Soyez-en tous remerciés !
Applaudissements.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous remercier. J’insiste particulièrement sur le travail de très grande qualité qu’a produit Mme la rapporteur, sur la mobilisation de la commission des lois dans son ensemble et sur la constance avec laquelle vous travaillez sur ces sujets. Cela augure de débats très approfondis sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, qui sera soumis à votre examen prochainement.
Sur ces sujets, que vous connaissez bien, vous avez pris l’habitude de travailler au-delà des sensibilités politiques. Vous avez déjà produit plusieurs rapports cosignés par des membres de l’opposition et de la majorité sénatoriales, et ce indépendamment des alternances politiques. Vous avez pris l’initiative d’organiser des débats, auxquels j’ai été invitée à participer, notamment sur l’application des lois. Il faut dire que vous vous êtes doté d’une commission qui veille à la qualité de cette application.
Je sais donc bien que je suis ici dans une assemblée qui est sensible à ces questions et les traite avec la hauteur nécessaire. La mobilisation unanime dont vous faites preuve aujourd'hui sur ce texte, qui donne de la force à cette haute autorité indépendante qu’est le Contrôleur général, l’illustre une fois de plus.
Dans ces conditions, j’avoue que j’ai quelque impatience à revenir devant vous pour aborder les questions de la prévention de la récidive et de l’individualisation des peines !
Sourires et applaudissements.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
La proposition de loi est adoptée définitivement.

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
Applaudissements.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (texte de la commission n° 528, rapport n° 527).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, notre assemblée est donc invitée à se prononcer sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à transposer la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales et une partie de la directive du 22 octobre 2013, sur le droit d’accès à un avocat.
Ce texte a été examiné par le Sénat et l’Assemblée nationale dans des délais contraints, en procédure accélérée, mais dans un esprit constructif, pragmatique et consensuel, ce dont je me félicite.
Dans l’ensemble, les modifications apportées par l’Assemblée nationale au texte voté par le Sénat à la fin du mois de février ont amélioré le texte, clarifié quelques points qui pouvaient encore poser des difficultés et l’ont complété de mesures utiles. Je veux souligner la qualité du travail réalisé par nos collègues députés, notamment Mme Cécile Untermaier, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale.
Aussi est-ce sans difficulté que la commission mixte paritaire, réunie mardi après-midi, est parvenue à un accord sur ce texte, qui, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, reprend la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Je veux revenir brièvement sur quelques points, qu’il me semble important de relever.
Tout d’abord, sur l’article 1er, qui vise à reconnaître des droits au suspect entendu dans le cadre d’une audition libre, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs clarifications bienvenues, qui ont été entérinées par la commission mixte paritaire.
S’agissant de la convocation écrite que l’officier de police judiciaire pourra adresser à la personne suspectée, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale posait problème, en ce qu’elle ouvrait la voie à des discussions contentieuses qui auraient pu fragiliser les procédures. Sur proposition de la rapporteur de l’Assemblée nationale et de moi-même, et en accord avec la Chancellerie, la CMP a adopté une rédaction un peu plus souple, aux termes de laquelle il appartiendra aux seuls officiers de police judiciaire de juger si le déroulement de l’enquête permet de mentionner, sur la convocation, la nature de l’infraction reprochée.
La CMP a, par ailleurs, répondu à une inquiétude de nos collègues députés de l’opposition, en remplaçant le terme « suspect » par celui, plus neutre et plus respectueux de la présomption d’innocence, de « personne soupçonnée ».
En outre, à l’article 3, relatif à la garde à vue, l’Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications, d’ampleur inégale, lesquelles ont été adoptées par la CMP sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.
En particulier, je veux saluer ici la solution assez habile que l’Assemblée nationale a trouvée s’agissant des gardes à vue prolongées en matière d’escroquerie en bande organisée. Comme vous le savez, dans sa décision du 4 décembre 2013 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était disproportionné d’autoriser des gardes à vue de quatre jours pour des infractions de corruption et de fraude fiscale en bande organisée. La rédaction votée par le Sénat, sur proposition du Gouvernement, rendait impossible, par cohérence, le recours à des gardes à vue prolongées pour des faits d’escroquerie en bande organisée, ce qui a légitimement inquiété les services d’enquête.
Le texte adopté par les députés prévoit toujours d’interdire les gardes à vue de quatre jours pour de tels faits. Toutefois, un régime dérogatoire demeurerait possible, à condition d’être spécialement motivé, dans trois hypothèses : si les faits portent atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, s’ils portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national – on pense aux trafics internationaux et aux fraudes fiscales internationales. En outre, le report de l’intervention de l’avocat au-delà de quarante-huit heures ne serait plus possible.
Cet amendement a été élaboré avec les services de la Chancellerie. Il constitue à mon avis une bonne façon de nous conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, tout en insistant sur l’importance que les services d’enquête et de police puissent continuer à réaliser des gardes à vue de quatre jours pour des faits susceptibles d’être particulièrement complexes – songeons, par exemple, à l’affaire de la fraude à la taxe carbone. La CMP a pleinement approuvé cette rédaction, sous réserve d’une clarification rédactionnelle.
Nous avons également apporté une précision s’agissant des modalités concrètes dans lesquelles une personne gardée à vue pourrait demander au magistrat de mettre un terme à cette mesure lorsqu’elle ne lui est pas effectivement présentée : ses observations seront alors consignées dans un procès-verbal spécial, qui devra être communiqué rapidement au magistrat.
En outre, j’attire votre attention sur la modification apportée par la CMP à l’article 6, sur l’initiative de notre collègue député Dominique Raimbourg – nous lui devons, ainsi qu’à Guy Geoffroy, plusieurs modifications adoptées lors de la CMP. M. Raimbourg a fait remarquer que l’Assemblée nationale avait prévu que le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui n’est délivré, en principe, qu’aux magistrats, ferait expressément partie des pièces du dossier susceptibles d’être communiquées aux parties ou à leurs avocats. Cette possibilité nous posait problème, le bulletin n° 1 contenant toute l’histoire judiciaire de la personne poursuivie.
Dans l’attente de garanties pour la personne, la CMP a supprimé cette mention et est revenue au texte du Sénat, qui prévoit que l’on peut communiquer toute pièce, sans plus de précisions, aux parties ou à leurs avocats. Mme la garde des sceaux pourra peut-être nous rassurer sur la pratique des juridictions en matière de communication des bulletins n° 1 figurant au dossier. Pour ma part, il me semble que, le plus souvent, ils ne sont pas communiqués.
Enfin, les modifications apportées par les députés aux autres articles du projet de loi ne posent pas de difficultés.
Je souligne que l’article 1er, introduit au Sénat pour permettre à la victime d’être assistée par un avocat lors des confrontations, a été voté conforme, et j’en remercie l’Assemblée nationale. Cet article montre que nous faisons le plus grand cas des droits des victimes.
Par ailleurs, les députés sont revenus, en séance publique, sur l’amendement qu’avait voté leur commission des lois ouvrant à l’avocat l’accès à l’intégralité du dossier de garde à vue.
Lors de la première lecture, nous avions indiqué les difficultés qu’une telle modification pourrait entraîner, même si elle avait été demandée par certains, notamment par les organisations représentatives des avocats.
En outre, le droit européen permet d’exclure une telle possibilité : nous ne sommes donc pas en infraction sur ce point avec nos engagements communautaires. Nous sommes heureux que l’Assemblée nationale ait suivi, en séance, la position du Sénat sur ce point.
Je terminerai par l’article 6 ter, introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Coronado, afin de permettre à une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire d’avoir accès aux enregistrements de vidéo-surveillance pour l’exercice des droits de la défense.
Cette mesure nous renvoie au texte que nous avons à l’instant adopté à l’unanimité, relatif au Contrôleur général de privation des lieux de liberté. En effet, à plusieurs reprises, des détenus se sont vu refuser l’accès à de tels documents, alors que les images de vidéo-surveillance leur permettaient d’établir des faits ou de démentir ce qui leur était reproché. Le Défenseur des droits nous a fait part de plusieurs cas de ce type dont il a eu à traiter. Une récente décision de la cour administrative d’appel de Lyon a validé le refus d’accès aux documents, ce qui me semble soulever un problème du point de vue du respect des droits de la défense.
De façon plus générale, je vous rappelle que, le 25 avril dernier, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a rappelé qu’« il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ».
Or, à l’heure actuelle, les conditions d’accès au dossier disciplinaire et les restrictions apportées aux droits de la défense sont définies par un décret et par une circulaire du 9 juin 2011.
Sur proposition conjointe de la rapporteur de l’Assemblée nationale et de moi-même, la CMP a élargi le champ des dispositions votées à l’Assemblée nationale, afin de mentionner expressément dans la loi le principe d’accès au dossier disciplinaire – figurant actuellement dans un décret – et le principe d’exercice des droits de la défense, qui s’appliquent aux personnes détenues comme à tout citoyen, avec une seule réserve, concernant la communication d’éléments qui pourraient présenter un risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement.
Mes chers collègues, tels sont, brièvement rappelés, les éléments sur lesquels la CMP n’a eu aucune difficulté à tomber d’accord. Je ne puis que vous inviter à adopter le texte du projet de loi, dans la rédaction issue de ses travaux.
Applaudissements.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier très chaleureusement les parlementaires qui ont participé à la commission mixte paritaire : si celle-ci a permis l’adoption d’un texte à l’unanimité, c’est au prix d’efforts mutuellement consentis par les députés et les sénateurs pour surmonter les divergences qui demeuraient et régler les difficultés rédactionnelles et techniques qui avaient été identifiées.
Nous arrivons aujourd'hui au terme du processus qui nous permettra d’adopter le projet de loi transposant la directive adoptée par le Parlement européen et par le Conseil en mai 2012. Nous pourrons ainsi respecter le délai de transposition qui nous avait été assigné, fixé au 2 juin prochain.
Rappelons-nous à quel point il importe de respecter ces délais, car la question est loin d’être indifférente.
D’abord, nous devons mettre notre droit interne en conformité avec le droit communautaire. Les États membres de l'Union européenne élaborant les directives, nous participons, nous-mêmes, à leur élaboration.
Il convient de le faire dans les délais impartis, sans quoi nous nous exposons à une procédure d’infraction dont l’issue est coûteuse : une indemnisation est due à l'Union européenne, sous astreinte journalière.
Surtout, nous devons veiller à la sécurité de nos procédures. Même conformes à notre droit national, elles demeurent susceptibles d’être annulées si elles ne sont pas conformes à une directive dont le délai de transposition a expiré.
Depuis plusieurs années – tout particulièrement ces derniers mois –, nous avons compris à quel point il est important de veiller à la sécurité des procédures. Des actes conformes à une loi peuvent être contestés par nos juridictions suprêmes et aboutir à des annulations de procédure, dès lors que cette loi n’est pas reconnue comme étant conforme, soit à la convention européenne, soit à la Constitution.
Une grande vigilance est donc requise quant à la conformité de nos lois pour éviter des annulations de procédure qui, bien entendu, peuvent concerner des infractions extrêmement graves.
Plus encore que le respect des délais, il importe de rappeler que cette transposition s'inscrit dans un processus initié en 1999 par le Conseil européen de Tampere, qui a décidé de construire un espace de liberté, de sécurité et de justice, posant les fondations mêmes de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des décisions pénales, un espace prévoyant des normes minimales pour la protection tant des victimes que des personnes poursuivies.
Ainsi, nous sommes passés du programme de Tampere, avec la mise en place des principes inspirant aujourd'hui l’action que nous conduisons dans le domaine judiciaire – cela aboutit, d'ailleurs, à la création d’instruments européens tels que le mandat d’arrêt européen –, au programme de La Haye, puis au programme de Stockholm de 2010 à 2014, que nous sommes en train d’achever. Ce dernier programme a défini les normes minimales en faveur des victimes et des personnes protégées.
Désormais, sous l’empire du traité de Lisbonne, l’ensemble du champ pénal relève du droit communautaire. Je suis donc conduite à travailler à la mise en place d’un parquet européen. À cet égard, nous avons commencé à enregistrer quelques succès. La Commission envisageait un dispositif placé au-dessus des États, mais nous avons obtenu un vote majoritaire en faveur d’un dispositif collégial qui permettra à chaque État d’avoir un représentant national veillant à la compatibilité de ce parquet européen avec les ordres juridiques et judiciaires nationaux. Cela évitera des frictions, même s'il reste encore à déterminer les conditions dans lesquelles ce parquet exercera l’action publique.
Nous nous inscrivons donc dans ce processus, dont la directive que nous transposons constitue la traduction concrète.
Je dois également vous rappeler que cette directive est articulée avec une autre, à venir, dont la date limite de transposition échoit à la fin de cette année 2014 ; celle que nous transposons ce jour, la « directive B », concerne le droit à l’information, et celle que nous devrons transposer, dite « directive C », concerne l’accès à l’avocat.
Nous nous situons donc dans un processus en construction. Dans un souci de cohérence, nous avons introduit des dispositions concernant la directive C dans la transposition actuelle, qui nous donne en effet l’occasion non seulement d’introduire les nouveaux droits prévus par la directive B, mais aussi de consolider une jurisprudence du Conseil constitutionnel remontant à 2011 et aux débats sur la garde à vue.
La question avait alors été posée, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’ici, au Sénat, de l’encadrement de l’audition libre. Les dispositions législatives en cause n’avaient pas été votées, mais le Conseil constitutionnel, lui, avait eu à se prononcer : il a considéré que, dans le cadre de l’audition libre, le justiciable doit être informé du fait qu’il peut quitter les locaux de l’enquête lorsqu’il le souhaite, ainsi que de la nature et de la date de l’infraction dont il est soupçonné.
Bien entendu, nous avons introduit les dispositions de la directive B, qui concernent le droit au silence, à l’interprétariat et à la traduction. Mais, même pour l’audition libre, nous considérons que la personne soupçonnée d’un délit ou d’un crime doit pouvoir recourir à un avocat – ce qui relève de la directive C.
D’une manière générale, les mesures contenues dans ce projet de loi encadrent les procédures pénales à tous les stades, de l’enquête à la poursuite et au jugement.
Nous l’avons dit, l’audition libre est encadrée. La garde à vue est améliorée. La personne a le droit d'en connaître le motif, elle peut avoir accès au dossier – accès jusqu’à maintenant réservé à l’avocat – et elle obtient une déclaration écrite de ses droits.
Concernant les personnes susceptibles d'être entendues au cours d’une instruction sous le statut de mis en examen ou de témoin assisté, là aussi, les droits sont consolidés ; mieux encore, les parties ont un accès facilité aux pièces du dossier. En contrepartie, l’Assemblée nationale a estimé qu’il importait de renforcer les sanctions en cas de violation du secret de l’instruction, si ces justiciables transmettaient des pièces du dossier à un tiers.
Enfin, les personnes faisant l’objet d’une comparution immédiate, qui sont entendues par le procureur, peuvent être assistées par un avocat. Cela permet d’éclairer le procureur, qui peut ainsi décider, par exemple, d’une instruction préparatoire.
Les personnes entendues dans ce cadre peuvent aussi demander des investigations complémentaires. Le président du tribunal correctionnel peut décider d’y donner suite, voire d’en charger un juge d’instruction, et pas seulement un membre de la formation de jugement.
Ainsi, toute une série de dispositions viennent consolider les droits de la défense et encadrer plus précisément l’audition libre des personnes soupçonnées, l’audition en garde à vue ou les auditions au cours de l’instruction.
Je veux rappeler ici une chose extrêmement importante et à laquelle je crois savoir, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous êtes particulièrement sensibles. Certains d’entre vous l’ont rappelé au cours de la première lecture, jusqu’à maintenant, nos procédures pénales ont été améliorées – ou du moins modifiées – sous le coup du droit européen ou, plus souvent encore, de décisions des cours suprêmes, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cela n’est pas satisfaisant, car on ne peut anticiper les modifications ainsi introduites, et donc en assurer la cohérence.
Cela n’est pas satisfaisant, parce que ceux qui interviennent dans ces procédures pénales – je rappelle qu’il s’agit à 97 % d’enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet, par le procureur de la République – n’ont pas de visibilité sur les modalités de la conduite de ces enquêtes.
Il est donc nécessaire de penser nos procédures pénales avec un souci de cohérence et de réfléchir notamment à la façon dont on peut améliorer l’exercice des droits de la défense et les conditions d’un procès équitable sans avoir à réagir dans la précipitation, soit à une décision d’une juridiction suprême, soit sous le coup du droit communautaire.
Pour ces raisons, j’ai chargé Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon – son activité juridictionnelle arrive à son terme –, entouré d’un avocat, d’un haut fonctionnaire de la police, d’un procureur de la République et d’un magistrat du siège, de réfléchir à l’architecture même de notre procédure pénale et de faire des propositions pour introduire davantage de contradictoire, notamment dans les enquêtes préliminaires et les enquêtes de flagrance, ce dans la perspective d’un meilleur équilibre.
Les représentants des enquêteurs, des policiers, se sont parfois inquiétés de l’introduction du contradictoire – on les a, par exemple, entendus lors de la réforme de la garde à vue – parce qu'ils ont le sentiment que la conduite des enquêtes est fragilisée et qu’on les désarme.
Mais l’expérience a montré que nous avons raison, dans un État de droit, de considérer qu’il faut faire droit à la défense et que les principes constitutionnels doivent être respectés et traduits dans des dispositions normatives. En effet, il s'avère à la pratique que les enquêtes sont plus performantes avec l’introduction du contradictoire.
Certes, nous entendons et comprenons ces inquiétudes – tout en les relativisant, car elles ne sont pas unanimes -, mais l’introduction du contradictoire ne désarme pas les enquêteurs. Comme vous le rappeliez, monsieur le rapporteur, nous pouvons préciser dans nos lois que certaines pièces ne peuvent pas être mises à disposition des défenseurs, y compris en référence aux dispositions communautaires.
C'est l’un des arguments auxquels j’ai récemment recouru à l’Assemblée nationale pour expliquer qu’il n’était pas judicieux de faire droit à un amendement consistant à donner accès à l’intégralité du dossier.
Les travaux de la mission Beaume nous permettront de définir avec plus de précision et de cohérence encore les modalités d’une introduction du contradictoire dans nos enquêtes de flagrance et dans l’ensemble de nos procédures pénales.
La mission Beaume me rendra son rapport au début du mois de juin. Quelques semaines plus tard, je vous le soumettrai, je vous consulterai et vous solliciterai afin que nous écrivions ensemble les nouvelles dispositions qui seront nécessaires pour construire en amont, et à notre main, l’architecture de nos procédures pénales.
Il s'agit donc d’un changement de méthode propre à mettre un terme à ces affrontements tout à fait factices tant avec les enquêteurs, qui se demandent quelles dispositions vont leur tomber sur la tête et comment ils maîtriseront la conduite de leurs enquêtes, qu’avec les avocats, qui, eux, considèrent que le défenseur est exclu, que les droits de la défense ne sont pas suffisamment respectés, que l’on fragilise le procès équitable et que nos procédures pénales ne sont pas conduites dans le plus strict respect de notre droit.
Ces inquiétudes comportent, des deux côtés, une part de subjectivité. Nous devons en tenir compte, mais il nous faut aussi éliminer ce qui se trouve à la source de cette subjectivité. Avec les travaux de la mission Beaume, nous devrions y parvenir.
En attendant, les travaux de la CMP nous ont permis d’avancer, avec une transposition bien construite et bien écrite. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous en remercie très chaleureusement et, une fois de plus, je vous sais gré de nous avoir permis de respecter les délais – sans quoi il en eût coûté quelques millions d’euros à la France !
Applaudissements sur les travées du g roupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’Union européenne nous encourage fortement à améliorer l’équité de notre procédure pénale, et c’est une excellente chose. Notre assemblée, dont le groupe du RDSE, est très attachée à la protection des libertés, et plus précisément à l’exigence d’un procès équitable.
Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 30 novembre 2009 une feuille de route dont découlent six mesures : elles visent toutes à instaurer des normes minimales en matière de procédure pénale. L’objectif est de permettre la reconnaissance mutuelle des décisions pénales et de compléter les obligations issues de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi de la Charte de l’Union.
Plusieurs directives déclinent ces mesures. La première directive, dite « directive A », a déjà été transposée. Aujourd’hui, nous transposons la « directive B » du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales : le temps presse puisque l’échéance pour la transposition a été fixée au 2 juin prochain. Toutefois, le projet de loi ne s’arrête pas là, car il transpose en partie la « directive C », relative au droit d’accès à un avocat.
L’information délivrée à la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou poursuivie à ce titre est indéniablement au cœur du procès équitable. Il n’y a pas de jugement contradictoire, pas d’égalité des armes, pas de défense effective si le principal intéressé ignore les droits qui lui sont reconnus par la loi, les chefs d’accusation retenus et les charges rassemblées contre lui.
C’est la raison d’être de la directive B, et le projet de loi renforce les droits de la défense tout au long de la procédure. Le texte a été amélioré, a gagné en clarté et en cohérence lors de son passage devant les deux assemblées. Aussi voudrais-je m’attarder sur les deux points les plus marquants de ce texte, qui traduisent une innovation et une lacune : il s’agit de la consécration du statut de suspect entendu librement – si tant est que l’on puisse parler de liberté en ce cas – et de l’accès au dossier pour l’avocat.
Le projet de loi consacre le statut du suspect entendu librement. Cette évolution est d’importance, car elle vient encadrer cette zone grise qu’est « l’audition libre ». Du point de vue des enquêteurs, cette audition libre a un avantage concurrentiel évident sur la garde à vue, puisque le suspect n’a quasiment aucun droit.
En effet, si les droits de la défense ont été renforcés par la loi du 14 avril 2011 sous la pression de la jurisprudence européenne et interne, le suspect entendu librement n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat. Le Conseil constitutionnel a seulement exigé que la personne soit informée de la nature, de la date de l’infraction et de son droit de quitter les locaux de police.
L’audition libre est largement utilisée ; elle a concerné environ 800 000 personnes en 2012, tandis que 380 000 personnes ont été placées en garde à vue.
Le projet de loi va au-delà de la légalisation de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, en prévoyant que seront notifiés au suspect son droit au silence, le droit à un interprète et, surtout, son droit à l’assistance d’un avocat. Le projet anticipe ainsi la transposition de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales Avec ce texte, l’audition libre ne sera plus un outil de contournement des droits de la défense.
Le second point que je souhaite aborder est l’accès au dossier pour l’avocat de la personne gardée à vue. La directive n’impose que des règles minimales ; notre combat pour une justice équitable doit nous conduire à aller plus loin.
La directive transposée, en particulier son article 7, a suscité de nombreux espoirs. Le deuxième paragraphe dudit article exige en effet un accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, ce qui semble imposer l’élargissement de la liste des pièces accessibles à l’avocat.
Aujourd’hui, l’avocat du gardé à vue ne peut consulter que quelques pièces du dossier ; cette limitation entame l’efficacité de la défense, l’avocat n’ayant notamment pas accès aux procès-verbaux d’audition des victimes ou de perquisition.
Madame la garde des sceaux, sur ce point, vous nous renvoyez à un autre rendez-vous qui fera suite à la publication des conclusions de la mission que vous avez confiée à M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon. Une réforme d’ampleur est probablement nécessaire, car nous légiférons trop souvent par petites touches.
Comment pouvons-nous être certains que cette réforme aura lieu ? De nombreuses réflexions ont été menées ; il est possible de citer par exemple la commission Donnedieu de Vabres ou encore la commission « Justice et droits de l’homme » présidée par Mme Mireille Delmas-Marty. Des propositions ont été adoptées, mais la réforme d’ensemble, cohérente, n’a pas eu lieu.
Vous nous avez proposé un rendez-vous et vous avez affirmé devant les députés qu’il ne sera pas repoussé aux calendes grecques. Sans doute faudra-t-il quitter cette approche selon laquelle le respect des droits de la défense s’oppose à l’efficacité des procédures.
Comme vous l’avez indiqué aux députés, madame le garde des sceaux, « l’on craint trop souvent d’introduire du contradictoire ou d’améliorer les droits de la défense dans le cadre des enquêtes pénales, alors que l’expérience a prouvé que l’efficacité de ces enquêtes s’en trouvait au contraire grandie ».
En attendant ce rendez-vous, comme en première lecture, le groupe du RDSE apporte son soutien à ce texte et à la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si nous nous réjouissons que ce texte prévoie un renforcement important des droits de la défense à toutes les phases de la procédure – il tend notamment à encadrer le déroulement des « auditions libres » en rendant plus systématique le droit de la personne suspecte à être assistée par un avocat –, je veux redire ici l’appel du groupe écologiste à une refonte plus globale des procédures d’enquête et d’instruction qui soit conforme aux principes énoncés par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme.
C’est le droit pénal et la procédure pénale qu’il faut reconsidérer dans leur entier. Il faut cesser de réviser notre droit par petits bouts, au rythme des délais de transposition des directives et des condamnations de la CEDH.
Je le rappelle, il aura fallu les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009, puis Brusco contre France du 14 octobre 2010, suivis de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 et des arrêts de la Cour de cassation du 19 octobre 2010 pour que soit enfin élaboré le projet de loi permettant à l’avocat d’être présent lors des auditions des personnes placées en garde à vue. Cette loi, adoptée le 14 avril 2011, était un premier pas, nécessaire, mais loin d’être suffisant.
Je veux saluer ici le travail de mes collègues écologistes, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, qui se sont investis avec conviction pour enrichir ce texte. Ils ont plaidé, avec vigueur, pour que des mesures essentielles aux droits de la défense soient adoptées immédiatement, sans attendre les conclusions d’une énième mission ou d’un énième rapport.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, je fais notamment référence à l’amendement écologiste présenté par M. Sergio Coronado, adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, prévoyant l’accès de l’avocat au dossier de l’enquête dès le début de la garde à vue et sur lequel le Gouvernement est revenu en séance.
En effet, les pièces de la procédure dont l’avocat peut prendre connaissance depuis la loi de 2011 sont limitativement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale. Cependant, ces documents ne concernent en rien les éléments de fond du dossier et ne permettent donc pas à l’avocat d’assister effectivement son client lors des auditions au cours desquelles il peut être présent.
Si la directive n’impose pas un tel accès au dossier, il nous semble pourtant que son esprit encourageait l’adoption d’une telle disposition. De surcroît, il ne fait aucun doute que, dans quelques années, si ce n’est quelques mois, les exigences de la jurisprudence de la cour de Strasbourg et des textes européens nous imposeront de revenir sur le sujet.
Toutefois, le présent projet de loi contient, dans l’ensemble, des avancées notables en matière de procédure pénale.
L’article 1er, par exemple, renforce de manière considérable les garanties offertes à la personne entendue dans le cadre de l’audition libre. En effet, le droit au silence, le droit à un interprète, ainsi que les droits à des conseils juridiques et, surtout, à l’assistance d’un avocat seront désormais notifiés au suspect entendu librement.
Nous nous félicitons également que la suppression de l’article 10, qui autorisait le Gouvernement à prendre une ordonnance pour adapter certaines dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la réforme du règlement Dublin II, ait été maintenue.
Cette refonte est nécessaire et les écologistes demandent depuis longtemps l’instauration d’un recours suspensif contre les décisions de transfert prises à l’encontre d’étrangers dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État membre.
Mais une telle réforme ne doit pas être élaborée à la légère, si j’ose dire, et hors du contrôle du Parlement. Le Gouvernement doit s’engager sur cette question et faire des propositions concrètes au législateur. Nous attendons avec impatience de pouvoir enfin débattre et améliorer les droits des demandeurs d’asile et, plus généralement, des étrangers, tellement mis à mal par le précédent exécutif.
Pour conclure, et malgré les quelques réserves évoquées précédemment, le groupe écologiste votera ce texte, et d’autant plus résolument que sa discussion constitue, à quelques jours des élections européennes, une belle occasion de montrer au plus grand nombre que l’Europe et la construction de son droit commun peuvent aussi contribuer à renforcer les droits fondamentaux de tous les citoyens européens.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, justifié par la nécessité de transposer avant le 2 juin 2014 – nous sommes donc dans les temps, c’est bien –…

… la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ce projet de loi procède à plusieurs ajustements d’ampleur inégale au sein des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’enquête, à l’instruction et à la phase de jugement.
Il procède également par anticipation, et nous vous en félicitons, madame le garde des sceaux, les deux aspects étant liés, à une transposition partielle de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, dont la transposition devra être achevée avant le 27 novembre 2016. Un nouveau projet de loi viendra donc compléter, le moment venu, ces dispositions.
Nous sommes bien entendu favorables à l’adoption de ce texte eu égard au caractère impératif des directives européennes qu’il transpose. Nous avons d'ailleurs toujours défendu un espace judiciaire européen et le Sénat avait beaucoup travaillé sur le mandat d’arrêt européen.
Pourtant, chacun constate que notre procédure pénale est bouleversée par les modifications par petites touches introduites par le droit communautaire mais aussi et surtout par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En conséquence, une refonte globale de notre procédure pénale est, à terme, inévitable, ce qui pose à l’évidence bien d’autres questions que celles qui sont évoquées aujourd’hui.
Quoi qu’il en soit, le travail parlementaire et la commission mixte paritaire auront permis d’apporter des modifications de nature à établir un texte qui représentait au départ de lourdes contraintes, notamment pour les forces de l’ordre. Des inquiétudes se sont exprimées sur l’efficacité de la procédure. Beaucoup nous ont mis en garde sur le risque d’augmentation du nombre de gardes à vue si nous compliquions trop les auditions libres.
Les comparaisons montrent que les auditions libres permettent de régler beaucoup de choses sans recourir à la garde à vue. On l’oublie toujours, mais il s’agit de la réalité que vivent chaque jour les enquêteurs !
Notre débat d’aujourd’hui est donc d’une grande importance, puisque nous renforçons une nouvelle fois les droits de la défense. Comment ne pas s’en réjouir ?
Mon propos sera relativement bref, nous avons largement discuté de ces questions en première lecture et encore avant-hier soir, lors de nos échanges en commission mixte paritaire. Je souhaiterais toutefois aborder plus précisément quelques aspects de ce texte.
Vous l’avez rappelé, madame la garde des sceaux, le principe de l’audition libre avait été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel en 2011.
Cette audition libre crée une nouvelle « strate » dans le statut des personnes entendues par les forces de police, puis par la justice. Elle concernera ainsi toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de « soupçonner » qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas gardée à vue.
Permettez-moi de m’arrêter un instant sur le terme « soupçonner », qui a suscité un débat en commission des lois. Les députés avaient en effet inventé, pour les personnes auditionnées en dehors d’une garde à vue, le statut de « personnes suspectées ». Or cette formule était pour le moins paradoxale : en dépit de la présomption d’innocence, la personne entendue en audition libre était malgré tout considérée comme suspecte. Voilà qui était un peu malheureux. Nous avons apporté les corrections nécessaires et les termes « personne suspectée » ne se trouvent plus qu’à l’article 4, à bon droit, car il est alors question de garde à vue et non d’audition libre.
Cette audition libre concernera donc toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas gardée à vue, que cette audition intervienne dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou sur commission rogatoire, ou encore d’une enquête douanière.
S’agissant des droits de la défense, nous ne pouvons, bien sûr, dénigrer tout le travail déjà effectué : la réforme de la garde à vue, pour ne citer qu’elle, était indispensable et a indéniablement fait progresser notre législation. Souvenez-vous de nos débats, sur les dangers de cette réforme, de la possibilité de faire connaître leurs droits aux gardés à vue, notamment le droit de garder le silence ou non… Tout cela a duré des années et, au final, il n’y a pas eu de catastrophe. Comme quoi, mes chers collègues, il faut toujours raison garder.
Il faut également conserver à l’esprit la nécessité constante de préserver une forme d’équilibre entre les droits de la défense et les moyens d’enquête destinés à permettre la manifestation de la vérité. Je pense à tous les aspects importants liés au contenu du dossier.
Un point mérite quelques éclaircissements, celui de la question de l’accès à la justice pour tout citoyen. En effet, madame le garde des sceaux, comment parler d’égal accès à la justice si, faute de moyens financiers, on ne peut bénéficier de la possibilité d’être assisté, comme nous le prévoyons ?
La réponse à cette question semble simple : le recours à l’aide juridictionnelle. Or les chiffres contenus dans l’étude d’impact de ce projet de loi concernant l’aide juridictionnelle sont impressionnants. Ce dispositif est déjà confronté à des difficultés considérables, et je ne vois pas comment le problème pourra être réglé aujourd’hui. Nous arriverons probablement à des situations dans lesquelles le suspect – pardon, le « soupçonné » – ne disposera pas d’avocat, faute de pouvoir rémunérer ce dernier pour une demi-journée ou une journée. Il s’agit là d’un point des plus inquiétants.
On peut faire de très belles réformes, mais encore faut-il qu’elles soient d’application effective et qu’elles se traduisent d’une manière ou d’une autre. L’aide juridictionnelle, on le sait, est en crise depuis plusieurs années et cela s’aggrave… On peut écrire de beaux textes, si on ne peut les appliquer, le résultat est redoutable.
En conclusion, sachez que nous voterons ce texte, qui permet à la fois de procéder à la nécessaire transposition d’une directive européenne et de faire avancer les droits de la défense auxquels nous sommes tous, j’en suis sûr, profondément attachés.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous arrivons ce matin au terme d’un exercice de transposition de directive qui concerne l’une des zones les plus sensibles de notre corpus juridique : la procédure pénale.
Le rôle de notre assemblée est – nous le savons – bien limité : dans un exercice de transposition, nous avons assez largement les mains liées.
Avec l’adoption de ce projet de loi, nous devrions être en conformité avec les exigences communautaires, du moins pour quelques mois…
Quelques mois, en effet, mais guère plus. Comme je l’ai déjà rappelé en première lecture, s’agissant de la question de l’accès au dossier – on pourrait sans doute trouver d’autres exemples –, les exigences d’autres directives, déjà adoptées, nous obligeront à modifier de nouveau notre droit dans les années à venir. Cela se fera avec ce sentiment désagréable d’avoir parfois un train de retard et de devoir transposer en urgence des directives dont on connaît pourtant depuis plusieurs années les exigences et la portée. Mais cette situation n’est pas propre au droit pénal.
Dans un avis publié le 10 mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme regrette : « une approche disparate, segmentée des problématiques relatives à la phase d’enquête dont les réformes, qui interviennent au gré de l’arrivée à échéance des dates de transposition des directives et des évolutions des jurisprudences européenne et constitutionnelle, paraissent souvent inabouties, voire insuffisantes. Il en découle une complexification des dispositions du code de procédure pénale ».
Ce constat de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, nous le partageons. Dans la suite de son avis, elle appelle de ses vœux « une réforme d’envergure de l’enquête pénale, traduisant une vision politique d’ensemble », ainsi qu’« un travail législatif ambitieux et réfléchi ».
Évidemment, il ne s’agit surtout pas de dénigrer les avancées récentes qu’a connues notre procédure en matière d’amélioration des droits de la défense ; je pense notamment à la réforme de la garde à vue, il y a quelques années. Il s’agit surtout de souligner la nécessité de réaliser un travail global, cohérent, de modernisation de l’enquête et du procès pénal, tout en continuant à défendre ce qui fait la spécificité de la procédure pénale française.
La matière scientifique, la doctrine, est extrêmement riche en ce domaine et nous ne manquons pas de rapports – rapport Donnedieu de Vabres, déjà ancien, rapport Delmas-Marty, rapport Léger et bien d’autres... Il nous faut maintenant passer du temps de la réflexion à celui de la décision. Et, cette décision, elle revient au législateur, qui doit effectuer ce travail de modernisation de notre droit répressif.
Pour en revenir au texte que nous examinons aujourd’hui, les avancées qu’il contient pour améliorer les droits de la défense ne seront vraiment opérationnelles que si de nouveaux moyens budgétaires importants sont dégagés pour en garantir l’effectivité.
Or l’étude d’impact jointe au projet de loi se révèle incomplète à plusieurs égards. Comme Mme Untermaier, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, je regrette, par exemple, que l’étude d’impact n’évalue pas le coût en équivalents temps plein annuels résultant de la notification et de la mise en œuvre des droits du suspect – depuis l’élaboration du texte de la CMP, je devrais plutôt dire de la personne « soupçonnée » –, ni le coût pour les finances publiques de la rétribution des interprètes qui viendraient assister les personnes étrangères auditionnées par les services d’enquête.
Le travail qu’a réalisé notre rapporteur est allé dans le bon sens et je salue les améliorations qu’il a introduites. Nous nous devons évidemment de transposer toutes les directives mais, à titre personnel, je suis quelque peu sceptique sur les améliorations réelles apportées au fonctionnement de la justice pénale par certaines des dispositions introduites dans ce projet de loi.
Nous y sommes certes contraints, mais je me demande parfois si, à force de vouloir – de devoir, dirai-je – établir un nouvel équilibre entre les droits des enquêteurs et ceux des personnes interrogées, l’enquête et la justice ne risquent pas d’y perdre un jour en efficacité.
Je reconnais que cette question n’est pas nouvelle ; elle avait déjà été soulevée par d’autres collègues au moment de la réforme de la garde à vue.
S’agissant d’un texte de transposition, nous voterons bien sûr l’ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, en souhaitant toutefois qu’à l’avenir nous n’attendions pas le délai limite – je ne suis pas le premier à le dire, et je ne serai sûrement pas le dernier – pour transposer les directives, surtout dans un domaine aussi sensible que le droit pénal.
Le changement de méthode que vous avez évoqué dans votre intervention, madame la garde des sceaux, me semble donc aller dans le bon sens et nous permettra, je l’espère, d’échapper aux critiques périodiquement formulées par les instances européennes et qui, à titre personnel, me paraissent assez injustes, compte tenu de la qualité générale de nos policiers, de nos gendarmes et de nos magistrats.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, avant d’aborder le contenu de ce projet de loi, auquel je suis favorable, comme j’ai pu le souligner lors de mes interventions, je voudrais vous faire part de quelques réserves concernant la forme et, plus précisément, l’organisation du débat.
Première réserve : personne ne l’ignore ici, les parlementaires ont un rôle important à jouer au stade de la transposition des textes européens, notamment celui de veiller à ce que les transpositions soient fidèles et exhaustives. Et même si les objectifs de la directive doivent être respectés, nous disposons de marges de manœuvre concernant, par exemple, le choix des moyens pour parvenir à ces objectifs, ce qui nous permet, heureusement, de faire des choix politiques.
Tout cela pour dire que, même si nous devons nous efforcer de respecter les délais de transposition, cet effort ne peut pas systématiquement justifier le recours à une lecture accélérée, laquelle ne permet pas, in fine, au législateur d’exercer convenablement son rôle sur ces sujets parfois techniques.
Seconde réserve : ce projet de loi vise à mettre notre législation en conformité avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, qui doit être transposée au plus tard le 2 juin 2014. Il anticipe aussi la transcription d’une partie de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat des personnes suspectées dans la perspective de sa nécessaire transposition avant 2016.
Il est dommage que cette transcription partielle, qui intervient bien avant le terme du délai de transposition, tombe sous le coup d’une procédure accélérée – même si je comprends, madame la garde des sceaux, l’intérêt de lier la réflexion sur ces deux directives – et il est surtout dommage que l’on ait choisi de procéder par étapes en divisant le texte.
Tout comme notre rapporteur, je pense que le présent projet de loi pouvait être plus ambitieux et qu’il aurait été plus logique, plus efficace et, surtout, plus sûr de préparer une loi de transposition unique pour ces deux directives. Encore aurait-il fallu changer la méthode et chercher à anticiper…
En effet, tout comme la procédure accélérée, les réformes au coup par coup empêchent toute remise à plat ambitieuse et cohérente de notre procédure pénale. Pourtant, cette dernière, parce qu’elle touche à la liberté des personnes mises en cause, doit être sûre et s’inscrire dans le temps, sous peine d’être sans cesse remise en question et donc, de fait, de fragiliser les enquêtes en cours.
Madame la ministre, vous avez justifié ce choix par le souhait d’attendre la remise du rapport, prévue en juin, de la mission chargée de mener une réflexion globale sur l’enquête pénale. Malgré les réserves que je viens d’émettre, on ne peut reprocher cette recherche d’expertise, qui marque une volonté de bien faire de votre part et que nous saluons.
Nous espérons donc que le Parlement pourra se saisir de ces travaux, qui s’ajouteront à d’autres rapports déjà sur les bureaux depuis quelques années, pour proposer un texte d’ampleur, cohérent et ambitieux qui nous évitera par la suite de devoir revenir par à-coups sur notre code de procédure pénale.
Sur le fond, ma position n’a pas évolué depuis le débat que nous avons eu il a quelques semaines. Nous soutenons donc l’ensemble des avancées que contient ce texte.
Tout d’abord, quel que soit le cadre juridique de l’audition libre, la personne mise en cause bénéficiera désormais d’un certain nombre de droits.
Jusqu’à présent, au regard de la loi de 2011, la personne entendue sous le régime de l’audition libre ne bénéficiait d’aucun droit particulier, hormis celui d’être informée « de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».
Or ce type d’audition au cours de laquelle une personne est amenée à s’exprimer sur des faits pouvant donner lieu à des poursuites – cela signifie qu’elle est susceptible de s’auto-incriminer – doit être strictement encadré. Tel était d’ailleurs le sens des amendements que nous avions déposés en 2011.
C’est pourquoi nous ne pouvons que soutenir les avancées du texte en la matière, d’autant que plusieurs de nos amendements ont été adoptés en première lecture.
Le projet de loi marque par ailleurs une avancée significative dans le sens du renforcement du caractère contradictoire de notre procédure pénale lors de la phase d’instruction, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Chaque partie, assistée d’un avocat ou non, devrait avoir accès aux pièces du dossier, en obtenir copie, pouvoir présenter des observations sur chaque pièce et chaque acte réalisés au cours de la procédure, pouvoir solliciter des investigations, avoir connaissance des observations et des demandes des autres parties et être en mesure d’y répondre. Il s’agit là d’une composante essentielle des droits de la défense et du procès équitable.
Pour finir, je souligne le maintien de la suppression de l’article 10 par l’Assemblée nationale. Cet article prévoyait une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance sur le droit d’asile et constituait un véritable cavalier, susceptible d’avoir pour effet de restreindre sérieusement les droits des demandeurs d’asile. Notre vote sur l’ensemble du texte était subordonné à sa suppression.
En attendant de disposer d’une réforme d’ampleur qui pourrait, qui sait, permettre aux avocats d’accéder à l’intégralité du dossier lors de la phase de l’enquête, et notamment lors de la garde à vue, je souhaite souligner l’excellent travail mené par notre commission sur ce texte, malgré la multiplicité et la complexité des textes en cours d’étude au même moment.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et au banc des commissions.

(Sourires.) Nous avons en effet eu le bonheur de débattre du présent projet de loi et de trouver un accord, au terme d’un travail très constructif, dans lequel notre collègue Jean-Pierre Michel, avec le sérieux qui est le sien, a joué un rôle majeur.
M. le rapporteur sourit.

Madame la ministre, chère garde des sceaux, nous avons vécu mardi dernier un après-midi contrasté. §
Puis, ce fut une autre commission mixte paritaire, concernant un autre projet de loi, relatif cette fois à la modernisation et à la simplification de la justice et portant également transposition de quelques textes européens.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Chaque chose en son temps !
Sourires.

Certes ! Je souhaitais cependant vous dire, madame la ministre, que les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire ont défendu de manière unanime notre position, tenant qu’il ne serait pas raisonnable de légiférer par voie d’ordonnance sur ce qui représente un cinquième du code civil, je veux parler du droit des obligations et des contrats.
Depuis l’intéressante discussion que nous avons eue ensemble dans cette enceinte à ce sujet, nous avons consulté de nombreux juristes et professeurs de droit. Ils nous ont notamment expliqué que l’ordonnance en question, telle qu’elle était rédigée, soulevait de lourds problèmes : elle supprimait en particulier un article du code civil qui constitue la meilleure protection dont dispose notre pays contre les subprimes, dont chacun connaît les effets extrêmement néfastes. Je ne cite que cet exemple, mais il en est beaucoup d’autres.
Notre position, très forte, est donc partagée par l’ensemble des groupes de notre assemblée, madame la garde des sceaux. Nous avons longuement dialogué avec nos collègues députés, et je dois dire qu’après cette discussion je n’ai pas perçu, sur le fond, l’argumentation qui les avait conduits à rejoindre, en séance publique, et non en commission, dans un premier temps, la position que vous défendez au nom du Gouvernement en faveur de ces ordonnances.
Comme la commission mixte paritaire n’a pas abouti, le texte reviendra devant chaque assemblée. Son approfondissement peut, en conséquence, se poursuivre. J’émets le vœu que de nouveaux efforts de réflexion soient menés sur ce sujet.

Comme le dit justement notre collègue, un autre sujet a retenu notre attention, qui ne figurait pas du tout dans le texte initial. La procédure accélérée pose ici véritablement un problème. Elle peut se concevoir pour un certain nombre de textes, mais, lorsqu’un sujet entièrement neuf apparaît dans la seconde assemblée saisie, qui n’a pas du tout été évoqué dans la première, cela pose question.
Nous sommes très sensibilisés au sujet du bien-être animal, mais également à ce que nous disent les représentants de la profession agricole, tout particulièrement dans nos départements. À cet égard, il nous revient de définir les bonnes rédactions. Notre collègue Thani Mohamed Soilihi a formulé, en commission mixte paritaire, une proposition de rédaction particulièrement étudiée et judicieuse. Elle permettrait de répondre aux inquiétudes de professionnels qui ne sont pas actuellement épargnés par les difficultés.
Cette proposition, je le dis sous votre contrôle, mes chers collègues, a été perçue favorablement par les sénateurs membres de la commission mixte paritaire. Comme ce texte va revenir devant chacune de nos assemblées, j’espère que nous nous inspirerons de la sagesse de notre collègue sénateur de Mayotte pour trouver une formulation qui apaise les inquiétudes de la profession agricole. Celles-ci doivent, à mon sens, être prises au sérieux.

M. Jean-Pierre Sueur. Je sais que M. le rapporteur, qui connaît bien le département de la Haute-Saône, est également très intéressé par ce sujet, comme beaucoup de nos collègues, y compris en Seine-et-Marne, n’est-ce pas monsieur Hyest !
M. Jean-Jacques Hyest opine.

J’en viens à l’objet du débat. Vous aurez pardonné ce préambule, madame la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est fait ! Mais avec regret…
Sourires.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce regret s’accompagne cependant d’un large sourire, ce qui m’autorise toutes les interprétations !
Nouveaux sourires.

Mais je n’allais pas me contenter de répéter ce que mes collègues ont dit, et fort bien dit !
Le projet de loi, dans la rédaction présentée par notre rapporteur, Jean-Pierre Michel, à la suite de la commission mixte paritaire, améliore le droit sur nombre de points. Je les reprends.
Il crée un statut des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement, sans être placées en garde à vue. La commission mixte paritaire a d’ailleurs pris soin de bien employer les termes « suspecté » et « soupçonné » dans chacun des cas envisagés, afin que les choses soient très claires.
Le texte améliore les droits des personnes gardées à vue :elles seront plus précisément informées de l’infraction reprochée et des motifs de la garde à vue, elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat et recevront un document écrit énonçant leurs droits.
Une déclaration des droits sera donnée à toute personne privée de liberté au cours de la procédure pénale.
Les personnes poursuivies, si elles sont citées directement, ou convoquées par un officier de police judiciaire, pourront plus facilement exercer les droits de la défense. Le délai avant la date d’audience est ainsi porté de dix jours à trois mois, ce qui constitue une garantie considérable.
Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées d’un avocat.
Tout cela va dans le bon sens.
L’amendement qui a été voté en commission des lois à l’Assemblée nationale visant à ouvrir à l’avocat la possibilité de consulter l’intégralité du dossier dès la garde à vue, mais qui a été, comme au Sénat, repoussé en séance, aurait suscité de nombreuses difficultés pratiques. Cette mesure, de surcroît, n’est pas imposée par le droit communautaire. Il nous semble donc que la position finalement adoptée par la commission mixte paritaire, après les deux assemblées, est plein de sagesse.
Je voudrais, en outre, dire combien nous devons nous réjouir de voir que ce texte tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 relative au régime dérogatoire en matière de garde à vue. J’insiste, de même, sur le fait que, sur l’initiative de notre rapporteur, le Sénat a amélioré le texte en précisant le point de départ de la garde à vue quand celle-ci faisait suite à une audition libre, consacrant ainsi une jurisprudence de la Cour de cassation.
Enfin, je me réjouis que la commission mixte paritaire ait trouvé une rédaction satisfaisante en ce qui concerne l’accès au dossier des personnes détenues faisant l’objet d’une procédure disciplinaire. Cela fait le lien avec la proposition de loi que nous venons d’adopter et va dans le sens d’une amélioration nécessaire, en l’espèce, des droits des personnes détenues.
Pour terminer, je souhaite revenir, après notre collègue Yves Détraigne, sur une question que j’avais déjà abordée lorsque le texte était venu devant le Sénat, celle de l’aide juridictionnelle.
Vous savez, madame la ministre, combien l’étude d’impact nous avait impressionnés, même si l’évaluation laissait imaginer que l’on pouvait aller de 13 ou 14 millions d’euros au double de cette somme. Il y a là tout de même un véritable problème : les mesures positives que comprend ce texte auront pour effet d’augmenter le coût de l’aide juridictionnelle.
Plusieurs solutions ont été envisagées, qui ne répondent pas toutes à l’attente des différentes professions du droit. J’émets le vœu que l’on continue à travailler sur le sujet. La question de l’aide juridictionnelle se pose déjà, et deviendra encore plus cruciale avec l’application du présent texte.
Ce projet de loi est toutefois très largement positif. Comme Mme Esther Benbassa le soulignait, les textes de cette nature montrent bien que des décisions européennes peuvent nous aider à améliorer notre droit. C’est tout à fait bénéfique, et cela mérite d’être dit, surtout dans le contexte actuel !
Applaudissements.
Sans prolonger inconsidérément ces débats, je voudrais apporter quelques éléments d’information en réponse à M. le rapporteur, à M. Hyest ou à M. Détraigne, non sans avoir au préalable remercié les intervenants pour leurs observations, qui ont enrichi la réflexion et ont attiré notre attention.
Nous savons que nous aurons un prochain rendez-vous. J’envisage que nous puissions procéder avant la date limite à la transposition de la directive Accès à l’avocat. Nous reviendrons donc devant vous, mais les délais impartis seront plus confortables.
Concernant l’aide juridictionnelle, effectivement, un problème se pose. Parmi la demi-douzaine de rapports élaborés sur ce thème ces dix dernières années, le Sénat en a produit un excellent, qui rappelait la nécessité de « réformer un système à bout de souffle ». Aucune mesure n’a encore été véritablement prise, nous n’avons pas diversifié les ressources, nous n’avons même pas fixé de doctrine sur le sujet.
Vous le savez, j’ai l’ambition d’une grande politique de solidarité nationale. Je n’en ai pas encore les moyens ; je les ai cherchés en explorant plusieurs pistes, qui présentent, dans la conjoncture actuelle, quelques inconvénients. Certaines constitueraient ainsi des prélèvements obligatoires, qui sont très difficiles à accepter aujourd’hui.
Je reste cependant persuadée qu’il faut diversifier les sources et conférer à l’aide juridictionnelle un fondement solide et durable, qu’il faut remonter le plafond de ressources, bien inférieur au seuil de pauvreté, qu’il faut revaloriser l’unité de valeur, qui n’a pas été modifiée depuis sept ans, ce qui n’est pas facile à accepter.
Il faut également élargir le champ des contentieux : un certain nombre de justiciables à petits revenus sont confrontés à des affaires qui les pénalisent vraiment, mais qui n’entrent pas dans le champ prévu.
En outre, il conviendra d’adopter certaines dispositions pratiques, en vue d’assurer un meilleur fonctionnement de l’aide juridictionnelle et de fluidifier les procédures. Il y a donc à faire sur le sujet.
Cette transposition aura incontestablement un impact sur l’aide juridictionnelle, puisqu’elle va créer des besoins. En effet, nous permettons, dans le cadre de l’audition libre, l’accès à l’avocat. L’étude d’impact a estimé que les dépenses supplémentaires, y compris administratives, liées à l’aide juridictionnelle s’élèveront à 50 millions d’euros.
Pour vous rassurer au moins partiellement à ce stade, monsieur Hyest – vous seriez sans doute totalement rassuré si je vous disais que les crédits sont d’ores et déjà disponibles ! –, je puis vous dire que nous avons intégré ces 50 millions d’euros dans nos discussions budgétaires, en vue d’appliquer les dispositions que nous introduisons dans notre droit interne.
Concernant maintenant l’accès au casier judiciaire, monsieur le rapporteur, lorsque le bulletin figure au dossier, il doit être accessible, comme toutes les autres pièces.
Vous l’avez rappelé, une discussion avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, notamment, a été engagée à propos de la mise à disposition des pièces du dossier et de l’usage abusif qui pourrait en être fait.
À cet égard, on peut, me semble-t-il, séparer les problèmes.
Pour ma part, j’estime qu’il est nécessaire que les pièces soient mises à la disposition des défenseurs et, comme le prévoit ce texte, du justiciable s’il n’a pas d’avocat. Il y a sans doute lieu d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire, en veillant à ce que cela se passe de la même façon dans toutes nos juridictions et pour toutes les enquêtes.
La circulaire, qui est actuellement en phase de finalisation – elle sera même prête avant la promulgation de la loi –, le précisera, afin de régler véritablement les problèmes de disparité des pratiques sur le territoire.
En tout cas, lorsque des éléments sont rassemblés sur un citoyen quel qu’il soit, il est souhaitable, dans une démocratie en tout cas, que ce dernier puisse en avoir connaissance. Il ne saurait en être autrement dans un État de droit. D’ailleurs, nos fichiers sont mis à la disposition des citoyens concernés : ces derniers ont le droit d’y accéder et même de procéder à des rectifications. On ne comprendrait donc pas qu’il soit possible de rassembler toute une série d’éléments sur un citoyen, qui, en outre, peuvent lui être préjudiciables, sans autoriser ce dernier à y accéder.
Si j’ai bien compris, le rapporteur de l'Assemblée nationale craint que les employeurs ne profitent de l’accès des citoyens à ces pièces pour les leur réclamer.
Le droit du citoyen n’est pas le droit de l’employeur. D’une façon générale, le droit du citoyen n’est pas le droit d’un tiers sur le citoyen.
À cet égard, il convient d’établir une distinction : la loi autorise les citoyens à accéder à des pièces les concernant, mais elle n’ouvre pas ce droit d’accès à un tiers. Je ne vois pas de difficultés juridiques ou pratiques à procéder de cette façon. Nous veillerons à préciser les choses dans la circulaire.
Concernant la garde à vue de quatre-vingt-seize heures, vous vous en souvenez, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté à l’unanimité, dans le cadre du projet de loi relatif à la géolocalisation, me semble-t-il, de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 relative au régime dérogatoire en matière de garde à vue. Celui-ci avait en effet estimé que la garde à vue de quatre-vingt-seize heures ne pouvait pas être retenue lorsque seule une atteinte aux biens était en cause. Il nous était donc apparu à tous qu’il valait mieux être prudent, afin d’éviter que des procédures lourdes, en matière de criminalité organisée, par exemple, ne soient annulées pour ce motif.
L'Assemblée nationale avait introduit une disposition prévoyant une garde à vue de soixante-douze heures. J’avais émis des inquiétudes quant au risque d’inconstitutionnalité. Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, un travail a été réalisé avec la Chancellerie, aussi bien avec la direction des affaires criminelles et des grâces qu’avec mon cabinet, qui a abouti à une rédaction plus rassurante.
Eu égard au travail réalisé avec la Chancellerie, j’ai estimé que nous avions éliminé les risques d’inconstitutionnalité. Cela étant, je serai ici aussi prudente que je l’ai été à l’Assemblée nationale, car je n’ai pas compétence, ni qualité, d’ailleurs, pour affirmer qu’il n’existe aucun risque d’inconstitutionnalité – on pourrait alors dissoudre le Conseil constitutionnel ! –, mais je pense que le risque est probablement mineur, voire dérisoire.
J’avoue ne pas avoir fait preuve d’une audace débridée sur ce point, m’en remettant à la sagesse de l'Assemblée nationale. J’ai donc laissé les parlementaires porter la responsabilité d’un risque éventuel, même si, au nom de la solidité des lois et de la sécurité des procédures, j’ai veillé à ce que l’on élimine le plus possible le risque. Toutefois, je le répète, je n’ai pas qualité pour affirmer que le risque est nul.
En tout état de cause, mesdames, messieurs les sénateurs, le dispositif qui vous est proposé nous permettra, me semble-t-il, d’avancer avec plus d’assurance.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’audition des personnes soupçonnées et ne faisant pas l’objet d’une garde à vue
I. –
Supprimé
II. – Après l’article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61 -1. – La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
« Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
II bis. – L’article 62 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 62. – Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.
« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
« Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l’article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62-2.
« Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63-1. »
III. – Le premier alinéa du III de l’article 63 du même code est ainsi rédigé :
« III. – Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, autre que la rétention prévue à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition. »
IV. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article 73 du même code, après le mot : « conduite », sont insérés les mots : «, sous contrainte, ».
I. – À l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles ».
I bis. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 78 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 62 est applicable. »
II. – L'article 154 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article 63-1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 63-1 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l'audition ou ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux personnes faisant l’objet d’une privation de liberté
Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue
I. – L’article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de formulaires écrits » sont remplacés par les mots : « du formulaire prévu au treizième alinéa » ;
2° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« – du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
« – du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
II. – L’article 63-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa ou une copie de ceux-ci. »
II bis. – L’article 65 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 65 – Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 61-1. »
III. – L’article 706-88 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l’article 706-73 ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la Nation définis à l’article 410-1 du code pénal ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables. »
IV. – Au second alinéa de l’article 323-5 du code des douanes, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
V. – Au VII de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « sixième à avant-dernier ».
Section 2
Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté
I. – Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-6 ainsi rédigé :
« Art. 803 -6. – Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
« 1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
« 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
« 4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
« 5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
« 6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
« 7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
« 8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
« 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
« Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »
II. – Au deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction ou de jugement
Section 1
Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction
I. – L’article 113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».
III. – L’article 114 du même code est ainsi modifié :
1° A Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l’article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;
3° Au début du septième alinéa, les mots : « L’avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs » ;
5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont supprimées ;
b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;
6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;
7° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».
IV. – L’article 116 du même code est ainsi modifié :
1° A Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après l’avoir informée, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète, le juge …
le reste sans changement
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne est également informée, s’il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d’instruction », sont insérés les mots : «, après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, » ;
3° La cinquième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le juge d’instruction informe ensuite la personne qu’elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. »
V. – À la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
VI. – 1. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
À l’article 114-1 du code de procédure pénale, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Section 2
Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement
I. – Au début de l'article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge ».
II. – Au début du premier alinéa de l’article 328 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Après l’avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».
III. – Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par des articles 388-4 et 388-5 ainsi rédigés :
« Art. 388 -4. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
« À leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d’un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
« Art. 388 -5. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
« S’il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu’il est possible de les exécuter avant la date de l’audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l’exécution selon les règles applicables au cours de l’enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d’être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l’article 63-4-3.
« Si les actes demandés n’ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l’audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l’article 83, pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. S’il refuse d’ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond. »
IV. – Après le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. »
V. – L’article 390-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ».
V bis. – Après le même article 390-1, il est inséré un article 390-2 ainsi rédigé :
« Art. 390 -2. – Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l’article 390 ou la notification de la convocation prévue à l’article 390-1 et l’audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’ont pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier demandé en application de l’article 388-4, le tribunal est tenu d’ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l’affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation. »
VI. – L’article 393 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui.
« Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. » ;
1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu. »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63-4-3. »
VII. – À l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 ».
VIII. – L’article 394 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L’avocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d’office, commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l’ouverture d’une information. »
IX. – La première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »
X. – À l'article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est insérée la référence : «, 388-4 ».
XI. –
Supprimé
XII. – L’article 706-106 du même code est abrogé.
XIII. – À l’article 706-1-2 du même code, les références : « 706-105 et 706-106 » sont remplacées par la référence : « et 706-105 ».
XIV. – À la première phrase de l’article 495-10 du même code, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
L’article 803-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. »
I. – À la fin de l’article 279 du code de procédure pénale, les mots : « procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise » sont remplacés par les mots : « pièces du dossier de la procédure ».
II. – L'article 280 du même code est abrogé.
Chapitre III bis
Dispositions relatives à l’accès aux preuves des personnes détenues poursuivies en commission disciplinaire
Le 4° de l’article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l’avocat, ou l'intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »
Chapitre IV
Dispositions diverses
I. – Après l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :
« Art. 67 F. – La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
« S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »
II. – L’article 323-6 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » ;
2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. »
La troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
2° Au début, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :
« Art. 64. – L’avocat assistant, au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Les articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est applicable en Polynésie française.
II. – Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »
II bis. – Au second alinéa de l'article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. – Le titre V de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 23 -1 -1. – L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l’audition ou de la confrontation prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° À l’article 23-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
I. – La présente loi entre en vigueur le 2 juin 2014.
Toutefois, le 5° et le neuvième alinéa de l’article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, l’article 1er bis de la présente loi, la référence à l’article 61-2 figurant dans les articles 77 et 154 du même code dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, l’article 8 et les II à III de l’article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
II. –
Supprimé

Nous allons maintenant examiner les deux amendements déposés par le Gouvernement.

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19, première phrase
Supprimer les mots :
autre que la rétention prévue à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique,
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Par cet amendement, nous tirons les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel intervenue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Sénat avait déjà amélioré les modalités de computation des délais de garde à vue, estimant que, si la garde à vue avait été précédée d’une audition libre, la durée de l’audition libre devait être intégrée dans la durée de la garde à vue. L'Assemblée nationale avait alors prévu une exception concernant le temps passé en cellule de dégrisement.
Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que ce temps doit être compté dans la durée de la garde à vue. Il me paraît donc risqué de maintenir cette exception.
C’est pourquoi nous réintroduisons le temps passé en cellule de dégrisement dans le temps de la garde à vue.
Tel est l’objet du présent amendement.

Permettez-moi au préalable de vous dire, madame la garde des sceaux, que les assemblées parlementaires n’apprécient pas tellement que des amendements soient déposés sur les conclusions d’une commission mixte paritaire.

Cela dit, j’émettrai à titre personnel un avis favorable sur cet amendement, et sur celui qui le suit.
Ce texte, examiné en urgence eu égard aux délais qui nous sont impartis, est, on l’a vu, compliqué et exige donc qu’on lui porte une attention particulière. Des erreurs ont pu être commises – en l’espèce, c’est le cas ! –, qui n’ont été relevées par aucun des membres de la commission mixte paritaire – après tout, nous pouvons, nous aussi, battre notre coulpe ! – ; certains articles doivent faire l’objet d’une coordination avec d’autres. Tel sera l’objet du second amendement.
La commission des lois ne s’est pas réunie, mais, à titre personnel, je pense que nous pouvons accepter cet amendement de précision, sans lequel le texte serait imparfait, le Conseil constitutionnel considérant que le temps de présence en cellule de dégrisement doit être imputé sur le délai de garde à vue.
L'amendement est adopté.

Sur l’article 2, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...
Le vote est réservé.

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les références :
, 4° et 5° de l’article 61-1
par la référence et les mots :
et 4° de l’article 61-1, et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Vous ne l’ignorez pas, mesdames, messieurs les sénateurs, je répugne à présenter des amendements en cours de discussion. Je m’impose une discipline très rigoureuse pour que le Parlement fasse son travail d’élaboration des lois. J’estime qu’il est préférable de présenter les amendements en amont pour permettre aux commissions d’en débattre et d’améliorer, le cas échéant, la rédaction des dispositions proposées, comme cela est parfois nécessaire.
Mais, comme l’a souligné M. le rapporteur, la technicité de ce texte est telle que nous nous rendons compte au fur et à mesure de son examen que des choses ont pu nous échapper.
L’amendement n° 2 est un amendement de précision. Lorsque, au cours d’une garde à vue, la personne est entendue sur une infraction autre que celle qui a justifié la mesure – cela revient à une audition libre -, le projet de loi prévoit que la personne doit être informée de son droit d’être assistée, dans ce nouveau cadre, par un avocat.
Cette précision paraît nécessaire : il convient de rappeler les droits liés à cette audition libre au sein de la garde à vue.
Tel est l’objet de cet amendement.

Ma position personnelle est identique, d’autant qu’il s’agit d’un amendement encore plus technique que le précédent.
Cet amendement vise en outre à lever une ambiguïté importante dans le texte : l’entrée en vigueur de l’intervention de l’avocat au cours de l’audition libre est reportée au 1er janvier 2015, alors que l’intervention de l’avocat lors de la garde à vue pour des infractions autres que celles ayant justifié la mesure doit être immédiate.

Il paraît nécessaire de lever cette ambiguïté. Je ne vois donc pas d’objection à accepter cet amendement, pas plus que M. Hyest, sans doute.
L'amendement est adopté.

Sur les articles 4 à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.