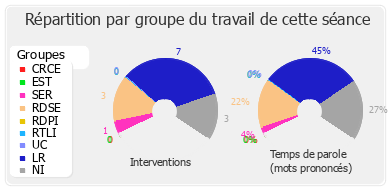Séance en hémicycle du 11 février 2009 à 21h00
Sommaire
- Hommage aux soldats tombés dans une embuscade en afghanistan
- Conférence des présidents (voir le dossier)
- Création d'une première année commune aux études de santé (voir le dossier)
- Retrait d'une question orale
- Dépôt d'un texte d'une commission
- Textes soumis au sénat en application de l'article 88-4 de la constitution
- Dépôt de rapports
- Dépôt d'un rapport d'information
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures cinquante-cinq.

La séance est reprise.

Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons appris avec beaucoup de douleur qu’un officier français et son interprète afghan avaient été tués dans une embuscade et qu’un sous-officier français avait été grièvement blessé.
Je vous demande d’observer une minute de silence en hommage à ces hommes.
Mme la ministre et Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et observent une minute de silence.

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
Jeudi 12 février 2009
Ordre du jour prioritaire :
À 9 heures 30 et à 15 heures :
1°) Suite du projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
À 22 heures :
2°) Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, en application de l’article 72-4 de la Constitution, sur la consultation des électeurs de Mayotte sur le changement de statut de cette collectivité ;
La conférence des présidents :

Mardi 17 février 2009
À 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 384 de M. Yves Daudigny à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Délimitation de l’aire géographique des AOC « Champagne »
Avenir de la Société nationale des poudres et des explosifs de Bergerac

- n° 405 de M. Jean Boyer à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 406 de M. Daniel Reiner à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 407 de Mme Bernadette Bourzai à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
Avenir du site de Meymac appartenant au groupe pharmaceutique Bristol-Myers Squibb

- n° 408 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
Amélioration des infrastructures routières dans le Gers

- n° 409 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à Mme la ministre du logement ;
Cession du pôle logement d’Immobilière Caisse des dépôts

- n° 410 de Mme Françoise Laborde à M. le Premier ministre, transmise à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
Délocalisations et crise des équipementiers automobiles en Haute-Garonne

- n° 412 de M. Daniel Laurent à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Modification du code de la propriété intellectuelle et protection des obtentions végétales

- n° 413 de Mme Françoise Férat à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 415 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Projet de délocalisation du service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements

- n° 416 de Mme Nathalie Goulet à M. le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance transmise à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
Groupe de travail concernant la ligne SNCF Paris-Granville

- n° 417 de M. Alain Fauconnier à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Problèmes des droits de douane américains sur les produits agricoles français

- n° 419 de M. Gérard Longuet à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
Impact du prix du gaz trop élevé sur les activités des serristes
Mesures prises récemment au niveau national concernant la requalification des copropriétés dégradées

- n° 424 de Mme Éliane Assassi à M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, transmise à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Prise en charge en France des réfugiés et demandeurs d’asile victimes de la torture dans leur pays d’origine
Nouvelle carte militaire et avenir de la base d’aéronautique navale de Nîmes-Garons

- n° 426 de M. Antoine Lefèvre à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Réaménagement de la RN 2

Ordre du jour prioritaire :
À 16 heures et le soir :
2°) Suite du projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
Sur la proposition de la conférence des présidents, le sénat a décidé d’examiner à partir de 16 heures les articles 13, 13 bis et 13 ter du projet de loi organique

Mercredi 18 février 2009
Ordre du jour prioritaire :
À 15 heures et le soir :
1°) Suite du projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
2°) Projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports (Urgence déclarée) (n° 501, 2007-2008) ;
La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ;

Jeudi 19 février 2009
À 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire :
1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole), (n° 144, 2007 2008) ;
3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, (n° 274, 2007-2008) ;
4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale, (n° 275, 2007 2008) ;
5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993, (n° 38, 2008 2009) ;
Pour les quatre projets de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée ;

6°) Suite de l’ordre du jour de la veille ;
À 15 heures et le soir :
3°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour prioritaire :
4°) Suite de l’ordre du jour du matin.
Je rappelle que le Sénat suspendra ses travaux en séance plénière du samedi 21 février 2009 au dimanche 1er mars 2009.
Semaine réservée par priorité au Gouvernement
Mardi 3 mars 2009
À 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 387 de Mme Marie-Thérèse Hermange à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- n° 394 de M. Bernard Piras à Mme la ministre de la culture et de la communication ;
- n° 398 de M. Jacques Mézard à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 404 de M. Roland Courteau à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 414 de M. Claude Bérit-Débat à M. le ministre de la défense ;
- n° 418 de Mme Esther Sittler à M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique ;
- n° 420 de M. Jean-Jacques Mirassou à M. le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants ;
- n° 421 de M. Didier Guillaume à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 422 de M. Jean-Paul Amoudry à M. le ministre de l’éducation nationale ;
- n° 429 de Mme Bernadette Bourzai à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 430 de Mme Raymonde Le Texier à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 431 de M. Christian Demuynck à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
- n° 432 de M. Gérard Bailly à M. le secrétaire d’État chargé des sports ;
- n° 434 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
- n° 435 de M. Louis Nègre à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 436 de M. Rémy Pointereau à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 443 de M. Claude Biwer à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
- n° 446 de M. Michel Billout à M. le Premier ministre ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 16 heures et le soir :
2°) Projet de loi pénitentiaire (texte de la commission, n° 202, 2008-2009) ;
La conférence des présidents a fixé :

Mercredi 4 mars 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi pénitentiaire.
Jeudi 5 mars 2009
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite du projet de loi pénitentiaire ;
À 15 heures et le soir :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite de l’ordre du jour du matin.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec un grand plaisir que je viens ce soir devant vous soutenir la proposition de loi portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
C’est un plaisir à plusieurs titres et, tout d’abord, en vertu de l’amitié qui me lie à la fois au rapporteur Jean-Claude Etienne, éminent professeur avec qui nous avons toujours travaillé en parfaite intelligence, et au président Jacques Legendre, dont les avis judicieux sur notre système d’enseignement éclairent toujours utilement l’action du Gouvernement, singulièrement de la ministre de l’enseignement supérieur.
Monsieur le président de la commission des affaires culturelles, monsieur le rapporteur, je tenais dès à présent à vous remercier sincèrement du travail que vous avez effectué pour faire avancer la cause des étudiants en santé.
C’est un sujet que vous connaissez particulièrement bien, monsieur le rapporteur, puisque, déjà en 1997, vous cosigniez avec Jean-François Mattéi et Jean-Michel Chabot un ouvrage plaidant pour la réforme de la première année des études de santé.
Je tiens aussi à remercier le président Nicolas About et le rapporteur pour avis Gérard Dériot d’avoir mis leurs compétences au service du bon avancement de cette réforme.
Monsieur Dériot, vous avez en la matière, de par votre profession de pharmacien, une expérience incontestable ; je vous remercie de vous être saisi du sujet pour nous apporter votre éclairage.
C’est aussi un plaisir pour moi de venir soutenir une initiative parlementaire commune au Sénat et à l’Assemblée nationale afin de combattre résolument l’échec en première année d’études de santé.
Enfin, c’est un plaisir de venir débattre avec vous tous d’un sujet qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur.
En effet, ainsi que MM. Etienne et Dériot l’ont souligné dans leur rapport respectif, chaque année ce sont 57 000 jeunes qui s’engouffrent en première année de médecine et de pharmacie, avec, le plus souvent, une très faible de chance de « décrocher » un concours : pour 80 % d’entre eux en médecine et 72, 4 % d’entre eux en pharmacie, cette première année est synonyme d’échec et, parfois, de vocation brisée. J’ajouterai même que, pour la majorité d’entre eux, cela signifie au mieux une nouvelle année de travail, de sacrifices et d’efforts qui aboutiront au même résultat, l’échec.
Ainsi, un très bon étudiant peut, à l’aube de sa vie professionnelle, perdre deux ans en première année de pharmacie, puis perdre deux nouvelles années en première année de médecine, ou l’inverse, c’est-à-dire perdre en tout quatre ans d’études supérieures pour aboutir à un échec, sans équivalence et sans voie de réorientation.
Ce gâchis de temps, d’énergie, d’espoirs et de rêves n’est pas acceptable.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous nous proposez d’agir. Je réponds à votre appel.
Vous savez ma volonté déterminée de faire de la licence une chance pour nos enfants : renforcer les socles de connaissances, ouvrir aux langues et au monde de l’entreprise tous les cursus pour faciliter les réorientations, l’insertion professionnelle et combattre l’échec.
Alors que toutes les composantes de l’Université - je dis bien « toutes » - ont pris le chemin de la réforme de leur première année de licence et bénéficient à ce titre du plan « réussir en licence », il serait incohérent de laisser les formations en santé de côté. C’est la chance des étudiants, et les présidents d’universités et directeurs d’unités de formation et de recherche – UFR - de santé ne s’y sont pas trompés puisqu’ils soutiennent tous votre initiative.
Qu’est-ce que le plan « Réussir en licence » ? C’est tout simplement relever le défi d’amener 50 % d’une classe d’âge vers son chemin de réussite. On en est loin en études de santé, n’est-il pas temps de s’y acheminer ?
Le plan « Réussir en licence » signifierait, pour les études de santé, entrer dans le système licence-master-doctorat et le processus de Bologne. Cela signifierait aussi mettre fin à la sélection par défaut du concours unique pour organiser une première année d’études commune aux quatre professions de médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes.
Tous ces professionnels de santé seront amenés à travailler ensemble et de façon coordonnée tout au long de leur carrière. Le moment est bien choisi pour souligner ce point, à la veille du vote à l’Assemblée nationale de la réforme conduite par ma collègue Roselyne Bachelot, qui met en place les agences régionales de santé chargées de coordonner tous les acteurs de santé d’un même territoire.
À l’évidence, cette coopération doit commencer dès la première année d’études. Outre la richesse incontestable de l’ouverture à l’autre, des bénéfices en termes d’informations sur les différentes carrières et les métiers de santé, la collaboration de toutes les filières est le gage, je le crois, d’un meilleur fonctionnement de notre système de santé et d’une meilleure prise en charge des patients.
Une année commune sanctionnée par quatre concours distincts, cela permettra à chaque étudiant de construire son parcours de réussite en fonction de ses motivations, et donc de sa vocation. C’est lui qui choisira la carrière qu’il souhaite embrasser.
Alors, bien sûr, cela ne signifie pas la fin du numerus clausus ni de la sélection. Celle-ci est et restera sévère, comme dans toutes les filières d’exigence et d’excellence. Elle est nécessaire. Mais aujourd’hui, c’est un effet de couperet sans appel pour de trop nombreux étudiants. C’est cela que nous devons combattre. Dans toutes les autres filières d’excellence, les étudiants échouant aux concours se voient reconnaître les crédits équivalant à leurs années de préparation. Des garanties du même ordre doivent être offertes aux étudiants de PCEM 1 et de première année de pharmacie.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que vous examinez aujourd’hui permet de corriger ce défaut rédhibitoire, tout simplement en créant une année commune aux quatre professions de santé concernées. Pour que cette année commune soit orientée non plus seulement vers le concours mais aussi vers d’autres parcours de formation, une nouvelle maquette est élaborée par des équipes pédagogiques engagées depuis de longs mois dans cette réforme. C’est la meilleure façon de donner à chacun sa chance de réussir. Poser des bases solides en sciences fondamentales tout en ouvrant l’enseignement aux matières plus littéraires permettra à ceux qui se réorienteront de réussir dans d’autres cursus.
Mais cette proposition de loi n’oublie pas ceux qui auront eu le cheminement inverse, c’est-à-dire ceux qui auront commencé leur formation dans une autre filière avant de découvrir leur vocation de professionnel de santé. Pour ceux-là, il semblait absolument indispensable d’ouvrir de nouvelles passerelles, parce qu’on ne sait pas toujours à dix-huit ans ce que l’on voudra faire toute sa vie, parce qu’il est extrêmement enrichissant pour un professionnel de santé d’avoir des connaissances dans d’autres domaines, et notamment en sciences humaines et sociales. La diversification des profils de nos futurs professionnels de santé est un atout supplémentaire et un gage de meilleure prise en charge des patients.
Ces passerelles, nombreuses, viendront s’ajouter à celle qui existe déjà. Elles permettront de donner leur chance aux vocations tardives, mais aussi d’accorder une deuxième chance à ceux qui auront échoué à dix-huit ans et qui voudraient renouer avec leur première vocation. C’est encore une façon de réduire la pression et la tension qui règnent actuellement en première année.
L’objectif de cette réforme est donc double. Elle vise à réduire le taux d’échec mais, surtout, à mieux orienter chacun de nos étudiants pour leur donner, à eux aussi, les moyens de s’épanouir dans leurs études.
C’est pourquoi je me réjouis, monsieur Jean-Claude Etienne, que votre proposition de loi prévoie la mise en place d’un « droit au remords » pour les étudiants qui, après avoir réussi plusieurs concours, reviendraient sur leur choix initial pour rejoindre une autre filière à laquelle ils pourraient prétendre.
Associer les pharmaciens à cette année commune prend alors tout son sens. Comment concevoir que ces derniers, qui ont un rôle de conseil auprès de la population, qui sont les experts des médicaments et les vigiles des médecins prescripteurs, ne partagent pas avec eux les bases de l’enseignement initial, fondement d’une culture commune ? Cela ne se fera pas en un jour, je le sais. Mais je sais aussi que les autorités représentatives des pharmaciens y tiennent vraiment. Ils me l’ont dit. J’ai confiance dans leur engagement moderne, sincère et résolu.
Toutes les autorités représentatives des quatre professions concernées se sont beaucoup engagées pour faire avancer cette réforme. Elles ont participé, dès octobre 2007, à la mission orchestrée par le professeur Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, que j’avais moi-même chargé de réfléchir aux améliorations qu’il est possible d’apporter à l’actuel PCEM 1. Elles ont participé à la concertation menée sur les dix recommandations du professeur Bach, avec tous les partenaires concernés, pour définir les grands principes de la réforme. Elles ont collaboré, avec la direction générale de l’enseignement supérieur, à l’élaboration d’une véritable feuille de route de la réforme dès le mois de juillet 2008, diffusée depuis lors à toutes les universités. Enfin, elles ont commencé à mettre en place, dans les universités, les outils et les équipes indispensables à la mise en œuvre concrète de la réforme le plus tôt possible.
Mesdames, messieurs les sénateurs, votre vote est très attendu puisqu’il conditionne la mise en place d’une réforme que l’on retardait depuis vingt ans, une réforme qui vise à améliorer l’organisation de la première année au bénéfice des étudiants.
Nous partageons le même constat – celui du gâchis de ces jeunes vocations –, alors donnons-nous les moyens d’agir, et c’est ce que nous propose aujourd’hui Jean-Claude Etienne. Si je sais que beaucoup d’entre vous partagent mon analyse, je sais aussi que certains ont fait entendre des doutes, voire des craintes. Aussi, je voudrais insister sur deux points.
D’abord, toutes les conditions matérielles sont réunies afin que l’État accompagne les universités et les étudiants pour le plus grand succès de la réforme. Vous avez voté en novembre dernier les moyens financiers du plan « Réussir en licence », qui ont été élargis, pour la première fois depuis janvier 2009, aux unités de formation et de recherche de santé. Cela représente jusqu’à 25 % d’augmentation de leurs moyens ! Ces crédits seront en partie utilisés pour renforcer le tutorat, car il nous semble que c’est le meilleur outil pour encourager les bons étudiants à persévérer et pour mener les plus fragiles vers la réussite.
Ensuite, je souhaite insister sur ma volonté d’associer, au plus vite, tous les acteurs au travail de réflexion et de rédaction que nous menons actuellement sur les textes d’application. Depuis l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi commune déposée par le député Jacques Domergue et par le sénateur Jean-Claude Etienne, mes services travaillent activement à la rédaction de projets d’arrêtés d’application, afin de pouvoir amorcer dès que possible la concertation sur les modalités de mise en œuvre de la réforme.
Vous l’aurez compris, cette réforme est faite au bénéfice des étudiants. Il est bien évident qu’ils seront invités, comme les autres parties, à réfléchir avec nous aux modalités de sa mise en œuvre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous pouvez le constater, c’est l’intérêt des étudiants qui guide mon action et qui a présidé à l’initiative des parlementaires Jean-Claude Etienne et Jacques Domergue, ce qui ne vous étonnera pas venant de leur part !
Au nom du Gouvernement, j’émets donc un avis très favorable sur ce texte qui rejoint et poursuit l’action politique que je mène depuis mon arrivée au ministère.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ils sont jeunes, ils ont 19 ou 20 ans, ils sont étudiants, ils voulaient être pharmacien, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
En juin 2008, vous l’avez dit, madame la ministre, ils étaient quelque 57 000 à se présenter et 44 509 ont été recalés.
Pour que l’échec ne soit pas vécu par ces jeunes comme une meurtrissure rédhibitoire – c’est le qualificatif que vous avez employé, madame la ministre –, nous devons accompagner ces étudiants ainsi fragilisés.
Nous devons leur offrir une possibilité de rattrapage pour revenir, aussi rapidement que possible, dans la filière de la santé, mais après avoir reçu un complément de formation dans les disciplines – souvent les mathématiques, la physique ou la chimie – où ils auraient pu se montrer insuffisamment préparés.
Nous devons également les aider à s’exprimer dans des domaines nouveaux où ils se trouveraient en meilleure adéquation avec leurs propres talents et où, par voie de conséquence, le succès serait mieux assuré.
C’est notamment à ce rendez-vous d’orientation, conforté ou infléchi, que cette proposition de loi nous invite.
Pour n’avoir jusqu’à présent rien tenté, ou presque, dans ce domaine, l’accès des jeunes Français aux études de santé s’apparente – cela a été souligné par plusieurs d’entre vous, et non des moindres – à un véritable parcours du combattant pour initiés, au moment même où l’on met en place en Europe, à la suite des accords de Bologne, le principe de formations par unités d’enseignement semestrialisées, préfigurant la généralisation du système licence-master-doctorat.
Qu’il me soit permis en l’instant de vous dire combien j’ai eu à cœur de déposer cette proposition de loi sur le bureau de la Haute Assemblée, alors que le député Jacques Domergue en faisait autant de son côté à l’Assemblée nationale.
Les aléas de l’ordre du jour ont permis à l’Assemblée nationale d’examiner en premier le texte qui vous est aujourd’hui soumis, mes chers collègues.
Je vais résumer en quelques mots les trois objectifs prioritaires de cette proposition de loi.
Tout d’abord, elle vise à permettre aux étudiants de véritablement choisir la filière qui leur convient le mieux – pharmacie, odontologie, maïeutique ou médecine – et donc à éviter ce à quoi ils sont soumis aujourd’hui, c’est-à-dire à faire un choix par défaut.
Ce choix par défaut introduit de facto une hiérarchie entre les quatre disciplines, qui doivent pourtant travailler ensemble. Or, on le sait bien, la médecine est la filière choisie avant la pharmacie, l’odontologie ou la maïeutique. À cet égard, j’espère que M. Autain ne m’en voudra pas de désigner ainsi la discipline de nos sages-femmes.
Sourires

Ensuite, elle tend à offrir de nouvelles perspectives en réorientant sans attendre les étudiants, soit vers un redoublement éventuellement conforté, soit vers un tout autre domaine.
Enfin, elle vise à développer une culture commune aux différents professionnels de santé, laquelle est pour le moment limitée à la première année « L 1 santé ».
Notre sentiment est que, au cours des années à venir, il conviendrait que les quatre branches de l’arborisation de la santé puissent se retrouver sur des thématiques partagées, répondant en forme d’écho tout au long de leur formation au partage culturel qui est proposé dans la « L 1 santé ». D’ailleurs, je vous remercie, madame la ministre, d’avoir rappelé mon engagement en faveur d’un tronc culturel commun des professions de santé.
L’apport des pharmaciens à ce socle culturel commun donne aux étudiants qui choisissent cette voie une possibilité de choix qui vient compléter l’éventail professionnel déjà constitué par les odontologistes, les médecins et les sages-femmes, ouvrant ainsi des possibilités de passerelles plus nombreuses, augmentant donc le choix et facilitant l’orientation des étudiants.
Le bénéfice que les pharmaciens peuvent en attendre est à la hauteur de leur apport. En pratiquant de la sorte, nous ajoutons une touche supplémentaire à la palette d’intervention dans le domaine des soins telle qu’elle est aujourd’hui assurée par les pharmaciens.
On connaît leur rôle dans la préparation et la délivrance des traitements tant en officines qu’en centres de soins. On connaît également leur rôle dans les laboratoires d’analyses ou de recherches. En revanche, on connaît moins un aspect particulièrement prometteur dont il convient de faire le plus grand cas – c’est ce que fait la proposition de loi –, à savoir leur présence dans l’équipe soignante, notamment pour la gouvernance des thérapeutiques. Aujourd’hui, un centre de soins ne peut plus concevoir une thérapeutique lourde ou structurée sans un pharmacien.
Cette proposition de loi vise donc à compléter et à moderniser la formation initiale dans le domaine de la santé en rapprochant les quatre disciplines, qui sont ainsi regroupées. Pour ce qui concerne la création de passerelles, vous y avez suffisamment insisté, madame la ministre, pour que je n’y revienne pas. Je précise simplement que deux catégories d’étudiants pourront bénéficier des passerelles dites « entrantes ». Je me permets d’insister sur ce point, car, en commission, certains de mes collègues souhaitaient avoir des précisions.
Premièrement, les candidats titulaires de master, de diplômes d’écoles de commerce ou d’instituts d’études politiques pourront désormais intégrer cette filière grâce à la proposition de loi.

Deuxièmement, des étudiants ayant validé au moins trois années d’études médicales, c’est-à-dire la première année plus deux années dans l’une des quatre filières, pourront se réorienter vers l’une de ces filières. C’est le fameux « droit au remords », que vous n’avez pas manqué de mentionner, madame la ministre.
J’ai consulté les représentants des étudiants et des enseignants, car certains disaient que ces dispositions suscitaient beaucoup d’interrogations, voire des réticences.
Il s’avère que, comme je l’ai clairement dit en commission, la Conférence des présidents d’université m’a écrit pour m’indiquer que la plupart des universités sont prêtes à s’impliquer le plus rapidement possible dans cette réforme. J’ai reçu un témoignage identique de la part de la Conférence des doyens d’UFR de pharmacie.
Je passerai sous silence les doyens de facultés de médecine et les doyens de facultés d’odontologie, qui étaient animés d’une certaine acrimonie à l’idée que l’on puisse repousser la mise en œuvre de cette réforme. J’ai d’ailleurs reçu des coups de téléphone en ce sens cet après-midi. Cependant, je continue à penser que nous devons respecter la minorité qui n’a pas encore acquis la certitude la plus absolue du bien-fondé de cette importante refonte du système de la première année d’études de santé.
Madame la ministre, conforté par mes collègues, et sur toutes les travées, je fais le plus grand cas de ceux qui s’interrogent. Je ne doute pas que, tout à l’heure, vous aurez à cœur de lever ces doutes de la façon la plus nette. Nous avons en effet besoin que tout le monde prenne la pleine mesure de l’événement et y souscrive. Je pense que la sérénité de la réflexion peut encore s’imposer à ceux – rares – qui se posent des questions.
Ayant pris en compte ces interrogations, vous ne serez pas étonnée que la commission ait déposé un amendement visant à retenir le principe – ô combien salvateur ou jugé comme tel par certains ! – de reporter l’application de ce texte le temps d’obtenir des assurances et de permettre aux universités de construire des thématiques de programmes et, éventuellement, des articulations avec les autres UFR afin que les passerelles prennent d’entrée de jeu toute leur signification.
Pour conclure, je voudrais dire que, avec cette réforme, la législation prend pour la première fois en compte un aspect qui, jusqu’à présent, il faut bien le confesser, avait été quelque peu négligé. Cette proposition de loi oblige en effet à un accompagnement systématisé des étudiants en situation d’échec. On expérimente ici un protocole d’assistance à l’étudiant pour lui éviter de se fourvoyer dans des impasses qui confinent parfois au gâchis, sur le plan tant individuel que collectif.
La proposition de loi initie enfin une épure culturelle commune aux professionnels de santé au moment où le travail en équipe de ces derniers apparaît de plus en plus souvent comme une exigence garantissant la performance des soins.
C’est pourquoi je me permets, mes chers collègues, de vous inviter à adopter cette proposition de loi, sous réserve du vote de l’amendement de report d’un an de sa date d’application.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a souhaité se saisir pour avis de cette proposition de loi, car, malgré sa brièveté, elle revêt à nos yeux une très grande importance.
En effet, au-delà d’une question d’organisation de l’enseignement supérieur, ce qui n’est déjà pas simple, ce texte vise à réformer le début du parcours des professionnels de santé dans notre pays. Or, dans le contexte démographique actuel de ces professions et à la veille de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, la proposition de loi comporte un réel enjeu. Il convient donc de replacer les modalités de cette nouvelle réforme et d’en apprécier les conséquences au regard de l’ensemble des évolutions en cours du monde de la santé. Par le passé d’ailleurs, la commission des affaires sociales s’est toujours exprimée sur les réformes des études médicales.
Comme cela a été dit par Mme la ministre et par notre excellent collègue Jean-Claude Etienne, le texte que nous examinons aujourd’hui vise avant tout à remédier aux défauts du système actuel et, en particulier, à accroître les chances des étudiants qui souhaitent s’engager dans des études de santé. L’un des apports essentiels de cette réforme est d’associer les quatre branches des professions de santé, qui doivent aujourd’hui travailler en permanence ensemble.
Cet objectif est évidemment prioritaire, car si l’on ne peut faire l’économie d’un mécanisme de sélection dès le début du cursus des études médicales, il n’est pas acceptable que celui-ci génère un taux d’échec aussi élevé que celui que l’on observe dans nos universités, ce qui est sans équivalent, à ce niveau d’étude, dans le reste du système éducatif de notre pays. Il est donc effectivement impératif de tout faire pour que les étudiants actuellement en situation d’échec, malgré parfois de bons résultats, aient la possibilité de se réorienter.
La mission confiée au professeur Jean-François Bach a permis de dégager, après une large concertation, des propositions concrètes de réforme. La commission des affaires sociales souscrit pleinement aux quatre objectifs que ces propositions visent à atteindre.
Premièrement, il s’agit de favoriser la réorientation rapide des étudiants ayant les plus grandes difficultés, le but étant de limiter le nombre des redoublements à l’issue de la première année.
Deuxièmement, il s’agit de rapprocher les quatre filières, c’est-à-dire la médecine, l’odontologie, la maïeutique et la pharmacie, pour développer un tronc commun à ces études, pour créer une culture commune chez les futurs acteurs de santé qui, comme l’a rappelé tout à l’heure Jean-Claude Etienne, seront amenés à collaborer dans leur vie professionnelle ultérieure et pour accroître les possibilités offertes aux étudiants grâce à la création de quatre concours distincts.
Troisièmement, il s’agit d’améliorer la pédagogie en accompagnant le parcours de l’étudiant et en améliorant son encadrement : développement du tutorat, reconfiguration des programmes, refonte des supports et du mode de délivrance des cours, par exemple en utilisant internet.
Quatrièmement, il s’agit d’offrir de nouvelles passerelles entrantes et sortantes, afin de permettre aux étudiants de ne pas perdre complètement les années d’étude effectuées, surtout pour les « reçus-collés » – ceux qui ont la moyenne mais ne réussissent pas le concours –, et de donner de nouvelles chances à ceux qui, tout en souhaitant faire des études médicales, suivraient d’autres cursus au début de leur parcours.
La proposition de loi instaure le cadre législatif nécessaire à la mise en place de cette réforme que le Gouvernement, d’une part, conformément à une circulaire ministérielle du 1er août dernier, et l’Assemblée nationale, d’autre part, souhaitent voir entrer en vigueur dès la prochaine rentrée universitaire.
Pour bien mesurer les conséquences concrètes d’une mise en œuvre – rapide – de cette réforme, j’ai auditionné, en tant que rapporteur pour avis, des doyens de facultés de médecine et de pharmacie, ainsi que des représentants des étudiants. J’en retiens, comme mes collègues de la commission qui ont fait de même dans leurs circonscriptions, essentiellement trois conclusions.
La première est qu’il existe un véritable consensus sur le principe de la réforme que tous attendent et qui devrait permettre de remédier, au moins en partie, aux défauts du système actuel. Même les étudiants en pharmacie, au départ sceptiques sur cette première année commune, nous ont indiqué qu’ils en acceptaient désormais le principe.
Deuxième conclusion : le calendrier très volontariste du Gouvernement, c’est-à-dire une entrée en vigueur à la rentrée prochaine, fait l’objet d’appréciations plus contrastées.
Cette échéance semble aujourd’hui effectivement prise en compte par les présidents d’université, recteurs et doyens, et ceux-ci sont en phase de concertation intense avec les différents acteurs concernés, en particulier les enseignants et les étudiants, afin de mettre en place la nouvelle organisation et les nouveaux programmes dès le mois de septembre prochain.
Dans l’ensemble, ils pourraient être prêts, mais certaines universités auront indéniablement plus de difficultés à respecter ce délai. En tout état de cause, une mise en œuvre dès l’année prochaine ne pourra se faire que si les textes d’application sont pris le plus rapidement possible, car de nombreux points demeurent encore imprécis, par exemple l’organisation des concours à la fin de la première année.
Troisième conclusion : les étudiants, dans leur ensemble, sont inquiets de la rapidité de la mise en œuvre de la réforme. Ils déplorent en particulier le manque d’information disponible tant pour les lycéens qui souhaitent s’inscrire l’année prochaine en médecine ou en pharmacie que, ce qui est peut-être plus grave encore, pour les étudiants actuellement en première année.
Vous le savez, madame la ministre, les parents de ces lycéens sont forcément inquiets de ne pas savoir exactement comment se déroulera l’année prochaine. L’avenir des enfants est source d’appréhension pour les parents, vous vous en rendrez compte quand vos propres enfants grandiront.
Sourires.

C’est pourquoi, madame la ministre, afin de rassurer les différents acteurs concernés, mais aussi pour nous éclairer, nous, sénateurs, je souhaiterais que vous puissiez vous engager sur quatre points que la commission des affaires sociales juge essentiels.
Le premier concerne la sortie des textes d’application, qui, à notre sens, doit être la plus rapide possible. En tout état de cause, si le calendrier d’application actuel est maintenu, ils devront être publiés au plus tard à la mi-mars, puisque l’inscription des lycéens doit se faire avant le 20 mars prochain. C’est en effet uniquement sur la base de ces textes que les autorités universitaires pourront véritablement établir leur communication, réformer leurs procédures et informer les étudiants.
Le deuxième point concerne les étudiants actuellement inscrits en première année. Malgré la réforme, ils doivent pouvoir présenter deux fois un concours dans une même filière, ce qui nécessitera, dans certains cas, l’autorisation de tripler la première année. Cette demande des étudiants est tout à fait légitime ; c’est une question d’équité pour l’ensemble des étudiants qui vont vivre ces évolutions.
Le troisième point a trait à la future réorientation des étudiants à l’issue du premier semestre. Il semble que la solution actuellement envisagée par votre ministère soit assez radicale, madame la ministre, à savoir conserver un nombre d’étudiants correspondant à deux fois et demie ou trois fois le numerus clausus à l’issue des premiers mois de formation. Les professeurs comme les étudiants pensent que ce nombre est trop restrictif. Il faudrait donc que la concertation se poursuive sur ce point et, surtout, que les options de réorientation proposées aux étudiants soient effectives.
Le quatrième point sur lequel nous attendons des assurances de votre part, madame la ministre, est celui des moyens, car l’adaptation de certains locaux, l’installation de systèmes de visioconférence, le développement du travail en effectifs réduits vont nécessiter, dès la prochaine rentrée ou dès la mise en œuvre de la réforme, des moyens supplémentaires. Il est impératif que ceux-ci soient à la hauteur de l’ambition portée par cette proposition de loi. Comme vous l’avez dit tout à l’heure, les financements ont été prévus.
Au total, compte tenu des questions soulevées, sur lesquelles nous attendons vos réponses, madame la ministre, la commission des affaires sociales a considéré que le délai retenu par la proposition de loi était un peu précipité. Elle a donc décidé de proposer au Sénat de reporter son entrée en vigueur d’un an. À cet égard, je remercie le président de la commission des affaires culturelles et son rapporteur d’avoir relayé notre demande. Un tel report devrait permettre à chacun de s’approprier cette réforme.
Il serait particulièrement dommageable, selon nous, que la mise en œuvre de cette importante réforme ne soit pas à la hauteur des attentes exprimées tant par les enseignants que par les étudiants. La priorité doit être de permettre à notre pays de continuer à disposer de professionnels de santé bien informés et bien formés. Tel est bien l’objet du grand bouleversement que vous proposez.
Aussi, sous réserve des engagements que vous voudrez bien prendre devant nous, madame la ministre, et du report d’un an de l’application du texte, la commission des affaires sociales votera la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous discutons d’une proposition de loi inaboutie, dans le contexte le plus défavorable qui soit. Les sujets de mobilisation de la communauté universitaire sont déjà multiples, inutile d’en ajouter un !
Le Gouvernement paraît vouloir écouter, mais semble incapable de corriger ses erreurs. La « mastérisation » de la formation des futurs enseignants, parce que contre-productive et précipitée, constitue un point dur de la mobilisation.
Or on nous propose aujourd'hui de jeter dans le bain des mesures gouvernementales mal ficelées, mal préparées, non négociées et précipitées le secteur des études de santé !
Le calendrier de cette énième réforme est tout aussi irréaliste que celui de la formation des enseignants. Même ceux qui sont en faveur de ce texte réclament, à juste titre, le report de sa mise en application.
Il est en effet tout simplement matériellement et financièrement impossible d’organiser, dans de bonnes conditions, dès la rentrée de septembre 2009, la première année des études de santé selon le dispositif proposé dans cette proposition de loi.
Je pense en particulier aux études odontologiques et pharmaceutiques pour lesquelles la mise en œuvre du LMD n’est toujours pas effective. Le processus de Bologne fixe 2010 comme date butoir : prévoir l’application du dispositif à la rentrée 2010 semblerait donc plus réaliste et plus approprié. Rien ne nous contraint à la précipitation, sauf le calendrier gouvernemental ! Sans cela, c’est au sacrifice d’une promotion que vous nous conduisez, madame la ministre.
Les procédures d’inscription « post-bac » pour les lycéens s’achèvent dans quelques semaines. Les élèves de terminale intéressés par des études médicales ne disposent à ce jour d’aucune information sur la réforme à venir de la première année. Ils sont tenus dans la plus totale ignorance et sont donc dans l’incapacité matérielle de s’inscrire en connaissance de cause.
Pour ce qui est des actuels « primants », l’incertitude quant à leur possibilité de redoublement à l’issue d’une sélection qui éliminera 80 % d’entre eux constitue une source supplémentaire de stress. Quant aux équipements immobiliers, je ne vois pas par quel miracle ils seront prêts à accueillir tous les étudiants en L 1 santé pour la rentrée 2009. Un report de l’application de cette réforme s’impose donc.
Cette réforme précipitée est également insuffisante. Vous restez au milieu du gué : nombre de professions de santé ne feront pas partie de cette licence « santé ». Certaines filières ont été exclues d’office de la réflexion du rapport Bach, sans motif sérieux. Le périmètre pose, au minimum, question. Ainsi, la question de l’intégration de filières de formation universitaire, d’autres ne l’étant pas ou l’étant seulement en partie, a été trop rapidement évacuée. De nombreuses filières recrutent par l’actuel PCEM 1 et ne sont pas intégrées dans la L 1 santé : ergothérapeutes, laborantins d’analyses médicales, manipulateurs d’électroradiologie médicale, pédicures-podologues, psychomotriciens, masseurs-kinésithérapeutes pour deux tiers des instituts de formation.
À travers le mode de recrutement, c’est également la question de la démocratisation de l’accès à certaines filières de santé qui aurait dû être posée.
Ainsi, le PCEM 1 de kinésithérapeute ne demande pas le même investissement financier que le concours des instituts privés, de l’ordre de 3 500 euros, ce qui constitue avant tout une sélection par l’argent. C’est donc une occasion manquée d’envisager la généralisation de la procédure de sélection par le PCEM 1 pour tous les futurs kinésithérapeutes, dans un objectif de démocratisation.
De fortes craintes pèsent également sur les conditions d’études. En parlant des étudiants de pharmacie, vous avez affirmé à l’Assemblée nationale, madame la ministre : « avant tout, ils pourront ainsi améliorer leurs chances de réussite ». Cette affirmation est-elle bien sérieuse et réellement fondée ? Je ne le pense pas, et les étudiants de pharmacie, que cette réforme inquiète légitimement, non plus. Ils vont échanger des enseignements dirigés – ED – et des travaux dirigés – TD – d’une trentaine d’étudiants contre des amphithéâtres surchargés en visioconférence.
Face à l’augmentation des effectifs du fait du regroupement des différentes premières années, le risque est grand de voir remises en cause, dans toutes les filières, la proportion des ED et des TD par rapport aux cours magistraux, actuellement de 30 % des cours dispensés en PCEM 1 et en PCEP 1, ainsi que les conditions de leur tenue.
C’est pourquoi le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CNESER, a demandé à votre ministère, d’une part, « d’apporter tous les moyens matériels, humains et financiers nécessaires pour garantir une qualité pédagogique au moins équivalente à celle observée aujourd’hui dans chacune des filières concernées, sans dégradation des conditions d’études » et, d’autre part, « que le financement de la licence santé ne se fasse pas en redistribuant les moyens initialement alloués aux autres filières universitaires dans le cadre du plan “ réussir en licence ”, comme cela est prévu à ce jour ».
Expliquez-nous, madame la ministre, comment la première année d’études de santé pourrait être également adaptée à ceux qui ne pourront pas devenir médecins, dentistes, sages-femmes ou pharmaciens.
Rien ne nous garantit que la réorientation à l’issue du premier semestre se fera sur le mode du volontariat. Nous n’avons pas d’information sur les filières que les étudiants pourront intégrer au second semestre, ni sur les conditions de cette intégration. Un étudiant ayant perdu tout goût pour les sciences pourra-t-il s’inscrire en sciences humaines ou en droit ?
À ce propos, nous ne disposons d’aucune étude statistique sur le parcours des étudiants sortis du cursus médical ou l’ayant abandonné permettant d’affiner le dispositif de réorientation, afin qu’il soit le plus profitable possible aux étudiants concernés.
À ma connaissance, aucune étude n’a été réalisée sur les résultats du premier semestre des étudiants « primants » et sur leur réussite au concours en tant que redoublants, ce qui leur ferait tout de même gagner un à deux ans par rapport à votre proposition de réorientation précoce. Il ne me semble pas que la boucle de rattrapage qui oblige à faire un cursus de licence complet afin de pouvoir repasser le concours soit la solution la plus appropriée.
Si votre objectif était de ne pas rallonger un cursus déjà très long, force est de constater qu’il est loin d’être atteint.
Vous avez l’occasion, madame la ministre, de donner corps au consensus existant sur la réforme des études de santé, ne la gâchez pas ! Nous partageons le diagnostic : afflux croissant d’étudiants, taux d’échec élevé, difficultés de réorientation, qualité insuffisante des enseignements, bachotage, recours à des officines privées… Nous partagions l’essentiel des objectifs du rapport Bach, bien que moins ambitieux que les conclusions du rapport Debouzie, mais nous ne partageons ni la méthode, ni les modalités de mise œuvre.
Cette proposition de loi pose plus de questions qu’elle n’en résout et conduit notre Haute Assemblée à donner un blanc-seing au Gouvernement. Nous devrions être associés à la préparation des décrets afin de pouvoir nous prononcer en toute connaissance de cause. C’est pourquoi nous demandons le report de son application.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui présente une réforme attendue de longue date, et positive à plus d’un titre.
Dès 2002, Luc Ferry et Jean-François Mattei, ministres, respectivement, de l’enseignement supérieur et de la santé, indiquaient l’intérêt qu’ils portaient à la création d’une année d’études commune aux professions de santé. Ils suggéraient même que cette création intervînt rapidement.
Ainsi la commission pédagogique nationale de la première année des études de santé a-t-elle été instituée en septembre 2002 pour faire des propositions sur le sujet. Menés par le défunt président de l’université Claude Bernard Lyon 1, Domitien Debouzie, ses travaux ont été fructueux et fort détaillés.
Les propositions faites par ce dernier sont à rapprocher, en grande partie, de celles qui vous ont été remises, madame la ministre, par le professeur Jean-François Bach et qui ont été reprises dans la présente proposition de loi.
Je note que quatre principes fondamentaux sous-tendent la création d’une année commune aux études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie.
Le premier principe est l’instauration d’une indispensable culture commune aux différentes professions de santé.
Le professeur Yvon Berland, président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, a souvent dénoncé le cloisonnement entre ces dernières. Dans son premier rapport de 2002, il indique que l’un des obstacles majeurs à la coopération entre les professionnels de la santé reste le cloisonnement et les contours trop variables de leurs cadres de formation.
Deuxième principe, cette année commune ne doit pas être une année blanche, de bachotage. Elle doit être intégrée dans le cursus global de la formation des professions de santé. Cela implique qu’elle prépare aux concours tout en assurant une formation intégrée à un cursus académique et professionnel. En somme, cette année doit être, selon l’expression du doyen Debouzie, « utile, constructive et apprenante ».
Cela me paraît essentiel, madame la ministre. De nombreux étudiants demandent d’ailleurs des garanties à ce propos – j’y reviendrai.
Le troisième principe est celui de l’absence de hiérarchisation des concours.
L’actuelle première année du premier cycle des études de médecine, ou PCEM 1, induit en effet une hiérarchisation entre les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme. L’existence d’un classement unique permet effectivement à un étudiant bien classé de choisir sa profession et contraint l’étudiant moins bien classé à un choix par défaut, notamment lorsqu’il se présente au concours pour la deuxième fois.
La mise en place de quatre concours séparés et indépendants, soit un concours par profession, devrait sans nul doute y remédier.
Le dernier principe fondamental est celui de la prévention de l’échec.
Les statistiques montrent que la moitié des étudiants ayant obtenu leur baccalauréat avec la mention « bien » échouent au concours de médecine et d’odontologie, alors qu’un tel taux d’échec n’est jamais observé dans les classes préparatoires des grandes écoles ou dans le premier cycle intégré des écoles d’ingénieur.
Après analyse de données recueillies à l’université Claude Bernard Lyon 1 pendant trois années consécutives, un portrait démographique des étudiants inscrits en PCEM 1 a été esquissé.
En moyenne, environ 30 % d’une cohorte de PCEM 1 intégrera la deuxième année du premier cycle des études médicales, ou PCEM 2, soit en un an, soit – surtout – en deux ans, voire en trois ans. En revanche, la moitié de cette cohorte quitte le PCEM 1 sans aucun diplôme, sans aucune équivalence ou dispense. La proportion d’abandons après une première tentative est élevée.
Des campagnes d’informations auprès des étudiants de PCEM 1 expliquent probablement cette réorientation rapide. Quasiment la moitié des étudiants qui ne sont pas admis en seconde année de médecine ou de pharmacie vont en DEUG sciences et technologies. Une autre part importante, environ 30 %, se dirige vers une profession paramédicale.
Ainsi, la prévention de l’échec par une réorientation des étudiants est l’avancée majeure de ce texte.
Je ne reviendrai pas sur tous les dispositifs proposés. Les deux rapporteurs et vous-même, madame la ministre, les avez fort bien exposés.
J’ai retenu, madame la ministre, une de vos déclarations à la presse : « il n’y aura pas de couperet mais il y aura l’ouverture dans les universités de semestres de rebond ».
Comme vous l’avez donc compris, mon groupe et moi-même saluons cette refonte de la première année d’études de santé.
Toutefois, nous sommes inquiets et demandons des garanties sur la mise en œuvre de cette refonte.
Nous demandons notamment des garanties sur l’organisation pédagogique de cette année commune.
Un nouveau programme commun aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme est à élaborer.
Le défi est de conserver le niveau actuel et les spécificités de chaque filière. Ce sujet nourrit de vives inquiétudes chez les étudiants en pharmacie. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement d’appel relayant leurs interrogations.
Dans son rapport, le professeur Bach propose un programme identique pendant le premier semestre, portant sur les matières fondamentales. Les modules spécifiques à chaque filière seraient introduits au cours du second semestre.
Il préconise surtout que ce programme commun soit établi par les commissions pédagogiques nationales des trois filières et le conseil de perfectionnement des sages-femmes. Quelle est votre position, madame la ministre, sur ce sujet ?
Nous demandons de même des garanties sur l’organisation des quatre concours et la validation des connaissances. Ces concours seront-ils organisés par université ? Chaque étudiant sera-t-il libre de choisir le nombre de concours qu’il présentera ?
Nous demandons des garanties sur la mise en place de moyens et de supports éducatifs suffisants.
L’accueil de tous les étudiants dans les locaux universitaires actuels des UFR médicales et pharmaceutiques paraît déjà problématique. Le recours aux nouvelles technologies et aux supports numériques dans la perspective d’un enseignement à distance est évoqué. L’envisagez-vous, madame la ministre ?
Vous misez également sur une meilleure orientation des futurs bacheliers et sur une information de ces derniers à propos de la difficulté et de la longueur des études de santé. Comment cela s’organisera-t-il concrètement ? Il est question d’entretiens préalables, de journée nationale d’information dans les lycées et d’opérations « portes ouvertes » dans les facultés. Qu’en sera-t-il ?
Enfin, nous demandons des garanties sur les orientations possibles des étudiants en situation d’échec. Vers quelles filières seront-ils orientés ?
Vous avez annoncé une réunion des doyens des universités et des facultés à ce sujet, au début de cette année. Qu’en est-il ressorti ?
Cette réforme nous semble une bonne idée. Toutefois, son entrée en vigueur mérite plus de temps et ses modalités d’application davantage de garanties.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’idée de rassembler dans une première année d’études commune les professions de santé n’est pas nouvelle. Elle a effectivement été proposée par le professeur Debouzie dans un rapport élaboré à la demande de Jack Lang et de Bernard Kouchner, alors ministres, respectivement, de l’éducation nationale et de la santé, et remis en 2003 – cela fait six ans : que de temps perdu ! – à leurs successeurs Luc Ferry et Jean-François Mattei.
Il s’agissait alors d’ouvrir, selon certaines modalités, le concours de fin de PCEM 1 aux quatorze professions de santé existantes, et non pas seulement à quatre.
Le texte qui nous est proposé aujourd’hui est très en retrait par rapport à cette recommandation. Il est vrai qu’est intervenu entre-temps le rapport du professeur Bach, beaucoup plus restrictif.
C’est sans doute la raison pour laquelle ce texte ne contient qu’une seule véritable nouveauté : l’intégration de la pharmacie. Dans de nombreuses universités françaises, la maïeutique bénéficie effectivement déjà d’une première année d’études commune à la médecine et à l’odontologie.
Néanmoins, il paraît difficile de s’opposer à cette réforme, même si l’on peut déplorer son manque d’ambition et le temps perdu – je l’ai déjà dit.
Nous pouvons nous demander si l’établissement d’un second rapport était absolument indispensable.
Nous aurions sans doute encore attendu un moment sans l’heureuse initiative de notre éminent collègue le professeur Etienne, tant l’indifférence du Gouvernement à tout ce qui concerne les études des professions de santé semble grande, malgré vos dénégations, madame la ministre.
Faut-il rappeler que c’est à l’un de nos anciens collègues, le professeur Giraud, que nous devons la création d’une filière universitaire propre à la spécialité de médecine générale ? Le Gouvernement avait tout simplement oublié de créer une telle filière lorsqu’il avait érigé la médecine générale en spécialité.
Je le ferai remarquer à M. Dériot, la commission des affaires sociales n’avait pas été saisie pour avis lors de l’examen de la proposition de loi du professeur Giraud.

C’est la première fois que nous sommes saisis. Attentif à ces questions relatives à la santé, je m’en félicite.
Venons-en au texte lui-même avec une première remarque d’ordre général.
On peut comprendre que l’organisation de cette première année soit déterminée par voie réglementaire, mais, comme nous le demandons de manière récurrente et comme l’a également demandé M. le rapporteur pour avis, nous aurions aimé connaître au moins les grandes lignes des arrêtés d’application, en cours d’élaboration ou peut-être, pour certains d’entre eux, déjà prêts. Cela permettrait de répondre à certaines interrogations et de calmer des inquiétudes éventuellement injustifiées.
Cela dit, je ne pense pas que ce texte a minima soit suffisant pour réduire le taux d’échec au concours de fin de première année, qui avoisine les 80 %. Les chances de remédier à ce gâchis humain auraient sans doute été plus grandes si les auteurs de cette proposition de loi avaient suivi les recommandations du rapport Debouzie qui préconisait – je le répète – une première année d’études commune aux quatorze professions de santé.
Il aurait été à tout le moins sage de l’ouvrir aux masseurs-kinésithérapeutes, qui le réclament et qui ont d’ailleurs lancé une pétition en ce sens, et sans doute aussi aux infirmiers. Nous aurions ainsi eu davantage de chances d’atteindre l’un des objectifs de cette réforme qui vise à garantir et à développer une culture commune aux métiers de santé afin de rapprocher leurs pratiques.
Je m’étonne d’ailleurs que l’on n’ait pas profité de l’intégration de la maïeutique dans la première année des études de santé pour accorder enfin à cette discipline la reconnaissance universitaire qu’elle mérite et qu’elle attend depuis plusieurs années. Nous avions déposé un amendement en ce sens, qui a malheureusement été écarté par la commission des finances en vertu de l’article 40 de la Constitution. Si le Gouvernement proposait une telle disposition, l’irrecevabilité financière ne pourrait lui être opposée. Nous attendons donc avec impatience que le Gouvernement fasse une proposition.
Il serait par ailleurs temps de songer au remplacement du terme « sage-femme » par une appellation qui tienne compte du fait que cette profession est exercée par de plus en plus d’hommes. Le terme de maïeuticien, reconnu par l’Académie française, me semblerait particulièrement bien adapté. J’ai d’ailleurs déposé un amendement qui, sans aller jusque-là, procède de cet esprit.
Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l’issue du premier semestre de la première année sont un autre sujet d’inquiétude.
Je ferai tout d’abord observer que rien ne permet d’affirmer qu’une réorientation précoce est préférable à un redoublement, d’autant que, dans l’hypothèse d’une réussite au concours, le redoublement fait gagner un à deux ans par rapport à la réorientation précoce. Tant que n’auront pas été effectuées des études comparatives entre les résultats du premier semestre d’un étudiant n’ayant pas encore redoublé et ceux qu’il obtient au concours en tant que redoublant, le doute est permis.
De même, il n’est pas fondé de prétendre que les étudiants ayant une moyenne de moins de 7 sur 20 à l’issue du premier semestre ou de la première année n’ont qu’une très faible chance de réussir au concours, même à l’issue d’un redoublement. Il nous manque, sur ce sujet également, des études statistiques.
Ensuite, la réorientation précoce suscite des interprétations divergentes. D’un côté, la circulaire du 1er août 2008 présente la mesure comme « obligatoire, tant à l’issue du premier semestre que de la première année ». De l’autre, le coauteur et rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale indique le 10 décembre 2008 que cette réorientation précoce n’est qu’« une simple faculté ».
Il nous a semblé qu’une disposition pouvant donner lieu à des interprétations aussi radicalement contradictoires devait être supprimée. C’est l’objet de deux de nos amendements.
Permettez-moi ensuite de douter de la faisabilité de cette possibilité de réinscription en première année d’études de santé offerte aux étudiants exclus précocement du système. En effet cette mesure, considérée comme une seconde chance de réussite, est un miroir aux alouettes.
Les étudiants réorientés au premier semestre étant les plus mauvais, leur chance de valider une première année de licence est minime. Il leur faudrait donc attendre deux ans et demi avant de se réinscrire en première année d’études de santé, avec une chance de réussite nettement moindre que les redoublants classiques. Je crains que cette deuxième chance ne s’apparente à une impasse.
L’un des effets de cette réforme est qu’elle va augmenter le nombre d’étudiants en première année, aggravant ainsi le gigantisme ou la massification auxquels les doyens doivent faire face dans l’organisation de l’enseignement. Pour améliorer la pédagogie, une université doit avoir le droit de fragmenter le numerus clausus entre plusieurs unités de formation et de recherche, afin que chacune d’entre elles organise un concours, comme c’est déjà le cas dans certains de ces établissements.
Les priver de cette possibilité serait les affaiblir face à des cours privés particulièrement dynamiques et onéreux et pourrait porter atteinte à l’égalité des chances en pénalisant les étudiants les plus démunis qui ne peuvent pas y accéder. À cet égard, on peut regretter qu’aucune enveloppe financière spécifique n’ait été affectée à la première année de licence dans le cadre de la loi de finances.
Mais il n’est peut-être pas trop tard pour rectifier le tir. Si j’en crois le nombre d’amendements déposés et les déclarations de nos deux rapporteurs, le report d’un an de l’application de cette réforme a toutes les chances d’être adopté par notre Haute Assemblée, ce dont nous nous félicitons.
Madame la ministre, ce délai pourrait vous permettre d’inscrire dans le projet de loi de finances pour 2010 les crédits nécessaires au financement de la réforme.
Telles sont les observations qu’appelle cette proposition de loi, que nous aurions aimée plus ambitieuse et moins discriminatoire. La position du groupe CRC-SPG au moment du vote dépendra du sort qui aura été réservé à nos amendements.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous étudions aujourd’hui est très attendu et représente une étape importante dans la réforme des études de médecine.
L’accès aux études de santé, et surtout à la seconde année de médecine, est extrêmement difficile. Or, malgré la difficulté du concours, les étudiants sont toujours plus nombreux à s’inscrire.
Comme vous l’avez souligné tout à l’heure, madame le ministre, la probabilité de réussite pour les étudiants qui s’engagent dans des études médicales est de 27 % seulement sur deux ans. Ce chiffre est éloquent. Il révèle un gâchis humain considérable.
Le principe même d’un numerus clausus n’est pas à remettre en cause, car il est le prix de l’excellence – vous l’avez dit tout à l’heure. Chacun le sait, s’engager dans des études médicales est un choix risqué. Plusieurs générations de jeunes se sont inscrites dans des études de santé en se résignant à cette situation. Mais ce risque est malheureusement dissuasif pour beaucoup d’élèves, qui n’oseront jamais prendre cette voie.
L’échec est difficile à supporter pour les jeunes concernés, qui sont bien souvent de bons élèves. De plus, lorsqu’ils redoublent et se voient recaler de nouveau, ils doivent repartir de zéro, car les possibilités de réorientation sont très limitées. Oui, quel gâchis et quelle perte de temps !
Depuis plusieurs années, des réflexions approfondies ont été menées, sur l’initiative des pouvoirs publics. Aussi, je me réjouis que les propositions de réforme formulées dans le rapport de M. Jean-François Bach soient aujourd’hui mises en œuvre.
La création d’une première année commune aux études médicales, odontologiques, de sages-femmes et, dorénavant, pharmaceutiques permettra d’élargir les débouchés ouverts aux étudiants, ce qui va dans le sens d’une réduction du taux d’échec et du nombre de redoublements en première année.
Les possibilités de réorientation constituent un autre apport de la proposition de loi. La fin de première année doit être sélective, puisque la sélection n’existe pas à l’entrée de cette première année. Mais est-il utile d’attendre un an lorsque les premiers mois sont souvent décisifs et révèlent déjà pour certains un retard important ? La réorientation en cours d’année me semble être une disposition de bon sens, qui permettra à l’étudiant de gagner du temps.
Il y a également trop de cas de jeunes qui redoublent pour se retrouver finalement sans diplôme au bout de deux ans. La proposition de loi tend à éviter cette situation en permettant à l’étudiant de rejoindre une autre formation et de se former dans les matières scientifiques pour revenir ultérieurement tenter le concours d’entrée en médecine, avec des chances renforcées. Bien des situations d’échec pourront être évitées grâce à cette mesure. L’étudiant devra alors être accompagné et bénéficier de l’aide de conseillers d’orientation.
Je soulignerai en outre l’importance des mesures permettant la diversification des profils des étudiants dans les études de santé. Il semble qu’il n’y ait point de salut dans ces branches pour les étudiants n’ayant pas un baccalauréat scientifique. Les connaissances scientifiques sont importantes, mais est-il normal que les étudiants aient tous le même profil ? Les élèves qui ont d’autres centres d’intérêt ne sont-ils pas dissuadés par avance de s’engager dans une profession de santé ? Pourtant, parmi eux, il y a des talents et des vocations qui ne demandent qu’à se révéler. Je trouve donc intéressante l’idée de passerelles pour des jeunes qui auraient découvert leur vocation « sur le tard ».
Par ailleurs, madame le ministre, je crois que vous avez l’intention d’introduire de nouveaux programmes en première année, concernant les sciences humaines et sociales, et également l’anglais, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour de futurs professionnels de la santé.
Je souhaiterais maintenant évoquer les questions ou les craintes liées à cette réforme.
Je comprends l’inquiétude des étudiants qui connaîtront la première année de mise en application de la réforme.
À la lecture de la proposition de loi, je constate que la situation des étudiants qui connaîtront l’année de réforme a bien été prise en considération et qu’une certaine souplesse est introduite : l’article 2 prévoit que la procédure de réorientation des étudiants à l’issue de la première année, ou dès le terme du premier semestre, pourra être différée jusqu’à la rentrée universitaire 2011-2012.
Nous avons également reçu des courriers d’étudiants en pharmacie estimant que leur première année d’études est bien organisée et craignant de ne pas retrouver dans l’année commune ces bonnes conditions d’étude, notamment les enseignements dirigés suivis en effectifs restreints.
Ce serait regrettable, car il me semble que les étudiants en pharmacie subissent également un taux d’échec important en première année. La réforme devrait donc leur être profitable. Je souhaiterais que vous nous confirmiez, madame le ministre, qu’ils ne seront pas dorénavant perdus dans de grands amphithéâtres et qu’ils garderont en première année la spécificité de leurs enseignements.
D’une manière plus générale, la réforme paraît difficilement applicable dans certaines universités, et ce pour des raisons matérielles tenant à la configuration des locaux. Comment ces problèmes seront-ils résolus ?
Par ailleurs, je souhaiterais profiter de ce débat pour rappeler combien il est important de promouvoir l’exercice de la médecine générale. Vous travaillez en ce sens, madame le ministre, et nous avons adopté en février 2008 une proposition de loi de notre ancien collègue Francis Giraud tendant à créer de nouveaux corps d’enseignants pour cette discipline.
Certaines régions manquent de médecins. On parle même de « désertification médicale ». La répartition du numerus clausus par faculté ne tient pas assez compte des besoins de santé des territoires. Cette répartition est souvent établie en fonction du nombre de bacheliers reçus et des capacités de formation existantes. Madame le ministre, souhaitez-vous moduler plus fortement le numerus clausus d’un point de vue géographique ? Pourriez-vous évoquer les mesures que vous comptez prendre pour inciter les étudiants à se diriger vers la médecine générale et s’établir dans des régions manquant de praticiens ?
Je vous remercie de nous éclairer sur ces quelques points.
Par ailleurs, je tiens à saluer votre détermination à mener une politique de réduction du taux d’échec à l’université, notamment au moyen du plan « Réussir en licence ».
Je souhaite également remercier nos rapporteurs, ainsi que M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles, de la qualité de leurs travaux et de leurs analyses.
Bien évidemment, le groupe UMP votera cette proposition de loi, qui engage l’indispensable et urgente réforme des études de santé.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Philippe Darniche applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui met en place une réforme des études médicales. Une de plus, serais-je tenté d’ajouter. Peut-être s’agira-t-il de la bonne ?
Depuis longtemps déjà, les études de médecine sont exigeantes et sélectives, focalisant les critiques et nourrissant une abondante littérature, comme en attestent les rapports Bach et Debouzie, qui ont été souvent évoqués.
Moins d’un étudiant sur cinq réussit à passer en deuxième année de médecine et un sur quatre en pharmacie. Et ce, au terme d’une compétition aussi impitoyable qu’injuste. Les amphithéâtres sont bondés et des élèves sont recalés tout en ayant la moyenne, en raison du numerus clausus. Pire, la plupart des étudiants peinent à se recycler, en dépit de leur bon niveau scolaire.
Pour répondre à ces critiques, le texte adopté le 16 décembre dernier par l’Assemblée nationale et examiné aujourd'hui par le Sénat crée une première année commune aux filières de médecine, sage-femme, odontologie et pharmacie. Il prévoit également une réorientation des étudiants les plus à la peine vers d’autres filières scientifiques, dès la fin du premier semestre et au terme de la première année. Enfin, ce texte crée des « passerelles entrantes » pour des étudiants titulaires de certains masters ou diplômes, afin de diversifier les profils.
L’idée de cette réforme agitait depuis longtemps le milieu médical. Elle procède sans doute de bonnes intentions.
La mutualisation des cours permettra notamment de donner une culture commune aux futurs médecins, sages-femmes, dentistes et pharmaciens.
Mais, et la question a souvent été posée, pourquoi avoir laissé de côté les autres professions de santé ? Sans aller jusqu’aux quatorze professions évoquées par M. Autain, le problème des kinésithérapeutes et des infirmières peut effectivement se poser. Nous le savons, parmi les premiers, beaucoup ont d’abord été tentés par des études médicales.
Quant au dispositif de réorientation des étudiants en difficulté, il devrait contribuer à diminuer le taux d’échec.
En effet, comme le montrent les études statistiques qui ont été menées, un étudiant ayant obtenu, au bout d’un semestre, une note moyenne inférieure à six n’a pratiquement aucune chance de réussir le concours en fin d’année. Le réorienter tout de suite vers un autre cursus scientifique lui évite la perte d’une année complète et lui donne un complément de formation utile pour retenter la première année des études de santé.
Néanmoins, en l’absence d’éléments précis, de nombreuses interrogations se posent et ont déjà été évoquées par les différents orateurs qui se sont succédé. Fixera-t-on une note minimale aux partiels en deçà de laquelle on estime que l’étudiant ne peut à l’évidence réussir aux concours ou conservera-t-on un nombre d’étudiants correspondant à un coefficient multiplicateur du numerus clausus ? S’agira-t-il d’un simple conseil à l’étudiant ou d’une obligation ? Aura-t-il la possibilité de s’inscrire dans un cursus qui ne soit pas scientifique ?
Le texte prévoit en outre une procédure de réorientation en fin de première année. J’imagine que seront concernés les étudiants les moins bien classés aux concours. Il semble qu’ils devront avoir validé, comme les précédents, une deuxième année de licence dans un autre cursus universitaire scientifique pour réintégrer la première année.
Certes, ce délai de « rattrapage » permet d’optimiser les chances de réussite aux concours, mais il constitue tout de même un « long détour » et s’apparente un peu à une « pénitence ». Finalement, ce qui se faisait souvent en deux ans se fera désormais en quatre !
Peut-être eût-il mieux valu organiser une sélection immédiate dès l’entrée en première année. Je sais que cette idée est certainement très incorrecte politiquement, mais elle pose la question de l’orientation des lycéens. Celle-ci doit être active, précoce et diversifiée, les lycéens ne mesurant pas toujours la difficulté et la longueur des études, en particulier celles de santé...
Quoi qu’il en soit, le dispositif de réorientation proposé suscite des inquiétudes légitimes chez les étudiants, notamment ceux qui sont actuellement inscrits en première année et ceux qui, en province, doivent souvent déménager pour poursuivre leurs études.
Je crois, madame la ministre, qu’il faut leur apporter des précisions et des engagements sur ce point, comme sur l’organisation matérielle de la première année et le niveau du numerus clausus.
Vous le savez, les étudiants en pharmacie craignent que le contenu de l’enseignement en première année ne soit pas adapté à leur spécialité et perde en qualité, alors qu’ils bénéficient aujourd’hui d’enseignements par groupes de trente ou trente-cinq élèves. Que pouvez-vous leur dire ?
Il est clair que la réforme pose des problèmes de logistique et de structures. Va-t-on adapter les locaux pour accueillir l’ensemble des étudiants de « L 1 santé » ou diviser les élèves sur deux sites avec l’installation de systèmes de visioconférence ? Plus généralement, quels seront les moyens consacrés à cette réforme ?
Toutes ces questions, madame la ministre, montrent combien ce texte reste imprécis. Certes, il s’agit d’une proposition de loi et la plupart des points relevés sont d’ordre réglementaire. Cependant, il est bien difficile de se prononcer ainsi dans le brouillard, sans connaître les décrets d’application. La brièveté des échéances envisagées laisse entendre qu’ils sont déjà bien avancés. Vous avez même précisé qu’ils étaient en préparation depuis plusieurs semaines.
Cela étant dit, je suis favorable, comme le groupe du RDSE que je représente, à la réforme proposée. Néanmoins, son application dès la rentrée 2009 me paraît précipitée. Un tel calendrier semble difficilement tenable pour certaines facultés et crée une réelle inquiétude, qui pourrait se transformer en agitation.
C’est pourquoi mon collègue Jean Milhau présentera, à l’article 2, au nom du groupe du RDSE, un amendement prévoyant un report d’un an. Nous espérons vous convaincre, madame la ministre, ou à tout le moins vous voir étudier cette possibilité.
Enfin, permettez-moi d’ajouter un mot sur le numerus clausus. En 2008, 7 300 places ont été ouvertes en médecine, chiffre en hausse. Mais le Conseil de l’ordre des médecins estime qu’il devrait être porté à 8 000 si l’on veut maintenir une couverture médicale satisfaisante de notre territoire. Quelles sont vos intentions à ce sujet, madame la ministre ?
Applaudissements sur certaines travées du RDSE. – Mme Muguette Dini et M. Jean Bizet applaudissent également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude Etienne a pour objet de réduire le taux d’échec très élevé des étudiants en première année d’études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de sage-femme. Comment ne pas souscrire à cet objectif ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Celui qui a été évoqué tout à l'heure par M. le rapporteur est extrêmement significatif : 44 509 étudiants ont été laissés en situation d’échec en 2008.
Cette proposition de loi offre l’opportunité de réformer le début du parcours des professionnels de santé de notre pays, en permettant aux étudiants qui y sont engagés de se réorienter vers d’autres filières, souplesse que nos amis anglo-saxons maîtrisent depuis longtemps.
Ce texte concourt ainsi à réduire le taux d’échec de l’université, qui est un de vos objectifs, madame la ministre. Nous le partageons tous.
J’accueille donc favorablement dans son principe ce texte, qui offrira également de nouvelles passerelles entrantes et sortantes, permettant une plus grande souplesse de choix aux étudiants. En outre, il se dégage un consensus sur le principe de la réforme, accepté par la majorité des associations d’étudiants en études de santé, après quelques réticences initiales.
Je souhaite cependant, comme nombre de mes collègues et sans être très original, appeler votre attention, madame la ministre, sur trois points, que mon collègue et pharmacien Gérard Dériot a soulevés à juste titre.
Le premier d’entre eux concerne la date de la mise en œuvre de la réforme que je juge, moi aussi, précipitée.
Son entrée en vigueur, prévue dès la rentrée universitaire 2009-2010, semble laisser un délai trop court pour que les mesures d’application réglementaires soient prises à temps pour la prochaine rentrée universitaire.
Plusieurs points méritent des ajustements. Ainsi, l’organisation des concours à la fin de la première année n’est pas définie à ce jour, même si j’ai compris que vous aviez l’intention d’aller vite. Les lycéens d’aujourd’hui n’ont pas encore reçu d’information sur cette réforme, alors que la procédure d’inscription s’achève dans un mois. Les étudiants actuels de ce cursus universitaire n’ont aucune vision à long terme, ce qui les fragilise psychologiquement. Enfin, se pose le problème de l’organisation matérielle des universités. À cet égard, l’université de Nantes, la plus proche de mon domicile, m’a fait part de quelques remarques, justifiées mais inquiétantes.
Il me semble donc raisonnable et nécessaire de reporter la date de la mise en œuvre de ce tronc commun à la rentrée universitaire 2010-2011.
Dans un second temps, nous devons aussi prendre en considération la situation des étudiants actuellement inscrits en première année, qui ne réussiront pas le concours, mais seront autorisés à redoubler.
de ces laissés-pour-compte de la réforme, dont le nouveau programme d’étude sera renouvelé à hauteur de 30 % des enseignements ?
Madame la ministre, on ne peut créer une situation discriminatoire par rapport aux étudiants du nouveau dispositif. Il est donc indispensable d’ajouter une mesure à la proposition de loi afin de corriger cette injustice. À mon tour, je pense qu’il faudrait autoriser ces étudiants à tripler leur première année.
Enfin, je reste très soucieux quant au contenu des enseignements prévus dans ce nouveau dispositif pour les études de pharmacie, dont la qualité risque de baisser. À l’heure actuelle, les étudiants en première année bénéficient de cent quatre-vingt-douze heures de travaux dirigés en effectifs restreints de vingt à trente étudiants par groupe. Ces cours, qui représentent aujourd'hui 30 % des enseignements de pharmacie, n’atteindront que 10 % au plus après la réforme.
Par ailleurs, les étudiants en première année ont l’obligation de faire un stage en officine qui pose les bases de leur futur métier. Ce serait un véritable recul de ne plus l’envisager.
Je vous interroge donc, madame la ministre : quelle solution proposez-vous de votre côté ?
En attendant vos réponses, j’indique d’ores et déjà que je suis plutôt favorable à cette proposition de loi et j’émets le vœu que nos collègues adoptent la même position.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Jean Milhau applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, vouloir réformer la première année d’études médicales est une nécessité, nul ne saurait le contester. L’objectif premier de cette proposition de loi est donc louable. Vouloir mettre fin à ce que certains qualifient de « gâchis humain », offrir plus de chances aux étudiants, reconsidérer cette première année afin que les professionnels de santé disposent d’un savoir commun qui ne soit pas uniquement fondé sur une stricte culture scientifique, est pertinent. Plus qu’un toilettage, c’est bien d’une refonte dont nous avons besoin.
Je commencerai par deux considérations d’ordre méthodologique sur ce texte.
La première tient au fait que cette réforme fait partie intégrante d’un ensemble complexe, qui repositionne la médecine et son exercice dans une société que nous savons changeante et qui se doit de faire face à des défis sanitaires renouvelés.
Cette situation nécessite une lecture et une appréhension globales.
Et je m’étonne de nous voir examiner ce soir cette proposition de loi, alors que nos collègues députés discutent en ce moment même d’un projet de loi plus large portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires – ce texte viendra d’ailleurs bientôt au Sénat –, qui comporte un volet formation.
Le Gouvernement aurait dû soumettre à concertation les propositions du rapport Bach dont est issue cette proposition de loi. Vous vous y étiez engagés. Mais, une fois de plus, c’est la précipitation qui l’emporte.
Seconde considération méthodologique, ce texte est constitué de deux articles qui renvoient à une multitude d’arrêtés ministériels.
Aussi ne pouvons-nous avoir qu’une vision très partielle des incidences qui pourraient découler de cette proposition de loi. Cela est fortement dommageable.
Venons-en brièvement au fond. En 2008, plus de 60 000 étudiants ont présenté l’un des concours de médecine, d’odontologie, de sage-femme ou de pharmacie. Du fait de l’application du numerus clausus, 20 % d’entre eux ont accédé à l’une des quatre filières. Pour la grande majorité des autres, peu d’alternatives se sont offertes. Cela n’est pas acceptable, au regard tant des besoins de notre pays que des perspectives de démographie médicale.
Certes, madame la ministre, le 16 décembre dernier, vous annonciez que le numerus clausus allait augmenter de manière progressive pour répondre aux besoins de santé sur des bases locales, mais nous n’avons pas entendu le même son de cloche de la part de votre collègue ministre de la santé. Dès lors, quel sera le suivi de cette annonce ?
Face à l’échec massif, il nous est donc proposé d’instaurer deux types de réponses. La première consiste à instaurer un tronc commun entre les quatre sections.
Si l’objectif fixé consistait réellement à former des professionnels de santé disposant d’un socle commun de connaissances, autres que purement scientifiques, alors pourquoi ne pas avoir introduit l’enseignement de la philosophie, de la psychologie, des sciences humaines, par exemple ?
La quasi-totalité de l’enseignement dispensé durant le premier semestre de « L 1 santé » sera constituée de sciences dites « dures ». On perçoit donc mal en quoi réside le changement, si ce n’est que les étudiants qui n’auront pas été réorientés précocement pourront passer les quatre concours.
La seconde réponse met en place une préorientation dès le premier semestre. Dans les faits, les étudiants qui ne seraient pas parvenus à un certain niveau au terme de ce laps de temps seraient contraints de se réorienter vers une autre faculté, notamment de sciences. Après avoir validé deux années de licence, ils pourraient de nouveau se présenter au concours.
Madame la ministre, si vous estimez contre-productif de maintenir ces étudiants dans un cursus où ils ne pourront pas réussir, vous ne vous attaquez pas aux causes de cet échec massif. Nous le savons tous, il est lié à la sélection sociale, qui se généralise de plus en plus, notamment dans les études de médecine. Je pense aux officines privées qui offrent du tutorat à ceux qui peuvent payer.
En outre, des conséquences découlent directement de la réorientation précoce. Êtes-vous bien certaine que les facultés de sciences, et les autres, auront la capacité d’accepter ces étudiants en cours d’année ? Y aura-t-il un programme spécifique pour eux ? Au-delà, comptez-vous accompagner ces étudiants lorsqu’ils seront contraints de déménager, alors que le niveau de vie moyen étudiant est faible ?
J’en viens aux considérations financières. Pas une ligne n’y est consacrée. Les financements seraient, nous dit-on, issus des crédits affectés au plan « Réussite en licence ». Or ces crédits n’ont pas été votés à cette fin.
En procédant de la sorte, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul, ce qui n’est pas sérieux ! Ne serait-il donc pas plus sage d’attendre la prochaine loi de finances, après que les universités auront pu présenter un dossier de demande de financement spécifique, pour inscrire les sommes nécessaires à la réalisation de cette réforme ? Pour notre part, nous le pensons.
Certains voudraient nous prêter l’ambition de ne rien faire. Bien au contraire, tout comme les étudiants et les doyens, nous sommes favorables à cette refonte. Pour autant, nous considérons que la précipitation qui a présidé à l’examen de ce texte nuit à sa crédibilité.
En lieu et place d’un texte issu d’une large et nécessaire concertation, qui pourrait fonder une nouvelle ère pour les études médicales, cette proposition de loi ne permet pas de répondre aux difficultés actuelles. Elle suscite nombre d’incompréhensions et d’inquiétudes.
Je ne peux m’empêcher de penser aux élèves des classes de terminale qui, dans certaines académies, se sont déjà préinscrits en faculté de médecine et qui ne savent même pas qu’une réforme se prépare.
Madame la ministre, nous serons très attentifs aux réponses que vous nous apporterez ce soir, en particulier sur nos amendements, et en fonction de celles-ci nous déciderons de notre position.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, chaque année, presque 60 000 bacheliers s’engouffrent dans les facultés de médecine et de pharmacie avec l’espoir, plus ou moins motivé, de s’engager de façon durable dans une formation médicale universitaire.
Parmi eux, seuls 13 % seront reçus au concours en fin de première année – soit un taux d’échec de 87 % – et 14 % ne réussiront qu’au terme d’une année de redoublement.
Tous les autres, soit près de 75 %, découragés ou épuisés par une ou deux années d’un cursus qui s’apparente plus à un parcours du combattant hypersélectif, notamment dans les matières scientifiques, qu’à une véritable acquisition d’un savoir fondamental, doivent repartir à zéro dans leurs études supérieures, quand ils ne sont pas totalement découragés de le faire.
Ce contexte crée, les précédents orateurs l’ont souligné, de multiples effets pervers : concurrence exacerbée entre étudiants, émergence d’une hiérarchisation qualitative des filières consécutive aux choix de celles-ci en fonction du classement au concours commun, primat du scientifique dans les chances de succès, prolifération d’écoles et de cours privés et coûteux de « bachotage » pour préparer au concours, voire, pire, renoncement par peur de l’échec de certains bons étudiants à choisir une profession de santé.
C’est pour mettre un terme à cette situation, plus connotée d’échec que de réussite, que la présente proposition de loi est soumise aujourd’hui à notre examen.
L’article 1er de ce texte tend, tout d’abord, à instituer une première année commune aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de sage-femme, avec des procédures de réorientation en cours et en fin de première année.
L’article 1er tend, ensuite, à créer des passerelles, entrantes et sortantes, entre les différentes filières médicales, d’une part, et d’autres cursus de formation, d’autre part.
Comme le texte donne une large latitude au ministre de l’enseignement supérieur et au ministre de la santé dans la rédaction des décrets d’application, il me paraît utile, pour toutes les parties concernées, que le débat parlementaire soulève quelques questions afin d’éclairer avec davantage de précision les modalités concrètes d’application de la future loi.
Premièrement, concernant la création d’une année commune et l’organisation, en fin d’année, de quatre concours différents, il semble qu’un large consensus se soit établi pour considérer que cette mesure est de nature à ouvrir plus de débouchés aux étudiants, à créer une culture commune à des professionnels destinés à travailler ensemble au service des patients.
Elle permettra, également, de briser la notion de hiérarchisation qualitative entre des professions qui font plus l’objet d’un choix par défaut, en fonction de la sélection, que d’un véritable choix professionnel par les étudiants.
Toutefois, la détermination des numerus clausus, par site universitaire, devra être décidée par les ministres, non seulement en fonction de la capacité de ces sites à former, mais également en fonction des besoins territoriaux en matière d’offre de soins, sujet dont nous reparlerons prochainement ici même lors du débat sur le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
Deuxièmement, s’agissant des principes de réorientation, en cours et en fin de première année, l’important est de maintenir allumée, dans l’esprit de l’étudiant, la flamme de l’espérance d’un débouché. Dans cette optique, il me semble utile d’avoir l’avis du Gouvernement sur un certain nombre de points.
Il serait d’abord nécessaire de recueillir son avis sur la réorientation à l’issue du premier semestre.
Il est prévu un tronc commun de formation entre tous les étudiants, pendant le premier semestre, et un contrôle des connaissances à la mi-année. Il est déjà statistiquement démontré que, à ce stade, il est possible d’identifier les étudiants qui ne conservent qu’une infime chance de franchir l’obstacle du concours en fin d’année.
D’où mes questions qui relayent celles que se posent encore nombre d’étudiants.
L’abandon des études médicales à ce stade, c'est-à-dire au bout de six mois, serait-il obligatoire ou facultatif en fonction des résultats des examens de la mi-année ? L’étudiant pourrait-il, en mars, rejoindre une filière en L 1, par exemple en sciences, pour tenter de réussir malgré tout sa première année universitaire ? Selon quelles modalités pourra-t-il le faire ? Les universités sont-elles prêtes à organiser cette réorientation ?
Il serait également utile de connaître l’avis du Gouvernement sur la possibilité offerte, ou pas, de redoubler cette première année. Il est en effet prévu d’interdire le redoublement à certains étudiants.
À partir de quel multiplicateur du numerus clausus – on a parlé de trois ou de quatre – pensez-vous scinder le collège des « recalés » et celui des « reçus-collés » ?
S’il est probable que les « recalés » reprendront réellement leurs études supérieures dans une autre filière, vous paraît-il possible de proposer une équivalence aux « reçus-collés » dans une autre discipline universitaire ?
Dans quelle mesure l’étudiant « reçu-collé » qui redouble sa première année et qui échoue encore au terme de la deuxième année pourra-t-il, en fonction de son résultat, bénéficier d’une équivalence dans une autre discipline universitaire afin de ne pas perdre ses deux années de formation ?
Troisièmement, quant aux passerelles, entrantes et sortantes, prévues, en second lieu, par l’article 1er, elles sont de nature à enrichir le profil des professionnels de santé.
Au-delà des questions déjà posées par M. le rapporteur, j’insiste sur le fait que l’accès aux professions de santé devrait être beaucoup plus ouvert aux étudiants sensibles aux disciplines de sciences humaines.
Mme la ministre opine.

Certes, les professions médicales exigent un minimum de connaissances scientifiques, mais il n’est pas besoin d’avoir un cerveau calibré pour résoudre, de tête, des intégrales triples ou des équations différentielles de degré n, pas plus que d’être un spécialiste du calcul matriciel, pour faire un bon médecin à l’écoute des douleurs de son patient ! Cette dimension de sélection par les sciences ne me paraît pas toujours adaptée à une optimisation de l’offre de soins.
Ma dernière question, madame le ministre, concerne l’intégration à venir des formations des professions paramédicales – kinésithérapeutes, infirmiers, etc. – dans le modèle LMD, en complémentarité du sujet que nous examinons aujourd’hui.
Ces professions, qui sont nombreuses, méritent une meilleure reconnaissance professionnelle.
Ne conviendrait-il pas de poursuivre les réflexions sur l’organisation de cursus complémentaires pour l’ensemble des professions de santé, afin de forger de véritables solidarités dans le corps médical tournées vers un seul et même objectif : la santé du patient ?
Madame le ministre, j’en suis convaincu, la proposition de loi qui nous est soumise est une véritable mesure de progrès. Il convient d’en adopter le principe aujourd’hui.
Cependant, compte tenu de l’inquiétude manifestée par certains, notamment par une partie des étudiants, voire des lycéens en cours d’inscription, je soutiendrai les propositions de report d’un an de cette importante réforme, pour qu’elle puisse être appliquée dans les meilleures conditions par les universités.
M. le président de la commission des affaires culturelles et M. le rapporteur, qui a achevé ses consultations le week-end dernier, nous ont convaincus du bien-fondé de cette position, même si nous sommes conscients qu’elle décevra tous ceux qui s’étaient beaucoup investis pour se préparer à une application de la réforme dès la rentrée de 2009, et qu’elle reporte de facto les solutions avancées pour lutter contre le taux d’échec dramatique des étudiants concernés.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à Mme la ministre.
Compte tenu de l’heure, je vais tenter de globaliser un certain nombre de réponses.
Les pharmaciens auront tout à gagner à cette réforme qualitative de l’enseignement dispensé en première année. Il est donc bien entendu que ce qui fait la force aujourd’hui de la première année de pharmacie servira de modèle aux autres filières. Il n’y aura pas de nivellement par le bas. C’est tout l’objet de cette réforme.
Par ailleurs, cette réforme se fera au bénéfice et au service des étudiants, qui ont été associés à la réflexion – ils ont encore été reçus cette semaine.
C’est pourquoi je tiens à vous rassurer : oui, il y a aura une période transitoire dont les modalités seront définies dans les arrêtés d’application. Les deux projets d’arrêtés sont prêts. Nous les soumettrons à la concertation dès que possible.
Toutefois, je peux vous affirmer que je veillerai à ce que des conditions de triplement facilitées soient garanties à tous les étudiants primants ou doublants lors de la mise en place du L 1 santé.
Oui, les étudiants pouvant bénéficier du « droit au remords » seront, bien entendu, des étudiants qui auront réussi au moins deux concours.
En outre, concernant les coefficients multiplicateurs qui seront appliqués pour la réorientation en fin de premier semestre, je prends l’engagement de proposer aux universités d’appliquer un coefficient élevé la première année pour l’affiner au fil du temps. Comme je l’ai dit, il ne s’agit pas de mettre en place des sanctions, il s’agit, au contraire, d’aider à se réorienter ceux qui en ont besoin. Ce coefficient sera probablement compris entre trois et quatre.
Enfin, j’ai entendu de manière récurrente poser la question de la date d’application de la loi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, mon intime conviction est que pour le bien-être des étudiants, nous devrions tout faire pour mettre en œuvre le plus rapidement possible cette réforme. Et je sais que les autorités universitaires et les équipes pédagogiques partagent mon sentiment.
Cela fait plus d’un an que nous travaillons avec tous les acteurs concernés sur le terrain. Les équipes pédagogiques se sont mobilisées, des circulaires ont été diffusées, la Conférence des présidents d’université a réalisé une enquête qui indique que les trois quarts des présidents d’université interrogés se disent prêts pour septembre 2009.
Mais ils ne sont que les trois quarts. Nous sommes déjà en février, les lycéens sont en train de s’inscrire pour leur entrée dans l’enseignement supérieur et la réforme n’a pas encore été votée.
Il est certain que les délais qui nous sont imposés sont courts. C’est pourquoi, je comprends tout à fait les inquiétudes que vous relayez, et je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Françoise Laborde applaudit.

Je suis saisi, par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mme Demontès, M. Domeizel, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 4.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires culturelles la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants (n° 146, 2008-2009).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
Aucune explication de vote n’est admise.
La parole est à M. Yannick Bodin, auteur de la motion.

Nous venons d’entendre à l’instant certaines de vos réponses, madame la ministre, mais j’avoue que demeure sur de nombreux points encore trop d’incertitude.
Une réforme de la première année des études de santé est nécessaire.
En effet, l’échec des étudiants en première année de médecine et dans certaines autres filières de santé s’élève à 80 %, voire à 90 %. Ce n’est pas acceptable !
L’étude du rapport du professeur Jean-François Bach, portant sur la réforme de la première année de médecine établit un diagnostic digne d’intérêt, qui aurait mérité des échanges au sein de la commission des affaires culturelles et avec le Gouvernement.
La proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui prétend, en effet, s’inspirer des conclusions de ce rapport, remis en février 2008, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
L’objectif visé par la réforme est l’amélioration de l’encadrement de l’étudiant afin d’éviter l’échec de ce dernier et de favoriser sa réorientation dans les meilleures conditions possibles.
La réalisation de cet objectif passe tout d’abord par une meilleure préparation des étudiants aux concours, ce qui implique une meilleure information sur les études et les carrières médicales, et ce dès le lycée. Cette information devrait comprendre des indications sur le numerus clausus par formation, ainsi que sur les besoins en zones urbaines et rurales « sous-médicalisées ». Ces données sont très importantes pour permettre aux étudiants d’appréhender leur futur métier.
Cette meilleure orientation aurait toute sa place dans le plan « Réussite en licence » que vous avez lancé en décembre 2007, madame la ministre. Pourtant, comme cela a déjà été souligné, il n’est pas fait mention de cette possibilité dans la proposition de loi qui nous est aujourd’hui présentée.
Dans ce texte, la première année d’études de médecine deviendrait commune avec la première année d’odontologie, de pharmacie et de sage-femme. Regrouper en première année de médecine plusieurs autres premières années d’études de santé est certainement une bonne chose. Cette proposition a le mérite d’éviter une sélection par défaut, comme c’est le cas avec le concours unique actuel.
Pour autant, une question importante se pose. Pourquoi avoir limité ce regroupement à quatre filières, alors que de nombreuses autres filières recrutent par le biais de l’actuelle première année de médecine ? Pour ne prendre qu’un exemple, je citerai les futurs kinésithérapeutes, qui sont donc exclus de ce regroupement alors que 70 % d’entre eux sont pourtant issus de la première année de médecine.
Cette disposition exclut sans raison et sans modalité de remplacement des filières qui sont en majorité alimentées par des étudiants en première année de médecine. Un travail plus approfondi sur ce point permettrait sans doute d’apaiser les craintes de nombreux étudiants et enseignants de ces autres filières d’études de santé.

De plus, n’apparaît pas, dans cette proposition de loi, la possibilité de passer plusieurs concours afin de diminuer les situations d’échec. Ce point constitue pourtant le cœur de la réforme. Sans cette mention, comment justifier l’intitulé même de ce texte prévoyant la « création d’une première année commune aux études de santé » ?
Un autre point essentiel à prendre en compte dans le projet de réforme qui nous est présenté est la prévention de l’échec des étudiants.
Pour ce faire, il est nécessaire d’organiser la réorientation de ceux qui ont obtenu la moyenne à leurs examens, mais n’ont pas été reçus aux concours, les « reçus-collés », ou ont échoué à leurs examens.
Cette réorientation pourrait avoir lieu soit dès le mois de janvier, après les premiers examens, soit à la fin de la première année. Pour les étudiants dont les résultats sont très insuffisants, la réorientation pourrait se faire vers une première année de licence sciences. En revanche, il faudrait permettre aux « reçus-collés » qui le souhaitent de poursuivre leurs études vers d’autres filières, leur première année étant validée.
Là encore, le manque de précision de cette proposition de loi ne peut que porter préjudice aux étudiants, puisque ni le choix des filières ni les modalités de la réorientation ne sont indiqués.
Enfin, le renforcement du tutorat doit être la clef de voûte de la réforme des études de santé. C’est un point essentiel pour lutter contre l’échec scolaire des étudiants. Là encore, cette proposition s’inscrirait parfaitement dans votre plan « Réussite en licence », madame la ministre, dont l’objectif est, permettez-moi de vous le rappeler, d’atteindre, à l’horizon 2012, le pourcentage de 50 % d’une classe d’âge au niveau licence. Or force est de constater qu’il n’en est même pas fait mention dans le texte que nous examinons aujourd’hui. Par qui ce tutorat sera-t-il assuré ? Sous quelle forme sera-t-il dispensé ? Des postes budgétaires seront-ils créés ? Combien d’heures y seront consacrées ?
Ne pas réaffirmer dans la loi que le tutorat doit être utilisé et valorisé laisse perdurer le système des « officines privées », dont on a aussi beaucoup parlé ce soir, et qui permet aux seuls étudiants issus des milieux favorisés de préparer le concours en parallèle avec des études à l’université. Cela pose une nouvelle fois le problème de l’égalité des chances à l’université. Il était pourtant facile, et immédiatement possible, de rompre avec les statistiques démontrant que les étudiants qui réussissent sont ceux qui sont issus de familles aisées.
Pour ma part, vous le savez, je suis très attaché à la diversité sociale, comme le soulignait le rapport d’information que j’ai présenté, en septembre 2007, au nom de la commission des affaires culturelles, qui a été unanime, n’est-ce pas, monsieur le président Legendre ?

Je l’ai dit au début de mon intervention, la réforme de la première année de médecine est nécessaire. Les propositions du rapport Bach ouvraient des pistes de réflexion. Lorsqu’il a été annoncé qu’une proposition de loi s’inspirant de ce rapport avait été élaborée, c’est avec un esprit ouvert que nous l’avons accueillie. Malheureusement, la lecture de la proposition de loi nous laisse perplexes.
En effet, en lieu et place de préconisations précises, ce texte, qui peut être assimilé à une loi d’habilitation, ne comporte aucune proposition concrète et précise répondant aux nombreuses questions qui sont posées et ne donne aucune garantie quant à la prise en compte des souhaits exprimés par les intéressés, étudiants et enseignants. C’est un chèque en blanc, j’allais presque dire une coquille vide.
Enfin, force est de constater que, une fois de plus, c’est la précipitation qui domine pour la mise en œuvre de la réforme. La proposition de loi prévoit – j’ose encore espérer que l’on pourra peut-être employer tout à l'heure l’imparfait – l’application du dispositif dès la rentrée 2009-2010. De l’aveu même des doyens d’université, qui appellent la réforme de leurs vœux, les universités n’auront pas les moyens de s’organiser matériellement et financièrement pour mettre en œuvre cette réforme à la rentrée prochaine, car nous sommes déjà au mois de février.
Le Gouvernement a transmis, le 1er août 2008, aux présidents d’universités de médecine, d’odontologie et de pharmacie une circulaire en vertu de laquelle ils sont invités à adapter, dès la rentrée universitaire 2009-2010, leurs licences en fonction du schéma LMD afin « de favoriser une meilleure réorientation des étudiants des professions de santé au sein de ces professions et vers d’autres filières ».
Malheureusement, comme pour la réforme de la formation des maîtres, aucune indication n’a été fournie aux présidents des universités pour que tous respectent un cadre commun pour la réécriture des licences. Cela explique d’ailleurs, pour une bonne part, le mouvement actuel de grève et de protestation des étudiants. Reconnaissez, madame la ministre, que nous vous avions prévenue au moment du vote de la loi.
Le processus de Bologne, sur lequel est fondée votre circulaire, fixe à 2010 la date butoir pour la mise en conformité du dispositif LMD par les États membres de l’Union européenne. Prévoir l’application du dispositif à la rentrée 2010 semblerait donc à la fois plus réaliste et plus respectueux du travail qui doit être mené par les universités. Profitons de cette année supplémentaire pour organiser les concertations nécessaires et permettre la mise en place de ces dispositifs dans la sérénité. La précipitation est toujours cause d’échecs ultérieurs. Voyez ce qui s’est passé pour les enseignants-chercheurs, par exemple, ou pour la réforme du lycée que votre collègue Xavier Darcos a dû abandonner au profit de missions confiées à MM. Descoings et Hirsch. Qui souhaite voir les étudiants et les enseignants de médecine se joindre à la mobilisation qui enfle chaque jour davantage ? Certainement pas vous, madame la ministre ! Pas plus que nous !
La sagesse exigerait de se donner le temps d’écouter chaque partie et de prendre en compte ce qui nous est dit.
En dépit des arguments que je viens d’exposer, je me doute, madame la ministre, que vous ne manquerez pas d’indiquer que vous préciserez les contenus de la proposition de loi, une fois adoptée. Pourtant, je considère qu’il est indispensable d’approfondir ici et maintenant l’étude de ce texte.
Une loi mettant en place un dispositif précis doit être élaborée. Pour ce faire, il est nécessaire d’auditionner les présidents des universités des filières médicales, les étudiants de ces filières, les professionnels issus de ces filières, …

…mais également vous-même, madame la ministre, puisque vous êtes la principale actrice de la réforme qui sera mise en place. Or ce travail n’a été fait ni par la commission des affaires culturelles ni par la commission des affaires sociales.
Seul ce travail nous permettra d’élaborer une loi digne de ce nom, susceptible de lutter contre l’échec en première année universitaire, de mettre en place un véritable dispositif de réorientation des étudiants, de valoriser le tutorat et d’intégrer l’ensemble des filières médicales et paramédicales. Trop de questions restent imprécises ou sans réponse.
C’est pourquoi nous demandons le renvoi à la commission de cette proposition de loi, avec le seul souci – croyez-nous – d’aboutir à une réforme nécessaire et utile, sur laquelle le plus grand nombre d’entre nous pourraient s’accorder ou parvenir – pourquoi pas ? – à un consensus.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Il me semble vraiment difficile de soutenir que les dispositions prévues dans la proposition de loi n’auraient fait l’objet d’aucune concertation, alors qu’elles résultent des trois rapports successifs qui, de 2003 à 2008, ont concerné la nécessaire réforme de la première année des études de santé. Je pense tout particulièrement au rapport de M. Jean-François Bach de février 2008, dont les préconisations inspirent largement la présente proposition de loi.
Par ailleurs, je rappelle qu’une circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche d’août 2008, adressée aux recteurs d’académie ainsi qu’aux directeurs d’unités de formation et de recherche concernés, a fixé les principales orientations de la réforme.
Notre rapporteur, M. Jean-Claude Etienne, a procédé à toutes les auditions nécessaires. Il a même poursuivi ses consultations en fin de semaine dernière.

En outre, je rappelle que la proposition de loi identique dont il était l’auteur a été déposée sur le bureau du Sénat en octobre 2008. Les sénateurs souhaitant s’intéresser au sujet ont donc eu toute latitude depuis lors pour approfondir la question et entendre les parties intéressées.
Enfin, notre amendement visant à reporter d’un an l’application de la réforme laissera tout le temps nécessaire à la poursuite des concertations liées à la mise en œuvre concrète au sein des universités.
Cela étant, il est vrai que le texte qui nous est proposé fixe un cadre très général pour cette réforme, renvoyant aux textes réglementaires le soin de fixer les modalités d’application. Il est donc légitime, d’une part, que nous demandions à Mme la ministre d’apporter tous les éclaircissements nécessaires compte tenu des questions que se posent encore les uns ou les autres, et, d’autre part, que nous nous préoccupions davantage encore à l’avenir des modalités d’application des textes que nous votons, mais l’organisation future de nos travaux devrait nous permettre de le faire plus facilement.
Le débat que nous avons eu ce matin en commission montre que la réforme de la première année des études de santé n’est pas sans lien avec des problématiques plus générales ayant une incidence sur l’organisation et le contenu des formations médicales et paramédicales.
C’est pourquoi il nous apparaîtrait utile d’organiser des auditions sur ces questions, qui pourraient être communes avec la commission des affaires sociales, si elle le souhaite. Je le répète, les réformes en cours sur les modalités de travaux du Sénat nous permettront d’y procéder, et nous avons bien l’intention de le faire.
En conclusion, cette motion tendant au renvoi à la commission ne me semblant pas justifiée, je vous demande, mes chers collègues, de la rejeter.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Je rappelle simplement que la loi est là pour poser les principes. D’ailleurs, je le sais, les deux assemblées sont soucieuses de ne pas avoir de lois trop bavardes. Je prends l’engagement devant la représentation nationale de veiller à faire en sorte que les arrêtés correspondent vraiment à l’esprit de nos discussions de ce soir.
La motion n'est pas adoptée.
I. - L'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1. - I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :
« 1° L'organisation de cette première année des études de santé ;
« 2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés ;
« 3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.
« II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
« 2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.
« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.
« III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. »
II. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. - Les arrêtés pris en application du présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous l’avez tous entendu ce soir, les orateurs sont unanimes pour souligner la nécessité de réformer la première année des études de santé au regard du taux d’échec actuel.
La mise en place d’une telle réforme permettrait, en principe, de faciliter la réorientation des étudiants en situation d’échec, par ailleurs inhérente au principe du numerus clausus qui y est instauré.
Néanmoins, j’aimerais évoquer quelques points problématiques liés à l’article 1er de cette proposition de loi et qui ont trait non seulement aux professions concernées, mais aussi aux modalités de mise en œuvre de cette réforme, lesquelles ne sont que trop peu explicitées.
J’aborderai tout d’abord l’exclusion des futurs kinésithérapeutes dans le projet de première année commune.
Cela risque d’être fortement préjudiciable à cette formation et aux étudiants optant pour cette voie. En effet, qui dit première année commune dit, par définition, tronc commun initial et donc apprentissage d’une culture commune de ce qu’est la santé. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’évoquer cela lors de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
Or les kinésithérapeutes sont actuellement 70 % à se présenter au concours commun par le biais de l’actuelle première année de médecine, et ce mode de sélection concerne les deux tiers des instituts de formation en masso-kinésithérapie. Les autres étudiants ont recours à une sélection par concours privé, qui relève moins d’un « recrutement qualitatif » des étudiants que d’une véritable sélection par l’argent : le coût moyen de ce concours se situe en effet entre 3 500 euros et 4 900 euros par étudiant selon les chiffres avancés par les fédérations, et cela pour une année préparatoire qui, de surcroît, est non validante !
La non-intégration des étudiants kinésithérapeutes au sein de cette première année commune aboutirait donc à une généralisation de ce type de sélection par concours privé, au mépris du principe d’égalité des chances qui doit rester le socle de notre système universitaire républicain.
Un second élément de préoccupation concerne ceux que nous avons évoqués à maintes reprises : les étudiants en pharmacie, qui restent encore nombreux à nous faire part de leurs inquiétudes face à la réforme qui leur est proposée. L’intégration de cette formation au système LMD et la mise en place d’une culture commune des études de santé présentent, sans conteste, de nombreux atouts. Mais cela ne doit pas se faire dans la précipitation, ni au prix d’une perte de qualité des enseignements spécifiques dispensés.
En effet, les étudiants en pharmacie bénéficient actuellement en première année d’un enseignement qui accorde une large place aux travaux dirigés : environ 30 % en moyenne d’enseignements dirigés dispensés, contre 10 % en première année de médecine. Les enseignants des facultés de pharmacie sont astreints à enseigner un minimum de 192 heures équivalents TD, alors qu’aucun quota n’est imposé aux enseignants des facultés de médecine.
Et pourtant, l’arrêté du 18 mars 1992 qui organise le premier cycle des études médicales impose bien un minimum de 30 % d’enseignements dirigés et pratiques. Mais cela n’est malheureusement pas appliqué dans un nombre croissant d’universités, du fait notamment d’effectifs trop élevés pour pouvoir l’assurer et du manque d’enseignants et de locaux.
La mise en place de cette année commune telle qu’elle est énoncée ne ferait donc qu’amplifier ce phénomène, au risque d’une sévère dégradation des conditions d’enseignement. Les étudiants en pharmacie passeraient ainsi d’un enseignement en petit groupe de 30 ou de 40 élèves à des cours réunissant de 150 à 200 étudiants, les effectifs globaux risquant, quant à eux, de tripler, voire de quadrupler.
Comment donc, dans de telles conditions, réussir à maintenir et à préserver la qualité de l’enseignement dont ils bénéficient actuellement ?
Cette forte hausse des effectifs va inévitablement accroître le recours aux enseignements sur supports numériques et aux téléconférences, induisant une perte de pédagogie évidente pour les étudiants en pharmacie, mais aussi pour l’ensemble des étudiants concernés par la réforme. En effet, – mais est-il utile de le rappeler, notamment aux enseignants comme moi qui sont présents ici ce soir ? – la richesse de l’interaction entre professeurs et élèves peut difficilement être compensée par le monologue d’une silhouette projetée dans un amphithéâtre surpeuplé.
Il est donc primordial de continuer à promouvoir un enseignement à taille humaine, qui est essentiel à la richesse et à la maîtrise des enseignements dispensés.
Et sans la mise à disposition des moyens financiers et humains nécessaires liée aux modalités de la réforme – moyens qui restent trop peu définis au regard du contenu de cet article –, celle-ci, prise en l’état, devrait clairement, je le crains, accroître les risques de gâchis humain qu’elle visait initialement à réduire.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans un souci d’économie de temps, j’irai à ce que je considère comme l’essentiel ; personne ne s’en plaindra ! Au demeurant, beaucoup a déjà été dit.
Madame la ministre, nous partageons le constat qui a conduit au dépôt de ce texte visant à réformer le cursus des études médicales dès la première année.
Nous pouvons souscrire à la proposition consistant à regrouper la première année, dans un tronc commun, les étudiants de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, laissant ouvert en fin d’année le choix de la spécialisation.
Nous approuvons les possibilités de réorientation à mi-parcours de la première année pour ceux des étudiants qu’un niveau insuffisant conduirait à l’échec, en les orientant vers des études scientifiques. Peut-être conviendrait-il aussi d’ouvrir des passerelles vers d’autres disciplines.
Nous pensons judicieuse la possibilité de laisser entrer vers ces disciplines médicales des étudiants justifiant de certains grades ou diplômes au cours de la deuxième ou troisième année.
Toutefois, madame la ministre, nous pensons que l’essentiel de la réussite réside dans le dispositif de la mise en œuvre – la voie réglementaire – de cette importante, nécessaire et urgente réforme. Or, cela a d’ailleurs été dit, ce dispositif nous est inconnu et tout le succès en dépend.
Des informations et des inquiétudes qui nous semblent fondées et qui remontent jusqu’à nous font apparaître que la concertation en l’état actuel est insuffisante. Il faut réussir cette réforme, madame la ministre. Elle est urgente, certes, mais l’urgence ne justifie pas la précipitation.
Il ne faut pas sacrifier ceux qui, entrés en première année, risquent d’en être les victimes. Il faut considérer la diversité des situations et des possibilités d’adaptation différentes sur le terrain. En un mot, nous pensons qu’il faut poursuivre encore la concertation avec tous, je dis bien « tous » les partenaires concernés pour ajuster au plus près le dispositif de la mise en œuvre.
Par conséquent, madame la ministre, il faut reporter la date d’entrée en vigueur de cette réforme à la rentrée 2010-2011, ce qui fait, par ailleurs, l’objet d’une proposition des deux commissions concernées que nous saluons et que nous remercions.
Sous réserve de l’adoption de ce report, nous voterons majoritairement pour la proposition de loi.

Madame la ministre, monsieur le président, mes chers collègues, permettez-moi, à l’occasion de l’examen de ce texte, d’aborder un des éléments du sujet qui, à lui tout seul, justifierait le renvoi à la commission, je veux parler de la démocratisation des études de médecine. J’en conviens, les principes posés par ce texte pourraient y participer, je dis bien « pourraient » ! Encore faut-il ouvrir le débat, ce que ce texte ne permet pas. C’est sur ce point que je souhaite vous interpeller, madame la ministre.
D’un côté, il y a une réalité statistique, celle de la démocratisation de l’école et de l’enseignement supérieur ; il y a aussi un discours présidentiel sur l’ouverture nécessaire des grandes écoles, et j’en suis heureuse.
Mais, de l’autre, il y a la réalité ! D’abord, cette démocratisation de l’enseignement supérieur concerne essentiellement les cycles courts. Ensuite, les inégalités ont changé de forme et renvoient désormais plutôt à la nature même des études. Je veux dire par là qu’il existe à l’Université des filières dites « d’excellence », qui ont totalement échappé au mouvement de démocratisation. La première d’entre elles, la plus sélective, madame la ministre, c’est malheureusement la médecine.
Je n’ai pas le temps de décrire le tableau des origines sociales des étudiants reçus. Mais, vous le savez, il est édifiant, et ce n’est pas un hasard.
Aujourd’hui, pour obtenir le concours, le passage par une officine privée est quasi obligatoire. Dans ces officines, d’ailleurs, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin : des équipes pédagogiques expérimentées, des enseignants, des spécialistes des cursus universitaires et même des professeurs agrégés. Tout ce monde s’y croise.
Vous trouvez ensuite des formations adaptées : du soutien intensif toute l’année, des stages de prérentrée et même une année préparatoire à l’année de préparation aux concours.
Vous trouvez enfin des moyens : des effectifs réduits à vingt-cinq par classe, des cours à quelques minutes à pied des facultés pour ne pas perdre de temps, bien sûr, un emploi modulable créé sur mesure en concertation avec les étudiants et une distribution de tous les supports – annales classées et corrigées, tableaux récapitulatifs, fiches de cours, résumés. Bref, tout y est. De quoi faire rêver les étudiants de nos facultés !
J’ai oublié deux détails essentiels.
D’abord, le coût de ces officines. Pour une année en classe préparatoire, par exemple, il faut compter jusqu’à 8 590 euros. Je dis bien 8 590 euros, pour s’inscrire à l’année préparatoire à l’année préparatoire au concours !
Enfin, je disais tout à l’heure que tout le monde semblait s’y croiser. Mais pas tout à fait... Vous ne croiserez pas beaucoup d’enfants d’ouvriers ou d’employés. Ceux-là, vous les trouvez sur les bancs de la fac, quand il reste de la place, à suivre des cours à des heures improbables, en train de courir derrière les polys et les livres à bas prix, ou derrière des étudiants admis qui voudront bien leur accorder quelques conseils ou aides. Pour ceux-là, sans moyens financiers, sans soutien particulier, les statistiques sont cruelles.
Voilà, madame la ministre, ce que je vois tous les jours à Marseille et quel est l’état de la situation des études de médecine un peu partout en France. Certains d’entre vous pensent peut-être que je grossis le trait. Malheureusement, non. Le mal est très profond.
Il faut revoir le cursus pour que la première année ne soit pas celle de l’échec de 80 % des étudiants inscrits. Une première année commune à l’ensemble des études de santé, sans doute ; des passerelles, des équivalences, des possibilités de réorientation, certainement !
Les étudiants qui ne peuvent se permettre de perdre une année tenteront peut-être leur chance. Mais, pour les rassurer réellement, beaucoup reste à préciser et à améliorer très concrètement : la question des moyens, de toute évidence, la question du numerus clausus, le principe même du concours. Autant de réponses qui pèseront dans les choix des futurs étudiants.
Aujourd’hui, la démocratisation de la médecine a échoué et a reculé. Le concours s’est financiarisé et de facto privatisé. Votre devoir, madame la ministre, est d’en prendre toute la mesure, de donner aux étudiants les mêmes chances et aux facultés de médecine les moyens d’assurer leur mission de service public.
Enseignants, parents, étudiants méritent une réponse urgente. La réforme est nécessaire, mais elle ne peut se faire sans concertation fouillée et surtout sans partir de principes bien posés. Or c’est tout ce qui manque à ce texte et à cet article !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons ce soir nous donne une bonne occasion, je crois, de répondre pleinement aux défis que représentent les premières années d’études de santé.
Ce n’est pas seulement parce qu’il convient de se mettre en conformité avec le processus de Bologne. C’est aussi parce qu’une réforme du système de sélection des étudiants qui seront appelés à nous soigner demain est indispensable.
Cette future loi est nécessaire également, car il convient d’adapter les modalités de réorientation des étudiants collés aux concours. Ce concours, qui est un véritable couperet, ne s’intègre que très imparfaitement aux nécessités d’une scolarité dans l’enseignement supérieur que nous avons organisée autour de trois diplômes : licence, master et doctorat, organisation dite « LMD ».
Cependant, cette proposition de loi n’est pas satisfaisante, car elle ne répond pas convenablement aux défis qu’elle est censée résoudre. On ne peut que regretter, d’ailleurs, que certaines propositions du rapport Bach qui allaient pourtant dans le bon sens, comme la mise en place du tutorat, n’aient pas été retenues.
Il ressort aussi de ce texte que l’on ne rompra pas, finalement, avec une certaine forme d’élitisme des carrières médicales. Plus précisément, c’est bien parce qu’il ne s’intéresse pas à la mise en œuvre pratique de la réforme proposée qu’il ne pourra pas remplir son objectif de réduction de l’échec en première année.
Alors que c’est d’une réorganisation complète de la filière que l’on aurait besoin, on se retrouve à gérer une crise qui ne conduira, en fin de compte, qu’à reproduire des mécanismes de sélection sociale et non à les supprimer.
J’en reviens à l’article 1er, que nous examinons actuellement.
Le premier point que j’évoquerai a trait à l’information des étudiants, qui peut paraître accessoire. Cependant, celui qui sait comment fonctionne le système universitaire français sait aussi qu’il s’agit d’une arme redoutable.
Les mieux informés sont aussi ceux qui réussissent le mieux. L’une des grosses lacunes de cette proposition de loi, c’est justement de ne pas mettre en place un système d’information en amont de la première année.
Là encore, on peut s’étonner de l’absence de dispositions permettant de rendre obligatoire la diffusion de ces informations. Le rapport Bach développait l’idée d’un entretien préalable entre l’étudiant potentiel et le corps universitaire. C’est une initiative qu’il aurait fallu encourager et développer.
Un second point de l’article 1er se révèle très insatisfaisant : il s’agit de l’harmonisation entre les différentes spécialités exigée par l’année unique. Un étudiant en pharmacie bénéficie d’un nombre d’heures de travaux dirigés substantiellement plus élevé qu’un élève en première année de médecine.
Sur quels critères l’harmonisation s’effectuera-t-elle ? La proposition de loi ne répond pas à cette question. En réalité, elle évacue, de fait, la question des moyens pour la mise en œuvre de cette réforme.
Il n’est en effet pas du tout équivalent, dans le cadre de l’enseignement d’une discipline, de favoriser les enseignements en cours magistraux plutôt que les cours de travaux dirigés. Les premiers sont indiscutablement moins pédagogiques que les seconds et produisent un « écrémage » – pardonnez-moi l’expression – bien plus important, si tel est le but recherché, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés des travaux dirigés correspondants.
Plus globalement, et on retrouve la question des moyens, cette réforme, toute nécessaire soit-elle, est faite a minima. Pour le dire clairement, les moyens ne suivent pas.
Afin de prévenir l’échec en première année, de nombreuses facultés ont mis en place des systèmes de tutorat. Le tuteur, généralement un étudiant en quatrième ou cinquième année, quelquefois un chargé de TD, a la possibilité d’établir un lien individuel avec l’étudiant et, donc, de mieux cerner ses difficultés et de l’aider à les surmonter.
Dans une discipline où l’échec en première année est abyssal – de l’ordre de 80 %, il faut s’en souvenir –, on aurait pu s’attendre à ce que cette proposition de loi reprenne une mesure aussi simple et efficace que le tutorat.
Tel n’est pas le cas, et on ne peut que le déplorer, d’autant plus que le tutorat aurait pu constituer un outil pour lutter contre la sélection par l’argent engendrée par la première année.
En ne retenant pas la solution du tutorat, on laisse les officines de cours privés occuper un terrain où tous les étudiants ne peuvent lutter à armes égales. Les prix qu’elles pratiquent viennent d’être rappelés par ma collègue du groupe socialiste.
En l’occurrence, ce choix ne fait qu’illustrer, une fois de plus, la place dévalorisée que l’on accorde à l’université dans notre pays.
Quoi que vous en disiez, madame la ministre, la réforme de l’enseignement supérieur n’atteindra jamais son objectif si l’on ne se décide pas à donner des moyens humains et financiers pour favoriser la réussite des étudiants.
On retrouve la même logique avec l’organisation matérielle des travaux dirigés. Comment peut-on penser que des travaux dirigés à cinquante, soixante, voire soixante-dix étudiants peuvent remplir leur fonction ?
Au-delà de vingt-cinq étudiants par TD, on ne peut déjà plus concilier soutien aux élèves en difficulté et approfondissement pour les élèves les plus à l’aise. Comment croyez-vous que l’on y parvienne à cinquante ?
Ce qui manque à cette proposition de loi, c’est donc l’assurance que les moyens financiers et humains indispensables à sa bonne réalisation seront mis en place.
Je prendrai un autre exemple, celui des cours magistraux. Les amphithéâtres sont bondés et les étudiants sont tellement nombreux qu’on a de plus en plus recours à la vidéoconférence.
Si cela peut paraître moderne, ce n’est pas forcément ce qui se fait de mieux du point de vue pédagogique. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec une étudiante en première année de médecine qui suivait certains cours en vidéoconférence : elle s’en serait volontiers passée !
Je souhaiterais donc que l’on envisage cette réforme de la première année des études de santé non pas sous le seul prisme des spécificités de ces disciplines médicales, mais aussi en étudiant la manière dont cette première année commune que l’on va créer s’intègre dans le système universitaire français et européen.
On va créer une filière commune à certaines disciplines médicales. Mais on va aussi mettre en place des modes de fonctionnement qui se calqueront davantage sur ceux des autres disciplines, notamment le droit, l’histoire ou l’économie.
C’est pour cette raison que j’ai voulu insister sur l’organisation pratique de cette première année. En effet, il n’est pas interdit de s’inspirer de ce qui se fait dans les autres disciplines ni de prendre la mesure des défis qu’elles rencontrent.
Si on veut démocratiser l’accès aux études de santé, il ne suffit pas de permettre aux étudiants de s’inscrire, il faut aussi leur donner les moyens de réussir.
Ce sont ces opportunités que cette proposition de loi ne met pas en place. Ce sont ces opportunités que nous essaierons d’inscrire dans la loi, mes chers collègues, au travers des amendements que nous vous proposerons au cours de la discussion.

Mes chers collègues, j’appelle chacun d’entre vous à la concision. En effet, nous ne pouvons poursuivre sur ce rythme, compte tenu de l’heure tardive. Je vous rappelle que la discussion du projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est prévue demain matin, à neuf heures trente.

M. le président. Mon cher collègue, je sais que vous avez prévu de longs discours. Je vous demande simplement d’adopter une petite discipline lors de vos interventions. Vous en avez d’ailleurs l’habitude, puisque vous donnez toujours l’exemple.
Sourires.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 8, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
et de sage–femme
par les mots :
de sage-femme, d'infirmier et de kinésithérapeute
La parole est à M. Serge Lagauche.

Cet amendement tend à inclure dans le processus de première année commune aux études de santé les kinésithérapeutes et les infirmiers.
L’exclusion des kinésithérapeutes et des infirmiers du bénéfice de cette première année de licence commune ne répond à aucune logique si ce n’est, en quelque sorte, à celle de « caste ».
Alors que le dispositif inclut dans la L 1 santé les pharmaciens qui n’exercent pas de tâches médicales, on exclut deux professions pourtant dites « paramédicales » du bénéfice de cette année de licence.
Je rappelle que les infirmiers, dont la formation est en cours de réforme depuis plusieurs années, se voient désormais déléguer des actes médicaux en vertu du décret du 29 juillet 2004. Leurs compétences déléguées sont sans cesse accrues. Ainsi, depuis l’année dernière, ils peuvent pratiquer le rappel de vaccination antigrippale, en vertu de l’article R. 4311-5-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, 70 % des kinésithérapeutes passent le concours en fin de L 1 ; ils sont recrutés à partir du PCEM 1, mais ne sont pourtant pas intégrés au processus mis en place par la proposition de loi. De très nombreux étudiants, admis au concours et bien classés, choisissent, par vocation, la kinésithérapie. Comme les infirmiers, les tâches qu’ils effectuent et les soins qu’ils apportent sont complémentaires des actes effectués par les médecins et requièrent des connaissances médicales.
J’ajoute que les futurs kinésithérapeutes sont tenus de financer des études souvent très chères, puisque leur formation s’effectue dans des établissements majoritairement privés. Ainsi, il faut compter entre 6 000 et 7 000 euros de frais de scolarité pour l’année de préparation en kinésithérapie, puis financer trois ans dans des instituts où la scolarité coûte en moyenne 4 000 euros. On en arrive donc à cinq années d’études pour un coût variant de 25 000 à 38 000 euros !
Ce coût ne rend pas les études de kinésithérapie accessibles à tous les étudiants ; seuls ceux qui sont issus de familles aisées peuvent envisager d’accéder à cette profession.
L’intégration des infirmiers et des kinésithérapeutes dans le L 1 santé favoriserait grandement l’interdisciplinarité, qui constitue un atout supplémentaire dans ces professions, et permettrait une plus grande ouverture de l’ensemble des professions ayant bénéficié d’une formation commune.

L'amendement n° 25, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, remplacer le mot :
sage-femme
par le mot :
maïeutique
II - En conséquence procéder à la même substitution dans l'ensemble de la proposition de loi.
La parole est à M. François Autain.

Il s'agit ici de donner une plus grande cohérence rédactionnelle à l’article L. 631-1 du code de l’éducation, en substituant aux termes d'« études de sage-femme » ceux d'« études de maïeutique ».
En effet, puisque, dans ce même article, il est fait mention des « études médicales, odontologiques, pharmaceutiques », pourquoi faire une exception pour les sages-femmes, en ayant recours à une périphrase qui évite de nommer leur spécialité par son nom, la maïeutique ?
Le terme de maïeutique vient du grec ancien et signifie « art d’aider les femmes à accoucher ». Par conséquent, on ne peut trouver mot plus juste, qui corresponde mieux au métier qu’exercent les sages-femmes.
Par ailleurs, nous devons penser aux hommes qui exercent ce métier.
Nous devrions nous habituer à parler non seulement de maïeutique, mais aussi de « maïeuticien », puisque ce terme a été reconnu par l’Académie française.

Il faut un début en tout ! Par conséquent, nous devrions, les uns et les autres, nous habituer à utiliser ces termes qui sont plus justes et n’ont donc aucune raison de ne pas être employés.

Monsieur Lagauche, en intégrant simplement les pharmaciens à la L 1 santé, nous avons pu prendre la mesure des problèmes et des interrogations qu’une telle décision soulevait, ne serait-ce que sur le plan matériel au regard de l’importance des masses à enseigner.
Ajouter une nouvelle discipline serait peut-être ajouter encore aux interrogations. Néanmoins, sur le fond, je rejoins votre préoccupation. Un jour viendra forcément où les masseurs-kinésithérapeutes auront leur place dans ce tronc commun. Ils le demandent, d’ailleurs, à la différence des infirmières et des infirmiers que nous avons également reçus et qui nous ont confirmé ne pas souhaiter participer, dans l’état actuel des choses, à cette première année commune aux études de santé. N’ayant pas pour habitude de faire boire quelqu’un qui n’a pas soif, j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 8.
En ce qui concerne l’amendement n° 25, j’ai moi-même parlé tout à l’heure de maïeutique, monsieur Autain. Je suis tout à fait d’accord avec vous sur le fond. Nous avons donc posé la question aux intéressées, qui ont répondu vouloir conserver le terme de « sages-femmes ».
Sur l’amendement n° 8, bien que majoritairement formés dans des écoles privées, les deux tiers des étudiants masseurs-kinésithérapeutes préparent d’ores et déjà leur première année en PCEM 1. Ce système est fondé sur le principe du cas par cas, par convention entre les écoles et les universités. Il présente l’avantage de revenir moins cher aux étudiants qu’une année de classe préparatoire privée.
La réforme ne changera rien, puisque ces étudiants pourront toujours être accueillis en L 1 santé par voie de convention.
En revanche, ils n’ont pas vocation à intégrer aujourd’hui – je dis bien « aujourd’hui » – la première année commune aux études de santé, puisque tous les kinésithérapeutes ne sont pas aujourd’hui formés de la même façon. À terme, il s’agit bien évidemment d’une option que nous n’excluons pas.
S’agissant des infirmières, les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, qui sont placés sous la tutelle du ministère de la santé, n’ont pas, pour le moment, en tout cas à très court terme, vocation à être remplacés par un cursus universitaire.
Un rapport des trois inspections générales – IGAS, IGF et IGA – a été remis à ma collègue Roselyne Bachelot-Narquin, qui, sur la base de ses recommandations, envisagera l’évolution de la formation des infirmiers.
Je voudrais tout de même rappeler que les professions paramédicales sont pleinement associées à cette réforme, puisque les passerelles entrantes prévues à l’article 1er permettront aux paramédicaux de se porter candidats pour entrer en deuxième année, sous réserve de réciprocité pour les reçus-collés de première année de santé d’intégrer les cursus paramédicaux. Par ailleurs, il sera toujours possible à un étudiant de L 1 santé de se réorienter vers des formations paramédicales.
L’amendement n° 25, qui tend à substituer le terme « maïeutique » aux termes « sage-femme », a suscité beaucoup d’interrogations au sein de mon ministère, comme vous pouvez l’imaginer, monsieur le sénateur.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous nous sommes rendu compte que le mot « femme » se rapportait non pas au praticien, mais à la patiente. Un ou une sage-femme, c’est celui qui a la sagesse des femmes, c’est-à-dire la science et la compréhension du corps féminin.
Marques d’approbation sur diverses travées
J’ajoute que ce terme très populaire est plébiscité par la profession.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

J’aimerais faire remarquer à Mme la ministre qu’il s’agit non pas seulement de modifier un mot, mais de rendre ce texte cohérent. L’article 1er vise les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. En toute logique, il devrait se référer aux études de maïeutique puisque l’on qualifie non pas des personnes, mais une science.

Ensuite, j’observe que vous accédez aux demandes des sages-femmes seulement quand cela vous arrange. Par exemple, je ne vois nulle trace dans ce texte de leur souhait de voir leur cursus intégré à l’Université.
Pour des raisons qui n’apparaissent pas évidentes, vous refusez un amendement qui prépare l’avenir ; je le regrette !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 9, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les cours sont dispensés par un enseignant.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Face au manque de moyens de l’université, face au manque de place dans les amphis, face à la pénurie de professeurs, une nouvelle pratique se développe dans les universités, le recours à la vidéoconférence.
Devant le développement de cette nouvelle manière de faire cours, l’amendement que nous vous présentons tend à placer les étudiants dans les meilleures conditions d’apprentissage possibles. Il relève donc d’abord d’une logique pédagogique.
Cela ne semble peut-être pas très moderne de refuser l’usage généralisé de la vidéoconférence et peut apparaître comme légèrement archaïque. Pourtant, il me semble nécessaire de bien établir qu’un cours d’amphithéâtre est avant tout un cours dispensé physiquement par un professeur à ses étudiants.
En effet, un cours n’est pas seulement un moment où le professeur transmet doctement son savoir ; c’est aussi un moment d’échange entre les étudiants et le professeur, à plus forte raison quand il s’agit de travaux dirigés. Ces derniers ont pour objet d’apporter un éclairage sur le cours dispensé en amphi, mais aussi de revenir sur les points qui peuvent poser problème aux étudiants. Il est peu probable que la vidéoconférence permette de réaliser pleinement et de manière satisfaisante cet échange. Interrompre ou interroger un écran, vous conviendrez que ce n’est pas évident !
La première année est une année excessivement difficile. Il apparaît donc que la vidéoconférence risque, en fin de compte, de la rendre encore plus sélective, en compliquant les conditions de suivi des cours.
La rationalisation des enseignements doit se faire au profit des étudiants. Tel est d’ailleurs l’objectif qui sous-tend cette proposition de loi. La vidéoconférence nous semble aller contre cet objectif et c’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement.
J’ajouterai, en conclusion, que si les amphis sont trop bondés et que l’on a besoin de recourir à la vidéo pour que les cours soient dispensés à tous les étudiants, il y aurait peut-être une autre solution : augmenter le nombre d’enseignants !
Je rappelle qu’aucun poste d’enseignant n’a été créé dans l’enseignement supérieur en 2008 et que, pour 2009, le Gouvernement va supprimer 450 emplois, alors même que l’enseignement supérieur fait partie des secteurs dits « sanctuarisés ».
Dans cette période où les enseignants-chercheurs s’interrogent sur leur statut, et alors que les recrutements d’enseignants sont de moins en moins importants, cela pourrait constituer un autre élément de la réforme de l’enseignement supérieur.
Je ne doute pas qu’enseignants et étudiants – et peut-être vous-même, madame la ministre – pourraient aisément s’accorder sur ce point.

Il existe, à l’heure actuelle, deux formes principales d’enseignement supérieur, lesquelles dépendent de la thématique et de l’importance du public auquel on s’adresse.
Pour des cours qui rassemblent un nombre important d’étudiants, nous avons besoin de faire appel à des techniques innovantes d’enseignement. Il reste toujours, fort heureusement, une place pour l’enseignement en petits groupes, sur un mode socratique de compagnonnage dans lequel la relation enseignant-enseigné est indispensable.
En ce qui concerne le premier aspect, nous ne pouvons pas fermer la porte aux établissements qui souhaitent entreprendre une démarche pédagogique innovante ; je pense notamment à l’université de Grenoble, très en pointe dans ce domaine.
En outre, ce serait aller à l’encontre de l’autonomie des universités que d’anticiper ou de prendre le pas sur les options que celles-ci pourraient retenir. Les universités doivent conserver la maîtrise de leur outil pédagogique.
L’avis est donc défavorable.
Même avis défavorable.
J’ajouterai simplement qu’en 2008 nous avons créé 2 250 supports de monitorat, soit 700 équivalents temps plein destinés à renforcer l’encadrement des étudiants dans le cadre du plan « Réussir en licence ».
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation par les mots :
, identique pour l'ensemble des établissements dispensant cette formation
La parole est à M. Serge Lagauche.

Cet amendement tend à éviter, d’une part, que ne surgissent trop de disparités de traitement entre les universités qui dispenseront un L1 santé, d’autre part, que la mise en place par voie réglementaire de l’organisation de ce cursus n’aboutisse, à terme, à un enseignement des professions de santé à deux vitesses, où coexisteront les bonnes facultés et celles où personne ne souhaitera plus étudier faute de places suffisantes aux concours et de bons débouchés à l’internat.
Nous souhaitons donc que les enseignements et les modalités du concours soient déterminés au niveau national et non établissement par établissement. Sinon, nous maintiendrons, voire nous accentuerons un système élitiste dans lequel les meilleures filières et formations ne seraient accessibles que dans certaines facultés et, de fait, réservées aux étudiants ayant préparé le concours dans le cadre des officines privées.

L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par Mmes Férat, N. Goulet, Morin-Desailly, Payet et Dini et MM. Maurey, Détraigne, Dubois, Biwer, Amoudry et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Compléter le 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, par les mots :
en garantissant en particulier la dispense d'enseignements dirigés à hauteur de 30 % du volume horaire global pour les études de pharmacie
La parole est à Mme Muguette Dini.

L'objet de cet amendement est de garantir que des enseignements dirigés seront dispensés aux étudiants en pharmacie à hauteur de 30 % du volume horaire global, dès lors que ces enseignements ne sont pas obligatoires en études de médecine.
En effet, la réforme ne doit pas se traduire par un appauvrissement en travaux dirigés de la première année d’études de pharmacie, ce qui pourrait nuire à la qualité de la formation. Ces enseignements doivent constituer, demain comme aujourd’hui, une part très importante du cursus dès la première année.
Nous sommes conscients que cette question relève plutôt du domaine règlementaire, mais le présent amendement vise surtout à attirer votre attention, madame la ministre.

Ces deux amendements ne relevant pas du domaine de la loi, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement n° 24 rectifié bis est retiré.
Monsieur Lagauche, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'information des lycéens et des étudiants sur les études et les métiers de la santé ;
La parole est à M. Claude Domeizel.

Lors de la présentation de son rapport, Jean-Claude Etienne a indiqué qu’il fallait que les étudiants puissent faire un vrai choix. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de ce souhait.
Si l’on veut réduire le taux d’échec au concours, il faut d’abord éviter que trop d’étudiants ne s’y présentent sans savoir ce que cela représente en termes de charge de travail, de durée d’études, de débouchés effectifs et de réalité des professions.
L’information sur ces données doit être réalisée dès le lycée et se poursuivre en L1. Elle doit être importante et ne saurait se résumer à la consultation facultative d’étudiants déjà engagés dans le processus lors d’un salon ou d’une journée portes ouvertes qui se tiendrait dans une faculté et qui aurait fait l’objet de peu de publicité dans les établissements d’enseignement secondaire.
Cette information doit être généralisée, accrue et améliorée ; elle constitue un véritable objectif en soi. Aussi souhaitons-nous inscrire cet objectif dans la loi au titre des mesures qui seront prises par voie réglementaire.
Je ne suis d’ailleurs pas le premier à le dire, ces dispositions répondant aux préoccupations exprimées dans le rapport Bach, qui préconisait de mieux préparer les futurs étudiants en les informant sur les études et les carrières médicales dès le lycée et à l’université.

Je comprends et partage l’objectif des auteurs de l’amendement ; vous l’avez d’ailleurs parfaitement exprimé, monsieur Domeizel.
Mais, à vrai dire, ces mesures me semblent redondantes, d’une part, avec les textes qui régissent d’ores et déjà le dispositif d’orientation active qui a été généralisé à la dernière rentrée, d’autre part, avec l’arrêté qui fixe le cadre des programmes. Je vous rappelle que le programme du premier semestre des études de santé prévoit qu’au moins deux jours sont consacrés à l’approfondissement de la connaissance des formations et des métiers concernés.
C’est pourquoi la commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement.
En effet, le dispositif de l’orientation active a déjà pour objet d’organiser cette information des lycéens, avec le concours des responsables des formations universitaires. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une disposition d’ordre législatif.

L'amendement n° 11 est retiré.
L'amendement n° 12, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités de l'entretien de pré-orientation et de motivation avec l'étudiant avant l'inscription en première année d'études de santé et les personnes habilitées à effectuer cet entretien ;
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Cet amendement répond aux mêmes préoccupations que celui que nous venons de défendre : prévenir l’échec au concours menant aux professions de santé.
Nous tentons, ici aussi, d’inscrire dans la loi l’une des propositions contenues dans le rapport Bach, afin que le pouvoir réglementaire en fixe les modalités d’application : il s’agit de la mise en place d’un entretien de pré-orientation et de motivation avec l’étudiant avant l’inscription en première année d’études de santé.
Les conclusions de ce rapport préconisaient qu’un entretien soit systématiquement organisé avec le doyen de la faculté de médecine pour ceux qui s’orienteraient dans cette voie. Le doyen Bach considérait que cet entretien, cumulé à une information dès le lycée, constituerait une « véritable orientation active », permettant aux étudiants « de choisir les carrières médicales pour lesquelles ils passeraient un concours ».
Nous souhaitons vivement que le Sénat suive les recommandations du rapport Bach, dont la qualité a été soulignée, et adopte cet amendement.

L’entretien visé à cet amendement est actuellement prévu en cas d’avis négatif d’une université sur le choix d’orientation d’un bachelier, dans le cadre du dispositif de réorientation active.
Pour m’être entretenu de ce sujet avec M. Bach, je crois pouvoir dire que sa position et celle de la commission sont identiques.
Aussi, je demande à son auteur de bien vouloir retirer l’amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Madame la sénatrice, cette disposition ne relève pas du champ législatif. Cela étant, je m’engage à ce que ce point soit précisé dans les arrêtés d’application de la loi.
J’ai déjà fortement encouragé les doyens, dans le cadre de l’orientation active, à mettre en place ces entretiens préalables, comme cela se pratique d’ores et déjà dans un certain nombre d’universités, par exemple à Rouen.
Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 12 est retiré.
L'amendement n° 13, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les modalités d'un tutorat, assuré par des étudiants des années supérieures ou par des enseignants pour des enseignements dirigés ;
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

L’un des objectifs majeurs de cette proposition de loi est de remédier à l’échec des étudiants en première année. Différentes pistes sont envisagées pour tenter d’y parvenir.
Notre amendement vise à mettre en place un moyen supplémentaire pour lutter contre l’échec des étudiants. Il s’agit, en l’espèce, de généraliser leur accès au tutorat. En effet, la relation entre les étudiants de première année et ceux des années supérieures est fondamentale pour la réussite au concours de fin de première année.
Des expériences de tutorat sont déjà conduites avec succès dans de nombreuses facultés. Il s’agit de la seule solution démocratique face à la recrudescence des officines privées, réservées aux étudiants issus de familles aisées et dont le coût des préparations est de l’ordre de 2 000 euros par an.
Le tutorat, partout où il existe, est dispensé moyennant une participation financière dérisoire de 5 à 20 euros par an.
Quand les tuteurs existent et qu’ils sont compétents, ce sont jusqu’à 70 % des étudiants d’une promotion qui y ont recours.
Les conclusions du rapport Bach préconisaient un encadrement généralisé des élèves de première année, s’appuyant sur un tutorat impliquant des étudiants d’années supérieures, des maîtres de conférence ou des professeurs d’université.
Toujours selon ce rapport, outre sa fonction d’aide à la préparation du concours, le tutorat constitue un outil de nature à permettre aux étudiants de première année d’affiner leur orientation.
Le présent amendement vise à donner une base légale à cette proposition.

Le tutorat est en effet extrêmement important. Pour le tuteur aussi, il n’y a rien de tel que d’enseigner pour apprendre. Simplement, la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit déjà ce tutorat, dont les modalités de mise en œuvre relèvent des universités, conformément au principe de leur autonomie.
Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Cet amendement est en effet satisfait par la loi de 2007. Le tutorat est évidemment très important et il doit pouvoir s’exercer y compris en première année des études de santé. L’arrêté d’application apportera des précisions à cet égard.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 14, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le contenu des programmes est établi en concertation avec les commissions pédagogiques des études de santé et celles des universités de sciences ;
La parole est à M. Yannick Bodin.

La sélection par les mathématiques est un problème ancien, qui, malgré ses détracteurs, a la vie dure.
Actuellement, la première année des études de santé est entièrement consacrée à l’enseignement des sciences dures, faisant de ces disciplines un outil de sélection au concours. Or les étudiants qui s’apprêtent à passer le concours ne sont pas forcément enclins à se former aux sciences dures ; ils sont davantage désireux de faire connaissance avec les disciplines de leurs futures professions.
Ce souhait d’apprentissage des disciplines de santé est logique, tandis que la sélection par les sciences est beaucoup plus contestable.
Est-il opportun de sélectionner de futurs médecins ou dentistes par les mathématiques ?
Ce n’est pas parce que l’on résout n’importe quelle équation sans difficulté que l’on sera doué pour procéder à des réductions de fracture ou pour accoucher des triplés dans les meilleures conditions ! Et inversement !
Sourires

Nous souhaiterions donc que les programmes de première année d’études de santé fassent l’objet de davantage de mixité entre les disciplines purement scientifiques et celles qui ont trait à l’enseignement des pathologies ou de la dispense de soins.
Pour ce faire, notre amendement tend à inciter les commissions pédagogiques des universités concernées à coopérer lors de la définition, par voie réglementaire, des programmes de L1 santé.

Sur le fond, cette mesure ne suscite aucune opposition. Il n’en reste pas moins qu’elle ne relève pas du domaine législatif.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
En effet, cette disposition ne relève pas du code de l’éducation. Cela étant, monsieur le sénateur, votre amendement est satisfait puisque le programme de L1 santé a fait l’objet, en juillet 2008, sur l’initiative de la direction générale de l’enseignement supérieur, d’un groupe de travail présidé par le professeur François Couraud et constitué de toutes les commissions pédagogiques concernées et des doyens des facultés de sciences.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Compléter le 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 163-1 du code de l'éducation par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats.
La parole est à M. François Autain.

Il s’agit, au travers de cet amendement, de laisser aux universités la capacité d’adapter les modalités d’accueil des étudiants aux besoins d’organisation et d’amélioration de la pédagogie, afin de leur permettre de pallier les difficultés que vont rencontrer les unités de formation et de recherche face à un afflux massif d’étudiants souhaitant s’inscrire en première année d’études médicales, afflux qui sera aggravé par cette proposition de loi, si celle-ci est adoptée.
La rédaction actuelle du texte laisse supposer que le concours de fin de première année, ainsi que le nombre d’étudiants admis dans chacune des quatre filières, sera fixé par université et non plus par faculté, comme c’est le cas aujourd’hui.
Cette liberté laissée aux universités permet de leur donner des moyens de lutter efficacement contre ces officines de cours privés dont on a beaucoup parlé, qui pénalisent les étudiants issus de milieux défavorisés. L’adoption de cet amendement favoriserait l’égalité effective des chances.

L’argumentaire de M. Autain est particulièrement prégnant. Son objectif est de conférer à une université implantée sur plusieurs sites dans des quartiers sociologiquement différents la possibilité de répartir entre ces derniers le nombre des étudiants.
Mme Ghali appréciera sans doute que la commission considère elle aussi que ces implantations universitaires sur différents sites dans des quartiers nouveaux et particulièrement fragiles sociologiquement sont très utiles. Les villes concernées par l’amendement de M. Autain sont essentiellement Lyon, Bordeaux et Toulouse.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, puisque son auteur a accepté de le rectifier afin de le rendre juridiquement recevable.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.
Monsieur Autain, j’ai particulièrement apprécié votre exposé des motifs, puisque vous vous placez sous l’égide du principe d’autonomie des universités, ce qui me réjouit.
Sourires

C’est exact, mais mon amendement ne se limite pas à cela, madame la ministre !
Certes, je prends aussi en considération le fond de votre amendement, monsieur Autain. Mais je sais que vous conférez aux mots tout leur sens !
Le numerus clausus est actuellement fixé par établissement et par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Aujourd’hui, le président de l’université n’a pas la possibilité de répartir ce numerus clausus entre différentes composantes. Or, comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur, cette possibilité se justifie pleinement pour certaines universités, telles celles de Lyon, de Toulouse ou de Bordeaux, qui possèdent plusieurs composantes, dont les plus récentes sont implantées dans des quartiers sociologiquement différents de ceux où sont situés leurs sites historiques.
À condition qu’un arrêté précise les modalités d’application de cet article, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Mme Christiane Demontès applaudit.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Dans le 4° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci
par les mots :
au terme de la première année des études de santé
La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Je crains fort de ne pas connaître le même succès avec cet amendement !
Sourires

La mise en place d’une réorientation précoce des étudiants à l’issue du premier semestre de la première année des études de santé vers un autre cursus n’est pas le moyen adéquat pour aboutir à l’effet escompté, à savoir permettre aux étudiants d’optimiser leurs chances de réussite aux épreuves de fin de première année.
En effet, réorienter un étudiant après trois mois vers une filière qu’il n’a pas choisie en estimant que cela va contribuer à son épanouissement ainsi qu’à sa réussite ultérieure ne me semble pas très crédible.
Il n’existe aucune statistique sur les résultats du premier semestre d’un étudiant primant et sur sa possible réussite au concours en tant que doublant. Dès lors, envisager le redoublement comme une perte de chance ou, dans tous les cas, comme une « année inutile » ne peut être justifié sur des bases statistiques. Cela relève simplement d’un jugement subjectif.
La réorientation précoce des étudiants n’ayant pas le niveau vers les facultés des sciences dans le but de valider une deuxième année de licence afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, présenter une nouvelle fois les concours de la première année d’études de santé ne me semble pas constituer une optimisation des chances.
En effet, considérant que les étudiants réorientés au premier semestre seront les plus mauvais étudiants, la chance pour eux de valider une première année de licence est minime. De ce fait, la boucle de rattrapage durerait deux ans et demi pour ceux qui souhaiteraient redoubler. Cette durée ne ferait qu’aggraver la perte de temps des étudiants plutôt que d’optimiser leurs chances et leur formation.
Enfin, la limitation des possibilités de redoublement ainsi que celles de réorientation des étudiants à l’issue du premier semestre vise seulement à restreindre le nombre d’étudiants inscrits en première année de ces études afin de masquer l’absence de moyens financiers pour mettre en œuvre correctement cette réforme, puisque, comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, aucun financement spécifique n’est prévu pour la L1 santé.
Pour toutes ces raisons, je vous demande d’adopter cet amendement.

L'amendement n° 15, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation, après les mots :
de la première année des études de santé
insérer les mots :
, lorsqu'ils en font la demande,
La parole est à M. Serge Lagauche.

Le dispositif que l’on nous demande d’entériner prévoit une possibilité de réorientation extrêmement précoce, dès la fin du premier semestre, des étudiants en L1 santé.
Je ne conteste pas la réorientation en fin de L 1. Elle peut-être appliquée sans le consentement des étudiants concernés. Les statistiques prouvent que les étudiants très mal classés au concours à l’issue de la L 1 ont effectivement peu de chances de réussir lors d’une seconde tentative. De l’avis des étudiants intéressés, il faudrait néanmoins réserver cette possibilité de réorientation aux derniers 15 % d’une promotion.
Si l’on procède à la réorientation précoce des étudiants à l’issue du premier semestre, autant dire que, dès mi-décembre, date de l’arrêt des cours, après seulement trois mois dans l’enseignement supérieur, avec tous les changements – rythme, travail, autonomie – que l’université implique pour un étudiant fraîchement sorti du lycée, le sort en sera jeté.
Cette sélection précoce aboutira à sortir des facultés de santé pour les orienter vers des facultés des sciences des étudiants en grande situation d’échec dans les matières de sélection du premier semestre, précisément les sciences. La situation est donc quelque peu ubuesque puisque des étudiants en échec en sciences se trouveraient réorientés vers une faculté des sciences.
Voilà pourquoi nous souhaitons que cette réorientation précoce, celle qui pourra être opérée dès la fin du premier semestre, ne se fasse que sur la base du volontariat de l’étudiant concerné.
Cet amendement reprend une demande présentée par plusieurs associations des disciplines concernées.
Je m’interroge enfin sur la manière dont les universités accueillantes pourront absorber un flot d’étudiants provenant des facultés de santé au début du deuxième semestre alors qu’elles auront logiquement fait le plein d’étudiants en L 1 au premier semestre, en fonction de leurs disponibilités.
Ces différents motifs nous incitent à vous demander de réserver la réorientation précoce en fin de premier semestre aux seuls étudiants demandeurs.

L’amendement n° 27 tend à interdire toute réorientation à l’issue du premier semestre. Il est contraire à la position adoptée par la commission la semaine dernière et je ne peux donc qu’y être défavorable.
L’amendement n°15 vise à rendre l’orientation facultative. Or l’orientation ne peut être facultative et elle s’inscrit dans l’esprit du texte. Cet amendement étant lui aussi contraire à la position adoptée par la commission la semaine dernière, je ne peux y être favorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 16, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants ayant obtenu la moyenne aux épreuves de première année et ayant échoué au concours d'entrée en deuxième année, sont admis à s'inscrire une deuxième fois en première année d'études de santé.
La parole est à Mme Christiane Demontès.

Nous attachons une grande importance à cet amendement. Il tend à autoriser le redoublement d’un étudiant reçu-collé, c’est-à-dire de l’étudiant qui a obtenu la moyenne aux épreuves, mais a été classé au-delà du numerus clausus au concours.
À l’heure actuelle, le redoublement est autorisé en L 1. Désormais, il ne le sera plus. Un étudiant ayant échoué au concours devra, avant de pouvoir tenter à nouveau sa chance, passer d’abord par la case L 2 en sciences, soit deux années de « perdues », même si, pendant ce laps de temps, cet étudiant acquiert des connaissances scientifiques.
Certes, on peut considérer que pour un étudiant ayant un niveau L 2 en sciences la sélection au concours par les sciences sera un jeu d’enfant, mais rien n’indique qu’il en sera de même pour la suite de ses études de santé.
Ce système alambiqué représente une perte de temps et ne constitue nullement un gage de lutte contre l’échec en première année. Nous souhaitons donc maintenir la possibilité de redoublement. Je constate d’ailleurs que certains de nos collègues partagent nos préoccupations puisque MM. Vendasi et Collin ont déposé un amendement, n° 5 rectifié, allant dans le même sens.

Si nous avons bien compris, ces mesures sont prévues par les textes règlementaires. Sous réserve que Mme la ministre nous le confirme, je vous invite à retirer et amendement, ma chère collègue.
Ces dispositions, effectivement très importantes, figureront dans les arrêtés d’application qui seront pris après concertation avec toutes les parties concernées.
J’ajoute que l’objet de la présente loi étant de donner plus d’acquis aux bons étudiants reçus-collés, je veillerai à ce que les arrêtés d’application leur garantissent non seulement l’acquisition de la totalité des crédits ECTS, c’est-à-dire des crédits transférables sur le plan européen, équivalents à une première année de licence, mais qu’ils leur laissent aussi la possibilité de redoubler.

Madame la ministre, l’une des difficultés auxquelles nous nous heurtons avec cette proposition de loi tient justement au fait que nous sommes obligés de vous faire confiance, car tout ne figurera pas dans la loi : des arrêtés seront pris.
Cet amendement est pour nous extrêmement important et c’est pourquoi nous le maintenons.
Nous comprenons votre propos, madame la ministre, mais nous ne pouvons pas vous faire un chèque en blanc.
Les domaines législatif et réglementaire sont fixés par la Constitution !
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 17, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants ayant obtenu la moyenne aux épreuves de première année et ayant échoué au concours d'entrée en deuxième année peuvent être admis en deuxième année de licence de sciences, à leur demande, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

Cet amendement est de la même veine que les précédents. Il tend à permettre l’admission en deuxième année de licence de sciences des étudiants reçus-collés, c’est-à-dire non admis au concours mais ayant obtenu la moyenne.
Madame la ministre, fort de ce que vous avez évoqué tout à l’heure concernant les sciences dures et l’allégement programmé du processus, il nous semble légitime que ces étudiants puissent intégrer la L2 en sciences, les programmes de première année étant similaires.
Ouvrir cette possibilité permettrait tout à la fois d’atténuer l’échec brutal à l’issue de la première année d’études médicales et de réduire le taux d’échec, qui flirte avec les 70 %.
Cette ouverture se justifie d’autant plus que certains titulaires de diplômes n’ayant rien à voir avec les études médicales auraient la possibilité d’intégrer la deuxième, voire la troisième année d’études médicales.
La logique serait respectée si, dans des filières concernant avant tout les sciences, les reçus-collés pouvaient intégrer la deuxième année en sciences.

A l’instar de l’amendement précédent, ces mesures seront prévues par les textes réglementaires. J’invite donc M. Mirassou à retirer son amendement après que Mme la ministre nous aura apporté une confirmation à cet égard. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Madame la ministre, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous maintenons notre amendement.
Nous considérons que le recours répété aux décrets affaiblit la loi. Si tout est mis en œuvre, ou supposé être mis en œuvre, pour « limiter la casse » et atténuer le traumatisme d’un échec à l’issue de la première année d’études de santé, pourquoi ne pas accepter cet amendement à vocation prophylactique et donner ainsi un signe fort aux étudiants qui souhaitent embrasser cette filière ?
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Vendasi et Collin, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Tout étudiant a la possibilité de présenter deux fois le concours de chaque filière, tenant compte de son cursus antérieur dans la limite de deux inscriptions maximum en L. 1 santé. Une levée exceptionnelle du cadrage du triplement au-delà de 10 % du numerus clausus sera autorisée pour l'année de transition.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
L'article 1 er est adopté.

L'amendement n° 18, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 635-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations d'enseignement supérieur permettant l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux, mentionnées au Livre III de la Quatrième partie du code de la santé publique, sont sanctionnées par les diplômes de licence, master ou doctorat. »
La parole est à M. Serge Lagauche.

Cet amendement tend à intégrer l’ensemble des formations d’enseignement supérieur paramédicales au processus de Bologne, appliqué en France par le système LMD, licence, master, doctorat.
Je rappelle que les États membres de l’Union sont tenus de mettre en place, avant 2010, un espace européen de l’enseignement supérieur structuré autour de deux cycles : un premier cycle d’au moins trois ans, la licence en France, et un second cycle, cours ou long, les deux ayant été retenus en France avec la maîtrise et le doctorat.
Les professions paramédicales ont toutes vocation à entrer dans le système LMD. Les études formant aux professions d’infirmier, d’orthophoniste ou de kinésithérapeute durant trois ans, elles pourraient ainsi être sanctionnées par une licence.

Cet amendement vise à intégrer l’ensemble des formations paramédicales post-baccalauréat dans le système LMD.
La concertation a été engagée par le ministre de la santé qui exerce la tutelle sur la plupart de ces formations.
J’ajoute qu’il s’agit une nouvelle fois d’une disposition d’ordre réglementaire.
Exclamations sur les travées socialistes.
Je suis également défavorable à cet amendement, mais pour un autre motif.
L’objet de la présente loi n’est pas de permettre la LMDéisation des professions paramédicales.
Un rapport a été remis à Mme Roselyne Bachelot-Narquin, qui est en charge de ces questions. C’est sur la base des recommandations de ce rapport que nous envisagerons l’évolution évidemment nécessaire des formations paramédicales.
La présente loi entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2009-2010.
La réorientation des étudiants à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci est mise en place au plus tard à compter de la rentrée universitaire 2011-2012.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L'amendement n° 6 rectifié est présenté par MM. Etienne et Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 1 est présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 3 est présenté par MM. Milhau, Barbier, Vendasi et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
L'amendement n° 7 est présenté par M. Darniche.
L'amendement n° 19 est présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
À la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les années :
par les années :
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié.

Après avoir poursuivi les consultations jusqu’à la fin de la semaine dernière, j’ai proposé hier matin à la commission des affaires culturelles de reporter d’un an la date d’application de ce nouveau dispositif. Je l’ai fait d’autant plus facilement qu’une majorité d’entre nous était favorable à ce compromis.
Nous tenons beaucoup à cette réforme que nous considérons comme un moyen essentiel pour lutter contre le taux d’échec très élevé des étudiants en première année d’études de santé. Nous attachons plus d’importance à l’adoption de son principe, qui semble faire l’objet d’un large consensus, qu’à sa date d’application.
Ce report permettrait de mettre en place, dans la sérénité, les conditions d’un succès plus affirmé de cette réforme.
En outre, cette année supplémentaire laisserait le temps aux universités de parfaire leur préparation et aux lycéens de mieux s’informer en amont.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 1.

Le principe de ce report, ébauché à l’origine par la commission des affaires sociales, a été repris par la commission des affaires culturelles. Je ne puis donc que souscrire à l’argumentaire de M. le rapporteur.

La parole est à M. Philippe Darniche, pour présenter l'amendement n° 7.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste.
L'amendement n° 30 est présenté par MM. Barbier, Milhau, Vendasi et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
À la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
à compter de l'année universitaire 2009-2010
par les mots :
au plus tard à compter de l'année universitaire 2010-2011
La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 2.

Dans la mesure où il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement de la commission, nous le retirons.

Il s’agit également d’un amendement de repli. Par conséquent, nous le retirons.
Mon intime conviction, vous la connaissez : pour le bien-être des étudiants, nous devrions tout faire pour mettre en œuvre le plus rapidement possible cette réforme. Je sais que les autorités universitaires et les équipes pédagogiques partagent mon sentiment.
Voilà plus d’un an que nous travaillons avec tous les acteurs concernés sur le terrain, les équipes pédagogiques se sont mobilisées, les circulaires ont été diffusées, la conférence des présidents d’université a réalisé une enquête indiquant que les trois quarts des présidents d’universités se disent prêts pour septembre 2009.
Cela étant, nous sommes en février, les lycéens sont en train de s’inscrire pour leur rentrée dans l’enseignement supérieur et la réforme n’a pas encore été votée. Il est certain que les délais qui nous sont imposés sont très courts.
C’est pourquoi je comprends tout à fait les inquiétudes que vous avez tous relayées ici, et je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Marques d’approbation.

M. Claude Domeizel. Madame la ministre, vous venez de nous expliquer que des circulaires ont été diffusées, etc. On se retrouve dans la même situation que pour l’audiovisuel.
Protestations sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Cela étant, je voterai bien sûr pour la série d’amendements, contre votre avis, parce que vous êtes défavorable à ces amendements, même si vous avez déclaré vous en remettre à la sagesse du Sénat.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 6 rectifié, 1, 3, 7 et 19.
Les amendements sont adoptés.

Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa de cet article.
La parole est à M. François Autain.

L'amendement n° 20, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les années :
par les années :
La parole est à M. Serge Lagauche.

Cet amendement s’inscrit dans la logique du report de l’application de la réforme à la rentrée 2010 que nous venons d’adopter.
Nous souhaitons que la mise en œuvre du processus de réorientation des étudiants en situation d’échec aux concours prévu pour 2011-2012 soit reportée à la rentrée de 2012.
Les problèmes de réorientation sont lourds à gérer. Il y a des hétérogénéités de situations en fonction des passerelles existant localement, du fait notamment du nombre de composantes dans chaque université. Il convient de maintenir un système de transition pour les étudiants déjà inscrits en L 1 et qui étaient, en vertu du système en cours, autorisés à redoubler.
Il importe aussi de mettre en œuvre la réforme des études communes dans la sérénité et d’appréhender, lorsque le système sera un peu rodé, le problème de la réorientation.
Même si je reste dubitatif quant à l’efficacité globale de la réforme, je pense qu’il vaut mieux régler les problèmes les uns après les autres afin d’éviter trop d’erreurs et de donner à cette réforme davantage de chances de porter ses fruits, à savoir la lutte contre l’échec en L1 santé.
Pour ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir reporter le processus de réorientation précoce des étudiants à l’année universitaire 2012-2013.

L’amendement n° 29, qui vise à supprimer le dispositif de réorientation des étudiants, est contraire à l’objectif de réduction du taux d’échec et à la position adoptée par la commission.
J’ajoute que, pour l’examen du contrôle des connaissances qui a lieu à la fin du premier semestre, les notes seront connues des étudiants. Ce contrôle a lieu actuellement, et les notes ne leur sont toujours pas communiquées. Il faut absolument combler cette carence !
Quoi qu’il en soit, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 29.
L’amendement n° 20 nous semble tout à fait logique avec la position de report d’un an de la réforme. En effet, il tend également à reporter d’un an la mise en œuvre des procédures de réorientation des étudiants, c’est-à-dire à appliquer celles-ci à compter de la rentrée universitaire de 2013. Ainsi, il pourrait être procédé à l’expérimentation souhaitée et à son évaluation en lui conservant sa valeur dans le temps.
La commission est donc favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.

L'amendement n° 21, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2009, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées, un rapport établissant les possibilités de mise en œuvre d'aides aux étudiants, inscrits en licence d'études de santé, s'engageant à s'installer dans les zones déficitaires en professions de santé. Les conclusions de ce rapport font l'objet d'un débat au sein des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles et sociales.
La parole est à M. Serge Lagauche.

À l’heure actuelle, en vertu de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, de nombreuses collectivités territoriales, régions ou départements, ont mis en place des dispositifs de bourses, d’un montant maximum de 24 000 euros, pour les jeunes internes s’engageant à s’installer comme médecins généralistes en zones déficitaires pour cinq ans.
Des dispositifs incitatifs existent également au niveau national, telles les exonérations fiscales accordées aux médecins s’installant dans certaines zones rurales ou communes de moins de 10 000 habitants.
Ces différents types d’aides n’ont, pour l’heure, pas permis de régler le manque criant de médecins dans certaines zones.
Le problème de ces zones déficitaires, en médecins généralistes plus particulièrement, est à tel point crucial que des initiatives voient le jour avec plus ou moins de bonheur : ainsi, tel département a récemment souhaité contraindre les jeunes diplômés en médecine à exercer quelques années en zone déficitaire ; on a aussi envisagé de taxer les médecins installés en zone non déficitaire pour les inciter à avoir une activité en zone déficitaire.
Nous pensons que ce type de déficit pourrait faire l’objet de solutions à la source. Je m’explique : pourquoi ne pas envisager que l’État accorde, dès les premières années d’études, des bourses importantes aux étudiants qui s’engageraient, une fois leurs études achevées, à s’installer en zones déficitaires ?
La question mérite d’être étudiée sérieusement. C’est pourquoi je propose que le Gouvernement s’en saisisse et transmette ses conclusions dans les meilleurs délais, avant le 30 juin prochain, aux deux commissions concernées afin que nous puissions avoir un vrai débat au Parlement sur ce sujet, débat qui pourrait déboucher sur le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi.

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur ce point. D’ici là, elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, car cette question ne relève pas du domaine de la loi.
Par ailleurs, je ne souhaite pas empiéter sur les compétences de ma collègue Roselyne Bachelot-Narquin. J’imagine que vous ne manquerez pas d’aborder avec elle le sujet de la régulation et de la démographie médicale lors de la discussion du projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires ». C’est dans ce texte que cet amendement trouverait tout son sens.

Nous comprenons bien que le Gouvernement ne veuille pas traiter la question au travers d’un amendement visant à insérer un article additionnel, mais il s’agit d’un véritable problème de société. C’est sans doute la raison pour laquelle M. le rapporteur s’en est remis à la sagesse de notre assemblée.
On pourrait également envisager que les internes soient obligés d’effectuer leur internat dans des hôpitaux ruraux. Cette expérience pourrait leur donner le goût d’un territoire qu’ils ne connaissaient pas auparavant. Il convient donc d’étudier sérieusement ce sujet, qui relève effectivement du domaine de Mme Bachelot-Narquin.
C’est pourquoi, même si M. le rapporteur a émis un avis de sagesse, il serait préférable de ne pas donner suite à cet amendement pour l’instant et de le réexaminer ultérieurement avec Mme Bachelot-Narquin. La question devra de toute façon être traitée.

Effectivement, nous présenterons de nouveau devant Mme Bachelot-Narquin un certain nombre de dispositifs, et je pense que tous les groupes le feront.
Au moment de la première orientation des étudiants, on pourrait leur montrer que la médecine générale peut s’exercer de telle et telle façon. Sans aller jusqu’à faire de la publicité, il conviendrait de souligner l’intérêt du service public. Vous avez aussi un rôle à jouer, madame la ministre, pour convaincre Mme Bachelot-Narquin.
Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.

L'amendement n° 21 est retiré.
L'amendement n° 22, présenté par MM. Lagauche et Bérit-Débat, Mme Blondin, M. Bodin, Mmes Bourzai et Demontès, MM. Domeizel et Fichet, Mmes Ghali, Lepage, San Vicente-Baudrin, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2009, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées, un rapport établissant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de la première année commune aux études de santé. Les conclusions de ce rapport font l'objet d'un débat au sein des commissions parlementaires chargées des finances, des affaires culturelles et des affaires sociales.
La parole est à M. Yannick Bodin.

Nous venons de décider sagement le report de la mise en œuvre de la réforme des études de santé et du processus de réorientation des étudiants en situation d’échec, notamment – c’est en tout cas ce que pensent fortement un certain nombre d’entre nous – pour des raisons de financement insuffisant de l’ensemble du dispositif.
Les 730 millions d’euros prévus pour l’application en 2008-2012 du plan « Réussir en licence », supposé accompagner la mise en œuvre hexagonale du processus de Bologne, ne permettront pas d’assurer la mise en œuvre de la première année de licence commune aux études de santé.
Je rappellerai que, sur ces 730 millions d’euros, seuls 35 millions ont été budgétisés pour 2008 et 67, 9 millions pour 2009, soit une enveloppe de 103, 3 millions d’euros pour les deux premières années de financement du plan.
Il est donc urgent que le Gouvernement s’engage sur les modalités et le montant du financement de cette première année commune aux études de santé.
Nous demandons que, avant le 30 juin 2009, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées un rapport établissant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de la première année commune aux études de santé, et que les conclusions de ce rapport fassent l’objet d’un débat au sein des commissions parlementaires compétentes, c’est-à-dire les commissions des finances, des affaires culturelles et des affaires sociales.
Un tel débat permettra de vérifier l’existence du financement effectif de la réforme dans la loi de finances pour 2010 afin de garantir l’application du dispositif à la rentrée, date que vient d’adopter notre assemblée dans sa grande majorité.

Il nous semblerait plus adapté de demander à Mme la ministre que le projet de loi de finances pour 2010 fasse clairement apparaître ce qui, au sein des crédits destinés au plan « Réussir en licence », relève de la réforme des études médicales. Ce point pourrait alors être débattu dans le cadre du débat budgétaire.
Nous suggérons aux auteurs de l’amendement de le retirer, mais nous souhaiterions connaître l’avis de Mme la ministre.
Il est défavorable, pour des raisons de principe. Le L1 santé n’est pas le seul : le L1 sciences humaines, le L1 droit, le L1 éco-gestion, le L1 sciences doivent également mettre en place des moyens très importants de réorientation, de tutorat, etc., et je ne privilégierai pas l’un ou l’autre : chacun aura droit à sa part du plan « Réussir en licence ».
En revanche, pour 2009, nous avons procédé au sein du budget du ministère – c’est la première fois depuis de longues années ! – à des réallocations de moyens, en fonction du nombre d’étudiants et de l’évolution des étudiants, dont les universités de santé ou comportant une filière santé ont largement bénéficié. Je citerai quelques chiffres : 4 millions d’euros supplémentaires pour le budget de l’université d’Angers, 5 millions d’euros pour Lille II, 4 millions d’euros pour Montpellier I, soit des augmentations de l’ordre de 25 % pour des établissements habitués à voir leurs moyens croître de 1 % ou de 2 % par an. C’est donc colossal !
En outre, tous les redéploiements d’emplois d’enseignant-chercheur se sont opérés au profit de ces mêmes universités ; ainsi, Lille II verra cette année la création de quinze postes d’enseignant-chercheur.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. Excellente université !
Sourires
Je m’engage donc à ce que les moyens soient disponibles pour le L1 santé, mais de la même manière qu’ils le seront pour les autres L1, dans le cadre du plan « Réussir en licence ».
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Nous avons pris ce soir une importante décision concernant la première année des études de santé qu’il est absolument nécessaire de compléter en affichant notre volonté de la soutenir par un engagement financier véritablement défini et ciblé. Tel est l’objet de l’amendement n° 22.
Je ne doute évidemment pas, madame la ministre, que vous tiendrez compte de notre demande, d’autant que, par notre vote de tout à l’heure, nous l’avons implicitement intégrée au texte. Il n’empêche que, si nous pouvions graver dès maintenant cet engagement dans le marbre, nous serions rassurés et dormirions plus sereinement cette nuit.
Sourires
L’amendement n’est pas adopté.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.
Compte tenu de l’heure, je ne peux, mes chers collègues, que vous inviter à la plus grande concision.

Dans le cadre des propos tenus par le président de la commission des affaires culturelles sur la façon dont les choses doivent se dérouler, nous sommes tout à fait d’accord avec le report d’un an de l’application du dispositif : il est effectivement important, notamment, de prendre le temps de procéder à certaines vérifications.
Les membres du groupe socialiste ont hésité toute la soirée pour savoir si, sur l’ensemble de la proposition de loi, ils s’abstiendront ou voteront positivement.
Madame la ministre, vous en avez appelé à la sagesse. Comme nous sommes des sages, nous attendrons que l’avenir se dessine plus clairement, car nous ne sommes pas certains que l’ensemble des ministres s’adapteront rapidement au nouveau rythme que la réforme en cours imprimera dorénavant aux travaux parlementaires.
L’expérience montre que certaines lois n’entrent jamais en vigueur parce que les décrets d’application ne sont pas publiés. C’est là une source fréquente de blocages, et ce problème relève également du contrôle parlementaire.
Madame la ministre, nous vous faisons pleinement confiance, mais l’incertitude qui pèse sur l’avenir nous conduit à considérer que l’attitude la plus sage que nous puissions adopter ce soir est l’abstention. Les réponses très positives que vous avez apportées – vous avez même accepté certains de nos amendements – nous donnent néanmoins l’espoir que nous pourrons être en total accord avec vous lorsque nous aborderons la phase d’application de cette loi.

Le débat a été long, mais il nous laisse un peu sur notre faim, et ce pour plusieurs raisons. La principale est sans doute que la plupart des amendements visant à préciser les termes de la loi ont été rejetés au profit de la voie réglementaire. De ce fait, l’objet de la loi se trouve réduit, dans les meilleurs des cas, à l’atténuation ou au contournement des effets les plus néfastes du numerus clausus, qui reste sacralisé.
Je conclurai par un regret que, d’ailleurs, nombre de nos collègues ont déjà exprimé : le débat a été disjoint – même si cela n’est pas de votre responsabilité, madame la ministre – de celui qui va avoir lieu dans quelques semaines et qui, par un effet mécanique inévitable, aboutira à la définition du profil sanitaire de notre pays pour les vingt ou trente années à venir.
Cette disjonction est difficilement concevable au moment où vous défendez un texte destiné à mettre en place sans le figer le cursus de formation de ceux qui, demain, représenteront le pilier de l’organisation sanitaire de notre pays : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes.
Ce cursus se trouve, en quelque sorte, cadenassé dans un volet réglementaire facilement dissociable de l’essence même de ce que devrait être la loi, si bien que la question demeure entière : quid des études médicales qui forgeront les praticiens de demain ?
Certes, madame la ministre, vous ne pouviez empiéter sur les prérogatives de votre collègue chargée de la santé. Vous comprendrez cependant que nous puissions regretter cette situation et que cela nous conduise à nous abstenir.

Madame la ministre, vous avez partiellement répondu aux questions que je vous avais posées dans la discussion générale, et je suis bien obligée de vous faire confiance.
J’espère que nous pouvons compter sur votre volonté de tenir tous les engagements que vous avez pris : alors, la loi sera effectivement une bonne loi, ce qui ne serait pas le cas si, par hasard, certains points devaient ne pas être réalisés. Je le regretterais, car l’idée qui sous-tend le texte est intéressante.
Je vais donc voter la proposition de loi, madame la ministre, et je compte sur vous.

Le groupe CRC-SPG s’abstiendra sur cette proposition de loi.
Certes, la Haute Assemblée a finalement voté le report de l’application de la réforme, point important auquel nous tenions et sur lequel nous avons donc satisfaction.
Malheureusement, d’autres points nous laissent sur notre faim. En particulier, madame la ministre, les explications que vous avez données en réponse aux nombreuses questions qui ont été posées au cours de la discussion générale, en particulier aux miennes, n’ont pas été satisfaisantes. Elles ont été assez brèves. Sans doute l’heure tardive vous a-t-elle empêchée d’intervenir aussi longuement que vous l’auriez souhaité.
J’estime cependant que nous pouvions d’autant plus légitimement attendre divers éclaircissements de votre part que la proposition de loi, faut-il le rappeler, renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser certains points. Aussi, je renouvelle ma demande : lorsqu’une loi est présentée au Sénat, nous aimerions connaître la teneur des textes d’application prévus pour la mise en œuvre des réformes qu’elle contient.
Enfin, je n’ai pas obtenu satisfaction sur la réorientation précoce, et je le regrette. Un risque réel subsiste pour les étudiants, car l’alternative n’est pas aussi satisfaisante que vous voulez bien l’affirmer.
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons.

Madame le ministre, nous allons franchir dans quelques minutes un pas très important pour les futurs étudiants des quatre filières concernées.
C’est vrai, nous avons été nombreux à exprimer des craintes. Pour ma part, les réponses que vous nous avez apportées me rassurent.
Par conséquent, c’est sans regret, et même avec enthousiasme, que je me prononcerai favorablement sur cette proposition de loi.

Le groupe du RDSE votera unanimement cette loi, puisqu’il a obtenu satisfaction sur le report de l’application de la réforme. Il restera cependant très vigilant sur le contenu des textes d’application.

Cela ne vous étonnera pas : le groupe UMP votera, bien sûr, la proposition de loi, car la voie réglementaire ne nous fait pas peur ; Mme la ministre s’est en effet fermement engagée à nous donner satisfaction sur les divers points en suspens.
Je ne saurais terminer sans féliciter notre collègue M. Etienne, qui a été un brillant rapporteur.
Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

M. le président. Nous n’oublierons pas le brillant rapporteur pour avis ni le brillant président de la commission des affaires culturelles !
Sourires

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.

J’informe le Sénat que la question orale n° 388 de Mme Anne-Marie Payet est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

J’ai reçu de M. Bernard Saugey, rapporteur de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures (no 34, 2008-2009), le texte de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Le texte sera imprimé sous le n° 210 et distribué.

J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de règlement (CE) n° …/… de la Commission du … mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Conseil et du Parlement européen en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4265 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Règlement (CE) n° …/… de la Commission concernant l’adoption d’une méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques visée à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4266 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4267 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y afférent.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4268 et distribué.

J’ai reçu de M. Bernard Saugey un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures (no 34, 2008-2009).
Le rapport sera imprimé sous le n° 209 et distribué.
J’ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole) (no 144, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 211 et distribué.
J’ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (no 274, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 212 et distribué.
J’ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale (no 275, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 213 et distribué.
J’ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d’éviter les doubles impositions et l’accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993 (no 38, 2008-2009).
Le rapport sera imprimé sous le n° 214 et distribué.

J’ai reçu de Mme Josette Durrieu un rapport d’information fait au nom des délégués élus par le Sénat sur les travaux de la Délégation française à l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale au cours de la première partie de la 55e session ordinaire – 2008 – de cette assemblée, adressé à M. le Président du Sénat, en application de l’article 108 du règlement.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 215 et distribué.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée, à aujourd’hui, jeudi 12 février 2009 :
À dix heures quarante-cinq et à quinze heures :
1. Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (no 83, 2008-2009).
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (no 96, 2008-2009).
À vingt-deux heures :
2. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, en application de l’article 72-4 de la Constitution, sur la consultation des électeurs de Mayotte sur le changement de statut de cette collectivité.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 12 février 2009, à une heure quarante-cinq.