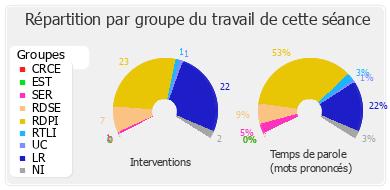Séance en hémicycle du 17 janvier 2017 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que sont parvenues à des textes communs, d’une part, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et, d’autre part, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé.

Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 17 janvier 2017, deux décisions relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- l’application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (n° 2016-604 QPC) ;
- l’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction (n° 2016-605 QPC).
Acte est donné de ces communications.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion du texte de la commission.
TITRE IER
STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER
La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français.
La République leur reconnaît le droit d’adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale.
Cet objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la Nation.
À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, l’État et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72-3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à :
1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ;
2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d’entre eux.
Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d’un développement durable, à accélérer les efforts d’équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l’échelle nationale et à l’échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à l’emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu’à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.
Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont définis en concertation par l’État, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

En 1956, Aimé Césaire rappelait que « l’égalité ne souffre pas de rester abstraite ». Ces propos illustrent parfaitement cette quête continuelle d’égalité promise par la République.
Aussi, je veux avant tout saluer en cet instant l’action du Gouvernement, qui, à travers le présent texte, a pris le parti d’étancher cette soif d’égalité, d’agir en faveur de l’amélioration du quotidien et des conditions de vie de ces quelque 2, 75 millions d’habitants des douze territoires citoyens de la République française.
L’action que sous-tend ce texte rappelle que la loi de départementalisation, conduite voilà maintenant soixante-dix ans dans certains territoires ultramarins, n’était qu’une amorce dans la marche sur le chemin de l’égalité.
Elle rappelle que l’égalité n’est pas seulement une notion philosophique ; elle est un principe fondamental de notre République.
Elle rappelle que la famille politique à laquelle j’appartiens n’a eu de cesse de s’engager avec force et d’œuvrer en faveur des outre-mer.
Elle me rappelle enfin que, d’où je viens, les écarts de niveau de vie persistent en dépit des politiques de développement volontaristes.
Cette quête pour l’égalité républicaine semble inassouvie, sans fin. En attestent les réussites que la gauche, à travers le quinquennat de François Hollande, peut mettre à son actif : la loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, le plan logement outre-mer, ou encore la loi visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer. Le présent texte vient parachever cette lente et longue démarche, sans pour autant y mettre un terme, parce que l’égalité formelle ne suffit plus, parce que la convergence entre tous les territoires de la République s’impose. Rome ne s’est pas faite en un jour ! Il en est de même pour l’égalité réelle.
Là où certains ne voient qu’une déclaration d’intention, je vois pour ma part un nouvel élan dans un lent et long processus. Il prolonge les causes défendues par ceux qui ont mené le combat politique pour la reconnaissance des outre-mer : Aimé Césaire, Léopold Bissol, Raymond Vergès, Joseph Pitat et Joseph Lagrosillière ne sont plus là pour en témoigner, mais ils continuent à vivre dans nos esprits. Ils avaient un rêve, ils se sont fixé des objectifs, un but. Il appartient à chaque Ultramarin, quel que soit son département, sa région ou l’article de la Constitution dont relève son territoire, d’embrasser leurs causes.
Ce projet de loi est loin d’être parfait ; il est jugé incomplet. Certains pensent même qu’il porte les traces de petits arrangements de dernière minute sans rapport avec son objet, et qui ne font pas l’unanimité.
Mais il a du moins le mérite de faire entendre ces voix trop lointaines que nous, élus ultramarins, avons à cœur de défendre pour rappeler qu’elles font aussi la richesse de la France.

Ce projet de loi repose sur les plans de convergence qui sont définis en concertation entre les collectivités locales et l’État.
Pour la mise en œuvre de ces plans, le texte du Gouvernement prévoyait, dans son article 2, de mobiliser trois dispositifs : l’expérimentation, possibilité ouverte à toutes les collectivités, , quelle que soit leur implantation, ainsi que deux autres mécanismes, ouverts à certaines collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir, d’une part, l’adaptation des lois et, d’autre part, l’habilitation à rédiger des lois dans un champ très défini par la loi.
Le texte de la commission fait disparaître l’article 2, qui énumérait ces dispositifs.
Je me permets de faire remarquer aux membres de la commission des lois que leur analyse n’est pas tout à fait exacte. En effet, il est écrit dans le rapport que « l’État et les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution – les régions et départements d’outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte – pourraient s’appuyer sur les trois leviers institutionnels que constitue le recours aux adaptations, aux expérimentations et aux habilitations prévues aux articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution ».
Mes chers collègues, vous n’avez cependant pas tenu compte de l’alinéa 5 de l’article 73 qui exclut La Réunion des possibilités d’adaptation et d’habilitation.
La suppression pure et simple, dans le texte de la commission, de la référence à ces leviers institutionnels que peuvent mobiliser les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ne saurait en rien changer la réalité constitutionnelle : La Réunion ne peut ni adapter des lois ni rédiger des textes dans un domaine bien défini de compétences. Dès lors, elle part dans cette conquête de l’égalité réelle avec un handicap de taille que rien ne saurait limiter, en l’état actuel de la Constitution.
La Réunion ne pourra donc utiliser que le dispositif d’expérimentation. Et chacun sait bien que tout ne peut être codifié par ce biais.
Comment pourra-t-elle répondre aux remarques – pertinentes, d’ailleurs – exprimées par la commission des lois quant à « la nécessité d’une approche adaptée tenant compte de la diversité des réalités des territoires ultramarins », ou encore à la prise en compte des « contraintes et […] caractéristiques particulières de ces territoires : superficie, environnement, patrimoine culturel et naturel » ?
C’est le deuxième texte sur lequel le Sénat, plus particulièrement sa commission des lois, écrit noir sur blanc ce que nous demandons depuis des années : la reconnaissance de notre réalité, de nos spécificités, de nos contraintes, mais aussi de nos atouts, avec les moyens législatifs adéquats.
C’est une évolution heureuse, sur le plan purement intellectuel. En revanche, sur le plan constitutionnel, La Réunion est condamnée à rester dans le droit commun, à devoir subir les éléments d’une réglementation qui n’est pas faite pour elle et des lois qui ne peuvent apporter aucune réponse positive aux défis qu’elle rencontre.

Il n’est pas question pour moi de rentrer ce soir dans un débat sémantique sur la notion d’égalité réelle, soixante-dix ans après la départementalisation. En ce sens, je rejoins mes collègues Jacques Cornano et Félix Desplan, qui ont déjà repris à leur compte les propos d’Aimé Césaire à ce sujet : l’égalité est ou n’est pas !
Dans nos territoires, que l’on évoque fréquemment comme des économies de comptoir ou des économies de transferts, c’est bien souvent en descendant dans la rue que nous avons obtenu des avancées. En effet, il faut le dire, en Guyane, la paix sociale s’achète, pourvu que la fusée parte à l’heure !
Pour autant, la discussion du présent texte nous donne une occasion unique de parler de nos territoires et de dessiner leur avenir. Vous le savez, mes chers collègues, ce projet de loi est le fruit d’un rapport de Victorin Lurel, qui dressait une énième fois un constat alarmant. Si je suis un historien attaché aux dates, je suis aussi un pragmatique, qui aime les faits et les chiffres. Ceux-ci sont têtus et leur réalité déplorable.
Les écarts de PIB par habitant vont de 15 % à 75 % selon les zones. Il ne s’agit là encore que du PIB, mais la liste des inégalités est longue. Celles-ci nous sont insupportables, dès qu’il s’agit d’accès aux services publics, aux soins de qualité, à l’emploi, à l’énergie, au logement, ou encore à l’éducation. Rappelons que, en Guyane, entre deux pas de tir de fusées, certains de nos compatriotes n’ont accès ni à l’eau ni à l’électricité.
C’est donc un défi de taille que nous devons relever. Il faut cependant le souligner, le travail réalisé à l’Assemblée nationale a enrichi de manière significative le projet de loi.
Au cours de nos débats, mes chers collègues, je vous proposerai de rectifier certaines anomalies qui subsistent sans que personne sache vraiment pourquoi. Je pense ainsi à la rémunération des prêtres, toujours imputée au budget de la collectivité territoriale de Guyane. Je vous suggérerai d’y mettre fin : il est temps que la séparation entre l’Église et l’État qui remonte en métropole à 1905 arrive dans notre territoire.
C’est aussi cela, l’égalité réelle : rétablir certains pans de droit dans nos territoires.
Chers collègues, profitons de l’examen de ce texte pour reposer les bases d’une relation de confiance entre l’État et ses outre-mer.
Je conclurai en rappelant les conseils précieux de Paul Vergés, citant Jean Jaurès : « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir. » Que ses mots et son engagement puissent nous inspirer ces prochains jours !

L’intitulé du projet de loi que nous examinons aujourd’hui montre, s’il en était besoin, que la notion d’égalité réelle vise avant tout le développement économique et social. Je ne doute pas un instant que cet objectif soit unanimement partagé dans cet hémicycle.
Le Gouvernement a choisi, avec ce texte, la voie de l’égalité qui honore la gauche, même si la différenciation, ne l’oublions pas, demeure une autre voie tout aussi respectable.
Pour ma part, je ne peux m’empêcher, à ce stade de nos débats, de souligner que le développement socio-économique dans nos territoires ultramarins me semble indissociable du bon fonctionnement de nos institutions locales. Je regrette donc que ce projet de loi, qui a pour objectif l’instauration de l’égalité réelle sur l’ensemble du territoire français, ait négligé l’aspect institutionnel au profit exclusif de l’aspect socio-économique. En effet, en matière de politiques publiques économiques, nous savons tous très bien, en tant que responsables publics locaux, combien les institutions locales jouent également un rôle déterminant.
Nous voyons bien, à travers ce texte, combien les besoins de chaque collectivité peuvent être divers et combien, d’une certaine manière, l’adaptation montre ses limites lorsqu’il s’agit d’atteindre la réalité locale au plus près.
Ainsi, je m’interroge sur le fait de savoir si la diversification des statuts institutionnels dans nos outre-mer ne nuit pas in fine à l’objectif affiché d’égalité. Autrement dit, n’avons-nous pas intérêt à lisser la spécificité législative de nos outre-mer pour l’ensemble de nos territoires ultramarins, exception faite pour la Nouvelle-Calédonie, et à promouvoir, de façon unifiée et simplifiée, l’application de l’article 74 de la Constitution ?
Au minimum, il ne doit plus être tabou de dire que l’identité législative peut, dans certains cas, être un plafond de verre indépassable pour l’adaptation. En effet, on le constate, la diversité des situations ultramarines conduit à une adaptation permanente des textes, souvent par ordonnances. La récente loi d’actualisation du droit outre-mer, qui a constitué une avancée, dont j’espère qu’elle se répétera dans le temps, révèle également la nécessité d’un ajustement régulier dans nos territoires.
Reste que ce texte revêt à mes yeux une autre avancée majeure pour le débat institutionnel que j’appelle de mes vœux, en Guadeloupe en particulier. Il montre sans ambiguïté que la République n’abandonne pas ses collectivités, que celles-ci soient régies par l’article 73 ou par l’article 74 de la Constitution. Cela me semble essentiel, parce que, trop souvent, le débat sur les institutions a été limité, sinon empêché par l’agitation du risque d’abandon de la République.

Le 12 mars 1946, devant l’Assemblée nationale constituante, Aimé Césaire déclarait : « L’intégration réclamée ne constituerait une improvisation. Ce serait l’aboutissement normal d’un processus historique et la conclusion logique d’une doctrine. »
La loi de départementalisation a constitué une étape fondamentale sur le long chemin de l’égalité. L’article 73 de la Constitution de 1946 posa le principe de l’identité de régime entre les départements d’outre-mer et les départements métropolitains. Dans les faits, il a fallu obtenir au cas par cas et non sans difficultés l’application d’un certain nombre de mesures d’égalisation.
Sept décennies plus tard, le bilan est insatisfaisant, les outre-mer accusant de sérieux différentiels si l’on se réfère aux indicateurs de développement humain.
Ainsi, en 2012, le PIB par habitant représentait en moyenne 62 % de celui de l’Hexagone. Selon l’enquête Emploi 2013, le taux de chômage des jeunes se situe entre 37, 4 % à Mayotte, 60, 6 % à La Réunion et 68, 2 % en Martinique, alors qu’il est jugé alarmant à 24, 6 % dans l’Hexagone. En 2013, 46 % des foyers allocataires ultramarins dépendaient complètement des prestations versées par les caisses d’allocations familiales pour vivre, contre 19 % en métropole. Le taux de pauvreté est entre trois et quatre fois plus élevé outre-mer que dans l’Hexagone. Le déficit de logements et l’importance de l’habitat insalubre, l’illettrisme touchent proportionnellement deux fois plus de personnes que dans l’Hexagone – 14 % contre 7%.
Ces éléments légitiment l’ambition du Président de la République et du Gouvernement, conscients que l’égalité réelle reste encore à construire. Je me félicite donc de l’examen de ce projet de loi, qui traduit la détermination du Gouvernement d’atteindre, sur une génération, une égalité des chances pour les Ultramarins et d’apporter des réponses aux enjeux auxquels l’outre-mer demeure confrontée, en dépit des avancées enregistrées.
Tout autant que l’égalité sociale, l’égalité réelle au plan économique s’impose. Il convient de réussir ce challenge. C’est à ce prix que l’outre-mer pourra accéder à des modèles propres de développement entraînant des formes de croissance créatrices d’emplois et, par là, de sérénité sociétale.
La mise en place des plans de convergence coconstruits, relayés par des contrats de convergence, à la dimension opérationnelle, devrait autoriser des avancées déterminantes sur la voie d’un développement durable autonome. Ces mécanismes devront fédérer les instruments de planification déjà existants : contrats de plan État-régions, programmes opérationnels européens…
La réussite de cette démarche ambitieuse nous permettra d’exaucer le vœu d’Aimé Césaire d’établir une « fraternité agissante aux termes de laquelle il y aura une France plus que jamais unie et diverse, multiple et harmonieuse, dont il est permis d’attendre les plus hautes révélations ».
L'article 1 er est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires d’un même État, notamment les territoires d’outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers entre ces territoires et la France hexagonale.

Le principe de continuité territoriale vise à compenser le coût de la distance entre la métropole et des territoires de la République qui en sont éloignés.
Au nom de ce principe, une dotation de continuité territoriale est instaurée au profit de la Corse depuis plusieurs décennies. Actuellement de l’ordre de 187 millions d’euros par an, elle contribue à la prise en charge des coûts des déplacements des personnes et des marchandises entre l’île de Beauté et la métropole. Dans les années 2000, les Ultramarins ont légitimement souhaité bénéficier eux aussi de l’application de ce principe. Réponse a été donnée avec l’article 60 de la loi du 22 juillet 2003 qui institue une dotation dite de « continuité territoriale » au bénéfice des collectivités ultramarines.
Mais force est de le constater, dès le départ, des lacunes se sont fait jour, notamment au regard du montant modeste de la dotation envisagée, sans comparaison avec celui de la dotation qui est attribuée à la Corse. L’article 60 susvisé a été soumis au Conseil constitutionnel au motif, non seulement qu’il était en deçà d’une véritable continuité territoriale, mais encore qu’il méconnaissait le principe d’égalité de traitement entre la Corse et les collectivités ultramarines.
Dans sa décision, le Conseil a jugé, d’une part, que « le principe dit de “continuité territoriale” n’[avait] valeur constitutionnelle ni en lui-même ni comme corollaire du principe d’indivisibilité de la République », d’autre part, qu’il n’y avait pas en l’espèce rupture du principe d’égalité avec la Corse, compte tenu des différences de situation entre la Corse et les outre-mer. Dont acte !
Par conséquent, le dispositif dit « de continuité territoriale » en vigueur dans les outre-mer est un mécanisme d’aides au voyage, éloigné d’une véritable continuité territoriale, car le montant limité de la dotation attribuée par l’État dicte l’obligation d’établir des critères et de faire des choix pour déterminer les publics bénéficiaires.
Dans son rapport de 2014, la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, la CNEPEOM, demandait d’analyser les conditions de la pérennité de ce dispositif et souhaitait que soient adaptés aux réalités ultramarines les coûts d’exploitation pesant sur les transporteurs régionaux. Elle donnait l’exemple de compagnies françaises de transport aérien des îles de la Caraïbe, confrontées en permanence à des concurrents étrangers desservant les mêmes lignes et ayant obtenu des droits de trafic en France, alors qu’elles bénéficient de coûts d’exploitation plus faibles. Qui plus est, des droits de trafic sont délivrés à des compagnies en vertu d’accords signés avec les pays étrangers, sans mesurer les conséquences que cela entraîne pour les outre-mer.
Il est donc nécessaire de prendre des dispositions propres à chacun des territoires ultramarins en fonction du contexte dans lequel s’exerce l’activité. Malheureusement, le texte que nous étudions aujourd’hui n’en donne aucune ébauche. Durant cette mandature, pas plus que durant les précédentes, aucun travail sérieux n’a été fourni par les gouvernements, par exemple sur le poids des taxes, le montant des redevances ou le sujet de la surcharge transporteur. La question de la continuité territoriale reste donc entière.

L'amendement n° 228, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Seconde phrase :
Remplacer les mots :
d’un même État
par les mots :
de la République
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Seconde phrase
Après le mot :
réguliers
insérer les mots :
ainsi que de solutions continues, sécurisées et performantes sur le plan économique de transport des données numériques
La parole est à M. Georges Patient.

La continuité territoriale, principe de « service public », a pour objectif de renforcer la cohésion et de faciliter les liaisons entre l’Hexagone et l’outre-mer, en compensant les handicaps liés à l’éloignement et à l’enclavement.
À l’heure du tout-numérique, la fracture ne cesse de grandir entre nos territoires représentant une réalité géographique et économique différente de celle de l’Hexagone. Certains départements, régions et collectivités d’outre-mer souffrent d’une fracture numérique, à l’instar de la Guyane, avec un taux de pénétration du haut débit très faible comparé au taux national. En outre persistent de forts décalages entre l’offre de communication électronique, plus chère et moins diversifiée. Enfin, la télévision numérique terrestre, la TNT, a un rythme de déploiement plus lent.
Face à une multitude de problématiques et d’acteurs – citoyens, entreprises, collectivités –, la participation de l’État est fondamentale. Il est nécessaire de faire du sur-mesure, de ne pas imposer des solutions qui ont un sens économique dans l’Hexagone, mais qui sont totalement inadaptées dans nos territoires : par exemple, considérer que la concurrence permettra la réalisation de progrès pour adapter les tarifs. La continuité numérique est une opportunité de développement de nos territoires à condition de veiller à ce que l’outre-mer bénéficie de l’ensemble des gains résultant de la disponibilité de services efficaces, accessibles et sécurisés.
Pour apporter une réponse à cet enjeu spécifique, le présent amendement vise à étendre à la continuité territoriale l’enjeu numérique comme priorité de l’action de l’État, notamment dans le transport et la sécurisation des données numériques.

Je comprends les motivations qui viennent d’être exprimées. Cependant, il n’est pas adapté de parler de continuité numérique, dans la mesure où il n’existe pas de réseau numérique national qui aurait vocation à relier tout le territoire.
En revanche, il convient d’encourager le développement de toute action favorisant l’accès des populations ultramarines à ces technologies. Ainsi, depuis le 1er décembre dernier, dans les territoires ultramarins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent commercialiser le très haut débit mobile. Les particuliers, comme les entreprises outre-mer, auront ainsi un accès aux nouveaux services et aux avantages de la 4G.
Pour toutes ces raisons, la commission des lois demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Bien sûr, le Gouvernement partage l’idée d’élargir la continuité numérique, puisque certains territoires et départements souffrent de fractures numériques. Nous y travaillons d’ailleurs, d’abord par le plan France très haut débit, à travers lequel le Gouvernement a décidé le déploiement du très haut débit dans l’ensemble du territoire français d’ici à 2022.
En outre, vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, le Gouvernement a réalisé l’extension de la 4G outre-mer à l’issue de l’examen de vingt-cinq dossiers de candidature, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, ayant choisi quatre départements lauréats. Nous avons ainsi permis le raccordement du territoire des îles Wallis et Futuna au futur câble sous-marin de communication entre les îles Samoa et Fidji, ce qui est très important pour le développement futur de Wallis-et-Futuna. La secrétaire d’État Axelle Lemaire et moi-même comptons réunir prochainement une table ronde pour poursuivre ce travail.
Pour toutes ces raisons, sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Je rappelle que l’article 3 bis résulte de l’adoption d’un amendement présenté à l’Assemblée nationale par Stéphane Claireaux et modifié à juste titre par le rapporteur de la commission des lois du Sénat.
L’amendement n° 29 rectifié tend à appeler l’attention sur un autre sujet en lien avec cet article, aux termes duquel la continuité territoriale, entendue comme l’organisation d’une offre de transports continus et réguliers entre les différentes composantes du territoire de la République et la France hexagonale, assure la cohésion territoriale de l’État. À ce titre, cette continuité représente un enjeu de souveraineté et doit constituer une priorité de l’action de l’État. Cet amendement vise à étendre cet objectif prioritaire au transport des données numériques ainsi qu’à leur sécurisation. C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste et républicain le soutient avec force.
L'amendement n’est pas adopté.

L'amendement n° 61, présenté par Mmes Hoarau et Assassi, MM. Billout, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les liaisons aériennes internationales depuis et à destination des outre-mer sont un facteur essentiel du rayonnement de la France et du développement économique des territoires ultramarins ; elles doivent être encouragées par une ouverture à la concurrence du ciel aérien.
La parole est à Mme Gélita Hoarau.

La desserte aérienne des outre-mer est primordiale, d’abord parce que ces entités – à l’exception de la Guyane – sont des îles et que la mobilité des citoyens est un droit inaliénable, ensuite parce que c’est un atout économique et touristique que nous devons négocier sur tous les plans.
Or les prix des billets, que ce soit pour les Antilles, pour l’océan Indien ou pour l’océan Pacifique, augmentent régulièrement. De nombreux paramètres sont à prendre en compte : les différentes taxes, mais aussi une concurrence timide. Les transporteurs aériens appliquent le yield management, c’est-à-dire une technique marketing de tarification flexible utilisée dans les services caractérisés par une forte présence de coûts fixes et par une certaine inertie des capacités proposées. En outre, en période de vacances scolaires, la clientèle que l’on dit « captive », celle des outre-mer, paie un prix exorbitant, calculé pour compenser la baisse du trafic touristique en période de basse saison. Le billet peut être ainsi trois fois plus cher en haute saison.
Ce n’est pas le seul problème. Il nous faut également aborder la question de la concurrence. Dans un rapport de 2014, le conseil économique, social et environnemental de La Réunion soulignait que seulement six compagnies desservaient l’île. Si l’on veut faire venir des touristes de notre environnement géographique, encore faut-il qu’ils aient la possibilité d’atterrir !
Une expérience a été menée, dite des « Iles Vanille ». L’idée était de proposer aux touristes une sorte de circuit des îles de l’océan Indien. Qu’a gagné La Réunion à cette mise en commun ? Presque rien, et ce parce que se sont posées des questions de visas et de délais pour les obtenir, mais aussi parce que la desserte n’a pas été aussi bien assurée que l’on veut le dire.
Il est donc impératif d’ouvrir le ciel ultramarin à d’autres compagnies aériennes, si l’on veut développer le tourisme dans nos outre-mer. Pour ce qui concerne La Réunion, je pense non seulement aux Comores ou à l’Afrique du Sud, mais aussi à la Chine ou à l’Inde, deux pays émergents qui ont la particularité d’être la terre natale de bien des Réunionnais. Les attaches familiales sont là, les coopérations économiques, sociales, éducatives, sportives peuvent être renforcées. Encore faut-il que la question de la desserte aérienne soit réglée.

Une telle disposition nécessite un examen plus approfondi et une réelle étude d’impact, car les risques de mettre en péril des compagnies aériennes sont réels. De plus, le concept de « ciel aérien » visé est inconnu du droit.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Nous partageons totalement cet objectif d’ouvrir, à terme, les ciels sur le monde entier. C’est vrai de La Réunion comme de tous les autres territoires. Il faut que nos concitoyens puissent voyager, voir d’autres pays, commercer, avoir des relations culturelles, que les plus jeunes puissent nouer des relations éducatives. Ce projet de loi prévoit des dispositions en ce sens. Force est de constater que, aujourd’hui, ces interconnectivités aériennes sont impossibles et compliquées.
Je partage l’avis du rapporteur : il s’agit d’un vrai chantier. Certes, des rapports et de nombreux travaux ont été menés et présentés au Sénat – lorsque j’étais députée, j’ai d’ailleurs assisté à une séance de travail sur ce thème.
C’est bien l’ambition que nous exprimons au titre IV de ce projet de loi. La demande de rapport sur l’interconnectivité et les connectivités aériennes et maritimes qui y a été maintenue le confirme.
L’objet de cet amendement est donc satisfait. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 bis est adopté.
La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation.

L'amendement n° 62, présenté par Mmes Hoarau, Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Première phrase
Après le mot :
logements
insérer les mots :
dont 100 000 logements sociaux
La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Nous nous félicitons que ce projet de loi aborde la question du logement, question si importante pour les populations d’outre-mer comme pour celles de la métropole. Cette problématique est d’ailleurs tellement prégnante que, le 29 août 2014, un plan logement a été adopté, qui définit des objectifs très précis. Plus spécifiquement, ce plan général a été complété le 26 mars 2015 par un volet outre-mer sur la période 2015-2020, signé par les ministres concernés et les différents acteurs du logement, qu’ils soient publics ou privés.
Dans les attendus et les constats de ce plan, sont reconnues les contraintes particulières de la politique du logement en outre-mer. Ces contraintes sont notamment liées à des besoins très importants attachés au rattrapage des retards actuels et aux effets de la croissance démographique, à la faiblesse d’un revenu moyen par habitant reflétant une forte proportion de bas revenus et un taux de chômage qui reste élevé. À cela s’ajoutent des disponibilités foncières limitées, des collectivités locales en situation financière difficile – comme partout –, ainsi qu’un parc de logements indignes important.
Les différents acteurs, dont l’État, se sont engagés à répondre à un objectif ambitieux : produire et réhabiliter au minimum 10 000 logements sociaux par an, qu’ils soient locatifs ou en accession.
Nous transcrivons par cet amendement ces objectifs sur la période retenue par cet article, soit dix ans. Cet objectif de construction est essentiel pour répondre à la demande sociale des habitants de l’outre-mer et aux enjeux de mixité et de droit pour tous au logement dans des conditions économiquement acceptables.

Cet amendement vise à flécher 100 000 logements par an dans le logement social, ce qui correspond à l’objectif fixé par le plan logement. Cependant, le projet de loi qui nous est soumis prévoit de globaliser le nombre de logements, en portant celui-ci à 150 000, en intégrant le Pacifique.
Les besoins n’étant pas les mêmes – à La Réunion par exemple, la construction de 9 000 logements par an est nécessaire –, la commission des affaires économiques a choisi de compléter cet article sans flécher la globalité, mais en précisant que les territoires auront la possibilité de décliner l’utilisation qui sera faite de ces logements. En d’autres termes, elle ne souhaite pas alourdir le processus en fixant un nombre strict de logements sociaux à toutes les collectivités, alors que celles-ci sont différentes. Elle privilégie la liberté.
La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 ter est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’Hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines suivants :
1° Accès à l’énergie ;
2° Accès au commerce électronique ;
3° Attractivité fiscale ;
4° Conséquences de la suppression de la condition du paiement des cotisations sociales pour l’accès aux prestations familiales concernant les travailleurs indépendants.

L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l’eau potable
La parole est à M. Antoine Karam.

Les départements et collectivités d’outre-mer accusent un retard important en termes d’infrastructures d’assainissement et d’accès à l’eau potable.
Le raccordement à un réseau d’assainissement concerne moins de la moitié de la population et les équipements relatifs aux eaux usées sont soit défectueux, soit inexistants, et souvent non conformes aux prescriptions de la directive sur les eaux résiduaires urbaines. Si l’accès à l’eau potable pour tous a bénéficié d’importants efforts, l’équilibre entre territoires n’est pas encore atteint. Dans un territoire comme la Guyane par exemple, 15 % de la population n’a pas l’accès à l’eau potable.
Cet amendement vise donc à intégrer cette problématique dans l'un des rapports que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur l’accès à l’énergie, afin de faire le point sur la situation et d’étudier les moyens nécessaires pour garantir l’accès à l’eau potable aux populations d’outre-mer.

Je l’ai précisé au cours de la discussion générale, les demandes de remise de rapports au Parlement sont contraires à la position de la commission des lois. C’est la raison pour laquelle celle-ci émet un avis défavorable sur cet amendement.
J’ai pu constater lors de mes déplacements, notamment en Guadeloupe, en Guyane, mais aussi très récemment à Mayotte, à quel point les enjeux dans le domaine de l’eau pénalisaient les concitoyens au quotidien.
L’accès à cette ressource est un droit de base et ne devrait plus être aujourd’hui une question difficile à régler sur l’ensemble du territoire. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, sur les territoires, l’État n’exerce pas cette compétence, qui est dévolue aux collectivités. Pour autant, il ne peut pas se contenter de regarder sans rien faire !
C’est la raison pour laquelle il a décidé d’élaborer un plan eau en partenariat avec les collectivités, l’agence régionale de santé, l’Agence française de développement, la Caisse des dépôts et consignations, l’ONEMA, les offices de l’eau et les comités de bassin.
Ce plan vise à renforcer durablement les capacités techniques et financières des collectivités, puisque c’est la question essentielle qui se pose aujourd’hui. Il doit donner lieu à l’élaboration, par la conférence régionale des acteurs de l’eau, de documents stratégiques dans chacun des territoires ultramarins, assortis d’indicateurs et d’objectifs précis d’amélioration du service public d’eau potable et d’assainissement. Ce plan fait suite à une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Inspection générale de l’administration et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ayant abouti à la remise du rapport au mois de juin 2015.
Je ne ferme pas la porte à l’idée d’un rapport. Nous devons avancer. Nous menons déjà un travail avec les collectivités qu’il faut peut-être nourrir par des réflexions encore plus poussées sur le sujet. C’est la raison pour laquelle, sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Je comprends la position de la commission. En effet, on ne peut pas demander au Gouvernement un trop grand nombre de rapports, même si les parlementaires ont pour mission de contrôler son action. Cependant, il est plus facile d’analyser une situation sur la base d’un document écrit que sur de simples propos, nécessairement plus flous.
Sur la question spécifique de l’accès à l’eau, il me paraît invraisemblable de refuser de demander un rapport. Mme la ministre vient de l’indiquer, des efforts ont été consentis. Le rapport permettrait aussi de les souligner, d’en dresser un bilan, de s’appuyer sur ce qui a été fait pour aller plus loin. Je rappelle que cette problématique concerne des territoires de la France !
J’insiste donc pour que cet amendement soit adopté. Personnellement, je le voterai.

Cet amendement vise à compléter l’article 3 quinquies relatif à la remise d’un rapport thématique par le Gouvernement. Pour mémoire, cet article fait partie des cinq articles nouveaux adoptés par l’Assemblée nationale à la suite de la présentation successive de cinq amendements du Gouvernement visant à regrouper en cinq grandes catégories l’ensemble des rapports prévus par les 42 articles du présent texte.
Selon le Gouvernement, ce choix permet de mieux organiser et de donner un sens à ceux-ci.
Après le passage du projet de loi devant la commission des lois du Sénat, il ne reste que deux articles renvoyant à l’élaboration de rapports : l’article 3 quinquies et l’article 3 sexies.
L’article 3 quinquies concerne l’accès à l’énergie, l’accès au commerce électronique, l’attractivité fiscale, les conséquences de la suppression de la condition du paiement des cotisations sociales pour l’accès aux prestations familiales concernant les travailleurs indépendants.
Sur la thématique de l’accès à l’énergie, l’amendement n° 136 rectifié bis d’Antoine Karam vise à intégrer la problématique de l’accès à l’eau potable dont il dénonce le caractère inégalitaire dans les outre-mer. À cet égard, je vous rappelle, mes chers collègues, qu’une pénurie d’eau frappe depuis plus d’un mois mon département, Mayotte, à telle enseigne que l’eau est rationnée et que des villages entiers sont parfois privés d’eau potable pendant plus de vingt-quatre heures. Il s’agit donc d’une question d’actualité majeure.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous engage à voter en faveur de cet amendement, car il est utile. Nous ne pouvons pas laisser nos territoires faire face seuls à un enjeu aussi essentiel.

Au moment où je vous parle, il fait moins deux degrés à Paris, mais c’est la saison des pluies en Guyane. « Quel bonheur, vous avez de l’eau ! », me direz-vous, sauf que 15 % de la population n’a pas accès à l’eau potable. Imaginez que 15 % des 66 millions d’habitants de la France hexagonale n’aient pas accès à l’eau potable ! Faites le calcul, il y aurait des émeutes…
Voilà quelques mois, Aline Archimbaud a arpenté la Guyane pour étudier le problème des suicides chez les Amérindiens. Savez-vous que dans ces territoires les enfants boivent de l’eau polluée au mercure, ce poison déversé dans nos fleuves par les orpailleurs clandestins, les garimpeiros, qui sont toujours bien présents, malgré tous les efforts de l’État ? Il serait incompréhensible de ne pas adopter un point de vue ne serait-ce qu’humanitaire sur la question de l’eau à la faveur d’un rapport.
Pour ma part, j’exhorte mes collègues de France hexagonale à faire un geste fort à l’égard d’un territoire qui est reconnu de par le monde pour le lancement de fusées dans le cadre d’Arianespace, y compris Soyouz et Vega, pour un chiffre d’affaires de 5, 2 milliards d'euros. Néanmoins, ce territoire abrite de fortes disparités. Telle est la réalité de la Guyane ! Nous aurons l’occasion de vous montrer, tout au long de ce débat, que nous sommes encore bien loin de l’égalité réelle.

Je reconnais bien volontiers, sur le principe, monsieur le rapporteur, l’existence d’un trop grand nombre de rapports. Cela étant, l’accès à l’eau potable est un problème dans tous les outre-mer.
J’ai présidé un syndicat intercommunal produisant et distribuant de l’eau potable dans la moitié de l’île de la Martinique. L’eau n’est arrivée que vers les années cinquante dans nos communes ; il a fallu aller vite. Les conduites en fonte sont déjà vétustes, dans des terrains soumis à une très forte sismicité. Aujourd'hui, sans même parler de la Guadeloupe, le taux de rendement du réseau d’eau est de 50 %. Autrement dit, lorsque 100 litres partent dans le réseau, seuls 50 litres arrivent à destination, et il n’y a pas d’eau au robinet !
L’eau est donc un problème général outre-mer, en particulier en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Il faudra consacrer des sommes énormes à la mise en conformité du réseau d’eau. Pour cela, il sera nécessaire de rassembler des connaissances et donc de produire un rapport.
Je comprends parfaitement l’attitude concernant les rapports d’une manière générale, mais, en l’espèce, soyons plus intelligents. Il se pose un important problème concernant la santé publique, l’égalité d’accès à une denrée indispensable à la vie. L’eau, c’est la vie ! Or l’eau nous arrive polluée au robinet par capillarité parce que la conduite est pourrie, si bien qu’elle n’est pas translucide et pas consommable.
Par conséquent, il faut savoir parfois assouplir ses positions et entendre la raison qui monte des territoires.

Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, en particulier par M. Serge Larcher, mais je veux rappeler qu’un mouvement social concernant l’accès à l’eau potable dure depuis près de six mois en Guadeloupe. Mme la ministre a pu s’en rendre compte lors de son passage sur l’île.
La décision de rendre un rapport sur l’accès à l’eau potable serait tout de même un signe fort de la prise en compte de cette problématique par le Gouvernement, signe qui me paraît nécessaire et qui ne relève pas d’une posture politique.

J’ai écouté avec une grande attention les arguments qui viennent d’être développés.
Je ne reviendrai pas sur la question des rapports, dont tout le monde conviendra qu’ils sont en nombre excessif dans le présent texte, même si l’on peut comprendre leur motivation de mise en exergue de certains sujets.
Il ressort des différentes interventions qu’il s’agit d’un sujet prioritaire. Vous saurez donc, mes chers collègues, sur d’autres thèmes, relativiser l’importance et l’impact d’un rapport… §C’est ce que nous pouvons collectivement constater.
Dans ces conditions, monsieur le président, la commission émet un avis de « sagesse favorable » sur cet amendement, mais soyez certain que je saurai rappeler à celles et ceux qui viennent de s’exprimer ce qu’ils ont dit s’agissant des rapports.

Les sujets abordés sont certes éminemment importants, mais j’ai du mal à comprendre ce qu’ils viennent faire dans la loi.
S’il est nécessaire de disposer d’éléments d’information sous forme de rapport, le ministère des outre-mer peut très bien diligenter des études. La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer peut également se saisir de ces sujets pour fournir des éléments permettant d’apprécier réellement la situation. Prévoir dans la loi la remise de rapports dans un délai d’un an rend rapidement obsolètes certaines parties de celle-ci.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 229, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.

Il s’agit d’un amendement de coordination avec la suppression de l’article 9 bis.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 139 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano, Antiste et J. Gillot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Accès au logement, habitat sans titre et occupation illicite du domaine public en outre-mer.
La parole est à M. Antoine Karam.

Cet amendement vise à traiter dans un rapport la question de l’égalité d’accès au logement. En effet, faute de logements disponibles, de nombreux citoyens d’outre-mer sont contraints de se tourner vers l’habitat spontané en occupant illégalement le domaine public.
Or, si la problématique de l’occupation illicite, souvent synonyme d’insalubrité, du domaine public fait l’objet d’une réponse concertée en Guadeloupe et en Martinique au travers des agences dites « des cinquante pas géométriques », les autres collectivités ultramarines restent démunies face au phénomène grandissant de l’habitat spontané et sans titre. C’est particulièrement vrai en Guyane où des milliers de personnes vivent désormais dans d’immenses zones d’habitat spontané, véritables bidonvilles formés en périphérie des zones urbaines.
Cet amendement a donc pour objet d’établir un état des lieux exhaustif de la situation sur l’ensemble des outre-mer, afin que soient préconisées des solutions adaptées aux réalités de chaque territoire.

La commission émet un avis défavorable, en partie pour les raisons que j’ai évoquées à propos de l’amendement précédent.
Je vous rappelle, mon cher collègue, que la CNEPEOM établit tous les deux ans un rapport public d’évaluation de l’impact socio-économique de l’application des titres II et IV de la présente loi. Un volet spécifique porte en outre sur la mise en œuvre des dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.
Également défavorable.
Monsieur le sénateur, de nombreux travaux ont été conduits sur ce sujet, en particulier par le député Serge Letchimy, à l’origine de la loi relative aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. Cette question est en outre parfois documentée dans le cadre des diagnostics réalisés pour l’élaboration des documents d’aménagement dans les schémas régionaux d’aménagement ou les plans locaux d’urbanisme.

Au moment où je vous parle, en Guyane, 15 000 à 20 000 demandeurs d’asile font la queue tous les matins pour obtenir quelques bons de nourriture auprès de la Croix-Rouge. Ces personnes, qui ne disposent pas de logement, s’installent partout. Ainsi naît de l’habitat spontané insalubre dans la périphérie des grandes villes, notamment à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Tous les rapports montrent que des gens vivent pratiquement sans eau, sans électricité et sans toit dans nos territoires.
Nous sommes heureux, si je puis dire, que l’examen de ce projet de loi relatif à l’égalité réelle outre-mer, en nous permettant d’exposer nos malheurs, soit l’occasion d’expliquer la situation à nos collègues de France hexagonale. Regardez ce qui se passe vraiment chez nous ! Le logement est à cet égard un exemple frappant. Nous sommes peut-être loin, mais c’est nous qui donnons à la France et à l’Europe une dimension mondiale.

La question de l’habitat insalubre renvoie directement, au moins pour deux départements d’outre-mer, la Guyane et Mayotte, à celle de l’immigration illégale. Les bangas, comme on appelle les bidonvilles à Mayotte, poussent comme des champignons, sur un territoire de 374 kilomètres carrés…
En 2012, on évaluait la population en situation irrégulière à 40 % de l’ensemble de la population. Aujourd'hui, d’après les évaluations reposant sur des recoupements portant notamment sur la consommation de riz et d’autres denrées, 50 % au moins de la population est en situation irrégulière et loge dans ces habitats insalubres, indignes.
J’entends les arguments de M. le rapporteur et du Gouvernement. Mon intervention ne vise pas forcément à aller dans le sens de cet amendement. Cependant, nous avons soulevé ces questions de très nombreuses fois devant la représentation nationale et il serait temps que celles-ci soient traitées à la hauteur des enjeux, parce qu’aucune politique de développement n’est possible dans ces territoires, en tout cas à Mayotte, tant qu’elles ne sont pas réglées.
Je profite donc de l’occasion pour marteler une nouvelle fois le constat : cette situation empêche le développement de l’île de Mayotte.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 quinquies est adopté.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’Hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines des transports et des déplacements.

Je profite de l’examen de cet article, mais j’aurais aussi pu intervenir sur l’article 12 quinquies s’il n’avait pas été supprimé par nos rapporteurs, pour parler de la nécessité d’améliorer le désenclavement de Wallis-et-Futuna, notamment en ce qui concerne la desserte aérienne du territoire.
Nous subissons le diktat monopolistique d’Air Calédonie international qui applique, pour les trois vols hebdomadaires qui desservent notre territoire, des tarifs prohibitifs, impose des horaires insupportables, destinés notamment à nous empêcher de prendre une correspondance à Fidji pour rejoindre la métropole via Hong-Kong ou Singapour, et à nous obliger à passer par la Nouvelle-Calédonie.
Une procédure d’appel d’offres a été lancée grâce aux plus hautes autorités de l’État que je remercie. Elle devrait permettre de mieux répondre aux attentes de nos populations. Fidji Airways s’y intéresse et accepterait une double desserte de Futuna et de Wallis, permettant aussi le développement du tourisme que nous souhaitons.
Hélas, une fois encore, nous pressentons que la préservation des intérêts de la compagnie calédonienne risque de passer avant l’intérêt de Wallis-et-Futuna et de ses populations, et de faire échec à ce qui a été engagé. Des freins nombreux apparaissent et nous inquiètent.
Madame la ministre, l’égalité réelle, ce n’est pas seulement l’égalité entre les outre-mer et la métropole, c’est aussi entre les différentes collectivités d’outre-mer.
Nous souhaiterions que le rapport visé à l’article 3 sexies prévoie de fournir des éléments sur la desserte aérienne de Wallis-et-Futuna, sur les prix et les horaires pratiqués, car actuellement, pour ce qui nous concerne, la continuité territoriale n’est pas assurée de manière satisfaisante.
L'article 3 sexies est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)

L'amendement n° 140 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan, Cornano, Antiste et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de ratifier la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail.
La parole est à M. Antoine Karam.

Chers collègues, régulièrement, à l’occasion de l’examen de différents textes, je fais tout mon possible pour sensibiliser la Haute Assemblée à la situation des populations autochtones de France.
Vous le savez, ces populations font face à de grandes difficultés. Voilà quelques mois seulement, Aline Archimbaud, cela a été dit, remettait avec une collègue de l’Assemblée nationale un rapport parlementaire sur les suicides des jeunes Amérindiens de Guyane. Il faut le rappeler, le taux de suicide y est dix à vingt fois plus élevé que celui qui est relevé dans la France hexagonale.
La reconnaissance de l’existence et de la richesse des cultures autochtones d’outre-mer est, de mon point de vue, un préalable à la reconnaissance de leur identité et à la restauration de l’estime de soi de ces populations.
La question de la ratification par la France de la convention 169 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT, relative aux peuples indigènes et tribaux est régulièrement posée par les associations et organisations représentatives.
Au-delà des freins constitutionnels évoqués dès lors que l’on aborde ce sujet, le présent texte n’est-il pas l’occasion de montrer aux populations autochtones de France que la République est à leur écoute, qu’elle est prête à étudier l’opportunité de ratifier la convention précitée ?
Alors, oui, je propose un nouveau rapport, mais celui-ci est hautement symbolique : il doit permettre de répondre clairement à une attente exprimée de longue date par nos compatriotes des peuples autochtones.

Défavorable, monsieur le président, toujours pour les mêmes raisons déjà évoquées s’agissant des rapports.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Cela étant, je veux revenir brièvement sur le logement, car le sujet est essentiel.
Au-delà de l’objectif de 150 000 logements prévu par la loi, je veux rappeler les démarches engagées en particulier avec la Guyane. Le pacte d’avenir pour la Guyane est conçu selon une démarche structurante globale ; il comprend des investissements structurants, une aide aux collectivités locales, une garantie d’emprunt, ainsi qu’une aide en matière d’éducation, mais aussi un accompagnement, afin de répondre de façon plus satisfaisante aux demandes de logement.
Il me paraît important de souligner, outre les dispositions législatives, les démarches que le Gouvernement engage avec les territoires. Ce sont des démarches innovantes, structurantes, importantes pour nos concitoyens de ces territoires qui en ont largement besoin sur de nombreux sujets.

Cet amendement vise à faire en sorte que la France reconnaisse la convention 169 de l’OIT qui a déjà été ratifiée par une vingtaine de pays. Il s’agit tout simplement d’une question de respect de populations qui se sentent extrêmement méprisées. L’exemple des populations amérindiennes a notamment été cité. C’est une façon de reconnaître leur identité et de leur permettre de restaurer l’estime d’elles-mêmes. La France reconnaîtrait ainsi que la diversité de cultures est une richesse pour elle. Je vous assure, mes chers collègues, que le fait de ne pas ratifier cette convention constitue une blessure pour de très nombreuses associations et populations.
Il s’agit non pas de questions financières, mais de respect de ces populations qui sont dans la République. La République vit dans la diversité, mais elle est unique ; c’est cette articulation qu’il faut trouver.
J’espère, mes chers collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, que vous serez sensibles à cette question. Je vous assure que nous pourrions avancer à partir de là !
L'amendement n'est pas adopté.

TITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE
Chapitre Ier
Instruments de mise en œuvre de la convergence
I. – §(Non modifié) L’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :
1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;
2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;
2° bis Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;
3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;
4° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre opérationnelle, précisant l’ensemble des actions en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ;
4° bis (Supprimé)
5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;
6°
Supprimé
7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;
8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.
III. – §(Non modifié) Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État, d’une part, et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.
IV. – §(Non modifié) Le plan de convergence fait l’objet d’une présentation et d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État.
IV bis. – §(Non modifié) Le plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d’une délibération spécifique.
V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard, le 1er juillet 2018.
VI. – §(Non modifié) Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.

L'amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano, Antiste et J. Gillot, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
économique,
insérer le mot :
sanitaire,
La parole est à M. Antoine Karam.

Cet amendement rédactionnel vise à intégrer un volet sanitaire au diagnostic prévu par le présent article.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Après les mots :
de développement économique
insérer les mots :
et d’implantation des entreprises
La parole est à M. Guillaume Arnell.

Cela a été rappelé, l’article 4 crée un instrument nouveau – les plans de convergence –, qui devrait permettre de soutenir le développement économique des collectivités d’outre-mer suivant une planification de long terme.
Cet amendement de précision vise à mentionner dans le corps de l’article 4 définissant ces nouveaux plans de convergence la nécessité de créer un environnement favorable à l’implantation d’entreprises qui est un facteur clé du développement économique d’un territoire.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi.

L'amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la demande de leur assemblée délibérante, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent avec l’État, pour chacun de ces territoires, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement avec la France hexagonale. Ce plan tient compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque territoire et définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :
1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;
2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;
3° Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;
4° Une stratégie de convergence de long terme en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque territoire. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;
5° Un volet regroupant l’ensemble des actions opérationnelles en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;
6° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre ;
7° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 74 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;
8° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;
9° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;
10° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.
III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État, d’une part, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.
IV. – Le plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d’une délibération spécifique.
V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces dans un délai de douze mois à compter de la demande mentionnée au I.
VI. – Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.
VII. – En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.
La parole est à M. Guillaume Arnell.

Il est frappant de constater combien les dispositions régissant les plans de convergence diffèrent selon qu’elles concernent les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou les collectivités régies par l’article 74.
Pour les premières, l’article 4 comporte pas moins de dix-sept alinéas définissant de manière impérative le contenu du plan de convergence, ainsi que son délai et sa procédure d’adoption.
Pour les secondes, l’article 5 comporte un alinéa et mentionne spécifiquement la Nouvelle-Calédonie : à titre d’exemple, pour Saint-Martin, l’État et la collectivité élaboreraient un plan de convergence en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité et inspiré du plan prévu pour les collectivités relevant de l’article 73. Il n’est envisagé ni contenu impératif ni délai.
C’est un peu comme si l’égalité réelle était à géométrie variable : impérative et contrainte pour les collectivités relevant de l’article 73, optionnelle pour celles qui relèvent de l’article 74.
Il est donc proposé de remédier à cette anomalie en prévoyant un cadre juridique clair pour les plans de convergence intéressant les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces.
En outre, la situation économique des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution étant très différente selon les territoires, l’élaboration des plans de convergence paraît devoir être, à notre sens, subordonnée à une demande des assemblées délibérantes concernées.

Sous couvert de tenir compte du statut spécifique des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, cet amendement tend à imposer à ces collectivités l’élaboration de plans de convergence. Une telle mesure devrait relever de la loi organique. C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.
Par le biais de cet amendement est mise en exergue la différence entre les collectivités selon que celles-ci sont régies par l’article 74 ou par l’article 73 de la Constitution. Cet amendement tend à ajouter des précisions qui ne me paraissent ni nécessaires ni même utiles.
En effet, s’il était adopté, l’initiative du plan de convergence ne serait plus conjointe entre l’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les EPCI, mais relèverait de la seule assemblée délibérante. Ce n’est pas l’esprit du texte que nous avons défendu jusqu’à présent. Nous préférons laisser aux exécutifs, qui disposent des moyens de pilotage adéquats, l’initiative d’un tel plan.
Par ailleurs, dans cet amendement sont évoquées les questions de la continuité territoriale, du prix des services bancaires et des missions de la BPI. Or ces aspects n’ont pas, me semble-t-il, vocation à être traités dans cet article du projet de loi relatif à la méthode d’élaboration des plans de convergence.
Enfin, et surtout, cet amendement méconnaît notre souhait de fixer un cadre suffisamment souple et adaptatif aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, pour tenir compte de leur statut spécifique.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Je n’ai aucune raison de douter de la véracité des propos de Mme la ministre ou de M. le rapporteur. Mais, par expérience, lorsque les textes sont imprécis, ils sont souvent interprétés en notre défaveur par la suite, quel que soit le Gouvernement en place.
C’est pourquoi nous voulions, à travers cet amendement, préciser la rédaction de l’article 5.
Toutefois, si tel est vraiment l’esprit du texte, madame la ministre, je retire mon amendement.

L’amendement n° 158 rectifié est retiré.
L'amendement n° 192, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés proposent à l’État de conclure le plan cité au premier alinéa, ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Je précise que ces observations vaudront défense de l’amendement n° 193, déposé à l’article 5 bis.
Il s’agit de reprendre une proposition émise par le Gouvernement dans deux amendements déposés au stade de l’examen du texte en commission, mais qui n’ont pas été retenus.
Le Gouvernement a indiqué qu’il proposera dans les meilleurs délais à toutes les collectivités ultramarines régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, la conclusion de plans de convergence et de contrats de convergence, les seconds constituant la déclinaison opérationnelle des premiers.
Les collectivités concernées bénéficient toutefois d’une autonomie garantie par leur statut, de valeur organique. Aussi, lorsqu’elles feront le choix de proposer de tels plans ou de tels contrats, il convient d’en assurer la concrétisation rapide. À défaut, la nature collaborative d’élaboration de ces plans et de ces contrats ne serait qu’une mesure d’affichage.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que, si l’initiative de conclure un plan de convergence provient des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, l’État devra formuler une réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Précisons que le présent amendement ne doit pas être analysé comme une mesure d’injonction à l’encontre du Gouvernement, dès lors que celui-ci en a fait lui-même la proposition devant la représentation nationale.

Je vous remercie, mon cher collègue, de vous opposer aux mesures d’affichage.
Cela dit, cet amendement tend à imposer un délai de réponse à l’État pour répondre à la sollicitation d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution. Il vise ainsi à ébaucher une procédure d’élaboration des plans de convergence sans prévoir pour autant ce qui se passe en l’absence de réponse de l’État. En outre, son adoption créerait une asymétrie entre l’État et les collectivités visées en imposant des délais à l’une des parties, l’État, sans prévoir l’équivalent pour les autres parties.
En conséquence, la commission des lois émet un avis défavorable.
Favorable, monsieur le président.
Dès lors que des collectivités sollicitent le Gouvernement pour élaborer un plan de convergence, il est de bonne administration que l’État puisse répondre dans le délai raisonnable de trois mois.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.
Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence.

Madame la ministre, vous avez déclaré que les plans de convergence, déclinés en contrats, devaient être « cohérents avec l’ensemble des outils contractualisés mobilisant des moyens financiers ». Vous évoquiez les programmes opérationnels européens ou les contrats de plan État-régions, les CPER.
Vous disiez aussi vouloir « concentrer les moyens contractualisés autour d’un axe stratégique unique pour obtenir les meilleurs résultats, régulièrement évalués sur la base d’indicateurs figurant dans la loi et arrêtés par les acteurs territoriaux et l’État ».
L’objectif est à la fois logique et louable. Néanmoins, nous nous trouvons confrontés à des obstacles que nous ne pourrons facilement franchir.
Selon le rapport de la commission des lois, « pour la dernière génération des CPER, conclus pour la période 2015-2020, l’État a axé ses financements sur la réduction des écarts en matière d’infrastructures et de services collectifs de base. »
En clair, cela signifie que les plans de convergence que signeront les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution devront obligatoirement porter sur les infrastructures et les services collectifs de base. Certes, cela correspond à des besoins, mais peut-être pas à des priorités fixées par les élus locaux.
Par ailleurs, ces contrats de plan État-régions courent jusqu’en 2020 ; autrement dit, il faudra attendre cette date pour que les plans de convergence coïncident avec les contrats de plan État-régions. Autant d'années perdues…
Et, puisque l’on parle de cohérence en matière de financement, permettez-moi de souligner une aberration. L’Agence française de développement, l’AFD, finance en effet deux extensions de ports dans l’océan Indien, chacun ayant vocation à devenir un hub maritime, d’une part, Port Réunion, d’autre part, le port de Maurice, et pour des montants assez similaires de 44 millions d’euros pour chaque projet.
Je ne veux pas dire que l’AFD joue sur les deux tableaux, mais, lorsque l’on parle d’utilisation judicieuse des fonds publics et de mesures d’austérité, il me semble qu’il y a là des incohérences ou des défauts de coordination qui coûtent cher et qu’il faudrait rectifier.
Il serait donc souhaitable que les collectivités d’outre-mer soient informées de l’ensemble des projets de développement financés par l’État français ou ses organismes, dans leur environnement géographique proche.

L’amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 sont déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.
Les contrats de convergence sont élaborés et signés par l’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre l’État et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence.
La parole est à M. Guillaume Arnell.

Je suppose, madame la ministre, que la même logique s’appliquera aux contrats de convergence qu’aux plans de convergence… Je retire donc cet amendement.

L’amendement n° 159 rectifié est retiré.
L’amendement n° 193, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés proposent à l’État de conclure des contrats de convergence, ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
L'amendement n'est pas adopté.
L’article 5 bis est adopté.
Je veux répondre brièvement à Mme Hoarau sur la cohérence des plans de convergence avec les contrats de plan et les programmes opérationnels européens, les POE, en cours. Rappelons que ces derniers peuvent faire l’objet d’un bilan à mi-parcours, en 2017 ou 2018. Ce sera précisément l’occasion de mettre en concordance les POE et PER, au besoin en les réorientant, avec les plans de convergence, déclinés en contrats de convergence.
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 1111-9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de convergence » ;
2° Au IV de l’article L. 1111-10, après les mots : « État-région », sont insérés les mots : « ou dans les contrats de convergence ». –
Adopté.
I. – Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 2563-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 2563 -7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;
2° L’article L. 2564-19 devient l’article L. 2564-19-1 ;
3° L’article L. 2564-19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2564 -19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;
4° L’article L. 2573-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »
II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;
2° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 3443-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 3443 -3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département. »
III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4434-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4434 -10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région. »
IV. – Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 5823 -1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° L’article L. 5842-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 71-111-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 72-101-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. »
VI. – L’article L. 212-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » –
Adopté.

L'amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.O. 6361-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 6362-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362 -2 -… – Si un plan de convergence a été signé avec l’État, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L.O. 6361-2 présente un état d’avancement des mesures prévues par ce plan. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.

Cet amendement vise à inclure un rapport sur l’état d’avancement des mesures prévues par l’éventuel plan de convergence adopté dans le rapport sur les orientations budgétaires présenté au conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.
Je comprends les réticences, mais il me semble nécessaire d’effectuer des bilans d’étape pour connaître l’état d’avancement des mesures.

Les dispositions de cet amendement sont contraires à la répartition des compétences entre le législateur organique et le législateur ordinaire, dans la mesure où le statut de Saint-Martin relève de la loi organique.
Bien que j’y sois favorable au fond, cet amendement ne peut être accepté par la commission des lois qui émet en conséquence un avis défavorable.
Nous comprenons votre démarche, monsieur le sénateur, mais l’avis du Gouvernement est également défavorable, pour les mêmes raisons.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. » ;
2° (Supprimé)
I bis. –
Supprimé
(Non modifié) Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées. –
Adopté.
II. – §
TITRE III
DISPOSITIONS SOCIALES
Le II de l’article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la cotisation d’allocations familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales qu’ils ont versées au titre de ces mêmes années. » –
Adopté.
(Supprimé)

L'amendement n° 99, présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : «, à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;
2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;
3° Après le 4° du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher.

Les départements d’outre-mer disposent de plusieurs mécanismes de décote sur les cessions de foncier public en faveur du logement.
S’agissant de la décote prévue par la loi relative à la mobilisation du foncier dite « décote Duflot », elle est applicable aux logements en accession sociale réalisés en PSLA – prêt social location-accession –, mais pas aux logements réalisés en LES – logement évolutif social.
Le LES est un outil essentiel de la politique du logement social outre-mer. Il permet en effet à des ménages ayant de faibles revenus d’accéder à la propriété, avec une aide de l’État.
Or ce dispositif ne peut pas actuellement bénéficier des dispositions relatives à la mobilisation du foncier public qui permettent à l’État de mettre en vente, avec une décote de prix, les terrains nus ou bâtis de son domaine privé ou de celui de certains établissements publics pour construire des logements, prioritairement sociaux.
Cet amendement vise donc à étendre la décote prévue à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques aux logements en accession sociale financés en LES.

Comme vous l’avez fort bien exposé, mon cher collègue, cet amendement vise à réserver un traitement particulier aux cessions réalisées dans les départements d’outre-mer pour favoriser le logement en accession sociale. Nous sommes tous conscients que cette mesure répond à un réel besoin. En conséquence, la commission des affaires économiques émet un avis favorable.
Avis très favorable ! Il serait en effet très pertinent d’appliquer la décote Duflot aux logements évolutifs sociaux, une mesure qui favoriserait l’accès à la propriété des personnes les plus modestes et contribuerait à construire le parcours résidentiel. Ce serait un vrai pas en faveur de l’égalité réelle.

Je précise simplement que cet amendement est le fruit du travail réalisé sur le foncier par la délégation sénatoriale à l’outre-mer.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 A.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-trois heures, est reprise à vingt-trois heures quinze.
Le II de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » –
Adopté.
(Supprimé)

L'amendement n° 194 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Patient, Cornano, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 114-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette analyse intègre des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer relevant de la compétence du conseil. » ;
2° Le 2° du II de l’article L. 114-4 est complété par les mots : «, et en y intégrant des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer relevant de la compétence du conseil ».
La parole est à Mme Karine Claireaux.

Cet amendement a pour objet de mieux évaluer les effets du renforcement du système de retraites à Mayotte, dont il est question dans ce texte, et, plus largement, de mieux évaluer les phénomènes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’incidence d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants, qui pourraient pénaliser les retraites des femmes dans les différentes collectivités territoriales d’outre-mer.
Il tend, à cette fin, à ce que le Conseil d’orientation des retraites prenne en compte la situation des outre-mer dans ses travaux.

Il est défavorable, car votre demande est satisfaite, ma chère collègue. En effet, le Conseil d’orientation des retraites et le comité de suivi des retraites prennent déjà en compte dans leurs travaux les données relatives aux outre-mer.
Nous sommes bien évidemment sensibles à cette question, madame la sénatrice, mais il nous semble que le Conseil d’orientation des retraites et le comité de suivi des retraites intègrent déjà dans leur analyse sur la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse des données spécifiques aux collectivités d’outre-mer.
Les précisions que vise à apporter votre amendement conduiraient à restreindre les données sur les outre-mer au regard de l’assurance vieillesse. En effet, les dispositions concernées ne visent que l’analyse des inégalités entre les hommes et les femmes au regard de l’assurance vieillesse.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L’amendement n° 194 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 9 B demeure supprimé.
(Supprimé)
L’ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l’assurance est ratifiée. –
Adopté.
(Supprimé)

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 64, présenté par Mmes Hoarau et David, MM. Watrin, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Représentativité
« Section 1
« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle
« Art. L. 2624 -1. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;
« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article.
« Section 2
« Représentativité patronale
« Art. L. 2624 -2. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.
« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.
« Art. L. 2624 -3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune de celles-ci, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
« Art. L. 2624 -4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1 et, d’autre part, selon le cas, des articles L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet de la procédure d’extension et d’élargissement prévue à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la présente partie, à la demande d’un des partenaires sociaux définis au présent article. »
II. – Il n’est pas tenu compte du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail pour déterminer la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales mentionnées au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Gélita Hoarau.

L’article 9 D a été supprimé par la commission des affaires sociales. La rapporteur pour avis a relevé « qu’aucune concertation préalable n’a été organisée sur ces dispositions qui remettent pourtant en cause l’équilibre des règles relatives à la représentativité des partenaires sociaux, et que la loi Travail permet déjà de remplir l’objectif poursuivi par le texte ». Dont acte !
Elle a rappelé, en outre, que les dispositions de cet article modifient en profondeur les règles de représentativité des partenaires sociaux élaborées depuis 2008.
Elle a précisé, enfin, que les conventions et accords collectifs de travail, dont le champ d’application est national, « s’appliqueront de plein droit, à compter du 1er avril 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, à partir du 1er janvier 2018, à Mayotte, sauf stipulation contraire, dans un délai de six mois suivant leur date d’entrée en vigueur. Le principe sera désormais l’assimilation et l’application directe des accords nationaux dans les territoires ultramarins précités. »
Le mot « assimilation » est bien écrit noir sur blanc. Avancer cet argument dans un texte de loi qui reconnaît les particularités des outre-mer est tout de même surprenant.
Or, parmi ces particularités, la composition du tissu économique est primordiale : les outre-mer ont un nombre considérable d’entreprises. Très souvent, celles-ci ne sont couvertes par aucune convention de branche, la branche n’étant pas constituée dans chaque entité d’outre-mer. Dans les faits, ces entreprises ne sont donc couvertes ni par une convention nationale ni par une convention locale.
Ainsi, l’article 9 D offre la possibilité aux organisations syndicales et patronales de faire avancer ce que l’on appelle généralement le dialogue social. La représentativité de chacune des deux composantes étant clairement définie, rien ne les empêche, dès lors, de signer des accords de branche.
J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le strict encadrement qui est prévu. Ces accords de branche ne peuvent être signés que s’ils obéissent à une double condition : d’une part, les secteurs d’activité intéressés ne doivent pas être déjà constitués en branche et, d’autre part, aucun accord national ne doit s’appliquer localement.
Il y va de la reconnaissance des spécificités du tissu économique ultramarin comme de la pérennité du dialogue social. C’est pour cela que je vous demande de voter en faveur de cet amendement.

L’amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Représentativité
« Section 1
« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle
« Art. L. 2624 -1. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;
« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article ;
« Section 2
« Représentativité patronale
« Art. L. 2624 -2. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.
« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.
« Art. L. 2624 -3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
« Art. L. 2624 -4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1, et d’autre part, selon le cas, de l’article L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier un accord de branche ou interbranches dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet d’une procédure d’extension ou d’élargissement. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.

Cet amendement vise à rétablir l’article 9 D, qui a été supprimé. Il faut préciser que le paysage conventionnel des collectivités ultramarines est différent de l’une à l’autre et se caractérise par un nombre important d’entreprises qui ne sont couvertes par aucune convention de branche nationale ou locale, soit parce que la convention collective nationale ne s’applique pas, soit parce que la branche n’est pas constituée outre-mer.
Le présent amendement tend à résorber cette difficulté, en permettant aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelon local de signer des accords de branche, à la double condition que le secteur d’activité intéressé ne soit pas déjà constitué en branche et qu’aucun accord national ne s’applique localement.

La commission est défavorable à ces deux amendements, qui vont dans le même sens. Naturellement, nous pouvons comprendre l’attente des travailleurs ultramarins en ce qui concerne la représentativité syndicale, mais comme l’a rappelé Mme Hoarau, la demande exprimée par les auteurs de ces amendements est satisfaite par l’article 26 de la loi Travail. Il n’y a donc pas lieu de rétablir la mesure adoptée par l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements, en raison de l’absence d’un avis favorable des partenaires sociaux nationaux sur cette question.
Aucun accord interprofessionnel régional intéressant un ou plusieurs départements d’outre-mer n’a, jusqu’à ce jour, été dénoncé pour une raison d’absence de représentativité des organisations syndicales signataires.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite s’accorder un délai de réflexion supplémentaire avant de trancher cette question.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L’amendement n° 65, présenté par Mmes Hoarau et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 9 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.
La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Vous l’aurez compris, c’est un amendement de repli, dans le cas où l’article 9 D, dont nous venons de discuter, n’aurait pas été rétabli. Il vise à réparer, autant que faire se peut, l’une des injustices dont l’outre-mer est victime. Cette injustice, qui concerne les droits des salariés ultramarins, existe depuis 1994, plus exactement depuis la loi du 25 juillet 1994, dite « loi Perben ».
Petit rappel historique : en 1994, le SMIC en vigueur outre-mer était inférieur à celui qui était appliqué en métropole ; un premier rapprochement s’est alors opéré et une deuxième phase a été mise en œuvre en 1995. L’alignement complet du SMIC des départements d’outre-mer sur le SMIC métropolitain ne sera effectif qu’au 1er janvier 1996, soit – il faut le dire – cinquante ans après la loi de 1946, qui prévoyait l’égalité entre citoyens des outre-mer et de la France hexagonale !
Selon l’article 16 de la loi Perben, « les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les départements d’outre-mer. » Depuis cette date, les outre-mer sont donc exclus du champ d’application, sauf spécification.
Cet article a été inséré dans le code du travail à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-1, qui dispose que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
La non-application de ces conventions collectives nationales dans les outre-mer a des conséquences sur les conditions d’emploi, l’accès à la formation professionnelle ou les garanties sociales, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux des branches professionnelles.
En clair, les outre-mer sont discriminés et le maintien de l’alinéa 3 de l’article L. 2222-1 du code précité constitue une réelle atteinte à l’égalité de traitement des travailleurs ultramarins par rapport à leurs homologues de France métropolitaine.

Comme pour les amendements précédents, celui-ci est largement satisfait par l’article 26 de la loi Travail. Avant cette loi, les conventions et accords nationaux devaient préciser explicitement qu’ils s’appliquaient aussi aux outre-mer. À partir du 1er avril 2017, ce sera l’inverse. C’est pourquoi l’avis de la commission des affaires sociales est défavorable.
Même avis, monsieur le président. Cet amendement est satisfait par la loi Travail.
Et pourtant, elle permet de satisfaire votre amendement… Je tiens d’ailleurs à saluer ici le travail de la députée Monique Orphé, qui a permis que l’Assemblée nationale adopte une telle mesure.
L'amendement n'est pas adopté.

L’amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
La parole est à Mme la ministre.
Avant de créer un conseil de prud’hommes à Mayotte, il nous semble nécessaire de former les futurs assesseurs, ainsi que d’adapter à la situation particulière du département les dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à cette juridiction.
La création d’un conseil de prud’hommes au 1er janvier 2022 paraît une échéance raisonnable pour assurer la transition entre les deux juridictions. Cet amendement vise, en conséquence, à supprimer le tribunal du travail de Mayotte à la date du 31 décembre 2021.
Je souhaite préciser que l’ordonnance de basculement de Mayotte vers le code du travail de droit commun est en préparation. Elle fait l’objet d’une étroite concertation avec les partenaires sociaux de Mayotte et sera soumise à consultation au mois de mars prochain. Si besoin, elle précisera la date de création du conseil de prud’hommes, mais nous préférons la fixer d’ores et déjà dans la loi.

Cet amendement tend à décaler, pour la deuxième fois, la date de création du conseil de prud’hommes. Nous ne pouvons que le regretter, mais nous comprenons aussi les raisons qui viennent d’être avancées par Mme la ministre. C’est pourquoi l’avis de la commission est favorable.

À titre personnel, je ne suis pas du tout à l’aise avec cet amendement. En effet, Mayotte a récemment connu de longs mouvements sociaux, dont l’une des revendications était l’application immédiate du code du travail de droit commun. Finalement, les négociations avec les partenaires sociaux ont abouti à ce que cela soit le cas au 1er janvier 2018.
Si je comprends les motivations qui poussent le Gouvernement à fixer des exceptions à l’application du code du travail à cette date, par exemple pour la mise en place du conseil de prud’hommes, cette question précise n’a pas été débattue avec les partenaires sociaux et je crains qu’une telle entorse à un calendrier âprement – et récemment – négocié ne plaise pas dans l’île.
Il est vrai que nous ne serons certainement pas prêts pour la mise en place, dès le 1er janvier 2018, d’un conseil de prud’hommes de droit commun, mais cela n’a-t-il pas été le quotidien de la collectivité, soumise à un véritable choc institutionnel et à des changements profonds pendant plusieurs années ? Pourtant, les choses se sont faites, certes à marche forcée…
C’est pourquoi, à titre personnel et même si j’en comprends les motivations profondes, je ne voterai pas en faveur de cet amendement. Peut-être est-il encore possible, avant de prendre acte complètement de cette décision, d’en discuter avec les partenaires sociaux ? Pour la paix sociale, il me semblerait préférable de remettre les choses à l’endroit et de discuter avec eux avant d’adopter une telle mesure.
Nous travaillons étroitement avec vous, monsieur le sénateur, sur nombre de sujets, parfois très délicats ; je n’ai donc pas besoin de vous rassurer. Par exemple, sur les questions liées à la fonction publique, les trois ministères concernés ont beaucoup discuté avec les partenaires sociaux, les collectivités et les élus, ce qui nous a permis d’avancer.
Le problème de Mayotte vient peut-être, en premier lieu, de l’impréparation de la départementalisation. En 2011 et dans les années suivantes, ce basculement s’est opéré à marche forcée, comme cela vient d’être dit. Or, quand on travaille ainsi sur tous les sujets, cela devient douloureux.
Nous ne nous inscrivons pas du tout dans une démarche de recul et nous ne remettons aucunement en cause les délais de mise en œuvre qui ont été arrêtés sur les autres sujets. Cependant, la procédure de création d’un conseil de prud’hommes n’est pas prête aujourd’hui et il me semble que nous pouvons – pour une fois – faire preuve d’anticipation et nous préparer au mieux. Je préférerais que nous ne soyons pas acculés par les difficultés en cas de précipitation à mettre en place cette instance.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 D.
(Supprimé)
I. – Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-8-1. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle.
« Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
« Pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –
Adopté.
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d’une personne handicapée ou dépendante » ;
2° À l’article L. 753-6, les mots : « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficient de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 ».
(Non modifié) Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant. –
Adopté.
II. – §
I. – Le titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé ou d’un handicapé adulte » ;
2° Au début de l’article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues par ce même article L. 381-8. »
II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018. –
Adopté.
I. – §(Non modifié) Le chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotteest ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le complément familial ; »
2° Au deuxième alinéa de l’article 7, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Après le même article 7, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Complément familial
« Art. 7 -1. – Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d’entre eux ait un âge supérieur à l’âge limite prévu au premier alinéa de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu’au moins l’un d’entre eux ait un âge inférieur à l’âge limite prévu à l’article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l’article 14.
« Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.
« Art. 7 -2. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution du salaire horaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.
« Art. 7 -3. – Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;
4° La section 4 bis est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa de l’article 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
« L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, qui apprécie si l’état de l’enfant justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;
b) Il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10 -2. – Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément mentionnés à l’article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le 3° du A du XIII de l’article L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A Au début des deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : « “ » ;
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. »
III. – §(Non modifié) Le I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à anticiper, dès 2018, la mise en place dans le département de Mayotte du complément familial et du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé – AEEH – et à accélérer, dès l’an prochain également, l’alignement partiel des allocations familiales prévu sur la période 2019-2021.
Mis en œuvre par le présent projet de loi, le plan Mayotte 2025 prévoit d’accélérer le rythme d’alignement des allocations familiales pour un, deux et trois enfants, afin d’atteindre dès 2021 les montants prévus en 2026. Selon le 1° du I de l’article 9 du texte présenté en conseil des ministres le 3 août dernier, cette accélération se concentrerait entre 2019 et 2021 et serait donc amorcée seulement dans deux ans, soit à partir du 1er janvier 2019.
Nous proposons, avec cet amendement, de commencer cette accélération au 1er janvier 2018, ce qui concernerait près de 20 000 familles.
Par ailleurs, les 2° et 3° du I de l’article 9 étendent à Mayotte, toujours à partir du 1er janvier 2019, le complément familial actuellement servi dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Le présent amendement vise à anticiper cette extension au 1er janvier 2018, mesure qui va bénéficier, dès l’an prochain, à plus de 2 500 foyers modestes.
Enfin, le complément d’AEEH est étendu à Mayotte à partir du 1er janvier 2019, en vertu des dispositions du 4° du I et du II de ce même article 9. Il est proposé, là encore, d’anticiper cette extension d’une année, au 1er janvier 2018, au bénéfice de près de 300 familles.

Cet amendement, déposé après le début de la discussion générale, n’a pas pu être examiné par la commission. Il a pour objet de fixer au 1er janvier 2018 la date d’extension et de revalorisation des prestations familiales à Mayotte que l’article 9 prévoyait jusqu’alors au 1er janvier 2019. À titre personnel, je suis favorable à cette mesure.

Je tiens à saluer cet amendement et à remercier le Gouvernement de ce geste, d’autant que la discussion générale n’a pas toujours permis d’insister suffisamment sur les avancées contenues dans le projet de loi.
Alors que la situation du département de Mayotte est telle que les sénateurs qui le représentent viennent régulièrement, dans cette enceinte même, réclamer l’égalité entre nos territoires, l’accélération proposée par le biais de cet amendement est naturellement la bienvenue. Il est vrai que nous sommes encore dans la période de Noël…
Sourires sur différentes travées.
L’amendement est adopté.
L’article 9 est adopté.

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, les mots : «, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires » sont supprimés.
La parole est à M. Guillaume Arnell.

Cet amendement vise à aligner les conditions d’attribution de l’aide au logement à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur celles qui sont applicables dans l’Hexagone, compte tenu des difficultés d’accès au logement outre-mer et pour mieux solvabiliser les ménages.
Trois grandes différences existent actuellement en la matière.
Tout d’abord, le mode de calcul de l’aide au logement ne tient pas compte des enfants ou personnes à charge au-delà de six dans les différents paramètres qui évoluent selon la taille de la famille : loyers plafonds, forfaits charges, logements en accession, nombre de parts et plafonds des mensualités de prêts.
Ensuite, le montant des forfaits charges est très inférieur à celui de l’Hexagone, puisqu’il est égal au tiers de ce dernier.
Enfin, il n’existe outre-mer qu’un seul loyer plafond par taille de famille, alors qu’il dépend, en Hexagone, de la localisation du logement et qu’au moins trois zones géographiques ont été mises en place.

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement pour savoir sur quels points une harmonisation pourrait être envisagée. Il est vrai que les dispositions qui encadrent les aides au logement varient sur quelques points, mais cela n’est pas toujours en défaveur des outre-mer…
En effet, le sujet est plus complexe qu’il n’y paraît… Depuis le rapport de Victorin Lurel, nous avons beaucoup travaillé sur cette question et nous cherchons à comprendre si la situation est, ou non, plus favorable.
Premier point, il n’existe pas, outre-mer, de logements dits conventionnés. Cela tient à l’utilisation de la ligne budgétaire unique – LBU – pour la construction de logements sociaux et rend inapplicables les aides personnalisées au logement, les APL. Par conséquent, l’allocation de logement familiale et celle de logement sociale se substituent en grande partie, dans nos territoires, à ces APL.
Ainsi, compte tenu de l’absence de ces logements conventionnés, l’extension du régime applicable dans l’Hexagone aux territoires ultramarins ne permettrait pas le service des APL et n’aurait donc qu’un effet marginal sur les prestations reçues effectivement par les familles.
Deuxième point, l’effet de cette mesure serait défavorable pour la plupart des familles, selon leur composition. En effet, il existe certes, dans les départements d’outre-mer, un plafonnement à six enfants ou personnes à charge, mais l’allocation logement est versée jusqu’aux vingt-deux ans de l’enfant à charge contre vingt et un ans dans l’Hexagone. Ainsi, le taux d’effort des ménages reste favorable jusqu’à huit enfants dans les départements d’outre-mer, malgré le plafonnement dont je viens de parler.
Le troisième point concerne le forfait charges. Aujourd’hui, les modalités de calcul ne paraissent pas forcément défavorables aux outre-mer, si l’on isole la composante liée au chauffage. Bien sûr, nous pouvons avoir une discussion sur la climatisation : doit-elle être considérée, à l’instar du chauffage, comme une dépense vitale ?
Vous le constatez, le régime actuel semble le plus souvent favorable aux ménages ultramarins, compte tenu des difficultés que ceux-ci rencontrent en matière d’accès au logement. Un alignement pur et simple sur le régime hexagonal risque de réduire la solvabilisation de certains ménages et n’est donc pas souhaitable.
Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.
En revanche, un sujet mérite une attention particulière, celui des jeunes travailleurs. J’ai sollicité la ministre chargée du logement afin d’envisager un alignement des allocations versées à ces personnes lorsqu’elles sont hébergées dans des foyers. Il nous semble que, actuellement, le système leur est plutôt défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)

L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La seconde phrase de l’article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
La parole est à Mme la ministre.
Au-delà de sa symbolique, cet amendement est important. Il vise à rétablir une disposition introduite par l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, qui souhaite supprimer la condition d’acquittement préalable des cotisations dues par les employeurs et travailleurs indépendants dans les départements d’outre-mer pour pouvoir bénéficier des prestations familiales.
Telle est aujourd’hui la réalité : dans les départements d’outre-mer, il est demandé aux travailleurs indépendants, et à eux seuls, avant qu’ils puissent percevoir leurs allocations familiales, de prouver qu’ils ont payé leurs cotisations sociales.
Cette conditionnalité est stigmatisante pour les travailleurs indépendants ultramarins, puisqu’elle n’existe pas pour ceux de l’Hexagone, quand bien même il peut arriver, là aussi, que certains ne payent pas leurs cotisations…
Il me semble qu’il faut dissocier clairement les choses : d’un côté, il existe une obligation pour les travailleurs de payer, comme tout un chacun, les cotisations qui sont dues ; de l’autre, les familles ont le droit de percevoir les allocations qui leur sont destinées.
Le Gouvernement tient à cette mesure, parce qu’elle est juste et conforme à l’esprit d’égalité réelle qui inspire ce texte et parce qu’elle met fin à la stigmatisation des travailleurs indépendants de nos territoires ultramarins.
S’il était démontré que les taux de recouvrement des cotisations sociales sont plus faibles outre-mer que dans l’Hexagone, nous sommes prêts à travailler pour que la prochaine convention d’objectifs et de gestion signée avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, pour la période 2018-2021 prévoie des actions particulières en l’espèce. Mais de grâce, laissons nos travailleurs indépendants, et surtout leurs enfants, percevoir leurs allocations familiales sur ces territoires !

Madame la ministre, vous l’avez dit vous-même, le taux de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants ne dépasse pas 50 % outre-mer, alors qu’il est de l’ordre de 90 % en métropole. C’est pour cette raison que la commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur cet amendement.
Vous avez par ailleurs indiqué que les modalités du recouvrement seraient renforcées, mais sans préciser de mesure concrète. Vous avez évoqué le contrat d’objectifs et de gestion de l’ACOSS pour la période 2018-2021, mais en 2018 vous ne serez pas en mesure de signer ce nouveau contrat…

La commission serait prête à réexaminer sa position dans les années qui viennent si les mesures que vous proposez pour améliorer le taux de recouvrement s’avèrent efficaces. On pourra alors renoncer à imposer aux travailleurs indépendants ultramarins la production d’un justificatif du paiement de leurs cotisations sociales.
Je veux revenir sur deux éléments qui me semblent essentiels.
Cette subordination du versement des allocations familiales au paiement des cotisations n’est actuellement pas prévue par la loi ni par les règlements. On la crée uniquement pour les travailleurs indépendants ultramarins. Ce n’est pas légal !
Vous indiquez une moyenne de recouvrement de 50 %, mais ce chiffre rend compte de l’existence de bons payeurs et de mauvais payeurs. Donc, la mesure que vous proposez stigmatise également les bons payeurs. Surtout, elle renvoie l’image que les Ultramarins ne paient pas leurs cotisations, qu’ils aiment frauder et passer au travers des réglementations. Ce message n’est pas bon !
Premièrement, il n’existe pas de conditionnalité dans la loi et on en crée une sans base légale à l’intention des seuls travailleurs indépendants ultramarins ; deuxièmement, il faut dissocier le versement des allocations de l’obligation de payer les cotisations. Des procédures de recouvrement de droit commun existent, des administrations travaillent déjà pour récupérer les sommes dues : il faut améliorer leurs performances.
Je le répète, cette mesure est véritablement injuste et elle n’est fondée ni juridiquement ni réglementairement. Il faut donc mettre fin à l’injustice résultant de cette conditionnalité.
Vous me dites que je ne serai plus là en 2018, madame la rapporteur, mais il ne s’agit pas de ma personne : la continuité de l’État a un sens et les administrations poursuivront leur travail. Peu importe qui signera la convention, c’est le travail réalisé qui compte.
Si vous étiez sensible à nos arguments, madame la rapporteur, nous pourrions dès maintenant avancer sur ce sujet, qui représente un signal important. Les combats symboliques méritent d’être menés, mais en l’occurrence le combat est plus que symbolique, puisque des familles sont touchées.

Je trouve scandaleux que l’on établisse une discrimination entre les travailleurs indépendants selon leur provenance au sein de la République.
Si le recouvrement des prestations sociales rencontre des difficultés, il faut régler celles-ci en trouvant les moyens de coercition adéquats. En revanche, je ne peux accepter que l’on exerce un chantage sur les travailleurs ultramarins en faisant peser sur eux une présomption – de quoi ? On n’en sait rien !– et en refusant de les traiter sur un pied d’égalité avec leurs homologues métropolitains s’ils ne se conforment pas aux ordres. C’est parfaitement scandaleux, voire inconstitutionnel !
Le groupe socialiste et républicain soutient fermement cet amendement du Gouvernement.

La parole est à Mme la rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Je tiens à rappeler que je suis tenue par l’avis de la commission des affaires sociales, même si je peux entendre les arguments développés de part et d’autre. Nous ne cherchons pas à stigmatiser les travailleurs ultramarins, loin de là, mais il est difficile de renoncer à cette mesure tant que rien n’est proposé pour améliorer le taux de recouvrement des cotisations sociales. Je comprends toutefois que vous y voyiez une discrimination, dans la mesure où seuls les travailleurs ultramarins doivent produire ce justificatif.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.
I. – La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 755-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule.
« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
« Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d’un montant inférieur à une somme déterminée. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 755-16-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. »
II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522-3 du même code.
III. –
Non modifié
Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017. –
Adopté.
Le I de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Visant à étendre et adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d’assurance accomplie dans le régime de base d’assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d’assurance accomplie par l’assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance.
« Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du salaire horaire minimal prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
« Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime de base d’assurance vieillesse lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
« Si l’assuré justifie d’une durée d’assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même avant-dernier alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d’assurance de l’intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre-mer, et au plus tard le 1er janvier 2035. » ;
2° Le chapitre V du titre II est complété un article 23-8 ainsi rédigé :
« Art. 23 -8. – Le régime complémentaire défini à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d’entrée en vigueur de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article 23-7 de la présente ordonnance. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent XII. »
IV. – Le XII de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte s’applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019. –
Adopté.

L’amendement n° 196 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Patient, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :
1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les mots : « agréées en application de l’article L. 1114-1 » sont supprimés ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 1131-3, à l’exception des mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131-2-1, » ;
2° L’article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les mots : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont supprimés. » ;
B. – Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;
2° À l’article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : «, L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;
3° Au 3° de l’article L. 2441-2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;
4° Le 2° de l’article L. 2441-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. » ;
5° Après l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442 -1 -2. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé :
« Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
6° Après l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442 -2 -1.- Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2141-11, les mots : « et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle » sont supprimés ;
7° À l’article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie » sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;
8° Le 1° de l’article L. 2445-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. » ;
9° Après l’article L. 2445-4, il est inséré un article L. 2445-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2445 -5. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. »
II. – La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :
« Art. 228. – L’article 40 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
La parole est à Mme Karine Claireaux.

Cet amendement vise à actualiser, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code de la santé publique relatives d’une part, aux examens des caractéristiques génétiques permettant de diagnostiquer une anomalie génétique rare et, d’autre part, à l’assistance médicale à la procréation, aux recherches sur l’embryon, ainsi qu’à l’interruption de grossesse pour motif médical.
Il a pour objet d’étendre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l’article 40 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé relatif au principe de non-discrimination en raison de son orientation sexuelle en matière de don du sang.

Je n’ai pas d’opposition de fond sur ces dispositions, mais j’observe que leur caractère particulièrement complexe et touffu aurait justifié une intégration au texte bien en amont de l’examen de celui-ci par notre assemblée.
Je m’interroge cependant sur la non-application à la Nouvelle-Calédonie du principe selon lequel, s’agissant du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur lorsque sont concernés des mineurs ou des majeurs sous tutelle. Certes, la compétence en matière de droit civil a été largement transférée à la collectivité calédonienne ; pour autant, l’État français reste compétent en matière de libertés publiques, et il me semble que c’est bien ce dont il s’agit en l’espèce, d’autant plus que le sujet est particulièrement sensible.
Moyennant les précisions qui pourront nous être apportées sur ce point par Mme la ministre, la commission des affaires sociales a décidé de s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
L’avis du Gouvernement est favorable. En effet, cet amendement vise à étendre à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les règles protectrices relatives aux conditions de la recherche et au recueil du consentement en vigueur sur l’ensemble du territoire national, en matière de recherche génétique permettant notamment de diagnostiquer une anomalie génétique rare. Cette proposition permet d’établir opportunément l’égalité des droits dans ce domaine.
L’amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
I. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, prévu à l’article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à l’article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique. –
Adopté.
L’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée. –
Adopté.
(Non modifié)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 514-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les deuxième à dernière phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l’audience prévue au 3° du présent article. » ;
2° L’article L. 832-1 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :
« 18° À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 551-1, à la première phrase de l’article L. 552-1, à l’article L. 552-3, au premier alinéa de l’article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : “quarante-huit heures” sont remplacés par les mots : “cinq jours” ;
« 19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 552-7, les mots : “vingt-huit jours” sont remplacés par les mots : “vingt-cinq jours”. »

L’amendement n° 127, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Rivollier.

L’article 10 bis A crée une discrimination notoire à l’égard des étrangers placés en centre de rétention administrative dans les outre-mer quant à leur droit de recours administratif et judiciaire. Une fois encore, l’esprit de ce projet de loi, qui s’attache à établir une égalité réelle des outre-mer vis-à-vis de l’Hexagone, n’est pas respecté.
Concernant spécifiquement Mayotte, cet article revient, et uniquement pour ce territoire, sur la seule maigre avancée de la loi de mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui permettait l’intervention du juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures, en l’espèce ramené à cinq jours. Au regard de la politique d’immigration désastreuse pratiquée à Mayotte, caractérisée par des expulsions d’étrangers massives, voire systématiques, cette disposition revient à priver définitivement les personnes en instance d’expulsion de l’accès à un juge.
Faut-il rappeler que le département de Mayotte, qui fait partie, depuis 2014, des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, ce qui implique que les normes nationales et européennes, notamment en matière de droits des étrangers, doivent s’appliquer de la même manière qu’en métropole, est néanmoins placé sous un régime dérogatoire ?
On justifie l’existence de ce régime par la pression migratoire. En effet, en 2015, Mayotte enfermait en rétention plus de 17 000 personnes, dont plus de 4 000 enfants, mais seulement deux postes d’intervenants associatifs sont financés pour assurer l’accès au droit de ces personnes.
Un manque de moyens ne saurait en aucun cas justifier une distinction de traitement entre les étrangers, qu’ils soient en métropole ou en outre-mer. Un manque de moyens ne saurait encore moins justifier cette atteinte profonde aux droits fondamentaux qu’est la possibilité du contrôle judiciaire d’une décision administrative.

Je me suis longuement interrogé sur l’opportunité du maintien de l’intervention du juge des libertés et de la détention dans un délai de cinq jours plutôt que de 48 heures sur le seul territoire de Mayotte.
Lors de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, le Sénat s’était prononcé en faveur du maintien à cinq jours de l’intervention du juge des libertés et de la détention. Aussi pourrions-nous nous féliciter du retour à la sagesse des députés. Cependant, le dispositif proposé n’est pas sans poser plusieurs difficultés.
Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un retour à la situation antérieure, car la durée de la première prolongation proposée serait de vingt-cinq jours – contre vingt jours antérieurement à la loi du 7 mars 2016 précitée –, délai que nous avions jugé trop long à l’époque.
Ensuite, est-il pertinent de ne prévoir une telle dérogation qu’à Mayotte, alors même que la seule ampleur des éloignements pourrait justifier d’étendre ce dispositif à la Guyane ?
Enfin, on ne peut que déplorer l’insécurité juridique née de ces tergiversations du législateur. La réforme du séquençage de la rétention n’est en effet entrée en vigueur qu’au 1er novembre dernier. Aucun bilan n’a été dressé, à ce jour, justifiant de revenir sur un dispositif aussi récent.
Néanmoins, devant la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve actuellement le département de Mayotte en raison de la part très élevée de l’immigration irrégulière par rapport à la population, la commission des lois a préféré conserver ce dispositif. J’émets donc, en son nom, un avis défavorable sur cet amendement.
L’article 10 A ne tend en aucun cas à revenir sur le principe de la réforme du contentieux introduite par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Il vise seulement à permettre une simplification de la tenue des audiences dans le strict respect des impératifs d’une justice impartiale et diligente, et en tenant compte des spécificités des géographies ultramarines en termes d’éloignement et/ou d’insularité.
Cet article prend en considération la situation très particulière de l’immigration irrégulière à Mayotte, tout en maintenant une égalité de traitement concernant la durée totale de rétention.
Avant la loi du 7 mars 2016, le délai, pour le premier renouvellement de la rétention, était de cinq jours. Au-delà de ce délai, la rétention pouvait être prolongée vingt jours, renouvelables une fois. La durée maximale de rétention s’établissait donc à quarante-cinq jours.
La loi susvisée n’a pas modifié la durée maximale de rétention, elle a seulement prévu l’intervention du juge au terme du deuxième jour de rétention pour une prolongation de vingt-huit jours, qui peut être suivie d’une nouvelle prolongation de quinze jours.
L’article 10 bis A adopté par l’Assemblée nationale prévoit un aménagement particulier applicable à Mayotte, en revenant au délai de cinq jours pour la première intervention du juge, la rétention pouvant être ensuite prolongée de vingt-cinq jours, puis de quinze jours, la durée maximale restant fixée à quarante-cinq jours. Il se borne donc à revenir, pour Mayotte, à l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi précitée. La durée maximale de rétention ne change pas, mais elle est « séquencée » de manière différente. Cet aménagement est justifié par des contraintes pratiques constatées sur place, en raison de la très forte pression contentieuse à laquelle le juge des libertés et de la détention doit faire face.
Dans la mesure où l’article 10 bis A ne modifie pas la durée totale de rétention, mais se borne à tirer les conséquences de difficultés pratiques, dans l’intérêt même d’une bonne administration de la justice et dans l’intérêt des justiciables, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de suppression n° 127.

L’article 10 bis A a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale par l’adoption de deux amendements identiques présentés par les deux députés de Mayotte, sous-amendés par Victorin Lurel. Il apporte des modifications au contentieux des décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Ces modifications visent un double objectif : la tenue de l’audience du juge administratif statuant en référé liberté en dehors du tribunal administratif et le rétablissement de l’intervention du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention à cinq jours.
Les auteurs de l’amendement n° 127 proposent de supprimer ces dispositions. Or, devant la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent actuellement les départements visés, en raison de la part trop élevée de l’immigration irrégulière par rapport à leur population, il n’est pas raisonnable de soutenir cette demande de suppression.
J’ajoute que la situation migratoire à Mayotte est si préoccupante qu’il ne se passe pas un mois sans que les représentants de cette île viennent la rappeler au Parlement. J’ai toujours été « épaté » par le fait que certains collègues de métropole ne s’intéressent que ponctuellement et partiellement à ce sujet, sans l’envisager d’un point de vue global.

C’est le cas avec cet amendement. Toucher au régime du droit des étrangers à Mayotte sans le prendre en compte dans son ensemble, c’est véritablement jouer à l’apprenti sorcier !
Si cet amendement est adopté, il faudra, bon an mal an, deux postes supplémentaires de juge des libertés et de la détention à Mayotte, une salle d’audience supplémentaire et du personnel de greffe et d’administration. Où allons-nous trouver les moyens ?

Ils n’existent pas et la situation migratoire à Mayotte est telle qu’il faut réagir.
Je suis bien sûr favorable à la protection de la liberté individuelle des personnes en rétention, mais si nous n’avons pas les moyens, dans ce pays, de protéger ces libertés, ne jouons pas aux apprentis sorciers.
Je suis donc farouchement opposé à l’adoption d’un amendement qui ne ferait qu’aggraver le problème de l’immigration clandestine à Mayotte au lieu d’y apporter une solution.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 10 bis A est adopté.
I. – §(Non modifié) L’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.
II. – §(Non modifié) L’ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.
III. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L’article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Du fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;
3° Le 3° de l’article 7 est abrogé. –
Adopté.

Mes chers collègues, nous avons examiné 26 amendements au cours de la journée ; il en reste 154.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 18 janvier 2017, à quatorze heures trente et le soir :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (n° 19, 2016-2017) ;
Rapport de M. Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois (n° 287, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 288, 2016-2017) ;
Avis de Mme Vivette Lopez, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 279, 2016-2017) ;
Avis de Mme Chantal Deseyne, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 280, 2016-2017) ;
Avis de M. Michel Canevet, fait au nom de la commission des finances (n° 281, 2016-2017) ;
Avis de M. Michel Magras, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 283, 2016-2017) ;
Avis de M. Jean-François Mayet, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 284, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 18 janvier 2017, à zéro heure cinq.