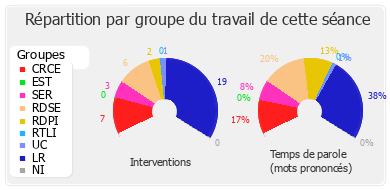Séance en hémicycle du 25 janvier 2011 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Cessation de mandat et remplacement de sénateurs
- Candidatures à une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Décision du conseil constitutionnel
- Communication d'un avis de l'assemblée de la polynésie française
- Souhaits de bienvenue à m. le président de la république de colombie
- Démission d'un membre d'une mission commune d'information et candidature
- Communication du conseil constitutionnel
- Décisions du conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité
- Responsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble mental (voir le dossier)
- Souhaits de bienvenue à un nouveau sénateur
- Responsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble mental
- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)
- Questions cribles thématiques (voir le dossier)
- Nomination d'un membre d'une mission commune d'information
- Enfants franco-japonais (voir le dossier)
- Demande d'avis sur des nominations
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Par courrier en date des 19 et 21 janvier derniers, MM. Nicolas About et Pierre Fauchon m’ont fait connaître qu’ils remettaient respectivement leur mandat de sénateur des Yvelines et de sénateur du Loir-et-Cher, à compter du samedi 22 janvier 2011 à minuit.
Acte est donné de ces décisions.
À la suite de la cessation du mandat de M. Pierre Fauchon, sénateur du Loir-et-Cher, le siège détenu par ce dernier est devenu vacant et sera pourvu, selon les termes de l’article L.O. 322 du code électoral, lors du prochain renouvellement partiel du Sénat.
Conformément aux articles L.O. 325 et L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration m’a fait connaître que, en application de l’article L.O. 320 du même code, Mme Roselle Cros est appelée à remplacer, en qualité de sénateur des Yvelines, M. Nicolas About.
Au nom du Sénat tout entier, je souhaite la plus cordiale bienvenue à notre nouvelle collègue.

J’ai reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine.
J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à cette commission mixte paritaire.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

J’ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 20 janvier 2011, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Acte est donné de cette communication.

En application de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, j’ai saisi, le 8 décembre 2010, le haut-commissaire de la République en Polynésie française en vue de la consultation de l’Assemblée de la Polynésie française sur la proposition de loi, présentée par M. Richard Tuheiava, visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Par lettre en date du 24 janvier 2011, j’ai reçu de M. le haut-commissaire de la République communication de l’avis favorable de l’Assemblée de la Polynésie française sur cette proposition de loi, qui sera examinée le jeudi 27 janvier 2011.
Acte est donné de cette communication.

M. le président. Mes chers collègues, il m’est particulièrement agréable de saluer la présence, dans notre tribune d’honneur, du Président de la République de Colombie.
Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

Le Président Juan Manuel Santos Calderón, avec qui nous venons d’avoir un long et très cordial échange, effectue sa première visite officielle hors du continent sud-américain depuis son élection, il y a six mois, et nous sommes heureux et honorés qu’il nous fasse l’amitié de venir d’abord en France. Je lui souhaite, en votre nom à tous, la bienvenue au Sénat de la République française.
Il est accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau. Parmi les ministres présents, je me permets notamment de saluer Mme María Ángela Holguín Cuéllar, ministre des affaires étrangères, qui était déjà venue prononcer au Sénat un superbe discours à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance des pays d’Amérique latine. Il est également entouré de nos collègues Michel Doublet, président délégué du groupe d’amitié France-Pays Andins, et Roland du Luart, vice-président du Sénat.
Aujourd’hui, le Président Santos veille à lutter contre la violence en Colombie, mais il est aussi le maître d’œuvre d’un vaste plan de réformes économiques et sociales, destiné à construire une société plus équitable et plus juste.
Le Sénat entretient des relations interparlementaires nourries avec le Sénat de Colombie, et notre groupe d’amitié France-Pays Andins s’est rendu dans ce pays en septembre dernier. Nos collègues ont pu constater la force de nos liens culturels, lesquels seront bientôt renforcés par un accord linguistique et universitaire, ainsi que l’intensité de nos relations politiques et économiques.
Membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour les deux prochaines années, la Colombie est un pays important d’une région, l’Amérique centrale et la Caraïbe, dont, ne l’oublions pas, nous faisons aussi partie, avec la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.
Alors que notre pays préside le G20 avec l’ambition de faire progresser une mondialisation mieux régulée, nos échanges de ce matin ont été précieux. Je ne doute pas que les échanges de demain avec le Président de la République le seront également, comme l’ont été ceux d’hier avec le Premier ministre.
Je redis au Président Juan Manuel Santos Calderón et à sa délégation combien nous sommes honorés de leur visite, heureux de les recevoir et attentifs à l’approfondissement de nos relations.
Applaudissements

J’ai reçu avis de la démission de Mme Raymonde Le Texier, comme membre de la mission commune d’information sur l’organisation territoriale du système scolaire et sur l’évaluation des expérimentations locales en matière d’éducation.
Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom du candidat proposé en remplacement.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 21 janvier 2011, quatre décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité (n° 87-2010 QPC, n° 88-2010 QPC, n° 89-2010 QPC et n° 90-2010 QPC).
Acte est donné de ces communications.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le vendredi 21 janvier 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (n° 2011-113 QPC et n° 2011-114 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
(Texte de la commission)

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, présentée par MM. Jean-René Lecerf et Gilbert Barbier et Mme Christiane Demontès (proposition de loi n° 649 [2009-2010], texte de la commission n° 217, rapport n° 216).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-René Lecerf, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi, que j’ai déposée avec mes collègues Christiane Demontès et Gilbert Barbier, s’insère d’abord dans la continuité de la loi pénitentiaire et reflète l’obstination du Sénat, commune à l’ensemble des groupes qui le composent, à mettre fin à ce sinistre constat d’humiliation pour la République que nos prisons ont, hélas ! trop longtemps mérité.
Les dispositions adoptées quant à l’évolution des conditions de détention, à l’obligation d’activité, au développement de l’emploi et de la formation en milieu carcéral ainsi qu’au renforcement des aménagements de peine et des alternatives à l’enfermement marquent d’incontestables avancées. D’autres initiatives sont allées opportunément dans le même sens, comme la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il ne peut donc surprendre que le Sénat veille d’abord à la pérennité de ces progrès lorsqu’il craint de les voir, même partiellement, remis en cause. Les débats d’hier sur le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure – LOPPSI –, et ceux de demain sur le Défenseur des droits en portent et en porteront témoignage.
Toutefois, la loi pénitentiaire, sans doute parce qu’elle fut exclusivement initiée par le ministère de la justice, sans partenariat réel avec celui en charge de la santé, n’a pu appréhender l’un des problèmes essentiels auxquels la prison d’aujourd’hui se trouve confrontée, la présence nombreuse de malades mentaux lourds dans nos établissements pénitentiaires. Non seulement cette présence est terriblement dérangeante pour les codétenus de ces personnes et pour le personnel de surveillance, mais elle est aussi bien peu compatible avec les valeurs de la République.
Tous ceux qui visitent régulièrement nos prisons – c’est le cas de nombreux membres de la commission des lois –, usant pour ce faire d’un droit qui ne leur est guère reconnu que depuis 2000, vous diront combien ils sont agressés par la prégnance de la maladie mentale, par ces regards vides ou ces visages hallucinés trop vite croisés au détour d’une coursive, par ces détenus attendant un train fantôme à votre arrivée et s’étonnant de n’avoir pu s’en aller avec lui lors de votre départ.
Comment s’étonner, dans ces conditions, que surviennent des drames majeurs, comme ceux qu’a connus la prison de Rouen, où, en l’espace d’une année, deux détenus furent tués par leurs codétenus, l’un d’eux dans des conditions particulièrement atroces, son meurtrier lui dévorant en partie les viscères ? Si, comme le pensait Albert Camus, une civilisation se juge au sort qu’elle réserve aux personnes détenues, nul doute qu’il nous reste beaucoup à faire.
Quant au nombre de suicides que l’on déplore chaque année dans nos prisons, la seule explication que l’on puisse donner au fait qu’il dépasse largement celui qu’enregistrent des pays comparables au nôtre tient encore à ce fléau de la maladie mentale, dont on sait bien que ceux qui en souffrent sont davantage exposés à la tentation suicidaire.
Sans doute vous souvenez-vous, mes chers collègues, que le Sénat a souhaité insérer dans la loi pénitentiaire, en guise de préambule permettant d’éclairer les autres réformes, la disposition suivante, qui porte sur le sens de la peine : « Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. » Néanmoins, quel sens la peine peut-elle bien revêtir pour ceux qui ne se rendent même pas compte de la nature de l’établissement où ils sont enfermés, pour ceux que terrorisent les voix qui les hantent et les dominent, ou encore pour ceux dont la totale abolition du discernement n’a pas été reconnue, dans la mesure où la prison est apparue aux cours d’assises comme le seul lieu susceptible de protéger durablement la société contre leur folie ?
C’est parce que l’on ne peut se satisfaire d’une pareille situation que les commissions des lois et des affaires sociales ont missionné un groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, composé des trois signataires de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, ainsi que de notre collègue Jean-Pierre Michel, qui n’a pas cosigné cette proposition de loi pour pouvoir en être le rapporteur.
Dans son rapport d’information intitulé « Prisons et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? », ce groupe de travail aborde nombre d’aspects qui ne seront pas examinés aujourd’hui, les auteurs de la proposition de loi s’étant bornés à reprendre les seules mesures de nature législative ayant fait l’objet d’un accord unanime.
Les réformes suggérées partent d’un constat accablant. À la lumière de l’expérience des responsables des services médico-psychologiques régionaux, les SMPR, et de l’étude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues, conduite en 2003 et 2004, 35 à 42 % d’entre elles souffriraient de troubles mentaux, et la proportion de celles qui seraient atteintes des pathologies les plus graves – schizophrénie ou autres formes de psychose –, et pour lesquelles la peine ne revêt guère de sens, atteindrait 10 %, soit plus de 6 000 personnes.
Cette situation ne répond ni aux exigences de l’éthique médicale – la prison, malgré les progrès réalisés, ne sera jamais un lieu de soins adapté –, ni aux exigences de la sécurité – quel que soit le quantum de peine, il ne correspond en aucune manière à l’évolution d’une pathologie –, ni à nos valeurs démocratiques, lorsque l’on voit que des personnes dont le discernement s’avère considérablement altéré sont plus sévèrement punies que celles qui ont pleine conscience de la portée de leurs actes.
Cette dérive du système français s’explique largement par la diminution drastique de la capacité d’hospitalisation en psychiatrie générale, par le souci thérapeutique d’un certain nombre de psychiatres de responsabiliser les malades en retenant plutôt l’altération que l’abolition du discernement, enfin, par l’absence d’alternative proposée aux tribunaux correctionnels et, surtout, aux cours d’assises.
C’est pourquoi, sans remettre en cause la distinction entre abolition et altération du discernement, telle qu’elle a été insérée dans l’article 122-1 du nouveau code pénal, cette proposition de loi entend préciser les dispositions du deuxième alinéa de cet article, pour en revenir à l’intention initiale du législateur.
Selon les termes de cet article, « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Les travaux préparatoires, notamment le rapport établi pour le Sénat par M. Marcel Rudloff, tout comme l’insertion de ces dispositions dans un chapitre du code pénal consacré aux causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité, ne laissent subsister aucune ambiguïté sur la volonté du législateur.
Pourtant, l’altération du discernement mène le plus souvent, et presque toujours devant les cours d’assises, à une aggravation de la peine. Comme le relève Jean-Pierre Michel dans son rapport, citant lui-même un document rédigé en 2005 par la commission santé-justice présidée par Jean-François Burgelin, ancien procureur général près la Cour de cassation, « ce n’est pas le moindre des paradoxes que de constater que les individus dont le discernement a été diminué puissent être plus sévèrement sanctionnés que ceux dont on considère qu’ils étaient pleinement conscients de la portée de leurs actes ».
La proposition de loi prévoit donc une réduction du tiers de la peine encourue dans l’hypothèse d’une altération du discernement au moment des faits. Il appartiendra, en outre, en tout état de cause, à la juridiction de fixer, dans la limite du plafond ainsi déterminé, la durée la plus appropriée, en tenant compte du fait que plus la personne est souffrante, plus sa situation justifie une prise en charge sanitaire de préférence à une incarcération.
Recherchant un meilleur équilibre entre réponse pénale et prise en charge sanitaire, la proposition de loi vise à renforcer parallèlement les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention. Le texte initial prévoyait que, si un sursis avec mise à l’épreuve était prononcé, il devait nécessairement comporter une obligation de soins. M. le rapporteur a amélioré cette rédaction, en lui retirant son caractère trop systématique, et en prévoyant à la fois un avis médical préalable et la possibilité d’une décision contraire du juge.
L’article 2 de la proposition de loi tend à autoriser le juge de l’application des peines à retirer les réductions de peines en cas de refus de soins de la part d’une personne incarcérée dont le discernement était altéré au moment des faits. Ce mécanisme, conformément aux principes actuels, met en place un retrait facultatif, s’agissant du crédit de réduction de peine dit « automatique », et un retrait de principe, sauf décision contraire du juge, s’agissant de la réduction supplémentaire de peine. Là encore, ce dispositif a été amélioré par M. le rapporteur.
Enfin, l’article 3 de la proposition de loi vise à permettre d’appliquer aux personnes dont le discernement était altéré les mesures de sûreté introduites par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, destinées pour l’heure aux seules personnes reconnues irresponsables. Comme l’écrit M. le rapporteur, « si des personnes jugées pénalement irresponsables ont été considérées par le législateur en mesure de respecter des mesures de sûreté – et d’encourir une sanction pénale en cas de manquement –, tel devrait, a fortiori, être le cas pour des personnes reconnues responsables dont le discernement était seulement altéré au moment des faits ». Il appartiendrait au juge de l’application des peines d’ordonner de telles mesures, qui seraient complétées par l’obligation de soins. Cet article illustre une fois encore la volonté de concilier la réduction de la peine encourue par les personnes atteintes de troubles mentaux et la nécessaire sécurité due à la société.
Cette proposition de loi ne pouvait évidemment pas reprendre les nombreuses suggestions du groupe de travail qui n’entrent pas dans le domaine législatif, comme le fait de prévoir l’affectation systématique des personnes dont le discernement est altéré dans les établissements pénitentiaires dotés d’un SMPR, de créer une spécialisation de niveau master en psychiatrie pour les infirmiers, de développer les formations communes aux professionnels de la justice et de la santé appelés à intervenir auprès des auteurs d’infractions atteints de troubles mentaux, ou encore d’améliorer les conditions de l’expertise. Sur ces points, je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport d’information.
Je tiens néanmoins à évoquer, avant de conclure, un certain nombre de réflexions et d’interrogations, sans doute moins consensuelles, mais que je pense largement partagées par les deux corapporteurs du groupe de travail de la commission des lois, Jean-Pierre Michel et moi-même.
Les unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, instituées par la loi d’orientation et de programmation pour la justice de 2002, posent ainsi un certain nombre de questions. Ces structures seront implantées dans des établissements de santé, et sécurisées par l’administration pénitentiaire, afin d’assurer l’hospitalisation, avec ou sans consentement, des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. La première unité de ce genre vient d’être construite à Lyon.
Ces structures marquent bien sûr un progrès dans la prise en charge médicale des personnes détenues, mais ne risquent-elles pas, dans le même temps, d’encourager à condamner et à incarcérer un nombre croissant de personnes atteintes de troubles mentaux, en toute bonne conscience de surcroît, puisque des structures psychiatriques existeront – enfin ! –, mais qu’elles seront réservées aux personnes condamnées ?
Le dispositif français nous apparaît souvent excessivement manichéen : soit la personne est reconnue irresponsable, et son suivi relève exclusivement du médecin, soit la personne est condamnée, et elle relève alors du juge.
De même, les barrières qui séparent les malades mentaux selon qu’ils ont commis une infraction ou non, et selon qu’ils ont été reconnus irresponsables ou responsables pénalement, ne sont-elles pas bien aléatoires ?
Alors que les unités pour malades difficiles, les UMD, pour lesquelles les listes d’attente sont considérables, accueillent indifféremment toutes les catégories de malades mentaux, ne pourrait-il pas en être de même pour les UHSA, à tout le moins pour ce qui concerne les personnes ayant commis de graves infractions ?
Sinon, n’en arrive-t-on pas à priver de soins ceux qui, souvent par chance, n’ont pas encore commis l’irréparable ? Combien de courriers recevons-nous, mes chers collègues, de parents désespérés nous racontant la tragédie vécue par l’un de leurs enfants ? Alors qu’ils avaient, en vain, alerté plusieurs autorités sur sa dangerosité, personne ne les a écoutés, et le drame mille fois annoncé a fini par se produire.
Enfin, alors que l’avenir de la prison de Château-Thierry a parfois semblé menacé, permettez-moi de rendre un hommage admiratif au personnel pénitentiaire qui y travaille et qui s’est peu à peu spécialisé dans la prise en charge d’une population pénale comptant 85 % de détenus psychotiques. À force d’écoute, de patience et de respect, avec des gestes simples comme celui de la main tendue, des résultats remarquables sont obtenus dans la stabilisation et le suivi des personnes détenues en souffrance. Nous sommes nombreux à penser que ce type d’établissement mériterait non seulement d’être préservé, mais aussi de faire école, car ni les UMD ni les UHSA, dont le prix de journée est sans commune mesure, ne suffiront à faire face à la dimension du problème posé.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’histoire de ce texte est liée au rapport qui avait été présenté par quatre membres de notre assemblée. Je ne m’attarderai toutefois pas sur ce point, que Jean-René Lecerf, l’un des auteurs de la proposition de loi, vient à l’instant d’évoquer dans son intervention.
Cette proposition de loi part d’un constat accablant : 10 % des détenus environ souffriraient de troubles psychiatriques très graves, et peuvent donc être véritablement considérés comme des malades mentaux, ce chiffre n’incluant pas les personnes souffrant de troubles du comportement, de troubles dus à des addictions ou de troubles dus à l’enfermement pénitentiaire lui-même.
Le code de procédure pénale prévoit pourtant une expertise, obligatoire en matière criminelle, facultative en matière correctionnelle. Les personnes déclarées pénalement irresponsables sont envoyées en hôpital psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation d’office, et celles dont la responsabilité est simplement altérée encourent une sanction pénale dont la juridiction fixe la durée et les modalités d’application. Toutefois, les psychiatres préfèrent souvent ne pas conclure à l’irresponsabilité totale, et l’on constate en effet que les rapports d’expertise qui vont dans ce sens tendent à se raréfier.
Quant aux jurys d’assises, lorsqu’ils sont confrontés à un délinquant dont la responsabilité peut être altérée en raison de troubles mentaux, ils ont tendance, par mesure de sécurité – on peut les comprendre ! –, à le condamner plus lourdement encore.
Pour remédier à ces difficultés, la proposition de loi qui vous est soumise prévoit que l’atténuation de la responsabilité résultant du rapport de l’expert constitue un facteur d’allègement du quantum de la peine encourue. En contrepartie, elle renforce toute une série d’obligations de soins pendant et après la détention de la personne concernée.
Le principe de l’atténuation de la responsabilité a été initialement posé par un arrêt de la Cour de cassation de 1885 puis, en 1905, par la fameuse circulaire Chaumié, du nom du garde des sceaux de l’époque. L’évolution de la psychiatrie a par la suite montré qu’il existait des gradations dans la maladie mentale et dans la conscience de la personne malade. C’est ainsi qu’est née l’alternative de l’article 122-1 du code pénal, qui distingue l’irresponsabilité totale et l’atténuation de responsabilité.
Cette distinction aurait dû limiter le nombre de malades mentaux graves en prison. Or, il n’en est rien, avec toutes les conséquences désastreuses qui en résultent pour le délinquant malade, pour l’établissement pénitentiaire, mais aussi, nous y reviendrons, pour la société.
L’altération du discernement devrait entraîner une diminution de la durée de la peine. Le rapporteur pour le Sénat de la loi portant réforme des dispositions générales du code pénal, Marcel Rudloff, avait conclu en ce sens. Les travaux préparatoires de ce texte attestent de cette volonté du législateur, également relevée par Jean-François Burgelin dans son rapport de 2005. Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé ce principe à propos de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, en indiquant que la juridiction peut toujours, sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal, prononcer une peine inférieure aux peines prévues.
Dès lors, la prise en compte de l’altération du discernement comme cause de réduction de la peine ne constituerait nullement un précédent dans notre droit. Un tel système est d'ailleurs appliqué dans d’autres pays, notamment en Espagne et en Italie.
La proposition de loi prévoit que la peine encourue est réduite d’un tiers dans le cas où le discernement est altéré : une peine de trente ans serait ainsi ramenée à vingt ans. On peut certes discuter de l’ampleur de cette réduction – nos collègues du groupe CRC-SPG déposeront d'ailleurs un amendement sur ce point –, mais ce choix, opéré dans un souci d’équilibre, est le fruit d’un compromis acceptable par le plus grand nombre d’entre nous.
Je remarque que cette méthode, propre au Sénat, et particulièrement à la commission des lois, grâce à son président Jean-Jacques Hyest, permet de faire évoluer notre législation dans le bon sens. À l’avenir, d’autres propositions de loi, émanant de divers groupes politiques, feront également l’objet de compromis porteurs d’avancées.
Dans la limite de ce plafond abaissé d’un tiers, le juge peut décider de la durée de la peine la plus appropriée, en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité du délinquant et, éventuellement, de son casier judiciaire. Le principe d’individualisation de la peine est donc pleinement respecté, je le dis solennellement. Le juge reste totalement libre, bien qu’il soit, comme toujours, contraint par un plafond : lorsqu’il juge un escroc qui encourt cinq ans d’emprisonnement, il ne peut pas le condamner à six ou sept ans d’emprisonnement !
Le code pénal contient d’ailleurs d’autres causes légales de diminution du quantum de la peine : c’est le cas pour les mineurs âgés de plus de treize ans, qui se voient appliquer une réduction de 50 %, mais aussi lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou de fausse monnaie livre des informations qui permettent de pousser plus loin les investigations et de trouver d’autres auteurs de ces infractions particulièrement graves.
Voilà pour les dispositions figurant dans la première partie de la proposition de loi.
Dans la deuxième partie du texte, et par souci d’équilibre, les auteurs de la proposition de loi ont prévu que les personnes dont le discernement est altéré par une maladie mentale, et qui seraient condamnées moins lourdement qu’aujourd’hui, se voient imposer diverses obligations de soins – ce qui, il faut bien le dire, n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Ainsi, si un sursis avec mise à l’épreuve est prononcé, avec ou sans peine ferme, il devra comporter une obligation de soins, laquelle ne sera toutefois pas automatique, le juge ayant la possibilité de passer outre, après avis médical. Notons que le suivi socio-judiciaire peut déjà être prononcé par le juge pour un très grand nombre d’infractions.
Par ailleurs, l’article 2 de la proposition de loi vise à permettre au juge de l’application des peines de retirer les réductions de peine pendant la détention en cas de refus de soins de la part d’une personne incarcérée dont le discernement était altéré au moment des faits. Cette décision serait également prise après avis médical.
Les psychiatres que nous avons entendus, s’ils étaient d’accord avec la proposition de loi, se sont montrés plus réticents sur ce dernier point, jugeant que l’on ne pouvait pas contraindre à une obligation de soins des personnes détenues, et que le fait de les inciter à se soigner était déjà, en soi, une thérapie.
Mes chers collègues, nous devons être conscients des contradictions de la pratique actuelle.
Une personne qui commet une infraction grave, par exemple un assassinat, et qui est déclarée pénalement irresponsable, sera hospitalisée d’office dans un hôpital psychiatrique. On ne lui demandera pas son avis et, pour son bien, on la soignera, y compris par les méthodes les plus dures, en la plaçant, par exemple, en chambre de contention ou d’isolement, ainsi que nous avons pu le constater dans les UMD que nous avons visitées.
En revanche, une personne qui commettrait la même infraction, mais dont le discernement serait simplement altéré au moment des faits, se retrouverait en prison, même si le quantum de peine venait à être atténué par ce texte. Elle serait, certes, vraisemblablement incarcérée dans un établissement doté d’un SMPR, voire, par périodes, placée en UMD, mais ne serait nullement soumise à une obligation de soins. Or les psychiatres ont eux-mêmes souligné que leurs rapports n’étaient pas des objets scientifiques incontestables et qu’ils pouvaient varier d’une personne à l’autre.
On nous dit bien que, dans un tel cas, les détenus seront incités à se soigner, l’infirmerie offrant un meilleur régime que la simple détention. Il n’en reste pas moins qu’une telle différence de traitement me paraît tout simplement impensable, mes chers collègues !
C’est la raison pour laquelle nous avons prévu que, dans ce cas-là, le juge de l’application des peines puisse faire jouer une série de mesures qui, nous l’espérons, conduiront les personnes en détention à suivre les soins que nécessite leur état de santé mentale.
Enfin, l’article 3 de la proposition de loi vise à permettre l’application des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du code de procédure pénale aux personnes dont le discernement est altéré à l’issue de leur détention. La décision du juge serait soumise à un avis médical ; il n’y aurait donc aucune automaticité, conformément aux remarques formulées par les représentants de la Chancellerie lors de leur audition.
En conclusion, je le répète, ce texte permet d’établir un meilleur équilibre entre la réponse pénale et la prise en charge sanitaire. Le dispositif a été approuvé à l’unanimité par la commission des lois, certains commissaires n’ayant pas pris part au vote.
Cette proposition de loi, que je vous propose d’adopter, mes chers collègues, est conforme au principe de proportionnalité, en ce qu’elle permet d’assurer à la fois la réduction de la peine encourue par les personnes atteintes de troubles mentaux et la nécessaire sécurité due à la société.
Elle ne vise nullement, comme je l’ai lu à tort dans des journaux qui pratiquent la désinformation, à prendre le contre-pied de la politique sécuritaire du Gouvernement. Un tel raisonnement n’a, en l’espèce, aucun sens.
Elle permet simplement de prendre en compte le malade mental délinquant, de le soigner mieux qu’il ne l’est aujourd’hui, mais aussi de l’y obliger, afin d’éviter la récidive et de protéger la société.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi vise à modifier le code pénal ainsi que le code de procédure pénale afin d’atténuer la responsabilité pénale des personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. Ce texte résulte du travail approfondi mené par les sénateurs Jean-René Lecerf, Gilbert Barbier et Christiane Demontès dans le cadre du groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, dont le rapport d’information est intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? »
Depuis plusieurs années, notre droit pénal a considérablement évolué pour mieux prévenir la lutte contre la récidive et prévoir des obligations de soin pour les personnes présentant des troubles psychiatriques et ayant commis des crimes ou des délits. Je pense notamment au suivi socio-judiciaire prévu par la loi du 17 juin 1998, à la surveillance judiciaire instituée par loi du 12 décembre 2005 et à la surveillance de sûreté issue de la loi du 25 février 2008.
Plus globalement, le Gouvernement, en particulier le ministère de la justice, s’est fortement intéressé à la question de la délinquance et du trouble mental puisque plusieurs lois adoptées au cours de la présente législature prennent en compte ce phénomène. Je citerai, à cet égard, les deux lois les plus récentes : celle du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, que je viens de mentionner, ainsi que celle du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. De son côté, la loi pénitentiaire n’avait pas pour objet de traiter du trouble mental en détention, mais ce texte important a toutefois permis de consacrer les droits des détenus et les devoirs de l’administration pénitentiaire.
L’article 1er de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à inscrire à l’article 122-1 du code pénal une réduction automatique de peine, à hauteur d’un tiers de la peine encourue, pour les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits.
Ce dispositif, qui diffère de la problématique de l’irresponsabilité pénale, vise à prendre en compte la situation particulière de l’altération du discernement. Actuellement, l’équilibre du dispositif laisse à l’appréciation du juge la détermination du quantum de la peine.
La prise en compte de la situation particulière d’altération du discernement est inscrite de longue date dans notre droit. Le principe fondamental d’individualisation de la peine est essentiel afin d’adapter la peine à la situation particulière du délinquant.
Le dispositif actuel est équilibré en ce qu’il permet de différencier, par exemple, le kleptomane, qui souffre d’un trouble de la volonté et bénéficie le plus souvent d’une diminution de peine en application de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, et le pyromane, qui souffre également d’un trouble de la volonté et relève donc lui aussi de cette même disposition, mais qui, compte tenu de sa dangerosité, sera en général sanctionné plus sévèrement.
Toutes les lois récemment adoptées témoignent de ce que le législateur entend faire preuve d’une plus grande sévérité à l’encontre des personnes atteintes de troubles mentaux, tout en favorisant la prise en charge médicale de ces derniers.
Cette proposition de loi, en remplaçant l’appréciation souveraine des juridictions par la réduction du tiers de la peine encourue, remet donc en cause l’équilibre de l’article 122-1 du code pénal et va à l’encontre de l’œuvre du législateur depuis l’adoption dudit code.
Elle semble également aller à l’encontre de l’appréciation du Conseil constitutionnel, qui, dans une décision du 9 août 2007 sur les peines planchers, rappelait que « le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; qu’il n’implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction ». Les Sages en concluaient que les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, « même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, […] permettent à la juridiction de prononcer, si elle l’estime nécessaire, une peine autre que l’emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale ».
Par conséquent, il est tout à fait manifeste que, pour le Conseil constitutionnel, l’atténuation de la responsabilité n’a pas pour conséquence d’entraîner obligatoirement une diminution de peine, par nature contraire au principe d’individualisation de la peine. Prévoir une réduction automatique conduirait à rigidifier le dispositif, alors que de telles situations requièrent une analyse au cas par cas.
Aux termes de la présente proposition de loi, les criminels les plus dangereux, et ceux qui ont commis les faits les plus atroces, ne pourront plus être condamnés à la peine maximale encourue si l’on considère, ce qui est souvent le cas, qu’ils ne sont pas totalement indemnes d’une pathologie mentale. En effet, dès lors que la loi affirmera que l’altération du discernement a pour conséquence une diminution de peine, la question du trouble mental de l’accusé deviendra ainsi un enjeu primordial de défense.
Par exemple, dans l’affaire du meurtre du petit Valentin Cremault, tué dans le département de l’Ain au mois de juillet 2008 par Stéphane Moitoiret, une réduction de peine d’un tiers serait certainement prononcée en raison de l’altération du discernement de l’individu.
L’opinion publique acceptera donc difficilement une telle réforme.
Prenons garde aux solutions qui remettent en cause la philosophie profonde de notre droit pénal en automatisant les sanctions.
Dans son article 2, la proposition de loi envisage de modifier également le régime de la peine pour les personnes atteintes au moment des faits d’une altération du discernement. Le texte prévoit un régime plus systématique et plus strict d’obligation de soins, afin d’assurer un traitement adapté aux auteurs d’infractions souffrant de troubles mentaux. C’est pourquoi il impose au juge d’assortir systématiquement le sursis avec mise à l’épreuve d’une obligation de soins et prévoit le retrait des réductions de peine en cas de refus de soins.
Une telle préoccupation retient toute l’attention du Gouvernement, car il est bien évident que la persistance des troubles et l’absence de prise en charge médicale adaptée constituent autant de risques de récidive. Elles sont aussi un frein à la réinsertion.
Mais il faut veiller à définir des solutions réellement efficaces et proportionnées et, à cet égard, le caractère systématique du dispositif paraît inadapté.
Certes, la commission des lois, consciente de la nécessité pour le juge d’adapter le régime de la peine et de prendre en compte l’infinie variété des situations individuelles, a souhaité qu’une telle mesure soit tempérée. Mais, dans certains cas, l’obligation de soins ne sera d’aucune utilité.
C’est pourquoi la commission des lois prévoit l’avis préalable d’un médecin, qui permettra éventuellement au juge de ne pas assortir le sursis avec mise à l’épreuve d’une obligation de soins lorsque cette dernière s’avère inutile.
Cependant, même ainsi amendée, cette disposition pose d’autres difficultés juridiques et pratiques.
Tout d’abord, la proposition de loi ne prend pas en compte les évolutions législatives essentielles de ces dernières années, comme le régime de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ou la rétention de sûreté.
Par ailleurs, le texte proposé inclut également dans le dispositif l’injonction thérapeutique, qui concerne des situations très particulières, telles que l’usage de stupéfiants ou la consommation habituelle et excessive d’alcool. Il conviendrait donc a minima de limiter la portée de la disposition en ne se référant qu’à l’obligation de soins.
Vous proposez que le juge de l’application des peines puisse revenir sur les réductions de peine prévues lorsque la personne détenue refuse les soins. À première vue, cette solution paraît efficace pour s’assurer d’un traitement réel des condamnés.
Toutefois, on ne peut pas mettre sur un même plan le traitement, dans le cadre de la peine, du trouble mental directement lié à l’origine de l’incarcération et le traitement en détention des troubles mentaux des délinquants ; imaginons par exemple le cas d’un kleptomane qui serait incarcéré pour viol.
Il est exact que certaines pathologies, parce qu’elles ont entraîné des faits graves, doivent être traitées dans le cadre de la peine. Ainsi, les juridictions peuvent assortir le suivi socio-judiciaire d’une injonction de soins.
Il faut cependant préciser plusieurs éléments.
D’abord, l’injonction de soins ne peut être prononcée que s’il est établi par une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
Ensuite, cette injonction n’est pas applicable en tant que telle en détention, car il serait inefficace et contraire à la déontologie médicale d’imposer, sous peine de sanctions, des soins à une personne déjà privée de liberté.
Enfin, l’individu ne fait l’objet que d’incitations à suivre ces soins dans des établissements adaptés, son refus étant considéré comme le signe qu’il ne manifeste pas des efforts sérieux de réadaptation sociale ouvrant droit aux réductions de peine supplémentaires.
Le mécanisme proposé est donc plus sévère que celui résultant du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, alors même que cette peine est prévue pour les infractions les plus graves.
Tout autre est la question du traitement en détention des troubles mentaux des personnes incarcérées. Celles-ci ont droit à des soins dans tous les types d’établissement et ne peuvent pas être contraintes, en dehors de l’hypothèse d’une décision d’hospitalisation d’office prise en cours d’exécution de la peine, à suivre ces soins, sous peine de sanctions.
Les dispositions relatives aux sorties de détention qui figurent dans l’article 3 de la proposition de loi nous paraissent également conduire à une confusion entre irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et atténuation de responsabilité pour cause de trouble mental.
En effet, il est proposé de régler la question de la sortie de détention des délinquants au discernement altéré dans la partie relative aux mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Ces propositions opèrent une judiciarisation des soins des troubles mentaux. Le juge de l’application des peines, hors le cadre d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une juridiction de jugement, pourra imposer des soins et diverses obligations, sous la contrainte.
Cela va à l’encontre, d’une part, des dispositions de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation et, d’autre part, des exigences constitutionnelles en la matière, telles qu’elles ont été rappelées dans une décision du 26 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En outre, la seule possibilité de recours contre pareille décision relève du juge des libertés et de la détention, qui est compétent pour statuer sur les demandes de mainlevée des hospitalisations d’office à la demande d’un tiers ou sur celles qui sont ordonnées par le préfet.
Dans le cadre de cette peine, des interdictions similaires à celles qui figurent à l’article 706-136 du code de procédure pénale peuvent donc être prononcées – elles peuvent également l’être dans le cadre des aménagements de peine ou d’une libération conditionnelle – sans qu’il soit aucunement nécessaire d’étendre les dispositions de cet article aux personnes dont le discernement est altéré.
Vous l’aurez compris, le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble des dispositions de cette proposition de loi, que je ne peux que vous inviter à rejeter en l’état, mesdames, messieurs les sénateurs. En outre, les amendements déposés sur ce texte ne me paraissent pas de nature à modifier la position que je viens de vous exposer.

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer la présence parmi nous de notre nouvelle collègue Mme Roselle Cros, sénatrice des Yvelines, un département cher à mon cœur. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Grâce à elle, le Sénat peut se targuer de compter en son sein quatre-vingts femmes et d’accentuer encore le record précédemment détenu par notre assemblée du plus grand nombre de femmes dans une assemblée nationale française depuis les origines de la République.
(Texte de la commission)

Nous reprenons l’examen de la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Madame la secrétaire d'État, votre intervention m’a quelque peu étonnée. Vous n’avez même pas abordé un sujet qui préoccupe, semble-t-il, beaucoup de sénateurs : aujourd'hui, le nombre de détenus atteints de troubles mentaux est non seulement très important, mais en augmentation ! Une telle omission est fort regrettable, notamment de la part d’une secrétaire d’État chargée de la santé !
Selon M. le rapporteur, le taux de détenus atteints de troubles graves serait de 10 %, une proportion que certains jugent sous-évaluée. Ainsi, dans une enquête réalisée en 2005, le docteur Betty Brahmy, responsable du service médico-psychologique régional de Fleury-Mérogis, avançait les chiffres de 20 % chez les hommes et de 30 % chez les femmes !
L’autre constat est que le nombre de personnes atteintes de troubles mentaux et incarcérées, jadis constant, ne cesse de croître année après année. C’est évidemment lié à l’augmentation du nombre de détenus, aux évolutions législatives intervenues depuis des années et à la politique pénale menée au cours des dix dernières années. À en croire ce qui vient d’être indiqué, celle-ci n’a eu de cesse de promouvoir l’individualisation des peines. En réalité, elle a surtout eu pour conséquence d’aggraver la situation dans les prisons.
De mon point de vue, et une large part des membres de mon groupe partage mon analyse, une telle situation est principalement liée à la mauvaise application de l’article 122-1 du code pénal, qui opère une distinction entre les personnes dont le discernement a été « aboli » – elles sont déclarées irresponsables – et celles dont le discernement a seulement été « altéré ». Nous le savons, ce phénomène s’explique plus par une volonté d’affichage politique vis-à-vis de l’opinion que par un souci de répondre à des problèmes réels.
Aujourd'hui, on constate un double mouvement. L’altération est devenue la règle, et l’abolition l’exception. De plus en plus de malades atteints de pathologies psychiatriques importantes sont renvoyés devant les tribunaux.
Comme l’ont indiqué les sénateurs qui m’ont précédée, la notion d’« altération », qui devait initialement jouer en faveur d’un allégement et d’un aménagement de la peine, donc d’une individualisation, est progressivement devenue un facteur d’aggravation ! Car, nous dit-on, que faire de l’individu si on ne le met pas en prison le plus longtemps possible ?
Nous voilà donc bien loin de l’esprit de la réforme adoptée en 1990. En théorie, il s’agissait de permettre à une personne atteinte d’un trouble passager au moment de la réalisation d’un crime ou d’un délit de disposer d’un procès, afin de lui permettre de prendre conscience de son acte, mais également de l’aider à trouver la voie de la guérison, ce qui ne saurait être le cas si elle est incarcérée pour de longues années !
Autre facteur notable d’aggravation, les évolutions législatives intervenues sur l’initiative de votre famille politique, madame la secrétaire d’État ! Elles se caractérisent par une assimilation, qui n’est pas sans risque, entre trois notions très différentes : la maladie mentale, la responsabilité pénale et la dangerosité, voire la « dangerosité présumée » !
Cet amalgame, qui joue, notamment, sur la peur de nos concitoyens permet de faire adopter des lois reposant sur l’émotion et de justifier des mesures très dangereuses pour les libertés publiques ; je pense particulièrement à la rétention de sûreté.
Dans un contexte marqué par une défiance du pouvoir politique à l’égard du pouvoir judiciaire, pouvoir judiciaire que les plus hauts responsables de l’État n’ont de cesse de taxer de laxisme, même si aujourd'hui le discours de la Chancellerie est revu pour faire mine de défendre les magistrats contre les parlementaires, et sont prêts à sanctionner et à livrer à la vindicte populaire, comment s’étonner que les magistrats et les jurés préfèrent opter pour l’altération du discernement, qui envoie en prison, et pour une aggravation de la peine que pour l’abolition du discernement ?
De la même manière, la rétention de sûreté, qui n’est rien d’autre que la possibilité d’enfermer à vie et sans jugement des personnes déjà condamnées, aura immanquablement pour effet de replonger dans le milieu carcéral d’anciens détenus condamnés par le passé, y compris en raison de l’application contestée de l’article 122-1 du code pénal.
Enfin, comment ne pas souligner que la procédure de comparution immédiate joue en la défaveur des personnes souffrant de troubles mentaux ? Sa rapidité, le peu de temps laissé aux avocats de la défense pour constituer leurs dossiers et établir un véritable dialogue avec leur client, la nature de la procédure qui n’est pas propice à l’expression des souffrances psychiques ainsi que le caractère non suspensif des demandes d’expertises psychologiques, tout conduit à faire entrer au fur et à mesure l’ensemble de ces pathologies dans les prisons de notre pays. Même s’il est vrai que dans l’immense majorité des cas les peines prononcées en comparution immédiate sont de courte durée, il n’en demeure pas moins que des personnes dont l’état psychique aurait nécessité une prise en charge médicale sans délai, laquelle aurait peut-être permis une réinsertion rapide, se retrouvent en milieu carcéral.
Enfin, comment ne pas souligner que la situation carcérale actuelle est elle-même un élément pathogène ? La surpopulation carcérale accroit le nombre des personnes qui, peu à peu, se mettent à présenter des troubles mentaux, ce qui augmente les difficultés des personnels et des détenus. C’est un problème sur lequel nous devons nous interroger même si le débat est difficile, comme nous avons pu le constater lors de l’examen de la loi pénitentiaire.
La proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui a le mérite de poser le problème de l’application de l’article 122-1 du code pénal et de prendre en compte l’atténuation du discernement.
Toutefois, l’article 2 de ce texte renvoie à l’application de dispositifs de droit commun et s’inscrit dans une démarche d’enfermement carcéral puisque, en l’état actuel, les dispositifs de soins psychiatriques sont insuffisants ou inadéquats pendant et après l’incarcération. Cette proposition de loi n’est donc pas de nature à corriger le manque de cohérence de la politique pénale, carcérale et psychiatrique actuelle.
Le discours que vous venez de prononcer, madame la secrétaire d'État, souligne l’incohérence et les contradictions de votre politique. Il est proposé de renvoyer en prison des personnes dont l’altération de responsabilité a été reconnue pour non-observation d’injonctions sociales ou médicales, tout particulièrement médicales avec l’obligation de soin, alors qu’il leur est difficile, leur jugement étant altéré, de bien comprendre, d’une part, le sens de la peine, ce qui renvoie à l’atténuation au lieu de l’abolition, et, d’autre part, la nécessité de se soigner. L’efficacité des soins est donc douteuse. Nous sommes en plein dans la contraction.
J’ai déposé un amendement qui ne sera pas examiné aujourd'hui, car il a été déclaré irrecevable par la commission des finances. Cet amendement visait à substituer aux peines de prison infligées en cas de non-respect de l’obligation de soin un accueil au sein d’établissement adapté à la pathologie. On peut objecter à cet amendement que ces établissements n’existent pas et qu’il faut les créer. Néanmoins, je viens d’apprendre que la commission des finances a approuvé sur la proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir un amendement, je le dis d’autant plus volontiers que je n’en suis pas signataire, aux termes duquel « toute personne, dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Chaque département français est pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. » En quoi mon amendement serait-il irrecevable si celui de M. Maurey est retenu ? Je demande donc que mon amendement soit examiné par notre assemblée !
En tout état de cause, cette proposition de loi constitue au moins une réponse pour celles et ceux qui, atteints de troubles mentaux temporaires au moment de la commission des faits, subissent une incarcération en lieu et place d’un suivi médico-social qui serait plus pertinent. J’ai beaucoup réfléchi. La logique voudrait que je m’abstienne de voter ce texte, mais il présente le mérite de poser le problème et de reconnaître que l’on ne peut continuer à envoyer des personnes malades en prison pour des périodes indéfinies. Je voterai donc cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui est issue, comme M. le rapporteur l’a rappelé, des travaux de réflexion du groupe de travail mené par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, question qui n’a, à ce jour, pas encore reçu de réponse satisfaisante dans notre pays.
Comme l’ont très clairement exprimé les rapporteurs du groupe de travail, Mme Demontès, MM. Lecerf et Barbier, « l’altération du discernement conduit le plus souvent à une aggravation de la peine prononcée ». C’est un constat, à mon sens, terrible étant donné les dispositifs de procédure existant déjà dans le code pénal et le code de procédure pénale.
En effet, légalement, il faut distinguer l’abolition et l’altération du discernement en raison d’un trouble mental. À première vue, le distinguo peut être délicat ; pourtant, dans le premier cas la personne n’est pas pénalement responsable alors que dans le second cas elle est punissable, la juridiction devant tenir « compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ». Cette législation participe, dans les faits, comme vous l’avez exposé, de manière significative, à la forte présence de personnes atteintes de troubles mentaux en détention : 25 % des détenus. C’est pourquoi vous nous proposez de corriger ces effets en modifiant le code pénal et le code de procédure pénale.
Il s’agit donc de prendre en compte la circonstance liée à l’altération du discernement dans la détermination de la peine et de son régime. Comme l’a souligné M. Lecerf, la peine à laquelle elles sont condamnées ne revêtirait aucun sens pour un certain nombre de personnes atteintes de troubles mentaux.
Nos collègues du groupe de travail ont montré que le milieu carcéral peut aggraver les pathologies. En outre, la cohabitation des détenus atteints de troubles mentaux avec d’autres qui en sont exempts est source de tensions et de violences.
Ainsi, le quantum de peine prononcé ne correspondrait en aucune manière à l’évolution d’une pathologie et, dans bien des cas, la personne quitterait la prison aussi malade qu’elle y est entrée.
Vous proposez, dans un premier temps, de réduire la peine privative de liberté en cas d’altération du discernement au tiers du quantum, tout en précisant qu’il appartiendra à la juridiction de fixer, dans la limite du plafond ainsi déterminé, le régime de la peine la plus appropriée, celle-ci pouvant être le sursis avec mise à l’épreuve et obligation de soins. C’est pourquoi l’expertise médicale est à notre sens primordiale.
Il n’est pas souhaitable, aujourd’hui, de remettre en cause la distinction entre abolition et altération du discernement, mais il semble important, comme vous nous le proposez, monsieur le rapporteur, de préciser que l’altération du discernement doit constituer une cause légale d’atténuation de responsabilité.
Ne perdons pas de vue, mes chers collègues, la variété des situations individuelles que les juges voudront bien analyser avec leur plus grande bienveillance.
Vous proposez, dans un deuxième temps, d’autoriser le juge de l’application des peines à retirer, en fonction de son appréciation, une partie des réductions de peine lorsque la personne, dont le discernement était altéré au moment des faits, refuse les soins qui lui sont proposés. Comme vous le savez, les détenus ne peuvent recevoir de soins psychiatriques en détention qu’avec leur consentement. Si la prise en charge médicale a pu connaître des aléas au cours des années passées, la volonté d’un traitement individualisé de la part de l’administration pénitentiaire semble, au contraire, avoir été une constante.
L’articulation entre l’atténuation de la peine et l’obligation de soins effective est aujourd’hui fondamentale pour individualiser et ré-humaniser les peines prononcées.
Par ailleurs, vous suggérez de combiner les mesures visant l’obligation de soins pendant la durée allant de la libération au terme de la peine encourue et les mesures de sûreté réservées aux personnes irresponsables. Ainsi, à leur libération, les personnes dont le discernement a été altéré pourront se voir appliquer l’obligation de soins, avec les conséquences qui en résultent.
L’insuffisance de la prise en charge semble se manifester trop souvent au moment de la sortie de prison. C’est pourquoi la pratique consistant à atténuer la peine des personnes présentant un trouble mental partiel peut être contestée si elle n’apporte aucune solution, notamment par rapport au traitement médical dont ont besoin ces individus.
Avant de conclure mon propos, vous me permettrez, à la suite de Jean-René Lecerf, d’évoquer et de défendre la prison de Château-Thierry, située dans mon département et où s’est rendue en 2009 notre commission des lois, établissement particulièrement concerné par l’accueil de personnes atteintes d’un trouble mental. La qualité de la prise en charge des détenus dans cet établissement est à souligner. Nous devons souhaiter le développement d’une telle prise en charge spécifique dans d’autres établissements de notre territoire. Il convient de donner à l’administration pénitentiaire des moyens pour ce faire.
Mes chers collègues, dans sa grande majorité, le groupe UMP votera cette proposition de loi en demandant au Gouvernement quelles mesures il entend prendre pour concilier les facteurs sociaux et médicaux avec les impératifs judiciaires.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les textes consensuels dans notre assemblée sont suffisamment rares pour être salués : c’est bien l’un d’eux que nous examinons aujourd’hui.
Cette proposition de loi est, en effet, le fruit d’un travail remarquable du Sénat auquel toutes ses composantes ont participé.
Cela a déjà été rappelé, dès l’examen de la loi pénitentiaire, Nicolas About et Jean-Jacques Hyest avaient souligné la nécessité de mettre en place un groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions. Ce groupe de travail, dont la présente proposition de loi reprend les recommandations, a été animé conjointement par la commission des affaires sociales et la commission des lois. L’occasion m’est ici donnée de saluer l’excellent travail de nos collègues Jean-Pierre Michel, Gilbert Barbier, Christiane Demontès et Jean-René Lecerf.
L’article 122-1 du nouveau code pénal a établi une distinction entre l’abolition du discernement et son altération. Dans le premier cas, la personne ayant commis une infraction est déclarée irresponsable ; dans le second cas, elle est pénalement responsable, donc punissable.
Cependant, si le facteur d’altération du discernement n’emporte pas l’irresponsabilité, il implique, dans l’esprit du législateur, une atténuation de la responsabilité pénale. Or tel n’est pas le cas dans la jurisprudence. C’est même le contraire qui s’observe puisque l’altération du discernement conduit parfois, en particulier aux assises, à une aggravation de la peine prononcée. C’est ce qui ressort des travaux conduits par le groupe de travail sénatorial.
Pour remédier à cet état de fait, la principale disposition de la proposition de loi est d’inscrire explicitement dans la loi que la peine privative de liberté est réduite du tiers en cas d’altération du discernement au moment de l’accomplissement de l’infraction, et ce en contrepartie d’un renforcement des obligations de soins pendant et après l’exécution de la peine.
Je veux, à ce stade, faire un commentaire d’importance : la présente proposition de loi ne doit en aucun cas être interprétée comme l’expression d’une défiance du pouvoir législatif à l’égard de l’autorité judiciaire. Cette défiance, la magistrature la ressent aujourd’hui parfois vivement dans une ambiance que certains textes et projets – mesures sur les peines planchers de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPPSI, introduction des jurys populaires en correctionnelle – tendent à entretenir.
Mais ici, rien de tel, car nous avons affaire à un texte équilibré. Il ne réduit pas le pouvoir d’appréciation du juge : une peine encourue de trente ans sera ramenée à vingt ans pour les malades mentaux comme elle l’est à quinze ans pour les mineurs.
Dans la limite de ce plafond, le juge décidera de la durée de la peine la plus appropriée.
Si l’équilibre des pouvoirs n’est donc pas l’enjeu principal de cette proposition de loi, celle-ci en soulève un autre, de non moindre importance.
Le rapport du groupe de travail sur la prise en charge des malades mentaux ayant commis des infractions fait état d’un chiffre plus qu’alarmant, qui a déjà été cité : 10 % des détenus actuels souffrent d’une altération mentale ; et encore, il ne s’agit pas de tous les détenus malades, mais d’une estimation du nombre de ceux qui sont spécifiquement concernés par le texte qui nous occupe, c’est-à-dire les détenus atteints de troubles mentaux tels que, pour eux, la peine n’a aucun sens.
Ce constat revêt une extrême gravité, parce qu’il signifie tout simplement que nous peinons à concrétiser le principe de base sur lequel se fonde tout notre droit pénal, depuis Beccaria jusqu’à Marc Ancel, la summa divisio entre personnes responsables et personnes irresponsables. Pourquoi peinons-nous à le faire ? À l’origine, ce n’est pas une question de droit, mais une question de moyens. Les travaux de la Haute Assemblée l’ont bien montré, les services médico-psychologiques régionaux sont souvent insuffisants et le manque de psychiatres rend difficile la prise en charge des malades mentaux : c’est le problème, que nous connaissons bien, de la démographie médicale, abordé sous l’angle de la justice pénale. La conséquence en est que, faute de pouvoir soigner, on incarcère ! Cette situation n’est pas acceptable ; elle l’est d’autant moins que la justice, elle aussi, manque de moyens. La loi pénitentiaire ne l’a que trop montré !
Nous voici donc dans la configuration de l’aveugle et du paralytique, à la confluence de la justice et de la santé, face à deux administrations qui, faute de moyens opérationnels suffisants, sont contraintes, si vous me permettez cette image, de se « renvoyer la balle ». Pour y remédier on appelle le législateur à la rescousse : hier, avec la loi pénitentiaire ; aujourd’hui, avec la présente proposition de loi ; demain, avec la réforme de l’hospitalisation d’office. Mais, nous le savons bien, l’intervention du législateur a ses limites. En effet, s’il peut toujours légiférer, le législateur ne réglera pas le problème tant que les moyens médicaux manqueront et que le système judiciaire sera tenu de supporter, tant bien que mal et plutôt mal que bien, une charge qui ne devrait pas lui revenir.
C’est sur ce point clef, madame la secrétaire d’État, que le groupe Union centriste tenait à attirer votre attention, avant de s’apprêter à voter la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, de l ’ UMP et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer nos collègues Jean-René Lecerf, Gilbert Barbier et Christiane Demontès, qui ont pris une initiative heureuse en déposant cette proposition de loi, poursuivant le travail de réflexion engagé avec Jean-Pierre Michel sur le problème de la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux.
C’est l’honneur du Parlement de mettre en lumière un dossier difficile, peu médiatique, qui touche quantité de familles françaises. Il est aussi symbolique de noter que les dix-huit lois dont nous avons débattu en matière pénale depuis huit ans ont sciemment jeté un voile sur cette question, à l’exception de la loi du 25 février 2008, qui ne s’est préoccupée, dans ce domaine, que de rendre plus difficile la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux. Je pourrais ainsi résumer cette attitude : « Cachez en prison ces malades que nous ne voulons pas voir ! »
Le législateur de 1810 avait, à l’article 64 du code pénal, reconnu l’irresponsabilité pénale en cas d’état de démence au moment des faits. Ce système était trop manichéen et plusieurs améliorations successives ont permis de faire évoluer l’application de la sanction : avec l’introduction des circonstances atténuantes en 1824 et 1832 ; avec la jurisprudence de la Cour de cassation posant, en 1885, le principe de l’atténuation des peines en cas d’altération du discernement ; avec la circulaire Chaumié de 1905 étendant ce principe aux personnes reconnues responsables de leurs actes tout en présentant un trouble mental.
La notion de démence ne prenant pas en compte l’ensemble des troubles mentaux modifiant le comportement, le législateur, en 1992, a distingué, à l’article 122-1 du nouveau code pénal, l’irresponsabilité découlant de l’abolition du discernement en raison du trouble mental et l’atténuation de la responsabilité en raison de l’existence d’un trouble mental altérant le discernement ou entravant le contrôle des actes.
Nous savons tous que l’application de cet article 122-1, qui a maintenant vingt ans, a posé de nombreux problèmes. Tout d’abord, on relèvera que l’abolition du discernement a été rarement reconnue, pas davantage que la démence. L’analyse de la jurisprudence, confirmée par les auditions des magistrats et des avocats, permet de constater, selon l’excellent rapport de notre collègue Jean-Pierre Michel, que « l’altération du discernement représente souvent un facteur d’aggravation de la peine », en particulier devant les cours d’assises, en raison des inquiétudes compréhensibles du jury. Celui-ci estime le plus souvent que, si la prison ne permet pas de soigner le condamné, la protection de la société prime et justifie de l’incarcérer le plus longtemps possible. Cette confusion de la dangerosité du délinquant et de la responsabilité pénale n’est pas souhaitable ni sur la forme ni sur le fond.
Il faut avoir vécu des audiences de cour d’assises – en présence, de surcroît, des victimes ou des familles de victimes justement éplorées – pour se rendre compte que, plus l’acte commis est grave, plus la notion de personnalisation de la peine s’estompe par rapport au spectre de la récidive. Cette tendance paraît d’autant plus évidente, depuis un quart de siècle, avec le tirage au sort total des jurés sans présélection et, surtout, le développement du discours sécuritaire. Les magistrats français ne sont pas laxistes, loin s’en faut, mais ils doivent souvent freiner des jurés formés par les journaux télévisés à la répression primaire.
À ce niveau du débat et après avoir parcouru attentivement le rapport, notamment les observations incluses de Jean-Pierre Michel et du président Jean-Jacques Hyest rappelant que des personnes sont condamnées à de lourdes peines de prison « afin de protéger la société alors que leur place est en établissement psychiatrique », il est clair que, devant les cours d’assises, les réactions des jurés populaires sont pour beaucoup à l’origine de ces dérives.
Face à un tel constat, n’est-il pas déraisonnable d’avoir le projet d’introduire des jurés populaires devant les tribunaux correctionnels ? Nous aurons certainement l’occasion de reparler de cette question… L’utilisation de la justice et des problèmes de délinquance à des fins médiatiques et électorales n’est jamais opportune ! De la même façon, le rapport note très justement que l’expertise psychiatrique n’est pas obligatoire en matière délictuelle et qu’elle est le plus souvent inexistante dans les toujours plus nombreuses procédures d’urgence.
Prison et troubles mentaux relèvent de deux problématiques différentes auxquelles notre société est confrontée : il y a, d’une part, les troubles mentaux qui ont un rôle dans la commission de l’infraction et/ou dans l’appréciation de la peine et, d’autre part, la prison elle-même comme facteur de déclenchement des troubles mentaux préexistants ou nouveaux – je pense en particulier aux addictions. Malheureusement, l’incarcération est aujourd’hui davantage un moyen de mise à l’écart de la société qu’un moyen de réinsertion et de lutte contre la récidive.
La proposition de loi qui nous est soumise constitue donc un pas positif afin d’améliorer la situation en remédiant à certains errements actuels. La modification de l’article 122-1 du code pénal et la réduction d’un tiers de la peine privative de liberté encourue sont autant de signes à destination des juridictions, qui conserveront néanmoins un large pouvoir d’appréciation. Certes, on peut s’interroger sur le fait que l’altération du discernement n’est pas toujours significative d’une perte de conscience de la gravité du comportement, encore plus lorsqu’elle est la conséquence de conduites addictives. Mais, d’une manière générale, il n’est pas sain que la reconnaissance de l’altération du discernement entraîne l’augmentation de la durée d’emprisonnement.
Enfin, cette proposition de loi conforte l’obligation de soins et sanctionne son refus. Nous y sommes favorables. Ce dernier point nous entraîne vers une autre question fondamentale, au niveau tant de la réalisation des expertises judiciaires que des soins en détention ou du suivi postérieur de l’obligation de soins : la question de la présence du psychiatre. D’où notre inquiétude face à l’insuffisance du nombre de psychiatres, à la désertification de nombre de territoires à ce niveau et à la diminution des lits de psychiatrie. Oui, la France manque globalement de psychiatres et ces derniers ont tendance à se regrouper autour des centres hospitaliers universitaires et dans le sud du pays ! Or nous connaissons le travail considérable accompli par les équipes psychiatriques, en particulier dans les plus petites maisons d’arrêt : il permet de limiter le nombre de suicides et de favoriser les soins et la réinsertion. La création de dix-sept unités d’unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, ne permettra pas de faire face à la diversité des problématiques présentées par tous les détenus. Pas de psychiatres, pas d’expertises, pas de soins, tel est donc l’enjeu des prochaines années !
En conclusion, j’annonce que nous voterons unanimement cette proposition de loi, qui constitue incontestablement un progrès mais en appelle d’autres ; c’est une question tant de sécurité que d’humanité !
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi fait suite au rapport « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? », établi par le groupe de travail commun à la commission des lois et à la commission des affaires sociales. Je tiens d’ailleurs à remercier aujourd’hui notre collègue Nicolas About – dont je salue la remplaçante –, alors président de la commission des affaires sociales, et notre collègue Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils avaient en effet souhaité tous les deux qu’un groupe de travail soit constitué, forts du constat que se trouvent aujourd’hui en prison des personnes à qui l’incarcération ne sert à rien, car elles ont besoin de soins, ce que la prison ne permet pas, ou très rarement.
À l’issue de ses travaux ce groupe de travail avait formulé un certain nombre de propositions d’ordre législatif. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui en reprend certaines.
Si, dans son article 64, le code pénal de 1810 posait le principe d’irresponsabilité pénale du « dément », le nouveau code pénal de 1993 a instauré un distinguo entre abolition et altération du discernement en raison d’un trouble mental. Ainsi, selon l’article 122-1 du nouveau code pénal, dans le premier cas, la personne n’est pas considérée comme « pénalement responsable », alors que, dans le second, elle « demeure punissable ». Il est clair que, dans l’esprit du législateur, l’altération du discernement en raison d’un trouble mental a été pensée comme une cause d’atténuation de la responsabilité. La rédaction de l’article 122-1 du code pénal dispose que, dans ce cas, lorsque la juridiction fixe la durée et les modalités de la peine, la personne punissable bénéficie d’un régime spécifique. Une réduction de peine devrait donc en découler. Or force est de constater, notamment à la lecture des auditions du groupe de travail, que tel n’a pas été le cas.
En effet, nous pouvons observer que, pour les jurys d’assises en particulier, la maladie mentale est bien souvent perçue et gérée comme un facteur de dangerosité supplémentaire qui nécessiterait une détention prolongée. De fait, l’altération du discernement est devenue un facteur d’aggravation de la peine, allongeant la durée d’emprisonnement des personnes atteintes de troubles mentaux.
Contrairement aux idées reçues et bien que les statistiques soient fragmentaires, si le nombre de non-lieux a baissé en valeur absolue, la part de ceux motivés par l’article 122-1 est restée stable, elle représente environ 5 % du total. Il n’est donc pas démontré que l’évolution du cadre juridique ait provoqué une diminution du nombre de reconnaissances d’irresponsabilité pénale. En revanche, de l’avis concordant de magistrats et d’experts, l’altération du discernement, conçue par le législateur comme une cause d’atténuation de la responsabilité, a constitué en pratique, et paradoxalement, un facteur d’aggravation de la peine allongeant la durée d’emprisonnement.
Par ailleurs, selon une enquête épidémiologique menée entre 2003 et 2004, la proportion de personnes atteintes de troubles mentaux les plus graves, pour lesquelles la peine n’a guère de sens, représenterait 10 % de la population pénale – les précédents orateurs l’ont déjà dit. Aujourd’hui, les établissements pénitentiaires connaissent de grandes difficultés pour gérer des situations qui cristallisent les contradictions entre une logique de soins et une logique répressive.
Cette situation ne peut que heurter nos principes humanistes. Elle contrevient à l’éthique médicale car les prisons ne sont pas des lieux de soins. Elle contrevient aux exigences de sécurité et, comme nous l’avons vu précédemment, à l’esprit de la loi et à nos valeurs démocratiques.
Il nous est donc apparu indispensable de rompre avec cette logique pour procéder à la réécriture de l’article L 122-1 du code pénal afin, dans une rédaction plus explicite, de mieux concilier réponse pénale et prise en charge sanitaire.
Ainsi l’article 1er de notre proposition de loi prévoit-il que, dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’une personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement, la peine encourue est réduite du tiers.
La juridiction devra donc, dans cette limite, fixer la durée de la peine, étant entendu que la personne est souffrante et que, plus cet état est important, plus la prise en charge médicale s’avère préférable à une incarcération.
De plus, dans le cas où un sursis avec mise à l’épreuve a été prononcé pour tout ou partie de la peine, sauf avis médical contraire ou décision contraire de la juridiction, cette peine doit être accompagnée d’une obligation de soins telle que prévue par l’alinéa 3 de l’article 132-45 du code pénal.
Quant à l’article 2 de la proposition de loi, il tend à compléter le troisième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, relatif aux réductions de peines, en donnant à la juridiction la liberté de retirer une partie des réductions de peines lorsque la personne refuse les soins qui lui sont proposés.
Cette logique est aussi reprise dans les modifications apportées à l’article 721-1 du code de procédure pénale, relatif aux réductions de peines en cas d’effort sérieux de réadaptation sociale.
La rédaction de l’article 3 de la proposition de loi s’inscrit dans cette même exigence de soins. Ainsi, un nouvel article, relatif aux mesures de sûreté, est introduit dans le code de procédure pénale, laissant la possibilité à la juridiction de prononcer une obligation de soins durant la période comprise entre la date de la libération et le terme de la peine encourue.
Avec ce texte, la loi est désormais précisée. Néanmoins, au-delà, se pose la question des moyens dont se dote notre société pour faire face à ces défis.
À ce titre, notre collègue Jean-Pierre Michel, tout comme d’ailleurs Jean-René Lecerf et l’ensemble du groupe de travail, insiste sur divers points dans son rapport.
Je pense notamment à la prise en charge médicale que nécessitent ces personnes. Elle ne peut se faire que dans le cadre d’un renforcement de l’organisation de la psychiatrie, laquelle doit permettre de garantir le lien entre obtention de réductions de peines et suivi sanitaire via un placement systématique dans des établissements pénitentiaires disposant d’un service médico-psychologique régional. Or ces services doivent être notoirement renforcés en personnels et plus équitablement répartis sur le territoire.
De même, comment ignorer que la justice éprouve les plus grandes difficultés à trouver des experts psychiatres qui apprécient l’abolition ou l’altération du discernement de la personne mise en examen au moment des faits commis et éclairent les juges ?
Demain, mes chers collègues, madame la secrétaire d’État, restera-t-il suffisamment de praticiens pour s’occuper, soit en milieu carcéral, soit en milieu hospitalier, de ceux dont la responsabilité pénale sera modulée en fonction de l’altération ou de l’abolition de leur discernement ?
Nous nous devons d’apporter des réponses. C’est dans cette logique que nous avons notamment proposé, dans notre rapport, d’envisager la construction de services médico-psychologiques régionaux supplémentaires dans les maisons centrales et de choisir les implantations des futurs établissements pénitentiaires en tenant compte de la démographie médicale, notamment en psychiatrie.
Je n’entrerai pas dans le débat que Jean-René Lecerf a introduit sur les objectifs des Unités hospitalières spécialement aménagées et que nous avons déjà eu au sein du groupe de travail – quel public, détenus ou non détenus, et quels troubles doivent-être concernés ? Même s’il est difficile de se prononcer sur ces structures, dont la première n’a été inaugurée que le 18 mai dernier à Lyon, il nous semble important d’établir des statistiques précises sur le profil des détenus accueillis afin de permettre une évaluation régulière de ces unités.
Madame la secrétaire d’État, bien que l’ayant écoutée avec beaucoup d’attention, je n’ai pas bien compris l’argumentation justifiant votre opposition à cette proposition de loi, qui, d’après ce que j’ai cru comprendre, sera votée par l’ensemble de notre assemblée.
J’espère que nous pourrons débattre de la prise en charge des personnes victimes de troubles psychiques à l’occasion de l’examen d’un prochain texte de loi sur la psychiatrie, un texte systématiquement annoncé et sans cesse reporté !
Effectivement, et j’en terminerai sur ce point, nous nous devons d’apporter des réponses médicales à ces détenus souffrant de troubles mentaux. À défaut, le sens même de la peine s’en trouverait perverti, l’objectif de réinsertion abandonné et notre système pénitentiaire mis en cause.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste et de l’UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est avec plaisir que j’interviens aujourd’hui devant vous, au sujet de cette proposition de loi consistant à atténuer la responsabilité pénale des personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits qui leur sont reprochés.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir à quel point les questions pénitentiaires sont au centre de mes préoccupations.
Je me permets de rappeler brièvement que, lors du débat sur la loi pénitentiaire, adoptée le 24 novembre 2009, je n’avais eu de cesse de dénoncer les atteintes graves faites aux droits des personnes détenues, voire, dans certains cas, la négation totale de leurs libertés fondamentales.
Les sénateurs Verts n’avaient d’ailleurs pas voté cette loi, qui semblait assez insatisfaisante, en dépit de tous les amendements adoptés dans ce cadre. Ceux-ci visaient, pour l’essentiel, à renforcer les droits des détenus, à rendre les dispositions du droit français conformes aux exigences communautaires et à reconnaître la dignité de la personne détenue.
J’ai par ailleurs rappelé, à l’occasion du débat sur l’édiction des mesures réglementaires d’application des lois qui s’est tenu voilà deux semaines, que le Gouvernement n’avait encore pris pratiquement aucune des mesures réglementaires prévues par la loi pénitentiaire, ce qui privait finalement cette loi de toute efficacité.
La proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui s’inscrit dans la ligne directrice de la vision progressiste du droit pénitentiaire partagée par les sénateurs d’Europe Écologie.
Il est en effet nécessaire de débattre de la question des détenus atteints de troubles mentaux et de l’atténuation souhaitable de la responsabilité pénale de ceux dont le discernement a pu être altéré, au moment des faits, par ces troubles.
Ce texte a pour point de départ ce constat inquiétant : près de 10 % des détenus souffrent de troubles psychiatriques très graves ! Dès lors la peine privative de liberté, telle qu’elle a été définie dans le cadre de la loi pénitentiaire précitée, ne signifie rien pour ces personnes.
En effet, selon cette loi du 24 novembre 2009, « le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».
Je reviendrai, ici, sur les trois points qui, dans les cas des personnes atteintes de troubles mentaux, ne semblent pas atteindre les objectifs légaux actuels : la sanction du condamné, l’insertion et la réinsertion de la personne détenue, la prévention de la récidive.
S’agissant de la sanction du condamné, nous pouvons légitimement douter qu’une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique lourde ayant altéré son discernement au moment des faits puisse trouver en une peine d’enfermement dans un établissement pénitentiaire traditionnel une sanction adaptée à sa situation.
Ce point est d’ailleurs rappelé dans le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, qui prévoit que les personnes dont le discernement était aboli au moment des faits sont irresponsables pénalement.
S’agissant de l’insertion et de la réinsertion de la personne détenue, cet objectif, inhérent à l’exécution de la peine, nécessite que l’auteur des faits ait pris conscience des motifs justifiant sa condamnation, ce qui est impossible dans le cas des personnes atteintes de troubles mentaux lourds.
S’agissant, enfin, de la prévention de nouvelles infractions et de la lutte contre la récidive, le but semble plus difficile à atteindre quand la personne est malade et que ses pathologies risquent d’empirer en prison, le milieu carcéral n’étant pas un lieu de soins. Si l’on ne peut que saluer les progrès de la prise en charge médicale en prison, des études ont néanmoins montré que la détention carcérale pouvait aggraver les pathologies, voire en susciter.
Au-delà de ces trois raisons, liées à un régime d’exécution de la peine inadapté aux personnes souffrant de troubles psychiatriques, il est important de souligner la situation choquante créée par la mauvaise application du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal.
Cet alinéa traite du cas des personnes dont le discernement n’était qu’altéré lors de la commission de l’infraction. Pour mémoire, le premier alinéa, que j’ai déjà cité, était relatif à l’abolition du discernement au moment des faits, entraînant l’irresponsabilité pénale.
Selon les dispositions de ce deuxième alinéa, les intéressés restent punissables, mais bénéficient d’un régime particulier quant à la fixation par la juridiction de la durée et des modalités de la peine.
Comme M. Jean-Pierre Michel le souligne à juste titre, dans son dernier rapport, cette disposition devrait conduire à une réduction de peine. Or – c’est regrettable – il en va différemment en pratique, la maladie mentale étant, dans la plupart des cas, un facteur aggravant, un « indice de dangerosité supplémentaire » justifiant « une détention prolongée », et ce plus particulièrement pour les jurys d’assises.
Ainsi on s’éloigne de l’esprit du législateur et, dans le même temps, on accroît la présence de personnes atteintes de troubles psychiques et psychiatriques en prison.
À cette occasion d’ailleurs, permettez-moi de m’élever contre votre position, madame la secrétaire d’État, car vous exprimez une nouvelle défiance envers le juge et son pouvoir d’appréciation, et remettez en cause le principe d’individualisation.
Quant à moi, je suis favorable au fait de réduire du tiers la peine privative de liberté encourue et d’encourager les peines alternatives à l’enfermement, notamment le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine assortie de soins, après avis médical.
Dans un seul souci de lutte contre les récidives, il est également souhaitable que le juge de l’application des peines, à la libération d’une personne condamnée dans les circonstances mentionnées dans ce second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, puisse ordonner une obligation de soins.
Je souhaite toutefois apporter une réserve quant aux mesures de sûreté applicables après la libération, telles qu’elles sont prévues à l’article 3 de cette proposition de loi.
Les modifications apportées par cet article entraînent de fait l’application de l’article 706-139 du code de procédure pénal, qui dispose que « la méconnaissance par la personne qui en a fait l’objet des interdictions prévues [par l’article 706-136] est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ».
Cela signifie que les personnes concernées par le deuxième alinéa de l’article 122-1 du code pénal, à savoir celles dont le discernement a été altéré par des troubles mentaux au moment des faits, risquent de retourner en prison après leur libération si elles ne respectent pas les mesures de sûreté imposées par le juge... C’est un cercle sans fin !
J’ai pris bonne note de l’obligation de soins accompagnant ces mesures, mais je me questionne sur le caractère opportun de cette possibilité d’une nouvelle incarcération, qui ne me semble pas être de nature à œuvrer en faveur de la guérison des personnes atteintes de troubles mentaux et de pathologies psychiatriques.
Enfin, je tiens à rappeler le Gouvernement à ses responsabilités et à attirer son attention sur l’effectivité de l’application de ces mesures. Il ne s’agit pas de légiférer à chaque fait divers ! Il est indispensable que tous les moyens soient donnés à la justice pour une efficacité de ces dispositions.
Vous n’êtes pas sans savoir, madame la secrétaire d’État, quelles sont les conditions difficiles dans lesquelles travaillent le personnel pénitentiaire et le personnel soignant. Il est temps que ces services disposent enfin des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation de la lourde tâche qui leur est confiée.
À ce sujet, j’espère que le programme de construction des Unités hospitalières spécialement aménagées sera à la hauteur de ces ambitions et n’aura pas à souffrir d’un retard dans sa mise en place.
L’objectif à venir doit donc être triple : proposer des mesures plus adaptées aux auteurs d’infractions souffrant de troubles psychologiques ; prévenir l’aggravation des troubles mentaux en prison ; améliorer les conditions de travail du personnel pénitentiaire et soignant intervenant en milieu carcéral.
Pour toutes ces raisons, les sénateurs Verts sont favorables à cette proposition de loi, à laquelle ils apportent tout leur soutien !
Je voterai donc ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées de l ’ UMP.
Mme Monique Papon remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Le second membre de phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

Avant toute chose, je tiens à saluer, comme l’ont fait les orateurs précédents, le travail considérable mené conjointement par nos collègues de la commission des lois et de la commission des affaires sociales – MM. Jean-René Lecerf, Jean-Pierre Michel, Gilbert Barbier et Mme Christiane Demontès – sur la prison et les troubles mentaux, ce qui a permis d’élaborer cette proposition de loi.
Le dispositif proposé par nos collègues à l’article 1erest simple : les personnes dont le discernement est atténué au moment des faits doivent pouvoir bénéficier automatiquement d’une réduction de peine d’un tiers. Ils feront en outre l’objet d’un suivi spécifique à leur sortie de prison. Ceux qui refusent l’injonction de soins à la sortie de prison devront purger la totalité de la peine normalement encourue.
Je rappelle qu’on estime à près de 25 % des personnes actuellement incarcérées le nombre de celles qui sont atteintes de troubles mentaux ; c’est considérable.
Comme cela est indiqué dans le rapport d’information, les résultats à ce jour les plus complets ont été établis par l’enquête épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison, qui a été conduite dans les années 2003-2004, à la demande du ministère de la justice et du ministère chargé de la santé.
Cette enquête, qui a été publiée en 2006, a permis de dresser un certain nombre de constats édifiants, qui sont d’ailleurs rappelés dans le rapport sur la proposition de loi.
Ainsi, 35 % à 42 % des détenus sont considérés comme manifestement malades, gravement malades ou parmi les patients les plus malades, selon une échelle d’évaluation de la gravité de l’état de la personne ; 42 % des hommes et la moitié des femmes détenus en métropole présentent des antécédents personnels familiaux d’une gravité manifeste ; 38 % des détenus incarcérés depuis moins de six mois présentent une dépendance aux substances illicites et 30 % d’entre eux une dépendance à l’alcool.
Enfin, un entretien sur cinq a débouché sur une procédure de signalement auprès de l’équipe soignante de l’établissement, en accord avec la personne détenue, sauf en cas d’urgence.
C’est dire combien est important le sujet dont nous débattons aujourd'hui.
Cela étant, je veux aussi rappeler que cette situation est de mieux en mieux appréhendée par les pouvoirs publics et l’administration pénitentiaire.
D’abord, les vingt-six services médicaux psychologiques régionaux, les SMPR, situés dans l’enceinte des maisons d’arrêt ou des centres pénitentiaires suivent les personnes au cours de l’incarcération et préparent la mise en place de leur suivi à la sortie de prison.
Par ailleurs, la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, a permis la création des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, dont Jean-René Lecerf a parlé tout à l'heure. Ces unités ont pour vocation de prendre en charge les personnes condamnées atteintes de troubles mentaux le temps nécessaire à leur stabilisation.
À ce jour, seule l’UHSA lyonnaise du Vinatier est en fonctionnement. La mise en fonctionnement des huit autres structures est prévue pour le deuxième semestre 2012.
Cependant, à mon sens, l’article 1er ne constitue pas une réponse appropriée au problème soulevé.
Le code pénal renvoie au juge l’appréciation de la peine, c’est indiscutable, et vous en avez parlé lors de votre intervention, madame la secrétaire d'État. C’est le principe de l’individualisation de la peine. Il est évident que les juges prennent déjà en compte la situation particulière de chaque personne mise en examen et adaptent en conséquence les peines qu’elles encourent et leurs aménagements.
Vous avez cité un certain nombre d’exemples, je peux en donner d’autres susceptibles de frapper l’imagination.
Ainsi, le kleptomane, qui souffre d’un véritable trouble de la volonté, mais dont la dangerosité pour la société reste quand même limitée, doit pouvoir bénéficier d’une diminution de peine. En revanche, le pédophile, ...

… qui souffre d’un même trouble de la volonté mais qui représente un danger pour la société, sera le plus souvent sanctionné sévèrement.
Dès lors, instaurer un mécanisme automatique et uniformisé reviendrait à rigidifier inutilement le système et risquerait de remettre en cause notre action de lutte contre la récidive.
Il est à craindre que, dans les procès les plus atroces, cette question du trouble mental de l’accusé ne devienne un enjeu primordial de défense. Pour avoir été avocate, je sais qu’on prend vite certains réflexes. De toute évidence, cette question va automatiquement devenir un enjeu primordial de défense. Ceux qui ne le comprennent pas n’ont bien évidemment jamais été avocat et n’ont jamais eu à assurer la défense de qui que ce soit.
Par exemple, dans l’affaire Fofana, bien que l’expertise n’ait pas conclu à l’atténuation de sa responsabilité, celle-ci a été plaidée pour le faire échapper à la peine maximale ; il faut quand même le rappeler.
Dans l’affaire du meurtre d’Anne-Lorraine Schmitt, trois expertises psychiatriques ont été obtenues, la dernière retenant une légère altération.
Il est bon qu’un tel sujet donne lieu à un débat. Mais il est clair selon moi que l’opinion publique ne sera pas favorable à cette réforme et qu’elle ne la comprendra pas. Ainsi que vous l’avez d’ailleurs souligné, madame la secrétaire d'État, je ne pense pas que le recours systématique à la réduction du tiers des peines encourues par les personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits soit la réponse idoine.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Il me semble beaucoup plus important d’aller dans le sens des efforts déjà engagés pour mieux accompagner et soigner ces personnes au cours et à l’issue de leur incarcération. Il y va de notre honneur de favoriser de telles mesures et non d’apporter une réponse systématique.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, mes chers collègues, je ne comptais pas intervenir, par respect envers Mme la secrétaire d'État, mais je ne peux pas, en tant que législateur, et ce de longue date, laisser dire n’importe quoi.
J’étais député lorsqu’a été révisé le code pénal. Relisez les excellents propos tenus à l’époque par le rapporteur au Sénat, Marcel Rudloff, qui était un éminent juriste, propos que le garde des sceaux d’alors avait confirmés : il disait que l’altération entraînait une diminution de la peine ! L’interprétation à l’envers de certaines décisions du Conseil constitutionnel me gêne beaucoup.
Madame Des Esgaulx, pourquoi avons-nous institué la rétention de sûreté et le suivi socio-judiciaire ? Parce que nous avons visé la dangerosité Vous pouvez ne pas être d’accord avec ces dispositions. Mais si on confond dangerosité et responsabilité, il n’y a plus de droit !
M. Jacques Mézard acquiesce.

C’est tout le sens de la démarche du groupe de travail et de ses conclusions. Bien sûr, prévoir une réduction de la peine d’un tiers, ce n’est pas forcément l’idéal, mais c’est envoyer un signal : Attention ! Vous ne pouvez pas condamner quelqu’un dont l’altération des facultés mentales est prouvée à une peine plus lourde que celui qui est en pleine possession de ses facultés.
Ma chère collègue, je veux bien vous suivre en ce qui concerne le pyromane ou le kleptomane. Cela étant, l’acte de pyromanie peut entraîner des morts. Mais le pédophile, lui, va être condamné plus sévèrement parce que la pédophilie ne procède pas d’une altération des facultés mentales.

Ne mélangeons pas les choses !
Il y a des gens qui tuent parce qu’ils sont schizophrènes, mais cela ne veut pas dire qu’ils se rendent compte de leurs actes et qu’ils en sont responsables. Faut-il les garder en prison indéfiniment ou les placer dans des établissements spécialisés ? Tel est le problème qui se pose.
La difficulté actuelle, madame la secrétaire d'État, vous le savez bien et vous l’avez également soulignée, c’est de trouver d’autres solutions que la prison pour ces gens qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres mais pour qui la prison n’a pas de sens puisqu’ils ne sont pas conscients de leurs actes. Il faut développer des expériences comme celles qui ont été menées dans bien d’autres pays tels que l’Allemagne ou les Pays-Bas, où nous nous sommes rendus.
Au demeurant, pour être tout à fait honnête et objectif, il faut dire aussi que nous avons prévu l’application de mesures de sûreté pour les cas où il y a altération des facultés mentales.
Le dispositif proposé par la commission est par conséquent équilibré, puisqu’il prend la mesure de la responsabilité en cas d’altération des facultés, et, en même temps, propose des dispositions pour éviter que la société ne soit en danger.
Pour avoir visité, comme Jean-René Lecerf, de nombreux établissements pénitentiaires, je vous assure qu’il faut trouver des solutions de remplacement ; certes le processus est engagé, mais il faut aller beaucoup plus loin pour éviter de faire de nos prisons de grands hôpitaux psychiatriques qui n’auraient pas les moyens de l’être.
Applaudissements

Je vous remercie, madame la présidente, de me donner la parole sur cet article 1er, ce qui va me permettre de répondre à l’argumentation développée par Mme la secrétaire d'État sur deux points.
Premier point, le code pénal de 1810 était très manichéen : soit on était responsable totalement, soit on n’était pas responsable du tout.
On s’est rendu compte très vite que la réalité était rarement blanche ou noire, qu’il lui arrivait plus souvent d’être grise. En 1905 est ainsi diffusée la circulaire Chaumié, qui posait en quelque sorte le principe « demi-fou, demi-peine ».
Aujourd'hui, avec l’augmentation de la responsabilité des malades mentaux dont le discernement a été altéré, on est passé en fait au principe « demi-fou, double peine ». Je ne suis pas sûr que la démocratie y ait beaucoup gagné.
J’en viens au second point.
Je comprends parfaitement, madame la secrétaire d'État, le souci qui est le vôtre d’assurer la sécurité de nos concitoyens. C’est un souci unanimement partagé dans cet hémicycle
M. le président de la commission acquiesce

Imaginons trois cas différents.
Le premier concerne une personne dont le discernement a été altéré. Dans ce cas, vous le savez très bien, le quantum de la peine n’a aucun lien avec la pathologie, ce qui signifie que, si la personne était dangereuse en entrant en prison, elle le sera autant, si ce n’est davantage, lorsqu’elle en sortira.
Dans un deuxième cas, la personne a été déclarée irresponsable ; très rapidement, il n’y a plus aucune mesure de protection de la société, d’où les propositions qui ont été faites, en dehors même du groupe de travail, pour trouver des solutions permettant d’accueillir de telles personnes dans des établissements spécialisés.
Enfin, il y a le cas de la personne qui souffrait déjà de troubles mentaux lourds avant même qu’elle ne commette une infraction. C’est la situation des « pousseurs » du métro ou du RER, celle des personnes qui, un jour, frappent à la porte du domicile où elles habitaient quelques années auparavant et qui poignardent la personne qui leur ouvre, alors qu’elles ne l’ont jamais rencontrée. Il y a également une réflexion à mener pour assurer la protection de la société dans ce type de situation.
Madame la secrétaire d'État, je crois qu’actuellement, en matière de protection de la société, notre système dans son ensemble n’apporte pas de réponses satisfaisantes.
Avec de nombreux collègues, J’ai visité, en Belgique, des établissements dits de défense sociale. Je ne suis pas favorable aux systèmes de défense sociale mais je reconnais qu’ils ont leur légitimité et qu’ils emportent en partie ma conviction dès lors que se trouvent ainsi placés dans des établissements hospitaliers fermés les différents types de personnes dont j’ai parlé.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.

L'amendement n° 1, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
du tiers
par les mots :
de moitié
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Ma position est exactement inverse de celle de Mme Des Esgaulx. Les avocats défendent toujours l’atténuation de la responsabilité, mais ce ne sont pas les avocats qui jugent : ce sont les juges, les psychiatres et, en l’occurrence, les jurés.
J’aurais souhaité que la peine soit réduite de la moitié plutôt que du tiers, dans un souci d’analogie avec ce qui est prévu pour les mineurs. Je sais que vous n’êtes pas d’accord, mais il faut tout de même tirer de vraies conséquences du discernement altéré de l’auteur des faits.

Bien sûr, le code pénal prévoit au moins deux situations dans lesquelles la peine encourue est réduite de moitié. La première tient à l’excuse de minorité, entre treize et seize ans, et je ne sache pas que, dans ce cas, la liberté du juge ne soit pas respectée : ce que vous dites, madame la secrétaire d'État, est donc inexact. La seconde concerne les repentis.
Nous aurions donc pu vous suivre, madame Borvo Cohen-Seat, sur la réduction de moitié, mais les auteurs de la proposition de loi ont estimé que, compte tenu de certains arguments, ceux qu’a développés Mme Des Esgaulx, un tiers était suffisant eu égard aux mesures d’obligation de soins.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit précédemment quant au principe même de la réduction des peines : le Gouvernement y est hostile et considère qu’il convient de laisser au juge le soin d’apprécier la durée de la peine qui doit être prononcée au regard des circonstances de l’espèce. J’émets donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 2, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
est assortie
par les mots :
peut être assortie
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Le fait que le sursis avec mise à l'épreuve soit automatiquement assorti d'une obligation de soins n’est pas conforme à l’individualisation des peines, à laquelle certains se disent très attachés tout en se déclarant favorables aux peines planchers…
Avec cet amendement, je propose de supprimer cette automaticité.

Je suggère à Mme Borvo Cohen-Seat de retirer son amendement, qui est, à mon avis, satisfait par le texte tel qu’il a été adopté en commission des lois.
En effet, j’ai présenté en commission un amendement qui supprime de fait cette automaticité puisqu’il prévoit la nécessité de recueillir un avis médical préalable, comme cela me l’avait été d’ailleurs suggéré par la Chancellerie.

L'amendement n° 2 est retiré.
L'amendement n° 3, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Dernière phrase
Après le mot :
assortie
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
des obligations visées aux articles 131-36-1 et 131-36-12
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le non-respect de ces obligations peut entraîner, après expertise médicale et psychologique, sauf décision contraire de la juridiction, l'application du 3° de l'article 132-45.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Avant d'imposer à la personne condamnée une injonction de soins, dont l'efficacité est souvent contestée, il serait préférable de mettre avant tout en place un suivi socio-judiciaire.

Cet amendement introduit une confusion entre le sursis avec mise à l’épreuve et le suivi socio-judiciaire ; or ces deux mesures sont tout à fait distinctes et ne peuvent donc être associées. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
(nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, après les mots : « des dispositions » sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article 122-1 et ». –
Adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »

L'amendement n° 4, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Dans la logique de ma démarche, je demande la suppression de cet article puisqu’il place, pour diverses obligations, des personnes dont l’altération de la responsabilité a été reconnue sous le régime du droit commun : ces dispositions tendent en réalité à les faire inexorablement retourner en prison. Or je considère qu’il doit y avoir une autre solution que la prison.
Néanmoins, je retire cet amendement.
Cela étant, je tiens à le dire, il est inadmissible que l’on ne m’ait pas expliqué la raison pour laquelle la commission des finances a jugé mon amendement n° 5 irrecevable, alors que, sur la proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir, qui sera examinée ce soir, elle a accepté un amendement strictement équivalent au regard des deniers de l’État.
Il est dommage que Marie-Hélène Des Esgaulx, qui est membre de la commission des finances, ne soit plus là : elle aurait pu m’apporter des explications...
Je le répète, cette méthode de travail est absolument intolérable pour les parlementaires. Je suis mise dans l’impossibilité de défendre mon amendement et je ne recevrai évidemment aucune réponse à son sujet, d’autant que le président de la commission des finances, qui a tout de même dû entendre parler de cette affaire, n’a pas jugé bon de venir aujourd’hui en séance ; j’aurais pourtant bien aimé qu’il m’explique les raisons de cette différence d’appréciation entre deux amendements parfaitement symétriques.
Ce n’est pas la première fois que cela se produit, mais on continue comme si de rien n’était ! Or, avec cette manière de procéder, le Parlement – ici, l’exécutif n’est pas en cause – n’est pas responsable de son propre travail, ce qui est proprement inconcevable.
L'article 2 est adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A
« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du discernement » ;
1° Après l’article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :
« Art. 706 -136 -1. – Le juge de l’application des peines peut ordonner, à la libération d’une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l’article 706-136 pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l’article 706-136 sont applicables. »
2° À la première phrase de l’article 706-137, les mots : « d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d’une mesure prononcée en application de l’article 706-136 ou de l’article 706-136-1 » ;
3° À l’article 706-139, la référence : « l’article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 » –
Adopté.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.

Mme la présidente. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
Applaudissements

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : Mmes Muguette Dini, Marie-Thérèse Hermange, M. Paul Blanc, Mme Catherine Deroche, MM. Jean-Pierre Godefroy, Ronan Kerdraon, François Autain.
Suppléants : M. Gilbert Barbier, Mme Brigitte Bout, MM. Guy Fischer, Marc Laménie, Jacky Le Menn, Jean-Louis Lorrain, Mme Patricia Schillinger.

J’informe le Sénat que les questions orales n° 1176 de M. Alain Milon et n° 1178 de M. Ambroise Dupont pourraient être inscrites à l’ordre du jour de la séance du mardi 15 février 2011.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux jusqu’à dix-sept heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur l’utilisation du « Flashball » et du « Taser » – ces termes ne sont pas des noms communs, je le précise, mais correspondent à des marques déposées – par les forces de police.
L’auteur de la question et le ministre, pour sa réponse, disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe politique.
Comme les fois précédentes, ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sera rediffusé ce soir sur France 3, après l’émission Ce soir (ou jamais !), de Frédéric Taddéï.
Je demande instamment à chacun des orateurs de respecter son temps de parole.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les violences à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique sont malheureusement fréquentes. Les policiers municipaux, au même titre que les policiers nationaux et les gendarmes, sont devenus des cibles privilégiées pour des délinquants de plus en plus violents.
Dans ce contexte, un certain nombre de maires ont souhaité doter les policiers municipaux de leur commune de moyens de force intermédiaire, notamment de pistolets à impulsion électrique, de manière qu’ils soient mieux protégés.
Si une telle décision est bien compréhensible, certains s’en sont toutefois inquiétés. Les moyens de force intermédiaire, pour utiles qu’ils soient, n’en restent pas moins des armes dont l’usage doit être très encadré et subordonné à une formation spécifique.
Afin de prendre en compte les observations qui avaient été formulées par le Conseil d’État en 2009, l’armement des agents de police municipale a fait l’objet d’un nouveau décret, en date du 26 mai 2010.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser comment les agents de police municipale sont formés à l’utilisation des moyens de force intermédiaire et dans quelles conditions ces derniers sont employés ?
Madame Payet, l’équipement des polices municipales en pistolets à impulsion électrique et en Flashballs est conforme aux principes généraux de l’armement de la police municipale.
Celui-ci, premièrement, est facultatif en ce sens qu’il est à la diligence du maire.
Deuxièmement, il est conditionné à la conclusion d’une convention de coordination entre le maire et l’État.
Troisièmement, il est fonction de la dangerosité des missions confiées à la police municipale.
L’usage des pistolets à impulsion électrique est évidemment entouré de très fortes garanties.
Tout d’abord, une formation préalable est délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. S’y ajoute une formation d’entraînement qui a lieu deux fois par an.
Ensuite, un système de contrôle permet à la fois d’assurer la traçabilité de chaque arme et d’en vérifier l’utilisation puisqu’un système d’enregistrement sonore et une caméra sont associés au viseur.
En outre, un rapport doit être remis au maire après chaque utilisation et, chaque année, le maire transmet lui-même un rapport au préfet et au procureur de la République.
Enfin, les conditions d’usage sont identiques à celles qui sont prévues pour la police et la gendarmerie nationales.
Afin d’être le plus complet possible, je précise que, à ce jour, dix-sept communes ont équipé leur police municipale de ces armes.

Je remercie simplement M. le ministre de ses réponses extrêmement précises.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à ce jour, dans le monde, l’utilisation du Taser par les forces de police des pays qui l’ont autorisée aurait provoqué la mort de centaines de personnes.
En France, plusieurs personnes ont récemment trouvé la mort dans des circonstances faisant apparaître la responsabilité présumée de cette arme, le dernier cas de décès remontant au 30 novembre dernier.
Aujourd’hui encore, les effets du pistolet à impulsion électrique sur la santé ne sont pas réellement connus. Supposé, selon son fabricant, ne causer aucun risque mortel, le Taser se banalise de plus en plus et reste employé dans des situations qui ne nécessitent pas toujours son usage.
En réalité, cette arme, qui inflige des souffrances importantes, est utilisée comme un moyen de neutralisation, de rétorsion ou d’intimidation sur des personnes ne présentant pas forcément un danger immédiat. De nombreuses forces de police aux États-Unis utilisent régulièrement les pistolets électriques comme un moyen de contrainte pour maîtriser des personnes récalcitrantes ou perturbées et qui, pourtant, ne créent aucun trouble sérieux.
Faut-il rappeler que, dans un rapport du 23 novembre 2007 sur le Portugal, le Comité contre la torture de l’ONU a condamné l’usage et l’équipement des forces de police en Tasers ? Le Comité s’inquiétait non seulement de la douleur aiguë engendrée par ces armes, douleur constituant une « forme de torture », mais aussi du fait que l’utilisation du pistolet électrique peut causer la mort. En effet, dans bien des cas, le choc émotionnel consécutif à la douleur causée par ces armes peut entraîner un arrêt cardiaque et donc provoquer la mort.
Compte tenu des questions soulevées par le développement de ces armes à neutralisation et des cas de décès répertoriés par des études fiables, aujourd’hui, nos concitoyens ne comprennent plus que l’on généralise leur emploi sans que le Gouvernement prenne davantage en compte leur dangerosité.
Sans même évoquer les risques de bavure, toujours bien réels, le Taser suscite encore de trop nombreuses interrogations. Dans ces conditions, pourquoi ne pas faire le choix de la prudence – un choix qui, en l’occurrence, peut sauver des vies humaines – en suspendant l’usage de cette arme ?
Monsieur Fortassin, puisque vous aurez la possibilité de vous exprimer à nouveau après moi, permettez-moi de vous interroger à mon tour. J’ai bien compris que vous étiez réservé quant à l’utilisation de telles armes, mais je n’ai pas saisi quelle autre solution vous proposiez. En réalité, le choix est assez simple et se situe finalement entre les armes à létalité réduite et les armes létales. Quelle est, selon vous, l’autre possibilité ?
Je vous rappelle que l’utilisation de ces armes n’est possible qu’en état de légitime défense.
Quel a été l’emploi des moyens de force intermédiaire en 2010 ? Les 3 408 Flashballs qui équipent les unités de police et de gendarmerie les plus exposées ont été utilisés à 1 481 reprises, ce qui est d’ailleurs moins important que l’année précédente, puisqu’on a dénombré 1 600 utilisations en 2009.
Concernant les lanceurs de balles de défense – il s’agit de modèles permettant de tirer à plus longue distance –, 3 166 pièces ont été utilisées à 491 reprises, chiffre cette fois plus élevé qu’en 2009.
S’agissant du pistolet à impulsion électrique, plus connu dans l’opinion publique sous le nom de Taser, il équipe les unités de police et de gendarmerie les plus exposées à hauteur de 4 051 pièces, qui ont été utilisées à 815 reprises en 2010, une donnée là encore moins importante que celle de l’année précédente puisqu’il y a eu 907 utilisations en 2009.
En outre, monsieur le sénateur, et je tiens à le préciser parce qu’un tel chiffre répond très exactement à votre question, ces armes ont été utilisées à 12 000 reprises depuis 2006. Lors de ces 12 000 utilisations, vous avez raison, des accidents sont survenus, y compris des accidents graves, mais leur nombre a été limité à vingt-deux. Ce sont certes vingt-deux cas de trop, je m’empresse de le dire, mais, rapportés au nombre total d’utilisations, ils ne représentent qu’une proportion de 0, 2 %.

Monsieur le ministre, lorsque des décès sont causés par l’utilisation d’armes traditionnelles, on considère que c’est une bavure et cela crée incontestablement une émotion profonde dans l’opinion publique. Lorsque c’est l’usage de Flashball ou de Taser qui est en cause, on a l’impression que c’est moins grave… Or ces armes ont tout de même entraîné la mort de vingt-deux personnes : ce n’est pas rien !
Monsieur le ministre, il existe bien une troisième solution pour dissuader des individus de se montrer par trop agressifs, pour les immobiliser ou les repousser, et on y a recours depuis fort longtemps : les canons à eau. Sachant qu’un gros orage disperse les manifestants, utilisez donc des Canadairs. Ce sera tout de même beaucoup moins dangereux ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France, comme d’ailleurs la plupart de ses partenaires européens, a fait le choix d’équiper ses forces de l’ordre en moyens de force intermédiaire, Flashball ou lanceur de balles de défense de 40 millimètres et pistolets à impulsion électrique.
L’emploi de ces moyens est évidemment encadré et demeure subordonné aux exigences de nécessité et de proportionnalité.
Malheureusement, des affaires récentes mettant en cause notamment le Flashball ont pu légitimement émouvoir nos concitoyens, lesquels s’interrogent sur les règles qui encadrent l’emploi de ces équipements.
Monsieur le ministre, même si vous nous avez déjà apporté certaines informations en répondant à notre collègue Mme Payet, pouvez-vous nous préciser le cadre législatif et réglementaire dans lequel les policiers et les gendarmes doivent inscrire leur action lorsqu’ils utilisent les moyens de force intermédiaire mis à leur disposition ?
Par ailleurs, pouvez-vous détailler les procédures de contrôle mises en œuvre lorsque des problèmes surviennent et indiquer notamment si des contrôles a posteriori sont réalisés sur les conditions d’usage de ces équipements ?
Monsieur Lefèvre, votre question porte en fait sur l’encadrement juridique de l’usage des moyens de force intermédiaire et sur l’évolution d’un tel usage, car il faut évidemment tenir compte des retours d’expérience.
Bien entendu, l’utilisation de telles armes s’inscrit dans un cadre légal, au travers des exigences du code pénal et du code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne la définition de la légitime défense et de l’état de nécessité.
Il existe, pour l’emploi de chaque moyen de force intermédiaire, qu’il s’agisse du Flashball ou des pistolets à impulsion électrique, une instruction qui rappelle les dispositions juridiques relatives à ces armes.
Ces instructions, je tiens à le souligner, sont régulièrement mises à jour, pour tenir compte à la fois de l’expérience et de l’évolution des connaissances médicales ainsi que des données techniques et scientifiques. Elles ont d’ailleurs été réactualisées en 2009 pour la police et au cours de l’année 2010 pour la gendarmerie.
Je le rappelle, les policiers et les gendarmes sont tenus de rendre compte de l’utilisation de ces armes.
J’ajoute que l’arme est munie d’une puce qui enregistre tous les paramètres de tir, c’est-à-dire la date, l’heure, la durée de l’impulsion électrique. Surtout, le viseur est désormais doté d’une caméra qui filme l’intervention. Par conséquent, toutes les précautions sont prises pour que la traçabilité de chaque utilisation soit totale, précisément afin d’éviter les litiges.
D’ailleurs, à ce jour, aucun décès n’a été judiciairement imputé à l’utilisation de telles armes en France.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse.
Sans doute un effort doit-il être fourni pour communiquer davantage sur la réglementation relative à l’usage de ce type d’armes.

Monsieur le ministre, il n’est pas question ici de revenir sur le principe d’un certain armement des forces de l’ordre : il importe en effet qu’elles aient les moyens de se protéger et de prévenir les accidents dont pourraient être victimes les personnes présentes sur la voie publique.
Toutefois, avant même les drames récents, plusieurs associations ont dénoncé le Flashball et le Taser comme des armes pouvant entraîner la mort, bien qu’elles soient définies comme non létales, et le Comité de l’Organisation des Nations unies contre la torture a qualifié l’utilisation du Taser de « traitement inhumain et dégradant », équivalant à une « forme de torture ».
Si l’on parle d’armes « à létalité atténuée », celles-ci n’en demeurent pas moins létales et nous devons donc les considérer comme telles.
Le Taser se range aujourd’hui parmi les armes de quatrième catégorie.
Il a par ailleurs été démontré que l’utilisation du Flashball était extrêmement imprécise du fait du risque de déviation des balles, même pour un tireur expérimenté.
Il est donc urgent d’agir pour rétablir la vérité sur ces armes et afin d’éviter au maximum les accidents.
Certes, l’arme idéale n’existe pas, mais l’État n’en a pas moins fait l’erreur de considérer Taser et Flashball comme des armes non létales. Il faut réparer cette erreur, et le faire rapidement. Je souhaiterais, monsieur le ministre, connaître vos intentions sur ce point.
Quant aux polices municipales, elles n’ont pas les mêmes missions que la police nationale : elles doivent rester des polices de proximité et leurs agents demeurer des agents de tranquillité publique. Il est urgent de légiférer sur la question pour que cessent les confusions entre police nationale et polices municipales, qui n’ont pas et ne doivent pas avoir les mêmes prérogatives.
Aujourd'hui, il y a autant de situations que de conventions signées entre l’État et les communes. Avec une meilleure répartition des compétences, et donc la disparition des confusions, les rôles respectifs de la police nationale et des polices municipales seront mieux définis.
Sur les 18 000 policiers municipaux, 8 500 sont armés d’armes de la quatrième à la septième catégorie et il n’y a encore jamais eu d’accident.
Comptez-vous, monsieur le ministre, uniformiser les textes applicables en la matière ?
Je pense très sincèrement, je l’ai déjà dit, que le recours aux moyens de force intermédiaire est – en tout cas aujourd’hui, car cela évoluera peut-être – la seule alternative à l’usage de l’arme en feu en situation de légitime défense, ce qui signifie que la suppression de ces armes à létalité réduite que sont le Taser et le Flashball aurait pour conséquence l’utilisation de l’arme à feu.
On ne peut pas ignorer – ce que vous ne faites d’ailleurs absolument pas dans votre question, monsieur Gautier – que 19 policiers et gendarmes sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions et que 12 870 policiers, dont 300 officiers et 30 commissaires de police, ont été blessés au cours de l’année 2010. Ces chiffres élevés soulignent, même s’ils sont aussi imputables à des accidents, qu’il s’agit d’un corps confronté à des situations particulières.
En 2010, il y a eu très exactement cinq affaires en France qui ont donné lieu à des enquêtes judiciaires ou administratives. Ces affaires étant en cours, je ne peux évidemment pas présager de leurs conclusions, mais, s’il y a faute, c'est-à-dire non-respect du principe de légitime défense, des sanctions seront naturellement prises. Pour être respectées, de toute évidence, les forces de l’ordre doivent être irréprochables.
À cet égard, j’insiste sur le fait que les forces de sécurité font certainement partie des services administratifs les plus contrôlés dans notre pays, ce qui est d’ailleurs parfaitement normal compte tenu des responsabilités qui sont les leurs. Ainsi, en 2010, 2 698 policiers et un peu plus de 3 000 gendarmes ont été sanctionnés pour non-respect de leurs obligations. C’est assez dire que les membres des forces de l’ordre ne sont pas à l’abri de toute punition.
Vous avez évoqué, monsieur Gautier, plusieurs associations ainsi que les Nations unies, et nous sommes nous-mêmes en discussion avec des ONG – notamment avec la représentante française d’Amnesty international – de manière à pouvoir prendre en compte, éventuellement, un certain nombre de leurs remarques.
S’agissant par ailleurs de vos questions relatives aux polices municipales, je crois y avoir déjà à peu près répondu précédemment.

Monsieur le ministre, c’est justement sur les polices municipales que mes préoccupations sont centrées et je note que vous n’êtes pas revenu sur la question clairement posée : envisagez-vous une clarification des missions des polices municipales par rapport à celles de la police nationale ?
La confusion qui est entretenue fait en effet courir des risques aux agents municipaux, car les agents des polices municipales sont souvent pris pour des policiers comme les autres, c'est-à-dire en fait des membres de la police d’État.
Je crains, de surcroît, que votre programme de diminution constante des effectifs de l’État, qui se trouve compensée sur le terrain par des recrutements en nombre à peu près équivalent dans les polices locales, ne conduise à un transfert de compétence de fait alors que tous les transferts de compétences opérés dans notre République l’ont été par la loi.

Monsieur le ministre, j’ai déjà interpellé à plusieurs reprises les ministres de l’intérieur successifs – et, me semble-t-il, notamment vous-même – sur la dangerosité du Taser X26 et du Flashball.
Chaque fois, j’ai obtenu la même réponse, celle que vous nous apportez cet après-midi encore : toutes les garanties existent, d’abord du point de vue de la formation, ensuite du fait que l’utilisation est limitée à certaines circonstances, principalement la légitime défense.
En outre, nous disait-on, s’il y avait eu des morts dues au Taser aux États-Unis, il ne pouvait pas y en avoir en France parce que les impulsions électriques utilisées chez nous étaient moins fortes. Or on compte aujourd’hui deux morts, l’un à Colombes, l’autre à Marseille.
Quant au Flashball, il a fait tout récemment un blessé très grave à Montreuil.
J’avais prévu, monsieur le ministre, de vous demander qui utilisait ces armes, comment et dans quelles circonstances, mais vous avez déjà en partie répondu à ces questions et je vais vous en poser deux autres.
D’abord, n’estimez-vous pas qu’il est indispensable, conformément à ce que préconise la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans un rapport, d’empêcher l’utilisation du Flashball dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre lors des manifestations sur la voie publique ?
Ensuite, quelle évaluation faites-vous de la dangerosité de ces armes ?
Peut-être le Taser est-il utilisé de façon moins dangereuse en France qu’aux États-Unis et peut-il être considéré, dans notre pays, comme une arme non létale lorsqu’il est employé à l’encontre de personnes qui se portent parfaitement. Mais cela reste-t-il vrai lorsqu’il est utilisé contre des personnes fragiles, et notamment contre celles qui souffrent d’insuffisance cardiaque, ce qui n’est pas écrit sur leur figure ? Il serait bon de savoir dans quels cas une décharge électrique peut être mortelle.
Madame Borvo Cohen-Seat, des enquêtes, vous le savez, sont en cours sur les décès qui se sont produits à Marseille et à Colombes et je ne peux donc pas me prononcer sur ce qui s’est réellement produit. Cependant, au terme de la procédure judiciaire, nous tirerons, le cas échéant, les leçons qui devront être tirées.
Vous m’avez interrogé sur l’utilisation de ce type d’armes à l’occasion des manifestations, et vous pensez sans doute à des manifestations comme celles qui se sont déroulées au cours de l’automne. Je vous précise que le pistolet à impulsion électrique ne doit pas être utilisé au cours de ces manifestations, sauf, naturellement, en situation de légitime défense.
Il est cependant indéniable que les policiers et les gendarmes sont de plus en plus souvent confrontés à de graves agressions qui visent à les blesser, voire à les tuer. Or mon devoir de ministre de l’intérieur est de faire en sorte que les forces de sécurité soient protégées : je ne serais pas dans mon rôle si je n’avais la préoccupation constante de garantir la protection de ceux qui ont la responsabilité d’assurer la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. J’observe que les voyous n’hésitent pas à tendre des guets-apens et parfois même à utiliser des armes de guerre.
Hors ces cas extrêmes, les forces de l’ordre sont souvent confrontées à des personnes en état de démence temporaire ; dans 54 % des cas, l’utilisation du pistolet à impulsion électrique est liée à la nécessité de réduire l’agressivité et la résistance de ces personnes, souvent sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.
En outre, je rappelle que le taux d’interpellation, une donnée qui n’est tout de même pas indifférente, est de 97 % après usage d’un pistolet à impulsion électrique.

Monsieur le ministre, que la police doive être en mesure d’exercer ses missions, personne ne le conteste.
Je constate néanmoins que le syndicat national des policiers municipaux demande un moratoire sur l’utilisation du Taser par les policiers municipaux. Ainsi, au sein même des forces de police, d’aucuns se posent des questions sur l’utilisation de ces armes en l’état actuel de nos connaissances quant à leur dangerosité.
J’observe également que, du fait de l’évolution de notre législation, de plus en plus d’opérations relatives à l’ordre et à la sécurité publique seront déléguées à des services de sécurité privés. Allons-nous, monsieur le ministre, autoriser les polices privées à se doter de ces armes de quatrième catégorie ?
Il s’agit d’un point d’autant plus préoccupant que le fabricant du Taser conduit, vous le savez, une campagne de publicité à peine déguisée, accessible très facilement, pour que tout un chacun se dote de ces armes en principe non létales.

Vous l’avez dit, monsieur le ministre, le Flashball et les pistolets à impulsion électrique constituent une alternative à l’usage des armes à feu par les forces de sécurité, mais ces équipements n’en demeurent pas moins des armes et peuvent être dangereux.
Toutes les mesures doivent être prises pour que leur utilisation se fasse dans le respect des règles de sécurité inhérentes à leur emploi et pour éviter, dans la mesure du possible, que ne se produisent des cas de blessures corporelles graves, comme ceux dont la presse et certains de mes collègues ont pu se faire l’écho. Je sais que vous y êtes attentif.
Monsieur le ministre, je veux vous interroger sur la formation des agents pouvant être équipés de ces moyens de force intermédiaire. Vous avez déjà en partie répondu à la question. Je souhaiterais cependant savoir s’il y a une obligation de formation continue, et non pas seulement une formation avant usage de ces équipements.
Au-delà de la simple maîtrise juridique et technique de l’emploi de ces moyens, des mises en situation sont-elles prévues dans les formations pour montrer aux forces de sécurité comment réagir et dans quels cas utiliser ces armes ?
Enfin, je voudrais en savoir un peu plus sur les ventes sur Internet et par correspondance.
Je suis allée sur la Toile : sur un site, le Taser était quasiment en vente libre pour toute personne majeure ; et pour acquérir un Flashball, étaient simplement exigés un certificat médical ou un permis de chasse et une pièce d’identité.

Mme Catherine Procaccia. J’avoue que je n’ai pas poussé la « conscience professionnelle » jusqu’à commander une de ces armes pour l’apporter en séance cet après-midi
Sourires.

En effet, j’estime que l’usage de ces armes par les particuliers est beaucoup plus dangereux que leur emploi par les forces de police.
Monsieur le président, m’est-il possible de revenir sur une question qui m’a été posée antérieurement ? M. Charles Gautier et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ont en effet soulevé des points qui méritent des éclaircissements.

C’est possible, monsieur le ministre, mais à condition que vous répondiez également à la très importante question de Mme Procaccia.
Je me tourne donc tout d'abord vers Mme Procaccia pour lui indiquer qu’un dispositif de formation initiale obligatoire est prévu pour tous les personnels susceptibles d’utiliser ces équipements, qu’il s’agisse des pistolets à impulsion électrique ou des Flashballs et autres lanceurs de balles de défense.
Cette formation doit être validée par une habilitation qui, naturellement, est individuelle et non pas collective. Celle-ci vérifie la fois le discernement, le sang-froid et la maîtrise des équipements, sur le plan tant technique que juridique, qu’ont acquis les personnels.
Vous m’interrogez sur le volet continu de cette formation. Le maintien de l’habilitation est précisément conditionné par le suivi d’une formation individuelle annuelle. Si cette obligation n’est pas respectée, bien entendu, des mesures sont prises.
Par ailleurs, vous vous souciez de ce qu’il en est s’agissant des ventes sur Internet. Vous avez eu raison d’attirer mon attention sur ce problème, qui m’a déjà été signalé. Je vous précise donc que ces armes ne sont en vente libre nulle part, et donc en aucun cas sur Internet. Si vous avez connaissance de cas précis, je vous remercie de nous les signaler et nous ne manquerons pas d’en saisir le parquet.
Puisque je dispose encore de quelques secondes, je précise à M. Charles Gautier que, en ce qui concerne les polices municipales, un décret adopté en mai 2010 aligne le dispositif de formation à l’usage de ces équipements sur celui qui existe pour la police et la gendarmerie nationales.
Je souhaitais également répondre à Mme Borvo Cohen-Seat, mais ne me souviens plus de la question qu’elle a posée… Bien sûr, j’y répondrai dès que la mémoire me reviendra…
En tout cas, mesdames, messieurs les sénateurs, si vous souhaitez observer par vous-mêmes les formations qui sont dispensées pour l’utilisation des armes de ce type, vous êtes les bienvenus. Nous organiserons avec grand plaisir la visite de ces centres de formation.

Monsieur le ministre, pour ma part, je vous invite, ainsi que les membres de votre cabinet, à aller sur Internet et à taper « Taser » ou « Flashball » sur un moteur de recherche.
Je vous assure que j’ai failli commander une arme de ce type pour voir jusqu’où je pouvais aller dans cette démarche sans rencontrer d’obstacle, mais je n’ai pas eu envie de communiquer mon numéro de carte de crédit
Sourires.

Je ne sais pas si ces armes sont vraies ou fausses, mais il est très facile d’en acheter. Je le répète, ce qui m’a le plus surprise, c’est qu’il y avait aussi peu de conditions à leur acquisition.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat évoquait tout à l'heure les polices privées, c'est-à-dire les entreprises de sécurité. Si les particuliers que nous sommes peuvent acheter de telles armes, je ne vois pas ce qui empêche une police privée d’en faire autant !

Je pense qu’il faut encadrer ces ventes sur Internet, comme on le fait pour d’autres produits, et vérifier l’identité des acheteurs.
Enfin, sur ces sites, les textes sont écrits dans un français tout à fait convenable, ce qui permet de penser que ce ne sont même pas des sites étrangers.

Monsieur le ministre, l’utilisation des nouvelles armes de quatrième catégorie – pistolets à impulsion électrique et lanceurs de balles de défense –, autorisées en France depuis quelques années, nous conduit à nous interroger très sérieusement.
Quand ces armes ont été autorisées, on nous a expliqué qu’elles permettraient d’éviter l’usage de certains moyens conventionnels d’intervention des forces de l’ordre, notamment des armes à feu, et donc d’épargner des vies. Elles avaient en commun, disait-on alors, d’être « non létales ». Je pense que cette qualification a rassuré de façon excessive un certain nombre de nos fonctionnaires de police, parce que la réalité est bien sûr plus complexe : si elles peuvent exceptionnellement tuer, ces armes sont, plus fréquemment, susceptibles de blesser et handicaper durablement.
Au-delà d’une formule séduisante, je crois donc que nous devons regarder la réalité en face : chaque mois nous apporte la preuve de la dangerosité de ces équipements. À Montreuil, ville dont je suis maire, en l’espace de dix-huit mois, deux jeunes hommes ont été gravement blessés par des tirs de Flashball émanant des forces de l’ordre. L’un y a perdu un œil, l’autre a déjà subi trois interventions chirurgicales et en gardera des séquelles durables au visage.
Dans aucun de ces deux cas, l’attitude des victimes n’était en cause : en clair, les fonctionnaires de police ne se trouvaient pas en état de légitime défense et ils n’ont pas respecté les consignes d’emploi de ces armes. Dans les deux cas, ils ont tiré au jugé, dans le tas, alors qu’ils étaient chargés de maintenir l’ordre à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique et ne se trouvaient nullement dans une situation où ils auraient eu à affronter des délinquants dangereux.
Pour lever toute ambiguïté, j’ajoute que l’utilisation de ces armes met en péril non pas seulement les personnes qui y font face, mais aussi nos propres forces de l’ordre. L’imprécision de ces armes, la gravité des blessures qu’elles causent, le manque évident de formation des agents – vous n’avez pas précisé ce point, monsieur le ministre, mais je crois que l’on offre au maximum deux demi-journées de formation à ces personnels – ainsi que l’extrême difficulté à respecter, dans l’urgence, des conditions très restrictives d’usage exposent ceux qui les manient à des risques juridiques et moraux disproportionnés.
D'ailleurs, des deux policiers qui sont en cause dans les affaires de Montreuil, l’un a été mis en examen et l’autre ne manquera pas de l’être. Est-ce bien ce que nous souhaitons ?
Combien de temps encore accepterons-nous que nos concitoyens soient mis en danger par l’équipement de ceux qui sont censés les protéger ? Combien de blessés, combien de morts faudra-t-il avant que l’on ne reconnaisse l’inadaptation et la dangerosité de ces armes pour la surveillance des manifestations de voie publique ?
L’alternative aux armes à létalité réduite, ce sont les armes à feu, avez-vous dit ; pour ma part, je considère que, s’agissant de la surveillance des manifestations, ce sont des effectifs plus nombreux, bien encadrés et bien formés.
Monsieur le ministre, il vous appartient aujourd’hui d’agir en limitant drastiquement l’usage de ce type d’armes et en mettant l’accent sur le renforcement des effectifs, sur la formation et sur l’inscription des forces de l’ordre dans une logique de proximité.

J'ajoute un mot sur les polices municipales et j’en aurai terminé, monsieur le président.
Monsieur le ministre, vous avez souligné qu’un décret récent alignait la formation des polices municipales sur celle de la police nationale pour ce qui concerne l’utilisation de ces équipements. Je considère qu’il y a là une confusion des rôles et des missions qui ne répond pas du tout à nos souhaits.
Ainsi, vendredi dernier au soir, à Montreuil, c’est la police municipale qui a dû procéder à la neutralisation de trois malfaiteurs qui avaient pris en otage un commerçant…

Mme Dominique Voynet. … et menaçaient de violer son épouse. La police nationale est arrivée vingt minutes plus tard, monsieur le ministre.
M. Jean Desessard applaudit.
M. Brice Hortefeux, ministre. Madame la sénatrice, tout d'abord, vous avez très largement préjugé des résultats de l’enquête en cours. Je vous le dis avec beaucoup d’humilité : dans notre pays, on est condamné pour bien moins que cela, et c’est un expert qui vous parle.
Sourires.
En effet, vous avez ici, sinon porté atteinte à la présomption d’innocence, du moins largement préjugé des résultats de l’enquête en cours en affirmant que, inéluctablement, l’un des policiers en cause serait mis en examen.
M. Brice Hortefeux, ministre. Croyez-moi, je vous encourage à être très prudente dans votre expression. Je le répète, c’est un expert en ce domaine qui vous parle !
Nouveaux sourires.
Vous avez abordé plusieurs problèmes.
Tout d'abord, vous évoquez ce qui s’est passé à Montreuil le 8 juillet dernier – lors de l’évacuation d’un squat, un jeune homme a été gravement blessé à l’œil par un tir de Flashball – et le 14 octobre dernier – un lycéen de seize ans a été blessé au visage par un tir de lanceur de balles de défense à l'occasion d’une manifestation.
Pour ces deux affaires, j’ai bien sûr demandé immédiatement une enquête de l’inspection générale des services, indépendamment de l’information judiciaire qui est en cours et sur laquelle je me garde bien de me prononcer.
Je vous le dis très directement : si ces enquêtes devaient révéler un usage inadéquat de ces équipements ou des dysfonctionnements, je prendrais bien entendu un certain nombre de mesures. Toutefois, comme je l’ai indiqué à M. Fortassin, de tels incidents sont plutôt rares puisque, de 2006 à 2010, on en a recensé vingt-deux – ce qui est encore trop, bien sûr –, pour quelque 12 000 utilisations de ces armes.
Vous demandez un moratoire, voire une interdiction de l’utilisation de ces armes à létalité réduite.
Je comprends votre point de vue, mais, je le répète, quelle est l’alternative à ces équipements ? Les armes à feu ? Là est la difficulté !
Je suis tout à fait attentif aux problèmes posés par ces équipements. Toutefois, si nous interdisons les armes à létalité réduite, nous devrons utiliser celles qui sont à létalité non réduite, c'est-à-dire que nous serons conduits à accepter l’utilisation des armes à feu.

Pas pour des manifestations ! Nous ne sommes tout de même pas en Tunisie.
Mon objectif est d’assurer la protection, la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens, mais je dois aussi veiller sur ceux qui ont la responsabilité de cette mission, et je ne puis les laisser sans moyens de défense.

Monsieur le ministre, il faut conclure, afin que le dernier intervenant puisse poser sa question.
Enfin, pour répondre à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat – je me souviens à présent de sa question ! –, les sociétés de sécurité privées n’ont pas le droit d’utiliser des armes de quatrième catégorie.

Monsieur le ministre, je ne suis pas convaincue par vos propos. Que ce soit à Montreuil, à Colombes ou à Marseille, il y a une vérité, qu’il faut savoir dire et assumer : ces armes sont mortelles ; la preuve en est qu’elles ont tué. Il faut donc cesser de mentir et admettre que leur dangerosité est bien réelle !
En outre, il faut que justice soit faite. Nous ne pouvons accepter l’impunité. J’ignore ce qui ressortira des instructions en cours, mais il est clair que celles-ci doivent aller jusqu’au bout. Nous devons connaître la vérité, et il faut que justice soit rendue. Les fautifs doivent être sanctionnés : c’est la condition sine qua non pour que la police soit respectée.
Enfin, vous demandez quelle est l’alternative à ces équipements. Vous le savez très bien, il existe de nombreuses solutions de rechange qui ne sont pas mortelles pour les citoyens, ne serait-ce que l’emploi des canons à eau. Surtout, il faut augmenter les effectifs. Dans toutes les banlieues, sur tous les territoires de France, nous avons besoin d’une police nationale – j’insiste sur cet adjectif – renforcée, voilà la vérité. Aujourd'hui, ce sont les citoyens qui sont les victimes de la réduction des effectifs.
Mme Dominique Voynet et M. Jean Desessard applaudissent.

Monsieur le ministre, face aux violences de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves auxquelles les représentants des forces de l’ordre, comme malheureusement l’ensemble des dépositaires de l’autorité publique, sont quotidiennement exposés, la France a choisi, ainsi que l’organisation des Nations unies l’a préconisé, d’équiper ses policiers et ses gendarmes en moyens de force intermédiaire, au premier rang desquels figurent, depuis 1993, le lanceur de balles de défense Flashball et, depuis 2004, le pistolet à impulsion électrique.
La dotation des forces de l’ordre en équipements alternatifs aux armes à feu a répondu à la volonté d’améliorer la sécurité de tous : les policiers, les mis en cause et les tiers. En effet, si l’utilisation de ces équipements, qu’il s’agisse du Flashball ou du pistolet à impulsion électrique, n’est pas sans risques, leur dangerosité apparaît infiniment moindre que celle des armes à feu, tel le pistolet automatique dont les agents sont équipés.
Monsieur le ministre, avec plusieurs années de recul, quel bilan peut-on tirer aujourd’hui de cette décision d’équiper nos forces de l’ordre en moyens de force intermédiaire ?
Vous avez répondu, voilà quelques instants, à mon collègue Antoine Lefèvre que de nombreux dispositifs techniques avaient été mis en œuvre en vue d’assurer une véritable traçabilité de l’utilisation de ces équipements. Existe-t-il un service spécifique qui exploite ces données en vue d’un travail statistique permettant de contribuer à l’élaboration d’un bilan plus détaillé encore ?
Madame Troendle, je l’ai dit, nous avons fait un choix clair, que nous assumons, celui d’équiper nos forces de sécurité de lanceurs de balles de défense et de pistolets à impulsion électrique, précisément pour éviter que la possibilité de réaction de nos forces de sécurité, en état de légitime défense, se résume au seul usage des armes à feu. C’est donc un équipement alternatif qui a été proposé à nos policiers et à nos gendarmes, effectivement confrontés de plus en plus souvent à des situations extrêmement difficiles, où ils sont la cible d’attaques visant à les blesser, voire à les tuer.
Par exemple, à Grenoble, au mois de juillet dernier, un policier qui avait été visé par un délinquant a miraculeusement échappé à la mort parce que la balle lui a frôlé le visage, juste sous le nez, devant la lèvre supérieure.
Je le dis très clairement, l’usage des armes à feu dans nos démocraties doit rester extrêmement rare. Ainsi, dans notre pays, il ne doit intervenir que dans les circonstances les plus graves.
Les armes à létalité réduites sont aujourd'hui des moyens de force intermédiaire indispensables, qui prennent place entre l’usage de la seule force physique et celui des armes à feu.
Je l’ai dit, la traçabilité de l’utilisation de ces armes est assurée grâce à la caméra associée au viseur et à la puce électronique qui enregistre, pour chaque tir, la date, l’heure, le lieu d’utilisation, la durée de l’impulsion s’agissant du pistolet à impulsion électrique ou la distance de projection du lanceur de balles de défense.
Toutes ces données sont recensées et conservées aussi bien à la direction générale de la gendarmerie qu’à la direction générale de la police nationale, afin d’éviter toute polémique.

Je veux seulement remercier M. le ministre d’avoir répondu à mes deux questions.

Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques.
Je vous remercie, monsieur le ministre, mes chers collègues, d’avoir participé à cet échange qui a permis d’éclairer le Sénat.
Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures dix, sous la présidence de Mme Monique Papon.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mardi 25 janvier 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de Cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-115 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.

Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste a présenté une candidature pour la mission commune d’information sur l’organisation territoriale du système scolaire et sur l’évaluation des expérimentations locales en matière d’éducation.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Bernadette Bourzai membre de la mission commune d’information sur l’organisation territoriale du système scolaire et sur l’évaluation des expérimentations locales en matière d’éducation, à la place laissée vacante par Mme Raymonde Le Texier, démissionnaire.

L’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de résolution, présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 674 rectifié [2009-2010]), et de la proposition de résolution, présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Louis Duvernois et plusieurs de ses collègues (n° 94), tendant toutes deux à permettre au parent français d’enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce.
Ces deux propositions de résolution, rédigées en termes identiques, feront l’objet d’une discussion générale commune.
La parole est à M. Richard Yung.

Madame la présidente, madame le ministre d’État, mes chers collègues, les enfants franco-japonais privés de liens avec leur parent français, en cas de séparation ou de divorce, vivent une situation particulièrement pénible. C’est en vérité de leur père qu’ils sont le plus souvent privés, et cela est pour eux une source de difficultés psychologiques, voire de déséquilibre. C’est d’ailleurs essentiellement cet aspect qui doit retenir notre attention dans cette discussion.
Par le biais de notre proposition de résolution, nous demandons la ratification par le Japon de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Nous souhaitons en outre que le Japon puisse faire évoluer son code civil sur le droit de la famille de manière à permettre la continuité et l’effectivité des liens familiaux. Enfin, nous suggérons que le comité de consultation franco-japonais sur l’enfant soit élargi de façon permanente au ministère japonais de la justice, voire éventuellement à d’autres ministères, d’une part, et qu’il puisse servir de structure de médiation pour les problèmes familiaux, d’autre part.
Ce débat est difficile, car il touche à des valeurs profondément ancrées dans la société : la place de l’enfant, les rôles respectifs de l’homme et de la femme dans le couple, le rapport entre les deux parents au sein de la famille, la relation entre les enfants et les parents.
Au Japon, le concept de liê établit clairement que le cœur de la famille est constitué de la mère, de l’enfant et de la maison ; le père se trouve en quelque sorte à l’écart. En Occident, notre conception est tout autre. Nous sommes donc en présence de deux traditions et de deux structures familiales qui s’opposent. Mais nous vivons dans un monde qui se transforme à la faveur des échanges entre les peuples, y compris des échanges matrimoniaux. C’est pourquoi il nous faut aborder cette question avec respect, en ayant le souci d’écouter aussi des arguments qui nous sont a priori étrangers.
On dénombre environ 10 000 naissances d’enfants binationaux par an au Japon. Par chance, toutes n’entrent pas dans la catégorie que nous examinons. Les parents français ne sont évidemment pas les seuls concernés : de nombreux pères américains, canadiens, allemands se trouvent confrontés au problème douloureux que j’ai décrit.
Avant d’en venir à l’exposé des motifs de cette proposition de résolution, je tiens à faire remarquer que c’est la première fois que le Parlement examine, en application de l'article 34-1 de la Constitution – il s’agit d’un droit nouveau, ouvert par la réforme de 2008 –, une proposition de résolution touchant à des affaires internationales. Je me réjouis d’ailleurs que notre collègue Louis Duvernois, lui aussi sénateur représentant les Français établis hors de France, ait suivi un chemin analogue au nôtre et ait déposé un texte identique. J’espère, bien entendu, que ces deux propositions de résolution seront adoptées.
La hausse du nombre de mariages franco-japonais est l’un des signes les plus tangibles du renforcement des liens entre le Japon et la France. En 2009 – je ne dispose malheureusement pas des chiffres de 2010 –, le consulat a transcrit 321 actes de mariage entre Français et Japonais. Il en résulte évidemment une augmentation du nombre d’enfants binationaux : 233 actes de naissance ont été enregistrés cette même année. L’autre conséquence, moins heureuse, est la hausse des séparations et des divorces.
Heureusement, tous les couples franco-japonais ne se séparent pas dans la douleur ; certains parviennent à une solution consensuelle, mais c’est moins souvent le cas lorsqu’ils ont un ou plusieurs enfants. Quoi qu'il en soit, des enfants binationaux en nombre croissant se retrouvent au centre d’un conflit entre leurs parents.
Ainsi, des enfants résidant sur le territoire français ont été enlevés par leur parent japonais et ramenés au Japon sans l’accord du parent français, qui s’était pourtant vu attribuer l’autorité parentale à la suite du divorce.
Étant donné qu’il n’existe aucune convention bilatérale entre la France et le Japon, les décisions judiciaires françaises ne sont pas systématiquement reconnues par la justice japonaise, laquelle donne généralement raison au parent japonais qui a enlevé l’enfant. En outre, le Japon ne sanctionne pas les déplacements illicites d’enfants et n’a pas encore signé la convention de La Haye de 1980. Cette dernière institue une coopération des autorités centrales pour assurer le retour des enfants illicitement déplacés du lieu de résidence habituelle.
Lorsque le couple binational réside au Japon, il arrive que le parent japonais abandonne le domicile conjugal et parte avec l’enfant sans le consentement de l’autre parent. En France, une telle pratique est sanctionnée. Au Japon, en revanche, elle n’est pas considérée comme une infraction et ne justifie donc pas le recours à des mesures d’exécution forcée pour faire revenir l’enfant au domicile familial. Le parent qui a enlevé l’enfant est même souvent maintenu dans ses prérogatives par la justice japonaise.
Dans ces conditions, des citoyens français ayant divorcé d’un ressortissant japonais se trouvent dans l’impossibilité d’exercer au Japon leurs droits parentaux. Les services consulaires français ont connaissance d’une quarantaine de cas, mais nous pensons qu’il y en a significativement plus. Les couples franco-japonais étant majoritairement constitués d’un ressortissant français et d’une ressortissante japonaise, ce sont le plus souvent des pères français qui sont concernés.
Alors que la loi française établit un partage de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce, l’article 819 du code civil japonais prévoit que la garde de l’enfant ou des enfants est accordée à un seul parent. Ainsi, dans 80 % des cas, l’autorité parentale est confiée à la mère en vertu du principe socialement admis qu’elle est la personne la plus importante pour l’enfant et qu’il n’appartient pas au père de s’occuper directement de son éducation. Dans d’autres cas, c’est la préservation des intérêts de la mère qui prévaut sur la continuité des relations de l’enfant avec ses deux parents. Ainsi, même lorsqu’un tribunal japonais constate l’instabilité de la mère, il peut choisir de lui confier l’autorité parentale.
Le Japon et la France n’ont pas non plus la même conception du droit de visite.
Selon la législation française, l’exercice de ce droit ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ; lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales a la possibilité d’organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Au Japon, le droit de visite est non pas inscrit dans le code civil, mais laissé à l’appréciation du juge aux affaires familiales et au bon vouloir du parent auquel a été attribuée la garde de l’enfant. En vertu de l’article 766 du code civil japonais, l’un des deux articles qu’il conviendrait de modifier à l’issue de la procédure de ratification de la convention de La Haye par le Japon, le juge japonais peut ordonner toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant.
Le parent français rencontre aussi des difficultés à expliquer au juge les raisons pour lesquelles il veut se voir reconnaître ce droit de visite. Au demeurant, il n’est pas rare que le juge japonais lui attribue un droit de visite. Toutefois, cette décision n’est pas mise en œuvre lorsque le parent japonais, invoquant la volonté de l’enfant, refuse que ce dernier voie son autre parent ; d’où des situations très douloureuses, d’autant qu’il arrive que le parent ayant la garde parle en mal à son enfant de la personne de laquelle il est séparé. Je précise aussi que, dans les affaires familiales, l’absence d’exécution des jugements n’est pas sanctionnée.
En outre, quand un droit de visite est accordé au parent français, il se résume souvent à une seule visite de quelques heures par mois, alors qu’en France les modalités les plus répandues prévoient un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par conséquent, de nombreux pères français, ou d’autres nationalités, n’ont plus de contact avec leurs enfants, qui se voient ainsi privés d’une partie essentielle de leur identité. Le droit de ces enfants à avoir deux parents, deux familles, deux cultures, deux langues, est bafoué. Il en résulte des effets psychologiques graves. Certains enfants souffrent notamment du syndrome d’aliénation parentale, un désordre psychologique qui atteint l’enfant lorsque le parent présent exerce sur lui, de manière plus ou moins consciente, une sorte de pression visant à détruire l’image du parent absent.

Face à ces situations très pénibles, la France, en liaison avec d’autres États, a entrepris de nombreuses démarches auprès du gouvernement japonais. En décembre 2009, l’ambassadeur de France à Tokyo – je tiens ici à lui rendre hommage, car il a fait de ce dossier sensible une priorité de son action – a ainsi obtenu la création d’un comité de conciliation franco-japonais, composé de représentants des ministères des affaires étrangères des deux pays et ayant pour objectif de faciliter les échanges et le partage d’informations. La France est le premier pays à mettre en place une telle structure avec le Japon ; nous nous en réjouissons.
Cet arrangement est bienvenu et montre que le Japon reconnaît l’existence du problème des enfants franco-japonais privés de liens avec leur parent français. Il demeure néanmoins insuffisant. D’autres initiatives sont nécessaires afin de faire prévaloir l’intérêt supérieur de ces enfants.
Il y a une certaine urgence à agir. Le nombre de cas, je l’ai dit, va croissant. Sans vouloir en faire un argument dans le cadre de cette discussion, je rappellerai les actes dramatiques commis ces derniers mois par plusieurs pères poussés à bout, pour les raisons que j’ai évoquées, peut-être pour d’autres, mais le résultat est là.
La présente proposition de résolution n’a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon, que nous respectons. Je suis moi-même un ami de ce pays, un admirateur de la culture et de la tradition japonaises, de cette capacité à concilier le moderne et l’ancien, à perpétuer les usages du passé tout en étant à l’avant-garde du progrès. Certes, nous le savons, l’évolution des sociétés est le fruit de longs processus, mais, sur le problème qui nous intéresse aujourd'hui, il faut tout de même avancer dans la mesure où il y aura de plus en plus de mariages franco-japonais.
Madame le ministre d’État, mes chers collègues, si le Japon nous entend et est prêt à progresser, à son rythme, dans le respect de ses propres procédures, sur les trois points que j’ai évoqués, à savoir la ratification de la convention de La Haye, la réforme du code civil japonais pour ce qui concerne ses articles 766 et 819 et la transformation du comité de conciliation, alors nous aurons contribué à résoudre un problème ô combien douloureux !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Françoise Laborde et M. Jean-Pierre Cantegrit applaudissent également.

Madame la présidente, madame le ministre d'État, mes chers collègues, cette proposition de résolution soulève un problème éminemment humain. C’est donc sur ce seul terrain que j’entends me placer en la défendant aujourd'hui, car la souffrance d’un père ou d’une mère n’a rien à voir avec un quelconque clivage partisan.
La question qui se pose est celle du droit légitime de l’enfant à conserver un lien familial avec ses deux parents et à pouvoir bénéficier ainsi de la richesse inestimable d’une double culture.
Voilà plus de deux ans que les élus de la circonscription concernée à l’Assemblée des Français de l’étranger ont appelé mon attention sur cette difficile situation, particulièrement injuste pour nos compatriotes parents d’enfants franco-japonais. La situation n’a pas évolué, malgré la ténacité des associations de nos amis Richard Delrieu – SOS Parents Japan – et Jacques Colleau – SOS Papa International.
La hausse du nombre de divorces observée au cours des vingt dernières années interpelle les législateurs que nous sommes sur l’évolution de la notion de famille dans nos sociétés, ainsi que sur la place de l’enfant au sein de celle-ci. En effet, le divorce a toujours une incidence sur le développement de l’enfant et c’est de son intérêt que le juge doit tenir compte au premier chef dans son jugement.
En cas de séparation et de divorce, la loi française établit un partage de l’autorité parentale et assure un droit de visite régulier au parent qui ne reçoit pas la garde. La non-présentation d’enfant y est sévèrement punie par la loi, que la force publique fait respecter. Le divorce entre les parents ne signifie pas le divorce d’un des deux parents avec les enfants.
La question se révèle plus délicate en matière de divorces internationaux, notamment, puisque c’est ce cas qui nous occupe aujourd’hui, lorsque l’un des antagonistes est japonais.
Aujourd'hui, 90 % des divorces se font au Japon par consentement mutuel à la mairie ; concernant les enfants, le formulaire de divorce à remplir par les époux ne permet d’indiquer, sans autre détail, que l’unique parent qui sera désormais détenteur de l’autorité parentale.
Sur les 10 % de divorces restants, environ 9 % vont se résoudre en conciliation judiciaire ; dans 1 % des cas, les parents ne parvenant décidément pas se mettre d’accord, il faut avoir recours à l’arbitrage d’un juge. L’autorité parentale, unique au Japon, est confiée, ainsi que la garde des enfants, dans plus de 80 % des cas à la mère. Le père ne reçoit, en échange, que des devoirs, principalement celui de payer une pension alimentaire, ce dont les pères japonais s’acquittent assez rarement.
Le parent qui n’a pas l’autorité parentale n’a plus aucun droit de regard sur l’éducation des enfants et ne reçoit que très rarement du tribunal un droit de visite, qui n’existe pas dans la loi japonaise et dont l’application est soumise, après le jugement et dans les faits, à l’arbitraire du parent détenteur du droit de garde.
Ainsi n’est-il pas rare qu’un des parents, généralement la mère, prenne l’initiative, avant même que la séparation soit décidée, d’enlever brutalement les enfants et de se réfugier dans sa famille en refusant qu’ils aient désormais le moindre contact avec leur autre parent, tout en réclamant une pension.
La loi japonaise ne punit pas l’enlèvement parental. Le Japon est le seul pays du G8, hormis la Russie, à n’avoir toujours pas signé la convention de La Haye sur les aspects civils des déplacements illicites d’enfant. Il n’applique pas non plus la convention relative aux droits de l’enfant, dite « convention de New York », qu’il a signée le 22 avril 1994. Pis, c’est le parent qui sera le plus prompt à enlever les enfants qui prendra l’avantage sur le plan juridique pour l’attribution de la garde et de la pension !
Soulignons dès à présent l’action de l’ambassade de France à Tokyo grâce, notamment à l’implication personnelle de notre ambassadeur, M. Philippe Faure, qui a permis la création dans cette même ville d’un comité de consultation franco-japonais sur l’enfant au centre d’un conflit parental. Ce comité a pour objet de faciliter le partage d’informations entre la France et le Japon et la mise en œuvre de mesures concrètes de coopération relatives aux cas individuels de déplacements illicites et de non-représentation d’enfant.
Lors de la troisième réunion de cette instance, au mois de décembre dernier, certaines avancées notables ont pu être soulignées : il en est ainsi, notamment, de la participation pour la première fois d’agents du ministère de la justice japonais et du règlement effectif ou en voie de l’être de quelques cas.
La France est le premier pays à avoir mis en place une telle structure avec le Japon.
Le 16 octobre 2009, lors d’une rencontre avec la ministre de la justice, Mme Keiko Chiba, l’ambassadeur de France et ceux de sept autres pays – l’Australie, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Nouvelle-Zélande – avaient appelé le nouveau gouvernement japonais à signer la convention de La Haye. Ce traité, ratifié par plus de quatre-vingts pays, a fixé des procédures pour assurer le retour des enfants dans leur pays de résidence habituelle et pour protéger le droit d’accès à l’enfant des deux parents.
Plus récemment encore, voilà une quinzaine de jours, Mme Hillary Clinton, secrétaire d’État, s’est entretenue à Washington avec M. Seiji Maehara, ministre japonais des affaires étrangères, des quatre-vingt-deux cas similaires de conflits parentaux américano-japonais ; elle a également demandé à l’État japonais de rejoindre les signataires de la convention précitée.
Le premier entretien susvisé avec un haut responsable politique japonais a été suivi, le 30 janvier 2010, d’une démarche menée par notre ambassadeur, M. Philippe Faure, avec le même groupe de pays auprès du ministre des affaires étrangères de l’époque, M. Katsuya Okada, et enfin, le 22 octobre 2010, d’une démarche auprès du successeur de Mme Chiba au ministère de la justice, M. Minoru Yanagida.
Cette dernière action, menée par l’ambassadeur américain au Japon, M. John Roos, a mobilisé pas moins de onze ambassadeurs et représentants d’ambassades, ainsi que la délégation de l’Union européenne. Jusqu’à présent, les États-Unis ont usé d’un ton bien plus comminatoire que la France pour parvenir au règlement du conflit qui nous occupe aujourd’hui. J’en veux pour preuve la résolution n° 1326, adoptée par le Congrès américain, tendant à condamner le Japon pour l’impunité qu’il assure à ses ressortissants coupables d’enlèvements parentaux internationaux.
En ma qualité de représentant des Français établis hors de France, pouvais-je rester insensible à la détresse de nos compatriotes expatriés, dont les droits et les sentiments sont ainsi bafoués et les laisser se débattre seuls dans cet inextricable problème ?

Très récemment, trois pères français connus pour souffrir de cette situation se sont donné la mort.
Transcendant les clivages politiques, cette question de société doit être appréhendée dans le respect de la souveraineté du Japon et des différences culturelles entre nos deux pays, liés par une amitié ancienne et solide. C’est le sens que j’ai souhaité donner à notre action, car en l’espèce il est question non pas de droite ou de gauche, mais d’humanité et de compassion.

Un élu responsable doit, à mes yeux, faire preuve de courage, et il me semble essentiel de compléter l’action diplomatique intense de notre ambassade à Tokyo par l’adoption d’une résolution montrant l’implication de la représentation nationale et, par voie de conséquence, de la nation tout entière dans ce problème aussi dramatique que délicat.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous prie d’apporter votre soutien à la présente proposition de résolution, dont les auteurs ne prétendent aucunement donner des leçons juridiques au Japon, mais demandent simplement la reconnaissance du droit des enfants binationaux à pouvoir grandir dans l’amour de leurs deux parents.
Applaudissements

Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à M. Roland du Luart.

Madame la présidente, madame la ministre d’État, mes chers collègues, j’interviens aujourd’hui en ma qualité de vice-président du groupe d’amitié France-Japon que j’ai eu l’honneur de présider de 1980 à 1990.
Je suis personnellement très attaché au renforcement des liens unissant nos deux pays et je souhaite vous indiquer les raisons pour lesquelles l’adoption des propositions de résolution aujourd’hui soumises à notre examen me semble inopportune.
Certes, ces textes ont été inspirés par des événements douloureux liés à la difficulté pour nos compatriotes divorcés de garder le contact avec leurs enfants. Cette situation, qui concerne une trentaine d’enfants, a conduit au suicide deux pères français privés de leurs enfants au cours des derniers mois. Je comprends donc – et je partage – l’émotion et l’implication de nos collègues représentant les Français établis hors de France pour tenter de mettre fin à cette situation dramatique. Mais la méthode retenue ne me semble pas appropriée.
La première proposition de résolution avait été déposée par M. Yung et trente-cinq sénateurs socialistes au mois de juillet dernier. Ses auteurs appelaient le gouvernement du Japon à trouver une solution et à signer la convention de La Haye de 1980, qui traite de la situation d’enfants de couples binationaux séparés. En outre, ils lui demandaient d’étudier la possibilité de modifier le code civil afin de permettre de garantir la continuité et l’effectivité des liens entre parents et enfants.
Ce texte constituait, à mes yeux, une ingérence inacceptable dans les affaires japonaises. J’observe, d’ailleurs, que notre collègue David Assouline, président du groupe d’amitié France-Japon, ne l’avait pas cosigné. J’observe également que, par la suite, ses auteurs l’ont rectifié pour le rendre identique à la proposition de résolution qui a été déposée le 6 novembre 2010 par M. Duvernois.
C’est donc sur cette dernière que nous devons nous prononcer aujourd’hui, les deux propositions de résolution ayant été jointes.
Je constate qu’elle est plus mesurée et reprend des recommandations formulées par le gouvernement français depuis plusieurs années. Sur le fond, je ne puis qu’y souscrire. Il est, en effet, indispensable que le Japon ratifie la convention de La Haye du 25 octobre 1980, puisqu’il est, avec la Russie, le seul pays du G8 à ne pas l’avoir fait. Et j’insiste pour que le gouvernement japonais définisse rapidement une position sur la question des enfants binationaux en cas de divorce.
Mais faut-il pour autant adopter une résolution, alors que parallèlement, sur le plan diplomatique, les choses avancent, comme viennent de le démontrer nos deux excellents collègues ? De plus, dans ce genre d’affaires, la discrétion semble préférable.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que les gouvernements français et japonais ont créé un organe de consultation sur l’enfant au centre d’un conflit parental en vue d’échanger les informations sur les cas concrets malheureusement déjà existants et pour lesquels se pose la question de l’autorité parentale au sein d’un couple franco-japonais divorcé ou séparé.
À travers cet organe, le ministère des affaires étrangères du Japon coopère étroitement avec l’ambassade de France se trouvant dans ce pays. Le gouvernement japonais est donc déterminé à poursuivre le dialogue avec la France et à prendre toutes les mesures possibles pour l’intérêt des deux pays.
Lors du déplacement de M. Bernard Kouchner au Japon au mois de mars dernier, le Premier ministre de l’époque lui avait indiqué qu’il allait donner des instructions aux ministères concernés en vue d’examiner la possibilité d’adhérer à la convention de La Haye.
Lors d’une conférence de presse le jour même de sa nomination, le nouveau Premier ministre, M. Naoto Kan, a demandé au ministre de la justice, M. Satsuki Eda, de traiter cette question de façon prioritaire et d’examiner la ratification de la convention de La Haye et la révision de la législation actuelle afin de respecter cette convention.
Le gouvernement du Japon a donc engagé le processus, bien qu’il existe, j’en conviens, une certaine réticence au sein de l’opinion publique à l’égard d’une adhésion à cette convention, car, dans certains cas, des mères sont rentrées au Japon en raison de violence domestique.
C’est pourquoi l’on peut redouter que l’adoption d’une résolution par le Sénat français ne soit considérée comme une pression extérieure injuste et ne provoque une réaction négative de la part de l’opinion publique japonaise vis-à-vis de la convention. Cela nuirait aux efforts entrepris par l’administration du Japon et par notre ambassade pour faire avancer les études nécessaires en vue de la ratification de la convention.

Force est de constater que le dépôt des propositions de résolution et leur inscription à l’ordre du jour du Sénat ont eu un effet incontestable d’accélérateur du processus du côté japonais, une troisième réunion du comité ayant eu lieu au mois de décembre.

Mes chers collègues, je crois que nous devons faire confiance aux autorités japonaises. Je suis en mesure de vous assurer de la sincérité de la démarche du Japon visant à trouver une solution. J’estime au contraire contreproductive l’adoption par le Sénat d’une résolution.
La plus grande prudence me semble nécessaire. Ne donnons pas un signal négatif à nos amis japonais, alors que nos relations diplomatiques sont excellentes, après la visite du Premier ministre François Fillon au mois de juillet dernier et la reprise des échanges parlementaires au cours de l’année écoulée, notamment au mois de septembre !
Au-delà du Japon, la question des enfants de couples divorcés se pose dans de nombreux pays et l’adoption des présentes propositions de résolution pourrait constituer un précédent fâcheux. Allons-nous adopter tous les mois des résolutions de ce type à l’encontre de tel ou tel pays ?

C’est pourquoi, à titre personnel et comme mon collègue et ami Pierre Hérisson, qui m’a chargé de l’indiquer à cette tribune, je voterai contre les propositions de résolution qui nous sont soumises.

Madame la présidente, madame la ministre d’État, mes chers collègues, l’union de deux personnes est toujours promesse de découvertes et de richesse. L’enrichissement est d’autant plus remarquable entre deux conjoints de nationalités différentes.
Un nouveau mode de vie, un mode de pensée, une éducation, une histoire, une culture, une langue différentes sont autant d’éléments que, bien souvent, l’on accepte avec enthousiasme, non seulement pour comprendre l’autre, mais aussi par souci d’apprendre et, plus tard, de faire partager ces connaissances démultipliées aux enfants à venir.
Ainsi, les couples binationaux sont, en général, particulièrement ouverts sur le monde et ont une vision bienveillante de l’altérité. Pourtant, cette formidable richesse peut aussi constituer le terreau idéal de déchirements et de luttes, dont tous les membres de la famille auront à souffrir. Ce sont les enfants qui se trouvent au cœur du conflit, au centre de l’arène, et qui paient le plus lourd tribut de ces querelles.
Les problèmes de partage de l’autorité parentale et de garde d’enfants se rencontrent auprès de nombre de couples binationaux. Depuis quelques années, ce sont les séparations de couples franco-japonais qui semblent engendrer les plus importantes difficultés dans ce domaine.
Je tiens donc à saluer l’excellente initiative de nos collègues Richard Yung et Louis Duvernois, qui, par ces propositions de résolution relatives aux enfants franco-japonais privés de liens avec leur parent français en cas de divorce ou de séparation, entendent appeler l’attention du gouvernement japonais sur cette situation aux effets dramatiques.
En Europe, un mariage sur cinq est aujourd’hui binational ; dans le même temps, un divorce sur cinq concerne un couple binational. En France, plus du quart des mariages sont binationaux : en 2009, ce sont 84 000 Français ou Françaises qui ont ainsi épousé une personne étrangère. Nous remarquons, malheureusement, que cette forte progression des unions mixtes a parallèlement engendré une augmentation de 9 % des enlèvements parentaux en 2008.
À côté de certaines affaires dramatiques très médiatisées, combien d’histoires, tout aussi bouleversantes, de vies brisées existe-t-il ?
Au Japon, près de 166 000 enfants japonais ou binationaux sont privés de l’un de leurs parents. Il s’agit presque toujours du père, et ce que les anciennes unions soient franco-japonaises ou 100 % japonaises. En effet, un million de pères japonais ne voient plus leur enfant.
Ainsi, au-delà de la « préférence nationale », qui, dans la plupart des pays du globe, commande l’attribution du droit de garde des enfants, le droit japonais donne littéralement les pleins pouvoirs à la mère. La société japonaise considère que celle-ci est la personne la plus importante pour l’enfant et que le père n’a aucun rôle à jouer dans l’éducation de ce dernier. En effet, en cas de divorce au Japon, un seul parent – dans plus de 80 % des cas la mère – exerce l’autorité parentale.
Quant au droit de visite du père, il n’est même pas codifié et ne bénéficie d’une reconnaissance jurisprudentielle que depuis 1964 ; et encore la Cour suprême du Japon a-t-elle refusé, par une décision de 1984, de lui donner une valeur constitutionnelle. Enfin, dans la pratique, ce droit de visite est subordonné au paiement de la pension alimentaire.
À bien des égards, vis-à-vis des enfants, le droit de la famille japonais est bien différent de celui de la plupart des pays occidentaux. À cela s’ajoute, pour ce qui concerne les affaires familiales, l’absence de sanction en cas de défaut d’exécution d’un jugement. Dans ces conditions, la mère japonaise peut, à loisir, arguer du refus de l’enfant de voir son père pour repousser la mise en œuvre de la décision judiciaire qui avait pu attribuer un droit de visite à ce dernier.
Par ailleurs, aucune convention bilatérale en matière judiciaire n’existe entre la France et le Japon. Les décisions de justice française ne bénéficient donc d’aucune reconnaissance de la part de la justice japonaise. De la même façon, le Japon n’a toujours pas signé la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et ne sanctionne pas les déplacements illicites d’enfants.
Dans ces conditions, il n’existe pas entre la France, signataire de cette convention depuis 1983, et le Japon de véritable coopération destinée à assurer le retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle.
Le Japon, par la voix de son précédent Premier ministre Yukio Hatoyama, a manifesté, voilà quelques mois, sa volonté de signer la convention. M. Hatoyama précisait à l’époque qu’il fallait éviter que le Japon soit perçu, selon son expression, comme un « pays à part ». Il me semble inutile d’insister encore davantage sur ce point.
La prochaine signature de la convention de La Haye, si elle est bienvenue, ne réglera sans doute pas pleinement le problème, le juge conservant toujours, conventionnellement, la possibilité de refuser la restitution de l’enfant, dès lors qu’il considère que celle-ci n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Pourtant, nombre de psychologues, pédiatres et spécialistes de l’enfance s’accordent pour témoigner de l’importance du contact persistant et le plus étroit possible entre l’enfant et ses deux parents.
Les êtres humains sont bien sûr extrêmement divers. Ces singularités s’expliquent notamment – il importe justement de le relever en cet instant – par leur culture ou leur langue. Seulement, comme le souligne le pédiatre Aldo Naouri, les êtres humains partagent strictement les mêmes besoins élémentaires, et l’un d’entre eux est bien le lien entre l’enfant, durant les premières années et même tout au long de sa vie, et ses deux parents. Pour construire convenablement son identité, l’enfant a impérieusement besoin de ce double lien, afin de développer la meilleure image possible de sa mère et de son père.

L’altération de la représentation de l’un d’eux suscitera chez l’enfant un profond trouble quant à la loyauté qu’il s’impose à leur égard et engendrera un grave conflit intérieur, qu’il ne pourra résoudre seul. Une pathologie spécifique a d’ailleurs été étudiée, sur le modèle du syndrome de Stockholm propre aux otages : le syndrome d’aliénation parentale. Les effets destructeurs d’une telle situation sur l’identité de l’enfant s’éprouveront alors tout au long de la vie.
La troisième réunion, à Tokyo, du comité franco-japonais de conciliation sur l’enfant au centre d’un conflit parental a donné lieu, voilà quelques semaines, au déplacement au Japon d’une délégation interministérielle française. La participation à cette réunion, pour la première fois, d’agents du ministère japonais de la justice témoigne d’une évolution positive.
Pour conclure, je veux manifester ma confiance dans la volonté des autorités japonaises d’œuvrer pour que ce douloureux problème des enfants franco-japonais privés de lien avec leur parent français trouve une issue satisfaisante, et ce pour toutes les parties en présence : l’enfant, la mère et le père.
Il est en effet évident, comme l’évoque cette image utilisée par M. Naouri, que les deux parents sont une échelle double sur laquelle l’enfant grimpe à la conquête de la vie.

Dès lors que l’un d’entre eux détruit l’autre, l’échelle s’écroule, entraînant l’enfant dans sa chute...
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à approuver ces propositions de résolution, dans l’intérêt même des enfants franco-japonais.
Applaudissements

Madame la présidente, madame le ministre d’État, mes chers collègues, les propositions de résolution déposées par certains de nos collègues nous donnent aujourd’hui l’occasion de débattre d’un sujet difficile et douloureux pour tous ceux qu’il vise : le déplacement illicite d’enfants.
Dans les faits, cette terminologie juridique adoucit quelque peu une réalité qui relève, pour la plupart des parents victimes, davantage du rapt que du simple déplacement. Malheureusement, dans de nombreux cas, le parent concerné est purement et simplement coupé de son ou de ses enfants.
Lorsque la situation est très conflictuelle, l’auteur de l’enlèvement de l’enfant profite souvent des conditions juridiques et culturelles de son pays pour consolider sa position et se soustraire au principe élémentaire du droit de visite.
De ce point de vue, le Japon offre un cadre favorable à ses ressortissants, en particulier à ses ressortissantes.
En effet, comme l’ont souligné nos collègues auteurs des propositions de résolution, ce pays, qui n’est pas signataire de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, ne sanctionne pas les déplacements illicites d’enfants, ne reconnaît pas les décisions judicaires étrangères et ne fait pas appliquer les mesures exécutoires. Le code civil japonais ignore le partage de l’autorité parentale.
En outre, dans la culture japonaise, la mère est considérée comme la personne la plus importante pour l’enfant.
Il résulte de la combinaison de tous ces facteurs que les tribunaux japonais accordent le droit de garde aux mères japonaises dans 80 % des cas.
In fine, les pouvoirs publics japonais donnent raison auparent japonais qui a enlevé l’enfant. Les couples franco-japonais étant la plupart du temps composés d’unFrançais et d’une Japonaise, les pères français sontpresque toujours lésés.
Ces conditions pénalisantes pour nos concitoyens entraînent parfois des drames. L’année dernière, deux Français se sont suicidés après avoir tenté, en vain, de récupérer leurs enfants enlevés par leurs ex-épouses. L’un d’entre eux s’était même vu reprocher par ses avocats japonais d’avoir quitté sa femme.
Compte tenu de la politique quasiment unilatérale des autorités japonaises, des avocats occidentaux vont jusqu’à conseiller aux pères étrangers de kidnapper leur enfant en premier, avant que la mère japonaise ne le fasse. Ces attitudes, certes extrêmes, reflètent la gravité de la pratique des déplacements illicites qui plonge des parents dans la détresse et déstabilise des enfants.
Les services consulaires français ont dénombré trente-cinq dossiers, chiffre qui ne tient pas compte des cas de parents résignés ou pensant pouvoir régler seuls leur problème.
De surcroît, le nombre de mariages franco-japonais est en hausse constante, mouvement qui s’accompagne aussi, hélas, d’une augmentation du nombre de divorces. Cette évolution laisse présager un accroissement des litiges. Et pas seulement avec la France, d’ailleurs...
On a recensé 37 000 mariages entre Japonais et étrangers, soit huit fois plus que voilà quarante ans, et 19 000 divorces de couples mixtes. En conséquence, il y aurait actuellement 180 cas d’enlèvements par des mères japonaises. Après les Français, ce sont les Américains, les Canadiens, les Australiens et les Britanniques qui sont les plus concernés.
Il est donc urgent de sensibiliser les autorités japonaises à la nécessité de s’impliquer dans ce dossier.

Tel est l’objet de ces propositions de résolution, qui seront sans doute approuvées par la plupart d’entre nous, mes chers collègues. Je crois en effet qu’il est important d’encourager le Japon à coopérer, dans l’intérêt de l’enfant.
Pour autant, il ne s’agit nullement de stigmatiser l’archipel, qui est tout de même signataire de la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Les Japonais ont leur propre approche de la politique familiale qui, je le répète, découle en partie de considérations culturelles, comme le rôle consacré de la mère pour l’éducation de l’enfant. Nous avons la nôtre, différente, modernisée, en particulier depuis l’institution du principe de coparentalité, du développement de la mesure de garde alternée, ou encore du congé de paternité, une politique familiale qui vise ainsi à concilier tous les intérêts, celui de l’enfant, celui de la mère et celui du père.
Mais il est peu probable que cette évolution propre à notre pays gagne le Japon dans l’immédiat. Je ne pense pas que le principe du droit de visite soit inscrit demain dans le code civil japonais. C’est pourquoi la coopération internationale est essentielle sur ce sujet. Il faut absolument l’encourager.
Comme le préconisent les auteurs des propositions de résolution, il serait bien évidemment souhaitable que le Japon ratifie la convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
L’archipel n’a qu’un petit pas à faire. Signataire de la convention internationale des droits de l’enfant, il dispose déjà des outils permettant une approche coopérative du sujet. Rappelons en effet que l’article 11 de ladite convention précise : « Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants ».
Cependant, je crois utile de souligner que cela ne suffirait pas, car, si la convention de La Haye oblige le pays signataire à s’acquitter de certaines obligations, notamment celles qui consistent à vérifier où se trouve l’enfant et à assurer son retour dans le pays initial, elle prévoit aussi des exceptions sur lesquelles certains pays signataires s’appuient sans aucun scrupule pour ne pas restituer l’enfant enlevé.
Il est donc également très important de favoriser la piste d’une éventuelle coopération bilatérale avec le Japon.
Afin d’encourager le dialogue entre les juges, nous avons conclu de nombreuses conventions bilatérales avec plusieurs pays d’Afrique, avec le Brésil, le Liban et bien d’autres États.

Nous devrions pouvoir y parvenir avec le Japon, d’autant que, depuis quelques années, on a pu noter que le gouvernement de ce pays faisait preuve d’une meilleure écoute. Il a en effet accepté, en 2009, la mise en place d’un comité franco-japonais de conciliation sur l’enfant au centre d’un conflit parental. C’est un début encourageant.
Madame la présidente, madame la ministre d’État, mes chers collègues, conséquence de la séparation des couples internationaux, les déplacements illicites d’enfants génèrent chaque année environ 400 dossiers, selon la cellule de magistrats français chargés de la médiation familiale internationale. Le cas spécifique du Japon ne doit donc pas faire oublier que des enfants binationaux impliquant d’autres pays subissent le même sort.
Sachant que la continuité du lien de l’enfant avec ses deux parents est essentielle à son épanouissement, les membres du RDSE approuveront à l’unanimité ces deux propositions de résolution.
Applaudissements

Madame la présidente, madame le ministre d’État, mes chers collègues, mon intervention sera brève. En effet, chacun d’entre nous, en particulier les sénateurs représentant les Français établis hors de France, connaît le contexte ainsi que la situation de nos ressortissants. Je n’y reviendrai donc pas, les auteurs des propositions de résolution les ayant déjà décrits mieux que je ne saurais le faire.
Reste que les deux propositions de résolution qui nous sont soumises cet après-midi sont particulières. Elles ont en effet une portée internationale. Dès lors, il nous importe d’être prudents quant à l’image et au message que la Haute Assemblée délivrera à l’issue de son vote.
Les cas de divorce et de séparation entre les couples franco-japonais et l’éloignement des enfants qui en résulte pourraient porter ombrage à nos relations avec le Japon. Si tel était le cas, nous le déplorerions.
Je tiens à le rappeler solennellement devant vous : le Japon est un pays ami, avec lequel nous entretenons de très bonnes relations. Nous souhaitons fermement que cela continue.
C’est dans cette logique que doivent s’inscrire les présentes propositions de résolution, en particulier celle de notre collègue du groupe UMP Louis Duvernois. Celle-ci doit avant tout être envisagée comme le témoignage de notre amitié envers le Japon. C’est en tout cas de cette façon que le groupe UMP l’entend.
Ces textes démontrent l’attachement de la Haute Assemblée à la bonne tenue des relations franco-nipponnes. Leur examen est l’occasion non seulement pour nous de manifester tout notre soutien au Japon dans son processus d’adhésion à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international, mais aussi de nous réjouir des démarches entreprises par ce pays.
Avant de conclure, je formulerai un vœu.
Depuis le 1er décembre 2009, les autorités françaises et japonaises ont créé un comité de consultation sur l’enfant au centre d’un conflit parental – nous nous en félicitons –, qui, à ce jour, traite vingt-huit cas.
La création de cette instance est l’illustration même de notre bonne collaboration avec le Japon. Il importe que ce comité, qui s’est réuni au mois de décembre dernier à Paris, poursuive le plus assidûment possible ses travaux, afin que les situations visées trouvent un dénouement raisonnable. Il y va du bien-être des enfants, auquel le Japon est autant attaché que nous, puisque, je le rappelle, nos deux pays ont ratifié la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre d’État, mes chers collègues, tout a été dit ou presque.
Connaissant bien le Japon et certains de nos compatriotes confrontés à ce douloureux problème, je voterai, comme tous les membres de l’Union centriste, les propositions de résolution que nous examinons.
Je les voterai, parce que cette initiative du Sénat redonnera de l’espoir à ceux qui l’ont perdu.
Je les voterai pour des raisons humaines, sans ignorer les arguments exposés tout à l’heure par M. du Luart.
Reste que le problème relève non seulement, comme cela a été dit, de la loi ou de la convention de La Haye, mais aussi d’un héritage culturel profondément ancré.
Comme l’indique l’exposé des motifs, et nombre d’orateurs l’ont rappelé, au Japon, l’autorité parentale relève de la mère, le père n’ayant pas vocation à s’occuper des enfants. La signature de la convention de La Haye ne suffira donc sans doute pas à faire évoluer les mentalités, même si, je m’en réjouis, le comité de consultation franco-japonais peut y contribuer.
Je voudrais, moi aussi, signaler le rôle très positif joué par notre ambassadeur Philippe Faure, qui, avec beaucoup de tact, s’est saisi de ce délicat problème.
Pour conclure, j’ajouterais que le sujet qui nous préoccupe aujourd’hui concerne d’autres pays plus proches de nous où la justice fait parfois obstacle au droit de visite. En Europe, il y a 18 % de couples mixtes et certains connaissent des difficultés analogues à celles des couples franco-japonais. La Commission européenne s’en est d’ailleurs émue récemment.
Je le répète, je voterai ces propositions de résolution, car elles vont dans le bon sens, tout en souhaitant que, un jour, la question des enfants binationaux fasse l’objet d’une étude plus exhaustive dans cette assemblée, afin, notamment, que nos amis japonais n’aient pas le sentiment d’être stigmatisés, ce qui n’est certainement pas l’intention de mes collègues ni la mienne, moi qui suis un amoureux de ce pays.
Applaudissements
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, en prenant l’initiative de déposer deux propositions de résolution relatives aux enfants franco-japonais privés de lien avec leur parent français en cas de divorce ou de séparation, le Sénat se saisit d’une question aux enjeux larges et aux répercussions concrètes.
La mondialisation favorise la circulation des personnes, dont la multiplication des couples binationaux est une conséquence. Le nombre accru de séparations ou de divorces en est malheureusement le corollaire, comme le soulignait Mme Lepage.
Aujourd’hui, certains parents n’hésitent pas à déplacer de manière illicite leur enfant, allant même jusqu’à priver l’autre parent de tout contact avec celui-ci. Parmi les couples franco-japonais séparés, une trentaine de cas, monsieur Yung, ont été portés à la connaissance du Gouvernement, mais peut-être en existe-t-il davantage.
MM. Duvernois et Yung, au nombre des auteurs des deux propositions de résolution, ont parfaitement décrit la situation, ses causes, ses complexités et ses difficultés. Face au désarroi et à la douleur qu’elle engendre chez certains de nos compatriotes, nous devons apporter des réponses concrètes et concertées.
De ce point de vue, nous pouvons nous appuyer sur l’excellence des relations entre la France et le Japon, que soulignait M. del Picchia.
Nous devons travailler en confiance, dans le respect mutuel de nos traditions juridiques, en nous gardant de toute ingérence et de toute appréciation hâtive des choix de nos amis japonais.
Nous sommes décidés à obtenir des résultats concrets dans l’intérêt des enfants et de leur père, souvent français.
Les propositions de résolution s’inscrivent en cohérence avec les initiatives prises par le Gouvernement pour renforcer la coopération entre la France et le Japon dans ce domaine.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois que chacun d’entre nous partage le constat : face aux déplacements illicites d’enfants franco-japonais, notre coopération est aujourd’hui dépourvue des instruments juridiques adéquats.
Le Japon n’est pas partie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980, comme l’a souligné M. Yung. Il n’est pas non plus lié à la France par un accord bilatéral de coopération judiciaire en matière civile.
En dépit des obstacles juridiques, le Gouvernement s’efforce de trouver des solutions concrètes à la situation de nos compatriotes privés de leur enfant. Il est bien évidemment à leurs côtés.
Le ministère des affaires étrangères et européennes ainsi que le ministère de la justice et des libertés suivent les cas individuels par l’intermédiaire des services diplomatiques et consulaires de la France au Japon. Nous travaillons également en concertation avec les autorités japonaises et en relation étroite avec les associations de défense des intérêts des pères français.
Pour aller au-delà d’un traitement ponctuel de chaque situation, un comité consultatif a été mis en place avec le Japon. À cet égard, je remercie MM. Duvernois et Pignard d’avoir exprimé leur reconnaissance à notre ambassadeur, qui a pris l’initiative de cette création. En effet, monsieur del Picchia, la France a été le premier pays à prendre une telle décision.
Les autorités françaises et japonaises examinent ensemble dans le cadre de cette instance les cas individuels, afin de dégager des solutions concrètes concernant l’exercice du droit de visite consulaire, le rétablissement du lien parent-enfant et la médiation familiale.
Vous l’avez tous souligné, le comité s’est réuni trois fois : aux mois de décembre 2009 à Tokyo, de juin 2010 à Paris et de décembre 2010 à Tokyo. Je tiens à souligner cette régularité. La quatrième réunion doit avoir lieu au mois de juin prochain à Paris.
Le ministère des affaires étrangères et européennes a associé le ministère de la justice et des libertés aux travaux de ce comité, dont nous espérons élargir les moyens d’action, en liaison avec les autorités japonaises.
Mesdames, messieurs les sénateurs, des initiatives ont été prises. Nous avons l’espoir qu’elles porteront rapidement leurs fruits au bénéfice des parents qui se trouvent en situation de détresse.
Aujourd’hui, vous souhaitez aller plus loin.
Pour approfondir la coopération, nous encourageons le gouvernement japonais, ainsi que tous les autres pays non signataires, à adhérer à la convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Aujourd’hui, le dialogue progresse entre la France et le Japon. Des efforts importants ont été réalisés pour rapprocher nos positions.
M. Duvernois l’a mentionné, des rencontres ont eu lieu entre les ambassadeurs des pays les plus concernés et les autorités japonaises. Mon prédécesseur avait d’ailleurs évoqué cette question lors de sa dernière visite au Japon au mois de mars dernier.
Des rencontres et séminaires ont également permis de sensibiliser les milieux décideurs japonais aux enjeux réels et au mode de fonctionnement de la convention de La Haye.
Certains d’entre vous l’ont indiqué, des signaux positifs sont à relever. Je pense à la position de l’ancien Premier ministre japonais. Le nouveau ministre de la justice du Japon a marqué sa volonté de faire du dossier de l’adhésion de son pays à la convention de La Haye l’une de ses priorités.
Nous sommes donc en phase avec nos amis japonais.
Les présentes propositions de résolution marquent un pas de plus dans le dialogue engagé entre la France et le Japon.
Ces textes font écho, dans leur esprit et dans leur lettre, à la résolution votée au mois de septembre dernier par la chambre des représentants américaine. Notre pays n’est donc pas le premier à prendre une telle initiative.
Ces textes s’inscrivent également dans le prolongement des actions menées et dans la cohérence avec notre volonté commune de convaincre le Japon d’adhérer à la convention de La Haye, madame Laborde.
La question que tout le monde se pose finalement aujourd'hui est la suivante : quelles sont les voies les plus efficaces de ce dialogue ?
M. du Luart, pour sa part, préconise une démarche plus discrète, si je puis dire, à savoir la voie diplomatique.
L’action du Gouvernement vise à résoudre les difficultés de nos concitoyens dans le cadre d’un dialogue confiant avec les autorités japonaises.
Les propositions de résolution que nous examinons expriment solennellement la préoccupation du Sénat face aux drames subis par certains de nos compatriotes.
Pour préserver la qualité de notre dialogue, veillons à trouver un juste équilibre entre l’expression de notre solidarité et le respect de la souveraineté du Japon, que personne ne conteste. Tel est le choix qu’il revient à chacune et chacun d’entre vous de faire.
Dans ces conditions, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de votre assemblée, qui a pris l’initiative de ces propositions de résolution, en a débattu très librement, et a écouté avec beaucoup de respect le point de vue des uns et des autres..)

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…
La discussion générale commune est close.
Nous passons à l’examen des deux propositions de résolution identiques, dont les termes sont les suivants :
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Rappelant que la présente proposition de résolution n’a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon ;
Affirmant son respect des différences culturelles entre le Japon et la France, ainsi que son attachement aux liens d’amitié qui unissent le Japon et la France ;
Rappelant que le Japon est partie à la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, dont le préambule rappelle que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », dont l’article 3, alinéa 1, dispose que dans « toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », et dont l’article 9, alinéa 3, dispose que les « États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » ;
Rappelant que le Japon est le seul État membre du G7 à n’avoir pas signé la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, qui vise à protéger les enfants des effets nuisibles causés par leur déplacement illicite ou leur rétention au-delà des frontières internationales ;
Rappelant que la législation japonaise ne reconnaît pas, en matière de droit de la famille, le partage de l’autorité parentale après un divorce et limite le droit de visite à l’appréciation du juge aux affaires familiales ;
Rappelant que les parents français font face à d’éprouvantes difficultés dans le cadre des procédures de justice qu’ils ont engagées au Japon ;
Rappelant que certaines décisions judiciaires qui leur accordent un droit de visite ne sont pas systématiquement appliquées en ce qu’elles se heurtent au refus du parent japonais et à l’absence de mesures exécutoires ;
Rappelant qu’il en résulte une situation préjudiciable à une trentaine d’enfants issus de couples franco-japonais qui, suite à une séparation ou à un divorce, se retrouvent privés de tout contact avec leur parent français et de liens avec leur second pays ;
Rappelant qu’il a été démontré que les enfants privés de contacts avec l’un de leurs parents souffrent d’un déficit affectif susceptible de nuire à leur développement personnel ;
Rappelant que les ambassades d’Australie, du Canada, d’Espagne, des États-Unis, de France, d’Italie, de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ont, à plusieurs reprises, fait part au gouvernement du Japon de leur inquiétude face à l’augmentation du nombre de cas d’enlèvements parentaux internationaux impliquant des ressortissants japonais ;
Rappelant, comme nous l’avions fait en octobre 2009, auprès de la ministre de la justice Mme Chiba et, en janvier 2010, auprès du ministre des affaires étrangères M. Okada, que nous avons proposé le 22 octobre 2010 au ministre de la justice M. Yanagida de continuer à travailler étroitement avec le gouvernement japonais sur ce sujet sensible ;
Soulignant l’importance de l’avancée que représente la mise en place, le 1er décembre 2009, d’un comité de consultation franco-japonais sur l’enfant au centre d’un conflit parental, chargé de faciliter les échanges et le partage d’informations et de permettre la transmission de documents ;
Souhaite que le comité de consultation franco-japonais sur l’enfant au centre d’un conflit parental soit élargi à d’autres ministères tels que ceux de la justice et des affaires sociales, qu’il puisse auditionner les associations de parents et qu’il ait la possibilité de mener des actions de médiation entre les parents japonais et français ;
Émet le vœu de voir émerger, dans un délai raisonnable, une solution qui, acceptable pour tous, soit respectueuse de l’intérêt supérieur des enfants issus de couples binationaux ;
Appelle de ses vœux le gouvernement du Japon à définir une position sur la question des enfants binationaux privés de liens avec leur parent non japonais ;
Appelle de ses vœux la ratification par le Japon de la convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Avant de mettre aux voix l'ensemble des propositions de résolution identiques, je donne la parole à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote.

Le présent débat, délicat et difficile, a été calme, courtois et responsable.

C’est tout à fait normal, en effet, car nous avons évoqué un grand pays, le Japon, ami de la France, dont la civilisation est, pour certains – dont je suis – un modèle. Gardons ce fait à l’esprit.
J’ai bien écouté les différents orateurs. En ma qualité de président d’un groupe d’amitié, je comprends l’intervention de M. du Luart, que j’estime particulièrement et qui a des responsabilités au sein du groupe d’amitié France-Japon, dont je suis membre.
J’ai apprécié également l’intervention du vice-président de la commission des affaires étrangères, Robert del Picchia, qui a calmement exposé les enjeux soulevés par la question que nous examinons.
MM. Yung et Duvernois, représentant, comme moi, les 2, 5 millions de Français établis hors de France – je m’attacherai particulièrement à ceux qui vivent au Japon –, ont, avec beaucoup de tact et de délicatesse, abordé ce très grave sujet. Je me réjouis du fait qu’appartenant à des groupes différents, nous ayons une même communauté d’intérêt, ce qui m’a profondément touché.
Si je prends la parole en cet instant, c’est parce que M. Thierry Consigny, vivant au Japon, membre, depuis quelques années, de l’Assemblée des Français de l’étranger et de la Caisse des Français de l’étranger, tout comme moi, et avec lequel je collabore étroitement, m’a alerté sur le point suivant : un certain nombre de nos compatriotes n’ont pas vu leurs enfants depuis quinze ou vingt ans ! Je suis très sensible à son appel.
Et je ne peux qu’être très profondément touché par le suicide, évoqué par nos collègues Yung et Duvernois, de certains de nos compatriotes. Certes, il est très difficile d’affirmer que la cause principale de leur acte est l’absence de contact avec leurs enfants, mais nous constatons néanmoins une corrélation entre ces faits.
Cette situation ne devrait-elle pas inciter ce grand pays ami qu’est le Japon, l’un des rares pays membres du G8 à n’avoir pas pris un tel engagement vis-à-vis de la communauté internationale, à signer la convention de La Haye relative aux enlèvements parentaux ?
Douze ambassadeurs occidentaux, dont celui de France, M. Philippe Faure, que je connais personnellement et que j’apprécie, ont rencontré à trois reprises le ministre japonais de la justice à cette fin. Des centaines de milliers de parents japonais, français, ou d’autres nationalités, appellent de leurs vœux un geste de la France pour accélérer le changement de comportement du Japon sur ce sujet.
Je remercie MM. Yung et Duvernois de leurs propositions de résolution qui, je pense, vont dans le bon sens et que je voterai.
Applaudissements

Madame la présidente, madame la ministre d’État, mes chers collègues, nous évoquons aujourd'hui – comme viennent de le rappeler les orateurs précédents – un drame humain extrêmement grave, sans, toutefois, que soit remise en cause l’amitié de la France et du Japon.
C’est justement en raison de cette amitié que nous devons dire à ce grand pays, que nous respectons, ce que nous ressentons. Si l’on est ami, on peut s’exprimer ; à défaut, cela signifie que tel n’est pas le cas.
Le présent débat démontre justement la profonde amitié que nous témoignons au Japon.
Je voterai bien entendu ces propositions de résolution. Il faut en effet rendre l’espoir à ceux qui l’ont perdu. Il faut également continuer à agir pour que nos amis japonais comprennent que l’humanité mérite quelques efforts. Comme le dit, si je ne me trompe, un proverbe asiatique, c’est dans le regard d’un ami que l’on peut le mieux se voir et se comprendre. J’invite donc le Japon à le faire.
Applaudissements

En mes qualités de membre du groupe d’amitié France-Japon et de représentant des Français établis hors de France, je me suis rendu à deux reprises au Japon, où j’ai pu rencontrer certains pères français qui vivent sur place dans la quasi-clandestinité, du fait de l’interdiction par les autorités japonaises de voir leurs enfants, qui leur ont été soustraits par les familles des mères de ces derniers. C’est, à double titre, un drame, d’une part, pour nos compatriotes, lésés du droit légitime de voir leurs enfants, et, d’autre part, pour ces enfants binationaux, qui, ne bénéficient pas de la double culture de leurs parents.
Toutes les interventions précédentes ont été d’excellente qualité.
S’il est possible de continuer à œuvrer dans le cadre du comité de consultation franco-japonais sur l’enfant au centre d’un conflit parental– je me suis entretenu sur ce sujet avec Philippe Faure, qui a été un pilote dans la mise en place de cette instance –, il convient aussi de montrer à nos amis japonais, pour lesquels nous avons la plus grande estime, que, entre amis, on peut se faire remarquer ce qui ne va pas.
Je tiens à remercier nos collègues Yung et Duvernois d’avoir pris l’initiative de ces deux propositions de résolution, pour lesquelles je voterai.
Applaudissements

Je mets aux voix les deux propositions de résolution identiques qui tendent à permettre aux parents français d’enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce.
Ces propositions de résolution identiques sont adoptées.

Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat, par lettre en date du 25 janvier 2011, de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente en matière d’énergie sur le projet de reconduction de M. Philippe de Ladoucette à la présidence du collège de la Commission de régulation de l’énergie et de nomination au sein de ce collège de MM. Jean-Christophe Le Duigou et Frédéric Gonand.
Ces demandes d’avis ont été transmises à la commission de l’économie.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-deux heures dix, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.