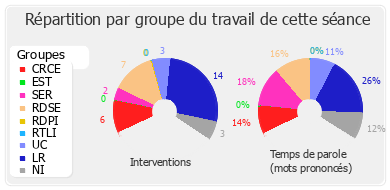Séance en hémicycle du 17 juillet 2014 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures vingt-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive (texte de la commission n° 691, rapport n° 690).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, oui, la commission mixte paritaire a réussi, et nous nous en réjouissons.
Cet engagement a été tenu. Nous devons en remercier non seulement les présidents des deux commissions des lois – Jean-Pierre Sueur, pour le Sénat, et Jean-Jacques Urvoas, pour l’Assemblée nationale –, mais aussi le rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale, Dominique Raimbourg, avec lequel nous travaillons depuis de longs mois.
Il a été tenu malgré les invectives, que je prends d’ailleurs souvent comme des compliments
Sourires.

Oui, mes chers collègues de la majorité, vous avez eu raison, et je vous en remercie, d’avoir suivi presque complètement les propositions de votre commission des lois et de son rapporteur « idéologue », « laxiste », « démagogue », « provocateur »
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – Mme la garde des sceaux fait un signe de dénégation.
Sourires.

Le projet de loi relatif à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive que nous avons voté en première lecture s’inscrit dans le prolongement de la loi pénitentiaire de 2009, qui définissait pour la première fois la prison comme l’exception.
À ce titre, l’article 3 du projet de loi oblige le juge à motiver spécialement la peine de prison ferme, non aménagée, y compris pour les récidivistes.
Par ailleurs, certaines des dispositions que vous avez votées donnaient plus de cohérence au texte, notamment celles portant sur la peine de contrainte pénale. En effet, elles tendaient à ce que cette dernière soit une peine autonome pour un certain nombre de délits – les délits routiers, par exemple – et elles la distinguaient beaucoup mieux du sursis avec mise à l’épreuve.
Enfin, d’autres dispositions que vous aviez votées, mes chers collègues, visaient à abroger des mesures contre lesquelles nous nous étions élevés fortement alors que nous étions encore dans l’opposition. Je me souviens des interventions de Robert Badinter, alors sénateur, de Jacques Mézard et d’Alain Anziani, notamment sur la rétention de sûreté et les tribunaux correctionnels pour mineurs.
En cet instant, je ne vais pas revenir sur toutes les dispositions qui restaient en discussion, mais vais simplement faire le point sur un certain nombre de désaccords importants qui étaient sur la table de la commission mixte paritaire et qui ont été résolus.
Le premier concernait le champ de la contrainte pénale. Un membre de la commission mixte paritaire qui n’est ni de mes amis politiques ni de mes amis tout court m’a dit, en forme de compliment, que ma proposition avait une certaine cohérence : il y avait en effet une certaine cohérence, mes chers collègues, à déclarer que la peine de contrainte pénale était une peine totalement détachée de la peine d’emprisonnement.
Suivant ainsi ce qui nous avait été indiqué lors de certaines auditions, notamment par Robert Badinter, trois types de peine auraient existé en matière délictuelle : la peine de prison, d’abord, le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve, ou SME, et la contrainte pénale, ensuite, et les peines pécuniaires ou de confiscation, enfin.
Ce n’est pas ce qui a été retenu. La raison pour laquelle nous nous sommes finalement ralliés à la version issue des travaux de l’Assemblée nationale tient à ce que la peine de contrainte pénale, prononcée pour quelques délits uniquement et détachée de la peine d’emprisonnement, aurait été applicable immédiatement, ce qui aurait, semble-t-il, surchargé de travail les juges d’application des peines et les personnels de probation.
Cet argument était un peu fallacieux, madame la garde des sceaux, puisque le Gouvernement a déposé l’amendement n° 2 – amendement qui pose, d’ailleurs, des problèmes de coordination importants, que nous ne pourrons malheureusement pas régler ce matin –, lequel prévoit l’application immédiate des dispositions relatives à la contrainte pénale. Si l’application est immédiate pour tous les délits prévus par ces dispositions, elle aurait pu l’être également pour les quelques délits que je proposais. La commission mixte paritaire en a décidé autrement.
Le deuxième désaccord avait trait au seuil des aménagements de peine. Vous connaissez, mes chers collègues, les allées et venues auxquelles ce sujet a donné lieu. Pour notre part, nous nous sommes battus pour maintenir le seuil défini par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont le rapporteur pour le Sénat était Jean-René Lecerf. Ce seuil, adopté par le Sénat à une large majorité, avait été conservé grâce au président de la commission des lois de l’époque, Jean-Jacques Hyest. Et c’était cohérent avec l’ensemble du projet de loi. La commission mixte paritaire a donc maintenu la version adoptée par le Sénat, ce dont je me félicite.
Le troisième désaccord opposait non pas le Gouvernement et le Parlement, mais l’Assemblée nationale et le Sénat. Il portait sur certaines dispositions introduites par l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur Dominique Raimbourg, notamment, qui visaient à accroître de façon importante les prérogatives de la police et de la gendarmerie.
J’avais proposé au Sénat de supprimer trois des quatre articles portant sur ce thème, et de largement modifier le dernier.
En commission mixte paritaire, pour arriver à un accord global, nous avons dû négocier sur ces articles.
L’article 15, qui prévoit de permettre la géolocalisation et l’interception des communications pour les personnes soupçonnées d’avoir violé une interdiction ou une obligation leur ayant été faite, avait été supprimé par le Sénat. Nous avons présenté un amendement commun, qui tend à rétablir le système prévu, mais en l’encadrant mieux, grâce à la fixation d’un seuil de gravité et d’une finalité à la mesure, cela afin de respecter notamment les décisions du Conseil constitutionnel.
Le Sénat avait également supprimé les articles 15 bis et 15 ter. Le premier a vu sa suppression maintenue ; le second a fait l’objet d’une nouvelle rédaction afin de soumettre au juge la transaction proposée par les officiers de police judiciaire.
Enfin, l’article 15 quater a été maintenu dans la rédaction du Sénat, qui en a restreint le champ. Cela nous paraît plus conforme à ce qu’il est possible de faire.
L’Assemblée nationale, qui examinait hier soir les conclusions de la commission mixte paritaire, a conservé ces mesures en l’état.
Le quatrième point de désaccord concernait la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, introduite dans le texte par la commission des lois du Sénat. Cette question, en effet, a fait l’objet d’un désaccord profond entre le Gouvernement et le Parlement, même si, sur ce point, les députés ont été plus faibles que vous, chers collègues de la majorité sénatoriale. §
Finalement, je me suis rallié au raisonnement selon lequel il convenait de conserver au présent projet de loi sa cohérence, en n’introduisant pas de réforme dans la réforme. La suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, lesquels, sans vouloir revenir sur ce sujet, n’ont pas donné les résultats escomptés, au point que tous les magistrats veulent leur suppression, doit donc figurer dans un autre texte.
Cet autre texte est prêt, d’ailleurs. J’en ai eu connaissance au cours du dernier trimestre de l’année dernière, lorsque j’effectuais, à la demande de Mme la garde des sceaux et du Premier ministre, une mission sur la protection judiciaire de la jeunesse. Ce texte, qui avait fait l’objet d’un arbitrage favorable, au moins par le ministère de la justice, avait par la suite été soumis à embargo.
Or, la veille de la commission mixte paritaire, le ministère de la justice a publié un communiqué – vous en avez tous eu connaissance, mes chers collègues –, selon lequel, « s’agissant du débat sur les tribunaux correctionnels pour mineurs […], le Gouvernement prend l’engagement de proposer la suppression de ces tribunaux correctionnels pour mineurs dans un texte sur la justice des mineurs qui sera présenté au premier semestre 2015 ».
J’espère, chers collègues qui serez encore sénateurs à cette date, que vous vous en souviendrez, afin d’inviter éventuellement le Gouvernement à tenir ses engagements !

Compte tenu de cet engagement du Gouvernement – et nous n’avons aucune raison de ne pas y croire –, nous avons accepté de ne pas introduire dans le présent projet de loi pénale la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Il est juste de dire, en outre, que le présent texte ne concerne pas les mineurs.
Le dernier désaccord, levé en séance au Sénat, avait trait à la suppression de la rétention de sûreté.
Lors de sa première réunion, la commission des lois avait suivi son rapporteur, et la rétention de sûreté – et non pas la surveillance de sûreté – avait été supprimée. Lors de sa deuxième réunion, quelques hésitations, quelques renoncements à mon avis coupables ont été notés. Et l’amendement tendant à rétablir la rétention de sûreté a été adopté.
J’ai tout de même retenu les déclarations de Mme la garde des sceaux à ce sujet : cette disposition, comme celle relative aux tribunaux correctionnels pour mineurs, concerne les criminels ; dès lors, afin de ne pas brouiller plus encore – certains organes de presse s’en chargent suffisamment – le projet de loi, lequel concerne les délinquants et non pas les criminels, le Gouvernement, pourtant hostile à la rétention de sûreté – Mme la garde des sceaux l’a dit très clairement –, a proposé de l’abroger dans un autre texte, à un autre moment. Compte tenu de ces arguments, avancés en séance plénière, le Sénat a maintenu la rétention de sûreté.
Tel est le résultat des travaux de la commission mixte paritaire. Cet accord, auquel certains sénateurs de l’opposition pourraient se rallier – auquel, du moins, ils pourraient ne pas s’opposer –, est un bon accord. Personne n’a mangé son chapeau, contrairement à ce que j’ai pu lire dans la presse.

Personnellement, d’ailleurs, je ne porte jamais de couvre-chef.
C’est une grande loi que nous allons définitivement adopter. C’est un nouveau défi, une nouvelle méthode pour combattre la récidive et donc l’augmentation de la délinquance, mais aussi pour garantir à nos concitoyens la plus grande sécurité, qu’ils réclament à juste titre des pouvoirs publics.
Évidemment, pour que ce texte soit une réussite, le Gouvernement doit y mettre les moyens, financiers comme humains ; il doit mobiliser les magistrats, son administration, notamment pénitentiaire, pour obtenir les résultats attendus. En tout état de cause, mes chers collègues, nous pouvons être fiers du texte que nous allons voter.
Je voudrais, pour conclure, rendre un hommage particulier à Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice, pour l’engagement qu’elle a mis et la volonté dont elle a fait preuve, afin que ce texte voie enfin le jour. §
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse d’être avec vous ce matin afin de conclure en ces lieux le parcours de ce projet de loi dont la discussion a été très dense.
Les débats ont été riches tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Je le dis même si je connais le goût particulier pour les querelles entre les deux chambres – en témoigne l’adjectif que M. le rapporteur, malgré tout le bien qu’il pense de la chambre basse, n’a pas résisté à utiliser voilà un instant pour qualifier les députés
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Les débats tenus dans les deux chambres du Parlement sont toujours de tonalités différentes, ces deux assemblées ayant des méthodes de travail, des approches, des sensibilités dissemblables.
Cela contribue à enrichir considérablement le travail parlementaire, donne vraiment sens à la navette et permet, même lorsque la procédure accélérée a été engagée, d’aborder de façon distincte et donc enrichissante les textes examinés.
Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, la façon dont s’est déroulée la commission mixte paritaire. En qualité de garde des sceaux, et au nom du Gouvernement, je veux m’autoriser à saluer non seulement la qualité du travail, mais aussi et surtout l’état d’esprit des parlementaires qui ont participé à cette commission mixte paritaire. Sa réunion, il faut le souligner, a été bien préparée par la qualité des débats et par l’état d’esprit, là encore, qui régnait aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, état d’esprit alimenté de façon continue par les deux rapporteurs, Dominique Raimbourg et Jean-Pierre Michel, qui travaillent ensemble sur ce texte depuis plusieurs mois.
Le Sénat s’était emparé du texte très en amont, comme il le fait souvent, en procédant à des auditions extrêmement diversifiées, en organisant des rencontres avec l’Assemblée nationale et en réalisant quelques travaux sur ce thème.
Si le parcours au sein des chambres parlementaires a été relativement réduit, le présent projet de loi a connu un long cheminement.
Nous avons en effet commencé à travailler sur ce texte avec la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, installée en septembre 2012. Cette méthode, complètement inédite, a été particulièrement féconde. Mais je ne veux pas ignorer tous les travaux effectués avant la conférence de consensus, y compris dans cette chambre. Cela fait des années, en effet, que certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, travaillent sur ces sujets. Il m’est ainsi arrivé à plusieurs reprises de saluer, du haut de cette tribune, le rapport de commission d’enquête parlementaire dit « rapport Hyest-Cabanel », publié en 2000. J’ai également participé au débat sur l’application de la loi pénitentiaire, qui m’a permis de vérifier, une nouvelle fois, que des travaux sur ce sujet avaient été menés bien avant la conférence de consensus.
Ces travaux ont été réalisés dans les chambres du Parlement, bien sûr, mais aussi au sein des universités, dans des espaces où se sont retrouvés des chercheurs, des universitaires, des parlementaires, des professionnels de la justice, des militants associatifs sensibles à ces questions. Une très grande variété de conceptions et d’expériences, en somme, se sont mêlées, ces dernières années, pour produire des études ou des analyses ; ce sont autant de matériaux mis à la disposition de la conférence de consensus, qui ont permis à cette dernière d’être un vrai succès.
La maturation du texte a donc été longue.
Si le parcours au sein du Parlement a été plus court, le projet de loi n’a cependant pas perdu en densité. Le texte, mesdames, messieurs les sénateurs, est à votre disposition depuis le 9 octobre 2013, et les auditions multiples que vous avez conduites vous ont permis de prendre en compte la diversité, la multiplicité des approches, des sensibilités et des perceptions sur ces sujets.
L’état d’esprit ayant présidé aux travaux de la commission mixte paritaire a permis d’aboutir à un texte que j’estime aujourd'hui de très grande qualité. Il s’agit là d’une appréciation non pas subjective, mais objective, qui se vérifiera dans le temps. Et le crédit des mesures adoptées reviendra aux parlementaires ayant participé à leur élaboration.
Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, le texte conserve ses dispositifs structurants. Tout d’abord, une totale liberté d’appréciation a été restituée aux magistrats grâce à la suppression de certains mécanismes. Ensuite, vous avez créé la contrainte pénale, qui s’est précisée et enrichie au cours du travail parlementaire, ce qui facilitera pour les magistrats l’appropriation de cette peine. Enfin, vous avez précisé, en adoptant le régime de libération sous contrainte, le dispositif de lutte résolue contre les sorties sèches, qui entraînent des récidives.
Par ailleurs, vous avez enrichi le texte en adoptant un certain nombre d’autres dispositions visant à consolider ces trois dispositifs très structurants et à élargir les normes pénales concernant des situations qui vous tenaient à cœur depuis plusieurs années.
Disant cela, je pense notamment à vos initiatives en matière de prise en compte de l’altération du discernement. M. Jean-René Lecerf a été très actif sur ce point : il a abordé cette question avec lucidité, mais aussi un grand sens des responsabilités. Il a souligné l’importance de la prise en charge des personnes dont le discernement est altéré, lesquelles ne doivent pas subir la rigueur d’une peine maximale et doivent pouvoir bénéficier de soins.
Vous avez aussi montré votre attachement à différents sujets, à l’instar de l’Assemblée nationale qui, sur l’initiative de M. Alain Tourret, a prévu, par exemple, une amélioration des conditions d’aménagement des peines pour les femmes enceintes. Toute une série de dispositions a ainsi été introduite : elles enrichissent les normes pénales et permettront à la politique pénale d’être plus efficace.
Je n’oublie pas non plus une disposition concernant l’incitation à la lecture, dont l’initiative revient à un député UMP. Nous avions souhaité retravailler cet amendement plus précisément. Grâce à vous, cela a été possible, et cette disposition figure désormais dans le texte.
Le Parlement a également voulu inscrire dans la partie législative du code de l’organisation judiciaire les bureaux de l’exécution des peines. C’est une bonne chose de consolider ces bureaux, qui permettent une plus grande diligence dans l’exécution des peines.
Les bureaux d’aide aux victimes, que nous avons créés dans tous les tribunaux de grande instance, ont également été introduits dans le code de l’organisation judiciaire grâce à vous.
Nous avons également inscrit dans la loi la justice restaurative, anticipant ainsi la transposition de la directive Victimes, qui doit intervenir d’ici à la fin de l’année 2016. Depuis janvier 2014, une expérimentation par anticipation des dispositions de cette directive est d’ailleurs menée dans huit tribunaux de grande instance, un suivi individualisé des victimes étant assuré, conformément aux nouvelles normes européennes.
Vous avez également prévu une sur-amende visant à contribuer au financement de l’aide aux victimes. Depuis la première année de la mise en place de cette aide, le Gouvernement a augmenté de 25, 8 %, puis de 7 %, le budget qui y est consacré. Une hausse est également prévue dans le cadre de la prochaine loi de finances. Nous le savons, il convient de diversifier les ressources de ce budget pour les pérenniser. Tel est donc l’objet de cette sur-amende.
D’autres dispositions permettront de saisir le juge de l’application des peines lorsque la mise à exécution d’une peine survient plus de trois ans après son prononcé. Cette mesure importante permet de reconsidérer la situation de la personne condamnée, pour déterminer s’il y a lieu d’aménager sa peine. En effet, une courte peine exécutée à l’issue d’un délai aussi long peut provoquer une désocialisation, si la situation de la personne a changé entre-temps.
Vous avez donc prévu des dispositions supplétives en ce sens – ne voyez aucune connotation péjorative dans l’utilisation de cet adjectif, bien au contraire ! – qui consolident l’armature même de cette réforme pénale.
Le travail fourni en commission mixte paritaire a été de très grande qualité, et je tiens à le saluer.
Lors des débats qui se sont déroulés au Sénat, vous aviez montré votre attachement à certaines dispositions introduites dans le texte de la commission, sur l’initiative de M. le rapporteur. Le fait d’avoir accepté soit de les aménager, soit de les différer montre les efforts que vous avez consentis pour permettre la réussite de la commission mixte paritaire et aboutir aujourd'hui à cette lecture conclusive.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens donc à vous exprimer ma gratitude, à titre aussi bien personnel, politique et institutionnel – en tant que ministre de la justice – que démocratique et civique. En effet, votre volonté d’aboutir nous permet maintenant de passer à l’application de nouvelles règles pénales et à une politique publique pénale dont nous voulons assurer l’efficacité. Celle-ci devra tout simplement se traduire par la réduction de la récidive, et non pas seulement par la lutte contre celle-ci. C’est la prévention de la récidive qui conduira à la réduction de cette dernière, et donc à la diminution des actes de délinquance et du nombre de victimes potentiellement exposées à ces actes.
Nous sommes quelque peu impatients d’appliquer ces nouvelles normes et de mesurer aussi vite que possible – c’est du moins ce que j’espère – les résultats en matière de prévention de la récidive, de lutte contre la sortie sèche et de réinsertion des personnes condamnées.
Vous avez également témoigné de votre volonté d’aboutir s’agissant de la contrainte pénale, que vous aviez prévue pour un certain nombre de délits, sans possibilité d’incarcération. Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, vous obéissez à une logique incontestable, en concevant un système des peines fondé d’abord sur l’amende, ensuite sur la contrainte pénale – peine autonome en milieu ouvert –, enfin sur l’incarcération. Cela contribuera évidemment à la cohérence et à l’efficacité de notre système pénal, et en particulier de l’incarcération, celle-ci étant prononcée pour une durée déterminée et impliquant une nécessaire réinsertion : le retour dans la société doit en effet être préparé à l’intérieur de la prison, afin que le condamné ne soit pas en situation objective de récidive – en tout cas de facilitation de la récidive.
Vous étiez très attachés à cette cohérence. Je le suis également, dans la mesure où, ces dernières années, la centaine de modifications du droit pénal et de la procédure pénale a produit une relative incohérence dans la hiérarchie des peines. Nous devons donc travailler sur cette question !
La hiérarchie des peines doit correspondre à la hiérarchie des valeurs de la République : il ne peut y avoir de déconnexion entre l’échelle des peines et celle de nos valeurs. Pour illustrer très clairement les choses, je dirai qu’on ne peut pas, dans une société aussi sensible que la nôtre à l’individu, à la personne humaine et à sa dignité, accepter que les atteintes aux biens soient punies plus sévèrement que les atteintes aux personnes. Il y a là des discordances qu’il nous faudra corriger dans le code pénal, afin de rétablir une connexion avec nos valeurs républicaines selon lesquelles la personne est plus importante que les biens. Même si le droit de propriété est un droit constitutionnel à la protection duquel nous devons veiller, même si l’atteinte aux biens doit être sanctionnée, la République doit délivrer le message selon lequel elle est encore plus attentive à l’intégrité des personnes : les atteintes portées à ces dernières seront donc punies plus sévèrement.
Ce travail de fond dans le code pénal reste donc à faire. Je l’ai confié à la mission présidée par Bruno Cotte, qui doit rendre son rapport à la fin de l’année 2015. Par ailleurs, des travaux du Parlement et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, sont déjà en cours. Nous ferons en sorte que tous aboutissent, pour que la hiérarchie des peines soit repensée et mise en cohérence avec l’échelle de nos valeurs.
Votre conception était donc tout à fait fondée, mesdames, messieurs les sénateurs. Simplement, il était prématuré, par rapport au travail de fond restant à accomplir, de la mettre en œuvre dans le cadre de ce texte.
Vous avez également accepté de modifier ce que vous aviez prévu en matière de sanctions s’agissant de l’inobservation des obligations et interdictions, et je vous en remercie. Si le juge correctionnel définit la durée maximale d’incarcération, celle-ci peut ensuite être prononcée par le juge délégué, éventuellement saisi par le juge de l’application des peines, qui pourrait décider une mise en œuvre partielle de l’incarcération, les parcours de désistance pouvant être, nous le savons, chaotiques. À certaines périodes, il faut resserrer le contrôle et la sanction ; à d’autres, il convient au contraire d’assouplir de telles mesures, la personne étant en cours de réinsertion.
En créant un délit spécifique, nous aurions pu rencontrer une difficulté, dans la mesure où il serait devenu nécessaire d’introduire de nouvelles poursuites, en risquant de suspendre la contrainte pénale, c'est-à-dire toutes les mesures de suivi. Le dispositif aurait ainsi perdu en efficacité.
Vous avez également accepté en commission mixte paritaire, ce dont je vous remercie également, que les services pénitentiaires d’insertion et de probation soient reconnus dans leurs missions régaliennes et soient pilotes dans la mise en œuvre de la contrainte pénale. Cela n’altère bien entendu en rien leurs relations avec les partenaires associatifs, lesquels interviennent en phase présententielle et produisent un travail de grande qualité qui est reconnu. La contrainte pénale, qui se fait en milieu ouvert, est une peine autonome en soi, non référencée à la prison. Ainsi, l’article 8 de ce texte vise à modifier l’article 131-3 du code pénal, en inscrivant la contrainte pénale après l’emprisonnement et avant l’amende et les autres peines en milieu ouvert. Sa mise en œuvre doit relever des missions régaliennes de l’État, en particulier du ministère de la justice.
Vous avez également tenu à rétablir les dispositions de la loi pénitentiaire – on peut le comprendre – pour des raisons aussi bien de droit que de constance. Nul n’ignore le travail de fond accompli à l’époque sur ce texte par le rapporteur Jean-René Lecerf et le président très actif de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest. Sur ce point, c’est l’Assemblée nationale qui a accepté de rapprocher son point de vue de celui qui était défendu par le Sénat.
Vous avez modifié le régime d’octroi des réductions de peine et de libération conditionnelle.
Par ailleurs – vous l’avez dit, monsieur le rapporteur –, le désaccord n’a pas disparu s’agissant des dispositions concernant la géolocalisation et les écoutes.
J’ai présenté hier soir à l’Assemblée nationale des amendements qui ont été rejetés, comme je m’en doutais. Je souhaitais néanmoins alerter très clairement les députés sur les risques constitutionnels qui existaient quant à ces dispositions. Il me paraît en effet responsable, de la part du Gouvernement, d’indiquer aux députés et aux sénateurs qu’il y a des risques potentiels.
Je vous remercie, monsieur le sénateur ! Hier soir, un député UMP a pourtant essayé de me chercher querelle sur ces amendements !
Ces amendements sont également souhaités par le ministère de l’intérieur. L’Assemblée nationale les ayant repoussés, le Gouvernement ne peut donc les défendre aujourd'hui devant le Sénat.
Mais, s’agissant de la géolocalisation, des écoutes et de la généralisation de la surveillance judiciaire, le texte comprend tout de même quelques dispositions suscitant des craintes de notre part.
Même si le texte n’était pas déféré au Conseil constitutionnel, nous ne serions pas à l’abri d’une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité. Je n’insiste pas, le débat ayant eu lieu hier soir à l’Assemblée nationale.
L’essentiel des travaux de cette commission mixte paritaire ayant été présenté par vos soins, monsieur le rapporteur, je n’irai pas plus loin.
J’évoquerai simplement la décision prise de ne pas supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs, par laquelle vous avez terminé votre intervention. Vous avez rappelé l’engagement du Gouvernement – je précise qu’il s’agit bien d’un engagement du Gouvernement, et non simplement de la garde des Sceaux – de présenter une réforme de l’ordonnance de 1945 au cours du premier semestre 2015. Le Gouvernement, qui ne souhaitait pas que des dispositions relatives aux mineurs soient inscrites dans ce projet de loi ne les concernant pas, marque ainsi son respect à l’égard du Parlement.
Je conclurai, mesdames, messieurs les sénateurs, en vous exprimant à nouveau ma gratitude pour la qualité tant de nos débats et de nos travaux, que du texte de loi issu des discussions en commission mixte paritaire.
Ma gratitude est plus profonde encore pour ces deux années au cours desquelles nous avons eu à traiter de toutes les questions de justice. Je pense notamment aux questions concernant la justice civile, à laquelle vous êtes aussi extrêmement sensibles, ou encore à celles qui portent sur la proximité territoriale de la justice, ce dernier point témoignant de votre très grand attachement à la présence de sites judiciaires au niveau des territoires, et donc à leur accessibilité à tous les citoyens, où qu’ils se trouvent.
Votre mobilisation permanente et constante sur les textes de loi relevant du domaine de la justice conforte le travail des magistrats, des greffiers, des personnels pénitentiaires, des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce n’est donc pas la seule gratitude de la garde des sceaux ou du Gouvernement que j’exprime devant vous ; c’est celle de l’ensemble des personnes qui font vivre ce beau service public de la justice !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.

Madame la garde des sceaux, il vous aura fallu beaucoup de ténacité, de courage, d’obstination et de volonté pour parvenir à ce 17 juillet, à ce jour où, nous l’espérons, sera votée cette réforme pénale que, malgré les critiques, les caricatures, les insultes, vous avez menée avec beaucoup de force et, également, un sens du dialogue et de l’écoute digne d’être souligné.
Il est rare, voire, me semble-t-il, sans précédent, qu’un texte de loi de cette importance soit précédé d’une concertation longue de dix-huit mois.
Il y a d’abord eu un groupe de travail présidé par Mme Nicole Maestracci, puis cette grande conférence de consensus au cours de laquelle tous les professionnels de la justice – magistrats, avocats, greffiers –, ainsi que les représentants de l’administration pénitentiaire, de la police et de la gendarmerie se sont exprimés. Toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces deux jours de rencontre en ont été marqués ! Les détenus ont également été entendus, tout comme, bien sûr, les victimes. Enfin, un grand débat national, organisé au siège de l’UNESCO, a permis d’aborder diverses questions : le sens de la justice, son but, son efficacité, les attentes de nos concitoyens à cet égard…
C’est donc au travers de ce parcours tout à fait remarquable et sans précédent, je le redis, que ce texte de loi a été préparé.
Vous comprendrez, mes chers collègues, que je tienne également à rendre hommage à mon collègue et ami Jean-Pierre Michel.
Je lisais ces jours derniers un nombre conséquent d’articles sur ce très vieux thème – cette littérature, vous le savez, est ancienne comme le Sénat – de l’utilité de la Haute Assemblée. Celle-ci joue un rôle éminemment important car, sans bicamérisme, il n’y a pas d’écriture de la loi : ni la navette ni ce travail collectif par lequel, progressivement, mot après mot, phrase après phrase, la loi s’élabore ne sont possibles !
Le Sénat démontre son existence quand, en son sein, des paroles fortes sont entendues, et c’est pourquoi je veux rendre hommage à Jean-Pierre Michel. Son rapport, j’en ai la conviction, était totalement fidèle à l’esprit de la loi. Il tirait les conséquences du texte, mais indiquait aussi avec netteté ce qui avait motivé son élaboration, quel était l’objectif attendu et pourquoi, en particulier, il convenait de revenir sur le sens de la peine et de créer de nouvelles peines, bien définies.
Aux caricatures qui, il est vrai, ont été brossées, vous avez, cher Jean-Pierre Michel, répondu avec beaucoup de talent. En un sens, celles-ci vous honorent ! Vivre, c’est lutter, à en croire Victor Hugo, qui avait bien raison de le penser !
Le Sénat est donc fort quand des paroles fortes s’énoncent en son sein. Ce fut très souvent le cas, beaucoup plus qu’on ne le prétend, et nous sommes honorés que notre rapporteur ait su, comme vous-même, madame la ministre, défendre l’esprit de cette loi.
La commission mixte paritaire est donc parvenue à un accord, dans des conditions que vous connaissez, mes chers collègues, celles d’un dialogue, parfois sans concession, parfois difficile, avec des demandes, des exigences, des compromis, et des points auxquels nous étions profondément attachés.
Je tiens à en citer trois.
Tout d’abord, la contrainte pénale est une vraie peine. M. le rapporteur avait proposé que cette peine fût la seule possible pour un certain nombre de délits. Ce ne sera pas le cas, conformément à l’accord que nous avons passé avec l’Assemblée nationale. Mais, à l’occasion de l’extension du dispositif à tous les délits, qui, selon les termes du projet de loi, aura lieu dans quelques années, on s’interrogera sur la possibilité de reprendre cette idée. C’est une des conclusions de la commission mixte paritaire.
Par ailleurs, le travail accompli par le passé, en particulier par Jean-René Lecerf, ayant été cité, je souligne quel a été notre extrême attachement à ce que l’on ne revînt pas sur les décisions prises lors du vote de la loi pénitentiaire et sur les aménagements de peine pour les non-récidivistes et les récidivistes.
Nous savons bien – on nous l’a suffisamment répété – qu’un arbitrage, pour reprendre le terme habituellement employé, a été rendu voilà quelque temps, mais nous considérons que le Parlement doit faire la loi. Le fait que le Sénat ait unanimement voté ces aménagements de peines et le renouvellement, voilà quelques semaines, de ce vote unanime constituaient de puissants arguments. Il y a donc eu un accord sur cette question, le Gouvernement ayant aussi marqué son accord.
C’est un point très important car, tout le monde le sait, une volonté d’en finir avec les sorties sèches est affichée dans ce projet de loi. Or, en finir avec les sorties sèches, cela signifie préparer et aménager la sortie de prison, de sorte qu’un individu, après six, sept, huit, dix ans de détention, ne se retrouve pas un beau matin sur le trottoir, sans attache familiale, sans environnement social, sans logement, sans travail.
La prison est une institution nécessaire et forte de la République. D’ailleurs, madame la ministre, je me réjouis que vous veniez très bientôt en inaugurer une dans le département du Loiret. Ces établissements pénitentiaires ont trois missions, toutes absolument indispensables : protéger la société, punir et préparer la réinsertion. La préparation de la sortie de prison est donc une dimension très importante de ce projet de loi, à laquelle il faudra consacrer des moyens, et nous serons très vigilants, sur toutes les travées, à cette question des moyens, qui sont véritablement essentiels.
Enfin, le dernier point auquel nous étions très attachés concerne la justice des mineurs., vous savez mieux que personne, madame la ministre, combien il fallut parfois discuter et convaincre pour parvenir au communiqué que vous avez bien voulu publier un lundi, à dix-sept heures, alors que la commission mixte paritaire se déroulait le mardi à dix heures trente.
Envers et contre tout, en dépit des démagogies et des polémiques, nous considérons que les mineurs sont des êtres en devenir et nous restons fidèles à l’ordonnance de 1945, même modifiée trente-sept fois, car c’est un texte qui peut toujours être amélioré. Nous estimons donc que l’engagement, pris par vous-même, madame la ministre, et, comme vous venez de l’indiquer à la tribune, par l’ensemble du Gouvernement, d’organiser au cours du premier semestre de l’année 2015 un débat autour d’un projet de loi sur la justice des mineurs et les tribunaux correctionnels pour mineur est un engagement très fort.
Nous sommes parvenus à un accord sur de nombreux autres sujets, que Jean-Pierre Michel a évoqués. Effectivement, les discussions fructueuses avec Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, que je tiens à saluer, avec Dominique Raimbourg, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, qui partage avec notre rapporteur une même passion pour la justice, ont été précieuses, tout comme les dialogues constants avec l’ensemble des membres du Gouvernement, les équipes de Matignon et celles de la Présidence de la République ayant suivi ce dossier. Je tiens à le préciser, et chacun se reconnaîtra.
L’histoire le dira, mais cette date du 17 juillet 2014 pourrait être importante dans l’histoire de notre justice, car ce projet de loi a pour philosophie de rompre avec le « tout carcéral ». Il s’agit d’affirmer que nous voulons l’impunité
Mme la garde des sceaux s’étonne.

Nous voulons aussi de la rigueur, au niveau tant de la détention, qui doit préparer la réinsertion, que de la contrainte pénale, qui doit être une vraie peine, préparée, accompagnée et suivie.
Pour conclure, mes chers collègues, je tiens à tous vous remercier d’avoir contribué à l’élaboration de ce projet de loi. J’y insiste, celui-ci marquera un changement de culture – je l’espère en tout cas – quant à notre façon d’appréhender la loi pénale et l’idée que nous nous faisons de la justice dans ce pays.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Notre groupe ne veut pas l’impunité pour les délinquants, monsieur le président de la commission des lois !

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le vrai débat, la question de fond qui resurgit constamment depuis de longues années, c’est le surpeuplement qui affecte nos prisons, …

… dans des conditions qui sont absolument détestables et intolérables par rapport aux valeurs de tous ceux qui sont présents dans cette assemblée.

Pour autant, on sait bien – pour reprendre d’autres propos qui ont pu être tenus dans certains journaux ou à l’Assemblée nationale – que la construction immédiate de 20 000 places de plus, d’une part, n’est pas possible et, d’autre part, ne résoudra pas le problème.
Telle est la réalité de fond, qui vous a certainement amenée, en même temps que d’autres arguments, madame la garde des sceaux, à proposer ce texte.
Le « tout carcéral » a longtemps été présenté comme la solution universelle à tous les maux de la délinquance.
Le projet de loi modifié par le Sénat redonnait un fil d’Ariane à notre politique pénale dans le labyrinthe législatif où elle s’était souvent perdue.
Cher rapporteur, vous avez parlé des attaques injustes que vous avez subies. Je ne sais pas si l’on peut vous pardonner le fait d’avoir contribué à la création du syndicat de la magistrature §mais, pour le reste, je ne puis que louer vos qualités. Je crois quand même que, à défaut d’avoir mangé votre chapeau, vous avez avalé pas mal de couleuvres.
Nous avons refusé la rétention de sûreté, les peines planchers ; notre groupe avait d'ailleurs déposé deux propositions de loi sur ces sujets. Nous avions aussi souvent contesté les lois pénales réactives aux médias ; dire cela n’est pas faire preuve de laxisme ; c’est simplement témoigner un attachement aux valeurs fondamentales de la République.
D’un commun accord, les peines planchers ont été supprimées de ce texte, comme la révocation automatique des sursis pour les récidivistes déjà plus lourdement condamnés.
La contrainte pénale, mesure phare de ce texte, a été conservée dans la version de l’Assemblée nationale. Mais cette version, nous l’avons quant à nous peu appréciée.
Le texte qui nous est aujourd’hui proposé – même si, monsieur le président de la commission des lois, vous considérez comme une réussite le simple fait qu’une commission mixte paritaire ait abouti, et nous connaissons votre enthousiasme constant pour tous ces grands succès – a perdu une part de la cohérence qui lui avait donnée lors de l’examen par le Sénat.
Nous avions prévu que la contrainte pénale devenait la peine principale pour une liste limitative de délits excluant les atteintes aux personnes. La Haute Assemblée, dans sa grande sagesse – et nous pourrions dire aux députés qui nous qualifient de « majorité ringarde » que nous n’avons guère de leçons à recevoir d’eux en la matière –…

… avait estimé qu’il fallait, avant son extension à tous les délits en 2017, susciter un nouveau débat autour de son évaluation.
Dans sa version actuelle, cette contrainte pénale pourrait s’apparenter à une énième sanction pénale parmi les innombrables autres qui existent déjà dans l’arsenal juridique.
Madame la garde des sceaux, vous aviez raison de poser le problème de la hiérarchisation des sanctions et de leur cohérence avec l’organisation judiciaire. Ce débat ne pourra pas être différé trop longtemps, car il y a là un véritable problème.
L’option choisie aboutit à une peine en milieu ouvert plus contraignante que le sursis avec mise à l’épreuve – il n’est pas supprimé –, pour un panel de délits moins graves.
Je ne suis d’ailleurs pas sûr qu’elle sera appliquée par les juges, tant du fait de son manque de lisibilité qu’en raison surtout, et nous le savons tous, du manque de moyens financiers et humains. Les gouvernements successifs, quels qu’ils soient, persistent et signent dans des réformes qui sont parfois trop superficielles hors de la réalité pénale : surpopulation carcérale, je l’ai dit, désocialisation des petits délinquants, inefficacité des processus d’insertion et de réinsertion, inexécution des peines, qui est aussi l’un des gros problèmes de notre système actuel, et, au bout de tout cela, épuisement des professionnels.
Le texte issu de la commission mixte paritaire a rétabli une disposition, supprimée par la Haute Assemblée, confiant aux officiers de police judiciaire le pouvoir de transiger sur certaines infractions, sur le modèle anglo-saxon. Quel est là le signal envoyé à nos concitoyens ? Quel est ce mauvais mélange de genres qui ne respecte pas les prérogatives de l’autorité de poursuite qu’incarne le procureur de la République ?
Nous regrettons que l’on aille vers de telles dispositions au mépris des grands principes de notre droit pénal.
À ce titre, il était essentiel que le suivi pénitentiaire des personnes placées sous suivi judiciaire reste une prérogative des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, et ne soit pas partagé avec des acteurs non régaliens, à la légitimité plus que floue.
Le Gouvernement s’étant engagé à déposer au début de l’année 2015 – vous l’avez d’ailleurs rappelé – un texte portant réforme de l’ordonnance de 1945, la commission mixte paritaire n’a pas conservé la disposition introduite par le Sénat qui supprimait les tribunaux correctionnels pour mineurs ; nous le regrettons. Dont acte. Je rappelle aussi que c’était un engagement de campagne du Président de la République.

Il y a les engagements tenus, ceux qui posent problème et ceux qui ne sont pas tenus, et qui devraient l’être. Mais c’est un autre débat…

Vous le savez, ces formations posent aujourd'hui plus de difficultés qu’elles n’en résolvent, et je suis heureux que vous ayez annoncé qu’on reviendra, dans quelques mois, sur ces textes.
Le texte que nous nous apprêtons à voter devrait être le symbole du refus du populisme pénal qui a trop longtemps présidé à l’élaboration de la politique pénale. Nous ne voulons pas qu’il devienne, madame la garde des sceaux, un simple texte d’opportunité ; nous souhaitons au contraire qu’il fasse l’objet d’une application forte.
Pour terminer, je souhaiterais – même s’il s’agit d’un cavalier dans le débat qui nous occupe – faire une très brève observation.
Nous avons entendu les déclarations de M. Arnaud Montebourg, ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, sur les professions réglementées. Il serait important, madame la garde des sceaux, que vous puissiez rassurer au moins la profession des avocats, en particulier dans les petits et moyens barreaux : ce sont en effet eux qui assument souvent la charge de la défense pénale, et il faut veiller à ne pas les fragiliser plus que ce n’est le cas actuellement.

Mme Esther Benbassa . Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive, selon l’intitulé adopté par le Sénat. Je veux le dire d’emblée – je serai bien sûr un peu moins critique que M. Mézard
Exclamations ironiques sur les travées de l’UMP.

… ce texte est une source de grande satisfaction pour le groupe écologiste.
D’une part, il constitue un véritable tournant pour la justice de notre pays. En effet, sans éluder la souffrance et la place des victimes ni céder à un quelconque laxisme, il instaure de véritables alternatives à l’incarcération dont on sait qu’elle est bien souvent à l’origine de la récidive.
La contrainte pénale, disposition phare du projet de loi, qui se déroulera en milieu ouvert, est ainsi une peine à part entière, une peine dont la finalité est de responsabiliser et de réinsérer dans notre société le condamné.
Nous souhaitons d’ailleurs avec force que cette nouvelle peine trouve rapidement toute sa place dans le système pénal, qu’elle soit véritablement appliquée et ne soit pas considérée par les magistrats comme une simple alternative au sursis avec mise à l’épreuve.
D’autre part, en élaborant un véritable texte de gauche, le Sénat a montré une fois de plus qu’il était capable non seulement d’esprit de consensus mais aussi d’ambition et de liberté.
Le succès de la commission mixte paritaire était nécessaire pour que les avancées introduites par le Sénat soient maintenues et défendues. Cela a été le cas, et le texte que nous examinons aujourd’hui nous paraît faire preuve d’équilibre.
Je veux ici saluer votre travail, madame la garde des sceaux, votre ténacité et votre engagement au service de cette réforme ambitieuse.
Nous regrettons, bien entendu, que la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, adoptée sur l’initiative des écologistes et de M. le rapporteur, n’ait pas été maintenue. Mais nous nous félicitons de l’engagement pris de la présentation, au premier semestre 2015 – nous comptons sur vous, madame la garde des sceaux –, d’un projet de loi de réforme de la justice des mineurs et nous serons vigilants quant à la tenue de cet engagement.
Si nous déplorons également l’abandon de certaines mesures comme l’abrogation de la rétention de sûreté, que nous appelions de nos vœux, nous partageons l’esprit de cette belle réforme.
Nous saluons, en premier lieu, le rétablissement d’une véritable individualisation des peines, qui passait par la suppression des mécanismes entravant la liberté d’appréciation des juges. Il était temps, mes chers collègues, de mettre fin à cette aberration que sont les peines planchersainsi qu’à la révocation automatique du sursis simple et du sursis avec mise à l’épreuve.
Au groupe écologiste, nous ne sommes ni dans l’idéologie §
Mme Esther Benbassa ne peut poursuivre son intervention.

Madame Benbassa, je vous propose de laisser pour l’instant la place à la tribune à l’orateur suivant, le temps que vous retrouviez votre voix.

Dès lors qu’elle ne s’appellera plus « Centre », elle sera forte ! Non à l’absorption !

Elle va devenir la plus petite région de France, c’est formidable ! Avant, il y avait le Limousin…
Cela étant, j’ai assisté, avec grand intérêt, à la commission mixte paritaire qui s’est mise d’accord sur le texte du projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, puisque tel est désormais son titre.
Madame la garde des sceaux, je le répète et vous l’avez d’ailleurs évoqué, une navette aurait été préférable. Sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de la géolocalisation, le texte pose toujours problème, même après la commission mixte paritaire. Je persiste à penser que la commission des lois avait eu raison de supprimer cette disposition, laquelle a ensuite été rétablie. Nous avons essayé de l’encadrer, mais cela ne me paraît pas suffisant.
À mes yeux, et après avoir entendu ce qui a été dit particulièrement sur les sorties sèches, il suffirait d’appliquer la loi pénitentiaire, en y mettant tous les moyens nécessaires.

La situation est tout de même extraordinaire. Pour que la prison ne soit pas uniquement un lieu d’enfermement, nous avons voté une loi qui prévoyait que la réinsertion commence – nous l’avons dit et répété – dès le premier jour d’incarcération.

Vous faites figurer dans le texte des dispositions sur la lecture. C’est très bien, mais ce que le gouvernement précédent avait fait voter n’a déjà pas été appliqué. Depuis deux ans, on ne peut pas considérer que les choses ont vraiment progressé dans ce domaine.
Ajoutons que la prison continue à être la cour des miracles. On y mélange grands délinquants en attente de placement dans un établissement pour peine et prévenus. Les maisons d’arrêt ne devraient pas servir à cela. Si l’on ne trouve pas de moyens, je peux vous assurer que l’on ratera cette réforme aussi, qu’elle ne changera strictement rien.

Quand on a cru à quelque chose et que l’on y croit toujours, je me demande pourquoi on fait une nouvelle réforme que l’on n’appliquera pas plus que les autres…

Madame la garde des sceaux, j’ai tout de même maintenant – hélas pour moi ! – une certaine expérience du fonctionnement de la justice.
Vous êtes assez sage pour ne pas insulter l’avenir !

On prend des mesures qui sont peut-être utiles pour réduire l’enfermement, mais pas la récidive. Néanmoins, ce n’est pas, me semble-t-il, la question !

On a voulu inventer la contrainte pénale, qui est née dans la confusion : dans sa conception initiale, elle était une peine alternative à l’emprisonnement.

Pas tout à fait, je vous l’accorde, et justement, je vais y venir.
Le juge pouvait choisir de recourir à la peine d’emprisonnement ou à la contrainte pénale, qui est une sorte de « super sursis avec mise à l’épreuve », applicable tant par le juge prononçant la peine que par le juge d’application des peines.
Ce dispositif avait été approuvé par l’Assemblée nationale moyennant une évolution dans le temps. Souhaitant en faire une peine autonome, je salue la logique de notre rapporteur, car il y en a bien une !, …

Attendez la suite, cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec lui !

Souhaitant donc en faire une peine autonome, le Sénat avait circonscrit l’application de la contrainte pénale au seul juge de l’application des peines, pour bien marquer le caractère « autonome » de cette nouvelle peine. Il était prévu, par ailleurs, de remplacer la peine de prison par la contrainte pénale pour certains délits.
On l’a bien vu, c’était une impasse. Le vol avait été inclus, puis supprimé. Cela montre qu’il restait quelques délits très mineurs. On constate ainsi la limite de l’exercice.
Madame la garde des sceaux, vous avez évoqué la différence entre les atteintes, d’une part, aux biens et, d’autre part, aux personnes. Je citerai un exemple bien connu de tous : celui de la personne âgée qui se fait cambrioler, dont la maison est complètement retournée et vidée. Pour elle, c’est un viol de son intimité extrêmement traumatisant, …

… même si elle n’a pas été agressée, même si elle était absente. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire trop de comparaisons dans l’absolu.
Il n’empêche que l’agression physique est plus grave encore !

Je ne dis pas qu’une agression physique n’est pas grave, mais ce type de cambriolage doit être sanctionné sévèrement, …

… davantage qu’un vol ordinaire.
À l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, la contrainte pénale n’est pas une peine autonome se substituant à la prison. Pour autant, on ne peut pas nier que, en lui-même, le dispositif finalement adopté n’est pas dénué de toute ambigüité, puisque la contrainte pénale a la nature d’une peine et l’apparence d’un aménagement de peine. Comment pourra-t-elle être perçue par les délinquants comme une véritable punition ? Comment les juges pourront-ils l’appliquer ? Nombreux sont ceux qui estiment que ces derniers en feront peu usage. Bref, la justice pourra-t-elle être rendue avec cette nouvelle mesure aussi bien qu’avant ? J’en doute !
Pour l’instant, seuls les délits susceptibles d’être punis de cinq ans d’emprisonnement sont concernés. Mais à partir de 2017, la contrainte pénale sera étendue aux délits passibles de dix années de prison. On va très vite et très fort ! Se pose toute la problématique, notamment, de la délinquance sexuelle, dont les auteurs peuvent cependant bénéficier d’un aménagement de peine. Quelles mesures prendra-t-on pour ce type de délinquants ? En tout cas, cela me paraît vraiment excessif.
Je passerai rapidement sur les tribunaux correctionnels pour mineurs. Madame la garde des sceaux, vous vous êtes engagée à réformer – enfin ! – en profondeur l’ordonnance de 1945.
On évoque cette ordonnance comme un texte sacré, alors qu’elle a été modifiée, comme l’a rappelé Jean-Pierre Sueur, trente-sept fois. Certes, il faut toujours en respecter les principes, mais je me demande ce qu’il reste du texte d’origine !
L’exposé des motifs, qui est très beau et efficace !

J’en suis d’accord !
Quant à la transaction pénale, je partage les inquiétudes exprimées par Jacques Mézard. Une procédure exécutée par les officiers de police judiciaire ! Elle est devenue un peu plus acceptable dans la mesure où, grâce au Sénat, elle a été placée sous l’autorité du procureur de la République et doit être homologuée. Mais il est extraordinaire que des parlementaires aient pu oublier à ce point le principe de la séparation des pouvoirs ! Comment peut-on voter au Parlement des amendements de telle sorte ?
Il en va de même pour les écoutes téléphoniques et la géolocalisation. Sur ces points, le projet de loi n’a pas vraiment été corrigé. Les écoutes peuvent être soit judiciaires, soit administratives. Ces dernières sont bien encadrées. Quant aux écoutes judiciaires, elles sont placées sous l’autorité du juge des libertés et de la détention ou – mais de moins en moins en raison de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation – du parquet. Ces questions soulèveront de véritables problèmes.
En conclusion, nous nous réjouissons qu’un certain nombre de correctifs aient été apportés au texte adopté par l’Assemblée nationale. Néanmoins, nous restons opposés à la philosophie qui sous-tend le présent projet de loi qui risque d’envoyer un signal négatif aux délinquants.
J’aurais pu également évoquer la césure du procès pénal qui suscite une grande inquiétude chez les magistrats. Nous n’approuvons pas non plus la suppression des peines planchers. Paradoxalement, les juges devront motiver les peines de prison. Nous assistons à un changement profond de philosophie de la justice pénale.
Madame la garde des sceaux, quoi que vous en disiez, cette réforme de la justice, comme toutes les autres, risque de se heurter à l’absence de moyens. C’est pourquoi les membres du groupe UMP ne pourront voter ce projet de loi. §

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour la suite de son intervention.

Monsieur le président, je vous remercie de votre indulgence !
Les auteurs d’infractions doivent être sanctionnés et les victimes obtenir réparation, mais, avant tout, il faut trouver le moyen de vivre ensemble, dans une société pacifiée. Le présent projet de loi, je le crois, y contribue par le lien social sur lequel il met l’accent.
Si nous regrettons les quelques reculs du texte émanant de la commission mixte paritaire par rapport à celui qui était issu des travaux du Sénat, je veux aujourd’hui me concentrer sur les avancées, les véritables progrès qu’il contient.
Ainsi, les conditions de sortie de détention seront particulièrement encadrées, et ce afin de lutter contre les sorties sèches, véritable terreau de la récidive.
La priorité sera donnée à la préparation de la réinsertion des détenus, aussi bien avant qu’après la sortie de prison. De surcroît, les conditions de mise en œuvre des aménagements de peine resteront celles qui sont inscrites dans la loi pénitentiaire et qui ont été unanimement adoptées par notre assemblée.
Enfin, la commission mixte paritaire, en retenant certaines propositions du Sénat, n’a pas fait l’économie du sort des plus fragiles de nos concitoyens.
D’une part, elle a instauré un mécanisme d’atténuation de peine pour les personnes atteintes de maladies mentales, atténuation couplée avec des obligations de soins.
D’autre part, elle a entériné la création d’une procédure de demande de mise en liberté pour motif médical au bénéfice des personnes placées en détention provisoire.
Cette disposition, qui reprend les termes d’une proposition de loi écologiste adoptée à l’unanimité par le Sénat au mois de février dernier et dont j’ai été le rapporteur, montre que le texte dont nous sommes saisis aujourd’hui permettra d’améliorer le droit et de combler certaines lacunes et certains vides juridiques.
En l’espèce, il s’agit de mettre un terme à une inégalité de traitement entre personnes condamnées et prévenues, en permettant également à ces dernières de bénéficier d’une suspension de peine quand leur état de santé est durablement incompatible avec la détention.
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, c’est avec conviction et sérénité que les membres du groupe écologiste soutiendront ce texte et tous ceux qui contribueront, à l’avenir, à rendre notre société plus juste et davantage inclusive. §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tel qu’il a été présenté, le présent projet de loi s’inscrit dans la lignée de la loi pénitentiaire de 2009, qui doit beaucoup à notre collègue Jean-René Lecerf. Cette dernière encourageait déjà les aménagements de peine, partant du principe incontestable, me semble-t-il, selon lequel la peine a pour objet non seulement de punir le délinquant et de protéger la société, mais aussi de tenter de préparer une réinsertion exempte de récidive.
En mettant l’accent sur la réinsertion du délinquant, notamment au travers de la mise en œuvre de la contrainte pénale – cette nouvelle peine de probation constitue la mesure phare du texte –, le projet de loi constitue donc en quelque sorte un prolongement de la loi pénitentiaire.
Mais, dans le même temps, force est de le constater, les actuels conseillers d’insertion et de probation s’occupent en moyenne chacun de 150 à 200 mesures de probation quand il faudrait, pour que le suivi soit réel et que la mesure porte ses fruits, limiter le nombre de dossiers traités par chaque conseiller à une quarantaine ou une cinquantaine.
Dans le même temps également, nous observons que, même à supposer que l’on parvienne à approcher ce ratio – madame la garde des sceaux, vous nous annoncez la création de 1 000 postes supplémentaires de conseillers d’insertion et de probation sur trois ans –, nous aurons toujours besoin de réaménager notre parc pénitentiaire, dont l’état actuel est loin d’être satisfaisant, avec un encellulement individuel trop rare, alors qu’il devrait être la règle depuis la loi pénitentiaire. Tâchons déjà d’appliquer cette loi !
Vous prévoyez, d’ailleurs, madame la garde des sceaux, un programme d’extension et de rénovation important du parc pénitentiaire, permettant la création de 6 000 nouvelles places…

… et la fermeture d’un peu plus de 1 000 places existantes. Personne ne peut dire que ce programme n’est pas absolument nécessaire. Il est même indispensable, et doit constituer une priorité !
Mais, en regard, la dure réalité budgétaire montre, hélas !, qu’il est quasiment impossible, aujourd’hui, de poursuivre financièrement plusieurs lièvres à la fois, notamment dans le domaine de la justice, où, certes, les moyens évoluent souvent plus vite que dans la plupart des autres secteurs d’intervention de l’État, mais où la France a encore un très important retard à combler par rapport à la plupart des pays comparables.
Certes, au terme de son examen par les deux assemblées et à la suite de l’accord majoritaire trouvé lors de la réunion de la commission mixte paritaire, le texte évite un certain nombre d’excès que nous pouvions craindre avant que le débat n’ait lieu et qui auraient pu s’apparenter à un détricotage en règle de toutes les mesures prises en matière pénale avant 2012 – je pense notamment à la suppression de la rétention de sûreté, qui a été évitée – et à une quasi-systématisation de l’application de la contrainte pénale pour tenter de remédier à la surpopulation dans les prisons.
C’est vrai, nous avons empêché que la contrainte pénale ne devienne la peine principale pour certains délits, contrairement à ce qu’avait initialement proposé M. le rapporteur s’agissant des délits passibles de cinq ans d’emprisonnement, au risque de délivrer un message de laxisme, redoutable pour notre société.
Oui, il faut sortir du tout carcéral, qui a souvent été dénoncé, mais, parfois, avec beaucoup d’exagération. En réalité, combien de courtes peines ne sont pas exécutées ?

Cela dit, il faut aussi poursuivre l’effort de rénovation et d’extension de notre parc pénitentiaire, comme prévu par la loi de 2009. Et, de toute évidence, les moyens vont manquer pour tout mener de front ! J’espère néanmoins me tromper. Cependant, la décision, prise lors de la réunion de la commission mixte paritaire, de généraliser, à partir de 2017, l’application de la contrainte pénale comme peine alternative à tous les délits, y compris, donc, à ceux qui sont passibles de dix ans d’emprisonnement, sans prendre le temps de dresser préalablement un bilan des deux premières années de mise en œuvre de cette nouvelle peine et sans ajuster le nombre de postes de conseillers d’insertion et de probation dont la création figure dans le texte – les 1 000 postes prévus ont été calibrés pour une nouvelle peine applicable aux délits passibles de cinq ans, et non de dix ans d’emprisonnement –, amène les membres de mon groupe, en l’état, à voter contre le présent projet de loi.
À titre personnel, cela ne m’empêche pas d’espérer que notre justice dispose un jour des moyens suffisants pour que l’on puisse réellement et en toute sécurité mieux adapter les peines à la personnalité des délinquants. Néanmoins, aujourd'hui, même si je rends hommage à votre volonté et à votre ténacité, madame la garde des sceaux, je crains, hélas !, que le compte n’y soit pas. §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, si nous pouvons regretter que la procédure accélérée ait été engagée sur le présent projet de loi, nous nous félicitons que ce dernier soit issu d’un long travail de concertation, ce qui est éloigné des débats, trop souvent engendrés sous le coup de l’émotion, auxquels la précédente majorité nous avait habitués en matière pénale.
Ce texte vise à prévenir efficacement la récidive et à donner un sens à la peine.
Pour ce faire, il définit des objectifs précis : sortir du tout carcéral, insister sur la personnalisation des peines, supprimer les mécanismes automatiques faisant échec à l’individualisation des peines et construire un parcours d’exécution des peines efficace en matière de prévention des risques de récidive.
Madame la garde des sceaux, nous approuvons l’ensemble de ces objectifs, même si nous aurions voulu aller plus loin. Par exemple, nous regrettons que la commission mixte paritaire soit revenue sur certaines dispositions qui nous semblaient importantes.
La mesure phare de ce texte, qui répond à l’idée selon laquelle la peine ne doit plus être synonyme de privation de liberté, est la contrainte pénale. Il s’agit d’une peine effectuée en milieu ouvert, entièrement tournée vers le suivi socio-éducatif du condamné, conçue comme un mode de sanction non pas moins sévère que la peine d’emprisonnement, contrairement à ce que l’on peut l’entendre un peu trop souvent, mais plus efficace que celle-ci, parce que plus adaptée au traitement de la plupart des délits.
L’expérience montre qu’une peine exécutée en milieu ouvert peut s’avérer plus contraignante qu’une peine de prison, car elle comporte une obligation de résultat : la personne condamnée sera absolument tenue de suivre les injonctions qui lui seront adressées – in fine, celle d’aller de l’avant. En ce sens, il nous semble que, en termes de lutte contre la récidive, la contrainte pénale sera plus efficace qu’une peine passive effectuée en prison dans les conditions que nous savons.
Le présent texte porte aussi l’exigence d’une individualisation de la peine selon la personnalité du condamné – cela a été évoqué –, avec, notamment, la suppression de mécanismes automatiques limitant les possibilités d’individualisation. Madame la garde des sceaux, vous connaissez la position de mon groupe sur cette question : depuis un certain nombre d’années, nous avons constamment défendu cette exigence, à travers différentes propositions de loi que nous avons déposées. Chacun dans cette enceinte a en mémoire les prises de position de mon amie Nicole Borvo-Cohen-Seat sur ce sujet.

Je soulignerai tout de même une innovation majeure de ce projet de loi : la césure pénale. Ce dispositif permettra de ménager opportunément le temps de la réflexion en autorisant des investigations qui aideront à décider de la peine la plus adaptée à la personnalité du condamné et donc de mieux prévenir la récidive.
Les membres de mon groupe saluent et soutiennent la très grande majorité des mesures de ce texte, mais – car il y a bien un « mais » !
Mme la garde des sceaux sourit.

Par exemple, il a finalement été choisi de maintenir la rétention de sûreté, que la commission avait supprimée. Nous regrettons que, contre toute attente, la majorité actuelle, qui a tant dénoncé cette mesure, …

… ait finalement décidé de la réintroduire en séance publique, prétendument pour préserver un certain équilibre du texte. À nos yeux, ce projet de loi était le véhicule adapté pour la supprimer. Sur ce point, nous sommes, aujourd'hui, dans l’impasse.
De la même manière, nous regrettons que la justice des mineurs soit l’oubliée d’un projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. L’instauration des tribunaux correctionnels pour mineurs, qui n’avait pas été précédée d’un travail de concertation, constitua une profonde régression par rapport au principe fondateur de l’ordonnance de 1945, à savoir faire primer l’éducatif sur le répressif.
Cela dit, madame la garde des sceaux, nous prenons acte de votre volonté de supprimer ces tribunaux dans les prochains mois. Les membres du groupe CRC qui considèrent que la priorité éducative n’exclut pas la fermeté ont un certain nombre de propositions à faire sur ce sujet. Nous sommes donc disponibles pour travailler en concertation avec vous, afin de redonner à l’ordonnance de 1945, que des lois successives ont étouffée, son ambition initiale, c'est-à-dire une juste conciliation entre la protection de la jeunesse et une répression de la délinquance des mineurs mesurée et adaptée.
Malgré ces quelques reculs, nous approuvons, bien entendu, ce texte, selon nous progressiste, qui redonne aux juges les outils permettant de considérer les délinquants autrement qu’à travers un acte ou une énumération de faits. En le soutenant, nous réaffirmons donc ce que nous avons défendu lors de l’examen de la loi pénitentiaire de 2009, à savoir que la peine doit aussi être un temps pour se reconstruire et se réinsérer. C’est, à nos yeux, le seul moyen efficace pour lutter contre la récidive, que la peine soit purgée en milieu ouvert ou fermé. La contrainte pénale, bien que limitée pour le moment dans son champ d’application, y contribuera très certainement, en dépit de ce qu’en disent tous ses détracteurs. Nous voterons par conséquent en faveur de ce texte.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, permettez-moi maintenant de laisser quelque peu de côté le sujet qui nous réunit ce matin pour vous faire part de ma grande colère. Je veux adresser un message au secrétaire d’État censé s’occuper des relations avec le Parlement.
Exclamations sur les travées du RDSE et de l'UMP.
M. René Garrec s’esclaffe.

Je prie ce secrétaire d’État, qui, député, avait voté, avec l’UMP, le traité Merkel-Sarkozy, ce traité qui renforce la crise que connaît notre pays, de ravaler son anticommunisme légendaire
M. Bruno Sido s’exclame.

… pour se consacrer un peu mieux à la mission que lui a confiée le Premier ministre et, surtout, pour déployer son énergie à donner du contenu à l’idée d’une politique de gauche… si ces mots ont encore du sens pour lui !
Enfin, je regrette que le président du groupe socialiste du Sénat s’inscrive dans les pas de M. Le Guen. §

Nous applaudissons les trois quarts du discours, et entendons le dernier !

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, si je n’ai pas les mêmes motifs de colère que ma collègue, je regrette, comme elle, que la procédure accélérée ait été engagée sur ce texte. Nombreux sont ceux à l’avoir déjà dit à cette tribune, et je l’ai moi-même maintes fois déclaré ici-même : la navette parlementaire permet, souvent, d’améliorer les textes. Cette conviction, je ne la renierai pas aujourd'hui.
Pour autant, la navette n’est pas l’alpha et l’oméga ni une garantie à 100 %, comme suffisent à le montrer les propositions de loi régulièrement déposées par notre collègue député Jean-Luc Warsmann pour rectifier un certain nombre d’erreurs, d’inexactitudes ou d’inadaptations figurant dans des textes législatifs votés sans qu’il ait été fait recours à la procédure accélérée.
J’en viens au projet de loi qui nous réunit ce matin : comme cela a été largement répété, il a fait l’objet d’une très large concertation en amont de sa présentation et, même, de son écriture. Il a donné lieu à l’organisation de très nombreux débats et de très nombreuses auditions dans les deux chambres du Parlement. La commission mixte paritaire elle-même, sous l’égide des rapporteurs et des présidents de commission, a énormément travaillé, allant jusqu’à corriger la rédaction d’un certain nombre d’articles. Enfin, et ce point me semble particulièrement important, l’évaluation des résultats du texte, la mesure de son efficacité et les rectifications qui seront éventuellement nécessaires ou utiles sont d’ores et déjà prévues.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ne valait-il pas mieux gagner quelques mois et voter ce texte plus rapidement, de façon que la future loi soit appliquée et évaluée avec davantage de célérité ?

Ainsi, nous serions déjà trois dangereux laxistes à ne rêver que d’impunité en matière de délinquance. Mais je n’en ai pas rencontré d’autres…
Nouveaux sourires.

Globalement, les objectifs sont partagés : punir les délinquants et limiter la récidive. La question reste celle de savoir s'il fallait s'en tenir aux options précédentes et construire des prisons, ou changer complètement de regard.
Madame la garde des sceaux, vous l'avez déjà rappelé plusieurs fois : pour ce qui est de la construction de prisons, jusqu’à présent, le premier euro d'investissement n’était pas prévu, pas plus que le recrutement des personnels – dont il est également question pour la mise en œuvre du présent texte… – requis par ces places de prison censées être construites sans argent ni le budget nécessaire à cette fin ! De sérieux manques pouvaient donc être relevés. Aujourd'hui, la position du Gouvernement consiste à changer de regard.
Cela étant, j’ai entendu dire que la peine d’emprisonnement constitue une sanction plus dure, donc plus efficace. Voilà un paradigme auquel je m'oppose fermement. « Plus dur », qu’est-ce que cela signifie ? La dureté est une notion parfaitement subjective, et c'est le ressenti de la personne qui subit la peine qui doit être pris en considération. Affirmer qu’une peine de prison est plus dure qu’une autre sanction est donc totalement subjectif.
Ensuite, une peine est-elle efficace parce qu'elle est plus dure ? Que doit viser le législateur ? Serait-ce une peine dure infligée à titre de revanche, dans un esprit de vengeance ? Ou bien une peine efficace, qui permet de protéger la société, de rétablir l'ordre public et le droit si c'est nécessaire ? Personnellement, je suivrai bien plus volontiers le Gouvernement sur cette seconde voie, celle d’une sanction efficace. La dureté, en tant que telle, ne revêt aucune signification.
Une sanction doit être adaptée à la personnalité du délinquant, à l’acte lui-même et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Enfin – j’y insiste –, elle doit être non pas dure, mais juste et efficace.
C'est ce qui nous est proposé par le biais de la contrainte pénale, mesure phare du présent projet de loi. Je reprendrai l'exemple cité par Jean-Jacques Hyest, dont l’analyse est celle d’un fin juriste, même si je ne partage pas toujours ses conclusions, pas plus que lui-même ne partage celles de Jean-Pierre Michel : un cambriolage. Selon Jean-Jacques Hyest, la personne cambriolée est atteinte dans son intimité ; sur ce point, il a entièrement raison.
Mais cet exemple m'en rappelle un autre, celui d’une réparation pénale – sorte de contrainte pénale adaptée aux mineurs – particulièrement réussie. Une personne a suivi une bande de gamins âgés de treize à seize ans qui s'amusaient, pendant l’été, à entrer dans des villas, à les dévaster, à casser et à piquer tout ce qu’ils pouvaient ; ils trouvaient cela très drôle !

Ces enfants n’ont pas été mis en prison ni placés dans un centre éducatif fermé. Ils ont été pris en charge dans le cadre d’une mesure de réparation pénale, et ils ont pris conscience de leurs actes. Ultérieurement, selon après la personne qui les suivait, aucun d’entre eux n’a été revu devant un tribunal.
Alors oui, dès lors qu’une sanction est juste, comprise, accompagnée et adaptée à la personnalité du délinquant, elle peut être mille fois plus efficace qu’une peine d’emprisonnement comme on en connaît aujourd'hui.
M. Hyest nous disait aussi que la contrainte pénale était une peine alternative. Eh bien non : elle traduit justement un changement de regard, un changement de position par rapport à la délinquance et aux délinquants… Et la contrainte pénale se doit précisément d’être extérieure à la prison, qui ne doit plus être la peine de référence, sans quoi on tourne en rond : doit-on choisir une sanction dure ou efficace ?
Au final, les membres du groupe socialiste estiment que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est équilibré, novateur, et qu’il porte un nouveau regard, non seulement sur l’acte de délinquance, mais aussi – car on oublie trop souvent que cet acte est commis par une personne – sur les délinquants et le contexte familial et social dans lequel ils vivent, dans une perspective d’inclusion et non d’exclusion.
Avec la contrainte pénale, la fermeté de la réponse pénale est affirmée, tandis que l’individualisation de la peine se trouve confortée. La prison redevient un dernier recours, ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d'être, et les sorties seront accompagnées, ce qui est indispensable si l’on veut lutter contre la récidive. Si, en France, il n’y avait plus de monsieur B. – je ne reviendrai pas sur son cas –, ce serait le rêve, une vraie réussite !
En somme, la société est protégée, et l'ordre public conforté. Comme d’autres, je regrette que le présent texte ne prévoie pas d’abolir le tribunal correctionnel pour mineurs. Cependant, madame la garde des sceaux, j’ai bien entendu sur ce sujet les promesses du Gouvernement, dont je suivrai l’engagement, tout comme cette question, ici ou ailleurs.
Certes, nous aurions pu aller plus vite, et plus loin. Il reste que la conférence de consensus a remué beaucoup de choses ; de nombreuses idées en ont jailli ; nombreux sont ceux à s'être emparés du sujet. Mais un pas a été franchi, celui du changement de regard. Ce pas est prudent, mais il est sûr.
Je rendrais un dernier hommage à M. le rapporteur, Jean-Pierre Michel, pour le travail qu’il a fourni, la cohérence de son propos et sa ténacité, ainsi qu’à Mme la garde des sceaux, pour son opiniâtreté et, de même, pour sa ténacité. Les membres du groupe socialiste soutiendront évidemment ce texte et le voteront des deux mains ! §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je m'exprimerai non pas au nom du groupe UMP, mais en mon nom personnel.

Je souhaiterais d'ailleurs remercier mon groupe de m'avoir accordé, tant en première – et unique – lecture qu’aujourd'hui, un temps de parole significatif, alors que nul n’ignorait nos divergences d’opinion sur ce projet de loi.

Vous le savez, je suis très attaché à la loi pénitentiaire de 2009. Non parce que j’en ai été le rapporteur, mais parce que j’ai conscience qu’elle a marqué une rupture profonde et nécessaire avec l’humiliation pour la République que constituait jusque-là notre univers carcéral.

Or, le projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales s’adosse – c'est indiscutable, et c'est heureux – à la loi pénitentiaire, qu’il s’agisse du sens de la peine, de la volonté de faire de la prison l’exception et l’ultime recours en matière délictuelle, ou encore de l’abandon des querelles stériles sur la primauté qu’il conviendrait d’accorder soit à la lutte contre la récidive, soit à la réinsertion, alors que celle-ci constitue le meilleur moyen de lutter contre celle-là.
Je suis convaincu que nous cherchons tous, sur toutes les travées de cet hémicycle, la réponse la plus efficace à la délinquance, et que nous savons tous qu’elle ne peut résider exclusivement dans la multiplication des places de prison. Je suis également convaincu qu’il n’y a pas de bonne justice sans la confiance de nos concitoyens et qu’il importe de retisser cette confiance des Français dans leur justice.
On pourrait d’ailleurs dire la même chose, mes chers collègues, de la politique et des politiques. Le fossé ne date ni d’hier ni des désillusions de l’actualité. Voilà quelques années, un sondage réalisé sur l’initiative du Conseil supérieur de la magistrature clouait journalistes, politiques et magistrats au pilori de la défiance.
Au cours de ses travaux, la commission mixte paritaire s’est efforcée de concilier les points de vue, parfois largement divergents, des deux assemblées, rendant ainsi à notre bicaméralisme des lettres de noblesse qui menaçaient de se ternir. Elle a aussi contribué à rejeter les réformes dans la réforme. Nous avions déjà écarté des dispositions relatives à la rétention de sûreté. Par ailleurs, j’avais fait observer qu’il était bien malaisé de tenter d’évaluer une loi pour l’essentiel inappliquée en raison de sa non-rétroactivité.
La commission mixte paritaire a fait de même pour ce qui concerne les tribunaux correctionnels pour mineurs. Certes, le Parlement aura à connaître, au début de l’an prochain, d’une réforme de l’ordonnance de 1945, mais, à tout le moins, il pourra aborder le problème de l’enfance délinquante dans sa globalité et non au hasard de l’examen d’un amendement ponctuel.
On a renoncé à faire de la contrainte pénale – l’une des novations essentielles de la réforme – une peine autonome encourue à titre de peine principale pour une série de délits. Elle redevient ainsi – du moins pour le moment – une simple alternative à l’emprisonnement, assortie cependant de moyens de contrôle renforcés. Portalis, §oserais-je dire que je parle ici sous son contrôle ?, devrait s’en satisfaire, lui qui déclarait : « il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible […] de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ».
Quant aux seuils d’aménagement de peine, j’avoue ma satisfaction de voir maintenue la solution retenue dans la loi pénitentiaire : aménagements possibles pour les peines de deux ans au plus concernant les primo-condamnés et pour celles d’un an au plus visant les récidivistes. Ces dispositions auront finalement résisté à bien des récidives gouvernementales…
Voir reconnue l’atténuation de responsabilité pénale à l’égard des personnes condamnées souffrant d’une altération du discernement constitue un autre motif de satisfaction. Cette évolution est d’autant plus indispensable que la distinction entre altération et abolition, largement brouillée par le déficit de lits psychiatriques en milieu fermé, nous convainc de plus en plus difficilement aujourd’hui. C’est un vote unanime du Sénat, datant de près de trois ans et demi, qui trouve ainsi sa consécration.
On ne peut éluder l’éternel débat sur un recul de l’emprisonnement qui marquerait un désarmement de la protection de la société propice au développement de la délinquance et de la récidive – questionnement que l’on retrouve dans le domaine de la contrainte pénale comme ce fut le cas en matière d’aménagement de peine ou d’alternatives à l’incarcération. Mais la réponse n’est-elle pas directement liée aux moyens dont on disposera pour mettre en œuvre et contrôler obligations et interdictions imposées aux personnes condamnées, pour développer le nombre et le contenu des travaux d’intérêt général, et pour renforcer considérablement l’indispensable accompagnement humain, condition essentielle de la qualité de la réinsertion et, partant, de l’absence de récidive ?
Comme le remarquait lors de la réunion de la commission mixte paritaire notre collègue Yves Détraigne, n’est-il pas prématuré de prévoir dès maintenant la généralisation de la contrainte pénale à tous les délits à compter du 1er janvier 2017, alors que les moyens de suivre l’exécution des contraintes pénales sont limités et ne devraient probablement pas avoir connu d’augmentation massive à cette échéance ?
Même si j’en comprends les raisons, je regrette, à cet égard, la suppression par la commission mixte paritaire de la possibilité qui avait été adoptée par le Sénat de déléguer à des associations la mise en œuvre de certaines peines. Cette faculté aurait apporté une part de souplesse qui ne pourra être compensée que par des recrutements massifs de personnels d’insertion et de probation. L’exemple de la loi pénitentiaire s’avère peu encourageant sur ce point et je doute à la fois que les promesses soient respectées et – si, par bonheur, elles étaient tenues – qu’elles suffisent à faire face à la montée des besoins que la réforme devrait générer.
Or, pour que cette réforme marque un progrès, il faut que chacun de nos concitoyens comprenne bien que la contrainte pénale comme les aménagements de peine ne sont pas des cadeaux faits aux délinquants, des procédures dont ils peuvent « bénéficier » – je n’emploie pas ce verbe de façon innocente.
Au contraire, il s’agit d’autres modalités de purger sa peine qui seront considérées par certains comme plus difficiles que l’enfermement, mais qui sont davantage porteuses d’avenir que l’emprisonnement, notamment dans les conditions où, aujourd’hui encore, celui-ci est pratiqué, avec une offre de travail qui n’a jamais été aussi limitée en dépit de l’obligation d’activité voulue par le législateur, avec un taux de détention qui atteint le ratio de 105 pour 100 000 habitants, avec une augmentation sensible du nombre de détenus dormant sur un matelas posé à même le sol et avec, d’une façon générale, des conditions de détention détestables dans bien des maisons d’arrêt.
Mes chers collègues, je ne me berce pas d’illusions sur la capacité de ce texte à modifier radicalement la situation de l’univers carcéral et la lutte contre la récidive, ni sur ses chances d’impliquer la société tout entière – bien au-delà des juges, des forces de l’ordre et de l’administration pénitentiaire – dans l’accompagnement de cette réforme. Mais je crois que la contrainte pénale, comme le refus des sorties sèches, apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de la loi pénitentiaire.
Je crains en outre que, au fil des alternances qui s’enchaînent régulièrement depuis plus de trente ans dans notre pays, les nouvelles majorités ne s’évertuent perpétuellement à défaire le travail de celles qui les ont précédées dans des domaines qui requièrent pourtant continuité et sérénité.
Le présent projet de loi, en tout cas c’est ma conviction, respecte l’acquis de la loi pénitentiaire et en développe même un certain nombre de virtualités. C’est la raison pour laquelle je lui apporterai mon suffrage, comme j’aurais souhaité que la loi pénitentiaire, en son temps, recueille davantage d’assentiments dans cette assemblée sur les travées de l’opposition de l’époque.
Applaudissements sur les travées de l’UMP, de l’UDI-UC, du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste.

La discussion générale est close.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Je vous remercie de m’avoir donné la parole, monsieur le président, car j’avoue que je suis toujours un peu circonspecte en ce qui concerne l’application du règlement du Sénat. Je connais mieux celui de l’Assemblée nationale, mais je n’ai aucun mérite, c’est simplement parce que je l’ai davantage pratiqué.
Par correction à l’égard des sénatrices et des sénateurs qui se sont exprimés, je souhaitais leur adresser mes remerciements pour la qualité de leurs interventions. J’ai apprécié la façon dont certains d’entre eux ont soutenu les dispositions de ce projet de loi, dont ils perçoivent bien, à la fois, la pertinence et l’efficacité attendue. Ils contribuent ainsi à la compréhension et à l’intelligibilité de ce texte, car cela peut s’avérer nécessaire. En effet, les magistrats qui voudront s’approprier les dispositions de ce dernier pourront s’interroger sur l’intention du législateur et la qualité des interventions permettra de les éclairer sur ce point.
Il en va de même, d’ailleurs, quand les intervenants contestent le projet de loi, s’interrogent sur certaines de ses dispositions ou les remettent en cause, parce qu’ils apportent indirectement des réponses qui permettent d’étoffer le débat parlementaire et de préciser l’expression de la volonté du législateur. Dans une démocratie, c’est bien le législateur qui élabore les règles de la vie en commun et il est bon que ceux qui doivent appliquer au quotidien ces règles comprennent bien son intention.
Je prends note des regrets qui ont été exprimés sur le recours à la procédure accélérée. Je ne reviendrai pas sur les propos que j’ai tenus en première et unique lecture et je pense que, même s’il n’y a eu qu’une seule lecture, elle fut de qualité. La loi pénitentiaire avait été examinée, elle aussi, en procédure accélérée et elle n’a pas pour autant perdu en qualité. Pourtant, elle n’avait pas bénéficié d’une maturation aussi longue que le présent projet de loi, dont vous avez suivi de près, mesdames, messieurs les sénateurs, tout le processus d’élaboration. Nous disposions déjà d’un matériau de qualité – disant cela, je ne remets pas en cause le travail accompli par les membres du jury de la conférence de consensus.
D’une façon générale, je suis toujours assez étonnée lorsque l’on me reproche d’envoyer un message aux délinquants, car je n’ai pas le sentiment – et je ne veux pas l’avoir – d’entretenir un dialogue avec les délinquants. La responsabilité législative que vous assumez, à partir des textes que vous soumet le Gouvernement, consiste à élaborer des règles et à s’interroger sur leur qualité, leur pertinence et leur durabilité, vis-à-vis de l’histoire, des valeurs et de la culture de ce pays. Tel est le dialogue que nous avons : c’est un dialogue avec nous-mêmes, avec la société, et non avec les délinquants.
Je ne dirai pas que, pendant les dix années des deux précédents quinquennats, au cours desquelles une centaine de modifications du code pénal et du code de procédure pénale sont intervenues, la majorité de l’époque était en dialogue avec les délinquants. Ou alors, mauvaise foi contre mauvaise foi, je dirai que cette instabilité et cette imprévisibilité ont pu être perçues par les délinquants comme des marques de faiblesse ! Allons-y !
Cela n’a pas de sens, car les délinquants eux-mêmes ne s’interrogent pas sur l’intention du législateur, les nouvelles règles qu’il a adoptées ou la sanction qui punira tel ou tel acte. Les choses ne se passent pas comme cela. S’il y avait un dialogue avec eux, il serait beaucoup plus simple de combattre la délinquance.
Je ne comprendrai jamais ces accusations. Lorsqu’elles sont totalement polémiques, je les laisse passer ; lorsqu’elles semblent argumentées, j’estime qu’elles méritent une réponse, parce qu’un argument se respecte.
Je pense malgré tout que la question n’est pas là. L’important, c’est ce qui a été fait. C’est pour cela que nous avons choisi de mettre en place cette conférence de consensus. C’est pour cela que j’ai fait un tour de France. Je suis allée expliquer ce projet de loi, y compris devant des publics très hostiles. Dans certains cas, les vingt premières minutes étaient très dures, face à des personnes totalement endoctrinées. L’échange portait non pas sur le contenu du projet de loi, mais sur des éléments tirés du discours de propagande qui prospérait depuis plus d’un an.
J’ai aussi proposé et organisé des rencontres avec des élus locaux à la Chancellerie. Je me suis déplacée dans des mairies, des conseils généraux et des conseils régionaux. Je suis allée au-devant des Français pour leur parler du contenu de ce projet de loi et de notre droit pénal.
Lorsque je parle de notre droit pénal, ce n’est pas pour le vilipender ou pour le discréditer. En effet, si nous ne respectons pas nous-mêmes ce qui fait le fondement de notre vie commune, personne ne le respectera ! J’explique simplement que telle disposition est inefficace et qu’il nous faut travailler pour la rendre plus efficace.
M. Hyest a déclaré à la tribune que nous changions de philosophie et que c’était la raison pour laquelle il ne voterait pas ce texte. En revanche, M. Lecerf, que je remercie, a expliqué que nous nous inscrivions dans la philosophie de la loi pénitentiaire. Nous nous inscrivons effectivement dans cette philosophie, mais surtout dans l’histoire du projet pénal républicain propre à la France. Les dix années de bouleversement du droit pénal et de la procédure pénale que j’ai évoquées ont été une parenthèse dans cette histoire.
En première lecture, j’ai rappelé le rôle joué par le Sénat dans la définition du projet pénal républicain. Les sénateurs républicains, de droite, du centre et de gauche, mais aussi des gardes des sceaux de droite ont participé à l’élaboration et à la consolidation du projet pénal républicain. Ils ont pris en considération, comme nous le faisons maintenant, la nécessité de construire un droit de la peine moderne, estimant que l’acte de délinquance mérite sanction, mais que la sanction doit avoir un sens pour la société, pour la victime et pour l’auteur de l'acte. Dans cette perspective, il n’y a pas d’incompatibilité entre la sanction et le travail de réinsertion. Voilà quel est le projet pénal républicain, voilà quelle est l’histoire du droit pénal français !
Les dix années qui ont vu une aggravation des réponses répressives, avec un allongement des durées d’incarcération, ont aussi été caractérisées par des injonctions contradictoires : il fallait réprimer plus sévèrement, enfermer de plus en plus longtemps et, en même temps, aménager de plus en plus vite les peines. Nous sortons de cette parenthèse, qu’il ne me paraît pas nécessaire de caractériser davantage.
Nous avons eu le souci, pendant deux ans, d’analyser la situation, d’évaluer notre système, de nous interroger point par point. C’est ainsi que nous avons constaté l’existence simultanée de mécanismes visant, en amont, à augmenter la durée de l’incarcération et, en aval, à gérer les flux carcéraux, avec la surveillance électronique de fin de peine, la SEFIP, et la procédure simplifiée d’aménagement de peine, la PSAP. De toute façon, le système était victime d’une embolie et il fallait trouver un moyen de régler ce problème. Je ne porte même pas de jugement de valeur sur cette situation, mais nous essayons de l’améliorer, en supprimant ces automatismes, aussi bien en amont qu’en aval, et en mettant en place un dispositif efficace.
Certains d’entre vous ont exprimé leur inquiétude quant aux moyens consacrés à cette réforme et cette préoccupation est légitime. Le Gouvernement y a déjà répondu. Je pense que vous avez entendu cette réponse, mais que vous estimez que nous échouerons néanmoins. Pourtant les moyens que j’évoque ont été inscrits en loi de finances : les 400 recrutements annoncés pour les services pénitentiaires d’insertion et de probation ont déjà été effectués pour l’année 2014 ; il n’y a donc pas de raison de mettre en doute les 300 recrutements annoncés pour l’année prochaine.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai envie de vous inviter à lutter résolument contre ce pessimisme qui vous envahit. Vous n’êtes pas obligés d’être pessimistes ! Je le répète très sincèrement : vous avez beaucoup de mérite ! Je crois que nous allons y arriver, parce que nous avons fait en sorte que les conditions soient réunies, du point de vue normatif comme en termes de politiques publiques.
Le Sénat a du mérite, parce qu’il a produit, pendant des années, le matériau de cette réforme. En première lecture, je vous ai rappelé le rôle du sénateur Bérenger et d’autres personnages, à la fin du XIXe siècle. Dès l’Ancien Régime, et même sous la Restauration, des réflexions ont été développées sur les systèmes pénitentiaires. Nous ne sommes donc pas en train de tout inventer et nous ne cherchons pas à accaparer tous les mérites. Nous pouvons tous convenir qu’une société, à certains moments, peut se rassembler autour de ses principes fondamentaux et, sur cette base, réussir des politiques publiques.
Nous augmentons donc les effectifs du service pénitentiaire d’insertion et de probation de 25 % en trois ans. Nous avons commencé à recruter des personnels pour l’application des peines, mais aussi, depuis 2013, des greffiers, et nous poursuivons cet effort.
Vous savez que nous avons réformé l’Observatoire de la délinquance et des réponses pénales, l’ONDRP, parce que nous voulons disposer de statistiques incontestables, qui nous permettent de mesurer vraiment l’efficacité de cette réforme. Nous sommes tellement soucieux de ce travail de mesure que nous avons laissé l’Assemblée nationale insérer dans le texte un article, que vous avez maintenu, obligeant le Gouvernement à présenter au Parlement une évaluation au terme de deux ans. Ainsi, le Gouvernement se fixe à lui-même un défi terrible, et il le relèvera.
Nous avons également créé un Observatoire de la récidive et de la désistance que nous soustrayons à l’emprise du ministère. Nous voulons donc être capables de mesurer les phénomènes de délinquance, mais aussi d’analyser les facteurs qui favorisent la désistance, c’est-à-dire la sortie de la délinquance. Nous le faisons de façon complètement objective, en conservant la bonne distance.
Depuis dix-huit mois, nous avons développé un important travail interministériel en signant des conventions avec le ministère tant des affaires sociales et de la santé que de l’éducation nationale. Vous savez que la population carcérale présente une sociologie particulière, puisque son taux d’illettrisme est trois fois supérieur au taux national. Nous avons également signé une convention avec le ministère du travail et de l’emploi et nous menons des expérimentations avec les départements et les régions dans le domaine de l’insertion par l’économie.
Ce travail est engagé, allons-y tous ensemble ! Vous nous présenterez vos griefs si nous échouons, ou si des engagements pris n’ont pas été suivis d’effets. En revanche, nous récolterons tous ensemble les fruits de cette réforme si la récidive et la délinquance reculent, si la réinsertion est améliorée, si nous rendons à des personnes le sens de leur propre dignité et, surtout, du respect des règles de la société, bref, si nous leur permettons de mener leur existence dans sa plénitude.
Excusez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir parlé un peu longuement. J’ai bien conscience de mettre un peu de passion dans mon propos, mais je sais que vous partagez cette passion. Je le sais parce que je vous fréquente assidûment depuis deux ans et, surtout, parce que je lis vos travaux depuis plusieurs années.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur les travées du RDSE.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Chapitre IER
Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
Au début du titre III du livre Ier du code pénal, il est ajouté un article 130-1 ainsi rédigé :
« Art. 130 -1. – Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
« 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ;
« 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
L’article 132-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. »
I. – L’article 709-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 709 -1. – Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d’appel, il est institué un bureau de l’exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l’issue de l’audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées. »
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Chapitre II
Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
Section 1
Dispositions favorisant l’ajournement de la peine afin d’améliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu
I. – La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 5 ainsi rétabli :
« Paragraphe 5
« De l’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
« Art. 132 -70 -1. – La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d’ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l’article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.
« Art. 132 -70 -2. – Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. »
II. – Après l’article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 397 -3 -1. – Quand il prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigations sur la personnalité en application de l’article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire en application du premier alinéa de l’article 397-3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du premier alinéa de l’article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 à 397-7, en détention provisoire en application du deuxième alinéa de l’article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l’un des motifs prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° de l’article 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas du même article 397-3 sont applicables. »
Section 2
Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;
2° À la fin de l’article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 ; le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans » ;
3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132 -36. – La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne, lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d’emprisonnement sans sursis.
« La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l’emprisonnement, lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement sans sursis. » ;
4° À l’article 132-37, les mots : « sans sursis emportant révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » ;
5° L’article 132-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° À l’article 132-39, les mots : « si la révocation du sursis n’a pas été encourue » sont remplacés par les mots : « si la révocation totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » ;
7° L’article 132-50 est ainsi rédigé :
« Art. 132 -50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »
II. – L’article 735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 735. – Lorsque la juridiction de jugement n’a pas statué sur la révocation du sursis en application de l’article 132-36 du code pénal parce qu’elle n’avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d’une requête motivée tendant à sa révocation.
« Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s’il y a lieu, de son avocat. »
III. – À la fin de l’article 735-1 du même code, les mots : « les modalités prévues à l’article 711 » sont remplacés par les mots : « la procédure prévue à l’article 735 ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° L’article 132-44 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; »
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger. » ;
3° L’article 132-45 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; »
b) Il est ajouté un 20° ainsi rédigé :
« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger. » ;
4° L’article 132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve dès lors que le manquement ou l’infraction ont été commis avant l’expiration du délai d’épreuve. » ;
5° À l’article 132-56, la seconde occurrence du mot : « second » est remplacée par le mot : « deuxième ».
II. –
Supprimé
I. –
Supprimé
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 723-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique » ;
b) (Supprimé)
(Pour coordination)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 721-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) À la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés.
II. –
Supprimé
À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Le huitième alinéa de l’article 729 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) À la dernière phrase, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
3° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l’article 729-3 est supprimée.
Après l’article 723-17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 723 -17 -1. – Lorsqu’une condamnation mentionnée à l’article 723-15 n’a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
« Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l’article 723-16. »
I. – Après le mot : « punissable », la fin du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée :
« . Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°A L’article 361-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la cour d’assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l’application du second alinéa de ce même article » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article 362 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la cour d’assises a répondu positivement à la question portant sur l’application des dispositions du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, les peines privatives de liberté d’une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu’à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. » ;
2° L’intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du discernement » ;
3° Après l’article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :
« Art. 706 -136 -1. – Lorsqu’une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Le dernier alinéa de l’article 706-136 est applicable. » ;
4° À la première phrase de l’article 706-137, les mots : « d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d’une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;
5° À l’article 706-139, après la référence : « 706-136 » sont insérés les mots : « ou de l’obligation de soins prévue à l’article 706-136-1 » ;
6° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
7° Le premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »
Chapitre II bis
Dispositions relatives à la justice restaurative
Le sous-titre II du titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Sous-titre II
« DE LA JUSTICE RESTAURATIVE
« Art. 10 -1. – À l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
« Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »
Chapitre III
Dispositions instituant la contrainte pénale
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les 2° à 8° de l’article 131-3 deviennent, respectivement, des 3° à 9° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° La contrainte pénale ; »
2° Après l’article 131-4, il est inséré un article 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 131 -4 -1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.
« La contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
« Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 132-44.
« Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
« 1° Les obligations et interdictions prévues à l’article 132-45 en matière de sursis avec mise à l’épreuve ;
« 2° L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, dans les conditions prévues à l’article 131-8 ;
« 3° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ;
« 4° à 6°
Supprimés
« Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132-46.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l’exécution de l’emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.
« Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu’elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.
« Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l’exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d’aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l’application des peines au regard de l’évolution du condamné.
« La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 131-9, après les mots : « ni avec », sont insérés les mots : « la peine de contrainte pénale ou » ;
4° et 5°
Supprimés
II. –
Supprimé
III. – À compter du 1er janvier 2017, au premier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés.
(Supprimé)
Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité de sanctionner certains délits d’une contrainte pénale à titre de peine principale, en supprimant la peine d’emprisonnement encourue, et évaluant les effets possibles d’une telle évolution sur les condamnations prononcées ainsi que ses conséquences sur la procédure pénale.
Au premier alinéa des articles 131-8 et 132-54 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 132-57 du code pénal, les mots : « deux cent dix » sont remplacés par les mots : « deux cent quatre-vingts ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 474, après le mot : « condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, » ;
2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre I er Bis
« DE LA CONTRAINTE PÉNALE
« Art. 713 -42. – Le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.
« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-1 du code pénal.
« Art. 713 -43. – Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du neuvième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de ce même article, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du neuvième alinéa dudit article, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° du même article 131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code.
« La décision du juge de l’application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.
« Art. 713 -44. – La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
« 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;
« 2° Supprimer certaines d’entre elles.
« Art. 713 -45. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.
« En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
« Art. 713 -46. – Le délai d’exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l’application des peines en cas d’incarcération du condamné, sauf lorsqu’il est fait application des trois derniers alinéas de l’article 713-47 ou de l’article 713-48.
« Art. 713 -47. – En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l’article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l’application des peines peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.
« Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le juge saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l’article 712-6 du présent code, fixe la durée de l’emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l’inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l’article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique.
« Lorsqu’il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l’application des peines peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l’article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
« Au cours de l’exécution de la contrainte pénale, le juge de l’application des peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas celle fixée par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal. Si la durée de l’emprisonnement ordonné est égale à cette durée ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.
« Art. 713 -48. – Si le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal. »
« Art. 713 -49. –
Supprimé
3°
Supprimé
II. –
Supprimé
TITRE II
DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L’EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre IER
Principes régissant la mise en œuvre des peines
I. – L’article 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :
« II. –
Supprimé
« III. – Le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions.
« Ce régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières.
« IV. – Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
« V. – Au cours de l’exécution de la peine, la victime a le droit :
« 1° De saisir l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
« 2° D’obtenir la réparation de son préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;
« 3° D’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
« 4° À la prise en compte, s’il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
« L’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ces droits tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
I bis – Après l’article 707-4 du même code, il est inséré un article 707-5 ainsi rédigé :
« Art. 707 -5. – En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l’article 707, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu à l’article 712-14. »
I ter, I quater et I quinquies. –
Supprimés
II. – Le titre préliminaire de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.
I. – Après l’article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article 708-1 ainsi rédigé :
« Art. 708 -1. – Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines s’efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine s’exécute en milieu ouvert. »
II. – L’article 720-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique soit à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines. »
III. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 723-1 et du deuxième alinéa de l’article 723-7 du même code est complétée par les mots : « ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l’article 729-3 ».
IV. – Le premier alinéa de l’article 729-3 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines ».
– L’article 728-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’auteur de l’infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n’a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu’elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la libération du condamné.
II. – L’article L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l’article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l’avant-dernier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
Le premier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
I
« Art. 747-1-2. – Le juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende une peine de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Cette décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire, conformément à l’article 712-6 du présent code. La substitution n’est pas possible si le condamné la refuse ou n’est pas présent à l’audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l’emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l’inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l’article 131-25 du code pénal.
« Par dérogation au second alinéa de l’article 131-25 du code pénal, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. »
II
Chapitre II
Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées
L’article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours ou d’un domicile personnel au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l’élection de domicile mentionnée à l’article L. 264-1 du même code soit auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès de l’organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées
Le premier alinéa de l’article 712-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces juridictions sont avisées, par les services d’insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine. »
Le second alinéa de l’article 13 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils procèdent à l’évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »
Chapitre IV
Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 141-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ;
a bis) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée d’avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
« – du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
« – du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
« – du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« – s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« – du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ;
a ter) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
« La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.
« L’article 64 est applicable à la présente mesure de retenue. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
2° Après le même article 141-4, il est inséré un article 141-5 ainsi rédigé :
« Art. 141 -5. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l’article 59, et après avoir recueilli l’accord du juge d’instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;
3° L’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : «, 14° et 17° » ;
a bis) Le 7° est abrogé ;
b) Au 8°, les mots : « un sursis avec mise à l’épreuve en application des dispositions du 5° » sont remplacés par les mots : « une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un suivi socio-judiciaire, d’une libération conditionnelle, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° » et, après la référence : « 14° », sont insérées les références : «, 19° et 20° » ;
c) Au 9°, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 11° » ;
d) Le 11° est abrogé ;
4° Après l’article 709, sont insérés des articles 709-1-1, 709-1-2 et 709-1-3 ainsi rédigés :
« Art. 709 -1 -1. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa des articles 131-9 ou 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès le début de la mesure de retenue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l’application des peines.
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée d’avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
« – du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
« – du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
« – du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« – s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« – du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« La retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
« La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.
« Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d’empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
« L’article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
« À l’issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l’application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
« Le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est en charge, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.
« Art. 709 -1 -2. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l’article 59, et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République ou du juge de l’application des peines ou sur instruction de l’un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;
« Art. 709 -1 -3. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’à l’issue de son incarcération, une personne condamnée n’a pas respecté l’interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l’application des peines ou, s’il a été fait application du deuxième alinéa de l’article 131-9 ou du second alinéa de l’article 131-11 du code pénal, du juge de l’application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l’ensemble du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation :
« 1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l’article 100 du présent code, à l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
« 2° Pour un crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° de l’article 230-32, à la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;
5°, 5° bis et 5° ter (Supprimés)
6° L’article 712-16-3 est abrogé ;
7° Au dernier alinéa de l’article 63-6 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-53-19, la référence : « 712-16-3 » est remplacée par la référence : « 709-1-1 » ;
8° La première phrase de l’article 803-2 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou de sa retenue » ;
b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou du juge de l’application des peines » ;
9° Au premier alinéa de l’article 803-3, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».
II. – Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : «, de la retenue ou de la rétention ».
(Supprimé)
Après l’article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 41 -1 -1. – I. – L’officier de police judiciaire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :
« 1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l’exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du présent code ;
« 2° Des délits prévus par le code pénal et punis d’une peine d’amende ;
« 3° Des délits prévus par le même code et punis d’un an d’emprisonnement au plus, à l’exception du délit d’outrage prévu au deuxième alinéa de l’article 433-5 dudit code ;
« 4° Du délit prévu à l’article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 5° Du délit prévu à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« 6°
« Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l’officier de police judiciaire peut soumettre l’auteur de l’infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l’obligation de consigner une somme d’argent, en vue de garantir le paiement de l’amende mentionnée au 1° du présent II ou, le cas échéant, de l’amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III du présent article.
« La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l’officier de police judiciaire et acceptée par l’auteur de l’infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s’il y a lieu, l’auteur de l’infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.
« II. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :
« 1° L’amende transactionnelle due par l’auteur de l’infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue ;
« 2° Le cas échéant, l’obligation pour l’auteur de l’infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;
« 3° Les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution de l’obligation de réparer le dommage.
« III. – L’acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
« En cas de non-exécution de l’intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d’homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l’article 41-1 du présent code ou une composition pénale ou engage des poursuites.
« III bis (nouveau). – Les opérations réalisées par l’officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.
« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et du procureur de la République » ;
b) Il est ajouté un article L. 132-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -10 -1. – I. –
Supprimé
« II. – Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d’animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l’administration pénitentiaire, les autres services de l’État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l’exécution des peines et prévenir la récidive.
« Dans le cadre de leurs attributions, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :
« 1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;
« 2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale ;
« 3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent II, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l’autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;
« 4° et 5°
Supprimés
« 6° Informent régulièrement les juridictions de l’application des peines ainsi que le service pénitentiaire d’insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent II et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.
« III. –
Supprimé
« IV. – Les informations confidentielles échangées en application du II du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers.
« L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 132-12-1, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;
4° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 132-13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« À la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De l’information des députés et des sénateurs
« Art. L. 132 -16. – Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l’objet des réunions de ces instances.
« Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance. »
Chapitre V
Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la libération sous contrainte
« Art. 720. – Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l’application des peines.
« À l’issue de cet examen en commission de l’application des peines, le juge de l’application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l’article 707, soit, s’il estime qu’une telle mesure n’est pas possible ou si la personne condamnée n’a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l’application des peines afin d’entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l’application des peines.
« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l’application des peines, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
« S’il n’est pas procédé à l’examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article. »
II. – L’article 712-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, la référence : « et 712-8 » est remplacée par les références : «, 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l’article 713-47 et à l’article 720 » ;
2° À la fin du 2°, la référence : « et 712-7 » est remplacée par les références : «, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l’article 713-47 ».
III. – À l’article 712-12 du même code, les références : « aux articles 712-5 et 712-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article 712-11 ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale, après le mot : « semi-liberté », sont insérés les mots : «, de placement à l’extérieur ».
L’article 721-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721 -2. – I. – Lorsqu’une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n’a pu bénéficier d’une mesure de libération sous contrainte ou d’une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l’application des peines peut, aux seules fins de favoriser l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :
« 1° Des mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal ;
« 2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l’article 132-45 du même code.
« La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d’aide prévues à l’article 132-46 dudit code.
« Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l’article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L’article 712-17 est applicable.
« Le présent I n’est pas applicable aux condamnés mentionnés à l’article 723-29.
« II. – Dans tous les cas, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l’interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l’obligation d’indemniser la partie civile.
« En cas d’inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L’article 712-17 est applicable. »
Chapitre VI
Dispositions visant à instaurer une contribution pour l’aide aux victimes
I. – Après l’article 707-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :
« Art. 707 -6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, sont affectées d’une majoration de 10 % perçue lors de leur recouvrement.
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.
« Cette majoration n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.
« Le montant de l’amende majorée bénéficie, s’il y a lieu, de la diminution prévue à l’article 707-3 du présent code en cas de paiement volontaire. »
II. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409 -1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à L. 612-41 font l’objet d’une majoration de 10 % mise à la charge de la personne sanctionnée.
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.
« Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l’État. » ;
2° Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 621-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration de 10 % mise à la charge de la personne sanctionnée. »
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes. »
IV. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464 -5 -1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à L. 464-5 font l’objet d’une majoration de 10 % mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné.
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes. »
V. – Le second alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration de 10 % mise à la charge des organismes sanctionnés.
« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.
« Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
VI. – §(Supprimé)
TITRE II BIS
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL
Après l’article 147 du code de procédure pénale, il est inséré un article 147-1 ainsi rédigé :
« Art. 147 -1. – En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé, physique ou mental, est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.
« En cas d’urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
« La décision de mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
« L’évolution de l’état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l’article 144 sont réunies. »
I. – L’article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « état de santé », sont insérés les mots : «, physique ou mental, », et les mots : «, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « . La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit » ;
b) À la seconde phrase, les mots : «, lorsque le pronostic vital est engagé, » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « prononcée », sont insérés les mots : « en cas d’urgence ou lorsque » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance. »
II. – L’article 729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement de l’article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé, physique ou mental, est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
(Supprimé)
Lorsqu’un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 735 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l’article 6 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n’a pas été totalement ramenée à exécution.
Toutefois, lorsqu’une juridiction de l’application des peines est saisie de l’octroi d’une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.
I. – Les articles 8, 9 et 10 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de cette date, le 1er janvier 2015.
II. – Les articles 7 bis à 7 quater, 7 quinquies, 16, 17, 17 bis à 18 et 18 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Les dispositions des articles 16 et 17 sont mises en œuvre dans un délai d’un an pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.
I. – Les articles 1er à 11 quater, les articles 13 et 14, le I de l’article 15, les articles 15 ter, 15 sexies à 18 ter, les I à IV et VI de l’article 18 quater, les articles 18 quinquies à 20 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Les articles 12 et 12 bis, le II de l’article 15 et l’article 15 quinquies sont applicables en Polynésie française.
III. – Les articles 12, 12 bis et 15 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 155-1 est complété par la référence : « et L. 132-16 » ;
2° L’article L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° À l’article L. 132-16, les mots : “ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, ” sont supprimés. » ;
3° Au 3° de l’article L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 » est remplacée par les références : «, L. 132-14 et L. 132-16 » ;
4° L’article L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l’article L. 132-16, les mots : “ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, ” sont supprimés. »
V. – L’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, la référence : « de l’article 3 » est remplacée par les références : « des articles 2-1 et 3 » ;
2° Au II, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 » ;
3°Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’application de l’article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, les communes, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions.” »
VI
VII

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Sur les articles 1er à 7 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture,
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Je l’ai dit, et je crois que M. Hyest y a été sensible, le Gouvernement a présenté hier soir plusieurs amendements à l’Assemblée nationale, en alertant les députés sur des risques d’inconstitutionnalité. Je le répète, nous ne faisons qu’évaluer ces risques, ils ne sont pas nécessairement réels. En tout cas, ils donneront lieu non pas forcément à une décision de censure du Conseil constitutionnel, mais peut-être à une réserve d’interprétation. Le Conseil constitutionnel peut aussi décider tout simplement de laisser passer. Quoi qu’il en soit, il est de notre devoir de vous dire que nous avons détecté quelques risques juridiques.
Manifestement le président Hyest partage cette analyse, puisqu’il a évoqué exactement les sujets sur lesquels ont porté les amendements présentés par le Gouvernement hier à l’Assemblée nationale. Ces amendements ont été rejetés, nous ne pouvons donc vous les représenter.
L’amendement n° 1 a pour objet de rétablir un membre de phrase rédigé ici, au Sénat, mais qui a été supprimé par la commission mixte paritaire. La disposition en question vise à inciter les détenus à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul en vue de lutter contre le taux d’illettrisme très élevé que j’ai évoqué. Je me dois de rappeler qu’un député de l’UMP, M. Jean-Frédéric Poisson, avait pris l’initiative de présenter un amendement. Il ne nous avait pas paru pouvoir être adopté en l’état mais je ne m’en étais pas moins engagée à le faire travailler, ce que nous avons fait. Nous défendons en effet cette disposition au Sénat dans le cadre d’un amendement au texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Vous aviez accepté, en première lecture, de faire prendre en considération les efforts pour l’apprentissage de la lecture et du calcul. Nous avions souhaité y ajouter l’encouragement à la participation à des activités culturelles, notamment de lecture.
La commission mixte paritaire a supprimé ce membre de phrase, considérant probablement qu’il y avait une tautologie. Tel n’est pas le cas puisque notre proposition élargit le public qui sera concerné. Certains détenus ne sont pas illettrés mais ils n’ont ni la pratique de la lecture ni l’habitude de participer à des activités culturelles. Notre incitation vise donc un public plus large que celui qui est strictement illettré.

La commission ne s’étant pas réunie, à titre personnel, je vous demande d’adopter ensemble ces quatre amendements qui ont été votés hier par l’Assemblée nationale. Trois d’entre eux sont des amendements de coordination et d’application de la loi : ils ne posent pas de gros problèmes. Le seul amendement de fond est le premier, l’amendement n° 1 sur l’article 7 ter A, qui revient au texte du Sénat en réintroduisant une incitation à la lecture. Nous ne pouvions qu’être favorables à cette proposition. Je vous demande d’accepter, dans un même vote, les quatre amendements que Mme la garde des sceaux vient de vous présenter.

Sur les articles 7 ter à 19, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Hormis les cas prévus par le II du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2014.
II. – Les articles 6, 7 bis, 7 ter, 16, 17, 17 ter, 18 et 18 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
III. – Les dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, ne s’appliquent, s’agissant des condamnations en cours d’exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu’aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter.
IV. – Les dispositions des articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 16 et 17 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d’un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
L’amendement n° 2 a pour objet de définir des dates d’entrée en application de certaines dispositions pratiques, par exemple, l’adaptation informatique du casier judiciaire national, qui nécessitent un délai. Nous vous proposons de différer l’application de certaines de ces dispositions, les unes jusqu’au 1er octobre 2014, les autres étant reportées au 1er janvier 2015.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après la deuxième occurrence du mot :
articles
insérer la référence :
12 bis,
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Les articles 12 et 12 bis
par les mots :
L’article 12
III. – Alinéa 3
Supprimer la référence :
, 12 bis
La parole est à Mme la garde des sceaux.
C’est un amendement de coordination avec la loi pénitentiaire en application en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

La commission s’est déjà exprimée.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
4° À la fin du premier alinéa du VII, les mots : « de l’article 30 est ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « et le cinquième alinéa de l’article 30 sont ainsi rédigés » ;
5° Au deuxième alinéa du VII, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « d’un domicile de secours ou » ;
6° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l’élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d’aide sociale et à l’exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès de l’organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir ; ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec le code de l’action sociale et des familles.

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je donne la parole à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Je voterai contre le projet de loi pour les motifs exposés par Jean-Jacques Hyest, qui s’est exprimé au nom du groupe.
Pour être tout à fait clair dans mon propos et sans vouloir paraphraser notre collègue Jacques Mézard dans son exercice d’explication de texte tout à l’heure, pour ma part, je ne veux pas l’impunité pour les délinquants, quels qu’ils soient. C’est encore mieux dit ainsi ! §Et j’ai moi aussi le sentiment qu’avec ce nouveau texte nous prenons, qu’on le veuille ou non, le risque de lancer aux délinquants le signal d’un certain laxisme – je pèse mes mots !
Pour autant, je souhaite, comme d’autres – nous l’avions dit en première lecture, et cela a été redit toute la matinée –, que nous en finissions avec la récidive et avec les « sorties sèches ».
Sur ce point, à l’issue des travaux de la CMP, a-t-on quelques garanties que le texte qui nous est transmis va véritablement améliorer les perspectives ? Je pense notamment à l’introduction de la contrainte pénale, qui reste un concept flou, dont on ignore aujourd'hui ce qu’il recouvre exactement. De quoi s’agit-il ? N’est-ce pas un « super sursis » avec mise à l’épreuve qui, en s’appliquant à tous les délits punissables à l’heure actuelle de dix ans d’emprisonnement, pourrait pourtant devenir en 2017 un outil tout à fait redoutable du droit pénal ?
Nous l’avons dit, il y avait déjà – il y a encore – un beau texte pour améliorer la situation à cet égard, c’est la loi pénitentiaire de 2009. Si celle-ci n’a pas eu les résultats escomptés, la raison en est naturellement le manque de moyens mis en œuvre pour son application.
Arrivera-t-on aujourd'hui à dégager plus de moyens pour l’application de cette nouvelle loi qui va précisément en exiger plus ? D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir déjà dégagé plus de moyens depuis deux ans ?
Malgré les engagements de Mme la garde des sceaux, qui a largement insisté sur ce point et ce matin encore et compte tenu de la situation budgétaire de notre pays, je ne suis pas persuadé que nous y parviendrons. Car cette nouvelle loi va exiger encore plus de moyens que la loi pénitentiaire de 2009 !
Enfin, permettez-moi de me féliciter de l’abandon en CMP de l’article 8 ter dans sa rédaction issue du Sénat sur proposition du rapporteur, qui faisait de la contrainte pénale une peine autonome. Avant d’en arriver là, il me semble en effet nécessaire que puissent être fournies les conclusions du rapport confié à Bruno Cotte. Mme la garde des sceaux a rappelé ce matin l’importance de cette mission pour la hiérarchie des peines. Dès lors, il faut se féliciter de la décision de la commission mixte paritaire d’accorder un délai de deux ans avant de soumettre au Parlement un rapport sur le sujet. Cela me paraît une excellente chose. Je le répète, je me félicite de cette nouvelle rédaction de cet article 8 ter, mais cela ne va pas m’empêcher – j’ai commencé par-là, je termine par-là ! – de voter contre ce texte.

Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, dont l’intitulé est désormais ainsi rédigé : « Projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ».

M. le Premier ministre, par lettre en date du 16 juillet 2014, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente en matière de transports sur le projet de nomination de M. Philippe Duron pour exercer les fonctions de président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Cette demande d’avis a été transmise à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Acte est donné de cette communication.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en œuvre de la garantie accordée à la société Banque PSA Finance.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des finances.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.