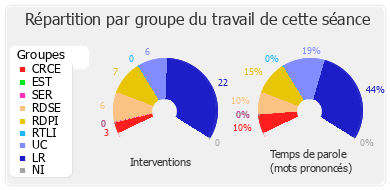Séance en hémicycle du 2 décembre 2009 à 14h45
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil supérieur de l’Établissement national des invalides de la marine et d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’orientation du service des achats de l’État.
Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite respectivement la commission de l’économie et la commission des finances à présenter des candidatures.
Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application des lois n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
Ces documents ont été transmis à la commission des finances et seront disponibles au bureau de la distribution.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », du compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », du compte spécial « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » et du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».
La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » retrace les moyens dont dispose le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.
Cette mission est dotée, pour 2010, de près de 11, 6 milliards d’euros, soit environ 3 % du total des crédits inscrits dans le projet de loi de finances.
Le plafond d’emplois de la mission est fixé à 145 286 équivalents temps plein travaillés : le ministère du budget constitue ainsi le quatrième employeur de l’État. Les dépenses de personnel correspondantes s’élèvent à près de 8, 4 milliards d’euros ; elles absorbent donc, pratiquement, les trois quarts des crédits de la mission. Cette prévision représente une baisse des effectifs de 2 % par rapport à 2009.
Cette diminution résulte de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques et, notamment, de la poursuite de l’intégration des réseaux de l’ancienne direction générale des impôts et de l’ex-direction générale de la comptabilité publique au sein de la direction générale des finances publiques créée en 2008.
Le développement de cette direction générale des finances publiques restera, en 2010, la plus marquante des évolutions dont la mission rend compte. En effet, les nouvelles directions départementales et régionales des finances publiques vont être déployées sur l’ensemble du territoire, à partir de la réunion des directions des services fiscaux et des trésoreries générales. L’achèvement de ce déploiement est prévu d’ici la fin de 2012.
Parallèlement, au niveau infra-départemental, les « guichets fiscaux uniques » sont mis en place pour les particuliers. Dans ce cadre, les démarches d’amélioration de la qualité du service et de simplification au bénéfice des contribuables, particuliers comme professionnels, doivent être poursuivies. En la matière, il faut souligner les efforts de l’administration qui, d’ailleurs, portent leurs fruits, si l’on en juge par les quelque 9, 7 millions de foyers fiscaux qui ont eu recours, en 2009, à la déclaration de revenus en ligne. Le franchissement du seuil des 10 millions de « télédéclarants » est attendu pour 2010. La commission des finances vous donne acte de ce succès, monsieur le ministre.
Cette évolution m’amène à évoquer un autre grand chantier du ministère du budget en 2010 : l’achèvement des deux grands projets informatiques que sont le programme Copernic et le système Chorus.
L’un des enjeux de Chorus est de fiabiliser la comptabilité de l’État, alors que la Cour des comptes a émis une réserve, en ce domaine, à l’occasion de ses travaux de certification.
En ce qui concerne Copernic, l’enquête de la Cour des comptes demandée par la commission des finances a confirmé l’intérêt de cette réalisation, sans dérive des coûts, même si la traçabilité des dépenses laisse un peu à désirer. Le « compte fiscal simplifié » des contribuables, la dématérialisation des échanges avec l’administration, la mise en place de référentiels nationaux constituent autant de progrès incontestables.
Cependant, notre audition « pour suite à donner », qui s’est tenue à la fin du mois d’octobre dernier, a permis de mettre en relief l’opportunité que la direction générale des douanes rejoigne, à terme, les applications développées par le programme Copernic pour la seule direction générale des finances publiques : en effet, les deux directions générales gèrent les mêmes contribuables. À cet égard, la commission des finances attend de connaître votre avis, monsieur le ministre.
Par ailleurs, une incertitude tient au coût des dépenses identifiées comme nécessaires au développement d’applications non imputables sur le programme Copernic, mais indispensables pour la poursuite de la modernisation engagée, notamment l’application destinée au recouvrement non contentieux. Peut-être pourrez-vous nous apporter un complément d’information sur ce point, monsieur le ministre ?
En tout cas, il est indéniable que le ministère chargé de la réforme de l’État se réforme lui-même. Je présenterai tout à l’heure un amendement visant à mieux apprécier les avancées de la révision générale des politiques publiques que ce ministère a la lourde responsabilité de piloter.
Mais, pour le moment, je souhaite vous faire part de la préoccupation que m’inspire l’évolution d’un indicateur souvent pertinent pour apprécier le climat social : le taux d’absentéisme. En 2008, comme en 2007 déjà, une augmentation sensible de cet absentéisme a été constatée dans les deux ministères du pôle économique et financier.
En particulier, on observe une augmentation du nombre de jours de congés de maladie, notamment les congés de maladie de longue durée, de 13 %. Il convient d’être particulièrement attentif à ce phénomène car, à l’évidence, la réforme ne pourra s’appliquer dans de bonnes conditions si elle ne suscite pas la pleine adhésion de ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre, c’est-à-dire les fonctionnaires.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat l’adoption des crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », comme des comptes spéciaux « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », comptes qui n’appelaient pas de commentaire particulier à cette tribune, dans le temps qui m’était imparti.

La parole est à M. Dominique de Legge, en remplacement de Mme Jacqueline Gourault, rapporteur pour avis.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre débat intervient, cette année, dans un contexte de consolidation des réformes entreprises depuis plusieurs années et de poursuite de l’objectif de réduction des effectifs de fonctionnaires que s’est fixé l’exécutif.
Renonçant, pour l’instant, au big bang statutaire préconisé par les conclusions du Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, le Gouvernement privilégie, aujourd’hui, la voie plus pragmatique de la poursuite du mouvement de fusion des corps : engagé dès le début des années quatre-vingt-dix et systématisé à partir de 2005, ce mouvement a permis, en cinq ans, de supprimer plus de trois cents corps. Il est un atout supplémentaire pour la mobilité des personnels et l’évolution de leur carrière.
J’exprimerai deux satisfactions et un regret.
Je me réjouis tout d’abord de la conclusion de deux dossiers suivis attentivement par la commission des lois, d’une part, l’achèvement de l’examen parlementaire du projet de loi sur la mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique, conçu tout à la fois comme la « boîte à outils » de la revue générale des politiques publiques et le remède aux cloisonnements des corps ; d’autre part, le terme du processus d’intégration à Bercy de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, le 1er janvier dernier. La fonction publique bénéficie désormais d’un pilotage cohérent.
Ensuite, votre budget vous permettra, monsieur le ministre, d’accompagner l’évolution et la diversification du recrutement des fonctionnaires.
Je note ainsi avec intérêt l’inscription de crédits destinés au fonctionnement de classes préparatoires intégrées à l’École nationale d’administration, l’ENA, et aux instituts régionaux d’administration, les IRA. Ces formations offrent un soutien pédagogique renforcé et un appui financier pour la préparation des concours externes. Je me félicite que vingt écoles de service public aient déjà mis en place une classe préparatoire : celle de l’ENA est ouverte depuis le 7 octobre et accueille onze jeunes filles et quatre jeunes gens. Il convient d’encourager ce dispositif en veillant à assurer son plein succès.
Parallèlement, la formation des agents publics est professionnalisée, dans l’esprit de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Les épreuves des concours sont remodelées : les IRA ont introduit au concours interne d’accès et au troisième concours la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Le taux de présence aux épreuves de la session 2008-2009 semble prouver l’adéquation de ces réformes aux attentes des futurs fonctionnaires.
Ces évolutions contribueront à accroître l’efficience des administrations, et donc la qualité du service rendu aux usagers.
Je conclurai mon propos en évoquant l’interruption pour le moins regrettable de l’aide ménagère à domicile, ou AMD.
Je le rappelle, cette aide s’adressait aux agents retraités de l’État faiblement dépendants, que cette perte d’autonomie soit permanente ou transitoire. Elle était alignée sur celle que finance la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les attributaires du régime général.
Constatant, non sans raison, d’ailleurs, que, pour les fonctionnaires, cette prestation bénéficiait à des profils moins strictement sélectionnés, le Gouvernement a souhaité procéder à un repositionnement de l’AMD et lancer une réflexion sur le champ et les modalités d’intervention de l’État à l’égard de ses agents retraités.

Cette prestation n’a donc pas été reconduite au 1er janvier 2009, et la réflexion demeure malheureusement, à ce jour, inaboutie. Mais j’ai bien noté, monsieur le ministre, lors de votre audition par la commission des lois, que vous vous êtes engagé à venir nous présenter les conclusions de vos travaux au cours du premier trimestre de 2010.
Cette aide correspond à un besoin réel, et je suis sûr, pour ma part, que nous trouverons une solution.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera plus spécifiquement sur le compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».
Dans le projet de loi de finances qui nous est soumis, la prévision des produits de cessions immobilières est assez ambitieuse, puisqu’elle s’élève à 900 millions d’euros, dont les trois quarts, soit 700 millions d’euros, devraient provenir de cessions réalisées par le ministère de la défense. Ce dernier se trouve en effet engagé dans un vaste mouvement de rationalisation immobilière – du moins peut-on l’espérer –, avec le regroupement de ses services centraux sur le site de Balard et le nouveau plan de stationnement des forces militaires.
Monsieur le ministre, compte tenu de l’état du marché, la réalisation de cet objectif de cessions paraît plus qu’incertaine, d’autant que la prévision repose non pas sur une véritable programmation, mais, pour l’essentiel, sur les arbitrages de la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014.
L’objectif de cessions immobilières retenu dans le cadre de la loi de finances pour 2009 était déjà exceptionnel : 1, 4 milliard d’euros de produits, dont un milliard issu des cessions du ministère de la défense. Or, selon le dernier point d’information qui m’est parvenu de vos services, le 15 octobre dernier, seuls 356 millions d’euros de recettes ont été enregistrés. Autrement dit, l’objectif pour 2009 ne sera pas atteint.
Par conséquent, il est à craindre que le niveau relativement bas – 200 millions d’euros – de l’objectif fixé pour 2010 en ce qui concerne les cessions autres que militaires ne reflète le souci du Gouvernement de minimiser, dans les résultats d’ensemble qui seront constatés, l’insuffisance déjà anticipée des ventes du ministère de la défense.
À partir du moment où votre chiffrage s’avère très artificiel, l’information donnée au Parlement paraît largement dépourvue de signification.
J’attire d’ailleurs votre attention sur un problème que vous connaissez bien : la contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État devrait rester très modeste. Seuls 30 millions d’euros sont prévus à ce titre, soit 3, 3 % des produits théoriques. Cette situation découle du fait que le niveau de crédits a été déterminé de façon automatique, en retenant les 15 % de la prévision de cessions non militaires, car, nous le savons, le ministère de la défense bénéficie d’un retour intégral du produit de ses ventes dans la perspective de ses dépenses immobilières.
Je souhaite également dire un mot des avancées récentes de la politique immobilière de l’État. Je tiens à le rappeler, car cela me tient à cœur, les cessions ne sauraient tenir lieu de doctrine d’action. À ce sujet, je parlerai donc d’un effort, que je reconnais, de maîtrise des coûts et de rationalisation des implantations.
D’une part, cette politique fait aujourd’hui l’objet d’une refondation fort opportune. Il s’agit d’un « nouveau départ », qui se traduit par l’amélioration de l’inventaire et de la valorisation du patrimoine immobilier de l’État, par la substitution, au régime traditionnel de l’affectation des immeubles domaniaux, de nouvelles « conventions d’utilisation », et par la mutualisation partielle, entre ministères, de l’emploi des produits de cessions immobilières.
D’autre part, le champ d’application de la rationalisation immobilière est en cours d’extension.
Sur le plan institutionnel, ce mouvement s’exerce au bénéfice de l’ensemble des services déconcentrés et en direction des opérateurs de l’État. Je sais, monsieur le ministre, que, à l’instar du Parlement, vous tenez à ce que ces derniers participent à l’effort global de rationalisation. Ces mesures sont conformes aux préconisations de la commission des finances.
Sur le plan opérationnel, l’élargissement concerne l’entretien des bâtiments et la gestion des baux. C’est une avancée qui mérite aussi d’être soulignée.
Au cours du contrôle budgétaire que j’ai effectué au premier semestre de cette année sur la gestion des baux en Île-de-France, j’ai pu mettre en évidence la méconnaissance du parc loué par l’État et le caractère onéreux des loyers qu’il acquitte, lesquels se situent souvent au-dessus du prix du marché. Modestement, ce rapport a donc servi d’aiguillon parlementaire et a contribué à ce qu’une révision des conditions locatives appliquées aux implantations de certains services soit conduite. Je pense, par exemple, au cas du Médiateur de la République et à celui du secrétariat d’État aux sports.
Parallèlement, des mesures structurantes ont été mises en place, consistant en une expérimentation d’un « tableau de bord » des baux de l’État pour une trentaine de départements, conformément à la recommandation que j’avais formulée, et, surtout, en un marché de renégociation – sorte de processus industriel – des baux de l’État en Île-de-France, signé en septembre dernier.
Monsieur le ministre, au-delà de ces points positifs, il existe encore des marges de progression. Il faut inciter France Domaine à aller plus loin et veiller à éviter la résurgence des mauvaises pratiques ou des négligences. L’attention doit être renforcée quant au coût des implantations.
C’est dans cette perspective que je présenterai, tout à l’heure, un amendement visant à améliorer l’information donnée au Parlement sur les engagements immobiliers de l’État.
D’une manière générale, si je ne craignais pas cet anglicisme, je dirais que la politique immobilière du ministère se présente comme un work in progress. Tout le monde l’aura compris, les marges de progression restent importantes, tant il est vrai que l’organisation et la gestion du parc immobilier de l’État sont toujours en chantier.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est sous le bénéfice de ces observations que la commission des finances a décidé de proposer au Sénat l’adoption des crédits du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le programme 221 « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » recouvre les budgets des principales administrations chargées de piloter la modernisation de l’État et la révision générale des politiques publiques, la RGPP, notamment ceux de la direction du budget et de la direction générale de la modernisation de l’État, la DGME.
À titre personnel et avant de vous présenter la position de la commission des lois sur ce programme, je tiens à vous faire part de ma réserve sur un certain nombre de principes qui animent la RGPP, à commencer par le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
La modernisation de l’État, selon moi, n’a de sens que si elle place le citoyen au cœur de son ambition. C’est pourquoi, afin d’en comprendre les ressorts, j’ai proposé à la commission des lois de porter une attention particulière aux deux chantiers complémentaires de la modernisation de l’État, qui visent chacun à faire évoluer la manière dont l’administration s’adresse aux citoyens et les services qu’elle lui offre. Il s’agit du développement de l’administration numérique et de l’amélioration de l’accueil dans les services publics.
Le bilan que l’on peut dresser du développement en cours de l’administration numérique, avec le site « mon.service-public.fr » et le dispositif « Ma démarche en ligne », est plutôt positif.
Néanmoins, pour mieux comprendre à quel public s’adressent ces nouveaux services, il serait souhaitable que la direction générale de la modernisation de l’État conduise une enquête sur le profil des utilisateurs de l’administration numérique. Dans la mesure où une telle étude lui permettrait, entre autres, d’identifier les publics qui ne sont pas concernés par la simplification des démarches administratives permise par la plateforme « mon.service-public.fr », elle serait ainsi incitée à développer, à leur intention, des actions spécifiques en matière de simplification administrative.
Tout ne peut être attendu de l’administration numérique : la garantie d’une haute qualité de l’accueil doit donc rester l’un des objectifs principaux de la modernisation de l’État.
L’amélioration de l’accueil figure d’ailleurs au nombre des objectifs fixés par le Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007. Elle passe par le déploiement, au sein des administrations, du référentiel Marianne, dont j’ai pu constater la pertinence au cours de mes déplacements.
Monsieur le ministre, je formulerai néanmoins trois réserves, en y associant trois recommandations.
Premièrement, pourquoi ne pas avoir publié « l’enquête mystère » conduite par la DGME pour étudier, à grande échelle, la qualité réelle de l’accueil dans les administrations ? Seules quelques très grandes tendances générales ont été communiquées par vos services, ne permettant absolument pas de se faire une idée précise pour chaque administration. Je note par ailleurs que l’absence de publication est contraire aux engagements pris lors dudit Conseil de modernisation des politiques publiques. Un tel document constituerait, pour les administrations concernées, une incitation puissante à engager la réforme de leurs procédures d’accueil.
Deuxièmement, la qualité de l’accueil ne peut reposer exclusivement sur l’investissement des personnels, même si celui-ci est essentiel. Elle représente un coût, que les gestionnaires et l’État doivent prendre en compte afin d’y consacrer des moyens financiers et humains suffisants.
Troisièmement, il est nécessaire de garantir la qualité de l’accueil en dépit des restructurations.
J’ai pu le constater, lorsque les services doivent procéder à une réforme de leurs procédures ou une à réorganisation de leurs structures, il arrive souvent que l’exigence de qualité de l’accueil soit mise de côté, malgré toute l’attention qui peut lui être portée par ailleurs. Or la RGPP a pour conséquence une multiplication de ces restructurations. Si l’on peut comprendre que la désorganisation de certains services rende difficile le maintien du même niveau d’accueil, il n’est pas acceptable que le public, en particulier les personnes les plus vulnérables, en fasse les frais et voit l’accès à ces services rendu plus malaisé.
La DGME devrait, à ce titre, fournir une aide spécifique aux services engagés dans une restructuration pour leur permettre de maintenir la qualité de leur accueil. D’une manière générale, elle devrait aussi assurer un meilleur suivi des administrations passées au référentiel Marianne, pour les encourager à poursuivre leur investissement.
Tous ces exemples le montrent, la modernisation engagée doit répondre au souci constant d’apporter un meilleur service aux citoyens.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, à la lumière de ces observations et recommandations, la commission des lois a entendu donner un avis favorable à l’adoption des crédits du programme 221 « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».

J’indique au Sénat que, pour cette discussion, la conférence des présidents a fixé le temps de parole à cinq minutes pour chaque groupe et à trois minutes pour la réunion des sénateurs n’appartenant à aucun groupe.
Je rappelle également que l’intervention générale vaut explication de vote pour ces missions.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Bernard Vera.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le périmètre de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » comprend la gestion patrimoniale de l’État et recouvre une bonne partie des enjeux de la fonction publique, puisque les crédits dévolus aux politiques de ressources humaines de l’État y sont intégrés. Je me bornerai donc, ici, à une simple évaluation des programmes relatifs au fonctionnement de nos administrations fiscales.
Le projet de budget pour 2010, comme beaucoup d’autres avant lui, fait de la réduction des effectifs de l’administration fiscale l’une des priorités de sa définition et de son exécution.
Cette année encore, près de 3 000 emplois vont être supprimés, menant l’administration à l’un des plus faibles niveaux d’emploi qu’elle ait jamais connus.
Pour la seule direction générale des finances publiques, la DGFIP, ce sont 2 569 emplois qui sont appelés à disparaître en 2010, car, selon ses responsables, les « avancées technologiques » et les « gains de productivité » sont tels que l’on peut, sans remettre en cause la qualité de service, ajuster le nombre d’emplois à la baisse.
À la vérité, une telle vision ne fait que s’appuyer sur quelques dogmes très prisés dans les milieux patronaux et gouvernementaux, notamment celui qui voudrait que « moins de fonctionnaires, ce serait moins de dépenses publiques et moins de déficit ».
L’un des problèmes, d’ailleurs mis en exergue dans son rapport par notre collègue Bernard Angels, est que la fusion entre les services du trésor et des impôts, qui a fait émerger la direction générale des finances publiques, ne semble pas rencontrer l’adhésion des personnels eux-mêmes.
Le dialogue social à la DGFIP est de plus en plus complexe, comme le montre le fait savoir que les organisations syndicales représentatives des personnels ont toutes quitté, le 30 novembre dernier, le comité technique paritaire central, dont l’ordre du jour portait précisément sur le budget pour 2010, est particulièrement éclairant à cet égard.
De même, l’augmentation du nombre de jours d’arrêt maladie, témoignant du mal-être des personnels, ainsi que l’accroissement non négligeable de la participation des agents aux mouvements revendicatifs sont autant de signes révélateurs de certains dysfonctionnements dans notre administration fiscale. La cause en est connue : les missions de service public – essentielles pour la nation – accomplies par les services fiscaux sont de plus en plus mises en cause.
Le plan de relance de l’économie, ne l’oublions pas, a consisté, pour une large part, à faire des centres des finances publiques des « guichets ouverts » de remboursements anticipés pour les entreprises, sans que des mécanismes de vérification ou de simple contrôle des procédures en question soient réellement mis en place.
En clair, on a recommandé aux agents, aux contrôleurs, aux inspecteurs de la DGFIP de réduire les activités de contrôle fiscal et de mettre l’administration au service des objectifs politiques immédiats du Gouvernement.
L’adoption successive de nouvelles procédures, telles que la télédéclaration, le télépaiement, le rescrit fiscal, l’expérimentation de nouvelles modalités de contrôle, conduit d’ailleurs à constater que, dès qu’il s’agit des entreprises, l’administration fiscale finit par adopter un profil nettement plus coopératif que celui qu’elle met en œuvre vis-à-vis des particuliers.
Pendant ce temps, on le sait, les avancées technologiques ne sont pas toujours des plus pertinentes.
En effet, dans un rapport d’information déposé le 28 octobre dernier, notre rapporteur spécial Bernard Angels indique que le programme COPERNIC, destiné notamment à faciliter ce que l’on appelle la e-administration, s’avère pour l’heure d’un montant supérieur aux prévisions initiales et d’une efficacité aléatoire, ainsi que l’ont montré certaines campagnes de recouvrement.
Le fait que COPERNIC ait été lancé par la seule DGI et que l’outil semble peu adapté à la nouvelle DGFIP, qui regroupe donc les services des impôts et du trésor, constitue d’ailleurs un problème réel. Cette fusion apparaît bel et bien comme la source de toutes les difficultés actuelles.
Nous nous y sommes opposés dès l’origine, notamment parce que l’un des principes sur lesquels s’est construite notre République est la séparation entre celui qui établit le rôle de l’imposition de celui qui en encaisse le produit.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, les dérives qui minent aujourd’hui le service public fiscal, et dont le budget pour 2010 est la traduction, ne peuvent recevoir notre agrément. C’est pourquoi les parlementaires du groupe CRC-SPG ne voteront pas les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera exclusivement sur le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ». À écouter notre collègue Nicole Bricq et à lire son rapport, la politique retracée dans ce compte serait encore très perfectible.
J’irai beaucoup plus loin en relevant que la gestion du patrimoine immobilier de l’État doit être très fermement prise en main. C’est toute la logique actuelle qui doit être revue, faute de quoi les pratiques récemment épinglées par la Cour des comptes n’auront aucune raison de cesser.
Certes, tout avait bien commencé avec la création, par l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2005, d’un compte d’affectation spéciale retraçant les recettes de cessions des immeubles de l’État et leur emploi. Cette mesure a coïncidé avec la mise en œuvre d’une politique immobilière étatique volontariste.
Ce compte mûrit encore dans le document budgétaire qui nous est présenté avec la double extension de son périmètre. En particulier, l’intégration aux recettes des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État ne pourra qu’en améliorer la lisibilité. Ainsi disposerons-nous de l’ensemble des recettes issues de la rationalisation du parc immobilier étatique au sein du même véhicule budgétaire.
Toutefois, par-delà la question formelle de la fidélité du cliché présenté au Parlement, se profile le problème essentiel : quelle est la stratégie immobilière de l’État ? En l’état actuel, elle semble inexistante.
Les documents qui nous sont soumis ne révèlent qu’une logique d’affichage purement quantitative. À partir de 2005, France Domaine s’est vu assigner des objectifs annuels de cessions immobilières de plus en plus ambitieux, afin d’accroître les recettes budgétaires non fiscales et de réduire le déficit.
Cette logique de surenchère dans la vente conditionne tout le reste, c’est-à-dire tout ce que dénonce le rapport public annuel 2009 de la Cour des comptes et ce à quoi il faut mettre fin.
À cet égard, je formulerai trois critiques.
D’abord, nous n’avons pas forcément vendu ce qu’il fallait. Afin de remplir leurs objectifs chiffrés, les services ont privilégié la cession des bâtiments les plus prestigieux et les plus coûteux. C’est ainsi que les produits se sont concentrés sur un petit nombre de cessions intervenues principalement dans la capitale, dont je suis l’un des élus. La quasi-totalité des cessions concerne des immeubles situés dans les VIe, VIIe, VIIIe et XVe arrondissements de Paris. Or la plupart des ministères concernés n’avaient pas donné leur assentiment. C’est ainsi que l’on a vendu le centre de conférences internationales de l’avenue Kléber et l’hôtel de Montesquiou-Fézensac, rue Monsieur.
Ensuite, non seulement nous n’avons pas forcément vendu ce qu’il fallait, mais, par ailleurs, l’État a pu mal vendre ses biens. Je ne suis pas persuadé que la cession de l’immeuble de l’avenue Kléber ait été une opération rentable, compte tenu du fait que l’organisation dans un autre lieu des trois ou quatre congrès ou sommets susceptibles qui auraient pu s’y tenir coûtera autant que ce que la vente a pu rapporter. Disant cela, je ne fais que paraphraser le propos de M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes. Lors de l’examen de la mission « Action extérieure de l’État », M. le ministre des affaires étrangères et moi-même nous sommes accordés sur la nécessité d’avoir à Paris un vrai centre de congrès.
À l’avenir, il est possible que nous vendions encore plus mal, étant donné que France Domaine se voit assigner des objectifs qui sont indépendants de l’état du marché immobilier.
Même lorsque le marché était haussier, les cessions de l’État n’ont sans doute pas été réalisées au meilleur prix, comme en témoignent les plus-values phénoménales obtenues en un temps record par un trop grand nombre des principaux acquéreurs de biens étatiques. L’une de ces plus-values a atteint 106 % du prix d’achat en seize mois ! Une autre a pu se chiffrer à 34 % en quinze jours ! Si des cessions si aberrantes ont pu être consenties dans le cadre d’un marché haussier, qu’en sera-t-il aujourd’hui ?
Enfin, ceci découlant sans doute de cela, dans la hâte à faire du chiffre, les ventes ont été réalisées dans de très mauvaises conditions juridiques.
L’augmentation du nombre des opérations et de leur importance financière ne s’est pas accompagnée d’un renforcement des règles régissant les procédures de cessions immobilières, qui demeurent incomparablement plus réduites que celles qui sont retenues ordinairement par l’État dans des domaines à fort enjeu financier, tels que celui de la commande publique.
Les dispositifs juridiques encadrant les cessions immobilières de l’État sont largement insuffisants. Contrairement à ce qui régit l’achat public, il n’existe aucun texte garantissant et organisant l’égalité de traitement entre les candidats. Le seul texte organisant les opérations de vente est un guide pratique des cessions amiables. En l’absence de règles précises, le contrôle des opérations et l’éventuelle sanction pour atteinte à la transparence des procédures sont rendus impossibles.
De plus, l’information fournie à la commission créée par l’arrêté du 20 octobre 2005 et chargée de veiller à la transparence et à la qualité des opérations de cession amiable d’immeubles du domaine privé de l’État est encore très incomplète. Et les plus importantes opérations, celles de gré à gré, en sont tout bonnement exclues.
Plus grave encore, ainsi que la Cour des comptes le révèle dans son rapport, les mouvements financiers par lesquels les investisseurs se portent acquéreurs de biens immobiliers de l’État ne sont pas toujours aisés à suivre et peuvent conduire à des dérives inadmissibles.
C’est le cas lorsque se substituent aux acquéreurs des sociétés non résidentes et immatriculées dans des paradis fiscaux. C’est déjà arrivé à plusieurs reprises pour des opérations très importantes impliquant des sociétés immatriculées au Luxembourg ou aux Îles Vierges britanniques.
Mes chers collègues, on ne peut pas, d’un côté, approuver le discours volontariste du Président de la République contre les paradis fiscaux et, de l’autre, laisser l’État faire ce genre de choses. Il faut être cohérent !
Je souhaite donc vous interroger, monsieur le ministre. Pour ce qui concerne le passé, le Gouvernement a-t-il l’intention de lancer une série d’enquêtes sur les cessions les plus problématiques déjà réalisées, voire de leur donner des suites judiciaires ? Pour l’avenir, le renforcement du corpus juridique des cessions immobilières du domaine privé de l’État est-il à l’étude ? En particulier, la généralisation des clauses de sauvegardes en cas de plus-values et la saisine systématique de TRACFIN pour les cessions les plus importantes sont-elles envisagées ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, puisque cinq minutes seulement me sont imparties, je limiterai mon intervention à quelques points du programme 148 « Fonction publique », non sans rappeler le contexte pour le moins brutal dans lequel il s’inscrit.
On constate en effet de nouvelles réductions massives des effectifs de fonctionnaires – près de 34 000 postes pour 2010, soit 100 000 postes au total en quelques années –, et une revalorisation très faible du point d’indice, auxquelles s’ajoute une loi dite de mobilité, nouvelle boîte à outils de votre « réduction » générale des politiques publiques
Concernant les crédits inscrits à ce programme au titre de la formation interministérielle, je m’inquiète de la baisse de 1, 9 % de la dotation aux instituts régionaux d’administration, dans la mesure où le nombre d’élèves de la future promotion est stable et que des charges nouvelles seront engendrées par la création de classes préparatoires intégrées et par la revalorisation du régime indemnitaire des personnels. Avec l’École nationale d’administration, il y a vraiment deux poids, deux mesures !
Par ailleurs, je regrette la suppression de l’indicateur mesurant l’utilisation effective du droit individuel à la formation, le DIF, dans le projet annuel de performances. La mise en œuvre intégrale de ce droit, mesure phare des lois de 2007, était pourtant prévue pour 2011.
Comme le démarrage en est, semble-t-il, poussif – en 2008, 868 agents ont été concernés pour 2 330 jours de formation –, l’indicateur disparaîtrait-il opportunément pour masquer de piètres résultats ? Je n’ose le supposer !
Les crédits de paiement consacrés à l’action sociale interministérielle s’élèvent, quant à eux, à 139, 4 millions d’euros.
Après une baisse de 4, 2 %, un tel plafonnement de l’enveloppe budgétaire empêche, de fait, de réaliser les engagements gouvernementaux, qu’il s’agisse de la nouvelle prestation d’aide au logement des enfants des agents poursuivant leurs études hors du domicile familial ou de la rénovation de l’aide ménagère à domicile.
Cette dernière a été brutalement supprimée en 2009, alors qu’elle correspondait à un réel besoin, au regard de la progression régulière du nombre de ses bénéficiaires. Le secrétaire d’État chargé de la fonction publique alors en place avait promis de la « repositionner » et de lui substituer – je cite la réponse qui a été faite à ma question écrite – « une prestation d’aide au maintien à domicile, susceptible de bénéficier à plus de retraités ». Or il n’en est toujours rien et le comité interministériel consultatif d’action sociale du 22 octobre dernier n’a pu que constater l’impossibilité de relancer l’AMD.
Dans les crédits, cela se traduit par une diminution de 89 % des aides aux agents retraités ! L’État se désengage ainsi de manière scandaleuse de tout effort spécifique envers les retraités et crée une coupure préjudiciable entre ces derniers et les actifs.
De surcroît, l’action sociale se transforme insidieusement en complément de salaire. C’est pourquoi les prestations individuelles sont systématiquement privilégiées au détriment du collectif, qu’il s’agisse de la restauration, de la garde des jeunes enfants ou du logement.
Pourtant, les prestations individuelles ne devraient exister que lorsqu’une structure collective ne peut vraiment pas être mise en place.
Certes, les jeunes parents s’accommodent du chèque emploi service universel, le CESU-garde d’enfant, qui monte en puissance, mais c’est surtout parce qu’il n’y a pas suffisamment de berceaux réservés en crèches. Qui a connu le casse-tête de rechercher une « nounou » sait combien il est plus simple, plus rassurant et moins onéreux d’obtenir une place en crèche.

Très cher aux collectivités locales et beaucoup moins à l’éducation nationale, qui ne veut plus accueillir les enfants de deux à trois ans.
Monsieur Arthuis, à Neuilly-sur-Marne, sur une classe d’âge représentant 600 enfants, la moitié seulement était scolarisée. Actuellement, il n’est plus possible de scolariser les enfants de deux à trois ans.

L’État s’est totalement désengagé en la matière, ce qui est une catastrophe pour les parents à la recherche de places en crèche.
Il serait bon que l’État favorise un peu ses fonctionnaires.
De même, l’agent qui dispose d’un restaurant interadministratif n’aura nul besoin de chèques-restaurant. Les qualités nutritives des menus qui y sont proposés sont par ailleurs facteur de bonne santé et contribuent à lutter contre l’obésité, contrairement aux sandwichs et autres hamburgers achetés à l’extérieur !
Par ailleurs, les crédits d’aide au logement sont en diminution sensible, avec des baisses de 17, 2 % pour l’aide à l’installation des personnels de l’État et de 54 % pour le prêt mobilité.
Monsieur le ministre, lors de votre audition devant la commission des lois le 17 novembre dernier, vous nous avez avoué ne pas avoir d’explication à ces baisses, ce qui est tout de même assez curieux ! Peut-être pourrez-vous aujourd’hui nous apporter quelques précisions.
Selon vos services, la faiblesse du nombre de dossiers de prêts mobilité, environ 300 en 2009, serait « liée à son caractère récent et à une information des potentiels bénéficiaires encore réduite ». Lancer une campagne d’information serait donc sans doute préférable à diviser l’enveloppe par deux !
Je m’interroge également sur le contingent préfectoral. En effet, les préfets se trouvent, tout du moins en Île-de-France, dépassés par les demandes déposées sur la base de la loi sur le droit au logement opposable, et les fonctionnaires de l’État ont de plus en plus de difficultés à accéder à leur parc de logements sociaux. J’aimerais obtenir également des précisions sur ce point.
Pour conclure, ce budget témoigne d’une nouvelle réduction irraisonnée des effectifs, d’un pouvoir d’achat en berne, d’atteintes répétées au statut et d’incertitudes liées à la réorganisation de l’administration territoriale de l’État. Le groupe socialiste ne saurait voter des crédits qui traduisent une politique de sape et de défiance envers les fonctionnaires !
Mme Monique Papon remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je répondrai aux différents points qui ont été évoqués par les intervenants plutôt que de me lancer dans un discours général sur la gestion des finances publiques et des ressources humaines.
Tout d’abord, comme vous l’avez souligné, monsieur Angels – et je vous en remercie –, le budget de mon ministère est maîtrisé. La politique de recherche d’efficacité et de maîtrise des coûts menée dans le cadre de la mission « Gestion des finances publiques et ressources humaines » a déjà permis de dégager des gains de productivité très importants, puisque plus de 18 000 départs à la retraite n’auront pas été remplacés sur la période 2003-2010, faisant ainsi du ministère du budget le premier contributeur aux réductions d’emplois dans la fonction publique.
L’année prochaine, ce sont près de 2 900 départs à la retraite qui ne seront pas remplacés, soit 58 % du total. Les crédits de titre 2 hors CAS « Pensions » affichent donc une baisse de 0, 43 % par rapport au montant inscrit – 6, 131 milliards d’euros – dans la loi de finances initiale pour 2009, ce qui est une performance. Quant aux crédits de fonctionnement et d’investissement, hors nouveaux loyers budgétaires, ils sont stables par rapport à l’année dernière. Les autorisations d’engagement sont en diminution de 1 % par rapport à 2009.
Monsieur Angels, vous avez par ailleurs évoqué le programme COPERNIC et l’opportunité de son utilisation par le service des douanes. À la suite des auditions menées sur cette question par la commission des finances du Sénat en octobre dernier, j’ai demandé à Philippe Parini, le directeur général des finances publiques, et à Jérôme Fournel, le directeur général des douanes et droits indirects, de lancer une étude sur les connexions possibles entre les différents systèmes et les coopérations à envisager. Je vous tiendrai informé des conclusions qui en seront tirées.
Je rappelle que l’élaboration de cette application, contrairement à ce qui a été affirmé tout à l’heure, n’a pas été du seul fait de l’ex-DGI, puisque l’ex-DGCP y a elle aussi participé.
Pour ce qui est du taux d’absentéisme, il ne faut pas donner une trop grande signification aux statistiques mentionnées dans le rapport. Il a en effet été procédé à un changement du mode de calcul, qui intègre à la fois les absences pour maladie et pour accident de service, les congés ou les autorisations d’absence de natures diverses, ainsi que les absences justifiées par le suivi d’actions de formation continue, ce qui est une nouveauté.
Au sein de la DGFIP, le nombre moyen de jours de formation continue par agent, qui était de 3, 76 en 2007, est passé à 4, 68 en 2008. Cette situation explique donc en très grande partie la progression du nombre moyen de jours d’absence par agent, passé entre ces deux années de 16, 8 à 17, 8, soit une journée de plus. Seule une infime partie de cette progression ne trouve pas à s’expliquer par la prise en compte des jours de formation continue.
Je le répète, l’augmentation du taux d’absentéisme s’explique bien par l’intégration de la formation, et non par des absences provoquées par le stress au travail, comme on l’entend parfois dire.
Monsieur Angels, vous avez en outre abordé un sujet qui nous est cher, celui de la diversité, sur lequel nous souhaitons être performants. Sur cette question, nous avons déjà accompli des progrès et nous devons continuer dans cette voie. Je pense par exemple à la Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, que j’ai signée, en tant que ministre chargé de la fonction publique, avec la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Elle s’applique bien entendu en premier lieu au ministère du budget.
Nous avons également beaucoup développé les PACTE, les parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État. Ce dispositif permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans sans aucun diplôme d’intégrer la fonction publique, par le biais d’un recrutement particulier par jury suivi d’une titularisation au bout d’une année de service.
Enfin, vaste sujet qui me tient réellement à cœur, j’ai développé les classes préparatoires intégrées, non seulement à l’ENA, mais également dans l’ensemble des autres écoles.
J’en viens à la fusion des corps, que nous souhaitons poursuivre. On dénombre aujourd’hui 380 corps dans la fonction publique d’État, dont 83 dans les établissements publics. La situation est très contrastée, puisque 90 corps environ regroupent, dans les administrations de l’État, 90 % des effectifs, les 10 % restants faisant l’objet d’une dispersion considérable dans des corps à très faibles effectifs. Ainsi, 53 corps d’établissements publics comptent moins de 150 agents, ce qui donne une vision très parcellaire.
Notre programme de fusion des corps, qui devait aboutir en 2009, débouchera plutôt en 2010. Il se traduira notamment par la création d’un plus grand nombre de corps interministériels, afin d’éviter ce cloisonnement que d’aucuns peuvent dénoncer, notamment les fonctionnaires concernés, par la suppression de corps à trop faibles effectifs, qui n’ont plus aucun sens en termes de gestion, et, bien évidemment, par des fusions dépassant les périmètres ministériels traditionnels.
Notre objectif est de parvenir à une fonction publique organisée par métiers. S’il peut s’avérer coûteux, car il suppose une adaptation des règles de gestion à des ensembles plus vastes, il permettra de réaliser de riches progrès.
Sur l’aide ménagère à domicile, évoquée par MM. de Legge et Mahéas, il ne faut pas, là aussi, faire d’erreur d’interprétation.
L’AMD n’était pas attribuée aux personnes ayant le plus besoin d’une aide sociale : avec une gestion à guichet ouvert, elle avait, en quelque sorte, glissé du champ de l’action sociale vers celui de la prestation sociale. Tel n’était pourtant le but dans lequel elle avait été créée.
Une réflexion similaire a d’ailleurs été menée au sein du régime général, aboutissant aux mêmes conclusions. L’essentiel des bénéficiaires appartenait à la catégorie GIR 6, soit le niveau de dépendance le plus faible, et disposait de revenus qui, certes, n’étaient pas élevés, mais dépassaient tout de même, pour un couple, 2 300 euros par mois. Ce faisant, l’AMD n’était pas attribuée aux personnes qui en auraient eu le plus besoin.
Nous avons alors choisi d’opérer un repositionnement de cette aide, ce qui n’a rien à voir avec une quelconque mesure d’économie.
Le maintien des engagements déjà conclus est assuré. Chaque euro dépensé restera consacré à l’action sociale interministérielle : CESU, réservation de places de crèches, aide au logement des fonctionnaires. Nous avons procédé à une répartition de ce budget, sans diminuer en aucune façon l’aide sociale aux fonctionnaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne conteste pas du tout le fait que certains puissent prôner une attribution différente des crédits, mais je ne peux laisser dire que nous avons fait des économies, car c’est faux ! Nous avons, j’insiste, procédé à une nouvelle répartition des sommes – dont je pourrais vous donner le détail exact, dispositif par dispositif –, jugeant qu’elles seraient plus utilement employées ainsi. Il aurait été d’ailleurs tout à fait anormal de chercher à faire des économies, alors que nous voulons justement développer ce volet de l’aide sociale.
Madame Bricq, les surfaces immobilières vont continuer à baisser. Comme vous l’avez dit, il s’agit bien d’un work in progress. Cela signifie que nous pouvons mieux faire, mais que ce n’est déjà pas si mal. Au cours des deux dernières années, une baisse des surfaces a été constatée, ce qui est inédit, avec une diminution de 137 000 mètres carrés. Si la politique en la matière n’en est qu’à ses débuts, elle existe bel et bien. C’est la raison pour laquelle je m’inscris en faux contre les propos de M. Pozzo di Borgo, car il est assez facile de tout caricaturer.
L’immobilier est un sujet qui, au choix, terrorise ou excite : soit il y a trop de transparence, et on n’a pas les bons acheteurs, soit il y a trop d’opacité, et c’est suspect. Aucune chance ne nous étant laissée, la meilleure des politiques immobilières est vraiment de ne rien faire, de conserver le même propriétaire, de garder tous les biens de l’État, et de ne pas bouger. Ainsi, nous éviterons toute critique !
Nous avons, pour notre part, choisi de développer une stratégie immobilière, indispensable si l’on veut réformer les services publics. Gérer 12 millions de mètres carrés de bureaux signifie forcément vendre, regrouper, entretenir. Notre stratégie est d’ailleurs déclinée dans les départements, et le sera demain chez les opérateurs de l’État, à qui nous avons demandé un inventaire précis.
On peut nous accuser de tout – c’est le jeu en politique –, mais pas de ne rien faire dans le domaine immobilier. Je le sais bien, l’action appelle la critique : l’acheteur ne convient pas, ou les conditions d’achat manquent de transparence. On nous dit que TRACFIN devrait s’en occuper. Certes, mais permettez-moi de vous faire remarquer que c’est déjà le cas, et à notre demande en plus. Nous n’acceptons pas n’importe quel acheteur et, avant de vendre, nous nous efforçons de vérifier l’origine des fonds : la plupart du temps, malgré les rumeurs, nous ne trouvons rien.
Nous faisons en sorte de protéger les intérêts de l’État, ce qui passe par une politique immobilière ambitieuse.
Bien évidemment, il nous arrive de nous tromper.
Mais c’est toujours celui qui est cité ! L’opération de la rue de la Convention n’est certainement pas la meilleure affaire réalisée par l’État, sauf qu’il n’y a pas perdu. Il a regroupé les services du ministère des affaires étrangères sur deux sites, contre neuf auparavant. Globalement, l’opération est bénéficiaire.
Avec le recul, il apparaît que l’Imprimerie nationale n’aurait pas dû vendre l’immeuble à un prix trop faible et que l’État aurait probablement dû se porter acquéreur de l’immeuble. La commission des finances du Sénat a d’ailleurs procédé à une audition sur ce sujet. Pour ma part, j’ai saisi l’inspection générale des finances pour examiner les conditions de cette opération antérieure à mon arrivée au ministère.
À l’époque, l’État n’avait pas une stratégie immobilière suffisamment affirmée. Mais ne vous y trompez pas ! Nous aurons à l’avenir d’autres cas – beaucoup moins frappants, je l’espère – pour lesquels nous regretterons d’avoir manqué d’anticipation. Nous ne pouvons pas toujours savoir ce que nous ferons dans trois, quatre ou cinq ans. Et ce qui est vrai pour l’État l’est aussi pour les collectivités locales et, bien sûr, pour les entreprises. Je le répète, je m’inscris en faux contre les propos qui ont été tenus sur ce sujet.
Madame Assassi, vous avez raison, l’augmentation de la qualité du service est majeure. Nous allons étendre la charte Marianne et la réactualiser, car cela n’avait pas été fait. Le déploiement du référentiel Marianne, qui lui a succédé, s’inscrit dans la deuxième phase de la révision générale des politiques publiques, au cours de laquelle nous améliorerons les procédures de simplification, l’accueil, les délais de traitement, la satisfaction des usagers.
Mes services vous ont d’ores et déjà fait parvenir un certain nombre d’éléments sur « l’enquête mystère ». Sachez qu’il s’agit plutôt pour l’administration d’un document de travail à usage interne, qui lui permet d’avoir une meilleure idée de la situation et de faire avancer les choses. Naturellement, si vous souhaitez des informations complémentaires, nous pourrons vous les communiquer.
Je terminerai mon propos en évoquant rapidement les cessions immobilières du ministère de la défense, lesquelles, madame Bricq, sont bien évidemment assises sur des actifs à céder, qui ont une valeur. S’il y a eu moins de ventes cette année, c’est parce qu’il était hors de question pour l’État de brader ses actifs immobiliers alors que nous étions en bas de cycle. Nous attendons que le marché soit meilleur. D’ailleurs, il est en train de remonter.
Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », figurant à l’état B.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Dont titre 2
6 885 449 631
6 885 449 631
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Dont titre 2
86 184 177
86 184 177
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Dont titre 2
367 675 628
367 675 628
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)
Dont titre 2
29 385 646
29 385 646
Facilitation et sécurisation des échanges
Dont titre 2
1 028 938 926
1 028 938 926
Fonction publique
Dont titre 2
350 000
350 000
Entretien des bâtiments de l’État

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits de la mission.
Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », figurant à l’état D.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations
Prêts pour le développement économique et social
Prêts à la filière automobile

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits du compte spécial.
Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics », figurant à l’état D.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics
Avances à des services de l’État

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits du compte spécial.
Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », figurant à l’état D.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Contribution au désendettement de l’État
Contribution aux dépenses immobilières
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits du compte spécial.
Ces crédits sont adoptés.

J’appelle en discussion l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 54 ter, qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ».
L’amendement n° II-9, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Après l’article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l’année, l’état d’avancement des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d’exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.
II.- En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Gestion des finances publiques et des ressources humaines.
La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur spécial.

Cet amendement tend à permettre au Parlement de disposer d’une information de qualité sur la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques.
Actuellement, le suivi des quelque 374 mesures adoptées par les trois premiers conseils de modernisation des politiques publiques n’est retracé, pour l’essentiel, que par deux rapports d’étape remis au Président de la République, en décembre 2008 et en mai 2009. Or ces documents ne font apparaître aucun chiffre au-delà de l’estimation globale de réduction des coûts au terme du processus.
Notre amendement vise donc à créer, sous la forme d’une annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, un « tableau de bord » de la RGPP. Ce document doit permettre au Parlement de suivre avec précision l’état d’avancement des réformes conduites.

Le sous-amendement n° II-196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° II-9, alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
présentant, pour l’année, l’état d’avancement des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007
par les mots :
présentant, pour l’année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° II-196 et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-9.
Pour mieux coller à la réalité de la RGPP, dont l’objet est vaste, ce sous-amendement vise à préciser que le Gouvernement pourrait être conduit à faire figurer en annexe du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion les seules mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques et qui sont arrivées à leur terme.
Les économies sont souvent dues à un ensemble de mesures. Estimer avec exactitude laquelle permet de réaliser ces économies est parfois très difficile, d’autant que celles-ci ne sont pas toujours immédiates. En la matière, les exemples sont multiples.
Le fait de pouvoir tirer des enseignements annuels des mesures qui sont mises en œuvre concrètement et de dire quel niveau d’économie celles-ci peuvent atteindre serait utile au Parlement dans le cadre de sa mission de contrôle. C’est pourquoi, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° II-9.

En présentant ce sous-amendement, le Gouvernement reconnaît implicitement la pertinence de notre amendement. Je l’en remercie.
Cependant, la commission n’a pas pu se prononcer sur ce sous-amendement dans la mesure où il vient d’être déposé. Après en avoir discuté avec le président de la commission des finances, il me semble que le dispositif proposé correspond à l’état d’esprit qui a présidé au dépôt de notre amendement. Il s’agit donc d’une avancée importante à laquelle je suis favorable.
Le sous-amendement est adopté.
L’amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 54 ter.

J’appelle en discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 63, qui sont rattachés pour leur examen aux crédits du compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».
L’amendement n° II-10, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Après l’article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l’année, les acquisitions immobilières de l’État de plus de 0, 5 million d’euros hors taxes et les prises à bail de l’État dont le loyer est supérieur à un million d’euros hors taxes dans la région Île-de-France et à 0, 5 million d’euros hors taxe dans les autres régions.
II.- En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Gestion du patrimoine immobilier de l’État.
La parole est à Mme Nicole Bricq, rapporteur spécial.

Cet amendement vise en quelque sorte à exercer un droit de suite à la séance du 1er avril dernier consacrée à l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009. À cette occasion, Mme Goulet avait présenté un amendement concernant la salle Pleyel.

À la suite des commentaires du président de la commission des finances et du rapporteur général, vous nous aviez alors garanti, monsieur le ministre, que les engagements immobiliers de l’État les plus importants se trouveraient retracés dans une nouvelle annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion de chaque année.
Or rien ne figure pas dans le projet de loi de finances pour 2010. Il faut pourtant que le Parlement soit pleinement informé sur les opérations en cause. Nous insistons donc pour que cette annexe figure dans le projet de loi de règlement que nous examinerons prochainement.
Je rappelle que cet amendement vise les engagements immobiliers de l’État portant sur des acquisitions de plus de 0, 5 million d’euros et des prises à bail dont le loyer est supérieur à 1 million d’euros dans la région d’Île-de-France et à 0, 5 million d’euros dans les autres régions.
Monsieur le ministre, en ce qui concerne les baux supportés par l’État, nous considérons que la mesure contribuera à accélérer la mise en place, actuellement en cours, de la centralisation du suivi à laquelle vous êtes attaché.
M. Éric Woerth, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat concernant la salle Pleyel est bien évidemment resté gravé dans ma mémoire ! Comment ne pas se souvenir d’une telle musique ?
Sourires.
J’avais pris l’engagement de dresser un état des baux en fonction des seuils et des cessions en 2009. Vous l’aurez, l’année n’est pas terminée !
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et respectera les engagements pris au printemps dernier.

Voilà une petite consolation après l’échec cuisant qu’avait subi mon amendement. Abandonnée par mes collègues au moment du vote, j’avais totalement oublié cette malheureuse affaire ! Je suis donc ravie de la voir resurgir. J’en remercie vivement Mme Bricq et je félicite la commission des finances de sa vigilance dans le suivi des engagements du Gouvernement.
L’amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 63.
Je constate d’ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L’amendement n° II-154, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
A. - Après l’article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l’alinéa précédent et les activités exercées dans le cadre de professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice des loyers d’activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».
II. - L’article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa (9°), après les mots : « activités commerciales » sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »
III. - L’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;
2° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».
IV. - Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».
B. - En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.

L’adoption de cet amendement pourrait contribuer à la baisse des charges publiques, en particulier pour les administrations publiques qui louent dans le secteur privé.
Il s’agit en effet de rendre possible le recours à un nouvel indice de référence pour l’indexation des loyers de bureaux et des locaux professionnels, baptisé « indice des loyers d’activités tertiaires », ou ILAT, qui serait en fait composé d’un panier de trois indices : l’indice des prix à la consommation hors tabacs et hors loyers, l’indice du coût de la construction et l’indice du produit intérieur brut en valeur.
L’intérêt est d’éviter d’avoir à subir l’évolution pour le moins erratique de l’indice du coût de la construction, qui, cela s’est vérifié, peut augmenter très fortement à certaines périodes et baisser par la suite. Plus stable compte tenu de sa composition tripartite, ce nouvel indice favoriserait la stabilisation du niveau des loyers d’activités tertiaires et sans doute la baisse des dépenses immobilières des administrations publiques.

Mme Nicole Bricq, rapporteur spécial. Votre amendement, mon cher collègue, vise probablement à appliquer la recommandation d’une organisation professionnelle.
M. Albéric de Montgolfier opine.

D’une certaine manière, votre proposition se rattache à l’une des dispositions de la loi LME du 4 août 2008, qui a créé un nouvel indice pour les loyers commerciaux en supprimant la référence à l’indice du coût de la construction. Cependant, celle-ci ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux.
La commission n’ayant pas examiné cet amendement, elle aimerait connaître l’avis du Gouvernement, au regard notamment des éventuelles conséquences d’une telle mesure sur les baux de l’État. J’ai déjà signalé dans mon rapport que ceux-ci se situaient souvent au-dessus des prix du marché. Ce dernier étant plutôt baissier en ce moment, il serait intéressant que M. le ministre nous éclaire sur ce point.
En attendant, j’émets a priori un avis plutôt favorable, car ce nouvel indice pourrait contribuer à faire baisser les dépenses immobilières des administrations publiques.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à créer un nouvel indice de référence pour le secteur tertiaire, l’ILAT, élaboré par l’INSEE et le ministère de l’économie, en liaison avec les professionnels du secteur. Le recours à cet indice permettrait d’éviter les fluctuations erratiques de l’indice du coût de la construction.
Madame Bricq, en 2010 – l’ILAT se situant à 1, 27 % –, l’adoption de cet amendement aurait un impact sur les loyers budgétaires, donc les loyers intra-administration, de 8, 4 millions d’euros, car l’État se référerait alors à cet indice pour ses bureaux. Hors administration, j’imagine que l’effet serait également important. En tout cas, je sais qu’un tel dispositif, de nature à mieux lisser les augmentations de loyer, est attendu par la profession.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 63.
Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », ainsi que des comptes spéciaux « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » et « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite », ainsi que du compte spécial « Pensions ».
La parole est à M. le président de la commission des finances.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me revient de vous présenter la mission « Régimes sociaux et de retraite » et le compte spécial « Pensions » au nom de la commission des finances, en remplacement de notre collègue Bertrand Auban, actuellement en mission à l’étranger.
Dans le temps, court, qui m’est imparti, je me limiterai à vous présenter les chiffres clés des retraites des fonctionnaires de l’État qui relèvent du compte spécial « Pensions » et de certains régimes spéciaux qui bénéficient d’une subvention d’équilibre de l’État au titre de la mission « Régimes sociaux et de retraite ».
Pour 2010, le coût global du compte spécial « Pensions » s’élèvera à 51, 1 milliards d’euros, contre 50, 1 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2009, soit une progression de 2 %.
Le nombre prévisionnel de pensionnés civils et militaires sera de 2, 3 millions fin 2010, soit une augmentation de 2, 8 % par rapport à 2009, comparable à l’évolution des crédits.
La mission « Régimes sociaux et de retraite » regroupe le financement d’un ensemble de régimes spéciaux de retraite en déclin démographique. Pour 2010, la contribution de l’État s’élèvera à 5, 72 milliards d’euros, soit une hausse importante de 10 % par rapport aux 5, 2 milliards d’euros prévus en 2009.
Ce budget soutient principalement les régimes sociaux et de retraite de la SNCF à raison de 3, 12 milliards d’euros, le régime des mineurs pour 971 millions d’euros, celui des marins pour 792 millions d’euros, de la RATP pour 526, 7 millions d’euros et de la SEITA pour 132, 3 millions d’euros.
Au total, près de 56, 8 milliards d’euros seront donc consacrés en 2010 au financement des retraites de la fonction publique et des régimes spéciaux dont l’État assure l’équilibre financier, soit 20 % de l’ensemble des dépenses budgétaires.
J’en viens maintenant à des considérations plus particulières sur la justification des crédits.
La subvention d’équilibre de l’État au régime des retraites des mines augmentera de 65 % en 2010. Il s’agit non pas d’une modification d’un équilibre démographique de cette caisse mais d’un contrecoup de la crise. En effet, le Gouvernement avait souhaité que la caisse des mines valorise son patrimoine immobilier. Je rappelle par exemple que la vente de l’hôtel Prince de Galles a « rapporté » 141 millions d’euros. Or, en 2010, les cessions immobilières seront réduites, entraînant à la hausse l’ajustement de la subvention de l’État.
S’agissant du régime de retraite des personnels de la RATP, l’adossement de la caisse autonome de la RATP au régime général est en sommeil depuis 2007, …

… en attente d’une décision de la Commission européenne. Celle-ci a enfin décidé, le 13 juillet dernier, que la création de la caisse constituait une aide compatible avec les règles de l’Union européenne, à la condition que la réforme du régime spécial soit entièrement mise en œuvre.
Dans ces conditions, il faudra que le Gouvernement nous éclaire sur les modalités de reprise du projet d’adossement et d’actualisation de la soulte que l’État aura à verser, laquelle, je le rappelle, était estimée entre 500 millions et 700 millions d’euros. Sur ce point, nous serons intéressés par votre réponse, monsieur le ministre.
Avant de conclure, je voudrais souligner la mise en œuvre de deux avancées notables dans la gestion des pensions.
En premier lieu, une norme commune à l’ensemble des caisses de retraites pour l’évaluation du coût de gestion des pensions a été adoptée, ce qui répond à une recommandation formulée l’année dernière par la commission des finances.
En second lieu, un service des retraites de l’État ayant pour objet d’optimiser l’organisation des services gestionnaires de la chaîne des pensions de l’État a été créé, ce qui correspond à une recommandation que la commission des finances avait formulée, dès 2007, dans le cadre du suivi de l’enquête sur la réforme de la gestion des pensions que nous avions demandée à la Cour des comptes.
Au final, le paiement des droits à pension constitue pour l’État une obligation de service public sur laquelle peu de marges de manœuvre se dégagent. Ce constat est d’autant plus vrai que le rituel législatif auquel nous nous livrions année après année pour réformer le régime des indemnités temporaires de retraite outre-mer a pris fin
M. le rapporteur pour avis rit.

… grâce à l’adoption d’un amendement d’extinction progressive de ce dispositif porté par M. Dominique Leclerc.
À cet égard, monsieur le ministre, il serait intéressant de nous présenter les premiers effets de cette réforme. Ce dispositif est-il de nature à vous aider à réduire le déficit budgétaire, et dans quelles proportions ? Nous sommes conscients de la faiblesse de son incidence en 2010, mais une petite piqûre de rappel sur ce point particulier répondrait à notre légitime vigilance.
Mes chers collègues, je vous propose, au nom de la commission des finances, d’adopter les crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » et du compte spécial « Pensions ».
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette mission retrace les principales subventions versées par l’État pour équilibrer les comptes de plusieurs régimes spéciaux de retraite. Elle met en évidence le caractère structurellement déficitaire d’un ensemble de régimes, maintenus sous perfusion depuis des décennies grâce à la solidarité nationale.
Quelque 5, 7 milliards d’euros y seront consacrés l’an prochain, soit 10 % de plus qu’en 2009. Inévitablement, le besoin de financement de ces régimes spéciaux va continuer à progresser dans les prochaines années, car l’évolution à la hausse de leurs dépenses sous l’effet du papy-boom et le mouvement à la baisse de leurs ressources créent un effet de ciseau.
Les dotations de l’État, qui jouent le rôle de variable d’ajustement, sont donc appelées à augmenter. Or rien ne garantit qu’elles seront en mesure de suivre l’évolution des besoins. C’est pourquoi la commission des affaires sociales s’interroge sur la pérennité de ces subventions : ne peut-on pas craindre, monsieur le ministre, que le contexte budgétaire contraint et les arbitrages financiers qui en découlent ne conduisent, à terme, à un abondement insuffisant de la mission ?
En attendant, l’évolution des crédits pour 2010 met en lumière quatre éléments principaux.
Premièrement, la dotation à la caisse autonome de retraite de la SNCF est en hausse relativement contenue de 2, 5% et s’établit à 3, 12 milliards d’euros, dans la continuité de la tendance observée ces dernières années.
Deuxièmement, la dotation à la caisse autonome de retraite de la RATP est plus conforme à la sincérité budgétaire. Après avoir été largement sous-budgétisée dans les exercices précédents, elle s’élève aujourd'hui à 527 millions d’euros, en augmentation de 5, 1 % par rapport à 2009.
Troisièmement, la subvention d’équilibre accordée au régime des marins – 792, 5 millions d’euros en 2010 – connaît une croissance de 6 % en raison de l’érosion continue de la masse salariale.
Quatrièmement, enfin, la subvention versée au régime des mines est en progression de 65 %, pour atteindre 971, 6 millions d’euros. Cette évolution est la conséquence, d’une part, de la diminution des transferts au titre de la surcompensation dont ce régime était l’un des principaux bénéficiaires et, d’autre part, du moindre rendement de ses actifs immobiliers.
Ce débat m’amène surtout à dresser un premier bilan de la réforme des régimes spéciaux engagée en 2007 par les pouvoirs publics et entrée en vigueur le 1er juillet 2008.
En harmonisant progressivement les règles en vigueur dans les régimes spéciaux avec celles qui sont applicables dans les régimes de la fonction publique, cette réforme se fixe deux objectifs : rétablir plus d’équité entre les assurés sociaux et garantir la viabilité financière de ces régimes sur le long terme.
Je rappelle également que l’adoption de cette réforme a été subordonnée à l’instauration de mesures salariales de compensation qui ont été actées dans des négociations d’entreprise. À la SNCF comme à la RATP ont été décidés notamment la création d’échelons supplémentaires d’ancienneté, le déblocage de la grille des salaires, la possibilité de rachat d’années d’études et la suppression de la condition d’âge pour l’affiliation au régime spécial. J’en tire la conclusion que le principe de la spécificité des droits des assurés de ces régimes a été préservé.
Bien sûr, ce dialogue social approfondi était nécessaire, mais je crains qu’il n’ait abouti à des contreparties qui pourraient, à terme, vider la réforme de sa substance. L’an dernier déjà, la commission des affaires sociales avait souligné le fort potentiel de dépenses supplémentaires que représentait l’octroi de ces mesures de compensation aux salariés. Au début de mon propos, je faisais remarquer que ces régimes étaient maintenus sous perfusion grâce à la solidarité nationale.

Nous confortons des régimes à prestations définies avec un taux de remplacement garanti, alors que le régime général des salariés est soumis à des cotisations fixes, de surcroît nettement supérieures, pour des pensions dont le taux de remplacement baisse régulièrement et des salariés soumis aux aléas du chômage. Sincèrement, j’estime que la solidarité des usagers et des contribuables a des limites. Nous aurons sans doute un débat sur ce point l’an prochain.
Les nouvelles estimations dont nous disposons nous permettent de confirmer ces analyses. Ainsi, la SNCF a revu à la hausse le coût des mesures d’accompagnement. En 2010, ce dernier serait supérieur de 30 millions d’euros aux prévisions initiales. En 2012, il atteindrait 50 millions d’euros de plus.
Ces dépenses supplémentaires viennent grever les économies attendues de la réforme : à la SNCF, les gains engrangés jusqu’en 2020 chuteraient à partir de cette date à un niveau inférieur au coût des mesures d’accompagnement ; à la RATP, la réforme engendrerait un surcoût jusqu’en 2015 en raison des contreparties accordées, puis ne dégagerait que de très faibles économies.
Aussi notre commission estime-t-elle que les gains résultant de cette réforme pourraient s’avérer beaucoup plus faibles pour la collectivité que ce que les prévisions initiales, optimistes, ne le laissaient penser. Nous souhaiterions, monsieur le ministre, que vous nous donniez votre sentiment sur ce sujet.
Cela étant, la commission des affaires sociales ne peut que se déclarer favorable à l’adoption des crédits de la mission pour 2010, car ils sont indispensables à la survie de tous ces régimes de retraite.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

J’indique au Sénat que la conférence des présidents a fixé pour cette discussion à cinq minutes le temps de parole dont chaque groupe dispose et à trois minutes celui dont dispose la réunion des sénateurs n’appartenant à aucun groupe.
Je vous rappelle également que l’intervention générale vaut explication de vote pour ces missions.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.
La parole est à M. Guy Fischer.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » ainsi que le compte spécial « Pensions » sont révélateurs, de manière pour le moins intéressante, des choix politiques de long terme mis en œuvre par les différents gouvernements.
Les régimes sociaux pris en charge par la mission, nul ne l’ignore, sont ceux dont le déséquilibre démographique est avéré et résulte de choix politiques antérieurs, qu’il s’agisse de la liquidation de Charbonnages de France ou de la réduction de la desserte ferroviaire, notamment.
Quant au compte spécial « Pensions », dont les crédits progressent de près de 5 % cette année, il est de plus en plus obéré par le mouvement de réduction du nombre de fonctionnaires en activité et par la progression du nombre de ceux qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.
Les dépenses liées aux régimes sociaux s’élèvent aujourd’hui à plus de 5 milliards d’euros, tandis que le compte spécial vient d’atteindre le montant de 51, 2 milliards d’euros, et ce malgré tous les artifices comptables en vogue, notamment depuis l’adoption de la loi portant réforme des retraites de 2003, utilisés pour comprimer autant que possible le montant des retraites et des pensions. La tendance qui se dessine pour les prochaines années – elle est d’ailleurs déjà engagée – est un écrasement de l’évolution des salaires et des retraites. Cette tendance se confirmera d’année en année.
Lorsqu’un droit est acquis, et c’est le cas ici, la solidarité nationale doit jouer.
Il faut cesser de considérer que les pensions et les retraites sont des charges qu’il faut réduire. En effet, 55 milliards d’euros de pensions versées, c’est aussi 55 milliards d’euros destinés pour partie à l’épargne, monsieur le ministre, et à la consommation ; c’est aussi 55 milliards de bases d’imposition. De manière générale, c’est de l’argent qui circule et qui fait tourner l’économie.
Depuis quelques années, nous assistons à une évolution dramatique pour les retraités. On voit en effet apparaître ce que l’on appelle des retraités pauvres – il s’agit d’ailleurs surtout de femmes – qui ne peuvent plus vivre de leur maigre pension. Réduire le pouvoir d’achat des retraités, c’est créer les conditions d’une récession économique.
Finalement, 55 milliards d’euros pour les retraités de la fonction publique et leurs ayants droit, c’est assez peu, surtout quand on sait que l’État a émis en juin 2009 l’équivalent de cette somme en bons du Trésor pour faire face à ses difficultés de trésorerie !
Tout est utilisé aujourd’hui pour comprimer la dépense. Ainsi la Caisse des mines a-t-elle réalisé cette année un certain nombre de cessions immobilières afin d’équilibrer ses comptes. Et les biens immobiliers qu’elle cède ne sont pas des maisons de mineurs dans les corons, croyez-moi ! L’État attend des cessions réalisables en 2010 qu’elles lui permettent d’économiser plus de 200 millions d’euros sur la subvention d’équilibre.
Nous contestons évidemment cette manière de procéder, qui en annonce de belles ! Nous en reparlerons lorsqu’il s’agira, notamment, de prévoir le financement des retraites des agents de La Poste par les crédits de cette mission. Les cessions immobilières viendront-elles, là encore, au secours de l’équilibre budgétaire global ?
Enfin, je dirai quelques mots sur les rendez-vous en souffrance, puisqu’il y en a.
Six ans après la loi portant réforme des retraites, le régime général de la sécurité sociale est en situation de déficit, lequel devrait s’élever à 33, 6 milliards d’euros en 2010. Quant au régime agricole, il est sous perfusion – la majorité en parle peu – depuis plusieurs années. Enfin, les régimes publics ne doivent leur équilibre qu’à l’accroissement continu du taux de cotisation. Cela remet en cause le dogme de la réduction des effectifs – le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux –, qui, on le voit, est inopérant.
Quant à la réforme des régimes spéciaux, même le rapport de notre collègue Dominique Leclerc confirme qu’elle n’aura pratiquement aucune incidence budgétaire réelle.
Les pensions et les retraites ne doivent plus être considérées comme un poids mort, une charge à réduire coûte que coûte. Commençons plutôt par mettre en œuvre des mesures de simple justice : prenons en compte la pénibilité, les carrières longues, ainsi que l’ensemble des états de service. Nous avons les moyens d’une telle justice : utilisons à cet effet les 120 milliards ou 130 milliards d’euros que l’État consacre aujourd’hui à la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’impôt des plus riches, ou des cotisations sociales des entreprises.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons ni les crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » ni ceux du compte spécial « Pensions ».
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, concernant les crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite », je commencerai par évoquer quelques points généraux.
Les crédits de cette mission, comme l’ont dit MM. Arthuis et Leclerc, s’élèvent à 5, 72 milliards d’euros, soit une augmentation de 10 % entre 2009 et 2010. Cette progression s’explique par une augmentation des dépenses, à la suite du relèvement des subventions de l’État en faveur des régimes spéciaux, comme l’a noté M. le président de la commission des finances. Ce transfert vise à compenser la disparition progressive du mécanisme de compensation entre les régimes spéciaux.
Enfin, l’arrivée à terme du programme de cessions immobilières de la Caisse des mines nécessite d’augmenter la subvention d’équilibre de l’État de 400 millions d’euros.
Concernant le compte spécial « Pensions », deux points sont à souligner : d’une part, la poursuite de la hausse des prestations de 1, 1 milliard d’euros du fait des revalorisations des retraites et du nombre de départs à la retraite, d’autre part, la mise en place du service des retraites de l’État.
Le service des retraites de l’État, service à compétence nationale, réunit l’ancien service des pensions et les centres régionaux des pensions. Il sera l’opérateur unique de la liquidation des pensions et du versement de ces dernières pour l’État. La réforme s’étendra jusqu’en 2012 et conduira à une réforme de fond en comble du processus de gestion des retraites afin de l’industrialiser et d’alimenter chaque année le compte retraite individuel de chaque fonctionnaire. C’est assez compliqué à faire. À cet égard, j’ai récemment réuni l’ensemble des gestionnaires au niveau des ministères. Chaque ministère devra alimenter le système. Le but est de pouvoir renseigner les fonctionnaires sur leur carrière, longtemps avant leur départ en retraite, ce qui n’est pas toujours possible aujourd'hui.
Le service des retraites de l’État mettra en œuvre un guichet unique afin d’améliorer l’accueil des usagers et expérimentera des centres d’appels téléphoniques.
À terme, monsieur le président de la commission des finances, les gains de productivité sont estimés à environ 1 200 emplois, soit 40 % des effectifs chargés, à un titre ou à un autre, des pensions.
Cette réforme est donc un exemple très concret de notre capacité « à faire mieux avec moins de moyens » en réformant les processus de gestion. De tels changements se font d’ailleurs souvent au bénéfice des usagers. Cette réforme s’étendra jusqu’en 2012.
Oui, c’est long, mais beaucoup de gens sont concernés. Tous les ans, vous serez tenus au courant de l’évolution du service de retraite des pensions de l’État.
J’évoquerai maintenant l’adossement du régime de la RATP au régime général.
Comme vous le savez, cet adossement est prévu par les textes réglementaires. Sa mise en œuvre a été suspendue pour deux raisons. La première, c’est que la priorité a été donnée à la réforme des droits, la seconde, c’est qu’un accord de la Commission européenne est nécessaire.
La Commission européenne a validé la réforme du financement par décision du 14 juillet de cette année. Elle a accepté la possibilité de réaliser un adossement. Pour autant, cet adossement n’est pas encore tout à fait d’actualité, des travaux techniques devant être effectués au préalable tout en prenant en compte la priorité donnée au rendez-vous des retraites en 2010. Le projet de budget pour 2010 n’intègre donc pas une hypothèse d’adossement, eu égard au délai nécessaire à sa mise en œuvre.
J’en viens à l’indemnité temporaire de retraite. L’extinction totale de ce dispositif est prévue sur un temps long, …
… puisqu’elle devrait intervenir en 2028. La réforme consiste en le gel du montant des indemnités déjà octroyées et en un écrêtement progressif des sur-pensions les plus élevées. Les choses se feront en douceur, afin de ne vexer personne !
Le bénéfice des sur-pensions est réservé à compter du 1er janvier 2009 aux fonctionnaires ayant un lien avec le territoire, disposition très critiquée. L’incidence de ces mesures sera très progressif, compte tenu du dispositif retenu et du stock existant.
Au 5 novembre 2009, 34 100 pensions avec indemnité temporaire de retraite ont été payées, contre 35 612 en 2008. La forte augmentation constatée en 2008 a donc été enrayée, ce qui est un premier succès. Alors que cette hausse était de 6 % à la fin de 2008, elle n’était plus que d’un peu plus de 3 % à la fin octobre 2009. Nous assistons donc à l’extinction progressive de cet avantage.
Concernant le compte d’affectation spéciale « Pensions », monsieur Leclerc, et les évolutions envisageables pour réduire les besoins de financement du régime de l’État, attendons le rendez-vous sur ce sujet prévu en 2010. À cette occasion, j’ai bien l’intention de jouer tout mon rôle de ministre de la fonction publique, en liaison avec mon collègue Xavier Darcos. Permettez-moi de ne pas répéter ce que j’ai déjà dit sur ce rendez-vous, qui est évidemment très important.
La réforme des régimes spéciaux de retraite a permis de réaliser des économies d’impact qui sont loin d’être négligeables. Elles sont en tout cas beaucoup plus importantes qu’on ne le laisse entendre aujourd'hui. Une longue négociation avec les organisations syndicales est nécessaire à cet égard.
On peut estimer à 500 millions d’euros cumulés d’ici à 2012 les économies qui seront réalisées à la suite de la réforme des régimes spéciaux, puis à 500 millions d’euros annuellement ensuite. Je sais bien que la crise nous fait perdre nos repères, mais 500 millions d’euros, c’est tout de même loin d’être négligeable !
À long terme, ce rendement diminuera du fait de l’acquisition de pensions d’un niveau plus élevé compte tenu de la prolongation de l’activité ; mais il faut savoir ce que l’on veut : ou les gens partent en retraite à trente ans et ils ont une petite pension, ou ils partent à soixante ans et ils ont une pension plus importante. Il me semble toutefois qu’il vaut mieux qu’ils partent plus tard…
Notons que la réforme des régimes spéciaux a entraîné un changement des comportements. Par exemple, à la SNCF, qui est au cœur du dispositif, on assiste à un recul des âges de départ en retraite. Ainsi, entre la mi-2006 et la mi-2007, de 80 % à 84 % des roulants de cinquante ans et des sédentaires de cinquante-cinq ans partaient en retraite à ces âges.
Entre la mi-2008 et la mi-2009, soit trois ans après la réforme, seuls 49 % des roulants et des sédentaires sont partis à la retraite respectivement à cinquante ans et à cinquante-cinq ans.
L’incitation à poursuivre le travail fonctionne. À cet égard, le fait de ne pas être mis à la retraite d’office à un certain âge est évidemment très important.
Cette tendance, je le pense, va s’amplifier. On la constate dans toute la fonction publique. Pour cette raison, nous aurons évidemment moins besoin du compte d’affectation spéciale « Pensions » : les gens partant moins tôt à la retraite, leur pension sera évidemment plus importante quand le moment de la retraite sera venu.
L’impact de cette réforme n’est donc pas négligeable du tout. Il est positif pour les agents de la fonction publique, qui prennent leur retraite un peu plus tard – au fond, c’est leur choix – et pour les finances de l’État.
M. Fischer a évoqué les retraités pauvres. Je vous indique, monsieur le sénateur, que nous avons augmenté le minimum vieillesse garanti de 5 % par an. Ainsi, l’engagement du Président de la République, qui prévoyait une hausse de 25 % sur l’ensemble du quinquennat, sera respecté.
Comme vous le savez, en termes de niveaux de vie, le ratio entre actifs et retraités est aujourd'hui plutôt favorable à ces derniers.
M. Éric Woerth, ministre. C’est tout de même un élément qu’il faut avoir à l’esprit. C’est pourquoi je souhaitais vous le rappeler.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste. – M. Gilbert Barbier applaudit également.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite », figurant à l’état B.
en euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Régimes sociaux et de retraite
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits de la mission.
Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial « Pensions », figurant à l’état D.
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Pensions
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
Dont titre 2
46 681 500 000
46 681 500 000
Ouvriers des établissements industriels de l'État
Dont titre 2
1 801 907 589
1 801 907 589
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
Dont titre 2
15 100 000
15 100 000
Ces crédits sont adoptés.

Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » ainsi que du compte spécial « Pensions ».

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements ».
La parole est à Mme le rapporteur spécial.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ayant juste cinq minutes pour présenter la mission « Remboursements et dégrèvements », qui est tout de même la plus importante du budget de l’État en volume, avec des crédits s’élevant à 95 milliards d’euros, j’irai à l’essentiel.
Tout d’abord, et contrairement à mon habitude – mais il faut dire ce qui est –, je souhaite vous faire part d’une bonne nouvelle : les efforts menés par la commission des finances du Sénat depuis l’examen du projet de loi de finances pour 2006 ont finalement trouvé, au moins partiellement, une réponse.
Après avoir demandé une enquête à la Cour des comptes sur le fondement du 2° de l’article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la LOLF, et après avoir obtenu un groupe de travail associant le Parlement et l’administration, nous constatons que la maquette budgétaire a finalement commencé à évoluer, du moins s’agissant des remboursements et dégrèvements des impôts d’État.
La présentation des crédits prévus par le projet de loi de finances pour 2010 isole, d’une part, les dépenses que l’on pourrait qualifier de « techniques » – elles représentent tout de même plus de 80 % du total – et, d’autre part, les dépenses concourant à la mise en œuvre de politiques publiques.
La LOLF n’a pas que des vertus, loin s’en faut, mais elle en a au moins une : elle peut permettre de faire émerger les enjeux politiques derrière la « cuisine » budgétaire. Nous en avons ici un cas d’école. Maintenant qu’il est possible d’identifier les remboursements et dégrèvements concourant à des politiques publiques, quelles conséquences politiques en tirons-nous ? Allons-nous pouvoir analyser l’adéquation entre les choix ayant motivé ces remboursements et dégrèvements et l’effet réel de ces mesures ?
Cela nous renvoie au débat sur les dépenses fiscales en général et sur les crédits d’impôt en particulier, dont les remboursements ne sont que la partie dite « restituée ». Les crédits d’impôt ressemblent tout de même beaucoup à des subventions. En commission, nous avons été plusieurs sénateurs à faire le lien entre l’augmentation du coût des crédits d’impôt et la stabilisation du montant des dépenses budgétaires.
Je vous donnerai deux chiffres. D’une part, les dépenses de l’État sont stables en volume. En 2010, elles augmenteront au même rythme que l’inflation, soit 1, 2 %, ce qui équivaut à 4, 3 milliards d’euros. D’autre part, les crédits d’impôt progresseront dans le même temps de 6 milliards d’euros. Il y a manifestement là un jeu de vases communicants.
La Cour des comptes demande que les dépenses fiscales pouvant faire l’objet d’une restitution soient incluses dans la norme de dépenses de l’État. Le rapporteur spécial de la commission des finances de l’Assemblée nationale a proposé de n’inclure dans la norme de dépenses que la partie restituée. Le Gouvernement préférerait, semble-t-il, traiter cette question dans le cadre des dispositions de la loi du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, notamment celles qui concernent les niches fiscales. Or leur diversité risque de poser problème.
À ce stade, la commission des finances n’a pas arrêté sa position. Pour ma part, je ne considère pas que la norme budgétaire soit obligatoirement le plus important. En revanche, ce qui me semble nécessaire, c’est que nous poursuivions le travail pour réintégrer le poids financier des remboursements et dégrèvements dans les domaines concernés.
Sur les crédits proprement dits, je me contenterai de quatre remarques.
Premièrement, la diminution de 20 % environ des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État par rapport à la prévision 2009 s’explique surtout par la non-reconduction de certaines mesures du plan de relance, notamment le remboursement mensuel de la TVA.
Deuxièmement, le montant des restitutions de la prime pour l’emploi devrait atteindre 2, 45 milliards d’euros, sous le double effet de la reconduction de la non-indexation des seuils du barème et de l’imputation du revenu de solidarité active, le RSA, versé en 2009, mesure dont les résultats seront ressentis en 2010.
Troisièmement, la diminution de 9 % des dégrèvements d’impôts locaux s’explique surtout par la suppression de la taxe professionnelle. L’effet est encore limité en 2010, car les dégrèvements sont versés pour une large part avec une année de décalage. Mais les élus notent que cette réforme marque la volonté de l’État de se désengager du financement des impôts locaux.
Quatrièmement, je souhaite évoquer le bouclier fiscal, car c’est sur les crédits de cette mission que s’impute ce qui s’appelle techniquement le « plafonnement des impositions directes ». En 2010, tout comme en 2009, 700 millions d’euros sont prévus. J’ai observé avec intérêt que les contribuables relevant du premier décile de revenu fiscal de référence représentaient 60 % des 18 000 bénéficiaires, mais seulement 3, 5 % des restitutions. À l’inverse, les contribuables du dernier décile représentent 30 % des bénéficiaires, mais plus de 90 % des restitutions.
En 2010, j’ai l’intention, en ma qualité de rapporteur spécial, de m’intéresser de manière plus précise au dispositif du bouclier fiscal. Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, du concours que vos services voudront bien nous apporter.
Pour le reste, les crédits de la mission traduisent les conséquences de décisions qu’on peut ne pas approuver, mais qui ont été prises ailleurs, notamment lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances. Pour cette raison, la commission des finances vous propose de les adopter. À titre personnel, je ne les approuve pas. Vous ne serez donc pas surpris de mon vote.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. le président de la commission des finances applaudit également.
La mission « Remboursements et dégrèvements » est une mission importante, puisqu’elle correspond à un volume total de crédits de près de 100 milliards d’euros.
Madame le rapporteur, vous avez noté que des axes d’amélioration avaient été bien identifiés et s’étaient concrétisés. Je vous remercie de votre objectivité, indépendamment de votre vote.
Tout d’abord, nous améliorons l’information sur la dépense fiscale. Les améliorations sont de deux types ; elles concernent la gouvernance et la transparence des informations.
Ainsi, la loi du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 met en place deux principes essentiels pour encadrer l’évolution du coût des dépenses fiscales.
D’une part, elle définit un objectif de dépenses fiscales. Certes, ce n’est pas dans la norme de dépenses. Il est assez compliqué de faire entrer un tel objectif dans une norme, même d’un point de vue conceptuel. À cet objectif de dépenses fiscales correspond un objectif de compensations des dépenses fiscales, notamment des niches. La décision a été prise en 2009 et l’objectif sera atteint non pas sur un, mais sur deux ou trois exercices. Nous aurons l’occasion de le redire devant le Parlement.
D’autre part, nous avons fixé une règle de gage. C’est celle que j’ai évoquée.
Nous avons également un principe d’information sur les dépenses fiscales, au travers d’un certain nombre de tableaux de synthèse, qui sont dans le document consacré aux voies et moyens.
Un des tableaux retrace le montant total des dépenses fiscales par mission et par impôt. Un autre récapitule le coût des dépenses fiscales adoptées depuis le dépôt du précédent projet de loi de finances ou proposées dans le projet de loi de finances de l’année. Un troisième détaille le coût des dix-huit dépenses fiscales les plus importantes, qui représentent plus de la moitié du coût total des dépenses fiscales.
Comme vous l’avez souligné, le débat doit effectivement porter sur les dépenses fiscales, plutôt que sur les restitutions. En d’autres termes, il doit porter non pas uniquement sur la « partie émergée de l’iceberg », mais sur l’ensemble de la dépense fiscale.
L’architecture du programme « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » a été profondément rénovée à l’occasion de ce projet de loi de finances. C’est une réponse à une demande de la Cour des comptes et des parlementaires. Comme je l’avais indiqué l’année dernière, cette refonte avait été différée d’un an. Nous la mettons donc en œuvre.
Cette nouvelle architecture repose sur la création de trois actions au sein du programme. L’action « Remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l’impôt » représente environ 75 % des crédits prévus pour 2010, et les actions « Remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques » et « Remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l’État » correspondent chacune à un peu plus de 10 % des dépenses.
Cette nouvelle nomenclature offre une vision plus claire, plus détaillée et plus construite de la nature des crédits du programme. Elle permet de mieux distinguer, d’une part, les remboursements et dégrèvements liés à la mécanique ou à la gestion de l’impôt – 90 % des dépenses –, sur lesquels le Gouvernement n’a strictement aucun levier d’action et, d’autre part, les remboursements liés à des politiques publiques, c'est-à-dire essentiellement des crédits d’impôt, soit environ 10 % des restitutions retracées sur le programme qui constituent la partie visible des dépenses fiscales.
Au sein de chacune de ces catégories, les remboursements et dégrèvements sont ventilés par impôt – vous l’avez indiqué tout à l’heure – pour plus de lisibilité.
Au total, cette nouvelle nomenclature enrichit la qualité de l’information portée à la connaissance du Parlement et vous permet évidemment de mieux débattre, tout au long de l’examen du projet de loi de finances – d’ailleurs, vous ne vous en privez pas, et vous avez bien raison –, des décisions qui sont prises sur ces sujets.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. – M. Gilbert Barbier applaudit également.

Nous allons procéder à l’examen des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements », figurant à l’état B.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Remboursements et dégrèvements
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

L'amendement n° II-176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier comme suit les crédits des programmes :
Programmes
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État
crédits évaluatifs
crédits évaluatifs
Cet amendement de coordination vise à ajuster les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements », à la suite des votes intervenus lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances.
Il tire principalement les conséquences de la suppression de l’imputation du revenu supplémentaire temporaire d’activité, le RSTA, sur la prime pour l’emploi, sujet qui a provoqué beaucoup de débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, et de la suppression du dégrèvement de taxe foncière relatif à l’abattement de 15 % des bases du foncier industriel. Cette suppression est compensée par un abattement de 35 % des bases du foncier industriel pour le calcul de la cotisation foncière.

La commission ne peut émettre qu’un avis favorable sur cet amendement, qui vise à tirer les conséquences de votes émis précédemment.
L'amendement est adopté.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements », figurant à l’état B.
Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix, modifiés, les crédits de la mission.
Ces crédits sont adoptés.

Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements ».

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Santé » (et articles 59, 59 bis et 59 ter).
La parole est à M. le rapporteur spécial.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Santé » s’élèveront, en 2010, à 1, 2 milliard d’euros.
Depuis le dernier budget, cette mission recouvre l’ensemble des crédits « sanitaires » relevant du ministère de la santé, mais ne comprend toujours pas de crédits de personnels, ceux-ci restant inscrits sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
Comme je le répète chaque année, cette mission demeure modeste eu égard aux dépenses d’assurance maladie, voire aux dépenses fiscales qui lui sont rattachées, ce qui nous conduit à analyser sous un autre jour les enjeux qui lui sont liés.
Le programme 204 « Prévention et sécurité sanitaire » comprend trois éléments principaux.
Tout d’abord, la pandémie grippale a bien sûr nécessité, dès cette année, d’importants mouvements de crédits. La commission des finances a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet lors de l’examen du décret d’avance de juillet dernier et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Ensuite, d’un point de vue organisationnel, on note la mise en place des agences régionales de santé, les ARS, ainsi que la fusion de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA, et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, l’AFSSET.
Enfin, a été lancé le deuxième plan de lutte contre le cancer.
S’agissant de la gestion de la pandémie, outre la question de la dotation versée à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS, que j’aborderai lors de la présentation de l’amendement que je proposerai à l’article 59 ter, je souhaiterais connaître, madame la ministre, l’état d’avancement de vos réflexions, d’une part, sur le projet de construction d’un ensemble de hangars de stockage sur le site de ravitaillement sanitaire des armées de Vitry-le-François, projet qui vise à permettre une centralisation accrue des sites relevant de l’EPRUS, et, d’autre part, sur l’élaboration d’un statut particulier pour les médicaments relevant du « stock national santé », qui permettrait de faire figurer non pas une date de péremption, mais une date de fabrication, en contrepartie de tests réguliers et encadrés de leur stabilité.
Ces deux questions que j’avais abordées lors de la mission de contrôle que j’avais menée sur l’EPRUS me semblent essentielles. À défaut, se reproduiront les mêmes difficultés que celles qui ont été rencontrées au moment de la grippe aviaire, à savoir dispersion des sites de stockage et péremption des masques et des vaccins.
Par ailleurs, la mission « Santé » sera marquée en 2010 par la mise en œuvre de deux préconisations de la révision générale des politiques publique, la RGPP : la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET, d’une part, et la création des ARS, d’autre part.
J’accueille favorablement cette rationalisation, tout en regrettant que ces mesures, qui constituent pourtant de puissants leviers en termes d’efficience, soient mises en place à moyens constants, voire croissants.
Si je peux comprendre qu’il est difficile, la première année, de prévoir une réduction des crédits et des effectifs destinés à ces structures, il serait incompréhensible qu’un tel rapprochement ne permette pas, à terme, une optimisation des moyens, et j’y veillerai.
Enfin, j’aborderai le lancement du deuxième plan de lutte contre le cancer, présenté par le Président de la République, le 2 novembre dernier.
J’approuve le choix du Gouvernement de continuer de faire de la lutte contre le cancer une priorité nationale. Toutefois, je souhaiterais en connaître la traduction précise en termes budgétaires pour l’année 2010. Par ailleurs, quelles leçons avez-vous tirées, madame la ministre, des lacunes du premier plan qui ont été soulignées dans de nombreux rapports ?
Concernant le programme 171 « Offre de soins et qualité du système de soins », j’observe, pour la deuxième année consécutive, une progression des crédits consacrés à la formation médicale, conformément à ce que vous aviez annoncé devant la commission des finances en juillet 2008, madame la ministre.
Ces dépenses avaient fait l’objet de sous-budgétisations les années passées. Si j’approuve les efforts menés en la matière, je souhaiterais cependant connaître le montant exact de la dette qui demeure aujourd’hui à ce titre.
Le ministère de la santé détient également des dettes à l’égard des établissements de santé au titre de certains contentieux. Les services de votre ministère m’ont indiqué avoir adopté « une politique de règlement transactionnel pour alléger le poids de la dette de l’État », qui aurait permis de verser 24, 9 millions d’euros à ce titre en 2008.
Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser l’état exact de la situation actuelle, compte tenu notamment de la hausse de certains contentieux en 2009 ?
Enfin, la principale dépense du dernier programme de la mission est l’aide médicale d’État, l’AME, dont les crédits prévus progressent, là aussi, pour la deuxième année consécutive, pour atteindre 535 millions d’euros en 2010.
Ces crédits ont également longtemps été sous-évalués et, malgré un assainissement de la situation intervenu en octobre 2007, la dette de l’État à l’égard de la sécurité sociale devrait représenter environ 318 millions d’euros à la fin de l’année 2009.
Dans ce contexte, la réévaluation de la dotation prévue pour 2010 représente un effort bienvenu, qui devrait limiter la formation de nouvelles dettes. Mais, compte tenu des évolutions passées, on ne peut l’affirmer, et ce d’autant que les réponses au questionnaire budgétaire que je vous ai adressé indiquent que « la dette de l’État vis-à-vis de la CNAMTS devrait continuer d’augmenter et atteindre près de 443 millions d’euros en 2011 ».
J’ai noté les efforts qui devraient être réalisés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009. Cependant, j’observe que la mise en œuvre d’une participation forfaitaire des bénéficiaires de l’AME, qui pourrait être une solution à l’augmentation de ce poste de dépenses, n’est plus évoquée. J’ai compris que cette solution pose des difficultés techniques. Est-elle totalement abandonnée, madame la ministre ?
Sous réserve de ces observations, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, d’adopter les crédits de la mission « Santé ».
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’évolution budgétaire des crédits consacrés à la mission « Santé » ayant été excellemment retracée par mon collègue Jean-Jacques Jégou, je concentrerai mon intervention sur trois points qui devraient faire, en 2010, l’essentiel de l’actualité de celle-ci : la rationalisation du système des agences sanitaires, la mise en œuvre du Plan cancer II et la nécessité de préparer une loi de santé mentale.
Le système des agences sanitaires regroupe une dizaine d’organismes de natures diverses qui auront à se positionner, à l’avenir, par rapport aux agences régionales de santé que nous avons créées dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
En effet, de nombreuses agences sanitaires disposent à la fois d’une compétence nationale et de réseaux territoriaux, et il convient de s’assurer qu’elles parviendront à travailler avec les ARS.
Parmi ces agences, deux d’entre elles seront confrontées à un défi supplémentaire : l’AFSSA et l’AFSSET, dont la fusion est imminente.
À la demande du Gouvernement, cette fusion sera opérée par voie d’ordonnance, et le délai qui lui a été accordé par le Parlement s’achève le 21 janvier prochain. Le moment me semble donc bien choisi pour faire le point.
L’intérêt de cette fusion est évident du point de vue de la rationalisation des structures : l’AFSSA et l’AFSSET traitent de sujets très proches ; surtout, la future organisation aura une taille critique suffisante pour compter au niveau européen, et donc espérer peser sur la détermination des normes sanitaires communautaires.
Pour autant, le rapprochement des deux agences ne doit pas se faire à n’importe quel prix.
L’AFSSET, qui est une structure légère comprenant 150 agents, est tournée vers la société et les ressources scientifiques externes, et elle s’attache à faire émerger des points de consensus entre experts.
L’AFSSA, pour sa part, est une entité beaucoup plus importante, puisque 1 200 agents, dont 800 scientifiques, travaillent dans ses laboratoires. Elle est donc, par nature, plus tournée vers son expertise interne.
Il existe par conséquent un double risque : d’une part, celui de voir les moyens consacrés par l’AFSSET à sa mission propre sur la santé au travail absorbés par les besoins de financement des laboratoires qui se consacrent principalement aux questions de qualité des produits agricoles ; d’autre part, sachant que l’AFSSA comporte, en son sein, l’Agence nationale du médicament vétérinaire, celui de mélanger compétences de gestion et compétences d’expertise, ce qui présenterait un danger en matière d’éthique et même de crédibilité.
Il faudrait donc que la future entité fusionnée se consacre à l’expertise. Cela signifie qu’il faudrait rattacher l’Agence nationale du médicament vétérinaire à l’AFSSAPS, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et intégrer les laboratoires de l’AFSSA à l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA. Le mandat d’expertise de la future agence serait ainsi clair et incontestable. Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, ce que vous pensez de ce schéma et nous préciser vos intentions en la matière ?
Le second sujet qui me tient à cœur concerne le lancement du Plan cancer II, présenté à Marseille, le 2 novembre dernier, par le Président de la République.
Nous soutenons tout particulièrement l’effort engagé en faveur de la prise en charge spécifique des jeunes atteints d’un cancer. Chaque année, 1 700 enfants âgés de moins de quinze ans sont diagnostiqués.
Le dépistage progresse aussi, puisque plus de 50 % des femmes participent au dépistage annuel du cancer du sein ; l’objectif de parvenir à un taux de 100 % en 2013 n’est donc atteint qu’à moitié.
Se pose alors la question de l’évaluation. En effet, on se contente trop souvent d’attendre l’échéance d’un plan pour procéder à une évaluation avant d’élaborer le plan qui lui succédera. Il peut en résulter un manque de continuité dans l’action publique. Il serait donc préférable de disposer d’indicateurs qualitatifs pérennes permettant d’avoir une vision de l’action entreprise sur la durée.
Je tiens également à souligner l’intérêt que présente un organisme tel que l’Institut national du cancer, l’INCa, qui a fait ses preuves en permettant une articulation dynamique entre recherche et qualité des soins. Peut-être pourrions-nous nous en inspirer pour faire progresser d’autres sujets de santé publique...
Enfin, j’estime particulièrement important d’aborder la question de la santé mentale.
L’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, l’OPEPS, a souligné, l’année dernière, la nécessité pour l’État de prendre un véritable engagement dans ce domaine.
Lors de l’examen de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le Sénat avait également conclu à la nécessité d’élaborer une loi de santé mentale. Je regrette donc qu’on en reste à une « politique des petits pas » et à une focalisation excessive sur la question des malades dangereux. Quelle est, madame la ministre, votre position sur ce point ?
Le programme de mise en place des unités hospitalières spécialement aménagées, destinées à fournir des soins aux prisonniers atteints de troubles mentaux, est une excellente idée, mais cela pose de nombreuses questions en termes de coûts et de relations entre personnels de santé et administration pénitentiaire.
Il est à mon avis nécessaire d’aborder la question de la santé mentale de manière large. La prise en charge des troubles mentaux dans notre pays est encore trop faible et impose de réfléchir à l’adaptation des structures existantes aux besoins.

J’espère que nous pourrons progresser dans cette voie, et peut-être nous apporterez-vous, madame la ministre, des informations de nature à nous apaiser.

M. Alain Milon, rapporteur pour avis. Cela étant, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur les crédits de la mission « Santé » sous réserve, bien sûr, de l’adoption de l’amendement qu’elle a déposé pour compléter le financement des missions de l’AFSSAPS, ainsi que de l’amendement de suppression de l’article 59 ter, incompatible avec les dispositions que nous venons d’adopter dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

Je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.
En outre, en application des décisions de la conférence des présidents, aucune intervention des orateurs des groupes ne doit dépasser dix minutes.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de quinze minutes pour intervenir.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. René Teulade.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la France consacre près de 9 % de sa richesse nationale aux dépenses publiques de santé, soit 210 milliards d’euros tous domaines confondus : sécurité sociale, interventions de l’État et des collectivités territoriales.
Selon plusieurs études récentes, les particuliers dépenseraient pour se soigner entre 40 % et 50 % de plus qu’en 2001. Les cotisations aux organismes complémentaires additionnées « du reste à charge » représenteraient une moyenne de 5, 4 % du revenu disponible et de 11 % du budget des personnes âgées.
Madame la ministre, vous nous demandez aujourd’hui de voter les crédits de la mission « Santé », qui s’élèvent à 1, 2 milliard d’euros. Voilà presque une semaine, nous avons adopté le budget de la sécurité sociale, dans lequel les prévisions de dépenses de l’assurance maladie pour 2010 sont fixées à 162 milliards d’euros.
La mission « Santé » regroupe des crédits essentiels pour mener à bien la politique de santé publique, qui comprend la prévention, la sécurité sanitaire, la protection maladie et l’offre de soins. Des crédits permettent également de financer les opérateurs essentiels que sont l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES, l’Institut de veille sanitaire, l’InVS, les agences régionales de l’hospitalisation, les futures agences régionales de la santé, les ARS, et les agences françaises de sécurité sanitaire.
Dans le contexte actuel de pandémie grippale, tous ces organismes prouvent leur utilité et rappellent que la santé publique est bel et bien une mission régalienne de l’État.
Le budget de la santé pour 2010 s’inscrit dans une certaine continuité, alors même qu’il doit faire face à une conjoncture particulière.
D’abord, il se situe dans un contexte financier difficile. Outre l’ampleur du déficit budgétaire, l’État a pris, en matière de santé publique, l’habitude de se décharger sur l’assurance maladie, soit purement et simplement par des transferts, soit de façon plus pernicieuse par des reconductions de dette, soit encore par des partages de financement.
Ensuite, il s’agit d’un budget de transition avant l’application totale de la réforme de l’hôpital public et notamment la création des agences régionale de santé ou la fusion de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
De plus, nous nous situons dans une période de pandémie grippale.
Mais tous ces éléments ne se traduisent pas dans la mission budgétaire que nous devons examiner.
Le 2 novembre dernier, le Président de la République a annoncé, promotion médiatique à l’appui – nous y sommes habitués ! –, un nouveau plan cancer 2009-2013, qui comprend trente mesures.
La Cour des comptes, le Haut Conseil de la santé publique puis l’Inspection générale des affaires sociales ont évalué le premier plan cancer. Selon le Haut Conseil de la santé publique, un tiers des soixante-dix mesures inscrites dans le plan de 2003-2007 ont été mises en place. Par conséquent, nous pouvons nous interroger sur l’utilité d’un nouveau plan, quand nous savons que le précédent n’a pas été appliqué dans son intégralité ! Même s’il est cofinancé inégalement par la mission « Santé » et l’assurance maladie, il mérite que nous nous y attardions.
Reprenant les préconisations du professeur Jean-Pierre Grünfeld et du Haut Conseil de la santé publique, ce plan doit permettre de lutter contre les inégalités d’accès à la prévention et aux soins, et de favoriser la recherche sur les déterminants du cancer, notamment environnementaux et comportementaux.
Seuls les crédits concernant le dépistage et la prévention sont inscrits dans la mission budgétaire. Nous pouvons constater que ces deux postes se trouvent, encore une fois, sous-financés. Mais nous aurons, je l’espère, l’occasion d’aborder de nouveau le sujet lors des prochains mois.
La naissance des agences régionales de santé va profondément modifier les contours et les modalités de la mise en œuvre des politiques de santé publique.
Vous avez ouvert 271 millions d’euros de crédits dans la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Mais nous pouvons constater, une fois encore, que le Gouvernement trompe la représentation nationale. En effet, ces 271 millions sont non pas une création de nouveaux crédits, mais le redéploiement de crédits depuis des services déconcentrés au titre des emplois, des crédits de masse salariale et des crédits de fonctionnement du ministère. Visiblement, le projet de loi de finances rectificative pour 2009 comblera ce manque de financement pour les ARS.
J’en viens au financement de la lutte contre la pandémie grippale.
La propagation du virus A/H1N1 a fortement perturbé le financement de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS. Alors que la programmation initiale des dépenses était de 290 millions d’euros, cet établissement a dû engager plus de 1 milliard d’euros au cours de l’année 2009, notamment pour l’acquisition des vaccins. Au total, les dépenses approcheront 1, 5 milliard d’euros.
Mais aucun signe de ces dépenses n’est visible dans le budget de 2010. Nous serons obligés de procéder à des ajustements dans les prochains textes budgétaires, car nous devons respecter l’obligation inscrite dans les textes fondateurs de l’EPRUS, à savoir la parité de financement entre l’État et l’assurance maladie.
Toujours sur la pandémie grippale, dans le programme 204 « Prévention et sécurité sanitaire », les actions 11 « Pilotage de la politique de santé publique » et 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » enregistrent une baisse des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.
L’Institut de veille sanitaire consacre en ce moment une part importante de ses moyens et de ses effectifs à la surveillance du virus A/H1N1. Mais nous constatons une timide augmentation de ses crédits. Cela paraît étonnant vu les besoins constatés en 2009.
Nous pouvons en déduire que l’Institut de veille sanitaire a dû procéder à des réallocations et différer certaines actions. Si vous l’aviez doté convenablement lors des précédents budgets, cet Institut aurait pu surveiller la survenue de cas de grippe A, tout en poursuivant d’autres actions.
De plus, vous n’avez prévu que cinq emplois équivalents temps plein supplémentaires, alors que trente-cinq seraient nécessaires pour consolider les cellules interrégionales d’épidémiologie existantes et créer les nouvelles antennes nécessaires pour assurer une action de veille et d’alerte dans les régions.
Avant de conclure, je voudrais attirer l’attention de la Haute Assemblée sur un problème qui va croissant, celui de la part du budget des ménages consacrée à la santé. Certes, la crise a augmenté les difficultés que rencontrent ces derniers pour faire face aux dépenses de santé, mais le Gouvernement et la majorité sont responsables de ce problème de santé publique.
Lors du débat sur la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, en refusant de vous attaquer avec toutes les armes possibles à la désertification médicale et aux dépassements d’honoraires – pour ne citer que ces points-là –, vous avez choisi de faire supporter le coût de l’accès aux soins à nos concitoyens, notamment aux plus défavorisés.
L’amendement qui a été adopté lors du débat à l’Assemblée nationale et qui vise à doubler l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire, passant ainsi de 100 euros à 200 euros pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans, est une mesure certes positive, mais insuffisante. Il n’empêche que les études réalisées montrent que la sécurité sociale a moins remboursé en 2008 et que le transfert de charges s’effectue vers les organisations complémentaires, d’une part, et vers les ménages, d’autre part. Or vous refusez de vous attaquer à ce problème, mettant la santé de nombre de nos concitoyens en danger.
Encore cette année, les faibles augmentations de certains crédits masquent la baisse importante d’autres. Mais les conséquences sur la santé des Français se ressentent malheureusement tous les jours.
Face à un système devenu illisible, le sentiment qui domine est celui d’une solidarité en recul. Ce système de santé tourne peu à peu le dos à l’idéal d’un égal accès de tous à des soins de qualité tel qu’il avait été défini lors de la création de la sécurité sociale dans le contrat élaboré en 1945, à la Libération, l’objectif étant alors d’éradiquer l’une des inégalités les plus intolérables de toutes : l’inégalité devant la souffrance et la maladie.
Cette évolution n’est pas le fruit du hasard et ne résulte pas uniquement des difficultés économiques. Elle est bien la conséquence d’un choix politique qui ne dit pas son nom, un système de santé privatisé dans lequel on est remboursé en fonction de la qualité de sa convention de santé privée. Se refusant à toute augmentation des cotisations sociales, le Gouvernement opère ainsi progressivement le transfert de la gestion et du remboursement des soins courants vers les mutuelles et les assurances privées.
Telles sont toutes les raisons pour lesquelles, madame la ministre, le groupe socialiste ne votera pas les crédits de la mission « Santé ».
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Santé » s’élèvent, pour 2010, à 1, 2 milliard d’euros. Cette quasi-stabilité par rapport à la loi de finances pour 2009 peut paraître étonnante eu égard aux grands changements qui affecteront la gestion de la mission l’an prochain.
Qu’il s’agisse de la réorganisation territoriale de la politique de santé, avec l’installation des agences régionales de santé, ou bien des moyens exceptionnels débloqués pour lutter contre la pandémie de grippe A ou encore du lancement du nouveau plan Cancer, qui doit mobiliser 730 millions d’euros pendant la période 2009-2013, toutes ces mesures auront évidemment une incidence.
Or, comme l’a souligné M. le rapporteur spécial, ces dispositions ne se traduisent pas de façon évidente dans la programmation budgétaire pour 2010. Certes, une grande part des dépenses correspondantes est financée par d’autres missions ou par l’assurance maladie, mais un effort de clarification de la part du Gouvernement serait à mon avis nécessaire.
Quoi qu’il en soit, plusieurs orientations de ce budget méritent d’être saluées, comme l’a signalé, entre autres, le rapporteur pour avis, M. Alain Milon.
C’est tout d’abord le cas des crédits consacrés à la formation initiale des internes au sein du programme 171 « Offre de soins et qualité du système de soins ». En hausse pour la deuxième année consécutive, ils devraient permettre de revaloriser la filière de médecine générale et d’ouvrir de nouveaux stages de formation des médecins, disposition parfaitement cohérente avec celle de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui fait du médecin généraliste le pivot de notre système de santé.
M. Bernard Cazeau proteste.

Par ailleurs, ce programme prévoit aussi une subvention de 770 000 euros au groupement d’intérêt public « Carte de professionnel de santé ». Madame le ministre, qu’en est-il de la fusion de cette structure avec le groupement d’intérêt public en charge du dossier médical personnel et avec une partie du Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier, le GMSIH, au sein de l’Agence pour les systèmes d’information de santé partagés, l’ASIP ?
Selon l’excellent rapport de M. Rémi Delatte, cette fusion « ferait de notre pays un leader de la télémédecine et du développement des systèmes d’information médicale partagée. ». Il est donc important de la mener à bien rapidement.
En outre, le renforcement substantiel de l’aide médicale d’État au sein du programme 183 « Protection maladie » traduit aussi, à l’évidence, l’effort de solidarité souhaité par le Gouvernement.
S’agissant du programme 204 « Prévention et sécurité sanitaire », j’approuve pleinement le choix du Gouvernement de continuer à faire de la lutte contre le cancer une priorité nationale.
Comme l’a souligné, entre autres, le rapporteur, l’enjeu est d’importance, le cancer étant devenu la première cause de mortalité en France, devant les maladies cardiovasculaires. C’est le premier risque d’affection de longue durée, avec 1, 5 million de patients et environ 320 000 nouveaux cas par an. On le sait, de fortes inégalités demeurent face au cancer, notamment en termes de qualité des soins prodigués. Ce point est extrêmement important.
Le précédent plan Cancer, lancé en 2002, avait de grandes ambitions. Des progrès importants ont été réalisés en matière de prévention, de dépistages organisés, de prise en charge, notamment avec la création d’un dispositif d’agrément en cancérologie des établissements hospitaliers.
Mais la Cour des comptes a relevé de nombreuses anomalies : défauts de pilotage comme de contrôles interne et externe à tous niveaux, faiblesse persistante des données épidémiologiques concernant la maladie, retards en matière de formation des personnels, carences en matière de cancers professionnels.
Espérons que, dans le nouveau plan, seront tirés les enseignements du premier ! D’une manière générale, on ne voit pas toujours les résultats concrets des plans annoncés à grand renfort de communication. Je pense notamment au plan Alzheimer. Madame le ministre, pouvez-vous nous dire ce qui a été fait depuis son lancement ?
Au-delà de ces maladies, je voudrais insister sur le sida, que l’on a un peu tendance à oublier. La Journée mondiale de lutte contre le sida a été l’occasion, pour un certain nombre d’associations, de rappeler l’engagement des pays riches à financer l’accès universel aux traitements.
Pour ma part, je souhaite mettre l’accent sur la politique de dépistage dans notre pays. Le Conseil national du sida, dont je suis le membre nommé par le président du Sénat et qui fait depuis plusieurs années le constat de son inadaptation, a défini une série d’orientations pour sa réforme.
Conçu et mis en place à une époque où les risques de stigmatisation et de discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH étaient particulièrement importants et où les bénéfices individuels du dépistage étaient limités en l’absence de traitement efficace, le dispositif n’a jamais été significativement modifié.
L’évolution de l’épidémie et le développement de nouveaux moyens thérapeutiques et prophylactiques ont radicalement changé les enjeux, tant individuels que collectifs, du dépistage.
On estime aujourd’hui le nombre de personnes ignorant leur séropositivité à quelque 40 000, et plus de la moitié des personnes nouvellement diagnostiquées le sont trop tardivement. §Ce retard au dépistage est non seulement une perte de chances thérapeutiques pour ces personnes, mais également une opportunité manquée de limiter la transmission du virus.
Le rapport de la Haute Autorité de santé rendu public en octobre dernier préconise, au-delà du maintien et du renforcement d’un dépistage ciblé et régulier pour les populations à risque, de proposer systématiquement un test de dépistage à l’ensemble de la population âgée de quinze ans à soixante-dix ans.
Loin de remettre en cause le principe du consentement libre et éclairé, cette évolution, qui devra faire l’objet d’une évaluation au bout de cinq ans, peut contribuer à la banalisation du dépistage, qui doit devenir un acte courant du suivi de santé.
Madame la ministre, quelles suites entendez-vous donner à ces recommandations, d’ailleurs convergentes avec celles qui ont été formulées par le Conseil national du sida en 2006 ?
Enfin, permettez-moi un dernier mot sur la grippe A/H1NI. Avec 22 morts et 730 000 consultations recensés la semaine dernière, l’épidémie s’est brutalement accélérée. Les centres de vaccination ne désemplissent plus. Certains attendent des heures pour finalement repartir sans être vaccinés. Quelques « réglages », notamment des horaires élargis les jours d’affluence ou des équipes plus étoffées, ne suffiront pas à désengorger les centres. Il est temps d’autoriser les généralistes et les pédiatres à réaliser les vaccinations dans leurs cabinets.

Ces derniers forment un maillage dense sur notre territoire et disposent de la confiance des patients, deux gages de réussite de la vaccination à grande échelle que vous souhaitez !
Sous réserve de ces observations, je voterai bien entendu ce projet de budget.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le budget que nous examinons aujourd’hui est en demi-teinte : sa hausse, estimée entre 1 % et 2 % par rapport au budget de l’année précédente, dissimule mal ses carences.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’aide médicale d’État, nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas pris, comme en octobre 2007, les mesures permettant l’apurement de la dette de l’État envers l’assurance maladie. Ce dispositif souffrant d’une sous-dotation chronique, le remboursement effectué en 2007 est naturellement sans effet sur les difficultés rencontrées pour l’exercice en cours : cette année encore, la totalité des besoins qui se sont exprimés n’est pas couverte financièrement.
Nous avons cru comprendre que le Gouvernement s’était engagé à apurer une nouvelle fois cette dette à l’occasion de la prochaine loi de finances rectificative pour 2009. Une sous-estimation récurrente des besoins n’est pas satisfaisante. Nous souhaiterions que le Gouvernement en tire toutes les conséquences, en majorant le montant de la dotation relative à l’aide médicale d’État.
Par ailleurs, nous ne pouvons nous satisfaire de la faible hausse dont bénéficie l’action 15 « Préventions des risques liés à l’environnement, au travail et à l’alimentation ». Vous le savez, l’AFSSET et l’AFSSA doivent prochainement fusionner. Certains acteurs, très impliqués dans le domaine de la santé au travail, nous ont fait part de leurs craintes : ils redoutent en effet que cette fusion n’entraîne la dissolution de la spécificité de l’AFSSET en matière de santé au travail.
S’il est vrai que le financement du ministère de la santé ne représente que 20 % du budget de l’AFFSET, les récents drames et accidents survenus au travail doivent inciter le Gouvernement à éviter que, à la faveur de cette fusion, le champ de la mission de l’AFSSET en matière de santé au travail ne soit réduit. Nous considérons donc que des financements complémentaires doivent lui être apportés, notamment pour lui permettre de renforcer les personnels de la future agence, spécialement ceux qui se consacrent aux problèmes de santé au travail, et ce d’autant plus que la mise en œuvre du plan santé au travail rend indispensable la création d’au moins cinq équivalents temps plein.
De même, nous nous étonnons d’une diminution d’environ 1, 9 % par rapport à 2009 des crédits affectés à l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades », et ce alors même qu’une grande majorité de cette dotation sera affectée aux agences régionales de santé.
Si nous saluons le deuxième plan cancer, nous nous interrogeons sur les conséquences que pourrait avoir la diminution des crédits alloués au dépistage, qui passent de 19, 2 millions d’euros en 2009 à 18, 5 millions en 2010. Cette diminution s’explique d’autant moins que le dépistage organisé du cancer du sein est progressivement monté en puissance. D’après les projections dont nous disposons, le taux de participation au dépistage devrait s’établir à 55 % en 2009 et atteindre plus de 62 % en 2011. La diminution programmée des dotations issues de l’État fait donc peser un véritable risque sur le dépistage primaire, dont on connaît pourtant l’importance dans le traitement des affections qui en font l’objet. À cet égard, nous partageons le constat formulé dans le rapport spécial du député Gérard Bapt, selon lequel « l’ensemble des travaux d’évaluation du plan cancer 2003-2007 ont mis en évidence la nécessité de poursuivre les programmes de dépistage organisé, et en particulier de renforcer le taux de participation de la population cible, qui demeure insuffisant ».
Enfin, nous regrettons que la lutte contre le saturnisme n’apparaisse pas clairement comme une priorité du Gouvernement. Selon une étude de l’INSERM, qui remonte à 2006 mais semble d’actualité, il y aurait en France, au bas mot, 84 000 enfants victimes de saturnisme. Cette maladie – il est important de le préciser – est liée à la pauvreté. Elle exige des pouvoirs publics qu’ils coordonnent leurs moyens pour lutter contre l’insalubrité, tant il est vrai que cette affection est trop souvent la conséquence de l’exposition à certains matériaux ou peintures essentiellement présents dans les habitats anciens et insalubres. On le sait, la contamination par le plomb peut avoir des conséquences très graves, particulièrement pour les femmes enceintes et les enfants.
Contrairement aux apparences, cette maladie, dont chacun constate la recrudescence, n’est pas une fatalité, puisque nous avons les moyens de la circonscrire par un traitement social d’urgence. Aucun traitement curatif n’existant à l’heure actuelle, nous sommes convaincus que la véritable solution passe par la suppression des logements insalubres.
Dans le même temps, un volet santé, reposant principalement sur le dépistage, doit être mis en œuvre, en organisant notamment l’information des populations concernées. Il exige une démarche volontariste, d’autant que, selon le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2004, « l’activité de dépistage sur le territoire apparaît notoirement insuffisante », sauf à m’indiquer que la situation a radicalement changé depuis cette date. Dans ce domaine, madame la ministre, il y a donc beaucoup à faire !
L’activité de dépistage n’est soumise à aucune obligation, ce qui provoque des disparités importantes d’un département à l’autre. Ainsi peut-on établir que 84 % des dépistages sont concentrés sur Paris et le département de Seine-Saint-Denis.
Nous considérons par ailleurs qu’il faut aider au développement de la recherche médicale dans ce domaine.
Enfin, en matière d’accès aux soins, nous ne pouvons que constater le caractère inopérant du système mis en place par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, autorisant les patients et leurs associations à saisir les ordres professionnels lorsqu’ils s’estiment victimes d’un refus de soins en raison de leur assujettissement à la couverture maladie universelle. Si ce mécanisme n’a été que peu utilisé à ce jour, c’est sans doute en raison de l’absence d’information des patients quant à leurs droits et obligations, en raison de leur vulnérabilité.
C’est pourquoi, compte tenu des difficultés grandissantes d’accès aux soins pour les personnes les plus défavorisées bénéficiant de la CMU, il aurait été souhaitable de renforcer les obligations pesant sur les professionnels de santé, notamment en autorisant le testing ou l’inversion de la charge de la preuve, d’autant que la loi HPST apporte la précision suivante : un praticien peut toujours opposer un refus de soins « fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins ». Cette nouvelle disposition, introduite par notre assemblée, risque de limiter la portée du principe de l’obligation de soins.
Nous regrettons d’autant plus cette situation que rien n’a été fait, ni dans la loi HPST ni à l’occasion du PLFSS pour 2010 dont nous venons de débattre, pour garantir l’accès de tous à des soins de qualité et à des tarifs opposables. Il est désormais reconnu que la part du budget des ménages consacrée à la santé a augmenté de 50 % depuis 2001. Cette situation résulte naturellement des mesures de déremboursement, mais aussi et surtout de l’explosion des dépassements d’honoraires qui pèsent sur l’ensemble des patients, et plus particulièrement sur les plus défavorisés d’entre eux.
Au regard des besoins et des populations, ce budget apparaît donc insuffisant. C’est la raison pour laquelle les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG voteront contre les crédits de cette mission.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes à la veille de plusieurs échéances cruciales pour notre politique de santé. En 2010, nous élaborerons une nouvelle loi de santé publique, nous réviserons les lois de bioéthique et veillerons à la mise en place des agences régionales de santé. Ces projets ambitieux auront une incidence majeure, nous l’espérons tous, sur notre système de soins.
La mission « Santé » regroupe – les différents orateurs l’ont rappelé – trois programmes budgétaires : « Offre de soins et qualité du système de soins », dont les crédits atteignent 491 millions d’euros ; « Protection maladie », doté de 585 millions d’euros ; et « Prévention et sécurité sanitaire », qui bénéficie de 124 millions d’euros. Ainsi, l’ensemble des crédits alloués à cette mission représente 1, 2 milliard d’euros, montant quelque peu dérisoire par rapport aux 179 milliards d’euros octroyés à la branche maladie de la sécurité sociale. Mais, ne nous y trompons pas, ces crédits jouent un rôle essentiel eu égard au caractère sensible des secteurs qu’ils financent : prévention, sécurité sanitaire, formation professionnelle et solidarité.
Ces crédits sont tout d’abord destinés à la politique de prévention ; ils sont ainsi affectés aux programmes destinés à faire évoluer les comportements, notamment dans le cadre de la lutte contre les pratiques addictives et à risque, en particulier chez les jeunes. L’importance de ces programmes n’est plus à démontrer lorsque l’on songe à l’augmentation de l’alcoolisation expresse des jeunes, appelée binge drinking. Cet usage destructeur, apparu voilà quelques années, aurait progressé de plus de 10 % en France entre 2005 et 2008, selon les chiffres de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies. En 2008, près de 20 % des jeunes de dix-sept ans interrogés s’y seraient livrés.
Cette évolution de la consommation alcoolique est forcément inquiétante : la dépendance précoce à l’alcool et ce type d’alcoolisation massive peuvent entraîner des actes de violence et des accidents graves pour ces mineurs.
Il est nécessaire d’orienter davantage la prévention contre l’alcoolisme en direction des jeunes de moins de seize ans, pour éviter la dépendance des jeunes âgés de dix-sept à dix-neuf ans.
Dans cette optique, madame la ministre, nous aimerions savoir quelles mesures spécifiques vous avez prévues en direction de ce public, et, plus généralement, comment vous comptez mettre en œuvre les dispositions de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires tendant à lutter contre ces comportements à risque.
Par ailleurs, des crédits de la mission « Santé » sont consacrés à la veille et à la sécurité sanitaires. Mes collègues ont parlé du rapprochement entre l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA, et l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, l’AFSSET, dont le principe a été inscrit dans la loi HPST. Cette unification de la prévention des risques liés à l’environnement, au travail et à l’alimentation était particulièrement nécessaire.
Je citerai un exemple que je connais bien, et que j’ai déjà évoqué à plusieurs reprises à cette tribune, celui du chlordécone aux Antilles. Il démontre bien la pertinence de ce rapprochement, car seule une approche globale permettra de lutter à la fois contre l’exposition de nos concitoyens aux polluants persistants et contre les contaminations des populations par voie alimentaire, comme c’est le cas aux Antilles.
En outre, la formation des professionnels constitue l’une des priorités du programme « Offre de soins et qualité du système de soins ». La médecine générale doit être au cœur de cette formation. Les crédits correspondants du programme assureront essentiellement le financement des stages extra-hospitaliers destinés aux futurs médecins, les généralistes devant constituer le pivot de l’offre de soins, comme le prévoit la loi HPST.
Ces stages permettront d’offrir à ces futurs médecins une formation clinique diversifiée qui, j’en suis sûre, concourra au développement de l’offre de soins de premier recours, à laquelle nous sommes attachés, et qui s’avère indispensable.
La mission « Santé » a aussi un rôle essentiel à jouer en matière de solidarité nationale, puisqu’elle finance l’indemnisation des personnes victimes de l’amiante et l’accès aux soins des personnes défavorisées. L’augmentation de 45 millions d’euros des crédits correspondants, qui permet de rapprocher les crédits alloués du montant effectivement dépensé, traduit la continuité de l’effort du Gouvernement pour améliorer la sincérité budgétaire quant aux sommes destinées à financer l’aide médicale d’État.
La mission « Santé » est marquée par les réformes structurelles, toujours issues de la loi HPST, sur laquelle nous avons travaillé de nombreuses semaines au printemps et au début de l’été 2009. Je pense naturellement, comme mes collègues, à la création des agences régionales de santé, lesquelles doivent permettre de renforcer l’efficacité du système de soins en regroupant, dans chaque région, l’ensemble des compétences nécessaires à la coordination de la politique nationale de santé et à son adaptation au plus près des besoins de nos concitoyens. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que les agences régionales de santé seront bien opérationnelles au premier semestre 2010 ? Leur mise en place à cette échéance nous paraît essentielle.
Je souhaite conclure en rendant hommage au Président de la République et au Gouvernement pour les dernières mesures qu’ils ont prises dans le domaine de la santé.
Je pense tout d’abord au plan cancer II, présenté le mois dernier, qui couvrira la période 2009-2013. Inspiré par le rapport du professeur Jean-Pierre Grünfeld, ce plan fondamental à nos yeux va consolider les acquis du plan 2003-2007 dans le domaine du dépistage et de la qualité des soins. Notre collègue François Autain a d’ailleurs souligné que ce premier plan portait enfin ses fruits en matière de prévention du cancer du sein.
Le plan cancer II se fixe également pour objectif plus ambitieux de réduire les inégalités face au cancer et de faire de la vie après le cancer, aspect qui n’avait pas été véritablement abordé jusqu’à présent, un axe à part entière de la lutte contre cette maladie.
Au-delà de la recherche, de l’observation, de la prévention et du dépistage, ce plan comprend également un volet relatif aux soins apportés aux malades, et à la vie pendant et après le cancer.
Pouvez-vous nous préciser, madame la ministre, quel sera le montant des crédits alloués à ce plan cancer II ?
Tous les jeunes, et tous les parents que nous sommes, se réjouissent également de la mesure qui vise à doubler l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé pour les moins de vingt-cinq ans, en la faisant passer de 100 euros à 200 euros. Cette décision est conforme à l’engagement pris par le Président de la République le 29 septembre dernier, lors de la présentation du « Plan Jeunes ». Mais cette mesure, pour être efficace, doit être identifiée, c’est-à-dire que les jeunes doivent être au courant de ces aides. J’aimerais donc, madame la ministre, connaître les moyens d’information que vous comptez mettre en œuvre pour porter cette mesure à la connaissance des intéressés.
Étant donné l’importance et la pertinence des actions prévues par la mission « Santé », le groupe UMP votera les crédits qui lui sont destinés.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avec 1, 2 milliard d’euros de crédits, la mission « Santé » fait figure de parent pauvre au regard de l’ensemble des crédits de notre système de santé. La part de la santé est d’ailleurs de plus en plus importante dans le budget des ménages depuis une décennie, comme l’a très justement fait remarquer notre collègue René Teulade, en raison des déremboursements et des charges nouvelles transférées au fil des années vers les assurés sociaux.
Dès 2010, nous allons connaître simultanément une réorganisation territoriale majeure de la politique de santé, avec l’installation des ARS, le lancement d’un nouveau plan de lutte contre le cancer et, bien-sûr, le dispositif de vaccination généralisé contre la pandémie de grippe A/H1N1.
En revanche, la traduction budgétaire de ces mesures semble tarder à se concrétiser. En effet, avec une augmentation des crédits de 50 millions d’euros l’année prochaine, le budget de la mission « Santé » incite au mieux à la « modestie », pour reprendre le terme gentiment employé par M. Milon, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Il apparaît en tout état de cause dérisoire eu égard aux grands changements qui affecteront cette mission en 2010.
Ainsi, le financement sur trois ans de la mise en place opérationnelle des ARS, qui verront progressivement le jour au cours du premier semestre 2010, se chiffrerait à 40 millions d’euros. Pour leur première année de fonctionnement, le besoin net de financement devrait être couvert par une ouverture de crédits dans le collectif budgétaire pour 2009 de l’ordre de 12 millions d’euros. Pour l’avenir, vous pariez sur les fruits d’un travail de redéploiement des crédits, permettant de dégager un autofinancement de 30 millions d’euros. L’espoir fait vivre !
Les ARS réuniront à terme près de 10 000 agents, dont, pour l’État, 7 810 équivalents temps plein. Qu’est-il prévu pour harmoniser les statuts des personnels provenant de divers horizons : Caisse nationale d’assurance maladie, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, secteur privé ? L’harmonisation se fera-t-elle vers le haut ou vers le bas ? Va-t-on instaurer différents types de statuts pour les agents ? Nous n’avons pour l’heure reçu aucune réponse à ces questions.
Ensuite, le deuxième plan cancer, s’il a le mérite de placer cette maladie grave au cœur des préoccupations, nous amène à douter de l’avenir. Je voudrais, comme d’autres orateurs l’ont fait avant moi, rappeler les conclusions auxquelles la Cour des comptes était parvenue l’année dernière dans un rapport consacré à la mise en place du plan cancer 2003-2007. Un tiers des soixante-dix mesures de ce plan ont été complètement réalisées, un tiers inégalement et un tiers peu ou pas du tout, faute de financements pérennes. Pourquoi faire un deuxième plan cancer si le premier n’a pas abouti ?
Le combat contre cette maladie, qui cause annuellement le décès de plus de 150 000 de nos concitoyens, va-t-il connaître ainsi le même sort que le plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer, qui avait été déclarée autre grande cause nationale l’année dernière ? Pour ce plan, évoqué par Gilbert Barbier, nous constatons une baisse de 5 % des crédits dans l’action « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades ». Il est vrai que la politique des effets d’annonce est une constante de ce gouvernement.
Ma troisième remarque concerne le traitement de la pandémie de grippe A/H1N1. Ce dernier est financé non par les crédits affectés à la mission « Santé », mais par une avance de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS.
Là encore, je ne reviendrai pas sur les amendements scélérats présentés par le Gouvernement lors du dernier PLFSS, adopté jeudi dernier par le Sénat.
Comme d’habitude, vous faites preuve d’une grande mesure, monsieur Cazeau ! Gardez donc la scélératesse pour d’autres dossiers !

Les assurés sociaux n’ont pas, selon nous, à se substituer à l’État pour régler les problèmes liés à la prise en charge exceptionnelle de cette mesure sanitaire.
À ce sujet, vous avez très certainement voulu démontrer que, en matière de vaccination de masse, vous pouviez vous passer des professionnels libéraux. Les files d’attente vous prouvent le contraire, comme Gilbert Barbier vous l’a déjà fait remarquer. Attendre des heures pour se faire piquer ! Jusqu’à quand demanderez-vous aux Français de s’appliquer ce masochisme républicain ?
Pour le reste, force est de constater que, en matière de crédits destinés à la santé publique, les années se suivent et se ressemblent.
Pour le programme « Prévention et sécurité sanitaire », les autorisations d’engagement pour 2010 s’élèvent à 471, 8 millions d’euros, soit une progression de 1, 74 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2009. Le montant des crédits de paiement est, quant à lui, de 491, 3 millions d’euros.
Cette augmentation recouvre des évolutions contrastées selon les actions du programme. Sur les sept actions auxquelles des crédits ont été attribués, trois enregistrent une diminution importante de leurs moyens, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement. Il s’agit des actions 11 « pilotage de la politique de santé publique », 14 « prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » et 16 « Réponse aux alertes et gestion des urgences, des situations exceptionnelles et des crises sanitaires ». On peut s’étonner de ces choix.
En effet, les mesures d’urgence prises dans le cadre de la préparation à une pandémie grippale ont été financées par une ouverture de crédits de l’ACOSS en faveur de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS, afin de compléter les crédits nécessaires.
La régularisation de la part prise en charge par l’État devra intervenir dans la loi de finances rectificative, si bien que les prévisions budgétaires incluses dans le projet annuel de performances pour 2010 ne permettent nullement de prendre la mesure, du moins à ce jour, de l’effort financier consenti par l’État pour lutter contre la grippe A.
En ce qui concerne le deuxième programme de la mission « Santé », il est constitué de la participation de l’État à l’organisation d’une offre de soins de qualité. Bien que marginaux par rapport au financement apporté dans ce domaine par l’assurance maladie dans le cadre du PLFSS, les crédits de ce programme n’en devraient pas moins avoir un rôle très important.
En effet, ils assurent principalement le financement des stages extra-hospitaliers effectués par les futurs médecins dans le cadre des formations médicales. Pour autant, comme la réflexion menée en matière d’organisation médicale dans le cadre de la loi HPST a vraiment été minimale, il est permis de s’interroger sur la crédibilité de ce programme.
Enfin, le dernier programme de la mission, celui qui concerne la protection maladie, sera doté en 2010 de 585 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, soit une hausse des crédits de 8, 3 % par rapport à 2009, à mettre au compte de la seule aide médicale d’État, ou AME, dont la sous-dotation structurelle est toujours d’actualité.
À cet égard, je tenais à souligner l’étrangeté de vos mesures visant à faciliter l’aide à l’acquisition de couvertures complémentaires de santé pour les assurés couverts par des contrats collectifs, lesquels profitent avant tout aux cadres des grandes entreprises. Elles permettront notamment de mieux leur rembourser leurs dépassements d’honoraires. Le coût de cette niche sociale est évalué à 2, 2 milliards d’euros pour 2010 ! Là encore, quel paradoxe ! C’est donc en quelque sorte aux contribuables, ou aux cotisants sociaux, et principalement aux bas revenus, qu’il revient d’entretenir le mécanisme pervers des dépassements d’honoraires pour les hauts revenus !
Il en est de même de la fiscalisation des indemnités journalières accordées aux victimes d’accidents du travail, sur laquelle nous souhaiterions connaître votre point de vue.
Sur tous ces sujets, comme sur d’autres, le décalage entre les bonnes intentions annoncées et les actes concrets saute aux yeux. Alors que ces crédits devraient traduire l’implication de l’État en matière de santé publique, ils démontrent en réalité la tendance de l’État à s’en décharger, soit sur l’assurance maladie, par le biais de transferts, purement et simplement, soit de façon plus détournée, par des reconductions de dettes – la dette au titre de l’AME, qui commence tout juste à être apurée depuis l’an dernier, en constitue un bon exemple –, ou encore par des cessions partielles de financement aux collectivités territoriales, qui constituent souvent les prémices d’un désengagement.
L’État se voit, ici ou là, obligé de saupoudrer des actions de rattrapage qui n’auraient plus lieu d’être si un travail de réflexion globale était mené en amont.
Les difficultés d’accès aux soins ne vont donc pas être réglées par ce budget. C’est moins une question d’argent qu’une question de volonté politique. Il serait temps de mettre les intérêts des assurés sociaux au cœur de vos préoccupations, avant de satisfaire tels ou tels lobbies. Je me dois ainsi d’insister sur le fait que de trois à quatre millions de nos compatriotes ne bénéficient toujours pas de couverture complémentaire de santé.
Telles sont toutes les raisons pour lesquelles, madame la ministre, le groupe socialiste ne votera pas les crédits de la mission « santé ».
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, avant de répondre aussi exhaustivement que possible aux différents orateurs qui se sont exprimés, je reviendrai brièvement sur les grandes orientations budgétaires de cette mission « Santé » et aborderai quelques points spécifiques de cette programmation pour 2010.
L’augmentation de 4, 4 % des moyens de cette mission vise plusieurs objectifs.
Tout d’abord, nous voulons prolonger en 2010 les priorités de l’État en matière de santé publique.
Le programme 204 « Prévention et sécurité sanitaire » sera doté de 471 millions d’euros en autorisations d'engagement et de 491 millions d’euros en crédits de paiement, soit des moyens stables par rapport à la loi de finances initiale pour 2009.
L’année 2010 s’inscrira toutefois dans un contexte marqué par de nouvelles avancées : la politique de santé publique sera territorialisée avec la mise en place des ARS ; notre action sur les comportements individuels « à risque » – l’alcool et le tabac –, mais aussi en matière de nutrition sera également renforcée par la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de la loi HPST ; enfin, nous entrerons dans la phase active de la mise en œuvre du deuxième plan cancer, qui vient d’être annoncé par le Président de la République.
Par rapport à la base 2009, la mise en œuvre de ce plan nécessitera d’inscrire progressivement, jusqu’en 2013, 750 millions d’euros de mesures nouvelles, principalement portées par l’assurance maladie. Ces efforts représenteront 102, 8 millions d’euros pour le budget de l’État en 2010, dont 79, 1 millions d’euros pour le programme 204 de la mission « Santé », soit une progression de 12, 5 millions d’euros par rapport à 2009.
Les crédits de la mission « Santé » participeront ensuite à l’effort de solidarité nationale à travers l’AME et la CMUC.
Beaucoup d’entre vous l’ont signalé, une mesure nouvelle à l’article 59 bis, proposée par le Gouvernement à travers un amendement déposé à l’Assemblée nationale, permettra de doubler le montant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans.
Cette mesure prolonge nos efforts pour favoriser l’accès aux soins des jeunes dont le taux de couverture complémentaire est moins élevé que celui du reste de la population. Son coût annuel est estimé à 30 millions d’euros, et elle sera financée à partir des excédents du fonds CMU.
En outre, le dispositif de l’AME est consolidé à travers un rebasage de 45 millions d’euros des crédits du programme 183 « Protection maladie ».
Comme l’a souligné M. le rapporteur spécial, cette augmentation traduit un effort de sincérité budgétaire dans la mesure où, depuis l’apurement des dettes de l’État à l’égard de la sécurité sociale qu’Éric Woerth avait mené à bien en 2007, à hauteur de 920 millions d’euros – ce n’était pas rien ! –, les insuffisances budgétaires par rapport aux besoins réellement constatés ont entraîné la reconstitution d’une dette vis-à-vis de la CNAMTS, qui s’élèvera à 380, 5 millions d’euros à la fin de 2009.
Monsieur le rapporteur spécial, il ne s’agit donc pas d’une « explosion » des dépenses de l’AME de droit commun ; nous voulons juste poursuivre l’effort entrepris depuis 2008 de doter correctement ce dispositif.
Ces dépenses font l’objet d’un pilotage étroit, qui a conduit à étendre progressivement aux bénéficiaires de l’AME les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux assurés de droit commun. Certains s’en sont choqués ; or, ce qui aurait été choquant, c’est de ne pas procéder de la sorte.
Les bénéficiaires de l’AME sont ainsi soumis au contrôle médical pour la mise en affection de longue durée, ou ALD. Le contrôle médical a été systématisé pour ces bénéficiaires en cas d’accès aux soins urgents.
Autres exemples, la substitution de médicaments génériques conditionne la prise en charge à 100 % des médicaments pour les personnes relevant du régime général, tandis que l’attestation d’un titre sécurisé par bénéficiaire du dispositif, demande qui a été souvent formulée par la Haute Assemblée, a été généralisée cette année.
La bonne gestion de ce dispositif est le gage de sa pérennité et de son acceptabilité par notre société. Soyez donc assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, de ma détermination à poursuivre la maîtrise des dépenses induites par ce système de prise en charge.
Par ailleurs, les crédits budgétaires de la mission « Santé » traduisent la volonté d’améliorer le pilotage stratégique des dépenses hospitalières.
Les 124, 5 millions d’euros de crédits du programme correspondent pour l’essentiel à la formation initiale des médecins. À ce titre, 104 millions d’euros seront consacrés à la formation médicale initiale extrahospitalière des étudiants de deuxième cycle, des internes et de l’année de recherche suivie par certains d’entre eux. Cette augmentation est liée au numerus clausus et à l’extension des stages du deuxième cycle des études médicales chez les médecins généralistes. Il nous faut renforcer la médecine de premier recours.
Conformément aux demandes réitérées du Parlement, ces crédits ont donc bénéficié d’une augmentation de presque 20 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2009.
J’en viens maintenant à certains aspects spécifiques de ce projet de loi de finances pour 2010 qui méritent un éclairage particulier.
Le premier point concerne le financement de la campagne vaccinale contre la pandémie grippale.
Les dépenses approcheront au final 1, 5 milliard d’euros, dont 1, 04 milliard d’euros d’achats de produits de santé, de dispositifs médicaux et de coûts logistiques pris en charge par l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS.
Nous avons fait le choix de la prévention, avec une campagne de vaccination généralisée. Nous avons commandé 94 millions de doses, ce qui nous a conduits à prévoir des ajustements en partie rectificative de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et en loi de finances rectificative pour 2009.
Une fois encore, je salue les organismes d’assurance maladie complémentaire qui ont apporté leur contribution à cette campagne. Celle-ci est la traduction de leur mission de prévention vis-à-vis de leurs affiliés, mais elle constitue aussi un geste de solidarité nationale.
L’UNOCAM souhaite apporter son concours sous la forme et selon les modalités proposées par le Gouvernement à l’article 59 ter de ce projet de loi.
S’agissant d’une contribution volontaire, je souhaite que nous respections ainsi la volonté de la partie versante.
Je vous demanderai donc de maintenir l’article 59 ter du projet de loi de finances pour 2010, qui affecte le produit de cette contribution exceptionnelle à l’EPRUS.
En outre, et par cohérence, le Gouvernement a déposé un amendement qui vise à la fois à supprimer les dispositions miroir de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et à réviser à la baisse le taux de cette contribution pour tenir compte de l’application d’un taux de TVA réduit sur les achats de doses de vaccin. Cette action était impossible tant que nous ne disposions pas de l’autorisation de mise sur le marché.
La mise en place des agences régionales de santé a également été évoquée. Effectivement, madame Procaccia, les agences verront le jour progressivement, au cours du premier semestre 2010. Leur création aura dès l’année prochaine une traduction budgétaire, puisque j’ai tenu à regrouper l’ensemble des moyens de fonctionnement des vingt-six agences sur un seul programme, afin d’accroître la lisibilité de ce dispositif.
Les moyens de fonctionnement des agences régionales d’hospitalisation jusque-là inscrits au sein du programme 171 « Offre de soins et qualité du système de soins » et prévus à hauteur de 21, 1 millions d’euros en 2009, seront réunis au sein de ce nouveau programme. Ce regroupement permettra d’abonder les ARS sous la forme d’une subvention globale, à partir des crédits des anciennes DDASS-DRASS. Les moyens des ARS seront ainsi globalisés dans les budgets des établissements, qui recevront une subvention de fonctionnement courant de l’État et de l’assurance maladie. Toutefois, cette subvention ne comprendra pas les crédits d’intervention de santé publique, qui seront délégués globalement et en cours d’année aux ARS, à partir du programme 204.
Ce programme contiendra d’ailleurs une nouvelle sous-action intitulée « Politique territoriale de santé », sur laquelle seront progressivement versés les crédits que les ARS auront à gérer en fonction des priorités régionales de santé publique.
Sans doute faudra-t-il faire évoluer la maquette budgétaire pour mieux rendre compte de cette réforme importante et des moyens qui y sont consacrés.
J’ajoute enfin que les coûts non pérennes de la mise en place des agences régionales de santé, estimés à 68 millions d’euros sur trois ans, feront l’objet d’un traitement spécifique. Ces dépenses seront autofinancées à hauteur de 40 % par redéploiement au sein des crédits du ministère de la santé et des sports, et des moyens supplémentaires seront prévus à hauteur de 12 millions d’euros en collectif budgétaire pour 2009.
Enfin, le Gouvernement a prévu que les régimes d’assurance maladie participeront à hauteur de 40 % du coût total d’installation des ARS, soit 28 millions d’euros, via l’abondement d’un fonds de concours.
Un troisième et dernier élément, important pour les comptes sociaux, n’apparaît pas dans les comptes de la mission « Santé » pour 2010 : c’est celui qui concerne les arbitrages récents visant à apurer les dettes de l’État à l’égard de la sécurité sociale. Des ouvertures exceptionnelles seront en effet prévues par le collectif de fin d’année pour éviter la reconstitution d’une dette sur l’exercice 2009, dette à laquelle fait la chasse M. le rapporteur spécial.
Il s’agira, dans ce cadre, d’apurer la dette antérieure au titre de l’AME, pour laquelle 278, 5 millions d’euros de crédits seront ouverts. Ces moyens seront bien entendu fléchés avec précision. C’est une demande bien légitime des partenaires sociaux et de vous-mêmes qui sera ainsi satisfaite.
Cet apurement traduira un effort de sincérité budgétaire, qui s’ajoute à notre décision de faire supporter intégralement par l’État le financement des 9, 4 millions de doses de vaccin destinées à l’Organisation mondiale de la santé, dans le cadre des actions de solidarité internationale, ainsi qu’à la révision de plus de 45 millions d’euros en projet de loi de finances pour 2010 des crédits au titre de l’AME.
J’en viens maintenant aux questions soulevées par les différents orateurs.
M. le rapporteur spécial, M. le rapporteur pour avis et Catherine Procaccia m’ont interrogée sur les conséquences de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET. Cette opération a pour objectif de rendre plus efficaces les missions de service public actuellement confiées aux deux établissements et de tirer les conséquences du Grenelle de l’environnement en matière de gestion des risques et de gouvernance. L’indépendance de ces agences était au cœur de mes préoccupations ; elle sera préservée. Au final, leur fusion permettra de faire émerger des problématiques nouvelles, sans que les problématiques actuelles soient pour autant négligées.
Les cultures propres des agences constituent une richesse et sont l’une des raisons qui expliquent, d’une part, les bonnes relations qu’elles entretiennent avec leurs partenaires, d’autre part, la satisfaction de leurs commanditaires. L’organisation interne du futur établissement devra bien entendu intégrer cette problématique de la visibilité des grands dossiers en se structurant autour de pôles bien identifiés.
J’ai demandé au conseiller d’État Thierry Tuot de mener un travail de concertation aussi large que possible avec l’ensemble des parties prenantes. Les engagements issus de cette concertation trouveront une traduction dans un projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, que je soumettrai au Parlement en janvier prochain. Celle-ci sera prise avant le 21 janvier 2010. Ainsi, le contrat d’objectifs et de moyens pourra être renouvelé et prolongé pour 2011.
S’agissant du plan cancer II, je crois avoir répondu assez largement à M. le rapporteur spécial et à M. le rapporteur pour avis, ainsi qu’à MM. Barbier et Teulade. Son financement, qui augmentera progressivement au cours des cinq prochaines années, sera assuré à la fois par l’État et l’assurance maladie. Monsieur le rapporteur spécial, 242 millions d’euros lui seront consacrés en 2009, et 314 millions d’euros en 2010.
M. le rapporteur pour avis m’a interrogée sur la santé mentale. Au total, le plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008 prévoyait une délégation pluriannuelle de crédits de fonctionnement de 287, 5 millions d’euros, complétés par 188, 5 millions d’euros provenant du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, et un financement spécifique pour la création du HSA.
Nous dressons actuellement le bilan de ce plan. Dès après, nous verrons comment le prolonger. Si le calendrier parlementaire n’est pas trop chargé, je présenterai un projet de loi relatif à l’hospitalisation sous contrainte afin d’y apporter les améliorations nécessaires.
M. Teulade a évoqué la répartition des dépenses liées à la grippe A H1N1. Nous avons déjà longuement évoqué ce sujet, je ne m’y attarderai donc pas.
M. Jean-Jacques Jégou a regretté l’absence d’optimisation des stocks de l’EPRUS avec l’arrivée à péremption des produits. Je partage pleinement cette préoccupation qui doit nous amener à nous interroger sur la sécurité des produits, mais aussi sur la bonne gestion des finances publiques.
J’ai donc donné instruction au directeur général de l’EPRUS de définir une stratégie de réduction des coûts de possession et d’entretien des stocks nationaux. Je transmettrai toutes les informations utiles sur ce sujet à M. Jean-Jacques Jégou, qui a accompli un travail remarquable dont j’ai tenu le plus grand compte pour améliorer la gestion de l’EPRUS.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le rapporteur général de la commission des affaires sociales, je tiens toujours le plus grand compte des travaux du Parlement, et tout particulièrement de ceux du Sénat. Ils ne sont jamais complaisants, mais ils constituent une aide précieuse à la décision publique.
Sourires.- Mme la présidente de la commission des affaires sociales fait un signe d’approbation.
Plusieurs intervenants m’ont demandé, et c’est une question d’actualité, pourquoi nous n’avions pas encore associé les médecins généralistes à la vaccination contre la grippe.
Les raisons en sont simples. Tout d’abord, il faut préserver la capacité soignante de nos médecins généralistes qui doivent faire face à un nombre croissant de consultations supplémentaires liées à la grippe A H1N1 : 410 000 voilà quinze jours, 730 000 la semaine dernière et nous devrions atteindre le nombre de 950 000. Il nous faut impérativement préserver la capacité soignante des médecins généralistes.
Les cabinets de médecine générale sont soumis à de très fortes tensions. Toutes les informations qui me reviennent vont dans ce sens. Et la situation ne va pas s’améliorer. Nous approchons de la période de Noël, pendant laquelle se développent différentes épidémies saisonnières, gastroentérites et bronchiolites notamment. Il est donc crucial d’assurer la permanence des soins alors que certains médecins aspirent bien évidemment à prendre quelques jours de congés à l’occasion de fêtes qui sont essentiellement familiales.
Hier, un généraliste, médecin traitant de 1 100 patients, me déclarait que, selon ses calculs, s’il devait vacciner ces 1 100 patients avant le 15 janvier, à raison de vingt-cinq jours de consultation et de vingt minutes bon poids par consultation, il lui faudrait vacciner quarante-quatre patients par jour, ce qui l’amènerait à faire des journées de quatorze heures.
Nous n’avons donc pas associé les médecins aux opérations d’abord pour préserver les capacités de soins, mais aussi pour des raisons de logistique.
La Fédération française des médecins généralistes, MG France, qui est le principal syndicat de médecins généralistes, a clairement été dans le sens du Gouvernement. Elle considère que la vaccination par des généralistes ne serait possible qu’avec des doses unitaires. Or, la majorité des stocks disponibles est composée de vaccins multidoses.
La Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, veut donner un coup de main. Mais que doit-on entendre par « coup de main » ? Les médecins prendront-ils en charge 5 %, 25 %, 50 % des vaccinations ?
Comment organiser la logistique d’une campagne de vaccination dont on ignore complètement le format ? Notre pays compte 22 000 pharmacies, 57 000 généralistes et 6 000 pédiatres. Comment puis-je organiser la diffusion des stocks de vaccins dans des conditions de sécurité sur la base d’un format que je ne connais pas et qui peut en outre varier d’un endroit à l’autre. C’est notamment le cas si une pharmacie sert un cabinet de médecins généralistes qui a décidé de ne pas vacciner. Dois-je rappeler que selon un sondage réalisé par Le Quotidien du médecin, la moitié des généralistes refuse de vacciner. La moitié ! Une union régionale du syndicat des médecins libéraux a même fait savoir au Gouvernement qu’elle ne voulait pas vacciner.
Comment pourrais-je organiser la logistique de la vaccination avec de telles distorsions ? C’est évidemment tout à fait impossible.
Nous n’excluons pas les médecins généralistes. Si certains d’entre eux ont du temps, s’ils souhaitent consacrer deux ou trois heures par jour à la vaccination, qu’ils viennent nous aider ! On a besoin d’eux dans les centres, dans les équipes mobiles ! On ne les exclut pas ! Ils ont toute leur place dans le dispositif. Mais il faut qu’ils comprennent les problèmes de logistique auxquels se heurtent le Gouvernement et la puissance publique. Il va nous falloir vacciner 300 000 personnes par jour. Nous aurons donc vraiment besoin des forces de la médecine générale.
Oui, je fais confiance aux médecins généralistes, mais je souhaite qu’ils prennent en compte les difficultés d’organisation d’une campagne de santé publique d’une ampleur sans précédent dans notre pays.
J’ai déjà répondu sur l’Agence des systèmes d’information partagés de santé, l’ASIP santé, qui fonctionne depuis le 15 septembre.
Monsieur Barbier, le dépistage du sida reste capital, et je vous remercie de l’avoir évoqué, au lendemain d’ailleurs de la Journée mondiale de lutte contre le sida. La France maintient ses efforts en ce domaine sur le plan tant national qu’international. Nous ne devons pas relâcher nos efforts. Certes, le taux de contamination a baissé de 22 % en cinq ans, mais certaines catégories de la population, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, restent particulièrement exposées puisque le taux annuel de contamination est de un pour cent personnes, soit deux cents fois plus que la moyenne de la population.
Nous voulons agir sur tous les fronts : la prévention, la réduction des risques, le dépistage, la prise en compte du soin, la prise en charge médicosociale et, bien entendu, la recherche.
Vous avez évoqué le rapport du Conseil national du sida. Je citerai pour ma part les conclusions du groupe d’experts dirigé par le professeur Yeni et, tout récemment, les conclusions de la Haute Autorité de santé ainsi que l’excellent rapport de Mme Lert et de M. Pialoux. Je tiendrai bien entendu le plus grand compte des conclusions de ces rapports. Je présenterai, au mois de janvier, un cinquième plan qui réservera une place toute particulière au dépistage, comme vous le souhaitez, monsieur Gilbert Barbier.
Monsieur Autain, comme vous l’avez souligné, insalubrité et saturnisme sont étroitement liés. Nous consacrerons 0, 5 million d’euros à la lutte contre l’insalubrité et 0, 65 million d’euros à la lutte contre le saturnisme. Il s’agit de normaliser les protocoles et mettre en œuvre les recommandations de l’INSERM en matière de dépistage, de financer une enquête sur les sources d’exposition au plomb à domicile.
Une proposition de loi, présentée par M. Jean-Luc Warsmann, a été déposée à l’Assemblée nationale. J’ai proposé un durcissement des dispositions prévues à l’article 19 en matière de réglementation et de procédures d’accréditation. J’ai également souhaité permettre aux préfets, en cas d’urgence, d’accélérer les procédures de mise en conformité. Le Gouvernement est donc mobilisé sur ce sujet.
Je remercie Mme Catherine Procaccia, militante convaincue de la prévention dans la lutte des comportements à risques, de son soutien dans les campagnes que nous menons contre l’alcool et le tabac. Soyez assurée, madame, de notre détermination à lutter de manière résolue, comme vous le souhaitez, contre toutes les conduites addictives.
Je n’insisterai pas sur les ARS afin de ne pas allonger encore un propos déjà bien long, mais je reviendrai sur ce sujet si vous le souhaitez.
MM. Autain, Teulade et Cazeau sont de trop fins observateurs des projets de loi de finances pour me reprocher d’avoir laissé fondre les crédits de l’action n° 14 de 1, 9 %. Je suis persuadée qu’ils auront parfaitement entendu, de leur oreille acérée, que cette baisse était due à un rebasage et au transfert de 3, 5 millions d’euros des crédits du GIP Datis, drogues, alcool, tabac info-service vers l’INPES dans le cadre de la reconfiguration de la téléphonie sociale. Je considère qu’il ne pouvait donc s’agir que d’une argumentation purement polémique de la part d’observateurs et de connaisseurs aussi fins des programmes dédiés à la santé.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Nous allons procéder à l’examen des crédits de la mission « Santé », figurant à l’état B.
en euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Santé
Prévention et sécurité sanitaire
Offre de soins et qualité du système de soins
Protection maladie

L'amendement n° II-46, présenté par MM. P. Dominati et Milon, est ainsi libellé :
Modifier comme suit les crédits des programmes :
en euros

Programmes
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Prévention et sécurité sanitaire
Offre de soins et qualité du système de soins
Protection maladie
TOTAL
SOLDE
Cet amendement a été retiré par son auteur.
Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits de la mission « Santé ».
J’appelle en discussion les articles 59, 59 bis et 59 ter, qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Santé », ainsi que l’amendement portant article additionnel également rattaché.
Au dernier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 ».

Le présent article prévoit en effet de proroger d’un an la taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché destinée à financer le centre national de gestion des essais de produits de santé, le CeNGEPS.
Ce centre est un groupement d’intérêt public, un GIP, qui a été institué au mois de mars 2007 pour quatre ans. Or, la période du recouvrement de la taxe additionnelle qui lui est affectée est fixée sur les ventes réalisées au titre des exercices 2005 à 2008.
Le présent article institue la prorogation d’un an de la perception de la taxe additionnelle afin de mettre en concordance la durée de financement du CeNGEPS avec celle de sa durée d’existence, et ainsi assurer le maintien du financement du GIP pour sa dernière année d’activité.
J’avoue m’interroger sur la création initiale de cette taxe additionnelle provisoire destinée à financer une structure qui n’existait pas encore à l’époque.
Je m’interroge également sur l’utilité même de ce centre. Peut-être pouvez-vous, madame la ministre, nous apporter quelques éléments d’information sur ce sujet. S’il paraît difficile de ne pas assurer le financement du CeNGEPS jusqu’à la fin de son mandat, je souhaite néanmoins qu’un bilan du soutien effectif apporté par le groupement à l’organisation des essais cliniques industriels en France soit réalisé. Il doit en tout cas être un préalable à une éventuelle décision quant au renouvellement du mandat du GIP en 2011.
Le centre national de gestion des essais de produits de santé est un GIP destiné à faciliter la coordination et la gestion des essais clinique à promotion industrielle qui sont réalisés dans les établissements de santé ou dans le cadre de réseaux de soins.
Son extinction est prévue pour mars 2011. En application de la loi de finances rectificative pour 2005, le financement du CeNGEPS est assuré par une taxe additionnelle à la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques qui est perçue par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS. La dernière perception de cette taxe est prévue en 2009 au titre des ventes de 2008. Le financement de la dernière année d’exercice du CeNGEPS n’est donc pas assuré puisque le financement du centre s’éteint un an avant l’arrêt de son activité.
L’article 59 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit de modifier l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2005 afin de proroger d’une année la perception de la taxe additionnelle sur les spécialités pharmaceutiques.
Outre l’article 59 du projet de loi de finances pour 2010, d’autres mesures ont des conséquences sur les taxes affectées à l’AFSSAPS. M. Alain Milon a déposé un amendement, n° II-75, visant à insérer, après l’article 59 bis, un article additionnel qui prévoit la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises responsables de la mise sur le marché de produits cosmétiques.
La proposition de loi de simplification du droit du député Jean-Luc Warsmann, contient également plusieurs dispositions relatives à la clarification des taxes liées à l’autorisation de mise sur le marché et prévoit un nouveau calendrier de paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques.
Ces taxes sont finalement assez complexes, mais il existe en tout cas une sorte de parallélisme des formes entre l’extinction de la structure et la collecte de la taxe nécessaire à son fonctionnement.
L'article 59 est adopté.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « vingt-cinq ans, à 200 € par personne âgée de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « seize ans, à 200 € par personne âgée de seize ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s’applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date.

Les membres du groupe CRC-SPG ont accueilli favorablement cet article 59 bis, qui a été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale.
En effet, comment s’opposer à une mesure qui permet aux jeunes de disposer d’une aide à l’acquisition d’une mutuelle complémentaire ?
Cette mesure était attendue, tant le nombre de jeunes et d’étudiants qui renonçaient aux soins pour des raisons financières était important. Ce renoncement se focalise principalement sur les soins qui sont dispensés par les spécialistes, plus particulièrement les psychologues et les gynécologues.
Si cette mesure constitue une avancée, nous craignons qu’elle ne suffise pas. Nous voterons donc en faveur de cet article 59 bis, tout en exhortant le Gouvernement à prendre prochainement les mesures nécessaires pour soutenir la médecine scolaire et universitaire, qui connaît d’importantes difficultés.
Nous ne devons pas perdre de vue que la deuxième cause de décès des jeunes, après les accidents de la route, est le suicide. Il est donc nécessaire de renforcer l’accès aux psychologues et aux psychiatres.
Enfin, nous ne voudrions pas que cet article soit un argument pour permettre au Gouvernement d’éluder la question de l’origine de ces difficultés d’accès aux soins, qui résulte d’un mouvement de paupérisation de la jeunesse.
L'article 59 bis est adopté à l'unanimité.

L'amendement n° II-75, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 59 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5131-7-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-7-4. - Les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1, mis sur le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0, 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.
« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
« À défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Depuis 2007 et en application des directives communautaires, l’AFSSAPS encadre l’évaluation de la qualité et de la sécurité d’emploi des produits cosmétiques. Pour ces missions, elle dispose d’experts internes et externes, d’équipes d’inspecteurs, de laboratoires d’analyse, et peut prendre des mesures de police sanitaire en cas de risque pour la santé publique.
Par ailleurs, l’Agence organise un système de vigilance afin de surveiller les effets indésirables résultant de l’utilisation de produits cosmétiques. Elle offre donc un service qui garantit la sécurité de ces produits.
Or elle ne reçoit à ce titre aucun revenu, alors que les médicaments et dispositifs médicaux sur lesquels elle exerce le même contrôle sont imposés à son profit.
Cet amendement vise donc à remédier à ce qui paraît comme une iniquité, tout en exonérant les plus petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 763 000 euros. Il n’y a aucune raison que les médicaments et les dispositifs médicaux paient pour la cosmétovigilance.
Le dispositif que vous propose la commission des affaires sociales est calqué sur celui qui existe déjà pour les dispositifs médicaux et ne devrait poser aucune difficulté de mise en œuvre.
J’estime enfin important que le produit de la taxe puisse servir à augmenter le plafond des emplois de l’AFSSAPS, qui a atteint les limites en termes de gains d’efficacité et qui risque de se trouver empêchée de mener à bien les missions qui lui sont confiées.

Cet amendement a pour objet de créer une taxe sur les produits cosmétiques, qui serait affectée à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009, un régime de simplification des taxes affectées à l’AFSSAPS a été adopté. Trois des treize taxes affectées à cette agence ont été supprimées, et d’autres ont vu leur assiette simplifiée. Il semblerait a priori peu opportun, un an seulement après cette réforme, de recréer une nouvelle taxe.
Par ailleurs, comme j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de ma mission de contrôle sur la taxation de l’industrie du médicament, la complexité et l’instabilité de la fiscalité nuit à la compétitivité de notre pays.
Enfin, l’affectation de taxes à un établissement public pose la question de l’indépendance de l’AFSSAPS, eu égard au poids déjà important des ressources fiscales dans ses recettes globales.
La commission des finances s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
La sagesse du Gouvernement l’incite à demander à M. le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le rapporteur spécial ayant déjà évoqué la question, je rappellerai que le produit des différentes contributions à l’AFSSAPS représente d’ores et déjà 80 % de ses ressources.
En outre, la subvention pour charges de service public du ministère de la santé à cette agence a augmenté de 4 millions d’euros entre 2007 et 2010.
Ce niveau de ressources est tout à fait suffisant pour que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure ces missions de pharmacovigilance dans de bonnes conditions, sans qu’il soit nécessaire d’augmenter ses ressources propres.
Il n’est sans doute pas opportun de créer une taxe nouvelle sans avoir établi au préalable, et précisément, les conséquences de cette mesure sur une partie de l’industrie. Sans porter de jugement de fond sur les arguments de M. Milon, j’estime que cette question mériterait au moins une concertation préalable avec les industriels concernés.
C’est la raison pour laquelle, à la suite de l’excellente argumentation de Jean-Jacques Jégou, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

L’indépendance de l’AFSSAPS à l’égard de l’industrie pharmaceutique et cosmétologique est fondamentale, car les décisions qu’elle prend ne doivent pas pouvoir être suspectées de complaisance ou de connivence à l’égard de ses financeurs. La suppression de tout lien financier entre l’Agence et l’industrie est, à notre sens, la condition de cette indépendance.
Or, actuellement, comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, 80 % des sources de financement de l’AFSSAPS proviennent de l’industrie des produits de santé, et la subvention du Gouvernement est si faible qu’elle ne parvient même pas à financer les missions régaliennes que l’Agence exerce pour le compte de l’État, notamment en matière de police sanitaire.
C’est pourquoi nous ne pouvons être favorables à un amendement qui procède de cette politique. L’AFSSAPS doit être à l’abri de tout soupçon et financièrement indépendante de l’industrie pharmaceutique et cosmétologique.

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° II-75 est-il maintenu ?

Dans la mesure où j’ai présenté cet amendement au nom de la commission des affaires sociales, je ne le retirerai pas.
Je souhaiterais ajouter quelques observations.
D’abord, actuellement, 80 % des financements de l’AFSSAPS proviennent de l’industrie pharmaceutique, dont les médicaments sont remboursés par la sécurité sociale.
La proposition qui est faite par la commission des affaires sociales consiste à rémunérer l’AFSSAPS pour un service considérable rendu à l’industrie du cosmétique.
Chacun se rend bien compte que les produits que nous consommons ne sont utilisés que si l’AFSSAPS donne son accord. Donc, il est normal que le travail rendu par les différents scientifiques de l’AFSSAPS soit reconnu et rétribué d’une façon ou d’une autre.
Même si la Haute Assemblée adopte notre proposition concernant l’instauration d’une taxe, je sais, pour avoir vécu avec certains de mes collègues l’expérience d’un vote bloqué à l’issue d’une commission mixte paritaire, que tout cela peut disparaître.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59 bis.
Il est institué, au titre de l’année 2010, une contribution exceptionnelle à la charge des organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale.
Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l’année 2010 à la contribution mentionnée au I du même article. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette dernière. Son taux est fixé à 0, 94 %.
Le produit de cette contribution est versé à l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-24 est présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-76 est présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° II-24.

Monsieur le président, avec votre autorisation, je souhaiterais revenir un peu plus longuement sur l’origine du dispositif prévu par l’article 59 ter.
Dans son texte initial, l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoyait également la création d’une contribution exceptionnelle des complémentaires santé aux dépenses liées à la grippe A H1N1.
Cependant, à la différence de l’article 59 ter, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoyait d’affecter le produit de cette nouvelle contribution à l’assurance maladie.
Le Gouvernement, souhaitant par la suite affecter le produit de cette taxe à l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS, qui a été chargé de l’achat des vaccins, a déposé deux amendements miroirs.
Le premier, visant à prévoir l’affectation de cette taxe à l’EPRUS, a été adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 et est devenu le présent article.
Le second, tendant à supprimer la disposition initiale du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui affectait le produit de cette taxe à l’assurance maladie, a été rejeté par le Sénat pour des raisons que je développerai un peu plus loin. Ce vote, mes chers collègues, a ensuite été confirmé en commission mixte paritaire.
Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui vient d’être adopté la semaine dernière prévoit l’affectation de la contribution des complémentaires santé à l’assurance maladie.
Reste donc toujours en discussion cet article 59 ter, dont nous avons à débattre aujourd’hui et qui prévoit, lui, l’affectation de cette taxe à l’EPRUS.
Par coordination avec les dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale voilà à peine une semaine, je vous propose comme notre collègue Alain Milon, qui a déposé un amendement identique, de supprimer cet article.
Le Gouvernement souhaite en revanche, dans le I de son amendement, revenir une nouvelle fois sur le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, alors qu’il n’a pas souhaité intervenir sur ce point, comme il l’a fait malheureusement pour d’autres dispositions, lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.
Sur le fond, je souhaiterais évoquer de nouveau les arguments que la commission des finances et la commission des affaires sociales ont développés, pour justifier l’affectation à l’assurance maladie de la contribution des complémentaires santé.
Affecter cette contribution à l’EPRUS aurait tout d’abord pour conséquence de réduire mécaniquement la dotation de l’État à cet établissement, qui, je le rappelle, est financé à parité par l’État et par l’assurance maladie, s’agissant de l’achat de produits de santé.
Or ces dépenses supportées par l’EPRUS relèvent du domaine régalien de l’État. Il n’y a pas de raison de diminuer la participation de l’État.
Ensuite, l’assurance maladie constitue un tout. Elle se compose de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire.
S’il est décidé de faire contribuer les organismes d’assurance maladie complémentaire à la vaccination contre la grippe A H1N1, ce doit être au titre de la participation de l’assurance maladie dans son ensemble. En effet, la part des organismes d’assurance maladie complémentaire est l’équivalent du ticket modérateur pratiqué dans le cas d’une vaccination ordinaire.
Vous allez très certainement nous dire, madame la ministre, comme vous l’aviez déjà indiqué lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, que nombre de dépenses, notamment la logistique, sont déjà supportées par l’État.
Or, comme l’avait signalé notre collègue Alain Vasselle, il est logique que l’État assure le financement de ces dépenses, qui relèvent, je le répète, de ses missions régaliennes. La participation de l’assurance maladie n’est justifiée que pour l’achat des produits de santé.
Je précise par ailleurs que certaines dépenses seront également prises en charge par l’assurance maladie sans que cela soit pleinement justifié. Ainsi, les frais d’information et de convocation des vaccinés sont financés par l’assurance maladie par le biais du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information pour la santé, le FNPEIS.
De même la campagne de communication – ces messages que l’on voit quotidiennement à la télévision – est financée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES, qui reçoit une dotation de l’État, mais aussi de l’assurance maladie.
Quant à l’argument selon lequel le Gouvernement s’est engagé auprès des assurances complémentaires de santé à ce que leur contribution soit utilisée au financement des vaccins, et donc affectée à l’EPRUS, je rappellerai simplement que, lorsque le PLFSS pour 2010 a été soumis pour avis au Conseil d’État, le Gouvernement n’a pas éprouvé le besoin d’y apporter de rectification. Ainsi, la disposition qui prévoyait que la part de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’UNOCAM, serait versée directement à la CNAM et non à l’EPRUS a été maintenue.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article 59 ter, et je me permets d’indiquer à la Haute Assemblée qu’il s’agit de la seule initiative prise par le Sénat dans le PLFSS qui, pour l’instant, a pu être maintenue.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° II-76.

Mon collègue Jean-Jacques Jégou ayant tout dit, je me contenterai d’ajouter que la commission des affaires sociales craint un problème de constitutionnalité si est supprimée, dans le cadre du projet de loi de finances, une dotation à l’assurance maladie votée définitivement dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Monsieur le président, si vous le permettez, et parce que je crains qu’il ne tombe, je présenterai mon amendement n° II-177, dans une dernière tentative pour convaincre la Haute Assemblée, en même temps que je donnerai l’avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques n° II-24 et II-76.

Pour la clarté des débats, je donne lecture des trois amendements portant également sur l’article 59 ter, qui devaient faire l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La contribution exceptionnelle instituée au titre de l'année 2010 à la charge des organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale versée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est supprimée.
II. - Alinéa 2, dernière phrase
À la fin de cette phrase, remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
L'amendement n° II-97 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Bout et Rozier, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer le taux :
par le taux :
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du taux de l'alinéa 2 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° II-96 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Rozier et Bout, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les sommes prélevées au-delà d'un montant de 231, 756 millions d'euros, ainsi que les sommes correspondant au coût des produits vaccinaux non utilisés dans le cadre de la campagne ou cédés à titre onéreux, sont déduites du montant du premier appel de la contribution visée au I de l'article L. 862-4 précité de l'année 2011. Le fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale informe les organismes concernés des modalités de cette déduction. L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires au calcul de ladite déduction au fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 décembre 2010.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Les deux amendements identiques n° II-24 et II-76 visent donc à supprimer l’article 59 ter, par coordination avec les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Je ne peux évidemment pas donner d’avis favorable, pour des raisons que M. Jégou m’a fait la grâce d’indiquer à ma place.
Il me paraît important de rappeler que les membres de l’UNOCAM ont souhaité apporter leur concours sous cette forme, aux côtés de l’assurance maladie obligatoire et de l’État, à l’effort de solidarité nationale. Ainsi, le versement de la contribution volontaire de ces organismes à l’EPRUS respecte la volonté des parties versantes et leur souhait d’inscrire leur action à la fois dans la droite ligne de leur mission de prévention à l’égard de leurs affiliés, mais aussi dans un souci de solidarité nationale. Cette affectation à l’EPRUS permettra en outre de garantir la bonne traçabilité du produit de cette contribution.
De plus, l’affectation du produit de la contribution des organismes d’assurance complémentaire à l’EPRUS ouvre la possibilité de préserver le principe de la parité entre l’État et l’assurance maladie pour le financement des dépenses de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Je n’y reviendrai pas puisque je vous ai présenté des tableaux très complets permettant de constater cette parité.
Le vote dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 d’une dotation rectificative de l’assurance maladie à l’EPRUS pour l’année 2009, d’un montant de 338 millions d’euros, ne conduira pas à une surdotation de 123 millions d’euros de l’établissement, car, comme vous avez pu le noter dans votre rapport spécial de juillet dernier, monsieur Jégou, une convention signée par l’EPRUS, la CNAMTS et l’ACOSS permet d’ajuster les versements aux besoins réellement constatés de l’établissement.
J’ajoute que l’adoption de ces amendements identiques entraînerait une aggravation des charges publiques. Ils doivent donc être considérés comme non recevables au sens de l’article 40 de la Constitution.
Pour toutes ces raisons, il est légitime de maintenir la contribution en question en l’affectant à l’EPRUS dans le cadre de ce projet de loi de finances. C’est pourquoi je vous saurais gré, messieurs les rapporteurs, de retirer vos amendements. Cependant, n’espérant guère que vous le ferez, j’indique qu’à défaut j’y serai défavorable.
J’ai donc déposé à l’article 59 ter un amendement ayant pour objet de supprimer la disposition, prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui affecte le produit de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires à l’assurance maladie. Cette disposition miroir est importante, je viens de le rappeler, car elle permettra d’éviter que les organismes d’assurance complémentaire n’aient à s’acquitter deux fois du montant de la taxe au titre de l’exercice 2010.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la diminution du coût des vaccins en raison de l’application d’un taux de TVA réduit à 5, 5 %, au lieu du taux de 19, 6 % initialement envisagé. L’économie de 96 millions d’euros ainsi réalisée doit être prise en compte dans le calcul du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des organismes d’assurance complémentaire.
L’attribution du produit de cette contribution à l’EPRUS entrera en compte dans le calcul de la parité du financement de cet établissement entre l’État et l’assurance maladie. Les dotations rectificatives pour assurer le bouclage de financement de l’EPRUS se répartiront selon des critères détaillés dans un tableau un peu complexe que je tiens évidemment à votre disposition, mais dont je vais peut-être vous épargner la lecture dans l’immédiat. Il montre que cette situation aboutirait à une surdotation de l’assurance maladie de 123 millions d’euros. Toutefois, le mécanisme de la convention passée entre l’EPRUS, la CNAMTS et l’ACOSS, fondée sur le besoin réel de l’établissement, permettrait de ne pas verser cette somme à l’établissement. En outre, une mesure modificative interviendra dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de ne pas voter les amendements identiques de suppression de l’article et d’adopter mon amendement. Cela vous permettrait de préserver au mieux la justice du traitement des organismes d’assurance complémentaire et de tenir compte du fait que cette demande avait été établie sur la base d’un taux de TVA à 19, 6 % alors que celui-ci, après l’obtention de l’AMM, est en réalité de 5, 5 %.

Madame la ministre, je suis très embarrassé et au regret de vous contredire, mais l’article 40 de la Constitution ne peut s’appliquer à des amendements de suppression !

Comme vous le savez, madame la ministre, mes chers collègues, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG sont opposés à la contribution exceptionnelle des complémentaires santé au titre de ce que le Gouvernement présente comme une participation des organismes d’assurance complémentaire à la pandémie de grippe A et que nous considérons quant à nous comme la continuation cette année de la contribution exceptionnelle imposée l’année dernière à l’occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Cela nous donne une nouvelle fois l’occasion de souligner à quel point il est tout de même étonnant – à moins que ce ne soit simplement révélateur – que la première mesure contenue dans la partie recettes du PLFSS pour 2010 soit précisément une mesure prétendument temporaire et correspondant à une dépense ciblée : la politique vaccinale contre la grippe A.
Autre curiosité : bien qu’il s’agisse d’une contribution théoriquement très ciblée, les financements qui en résultent sont orientés vers l’assurance maladie, alors que, on y a insisté, c’est l’EPRUS qui a acheté les doses de vaccins. Le faisceau d’indices tend à conforter notre conviction : la contribution vise à financer moins l’EPRUS que l’assurance maladie elle-même ! C’est ce qui lui donne un tout autre sens.
Madame la ministre, les membres de l’UNOCAM, en particulier les assurances complémentaires privées – je le tiens du président de la Fédération française des sociétés d'assurances –, indiquent avoir été, pour cette contribution, « mis au pied du mur ». Contrairement à ce que vous affirmez, elle n’est pas le résultat de la volonté des organismes d’assurance complémentaire, elle leur a bien été imposée !
Enfin, je ne voudrais pas embarrasser le Gouvernement, mais il me semble que la rédaction de cet article 59 ter témoigne d’un léger flottement, à moins que ce ne soit un manque de concertation entre les différents ministres. Car, au moment où M. Woerth, ministre chargé du budget, demandait à l’Assemblée nationale d’adopter le principe de cette contribution en précisant qu’elle serait destinée à l’EPRUS, Mme Bachelot-Narquin, ministre chargée de la santé, faisait voter de son côté contre les amendements qui allaient dans ce sens. Tout cela nous semble être le signe d’une mauvaise coordination, peut-être même d’une mauvaise gestion. C’est à l’image de la politique du Gouvernement en matière de financement de la protection sociale.
On comprendra, compte tenu de cette situation, que nous préférions laisser le Gouvernement et la majorité régler entre eux leur désaccord quant à l’affectation d’une taxe que nous dénonçons par ailleurs, notamment au regard du risque de répercussions sur les mutualistes. Nous ne participerons donc pas au vote de ces amendements identiques et, le cas échéant, nous nous abstiendrons sur l’article 59 ter.

Madame la ministre, je continue, comme lors de l’examen du PLFSS, à soutenir votre proposition de verser la contribution en question à l’EPRUS.
La logique de la situation m’échappe : pourquoi avoir voté la création de l’EPRUS si c’est pour ne pas donner à celui-ci les moyens dont il a besoin ? Sa vocation est pourtant, me semble-t-il, de faire face au risque de pandémie par l’achat de vaccins ! Malgré toutes les explications du rapporteur spécial, je ne comprends toujours pas. En revanche, j’ai bien compris que le rapporteur général de la commission des affaires sociales voulait essayer de combler le trou de la Sécu ! C’est la seule explication que je vois au fait que l’on nie l’existence de l’EPRUS. Mais alors, pourquoi l’avoir instauré ?
Par ailleurs, si nous adoptons les amendements de suppression de l’article, l’amendement de la ministre ne sera pas soumis au vote, non plus que le mien, qui va dans le même sens bien qu’étant légèrement différent. L’UNOCAM, c’est-à-dire les assurances complémentaires, devra alors verser 280 millions d’euros alors que sa contribution aurait dû s’établir, selon ses calculs, entre 231 millions et, aux termes de l’amendement de Mme la ministre, 240 millions d’euros. M. Autain s’est à juste titre interrogé : qui paiera ces 40 millions d’euros supplémentaires ? Croyez-vous vraiment que ce seront les assureurs ? Vous allez voir vos cotisations d’assurance maladie !
De plus, le procédé est malhonnête puisqu’un engagement avait été pris. Moi aussi j’ai consulté les représentants de l’UNOCAM et d’un certain nombre d’assurances complémentaires. Ils sont d’accord pour payer, mais sur les bases qui ont été fixées. Or, supprimer l’article 59 ter, ce serait revenir sur cet engagement. Je le répète : si nous votons ces amendements de suppression, comme d’habitude, ce sont les assurés qui paieront. Je ne vois pas comment on peut vouloir mener de grands combats contre les pandémies et faire payer toujours les mêmes, c’est-à-dire les assurés.
Enfin, M. Jégou a mentionné le ticket modérateur. Certes, mais il porte sur 35 % des frais, quand 93 % de la population a une complémentaire maladie : d’habitude, ce n’est pas 93 % de la population qui se fait vacciner ! Or, dans le cas qui nous occupe, ce sont 94 millions de doses de vaccin qui doivent être financées. Cela représente donc beaucoup plus de 40 millions d’euros, et c’est nous, les assurés, qui allons les payer à travers la contribution de l’UNOCAM.

Je commencerai par un petit point d’histoire à l’intention de notre collègue Catherine Procaccia.
La demande qu’elle formule en ce qui concerne la juste contribution des complémentaires est légitime. Sur cette question, j’adhère tout à fait à son argumentation, qui, à mon avis, mérite d’être prise en considération.
Pour ce qui est du transfert de la dépense à l’EPRUS, en revanche, je ne la suivrai pas. Mme Procaccia ne siégeait pas encore parmi nous à l’époque où le Gouvernement a mis en place le plan Biotox. Le Sénat avait alors dénoncé cette initiative, parce qu’elle tendait en réalité à faire supporter en totalité à la CNAM le financement de ce plan, qui relevait de la compétence régalienne de l’État. Le Gouvernement avait passé outre, nous donnant à comprendre qu’il n’avait pas d’autre solution dans le moment où nous en débattions.
Lorsque nous avons eu, par la suite, à débattre de la création de l’EPRUS, le Sénat a obtenu qu’il y ait au minimum une parité de financement entre la CNAM et l’État, et ce exclusivement pour les produits de santé. Mais la réquisition des personnels et toute la logistique relative aux menaces sanitaires devaient relever du budget de l’État et non pas de l’assurance maladie.
Nous sommes toujours sur cette ligne et nous demandons ni plus ni moins que le respect d’une décision du Parlement confirmée par l’Assemblée nationale et par le Sénat lors de l’examen des différents PLFSS. Nous ne demandons rien d’autre.
Aujourd’hui, nous constatons que le Gouvernement, qui au moment de la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le PLFSS pour 2010 en séance publique, a admis l’argumentation puisqu’il n’a pas déposé d’amendement, a changé d’avis. La dotation de la CNAM à l’EPRUS n’a été modifiée que pour tenir compte du changement de taux de TVA sur l’achat des vaccins et du don à l’OMS d’une partie de ces vaccins.
Autre élément : lors de l’examen du PLFSS, le Gouvernement avait également justifié le dépôt de son amendement en prétendant vouloir donner une meilleure traçabilité à la contribution des complémentaires en transférant celle-ci à l’EPRUS plutôt qu’à la CNAM. C’est effectivement une demande exprimée par les complémentaires – elle est tout à fait justifiée – mais ce n’est pas en transférant cette somme à l’EPRUS que l’on obtiendra une meilleure traçabilité. C’est une question de clairvoyance et de suivi de la part de la Haute Assemblée, de l’Assemblée nationale et du Gouvernement sur la part exceptionnelle des complémentaires au financement de la pandémie.
En fait, cette opération est un tour de passe-passe qui consiste à permettre à l’État de faire l’économie d’une partie de sa contribution en la faisant financer par les complémentaires, alors que la contribution de celles-ci doit s’imputer sur la part de la CNAM. Ce n’est rien d’autre que cela.
Il me paraissait donc utile de faire ce point d’histoire à l’intention de notre collègue Catherine Procaccia, dont je partage les préoccupations, mais il ne faut pas mélanger, d’une part, la juste contribution des complémentaires et, d’autre part, les modalités de financement du dispositif entre la CNAM et l’EPRUS.
Le Gouvernement avait proposé de créer une contribution exceptionnelle. Je rappelle qu’aucun amendement n’a été déposé à l’Assemblée nationale et au Sénat, et le Parlement dans son ensemble a approuvé l’affectation à la CNAM de la contribution des complémentaires. Pour nous, ce débat était clos.
Mais, alors que l’encre du PLFSS est encore à peine sèche et que le texte est soumis au Conseil constitutionnel, le Gouvernement veut revenir dessus une semaine après son adoption pour prévoir l’affectation de la contribution à l’EPRUS.
Après avoir fait voter à l’Assemblée nationale un amendement en ce sens, alors même que le Sénat adoptait sans modification l’article du PLFSS qui affectait la taxe à la CNAM, le Gouvernement se rend compte maintenant que le résultat de ses manœuvres risque d’aboutir à la création de deux taxes, l’une dans le PLFSS et l’autre dans le projet de loi de finances. Il vient donc nous demander de nous déjuger en effaçant nos décisions de la semaine dernière.

Ces méthodes ne sont pas acceptables. Le Parlement s’est prononcé sur ce sujet de manière particulièrement claire et nous ne pouvons pas y revenir sous le simple prétexte que notre vote ne convient pas au Gouvernement. Je rappelle que le Gouvernement a fait adopter quatre amendements lors de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le PLFSS, amendements qui remettaient en cause les équilibres de la CMP.

Monsieur Vasselle, je vous demande de respecter la règle : il faut conclure !

Monsieur le président, je suis désolé, mais ce sujet est suffisamment important pour que vous me permettiez de terminer. J’ai dépassé mon temps de vingt-neuf secondes, j’en ai encore pour trente secondes.
Le Gouvernement veut parachever son œuvre en revenant aujourd’hui sur l’une des rares modifications que le Parlement a apportées à son texte. Accepter cela, c’est admettre que nous ne servons à rien et que les budgets de l’État et de la sécurité sociale pourraient aussi bien être adoptés par ordonnances.
Je soutiens donc sans réserve les amendements de suppression de l’article 59 ter présentés par nos collègues Jean-Jacques Jégou et Alain Milon.
J’ajoute qu’une modification de l’affectation de la taxe en loi de finances risquerait de se révéler inconstitutionnelle, comme l’a rappelé notre collègue Alain Milon.
En effet, l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale donne un monopole aux lois de financement pour l’affectation des recettes de la sécurité sociale. Il n’est pas possible de revenir en loi de finances sur une telle affectation.
J’ajoute que le PLFSS est en cours d’examen par le Conseil constitutionnel et que si nous supprimons aujourd’hui une recette très importante à la CNAM, nous porterons atteinte à l’équilibre du PLFSS, ce qui pourrait entraîner sa non-conformité à la Constitution.
Je vous prie de m’excuser d’avoir été un peu long, monsieur le président, mais ne nous ridiculisons pas en ne suivant pas la position de nos collègues.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à ce stade du débat, il doit être possible de concilier toutes les préoccupations.
Madame la ministre, chronologiquement, nos collègues députés ont d’abord voté l’article 59 ter. La commission mixte paritaire s’est ensuite réunie et elle a confirmé le vote du Sénat visant à affecter cette contribution exceptionnelle à la CNAM.
Cette contribution est remise en cause ce soir, parce que nous devons nous prononcer sur l’article 59 ter.
S’agissant de la dévolution du produit de cette contribution exceptionnelle à la CNAM ou à l’EPRUS, je pense franchement, madame la ministre, que la cause est entendue, en tout cas ici au Sénat. D’ailleurs, lorsque vous avez donné l’avis du Gouvernement, vous avez semblé exprimer un doute sur la possibilité de défendre votre amendement n° II-177, parce que vous aviez sans doute l’intuition que les amendements de suppression de nos collègues Jean-Jacques Jégou et Alain Milon seraient votés par notre assemblée.
Donc, si tel est le cas et pour ce qui est du solde des finances publiques – je parle sous le contrôle d’Alain Vasselle –que l’argent aille à l’EPRUS ou à la CNAM, c’est parfaitement équivalent : il n’y a en aucune façon une aggravation du déficit public.

On peut toujours discuter sur le point de savoir s’il faut améliorer la situation de la protection sociale…

… en aggravant celle de l’État, mais c’est toujours le contribuable qui paie, d’une manière ou d’une autre.
Reste le niveau de la cotisation. Mme Catherine Procaccia nous dit qu’il n’est pas question de payer plus parce que c’est un prélèvement excessif. La commission des finances est, bien sûr, solidaire de cette préoccupation.
Par conséquent, sur le plan constitutionnel, rien ne s’oppose, me semble-t-il, à ce que nous puissions dans une loi de finances – fût-ce une loi de finances rectificative – modifier un taux qui a été fixé en projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Donc, je propose que, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative les 17 et 18 décembre, nous déposions un amendement visant à porter le taux que vous aviez fixé de 0, 94 % à 0, 77 %. Il me semble alors que nous aurons satisfait aux préoccupations des uns et des autres.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.
Cela ne règle pas le problème de la répartition !
Les amendements sont adoptés.

En conséquence, l'article 59 ter est supprimé et les amendements n° II-177, II-97 rectifié et II-96 rectifié n’ont plus d’objet.
Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Santé ».

Monsieur le président, mes chers collègues, l’ordre du jour prévoyait que nous examinions, ce soir, les crédits de la mission « Plan de relance de l’économie ».
Malheureusement, nous avons terminé nos travaux cette nuit à une heure trente, et ce matin nous avons dû décaler la reprise de la séance à dix heures trente. Or, nous ne pourrons manifestement pas commencer l’examen des crédits de la mission « Plan de relance de l’économie » avant minuit.
Dans ces conditions, l’examen des crédits de cette mission sera reporté soit demain soit vendredi. J’étudie les différentes possibilités avec M. le ministre chargé du plan de relance.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Travail et emploi » (et articles 61, 62 et 63).
La parole est à M. le rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la mission « Travail et emploi » présente des crédits de 11, 4 milliards d’euros destinés en principe à réduire le chômage en créant des emplois.
En réalité, le montant total des crédits affectés par le Gouvernement à la réduction du chômage s’élève à 55 milliards d’euros, ce qui est considérable. Ils sont répartis dans différents budgets.
Premièrement, 25 milliards d’euros sont destinés à payer les allègements de charges des entreprises jusqu’à 1, 6 SMIC. Il est à noter qu’ils sont récurrents, sans limite de durée, et que personne apparemment ne veut commencer à les réduire. Ces crédits sont plutôt destinés à des maintiens qu’à des créations d’emploi, ils ne créent aucun emploi nouveau. Ainsi, depuis 2003, l’État aura dépensé pour cette opération 160 milliards d’euros, sans créer un seul emploi, ce qui n’est pas extrêmement efficace, …

… et cela va continuer encore longtemps si on n’arrête pas cette opération.
Deuxièmement, 10, 9 milliards d’euros sont prévus pour des dépenses fiscales, dont 3, 2 milliards d’euros de prime pour l’emploi, que l’on ne veut pas réduire. Ils servent, dit-on, à motiver les chômeurs pour qu’ils veuillent bien travailler. D’ailleurs, on ne sait pas combien de chômeurs ont repris le travail avec cette subvention, mais c’est un chiffre considérable.
Troisièmement, 6, 45 milliards d’euros sont consacrés aux allégements ciblés de charges, en particulier sur les heures supplémentaires des 35 heures dont le coût global avoisine 3 milliards d’euros. Nous ne savons pas non plus combien d’heures supplémentaires ont été engendrées, mais aucun emploi nouveau n’a été créé.
Quatrièmement, 1, 8 milliard d’euros sont prévus au titre du plan de relance pour les contrats aidés et l’apprentissage. J’aimerais bien savoir de quoi il s’agit exactement.
Enfin, à ces crédits, viennent s’ajouter les 11, 4 milliards d’euros de notre mission.
En tout, cela représente donc 55 milliards d’euros. C’est quasiment le montant du budget total de l’éducation nationale, qui s’élève à 60 milliards d’euros, et 1, 5 fois et demi le budget de la défense, qui s’élève à 37 milliards d’euros.
Je regrette de constater que ce budget considérable comporte beaucoup d’allégements de charges sans créer d’emplois.
Le financement de création d’entreprises n’existe pas, ni la modernisation des outils de production, ni la réalisation de produits nouveaux, ni le développement des exportations. Rien de tel n’est prévu dans le budget de l’emploi alors qu’il s’agit de la seule façon de créer réellement de nouveaux emplois et d’aboutir à la croissance tant attendue !
Je constate aussi que ce budget est financé par des emprunts récurrents et sans limite de durée. Combien de temps cela va-t-il durer ? Ils concernent uniquement des dépenses de fonctionnement et pas d’investissement. Ils ne préparent donc pas l’avenir.
Ce budget aggrave ainsi considérablement les déficits budgétaires et la dette sans limite de durée. On ne reviendra jamais à l’équilibre budgétaire tant que l’on ne se résoudra pas à réduire ces allégements et ces aides. Il serait préférable de faciliter les investissements des entreprises plutôt que de les aider à financer leur personnel.
J’en viens à mon budget, qui se décompose en quatre programmes.
Le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » s’élève à 5, 9 milliards d’euros.
Sur cette somme, 1, 36 milliard d’euros sont versés à Pôle emploi au titre d’une subvention pour charge de service public, et 1, 5 milliard d’euros au Fonds de solidarité pour indemniser les demandeurs d’emploi en fin de droit. Nous constatons que ces 2, 8 milliards d’euros n’ont rien à voir avec des créations d’emploi.
Par ailleurs, 1, 7 milliard d’euros sont consacrés aux contrats aidés, seuls créateurs d’emploi, dont 156 millions d’euros seulement iront aux contrats marchands et 1, 4 milliard d’euros aux contrats non marchands. Il serait préférable que les budgets soient un peu mieux répartis vers les contrats marchands, qui créent de véritables emplois, même si les contrats non marchands permettent tout de même aux chômeurs de retrouver un travail.
Notons, également, le financement des missions locales pour 175 millions d’euros et des maisons de l’emploi pour 90 millions d’euros, ce qui est dérisoire par rapport à l’excellent travail qu’elles font à l’égard des jeunes en difficulté.
C'est la raison pour laquelle je souhaite vous proposer une augmentation de crédits de 150 millions d’euros pour les missions locales et peut-être pour les maisons de l’emploi.
Nous pourrions les financer en supprimant les aides pour les repas du personnel des restaurants, qui bénéficient de la baisse de la TVA, soit 2 milliards d’euros, ou par tout autre moyen. Le principal est que nous trouvions 150 millions ou 200 millions d’euros sur 55 milliards d’euros.
Je rappelle que les missions locales ont permis l’accès au CIVIS à 830 000 personnes et à des emplois classiques à 220 000 personnes en cinq ans.
Nous constatons que le plus grand nombre d’emplois a finalement été obtenu en dépensant 175 millions d’euros sur les 55 milliards d’euros affectés à l’emploi. À quoi ont servi tous ces crédits ? N’y a-t-il pas du gâchis ?
Nous ne connaissons pas, en revanche, le rendement de Pôle emploi, qui coûte 5 milliards d’euros, ce qui me paraît très élevé. Ne pourrions-nous réaliser ici des économies ?
Voilà pourquoi je tiens absolument à augmenter les subventions pour les missions locales, quel que soit le financement. Si le financement par la restauration est refusé, le programme 103 pourrait y subvenir.
Le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » absorbera 4, 6 milliards d’euros dont l’utilisation principale sera, une fois de plus, des dispositifs d’exonération de charges, associés aux contrats en alternance pour faciliter l’apprentissage – 1 milliard d’euros – et à la compensation aux régions du coût financier des compétences qui leur ont été transférées en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. En quoi cela concerne la création d’emplois ? Ces allégements de charges sont encore une fois sans emplois à la clef !
Par ailleurs, 900 millions d’euros seront utilisés pour les zones de revitalisation rurale et les services à la personne. Peut-être pourrions-nous prélever un peu d’argent dans les crédits consacrés aux services à la personne pour financer les missions locales et les maisons de l’emploi ?
Le programme 111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » est doté de 80 millions d’euros destinés à l’amélioration des conditions de travail et à l’application du droit du travail par l’administration. Ici aussi, il n’y a aucune création d’emploi en vue !
Le programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail » comprend 810 millions d’euros dévolus à l’ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre par les autres programmes de la mission « Travail et emploi ». Celle-ci emploie 10 680 équivalents temps pleins travaillés au sein de l’administration. Ne pourrait-on pas réaliser dans ce secteur également des économies ?
En outre, près de 60 000 personnes sont employées par les opérateurs chargés de la politique de l’emploi, principalement Pôle emploi, qui regroupe 46 000 personnes. Cette opération de grande ampleur fera l’objet d’un bilan d’étape que je souhaite mener en 2010, un an après la création de cette institution. Il s’agira de savoir quel est le véritable coût de la fusion et quelle est son efficacité dans la lutte contre le chômage.
Ainsi, en baisse de 6 % par rapport à 2009, le périmètre budgétaire de la mission « Travail et emploi » de 11, 4 milliards d’euros ne représente, en réalité, qu’un peu plus d’un cinquième des dépenses globales de l’État au titre de la politique de l’emploi, qui se monte, je le répète, à 55 milliards d’euros, le tout pour ne pas créer d’emplois !
C’est pourquoi l’évaluation de l’efficacité au regard de la lutte contre le chômage de l’ensemble de la politique de l’emploi demeure le vrai problème et nécessite de profondes modifications.
J’ai, dès leur création, considéré que la prime pour l’emploi, qui représente 3, 3 milliards d’euros, et l’exonération d’impôt sur le revenu d’heures supplémentaires, qui représente 1, 2 milliard d’euros, s’apparentaient davantage à des dépenses d’ordre social qu’à une politique de l’emploi.
À cet égard, je suis frappé qu’année après année l’indicateur de performance relatif à la prime pour l’emploi ne soit toujours pas renseigné et que nous ignorons l’effet de cette dépense sur la situation du chômage. Nous continuons quand même à l’appliquer.
Quelle est l’efficacité des allégements de charges sociales ?
J’avais proposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2009 un amendement pour que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité au regard de l’emploi des allégements généraux de charges et des cotisations sociales avant le 15 juin 2009.
Je constate que, malgré mes demandes, ce rapport n’a toujours pas été remis. Or il convient que les parlementaires, qui votent le budget, soient informés de l’emploi des crédits adoptés et de leur efficacité.
Je proposerai dans d’autres débats que le Gouvernement allège les salaires des charges de financement de la sécurité sociale. En les faisant payer autrement par les entreprises, notamment en les asseyant sur le chiffre d’affaires ou sur la TVA, il n’aurait plus à les rembourser et économiserait une dizaine de milliards d’euros.
Par ailleurs, une telle mesure diminuerait les coûts de production et faciliterait les ventes et la croissance.
Les charges sur salaires sont si importantes que le Gouvernement dépense beaucoup d’argent pour les réduire. Pourquoi ne pas les supprimer et les faire porter sur le chiffre d’affaires ou la TVA ? Cela ferait gagner beaucoup d’argent à l’État et limiterait les conséquences des emprunts et de la dette.
Dans l’immédiat, je vous proposerai, comme je l’ai annoncé, un amendement de suppression de l’exonération ciblée de cotisations sociales sur l’avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants, dont le coût est de 150 millions d’euros.
Cet avantage consenti en 1998 ne se justifie plus depuis l’abaissement à 5, 5 % du taux de TVA dans la restauration.
S’agissant de l’évaluation des crédits budgétaires de la mission « Travail et emploi », plusieurs sujets me tiennent à cœur comme la formation et l’accès à l’emploi des jeunes.
Les dispositifs de formation en alternance – contrats d’apprentissage ou de professionnalisation – offrent les meilleurs taux d’insertion dans l’emploi, soit plus de 60 %.
C’est pourquoi la formation professionnelle des jeunes, en particulier l’apprentissage, doit devenir une priorité nationale afin que les jeunes ne sortent pas du système éducatif sans aucune qualification. Il faudrait donc supprimer le collège unique, source principale du chômage des jeunes et de la délinquance.
Au lieu de dépenser des sommes énormes de l’ordre de 20 milliards d’euros pour remettre les jeunes au travail après formation, il serait préférable de bien les former dès le collège à des métiers. Ce débat concerne d’autres budgets.
Je vous proposerai donc que les 150 millions d’euros de crédits de l’exonération de l’aide en nature dans la restauration soient redirigés vers les missions locales pour un montant de 100 millions d’euros et vers le Fonds d’insertion professionnelle des jeunes, qui finance les actions de prise en charges des jeunes – aide au permis de conduire, prospection d’entreprises, prêt de scooter –, pour un montant de 50 millions d’euros. Il s’agit d’une des actions les plus efficaces pour remettre les jeunes au travail. C’est fondamental et très apprécié. J’en sais quelque chose à titre personnel.
Il faut absolument que vous acceptiez, monsieur le ministre, chers collègues, d’augmenter les crédits des missions locales et des maisons de l’emploi pour favoriser l’insertion des jeunes, car le manque d’intégration est source d’insécurité et de délinquance ! Ça ne coûterait que 150 millions d’euros sur un budget de 55 milliards d’euros …

… où il y a tout de même un certain nombre d’économies à réaliser ! Ces sommes seraient beaucoup mieux utilisées si elles étaient investies dans les missions locales et les maisons de l’emploi.
Enfin, au lieu de maintenir le cloisonnement entre l’éducation nationale et le monde de l’entreprise, il conviendrait de renforcer les filières de formation en alternance.
Je vous proposerai donc un amendement tendant à inciter les entreprises à partir de 50 salariés à embaucher 4 % d’apprentis parmi leurs effectifs, à condition, évidemment, qu’elles aient reçu les demandes correspondantes. Il faut absolument que les apprentis trouvent les moyens d’avoir un patron d’apprentissage.

Monsieur Dassault, vous avez largement dépassé votre temps de parole. Veuillez conclure !

M. Serge Dassault, rapporteur spécial. Ainsi, mes chers collègues, après vous avoir exposé mon point de vue de chef d’entreprise sur ce budget et regretté son manque d’efficacité au regard des sommes dépensées pour créer des emplois, je vous invite, pour ne pas retarder sa mise en œuvre et en espérant une profonde modification pour 2011, à voter les crédits de la mission « Travail et emploi », assortis des amendements que j’ai déposés.
Applaudissementssur certaines travées de l’UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je m’exprime en remplacement d’Alain Gournac, rapporteur pour avis de cette mission, qui est en déplacement à l’étranger. Je présenterai donc en son nom la position de la commission des affaires sociales sur les crédits du travail et de l’emploi.
L’année 2009 a été marquée par une augmentation du chômage de 25 % dont nous avons tous pu mesurer les conséquences dans nos départements : de nombreux contrats d’intérim n’ont pas été renouvelés, les plans sociaux se sont succédé, ce qui a plongé des familles dans la peur du lendemain.
Face à cette situation difficile, qui s’explique naturellement par la grave crise que traverse l’économie mondiale, le Gouvernement a su mobiliser tous les outils de la politique de l’emploi pour atténuer la hausse du chômage.
Le recours au chômage partiel a ainsi été facilité, permettant d’éviter de nombreux licenciements. Les contrats aidés ont été multipliés, avec pour effet de maintenir dans l’emploi des personnes qui s’en seraient, autrement, éloignées. Un plan d’urgence pour l’emploi des jeunes a été lancé dès le mois d’avril, dans le but, notamment, de soutenir les formations en alternance. Le recours au contrat de transition professionnelle a été élargi : ce contrat peut désormais être signé dans quarante bassins d’emploi durement touchés par la crise, alors qu’il ne s’appliquait initialement que dans six d’entre eux. Je ne veux pas oublier non plus la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, qui contribuera, dès l’an prochain, à lutter contre le chômage en permettant de former les personnes les plus éloignées de l’emploi.
Toutes ces mesures ont produit des résultats : les comparaisons internationales montrent que la France a été l’un des pays les plus volontaristes et que la hausse du chômage a été moins forte chez nous que dans la plupart des pays voisins.

Nous n’y voyons aucun motif de triomphalisme, mais simplement la confirmation que les pouvoirs publics ont trouvé des réponses appropriées à une crise économique particulièrement violente.

À l’avenir, M. Gournac souhaite que de nouvelles pistes soient explorées, par exemple, dans le domaine du télétravail, …

… des groupements d’employeurs ou du prêt de main-d’œuvre, afin qu’aucun gisement d’emplois ne soit négligé. Pour ma part, j’estime que le droit du travail devra être adapté pour accompagner ces nouveaux dispositifs.
Pour l’année 2010, la commission des affaires sociales a deux convictions.
Tout d’abord, il lui paraît indispensable de maintenir des politiques vigoureuses de soutien à l’emploi : même si l’on observe quelques signes encourageants de reprise, nous savons que le chômage risque d’augmenter encore pendant plusieurs trimestres. Il serait donc imprudent de baisser la garde !
Ensuite, la mise en œuvre de mesures d’urgence contre le chômage ne doit pas nous conduire à négliger la préparation de l’après-crise : les réformes de structure doivent se poursuivre et nous devons éviter d’adopter des mesures qui paraîtraient bénéfiques dans l’immédiat, mais nous pénaliseraient à moyen terme – je pense en particulier aux préretraites, fidèle en cela à la position constante de notre commission.
La commission des affaires sociales estime que le projet de budget pour 2010 répond à ces deux exigences.
Les crédits de la mission « Travail et emploi » se maintiennent en effet à un niveau élevé, surtout si l’on intègre ceux qui figurent dans la mission « Plan de relance de l’économie ». Ils permettront de prolonger plusieurs mesures qui ont porté leurs fruits, par exemple, l’aide à l’embauche dans les très petites entreprises ou le dispositif « zéro charge » pour le recrutement d’un apprenti.
Notre commission s’interroge cependant sur le montant de la dotation prévue pour le chômage partiel, très en retrait par rapport aux dépenses constatées en 2009 : monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous nous indiquer comment cette dotation a été évaluée et ce que fera le Gouvernement si elle devait se révéler insuffisante dans le courant de l’année prochaine ?
Par ailleurs, la volonté de réforme du Gouvernement ne se dément pas. Ainsi, la fusion des anciens services de l’ANPE et des ASSEDIC dans Pôle emploi se poursuit à un rythme soutenu – nous sommes un certain nombre, dans cet hémicycle, à avoir suivi cette réforme. Par ailleurs, les psychologues de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, chargés de l’orientation des demandeurs d’emploi, vont être rattachés à Pôle emploi, conformément aux préconisations de la première mission d’information sénatoriale sur la formation professionnelle – le Conseil constitutionnel a d’ailleurs validé ce transfert récemment. Le nouveau contrat unique d’insertion va également entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Enfin, le régime des aides à la création d’entreprise a été modernisé.
Ce projet de budget répond donc, selon nous, aux deux critères qui permettent de définir un bon budget, à savoir la poursuite du soutien à l’emploi et la préparation de l’avenir.
Pour conclure, j’évoquerai brièvement la baisse de la TVA dans la restauration, en indiquant que notre commission s’inquiète des créations d’emploi effectives qui résulteront de cette mesure.
Au total, la commission des affaires sociales s’est déclarée favorable à l’adoption des crédits de la mission « Travail et emploi », ainsi qu’à celle des articles rattachés, sous réserve de l’adoption d’un amendement qui sera présenté dans la suite des débats.

Je rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.
Je rappelle qu’en application des décisions de la conférence des présidents, aucune intervention des orateurs des groupes ne doit dépasser dix minutes.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Jean-Paul Alduy.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre pays va devoir prendre en compte 600 000 chômeurs supplémentaires cette année.
Ce choc social est la conséquence de la crise économique mondiale et, il faut le rappeler, sans la mobilisation du chef de l’État et du Gouvernement en faveur du soutien à l’économie, exprimée notamment par le plan de relance, l’augmentation du nombre de chômeurs constatée n’aurait pas été de 20 %, mais sans doute du double ou du triple ! Il m’est facile, en tant que sénateur d’un département limitrophe de l’Espagne, de rappeler que notre voisin du sud, hier cité en modèle, fait face à un choc sans commune mesure avec le nôtre : le chômage y a augmenté de 150 % !

L’Espagne approche des 5 millions de chômeurs, pour une population de 46 millions d’habitants ! Nous ne devons donc pas relâcher notre effort, car le pire pourrait être encore devant nous si notre mobilisation faiblissait.
Les crédits qui nous sont présentés s’élèvent à 11, 4 milliards d’euros, auxquels il faudrait sans doute ajouter 1, 4 milliard d’euros inscrits, pour 2010, dans la mission « Plan de relance de l’économie », ce qui porte le total à 12, 8 milliards d’euros, soit deux milliards d’euros de plus que le plafond prévu l’an dernier dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. Voilà une nouvelle illustration de la volonté du Gouvernement de faire face !
Pour ne pas reprendre les interventions très complètes des rapporteurs, je centrerai mon intervention sur les jeunes.
La jeunesse française, c’est-à-dire la tranche d’âge de 16 à 25 ans, connaît un des taux d’activité les plus faibles d’Europe, soit 30 %, alors que la moyenne européenne s’élève à 60 %, et elle est en outre frappée par un chômage massif. Nous devons donc agir sur ces deux plans : relever le taux d’activité et réduire le taux de chômage. En outre, les dispositifs d’aide et d’accompagnement doivent continuer à s’appliquer au-delà de 25 ans, car leur rupture a des effets souvent dramatiques à cet âge.
Le plan d’urgence pour l’emploi des jeunes, présenté par le Président de la République en avril dernier, s’attaque au sujet. J’en rappelle les principales mesures : une prime de 3 000 euros pour l’embauche en contrat à durée indéterminée, le dispositif « zéro charge » pour les embauches d’apprentis dans les entreprises de onze salariés et plus, ou encore les contrats d’autonomie, dont l’objectif est d’insérer 45 000 jeunes dans l’emploi dans les trois prochaines années.
Le développement de l’apprentissage, comme l’a rappelé M. le rapporteur spécial, est assurément une voie à privilégier et je voterai l’amendement qu’il a déposé, tendant à inciter toutes les entreprises de 50 salariés et plus à accueillir au moins 5 % d’apprentis parmi leurs effectifs.
De même, je crois nécessaire de développer les formations en alternance et je souhaite vous poser une question, monsieur le ministre : parmi les nombreuses mesures d’urgence qui seront applicables jusqu’à la mi-2010, le Gouvernement envisage-t-il d’étendre la formation en alternance chez les employeurs publics ? Des mesures d’urgence en faveur des collectivités locales ont déjà été étudiées par votre ministère, me semble-t-il, pour donner suite aux conclusions d’un rapport de l’Assemblée nationale, mais qu’en est-il exactement aujourd’hui ?
J’évoquerai maintenant les missions locales « jeunes » et les maisons de l’emploi.
La « boîte à outils » des aides directes et incitations fiscales est, aujourd’hui, diversifiée et renforcée. Encore faut-il que nous disposions de services publics associant tous les acteurs de terrain pour conférer à ces outils leur pleine efficacité !
Les missions locales « jeunes » constituent un service de proximité associant les collectivités locales pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ces organismes, après quinze années d’existence, ont prouvé leur efficacité et, en 2009, Pôle emploi leur a confié l’accompagnement de 230 000 jeunes. Comme M. le rapporteur spécial, je crois nécessaire d’accroître le soutien financier de l’État à ces missions, car, je le rappelle, les collectivités locales assument aujourd’hui l’essentiel de la charge du développement de leurs activités.

Concernant les maisons de l’emploi, je me permettrai d’être un peu plus long, car je sais que les avis sont partagés. Les premières ont été créées, il y a tout juste quatre ans, par Jean-Louis Borloo, dans le cadre du plan de cohésion sociale. Elles prouvent leur pertinence territoriale dans les actions mobilisant les secteurs professionnels et les entreprises en faveur de l’emploi local ou de la lutte contre les exclusions.
Dans les secteurs émergents, elles ont par exemple contribué à l’organisation, à la professionnalisation et au développement des services à la personne. Plus récemment, elles ont engagé une réflexion avec les secteurs professionnels concernés par les nouvelles lois liées au développement durable, comme par exemple le secteur du bâtiment. Je rappelle que les maisons de l’emploi sont les premières structures locales à s’emparer nationalement de la problématique des emplois liés au « plan climat », en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME. Ce type d’actions illustre l’un des rôles des maisons de l’emploi : innover dans l’action, créer des synergies entre les acteurs locaux pour participer au développement de l’emploi sur nos territoires.
Les maisons de l’emploi ont su aussi répondre à l’une des demandes du plan de cohésion sociale, consistant à permettre à certaines populations en rupture de renouer avec le service public de l’emploi pour favoriser leur insertion, en proposant, notamment dans les quartiers sensibles ou en zone rurale, des services de proximité, sans condition d’accès, adaptés à chacun. Je citerai également la gestion des clauses d’insertion des marchés publics, qui exige un vrai travail de proximité et une vraie capacité à coordonner entreprises et maître d’ouvrage public, pour encourager l’embauche durable des demandeurs d’emploi des quartiers fragile. Permettez-moi de citer l’exemple de Perpignan : 300 jeunes ont pu bénéficier d’une expérience professionnelle significative, grâce aux clauses d’insertion prévues pour les marchés publics. Citons enfin les dispositifs permettant de créer son propre emploi, ou encore les cyber-bases emploi qui, en luttant contre la fracture numérique, travaillent à l’accès de tous à la même information et donc à la lutte contre les exclusions.
Je ne développerai pas davantage l’utilité sociale, que je crois démontrée, des maisons de l’emploi : en effet, elles mettent en mouvement la responsabilité sociale des entreprises sur leur territoire.
Mais si missions locales et maisons de l’emploi ont prouvé leur utilité, je crois devoir insister sur la nécessité d’une meilleure coordination de leurs actions. La qualité de l’action des maisons de l’emploi dépend, pour beaucoup, de la qualité des relations et de la synergie qu’elles ont su – qu’elles ont pu – instaurer, d’une part, avec les services de l’État et Pôle emploi et, d’autre part, avec les différents échelons territoriaux, conseil régional, conseil général, groupements de communes et communes.
Monsieur le ministre, vous avez élaboré un cahier des charges de ces maisons de l’emploi qui permettra de continuer, dans les cinq années à venir, le travail accompli dans les bassins d’emplois concernés. Je crois, pour ma part, que la fusion des outils territoriaux – missions locales pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, maisons de l’emploi mobilisant la responsabilité sociale des entreprises pour l’emploi local et luttant contre l’exclusion, mais aussi permanences d’accueil, d’information et d’orientation et plans locaux d’insertion par l’économie –, déjà réalisée sur certains territoires, doit être aujourd’hui clairement demandée par l’État. Cette fusion se heurte souvent à des particularismes locaux qui n’ont pas lieu d’être, tant le rassemblement de tous les partenaires de la formation, de l’emploi et de la création d’entreprises est une ardente obligation dans nos territoires.
Je souhaite, monsieur le ministre, qu’une action vigoureuse de l’État permette cette fusion, par exemple au sein d’une agence partenariale réunissant l’État, les collectivités locales, Pôle emploi, les partenaires privés, les chambres consulaires et les syndicats professionnels. Après la réforme qui a créé Pôle emploi, le temps est venu de simplifier et de rassembler les différents outils territoriaux créés et additionnés au fil des années. L’efficacité de Pôle emploi et des collectivités locales en serait renforcée, pour le plus grand bénéfice de nos politiques de la ville et de lutte contre les exclusions.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord vous faire part de notre mécontentement face au manque, cette année, d’auditions préparatoires en commission.
Pour ses travaux, M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales – je regrette qu’il ne soit pas présent ce soir – a peut-être entendu à huis clos certains des acteurs concernés, mais nous déplorons l’absence d’auditions en commission, notamment celle des ministres.
Ce n’est pas reconnaître, loin s’en faut, le rôle accru du Parlement, ambition pourtant affichée dans la dernière réforme constitutionnelle ! À ce titre, mes chers collègues de la commission des affaires sociales, je vous rappelle la parodie d’audition à laquelle nous avons assisté pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale…

La campagne de communication sur le renforcement de nos institutions n’est en réalité qu’un leurre qui cache mal le mépris du Gouvernement envers le parlement. Il y a les discours et il y a la réalité ! Cette précipitation est une illustration supplémentaire de la marche forcée dans laquelle ce gouvernement veut nous faire travailler.
J’en viens au budget de la mission « Travail et emploi ».
Nous ne pouvons que constater qu’il n’est vraiment pas à la hauteur des besoins. Alors que notre économie connaît une grave crise et que les destructions d’emplois se chiffrent par milliers chaque jour, sans signe d’amélioration avant le second semestre de 2010, il affiche des crédits en baisse de 6 %. Ce ne sont pas les quelques hausses sur tel ou tel programme, ni le « raccrochage » du plan de relance, ni les exonérations de cotisations sociales, ni certaines dépenses fiscales qui pourront nous tromper !
Je rejoins, une fois n’est pas coutume, M. le rapporteur spécial de la commission des finances : ce budget ne contient aucune mesure forte en faveur de la création ou du maintien d’emplois sur notre territoire. Tout au plus est-il constitué d’un catalogue de mesures « rustines », posées ici et là pour cacher l’ampleur des dégâts.
Ainsi, le travail précaire et le travail à temps partiel subi sont institutionnalisés par l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion. Les destructions d’emplois non seulement ne sont pas combattues, mais ne coûtent pratiquement rien aux employeurs, grâce aux contrats de transition professionnelle, les CTP, et aux conventions de reclassement personnalisé, les CRP, alors que seule une minorité des titulaires d’une CRP parvient à se réinsérer dans l’emploi au terme de la convention – M. le rapporteur pour avis l’écrit lui-même dans son rapport. Enfin, les exonérations de cotisations sociales en tout genre, qui sont offertes aux employeurs, semblent être la seule réponse du Gouvernement aux énormes problèmes à résoudre.
Ce budget permet, au mieux, un simple accompagnement social du chômage et il banalise une triste réalité, celle des travailleurs pauvres. D’après l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, 9, 9 % des travailleurs salariés ont aujourd’hui un revenu mensuel inférieur au seuil de pauvreté, soit 910 euros.
Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, je pourrais résumer en quelques mots votre politique : casse des droits des salariés et cadeaux fiscaux aux patrons !
Un autre fait marquant, non jugulé avec ce budget, est la forte hausse du chômage qui touche les jeunes, en particulier les jeunes peu qualifiés. Entre mai 2008 et mai 2009, le nombre de jeunes de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi a augmenté de 32, 6 %, alors que la hausse générale du chômage était de 18, 4 %.
Par ailleurs, on peut s’alarmer de la situation des 120 000 jeunes sortis en 2009 du système scolaire sans diplôme et sans qualification, lorsque l’on sait que, parmi celles et ceux qui sont sortis de l’école en 2004 dans la même situation, 32 % n’ont toujours pas trouvé d’emploi en 2009, soit cinq ans plus tard ! Il est donc urgent de mettre en place de vraies mesures destinées à leur permettre de trouver un emploi dans des conditions acceptables.
C’est pourquoi nous soutiendrons – de nouveau, c’est inhabituel ! – les amendements proposés par M. le rapporteur spécial Serge Dassault, quant à la suppression de l’exonération dont bénéficient les restaurateurs sur les paniers repas de leurs salariés et, surtout, quant à l’affectation des fonds ainsi économisés.
En effet, cette exonération de charges, justifiée par le taux de TVA appliqué jusqu’ici dans ce secteur – 19, 6 % –, n’a plus lieu d’être après le passage à 5, 5 % de ce taux et son maintien à ce niveau, malgré les nombreux effets d’annonce sur un éventuel retour à 19, 6 %. Je vous rappelle, mes chers collègues, que cette baisse engendre un manque à gagner pour le budget de 2, 8 milliards d’euros.
Cette suppression rapporterait 150 millions d’euros de recettes nouvelles. Toujours dans l’idée de donner un emploi à nos jeunes et pour ne citer qu’un exemple, je pense que les missions locales, qui ont déjà prouvé leur efficacité, seraient ravies – c’est le moins qu’on puisse dire ! – de voir leur budget augmenter d’autant.
S’agissant de l’amendement sur l’apprentissage, nous ne sommes pas convaincus qu’il permettra une amélioration de la situation des jeunes. Dans ce domaine, nous savons que tout dépend du contenu de l’apprentissage et de l’état d’esprit de l’employeur. Nous en reparlerons lors de l’examen de cet amendement.
Dans la même logique, nous souhaitions la reconduction de l’allocation équivalent retraite, l’AER, pour l’année 2010. Cette mesure, qui permet à des personnes proches de la retraite de partir dans des conditions dignes, après une vie salariée bien remplie, libère, par la même occasion, des emplois pour les jeunes arrivant sur le marché du travail.
Face aux très mauvais chiffres du chômage d’octobre, monsieur Wauquiez, vous aviez annoncé des « mesures plus offensives » à partir de 2010. Pourquoi ne pas les inscrire dès aujourd’hui dans le présent budget ? À moins que ce ne soit qu’une déclaration de plus…
À propos, justement, de distorsion entre les déclarations et la réalité du terrain, je souhaite m’attarder sur la situation extrêmement préoccupante de Pôle emploi, qui illustre parfaitement cette distorsion. Non, contrairement à la communication gouvernementale, que semble relayer M. le rapporteur pour avis, Alain Gournac, Pôle emploi n’a pas surmonté ses difficultés !
Certes, la fusion entre l’Agence nationale pour l’emploi et les ASSEDIC fut concomitante à l’arrivée de la crise et cette donnée ne peut être niée. Néanmoins, au vu de la manière dont cette réforme a été engagée, avec un total manque d’anticipation – résultat du caprice idéologique d’un gouvernement décrétant une priorité, sans se soucier de l’intendance qui n’avait qu’à suivre, mais qui ne le pouvait pas tant les difficultés à régler étaient énormes –, tout laissait présager qu’elle serait très douloureuse.
Ainsi nous sommes allés de renoncements en renoncements en termes de suivi des demandeurs d’emploi, le contingent suivi par un conseiller passant de 30 à 60, puis aujourd’hui, en moyenne, à 94 demandeurs d’emplois, sachant que, dans certaines agences, ce ratio peut monter jusqu’à 130, voire 180 demandeurs d’emplois !

Ces changements ne sont pas des détails. Ils modifient l’essence même de ce travail.
Ainsi, la personnalisation des prestations et le renforcement de l’accompagnement, principal objectif de la fusion, sont tout simplement impossibles à réaliser. Et ne parlons même pas de l’activité de prospection des entreprises, que les salariés de Pôle emploi devaient aussi prendre en charge...

D’un prétendu service personnalisé, on en est arrivé à un véritable travail à la chaîne. Ni le transfert à la hâte de 320 000 dossiers vers de coûteuses structures privées ni les recrutements opérés ne vont suffire à remédier à cette situation, d’autant qu’on nous annonce déjà, avec le reflux du chômage, une diminution des effectifs de Pôle emploi. Donnons-lui déjà le personnel qu’il faut, avant de penser à le réduire !
Le plus grave est que cette fusion, bâclée et encore inachevée, va créer deux types de sacrifiés : les salariés de Pôle emploi, confrontés à des conditions difficiles de travail, et les demandeurs d’emploi eux-mêmes, encore plus mal accompagnés.
Prétendre que les difficultés sont derrière Pôle emploi est faux ! Vos discours, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, se heurtent, là encore, aux réalités.
Évidemment, comme M. le rapporteur pour avis le dit, nous ne prétendons pas avoir la solution miracle pour faire refluer le chômage. Mais, sachant que l’argent est le nerf de la guerre, nous déplorons que le Gouvernement refuse d’aller le chercher là où il est, en abrogeant le bouclier fiscal et en taxant les stock-options, les jetons de présence et les parachutes dorés.
Il préfère au contraire mettre en place la fiscalisation des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Nous voterons évidemment contre cette mesure particulièrement choquante et indécente, mais nous y reviendrons le moment venu.
La situation de l’emploi est aujourd’hui très préoccupante et elle est loin de s’améliorer. Comment, dans un tel contexte, justifier une politique drastique de réduction de fonctionnaires, quand, entre 2008 et 2009, les conseillers ministériels ont vu leur nombre augmenter de 17 % et leurs salaires progresser très substantiellement ? Comment imposer la rigueur salariale à toutes et à tous quand le Gouvernement ne cesse d’augmenter son train de vie ?
Nous estimons donc que le budget de la mission « Travail et emploi » n’est pas à la hauteur des besoins de notre pays. J’aurais souhaité aborder d’autres thèmes, par exemple le travail au noir ou l’égalité professionnelle, tous ces dossiers que le Gouvernement prétend vouloir ouvrir, mais qui sont tout juste évoqués et ne font même pas l’ombre d’une mesure dans ce budget !
Ce dernier répond à un « plan com », un plan de communication, qui est un véritable écran de fumée, mais ne permettra en rien d’apporter les réponses concrètes dont notre pays a besoin pour combattre la crise et ses conséquences en matière d’emploi.
C’est la raison pour laquelle nous voterons contre.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, malgré les récentes déclarations gouvernementales, la sortie de crise n’est pas tangible !
Les chiffres du chômage du mois dernier sont là pour en attester : ils progressent de 1, 3 % sur un mois et de près de 17 % sur une année. Nous sommes bien dans une situation extrêmement difficile.
D’ailleurs, le discours gouvernemental laissant penser que la situation nationale serait meilleure que celle de nos voisins européens est certes vrai pour certains, mais pas pour d’autres. Ainsi, l’Italie et l’Allemagne font mieux que nous : leur taux de chômage est inférieur à 8 %, alors que le nôtre flirte avec le niveau de 10 %.
Cette crise sans précédent a des effets catastrophiques sur l’ensemble de notre économie.
Elle est d’autant plus inquiétante qu’elle frappe très durement le secteur industriel. Or, tous les économistes le reconnaissent, c’est un secteur particulier et essentiel. II est le lieu principal des innovations technologiques et des gains de productivité. Un rapport récemment remis au Premier ministre, intitulé « Pour une nouvelle politique industrielle », considère que « même si la part des services dans l’économie s’accroît, une industrie solide est nécessaire à un équilibre vertueux de la balance commerciale et à la croissance ».
Ce secteur industriel a perdu plus de 125 000 emplois en un an, des disparitions qui enclenchent mécaniquement un effet domino. Les sous-traitants et les entreprises partenaires sont, à leur tour, touchés de plein fouet et, parfois – en tant qu’élus locaux, nous ne le savons que trop bien –, ce sont des territoires entiers qui sont déstructurés économiquement et socialement. Il suffit de considérer le secteur automobile pour s’en rendre compte.
Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, votre budget permettra-t-il de relever les défis qui sont les nôtres ? Saura-t-il apporter des réponses aux légitimes angoisses de nos concitoyens et de leur famille ? J’en doute !
Ma première remarque concerne l’évolution des crédits de cette mission. À périmètre constant, ils sont en baisse de 1, 73 %, soit 410 millions d’euros. Dans le contexte actuel de hausse du chômage et de précarité, comment justifiez-vous cette contraction ? À nos yeux, elle traduit parfaitement la priorité que vous accordez au travail et à sa revalorisation... une priorité faite de discours, mais certainement pas d’actes !
Ainsi le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » est doté d’une enveloppe de 5, 886 milliards d’euros, soit une baisse des crédits de 2, 9 % par rapport à 2009. En réduisant les possibilités de financement, vous remettez en cause le potentiel des hommes et des femmes concernés à intégrer ou réintégrer l’emploi. Aujourd’hui, nous le savons bien, la croissance n’atteint que 0, 3 % et ne permet pas le retour à l’emploi et la baisse du chômage.
En outre, ce sont particulièrement les jeunes qui sont concernés par cette situation. Le taux de chômage des 16-25 ans est passé de 18 % à 24 % et je ne parle pas des quartiers en difficulté et des banlieues. Dans les faits, un jeune sur quatre est au chômage : un quart de notre avenir collectif n’a pas sa place dans notre économie !
Quant aux femmes, les données parues dans le dernier rapport du Secours catholique laissent transparaître une situation dramatique : 42 % des femmes seules vivent uniquement de transferts sociaux, cette proportion passant à 60 % quand elles ont des enfants. La pauvreté et la précarité sont leur lot quotidien.
Dans un contexte où les plans sociaux se multiplient, les seniors qui éprouvent les plus grandes difficultés à retrouver un emploi ne sont pas épargnés. On aurait pu penser que le dispositif AER – allocations équivalent retraite, allait être reconduit en 2010. Ce n’est pas le cas, le Gouvernement se contentant tout juste de prolonger les entrées de 2009.
Le Comité national des entreprises d’insertion demande une juste revalorisation de « l’aide au poste ». Stable depuis de trop nombreuses années, cette aide est d’un montant de 9 650 euros et il est demandé de la réévaluer à hauteur de 12 500 euros, ce qui permettrait aux entreprises d’insertion de poursuivre leurs actions d’accès et de retour à l’emploi pour ceux qui en ont le plus besoin.
Bien sûr – Mme Procaccia l’a tout à l’heure souligné –, le Gouvernement a enfin compris que les contrats aidés pouvaient être, dans certaines situations, tout à fait utiles. Il est donc heureux – et nous l’apprécions – que le taux de subvention passe de 70 % à 90 %. Cela dit, le « contrat aidé » doit faire l’objet de politiques d’accompagnement et de formations, et c’est bien souvent là que le bât blesse.
Je veux indiquer également que les collectivités territoriales, que vous ne cessez de stigmatiser, investissent dans ces contrats aidés, auxquels elles croient. Elles prennent toute leur part dans le soutien à l’économie et aux populations victimes de la crise. Toutefois, cette dynamique ne doit pas être brutalement rompue lorsqu’il y a passage d’un dispositif à l’autre ; je pense en particulier au contrat unique d’insertion qui devrait voir le jour en janvier prochain.
Je voudrais une nouvelle fois attirer votre attention sur la situation de Pôle emploi.
Le Gouvernement avait promis – on en a déjà parlé, en particulier lors de l’examen du projet de loi sur la formation professionnelle – qu’un conseiller aurait à suivre au plus une soixantaine de personnes. Or, aujourd’hui, un conseiller a, en moyenne, la charge de 150 à 160 demandeurs d’emploi. Comment comptez-vous obtenir une amélioration du service rendu alors que les moyens font défaut ?
Que dire des contrats d’autonomie ? J’observe qu’en un peu plus d’un an et pour la somme faramineuse de 30 millions d’euros, seuls 1 000 contrats ont été signés.

La presse a récemment titré « La faillite du plan banlieue ». C’est dire !
Alors que l’économie mondiale est en pleine transformation, les entreprises sont confrontées à des choix multiples et doivent anticiper.
À cet égard, le programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » revêt une grande importance. Vous diminuez, monsieur le ministre, les crédits de près de 12 %.
Cette logique qui sacrifie nos lendemains se retrouve aussi dans les programmes concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, mise en place dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale de M. Borloo. La GPEC est un facteur déterminant pour éviter les restructurations brutales. Là aussi, vous passez de 11 millions d’euros à 7 millions d’euros.
Vous mécontentez tout le monde, les entreprises, comme la population active. Ce budget n’est pas à la hauteur, compte tenu de la situation que connaît notre pays. Il hypothèque notre avenir, pénalise les plus fragiles, les jeunes et ne constitue pas l’instrument adéquat pour faire face aux bouleversements importants de notre économie. Nous n’adopterons pas un budget qui nie la gravité de la situation.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, très sincèrement, dans le contexte actuel, je reconnais que la tâche du Gouvernement n’est pas facile.
La première des difficultés est bien entendu liée à la situation économique particulièrement dégradée de notre pays.
Si la France résiste mieux que d’autres à la crise – mais elle n’est pas la seule –, il n’en reste pas moins que le chômage a progressé de 25 % en un an Avec une hausse de 52 400 inscrits, le nombre de demandeurs d’emploi a, le mois dernier, dépassé 2, 6 millions, sans compter que la reprise qui semble s’annoncer ne produira sans doute pas ses premiers effets sur l’emploi avant neuf mois – aux dires des plus optimistes – et plus vraisemblablement pas avant un an.
Je suis bien sûr conscient que le Gouvernement n’est pas responsable de tout, notamment de l’ensemble de l’activité économique, et que sa marge de manœuvre est contrainte avec un tel déficit budgétaire.
Nous saluons les points positifs de ce budget : le financement en 2010 de 360 000 contrats uniques d’insertion dans le secteur non marchand et de 50 000 dans le secteur marchand ; les mesures de soutien à la formation en alternance ; la limitation au recours des préretraites.
Nous avons bien noté également que vous souhaitiez renforcer la politique de santé – il y a eu cette année quelques exemples dramatiques – et de sécurité. Cette politique voit ses crédits augmenter de 30 millions d’euros, ce qui représente une progression de 20 %.
Nous nous félicitons aussi de la volonté du Gouvernement de promouvoir l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, de maintenir l’emploi des seniors, dont un sur quatre seulement travaille encore à l’âge de soixante ans, taux qui est l’un des plus bas d’Europe.
Cependant, monsieur le ministre, malgré ce que je viens de rappeler, plusieurs éléments importants me semblent insuffisants dans le budget que vous proposez.
Les moyens financiers de la mission « Travail et emploi », dont les crédits diminuent à périmètre constant, ne sont pas à la hauteur des besoins : sur un total de 52 milliards d’euros dévolus au travail et à l’emploi, seuls 11, 2 milliards d’euros sont directement affectés à la mission « Travail et emploi ». Onze autres milliards d’euros sont en fait des dépenses fiscales, et les trente milliards restants correspondent à des exonérations de cotisations sociales.
Je voudrais également souligner la très préoccupante situation de Pôle emploi. La fusion de l’ANPE et de l’UNEDIC avait été faite – je l’avais dit en son temps – de manière précipitée. On voit le résultat aujourd’hui. Mme Lagarde s’était engagée à ce que chaque conseiller de Pôle emploi soit, à terme, en charge de 60 demandeurs d’emploi.

Or le ratio est aujourd’hui supérieur à 100. Je pense même qu’elle avait cité le chiffre de 30 pour les publics les plus en difficulté.
Autant vous dire qu’on est loin du compte et que les recrutements auxquels a procédé Pôle emploi cette année ne seront vraisemblablement pas suffisants.
En outre – et c’est là que le bât blesse le plus à mon sens –, l’accompagnement social prévu pour les personnes privées d’emploi est loin d’être suffisant, car de nombreuses études nous montrent que le nombre de personnes en situation précaire, celles qui précisément ont absolument besoin de ces aides spécifiques, ne cesse d’augmenter.
Nous pensons notamment que les crédits affectés à l’allocation de solidarité spécifique, l’ASS, ou à l’allocation équivalent retraite, l’AER, sont insuffisants parce qu’ils ne prennent pas en compte les nombreux chômeurs victimes de la crise qui arriveront en fin de droit et se retrouveront sans aucune couverture à la fin du deuxième semestre de 2010 et au début de 2011.

Enfin, je note que le programme « Accès et retour à l’emploi » voit ses crédits diminuer de 145 millions d’euros tandis que ceux du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » accusent une baisse de 11 %.
Tout cela va à l’encontre du renforcement absolument nécessaire de l’accompagnement social des personnes privées d’emploi, dont le nombre s’accroît et qui voient leur situation se dégrader. Cette dimension n’est pas assez valorisée dans votre budget. Vous comprendrez que, dans ces conditions, monsieur le ministre, notre groupe soit extrêmement réservé sur ce budget.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'état, mes chers collègues, quel que soit l’endroit où je porte mon attention en matière de politique de l’emploi menée par le Gouvernement, je ne vois aucune bonne raison – et je m’en désole – de souscrire à l’optimisme souriant de Mme Lagarde, pas plus qu’à la vigueur auto-satisfaite du Président de la République.
Comme garde-corps en politique, je me remémore, aussi souvent que nécessaire, cet adage minimal : n’est pas devin qui veut. Il ne suffit pas de décréter que le pire est derrière nous pour que les Français y croient, surtout s’il s’agit d’un pari sur un avenir aussi incertain aujourd’hui qu’il l’était hier.
Il ne suffit pas que le Président de la République aille féliciter les salariés de Pôle Emploi pour que nous soyons dupes du succès de cette structure, quand nous savons que chaque agent a la charge de plus de 120 demandeurs d’emploi. Que le Président de la République en soit fier, c’est une chose. Qu’il croit, comme il l’a dit, que « le climat social est aussi apaisé qu’on pouvait l’imaginer », alors que les syndicats – même les plus modérés – dénoncent les difficultés croissantes des salariés, confine à l’aveuglement.
Les chiffres du chômage que vous nous servez ne reflètent pas la réalité puisque sont exclus : les salariés victimes de licenciements économiques bénéficiant d’un contrat de transition professionnelle ou d’une convention de reclassement personnalisé ; les radiations par défaut d’actualisation, soit 42, 2 % en octobre dernier, de ceux qui se désespèrent et renoncent à chercher du travail face à la conjoncture actuelle ; les personnes en chômage partiel ; enfin, les demandeurs d’emploi des autres catégories de classement.
Il convient néanmoins de ne pas oublier que, derrière les promesses, les programmes, le marketing politique, il y a une réalité que vivent plus de quatre millions de Français et leurs familles.
Dans la vraie vie, monsieur le ministre – et tous mes collègues de bonne foi qui connaissent le quotidien de leurs concitoyens peuvent en attester – la réalité de l’emploi et ses conséquences partout en France sont une vraie catastrophe.
Alors, bien sûr, la crise a bon dos. Mais pendant ce temps, que faites-vous ?
En étudiant les chiffres, j’ai constaté que 580 000 destructions d’emplois marchands étaient intervenues en 2009, sans marge d’action puisque les outils de traitement conjoncturels sont déjà sollicités.
Vous pariez sur une normalisation progressive de l’activité économique pour 2010 ramenant ce chiffre à 190 000 destructions d’emplois. Une normalisation à 190 000, c’est ce que l’on appelle un oxymore !
Malgré ces chiffres, les dotations de la mission « Travail et emploi » pour 2010 sont en régression de 6, 2 %.
Le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » subit une coupe de 2, 4 %.
Le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » est en diminution de 11, 8 %. C’est ce que l’on appelle une anticipation joyeuse et optimiste, sans doute.
La mission « Plan de relance » a déjà absorbé 170 millions d’euros en autorisations d’engagement et 142 millions d’euros en crédits de paiement.
L’AER n’est pas reconduite en 2010, alors que le Gouvernement s’était engagé, lors du sommet social de février dernier, à prolonger l’ouverture de ce dispositif.
De même, aucune nouvelle entrée n’est prévue pour l’allocation de fin de formation. L’« aide au poste » dans les entreprises d’insertion n’a pas été revalorisée depuis huit ans. Le resserrement est à l’œuvre dans le cadre des dispositifs censés permettre le relèvement du taux d’emploi des salariés de plus de cinquante ans, prévu par le Plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors 2006-2010. Attention, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, 2010, c’est demain !
Le nombre de journées de chômage partiel a atteint 4, 1 millions d’heures en 2008 et pas moins de 6, 9 millions d’heures en 2009. Pour ce qui est de la « glandouille » que Fadela Amara promettait d’éradiquer, je m’en tiendrai à la remarque suivante : en la matière, il conviendrait de donner l’exemple en nous occupant en priorité des habitants des zones urbaines sensibles, les ZUS, qui, pour 33 % d’entre eux, vivent en dessous du seuil de pauvreté, cette proportion atteignant plus de 44 % pour les moins de dix-huit ans, qui sont les premiers touchés par les inégalités de revenus.
Je vous mets au défi d’emmener une délégation expliquer à ces personnes que, si elles sont pauvres et sans emploi, c’est parce qu’elles « glandouillent » !
Je finirai par les dépenses fiscales.
À l’instar du duo comique qui sévit sur Internet en décernant les « Satanas d’or », je propose de décerner au Président de la République le titre d’« Homme qui valait trois milliards », puisque c’est le prix que coûtera le cadeau fiscal consenti à la restauration.
On s’abstiendra de rappeler que les effets d’aubaine escomptés n’ont pas vraiment profité à ceux qui auraient dû en bénéficier. On n’a pas réellement assisté à une explosion de l’embauche dans ce secteur.
Pendant ce temps, à l’instar du Président de la République, qui affectionne les diversions, au lieu de vous soucier réellement de mettre en œuvre les moyens que requiert une situation économique frappant de plein fouet les plus fragiles, vous aidez les banques à réitérer leurs exploits. Vous aidez les grands patrons – saluons au passage l’immense courage qu’il a fallu à M. Estrosi pour doubler le salaire d’un patron d’entreprise publique –, vous baissez la TVA dans la restauration. Enfin, j’en viens à la fameuse diversion, vous vous achetez une morale en menaçant de punir les méchants employeurs qui font travailler depuis des années les vilains sans-papiers dans les secteurs dits « en tension ».
Soit dit en passant, expliquez-nous comment résoudre cette contradiction qui voudrait que ces méchants employeurs assument le risque d’une garde à vue en fournissant aux sans-papiers les fiches de paie requises pour fonder une demande de régularisation ?
Pour nous faire oublier vos choix en matière de fiscalité, vous attirez notre attention sur des problèmes qu’il nous faudra certes résoudre, mais qui ne pèsent pas lourd comparés aux 30 milliards d'euros d’exonérations sociales et aux 11 milliards d'euros d’exonérations fiscales que coûtent vos cadeaux hasardeux, parmi lesquels on peut citer les exonérations sur les heures supplémentaires, contre-productives en termes de création d’emplois.
Si nous ne pouvons souscrire aux orientations de cette mission du projet de loi de finances, c’est simplement par pur bon sens, celui-là même qu’une promenade sur le terrain vous ferait recouvrer ! Mais il vous faudrait vous éloigner des sentiers battus par les équipes de communication, des castings de figurants dociles et des caméras complaisantes. Il vous faudrait aller là où la fameuse valeur travail dont vous nous avez rebattu les oreilles pendant vos campagnes s’est terriblement désagrégée, jusque dans les rangs de ceux qui ont cru dans vos promesses, là où le chômage n’est pas une variable d’ajustement macro-économique, là où plus de 100 demandeurs d’emploi par conseiller de Pôle Emploi n’est pas seulement une donnée moyenne qui n’atteint pas son objectif, mais une source de découragement pour tous !
Ce n’est que sous réserve de la prise en compte de quelques suggestions auxquelles vous restez sourds, comme le prolongement de six mois de la durée d’indemnisation des chômeurs à 80 % des salaires, l’extension des contrats de transition professionnelle à l’ensemble des bassins d’emploi avec une durée d’indemnisation de deux ans, ou l’augmentation des coûts des licenciements pour les entreprises qui reversent des dividendes ou rachètent leurs propres actions, que nous pourrions prendre au sérieux la mission « Travail et emploi » du projet de loi de finances pour 2010.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nul besoin de dépenser 3 millions d’euros en sondage pour savoir que le chômage est la première préoccupation des Français. Avec la plus grave récession qu’ait connue notre pays depuis l’après-guerre, un chômage en augmentation de 30 % en un an et demi, un recours au chômage partiel plus que décuplé, il n’est pas difficile de comprendre que la véritable sortie de crise dépend de la reprise de l’emploi.
Les politiques en faveur de l’emploi sont donc au cœur des défis que nous a lancés cette crise sans précédent. C’est dire si nous nous attendions à voir le Gouvernement proposer des politiques innovantes, se mobiliser pour les victimes de la récession, lancer des pistes de réflexion, bref, investir massivement pour l’avenir.
Les crédits de la mission « Travail et emploi » aurait dû connaître une augmentation aussi exceptionnelle que le sont les circonstances. Or, ils sont en diminution !
D’après notre rapporteur, cette diminution est factice. Le plan de relance, les dépenses fiscales et les exonérations de cotisations sociales concentrent, d’après lui, la réalité des efforts réalisés en matière d’emploi. Toutefois, même en tenant compte de cet argument, la pertinence des choix économiques et politiques du Gouvernement est douteuse.
Rappelons d’abord que, selon la Cour des comptes, l’impact des exonérations de cotisations sociales en matière de création d’emplois est très marginal, alors même que le coût de ces dispositifs est évalué à 30 milliards d’euros. Ces cadeaux pèsent sur le budget de la sécurité sociale, la couverture de nos risques se réduisant face à l’ampleur des déficits.
Avec de tels résultats, faire de la politique d’exonération des charges le dispositif le plus important en matière d’emploi augure mal de la suite, d’autant qu’un des reproches adressé à ce dispositif, outre celui d’être une trappe à bas salaires, est de ne financer que les emplois les moins qualifiés, donc les plus précaires. Aucune mesure n’est prévue pour soutenir et donner la priorité aux emplois à forte valeur ajoutée.
Quant aux dépenses fiscales, et donc au financement des heures supplémentaires, elles permettent justement d’éviter des embauches en jouant sur l’augmentation du temps de travail. Cherchez l’erreur !
Enfin, le plan de relance concentre les actions en faveur du reclassement des salariés licenciés économiques avec des crédits totalement prélevés sur la mission « Travail et emploi ». Or, il ne devrait prendre en charge que des mesures exceptionnelles et temporaires pour 2010. En gonflant artificiellement ses crédits avec des transferts provenant d’autres missions, le Gouvernement se borne à faire du recyclage pour justifier ses effets d’annonce.
Selon notre rapporteur, le Gouvernement aurait mobilisé une grande variété d’outils de lutte contre le chômage. M. Gournac a notamment cité en commission le recours au chômage partiel et les conventions de reclassement.
Monsieur le ministre, lutter contre le chômage en favorisant le chômage, et présenter cela comme un progrès et le fruit des efforts du Gouvernement, il fallait le faire. Vous l’avez osé ! Dans la catégorie des perles, on peut également mentionner l’affirmation de notre rapporteur selon laquelle « le Gouvernement a résisté à la tentation d’avoir recours aux dispositifs de préretraite ».
En réalité, au dispositif de préretraite s’est substituée l’utilisation par les entreprises de la rupture conventionnelle, c’est-à-dire le licenciement. Bref, le seul constat qui peut être dressé est que le taux d’activité des personnes de plus de 55 ans est toujours aussi bas.
Et ce n’est pas l’affirmation incantatoire du Gouvernement sur cette question qui devrait faire bouger les lignes, puisque la seule mesure concrète en la matière est l’instauration d’une pénalité de 1 % de la masse salariale à l’encontre des entreprises qui n’auraient pas signé le plan senior au 1er janvier 2010. Les entreprises concernées ayant une obligation de moyens, mais pas de résultats, on peut considérer qu’il s’agit d’un dispositif chargé à blanc.
Enfin, alors que la situation des jeunes ne cesse de s’aggraver, que leur taux de chômage en 2009 est d’un peu plus de 25 %, avec des pointes à 42 % dans les banlieues, les mesures qui leur sont destinées se résument à l’apprentissage.
Or, on le sait bien, de nombreux jeunes en qualification ne trouvent ni contrats ni lieux de stage, ce qui explique qu’une baisse de 10 % des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ait été prévue en 2010. Si telle est la mesure phare du Gouvernement, elle se révèle peu porteuse pour les jeunes.
J’ajouterai que, lorsqu’on sait que plus de 62 % des diplômés de 2008 n’avaient toujours pas trouvé d’emploi un an après, on voit à quel point la question de l’insertion sur le marché du travail concerne tous les jeunes au-delà de leur niveau de formation. Face à ce constat, le Gouvernement ne propose rien.
Le temps m’étant compté, j’en terminerai là. Proposer au Parlement un budget si indigent alors que le chômage ne cesse d’augmenter et l’avenir de s’obscurcir est inquiétant.
Tout le monde l’admet : si la crise financière est peut-être derrière nous, la crise économique est toujours là et la crise sociale, encore devant nous. À l’examen de ce budget, le groupe socialiste ne peut que constater la démission du Gouvernement sur le front de l’emploi. Les Français apprécieront. Quant à nous, bien évidemment, nous ne voterons pas les crédits de cette mission.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les chiffres du chômage en octobre sont mauvais, comme l’a reconnu avec franchise Mme Lagarde.
À l’évidence, le Gouvernement a été surpris par cette nouvelle et franche dégradation. Le directeur général de Pôle emploi lui-même s’est dit dans l’incapacité d’éclairer cette évolution. Quelques jours plus tôt, en réponse à une question d’actualité que je lui avais posée sur la situation de l’emploi observée en septembre, Mme Lagarde tentait, avec sincérité, de nous rassurer en évoquant une « décélération de la dégradation ».
Monsieur le ministre, alors que vous vouliez voir dans ce ralentissement de la hausse les premiers signes précurseurs d’une sortie de crise, vous voilà brutalement replongés dans le réel ! Cela a d’ailleurs conduit, il y a quelques jours, Mme Lagarde à reconnaître que « la tendance à la dégradation de l’emploi devrait se poursuivre quelques trimestres ».
À l’appui de votre analyse, l’OCDE estime que la hausse du taux de chômage pourrait bien ne pas s’achever avant le début de 2011, date à laquelle il pourrait dépasser le taux de 10 % en métropole. Le Premier ministre lui-même reconnaît que l’économie française ne recommencera à créer des emplois que lorsqu’elle retrouvera un niveau de croissance de 2 %.
Dans ce contexte, comment comprendre, et accepter, que les dotations de la mission « Travail et emploi » pour 2010, affichent, hors mesures du plan de relance, une diminution de l’ordre de 5 % ? Comment comprendre les réductions des dispositifs d’accompagnement comme le chômage partiel et l’allocation équivalent retraite ? Comment comprendre que la subvention que l’État accorde à Pôle emploi, qui est maintenue au même niveau que l’an passé, n’augmente pas ? Comme mes collègues l’ont fait remarquer, devant l’accroissement du nombre mécanique des demandeurs d’emploi, on peut craindre une nouvelle dégradation des conditions de fonctionnement de ce service public, qui est déjà particulièrement mis à mal.
Dans ce contexte de crise, la formation professionnelle aurait dû, vous en conviendrez, monsieur le ministre, trouver une place privilégiée dans le budget.
Or, pour ne prendre qu’un seul exemple, qui a également été évoqué par mes collègues, les contrats d’apprentissage sont en baisse d’une année sur l’autre, et dans des proportions très significatives. De même, la baisse des crédits pour 2010 concernant les contrats de professionnalisation est surprenante.
J’en viens à l’AFPA, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont la subvention est réduite de 20 millions d’euros. Cette diminution semble correspondre à une réduction de sa dotation d’investissement. Or, monsieur le ministre, jamais autant qu’aujourd’hui sans doute, cet organisme n’a eu besoin de budget pour entretenir le patrimoine que vous venez ou que vous allez lui transférer.
J’observe par ailleurs que l’AFPA se trouve, et j’ai déjà eu l’occasion de vous exprimer toutes mes craintes sur ce sujet, engagée dans un processus malthusien. Les embauches sont désormais gelées, alors même qu’elle devrait être au plein de sa capacité pour assurer l’accompagnement sur le marché de l’emploi et la sortie de crise.
Alors, non seulement je ne vous fais pas de procès d’intention, mais je vous donne pleinement raison lorsque vous déclariez il y a quelques jours dans Le Monde qu’il fallait des mesures plus offensives pour l’emploi. Or, ce projet de budget n’est, me semble-t-il, ni à la mesure du contexte observé, que j’ai décrit tout à l’heure, ni en phase avec vos propres déclarations. Comment expliquer ce décalage ? Je propose une hypothèse. Vous avez élaboré ce projet de budget sur un pari, celui de la sortie de crise dans les prochains mois. J’observe d’ailleurs que la tonalité du rapport de notre rapporteur Alain Gournac, sans doute rédigé avant que nous ayons connaissance des chiffres du mois d’octobre, le confirme : « En cette fin d’année 2009, plusieurs signes positifs permettent d’espérer que la période la plus difficile est maintenant derrière nous ».
Ce pari, on le constate aujourd’hui, est en fait une erreur d’analyse, qui rend caduque et dépassé ce projet de budget, avant même son début d’exécution.
M. Guy Fischer remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le budget de la mission « Travail et emploi » que j’ai l’honneur de vous présenter a fait l’objet d’une discussion constructive à l’Assemblée nationale. Sans doute nos débats permettront-ils de l’enrichir encore, et je veux d’ores et déjà saluer le travail réalisé par les commissions des finances et des affaires sociales et leurs présidents respectifs, Jean Arthuis et Muguette Dini. Je veux également remercier les rapporteurs, MM. Serge Dassault et Catherine Procaccia, qui a aujourd'hui prêté sa voix à Alain Gournac.
Le volet « travail » de la mission « Travail et emploi » a une importance fondamentale, car il est au cœur de la politique de revalorisation du travail que mène le Gouvernement, et j’entends bien, à la tête de ce ministère, le replacer au centre de nos politiques sociales. Le travail est en effet la source de l’innovation, le moteur de la création de richesses dans notre pays. C’est sur lui que reposent l’équilibre de nos modèles de solidarité intergénérationnelle et la solidité de notre cohésion sociale.
Voilà pourquoi toute notre action doit tendre à le promouvoir et à le garantir.
Afin nous donner les moyens de cette ambition, au sein de la mission « Travail et emploi » le projet de budget porte inscription de 891 millions d’euros de crédits pour les programmes qui correspondent au champ « travail », à savoir les programmes 111 et 155, conformément au à la programmation triennale 2009-2011.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de finances pour 2010 prévoit les crédits nécessaires pour répondre aux nouveaux défis que doit relever le ministère du travail, et l’activité de mon ministère s’est organisée autour de quatre grands chantiers.
Le premier consiste à renforcer la politique de santé et de sécurité au travail, afin de permettre à tous ceux qui travaillent de le faire dans de bonnes conditions, quel que soit leur âge. La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est une nécessité si nous voulons que notre société connaisse à la fois le progrès économique et le progrès social. Le projet de loi de finances consacre 30 millions d’euros à cette politique, ce qui représente une progression de plus de 20 % par rapport aux crédits que vous aviez votés l’an dernier.
Poursuivant l’effort engagé par le premier plan santé au travail pour réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, le deuxième plan santé au travail pour 2010-2014, qui sera mis en place à partir du début de l’année prochaine, aura pour objectif de mieux prendre en compte les nouveaux risques professionnels, dont il est, à juste titre, beaucoup question aujourd'hui : les risques psycho-sociaux et les pathologies plus classiques liées au travail, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques et les risques liés à l’utilisation de produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques.
Afin de mieux connaître ces nouveaux risques professionnels, le programme 111 finance l’AFSSET, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, à hauteur de 9, 7 millions d’euros et l’ANACT, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, à hauteur de 12, 5 millions d’euros. J’espère d’ailleurs que le dispositif de prévention des risques sera encore plus performant une fois réalisée la fusion de l’AFSSET et de l’AFSSA.
De façon complémentaire, je poursuis la réforme des services de santé au travail, qui fera l’objet d’un projet de loi au début de 2010. À cet effet, je réunirai après-demain le Conseil d’orientation sur les conditions de travail, le COCT, et j’ai adressé aux partenaires sociaux un document présentant les principaux axes de cette réforme : développer sur le terrain les équipes pluridisciplinaires de santé au travail ; instaurer la transparence en matière de gestion financière des services de santé au travail, avec publication et certification des comptes ; réformer la gouvernance. Je me suis d’ailleurs rendu, pas plus tard que la semaine dernière, dans un service de santé au travail interentreprises, à Bordeaux, afin d’étudier avec les différents acteurs la manière dont cette action est conduite.
L’ANACT joue un rôle important dans la politique d’amélioration des conditions de travail. Sa subvention a été fixée à 12, 49 millions d’euros, ce qui représente un retour au niveau de la loi de finances initiale pour 2008, après la réduction opérée en 2009.
Dans le cadre du plan d’urgence pour la prévention du stress au travail, que j’ai lancé en anticipation du deuxième plan santé au travail, j’ai décidé que l’ensemble de ces actions seraient menées en direction des PME et des TPE.
L’ANACT joue aussi un rôle décisif à travers la gestion du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail, le FACT, qui finance des investissements immatériels ou des études préalables afin de permettre aux entreprises d’améliorer les conditions de travail de leurs salariés. Ce fonds a vocation à monter en puissance, comme en témoigne la progression de ses crédits, qui passeront de 1, 9 million d’euros en 2009 à 3 millions d’euros en 2010.
Le deuxième chantier concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sujet qui a été souvent évoqué ici.
Dans un pays où 83 % des femmes âgées de vingt-cinq à quarante-neuf ans travaillent, les femmes sont cinq fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel…
… et leur rémunération est inférieure en moyenne de 27 % à celle des hommes. C’est un scandale !
Il faudra non seulement veiller à l’application des lois existantes, mais également aller plus loin. C’est la raison pour laquelle le programme 111 financera, à hauteur de 11 millions d’euros, les actions développées en faveur de la qualité et de l’effectivité du droit dans ce domaine.
Par ailleurs, à la suite du rapport que m’a remis Brigitte Grésy, inspectrice générale des affaires sociales, j’ai invité les partenaires sociaux à négocier, en vue de préparer un projet de loi pour le début de 2010 sur l’ensemble de ces questions.
Promouvoir le travail, c’est aussi mettre un terme à l’immense gâchis que représente la mise à l’écart des travailleurs dès qu’ils ont plus de cinquante ans, et cela constitue notre troisième chantier.
De fait, cette mise à l’écart ne satisfait personne, ni les salariés, ni les entreprises, et elle nuit à notre modèle social. C’est pourquoi le ministère du travail poursuit la politique engagée par le Gouvernement en faveur de l’emploi des seniors, en incitant les entreprises à prendre leurs responsabilités. J’ai d’ailleurs observé que M. Plancade, Mme Le Texier et Mme Demontès ont indirectement évoqué ce sujet.
Le plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors 2006-2010 a pour objectif de relever le taux d’emploi des 55-64 ans au-dessus des 50 % à l’horizon 2010. Nous en sommes à peine à plus de 38% aujourd’hui…
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 fait obligation aux entreprises de plus de 50 salariés d’être couvertes par un accord de branche. À défaut d’en avoir signé un avant le 1er janvier 2010, une pénalité de 1 % de la masse salariale est prévue en cas de manquement à cette obligation. Je tiens à dire à la Haute Assemblée que je suis déterminé à mettre en œuvre cette disposition.
Le quatrième chantier est celui du renforcement du dialogue social.
À cet égard, nous consacrons 26, 6 millions d’euros à la formation des personnels syndicaux. Nous le faisons aussi pour la formation des conseillers prud’homaux.
Pour accompagner la mise en place de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, nous développons aussi un programme de mesure de l’audience de la représentativité syndicale : c’est le projet MARS, auquel nous consacrons 11 millions d’euros en autorisations d’engagement. Pour ce faire, nous avons lancé un appel d’offres dont l’échéance est fixée à 2013.
Pour terminer, je dirai que le ministère du travail se donne les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs, tout en veillant à l’efficacité de la dépense et de l’action publiques.
Nous poursuivons en premier lieu le plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail : 60 agents supplémentaires seront recrutés en 2010 – 50 inspecteurs, 10 médecins et ingénieurs et 100 contrôleurs. Au total, l’inspection du travail aura bénéficié du renfort de près de 700 agents sur une période de cinq ans. C’est considérable !
Cette progression s’inscrit dans le cadre du programme de fusion des services de l’inspection du travail des ministères de l’agriculture, des transports et du travail, qui est entrée en vigueur au début de cette année ; l’année 2009 est donc une année de transition. Cette fusion ayant montré son efficacité, nous poursuivrons la mobilisation de l’ensemble de ces personnels.
D’ailleurs, en 2010, nous allons généraliser les nouvelles directions régionales communes aux ministères du travail et de l’économie, les DIRECCTE – directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi -, en tenant compte de l’expérimentation menée dans cinq régions préfiguratrices : Aquitaine, Languedoc, PACA, Franche-Comté et Rhône-Alpes. Ces nouvelles structures constitueront un interlocuteur unique pour les entreprises et seront ainsi susceptibles d’apporter des réponses beaucoup plus appropriées à leurs besoins.
Ces changements décisifs pour accompagner l’évolution des missions du ministère du travail sont conduits dans un cadre budgétaire respectant les engagements du plan triennal, en particulier celui du non-renouvellement d’un départ à la retraite sur deux. Au total, ce sont 163 emplois qui seront supprimés, étant entendu que 160 agents supplémentaires seront recrutés dans le cadre du plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail. Ce retour catégoriel explique notamment la stabilité de la masse salariale de mon ministère, qui s’établit, comme l’an dernier, aux alentours de 439 millions d’euros.
Les moyens consacrés au programme 155, soit 823 millions d’euros en autorisations d’engagement, permettront d’améliorer significativement la qualité du service rendu aux usagers, comme en témoigne la forte augmentation des crédits d’intervention destinés au financement des maisons départementales des personnes handicapées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les crédits prévus pour le champ « travail » de la mission « Travail et emploi » devraient nous permettre de mener à bien les missions qui sont les nôtres : promouvoir le travail, renforcer le dialogue social, respecter les engagements budgétaires. C’est en mettant en œuvre ces objectifs dans un souci d’efficacité et de justice que nous pourrons contribuer au renforcement du lien social dans notre pays.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d’abord de souligner le remarquable travail de M. le rapporteur spécial, Serge Dassault, dont certains points ont même été salués par Mme Annie David, et son examen détaillé des crédits de la mission. Nous y reviendrons lors de l’examen des amendements qu’il a déposés, ce qui nous permettra d’ailleurs d’apporter un éclairage précieux sur la politique de l’emploi.
Je veux ensuite remercier Mme le rapporteur pour avis, Catherine Procaccia, de son intervention. Qu’elle soit assurée qu’il n’est pas question pour nous, dans cette période particulièrement complexe et délicate, de baisser la garde en matière de politique de l’emploi.
Je veux dire à Annie David et à Claude Jeannerot, dont les interventions se rejoignent sur ce point, que nous continuerons bien entendu à mener une politique offensive dans ce domaine au cours de l’année 2010. Comme en 2009, nous concentrerons notamment nos efforts pour dégager de nouveaux gisements d’emplois sur l’« économie verte ».
À ce sujet, j’indique à M. Plancade, toujours attentif à la question des personnes les plus éloignées de l’emploi, que plusieurs lignes de la mission concernent ces dispositifs. Il est vrai que ces personnes doivent faire l’objet de notre constante préoccupation dans cette période difficile, où le risque est élevé de s’enfermer dans le piège du chômage de longue durée.
Je remercie Mme Demontès de son objectivité. Elle a en effet reconnu que la France faisait partie, avec l’Allemagne et l’Italie, des pays qui ont le mieux amorti le choc de la crise en termes d’emploi, même si, à l’évidence, la situation sur le terrain est terriblement douloureuse pour ceux qui ont perdu leur emploi dans cette période.
Je me permets de saluer l’intervention de M. Jeannerot concernant l’AFPA, sujet qu’il connaît bien. Je tiens à le rassurer, car les mesures que nous avons prises en faveur des jeunes ont permis de redresser la situation dans le domaine de la formation en alternance et des contrats de professionnalisation.
Au début de l’année, les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage enregistraient une chute de 20 %, ce qui était catastrophique. Depuis septembre, nous avons nettement redressé la barre. Tous les jeunes ne décrochent pas un contrat, tant s’en faut. En revanche, nous faisons mieux pendant la crise qu’avant. Je tiens à votre disposition tous les chiffres, qui ont été validés par les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers. Les retours budgétaires que nous avons nous le prouvent également.
Concernant le reste de la politique de l’emploi, permettez-moi de souligner l’importance des moyens d’intervention.
Les programmes 102 et 103 sont dotés d’un montant de 10, 5 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 1, 4 milliard d’euros pour abonder le Fonds d’investissement social, inscrits dans le plan de relance, ainsi que 410 millions d’euros au titre de la prolongation pour six mois du dispositif « zéro charge » pour les TPE, les très petites entreprises. Au total, cela représente 12, 3 milliards d’euros, soit 2, 4 milliards d’euros de plus que ce qui était prévu dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.
Je souligne que les crédits sont en augmentation de plus de 20 %, ce qui montre l’ampleur de l’investissement de l’État dans cette période pour l’ensemble des outils de la politique de l’emploi.
Le fil rouge de toutes les mesures du plan de relance, c’est l’emploi, rien que l’emploi, toujours l’emploi. Des moyens exceptionnels ont donc été mobilisés.
Je reviendrai sur la question des allégements de charges au cours de l’examen des amendements et des échanges que j’aurai avec vous, monsieur le rapporteur spécial. En attendant, je me permets de préciser, avant la remise du rapport que vous appelez de vos vœux, que les allégements de charges permettent sans doute aujourd’hui de préserver l’équivalent de 800 000 emplois. Il ne faudrait donc pas les remettre en cause dans cette période. Vous êtes d’ailleurs le premier à défendre l’abaissement des charges pour les entreprises, considérant que c’est la meilleure manière de renforcer l’emploi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de souligner l’importance du dispositif « zéro charge », qui a permis plus de 650 000 embauches dans les TPE. C’est un dispositif auquel je tenais. La réalité de l’emploi est en effet le fait de ces entreprises-là, qui sont trop souvent oubliées.
Pour finir, je voudrais revenir sur quelques idées simples.
Tout d’abord, nous avons essayé de mettre en place des mesures concrètes, directement applicables et, surtout, négociées avec les partenaires sociaux. Je veux ici souligner leur esprit de responsabilité dans la crise, car la plupart des dispositifs dont nous discutons ont été conçus et améliorés par eux.
Ensuite, toutes ces mesures sont « débranchables ». Je n’ai voulu aucune mesure structurelle, ce qui aurait été irresponsable en termes de gestion du déficit. Dès que la situation sera meilleure, toutes pourront être interrompues. Nous reviendrons alors à un étiage raisonnable en matière de dépenses et en termes de bonne gestion.
Enfin, je tiens à dire que la politique de l’emploi nécessite du sang-froid. Si certains mois sont difficiles, comme ce fut le cas d’octobre, d’autres sont meilleurs. À ces moments-là, ne déduisons pas que nous sommes sortis de la crise. Comme vous l’avez dit les uns et les autres, des mois difficiles sont encore devant nous. C’est pourquoi nous devons tenir le cap et faire tourner à plein régime les mesures qui nous sont nécessaires.
La politique de l’emploi n’a besoin ni de marketing ni de coups de barre à gauche ou à droite. Il lui faut plutôt des acteurs de terrain équipés d’outils fiables pouvant être utilisés le plus vite possible.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures trente, sous la présidence de M. Bernard Frimat.