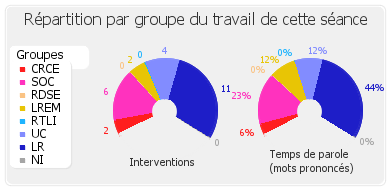Séance en hémicycle du 27 janvier 2009 à 10h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Retrait d'un projet de loi
- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Application de l'article 57 de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le Premier ministre a fait connaître, le 26 janvier 2009, à M. le président du Sénat qu’il retirait du Sénat le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris (n° 281, 2006-2007), déposé le 22 mars 2007 sur le bureau du Sénat et rattaché à la séance du 22 février 2007.
Acte est donné de ce retrait.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, que nous avons adopté le 23 janvier 2009.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : M. Jean-Paul Emorine, Mme Elisabeth Lamure, MM. Laurent Béteille, Philippe Marini, Daniel Dubois, Daniel Raoul et Yannick Botrel.
Suppléants : MM. Philippe Darniche, Philippe Dominati, François Fortassin, Pierre Hérisson, Michel Houel, Charles Revet et Mme Odette Terrade.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, auteur de la question n° 286, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question est liée au projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, dont nous allons commencer l’examen cet après-midi.
Sur notre territoire, la charge des véhicules routiers est fixée à 40 tonnes. Or un certain nombre d’industriels nous ont demandé de prendre des mesures visant à faire passer la charge autorisée à 44 tonnes, comme c’est le cas dans de nombreux pays européens, tels les Pays-Bas ou la Suède, qui permettent respectivement des charges de 50 tonnes et de 60 tonnes.
En raison de l’augmentation des prix du carburant et des conséquences de telles dispositions sur l’écologie, il semble évident qu’une augmentation de la capacité des véhicules permettrait d’éviter un certain nombre de gaspillages.
Je tiens à souligner que j’ai déjà attiré l’attention de M. le ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur cette question le 27 juin 2007 et le 10 juillet 2008, mais il ne m’a pas été répondu.
Monsieur le secrétaire d'État, je souhaiterais que vous m’indiquiez quelles mesures peuvent être envisagées pour aider les entreprises qui utilisent les transports routiers et se mettre ainsi plus en conformité avec le Grenelle de l’environnement ?
Madame le sénateur, M. Borloo, qui m’a chargé de vous apporter une réponse, vous prie d’excuser son absence.
En vertu de l’article R. 312-4 du code de la route, le poids maximal autorisé est fixé à 40 tonnes. Cette limite correspond à celle qui est prévue par la réglementation européenne pour le transport international et à celle qui est en vigueur dans d’autres pays européens comme l’Allemagne ou l’Espagne.
Des dérogations sont prévues pour le transport combiné lorsque la plus grande partie du trajet s’effectue par voie ferrée ou par voie navigable, la limite autorisée pouvant être portée à 44 tonnes pour les dessertes routières terminales. La desserte des ports maritimes ainsi que des autoroutes ferroviaires Perpignan-Luxembourg et Aiton-Orbassano peut également être effectuée à 44 tonnes dans un périmètre de 100 kilomètres.
D’autres dérogations à la règle des 40 tonnes existent aussi pour répondre aux besoins de certains trafics particuliers, comme le transport du bois – à cause de la tempête, l’Aquitaine en aura besoin dans les jours à venir ! – ou des récoltes de betteraves.
À la suite du Grenelle de l’environnement, M. le ministre d’État a demandé à ses services de travailler sur l’extension de cette dérogation aux dessertes des installations fluviales, sur le modèle de ce qui existe pour les ports maritimes. Cette extension devrait contribuer à rendre plus attractif ce mode de transport, qui est, par ailleurs, particulièrement intéressant sur le plan écologique.
Nous aurons également une discussion au niveau communautaire sur la question des poids et dimensions des poids lourds, car la Commission européenne vient de faire réaliser une évaluation de la directive actuellement en vigueur, qui date de 1996. Cette étude, qui aborde en particulier la question des équilibres modaux susceptibles d’être modifiés en cas d’évolution des règles existantes en la matière, traite aussi des implications qu’auraient ces mesures en termes d’économie, de sécurité routière ou d’entretien des infrastructures.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Mais j’ai été saisie par la société d’exploitation des sources Roxane, dont l’activité est, comme vous le savez, extrêmement importante, notamment dans le domaine des transports. Selon elle, le seul intérêt que le Gouvernement aurait de refuser de porter la limite autorisée à 44 tonnes serait de placer les chemins de fer dans une situation encore plus inconfortable. Mais les difficultés sont là. À l’aune du Grenelle de l’environnement, il convient donc de réexaminer ces dispositions. J’ajoute que l’Orne, département enclavé, est situé assez loin des ports de pêche !

La parole est à M. Alain Dufaut, auteur de la question n° 336, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une fois de plus, je tiens à attirer l’attention du Gouvernement sur les difficultés rencontrées dans la réalisation de la liaison est-ouest au sud d’Avignon, dite liaison LEO.
Cette infrastructure routière de compétence nationale permettra à terme de relier les autoroutes A7 et A9. Son tronçon principal assurera une meilleure fluidité du trafic routier autour d’Avignon, avec la création d’un nouvel axe de circulation permettant aux automobilistes, et surtout aux nombreux poids lourds, de contourner Avignon par le sud, décongestionnant ainsi la rocade urbaine d’Avignon.
De plus, la LEO désenclavera la gare TGV d’Avignon, actuellement difficilement accessible au confluent du Rhône et de la Durance.
Toutefois, alors que ce projet est à l’étude depuis plus de vingt ans et qu’il bénéficie d’une DUP, une déclaration d’utilité publique, du 16 octobre 2003, un seul ouvrage d’art permettant la traversée de la Durance en aval et facilitant le transit routier entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône est en construction, alors que le contrat de plan État-région stipulait, à ma demande, la « construction simultanée des deux ponts sur la Durance ».
Malheureusement, en raison d’un manque de financement, les tranches suivantes de la LEO ne sont toujours pas à l’ordre du jour, alors que la première tranche, qui ne résoudra en rien la problématique d’Avignon, du Vaucluse et du Gard, sera livrée fin 2009.
Une telle incertitude dans la planification de la phase finale de cette infrastructure met donc en grand danger le développement économique de tout un bassin de vie.
La seule solution permettant de garantir la suite de la réalisation de la LEO est la mise en place d’un partenariat public-privé, un PPP, prévoyant une contribution partielle des collectivités territoriales. La solution de la concession, un temps envisagé, ne peut plus être aujourd’hui retenue, car un tel choix nécessiterait de reprendre la procédure de la DUP et repousserait d’autant la réalisation de cette voie rapide.
Un tour de table entre les collectivités territoriales concernées devait être organisé par le préfet de la région PACA, afin de finaliser leur accord à une contribution financière.
Par ailleurs, le PPP de la LEO devait être inscrit, dans son principe, à la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, la MAPP.
Or, à ce jour, aucune de ces deux actions n’est encore intervenue.
Le plan de relance de 26 milliards d’euros présenté par le Président de la République prévoit un effort en matière d’investissement à hauteur de 10, 5 milliards d’euros. Il me paraît évident que, dans le choix des infrastructures à financer dans le cadre de cette enveloppe, les tranches suivantes de la LEO, estimées à 250 millions d’euros, devront trouver toute leur place, car elles ne représentent que 2, 5 % de la somme annoncée, voire 1, 8 % si les collectivités territoriales y participent pour moitié.
Je souhaite donc savoir à quelle date interviendra la mise en place du PPP nécessaire au financement des phases non réalisées de la LEO.
Monsieur le sénateur, j’ai eu personnellement l’occasion de rencontrer le député-maire et l’ensemble des élus de Châteaurenard, qui m’ont fait part de leurs préoccupations sur cet axe routier prioritaire devant relier l’A7 et l’A9. Je partage votre point de vue sur l’utilité de cette liaison non seulement pour Avignon, mais également pour l’ensemble de ce bassin de vie.
J’en reviens à la question que vous avez posée à M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de liaison est-ouest, LEO.
Les travaux de la section centrale au droit d’Avignon ont été déclarés d’utilité publique le 16 octobre 2003, comme vous l’avez fort justement rappelé, monsieur le sénateur, et les travaux concernant la première tranche entre Courtine et Rognonas sont en cours. Cette tranche pourra ainsi être mise en service à la fin de 2009. L’achèvement de la section a été envisagé dans les limites d’un contrat de partenariat public-privé. De premières discussions ont été conduites par le préfet avec les collectivités territoriales concernées par le financement de ce projet, sans toutefois aboutir à un accord de celles-ci.
La poursuite du projet doit par ailleurs être réexaminée à l’occasion des réflexions menées actuellement sur la programmation des infrastructures à la suite du Grenelle de l’environnement. La liaison est-ouest d’Avignon doit donc être soumise à la revue générale des projets pour vérification de son adéquation avec les nouveaux objectifs fixés par le Gouvernement en matière de politique durable des transports.
À l’issue de cette revue des projets, les discussions sur le bouclage du plan de financement de l’infrastructure pourraient être relancées entre l’État et les collectivités territoriales. Si elles aboutissent, la procédure d’évaluation préalable par la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé, MAPPP, pourra être achevée. J’y veillerai d’autant plus personnellement, monsieur le sénateur, que je partage la préoccupation qui est la vôtre sur cette liaison essentielle.

Je remercie M. le secrétaire d'État de sa réponse. Je sais qu’il connaît parfaitement le dossier, puisqu’il s’est rendu sur place avec notre collègue député M. Bernard Reynès, et qu’il est conscient de l’importance de l’achèvement de cette infrastructure pour le bassin de vie du Grand Avignon.
Toutefois, je ne suis pas entièrement satisfait, car sa réponse sous-entend que la réalisation sera différée, ce qui n’est pas compatible avec le suivi du chantier. En effet, la première tranche se terminera à la fin de 2009 ; vous l’avez confirmé, monsieur le secrétaire d’État. À cause de ce hiatus, la continuité ne sera pas assurée et c’est dommageable pour le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône et l’ensemble du bassin de vie.
Pour ma part, je considère que la réalisation finale de la LEO est un élément essentiel de l’aménagement du territoire. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, je compte beaucoup sur vous pour finaliser ce projet.

La parole est à Mme Esther Sittler, auteur de la question n° 358, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Je souhaite attirer l’attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l’application de l’article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, notamment sur les dispositions relatives à la redevance d’assainissement et plus précisément sur les quantités d’eau prélevées sur des sources autres que le réseau de distribution et rejetées dans le réseau d’assainissement.
Il est écrit à l’article 57 de la loi précitée codifié à l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d’eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers. »
Or le décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l’eau et modifiant le code général des collectivités territoriales, pris en application de cet article, ne vient nullement clarifier les conditions de mise en œuvre de cette obligation d’installation d’un dispositif de comptage.
Si la loi sur l’eau rendait cette installation obligatoire dans tous les cas, le décret, contrairement à la loi, offre une autre solution à l’installation de dispositifs de comptage en prévoyant que la redevance d’assainissement peut être calculée par la collectivité ou son délégataire « sur la base de critères permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l’habitation et du terrain, le nombre d’habitants, la durée du séjour. »
Si la détermination des volumes d’eau rejetés dans le réseau de collecte des eaux usées au moyen de ces critères paraît envisageable dans le cas où l’alimentation en eau se fait totalement à une autre source, elle paraît en revanche très difficile lorsque cette alimentation n’est que partielle.
Ainsi, seule l’installation d’un dispositif de comptage semble offrir les garanties nécessaires de précision en matière d’évaluation des quantités rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées.
Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositifs de comptage, le décret précité laisse l’autorité organisatrice fixer les conditions de transmission des relevés.
Enfin, l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ajoute à la confusion.
Le propriétaire des bâtiments concernés par la récupération des eaux de pluie utilisées à l’intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées doit mettre en place « un système d’évaluation du volume » et tenir à jour un carnet sanitaire comprenant notamment le relevé mensuel des consommations. Toutefois, il n’est contraint de déclarer en mairie ces volumes utilisés que lors de la déclaration de l’installation d’un système de récupération des eaux de pluie, soit une seule fois.
Par conséquent, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous, d’une part, m’expliquer pourquoi l’article R. 2224-19-4 ouvre une solution de remplacement à l’installation d’un dispositif de comptage qui n’est pas prévue par le législateur et, d’autre part, me préciser dans quelle mesure les critères mentionnés destinés à évaluer le volume d’eau prélevé sont applicables en cas de prélèvement partiel ?
En outre, ne conviendrait-il pas de préciser les conditions de transmission des relevés ? La simple déclaration en mairie ne semble pas suffisante pour garantir l’applicabilité de cette réglementation.
Enfin, je souhaite savoir si des sanctions sont applicables en cas de non-respect de l’obligation de déclaration en mairie et de non-transmission des relevés.
Madame le sénateur, effectivement, l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales introduit l’obligation pour les usagers raccordés ou raccordables à un réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de l’eau prélevée sur les autres sources que le réseau d’eau potable. Un décret doit préciser les modalités de prise en compte du volume compté dans le calcul de la redevance d’assainissement.
Le dispositif de comptage est généralement implanté au point de prélèvement et comptabilise non seulement les volumes prélevés pour le logement raccordé ou raccordable au réseau d’assainissement, mais également des volumes destinés à l’arrosage du jardin ou à l’abreuvage d’animaux. Dans ce dernier cas, la définition de l’assiette de la redevance d’assainissement impose la pose de compteurs divisionnaires. En tout état de cause, le comptage n’est possible que sur de l’eau propre.
II convenait donc d’assurer aux collectivités organisatrices des services d’assainissement la sécurité juridique nécessaire en l’absence de compteur ou lorsque le compteur enregistre des volumes prélevés pour d’autres usages que ceux du logement raccordé au réseau d’assainissement. À cette fin, la possibilité d’une évaluation forfaitaire de l’assiette de la redevance d’assainissement, qui existait déjà, a été maintenue pour les cas où le volume prélevé ne serait pas fourni au service d’assainissement.
Par ailleurs, l’arrêté du 21 août 2008 a permis de préciser les possibilités d’utilisation des eaux pluviales dans l’habitation. L’examen de ces modalités a notamment mis en évidence les difficultés techniques de comptage du volume récupéré. Le plus souvent, seule une évaluation du volume récupéré au vu des caractéristiques de l’installation est possible. Cette évaluation est effectivement à réaliser pour la déclaration en mairie de l’utilisation des eaux pluviales. En cas de comptage, les volumes annuels utilisés pourront bien entendu être retenus pour le calcul de la redevance communale d’assainissement, en substitution du volume prélevé.
Il apparaît donc désormais possible de compléter les dispositions de l’article R. 2224-19-4 en précisant les conditions dans lesquelles les données relatives au comptage peuvent être prises en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement. En tout état de cause, il conviendra de maintenir la possibilité pour le service d’assainissement de procéder à une évaluation forfaitaire en l’absence de compteurs ou si les compteurs ne répondent pas aux normes techniques en vigueur.
Le projet de décret modifiant l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales sera prochainement soumis à la concertation par les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le MEEDDAT.

La réponse de M. le secrétaire d’État me satisfait.
L’installation d’un dispositif de comptage sur le système de récupération des eaux pluviales est encouragée, ce que je comprends très bien. Toutefois, pour l’exploitation des eaux usées traitées par une station d’épuration, les collectivités devront s’y retrouver financièrement !
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de prendre cet arrêté complémentaire.

La parole est à M. Martial Bourquin, auteur de la question n° 368, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.

Ma question s’adresse à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
La ligne à grande vitesse Rhin-Rhône doit voir le jour en 2011. Il est indispensable que les transports collectifs en lien avec cette nouvelle gare puissent être développés et adaptés.
Vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d’État, ce projet répond parfaitement aux objectifs fixés par la future loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dont nous allons commencer l’examen cet après-midi.
La ligne a pour mission d’assurer l’intermodalité entre la LGV Rhin-Rhône et le réseau classique. Ce projet permettra par ailleurs, avec l’instauration de sept haltes ferroviaires intermédiaires entre Belfort et la Suisse, de créer un système de transport collectif efficace. Il constitue surtout une opportunité formidable d’assurer une ouverture performante vers le réseau ferroviaire suisse et, en retour, de permettre l’accès des ressortissants suisses à la nouvelle gare LGV.
Pourtant, si les objectifs qui coulent de source s’avèrent partagés, la concrétisation de cette réalisation semble problématique.
Actuellement inscrit au contrat de projets État-région Franche-Comté 2007-2013 pour un financement partagé entre l’État, le conseil régional, RFF, le conseil général du Territoire de Belfort et l’État fédéral suisse pour un montant 64 millions d’euros, le coût de cette réouverture est désormais évalué entre 84 millions d’euros et 90 millions d’euros.
On ne peut pas imaginer un seul instant que la région Franche-Comté et l’État abandonnent ce projet de réouverture de ligne faute de volonté politique. La région a d’ailleurs déjà indiqué qu’elle était prête à assumer une partie de ce surcoût, au prorata de son engagement initial ; mais elle ne peut faire l’effort seule.
Le Président de la République annonçait en décembre dernier un soutien massif de l’État à des projets d’investissements publics, notamment dans le domaine des transports. Nous espérons sincèrement qu’il ne s’agit pas d’effets d’annonce et que ces propos se traduiront par des projets concrets à l’image de cette ligne.
Monsieur le secrétaire d’État, de quelle manière l’État entend-il prendre à sa charge, aux côtés des collectivités territoriales, une partie de ce surcoût ?
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention de M. le ministre d’État Jean-Louis Borloo sur le dossier de réouverture de la ligne Belfort-Delle au trafic voyageurs, qui permettra une amélioration du transport ferroviaire en Franche-Comté, avec une desserte ferroviaire de la nouvelle gare TGV de Méroux, des liaisons TER, des correspondances avec le réseau classique et, vous l’avez souligné, une liaison avec la Suisse.
Nous pouvons vous le confirmer, ce projet fait partie des priorités de l’État en Franche-Comté. Comme vous l’avez rappelé, cette opération est inscrite au contrat de projets État-région Franche-Comté 2007-2013 pour un montant de 64 millions d’euros, la participation de l’État représentant 19, 85 millions d’euros.
L’État a confirmé son engagement pour cette opération en mettant en place, dès 2007, les crédits nécessaires à la signature de la convention de financement des études d’avant-projet.
Vous l’avez souligné, les résultats de la première phase de ces études, qui ont été récemment présentés, montrent que le coût à la terminaison de l’opération, avec un objectif de mise en service en 2012, serait supérieur à la somme inscrite pour le contrat de projet.
La deuxième phase des études d’avant-projet permettra d’approfondir un scénario de dessertes et d’arrêter notamment les conditions de réalisation de l’opération en tenant compte de la suppression des passages à niveau de la ligne. C’est une priorité que nous partageons tous.
Quand le coût du projet sera arrêté, le financement du surcoût méritera d’être discuté lors de la révision à mi-parcours du contrat de projets État-région, par redéploiement de crédits provenant d’autres opérations. Vous savez très bien qu’on aura toujours la possibilité, dans le cadre des opérations qui ne seront pas réalisées, de redéployer des crédits sur cette opération qui demeure prioritaire.

Monsieur le secrétaire d’État, vous venez de nous faire part de l’intérêt à la fois local, régional et international de cette réalisation.
Vous avez évoqué la mise en œuvre de ce chantier. Cependant, la question du surcoût ne se pose pas de la même façon pour les collectivités publiques que pour l’État. Les collectivités ne peuvent déclencher une opération que si elles disposent des crédits correspondants. Par conséquent, cette question du surcoût ne devra pas être examinée dans un avenir proche ou lointain, car elle est pour nous très concrète.
Il serait bon d’organiser, dans un délai relativement court, une réunion à visée opérationnelle entre l’État, Réseau ferré de France, et l’ensemble des financeurs de la région de Franche-Comté, pour étudier non seulement le chantier, mais aussi le plan de financement, afin de « mettre sur les rails » ce projet, comme le souhaite l’État.
Les entreprises du bâtiment public ont besoin de travailler. Or ce chantier est prêt. C’est maintenant à l’État d’intervenir pour indiquer à quel niveau il entend prendre en charge ce surcoût.

La parole est à M. Éric Doligé, auteur de la question n° 377, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Monsieur le secrétaire d’État, la relance passe par les investissements : le plan du Gouvernement les favorise heureusement par le biais de divers dispositifs.
Les infrastructures de transport constituant des conditions indispensables de développement de notre pays, nous devons garantir leur financement, et il a ainsi été décidé que des infrastructures diversifiées seraient financées par les routes.
L’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, est l’outil qui doit permettre de mettre en œuvre cette logique. Elle a été dotée de diverses ressources permettant d’attribuer des financements.
Or la baisse du trafic déstabilise quelque peu les recettes attendues. L’État avait de ce fait décidé de relever de 300 millions d’euros la redevance domaniale des sociétés d’autoroutes. Au-delà du montant lui-même, c’est l’importance de l’augmentation qu’il convient de considérer, puisqu’elle atteint 280 %.
Après discussion, nous sommes revenus à une augmentation de 200 millions d’euros de la redevance domaniale acquittée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. À l’évidence, l’économie générale des concessions risque d’être déstabilisée.
Ainsi, pour ce qui est du projet de construction de l’A 19, actuellement en cours de réalisation, qui relie Artenay à Courtenay, la seule augmentation de la contribution risque de mettre durablement la société concessionnaire en perte, voire en faillite, s’il s’avérait difficile de financer cette charge imprévue dans l’équilibre tendu de la concession. Une telle situation financière engendrerait inévitablement la dégradation de la notation de la société et rendrait donc encore plus difficile ses conditions de refinancement, particulièrement dans un contexte d’effritement du trafic. Or le seul refinancement des crédits représente environ 80 % du financement du projet.
Je me permets également de préciser que le Gouvernement change ainsi totalement les règles du contrat. Pour l’autoroute A 19, les collectivités se sont engagées à hauteur de 40 millions d’euros, soit le même montant que l’État, avec une clause de retour à meilleure fortune, qui n’incluait pas une telle augmentation de taxe. En augmentant ses propres prélèvements, l’État diminue la possibilité de retour aux collectivités. Je me pose la question de la légalité d’une telle opération.
Au-delà de cet exemple concret, je souhaite connaître l’appréciation portée par le Gouvernement sur les conséquences d’une telle évolution du contexte fiscal et juridique des concessions. En procédant ainsi, le Gouvernement ne risque-t-il pas de fragiliser les projets qui pourraient être portés par un contrat de partenariat public-privé, faute d’une confiance suffisante entre les partenaires sur la pérennité juridique et fiscale des projets ?
À la suite du dépôt au Sénat de divers amendements, l’État envisage, je le sais, avec relativement peu d’empressement, d’allonger la durée des concessions. C’est une avancée intéressante. Il faudrait également, en ces périodes difficiles, amender le non-adossement qui a pénalisé bien des opérations.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de me faire part de votre analyse sur ces différents points.
Monsieur le sénateur, vous évoquez un projet d’augmentation de la redevance domaniale des sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui a été mentionné à l’occasion de questions sur le financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Permettez-moi tout d’abord de rappeler que la loi de finances de 2009 prévoit qu’une dotation budgétaire importante sera consacrée à l’AFTIF, dans l’attente de la disponibilité des ressources pérennes qui lui seront consacrées et, en particulier, du produit de l’éco-redevance sur les poids lourds circulant sur le réseau routier national.
Cette éco-redevance modifiera sensiblement les choix des transporteurs. En particulier, elle entraînera, d’après les simulations réalisées par nos services, un report du trafic au bénéfice des autoroutes concédées.
L’instauration de cette éco-redevance se traduira donc globalement pour les sociétés concessionnaires par des recettes supplémentaires. Il me semble donc tout à fait légitime de tenir compte de cet effet dans les discussions à venir avec les sociétés en question. Une telle situation pourrait nous conduire à ajuster la redevance domaniale.
À ce jour, le montant de la redevance domaniale est calculé à partir de deux éléments : d’une part, la valeur locative du domaine public occupé par les sociétés concessionnaires – il s’agit, concrètement, du kilométrage de chaque réseau multiplié par le nombre de voies –, d’autre part, le chiffre d’affaires de ces sociétés. Il faudra examiner s’il y a lieu de modifier ces éléments de calcul pour tenir compte des reports de trafic.
Pour autant, nous sommes particulièrement attentifs à ne pas bouleverser l’économie des contrats de concession. C’est tout particulièrement le cas pour ce qui concerne l’autoroute A 19 : le contrat doit garantir le financement de la dette contractée, dont l’ampleur est plus limitée que celle que l’on observe pour d’autres contrats.
Nous devrons prendre en compte cet élément dans la réflexion sur les ajustements que je viens d’évoquer, lesquels ne devront certainement pas nuire au financement privé des projets d’infrastructure que nous appelons de nos vœux.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de votre réponse.
Je tiens simplement à formuler quelques observations.
Je suis tout à fait d’accord avec vous, il est nécessaire d’apporter des financements pérennes à cet organisme indispensable.
L’éco-redevance ne pose pas de problème particulier, bien que l’on ne connaisse pas encore aujourd’hui le retour financier qu’elle permettra d’engendrer et qui devrait contribuer aux différents investissements d’infrastructure.
Je me permets d’insister sur un seul point, à savoir l’augmentation de la taxe. Au moment de la négociation des concessions, à laquelle les collectivités ont été partie prenante, le montant de la taxe était connu : l’équilibre était assuré et les collectivités bénéficiaient d’un retour financier.
À partir du moment où l’État prélève plus, les recettes disponibles dans le compte d’exploitation seront moindres, et les collectivités n’auront probablement plus la possibilité d’avoir un retour financier tout au long de la concession. Finalement, ce sont les collectivités qui vont indirectement payer l’augmentation de la redevance. Je me permets donc d’insister non seulement sur la mise en difficulté des collectivités, mais aussi sur l’éventuel déséquilibre des sociétés autoroutières sur de petites portions.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 369, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question concerne ce que l’on appelle le « petit éolien », c'est-à-dire les aérogénérateurs dont la puissance est inférieure à 36 kilowatts.
Le petit éolien a l’avantage de représenter un investissement accessible aux acteurs du monde rural. La demande croissante d’aérogénérateurs de petite puissance provient notamment des agriculteurs, qui souhaitent ainsi diversifier leurs activités. Il y a là un potentiel non négligeable de kilowattheures « vert » pour les campagnes françaises, avec un impact psychologique a priori tout aussi favorable sur ces territoires pour le développement des énergies renouvelables et des actions de maîtrise de l’énergie.
Comme vous le savez, plusieurs sources d’énergies renouvelables sont exploitables sur chaque territoire –biomasse, solaire, vent, hydraulique –, l’essentiel étant d’établir des complémentarités, afin de répondre au mieux à la demande en fonction des ressources. Le petit éolien constitue un moyen adapté, et ce en complémentarité du photovoltaïque, notamment.
Monsieur le secrétaire d’État, comme le photovoltaïque, le « petit éolien » permet aux acteurs ruraux, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une exploitation agricole, d’une coopérative ou d’une collectivité locale, d’investir directement dans un outil de production d’électricité renouvelable décentralisé.
Or, faute de se situer en zone de développement éolien, les petites éoliennes n’obtiendront pas de certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat et ne pourront donc pas être raccordées au réseau dans des conditions économiques acceptables.
De ce fait, la pertinence économique d’une petite éolienne, déjà très compromise faute d’un tarif spécifique adapté, devient quasiment nulle.
Si le Gouvernement souhaite encourager le développement des énergies renouvelables, pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2020, et faire en sorte que ce développement participe à la revitalisation de l’espace rural, il ne doit pas oublier l’éolien de petite puissance.
Afin de soutenir cette filière, il faudrait éliminer les principaux freins à son développement : exclure les aérogénérateurs de moins de trente-six kilowattheure de la procédure lourde des autorisations réglementaires, supprimer l’obligation qui est faite au petit éolien d’être inclus dans une zone de développement de l’éolien et créer un tarif d’achat adapté au petit éolien.
Monsieur le secrétaire d’État, quelles sont les intentions du Gouvernement ?
Monsieur le sénateur, M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, a présenté le 17 novembre dernier le plan de développement des énergies renouvelables de la France, issu du Grenelle de l’environnement.
Ce programme a pour objectif de porter à 23 % au moins la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole de la production annuelle d’énergie renouvelable.
Comprenant cinquante mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières – bioénergies, éolien, géothermie, hydroélectricité, solaire, énergies de la mer, etc. –, ce programme a pour ambition un changement complet d’échelle, à savoir le doublement de la production d’énergies renouvelables en douze ans, la multiplication de la production par deux pour le bois-énergie, par six pour la géothermie, par douze pour les réseaux de chaleur et par quatre cents pour le photovoltaïque, ce qui correspond à un changement d’échelle majeur.
De surcroît, ce plan sera à haute qualité environnementale : le développement de chaque source d’énergie devra respecter le paysage, le patrimoine, la qualité de l’air et de l’eau ainsi que la biodiversité.
Les mesures qu’il contient trouvent leur traduction dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, qui sera prochainement débattu au Parlement, ainsi que dans la loi de finances pour 2009, la loi de finances rectificative pour 2008 et des textes réglementaires.
En ce qui concerne le petit éolien, le comité opérationnel du Grenelle de l’environnement, auquel ont participé les professionnels des énergies renouvelables, estime que, « outre le fait que les petites éoliennes, même en grand nombre, ne participeraient que fort peu aux objectifs 2020, il reste à conduire de nombreuses études de gisements, de mesures de performance et de longévité sur les matériels, et un travail de fond sur les autorisations d’édifier et d’exploiter pour mettre en œuvre de façon satisfaisante la filière et décrire les moyens de la soutenir ».
Compte tenu de ces conclusions, il a été décidé de ne pas créer un régime d’exception pour les petites éoliennes.
Néanmoins, il convient de noter que, outre le tarif préférentiel d’achat de l’énergie éolienne produite en zone de développement éolien, les petites éoliennes intégrées aux résidences principales peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %.

Je ne vous cache pas ma déception, monsieur le secrétaire d’État. Toutefois, étant donné que vous vous êtes contenté de lire la réponse rédigée par le ministère de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et que vous ne faites que représenter dans cet hémicycle M. Borloo, que l’on voit rarement, je ne débattrai pas plus longtemps avec vous.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet lors de la discussion au Sénat du projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

La parole est à Mme Fabienne Keller, auteur de la question n° 314, adressée à M. le ministre de la défense.

Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais attirer votre attention sur les perspectives préoccupantes de l’Établissement public d’insertion de la défense, l’EPIDE, appelé encore « Défense deuxième chance ».
Je voudrais souligner l’efficacité et la qualité de cet outil pour les jeunes adultes en grande difficulté. Grâce à l’internat, aux enseignements, aux stages professionnels ainsi qu’à l’activité sportive, ils peuvent retrouver un équilibre et un projet de vie. Cette structure doit beaucoup au ministère de la défense, ainsi qu’aux personnels, issus en grande majorité de l’armée française. Je rappelle que l’EPIDE a été créée sur l’initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, lorsqu’elle était ministre de la défense.
Le Gouvernement entend-il confirmer son soutien à ce dispositif, notamment par la coordination entre les trois départements ministériels concernés que sont, respectivement, la défense, l’emploi et la politique de la ville ?
Tout en vous remerciant d’être venu spécialement répondre à ma question – mais je sais qu’elle vous concerne directement –, je voudrais vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur les perspectives de développement de cet établissement public, qui constitue un élément-clef de notre politique de cohésion sociale.
Permettez-moi de m’inquiéter plus particulièrement pour l’établissement de Strasbourg, que j’ai vu se créer et se développer et qui, parmi l’ensemble des dispositifs d’insertion des jeunes, offre une réponse particulièrement adaptée.
Je conclurai mon intervention par un élément d’actualité : le 21 janvier dernier, Mme Geng a, dans un document très intéressant qu’elle a présenté devant le Conseil économique, social et environnemental, souligné la qualité de ce dispositif au regard des grandes difficultés des publics accueillis.
Madame la sénatrice, je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir posé cette question, qui marque votre intérêt, non seulement pour l’établissement de Strasbourg, mais aussi pour l’ensemble du dispositif « Défense deuxième chance » porté par l’Établissement public d’insertion de la défense.
Je vais vous répondre très directement, au nom du ministre de la défense, mais aussi en mon nom propre. Dans mes fonctions de secrétaire d’État, j’ai suivi ce dossier aux côtés de M. le ministre. L’année dernière, j’ai défendu devant le Parlement l’actualisation de ce dispositif et j’ai également assisté voilà quelques jours à la présentation devant le Conseil économique, social et environnemental de l’excellent rapport de Mme Geng, qui a suscité un vif débat auquel j’ai participé. Ce rapport dresse un bilan très précis et très réaliste du dispositif, en même temps qu’il trace des perspectives d’évolution.
Le ministère de la défense, tout comme les deux autres départements ministériels de tutelle de cet établissement public – le secrétariat d’État à l’emploi et le secrétariat d’État à la politique de la ville –, soutient plus que jamais l’idée d’une insertion professionnelle des jeunes, sur une base volontaire, à l’aide d’une pédagogie inspirée du professionnalisme, de la discipline, de la pédagogie et de la connaissance du milieu dont disposent les militaires.
La meilleure preuve de cet intérêt réside dans la validation, au mois de novembre dernier, du premier contrat d’objectifs et de moyens de cet établissement public. Ce premier COM donne à l’établissement la visibilité nécessaire à sa stabilisation sur les trois prochaines années.
Le principe d’un maximum de vingt-deux centres a été réaffirmé. C’est certes frustrant pour ceux qui, comme moi lorsque j’étais maire, ont été candidats malheureux à ce dispositif. Mais nous devons, aussi, être réalistes : ce format pour le moment limité permettra un redéploiement au profit de centres déjà ouverts ou à ouvrir dans des bassins d’emploi et de vie adaptés à l’activité d’insertion professionnelle de jeunes en voie de marginalisation.
Ce dispositif, qui a d’ores et déjà fait ses preuves, nous semble promis à un bel avenir : ce constat, qui est dressé dans le rapport Geng et que vous avez vous-même rappelé à l’instant, madame la sénatrice, est également partagé, sur ces travées comme sur celles du Conseil économique, social et environnemental, par des personnalités dont les sensibilités politiques et syndicales sont très diverses.
Ce dispositif, interministériel, très ouvert mais aussi militaire, dont la création relevait d’une bonne intuition, permet, dans le cadre de la revue générale des politiques publiques, la RGPP, à un certain nombre de militaires, qu’ils soient officiers ou sous-officiers, de prolonger leur carrière en participant à la vie de ces établissements.
Par ailleurs, madame la sénatrice, les premiers résultats obtenus par le centre de Strasbourg confirment, comme vous le suggériez dans votre question, la pertinence de son implantation. L’activité de ce centre sera d’ailleurs progressivement renforcée au cours des prochaines années.
Si ce dispositif fonctionne déjà très bien, il conviendra d’assurer son évolution étape par étape, notamment en fonction des moyens financiers dont nous disposerons.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie très sincèrement de votre implication personnelle dans ce dispositif, sans laquelle ce contrat d’objectifs et de moyens n’aurait peut-être pas pu être bouclé.
Ces centres permettent à des militaires, grâce à leurs compétences, leur expérience et leur savoir-faire, d’effectuer une belle transition professionnelle en même temps qu’ils offrent une opportunité à des jeunes qui, à un moment donné de leur vie, ont suivi des chemins de traverse.
Une fois encore, monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre conviction et de votre volonté politique forte.
Je me dois toutefois de rappeler quelques chiffres. Chaque année, 60 000 jeunes en difficulté sérieuse sont recensés lors des journées d’appel de préparation à la défense, qui constituent une occasion unique de voir l’ensemble d’une génération. Autrefois, 30 000 d’entre eux étaient pris en charge par le service national, ce qui explique que Mme Alliot-Marie ait, à l’époque, fixé un objectif de 20 000 places. Aujourd’hui, un peu plus de 2 000 places sont disponibles. Est-ce vraiment à la hauteur des défis ?
Bien sûr, d’autres dispositifs d’insertion existent, mais ces établissements ont le mérite de donner à des jeunes qui se sont égarés sur des voies peu constructives une nouvelle chance aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. C’est pourquoi je me permets, monsieur le secrétaire d’État, de plaider pour que l’on octroie à ces établissements des moyens complémentaires, et donc des places supplémentaires, à Mulhouse, à Strasbourg et dans la France entière.

La parole est à Mme Claudine Lepage, auteur de la question n° 376, adressée à M. le ministre des affaires étrangères et européennes.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur les vives préoccupations que suscite le devenir des Comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle dans l’Union européenne.
La fermeture évoquée de ces comités consulaires suscite de grandes inquiétudes, exacerbées par la situation économique actuelle.
Ainsi, à titre d’exemple, la fermeture de celui de Munich est envisagée pour 2010, voire dès 2009. Le bilan de ses activités est pourtant très satisfaisant, puisque ce comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle comptabilise cent douze embauches sur l’année 2008, et ce malgré le ralentissement économique déjà perçu depuis le mois de septembre. Son taux de placement est par ailleurs comparable à celui de l’année précédente, pour un coût qui demeure remarquablement bas, environ 300 euros par placement.
On peut s’interroger par ailleurs sur la nécessité de transformer ces comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle, pourtant performants, en structures de type associatif. Cette mutation présente de multiples inconvénients, notamment en termes de coût puisque, à service égal, le budget nécessaire est doublement supérieur.
Par ailleurs, la philosophie même du service, qui évolue vers une logique d’aide à l’entreprise plutôt que d’aide aux candidats, suscite des interrogations et des préoccupations au seuil d’une crise qui risque de durer et qui promet malheureusement une recrudescence de licenciements économiques.
Certes, les demandeurs d’emploi français établis à l’étranger peuvent parfaitement se tourner vers les agences locales pour l’emploi, lorsqu’elles existent. Mais force est de constater que le service offert leur est moins bien adapté. Ainsi, aucune sensibilisation au marché local de l’emploi et à sa spécificité culturelle ne peut leur être proposée. D’ailleurs, ces mêmes opérateurs locaux réorientent très fréquemment nos compatriotes vers les services emploi des consulats, jugés plus appropriés à leur demande d’intégration professionnelle.
En outre, l’avenir des CCPEF provoque la légitime émotion de leurs employés actuels, les conseillers emploi, souvent recrutés locaux de l’État français, qui viendraient, eux aussi, grossir les rangs des demandeurs d’emploi, alors même que les perspectives sont partout très sombres pour les années à venir.
Dès lors, madame la secrétaire d'État, je souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement quant à l’avenir de ces comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle.
Madame la sénatrice, je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer sur le devenir des comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle, qui suscite, comme vous le soulignez, quelques inquiétudes.
Bien que je comprenne l’émoi que vous évoquez, nous ne pouvons toutefois faire l’économie d’une réflexion sur leur évolution, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la citoyenneté européenne et le principe de non-discrimination entre les ressortissants des différents pays de l’Union européenne nous amènent à nous interroger sur ce sujet.
Cette question a été l’un des axes de travail de la présidence française de l’Union européenne. Plusieurs rencontres et enquêtes auprès de nos postes et de nos homologues étrangers ont démontré que seule la France intervenait en matière d’emploi de ses ressortissants.
Sur ce point, certains s’interrogent d’ailleurs sur la validité de nos dispositifs au regard du principe de non-discrimination.
Les résultats de la récente enquête confirment également la bonne application du droit européen à nos compatriotes, notamment en matière d’accès aux services de placement.
En outre, les décisions du conseil de modernisation des politiques publiques en matière de réorganisation de la carte des ambassades et des consulats, qui portent, en particulier, sur un ajustement du réseau consulaire dans l’Union européenne, se traduisent budgétairement par la suppression de six équivalents temps plein sur trois ans dans le domaine de l’emploi.
Enfin, les dotations inscrites au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 conduiront à une forte pression sur les crédits sociaux du département, donc à un nécessaire rééquilibrage de nos moyens sur les zones Afrique–océan Indien–Maghreb en direction du placement et de la formation professionnelle de nos ressortissants binationaux en difficulté d’insertion.
Sur les quarante et un comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle, seize sont implantés dans les pays de l’Union européenne. Ils ont réalisé, en 2007, la moitié des placements recensés sur l’ensemble du dispositif et bénéficié de près de 44, 5 % du montant des subventions allouées par la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle en matière de placements.
À titre indicatif, les subventions attribuées aux autres zones géographiques s’établissent à 30, 6 % pour le continent américain, à 13, 8 % pour l’Asie et à 10 % pour l’ensemble Afrique–Maghreb–Moyen-Orient.
À ce stade, il s’agit surtout de se dégager de l’activité « placement » stricto sensu dans l’Union Européenne, les consulats généraux conservant un rôle de conseil et d’information en direction de nos compatriotes.
Pour les appuyer dans cette tâche, les postes ont été invités à identifier quelques partenaires privés ou publics locaux avec lesquels ils pourraient travailler. Une convention définissant les services attendus pourrait être signée entre le poste et le prestataire.
Les consulats généraux seront également invités à diffuser les informations utiles à nos compatriotes en les mettant en ligne ou en éditant des fascicules. Cette démarche, qui privilégie ainsi le conseil aux candidats, rejoint la préoccupation que vous émettez, madame la sénatrice, de pouvoir compléter l’activité des agences locales de placement par un service de conseils adapté au public français.
Nos ressortissants peuvent également avoir recours au réseau EURES, réseau européen qui a pour objet de faciliter la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange. EURES dispose de sept cents conseillers, intervenant tant auprès des demandeurs d’emploi que des employeurs intéressés par le marché de l’emploi européen. Le service international de l’ANPE et l’Espace emploi international constituent également des partenaires actifs susceptibles d’apporter leur contribution au dispositif de placement à l’étranger.
Permettez-moi ensuite de vous préciser que le recours à des organismes de type associatif s’accompagne d’un allègement des coûts de fonctionnement non négligeable.
Sur les quarante et un CCPEFP, vingt-sept sont hébergés dans le cadre de structures associatives, telles que les chambres de commerce et d’industrie ou les associations tournées vers l’emploi. Le recours aux CCI assure une plus grande proximité avec les entreprises susceptibles de proposer un emploi et permet de réaliser des recettes grâce à la tarification du service rendu aux sociétés, recettes qui s’ajoutent aux crédits consacrés par l’État en matière d’emploi.
La part d’autofinancement progresse régulièrement depuis 2005 : en 2007, 416 000 euros sont venus ainsi s’ajouter aux 549 000 euros de subventions servies par l’État en matière de placements. Par ailleurs, dix-sept chambres ont développé un service de l’emploi sans participation du ministère des affaires étrangères.
Enfin, la situation des agents de droit local est une préoccupation du ministère. Celui-ci s’attachera à organiser les suppressions de poste qui découlent de cette réorganisation en prenant en considération les situations individuelles des personnes concernées et en veillant naturellement à la stricte application du droit local. Le ministère procédera par voie de consultation des CCPEFP de chaque ambassade ou de chaque consulat.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. Permettez-moi de revenir sur deux points.
Tout d’abord, vous avez parlé de la bonne application du droit européen à nos compatriotes. C’est un vœu ! Moi qui ai vécu trente-cinq ans dans différents pays de l’Union européenne, je puis vous dire que ce droit n’est pas toujours respecté. La discrimination est parfois très subtile. Elle porte non pas sur la nationalité, bien sûr, mais, par exemple, sur la langue, dont l’usage est toujours moins aisé pour un non-natif. En matière de formation professionnelle, il existe bien une reconnaissance des diplômes universitaires, mais il n’en demeure pas moins qu’il reste beaucoup plus difficile de faire valider un diplôme obtenu dans un pays tiers, restreignant ainsi les possibilités d’accéder à un emploi.
Ensuite, vous l’avez souligné, la sensibilisation aux spécificités locales de chaque marché de l’emploi est essentielle. Pour ma part, je souhaite que ce service continue d’être offert à nos compatriotes résidant dans l’Union européenne.

La parole est à M. François Rebsamen, auteur de la question n° 366, adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Je souhaite attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le projet de création d’un « Pôle national de la statistique publique », décidée au cours de l’été 2008, sans concertation préalable.
Je m’interroge sur les effets néfastes que cette décision pourrait avoir, d’une part, sur le droit des citoyens, des acteurs économiques, sociaux, syndicaux et politiques à une information objective des réalités économiques et sociales, et, d’autre part, sur l’avenir des directions régionales, notamment celle de Dijon, qui compte aujourd’hui 145 agents.
Présenté, dans un rapport remis au Premier ministre, comme une création et un regroupement, ce projet apparaît plutôt comme un démantèlement d’activités existantes par le transfert de 543 postes, dont 310 seraient issus des directions générale et régionale de l’INSEE et 142 des centres nationaux informatiques.
Or les deux tiers du personnel de l’INSEE travaillent en région pour répondre aux besoins d’expertise des territoires et assurer le suivi des enquêtes. Il me semble incohérent et dangereux d’imposer une délocalisation de tout ou partie des services par une décision unilatérale prise dans l’urgence et sans concertation avec les utilisateurs et les acteurs de la statistique publique.
Par ailleurs, la production de statistiques de qualité repose sur le savoir-faire d’un personnel spécialisé. La délocalisation exposerait l’INSEE à de nombreux départs d’experts en poste, comme l’illustre l’exemple britannique.
Enfin, au début du mois de septembre, le Président de la République annonçait à des élus de Moselle, département le plus touché par les restructurations militaires, des mesures de compensation, dont la délocalisation d’un millier d’emplois de l’INSEE à l’horizon 2011.
L’INSEE éclaire en toute indépendance les grands débats de la société par des études économiques et sociales objectives ; aussi, elle ne doit pas être un moyen de compensation d’autres réformes.
Ce projet, s’il arrivait à terme, menacerait l’existence même de nombreux établissements régionaux, notamment celui de Dijon, qui compte aujourd’hui, je le répète, 145 agents, le rapprochant dangereusement du seuil de viabilité d’un établissement régional, fixé à 80 agents.
Les coûts financiers d’une telle délocalisation, de toute évidence très importants, sont évoqués à de nombreuses reprises dans le rapport, mais les éléments de chiffrage précis ont été supprimés de sa version publique. Aussi, je souhaiterais obtenir plus d’éléments concernant le coût de ce projet et savoir si une évaluation des bénéfices de la délocalisation a été engagée.
Par ailleurs, les mesures d’accompagnement en direction des agents qui ne suivraient pas leur emploi délocalisé, évalués à près de 500, dont le rapport fait mention, pourraient-elles nous être précisées ?
Enfin, cette décision de délocalisation risque de porter atteinte à la qualité et à l’indépendance des travaux de l’INSEE et aux conditions de vie et de travail des agents. Par conséquent, je demande au Gouvernement de revenir sur son projet de délocalisation, qui signifierait le démantèlement d’un service de l’INSEE.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de Christine Lagarde, qui est chargée de ce dossier.
Vous avez bien voulu attirer son attention sur le projet de création d’un pôle national de la statistique publique.
Le Président de la République a souhaité relancer une politique d’implantation d’emplois publics en région, en s’appuyant sur plusieurs principes : d’abord, apporter de l’activité économique à des territoires qui en ont besoin ; ensuite, réduire le coût de gestion des administrations, notamment en matière immobilière ; enfin, réaliser des synergies permettant une meilleure efficacité des services publics.
Compte tenu de la restructuration des forces armées sur notre territoire, le Président de la République a désiré que cette politique s’applique prioritairement à l’agglomération de Metz. En effet, la proximité de cette ville avec l’Office statistique des Communautés européennes ainsi que sa desserte par le TGV ont conduit le Gouvernement à considérer que le service statistique public pouvait contribuer à une opération de délocalisation vers la Moselle.
Le Premier ministre a donc demandé à M. Jean-Pierre Duport, vice-président du Conseil national de l’information statistique, et à M. Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’INSEE, de dessiner les contours d’un tel centre statistique en prenant en compte les quatre objectifs suivants : préserver la qualité de la production du service statistique public ; apporter une véritable valeur ajoutée au fonctionnement des administrations, en exploitant toutes les sources de synergie ; créer à Metz un acteur important du service statistique public et un bassin d’emploi attractif pour les agents ; enfin, faciliter l’installation des agents via les mesures d’accompagnement appropriées.
Le 2 décembre dernier, MM. Duport et Cotis ont transmis leur rapport au Gouvernement. Sur la base de celui-ci, le Premier ministre a décidé, le 15 janvier 2009, la création d’un centre statistique à Metz. Ce centre sera structuré en quatre piliers : les statistiques sociales et locales ; les produits de diffusion ; les ressources humaines ; l’informatique.
Il s’agira d’une implantation de près de 625 postes, dont 500 en provenance du service statistique public – la direction générale de l’INSEE, les directions régionales, les centres nationaux informatiques, la DARES, la DREES – et environ 120 créations sur place, à savoir un centre d’enquêtes téléphoniques et un centre de formation aux statistiques européennes.
La création du mastère de statistiques publiques européennes sera mise à l’étude, au préalable, en lien avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les modalités de mise en œuvre du projet et ses mesures d’accompagnement feront l’objet de concertations avec les organisations représentatives dans les meilleurs délais.
Cette décision constitue une mesure d’aménagement du territoire et une mesure de solidarité nationale envers des régions touchées par la réforme de la carte militaire.
Le Gouvernement restera spécialement attentif à la qualité de la statistique publique ainsi qu’aux personnels du service statistique public, qui remplissent leur mission avec une compétence et un dévouement exemplaires.

Votre réponse ne me surprend pas, madame la secrétaire d’État. Je suis moi-même très attaché, comme tous les habitants du Grand-Est, à la compensation du préjudice subi par Metz du fait du retrait total de plusieurs régiments.
Un rapprochement de l’INSEE et de l’Office statistique des communautés européennes, EUROSTAT, certes envisageable, ne peut néanmoins pas s’effectuer au détriment de l’activité et de l’attractivité de l’INSEE ni, comme l’a souligné le directeur général de l’INSEE, entraver la relation nécessairement étroite qui doit exister entre l’INSEE, les autres services du ministère et la recherche académique.
Madame la secrétaire d’État, vous n’avez pas répondu précisément à ma question – mais je ne vous en veux pas pour autant – concernant le coût qu’entraînerait une telle opération sur les finances publiques, le devenir des personnels et les menaces qui pèsent sur les directions régionales, lesquelles seront fortement mobilisées alors qu’elles contribuent largement à l’expertise des territoires. Les élus locaux travaillent en effet à partir des statistiques qui leur sont fournies par l’INSEE.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants, dans l’attente de M. le secrétaire d’État.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures seize, est reprise à onze heures dix-huit.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, auteur de la question n° 375, transmise à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Monsieur le président, pendant les séances de questions orales, il n’est pas d’usage, ni même prévu par le règlement, de faire un rappel au règlement. Permettez-moi néanmoins d’appeler l’attention du bureau du Sénat sur les conditions dans lesquelles se déroulent ces séances, qui sont l’un des moyens dont disposent les sénateurs pour contrôler l’activité du Gouvernement. Je le dis d’autant plus volontiers que ma question entre dans le champ de compétences de M. Marleix.
Nous venons d’entendre Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l’homme, répondre à une question sur l’avenir de l’INSEE, adressée à Mme Christine Lagarde, qui est pourtant assistée de nombreux secrétaires d’État.
Dans un instant, M. Marleix, secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, répondra à une question importante de M. Fauconnier, portant sur la fermeture de tribunaux, adressée à Mme Rachida Dati.
Je me demande donc si l’on ne se moque pas des sénateurs. Tout cela ne me semble pas très correct !

Je vous donne acte de votre observation, monsieur Michel.
Veuillez poursuivre.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite appeler votre attention sur les conséquences pour les collectivités territoriales de l'application de la loi du 1er février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, la loi impose aux collectivités locales, et aux communes en particulier, de rendre accessibles les bâtiments et les espaces publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite d'ici à 2015.
Cette volonté politique est parfaitement légitime, et j’y souscris sans réserve. Elle correspond à une exigence d'intégration sociale pour celles et ceux que les aléas de la vie placent en situation de handicap.
La solidarité n'a pas de prix, mais elle a un coût, qu'il convient à mon sens de mutualiser. Le conseil général de la Haute-Saône a ainsi décidé d'aider les communes rurales à conduire les études et à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux publics à l'horizon 2015. Les communes doivent en effet supporter des charges de plus en plus lourdes et souvent imposées par l'État : passeports biométriques ou service minimum d'accueil dans les écoles, pour ne citer que deux exemples récents.
Les maires sont donc fortement préoccupés par les dépenses publiques nouvelles que la mise aux normes des bâtiments, trottoirs, voiries impliquera dans les prochains budgets communaux. Ces élus de proximité veulent naturellement concilier respect de la loi, effort de solidarité et modération fiscale. C'est un peu pour eux, disons-le franchement, le triangle introuvable !
En conséquence, monsieur le secrétaire d’État, ne vous paraît-il pas opportun de mettre en place une enveloppe exceptionnelle et bonifiée, dans le cadre de la dotation globale d'équipement, lors des prochaines lois de finances, afin que l'État appuie l'engagement des communes dans leur lutte contre les handicaps ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir excuser mon léger retard. Il est imputable aux travaux qui ont lieu sur le boulevard Saint-Germain et qui rendent la circulation extrêmement pénible. Force est de constater que l’accessibilité au Sénat est de plus en plus difficile.
Sourires
Je vous prie également de bien vouloir excuser l’absence de Mme Alliot-Marie, mais votre question, monsieur Michel, entre dans mon domaine de compétences. J’espère que ma réponse vous conviendra.
Votre interrogation porte sur les difficultés d’application rencontrées par les communes, notamment par les plus petites d’entre elles, de la loi du 11 février 2005 qui vise à rendre effectif l’accès à la cité pour les personnes handicapées. Il est évident que la réalisation de cet objectif impose de nouvelles charges à l’État, aux collectivités territoriales et aux entreprises.
Cette loi n’ouvre pas de droits à compensation, car il s’agit d’une mesure à caractère général. Je suis toutefois très attentif aux charges imposées aux communes par le biais de la réglementation. À cet égard, le Gouvernement est déterminé à mieux associer les collectivités locales à l’élaboration des normes qui les concernent directement.
C’est dans cet esprit que, concrétisant une revendication déjà ancienne, a été mise en place, en septembre dernier, la Commission consultative d’évaluation des normes, la CCEN.
Cette instance est consultée, préalablement à leur adoption, sur l’impact financier des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales.
Le projet de texte présenté à la CCEN est accompagné d’une analyse de ses incidences financières prévisionnelles, directes et indirectes.
Dans le cas précis qui vous préoccupe, la commission a examiné le 8 janvier dernier, donc très récemment, le projet de décret relatif à l’accessibilité et à l’aménagement des lieux de travail. Elle a souhaité différer son avis dans l’attente d’un chiffrage plus précis, pour ne pas dire exhaustif, des incidences financières que j’évoquais voilà un instant. Je veillerai à ce que ses recommandations soient prises en compte, dès lors qu’elles seront compatibles avec les obligations fixées par la loi.
Monsieur le sénateur, je vous rappelle également que la dotation globale d’équipement peut bien entendu être mobilisée pour subventionner les travaux d’accessibilité. C’est d’ailleurs le cas dans la plupart des départements puisque le préfet et la Commission consultative travaillent ensemble sur ces dossiers.
Cependant, je le souligne, les catégories d’opérations prioritaires éligibles à la DGE dépendent des choix arrêtés dans chaque département par la commission d’élus compétente.
Enfin, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009, qui est en cours d’examen devant le Parlement, le Gouvernement a proposé une mesure de soutien à l’investissement local dans le cadre du plan de relance. Le versement anticipé des sommes dues au titre du fonds de compensation pour la TVA constituera une recette supplémentaire importante pour les communes en 2009, dès lors qu’elles auront augmenté leur investissement, ne serait-ce que d’un euro.
Ce retour de TVA anticipé pourrait être utilement mobilisé pour réaliser les travaux d’accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments publics:
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments qu’il me paraissait utile de vous apporter sur ce dossier. Le Gouvernement y attache une grande importance. Il souhaite, comme l’ensemble de nos concitoyens, que les personnes handicapées bénéficient de conditions de vie normales.

La parole est à Borvo Cohen-Seat, auteur de la question n° 357, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Ma question s’adresse en effet à Mme le ministre de l’intérieur, mais, pour une fois, M. Marleix est tout à fait habilité à me répondre.
Avec le vote électronique, les récentes élections prudhommales ont été émaillées de quelques incidents même si, finalement, le scrutin a été validé. Ces événements me conduisent à vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur cette technique de vote qui, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel, peut donner lieu à des incidents risquant d’accroître la réticence psychologique des citoyens et de casser le lien symbolique entre ces derniers et l’acte électoral.
En septembre 2007, le Conseil constitutionnel profite de la remise de ses observations sur les élections législatives de 2007 pour souligner les errements potentiellement inhérents aux machines à voter. Sans se poser en adversaire de principe des ordinateurs de vote, le juge suprême rappelle qu’il a été saisi d’un certain nombre de réclamations portant notamment sur l’impossibilité d’effectuer des tests de bon fonctionnement et d’imprimer des procès-verbaux.
Aucun de ces dysfonctionnements n’a été examiné par le Conseil Constitutionnel, car les écarts de voix entre les candidats ne pouvaient donner lieu à aucun litige ni à aucune contestation. Cependant, la dématérialisation du bulletin constitue une rupture radicale, aux conséquences peu prévisibles sur le processus de vote, dont les risques ne doivent pas être sous-estimés.
Dans le système actuel, le citoyen est impliqué dans le processus électoral, notamment par l’intermédiaire du dépouillement public.
La simplicité du processus de vote est un élément essentiel de la confiance que les citoyens peuvent y apporter. Les innovations techniques concernant le fonctionnement de notre vie démocratique ne doivent pas être subies ; elles doivent être pensées par et pour l’ensemble de la société. C’est pourquoi je considère qu’un large débat public s’impose sur ce sujet.
Monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous m’indiquer si vous envisagez d’engager un tel débat avant les prochaines échéances électorales ?
Madame le sénateur, vous avez interrogé Mme le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les dysfonctionnements survenus à Paris lors du vote électronique aux récentes élections prud’homales ainsi que sur l’utilisation du vote électronique en général.
Notre département ministériel n’étant pas chargé de l’organisation des élections professionnelles – c’est le ministère du travail qui est concerné –, je ne me prononcerai pas sur la nature des difficultés rencontrées lors des dernières élections prud’homales.
Il n’en est pas moins vrai que le vote électronique représente un enjeu pour le fonctionnement de la vie démocratique, dans une société qui a vu, ces dernières années, une diffusion croissante des outils numériques.
À l’heure actuelle, les machines à voter représentent en matière de vote électronique la seule alternative utilisée pour les élections politiques.
À la suite des problèmes rencontrés lors de l’élection présidentielle de 2007 a été constitué un groupe de travail qui a procédé à une série d’auditions de façon à recueillir un maximum d’opinions sur le vote électronique.
Dans un rapport rendu dans le courant du premier trimestre de 2008, cette instance a estimé qu’il fallait continuer à utiliser les machines à voter, tout en recommandant de modifier certaines dispositions législatives et réglementaires ainsi que le règlement technique qui leur est applicable.
Ces adaptations sont en cours de réalisation et pourraient être insérées dans un projet de loi relatif à la modernisation de la vie démocratique locale, projet qui est déjà dans les cartons du ministère de l’intérieur et qui pourrait être, je l’espère, soumis au Sénat et à l’Assemblée nationale avant la fin de l’année.
Les travaux de révision du règlement technique ont également été engagés avec le secrétariat général de la défense nationale.
Par ailleurs, au cours des débats qui se sont déroulés devant les deux assemblées sur le « paquet électoral » – vous étiez présente, madame le sénateur –, la question du recours au vote par Internet pour l’élection des députés des Français de l’étranger, nouvelle catégorie de députés, a été soulevée à plusieurs reprises.
Là encore, je considère que la réflexion doit être menée rapidement. Je m’y suis personnellement engagé lors de la discussion parlementaire, notamment dans cet hémicycle. Les acteurs concernés, notamment le bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger, les associations qui les représentent et, bien entendu, les parlementaires, seront consultés et participeront à cette réflexion. Le débat sur ce sujet au Sénat a d’ailleurs été particulièrement dense, riche et intéressant.
La fiabilité des systèmes, leur intégrité et leur sécurité, ainsi qu’un niveau élevé de transparence sont nécessaires, chacun en conviendra. Nous avons donc besoin d’un débat objectif, c’est-à-dire éclairé par des avis techniques et scientifiques de haut niveau.
Tel est le sens de l’action politique qui sera conduite dans ce domaine, avec le souhait d’avancer sur ce dossier. Il n’est pas concevable, en effet, dans une société comme la nôtre, où les nouvelles technologies de l’information et de la communication se sont largement développées et se développeront encore dans les prochaines années, d’en rester à des modes de votation qui peuvent aujourd’hui paraître un peu désuets et obsolètes.
Donc, comme vous le souhaitiez, madame le sénateur, la concertation va se poursuivre.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Il est vrai qu’avec l’évolution des nouvelles technologies les pratiques anciennes n’ont plus lieu d’être. Mais, dans le même temps, on a constaté que le vote électronique n’était pas un facteur de plus grande participation électorale.
Vous savez certainement ce que la fédération des Associations françaises des sciences et des technologies de l’information pense du vote anonyme.
La question mérite un réel débat. J’espère que nous pourrons l’avoir au Parlement, afin de trouver un bon équilibre entre technologie et démocratie.

La parole est à M. Alain Fauconnier, auteur de la question n° 372, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Comme je l’ai souligné dernièrement dans cet hémicycle, lorsque je me suis adressé à vous, monsieur le secrétaire d’État, à propos de la gendarmerie – je tiens d’ailleurs à vous remercier, car la concertation que nous attendions depuis longtemps a eu lieu –, le sud du département de l’Aveyron a connu ces dernières années l’amputation brutale d’un certain nombre des services publics dont il jouissait jusque-là.
Je sais bien qu’il n’est pas le seul à subir les effets d’une politique purement comptable menée par le Gouvernement. Mais la répétition des attaques contre l’hôpital, les écoles, la poste, la Banque de France, les trésoreries ou la gendarmerie font que, à la longue, les élus, au demeurant de sensibilité différente, tout comme la population, finissent par dire : « trop c’est trop ! ».
La charge est aujourd’hui menée contre la justice.
Au terme d’un processus engagé voilà deux ans sans raison aucune, sans concertation, je tiens à le préciser, et d’une manière toute souveraine, Mme la garde des sceaux a décrété, entre autres, la suppression du tribunal de grande instance de Millau et celle du tribunal d’instance de Saint-Affrique, cité dont j’ai l’honneur d’être le maire, et ce malgré les conséquences extrêmement néfastes pour l’accomplissement de la vie judiciaire.
En témoigne, par exemple, un fait divers tout à fait actuel : l’arrestation, voilà quelques jours, d’un criminel à Millau, dont le tribunal instruit actuellement le dossier. Après la fermeture du tribunal, à quelle juridiction – celle de Rodez, de Montpellier, de Toulouse… – échoira cette mission, avec tout ce que cela impliquera de perte de temps et d’argent ? Dans un territoire particulièrement vaste, les gendarmes requis pour encadrer le prévenu passeront leur temps sur les routes, à moins que ce ne soit le juge d’instruction qui se déplace en permanence, s’il reste encore un juge d’instruction !
Quoi qu’il en soit, en attendant la réponse aux légitimes recours déposés par les élus de quarante petites villes de France devant le Conseil d’État, la fermeture des tribunaux de Millau et de Saint-Affrique devait initialement être effective le 1er janvier 2011 ce qui, à défaut de satisfaire les populations, les professionnels et les élus, leur laissait au moins un peu de temps pour se préparer. Or, récemment, ces derniers ont appris que, finalement, par une nouvelle décision aussi régalienne que la précédente, et assortie d’aucune explication, cette fermeture vient d’être avancée au 1er octobre 2009, c’est-à-dire dans moins de dix mois.
Ma première question est donc la suivante : qu’est-ce qui a motivé cette nouvelle décision, tout droit sortie du « bon plaisir » de l’Ancien régime ? Qui l’a prise, et dans quel but ?
Par ailleurs, le Gouvernement ne ferait-il pas mieux d’instituer un moratoire des services publics avant toute fermeture de l’un d’entre eux, afin que la nation ne se délite pas davantage ? Au lendemain de la crise, les services publics sont plus que jamais nécessaires !
Monsieur le sénateur, Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, vous prie de bien vouloir l’excuser, car elle est actuellement retenue par la séance solennelle d’ouverture de la Cour des comptes.
Vous avez souhaité l’interroger sur la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire dans le département de l’Aveyron, et particulièrement sur le projet de fermeture anticipée du tribunal de grande instance de Millau et du tribunal d’instance de Saint-Affrique.
Comme vous le savez, la révision des implantations judiciaires a vocation à prendre effet pour tous les tribunaux d’instance le 1er janvier 2010 et pour tous les tribunaux de grande instance le 1er janvier 2011.
Toutefois, il importe que cette réforme se mette en place de manière progressive et échelonnée tout au long de l’année. Un certain nombre d’inconvénients, que vous avez relevés, existent. Mais les juges d’instruction peuvent parfaitement se déplacer, sans déchoir pour autant.
Lorsque les situations individuelles de chacun des agents concernés par la réforme sont réglées et que l’infrastructure immobilière de la juridiction de rattachement est jugée satisfaisante pour permettre l’accueil de la juridiction regroupée, la date du transfert de l’activité peut être avancée, sur la proposition des chefs de cours d’appel, après avis des assemblées des juridictions concernées, des structures locales de dialogue social et des auxiliaires de justice.
C’est le cas du tribunal de grande instance de Millau, dont la suppression pourrait intervenir dès le 1er octobre 2009. Pour cette juridiction, les services de la Chancellerie se sont assuré que toutes les conditions utiles à la réalisation de la fermeture anticipée étaient réunies et ont procédé aux consultations nationales nécessaires. Un projet de décret permettant cette anticipation est en cours de signature.
En revanche, le reclassement des fonctionnaires du tribunal d’instance de Saint-Affrique, ville qui vous est chère, n’ayant pas encore trouvé de solution, il n’est pas, en l’état, envisagé de modifier la date de suppression de cette juridiction, fixée par le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 au 1er janvier 2010.

Je ne suis pas surpris de la réponse de M. le secrétaire d’État. Bien entendu, elle ne me satisfait pas ; elle est même inacceptable.
La décision de fermer les tribunaux en 2011 n’a fait l’objet d’aucune concertation ; je l’ai redit à Montpellier à Mme Rachida Dati. Quand le président du tribunal de grande instance de Montpellier est venu à Saint-Affrique pour annoncer la réforme au personnel, je me trouvais à la mairie, mais je ne l’ai jamais vu, ce qui est tout de même un peu fort ! Maintenant, la date est avancée de neuf ou dix mois ! Le bâtonnier de Millau aurait fait, semble-t-il, une déclaration en disant qu’il y était favorable. Or il n’y a eu aucune réunion des avocats, et ceux-ci ont fortement protesté contre cette déclaration.

La parole est à M. Michel Houel, auteur de la question n° 350, adressée à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

a cystite interstitielle est une maladie inflammatoire chronique de la vessie extrêmement douloureuse, qui débute en moyenne entre trente et quarante ans et touche essentiellement les femmes. Plus fréquente qu’on ne le croit, elle se caractérise par un besoin urgent et très fréquent d’uriner avec des douleurs au niveau du bas-ventre.
Le manque d’autonomie qui en découle peut avoir des conséquences importantes sur la vie professionnelle, sociale et familiale. En effet, les patients doivent adapter leur mode de vie. L’impact psychologique est considérable : plus de 50 % d’entre eux sont déprimés et le taux de suicide est quatre fois plus élevé que pour le reste de la population. Une étude épidémiologique a également montré qu’une majorité de malades ne pouvaient plus travailler à temps plein et que leur qualité de vie est comparable à celle des dialysés.
Le décret du 3 mars 2008 facilite la prise en charge des patients souffrant de maladies rares ou graves, et le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, développé en 2007, a pour objet de garantir une offre de soins initiale de qualité afin de limiter la perte d’autonomie.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ces avancées tout à fait notables. Néanmoins, monsieur le secrétaire d’État, cela ne suffit pas : ces malades subissent un handicap quotidien ; ils ne peuvent, en effet, marcher ou rester debout très longtemps, ou encore demeurer en position assise.
Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d’État, de prendre les mesures afin que ces malades puissent disposer, tout simplement, d’une carte officielle de priorité pour personnes handicapées, et qu’ainsi leur invalidité soit reconnue.
Monsieur le sénateur, vous interrogez Roselyne Bachelot-Narquin sur la question de la cystite interstitielle, la CI.
Cette maladie provoque d’intenses douleurs ainsi que des mictions fréquentes et urgentes de jour comme de nuit, et évolue par poussées. La prévalence de la CI est mal connue en France ; on estime qu’elle touche 1 femme sur 1 000.
Le diagnostic de la CI est dit « d’exclusion » ; il doit être établi dans une consultation spécialisée d’urologie. La prise en charge thérapeutique optimale est multidisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle doit associer des mesures hygiéno-diététiques, un traitement médicamenteux et/ou neurophysiologique, des instillations vésicales et des séances de kinésithérapie.
Le décret n° 2008-211 du 3 mars 2008 organisant le dispositif de « prise en charge à titre dérogatoire de certaines spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations », en principe non remboursés, pour des patients souffrant de maladies rares ou graves, a permis de garantir aux patients une meilleure prise en charge, ce dont il faut se réjouir.
Une demande de carte d’invalidité est instruite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au sein de la maison départementale des personnes handicapées. Cette carte est traditionnellement délivrée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, bénéficiaire d’une pension d’invalidité classée en troisième catégorie par la sécurité sociale.
Il revient donc aux patients malheureusement atteints d’effectuer la demande de carte d’invalidité, qui sera attribuée au regard du handicap estimé lors de l’instruction du dossier.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. C’est la première fois que l’on nous indique qu’il est possible d’obtenir cette carte d’invalidité auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Vous comprenez qu’il est tout de même désagréable pour une personne atteinte de cette maladie, si tout à coup elle a besoin d’aller aux toilettes, de devoir entrer dans un café et de consommer, même si elle ne boit pas, pour ne pas avoir à se justifier, ou d’exposer ses soucis de santé au patron qui lui demande où elle va. Je crois important que ces personnes aient la carte de handicapé.

La parole est à M. Alain Gournac, auteur de la question n° 361, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Je souhaite aborder un sujet qui me paraît extrêmement important : le bruit à l’hôpital.
Le Sénat s’est beaucoup battu, aux côtés de Lucien Neuwirth, pour la lutte contre la douleur à l’hôpital. Il semble qu’il faille aujourd’hui mener un nouveau combat – certes sans lien direct avec le précédent – pour qu’enfin il ne soit plus impossible, ou presque, de dormir, la nuit, à l’hôpital.

Il ne s’agit en rien de mettre en cause le personnel, qui, tout le monde s’accorde à le reconnaître, est remarquable et réalise un travail formidable.
C’est sans doute quand on est hospitalisé – donc malade ! –, que l’on a le plus grand besoin de silence pour dormir.
Cette nuit, j’ai accompagné l’un de mes amis à la mort ; j’étais présent avec lui à l’hôpital : les portes qui claquent, les chocs lors des déplacements de brancards, les roulettes de chariot qui grincent, l’occupant d’une chambre voisine qui écoute la radio, les bruits de chaussures, des équipements médicaux, des conversations – de ce point de vue, chacun de nous est responsable quand il va à l’hôpital –, les personnels qui s’interpellent en urgence dans les couloirs – « Va au 6 ! Vite ! » –, la relève des équipes se passant les consignes… Il y avait même des visiteurs bavardant devant la porte de la chambre ; je croyais qu’il n’y avait pas de visites la nuit !
Et le lendemain matin, alors que le malade, après avoir mal dormi, essaye de récupérer, a lieu ce qu’un ancien ministre de la santé avait plaisamment appelé « l’intéressante pratique de la distribution des thermomètres à six heures du matin » !
Je le répète, il ne s’agit absolument pas de mettre en cause le personnel, qui est admirable. Mais, monsieur le secrétaire d’État, je vous prie de transmettre ma demande à Mme le ministre de la santé : il faut que nous essayions, dans la mesure du possible, d’éviter la plupart de ces bruits ; il sera sans doute difficile de les éliminer tous, mais nombre d’entre eux sont sans doute aisés à supprimer. Peut-être le personnel, qui n’est pas toujours en nombre et doit agir vite, ne se rend-il pas compte de l’effet de ces bruits sur les malades, qui, du fait de leur faiblesse, de leur fatigue, de la passivité que celles-ci induisent, ne disent rien.
J’ai tenu la main de mon ami jusqu’à son décès, à sept heures du matin : je peux vous dire exactement comment s’est passée la nuit !
Monsieur le secrétaire d’État, c’est à nous qu’il revient de prendre en compte, avec sérieux, le bruit la nuit à l’hôpital. Et si je ne mentionne que l’hôpital, c’est parce que je me limite à ce que j’ai vécu ; d’autres institutions sont probablement concernées aussi.
Nous devons absolument nous fixer un objectif à moyen terme, commencer par établir une liste des bruits faciles à éviter, puis élaborer un plan, comme nous l’avons fait dans d’autres domaines, pour atteindre une qualité de vie qui soit la moins mauvaise possible et, peu à peu, parvenir à supprimer tous ces bruits qui résonnent si fort aux oreilles d’un malade, d’un opéré, bref, d’une personne en situation de détresse.
M. René-Pierre Signé applaudit.
Monsieur le sénateur, vous interrogez Roselyne Bachelot-Narquin sur les mesures à mettre en œuvre afin de limiter les désagréments liés au bruit dans l’hôpital.
Cette question fait l’objet d’une attention constante au sein des établissements de santé. Des solutions techniques et de construction existent pour réduire les nuisances sonores, et des opérations de sensibilisation ont également été menées auprès du personnel. En effet, des actions de formation continue du personnel, notamment paramédical, sont régulièrement conduites afin d’améliorer la prise en charge du malade en termes, notamment, d’accueil, de propreté et de bruit.
Le 25 avril 2003, un arrêté consacré au bruit dans les établissements de santé a été signé afin de préciser quelles règles doivent s’appliquer pour limiter le bruit. Y sont précisément définis les seuils et exigences concernant l’isolement acoustique entre les différents types de locaux dans un hôpital.
La circulaire d’application précise en outre les dispositifs à mettre en œuvre afin d’atténuer les bruits extérieurs liés à la vie normale de l’établissement, tels que le passage des véhicules d’urgence, l’atterrissage ou le décollage d’hélicoptères, les livraisons, la collecte des déchets, et, pour les chariots et les lits, les chocs lors des déplacements.
Ces exigences sont également précisées pour les isolements à prévoir vis-à-vis de l’extérieur.
Le code de la santé publique dispose que chaque établissement de santé doit procéder à une évaluation régulière de la satisfaction de ses patients. Les questions portent notamment sur les conditions d’accueil et de séjour. Un livret d’accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé est par ailleurs remis à chaque patient.
Un indicateur important porte sur l’absence de nuisances diverses telles que le bruit, l’éclairage ou les odeurs. C’est un objectif prioritaire pour rendre compte de la satisfaction des patients.
Comme vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, la qualité de la prise en charge globale des patients est une préoccupation constante de l’ensemble des acteurs de santé.

Qui se plaint a peur des représailles ! On sait comment cela se passe !

Monsieur le secrétaire d’État, je vous ai écouté avec attention, et je sais que vous dites vrai. Néanmoins, j’appelle, sincèrement, à une évaluation de toutes les mesures qui ont déjà été prises.
Certes, des dispositions figurent dans le code, un arrêté a été pris, une circulaire d’application a été publiée, mais il devrait tout de même être facile de procéder à une évaluation ! Je n’ai même pas évoqué les hélicoptères, je m’en suis tenu aux bruits provenant du service lui-même. Il ne doit pas être très compliqué d’éliminer le bruit des portes qui claquent sans fin ! Tout ce qui a été fait est très bien, monsieur le secrétaire d’État ! S’agissant du livret d’accueil, je le connais par cœur ; j’en ai un sur moi, je peux vous le montrer ! Je continue néanmoins de penser que nous devons nous fixer un objectif global pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroule la nuit à l’hôpital, même si, bien évidemment, la situation n’est pas catastrophique à proprement parler.
Je le répète, monsieur le secrétaire d’État, la personne malade, qui vient d’être opérée, qui est faible, doit absolument avoir la possibilité de dormir la nuit. Sans cela, elle va somnoler dans la journée et elle aura d’autant plus de difficulté à dormir la nuit suivante.
C’est un appel que je lance, je ne demande rien d’autre ! Et j’espère, mes chers collègues, ne pas être hospitalisé trop vite : c’est donc plutôt pour les autres que je souhaite que nous nous engagions dans cette démarche.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, auteur de la question n° 374, transmise à Mme la ministre de la santé et des sports.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le secrétaire d’État chargé des sports, mes premiers mots seront pour regretter l’absence de Mme la ministre de la santé. Mais il est vrai que la situation des vieux migrants exige d’eux un véritable sport !
Sourires.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je souhaite vous interpeller sur la situation des vieux migrants, ces personnes âgées que l’on nomme affectueusement les « chibanis ». Ils ont pour la plupart travaillé vingt, trente ou quarante ans en France, pour des salaires très bas et dans des conditions qui laissent souvent des traces sur leur santé.
À l’heure de la retraite – quand ils ont la chance d’y arriver –, ils se trouvent confrontés à des difficultés importantes liées aux allers-retours entre ces deux pays avec lesquels ils ont des liens très forts : leur pays de résidence, où ils ont toujours vécu, et leur pays d’origine.
En effet, même s’ils continuent à résider régulièrement en France, ces migrants, une fois à la retraite, se rendent souvent dans leur pays d’origine pour un mois, deux mois, parfois davantage. Ces allers-retours sont nécessaires au maintien des liens familiaux dans le pays, et importants pour la conservation de leurs droits dans leur pays de résidence.
Or plusieurs associations qui accueillent les chibanis, les médecins qui les suivent, nous ont alertés sur la précarité de leur situation et les problèmes administratifs qu’ils vivent : en raison de ce « nomadisme » ces vieux migrants perdent le bénéfice de nombreuses prestations sociales. Ces populations vulnérables, particulièrement fragiles, connaissent en particulier des difficultés d’accès au logement, d’accès aux soins, d’accès aux droits sociaux.
En matière de logement, tout d’abord, les migrants ne peuvent s’absenter de leur domicile plus de trois mois s’ils veulent pouvoir bénéficier de l’allocation logement ; tout séjour d’une durée supérieure entraîne la suspension de leur allocation.
Dans le domaine de la santé, ensuite, l’accès aux produits pharmaceutiques n’est pas le problème le moins important. En effet, en raison d’instructions données aux pharmacies par les caisses d’assurances-maladie, ces migrants ne peuvent obtenir de traitement pour une durée supérieure à un mois. De ce fait, les migrants malades – et ils sont nombreux – suivant un traitement pour une maladie chronique ou une infection de longue durée ne peuvent voyager plus d’un mois. Même quand leur ordonnance est renouvelable trois mois, ils sont obligés de revenir pour pouvoir se procurer leurs médicaments, alors qu’ils pourraient bénéficier de leur traitement pour au moins un trimestre, ce que les pharmacies leur refusent. Parce que le voyage est onéreux, ces migrants préfèrent parfois interrompre leurs soins pendant un temps. Tout cela a de graves conséquences sur leur santé, voire aggrave leur pathologie.
Ces retraités, compte tenu des conditions de vie et de travail qu’ils ont connues pendant toute leur existence, sont beaucoup plus fragiles que d’autres. Ainsi, les travailleurs migrants souffrent dès l’âge de cinquante-cinq ans de pathologies que l’on ne rencontre chez les Français que parmi les personnes de vingt ans plus âgées.
En termes de droits sociaux, enfin, il faut noter que de nombreux migrants, ayant travaillé toute leur vie à de très bas salaires, bénéficient en France du minimum vieillesse ou d’une retraite complémentaire. Or, pour pouvoir toucher ces prestations, ils doivent résider en France de manière stable et continue, ce qui est incompatible avec le mode de vie qu’ils adoptent une fois à la retraite et les nombreux allers-retours qu’il comporte. On leur demande de produire leur passeport pour constater qu’il n’y a pas eu d’absence de plus de deux mois, ce qui me semble un contrôle abusif lorsqu’ils ont une carte de résidence « retraité ».
Les caractères de stabilité et de continuité de l’obligation de résidence sont à leur égard inadaptés et constituent pour eux un obstacle sévère. On leur propose parfois une indexation de leur retraite complémentaire sur la monnaie de leur pays d’origine ; mais alors, ils doivent diviser leur pouvoir d’achat par dix !
Tout cela m’amène à souligner que l’obligation de résidence régulière ne doit pas être considérée comme une obligation de résidence continue, afin qu’il puisse être tenu compte des pratiques de vie, des va-et-vient entre le pays d’origine et le pays de résidence.
Je souhaite donc savoir quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour garantir le droit d’accès effectif de ces personnes hautement vulnérables au logement, aux soins, aux prestations sociales. Ne pense-t-il pas que ces personnes ont suffisamment cotisé, par leur travail en France, pour pouvoir obtenir, notamment, le droit à la santé et aux soins lorsqu’ils sont à la retraite ?
Madame la sénatrice, vous avez bien voulu appeler l’attention de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, sur la situation des « chibanis », qui sont des ressortissants des pays du Maghreb venus en France dans les années soixante-dix pour y travailler.
Ces personnes sont désormais retraitées. Elles vivent en France, mais effectuent de fréquents allers-retours entre la France et leur pays d’origine, notamment pour rejoindre les membres de leurs familles qui y demeurent toujours.
Vous indiquez que ces allers-retours ont pour conséquence la perte de certains de leurs droits sociaux, notamment au regard de leur retraite et des allocations logement. En outre, ceux qui souffrent de maladies chroniques seraient contraints de revenir très fréquemment en France dès lors que les prescriptions médicales ne sont données que pour une durée limitée à un mois.
Votre question appelle trois observations.
Tout d’abord, concernant les droits à la retraite, il est important de préciser que ces migrants ont, pour la quasi-totalité d’entre eux, exercé une activité professionnelle en France. Ils perçoivent à ce titre une pension contributive de la part des régimes de retraite de base et complémentaire. Cette pension contributive, qui est la contrepartie des cotisations versées, est « exportable », c’est-à-dire qu’ils peuvent continuer à la percevoir dans son intégralité quel que soit le pays dans lequel ils résident.
Toutefois, comme vous l’indiquez, un certain nombre d’entre eux perçoivent de petites retraites en raison soit de carrières incomplètes, soit de salaires souvent faibles. En conséquence, ces personnes se voient allouer, en complément de leur pension contributive, une allocation différentielle dans le cadre du minimum vieillesse.
Il est important de rappeler que la prestation non contributive que constitue le minimum vieillesse est subordonnée à une condition de ressources et à une condition de résidence. Cette prestation exprime la solidarité de la nation à l’égard des personnes qui perçoivent en France de faibles retraites. Le montant de cette prestation a donc été fixé à un niveau permettant aux intéressés de vivre décemment sur notre territoire.
Ces prestations n’ont pas vocation à être exportables et ne sont donc pas versées aux personnes qui quittent durablement le territoire français. Ce principe de non-exportation des prestations non contributives n’est pas propre aux chibanis.
Ensuite, concernant les allocations logement, pour prétendre bénéficier d’une aide, il faut pouvoir justifier d’une résidence de huit mois sur le territoire français. En cas de résidence à l’étranger de plus de quatre mois, ces personnes ne peuvent plus prétendre au bénéfice des aides au logement.
Pour prendre en compte la situation des anciens salariés hébergés en foyers de travailleurs migrants ou en résidences sociales et dont les retraites contributives sont très faibles, l’article 58 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a permis de créer une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine.
Cette aide est ouverte aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, vivant seuls et âgés d’au moins soixante-cinq ans, qui justifient d’une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze ans précédant la demande d’aide et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d’origine. Elle a pour but de compléter leurs ressources afin qu’ils puissent, s’ils le désirent, retourner régulièrement dans leur pays d’origine.
Compte tenu toutefois des difficultés juridiques complexes, soulignées par le Conseil d’État, que soulèvent les modalités d’application de cette mesure, le Gouvernement privilégie une mise en œuvre de ce dispositif par voie d’accords bilatéraux avec les pays les plus concernés.
En dernier lieu, s’agissant de la délivrance de traitements pour les patients malades chroniques, il est vrai qu’en règle générale les pharmaciens n’ont pas le droit de délivrer de médicaments pour une durée supérieure à un mois. Cette limitation résulte non pas d’une instruction de la Caisse nationale d’assurance maladie, mais de l’application de l’article L. 5123-7 du code de la santé publique, édicté pour des raisons de santé publique et pour éviter tout gaspillage.
Toutefois, des exceptions existent, en particulier pour la délivrance de médicaments en grands conditionnements, dans le cas d’un traitement de trois mois pour une pathologie chronique, l’hypertension artérielle notamment. Le Gouvernement est d’ailleurs favorable au développement des prescriptions de ces grands conditionnements, plus économiques pour le patient et l’assurance maladie.
En outre, une circulaire de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés autorise les caisses à prendre en charge les médicaments des assurés qui sont obligés de se rendre à l’étranger pour des durées supérieures.
Comme vous pouvez le constater, madame la sénatrice, le Gouvernement est mobilisé sur cette question et met en place les dispositifs adaptés, qui répondent, je l’espère, à vos légitimes préoccupations.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Vous oubliez malheureusement de dire, concernant le droit à la retraite, que la pension reçue exploitable est souvent divisée par dix, ce qui restreint énormément le pouvoir d’achat.
Concernant l’allocation logement, la condition de résidence suppose une durée de huit mois consécutifs. Nous souhaitons que l’interruption de cette durée puisse être comprise entre deux et quatre mois, et non plus inférieure à deux mois. Ainsi, cette interruption pourra intervenir en une seule fois.
S’agissant des soins, nous regrettons que l’exception prévue puisse être admise seulement par le biais d’une autorisation spéciale, très difficile à obtenir. Nous demandons au Gouvernement, dans ce type de cas, de bien vouloir adresser une circulaire aux caisses d’assurance maladie, ou bien aux pharmaciens, afin que cette autorisation puisse être obtenue plus facilement.

La parole est à M. François Patriat, auteur de la question n° 365, transmise à M. le secrétaire d’État chargé des sports.

J’associe à ma question mes collègues et amis René-Pierre Signé et Didier Boulaud, ainsi que Marcel Charmant, président du conseil général de la Nièvre, qui est présent dans les tribunes.
Depuis le mois de novembre, la région Bourgogne, comme d’autres régions touchées par la crise, perd environ 100 emplois par jour. Près de 3 000 suppressions d’emplois sont annoncées sur le territoire bourguignon, auxquelles il faut ajouter la suppression de 1000 emplois intérimaires.
Le Sénat va entamer aujourd’hui l’examen du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dont vous connaissez les grandes lignes, monsieur le secrétaire d’État. Or, vendredi dernier, alors même que cette question orale relative au circuit de Formule 1 de Nevers Magny-Cours était prête depuis longtemps, une goutte d’eau a fait déborder le vase : lors de la discussion du projet de loi relatif au plan de relance, le Sénat a adopté au cours de sa séance publique du soir, un amendement visant à simplifier les procédures d’installation d’un nouveau circuit homologué de Formule 1 à Flins-sur-Seine, dans les Yvelines. Cet amendement a été déposé, de surcroît, par des sénateurs des Bouches-du-Rhône et de la région Poitou-Charentes.
Or, actuellement, aucun des membres du Gouvernement – vous êtes venu à Magny-Cours, monsieur le secrétaire d’État, je vous ai rencontré – n’a répondu à nos questions sur la poursuite éventuelle d’un grand prix de Formule 1 sur ce circuit, qui présente pourtant l’avantage d’être déjà construit ; il est d’ailleurs à l’origine de la création d’une technopole de recherche et de technologie liées à l’automobile de 425 emplois. J’ajoute que la Nièvre compte 3 250 emplois liés à la filière automobile. Le circuit de Nevers Magny-Cours génère également 30 millions d’euros de retombées économiques dans un département qui est déjà sinistré.
En outre, la région, le département et l’État ont financé une école formant des ingénieurs spécialisés dans le secteur de l’automobile – l’Institut supérieur de l’Automobile et des transports, l’ISAT –, installée à Nevers Magny-Cours, à côté de la technopole de recherche, et associée au Polytechnicom de Bourgogne ; cette école comptera bientôt 500 élèves.
Pensez-vous vraiment, monsieur le secrétaire d’État, que l’annonce de l’arrêt du Grand Prix de France de Formule 1 à Magny-Cours sera de nature à pérenniser cette activité économique nécessaire, voire indispensable, à la région ?
Pensez-vous qu’une telle décision, prise dans la période actuelle, où il est si difficile de trouver des fonds publics, et autorisée subrepticement par l’État – M. Devedjian a dit ici même que l’amendement avait reçu le soutien du Premier ministre ! – permettra de réduire la dépense publique ?
La construction d’un nouveau circuit coûtera entre 120 et 150 millions d’euros, alors qu’il en existe déjà un, de surcroît « grenellement compatible », qui ne suscite aucune opposition de la part des populations locales, qui présente l’avantage d’être accessible, et dont les collectivités locales entendent poursuivre l’aménagement. Je vous rappelle que, lors des deux derniers Grands Prix, le conseil général de la Nièvre et la région Bourgogne avaient investi 3 millions d’euros chacun et que l’État devait verser 300 000 euros. Or l’État n’a pas honoré sa promesse pour le dernier Grand Prix.
À aucun moment, le Gouvernement n’a fait de déclaration de nature à nous soutenir et à maintenir le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit de Nevers Magny-Cours en 2009 et 2010.
J’attends aujourd’hui votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
M. René-Pierre Signé applaudit.
Monsieur le sénateur, vous interrogez M. le Premier ministre sur l’avenir du Grand Prix de France de Formule 1 et, plus particulièrement, sur celui du circuit de Magny-Cours, dans la Nièvre.
Il me semble tout d’abord nécessaire de préciser que la décision d’inscrire ou non au calendrier de la saison internationale une épreuve telle que le Grand Prix de France de Formule 1 relève de la compétence exclusive de la Fédération française de sport automobile. Celle-ci, agissant en tant que fédération sportive, mais aussi en tant que promoteur de l’épreuve, a décidé en octobre dernier de renoncer à l’organisation d’un Grand Prix de France en 2009.
Comme secrétaire d’État chargé des sports, je regrette, bien sûr, que cette épreuve ne puisse être organisée en 2009, mais je comprends aussi les raisons qui ont conduit la fédération à cette décision.
Ainsi que vous le savez, en dépit d’une brève période favorable, en 2006 notamment, et de l’aide apportée par les collectivités territoriales, l’organisation de l’épreuve à Magny-Cours s’est avérée structurellement déficitaire. Cela explique du reste que la Fédération française de sport automobile ait accepté en 2005, pour sauver l’épreuve, d’assumer les responsabilités de promoteur, ce qui n’entre pas dans le cadre de ses missions habituelles.
Les déficits d’exploitation constatés par la fédération depuis deux ans risquaient de compromettre sa santé financière et la réalisation de ses autres actions. En outre, l’augmentation annuelle des droits versés contractuellement à l’organisateur sur le plan mondial, M. Ecclestone, ne permettait pas d’espérer une inversion de cette tendance.
Par ailleurs, M. Ecclestone a fait part de son souhait de quitter le circuit de Magny-Cours pour des raisons qui le regardent. Il est donc très vraisemblable qu’il n’aurait pas renouvelé, à son terme, son contrat avec la fédération.
C’est dans ce contexte que la fédération a exploré en 2008 toutes les solutions permettant le maintien du Grand Prix de France dans des conditions économiquement viables. Des projets très divers, dont celui de Magny-Cours 2 et plusieurs autres en région Île-de-France, ont été présentés ; ils doivent encore être approfondis.
Le Gouvernement est sur la même ligne et cherche à faciliter toute démarche permettant de faciliter le maintien d’un Grand Prix de France. Il est toutefois conscient que la réussite d’un projet est directement liée à son modèle économique, étant observé que les seules ressources significatives pour le promoteur de la manifestation proviennent essentiellement de la billetterie.
Il ne serait pas raisonnable, monsieur le sénateur, de nous engager dans une voie qui conduirait à une impasse financière semblable à celle que nous avons connue au cours des dernières années.
Quelle que soit la candidature finalement retenue pour organiser le Grand Prix de Formule 1, je n’ai aucune inquiétude concernant l’avenir du circuit de Magny-Cours. Je constate en effet que les circuits automobiles en France sont généralement très rentables et induisent, de manière stable et durable, une activité économique importante.

Monsieur le secrétaire d’État, pourquoi la billetterie des derniers Grands Prix s’est-elle avérée déficitaire ? La faute en revient non pas aux collectivités locales, mais aux partenaires privés, Renault, Total et Michelin, qui ont renoncé à verser leur participation de 1, 5 million d’euros. Ces crédits font cruellement défaut dans la trésorerie des organisateurs de l’épreuve.
La billetterie ne changera rien au fait que le Grand Prix soit organisé à Paris ou ailleurs, puisque le circuit fait le plein : la décision résultera forcément du souhait d’un autre partenaire d’organiser cette manifestation en région parisienne : telle est la volonté de M. Ecclestone, nous le savons depuis longtemps.
Les élus bourguignons auraient apprécié de recevoir le soutien du Gouvernement, notamment pour pouvoir financer le site Magny-Cours 2. On nous explique que l’organisation d’un Grand Prix de Formule 1 coûte 4 ou 5 millions d’euros, et on trouve 150 millions d’euros pour construire un nouveau circuit !
De surcroît, ce circuit situé en région parisienne sera construit sur un terrain dédié à l’agriculture biologique. Le jour même où nous commençons à examiner le projet de loi de programme relatif à la mise œuvre du Grenelle de l’environnement, le Gouvernement favorise cette implantation et abrège les procédures de délégation de service public afin d’accélérer le début des travaux de construction.
Ainsi, le Gouvernement signe l’arrêt de mort du Grand Prix de Magny-Cours et manifeste ouvertement sa volonté de favoriser, pour des raisons sans doute amicales, un circuit de proximité. Ce choix coûtera cher non seulement au territoire bourguignon, mais aussi à la France !
M. René-Pierre Signé applaudit de nouveau.

La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 370, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Je souhaite appeler l’attention du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique que vous représentez, monsieur le secrétaire d’État, sur la situation difficile et paradoxale dans laquelle se retrouvent certaines collectivités territoriales pour équilibrer les budgets de leurs services publics industriels et commerciaux.
En effet, l’instruction budgétaire M4 contraint les collectivités qui gèrent un service public industriel et commercial, tel un service d’assainissement ou un service de distribution d’eau potable, à constituer des dotations d’amortissement en vue de provisionner le remplacement des ouvrages et équipements affectés au service. Sur le principe, cela n’est pas contestable, car il s’agit d’une opération d’ordre budgétaire qui se traduit par une dépense en section d’exploitation et une recette du même montant en section d’investissement.
Afin de pouvoir réaliser ces opérations d’ordre, qui sont strictement encadrées et obligatoires, les collectivités peuvent parfois être obligées d’augmenter les redevances qui alimentent leur budget, sans avoir de dépenses nouvelles à couvrir. Elles accumulent ainsi, en section d’investissement, des réserves importantes. Dans le même temps, il leur arrive d’avoir des difficultés à équilibrer les opérations réelles de la section d’exploitation du budget en question.
Dans la mesure où la section d’exploitation doit être équilibrée par le seul moyen de la redevance payée par l’usager – ainsi, les collectivités de plus de trois mille habitants ne peuvent pas verser de subvention du budget principal vers le budget d’un service public industriel et commercial –, donc dans la mesure où il n’est pas possible juridiquement de faire des reprises sur les excédents de la section d’investissement afin d’équilibrer la section d’exploitation, certaines collectivités, dont la mienne, n’ont pas d’autre choix, pour répondre aux impératifs de l’instruction budgétaire M 4, que d’augmenter, chaque année, le montant de la redevance réclamée aux usagers, alors même que le budget du service accumule des excédents et qu’aucun service supplémentaire n’est apporté.
Cette situation est, vous en conviendrez, difficile à justifier dans le contexte économique et social actuel. Je souhaiterais donc savoir si l’instruction budgétaire et comptable M 4 ne pourrait pas être modifiée dans un sens plus réaliste, en autorisant, par exemple, sous certaines conditions, les collectivités à différer la constitution de dotations d’amortissement ou à reprendre en section de fonctionnement les excédents accumulés en section d’investissement dont elles n’ont pas l’usage.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence d’Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui ne pouvait être présent ce matin.
Vous avez appelé son attention sur l’instruction comptable relative aux services publics industriels et commerciaux, les SPIC.
Ces derniers, qui interviennent dans un champ d’action ouvert à la concurrence, doivent logiquement tenir une comptabilité conforme aux principes fixés par le plan comptable général appliqué par les entreprises privées.
La réglementation budgétaire et comptable actuelle applicable aux SPIC est conforme à l’objet de ces services, aux principes de respect des règles de concurrence et de sincérité budgétaire et comptable.
Le financement de l’activité de ces SPIC est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Cela implique donc de déterminer le coût complet des services rendus à ces derniers, lequel inclut obligatoirement l’amortissement des équipements affectés à la réalisation des prestations qui sont la contrepartie de la redevance.
L’instruction budgétaire et comptable M 4 ne fait que reprendre cette obligation d’amortissement de tous les biens inscrits à l’actif des services publics industriels et commerciaux, à l’exception de ceux que leur nature exclut du champ de l’amortissement, à savoir essentiellement les terrains.
Méconnaître l’obligation d’amortir, ou encore différer la constatation des amortissements, serait donc source de distorsion de concurrence et d’insincérité des comptes des SPIC ; je sais que je m’adresse à un conseiller de chambre régionale des comptes.
Par ailleurs, la constatation des amortissements a un impact budgétaire. Elle crée une charge d’exploitation, mais également une recette d’investissement. Elle constitue donc une ressource provenant directement de l’exploitation du service. Elle permet, dans la majorité des cas, de financer soit de nouvelles dépenses d’investissement – acquisition ou renouvellement de biens –, soit le remboursement des emprunts contractés par le service.
La situation spécifique évoquée - suréquilibre de la section d’investissement dû à la constatation des amortissements -, qui vous touche tout particulièrement, monsieur le sénateur, implique que le SPIC en cause ait totalement autofinancé l’acquisition de ses biens, qu’il ne procède pas à de nouvelles dépenses d’investissement et qu’il ait peu de dettes.
Cette configuration est atypique et ne peut donc justifier, à elle seule, la création d’une autorisation générale de reprise d’un excédent d’investissement en section d’exploitation.

La réponse que vous m’avez faite, monsieur le secrétaire d’État, est tout à fait orthodoxe sur le plan comptable. En matière budgétaire, vous qui êtes maire, vous savez la difficulté de faire passer auprès du contribuable le message selon lequel on va augmenter la redevance non par manque d’argent, mais au nom de normes comptables qui obligent à constituer des excédents en section d’investissement et empêchent ainsi d’équilibrer la section de fonctionnement.
Cela pose un vrai problème dans le contexte actuel : comment expliquer aux contribuables que l’augmentation de la redevance répond exclusivement à un souci de perfection sur le plan comptable ?
La difficulté est réelle et elle mériterait d’être étudiée, de même que l’on s’est penché sur la situation des petites communes qui avaient accumulé des excédents en investissement dont elles n’avaient pas l’usage.

La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 303, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

C’est une question que j’avais évoquée auprès de M Barnier, lequel m’a incité à la poser. Je ne doute pas que M. Santini me donne une réponse qui reflète la position de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Il s’agit des difficultés de l’agriculture dans le secteur de l’élevage et, plus particulièrement, dans le bassin allaitant.
La politique agricole commune a entraîné, par le découplage des aides qui peuvent paradoxalement être obtenues sans produire, par la mise en place de la conditionnalité de ces aides, une baisse de production de la viande et du lait, du nombre des agriculteurs, des têtes de bétail, et une course à l’agrandissement.
En outre, la répartition des aides est inégalitaire entre les productions, les producteurs et les différents territoires. Même si les objectifs restent les mêmes – approvisionnement, environnement, meilleures conditions de santé et de bien-être des animaux –, même si le fonctionnement reste inchangé, la demande essentielle, que je relaie, porte sur la modification du système d’attribution des aides.
Or, aujourd’hui, la révision de la PAC semble instaurer de nouvelles règles qui pourraient être résumées ainsi : la possibilité de mettre en œuvre la régionalisation des aides – c’est une demande très forte des agriculteurs de la région Bourgogne ; la possibilité de conserver la prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes, la PMTVA, et la prime à la brebis, insuffisantes par ailleurs, ou de les découpler totalement ou partiellement ; l’introduction d’une flexibilité dans l’utilisation de l’article 68 avec, d’abord, une augmentation du plafond de 2, 5 à 3, 5 % pour les aides couplées ; la possibilité de modifier la part non utilisée de l’enveloppe des aides directes de chaque État et la réserve ; enfin, la possibilité, dans le cadre de l’article 64, de réorienter les aides lors de leur découplage vers d’autres agriculteurs, dans la limite d’une baisse de leur actif de 25 % pour l’agriculteur en question.
Il s’agit d’une question technique, comme c’est souvent le cas avec la PAC. Si elles se confirmaient, ces modifications pour les éleveurs, en particulier ceux du bassin allaitant, iraient dans le bon sens.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Michel Barnier, en déplacement à Madrid, où il intervient à la Conférence « sécurité alimentaire pour tous ».
Je souhaite répondre à votre question en distinguant trois parties : quel constat faisons-nous sur notre agriculture aujourd’hui ? Quels objectifs peut-on se donner pour la politique agricole commune demain ? Quels outils faut-il mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ?
Tout d’abord, s’agissant du constat, vous avez raison : l’élevage, notamment dans le bassin allaitant, connaît une situation difficile. C’est pourquoi, sans attendre les résultats de la commission des comptes de l’agriculture fin décembre, le Gouvernement a arrêté un plan d’urgence pour l’agriculture doté de 205 millions d’euros, qui ont été complétés, pour 15 millions d’euros, par la Mutualité sociale agricole et, pour 30 millions d’euros, par les établissements de crédit. Plus de la moitié est consacrée à l’allègement des charges financières et à la prise en compte des cotisations sociales. Les enveloppes ont été attribuées à plus de 80 % aux départements d’élevage. Les premières avances seront versées en février.
Par ailleurs, des aides exceptionnelles, d’un montant de 50 millions d’euros, ont été dégagées pour les éleveurs ovins, dont la moitié leur est définitivement acquise.
Ensuite, pour ce qui est des objectifs de la politique agricole commune, la présidence française s’est mobilisée pour obtenir un accord sur le bilan de santé de la PAC, exercice prévu dans la dernière réforme de juin 2003 pour ajuster les mécanismes de la PAC. L’accord du 20 novembre, le premier conclu à vingt-sept, doit permettre, grâce à la détermination du ministre de l’agriculture et de la pêche, de préparer 2013. En effet, cette échéance fut la seconde priorité agricole de la présidence française.
Pour reprendre l’initiative et ne pas se laisser enfermer par le débat budgétaire, les conclusions présentées par Michel Barnier lors du Conseil des ministres de l’agriculture ont été adoptées par vingt-trois de nos partenaires. Elles réaffirment la nécessité d’une politique agricole commune et ambitieuse en Europe. Cette étape est indispensable : nous ne décidons pas seuls !
Les objectifs que vous mettez en avant sont précisément ceux qu’a portés Michel Barnier : une PAC plus réactive, plus préventive, plus équitable, au service d’une agriculture durable ancrée dans nos territoires. La « boîte à outils » qu’il a négociée va permettre de rendre cette PAC plus légitime dans la perspective de 2013. Michel Barnier annoncera ses orientations à l’issue de la concertation qu’il a engagée à la mi-février.
Enfin, en ce qui concerne les outils, vous demandez au Gouvernement de transférer aux régions la gestion des aides directes parce que ce serait le meilleur moyen de soutenir l’agriculture française. Telle n’est pas l’analyse du Gouvernement !
Aujourd’hui, l’enjeu est double : d’une part, rééquilibrer les soutiens au profit de productions qui sont en difficulté, quelle que soit leur localisation – je pense à la production ovine, à la production laitière en montagne, à la politique de l’herbe, ou encore à la relance de la production de protéagineux ; d’autre part, mettre en place un dispositif de couverture des risques climatiques et sanitaires pour les entreprises agricoles les plus vulnérables de notre appareil productif et les moins bien protégées.
Ce double enjeu ressort de choix stratégiques pour notre agriculture qui ne peuvent se décliner en de multiples politiques régionales. Ces priorités, sur lesquelles les régions de France ont été consultées, ont été partagées.
Notre différence, c’est le niveau de gestion. Pour le Gouvernement, après consultation de l’ensemble des partenaires, dont les régions, la décision appartient à l’État. Mais cela n’exclut pas, dans le cadre du bilan de santé de la PAC, de conduire des politiques conjointes et largement déconcentrées pour répondre aux nouveaux défis, au travers de la politique de développement rural dont les moyens sont accrus.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse.
L’accord du 20 novembre dernier prévoit la possibilité de mettre en œuvre la régionalisation à l’échelle de l’État membre. Cela favoriserait la distribution des aides aux entreprises agricoles et aux agriculteurs les plus démunis. Je ne pense pas qu’une telle mesure constitue un obstacle, bien au contraire.
Pour les agriculteurs de Bourgogne, s’agissant de la PAC, deux points sont essentiels.
D’une part, la production doit rester la préoccupation principale des agriculteurs.

C’est leur premier métier ! Ils ne sont pas des jardiniers de l’espace et n’ont pas vocation à entretenir l’environnement, même s’ils le font. Ils doivent avant tout offrir des produits de qualité et il faut les y aider.
D’autre part, j’y insiste, la régionalisation des aides est indispensable pour mieux cibler les entreprises agricoles et les agriculteurs en difficulté et donner ainsi une dynamique nouvelle à des régions où l’agriculture connaît des difficultés. Et je n’évoquerai pas les épizooties successives telles l’encéphalopathie spongiforme bovine, la fièvre aphteuse, la fièvre catarrhale ovine, dont les conséquences sont aujourd'hui beaucoup plus importantes que prévu.
Monsieur le secrétaire d'État, sur la question de la régionalisation, nous sommes en désaccord : si je comprends votre position, je persiste à considérer qu’une telle mesure serait opportune.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.