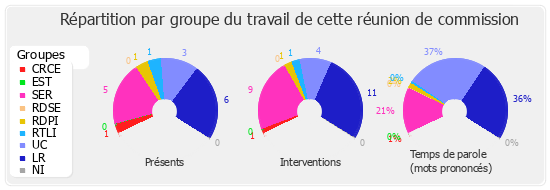Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 23 février 2022 à 8h30
Sommaire
- Proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d'organisation de l'élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19
- Proposition de loi visant à améliorer les conditions sanitaires d'organisation des élections législatives dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19
- Propositions de nomination de m. julien boucher aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de m. françois séners et mme jacqueline gourault aux fonctions de membres du conseil constitutionnel en application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution
- Audition de m. julien boucher candidat proposé par le président de la république aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (voir le dossier)
- Vote sur la proposition de nomination par le président de la république de m. julien boucher aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (voir le dossier)
- Audition de m. françois séners candidat proposé par le président du sénat pour siéger au conseil constitutionnel (voir le dossier)
- Vote et dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination par le président du sénat de m. françois séners pour siéger au conseil constitutionnel (voir le dossier)
- Audition de mme jacqueline gourault candidate proposée par le président de la république aux fonctions de membre du conseil constitutionnel (voir le dossier)
- Vote sur la proposition de nomination par le président de la république de mme jacqueline gourault aux fonctions de membre du conseil constitutionnel
- Dépouillement des scrutins sur les propositions de nomination par le président de la république de m. julien boucher aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de mme jacqueline gourault aux fonctions de membre du conseil constitutionnel
- Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation nouvelle lecture
La réunion
Proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d'organisation de l'élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19
Examen des amendements au texte de la commission et proposition de loi visant à améliorer les conditions sanitaires d'organisation des élections législatives dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19 - examen des amendements au texte de la commission

Nous examinons les amendements de séance sur la proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d'organisation de l'élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION
Article 3
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1 rectifié.

Nous examinons à présent les amendements de séance sur la proposition de loi visant à améliorer les conditions sanitaires d'organisation des élections législatives dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19.
EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION
Article 2
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 2 rectifié.
Après l'article 2
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1.
La commission a donné les avis suivants :
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
PROPOSITION DE LOI
Propositions de nomination de m. julien boucher aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de m. françois séners et mme jacqueline gourault aux fonctions de membres du conseil constitutionnel en application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution
Examen des rapports

Nous allons procéder, à partir de 9 heures, en application de l'article 13 de la Constitution, aux auditions publiques, ouvertes à la presse, de trois candidatures soumises à l'aval de notre commission : à 9 heures, celle de M. Julien Boucher, dont la reconduction aux fonctions de directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) est envisagée par le Président de la République - pour des raisons pratiques, la session parlementaire étant suspendue ce vendredi, cette désignation est anticipée de quelques semaines - ; à 9 heures 45, celle de M. François Séners, candidat du président du Sénat au Conseil constitutionnel ; à 11 heures, celle de Mme Jacqueline Gourault, candidate du Président de la République au même Conseil.
Pour tenir compte de la modification de notre Règlement en vigueur depuis le 1er octobre 2021, je vais, préalablement à ces auditions, vous présenter un certain nombre d'observations sur ces candidatures.
En application de l'article L. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), le ministre de l'intérieur et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont proposé au Président de la République la reconduction de Julien Boucher pour un deuxième mandat en tant que directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En application de l'article 13 alinéa 5 de la Constitution, nous allons donc procéder aujourd'hui à son audition, qui sera suivie d'un vote, dans les conditions prévues par les lois organique et ordinaire du 23 juillet 2010.
Avant de recevoir M. Boucher, je souhaite vous présenter quelques informations sur son parcours - que la plupart d'entre nous connaissent déjà, puisque nous l'avions auditionné en vue de l'exercice de ces mêmes fonctions, le 3 avril 2019. Je m'attarderai davantage sur son bilan à la tête de l'Ofpra au cours des trois dernières années.
Julien Boucher est membre du Conseil d'État depuis sa sortie de l'École nationale d'administration (ENA), en avril 2002. Il a effectué les dix premières années de sa carrière au Palais-Royal, d'abord en tant qu'auditeur, puis comme maître des requêtes, à partir de 2005. À partir de 2008, il a exercé les fonctions de rapporteur public près l'assemblée du contentieux. Lors de sa dernière année de rattachement à cette institution, il a assuré le rôle de conseiller pour les affaires constitutionnelles auprès du secrétaire général du Gouvernement, de mars 2011 à juin 2012.
Pour la deuxième partie de sa carrière, débutée en 2012, M. Boucher a été nommé, par la voie du détachement, directeur des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l'égalité des territoires et du ministère de l'écologie. Il a occupé ces fonctions pendant sept ans.
Puis, en l'absence d'opposition du Sénat et de l'Assemblée nationale, Julien Boucher a été nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois ans en tant que directeur général de l'Ofpra, à compter du 15 avril 2019.
Je rappelle que l'Ofpra, établissement public créé en 1952, a la charge de l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de la convention de New York du 28 septembre 1954 sur l'apatridie. Dans ce cadre, il a pour mission de statuer sur les demandes d'asile et d'apatridie qui sont déposées sur le sol français. Si l'Office a initialement été placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, celle-ci est exercée depuis 2010 par le ministère de l'intérieur. Cette tutelle n'affecte toutefois pas l'indépendance de l'Ofpra, qui, selon les termes de l'article L. 121-7 du Ceseda, exerce ses missions « en toute impartialité [...] et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ».
Au cours de son premier mandat, M. Julien Boucher a été confronté à deux défis majeurs.
Le premier est d'ordre structurel : il s'agit de la hausse tendancielle du nombre de demandes d'asile sur la dernière décennie. Sa prise de fonction a, en effet, eu lieu dans un moment de particulière tension pour l'Office. Près de 132 000 demandes ont été enregistrées en 2019, soit le niveau le plus élevé jamais constaté. Je rappelle que ce chiffre n'était que de 65 000 en 2014. Il a donc doublé en l'espace de cinq ans...
Dans le même temps, des objectifs ambitieux en termes de délai de traitement des demandes ont été assignés à l'Ofpra. En 2017, le plan d'action gouvernemental intitulé « Garantir le droit d'asile, mieux maîtriser les flux migratoires » a fixé un objectif de 60 jours à l'horizon 2023 pour le délai d'examen des demandes d'asile par l'Ofpra. En 2019, ce délai s'élevait à 166 jours.
M. Boucher a ensuite été confronté à un second défi, cette fois conjoncturel, qui a rendu cet objectif, au mieux, irréaliste et, au pire, caduc : la pandémie de covid-19. L'Office a, en effet, totalement interrompu son activité d'accueil et de réception des demandeurs au cours du premier confinement, ce qui a mécaniquement augmenté le délai de traitement. Ainsi, en 2020, malgré la diminution nette des flux de demandeurs d'asile, avec 96 000 demandes enregistrées, le délai d'examen a grimpé à 262 jours.
Un deuxième mandat de M. Boucher s'effectuerait dans un contexte plus propice. D'une part, la reprise des flux de demandes d'asile est encore inférieure à la période précédant la crise sanitaire, avec environ 100 000 demandes pour 2021. D'autre part, l'Ofpra a bénéficié, sur les derniers exercices, d'un renforcement considérable de ses moyens. La loi de finances pour 2020 a ainsi accordé 200 ETP supplémentaires à l'établissement public, dont 150 fléchés directement vers la demande d'asile. Dans ce contexte, Julien Boucher a estimé, lors des auditions budgétaires de nos collègues Muriel Jourda et Philippe Bonnecarrère, qu'atteindre l'objectif de 60 jours en 2023 ne lui semblait pas hors de portée.
Je précise enfin que, sous la direction de M. Boucher, l'Office a dû procéder à d'importantes transformations pour tirer les conséquences de la loi dite « Asile et immigration » du 10 septembre 2018. La plus importante est la mise en place d'une procédure d'examen accélérée lorsqu'une demande d'asile a été déposée au-delà d'un délai de 90 jours. Afin de fiabiliser les relations entre l'Ofpra et les demandeurs d'asile, un portail de communication dématérialisée a également dû être créé.
Au total, et sous réserve de la prestation de M. Boucher, qui pourrait être questionné en particulier sur la façon dont il entend assurer le « retour à la normale » du fonctionnement de l'Ofpra après la période du covid et le retour à la hausse des demandes d'asile, il me semble que ce candidat présente les qualités professionnelles pour être reconduit dans ses fonctions.
Notre commission entamera, dans un second temps, les auditions des candidats présentés pour siéger au Conseil constitutionnel, en application de l'article 56 de la Constitution, afin de pourvoir deux des trois sièges bientôt vacants au sein de cette institution.
En application de l'article 13 de la Constitution, nous avons à étudier, conjointement avec les membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale, la candidature de notre ancienne collègue et actuelle ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. Je note d'ailleurs que, si cette proposition devait être acceptée, d'anciens membres de la commission des lois du Sénat occuperaient le tiers des sièges de cette institution, MM. Mézard et Pillet ayant été nommés lors du dernier renouvellement.
En application de l'article 56 de la Constitution et de l'article 19 bis du Règlement du Sénat, nous devons également examiner la proposition du président Larcher tendant à nommer François Séners, conseiller d'État, en remplacement de Mme Dominique Lottin.
S'il revient au Conseil constitutionnel de contrôler la conformité à la Constitution des actes législatifs du Parlement, il incombe à ce dernier de s'assurer de l'adéquation des profils des candidats présentés par les trois autorités de nomination que sont le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale. De notre vigilance dépend l'équilibre dynamique des pouvoirs qui est devenu le fondement de nos démocraties modernes.
Cet équilibre est aujourd'hui primordial au regard du champ d'action qui est celui du Conseil constitutionnel depuis sa jurisprudence de 1971, qui intègre, dans les normes de son contrôle, le « bloc de constitutionnalité », alliée, depuis 2008, à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), laquelle lui permet d'exercer un contrôle a posteriori. Ce champ d'action fait aujourd'hui l'objet de critiques.
La première d'entre elles n'est pas nouvelle et concerne la part qui revient au Conseil constitutionnel dans l'élaboration de la loi. À ce titre, un candidat à l'élection présidentielle, dont j'ignore s'il a recueilli ses 500 parrainages, affirmait récemment vouloir supprimer le contrôle de constitutionnalité de la loi. Je ne reprends évidemment pas ces propos polémiques et outranciers. Les mots du doyen Vedel sont toujours d'actualité : le Conseil constitutionnel possède la gomme, mais pas le crayon.
Toutefois, certains peuvent estimer que le Conseil use souvent de cette gomme pour corriger les contours ou estomper les contrastes voulus par le législateur et créer de nouvelles nuances, via des réserves d'interprétation. En outre, la motivation de certaines censures restant peu explicite, elle laisse parfois le législateur dans l'expectative sur ce qu'implique vraiment la lecture de la Constitution par le Conseil constitutionnel : j'en veux pour preuve la question du suivi des condamnés terroristes sortant de détention.
Par ailleurs, les propos récents du président Laurent Fabius, affirmant que, « en étudiant une QPC, [le Conseil constitutionnel doit] apprécier la balance entre l'intérêt personnel du justiciable et l'intérêt général », peuvent être sujet à discussion. Certes, le contrôle de proportionnalité fait partie intégrante du contrôle de constitutionnalité, mais ce dernier doit se borner à écarter les dispositifs manifestement déséquilibrés, afin que le juge constitutionnel ne se substitue pas au législateur dans l'appréciation de l'opportunité de la loi. Juger de l'opportunité d'une loi relève de l'exercice de la souveraineté, et la souveraineté émane du peuple, non du juge, fût-il constitutionnel.
La position du Conseil constitutionnel de considérer des ordonnances non ratifiées comme des « dispositions législatives », au sens de l'article 61-1 de la Constitution, pour pouvoir mieux les soumettre à des questions prioritaires de constitutionnalité, a également suscité plus que de l'incompréhension. Et, à l'initiative de Jean-Pierre Sueur, le Sénat a souhaité rappeler que seule une ordonnance ratifiée expressément a valeur de loi.
Enfin, l'articulation du droit international conventionnel et de la Constitution est devenue une question majeure, à mesure notamment que l'intégration européenne a conduit à ce que le droit de l'Union européenne régisse de plus en plus précisément, directement ou indirectement, des domaines qui relèvent des fonctions régaliennes et qui sont, de ce fait, d'une sensibilité politique particulière. C'est dans ce cadre que le Conseil constitutionnel a récemment rappelé sa théorie selon laquelle l'atteinte aux principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France peut faire obstacle à l'obligation de transposer des directives européennes.
Dans ce contexte, il est important que la composition du Conseil constitutionnel puisse allier non seulement une expertise dans la chose juridique, puisque la QPC, notamment, a fait évoluer le Conseil en une véritable juridiction constitutionnelle, mais également une connaissance profonde du fonctionnement de nos institutions, au niveau national comme au niveau local.
C'est au regard de ce prisme d'analyse qu'il faut, à mon sens, examiner aujourd'hui les candidatures proposées par le président du Sénat et le Président de la République.
Évoquons ces deux candidatures.
François Séners, candidat proposé par le président du Sénat, n'est pas étranger à nombre d'entre nous, puisqu'il a été directeur de cabinet du président Larcher de 2014 à 2017, fonction qui s'est inscrite dans une carrière riche et diversifiée.
Issu de l'ENA, M. Séners a été administrateur civil avant d'être nommé au Conseil d'État - d'abord en tant que maître des requêtes au tour extérieur, puis comme conseiller d'État -, institution dont il a été le secrétaire général et où il exerce encore, à ce jour, les fonctions de président adjoint et de rapporteur général de la section du rapport et des études.
Dans une carrière également consacrée à l'administration active, François Séners a occupé des fonctions variées : sous-préfet, conseiller technique en cabinet ministériel, conseiller de tribunal administratif, conseiller au cabinet du Premier ministre, adjoint au secrétaire général du Gouvernement, membre du Conseil national de l'Ordre des médecins et directeur de cabinet du garde des sceaux, alors Rachida Dati.
Sous réserve de la prestation qu'il effectuera aujourd'hui, lors de l'audition qui va s'ouvrir, le profil de M. Séners - à la fois juriste, fin connaisseur de l'administration de l'État et très au fait du fonctionnement du Parlement et du Gouvernement et des relations entre ces organes - me semble tout à fait correspondre aux qualités attendues d'un membre du Conseil constitutionnel.
Je ne vous présenterai que très succinctement le parcours de la candidate du Président de la République, Jacqueline Gourault, que nous connaissons tous bien, d'abord parce que celle-ci a été l'une des membres de notre commission jusqu'à encore récemment, ensuite parce que l'examen de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a été l'occasion de longs échanges avec elle, en sa qualité de ministre de la cohésion des territoires.
De fait, si Mme Gourault a exercé en tant que professeur d'histoire-géographie, sa carrière a essentiellement consisté en des fonctions d'élue ou de membre du Gouvernement. En tant qu'élue, Jacqueline Gourault a été maire de La Chaussée-Saint-Victor, dans le Loir-et-Cher, conseillère régionale, présidente de communauté d'agglomération, puis sénatrice du groupe centriste, membre de notre commission, présidente de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat et vice-présidente du Sénat. En tant que membre du Gouvernement, Mme Gourault a été ministre auprès du ministre de l'intérieur, avant de devenir ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
La candidature de Mme Gourault a été la cible de critiques depuis son annonce par le Président de la République, lui reprochant notamment de ne pas être juriste. C'est, à mon sens, un mauvais procès. Si la fonction de membre du Conseil constitutionnel implique évidemment d'avoir une appétence et une capacité pour traiter de questions juridiques, elle n'impose pas que tous les membres de cet organe soient d'éminents juristes avant leur entrée en fonction. Il faut, en revanche, que chaque membre ait une conscience aiguë des enjeux de politiques publiques et de libertés fondamentales qui sont en cause dans le contentieux constitutionnel.
À cet égard, la présence de parlementaires aguerris et d'anciens membres du Gouvernement apparaît importante pour s'assurer que, dans la collégialité de la prise de décision du Conseil constitutionnel, l'application d'une règle ou d'un principe de droit soit décidée en pleine connaissance de ses effets concrets sur le fonctionnement des institutions et, plus largement, compte tenu des droits et libertés garantis, sur la société elle-même.
À cette aune, la candidature de Mme Gourault me semble dotée d'une crédibilité certaine, que l'impétrante devra évidemment nous confirmer au cours de son audition.
Je vous propose désormais d'accueillir notre premier candidat, Julien Boucher.
Audition de M. Julien Boucher candidat proposé par le président de la république aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides
Audition de M. Julien Boucher candidat proposé par le président de la république aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides

Monsieur le directeur général, je vous souhaite la bienvenue pour cette audition, qui fait suite à la proposition conjointe du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur de vous reconduire à la tête de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
Cette audition a un caractère public et est retransmise. Elle intervient en application de l'article 13, alinéa 5, de la Constitution ; elle sera suivie d'un vote dans les conditions prévues par la loi organique et la loi ordinaire du 23 juillet 2010. Le Président de la République devra renoncer à cette nomination si l'addition des votes négatifs exprimés à l'Assemblée nationale et au Sénat représente, au total, au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Le vote aura lieu à la suite de notre audition. Nous devrons procéder au dépouillement en fin de matinée, dans le même temps que nos collègues députés. Les délégations de vote ne sont pas autorisées, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Monsieur le directeur, j'ai présenté aux membres de la commission, avant de vous recevoir, des éléments sur votre parcours et votre action à la tête de l'Ofpra. Sur le fond, votre premier mandat a pris place à un moment charnière pour l'Office, qui a été confronté à de nombreux défis depuis 2019 : l'augmentation toujours plus importante de la demande d'asile d'abord, le choc de la crise sanitaire ensuite et, tout du long, la nécessité de s'adapter aux nombreuses évolutions du régime juridique de l'asile. Vous nous détaillerez la manière dont vous appréhendez ces différents défis et les actions que vous avez engagées pour y faire face.
Je commencerai par des questions générales : quel bilan tirez-vous de votre premier mandat ? Quels seront les objectifs prioritaires de l'Ofpra pour les prochaines années ? Est-il nécessaire d'engager des réformes de son organisation et de son fonctionnement ? Dans un contexte d'augmentation continue des demandes d'asile, les moyens de l'Ofpra, qui ont fait l'objet d'efforts notables, vous semblent-ils suffisants ?
Après avoir effectué il y a quelques mois un point de situation sur l'activité de l'Office devant votre commission, je suis très honoré de m'exprimer à nouveau devant vous, à l'occasion de la proposition faite au Président de la République de me reconduire dans mes fonctions de directeur général.
D'emblée, à titre personnel, je retiens la richesse humaine de mon mandat de trois ans : chaque jour, des centaines d'entretiens sont menés, dans nos locaux de Fontenay-sous-Bois et de Cayenne, ainsi que lors des missions foraines organisées sur le territoire national. Ce qui fait l'Ofpra, ce sont les femmes et les hommes qui oeuvrent pour l'Office et sa difficile mission, avec la conscience aiguë de l'étendue de leurs responsabilités, vis-à-vis des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection internationale comme de leurs concitoyens. Cette communauté de travail est particulièrement attachante et stimulante. Les réalisations que je vais vous présenter sont avant tout celles des agents de l'Ofpra.
J'ai été nommé en avril 2019, dans un contexte où les demandes d'asile étaient en constante augmentation. Ainsi, en 2019, le nombre de 133 000 demandes était historique, mettant à mal notre volonté de réduire les délais de traitement. C'est pour faire face à cette situation que la loi de finances pour 2020 a autorisé la création de 200 emplois supplémentaires, portant le plafond d'emplois au-delà des 1 000 agents.
Ma première priorité a été de donner corps à ce changement de dimension de l'établissement, dans un contexte qui a rapidement été marqué par la crise sanitaire. Malgré ces difficultés, nous avons procédé entre fin 2019 et fin 2020 à l'ensemble des recrutements, et nous avons ensuite formé ces nouveaux agents, la plupart étant des officiers de protection instructeurs, dont le parcours d'apprentissage est très exigeant : sont demandés, d'une part, des connaissances juridiques et géopolitiques et, d'autre part, des savoir-faire et des savoir-être qui ne viennent que de l'expérience. À Fontenay-sous-Bois, nous avons étendu nos emprises immobilières de manière substantielle.
Il a également fallu adapter l'organisation de l'Office, notamment celle des divisions géographiques, pour mieux combiner la spécialisation géographique de l'Office et l'exigence de mutualisation des principaux flux de demandes, mutualisation qui est un gage de réactivité face aux évolutions de la composition des flux par nationalité.
Grâce à l'ensemble de ces dispositions, nous avons retrouvé rapidement les niveaux de traitement d'avant la crise, avec 140 000 décisions rendues en 2021. Cela représente un niveau d'activité sans précédent, en hausse de 55 % par rapport à 2020 et de 16 % par rapport à 2019, dernière année d'activité complète avant la crise sanitaire. Nous avons ainsi pu réduire massivement le nombre de demandes en attente, passé de 90 000 dossiers en octobre 2020 à moins de 48 500 en janvier 2022 - soit l'équivalent de quatre mois d'activité.
Ces chiffres sont un peu abstraits et il faut rappeler que derrière chaque dossier se trouve un demandeur qui attend une réponse de l'Office, parfois depuis longtemps. Chaque demande fait l'objet d'un examen individuel approfondi et l'expertise de l'Office continue à être transmise aux nouveaux collaborateurs, par exemple sur la vulnérabilité des demandeurs, les connaissances sur les pays d'origine ou la vigilance sécuritaire, dont la responsabilité a été confiée par la loi à l'Office.
L'autre grande priorité de mon mandat a porté sur la protection juridique et administrative des bénéficiaires d'une protection internationale. L'Ofpra établit les documents tenant lieu d'actes d'état civil pour les personnes admises à une protection. Un autre aspect de cette mission consiste dans le suivi des personnes concernées, notamment les procédures susceptibles de conduire à une remise en cause de ce statut, à savoir les procédures de fin de protection, que l'Office mène sur le fondement de signalements, par exemple en cas d'allégeance aux autorités du pays d'origine ou de faits susceptibles de caractériser une menace pour l'ordre public.
Au fil des années, le nombre de personnes placées sous la protection de l'Office a significativement augmenté, pour s'élever à 500 000 personnes, adultes et enfants confondus. Leur bonne intégration est un enjeu crucial ; l'Office y contribue en matière d'état civil, car la délivrance des documents est nécessaire pour accéder à certains droits et services. Cette activité croît au même rythme que la population des personnes protégées. En outre, l'augmentation de cette population et la vigilance demandée par le ministère de l'intérieur aux préfets en ce qui concerne les personnes susceptibles de représenter une menace grave pour l'ordre public conduisent également à une augmentation de l'activité en matière de suivi du statut et de traitement des signalements.
J'ai donc souhaité renforcer l'activité de protection administrative et juridique, en créant un nouveau pôle « protection » constitué de deux divisions, toutes deux compétentes en matière d'état civil, tandis que l'une d'entre elles inclut un service de suivi du statut, qui est chargé de l'ensemble des procédures susceptibles de conduire à une remise en cause du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. La création de ce service s'est traduite par une forte augmentation de l'activité de l'Office en la matière, avec 1 000 procédures de réexamen du statut en 2021, contre 400 en 2020. Ces procédures sont difficiles, mais nécessaires, car elles contribuent à la confiance du public dans l'institution de l'asile.
J'en viens aux priorités qui seront les miennes si je suis reconduit dans mes fonctions.
L'enjeu immédiat est de mener la réduction du nombre de demandes en attente, pour réduire les délais de traitement. En 2019, le délai de traitement était inférieur à cinq mois et demi, il est passé à huit mois en 2020 du fait de la crise sanitaire et s'est maintenu à ce niveau en 2021. En effet, la résorption du stock a tout d'abord un effet négatif sur les délais de traitement. Depuis le dernier trimestre de 2021, grâce à la réduction très importante du stock en attente, les délais s'orientent à la baisse et sont désormais de sept mois. La baisse va s'accélérer à mesure que l'on s'approche du stock incompressible de dossiers en attente. Notre cible, ambitieuse, est fixée à deux mois.
Des adaptations sont nécessaires pour y parvenir, notamment dans la programmation de l'activité de l'Office. Nous menons des chantiers de modernisation des méthodes de travail de l'Office et des relations avec les usagers, grâce au numérique : un nouveau portail numérique permet une dématérialisation d'un certain nombre de procédures. En Bretagne et Nouvelle-Aquitaine, l'expérimentation a été concluante, les acteurs se sont bien approprié l'outil. Très prochainement, nous allons généraliser cette mesure à l'ensemble du territoire métropolitain, au début du deuxième trimestre de cette année.
Au-delà, nous devons continuer à accroître la capacité d'adaptation de l'Ofpra à une demande d'asile par nature difficile à anticiper. Ceci implique de poursuivre des actions déjà entreprises, notamment en matière de gestion des ressources humaines : par exemple mieux anticiper les besoins ou fidéliser davantage les collaborateurs de l'Office, mais aussi adapter en permanence les modalités de traitement des demandes. Pour rappel l'instruction des demandes se fait pour l'essentiel au siège, à Fontenay-sous-Bois. Cette concentration favorise la spécialisation des agents et une adaptation rapide de l'activité, par exemple en concentrant les interprètes pour les langues rares.
Il est néanmoins important de combiner cette organisation avec une présence territoriale, qui est à géométrie variable. En 2021, nous avons réalisé 50 missions foraines, niveau jamais atteint jusqu'à présent. Pour l'outre-mer, l'Ofpra dispose d'une antenne permanente à Cayenne, et peut entendre les demandeurs par visioconférence.
Un dernier enjeu sera l'adaptation du dispositif au règlement européen à venir sur l'asile, qui sera issu du pacte européen sur la migration et l'asile. Il y a déjà de premières réalisations puisque le règlement relatif à la nouvelle Agence de l'Union européenne pour l'asile (EASO) est entré en vigueur récemment. Celle-ci a pour mandat de favoriser la convergence des pratiques nationales. L'Ofpra devra jouer un rôle actif pour organiser cette convergence, en faisant valoir ses priorités et son expertise.
Enfin, en ce qui concerne la protection administrative et juridique, nous devrons garantir une délivrance rapide des documents d'état civil pour les personnes sous protection, dans un contexte de complexification de cette activité du fait de l'évolution des pays d'origines. Il faudra également simplifier les formalités pour les bénéficiaires d'une protection, avec une meilleure transmission directe des informations d'état civil entre administrations des différents pays.
Voilà les priorités qui devraient guider la gestion de l'Ofpra à l'avenir. Sans perdre de vue les fondamentaux de sa mission décidés en 1952, à la suite de la convention de Genève, l'établissement devra continuer à se moderniser. En ce soixante-dixième anniversaire de l'Office, l'attachement au droit d'asile est une force pour l'Ofpra, qui me rappelle chaque jour mes responsabilités. Vous pourrez compter sur mon engagement si mon mandat est renouvelé.

L'accroissement des effectifs et la nécessité de conserver une force opérationnelle importante posent une question de valorisation des carrières. L'Ofpra reste cloisonné et ne facilite pas les mobilités. Existe-t-il un problème d'attractivité ou de fidélisation des personnels?? Peut-on rester compétitif dans un secteur où les personnels peuvent être débauchés??
Au début de votre mandat, un conflit social substantiel a eu lieu à la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ce mouvement de mécontentement semblait venir d'une nécessité de respecter des taux de rendement. À l'OFPRA, les officiers de protection pourraient avoir été heurtés par ce délai cible de deux mois, alors que leur mentalité professionnelle est faite de beaucoup d'empathie vis-à-vis des demandeurs. Est-ce un défi pour la prochaine période ? Le consensus est-il trouvé ?
Enfin, pensez-vous qu'il soit possible d'améliorer le potentiel humain de l'interprétariat, défi permanent étant donné la diversité des demandeurs ? Les techniques évolutives de l'interprétariat vous permettent-elles de surmonter ces difficultés ?

Monsieur, je souscris à vos propos sur la richesse humaine qui domine au sein de l'Office. Les missions des personnels sont complexes, et demandent beaucoup d'humanité. C'est grâce à ces hommes et ces femmes que les délais d'examen ont été réduits.
Pour relever tous ces défis, vous avez sollicité l'aide de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Cependant, l'appui de la DITP impliquait de faire intervenir des consultants d'un grand cabinet de conseil privé. L'intervention de ce cabinet a-t-elle été utile ? Comment ont réagi les personnels ? N'étaient-ils pas capables de relever seuls ces défis ?

Combien de familles n'ont pas pu rejoindre un de leur membre ayant obtenu le statut de réfugié en France ? Je pense notamment aux ressortissants afghans.
Quel est le ratio de personnes ayant obtenu le statut de réfugié en France après un refus dans un autre pays européen ?
L'Ofpra est-il systématiquement présent devant la CNDA quand une décision de refus a été prise pour un motif lié à la sécurité nationale ?
Les réfugiés disposent de droits à la formation, à l'apprentissage de la langue et au travail : faut-il ouvrir des droits directement aux demandeurs d'asile, plus tôt, en attente de la décision sur leur futur statut ?

Enregistrez-vous déjà des défections chez les personnels récemment recrutés ? Par ailleurs, rencontrez-vous des difficultés entre votre public masculin et votre personnel, principalement féminin ?
La CNDA a indiqué au cours d'auditions que nous avons conduites récemment avoir besoin d'un volume de dossiers suffisant pour faire fonctionner correctement la juridiction et que, paradoxalement, la baisse de ce volume de dossiers n'était pas intéressante et pourrait même mettre à mal son fonctionnement. En va-t-il de même pour l'Ofpra ?

Nous nous sommes rendus à Cayenne il y a un peu plus de deux ans. Les flux migratoires y sont massifs, ce qui déstabilise la société. Nous avons été impressionnés par les volumes croissants des demandes d'asile déposées en Guyane, venant non seulement d'Amérique mais aussi du monde entier, pour accéder au territoire français. Quelle est l'évolution de la situation ? La Guyane a été très fortement touchée par la covid. Je crains que la situation n'ait empiré, pouvez-vous détailler les actions que vous avez engagées pour y faire face ?

Quelle est l'analyse d'un dossier type par vos services ? S'agit-il uniquement d'entretiens ? Disposez-vous de grilles précises d'analyse ?
À Mayotte, au mois de septembre, nous avons aussi constaté d'importants problèmes. Nul ne peut nous dire combien de personnes arrivent sur le territoire : 30 000, 100 000 ? Il est impossible de cerner les contours de cette immigration très importante, qui renforce l'insécurité. Comment traitez-vous la situation particulière de Mayotte ?

Est-il difficile pour le directeur de l'Ofpra de motiver les personnels, alors que seules 20 % des décisions de refus du statut de l'Office sont en fait suivies d'effet ? Ces instructions semblent ne servir à rien, puisque les personnes en question restent sur le territoire. Le moral des troupes est-il impacté ?
Les questions d'attractivité sont majeures, car l'Ofpra est composé d'hommes et de femmes qui font toute sa richesse. D'une manière générale, nous n'avons pas, pour les fonctions d'officier de protection instructeur, de difficultés à recruter sous contrat. En revanche, l'attractivité des concours administratifs baisse un peu. La difficulté porte plutôt sur la fidélisation des agents, car la formation est longue, et l'expérience des personnels doit ensuite être transmise aux nouveaux agents. Nous travaillons sur ces enjeux, notamment sur la qualité de vie au travail ou les perspectives de carrière.
Concernant les carrières, beaucoup a été fait pour décloisonner l'Ofpra. Les compétences des agents sont très valorisées à l'extérieur. Le corps des officiers de protection de l'Ofpra a été inclus dans le corps des attachés d'administration de l'État, ce qui favorise la mobilité, qui fonctionne bien. En revanche, il est plus difficile de construire des parcours de carrière, pour des agents qui reviendraient dans l'institution après une expérience ailleurs.
Concernant le dialogue social, depuis ma prise de fonction, il n'y a pas eu de conflit social. J'attache une grande importance à un dialogue social nourri. La quantité de travail est exigeante, les objectifs de délai le sont tout autant. Les agents doivent pouvoir rendre leurs décisions avec toute la qualité souhaitée. Il s'agit de proportionner le temps passé sur un dossier à ses particularités. Le délai de deux mois est un délai moyen : nous devons pouvoir passer moins de temps sur des dossiers, et parfois beaucoup plus, car certains dossiers exigent des instructions longues.
Les interprètes sont recrutés par des marchés de prestataires. Les ressources sont rares, notamment pour certaines langues. Nous devons donc anticiper les besoins pour que nos prestataires puissent eux-mêmes anticiper nos demandes.
Madame Assassi, la DITP, au titre de sa responsabilité pour accompagner les réformes prioritaires du Gouvernement, m'avait fait connaître sa disponibilité. Nous avons réduit de manière très importante le stock de demandes en attente, ce qui est un préalable à toute réduction des délais de traitement. Cependant, cela ne sera pas suffisant pour atteindre nos objectifs ambitieux. Recourir à une mission de conseil permet de nous intéresser au « dernier kilomètre », ce qui implique de modifier certaines méthodes de travail. La réduction du nombre de dossiers implique des transformations de nos méthodes de travail, pour mieux anticiper les demandes. De plus, l'Ofpra a augmenté de 25 % ses effectifs en pleine crise sanitaire. Il semblait important, dans cette période de stabilisation, d'être accompagné pour travailler sur le collectif, qui a été affecté par cette période de crise dans laquelle le télétravail s'est fortement accru. Le travail de l'officier de protection peut également être très solitaire. Nous avons donc favorisé le compagnonnage pour renforcer le collectif de travail. Il est trop tôt pour dresser un bilan. La phase de diagnostic est achevée ; nous cherchons maintenant des solutions. Cette mission suscite des débats, elle est faite pour en susciter et pour nous amener peut-être à interroger nos pratiques. Ce que je souhaite dire, c'est que l'intervention d'un cabinet de conseil via la DITP n'implique pas que ce sont les consultants qui décideront. À l'issue de la mission, les solutions proposées feront l'objet de concertations, en cherchant toujours à préserver à la fois la qualité de vie au travail et la qualité des décisions rendues.
Monsieur Leconte, concernant les réunifications familiales, l'Ofpra atteste de la composition familiale, mais la demande de visa relève du ministère des affaires étrangères. Je n'ai donc pas de chiffres à vous donner. Concernant l'Afghanistan, ce ministère a déployé des moyens supplémentaires dans ses services consulaires pour traiter plus rapidement les demandes, notamment au Pakistan.
Concernant les mouvements secondaires, il est difficile de disposer de chiffres précis. Les personnes « dublinées » représentent environ 30 % des dossiers, mais je n'ai pas de données précises à vous communiquer.
En raison du nombre très important de recours, nous ne pouvons pas être présents systématiquement lors des audiences de la CNDA. Nous choisissons alors les dossiers qui exigent notre présence. Pour les décisions motivées par des questions de respect de l'ordre public, notre présence est systématique.
Enfin, le droit au travail pour les demandeurs d'asile n'est pas complètement inexistant. Quand une décision n'est pas prise dans les six mois, les demandeurs peuvent obtenir une autorisation de travail. D'où l'importance de traiter les dossiers dans un délai cible de deux mois, ce qui rendra cette problématique résiduelle.
Madame Jourda, pouvez-vous préciser votre question sur les difficultés que pourraient rencontrer les personnels féminins??

Le directeur d'un autre organe de l'État nous disait que le public masculin n'arrivait pas à considérer la parole féminine comme une parole d'autorité. Est-ce le cas à l'Ofpra ?
Les officiers de protection de l'Ofpra sont majoritairement des femmes, mais nous n'avons pas constaté de difficulté particulière. La relation entre l'instructeur et le demandeur est une relation non pas d'autorité, mais de dialogue. Il s'agit de coopérer, donc d'établir une forme de confiance. En cas de comportement inacceptable, nous sommes très vigilants pour apporter une réponse adéquate.
Monsieur Bas, en Guyane, le nombre de demandes d'asile est très important. Traditionnellement d'origine haïtienne, la demande s'est diversifiée. La demande haïtienne représente actuellement 65 % des dossiers. Les nouveaux requérants viennent d'autres pays d'Amérique, et plus récemment de Syrie et Palestine, en transitant par le Brésil. Les flux ont été très variables en 2021 - nous avons connu, par exemple, un pic de demandes au printemps. Quoi qu'il en soit, du point de vue du traitement des demandes d'asile, il n'y a pas de stocks : nous arrivons à traiter les dossiers au moment de leur arrivée, la situation est saine.
Monsieur Marc, le moment fondamental de la demande d'asile est bien l'entretien, qui a pour objet de comprendre le parcours et le profil du demandeur, à partir desquels nous pouvons évaluer les craintes du demandeur d'asile à retourner dans son pays d'origine. Les officiers disposent d'une information très précise sur les pays d'origine, que nous confrontons aux déclarations des demandeurs. Nous interrogeons aussi, le cas échéant, des partenaires extérieurs, par exemple pour les enquêtes administratives de sécurité, ou en interrogeant le fichier Dublin.
Les demandes d'asile à Mayotte viennent à 80 % des Comores ; le reste émane de ressortissants de l'Afrique continentale, principalement de la région des Grands Lacs. Cette dernière demande a diminué au cours de la crise, mais elle pourrait reprendre.
Nous avons organisé six missions foraines à Mayotte - ce chiffre est très important -, et massivement utilisé la visioconférence : nous n'avons plus de stocks de dossiers, et nous traitons, là aussi, les dossiers au fur et à mesure de leur arrivée. Par ailleurs, en vertu d'un décret publié il y a quelques jours, nous allons ouvrir une antenne à Mayotte, ce qui autorise des remises en main propre de documents, facilitant ainsi les procédures.
La question de l'effectivité des décisions de l'Ofpra ne relève pas de son autorité. En revanche, l'Office travaille avec conscience et rigueur, sans être aveugle à ce qui se passe par la suite. Notre responsabilité est de bien communiquer les décisions aux préfectures, en temps réel, pour qu'elles en tirent les conséquences en matière de séjour et d'éloignement.

Je vous remercie pour l'ensemble de vos précisions.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Vote sur la proposition de nomination par le président de la république de m. julien boucher aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides
Vote sur la proposition de nomination par le président de la république de m. julien boucher aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides

Nous avons procédé à l'audition de M. Julien Boucher, dont la nomination par le Président de la République est envisagée pour exercer les fonctions de directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Nous allons maintenant procéder au vote sur cette proposition de nomination.
Ce vote se déroulera à bulletins secrets, comme le prévoit l'article 19 bis de notre Règlement. En application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 novembre 1958, les délégations de vote ne sont pas autorisées.
Le dépouillement aura lieu à 12 heures 20, de manière simultanée avec l'Assemblée nationale.
Je vous rappelle que le Président de la République ne pourra pas procéder à la nomination de Julien Boucher si les votes négatifs au sein des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Il est procédé au vote.

Monsieur Séners, je vous souhaite la bienvenue. Cette audition fait suite à la proposition du président du Sénat de vous nommer membre du Conseil constitutionnel en remplacement de Mme Dominique Lottin, en application de l'article 56 de la Constitution.
Cette audition est publique : la presse et le public y ont accès. Le vote et le dépouillement auront lieu à l'issue de votre audition. Chers collègues, la délégation de vote n'est pas autorisée.
Monsieur Séners, j'ai présenté aux membres de la commission, avant de vous recevoir, quelques indications sur votre parcours, dont vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre en valeur certains éléments.
Sur le fond, le but de l'audition vise surtout à ce que vous nous exposiez ce que vous pensez pouvoir apporter au Conseil constitutionnel en tant que rapporteur ou lors des délibérations collectives, et ce que vous pensez de ce que doit être le positionnement du Conseil dans notre démocratie. Il s'agit de la vaste question de la légitimité du censeur de la loi, qui, dans notre conception de la démocratie, est l'expression de la souveraineté nationale.
Cette audition revêt à mes yeux une importance particulière, car le poids des décisions du Conseil constitutionnel rend hautement nécessaire le regard critique de votre commission sur la nomination des membres du Conseil.
Je me permets de vous présenter rapidement mon parcours, avant de vous présenter le regard que je porte sur le rôle de l'institution.
Un juriste n'est jamais une personne désincarnée : il est le produit de son histoire personnelle et de son parcours, qui, pour ma part, a commencé la même année que la Constitution de la Ve République. Ce n'était pas un signe prémonitoire : une jeunesse passée entre l'Alsace, la Lorraine et le Dauphiné m'a tenu très éloigné de la vie institutionnelle. Je n'ai découvert son intérêt qu'au cours de mes études, et plus encore à l'occasion d'une rencontre qui m'a marquée avec un élu local, qui deviendra ensuite un très éminent sénateur, Daniel Hoeffel. En quelques heures, il m'a fait découvrir, bien mieux que dans les manuels, toute la richesse et les responsabilités de la vie locale. J'aurais pu m'engager dans cette voie territoriale, mais j'ai finalement choisi le service de l'État. Cependant, par fidélité à ce qui m'avait séduit, je me suis engagé dans un parcours de terrain, celui de la préfectorale, qui m'a conduit dans le Val de Loire, en Île-de-France et en outre-mer.
Grâce à la confiance que m'a témoignée le ministre Louis Le Pensec, qui m'avait confié la mission de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie - les nouvelles institutions issues des accords de Matignon se mettaient alors en place -, les enjeux calédoniens sont toujours restés, depuis trente ans, une ligne de fidélité - M. le sénateur Frogier le sait bien.
Suffisamment éclairé sur les réalités de la vie administrative, j'ai pu devenir un juge administratif assez honorable, à Nice, puis au Conseil d'État, pour l'essentiel à la troisième chambre de la section du contentieux, qui traite des contentieux des collectivités territoriales, de l'agriculture et en partie des questions fiscales. Pendant huit ans, j'ai été le rapporteur public de cette chambre.
Par peur de devenir un juge un peu déconnecté des responsabilités publiques, j'ai pris de nouvelles responsabilités, au ministère de la justice, au Conseil d'État comme secrétaire général, au secrétariat général du Gouvernement, où je me suis occupé, en 2010, de la nouvelle organisation territoriale de l'État, et au Sénat, où j'ai dirigé pendant trois ans le cabinet du président Larcher. Désormais, au Conseil d'État, je suis chargé des études, qui sont très souvent en résonance avec les questions traitées au Sénat, comme la citoyenneté, l'évaluation des politiques publiques ou les états d'urgence.
Je souhaite concentrer mon propos sur l'enjeu fondamental de la place du juge constitutionnel dans le fonctionnement des institutions et dans la création des normes de droit. Le droit constitutionnel est éminemment politique. On ne peut le pratiquer sans connaître parfaitement le jeu des institutions.
Au cours de la dernière décennie, à la traditionnelle séparation des pouvoirs semble se substituer une confrontation entre deux pôles, un pôle politique - il regroupe le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif - et un pôle juridictionnel. Un glissement progressif semble même avoir eu lieu, de la primauté du législatif, essence même de la pensée révolutionnaire, vers une primauté de l'exécutif, avec le parlementarisme rationalisé de 1958. Ces dernières années, ce glissement semble même aller vers une forme de primauté du juridictionnel ; cependant, j'ai la profonde conviction qu'elle ne peut pas être tenue pour un acquis acceptable. L'équilibre démocratique ne peut reposer sur un seul pôle : il doit reposer sur les trois. La recherche d'un rééquilibrage est essentielle pour notre démocratie ; la responsabilité en incombe à tous les acteurs, et donc, entre autres, au juge constitutionnel.
La nécessaire réévaluation de la fonction délibérative du Parlement repose pour une part non négligeable sur la consolidation du bicamérisme. Au temps additionnel de la navette, qui répond à un enjeu de qualité de production de la loi, s'ajoute la nécessité grandissante de distanciation vis-à-vis de l'exécutif. Telle est la question de l'autonomie du processus parlementaire. Il s'agit non pas de définir une théorie de l'opposition, mais une théorie de la dissociation entre le législatif et l'exécutif ; cette dissociation est l'une des lignes de force de l'institution sénatoriale.
J'en viens au rôle du juge constitutionnel dans cet équilibre institutionnel.
Le débat sur le pouvoir des juges est vif. Il repose sur un glissement sémantique un peu pernicieux. La question est plutôt celle du devoir des juges, qui doivent être des gardiens de la Constitution, qui doivent avant tout faire respecter avant d'interpréter, et en rien ne modeler le droit à leur idée : il s'agit de respecter le principe cardinal qui consiste à dire le droit, et non à créer le droit. La pratique n'est pas aussi limpide, les interstices existent, ils demandent parfois des interprétations, mais le cap doit être maintenu.
D'où un certain nombre d'orientations structurantes.
La création jurisprudentielle doit être limitée au strict nécessaire, et doit chercher non pas l'inventivité, mais la conformité au droit. La créativité juridique est bienvenue chez les universitaires, mais le juge doit répondre à une exigence de rigueur. C'est la ligne du Conseil constitutionnel depuis de nombreuses années, notamment dans la défense des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Nous cherchons ces principes dans l'identification de fondements textuels, dans des textes constants et anciens, idéalement antérieurs à la Constitution de 1958, et qui n'ont jamais été fondamentalement remis en cause. Le cap est limpide.
Deuxième ligne de force : quand la jurisprudence se doit d'être interprétative, par exemple pour évaluer des questions de proportionnalité, la ligne doit rester strictement fidèle au principe consistant à limiter le pouvoir du juge constitutionnel, dont le pouvoir n'est pas de même nature que celui du législateur. Les deux légitimités sont différentes.
Troisième orientation : quand une décision du Conseil présente un caractère innovant, elle doit être prévisible, donc idéalement annoncée. La première innovation marquante du Conseil constitutionnel date de juillet 1971 ; elle a révélé que le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen faisaient partie du bloc de constitutionnalité. Dès 1969, les acteurs, universitaires comme parlementaires, avaient anticipé cette évolution et avaient donc pu nourrir le débat.
Enfin, quand les jurisprudences peuvent avoir une tentation d'audace, le juge a alors une responsabilité de retenue. La retenue est une valeur cardinale pour le juge constitutionnel. Une jurisprudence audacieuse ajoute aux règles constitutionnelles ; or cette audace n'incombe qu'au constituant. Il est tout à fait exclu de déroger à une telle règle. Les textes constitutionnels peuvent évoluer, et il n'est pas du tout illégitime que le Conseil constitutionnel alerte le constituant sur des difficultés ou des évolutions souhaitables.
Fréquemment, le constituant a ainsi pu se saisir de questions soulevées par le Conseil constitutionnel, comme la parité dans les élections locales, la capacité pour les collectivités territoriales à expérimenter en matière législative, la capacité donnée aux outre-mer de fusionner régions et départements, ou encore l'encadrement de la faculté de dépôt d'amendements en première lecture, difficulté levée par la réforme de 2008.
Il me semble aussi indispensable que la jurisprudence constitutionnelle veille à respecter les deux piliers constitutionnels que sont les droits et libertés, ainsi que la régulation du fonctionnement des pouvoirs constitutionnels : ce second pilier ne peut devenir un parent pauvre de la jurisprudence constitutionnelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 16, énonce clairement ce qu'est une Constitution, qui ne peut exister sans ces deux socles fondamentaux de l'État de droit.
Je termine par les questions internationales, à savoir les liens du Conseil constitutionnel avec la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Deux légitimités se télescopent : le primat de la Constitution et le primat du droit international, ce dernier étant reconnu par notre adhésion à la Convention de Vienne sur l'interprétation des conventions européennes. La difficulté est de concilier ces deux logiques, sans rogner notre identité constitutionnelle, qui, en certaines circonstances - que j'espère les plus rares possible -, nous pousse à revenir au primat indépassable de notre droit constitutionnel.
Le dialogue des juges est parfois présenté de manière un peu erronée. Ce n'est en rien un condominium qui viendrait faire obstacle à l'action politique. À l'origine, le dialogue des juges avait une double fonction : éviter les guerres et confrontations entre juges, mais aussi le pouvoir des juges.
Pour que notre Constitution reste bien au sommet de notre ordre juridique s'est construite l'idée d'une identité constitutionnelle, qui trouve son pendant dans le dialogue international des juges. Cette idée est riche de développements. Contrairement à ce que j'entends parfois, ce n'est pas une guerre française perdue : un, elle n'est pas française ; deux, elle n'est pas perdue.
Pratiquement toutes les autres juridictions des démocraties voisines ont mené des bras de fer avec la CEDH ou la CJUE. L'Italie, en 2011, dans l'affaire sur la présence de crucifix dans les écoles italiennes, a poussé la CEDH à reconnaître une originalité juridique forte au sein des États signataires de la Convention. Le Royaume-Uni, depuis l'adoption de son Human Rights Act de 1998, a pu faire reconnaître des particularismes dans son ordre juridique interne. Les juges de Karlsruhe ont aussi eu des débats complexes, mais potentiellement fructueux, avec les juges de la CJUE.
Le protocole n° 15 de la Convention européenne des droits de l'homme est une étape significative de l'évolution de cette institution : il a introduit dans le fonctionnement de la Convention européenne le principe de subsidiarité et le respect de marges d'appréciation pour les États, ce qui a conduit à la limitation du nombre de saisines de la juridiction de Strasbourg.
Voilà qui nous autorise un regard plus optimiste sur le sujet sensible des fondamentaux de l'identité constitutionnelle de la France.

Le Conseil constitutionnel a récemment décidé de conférer une valeur législative à des dispositions issues d'ordonnances, pour faire bénéficier nos concitoyens de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les débats furent vifs. Le Sénat a adopté à une très large majorité, avec plus de 300 voix favorables, un texte rappelant ce qu'a dit le constituant en 2008, à savoir que la ratification des ordonnances devait être expresse. Jusqu'alors, le contentieux portant sur des ordonnances non ratifiées relevait du Conseil d'État. Quelle est votre position ? Approuvez-vous cette évolution ?
Au cours des trente dernières années, le Conseil d'État a changé de jurisprudence concernant les cavaliers législatifs. Il fut un temps où il était rare que des amendements devenus des articles de loi soient déclarés anticonstitutionnels au seul motif qu'ils semblaient aller au-delà de l'objet strict énoncé par l'intitulé du projet de loi.
Faire adopter des propositions de loi est parfois le parcours du combattant, à l'image de celles adoptées par le Sénat sur les sondages, que l'Assemblée nationale n'a jamais voulu inscrire à son ordre du jour. Les amendements sont parfois salutaires. Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel avait été aussi stricte qu'aujourd'hui, tout aurait été bloqué. Le droit d'amendement, pour les parlementaires, est comme l'air que l'on respire. Que pensez-vous de la pratique actuelle du Conseil ?

Depuis quelques années, l'application de l'article 45 de la Constitution au Sénat est très stricte, bien plus qu'à l'Assemblée nationale. Pensez-vous que l'adoption à l'Assemblée nationale d'amendements déclarés irrecevables au Sénat soit une faute de procédure, qui pourrait conduire à une censure du Conseil constitutionnel??
Comment considérez-vous les 227 censures du Conseil constitutionnel de lois préexistantes par le biais de la QPC ? Cela va-t-il plus loin qu'un simple contrôle constitutionnel ? Comment jugez-vous l'évolution engagée à la suite de la révision de 2008 ?
Vous nous avez parlé de l'immuabilité des principes constitutionnels. Quel est votre point de vue sur la décision de 2018 sur le principe constitutionnel de fraternité, qui a été vu comme un moment fort au sein du Conseil constitutionnel ?
Je reste étonné par la manière dont vous évoquez la hiérarchie des normes au niveau international. Le Parlement doit être impliqué dans la mise en oeuvre du droit européen, constitué de traités, mais aussi de procédures variées.
À vous écouter, nous pourrions penser que le juge constitutionnel serait au-dessus de tout. Ce dialogue des juges est-il simple ? Faut-il une « pédagogie de la complexité », pour reprendre l'expression de Mme Delmas-Marty, et faut-il restaurer le pouvoir du politique ?

Vous parlez d'un équilibre entre audace et retenue. Le terme de retenue m'a interpellé, car le Conseil constitutionnel a un pouvoir d'interprétation et de contrôle de proportionnalité : la Constitution n'est pas une langue morte. Le 6 juillet 2018, le Conseil a reconnu le principe constitutionnel de fraternité. A-t-il alors fait preuve d'audace, et aurait-il dû faire preuve de retenue??
La composition du Conseil constitutionnel doit-elle respecter la parité ?
Des règles de déport doivent-elles être appliquées, notamment pour l'examen des QPC ?
Agirez-vous afin que les procédures en matière de contentieux électoral soient améliorées ? Le Conseil a considérablement évolué, mais il partait de très loin ; la situation n'est toujours pas satisfaisante.

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre présentation. Au-delà de votre expertise juridique au plus haut niveau, vous avez conjugué une expérience de terrain dans l'administration, une expérience de l'exécutif et une expérience du législatif, dans vos fonctions au Sénat. J'apprécie votre réflexion sur le contrôle de constitutionnalité, car vous l'avez situé à sa place dans le jeu des institutions. Nous constatons presque une unité fonctionnelle entre la Présidence de la République, le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Dans ce système politique, il est important que les contre-pouvoirs puissent s'exercer. Cette exigence est une des clefs de l'évolution progressive du Conseil constitutionnel, surtout à partir de 1971.
Nous sommes parfois surpris de constater que la logique du contrôle de constitutionnalité ne s'est pas toujours accompagnée d'une meilleure protection du Parlement dans le jeu institutionnel. Nous avons su tirer les conséquences d'un relatif affaiblissement du Parlement par rapport à l'exécutif dans le régime de la Ve République, en renforçant le contrôle de fond de la constitutionnalité des lois, mais sans défendre suffisamment le Parlement dans la procédure législative. Pourriez-vous approfondir votre présentation sur ce point ?
Parfois, comme législateur, nous avons du mal à accepter la censure du Conseil constitutionnel, mais, dans certains cas, on regrette qu'il n'aille pas assez loin ! C'est le cas du recours à l'article 11 de la Constitution pour réviser celle-ci. La Constitution ne peut être révisée sans l'accord du Parlement, comme l'affirme l'article 89 de la Constitution. Si, à l'avenir, nous devions en venir à réviser la Constitution, l'application de l'article 89 vous semble-t-elle devoir s'imposer dans tous les cas ?

Ma question porte aussi sur la question de la fraternité. Sa reconnaissance comme principe à valeur constitutionnelle a permis de légaliser l'aide portée aux migrants en situation illégale. Est-ce une jurisprudence audacieuse ou interprétative ?

Monsieur Séners, votre maîtrise des sujets et la pertinence de vos propos montrent que votre aptitude à occuper ces hautes fonctions semble acquise.
La notion d'identité constitutionnelle de la France est essentielle. C'est un peu le dernier rempart dont nous disposons contre la primauté du droit européen. Mais nous n'aurons pas le temps d'aborder ce point.
Il me semble qu'une forme de dialogue serait possible entre le Conseil constitutionnel et le Parlement. Comment le faire vivre ? Par des colloques et des conférences, des ateliers de jurisprudence, des interventions des parlementaires directement devant le Conseil constitutionnel, des contributions extérieures ? Le cas échéant, cela pourrait-il se faire dans le cadre du contrôle préalable ou lors de l'examen de QPC ?
Concernant la nature législative des ordonnances non ratifiées, la jurisprudence du Conseil constitutionnel me semble paradoxale. L'intention première du Conseil me semble éminemment louable, étant donné l'inflation des ordonnances et le faible taux de ratification. Partant de ce constat, le Conseil a estimé légitime d'exercer un contrôle, au titre de la QPC, de ces trop nombreuses ordonnances non ratifiées.
Cependant, le premier paradoxe est de découvrir, au bout de soixante ans de consensus, que ces ordonnances non ratifiées sont de nature législative. Voilà une première surprise.
Le deuxième paradoxe est qu'une percée conceptuelle d'une juridiction repose en principe sur un risque de déni de justice. Il est difficile d'imaginer que ce risque ait existé, car ces actes pouvaient bien être jugés par un juge.
Le troisième paradoxe, fondamental, est que le souhait de consolider la nature législative de ces ordonnances conduit à affaiblir la loi. Les ordonnances non ratifiées sont de nature réglementaire, comme en dispose la Constitution, et il ne peut en être autrement, au nom des principes démocratiques. L'élaboration de la loi peut être temporairement confiée au pouvoir exécutif - c'est le sens de l'article 38 de la Constitution - pour une durée déterminée, et sous réserve de la ratification par le Parlement de ce qui est produit. Le texte est clair. Ce qui n'est pas ratifié ne peut devenir législatif et reste évidemment réglementaire.
Cette jurisprudence me semble donc audacieuse. L'intention est louable, mais le résultat est perturbant.
Concernant les cavaliers, dont les censures augmentent, je serais moins catégorique. L'intention est tout aussi louable. Le Conseil constitutionnel a fait émerger un objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi. Outre la réforme de 2008, qui assouplissait les conditions de dépôt des amendements en première lecture, l'idée que la loi ne soit pas un fourre-tout me semble légitime. Le balancier est-il allé trop loin ? Les assemblées ont une responsabilité en la matière, car elles assurent elles-mêmes le contrôle de la recevabilité des amendements. Le constituant devra peut-être revenir sur cette question.
En cas d'acceptation d'un amendement à l'Assemblée nationale, retoqué au Sénat au nom de l'article 45 de la Constitution, je vous ferai une réponse qui n'est pas une réponse de Normand...
Si les caractéristiques d'un cavalier sont réunies, la censure doit être prononcée.
Quant à la question de savoir si le « deux poids, deux mesures » entre les deux assemblées serait un motif de censure constitutionnelle, je préfère réserver ma réponse. Si j'avais l'honneur de siéger au Conseil constitutionnel, cette question appellerait une délibération collégiale.
Les 227 censures et réserves d'interprétation sur 900 QPC déposées sont nombreuses, effectivement. Il faut cependant assumer les conséquences de la réforme de 2008, qui s'explique par le fait que nous venons de vivre une forme de décennie de déstockage des dispositions contestables. Le résultat, certes, peut paraître préoccupant : un quart des QPC a abouti à une censure ou à une réserve d'interprétation.
L'instrument de la QPC n'ouvre pas le même champ de jurisprudence que le contrôle de constitutionnalité a priori. Seuls les droits et libertés garantis par la Constitution peuvent faire l'objet d'une QPC, ce qui laisse au législateur un nombre considérable de dispositions qui ne peuvent faire l'objet d'un tel contrôle.
Madame de la Gontrie, la décision sur la fraternité fait partie des jurisprudences audacieuses. Un mot n'a pas forcément valeur de droit positif. Si j'écris « liberté », je peux composer un magnifique poème, mais je ne pose pas une règle de droit. Si j'écris que la liberté permet de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, j'énonce une règle normative. Concernant la fraternité, le mot apparaît trois fois dans la Constitution : dans la devise de la République, ainsi que dans des dispositions portant sur l'outre-mer, dans lesquelles la fraternité est qualifiée d'« idéal ». Cela en fait-il pour autant un principe à valeur constitutionnelle ? C'est ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel. Je n'y suis en rien opposé par principe. Cependant, la question ne faisait pas consensus, et il n'était pas illégitime que le Conseil constitutionnel renvoie la question au constituant. Voilà, madame de la Gontrie, ce que j'entendais par « retenue » ; en reconnaissant ce principe, n'oublions pas que le Conseil a censuré des dispositions législatives. Idéalement, une telle innovation doit être prévisible. De plus, une telle décision me semble relever davantage de la légitimité du constituant.
Concernant le droit européen, je n'ignore pas toute la force de notre adhésion au droit européen et la nécessité de la cohérence d'ensemble de l'ordre juridique de l'Union. Le Conseil constitutionnel joue un rôle majeur en la matière, car la transposition des directives fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité pour les lois de transposition, ce qui constitue une rupture avec la jurisprudence dite « IVG », dans laquelle le Conseil avait renvoyé aux juridictions de droit commun le soin d'exercer ce contrôle. Aujourd'hui, le Conseil se saisit du droit de l'Union pour les lois de transposition. La combinaison de notre droit interne et du droit de l'Union est effectivement un sujet majeur.
Je ne verrai, à titre personnel, que des avantages à la parité dans la composition du Conseil constitutionnel. Comme pour la parité dans les collectivités locales, il faudrait en passer par une révision de la Constitution ; c'est au constituant de se saisir du sujet.
Concernant les règles de déport, cela relève d'abord de la police interne d'un collège. Ces règles me semblent essentielles à la crédibilité de l'institution. Dans le règlement spécifique à la procédure de QPC, des règles de déport existent, ainsi que des règles de récusation, qui restent perfectibles. En revanche, il n'y a pas de règles de déport pour l'examen a priori des lois. Le président Fabius souhaite émettre des règles en ce sens. J'y suis favorable.
Les procédures électorales ont, en effet, beaucoup évolué. Nous partions, certes, de loin. La possibilité d'entendre les parlementaires constitue un progrès considérable en matière de contradictoire, mais je reconnais que nous pouvons encore progresser.
Monsieur Bas, le Conseil constitutionnel peut améliorer l'équilibre des pouvoirs institutionnels tout d'abord en veillant au respect strict des règles procédurales. Le vote d'une loi organique, dans le contexte de la crise sanitaire, n'a pas respecté les délais d'adoption : nous aurions pu nous attendre à un feu rouge du Conseil constitutionnel, ce ne fut pas le cas.
J'en viens à la question des amendements du Sénat : le Conseil constitutionnel, en 2015, contre la lecture de l'Assemblée nationale, a imposé la capacité pour celle-ci de reprendre en nouvelle lecture des amendements du Sénat, ce qui me semble une intervention tout à fait légitime.
Concernant les modalités de révision de la Constitution, j'appréhende aujourd'hui la question comme un juge qui se laisse guider par la conformité aux textes. Contrairement à l'article 11, l'article 89 est un article dédié à la révision de la Constitution. Pour un juriste normalement formé par ses maîtres, la règle spéciale déroge à une règle générale. Il n'est donc, en l'espèce, pas facile de retenir une règle générale, qui porte sur des dispositions beaucoup plus larges.
Monsieur Bonnecarrère, dans le dialogue des juges, le mot clef est bien le « dialogue ». Le seul fait de se parler et de se rencontrer permet de réduire les difficultés. À la troisième chambre de la section du contentieux au Conseil d'État, compétente en matière fiscale, nous avions pris l'habitude, une fois par an, de rencontrer l'ensemble des juges du contentieux fiscal du Conseil d'État et les fiscalistes du ministère des finances, simplement pour débattre ensemble des problèmes de fond et de difficultés d'interprétation de la jurisprudence. De ce dialogue, qui n'entachait en rien l'indépendance des juges et de l'administration, naissait toujours une meilleure compréhension des enjeux. La même logique devrait prévaloir entre le Parlement et le Conseil constitutionnel. Initier un processus d'abord informel serait sans doute la meilleure solution ; il serait pragmatique de se rencontrer, par exemple, une fois par an, pour échanger autour d'un programme de travail préétabli. Le processus pourrait ensuite se structurer. Cette orientation est éminemment souhaitable.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Vote et dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination par le président du sénat de m. françois séners pour siéger au conseil constitutionnel
Vote et dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination par le président du sénat de m. françois séners pour siéger au conseil constitutionnel

Nous avons procédé à l'audition de M. François Séners, que le président du Sénat envisage de nommer au Conseil constitutionnel.
Nous allons maintenant procéder au vote sur cette proposition de nomination.
Il se déroulera à bulletins secrets, comme le prévoit l'article 19 bis de notre Règlement. En application de l'article 3 de la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les délégations de vote ne sont pas autorisées.
Je vous rappelle que le président du Sénat ne pourrait pas procéder à la nomination de M. François Séners si les votes négatifs au sein de notre commission représentaient au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.
La commission procède au vote puis au dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination, par le président du Sénat, de M. François Séners aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants : 30
Bulletins blancs : 5
Bulletins nuls : 4
Suffrages exprimés : 21
Pour : 20
Contre : 1
La commission donne un avis favorable à la nomination, par le Président du Sénat, de M. François Séners aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel.
Audition de Mme Jacqueline Gourault candidate proposée par le président de la république aux fonctions de membre du conseil constitutionnel
Audition de Mme Jacqueline Gourault candidate proposée par le président de la république aux fonctions de membre du conseil constitutionnel

Madame, nous vous souhaitons la bienvenue pour votre audition, qui fait suite à la proposition du Président de la République de vous nommer membre du Conseil constitutionnel en remplacement de Mme Nicole Maestracci, en application des dispositions de l'article 56 de notre Constitution.
Cette audition, qui suit celle que vous venez d'avoir à l'Assemblée nationale, intervient en vertu de ce même article, qui prévoit l'application de la procédure de l'article 13, alinéa 5, de notre Constitution.
Elle sera suivie d'un vote, dans les conditions prévues par la loi organique et la loi ordinaire du 23 juillet 2010. Je rappelle que le Président de la République devra renoncer à votre nomination si les votes négatifs qui s'exprimeront au sein des deux commissions des lois représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le vote aura lieu à la suite de notre audition.
Cette audition a un caractère public et est ouverte à la presse. Nous procéderons au dépouillement à son issue, de manière simultanée avec l'Assemblée nationale. Je rappelle que les délégations de vote ne sont pas autorisées.
Je précise que j'ai présenté aux membres de la commission, ce matin, avant de vous recevoir, des indications sur votre parcours, dont vous pourrez naturellement mettre en valeur certains éléments.
Sur le fond, cette audition vise surtout à ce que vous nous exposiez ce que vous pensez pouvoir apporter au Conseil constitutionnel en qualité de rapporteure ou lors des délibérations collectives, et ce que vous pensez de ce que doit être le positionnement du Conseil au sein de notre démocratie.

Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est avec une certaine émotion que je reviens aujourd'hui au Sénat, où j'ai siégé pendant tant d'années, à vos côtés, au sein de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous les présidences de Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Sueur et Philippe Bas.
Je mesure l'immense honneur que représente pour moi la proposition du Président de la République de me nommer au Conseil constitutionnel. Si votre commission et celle de l'Assemblée nationale l'approuvent, je rejoindrai deux anciens sénateurs, François Pillet et Jacques Mézard, ce qui est, je crois, une belle reconnaissance pour notre Haute Assemblée.
Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à cette proposition de nomination. Je l'ai accueillie avec la plus grande solennité, avec détermination, mais aussi avec humilité, car mes origines, mon parcours, dont vous avez, monsieur le président, rappelé les grands jalons, ne m'y prédestinaient pas particulièrement. J'ai grandi à Montoire-sur-le-Loir, au coeur du Vendômois, dans un milieu rural et agricole. Je suis un pur produit de l'école républicaine. Mon parcours a été celui de millions de Français : école communale, collège, lycée, université. J'ai ensuite choisi l'enseignement, et j'ai été fière d'exercer pendant vingt-cinq ans cette fonction, que je considère comme l'une des plus belles, mais aussi des plus exigeantes.
En 1989, je suis élue maire de La Chaussée-Saint-Victor, près de Blois, une commune de 4 500 habitants située au bord de la Loire, à une époque où, je dois le dire, peu de femmes accédaient à des responsabilités politiques. J'ai exercé pendant vingt-cinq ans ce beau mandat. Il a construit la femme politique que je suis. J'en ai gardé le goût de la proximité et du pragmatisme. J'ai aussi pu mesurer les difficultés concrètes qui se posent chaque jour à nos élus locaux et à leurs administrés.
En parallèle, j'ai également pu exercer à tous les autres échelons des collectivités locales, puisque j'ai été conseillère régionale, conseillère départementale et présidente d'une communauté d'agglomération. Ces mandats locaux m'ont conduite assez naturellement dans la chambre des territoires qu'est le Sénat, où j'ai siégé durant quinze ans. J'ai pris part, à vos côtés, à la fabrique de la loi. J'ai été durant toutes ces années et je reste aujourd'hui une fidèle défenseure du Parlement, en particulier du bicamérisme, dont j'ai toujours considéré qu'il était un socle essentiel à l'exercice de la démocratie de notre République.
C'est avec ces convictions que, en 2017, j'ai rejoint le Gouvernement. Nous avons eu, durant ces cinq années, de nombreuses occasions de travailler ensemble, en particulier, ces derniers mois, avec la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS), qui a été promulguée hier, mais aussi avec la loi organique d'application de l'article 72 de la Constitution ou la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, sur lesquelles nous avons oeuvré pour trouver des marges de manoeuvre concrètes dans le cadre du principe constitutionnel d'égalité. Ces lois ont été des illustrations du principe de différenciation, que j'appelais de mes voeux. Elles démontrent qu'il est possible de reconnaître la diversité de nos territoires, qui est une immense richesse, tout en garantissant l'unité de la République. Je pourrais aussi, bien sûr, évoquer le projet de révision constitutionnelle qui prévoyait les adaptations nécessaires à une meilleure organisation des pouvoirs locaux, mais qui n'a pas pu aboutir, comme vous le savez.
En somme, j'ai pratiqué « de l'intérieur » toutes les institutions politiques qui forment notre République aux plans local comme national, à l'exception de l'Assemblée nationale, mais, comme je l'ai dit à vos collègues députés ce matin, ce n'est pas faute d'y avoir passé du temps ces cinq dernières années.
Mon approche et ma méthode, vous les connaissez : c'est le dialogue et la recherche in fine du juste équilibre. C'est ce qui a guidé mon action tout au long de ma vie politique, en particulier ces derniers mois, dans le cadre du projet de loi 3DS, où nous avons su trouver ensemble des solutions à des questions difficiles. Cette culture de l'écoute et du débat correspond d'ailleurs pleinement, je crois, au fonctionnement collégial du Conseil constitutionnel.
J'ai aussi beaucoup traversé la France. Je me suis confrontée au terrain en tant que ministre, comme parlementaire et comme élue locale.
Ces expériences m'ont donné une appréciation concrète et humaine des enjeux qui traversent la société. Elles m'ont aussi donné du recul sur le cadre normatif qui régit notre République et qui garantit l'équilibre de nos pouvoirs.
Le recul est, je crois, une qualité importante d'un juge constitutionnel, qui doit en permanence arbitrer et concilier les principes constitutionnels, entre égalité et droits de propriété, liberté individuelle et intérêt général, libre administration et équilibre des comptes publics. Arbitrer et concilier, c'est d'ailleurs aussi ce que font beaucoup d'élus, les maires en particulier, pour trouver le bon équilibre entre des aspirations en apparence contradictoires.
Si vous approuvez ma nomination, je m'engagerai de manière résolue à défendre notre bloc de constitutionnalité, qui est au sommet de la hiérarchie des normes : notre Constitution de 1958, adoptée par référendum par le peuple français, sous l'impulsion du général de Gaulle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui inspire le monde depuis plus de deux cents ans, le préambule de 1946 et ses conquêtes sociales issues du programme du Conseil national de la Résistance, la Charte de l'environnement, qui a posé, dès 2005, des principes d'une grande actualité.
Ce bloc de constitutionnalité, c'est notre bien commun, c'est le cadre à partir duquel nous faisons société. Il porte la marque de notre histoire et de nos combats collectifs, mais il est aussi profondément moderne et vivant. C'est peut-être cela qui fait la longévité de notre régime constitutionnel, qui deviendra, l'année prochaine, le plus long que notre pays ait connu.
Le Conseil constitutionnel est une institution qui s'inscrit dans son temps, comme en témoigne le succès de la procédure des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), introduite dans notre droit à l'initiative du président Nicolas Sarkozy.
C'est une institution dans la cité, à l'image, d'ailleurs, des audiences hors les murs lancées par le président Laurent Fabius.
C'est une institution de l'urgence parfois, comme elle n'a notamment montré durant la crise terroriste ou la crise sanitaire que nous connaissons depuis deux ans, mais c'est aussi une institution du temps long, qui sait faire preuve de constance et de stabilité.
Son rôle est non pas d'être une troisième chambre, comme on peut parfois l'entendre, mais bien de rester un garant vigilant de l'équilibre des pouvoirs, des libertés individuelles et collectives, de l'égalité des droits, en créant du consensus autour de ce qui nous rassemble, nos valeurs constitutionnelles.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai acquis tout au long de ma vie une connaissance concrète des institutions de la République, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, de l'organisation des élections, du rôle des partis, de la décentralisation, de la manière dont s'élabore la norme et dont elle s'applique concrètement dans le quotidien des élus et de nos concitoyens.
Je suis prête à franchir une nouvelle étape et à mettre ces quarante années d'expérience et de responsabilité publique au service de la défense des institutions de notre pays. Je suis prête aussi à abandonner l'arène politique et le débat public. Je serai au Conseil constitutionnel non pour défendre un programme, mais pour exercer ma mission de juge constitutionnel, en toute indépendance et de manière impartiale, pour défendre avec détermination la République et sa Constitution.

Aux termes de l'article 57 de la Constitution, « les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. »
Ne serait-il pas opportun, dans le cadre d'une future loi organique, d'imaginer un délai de vacance - de « viduité » pour reprendre un mot en usage dans le droit civil, notamment en matière de divorce - après la cessation des fonctions, afin d'éviter les déports systématiques ?

Madame, je vais vous poser deux questions qui n'étonneront pas mes collègues.
La première concerne les ordonnances. Vous n'ignorez pas que le Conseil constitutionnel a décidé de donner valeur législative à des ordonnances, afin, a-t-il dit, de rendre celles-ci susceptibles de QPC, ni que le Sénat a adopté, à une très large majorité, une proposition de loi visant à rappeler que la Constitution, depuis 2008, prévoit que les ordonnances ne peuvent donner lieu qu'à une ratification expresse par le Parlement.
Approuvez-vous ou non cette décision du Conseil constitutionnel ? Cette question, très précise, appelle une réponse qui le soit tout autant.
Ma seconde question concerne les cavaliers. Vous savez que la jurisprudence du Conseil constitutionnel a complètement changé : voilà trente ans, pratiquement aucun amendement n'était déclaré inconstitutionnel parce qu'il allait au-delà du libellé du projet de loi. Nous sommes passés de cette position extrêmement ouverte - il n'y avait pratiquement pas de restrictions - à une position inverse, puisque, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles beaucoup de dispositions ayant pourtant un rapport, bien que parfois indirect, avec le texte, ce qui me paraît porter atteinte à la liberté d'amendement qui est consubstantielle à notre fonction. Approuvez-vous ou non cette évolution ?

Votre nomination faite suite à deux nominations par un Président de la République de ministres en exercice ou ayant récemment quitté leurs fonctions, MM. Laurent Fabius et Jacques Mézard. Il semble que cela devienne assez habituel.
Toutefois, compte tenu du débat existant aujourd'hui en Europe sur la primauté du droit européen et les identités constitutionnelles, et alors que l'on essaie d'établir de manière claire, dans l'ensemble de l'Union européenne, des règles d'État de droit et d'indépendance de la justice, considérez-vous que ce type de nomination, consistant, pour le candidat, à passer directement de l'arène politique et de l'exécutif à une fonction de juge constitutionnel soit un bon exemple pour d'autres pays européens ? Je crois que tout le monde vous apprécie ici, mais la question mérite, me semble-t-il, d'être posée.
Deuxièmement, l'objet de cette audition est d'avoir des réponses sur ce que vous pourriez faire, en tant que juge constitutionnel, sur des points précis qui peuvent nous interpeller. Quelle serait votre attitude si le Conseil constitutionnel était saisi d'un projet de référendum, déposé en vertu de l'article 11, qui porterait une révision constitutionnelle, donc en contournement de l'article 89 ? Quel rôle, selon vous, le Conseil constitutionnel doit-il avoir dans un tel cas ?

En dix ans, le Conseil constitutionnel a été saisi plusieurs centaines de fois pour trancher des questions prioritaires de constitutionnalité et a eu l'occasion de censurer plus de 200 lois.
Dans une réponse écrite que vous avez apportée à un questionnaire adressé par la commission des lois de l'Assemblée nationale concernant les modalités de votre participation aux délibérations, eu égard à votre expérience de parlementaire et aux fonctions de ministre que vous avez exercées durant cinq ans, vous avez indiqué : « je m'abstiendrai de délibérer s'agissant notamment des questions sur lesquelles j'ai été amenée à m'exprimer publiquement comme parlementaire ou membre du Gouvernement. » Peut-on conclure de votre réponse que vous considérez que les règles de déport ne sont applicables que lorsqu'il y a eu une expression publique, et non une participation à une délibération ?
Par ailleurs, comment allez-vous pouvoir exercer votre mandat de membre du Conseil constitutionnel, dès lors que vous avez été parlementaire pendant seize ans et ministre pendant cinq ans et que vous considérez vous-même que vous ne pouvez pas participer aux délibérations qui portent sur des sujets que vous avez traités ?
En deuxième lieu, je souhaite connaître la position que vous auriez adoptée si vous aviez participé à la délibération du Conseil constitutionnel qui a donné lieu à la décision du 17 mai 2013 sur la loi sur le mariage pour tous. Vous avez voté contre cette loi. Membre du Conseil constitutionnel, en auriez-vous envisagé la censure ?

Madame, je vous remercie de nous avoir rappelé que vous êtes une législatrice, comme sénatrice ayant participé durant un certain nombre d'années aux travaux de la commission des lois. Cela ne suffit peut-être pas à faire de vous une juriste - vous avez eu l'humilité de le reconnaître -, mais cela suffit à vous qualifier comme législateur.
Il me semble que le Conseil constitutionnel n'a pas seulement besoin de juristes. Il a aussi besoin de personnalités qui connaissent la société française. Je crois que les mandats locaux que vous avez exercés, votre activité de sénatrice, vos fonctions ministérielles sont des qualifications pour entrer au Conseil constitutionnel. Juristes, professeurs de droit et magistrats ne sauraient avoir le monopole de la capacité de siéger au Conseil constitutionnel, qui est une juridiction d'une nature particulière.
Il est très important que vous ayez également rappelé votre volonté d'indépendance et d'impartialité. Elle vous est garantie, si vous êtes nommée, par le statut des membres du Conseil constitutionnel, la longueur du mandat, le statut matériel, avec des contreparties qui sont aussi des sacrifices pour une personnalité ayant apprécié les fonctions électives, puisque vous n'aurez plus la parole. Cette réserve est également un élément très important pour la réputation d'indépendance et d'impartialité du Conseil ; il faut évidemment la respecter.
Je veux vous interroger sur l'équilibre des pouvoirs. Dans nos institutions, bien au-delà de ce que le général de Gaulle avait pu envisager, il y a une unité fonctionnelle entre le Président de la République, le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale, qui a pu faire dire que la loi est devenue la loi de l'exécutif plus que celle du Parlement - surtout, évidemment, quand le Sénat ne l'a pas votée.
J'aimerais vous entendre dire que, lorsque des questions de procédure législative seront soulevées - je pense notamment aux habilitations législatives -, vous serez du côté du Parlement contre les abus de pouvoir éventuels du bloc exécutif. Ferez-vous respecter les droits du Parlement ? En particulier, il est très important que vous puissiez nous dire votre conviction personnelle sur le fait que l'on ne puisse pas, aujourd'hui, en France, réviser la Constitution sans vote du Parlement.

Premièrement, je veux exprimer mon étonnement : vous n'avez pas cité, dans le bloc de constitutionnalité, les « principes particulièrement nécessaires à notre temps ». Je pense pourtant que c'est une composante importante du bloc de constitutionnalité.
Deuxièmement, de manière plus fondamentale, il y a deux façons de concevoir les cours constitutionnelles. Dans la première, « française » si je puis dire, le Conseil n'est pas encore une cour constitutionnelle et, de ce fait, comprend des membres qui n'ont pas forcément d'expérience juridique ou qui ne sont pas politistes.
Dans la seconde, qui correspond aux visions allemande ou américaine, ce sont avant tout l'expérience juridique, l'expérience en matière de sciences politiques qui sont appréciées.
Ma question est très simple : ne pensez-vous pas que l'on devrait évoluer et passer d'une logique de conseil constitutionnel à une logique de cour constitutionnelle ? Ne pensez-vous pas que l'expérience est nécessaire ? Par ailleurs, le modèle de la cour constitutionnelle n'est-il pas le meilleur pour éviter les accusations de politisation, récurrentes s'agissant du Conseil constitutionnel ?

Monsieur Kanner, vous proposez qu'un ministre ne puisse être nommé au Conseil constitutionnel avant un certain laps de temps. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'un ministre en exercice est nommé : il y a eu de telles nominations sous toutes les majorités - y compris par le général de Gaulle.
Je pense que l'indépendance est garantie par ce qu'a évoqué Philippe Bas, à savoir un renouvellement par tiers tous les trois ans, qui permet de refléter le turn-over des majorités, et une nomination pour neuf ans : le juge constitutionnel ne dépend plus, durant neuf ans, d'aucune instance politique. Il est inamovible : s'il quitte le Conseil constitutionnel, c'est pour des raisons qui lui sont propres.
Monsieur Sueur, je dois dire que je m'attendais à ce que vous m'interrogiez sur les ordonnances, compte tenu du texte qui a été voté au Sénat. Le Conseil constitutionnel a décidé récemment que, faute de ratification dans le temps imparti par la loi d'habilitation, l'ordonnance, qui n'était que réglementaire, devient législative. Je suis aujourd'hui devant vous pour défendre ma candidature au Conseil constitutionnel, non pour commenter ce qu'il a décidé.
En ce qui concerne les cavaliers, il est vrai qu'il y a eu une évolution. Autrefois, c'est le Gouvernement et lui seul qui déclarait, après avoir été saisi, qu'un amendement était un cavalier. Depuis la réforme de 2008, tout amendement est recevable dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte. Cette décision, qui est une petite révolution, est venue formaliser l'article 45 de la Constitution dans sa version actuelle. Alors que le législateur voulait l'assouplir, le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur cet article pour valider le droit de considérer que des amendements étaient des cavaliers.
Cela dit, je veux insister sur l'évolution qu'a marquée la création du contrôle a priori des recevabilités par les commissions permanentes des deux chambres parlementaires. Ce contrôle n'existait pas avant 2014. Cela n'a pas été une exigence du Conseil constitutionnel : c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont décidé, devant l'inflation du nombre d'amendements, de reprendre au sein de leurs règlements respectifs les règles constitutionnelles en la matière, et de déclarer irrecevables, avant la discussion, les amendements n'y répondant pas - chacun sait que le règlement des assemblées est soumis au Conseil constitutionnel.
D'ailleurs, j'ai toujours entendu les députés dire que le Sénat avait été novateur en rédigeant son vade-mecum, qui permet, lors de la discussion en commission, d'avoir un référentiel pour apprécier si un amendement est ou non recevable au titre de l'article 45 de la Constitution. Il me semble que l'article 45 permet un certain équilibre entre le rôle des assemblées et celui du Conseil constitutionnel.
Monsieur Leconte, la primauté du droit européen fait actuellement débat, compte tenu d'un certain nombre d'événements qui se sont passés en Europe, comme la remise en cause du principe même des traités de l'Union européenne par la Pologne, ou encore le jugement, contraire à l'avis de la Cour européenne, qui a été rendu il y a deux ans par la Cour de Karlsruhe sur une question préjudicielle - il n'a d'ailleurs pas été suivi par le gouvernement allemand.
Pour ma part, j'ai des idées assez claires : l'Europe a d'abord été construite avec une volonté de paix, pour développer la démocratie et l'État de droit dans les États membres, les traités traduisant la volonté de ses derniers d'adhérer à ces principes. En tant qu'ancienne professeure d'histoire-géographie, je suis consciente de l'importance de se rappeler les circonstances historiques.
Je suis donc convaincue que le droit européen doit être respecté - il est d'ailleurs transposé dans notre droit national - et qu'il devient notre droit à tous.
Cela n'empêche pas de considérer le principe d'identité constitutionnelle, sur lequel j'ai été interrogée lors de mon audition devant l'Assemblée nationale.
S'il existe des valeurs partagées, reconnues à la fois par le droit constitutionnel français et au niveau européen, il peut y avoir un certain nombre de points en discussion. Assez récemment, le Conseil constitutionnel a reconnu l'interdiction de transférer des pouvoirs de police administrative à des personnes privées comme une spécificité française. On peut penser à d'autres sujets, par exemple à la laïcité, qui est une identité tout à fait particulière de notre Constitution et qui représente, chez nous, quelque chose qui n'a pas de signification dans d'autres pays, même si le niveau européen reconnaît la liberté de conscience et la liberté de religion. Je crois donc que l'identité constitutionnelle est très importante.
Pour conclure sur ce point, je crois que le dialogue des juges est essentiel dans la recherche de la convergence entre le droit national et le droit européen. Je rappelle que ce sont les deux ordres de juridictions, c'est-à-dire le Conseil d'État et la Cour de cassation, qui sont chargés du respect des mesures conventionnelles dans notre pays.
Sur le référendum, la Constitution est assez claire : c'est avec l'article 89 que l'on touche à la Constitution. Le droit de référendum de l'article 11 concerne les organisations publiques, l'économie, des valeurs sociales etc. Chacun sait que le général de Gaulle a utilisé l'article 11 en 1962, ce qui lui a permis de modifier la Constitution pour y inscrire l'élection du Président de la République au suffrage universel, et en 1969, sans succès cette fois.
Bien évidemment, j'ignore, si le cas se présentait aujourd'hui, quelle serait la décision du Conseil constitutionnel, mais je sais que la décision « Hauchemaille » du Conseil permet un contrôle renforcé des textes portés par la question référendaire. C'est donc un outil supplémentaire pour faire respecter les principes de la Constitution et les différences entre l'article 11 et l'article 89.
Madame de La Gontrie, le déport est bien évidemment prévu dans le règlement du Conseil constitutionnel. Dans quels cas jugerai-je que je dois me déporter ? Certains cas sont absolument évidents. Par ailleurs, il y a, au Conseil constitutionnel, une collégialité, un président, des services juridiques, qui peuvent aider ses membres à trancher la question d'un déport. C'est une question de conscience, mais c'est aussi une question de légalité.
Vous m'avez interrogée sur le mariage pour tous. Quand je serai au Conseil constitutionnel, je ferai respecter la Constitution, peu importe mon opinion personnelle.
Monsieur Bas, je vous remercie pour vos mots. L'équilibre des pouvoirs est très important et le respect du Parlement est absolument fondamental. D'ailleurs, le pouvoir d'appréciation appartient au Parlement, non au Conseil constitutionnel, dont le rôle est de vérifier que la loi est conforme aux grands principes constitutionnels.
Il me semble que j'ai répondu à vos questions sur le référendum.
Monsieur Kerrouche, je considère que les ordres juridictionnels, tels qu'ils existent aujourd'hui en France, fonctionnent et sont très équilibrés.
J'ai regardé comment les choses fonctionnaient dans les autres pays de l'Union européenne. Je puis vous dire qu'il y a aussi des nominations politiques à la Cour de Karlsruhe ! C'est un mythe de penser que cela n'existe pas : les partis politiques ne sont pas absents du processus de nomination.
Je pense que le Conseil constitutionnel ne doit pas devenir une Cour suprême comme aux États-Unis. Le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel sont des « institutions faîtières », mais le Conseil constitutionnel ne chapeaute pas les deux ordres. Il est complémentaire. C'est un équilibre de nos institutions.
En tout état de cause, c'est avec cet état d'esprit que j'entrerai au Conseil constitutionnel, si vous me le permettez.

À ceux qui s'interrogent sur la nomination d'un membre du Gouvernement au Conseil constitutionnel, je veux rappeler que le doyen Vedel évoquait un « devoir d'ingratitude pour celui qui a été nommé à l'égard de celui qui l'a nommé. »
Je vous remercie, madame.
Vote sur la proposition de nomination par le président de la république de mme jacqueline gourault aux fonctions de membre du conseil constitutionnel
Vote sur la proposition de nomination par le président de la république de mme jacqueline gourault aux fonctions de membre du conseil constitutionnel

Nous avons procédé à l'audition de Mme Jacqueline Gourault, que le Président de la République envisage de nommer au Conseil constitutionnel.
Nous allons maintenant procéder au vote sur cette proposition de nomination.
Il se déroulera à bulletins secrets, comme le prévoit l'article 19 bis de notre Règlement. En application de l'article 3 de la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les délégations de vote ne sont pas autorisées.
Je vous rappelle que le Président de la République ne pourrait pas procéder à la nomination de Mme Jacqueline Gourault si les votes négatifs au sein de notre commission et de la commission des lois de l'Assemblée nationale représentaient au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
Les dépouillements des scrutins de l'Assemblée nationale et du Sénat auront lieu simultanément au sein des commissions lois des deux assemblées à 12 heures 20.
Il est procédé au vote.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Dépouillement des scrutins sur les propositions de nomination par le président de la république de m. julien boucher aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de mme jacqueline gourault aux fonctions de membre du conseil constitutionnel
Dépouillement des scrutins sur les propositions de nomination par le président de la république de m. julien boucher aux fonctions de directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de mme jacqueline gourault aux fonctions de membre du conseil constitutionnel
La commission procède au dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination, par le Président de la République, de M. Julien Boucher aux fonctions de directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, simultanément à celui de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants : 30
Bulletin blanc : 1
Bulletin nul : 0
Suffrages exprimés : 29
Pour : 28
Contre : 1
Agrégé à celui de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le résultat est le suivant :
Nombre de votants : 45
Bulletin blanc : 1
Bulletin nul : 0
Suffrages exprimés : 44
Seuil des trois cinquièmes : 27
Pour : 42
Contre : 2
La commission procède au dépouillement du scrutin sur la proposition de nomination, par le Président de la République, de Mme Jacqueline Gourault aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel, simultanément à celui de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants : 31
Bulletins blancs : 3
Bulletin nul : 0
Suffrages exprimés : 28
Pour : 12
Contre : 16
Agrégé à celui de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le résultat est le suivant :
Nombre de votants : 76
Bulletins blancs : 3
Bulletin nul : 1
Suffrages exprimés : 72
Seuil des trois cinquièmes : 44
Pour : 41
Contre : 31
La réunion, suspendue à 12 h 25, est reprise à 14 heures.

Nous examinons en nouvelle lecture la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation. La commission mixte paritaire a échoué. L'Assemblée nationale a choisi de reprendre son texte de première lecture, en retenant simplement, parmi nos propositions, le principe d'un délai de réflexion, mais en le réduisant de trois à un mois. Les principaux points d'achoppement ont été la question de la situation des mineurs et celle de la désignation de l'administration chargée de la procédure simplifiée de changement de nom. Le Sénat souhaitait que celle-ci relève d'abord du ministère de la justice, et non des services d'état civil des mairies.

Après l'échec de la commission mixte paritaire du 17 février dernier, nous sommes appelés à nous prononcer en nouvelle lecture sur la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation, adoptée lundi par l'Assemblée nationale.
Ce texte important, tant du point de vue des principes qu'il met en jeu que des conséquences qu'il peut avoir sur la vie de nombreux concitoyens et leur famille, a été examiné en toute fin de session avec une célérité qui ne me semble pas justifiée.
Nous avons toutefois réussi à mener nos travaux avec sérieux et en faisant appel à l'expertise de nombreux professionnels : magistrats, avocats, personnels de mairie, professionnels de la petite enfance, professeurs de droit... C'est leur analyse qui a nourri la position de notre commission, puis du Sénat, et non des partis pris idéologiques comme certains l'ont suggéré !
Le Sénat n'a pas été hostile à cette proposition de loi. Il a été conscient de la nécessité de simplifier les démarches de changement de nom pour répondre à certaines situations particulièrement problématiques.
Nous avons réussi à « converger » sur certains points, ce que les députés ont semblé oublier !
Nous avons accepté une souplesse accrue sur le nom d'usage, pour apporter une solution rapide aux personnes majeures qui souffrent dans leur vie quotidienne de devoir utiliser le nom d'un parent maltraitant ou délaissant ; une procédure de changement de nom simplifiée - sans justification d'un intérêt légitime - dès lors que le changement de nom consiste à choisir un nom issu de sa filiation ; et le principe de redonner aux adultes le même choix que celui des parents à la naissance de leur enfant, dans le cadre de l'article 311-21 du code civil, que ce soit pour leur nom d'usage ou leur nom de famille.
Le Sénat a également adopté conformes l'article 2 bis, qui donne compétence à une juridiction qui prononce un retrait de l'autorité parentale de se prononcer sur un changement de nom du mineur, et l'article 3, qui supprime l'intervention du tuteur pour un changement de prénom du majeur protégé.
Deux points de divergences demeuraient toutefois et ils ont été suffisamment importants pour empêcher de trouver un compromis en CMP. Le premier concerne la situation des mineurs et le second le rôle des communes. Je vais en rappeler brièvement les enjeux.
Toute notre réflexion a été construite autour de l'idée qu'un enfant ne fait pas la différence entre un nom d'usage et un nom de famille : le faire connaître dans sa vie de tous les jours sous un autre nom - ce qui est le propre du nom d'usage qui n'est pas une simple mention administrative - équivaut, en pratique, à lui faire changer de nom.
De ce fait, l'article 1er de la proposition de loi présente un défaut de conception puisqu'il est fondé sur l'idée qu'il serait légitime de changer le nom d'un enfant pour faciliter la vie quotidienne d'un parent, en l'occurrence la mère qui n'aurait plus à montrer son livret de famille, ou pour« restaurer l'égalité parentale ».
Nous avons été soucieux de ne pas perturber l'enfant dans la construction de son identité et sa vie sociale dans un contexte conflictuel ou hors intervention du juge.
Nous n'avons pas souhaité autoriser une substitution de nom pour les mineurs à titre d'usage. Nous n'avons pas accepté non plus la solution proposée par les députés pour répondre à la demande de simplification exprimée par le collectif « Porte mon nom ». Il s'agirait de permettre à un parent de décider seul, au cours de la minorité de son enfant, d'adjoindre à titre d'usage son nom de famille au nom de l'enfant, à charge pour lui d'en informer en temps utile préalablement l'autre parent pour que celui-ci puisse saisir le juge aux affaires familiales (JAF) en cas de désaccord.
Cette disposition pourrait créer des situations instables dans lesquelles l'enfant serait nommé différemment selon qu'il est chez son père ou sa mère, et devrait revenir à son nom d'origine si le juge considérait qu'il n'est pas de son intérêt d'adjoindre l'autre nom.
À l'article 1er, le Sénat a donc préféré s'en tenir au droit existant pour les mineurs et maintenir la nécessité d'un accord des deux parents, s'ils exercent conjointement l'autorité parentale, ou d'une décision du JAF.
Quant à la procédure de changement de nom simplifiée de l'article 2, ses effets sur les enfants mineurs ne semblent pas avoir été suffisamment expertisés. Si l'on peut concevoir qu'un majeur puisse une fois dans sa vie choisir son nom par simple déclaration, sans aucune justification, il semble inopportun que ce changement de nom ait un effet automatique « par ricochet » sur les enfants de moins de 13 ans, sans aucun contrôle, ni information de l'autre parent.
Le deuxième point de blocage concerne les communes : nous n'avons pas souhaité que la simplification du fonctionnement de l'administration centrale du ministère de la justice se fasse au détriment des services de l'état civil des mairies.
La procédure de changement de nom par décret instituée par l'article 61 du code civil est critiquée depuis des années pour son caractère long, coûteux et aléatoire. Je n'y reviendrai pas. La procédure choisie dans le cadre de l'article 2 de la proposition de loi semble avoir été conçue de manière opportuniste pour pallier l'abandon d'un projet de numérisation et de dématérialisation de la procédure et les difficultés liées à la crise sanitaire.
En première lecture, nous avons proposé à titre d'alternative une procédure simplifiée qui resterait, comme aujourd'hui, centralisée auprès du ministère de la justice. Il s'agissait d'une procédure sur simple arrêté, et non plus sur décret du Premier ministre, que le ministère aurait engagé par téléprocédure, avec un formulaire Cerfa, pour rendre cette démarche facile et accessible à tous sur tout le territoire. Nous y avions apporté des garanties, avec l'institution d'une période de réflexion de trois mois et une recevabilité soumise à l'absence d'enfants mineurs pour éviter tout effet ricochet.
Cette solution du « juste milieu » n'a pas trouvé d'écho auprès des députés qui sont revenus à leur procédure initiale, sans autre changement que de prévoir un délai de réflexion d'un mois, ce qui semble insuffisant au regard de la portée de la démarche.
Les députés ont donc peu ou prou repris l'intégralité de leur texte de première lecture.
Ce n'est pas une surprise : après le passage de leur texte au Sénat, ils ont aussitôt dénoncé un « détricotage », sans même relever les avancées votées par notre assemblée et que j'ai rappelées. Les députés ont présenté notre position de manière caricaturale et refusé toute évolution destinée à mieux prendre en compte les mineurs et à ne pas transférer de tâche supplémentaire aux communes.
Je vous propose de prendre acte de la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons et de ne pas adopter de texte de commission, ce qui entrainerait un rejet de principe de l'amendement qui a été déposé.
Avec votre accord, je déposerai au nom de la commission la motion tendant à opposer au texte la question préalable dont vous avez eu le projet en vue de la séance.
Enfin, en application du vadémécum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre des dispositions restant en discussion sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture relative au choix du nom issu de la filiation. Je vous propose d'indiquer qu'elles portent sur : le nom d'usage, d'une part, et sur la procédure de changement de nom, d'autre part.

Le vrai « détricotage » consiste à défaire, avec une vision superficielle, une législation reposant sur l'indisponibilité de l'état des personnes qui a été instituée par la République dans l'intérêt de la protection des personnes. Il est facile de mettre en avant certaines situations particulières pour justifier ses bonnes intentions pour légiférer, mais il faut prendre en compte l'ensemble des cas, et évaluer toutes les conséquences d'un changement de la loi. Or, un changement du nom d'usage aurait des conséquences lourdes pour l'enfant ; tout changement pour des raisons de commodité pour le parent qui aurait la charge de l'enfant sans porter son nom mettrait aussi en péril le respect de l'autorité parentale exercée par l'autre parent. Cela fait beaucoup d'inconvénients pour résoudre un problème assez limité... Méfions-nous de ces textes de fin de législature par lesquels on cherche à changer la législation pour des raisons superficielles ou émotives. L'enfer est pavé de bonnes intentions... Je pense par exemple à la loi allongeant le délai de recours à l'IVG, à laquelle des gynécologues se sont opposés pour des raisons médicales. Il fallait que quelqu'un se levât pour dénoncer ces intentions pernicieuses. C'est ce qu'a fait notre rapporteure !

Je souscris tout à fait aux propos de Philippe Bas. Je m'interroge sur la qualité de ces textes qui interviennent en fin de mandat. Il est dommage d'en arriver à une question préalable, que je voterai, sur ce sujet qui aurait pu nous rassembler autour de la protection des intérêts de l'enfant. La procédure de changement de nom mérite d'être simplifiée. Il est dommage de ne pas approfondir la réflexion à travers une vraie nouvelle lecture. Toutefois, il faut veiller à ne pas charger la barque des communes sans contrepartie. J'aimerais que l'on dresse le bilan des charges qui ont été reportées sur les communes pendant ce quinquennat. Nous ne voulons pas bloquer le système, mais encadrer le transfert de cette compétence, en prévoyant des compensations financières. Je ne peux que regretter qu'un texte aussi important arrive seulement en fin de mandat.

En effet, c'est dommage ! Nous avons examiné ce texte en recherchant l'intérêt de l'enfant. Nous avons cherché un consensus, mais je pense que les députés n'avaient pas envie d'en trouver un. Finalement, cela me fait penser à cette phrase d'Antoine Blanc de Saint-Bonnet, philosophe du XIXe siècle : « On aime les événements ; cependant au milieu des choses qui passent, on devrait songer aux lois qui restent. »

Effectivement, un accord en CMP n'était pas inenvisageable.
La motion COM-2 est adoptée. En conséquence, la commission décide de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

J'avais déposé l'amendement COM-1, mais je suivrai notre rapporteure. Pour dialoguer il faut être deux ! En ce qui concerne nos échanges avec l'Assemblée nationale, j'ai l'impression que nous sommes revenus à la situation qui prévalait en 2017...

C'est juste !
Il résulte de la décision de déposer une motion que nous n'adopterons pas de texte en commission.
Le projet de loi n'est pas adopté.
Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
La réunion est close à 14 h 20.