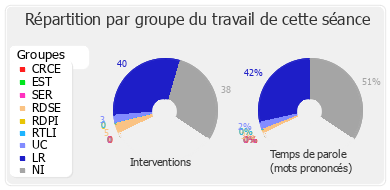Séance en hémicycle du 3 février 2009 à 16h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

Par lettre en date de ce jour, M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement m’a informé qu’en raison de la durée du débat sur le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement il retirait de l’ordre du jour prioritaire du Sénat, pour le reporter ultérieurement, le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés, et portant diverses dispositions relatives aux transports.
Acte est donné de cette communication.
En conséquence, ce projet de loi est retiré de l’ordre du jour des séances des mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 février.

Monsieur le président, j’apprécie beaucoup le fait que l’on décale l’examen du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés, et portant diverses dispositions relatives aux transports, eu égard à l’importance du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dit Grenelle I, dont nous avons commencé l’examen la semaine dernière.
J’aimerais d’emblée couper les ailes à des « canards » qui circulent, si vous me permettez cette image : nos travaux se déroulent dans un climat de sérénité, sur un rythme qui me paraît correct et dans les conditions habituelles, rapporteur et membres du Gouvernement à l’écoute, comme il est normal pour un débat parlementaire.
Permettez-moi maintenant d’émettre un vœu, même si ma demande risque fort d’être refusée. Mais, après tout, cent pour cent des gagnants ont tenté leur chance !
Sourires

Compte tenu de l’importance du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, je souhaite que le vote sur l’ensemble n’ait pas lieu en catimini un vendredi soir.
Monsieur le président, dans la ligne des réflexions du groupe de travail sur l’application de la révision constitutionnelle, dite commission Larcher, ne serait-il pas possible d’anticiper sur les décisions à venir et de reporter le vote sur l’ensemble du projet de loi à mardi prochain ? Compte tenu de l’implication de tous nos collègues, sur quelque travée qu’ils siègent, et de l’intérêt que nous portons tous à ce texte – j’en veux pour preuve le nombre d’amendements déposés – il conviendrait, me semble-t-il, de donner ainsi plus de solennité au vote final.
Vous me rétorquerez qu’une telle possibilité ne figure pas encore dans le règlement. Par conséquent, je m’en remets à votre bonne volonté, monsieur le président, et je vous remercie déjà d’avoir reçu ma requête.

Mon cher collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
J’évoquerai cette question demain soir en conférence des présidents. Vous connaissez l’importance des pratiques initiales !
Je me réjouis d’être aujourd’hui sollicité dans cet hémicycle pour que soit appliquée une disposition qui fait l’objet de discussions depuis un peu plus de trois mois. J’ose croire que la sérénité à laquelle vous avez fait allusion est de bon augure pour les débats que nous aurons sur notre futur règlement !
Cela dit, je reste très attentif au respect du règlement actuel, ce qui relève de ma responsabilité. Mais, je le répète, soyez sûr que votre demande sera évoquée demain soir en conférence des présidents.

M. le président. Je me dois en effet de porter la parole d’un sénateur si désireux d’anticiper sur le nouveau règlement qu’il ne peut attendre l’examen, mardi prochain, du projet de loi organique sur l’organisation de nos travaux !
Sourires
Nouveaux sourires.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (nos 42 et 165).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 19.
CHAPITRE V
La recherche dans le domaine du développement durable
I. - La recherche joue un rôle central dans l'analyse des processus environnementaux et est à l'origine d'innovations technologiques indispensables à la préservation de l'environnement et à l'adaptation aux changements globaux de la planète. L'effort national de recherche privilégiera les énergies renouvelables, notamment la production d'énergie solaire photovoltaïque à partir de couches minces, l'énergie des mers et toutes les ressources de la géothermie à différentes profondeurs, le stockage de l'énergie, les piles à combustible, la maîtrise de la captation et du stockage du dioxyde de carbone, l'efficacité énergétique des bâtiments, des véhicules et des systèmes de transports terrestres, maritimes et aériens, les biocarburants de deuxième et troisième générations, la biodiversité, la compréhension des écosystèmes, notamment anthropisés, l'analyse des déterminants comportementaux et économiques de la protection de l'environnement, l'observation et la compréhension des changements climatiques et l'adaptation à ces changements.
En vue d'améliorer les relations entre la santé et l'environnement, un effort particulier sera consenti en faveur de la recherche dans les domaines des substituts aux substances chimiques, de l'éco-toxicologie et de la toxicologie, et en faveur des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé. Un programme permettra de développer les recherches sur les maladies infectieuses et les risques sanitaires liés au changement climatique. Les technologies propres et le développement de produits propres, les technologies du traitement de l'eau et des déchets et de la protection des sols et les méthodes permettant de réduire l'utilisation d'intrants en agriculture, la contribution des végétaux à l'amélioration de l'environnement et de la santé feront également l'objet de programmes spécifiques. La capture et le stockage du dioxyde de carbone seront soutenus par l'organisation d'un cadre juridique adapté et l'allocation de financements particuliers.
II. - La mise en réseaux des laboratoires de recherche, la réalisation de plates-formes d'essais et la constitution ou le renforcement de pôles d'excellence, en coopération avec les autres pôles européens, contribueront à la réalisation de ces objectifs. Ils concerneront notamment le stockage électrochimique de l'énergie et les batteries, les composants électroniques de puissance, les chaînes de traction hybrides et électriques, l'éco-construction, la réhabilitation des sols pollués et la modélisation de la ville.
À ces efforts de recherche et de développement de technologies nouvelles devront correspondre des actions accrues de formation dans les différents cursus éducatifs et auprès des milieux professionnels. Parmi ces actions, une attention particulière sera portée aux métiers du recyclage. Elle sera accompagnée d'un effort de valorisation de l'image de ces métiers pour soutenir la création d'emplois et l'orientation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emplois.
La France encouragera au plan européen la coordination des programmes de recherche scientifique et technologique dans le domaine du développement durable.
L'État mobilisera d'ici à 2012 un milliard d'euros supplémentaires en matière de recherche sur le développement durable, notamment sur le changement climatique, les énergies et les moteurs du futur, la biodiversité, l'impact de l'environnement sur la santé et les technologies du traitement des déchets et du recyclage.
Les dépenses de recherche sur les technologies propres et sur la prévention des atteintes à l'environnement seront progressivement augmentées pour atteindre, d'ici à la fin 2012, le niveau des dépenses de recherche sur le nucléaire civil. La stratégie nationale de recherche énergétique mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique sera mise à jour pour tenir compte de ces nouvelles orientations. Le rapport annuel prévu au même article 10 rendra compte de l'exécution de cet engagement.
Afin d'accélérer la mise en œuvre des nouvelles technologies ou des nouveaux services contribuant à la lutte contre le changement climatique, les démonstrateurs de nouvelles technologies de l'énergie pourront bénéficier du soutien de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le rapport annuel mentionné à l'article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée rendra compte de l'avancement des projets ainsi soutenus, notamment des projets sur la biomasse prévus par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui prévoit des actions d'aménagement du territoire et de développement économique.
Le soutien aux innovations éco-responsables se traduira notamment par la mobilisation et la coordination des pôles de compétitivité travaillant dans le domaine de l'environnement et par la mise en place de mécanismes favorisant le développement des entreprises éco-innovantes.
Les mesures d'aide au transfert et au développement industriel de nouvelles technologies tiendront compte de leurs performances environnementales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, avec cet article, nous entamons le chapitre sur la recherche dans le domaine du développement durable.
Les engagements du Grenelle de l’environnement rappellent l’importance du rôle de la recherche dans la mise en œuvre des objectifs en matière de développement durable, d’énergie, de biotechnologies et de biodiversité. Ils soulignent également l’importance des travaux et recherches menés dans le secteur de la santé, notamment sur les liens qui existent entre santé et environnement.
Le paragraphe I de cet article définit les priorités de l’effort national de recherche en ciblant un certain nombre de domaines d’investigation. Si la démarche est louable, elle présente néanmoins le risque d’enfermer artificiellement la recherche dans quelques domaines, certes importants, mais en nombre limité.
C’est pourquoi nous voulons réaffirmer ici le rôle de la recherche fondamentale, qui est riche de sa liberté, tant dans ses domaines d’investigation que dans le temps qu’on lui accorde. Nous regrettons que cette dimension ne soit pas prise en compte dans le projet de loi Grenelle I, certains allant jusqu’à dire, comme je l’ai entendu, que la recherche fondamentale n’existe pas !
Le paragraphe II de cet article porte sur les moyens accordés, soit la mobilisation par l’État, d’ici à 2012, d’un milliard d’euros supplémentaires en matière de recherche sur le développement durable. On ne sait pas vraiment comment va être employé cet argent qui ne remplacera pas des crédits budgétaires forts et constants, lesquels sont inexistants dans la dernière loi de finances !
Le reste devrait être pris en compte par l’augmentation du crédit d’impôt recherche dans la loi de finances pour 2009 et par une augmentation de la dépense fiscale liée au crédit d’impôt recherche conformément à la loi de finances pour 2008. Cette augmentation devrait faire du crédit d’impôt recherche la cinquième dépense fiscale du budget général. Ce type de dégrèvement d’impôt finance désormais 30 % des dépenses de recherche et de développement des entreprises.
Comme le rappelait récemment mon collègue Ivan Renar, « plus de 2 milliards d’euros seront consacrés au crédit d’impôt recherche en 2008, et ce dispositif fiscal, profitant avant tout aux grands groupes, pourrait s’élever à 3 milliards ou 4 milliards d’euros en 2012 ».
Alors que toutes les activités d’enseignement et recherche publics sont soumises aux évaluations de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, l’AERES, le crédit d’impôt recherche n’a donné lieu à aucune évaluation. Deux poids, deux mesures, en somme, entre la recherche publique et la recherche privée ! La France ne consacre en effet que 0, 6 % de son PIB à la recherche publique, et l’on déplore encore la suppression de 900 emplois dans les universités ou les organismes.
Troisième pays scientifique en 1970, la France se place désormais au quatorzième rang mondial pour la dépense intérieure de recherche et de développement par rapport au produit intérieur brut.
On ne peut pas entamer l’examen de l’article 19 en laissant croire que les protestations des chercheurs ne parviennent pas dans cet hémicycle.
Le 29 janvier dernier, le monde de la recherche a fait entendre sa voix pour dénoncer les suppressions d’emplois, la massification des embauches précaires sous contrats de droit privé, la mise en concurrence des universités, des organismes, des unités et de l’ensemble des personnels.
Il demande l’abandon du projet de décret sur la carrière des enseignants chercheurs, la reconnaissance des doctorants en tant que salariés au travers d’un statut unique, un budget à la hauteur des besoins, un autre système de répartition des crédits et la régénération de véritables organismes publics de recherche dotés des moyens et des statuts de leur mission.
Aujourd’hui, les enseignants chercheurs sont en grève illimitée : un mouvement de grande ampleur avec lequel il faudra compter !
En ce qui concerne le développement durable, l’article 19 pourrait paraître positif, mais il s’inscrit dans une politique gouvernementale de déstabilisation et de destruction de l’appareil public de recherche, pourtant seul capable de répondre aux besoins de notre pays sur le long terme.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le Grenelle de l’environnement fait le constat d’une faiblesse de la recherche dans le domaine du développement durable, alors même que cette recherche peut et doit être à l’origine d’innovations et d’avancées techniques et scientifiques importantes pour notre pays.
Au-delà de l’objectif majeur de ce texte en direction de la préservation de la planète et de la santé des citoyens, les progrès attendus seront un formidable facteur de croissance dans des domaines qui sont encore inexploités, mais qui seront les piliers de notre économie de demain.
Il est donc essentiel, comme dans toute matière innovante, de construire un socle solide d’où découleront des outils technologiques et décisionnels fiables.
Le 3 juillet 2008, Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, déclarait dans le journal Le Figaro qu’un milliard d’euros supplémentaires serait, conformément aux engagements du Président de la République, consacré à la recherche dans les domaines du développement durable conformément au Grenelle de l’environnement.
Aujourd’hui, la France manque cruellement de chercheurs dans le champ scientifique de l’écotoxicologie et de la toxicologie, notamment environnementale, champs primordiaux pour comprendre et analyser l’impact d’une éventuelle dégradation de l’environnement sur la santé et, bien entendu, pour trouver des innovations technologiques permettant d’y remédier.
En effet, il ne peut être envisagé de créer des structures de recherches innovantes sans, dans le même temps, déployer les moyens financiers et humains nécessaires.
C’est ainsi que Mme la ministre annonçait dans cette même parution que 400 chercheurs en toxicologie et en éco-toxicologie seraient recrutés dans les organismes publics de recherche et les universités françaises dans les cinq à dix prochaines années et que ces deux disciplines seraient fédérées au sein d’un réseau national de recherche adossé à des filières universitaires d’excellence.
Je souhaitais rappeler ici cet engagement public sur un sujet aussi important que la recherche en matière de développement durable.
Les territoires, certaines collectivités locales, le monde scientifique, sont prêts à se lancer dans de tels projets. Mais pour ce faire, l’État doit s’engager fortement à leurs côtés, afin de concrétiser des projets ambitieux. Ce débat doit être l’occasion de marquer une telle volonté d’engagement.

L'amendement n° 760 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Bailly, Revet, Bizet et Pierre, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
l'énergie des mers
insérer les mots :
, l'énergie des cours d'eau
La parole est à M. Rémy Pointereau.

Il existe actuellement des milliers de moulins à eau pouvant fournir de l’énergie hydroélectrique installés sur des sites que les propriétaires n'exploitent pas ou n’exploitent plus, malgré leur désir, faute de matériel adapté, en particulier, aux basses chutes.
Les études actuelles sont entreprises par de petits industriels ou artisans. Il serait souhaitable que les « turbiniers » français puissent reprendre leur rang, l’énergie des cours d’eau paraissant aujourd’hui sous-exploitée.

Cet amendement vise à prévoir que l’effort national de recherche privilégie également, au titre des énergies renouvelables, la recherche en matière d’énergie des cours d’eau.
La liste des domaines de recherche qui apparaît au I de l’article 19 vise spécifiquement les enjeux de l’avenir, à savoir les énergies renouvelables à privilégier – le solaire photovoltaïque, la géothermie ou les piles à combustible –, alors que l’énergie des cours d’eau est une énergie déjà utilisée depuis plusieurs siècles.
Par ailleurs, le développement de cette énergie pourrait aller à l’encontre du bon état écologique des eaux, comme cela a été évoqué lors de l’examen du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, qui avait donné lieu à des discussions parfois tendues sur ce sujet.
De ce fait, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’énergie des cours d’eau est un domaine que nous devons développer pour atteindre notre objectif, puisque 23 % de notre consommation finale devra provenir d’énergies renouvelables. Cela dit, nous travaillons sur une amélioration incrémentielle des dispositifs existants.
Or l’article 19 a pour objet les ruptures technologiques, ce qui est le cas des énergies des mers. C’est la raison pour laquelle ces dernières pourront bénéficier d’un financement par le fonds « démonstrateurs recherche », qui est doté de 400 millions d’euros.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Monsieur le président, soucieux d’éviter que cet amendement ne soit rejeté, je vais sans doute le retirer. J’estime cependant qu’il est nécessaire d’étudier cette question, dans la mesure où il existe, sur nos rivières, des milliers de moulins qui ne sont pas utilisés, faute de moyens, alors que leur fonctionnement ne nuirait absolument pas à l’environnement.
Il serait dommage, me semble-t-il, de ne pas exploiter une énergie renouvelable disponible.

À l’évidence, mon cher collègue, cet amendement n’a pas sa place ici. En effet, l’article 19 a pour objet la recherche fondamentale, alors que l’amendement n° 760 rectifié vise à remettre en valeur, comme vous venez de l’expliquer, d’anciens moulins et turbines. Ces dispositions auraient mieux trouvé leur place au sein de l’article 17.
C’est donc la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir le retirer. Les dispositions que vous proposez d’insérer pourront faire l’objet d’un amendement à l’article 17, que nous examinerons de nouveau lors de la deuxième lecture de ce texte.

Monsieur Pointereau, qu’en est-il finalement de l’amendement n° 760 rectifié ?

Puisque nous pourrons le réexaminer à l’occasion d’une deuxième lecture, je le retire, monsieur le président.

L’amendement n° 760 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 333 est présenté par MM. Sergent, Courteau et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries, Teston et Guillaume, Mme Blandin, MM. Antoinette, Gillot, Lise, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 376 rectifié bis est présenté par MM. Pintat, Merceron, Amoudry, B. Fournier, J. Blanc, Pierre, Revet et Gournac.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
piles à combustible,
insérer les mots :
la maîtrise de l'équilibre entre l'injection et le soutirage de l'électricité sur les réseaux de distribution d'électricité,
La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l’amendement n° 333.

Cet amendement vise à permettre une meilleure maîtrise de l’équilibre entre l’injection et le soutirage de l’électricité sur les réseaux de distribution d’électricité.
L'architecture des réseaux électriques a été conçue et s'est développée dans le cadre d'un système centralisé, à partir d'un nombre relativement limité de grosses ou très grosses unités de production. Le développement d'installations d'énergies renouvelables raccordées à ces réseaux implique, notamment, une multiplication des points d'injection sur les ouvrages de distribution.
Madame la secrétaire d’État, aujourd’hui, le recours à la géothermie, au photovoltaïque, voire à l’éolien domestique ont entraîné une évolution qui provoque certaines perturbations, lesquelles ont notamment pour effet de rendre plus complexe l'indispensable maintien en temps réel de l'équilibre local entre les injections et les soutirages d'électricité.
Pour cette raison, les solutions techniques à mettre en œuvre pour assurer le maintien de cet équilibre sur les réseaux de distribution d'électricité constituent également un thème de recherche à privilégier. En effet, dans nos syndicats, nous nous apercevons de plus en plus de la difficulté qu’il y a à bien maîtriser tous ces flux.

La parole est à M. Bernard Fournier, pour présenter l'amendement n° 376 rectifié bis.

Pour garantir le développement et la diversification des énergies renouvelables inscrits à l’article 17 de ce projet de loi, il ne faut pas perdre de vue l’importance des réseaux de distribution d’électricité. En effet, les sites de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, dont le nombre atteint 6 300, sont, pour la très grande majorité d’entre eux, raccordés à ces réseaux. Cependant, ces infrastructures n’ont pas été conçues à cette fin. La multiplication des points d’injection sur les ouvrages de distribution va donc avoir pour effet de rendre plus complexe la maîtrise de l’équilibre entre les injections et les soutirages d’électricité, maîtrise indispensable en temps réel.
Cet amendement vise donc à compléter l’article 19, afin d’élargir l’effort national de recherche à ce thème particulier.

Du fait du développement des énergies renouvelables raccordées aux réseaux électriques, les points d’injection sur les ouvrages de distribution se sont multipliés, ce qui peut entraîner certaines perturbations. Je pense, en particulier, aux éoliennes.
La recherche en la matière est donc un enjeu important, car il s’agit de trouver des solutions à mettre en œuvre pour assurer le maintien de l’équilibre entre les injections et les soutirages, c'est-à-dire entre l’offre et la demande.
Cependant, il ne paraît pas nécessaire de citer expressément ce domaine de recherche, qui est induit par la priorité donnée à la recherche en matière d’énergies renouvelables. Dans son rapport, la mission commune d’information sénatoriale sur la sécurité d’approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver avait d’ailleurs souligné que le système électronique de contrôle des éoliennes était trop sensible, puisque celles-ci « décrochaient » des réseaux à 49, 5 hertz et les « raccrochaient » à 50, 1 hertz. La marge est donc très étroite.
Les auteurs de ce rapport avaient également fait remarquer qu’il faudrait permettre aux éoliennes, comme aux autres installations électriques, de « raccrocher » ou de « décrocher » d’une façon plus souple, car ces éoliennes avaient précisément empêché le rétablissement rapide du réseau de transport et de distribution d’électricité.
Il s’agit donc non pas d’un problème de recherche, mais d’un problème technique, qui doit être résolu.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements identiques.
En effet, la question de la gestion des sources intermittentes, s’agissant des énergies éolienne et photovoltaïque, est traitée dans le cadre des projets de recherche qui bénéficient du fonds « démonstrateurs recherche ». Elle concerne les filières technologiques « stockage de l’énergie » et « réseaux intelligents ».

L’amendement n° 333 est effectivement très technique, mais il traduit tout de même une réelle préoccupation.
Même si la recherche en ce domaine est importante, nous sommes aujourd’hui confrontés à un vrai problème technique, que nous allons devoir résoudre. En effet, les points d’injection, qui sont de plus en plus nombreux, créent des perturbations importantes sur tous les réseaux.
Au demeurant, puisque vous venez de me donner quelque assurance sur ce sujet, madame la secrétaire d’État, je retire cet amendement.

L’amendement n° 333 est retiré.
L’amendement n° 376 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Fournier ?

À la suite des explications données par Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur, je retire cet amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 376 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 133 rectifié est présenté par MM. Pointereau, Pillet, Revet, Bizet, Pierre et Bailly et Mme Procaccia.
L'amendement n° 334 est présenté par MM. Courteau et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries, Teston et Guillaume, Mme Blandin, MM. Antoinette, Gillot, Lise, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
stockage du dioxyde de carbone
insérer les mots :
et notamment par les végétaux,
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l’amendement n° 133 rectifié.

Nous proposons de modifier l'article 19 pour y mentionner expressément la recherche sur le stockage du dioxyde de carbone par les végétaux.
En effet, les végétaux, par le mécanisme de la photosynthèse, fixent le carbone contenu dans le CO2, tout en libérant de l'oxygène. Ils participent ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour pouvoir prendre en compte ce stockage, il est nécessaire de le mesurer plus précisément, car il varie en fonction des espèces végétales et des conditions d'implantation.
Les végétaux apportent en outre, je le rappelle une nouvelle fois, de nombreuses contributions à l'amélioration de l'environnement en termes de régulation de la température intérieure des bâtiments situés à proximité et, donc, de réduction de la consommation d'énergie par le chauffage ou la climatisation. Ils permettent également d’améliorer la qualité de l'air extérieur et intérieur grâce à leur capacité à l’humidifier et à fixer les particules fines, particulièrement nocives pour la santé, et certains polluants. Ils permettent d’introduire et de préserver la biodiversité en ville. Ils ont une action positive sur la santé physique et psychique des individus. Des études ont ainsi montré une diminution du stress par l’apport de végétaux. Ils contribuent aussi à la prévention des inondations et à la réduction des nuisances sonores.
Compte tenu de ces éléments, la plantation d'arbres et de végétaux pérenne peut permettre d’atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement en termes non seulement de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de préservation de la biodiversité et de prévention des risques pour l'environnement et la santé. Dans cette perspective, il est donc nécessaire d'intensifier la recherche sur le végétal.

Par cet amendement, il est proposé d’inscrire à l’article 19 une piste qui paraît particulièrement importante pour le stockage du dioxyde de carbone, celle des végétaux.
Avant de modéliser divers dispositifs mécaniques, chimiques et minéraux, il nous faut bien évaluer et favoriser toutes les activités de fixation du carbone grâce à la photosynthèse, donc en période de lumière sur les plantes, les arbres, le phytoplancton, et sans relargage programmé.
Signalons au passage que la lutte contre l’effet de serre contribue à ne pas acidifier les océans et préserve ainsi le phytoplancton à squelette calcaire et son action de fixation du dioxyde de carbone.

Messieurs Pointereau et Courteau, ces amendements identiques sont en réalité satisfaits. En effet, il est mentionné, à l’article 19, la recherche en matière de maîtrise de la captation et du stockage du dioxyde de carbone, qui concerne, bien entendu, les végétaux.
La commission vous demande donc de bien vouloir retirer ces amendements, dans la mesure où leur adoption introduirait une redondance. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il est identique à celui que vient d’émettre M. le rapporteur.

Il aurait été préférable, selon nous, de mentionner expressément dans la loi que les végétaux participent au stockage du dioxyde de carbone. La végétalisation des zones urbaines constitue un enjeu important et, en la matière, il faut toujours enfoncer le clou !
Il faut reconnaître néanmoins que nous avons déjà beaucoup insisté sur la présence de végétaux autour des bâtiments. De surcroît, vous nous dites, monsieur le rapporteur, que notre amendement est déjà satisfait. Je ne m’entête donc pas et j’accepte de le retirer, par peur d’être battu ! §

L'amendement n° 133 rectifié est retiré.
Monsieur Courteau, l'amendement n° 334 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, monsieur le président. Nous estimons que ça va mieux en le disant. Nous pensons, comme notre collègue, qu’il faut enfoncer le clou. Nous allons donc l’enfoncer !
Sourires.

M. le président. Vous pratiquez par marcottage, ce qui est à mon avis plus propice à la végétation !
Nouveaux sourires.

Je mets aux voix l'amendement n° 334.
L'amendement n° 515, présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
la biodiversité,
insérer les mots :
l'exploration et la caractérisation de la biodiversité en vue de l'amélioration des plantes,
La parole est à M. Marcel Deneux.

Cet amendement tend à compléter la liste des secteurs qui bénéficieront de l’effort national de recherche. Nous proposons d’ajouter à cette liste, qui inclut déjà la biodiversité, la recherche sur les végétaux, essentielle pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes et pour concevoir des systèmes de production agricole durables incluant la sélection d'espèces végétales et de variétés adaptées à cet impératif de durabilité, notamment des espèces plus robustes qui pourront résister aux aléas climatiques.
Les outils modernes de la recherche devront être davantage utilisés pour explorer les caractéristiques naturelles des plantes, afin d'identifier ou de sélectionner les végétaux qui permettront de répondre à tous les nouveaux enjeux qui vont se présenter, notamment à toutes les perspectives ouvertes par le concept de raffinerie végétale que je défends par ailleurs.

Cet amendement porte sur les sciences du végétal, un domaine de recherche particulièrement important qui figure déjà à l’article 19, mais sous le seul angle de la contribution des végétaux à l’environnement et à la santé. Restreindre ces sciences du végétal aux seules relations avec la santé et l’environnement pourrait donner une vision biaisée de ces sciences, qui visent à comprendre le fonctionnement des plantes, de leur génome et des fonctions des gènes jusqu’aux relations entre plantes, milieux et organismes vivant au sein des écosystèmes. Il s’agit donc d’un domaine large auquel la commission des affaires économiques a toujours porté le plus grand intérêt. Ainsi, dans son rapport d’information de mai 2003 intitulé « Quelle politique des biotechnologies pour la France ? », elle avait appelé, par la voix de MM. Jean Bizet et Jean-Marc Pastor, au développement de la recherche en matière de génomique végétale.
Il est vrai toutefois que la liste des thèmes privilégiés dans le cadre de l’effort national de recherche, qui figure à l’article 19, est déjà longue. Faut-il l’allonger encore, alors même que l’article L. 241-1 du code de la recherche dispose que « la recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale » ?
C'est la raison pour laquelle la commission sollicite l’avis du gouvernement sur cet amendement.
Dans le domaine de la biodiversité, la recherche sur les plantes est extrêmement importante, ne serait-ce que pour choisir les plantes les mieux adaptées au milieu dans lequel elles sont cultivées.
L’exemple du riz malgache est souvent cité actuellement : il s’agit d’un riz « bio », qui n’est pas cultivé sous eau et dont les rendements sont dix fois supérieurs à ceux du riz dit « conventionnel », justement parce qu’un travail a été réalisé pour choisir la graine la mieux adaptée au sol et au climat.
De la même manière, des projets de recherche sont menés actuellement pour produire, à partir de l’ensemble de la plante et non pas d’une partie seulement, des biocarburants de deuxième génération.
Cela étant dit, si nous nous engageons dans la logique suggérée par cet amendement, il faudra également ajouter à cette liste des recherches menées dans le domaine de la biodiversité la recherche sur les sols, extrêmement importante, ainsi que la recherche sur l’ensemble des écosystèmes. La liste s’allongerait alors considérablement.
En conséquence, pour ne pas avoir à citer l’ensemble des domaines dans lesquels nous devons développer la recherche, je souhaiterais que vous retiriez cet amendement, monsieur le sénateur. La recherche sur l’adéquation des plantes au climat et au milieu n’en restera pas moins l’une des priorités du Gouvernement.

M. François Fortassin. J’ai beaucoup apprécié les précautions sémantiques et oratoires de Mme la secrétaire d’État.
Sourires
Mme la secrétaire d’État manifeste son étonnement

Si l’on souhaite limiter la recherche sur le végétal, un retrait de l’amendement présenté par M. Deneux s’impose effectivement. Si, au contraire, l’on considère que cette recherche est indispensable, cet amendement doit être soutenu.
J’irai un peu plus loin, au risque d’être désagréable. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur le président, je resterai courtois.
Sourires

M. François Fortassin. Ne voudrait-on pas, par hasard, s’abstenir de prononcer certains mots qui fâchent ?
Rires et exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Je ne les prononcerai pas non plus, mais chacun aura compris de quoi il s’agit.
Quoi qu’il en soit, je ne comprends pas la demande de retrait du Gouvernement d’autant que, très prudemment et avec beaucoup d’habilité comme à son habitude, M. le rapporteur s’en est en quelque sorte remis à la sagesse du Sénat.

Vous faites erreur. M. le rapporteur s’en est remis à l’avis du Gouvernement.

Je voudrais faire une proposition. L’amendement n° 524 rectifié, présenté, entre autres cosignataires, par Mme Blandin, tend également à allonger la liste figurant à l’article 19. Les amendements n° 515 et 524 rectifié étant complémentaires, Mme Blandin ou M. Deneux pourraient peut-être sous-amender l’un de ces amendements afin d’obtenir une liste complète où figureraient notamment les sciences du sol.

Derrière la banalité des mots, l’amendement n° 515 est important, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, beaucoup d’agriculteurs ne voient derrière la biodiversité que les pâquerettes et les petits oiseaux alors que ce terme englobe en réalité l’ensemble de la faune et de la flore, y compris les végétaux cultivés par les agriculteurs. Il est important de le souligner dans le projet de loi afin que ceux qui protègent la biodiversité ne soient pas accusés d’oublier l’agriculture.
Ensuite, depuis des décennies, la recherche est majoritairement orientée vers des plantes qui, si elles produisent davantage, nécessitent aussi davantage de traitements, car elles sont plus fragiles. Entre mon père qui faisait 40 quintaux de blé à l’hectare et ma sœur qui en fait 110, la quantité d’intrants à l’hectare n’est pas la même. Et je pourrais prendre également l’exemple de la pomme de terre qui est similaire.
Dans le prolongement du Grenelle, la recherche doit donc aujourd’hui s’orienter vers des plantes plus rustiques et plus robustes qui, certes, produiront moins mais nécessiteront aussi moins d’intrants. Pour protéger la pomme de terre du mildiou, vingt passages sont nécessaires si l’on veut qu’un produit correct soit distribué sur le marché. Une telle situation ne peut pas durer !
Je préfère que l’on obtienne des pommes de terre plus résistantes quoique moins productives plutôt que de voir procéder à une addition toujours plus importante de traitements qui vont finir par dégrader la qualité des sols. Déjà, aujourd’hui, des agriculteurs hollandais viennent produire en Picardie ce qu’ils ne peuvent plus produire sur leurs sols.

M. le rapporteur a évoqué les modifications génétiques, sans toutefois les nommer expressément et M. Fortassin a eu la grande pudeur de ne pas citer le nom.
Dans l’objet de son amendement, M. Deneux à écrit : « Les outils modernes de la recherche doivent être utilisés pour explorer les caractéristiques naturelles des plantes… », ce qui ne conduit pas automatiquement vers la génomique mais vise aussi les interactions entre espèces ou avec les sols. Dans ces domaines, la recherche est très pauvre et mérite d’être soutenue.
Je sais bien que, ce faisant, on ouvre la porte à d’autres monstres qui ne sont pas de mes amis. Mais la recherche est une chose et les implantations en plein sol en sont une autre. Tout est affaire de limites, que l’on peut décider de franchir ou de ne pas franchir. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la recherche.
Cela dit, je ne suis pas favorable à la proposition de M. le rapporteur qui consiste à sous-amender l’un des deux amendements par l’autre. Il en résulterait une altération de l’un et de l’autre ! Nous ne sommes pas mus par les mêmes intentions ; deux votes distincts ne feront donc pas de mal.

Je ne peux que soutenir l’amendement présenté par M. Deneux. Notre chambre est composée de praticiens. Comment pourrait-elle refuser un amendement qui place la recherche au centre de la réflexion ?
Par le passé, nous avons souvent dénoncé la place insuffisante de la recherche dans nos débats et le fait que, parfois, la passion l’emportait sur la raison. L’amendement présenté par notre collège Marcel Deneux permet d’y remédier.
Contrairement à Mme Blandin, je ne vois pas de monstres a priori. Seul ce qui pourrait être monstrueux pour l’homme me soucie et c’est à la recherche qu’il revient de le déterminer.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je voterai cet amendement, si toutefois notre collègue Marcel Deneux le maintient, ce que je le prie de faire.
Je n’assistais pas ce matin à la réunion de la commission, mais M. le rapporteur m’a affirmé cet après-midi qu’il émettrait un avis de sagesse sur cet amendement. Il m’a même dit pencher très fort en sa faveur !

M. le président. Vous nous proposez là une interprétation personnelle de la pensée du rapporteur, monsieur Braye !
Sourires

Je voudrais en revanche remercier tous les orateurs qui viennent d’exprimer leur soutien à cet amendement.
Nous ne pouvons pas, en matière scientifique, interdire aux chercheurs d’effectuer leur travail de recherche et d’acquérir des connaissances, car c’est précisément cela qu’on attend d’eux, et non de trouver la vérité quant au cheminement des hommes !
Il serait donc criminel de notre part de rejeter l’amendement de M. Deneux. Celui-ci, en effet, vise à encourager des recherches sur la connaissance intime de la biodiversité végétale. Le repousser, ce serait un retour au Moyen Âge !
Je crois que ce que nous propose M. Deneux relève du simple bon sens et que nous devrions donc le suivre.

Dans l’état actuel de notre débat, il me semble que mon amendement peut recevoir un vote favorable de la part de la Haute Assemblée. En outre, je pense qu’au lieu de le sous-amender, comme me le proposait M. le rapporteur, il vaut mieux laisser le soin de le faire à l’Assemblée nationale, voire au Sénat lors de la deuxième lecture.

Il est sûr qu’en conjuguant les deux textes on peut parvenir à une rédaction intéressante, mais, en cet instant, je préfère soumettre le mien au vote.
Nous partageons pleinement les objectifs qui viennent d’être énoncés sur les différentes travées de cet hémicycle.
Nous réfléchissons d’ailleurs actuellement aux possibilités d’améliorer les plantes et les sols. En effet, travailler sur les sols – de manière à savoir, en particulier, comment il est possible de mieux fixer l’azote – est une priorité absolue. Il existe ainsi de nombreux sujets sur lesquels des recherches sont justement en cours.
En ce qui concerne plus particulièrement l’amendement n° 515, le Gouvernement s’en remet finalement à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 524 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :
notamment anthropisés,
insérer les mots :
l'étude des services obtenus des écosystèmes, l'écologie de la restauration et le génie écologique, les inventaires du patrimoine naturel,
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Il s’agit toujours, avec cet amendement, des pistes essentielles de recherche. Dans l’article 19, sont mentionnées en priorité les innovations technologiques.
Tout comme dans l’article 1er, où la biodiversité avait été ajoutée à la hâte, au point que le rédacteur du texte n’avait pas pris soin d’en tirer les conséquences grammaticales dans la suite de la phrase, on voit bien ici que la culture de celui qui a tenu la plume est plus celle d’un connaisseur en matière de technologie que celle d’un naturaliste !
Il est vrai que le rédacteur du texte mentionne bien la biodiversité, mais cette seule mention ne suffit pas. On peut craindre en effet que certaines personnes peu au fait de l’évolution des recherches n’entendent par ce terme que la connaissance, le recensement et la description des espèces, des races et des variétés. Si les inventaires de ce type, inachevés, sont indispensables, d’autant que la taxonomie et la systématique méritent d’être soutenues, il est un autre domaine, moins popularisé, qui est tout aussi indispensable, l’étude du fonctionnement des espèces entre elles et dans leur milieu et, comme ce système est aussi le nôtre, l’étude des services rendus par la biodiversité. C’est précisément ce que nous souhaitons ajouter par notre amendement.
À titre d’illustration, citons le plus connu de ces services, la pollinisation des fleurs par les insectes – dont les abeilles –, qui permet la production alimentaire fruitière et légumière.
Un autre exemple sera de plus en plus d’actualité : celui des zones humides, tourbières et marécages, et de leur rôle « tampon ». Elles agissent comme des éponges et limitent les inondations en cas de fortes précipitations, tout en gardant l’humidité en période de sécheresse.
On pourrait en outre citer le rôle des haies pour les cultures ou celui des légumineuses pour fixer l’azote.
Ces recherches sont indispensables pour qualifier notre regard sur la protection des milieux et la quantification des services qu’ils rendent.
Ces recherches sont attendues par les aménageurs et par les entreprises en quête d’indicateurs pour évaluer, voire compenser, les impacts des activités. Elles sont aussi attendues par les agriculteurs pour d’éventuelles rémunérations en contrepartie de l’attention qu’ils porteront à tel ou tel écosystème complexe qu’ils protégeraient.
Voilà pourquoi il nous semble indispensable d’inscrire « l’étude des services obtenus des écosystèmes » dans les recherches prioritaires. La fin de cet amendement apportait initialement une précision complémentaire, à savoir « l’étude des mécanismes d’adaptation de la biodiversité face aux changements globaux ». Nos équilibres économiques, et donc sociaux, sont en effet étroitement liés à des activités en rapport avec le climat, les cultures, les élevages, les forêts et la pêche.
Il est possible – peut-être – de s’adapter à la remontée des bancs de poissons dans l’Atlantique, par exemple en allant les chercher ailleurs. Mais la forêt ne va pas déménager !
Sourires

L’achat de terrains en Wallonie par quelques viticulteurs champenois est quant à elle une anticipation qui n’est pas à la portée de tout le monde.
Aussi de sérieuses recherches doivent-elles être soutenues sur ces adaptations.
Cependant, prévoyant que M. Sido allait me dire que cette partie de l’amendement était satisfaite par l’article, j’ai rectifié mon amendement de façon à enlever ce membre de phrase.
En revanche, les inventaires restent indispensables. Ils sont demandés par tous les scientifiques et toutes les associations. Ils sont loin d’être achevés, et déjà disparaissent des animaux et des plantes qui n’ont pas encore été nommés !
Inventaires d’une part, services rendus d’autre part, telles sont les deux orientations de recherche que je souhaite voir mentionnées dans cet article, de la même façon que, en ce qui concerne les technologies et l’efficacité énergétique, vous vous êtes donné les moyens d’inscrire six exemples.
Très bien ! sur les travées du groupe socialiste.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il serait effectivement utile, si nous en avions le temps, de reprendre la réflexion que beaucoup parmi nous ont entamée, quand ils faisaient leurs humanités, sur la phrase suivante : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »…
Sourires

Le présent amendement précise le champ d’application de la recherche concernant la biodiversité et les écosystèmes. Le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, n’a en effet pas précisé les orientations dans ce domaine, alors qu’il l’a fait de manière très précise pour les énergies renouvelables.
Cependant, je m’interroge sur l’utilité d’entrer à ce point dans le détail, alors que l’article 19 évoque déjà la recherche en matière de biodiversité et de compréhension des écosystèmes.
Sur cet amendement, la commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.
Il est bien prévu, dans le présent projet de loi, à l’article 20, alinéa 3, de travailler sur les services rendus par la biodiversité. De la même façon, les inventaires dont il est question dans cet amendement sont prévus à l’article 22.
Cela dit, il ressort clairement de l’ensemble de nos débats que la manière la plus efficace de rendre la biodiversité plus intelligible et de marquer son importance pour nos interlocuteurs serait de parvenir à valoriser les services qu’elle rend.
Il existe très peu d’études sur le sujet, et celles qui ont été menées sont d’ailleurs rarement françaises. C’est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement favorables à ce que le tout premier de travail de recherche sur la biodiversité consiste bien à valoriser les services rendus par les écosystèmes.
D’ailleurs, je signale à ceux d’entre vous à qui cela aurait échappé qu’hier s’est déroulée la journée mondiale des zones humides.
Sourires
Le Gouvernement est donc plutôt favorable à l’amendement n° 524 rectifié.

Si notre groupe s’est abstenu sur l’amendement précédent, c’est tout simplement parce qu’il nous semblait que notre collègue M. Deneux tendait à trop cibler les choses en insérant l’expression : « en vue de l’amélioration des plantes ».
En effet, pour moi, l’exploration et la caractérisation de la biodiversité vont bien au-delà d’une simple amélioration des plantes. Il s’agit en fait de chercher à comprendre totalement ce qu’est un écosystème, et tout ce que peut apporter à notre monde le génie écologique.
Voilà pourquoi nous voterons le présent amendement, après nous être abstenus sur le précédent.
L'amendement est adopté.

Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 742, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du second alinéa du I de cet article, après le mot :
agriculture,
insérer les mots :
les énergies renouvelables de la mer,
La parole est à M. Louis Nègre.

L’article 19 ne fait pas mention des énergies renouvelables de la mer, ou ERM. Pourtant, ces énergies représentent l'avenir, notamment en ce qui concerne la production de biocarburants.
Il importe donc que les ERM puissent bénéficier pleinement du soutien de l'État, comme toutes les autres techniques citées.
Par ailleurs, la production de l'énergie marine qui utilise l'effet des marées, des vagues ou des courants nous intéresse directement, car la consommation énergétique de l'Union européenne ne repose que pour 6 % sur des énergies renouvelables.
L'État doit donc soutenir ce type d'énergies, car le milieu marin apporte un mode énergétique propre, renouvelable, silencieux et invisible. Je rappelle par ailleurs que nous sommes la troisième puissance maritime mondiale.

Je voudrais dire à notre honorable collègue que le présent amendement est satisfait, car les énergies renouvelables de la mer sont citées au premier alinéa du I de l’article 19.
Aussi la commission demande-t-elle à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

J’ai bien lu moi aussi le I de l’article 19. Je voulais simplement insister.
Mais je vois que M. le rapporteur et le Gouvernement comprennent tout l’intérêt d’examiner de très près, notamment par la recherche, ces énergies renouvelables du milieu marin, qui sont très spécifiques.
Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mon amendement.

L'amendement n° 742 est retiré.
L'amendement n° 336, présenté par M. Guillaume, Mme Blandin, MM. Courteau et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries, Teston, Antoinette, Gillot, Lise, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots :
la réalisation de plates-formes d'essais
insérer les mots :
notamment de très grandes infrastructures au rayonnement national, européen et international.
La parole est à M. Didier Guillaume.

Nous nous accordons tous sur le fait que la recherche doit occuper une place centrale dans ce projet de loi.
L’objectif est en effet de produire les savoirs, mais aussi les innovations technologiques qui nous permettront de préserver l’environnement et de nous adapter aux changements globaux de notre planète. On ne peut que saluer cette ambition, inscrite dans le texte.
Je voudrais évoquer brièvement ce sujet à l’occasion de la présentation de l’amendement n° 336.
En effet, la place centrale de la recherche permettra à la France d’entrer de plain-pied dans une économie à forte valeur ajoutée, celle du savoir et de la connaissance.
Par ailleurs, au regard des enjeux scientifiques, politiques et de la demande de la société, qui ont été bien identifiés au cours de la première partie du Grenelle de l’environnement, il est indispensable de mobiliser une part significative de la communauté scientifique.
Pour ce faire, il convient de donner à cette dernière les moyens de travail et les outils de coopération nécessaires à l’échelle nationale. Dans ce but, il faut mettre en place des dispositifs adaptés. La mise en réseaux de laboratoires de recherche, la réalisation de plates-formes d’essais et la constitution ou le renforcement de pôles d’excellence, en coopération avec les autres pôles européens, comme le propose l’article 19, sont des mesures excellentes.
Mais j’aimerais ici attirer votre attention sur les outils de recherche mis à disposition des scientifiques afin de donner à nos pôles un véritable caractère d’excellence à l’échelle européenne.
En ce qui concerne les plates-formes d’essais prévues dans l’article 19, je voudrais indiquer que leur nature peut avoir un impact décisif. Aussi le présent amendement vise-t-il à proposer la mise en place de très grandes infrastructures, sur le modèle du synchrotron de Grenoble, que tout le monde connaît, et dont l’impact serait sans nul doute très positif.
Ces très grands équipements permettent d’atteindre une échelle d’analyse impensable dans de simples laboratoires de recherche.
Au-delà de la recherche scientifique, ces très grandes infrastructures permettent, en termes de transfert de connaissance, un nombre important de partenariats industriels et de dépôts de brevet. En termes de retombées économiques, elles permettent toujours de nombreuses créations d’emplois et d’entreprises.
Cet amendement vise donc simplement à préciser la nature des plates-formes d’essai à réaliser. Notre proposition est de créer des structures spécifiques sur le modèle des grands instruments, dont on connaît l’efficacité. De telles infrastructures pourraient être de véritables têtes de pont des réseaux de recherche nationaux ; elles permettraient de viser l’excellence, de renforcer l’attractivité scientifique de la France et d’assurer un rayonnement de la recherche française aux niveaux européen et international.

Cet amendement est satisfait, puisque, au même alinéa de l’article 19, il est évoqué « la constitution ou le renforcement des pôles d’excellence ».
Par ailleurs, je note que l’auteur de l’amendement n’établit pas de relation entre la taille d’une infrastructure et son rayonnement.
Aussi, la commission lui demande de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission, monsieur le président.
Si cela peut vous rassurer, monsieur Guillaume, je vous informe que, dans le cadre du programme de recherche sur le Grenelle, nous avons l’intention de mettre en place plusieurs plates-formes technologiques. Je puis d’ores et déjà citer celle qui sera consacrée au photovoltaïque, autour de l’Institut national de l’énergie solaire, l’INES, très efficace, celle qui sera consacrée aux bâtiments, notamment les bâtiments à énergie positive du futur, autour du Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, et de l’INES, celle qui sera consacrée au stockage de l’énergie, autour du Commissariat à l’énergie atomique, le CEA, enfin, celle qui sera consacrée aux véhicules hybrides, autour de l’Institut français du pétrole, l’IFP.
Aussi, monsieur le sénateur, vos objectifs sont d’ores et déjà bien pris en compte par le Gouvernement et la rédaction du projet de loi devrait vous satisfaire.

Monsieur le rapporteur, je vous rassure, je n’établis pas un lien entre la taille de tel de tel équipement et le niveau de la recherche qui y est menée. Si nous évoquons ces très grands équipements, c’est justement dans le but de dépasser la simple localisation d’un laboratoire ou d’une unité de recherche et de mettre en relation plusieurs laboratoires, plusieurs pôles, plusieurs unités de recherche, de telle sorte qu’ils atteignent une taille critique.
Madame la secrétaire d'État, je ne vois pas en quoi cet amendement est satisfait. Aussi, je le maintiens.
L'amendement n'est pas adopté.
M. Guy Fischer remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

L'amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
La France encouragera en outre-mer les coopérations transfrontalières ou régionales avec les pays voisins, entre équipes de recherche travaillant sur les problématiques de développement durables dans des milieux similaires, et favorisera à titre expérimental les échanges de savoir-faire pouvant aboutir à des applications et des innovations concrètes dans les collectivités d'outre-mer.
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

Les crédits ordinaires consacrés à la coopération décentralisée, à la coopération régionale ou aux programmes opérationnels européens de coopération transfrontalière ou interrégionale, tels INTERREG III et le Programme opérationnel de coopération transfrontalière Guyane-Brésil-Surinam, appelé PO Amazonie, ne permettent pas à ce jour la mise en place en outre-mer de programmes de coopération avec des pays tiers à la hauteur des enjeux dans le domaine de la recherche, notamment la recherche appliquée au développement durable.
Des structures existent, des initiatives sont prises à l’échelle régionale, tel le projet de pôle ressources sur la biodiversité, et des programmes de coopération émergent sur l’Amazonie, notamment dans le cadre de colloques et de projets universitaires. Désormais, il convient de structurer de véritables réseaux d’échanges de savoir et de savoir-faire avec des chercheurs de pays tiers voisins des régions et des collectivités d’outre-mer concernées par des problématiques qui sont souvent de portée générale, mais dont la ressource se situe sur ces territoires.
Pour cela, non seulement des crédits, mais également des cadres réglementaires – et, à tout le moins, le droit à l’expérimentation – sont nécessaires.
Concrètement, par exemple, la France, par le biais des régions de la zone Caraïbe, pourrait être davantage présente au sein de l’Organisation du traité de coopération amazonienne, l’OTCA, avec lequel les Espagnols développent de nombreux partenariats, alors que nous sommes à la traîne sur ce dossier.
Concrètement encore, au-delà de la coopération engagée entre les sept régions ultrapériphériques européennes, un réseau pourrait prendre forme entre ces régions et les régions d’États voisins ou transfrontaliers et se structurer à terme sous une forme juridique conforme aux règlements des États concernés.
Pour finir, je rappelle l’engagement qu’a pris en Guyane le Président Nicolas Sarkozy, en présence de son homologue brésilien, de créer une académie Guyane-Brésil de la biodiversité.
Bref, beaucoup reste à faire, et j’espère donc, mes chers collègues, que vous adopterez cet amendement.

M. Bruno Sido, rapporteur. Mon cher collègue, cet amendement est satisfait.
Murmures sur les travées du groupe socialiste.

En effet, la coopération transfrontalière existe déjà en matière de recherche dans le développement durable. Ainsi, un projet d’académie franco-brésilienne de la biodiversité a été lancé en décembre 2008. Citons également l’initiative pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens dans le Pacifique Sud, dite « CRISP ».
Par ailleurs, la problématique de la coopération transfrontalière ou régionale concerne non pas uniquement l’outre-mer, mais l’ensemble du territoire national.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Pour ma part, j’estime qu’un texte aussi fondamental que celui que nous examinons actuellement se doit d’inclure cette référence. Or, l’article 49, lui non plus, ne fait pas référence à la coopération transfrontalière ou à la recherche.
Aussi, je maintiens mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 344 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En outre-mer, les organismes de recherche implantés sur place ainsi que les programmes de recherches qui y sont menés seront incités à développer, outre la recherche fondamentale, une part conséquente de recherche appliquée et d'études finalisées en lien avec les préoccupations des territoires et les problématiques de développement durable de ces derniers.
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

Des organismes de recherche nationaux, qui ne comptent pas parmi les moindres, sont implantés outre-mer : le CNRS, l’Institut Pasteur, l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, ou le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. En Guyane, par exemple, on en dénombre une quinzaine, si l’on compte parmi eux l’Office national des forêts, l’Office national de la faune sauvage, la mission Parc, tous étant des outils contribuant à une meilleure connaissance et à une meilleure gestion des ressources naturelles.
Mais les chercheurs ne font que passer. Comme les thésards, la compétence locale est peu ou pas valorisée, et la capitalisation des recherches effectuées sur place est faible, ou à tout le moins émergente, grâce à des programmes comme le Réseau de diffusion scientifique et technologique, le RDST, assuré par le parc naturel régional pour le compte de l’État et de la région.
Quant au transfert des connaissances vers des applications techniques ou industrielles, il s’effectue très lentement, en dépit de tous les mémoires, rapports et thèses prometteurs en la matière.
Aujourd’hui, la recherche en France est en train de se restructurer autour de l’Agence nationale de la recherche, et je m’inquiète donc de la manière dont les régions d’outre-mer et leurs problématiques environnementales et de développement durable, si périphériques géographiquement, bénéficieront des nouvelles modalités de répartition des crédits affectés aux programmes de recherche de ces organismes nationaux.
Mon amendement vise donc à garantir que la recherche en outre-mer sera bien confortée, en lien avec les préoccupations des territoires et les enjeux de développement durable. À cette fin, j’en appelle à la vigilance de tous.

Cet amendement ne me semble pas ressortir au domaine de la loi.
Par ailleurs, les grands organismes de recherche situés dans les collectivités ultramarines mènent déjà des programmes de recherche qui portent spécifiquement sur les problématiques propres à l’outre-mer.
On peut prendre l’exemple de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, l’IFREMER, qui mène des actions spécifiques en faveur du développement de la pêche et de l’aquaculture outre-mer.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 19 est adopté.

TITRE II
BIODIVERSITÉ, ÉCOSYSTÈMES ET MILIEUX NATURELS
CHAPITRE IER
Maintenir et développer la biodiversité
L'amendement n° 525 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d'évolution
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

L’intitulé du chapitre Ier, tel que l’a rédigé l’Assemblée nationale, à savoir « Maintenir et développer la biodiversité », témoigne d’une vision vraiment optimiste de l’état des lieux.
Seize mille espèces sont menacées d’extinction ; c’est le cas pour un oiseau sur huit, un mammifère sur quatre et un conifère sur quatre. C’est donc à une autre crise que nous avons affaire, une crise silencieuse, insidieuse, mais tout aussi grave, dont les premières victimes sont, dans le monde, les plus pauvres, et, ici, ceux dont la profession dépend de la richesse biologique, à commencer par les pêcheurs.
La France est responsable de 10 % des récifs de la planète et de 8 millions d’hectares de forêts exceptionnelles, sans parler de la nature ordinaire, qui, à raison de l’équivalent d’un département tous les dix ans, disparaît par artificialisation.
Après trois milliards d’années d’évolution, nous abordons la sixième extinction d’espèces. Or l’économie mondiale dépend pour 40 % de la biodiversité et de ses services. Le Millennium ecosystem assessment a donné l’alerte : 60 % des services vitaux fournis à l’homme sont en déclin.
Nous savons tous que la faune sauvage africaine fait complètement illusion grâce au cinéma et à la télévision. Combien de touristes s’imaginent que les lions et les éléphants du Kenya, les gorilles du Congo ou les tigres du Bengale seront à portée immédiate de leurs objectifs ? Certains déposent même des réclamations, parce qu’ils ont vu moins d’animaux qu’ils ne l’avaient imaginé. Chez nous, les hannetons, les courtilières et les papillons ont déserté les jardins.

Mais nous avons le film Microcosmos !
Alors, il n’est vraiment pas de mise de parler de « maintien de la biodiversité » ; nous sommes face à une hémorragie, que nous devons contenir avec résolution, mais modestie. Malgré toutes les conventions internationales que nous avons signées, les effectifs continuent de décroître.
Quant au mot « développer », que proposent les députés, il est encore plus illusoire : la nature ne se recapitalise pas comme une banque !
Premièrement, on ne crée pas d’espèces, sauf à considérer que les chimères génétiquement modifiées dans les laboratoires vont tout repeupler ; deuxièmement, le renforcement ponctuel des effectifs par multiplication, à l’exemple du gibier, pour la chasse, ou bien par protection, à l’exemple des cormorans, crée, à défaut d’un travail sur les milieux, plus de déséquilibres qu’il n’apporte d’avantages, parce qu’on n’a pas non plus travaillé sur la chaîne et les continuités.
C’est pourquoi nous vous proposons, pour l’intitulé du chapitre Ier, un titre plus réaliste, qui correspond davantage à la gravité de la situation.

À l’article 20, nous allons aborder une importante série d’amendements ayant pour objet de préciser l’objectif visé en matière de protection de la biodiversité.
Ces amendements sont intéressants à plusieurs titres.
D’une part, en prenant acte du recul très important de la biodiversité, madame Blandin, ils tendent à faire de l’enraiement de celui-ci un objectif premier. Il faut appeler un chat un chat !
D’autre part, ils tendent à insister sur la nécessité de restaurer, à l’avenir, les capacités d’évolution de la biodiversité, objectif qui paraît plus juste que l’idée qu’il faudrait simplement la développer.
Conformément au souhait de la commission, Mme Blandin a rectifié son amendement de telle sorte que celui-ci fasse tant soit peu la synthèse des autres amendements.
C’est pourquoi la commission émet un avis tout à fait favorable à la nouvelle rédaction de l’intitulé.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l’intitulé de cette division est ainsi rédigé.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Maintenir et développer la biodiversité sauvage et domestique exige des mesures de protection, de valorisation, de réparation et de compensation des milieux, associées à la constitution d'une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales, ainsi qu'un suivi et une évaluation de la mise en œuvre et des résultats de ces dispositifs. Ces mesures prendront en compte les problématiques spécifiques des territoires ruraux et de montagne.
Ces principes seront articulés avec les dispositifs existants de protection de la biodiversité, qu'ils soient de portée générale ou qu'ils concernent des zones protégées. Lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou d'un projet susceptible de nuire à la biodiversité, une compensation visant à rétablir les effectifs des espèces ou variétés menacées et les superficies des milieux auxquels il a été porté atteinte dans le cadre des trames vertes et bleues sera rendue obligatoire selon des modalités définies par décret.
L'État étudiera avec les parties prenantes du Grenelle de l'environnement les dispositifs permettant de valoriser les services rendus par la biodiversité à la collectivité et aux acteurs socio-économiques.
À ces fins, la stratégie nationale de biodiversité sera renforcée, et assortie d'une déclinaison locale concertée, notamment en outre-mer. Une stratégie nationale de création d'aires protégées terrestres identifiant les lacunes du réseau actuel sera établie afin que 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain soient placés dans les dix ans sous protection forte. La réalisation de cet objectif passe notamment par deux voies : d'une part, la création de trois nouveaux parcs nationaux et d'autre part, l'acquisition de 20 000 hectares de zones humides par les collectivités publiques à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole. Les 20 000 hectares de zones humides précités seront identifiés de façon concertée avec l'ensemble des acteurs de terrain, sur la base de données scientifiques.
Par ailleurs, des aires marines protégées seront mises en place pour préserver la biodiversité marine afin de couvrir, en incluant notamment le réseau Natura 2000 en mer et la création de parcs naturels marins, 10 % des eaux placées sous la souveraineté de l'État, d'ici à 2012 en métropole et d'ici à 2020 dans les départements d'outre-mer ; les collectivités d'outre-mer et les collectivités en Nouvelle-Calédonie volontaires seront accompagnées dans la mise en place et la gestion d'aires marines protégées. Des plans de conservation ou de restauration compatibles avec le maintien et le développement des activités humaines seront mis en place dans les cinq ans afin de protéger les espèces végétales et animales en danger critique d'extinction en France métropolitaine et outre-mer, dont 131 espèces ont été dénombrées en 2007. Des plans de lutte contre les espèces invasives, terrestres et marines seront mis en œuvre afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts négatifs.
Le soutien à la création d'un groupe d'expertise scientifique internationale pour la biodiversité, sur le modèle du Groupe d'experts inter-gouvernemental sur l'évolution du climat, sera renforcé et constituera un axe important de la diplomatie environnementale.

Ce ne sont plus seulement les naturalistes qui alertent sur la disparition des espèces, ce sont désormais les agriculteurs des États-Unis, qui sont privés du rôle des polinisateurs dans leurs vergers.
Ce sont aussi des parlementaires. Je citerai les rapports faits au nom de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, l’un par MM. Claude Saunier et Pierre Lafitte et intitulé « La biodiversité : l’autre choc ? l’’autre chance ? », l’autre par M. Marcel Pierre Cléach, sous le titre « Marée amère : pour une gestion durable de la pêche ».
Ces sénateurs nous alertent sur le rythme de disparition des espèces, dix à cent fois supérieur au tempo naturel qui est à peu près d’une espèce sur cinquante mille par siècle.
M. Marcel-Pierre Cléach révèle que, depuis 1965, il n’y a plus de stock inexploité en mer et que, de 1950 à 2004, le débarquement des pêches est monté de 15 millions de tonnes à 85 millions de tonnes.
Et puis, au sein même du Gouvernement, ce ne sont plus seulement les ministres de l’environnement qui alertent. Sur le site du Quai d’Orsay, on peut lire : « Au cours des cinquante dernières années, les activités humaines ont entraîné des modifications au niveau des écosystèmes de manière plus rapide et plus étendue qu’à aucune autre période de l’humanité et une perte substantielle et dans une large proportion irréversible de la diversité biologique sur terre ».
Le WWF, le World Wide Fund, a mis au point un indice qui est pertinent depuis 1966. Depuis trente ans, il a relevé une diminution du nombre des espèces de 31 % pour les animaux terrestres, de 27 % dans les mers et de 28 % en eaux douces. Par ailleurs, 20 % des coraux sont morts et 30 % des mangroves ont disparu.
L’alerte sur la biodiversité n’est pas compassionnelle, même si certains massacres nous révulsent, elle est simplement de salut public. Il est urgent de réaliser que notre sort est vraiment lié à celui des autres espèces, en raison des échanges et des services, et que le déséquilibre annoncé peut se précipiter.
M. Jean-Patrick Le Duc, enseignant au Muséum national d’histoire naturelle, nous compare aux passagers insouciants d’un avion qui perdrait un à un ses boulons, sans que quiconque s’en inquiète. À partir de combien de boulons allons-nous nous écraser ?
Le CNRS et L’INRA nous alertent sur les disparitions en cascades et les espèces co-menacées tout simplement parce que leur nourriture était principalement constituée d’une plante qui a disparu ou parce que leur reproduction dépendait de la visite d’un papillon qui a déménagé pour des raisons climatiques. Là aussi, nous aurons besoin des trames vertes.
La nouvelle rédaction de la commission, en décomposant l’article en une succession d’alinéas a clarifié, sur la forme, les objectifs de l’État. Mais cette substitution intégrale au texte sur lequel nous avions travaillé n’a pas facilité notre tâche, car il est devenu difficile de s’y retrouver dans la numérotation.
Enfin, mes chers collègues, j’attire votre attention sur un membre de phrase du projet de loi, que la commission a conservé et qui laisse la voie ouverte à tous les consensus et aux pires méfaits. En effet, il est prévu que l’on mette en place des « plans de conservation ou de restauration compatibles avec le maintien et le développement des activités humaines ». Franchement, qui pourrait être contre ?
Nous ne voulons pas sauver une plante ou un animal contre la survie de l’humanité. Nous ne nous inscrivons pas dans la ligne du titre provocateur du livre de M. Yves Paccalet : L’Humanité disparaîtra, bon débarras ! Reconnaissez néanmoins qu’une telle phrase rend possible toutes les destructions, tous les renoncements. Tout bétonneur peut demain s’en servir pour argumenter, défendre l’investissement qu’il veut réaliser sur une zone protégée.
Quand M. Charles Josselin, sénateur de Bretagne, a le 21 mai 2008, au nom de notre groupe, déposé, un amendement de vigilance sur les zones Natura 2000 situées dans des périmètres portuaires, lors de la discussion du projet de loi portant réforme portuaire, M. Dominique Bussereau, alors secrétaire d’État chargé des transports, a eu des paroles rassurantes et notre collègue a accepté de retirer son amendement.
Quand Charles Revet, le 26 juin 2008, a posé une question au Gouvernement, ce même Dominique Bussereau lui répondit : les zones Natura 2000 ou aires marines protégées sont parfaitement compatibles avec l’activité humaine, mais nous attendons 30 000 emplois. Nous tiendrons compte des contraintes environnementales, mais nous développerons nos ports.

Dès lors, le ver est dans le fruit. Si, sur un même territoire, on prétend tout à la fois détruire et sauver, admettez que cette phrase pose un problème.
Nous n’avons pas déposé d’amendement, car nous avons une confiance mais la plus grande vigilance s’imposera dans les déclinaisons du Grenelle II.

Je suis saisi de dix-huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61 rectifié bis, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Pour préserver et accroître la biodiversité sauvage et domestique, l'État se fixe comme objectifs :
- la constitution, d'ici 2012, d'une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales ;
- la mise en œuvre de mesures de protection, de valorisation, de réparation des milieux et espèces naturels et de compensation des dommages causés à ceux-ci tenant compte des spécificités des territoires ruraux et de montagne et s'articulant de manière cohérente avec les dispositifs existants de protection ; sans préjudice des dispositifs de compensation et d'évaluation en vigueur, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un projet ou d'un programme susceptible de nuire à la biodiversité, des mesures de compensation proportionnées aux atteintes portées aux continuités écologiques dans le cadre de la trame verte et bleue seront rendues obligatoires selon des modalités définies par le code de l'environnement en concertation avec les élus locaux et les acteurs de terrain ;
- le renforcement du rôle de la stratégie nationale de la biodiversité et l'élaboration, notamment en outre-mer, de stratégies régionales dans le respect des compétences des collectivités territoriales et en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés ;
- la mise en œuvre d'une stratégie nationale de création d'aires protégées terrestres identifiant les lacunes du réseau actuel afin de placer sous protection forte, d'ici dix ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain : cet objectif implique notamment la création de trois nouveaux parcs nationaux et l'acquisition à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, de 20 000 hectares de zones humides par les collectivités publiques, identifiées en concertation avec les acteurs de terrain, sur la base de données scientifiques ;
- la création d'aires marines protégées afin de couvrir, en incluant notamment le réseau Natura 2000 en mer et la création de parcs naturels marins, 10 % des eaux placées sous la souveraineté de l'État dans les limites de la mer territoriale, d'ici 2012 en métropole, et d'ici 2020 dans les départements d'outre-mer ; les collectivités d'outre-mer et les collectivités en Nouvelle-Calédonie volontaires seront aidées pour la mise en place et la gestion de ces aires ;
- la mise en place d'ici 2013 de plans de conservation ou de restauration compatibles avec le maintien et le développement des activités humaines afin de protéger les espèces végétales et animales en danger critique d'extinction en France métropolitaine et outre-mer, dont 131 ont été recensées en 2007 ;
- la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces invasives, terrestres et marines afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts négatifs ;
- la réalisation des documents d'objectifs dans les sites Natura 2000 d'ici 2013 ;
- le renforcement du soutien de la France à la création d'un groupe d'expertise scientifique internationale pour la biodiversité sur le modèle du Groupe d'experts inter-gouvernemental sur l'évolution du climat.
La parole est à M. le rapporteur.

Le constat de la nécessité de stopper la perte de biodiversité est aujourd’hui partagé par tous. J’en veux pour preuve l’adoption, à l’unanimité, de l’amendement n° 525 rectifié, présenté par Mme Blandin.
Nous assistons en effet, depuis quelques dizaines d’années, à la disparition d’espèces animales et végétales, et ce à une vitesse sans précédent. Nous perdons beaucoup de boulons. Or, les écosystèmes nous fournissent de nombreuses ressources et leur bon fonctionnement dépend de la diversité biologique.
La commission adhère globalement aux objectifs fixés à l’article 20 et suivants. Elle insiste toutefois sur la nécessité de ne pas rééditer les erreurs du passé – je pense à Natura 2000 – et d’associer en conséquence, très en amont, l’ensemble des acteurs, notamment les élus locaux, à la mise en œuvre des mesures, en particulier pour ce qui concerne la trame verte et bleue.
La commission propose donc, dans l’amendement n° 61 rectifié bis, outre des modifications rédactionnelles, d’insister sur le rôle des collectivités territoriales, d’une part, pour l’élaboration du volet local de la stratégie pour la biodiversité et, d’autre part, pour la définition des mesures de compensation dans la trame verte et bleue.
Cet amendement tend également à préciser, et c’est un élément important, que les mesures de compensation demandées au porteur de projet devront être proportionnées aux atteintes.
Enfin, la commission estime qu’un vrai débat devra impérativement se tenir au Parlement pour décider, au moment du projet de loi d’engagement national pour l’environnement, c’est-à-dire le Grenelle II, des meilleures modalités d’élaboration et de gestion de la trame verte et bleue qui devront être très largement décentralisées.

Cet amendement est assorti de dix-neuf sous-amendements.
Les deux premiers sont identiques.
Le sous-amendement n° 148 rectifié est présenté par M. Le Grand.
Le sous-amendement n° 757 rectifié est présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, remplacer les mots :
préserver et accroître la biodiversité sauvage et domestique
par les mots :
stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d'évolution
Le sous-amendement n° 148 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter le sous-amendement n° 757 rectifié.

J’ai longuement expliqué les raisons pour lesquelles je souhaitais la rectification de l’intitulé du chapitre Ier du titre II. Ce sous-amendement vise à apporter la même rectification au membre de phrase identique qui figure dans le corps de l’amendement n° 61 rectifié bis. Il ne me paraît pas utile de développer davantage.

Le sous-amendement n° 792, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- l'évaluation des services rendus par la biodiversité à la collectivité, aux acteurs socio-économiques, avec les parties prenantes du Grenelle de l'environnement ;
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Le sous-amendement n° 792 a trait à l’évaluation des services de la biodiversité et de leurs valeurs, qui a été passée par pertes et profits lors du passage de l’article 20 du projet de loi à l’amendement n° 61 rectifié bis, au même titre, d’ailleurs, que la participation des parties du Grenelle à ce travail.
Or, s’il y a un point à faire connaître et à travailler, c’est bien la notion de service rendu. Si vous dites aux gens que le crapaud sonneur à ventre jaune a disparu, ils sourient ou ils haussent les épaules ; si vous leur dites que le crapaud qui mangeait les moustiques a disparu, ils voient les choses autrement.
Si vous déclarez que 30 % des bactéries lactiques ont disparu en vingt ans, cela ne les touche pas ; si vous leur dites que ces bactéries permettaient la fabrication du fromage, ils vous prêtent une autre attention.
Enfin, si vous leur expliquez que leurs maisons sont inondées parce que le marais voisin a été comblé, ils auront une autre vision des écosystèmes et soutiendront l’acquisition de 20 000 hectares de zones humides.
Au-delà de ces anecdotes, sachez que le collège employeur, avide d’indicateurs pour guider les stratégies, tout comme le collège syndical, au premier rang desquels les syndicats agricoles, soucieux de disposer d’outils pour négocier des gestions différenciées, étaient très demandeurs de ces évaluations.
À ce point du texte, nous avons considéré la biodiversité comme un tout, comportant les populations animales et végétales – l’espèce humaine n’est pas oubliée –, leur milieu de vie, leurs interactions et, désormais, les services rendus : pollinisation, évitement d’inondations, captation du carbone entre autres.
Si certains services se monnayent déjà – je pense à ces énormes camions qui traversent les États-Unis pour apporter en urgence des ruches au pied des vergers condamnés par la disparation des pollinisateurs –, nous sommes très loin du compte et des connaissances nécessaires pour faire ce compte ; songeons au phytoplancton, voire simplement aux terres retenues par une haie sur un terrain pentu. De toute façon, le but n’est pas d’avoir une vision comptable de la vie sur terre. Nous souhaitons en promouvoir la prise en compte dans les aménagements, les décisions publiques, le patrimoine arboré d’une ville, d’éventuels mécanismes de compensation, mais nous ne rangeons pas d’emblée les écosystèmes dans le système marchand, d’autant que nous sommes encore loin de maîtriser cette monnaie.
La notion de service est trop récente. Son utilisation s’est certes développée, mais aujourd’hui nous savons que 60 % des services écosystémiques sont utilisés de façon non durable. C’est de cela que nous devons nous préoccuper avant toute chose.
Le sous-amendement n° 791 vise donc à supprimer le mot « valorisation », car il est ambigu. Il peut être interprété comme la recherche d’une augmentation de la valeur des services des écosystèmes, ce qui n’est pas toujours possible ni souhaitable. Je prendrai un simple exemple. Hier, valoriser une tourbière, c’était en faire un combustible à faible rendement et à fort dégagement de CO2. Faire cela aujourd’hui serait une erreur. La priorité actuelle est de mieux connaître les services rendus par les écosystèmes en termes biologiques.
En résumé, le sous-amendement n° 792 vise à introduire la notion d’évaluation et le sous-amendement n° 791 à supprimer les mots « de valorisation ».

Le sous-amendement n° 791, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, supprimer les mots :
de valorisation,
Ce sous-amendement est défendu.
Le sous-amendement n° 526 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier membre de phrase du quatrième alinéa de l'amendement n°61 rectifié bis, après le mot :
ruraux
insérer le mot :
, insulaires
La parole est à M. Serge Larcher.

Il s’agit d’un sous-amendement de précision.
Dans une énumération, nous savons l’écueil que constitue la tentation de l’exhaustivité. Il en est ainsi lorsque, au détour d’une phrase, on entame une liste de territoires.
D’autres types de territoires que ceux qui sont mentionnés mériteraient une approche spécifique : les zones humides, pour le service d’assèchement qu’elles rendent et de façon à valoriser encore plus leur réputation ; les zones périurbaines, où se fait lourdement sentir l’empreinte écologique de la ville, de ses transports, de ses apports d’énergie, de ses rejets, des loisirs de ses habitants, où les initiatives de maraîchage de proximité deviennent de plus en plus pertinentes ; des zones de captage, aux besoins de protection supérieurs ; des zones littorales fragilisées par l’évolution du trait de côte et, pour leur partie marine, déterminante pour la survie de la ressource piscicole, car c’est là, et là seulement, que se font les pontes – pour les tortues en particulier – et la croissance des alevins.
Mais il faut choisir. Il me semble juste de citer la spécificité des territoires ruraux, car la qualité du travail des agriculteurs est déterminante pour la biodiversité.
Il est juste également de mentionner la montagne, le législateur a même inséré cette notion dans une loi.
Nous proposons donc, pour notre part, d’ajouter une référence à la spécificité insulaire. C’est une demande forte des différentes catégories de collectivités d’outre mer, c’est aussi une nécessité pour la Corse et nos îles atlantiques.
Les îles cumulent souvent, d’une part, une très grande richesse terrestre et marine, liée à l’évolution particulière des écosystèmes isolés, à l’omniprésence près des côtes de zones d’alevinage et, en zone tropicale, de récifs coralliens ou de mangroves et, d’autre part, un déficit d’équipements de remédiation tels que des stations d’épuration aux normes ou des unités de tri et de recyclage des déchets.
En conséquence, faute d’investissements aussi qualitatifs qu’en métropole, les impacts des activités humaines sont plus dommageables à la biodiversité.
On pourrait aussi évoquer certaines tolérances inadmissibles à l’égard de substances prohibées en métropole : le chlordécone aux Antilles, certains pesticides utilisés au-delà des normes sur les fraises de Nouvelle-Calédonie, etc. Ces molécules, qui affectent la santé, sont aussi toxiques pour les écosystèmes. Voilà une autre triste spécificité de nos îles !
C’est pourquoi nous proposons de citer, entre les territoires ruraux et de montagne, les territoires insulaires.

Le sous-amendement n° 793, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 61 rect. bis, après les mots :
de montagne
insérer les mots :
, du rôle que peut jouer la diversité intraspécifique des espèces de culture et d'élevage
La parole est à M. Marc Daunis.

Malgré sa relative simplicité, ce sous-amendement est important. Il vise deux objectifs particuliers.
D’une part, il tend à préciser que les mesures mises en place dans le cadre de la constitution des trames verte et bleue doivent prendre en compte les spécificités de l’ensemble des territoires, et non uniquement des territoires ruraux et de montagne.
D’autre part, il a pour objet de spécifier que l’activité agricole peut jouer un rôle de premier plan en matière de biodiversité, et ce en montagne comme ailleurs. Ainsi, nous constatons que le maintien de terres agricoles au niveau des espaces péri-urbains est de plus en plus fondamental.
Il y a là un enjeu important, d’où ce sous-amendement visant à introduire le membre de phrase suivant : « du rôle que peut jouer la diversité intraspécifique des espèces de culture et d’élevage ».

Le sous-amendement n° 776, présenté par MM. Raoult, Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Repentin, Ries, Teston, Guillaume, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le mot :
protection ;
rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa de l'amendement n° 61 rect. bis :
sans préjudice des dispositions relatives à l'évaluation environnementale, des mesures visant à compenser les atteintes aux continuités écologiques seront rendues obligatoire dans les documents de planification et les projets susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur la trame verte et bleue, selon des modalités définies par décret ;
La parole est à M. Roland Courteau.

La création d’une trame verte et bleue et sa reconnaissance législative doivent s’insérer autant que possible dans les dispositifs existants.
À ce titre, les documents de planification ainsi que les projets sont d’ores et déjà soumis au régime de l’évaluation environnementale tel que défini par le code de l’environnement. Ce régime prévoit des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier lieu, de compensation sur l’ensemble des aspects environnementaux.
Il paraît important de préciser que ce dispositif n’est pas remis en cause dans le cadre de la trame verte et bleue et d’insister, uniquement pour la compensation, sur la spécificité de cette trame en termes de continuités écologiques. Tel est l’objet du présent sous-amendement.
Par ailleurs, la compensation vise à rétablir un équilibre rompu entre des intérêts complémentaires ou antagonistes.
L’ajout du terme « proportionnée » comme adjectif du terme « compensation » est au mieux redondant. Au pire, il soulève des interrogations quant à la nature même de la compensation. Dès lors, nous proposons de s’en tenir au seul terme « compensation », qui garantit par lui-même le retour à l’équilibre rompu par les atteintes portées à l’environnement.

Le sous-amendement n° 794, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 61 rect. bis, remplacer les mots :
aux continuités écologiques dans le cadre de la trame verte et bleue
par les mots :
aux effectifs des espèces, aux milieux perturbés et à leur fonctionnalité, et aux continuités
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Considérer que, si la réalisation d’un équipement entraîne des impacts négatifs sur les milieux naturels il suffit de compenser ces impacts, est une idée fort simple.
Cette idée est même un peu simpliste, bien qu’elle figure dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Dans son article 2, celle-ci dispose que l’étude d’impact figurant dans le dossier soumis à enquête publique pour un certain nombre d’équipements doit comprendre au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement.
Or, sauf cas vraiment exceptionnel, la compensation exacte des dommages est impossible, en raison soit d’une insuffisance de connaissances scientifiques, soit d’une impossibilité technique à la mettre en œuvre, soit d’un coût disproportionné par rapport à l’équipement ou à l’ouvrage. Par conséquent, de manière générale, elle n’empêchera pas une perte plus ou moins importante de diversité biologique.
De plus, il arrive fréquemment que des compensations prévues ne sont pas mises en œuvre, notamment lorsqu’elles demandent des efforts sur de nombreuses années.
Enfin, il existe actuellement une tendance consistant à vouloir compenser des impacts négatifs en un lieu donné par des actions sur des territoires éloignés, voire franchement lointains. Eh bien, non ! On ne compensera pas la perte du lys maritime sur la zone de l’incinérateur de Marseille en finançant un programme de sauvegarde de la pervenche de Madagascar !
La possibilité de compensation doit donc être limitée aux seuls cas dans lesquels l’équipement est réellement indispensable et alors qu’il est impossible de faire autrement. Ce n’est pas une solution de facilité !
Certes, lorsque des ouvrages ont un caractère vraiment essentiel, par exemple lorsqu’ils concernent la santé humaine ou la sécurité, il est préférable de prévoir une compensation des impacts négatifs, mais ce dispositif doit rester exceptionnel. Il ne doit pas aboutir, de façon déguisée, à ce que l’on puisse tout faire en échange de solutions à quelques euros, surtout lorsque l’on sait qu’elles ne fonctionnent pas.
Ce sous-amendement tend donc à limiter la possibilité de détruire, puis de compenser, à des projets cruciaux. Dans son article 6, la directive européenne concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages limite déjà cette possibilité, en cas d’atteinte aux espèces et aux écosystèmes fragiles et prioritaires, aux seuls programmes de santé humaine, sécurité publique et protection de l’environnement.
Je propose donc en fait deux sous-amendements qui se succèdent. L’un précise que la loi encadre le type de projets donnant lieu à compensation. L’autre détaille la nature de ces compensations. Il ne s’agit pas d’enrichir un territoire voisin avec cent grenouilles supplémentaires, il s’agit de restaurer un milieu !

Le sous-amendement n° 795, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 61 rect. bis par un membre de phrase ainsi rédigé :
la loi précise les catégories de programme ou de projets pour lesquels des compensations peuvent être acceptables ;
Ce sous-amendement est déjà défendu.
Le sous-amendement n° 777, présenté par MM. Raoult, Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Repentin, Ries, Teston, Guillaume, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 61 rect. bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la réduction, à l'occasion du renouvellement des concessions ou des autorisations, des atteintes portées aux continuités écologiques par les ouvrages hydrauliques ou les grandes infrastructures linéaires, au regard des connaissances scientifiques et des moyens techniques disponibles ;
La parole est à M. Paul Raoult.

Dans le cadre des engagements pris par l’ensemble des parties lors du Grenelle de l’environnement, en particulier sur la constitution d’une trame verte et bleue et la conservation ou la restauration des continuités écologiques, il est important que l’État se révèle exemplaire à l’occasion du renouvellement des concessions ou des autorisations relatives aux ouvrages et infrastructures qui relèvent de sa compétence et qu’il veille ainsi à réduire les atteintes portées aux continuités écologiques. Tel est l’objet du présent sous-amendement.
La notion de trame verte et bleue est nouvelle. Il faudra la populariser, mais aussi l’intégrer à l’avenir dans notre manière d’aménager le territoire et la traduire dans les schémas de cohérence territoriale et dans les plans locaux d’urbanisme.
Ce concept est à la fois précis et imprécis dans la mesure où, dans ce domaine, les connaissances scientifiques ne sont pas complètes et celles des élus relativement peu importantes. Nous ne sommes jamais que le reflet de la population que nous représentons !
Cela signifie qu’un effort de tous sera nécessaire pour faire comprendre que, à l’heure actuelle, notre politique de protection de la nature ne doit plus se limiter aux milieux naturels exceptionnels, mais également englober les milieux naturels les plus banals et, par conséquent, s’appliquer sur l’ensemble du territoire.
Il faut ensuite prendre en compte les continuités écologiques. Les routes et les grands équipements linéaires ont fragmenté l’espace naturel et cette fragmentation a entraîné une diminution de la biodiversité car chaque espèce a besoin d’un habitat précis. En réduisant son habitat, vous la conduisez en réalité à la mort !
Nous devons donc conduire une réflexion globale en matière d’aménagement de l’espace, en y intégrant la nature dans son caractère exceptionnel, mais aussi dans sa banalité.
La problématique est identique pour la trame bleue : il suffit d’une interruption de l’espace naturel le long d’un cours d’eau pour que la continuité écologique soit rompue, la connectivité cassée et la richesse de tout l’environnement de la rivière entamée. Les réflexions autour de la question du barrage sont donc beaucoup plus importantes qu’on ne le croit.
De plus, il faut prendre en compte, non seulement la continuité écologique, mais aussi la transversalité écologique. Par exemple, le brochet se reproduit dans les espaces marécageux situés le long de la rivière. Par conséquent, si vous créez des berges insubmersibles et que le poisson ne peut pas traverser, vous le tuez !
Une analyse globale de l’organisation de l’environnement naturel est donc nécessaire, en même temps qu’une réflexion sur les différents aménagements du territoire qui peuvent être mis en œuvre. À mon sens, il s’agit d’une réflexion profonde, qui dépasse la banalité des termes « trame bleue » et « trame verte » et qui nous obligera à un effort certain lors de l’élaboration des SCOT et des PLU.

Le sous-amendement n° 534 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa de l'amendement n° 61 rect. bis, remplacer le mot :
notamment
par les mots :
y compris
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Ce sous-amendement est très simple et se défend rapidement.
Les stratégies locales cohérentes de la France s’appliquent sur tout son territoire, qu’il soit métropolitain ou ultramarin. Nous proposons simplement d’introduire le terme « y compris », qui renvoie plus nettement à cette idée d’intégration de toutes les régions, territoires et départements d’outre-mer. On les oublie trop souvent, alors même qu’ils sont encore plus concernés par la biodiversité que le territoire métropolitain !

Le sous-amendement n° 533 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa de l'amendement n° 61 rect. bis, remplacer le mot :
régionales
par les mots :
locales cohérentes
La parole est à Mme Odette Herviaux.

Si vous le permettez, monsieur le président, nous souhaitons modifier une nouvelle fois ce sous-amendement. Il ne s’agirait plus de remplacer le mot « régionales », mais d’ajouter après ce mot les termes « et locales cohérentes »

Il s’agit donc du sous-amendement n° 533 rectifié bis.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

À l’heure de la décentralisation, alors que le principe de la république décentralisée a été reconnu dans la Constitution et que certaines collectivités ont été précurseurs en matière d’actions en faveur de la biodiversité, il nous semble pour le moins maladroit d’arrêter que le niveau local devrait décliner ce que le niveau national aurait décidé, ou alors qu’on nous dise carrément que la charge de planifier les stratégies locales incombera désormais aux préfets et que ceux-ci disposeront de la totalité des moyens nécessaires à la protection de la biodiversité dans les régions et départements.
Dans un souci de respect des dynamiques qui sont à l’œuvre ou en préparation sur le terrain et dans un souci de stratégie partagée, nous proposons donc cette nouvelle rédaction. Elle nous semble plus respectueuse des efforts déjà initiés et, pour beaucoup d’entre eux, déjà réalisés par l’ensemble des collectivités.
Le sous-amendement n° 796, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis par un membre de phrase ainsi rédigé :
cette stratégie inclura les mesures pour appliquer les décisions, résolutions et recommandations adoptées par les Conférences des Parties des conventions internationales relatives à la biodiversité, et mettra en œuvre les programmes de travail de la Convention sur la diversité biologique ;
La parole est à M. Paul Raoult.

La France a ratifié de nombreuses conventions internationales qui l’engagent sur des décisions et des programmes : convention RAMSAR sur les zones humides, convention de Bonn sur les espèces migratrices et accords associés, convention CITES sur le commerce international de la faune et de la flore, convention relative au patrimoine mondial, convention alpine, convention OSPAR, convention des mers régionales, conventions d’Apia et de Nouméa, etc. Elle doit d'ailleurs rendre compte de ce qu'elle met en œuvre.
Par exemple, la convention sur la diversité biologique a prévu un nombre important de programmes de travail, notamment sur les forêts, les îles, les montagnes, les eaux côtières et marines, les aires protégées, les espèces exotiques envahissantes et les stratégies mondiales de conservation des plantes.
Ces programmes, qui font l’objet de nombreuses discussions avant leur adoption et sont soumis à des évaluations régulières sur les progrès réalisés, ont tous été approuvés et votés par la France.
Certes, de nombreuses actions préconisées sont mises en œuvre en France, mais elles ne le sont pas toutes, et en tout cas pas dans le cadre logique, cohérent et coordonné de ces programmes. La stratégie nationale de conservation de la diversité biologique en reprend plusieurs, mais de nombreuses actions sont ignorées.
Or, tant pour l’efficacité que pour le respect de nos engagements, un effort devrait être fait pour inclure complètement ces programmes de travail et le suivi de leur mise en œuvre dans l’ensemble de nos documents concernant la stratégie de conservation de la diversité biologique.
Il y a urgence, ne serait-ce que pour atteindre l'objectif de 2010 décidé par la convention sur la diversité biologique, à savoir enrayer la perte de biodiversité. La France souscrit à cet engagement européen, puisqu’elle l'a repris dans sa stratégie nationale sur la biodiversité.
Il est indispensable que la France soit en mesure de mettre en œuvre, sur son territoire, les décisions prises dans le cadre international qu'elle a elle-même approuvées.
Prenons l’exemple des zones humides. Il y a là un enjeu important. Nous avons signé la convention RAMSAR, mais les zones humides continuent de disparaître. Les efforts réalisés ici ou là sont malheureusement largement insuffisants. Or, si nous n’agissons pas, c’est la protection des champs captants qui sera remise en cause, puisque les zones humides jouent le rôle d’éponges et permettent de purifier les eaux superficielles qui vont ensuite s’infiltrer dans la nappe phréatique. Il est donc urgent de protéger ces zones humides et d’appliquer la convention RAMSAR.

Le sous-amendement n° 797, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la mise en œuvre d'une législation destinée à l'application du j de l'article 8 (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et l'article 15 (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) de la convention sur la diversité biologique qui sera soumise au Parlement ;
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

La Déclaration des droits des peuples indigènes adoptée le 13 septembre 2007 constitue une référence internationale, tout comme la convention sur la diversité biologique de 1992 garantissant l’engagement des États pour la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi qu’un partage juste et équitable des bénéfices des ressources génétiques. Cent soixante pays sont signataires.
Paris a accueilli la conférence internationale pour la biodiversité sur le thème « Science et gouvernance » les 24 et 28 janvier 2005. C’est la France qui a proposé en 2005 la création d’un mécanisme international d’expertise scientifique sur la biodiversité, ou IMOSEB.
Signalons au passage que, si ces dispositifs d’encadrements sont louables, il n’en demeure pas moins que la convention 169 de l’Organisation internationale du travail est à ce jour le seul instrument de protection des droits des peuples indigènes. En la signant, la France s’honorerait et marquerait un pas significatif pour la protection et la reconnaissance des droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne le contrôle de leurs ressources naturelles, ainsi que la protection des savoirs et des patrimoines traditionnels.
Signer et mettre en application la convention 169 permettrait donc une lutte plus efficace contre le biopiratage.
La communauté internationale accorde actuellement une extrême importance à la mise en œuvre des articles 8 j – préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales – et 15 – accès et partage des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques – de la convention pour la biodiversité.
L’article 8 concerne la conservation in situ, la préservation et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.
L’article 15 ne concerne que les ressources génétiques : populations et races animales, variétés végétales anciennes et nouvelles, populations et souches microbiennes, espèces et types sauvages apparentés aux espèces cultivées ou domestiquées.
Le paragraphe 7 oblige les États à avoir une législation.
Il est urgent de résoudre ce problème de législation pour deux raisons.
Il convient de limiter le pillage de nos ressources génétiques, particulièrement en outre-mer. Par exemple, on peut constater que des laboratoires australiens prospectent beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs accusations de biopiraterie ont été rapportées, mais pour que les actes visés soient qualifiés de biopiraterie, cela suppose une interdiction. En France, la législation étant inexistante, mis à part un embryon dans le parc de Guyane, on peut « voler » tout ce qu’on veut comme ressource génétique sans que ce soit illégal. Pour illustrer mon propos, je citerai la moisissure qui sert à fabriquer le roquefort !
Sourires

Ensuite, il s’agit de sécuriser les industriels français utilisateurs de ressources génétiques pour la pharmacie, la cosmétique, les semences et les biotechnologies. L’incertitude juridique fragilise leurs activités.
La prochaine réunion de la Conférence des Parties à cette convention devrait, en octobre 2010, adopter un régime international sur l’accès et le partage des avantages résultant de l’utilisation de la diversité génétique.
Plusieurs décisions de la Conférence des Parties à cette convention, approuvées par la France, demandent aux États de mettre en place des législations nationales. Cela est d’autant plus urgent pour notre pays que la diversité génétique des espèces sauvages et les savoirs traditionnels des populations autochtones des départements et territoires d’outre-mer ne bénéficient d’aucune protection et que notre pays ne dispose pas de législation permettant de lutter contre le biopiratage.

Le sous-amendement n° 765 rectifié, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, remplacer le millésime :
par le millésime :
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de l'engagement n°177 du Grenelle sur la biodiversité et les ressources naturelles, qui prévoit que la France s'engage plus fortement dans l'animation du réseau international de protection des récifs coralliens.
Il nous semble en effet injustifié que le projet de loi prévoie un décalage de huit ans pour la mise en place des aires marines protégées dans les DOM et en métropole.
Cela est d'autant plus dommageable que la richesse environnementale marine de l'outre-mer est très substantielle : la richesse de la biodiversité ultramarine permet à la France de siéger dans la quasi-totalité des instances internationales de préservation de l'environnement.
Ainsi, l'outre-mer comprend 97 % de la superficie des eaux maritimes françaises, et plus de la moitié des espèces de cétacés et pinnipèdes existants vit, se nourrit ou migre dans cet espace maritime. C'est pourquoi nous proposons de diminuer le délai qui lui est imposé de moitié.
En outre, la France devrait prendre, à compter de juillet 2009, la présidence de l'initiative internationale pour les récifs coralliens, l’ICRI.
L’adoption de sous-amendement constituerait un signal fort adressé à nos compatriotes ultramarins et à nos partenaires internationaux sur l'engagement français en la matière.

Le sous-amendement n° 538 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le neuvième alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, remplacer le mot :
invasives
par les mots :
exotiques envahissantes
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Dans les conférences internationales, l’anglais prime tant que le terme soustainable nous a donné « le développement soutenable », expression que vous avez d’ailleurs repoussée, mes chers collègues, au début de nos débats. Aujourd’hui, le mot « envahissantes » est rejeté au profit du terme « invasives », qui vient de global invasive species database, base de données mondiale contre les espèces envahissantes. Il s’agit de référencer ces espèces et d’alerter les instances mondiales sur les dangers qu’elles représentent.
Dans son amendement n° 37 à l’article 10, M. le rapporteur a souhaité remplacer le mot « hinterland » par « arrière-pays ». Quoi de plus logique !
Très bien ! et marques d’approbation sur les travées de l ’ UMP.

Les biologistes francophones travaillent de très longue date sur les animaux et les plantes importés volontairement ou accidentellement qui se multiplient et perturbent nos écosystèmes, comme certaines espèces indigènes tel l’écureuil roux européen.
Les biologistes qualifient ces espèces d’exotiques parce qu’elles viennent d’ailleurs, et d’envahissantes parce que leur prolifération pose de sérieux problèmes aux espèces locales et à leur milieu.
C’est donc à un choix sémantique plus francophone que vous invite ce sous-amendement. Si vous n’êtes pas convaincus par mon argument, reportez-vous à la Constitution, selon laquelle « la langue de la République est le français ».
Le terme « invasif » est un anglicisme, qui, si l’on se reporte aux dictionnaires français, devrait être réservé à certains procédés médicaux d’exploration, pour visionner par exemple un ulcère dans l’estomac ou certaines tumeurs pouvant se propager.
Il convient donc d’utiliser les termes scientifiquement validés dans les études et dans les plates-formes de débats. Les décisions de la Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique se réfèrent aux espèces exotiques envahissantes.
Sourires

Le sous-amendement n° 799, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, remplacer les mots :
d'un groupe d'expertise scientifique internationale pour la biodiversité
par les mots :
d'une plate-forme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services des écosystèmes
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Le chef de l’État français a proposé en janvier 2005, lors de la conférence internationale à Paris, « Biodiversité, science et gouvernance », la création d’un organisme regroupant des scientifiques qui seraient chargés de donner des informations et des recommandations aux politiques dans le domaine de la diversité biologique, à l’image de ce que fait le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, dans le domaine des changements climatiques, lequel s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix.
Depuis, la France a mis en place un groupe international de réflexion sur ce que pourraient être cet organisme et le processus IMOSEB. Plusieurs réunions ont été organisées sur tous les continents. Il en est résulté des propositions, et ce processus a reçu le soutien de l’Union européenne.
Parallèlement, le programme des Nations unies pour l’environnement poursuivait sa réflexion pour qu’une suite soit donnée au travail important effectué à la demande de l’Assemblée générale des Nations unies et qui a débouché sur un document de référence, l’évaluation des écosystèmes en début de millénaire.
Le programme des Nations unies pour l’environnement souhaitait mettre en place un mécanisme permanent de suivi. Finalement, il a été considéré que les deux initiatives étaient complémentaires et pouvaient donner lieu à un projet commun, l’IPBES ou Intergovernemental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services.
Une première réunion s’est tenue à Kuala Lumpur en novembre 2007. Le principe de la création de l’IPBES est maintenant engagé, et une autre réunion est prévue en février 2009. Le texte de loi doit reprendre le titre exact de ce programme pour ne pas revenir en arrière, et il est important que la France continue de soutenir la mise en place le plus rapidement possible de cette plate-forme.

Le sous-amendement n° 800, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, après les mots :
d'un groupe d'expertise scientifique internationale pour la biodiversité
insérer les mots :
et l'évaluation des services qu'elle rend
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Chacun aura compris que la biodiversité rend de grands services à l’humanité. Par conséquent, je m’en tiendrai aux arguments que j’ai avancés précédemment.

Le sous-amendement n° 798, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis par les mots :
et à la participation de ses scientifiques à ce groupe
La parole est à M. Marc Daunis.

Il faut aller plus loin que le renforcement du soutien à la création du groupe d’expertise internationale et encourager la participation de scientifiques français à cette plate-forme.
En effet, pour diverses raisons, les chercheurs français sont très peu présents dans les organismes internationaux de ce type : travaux d’expertise non pris en compte dans leur évaluation, problèmes de financement de leur participation aux réunions, problèmes de langue, etc.
C’est ainsi que la préparation du Millennium Ecosystem Assessment, qui a mobilisé plus d’un million d’experts mondiaux, a vu la participation de moins d’une dizaine de Français, alors que nous comptons des dizaines d’experts du niveau requis. Du reste, le conseil d’administration de ce Millennium ne comporte aucun Français. La liste des experts en comprend beaucoup qui sont envoyés de France, mais il s’agit d’experts appartenant à des organisations internationales telle l’UNESCO, dont le siège est en France. Si l’on y regarde bien, sur 1 300 auteurs répartis dans 95 pays, on dénombre exactement 7 Français.
Il est donc essentiel que, dès le départ, soient mis en place les moyens adéquats pour faire valoir l’expertise des chercheurs français dans la plate-forme en cours de création.

L'amendement n° 210, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
Maintenir et développer la biodiversité sauvage et domestique
par les mots :
Préserver la biodiversité, maintenir ses capacités d'évolution et les fonctionnalités des écosystèmes
La parole est à Mme Évelyne Didier.

La nécessité de préserver la biodiversité a déjà été largement évoquée.
Selon nous, il est inutile de préciser que la biodiversité concerne les espèces sauvages et domestiques. Le terme de « biodiversité » suffit à englober l’ensemble des espèces.
En revanche, il nous paraît judicieux de préciser que les capacités d'évolution des espèces doivent être maintenues. Les travaux scientifiques portant sur la biodiversité font ressortir que celle-ci est notre assurance-vie et que de sa qualité dépend celle de notre avenir. Le maintien de la capacité d’évolution des espèces est, à cet égard, aussi important que le seul maintien d’un nombre minimal d’individus de chaque espèce.
De plus, la protection de la fonctionnalité des écosystèmes, c’est-à-dire le maintien des services que nous obtenons de ces derniers, doit elle aussi être explicitement mentionnée.
Par conséquent, il paraît bien plus pertinent de se fixer un objectif de préservation dynamique qui permette de maintenir ce dont les générations futures auront besoin.
J’indique que, si cet amendement devait ne pas être retenu, je me rallierais au sous-amendement n° 757 rectifié, présenté par notre collègue Marie-Christine Blandin.

L'amendement n° 527, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du premier alinéa de cet article par les mots :
, et le rôle que peut jouer la diversité intraspécifique des espèces de culture et d'élevage
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Nous sortons d’une grande période dans laquelle l’agriculture se caractérisait par la volonté de produire afin d’assurer la suffisance alimentaire, mais était aussi façonnée par les exigences de la grande distribution et de l’industrie agroalimentaire, plus soucieuses de l’uniformité du calibre, de l’esthétique et de la perfection sanitaire que de la diversité ou des particularités nutritionnelles.
Répondant à cette évolution des marchés, l’INRA s’était engouffré dans la voie d’une production normée, plus intense et plus rapide, faisant de nos territoires et de leurs sols, quelles que soient leurs spécificités, des sortes de « terres de mission » : il fallait amender les sols pour les rendre tous aptes aux mêmes semis plutôt que de voir une richesse dans les différents terroirs, où il y a autant à prendre dans les variétés cultivées et les races d’élevage locales qu’à agir pour les transformer.
Maintenant, nous sommes entrés dans une période de mutation. De nouvelles recherches, le goût des consommateurs, les services rendus par les races locales – certaines étant adaptées aux marécages, d’autres aux pentes, d’autres encore à la lutte contre l’incendie, etc. – rappellent à notre souvenir des espèces aux limites de la disparition. Même les généticiens, entre paillasse et ordinateur, commencent à avoir les yeux de Chimène pour les variétés locales !
Sourires

Pourtant, ceux qui les ont sauvées, ceux qui en assurent la reproduction, amateurs isolés ou professionnels vertueux, ne voient pas leur tâche facilitée : coûts d’entretien, de vaccination, d’inscription dans les salons – je pense aux chevaux de trait –, tracasseries des semenciers, refus des distributeurs…
Bien sûr, nous ne résoudrons pas tous leurs problèmes par la simple inscription dans ce Grenelle d’orientation de l’importance des races locales et des variétés végétales des territoires ; des aides spécifiques ou des négociations entre filières seront également nécessaires. Mais nous aurons au moins ouvert un cadre favorable à leur action par la mention de notre intérêt pour ces races et ces variétés.

L'amendement n° 759 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Pierre, Bailly, Bizet et Revet, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du premier alinéa de cet article par les mots :
, ainsi que le patrimoine séculaire des moulins et de leurs ouvrages
La parole est à M. Charles Revet.

Dans la mesure où la protection des sites est prise en compte dans le Grenelle, par exemple pour l'implantation des éoliennes, il paraît souhaitable d'introduire aussi la notion de protection du patrimoine que constituent les moulins et de leurs ouvrages.

Les amendements n° 186 rectifié et 528 sont identiques.
L'amendement n° 186 rectifié bis est présenté par Mmes Escoffier et Laborde et MM. Collin, Mézard et Milhau.
L'amendement n° 528 est présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article :
Si, en dépit des mesures prises pour éviter puis pour réduire ses impacts, un plan, projet ou programme est susceptible de nuire à la biodiversité, notamment dans le cadre de la trame verte et bleue, une compensation visant à maintenir et améliorer l'état de conservation des espèces et habitats impactés et à garantir les fonctionnalités des écosystèmes menacés est obligatoire, selon des modalités définies par décret.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Cet amendement, qui tend à améliorer la rédaction de la disposition relative à la compensation des dommages causés à la conservation des espèces et habitats, a en fait un double objet.
En premier lieu, il vise à replacer la compensation dans le cadre juridique en vigueur, c’est-à-dire celui du code de l’environnement, qui pose expressément quatre principes : le principe de précaution, le principe d’action préventive, le principe pollueur-payeur et le principe de participation. Les trois premiers de ces principes peuvent se traduire par les verbes : éviter, réduire et compenser. Il s’agit donc de ne pas limiter la compensation au simple remplacement des espèces et des habitats détruits, mais bien de prévoir une réelle restauration, c’est-à-dire la revitalisation de l'écosystème dans son ensemble. Une telle restauration ne pourrait que concourir à l’objectif de développement durable, qui, par le respect du présent, protège l’avenir. N’est-ce pas exactement le sens de cette formule de Saint-Exupéry : « On n’hérite pas de ses parents, on emprunte à ses enfants » ?

La citation exacte est : « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » !

En second lieu, cet amendement vise à préciser que la compensation ne doit pas être limitée aux seuls cas d'atteintes à la trame verte, c’est-à-dire aux espaces naturels protégés, et à la trame bleue, c’est-à-dire aux masses d’eau et à leurs berges. Une telle limitation porterait en effet atteinte au principe général introduit dans la loi relative à la protection de la nature de 1976, dont il n'est nullement justifié de restreindre le champ d'application à la trame.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 528.

J’ai exposé mes arguments en présentant un sous-amendement ayant le même objet.

L'amendement n° 529, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La loi précise les catégories de programme ou de projets pour lesquels des compensations peuvent être acceptables.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

L'amendement n° 744, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
À cet égard il est souhaitable que l'agriculture prenne globalement et systématiquement le virage de l'agro-écologie, en utilisant la biodiversité, dont la biodiversité cultivée, l'utilisation des prédateurs, le respect des insectes butineurs, comme une richesse au même titre que les intrants actuels.
La parole est à M. Jacques Muller.

La rédaction de l’article 20 me donne l’impression de laisser de côté une dimension importante. L’amendement n° 744 vise donc à inscrire clairement dans le texte que la biodiversité doit être considérée non pas comme un obstacle qu’il faudrait lever, comme une contrainte dont il faudrait s’affranchir, mais comme un atout, comme une ressource, voire comme un facteur de production. Voilà qui nous ramène à la question agricole !
Trop longtemps, le développement agricole a reposé sur la mécanisation, c’est-à-dire sur l’économie du facteur travail, l’« artificialisation » du milieu et des pratiques : je pense notamment aux élevages hors sol, aux intrants chimiques, à la sélection tournée vers la hausse des rendements plutôt que vers la résistance aux maladies.
Il fut une époque, c’est vrai, où l’objectif prioritaire était d’accroître les rendements. Aujourd’hui, les enjeux sont autres : nous devons préserver l’emploi dans l’agriculture et reconsidérer le rapport entre l’agriculture et l’environnement.
Je souhaite donc, à travers cet amendement, montrer que l’espace agricole, qui occupe l’essentiel de l’espace français, ne doit pas être considéré comme un espace à part, traversé par une trame verte, mais qu’il constitue lui-même un espace de biodiversité, et que l’agriculture a aussi pour fonction de valoriser cette biodiversité.
Peut-être est-ce du fait de mon passé d’ingénieur agronome que j’insiste : nous devons inscrire dans la loi cette nécessité de prendre le tournant de l’agro-écologie, laquelle ne se confond pas avec l’agriculture biologique ; l’agro-écologie consiste seulement à remettre à l’ordre du jour l’agronomie, les pratiques agricoles intégrées, celles qui valorisent déjà les phénomènes naturels.
Je conclurai en rappelant que Guy Paillotin, ancien président de l’INRA, aujourd’hui secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France, nous a déclaré, lorsqu’il a été entendu par la commission des affaires économiques, non pas que l’agriculture allait dans le mur, mais qu’elle était dans le mur !
Nous devons entendre ce message et considérer que l’agriculture, sans forcément devenir agriculture biologique, doit prendre le virage de l’agro-écologie.

L'amendement n° 532, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une législation destinée à mettre en œuvre le j de l'article 8 (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et l'article 15 (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) de la convention sur la diversité biologique sera soumise au Parlement.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Cet amendement concerne la convention sur la diversité biologique et les droits des peuples autochtones contre le biopiratage. Il a été défendu.

L'amendement n° 535, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :
notamment en outre-mer.
par les mots :
sans omettre l'outre-mer
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Cet amendement tend à faire en sorte que l’outre-mer ne soit pas oublié.

L'amendement n° 536, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après la première phrase du quatrième alinéa de cet article, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Cette stratégie inclura les mesures pour appliquer les décisions, résolutions et recommandations adoptées par les Conférences des Parties des conventions internationales relatives à la biodiversité. Elle veillera à mettre en œuvre les programmes de travail de la convention sur la diversité biologique.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Il s’agit, comme avec le sous-amendement n° 796, du respect par la France des engagements internationaux auxquels elle a souscrit.

Les amendements n° 121 rectifié et 622 sont identiques.
L’amendement n° 121 rectifié est présenté par MM. César, Bizet, Doublet, Laurent, Cornu, Pointereau, Bailly, Vasselle, Grignon, Lefèvre et B. Fournier et Mme Procaccia.
L'amendement n° 622 est présenté par M. de Montgolfier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :
l'acquisition
par les mots :
la protection et la valorisation
La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié.

Les objectifs assignés à la stratégie nationale de biodiversité ne peuvent être atteints par la seule acquisition de zones humides et sans que la question de la gestion de ces espaces ait été abordée et résolue.
La simple acquisition de telles surfaces ne saurait garantir leur protection et leur valorisation. Il est par conséquent préférable d'envisager celles-ci sans préjuger les moyens d'y parvenir.
L’adoption de cet amendement aura pour effet de mettre le quatrième alinéa de l'article 20 en cohérence avec son premier alinéa, dont les députés ont adopté une nouvelle rédaction affirmant que le maintien et le développement de la biodiversité passent par la protection et la valorisation de cette dernière.

L'amendement n° 622 n’est pas soutenu.
Les amendements n° 146 rectifié ter et 411 sont identiques.
L'amendement n° 146 rectifié ter est présenté par MM. Revet, Laurent, Pointereau et Bécot, Mme Procaccia et MM. Pierre, Juilhard, Detcheverry et Magras.
L'amendement n° 411 est présenté par M. Navarro, Mmes Herviaux et Blandin, MM. Le Menn, Repentin, Teston, Ries, Raoul, Raoult, Guillaume et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots :
souveraineté de l'État,
insérer les mots :
dans les limites de la mer territoriale,
La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l’amendement n° 146 rectifié ter.

Selon la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les États exercent leur pleine souveraineté sur la mer territoriale, qui s'étend jusqu'à 12 miles des côtes.
Pour avoir représenté la France lors de la conférence de l’ONU sur le droit de la mer, je peux vous confirmer qu’il en est bien ainsi !
Sourires

L'amendement n° 366, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots :
activités humaines
insérer les mots :
, notamment cynégétiques,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 650, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
invasives, terrestres et marines
par les mots :
exotiques envahissantes, animales ou végétales, vivant en milieu aérien, maritime ou terrestre,
La parole est à M. Jacques Muller.

Il s’agit, par cet amendement, d’une part, de fournir une traduction plus exacte que celle qui est trop directement reproduite à partir de l’anglais lorsqu’il est question d’espèces « invasives », d’autre part, d’introduire l’idée selon laquelle l’air est aussi une composante importante de l’environnement et qu’il convient donc de le prendre en compte dans la préservation de la biodiversité.
Pour illustrer mon propos, j’évoquerai le problème, désormais planétaire, de l’effondrement des cheptels d’abeilles. Compte tenu du rôle des abeilles et des insectes volants en général dans les écosystèmes et des grands dangers que leur font courir un certain nombre de procédés techniques, il me paraît important de pouvoir inscrire dans la loi que l’air fait partie de cet environnement qui permet de soutenir la biodiversité.

L'amendement n° 539, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
d'un groupe d'expertise scientifique internationale pour la biodiversité
par les mots :
d'une plate-forme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services des écosystèmes
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

L'amendement n° 540, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
La participation des scientifiques français à cette plate-forme sera encouragée.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Il s’agit d’un appel à la présence réelle, et pas seulement virtuelle, des scientifiques français dans les plates-formes internationales.

Pour les raisons exposées à propos de l’amendement n° 525 rectifié, la commission est tout à fait favorable à la formulation proposée par Mme Blandin dans le sous-amendement n° 757 rectifié.
La commission demande le retrait du sous-amendement n° 792, qui sera satisfait par l’adoption du sous-amendement n° 530 rectifié bis, à l’article 22.
J’ajoute que, si la commission adhère à la proposition de Mme Blandin de mieux évaluer les services rendus par la biodiversité, elle souhaite en revanche conserver l’objectif de leur valorisation, qu’a d’ailleurs mis en avant le groupe de travail du Grenelle sur la biodiversité, car cette valorisation n’est pas forcément contradictoire avec la protection. Ce groupe de travail a en effet rappelé que les études avaient fait ressortir l’importance économique considérable des biens et services incarnés dans les écosystèmes et le fait que la conservation des milieux accompagnée de pratiques d’utilisation durable apparaît préférable à l’exploitation intense après reconversion, y compris d’un point de vue économique.
Pour les mêmes raisons, tenant à son attachement à la notion de valorisation de la biodiversité, la commission demande également le retrait du sous-amendement n° 791.
Le groupe de travail du Grenelle sur la biodiversité a indiqué que la France devrait suivre l’exemple de la Suède et qu’il serait pertinent de mieux définir la valeur de la biodiversité, afin de pouvoir mettre en œuvre des mécanismes économiques et financiers en sa faveur, portant sur la fiscalité et les critères de redistribution, les mécanismes de marchés et les règles comptables. Le groupe propose, par exemple, que soient privilégiés dans les projets publics, les organismes qui ont entrepris des démarches d’engagements environnementaux.
Le rapport précise également que la mise en œuvre de la trame verte nationale nécessitera de mener une réflexion en termes de valorisation des territoires qui en font partie, notamment par un système de labellisation, mais aussi par des mesures fiscales, l’idée étant de faire en sorte que l’appartenance à cette trame soit vécue comme une opportunité et non pas comme une contrainte.
La commission émet un avis tout à fait favorable sur le sous-amendement n° 526 rectifié, car il apparaît opportun d’inclure dans l’article 20 la nécessité de traiter les problématiques spécifiques des territoires insulaires.
La commission partage l’objectif de prise en compte de la diversité des espèces de culture et d’élevage, mais il lui semble que le sous-amendement n° 793 est déjà satisfait par celui qui, présenté par les mêmes auteurs, évoque la nécessité de sauvegarder la biodiversité sauvage et domestique. Elle demande donc le retrait du sous-amendement n° 793.
S’agissant du sous-amendement n° 776, la commission partage totalement l’objectif de M. Raoult, qui est de préciser que le dispositif de compensation prévu dans les trames verte et bleue concerne les continuités écologiques et s’appliquera « sans préjudice des dispositifs d’évaluation et de compensation en vigueur ». L’amendement n° 61 rectifié bis le précise d’ailleurs explicitement.
La commission souhaite, en revanche, maintenir la notion de « compensation proportionnée ». Elle a accepté le principe de la compensation, qui constitue en tant que tel un progrès très significatif, mais elle souhaite en cette matière garder un juste équilibre. Elle demande donc le retrait de ce sous-amendement n° 776, qui est en partie satisfait par l’amendement n° 61 rectifié bis.
La commission demande également le retrait du sous-amendement n° 794. La rédaction proposée par la commission est plus souple et correspond davantage à l’esprit du projet de loi de programme. Il reviendra aux textes d’application de cette loi de préciser les modalités concrètes d’application du principe de compensation.
Le sous-amendement n° 795 vise à préciser les catégories de programmes ou de projets pour lesquels des compensations peuvent être acceptables, afin de ne pas remettre en question l’article 6 de la directive « Habitats », qui concerne les sites Natura 2000. Comme je l’ai déjà indiqué, l’amendement n° 61 rectifié bis précise explicitement que les dispositifs existants ne sont pas remis en cause. En conséquence, l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui transpose l’article 6 de cette directive, continue à s’appliquer.
Le sous-amendement n° 795 apparaît donc largement satisfait et la commission en demande le retrait.
Le sous-amendement n° 777 est satisfait, me semble-t-il, par les dispositions sur les trames verte et bleue. Celles-ci visent en effet précisément à préserver les continuités écologiques auxquelles le sous-amendement fait référence et, en conséquence, à y appliquer les principes de l’évaluation environnementale, qui visent à éviter, réduire et, à défaut, compenser les dommages causés. Par conséquent, la commission demande le retrait de ce sous-amendement.
La commission a émis un avis favorable sur les sous-amendements n° 534 rectifié et 533 rectifié.
La commission demande le retrait du sous-amendement n° 796 : il n’apparaît pas nécessaire, dans ce projet de loi de programme, d’entrer dans le détail du contenu de la stratégie nationale de la biodiversité, qui sera élaborée en étroite concertation avec le comité de suivi du Grenelle de l'environnement.
S’agissant du sous-amendement n° 797, je rappellerai que la France ayant signé et ratifié la convention de Rio, elle devra prendre des mesures d’application, comme pour toute convention internationale. Il n’apparaît donc pas opportun de mentionner ici cette convention plus qu’une autre. La commission demande, par conséquent, le retrait de ce sous-amendement.
Mme Payet nous propose de manière fort pertinente, avec le sous-amendement n° 765 rectifié, d’adopter des objectifs plus ambitieux pour la protection de la biodiversité outre-mer, thème qui lui tient à cœur. La commission émet un avis très favorable.
Le sous-amendement n° 538 rectifié me donne l’occasion de saluer une fois de plus la connaissance très approfondie qu’a Mme Blandin de ces sujets. La commission est donc un avis tout à fait favorable à la formulation plus précise et plus rigoureuse qu’elle nous propose ici.
Les travaux internationaux sur la biodiversité ont progressé à la conférence de Kuala Lumpur, mais l’organisme scientifique compétent en matière de biodiversité n’est pas encore créé. En conséquence, la France ne peut décider seule du futur nom de cet organisme. Il faut en débattre et il est préférable d’en rester au terme générique. La commission demande donc le retrait du sous-amendement n° 799.
Il en va de même pour le sous-amendement n° 800. Si la commission partage l’objectif de ses auteurs, à savoir mieux évaluer les services rendus par la biodiversité, elle considère qu’il sera satisfait par l’adoption du sous-amendement n° 530 rectifié bis, à l’article 22, consacré à la connaissance de la biodiversité.
Le sous-amendement n° 798 n’apporte aucune précision sur les modalités suivant lesquelles la participation des scientifiques à la plate-forme internationale sur la biodiversité sera encouragée. En l’état, même si son objectif est tout à fait louable, il apparaît superfétatoire. La commission en demande donc le retrait.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 210 au profit du sous-amendement n° 757 rectifié.
L’amendement n° 527 a le même objet que le sous-amendement n° 793 : avis défavorable.
Même si l’on ne peut que partager le souci des auteurs de l’amendement n° 759 rectifié quant à la protection des moulins à eau et à vent, ils reconnaîtront que celle-ci n’a que peu de rapport avec la préservation de la biodiversité, qui concerne les espèces et les sites naturels. De plus, il n’est pas sûr qu’une telle mention, très précise, relève vraiment d’une loi de programme.

L'amendement n° 759 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

En ce qui concerne les amendements identiques n° 186 rectifié bis et 528, je rappelle que l’amendement n° 61 rectifié bis précise explicitement que les dispositifs de compensation et d’évaluation déjà existants ne sont nullement remis en cause par la rédaction adoptée s’agissant des trames verte et bleue. Autrement dit, le régime de l’évaluation des incidences des projets dans les sites Natura 2000, en particulier, n’est pas remis en cause. Il est bien prévu qu’il faut prendre des mesures d’abord pour éviter, puis pour réduire l’impact des projets.
S’agissant de l’application de la compensation, il nous paraît préférable d’adopter une rédaction simple, à travers la notion de compensation des atteintes portées aux continuités écologiques.
Ces amendements étant largement satisfaits, la commission en demande le retrait.
L’amendement n° 529 a le même objet que le sous-amendement n° 795. La commission émet un avis défavorable pour les raisons déjà évoquées.
L’amendement n° 744 apparaît redondant avec de multiples dispositions du projet de loi, qu’il s’agisse de la biodiversité ou de l’agriculture. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 532 a le même objet que le sous-amendement n° 797 : avis défavorable.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 535, qui sera satisfait par l’adoption du sous-amendement n° 534 rectifié.
L’amendement n° 536 a le même objet que le sous-amendement n° 796 : avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 121 rectifié, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat, et cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, dans certains cas, il n’est effectivement pas nécessaire en effet d’acquérir systématiquement les zones humides pour les protéger. À cet égard, la commission est réservée sur la nécessité d’inscrire dans cette loi de programme les moyens destinés à atteindre les objectifs fixés, qui sont le placement de 2 % du territoire sous protection forte.
Ensuite, la commission a pris note que l’objectif d’acquisition de 20 000 hectares de zones humides, soit environ 1, 3 % du total des zones humides, figurait dans les propositions du groupe de travail sur la biodiversité et visait les zones humides les plus menacées par l’urbanisation. Mais elle souhaiterait avoir des réponses précises sur la manière dont ce chiffre a été déterminé et sur ses fondements scientifiques.

Je précise, avant d’entendre le Gouvernement, que cet avis de sagesse est conditionné à la transformation de cet amendement en sous-amendement à l’amendement n° 61 rectifié bis et au remplacement de la notion de « valorisation » par celle de « mise en valeur ».
L’amendement n° 146 rectifié ter est satisfait par l’amendement n° 61 rectifié bis qui, en prévoyant la réécriture de l’article 20, a pris en compte la précision souhaitée par M. Revet. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
Monsieur Muller, la rédaction proposée dans le sous-amendement n° 538 rectifié me paraît plus simple que celle qui figure dans votre amendement n° 650, que je vous demande donc de bien vouloir retirer.
L’amendement n° 539 a le même objet que le sous-amendement n° 799 : avis défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 540, qui a le même objet que le sous-amendement n° 798.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 61 rectifié bis.
Sur le sous-amendement n° 757 rectifié, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Comme M. le rapporteur l’a indiqué, le sous-amendement n° 792 est satisfait par le sous-amendement n° 530 rectifié bis, déposé à l’article 22, et pourrait donc être retiré.
Le principe de la valorisation est indispensable. On protège les territoires que l’on acquiert, et ceux-ci peuvent être valorisés par le biais du pâturage extensif, par exemple, ou par l’exploitation des tourbières ; mais je reviendrai sur ce point en abordant la question des zones humides. Il me semble extrêmement important de préciser qu’il s’agit bien d’espaces partagés, sur lesquels des actions peuvent être engagées sous certaines conditions.
Par conséquent, le Gouvernement vous demande, madame Blandin, de bien vouloir le retirer le sous-amendement n° 791.
En revanche, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 526 rectifié.
Le sous-amendement n° 793 vise à ajouter un membre de phrase très précis. Certes, l’agriculture a un rôle incontournable à jouer dans la préservation de la biodiversité, mais il faut aborder la question de la diversité sous tous ses aspects. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
Le sous-amendement n° 776 est satisfait par la rédaction que présente la commission.
Le sous-amendement n° 794 me pose un problème dans la mesure où il n’existe pas de définition légale des termes qu’il vise à introduire. En conséquence, le Gouvernement vous demande, madame Blandin, de bien vouloir le retirer.
Ainsi que l’a rappelé M. le rapporteur, la compensation est bien, par défaut, le dernier recours. Il n’est pas question de remettre ici en cause les dispositifs qui prévoient une évaluation préalable. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait du sous-amendement n° 795.
Le Gouvernement sait parfaitement qu’il doit consentir des efforts pédagogiques importants sur les différents sujets abordés, notamment sur la question de la continuité écologique. Cela dit, le sous-amendement n° 777 est satisfait par la rédaction de l’article telle qu’elle est proposée par la commission et pourrait donc être retiré.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 534 rectifié, car l’outre-mer a un rôle fondamental à jouer au regard de la biodiversité.
Il est également favorable au sous-amendement n° 533 rectifié.
La stratégie nationale de la France sur la biodiversité doit normalement inclure les différents objectifs qu’elle s’est fixés en adoptant les différentes conventions qu’elle a signées ; la liste en est d’ailleurs relativement longue. Le Gouvernement demande donc à Mme Blandin de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 796.
Le sous-amendement n° 797 soulève la question de la propriété de l’accès aux ressources génétiques. Actuellement, vous le savez, le principe du libre accès s’applique. Une expérimentation est en cours dans la forêt guyanaise. Nous proposons donc d’engager une étude beaucoup plus complète avec les ministères concernés et de dresser le bilan de l’expérience menée en Guyane, car il nous semble prématuré de légiférer dès maintenant sur ce sujet. Aussi, je vous demande, là encore, madame Blandin, de bien vouloir retirer ce sous-amendement.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 765 rectifié. L’essentiel de nos ressources en matière de biodiversité se situe outre-mer. L’objectif de 2020 est déjà ambitieux, celui de 2015 l’est plus encore. On nous demande d’être ambitieux, nous le serons !
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 538 rectifié. Les scientifiques parlent effectivement d’espèces « exotiques envahissantes ».
Concernant la dénomination du groupe d’expertise scientifique internationale pour la biodiversité, nous sommes passés du GIEB, à l’IMoSEB, puis à l’IPBES. Depuis que je suis chargée de ce dossier, le nom n’a cessé de changer. J’ose espérer que, à Nairobi, nous parviendrons à retenir un nom pour cette future structure. Il est sans doute prématuré de vouloir le faire ici. En conséquence, madame Blandin, je souhaite le retrait du sous-amendement n° 799.
Le sous-amendement n° 800 sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 530 rectifié bis, à l’article 22, comme M. le rapporteur l’a indiqué.
Par ailleurs, le Gouvernement partage les objectifs visés à travers le sous-amendement n° 798, mais cette mention n’a pas sa place dans ce texte.
L’amendement n° 210 étant satisfait par l’amendement de la commission, je vous demande, madame Didier, de bien vouloir le retirer.
L’agriculture est certes prioritaire, comme nous l’avons dit à propos du sous-amendement n° 793, mais il est difficile de viser très précisément une forme de diversité. Par conséquent, je souhaite, madame Blandin, le retrait de l’amendement n° 527.
Il me semble que, à la demande du rapporteur, l’amendement n° 759 rectifié a été retiré. Il n’avait effectivement que peu de rapport avec l’article 20, qui a trait à la biodiversité. En outre, le projet de loi tel qu’il est rédigé ne remet pas en cause la question des droits fondés en titre.
Les amendements identiques n° 186 rectifié bis et 528 sont satisfaits. Comme je l’ai indiqué tout à l'heure, les principes d’évaluation et de compensation ne sont pas remis en question.
Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement demande à Mme Blandin de bien vouloir retirer l’amendement n° 529.
Monsieur Muller, l’agriculture est évidemment l’un des acteurs majeurs de la biodiversité, mais il n’est pas le seul. Les débats du Grenelle de l’environnement ont été l’occasion de réunir autour d’une même table tous les acteurs concernés – ceux de la chasse ou du tourisme, par exemple –, et des avancées substantielles ont été réalisées, sur lesquelles je reviendrai lorsque nous aborderons l’article 28. Il importe donc de ne pas pointer du doigt tel ou tel secteur.
Par ailleurs, l’agriculture aura un rôle à jouer dans la gestion des zones humides, sujet que j’évoquerai plus précisément dans quelques instants.
Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement n° 744.
Le Gouvernement s’est déjà prononcé sur l’amendement n° 532.
L’amendement n° 535 est satisfait par le sous-amendement n° 534 rectifié.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 536.
J’en viens à l’amendement n° 121 rectifié, qui concerne les zones humides.
Hier, c’était la Journée mondiale des zones humides. Les représentants du Conservatoire du littoral et des agences de l’eau, les deux acteurs majeurs pour l’acquisition des zones humides, m’ont assuré que l’acquisition de 20 000 hectares de zones humides par les collectivités publiques dans les cinq ans à venir – globalement, la France compte 3 millions d’hectares de zones humides, ce qui relativise l’importance de la surface retenue – est réalisable et raisonnable. J’en ai même conclu que l’on pourrait aller au-delà. Cette acquisition, dont l’ampleur a été arrêtée avec les acteurs en question, permettra d’atteindre notre objectif de 2 % d’aires protégées.
Par ailleurs, les zones humides n’ont nullement vocation à être mises sous cloche. Elles doivent être gérées et valorisées avec les partenaires locaux, notamment avec les agriculteurs. Dans certaines zones, les agriculteurs font paître leurs bêtes ou procèdent au fauchage pendant des périodes données.
Enfin, ces zones nous rendent service non seulement en termes de biodiversité, mais aussi dans la mesure où ce sont des zones d’épuration très intéressantes. Il faut savoir, par exemple, que le système d’épuration de la ville de New York utilise des zones humides. De plus, elles servent de bassins d’expansion des crues. Récemment, dans le bassin de la Garonne, elles ont permis de ralentir l’arrivée des eaux.
C'est la raison pour laquelle, dans une logique de gestion, je suis très attachée à cette disposition prévoyant l’acquisition de 20 000 hectares de zones humides. Aussi le Gouvernement est-il défavorable à la suppression du terme « acquisition ».
Concernant les amendements identiques n° 146 rectifié ter et 411, le Gouvernement partage l’avis de la commission : ces amendements étant satisfaits, il demande à leurs auteurs de les retirer.
Je demande à M. Muller de bien vouloir retirer l’amendement n° 650. Si l’expression « espèces exotiques envahissantes » est bien celle qui est utilisée par les scientifiques, l’ajout de la notion de « milieu aérien » ne nous semble pas nécessaire dans la mesure où il est de toute façon question des espèces « terrestres » et « marines ».
De même, le Gouvernement demande à Mme Blandin de retirer les amendements n° 539 et 540.
Le sous-amendement est adopté.

Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Madame Blandin, le sous-amendement n° 792 est-il maintenu ?

Ayant la promesse de voir ma préoccupation prise en compte lors de l’examen du sous-amendement n° 530 rectifié bis, je le retire, monsieur le président.

Ce sous-amendement vise à supprimer, dans l’amendement n° 61 rectifié bis, les mots « de valorisation ». Or, comme Mme la secrétaire d’État nous l’a expliqué, il y a tout lieu de faire référence à la valorisation.
Il est vrai que, pour certains, « valoriser » les Dombes, cela veut tout boucher et construire un grand lotissement. Ce genre de valorisation, nous n’en voulons pas !
Compte tenu des explications apportées par Mme la secrétaire d’État, j’accepte de retirer cet amendement.
Le sous-amendement est adopté.

Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Madame Blandin, le sous-amendement n° 793 est-il maintenu ?

Oui, monsieur le président. Bien que la biodiversité concerne de nombreux domaines, nous tenons à ce que le projet de loi mentionne le rôle spécifique, dans les territoires, des races et des espèces locales. Je pense, par exemple, au rôle des chèvres en Corse dans la lutte contre les incendies.
Le sous-amendement n’est pas adopté.

M. Charles Revet. Pour autant, nous ne sommes pas contre les chèvres en Corse !
Sourires
Nouveaux sourires
Le sous-amendement n’est pas adopté.

Puisque l’on nous assure que les autres codes restent en vigueur, nous considérons qu’il n’y a pas lieu de soumettre au vote ces deux sous-amendements et nous acceptons de les retirer.
Le sous-amendement n’est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.

Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 533 rectifié bis.
Le sous-amendement est adopté.

Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Madame Blandin, le sous-amendement n° 796 est-il maintenu ?

Ce sous-amendement, qui concerne la convention sur la biodiversité biologique, nous semble indispensable en raison du vide juridique considérable dont les conséquences pèsent en particulier sur nos départements et collectivités d’outre-mer. En effet, à défaut d’application de cette convention, il existe un risque de pillage de leurs ressources génétiques.
Je précise que cette convention reprenait également des dispositions de la convention de l’Organisation internationale du travail, mais, là encore, la signature fait défaut !
Nous demandons que ces dispositions de la convention sur la biodiversité biologique soient reprises dans le projet de loi en vue de sauver les ressources génétiques de l’outre-mer et les peuples autochtones qui en vivent.

Nous voterons ce sous-amendement.
Vous nous avez indiqué, madame la secrétaire d’État, qu’il faudrait un peu de temps, mais tous ceux qui mettent en péril la diversité par les pillages auxquels ils se livrent, eux, ne prennent pas leur temps !

Il s’agit d’une question importante. Madame Blandin, afin d’éclairer notre vote, pouvez-vous nous donner des précisions sur ce « pillage génétique » ?

Le Costa-Rica a fait le choix de « valoriser » – terme que vous souhaitez voir figurer dans la loi – ses ressources génétiques. Ainsi, il y a au Costa-Rica des guides forestiers qui accompagnent des représentants de l’industrie pharmaceutique et leur montrent telle orchidée ou tel arbre connus, à l’origine, des seuls indigènes. Cependant, la condition indispensable pour l’utilisation de ces plantes est le partage des royalties des médicaments mis au point grâce à ces plantes entre les firmes pharmaceutiques et ces mêmes indigènes. Je pense, par exemple, à l’utilisation de certaines étamines pour la fabrication de médicaments anti-cancer.
On a pu observer des situations semblables dans nos départements et collectivités d’outre-mer. Les autochtones ont fait connaître leurs ressources naturelles à de nombreuses firmes. Or, contrairement à ce qui se passe au Costa-Rica, ces firmes pillent les ressources, et parfois même détruisent les plantes sur place pour qu’elles ne profitent à pas à la concurrence.
Nous ne connaissons pas, en Europe, d’expérience semblable à celles qui existent en Amérique latine.
Sourires
Effectivement ! Cela étant, la Conférence des Parties s’est engagée à ce que cette protection soit mise en œuvre en 2010, c'est-à-dire dès l’année prochaine.
Le sous-amendement n’est pas adopté.

La commission s’en était remise à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 121 rectifié à condition qu’il soit transformé en sous-amendement. Monsieur César, acceptez-vous la proposition de M. le rapporteur ?

sous-amendement n° 121 rectifié bis, présenté par MM. César, Bizet, Doublet, Laurent, Cornu, Pointereau, Bailly, Vasselle, Grignon, Lefèvre et B. Fournier et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Au sixième alinéa de l'amendement n° 61 rectifié bis, remplacer les mots :
l'acquisition
par les mots :
la protection et la mise en valeur
La parole est à M. Gérard César.

Aujourd’hui, les agriculteurs entretiennent parfaitement toutes les zones, avec dévouement, en y mettant tout leur cœur et en respectant la biodiversité. Il n’est donc aucunement nécessaire – ce serait même anormal – que le ministère ou le Conservatoire du littoral puissent acquérir – et avec quels moyens financiers, en ces temps de crise ? – 20 000 ou 30 000 hectares de zones humides.

Je peux vous assurer, mon cher collègue, que nous étions tous d’accord !
L’acquisition de 20 000 hectares de zones humides serait un minimum au regard des enjeux. Vous devez prendre conscience que ces 20 000 hectares nous permettront tout de même de disposer d’eau potable dans des conditions économiquement bien meilleures ! Les zones humides, en effet, en agissant comme des éponges, épurent l’eau naturellement. Cela nous évitera de payer des usines d’épuration d’eau qui coûtent une fortune !
Mme la secrétaire d’État a pris l’exemple de la ville de New York. Renseignez-vous ! La ville de New York a préféré acheter des terrains en zone humide pour éviter d’avoir à financer la construction d’une usine ! Nous n’allons quand même pas faire moins que les New-Yorkais !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

En tant que président d’un parc naturel, je dois me battre tous les jours et mener des concertations avec les agriculteurs afin qu’ils cessent de drainer des zones humides, d’ailleurs subventionnées par le conseil général.
Dans une zone humide que je connais bien, nous avons pu tirer 7 millions de mètres cubes d’eau d’un champ captant. Si nous avions laissé les agriculteurs drainer cette zone humide, il aurait fallu financer l’installation d’une usine d’épuration pour traiter ces 7 millions de mètres cubes d’eau afin de les débarrasser, entre autres, des pesticides !
L’acquisition de 20 000 hectares est donc vraiment peu de chose au regard de l’enjeu que représente le ravitaillement en eau de notre pays !
Franchement, monsieur César, je ne vous comprends pas ! Je répète que cette mesure décisive du Grenelle de l’environnement a été acceptée par la FNSEA et les chambres d’agriculture. Au sein du comité opérationnel que je préside, nous débattrons d’ailleurs de ce sujet durant toute la journée de demain.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Compte tenu des explications de Mme la secrétaire d’État et de M. Raoult, je demande avec insistance à M. César de retirer son sous-amendement. Ces enjeux d’une extrême importance ont en effet fait l’objet d’un accord, dans le cadre du groupe de travail, avec la profession agricole.

Il m’arrive souvent d’être d’accord avec mon ami Paul Raoult. Mais les organisations professionnelles sont favorables à l’amendement, transformé en sous-amendement, que j’ai déposé, car les agriculteurs entretiennent également ces zones.
J’accepte de retirer ce sous-amendement, mais mes collègues cosignataires, que je n’ai pas consultés, en seront certainement très contrits. Nous tenterons d’améliorer cette proposition à l’occasion de la deuxième lecture.

Le sous-amendement n° 121 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l’amendement n° 765 rectifié.

Je soutiens le sous-amendement de Mme Payet, qui propose de remplacer la date de 2020 par celle de 2015.
Afin d’éclairer le Sénat, je tiens à rappeler que notre groupe avait déposé un amendement proposant la date de 2012 pour la métropole et les zones ultramarines volontaires, et de 2020 pour les autres zones. Cet amendement a été déclaré irrecevable en vertu de l’article 40 de la Constitution, ce qui prouve que l’on n’avait pas provisionné suffisamment d’argent pour les départements et collectivités d’outre-mer.
Je me félicite que la date de 2015 ait finalement pu faire l’objet d’un accord.
Le sous-amendement est adopté.

Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 538 rectifié.
Le sous-amendement est adopté.

Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Madame Blandin, le sous-amendement n° 799 est-il maintenu ?

Notre proposition visait à adapter le texte du projet de loi au nouveau vocabulaire des dispositifs internationaux. J’ai bien entendu l’argumentation de Mme la secrétaire d’État selon laquelle les choses peuvent évoluer. Le problème, c’est que le Grenelle d’orientation, lui, est destiné à durer ! Je proposais donc d’anticiper la formulation retenue par tous les États, car je serais fort étonnée de les voir revenir sur leur position.
Puisque vous préférez garder un nom déjà obsolète, madame la secrétaire d’État, j’en prends acte sans me battre davantage et je retire mon sous-amendement.

Je le retire, en espérant que le Sénat adoptera, à l’article 22, mon sous-amendement n° 530 rectifié bis, relatif à l’évaluation des services rendus par la biodiversité.

Oui, monsieur le président, parce que nous tenons beaucoup à la place de nos scientifiques dans ce groupe de travail sur la biodiversité. Leur présence devrait aller de soi et nous ne devrions pas avoir à le préciser dans une loi, mais je me rallie à l’excellente démonstration de M. Daunis : ils ne sont que 7 sur 1 300 ! Lorsque nous examinerons la question de la santé environnementale, nous verrons que, faute de toxicologues, nous n’arrivons pas à pourvoir les postes qui sont attribués à la France.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l’article 20 est ainsi rédigé et les autres amendements n'ont plus d'objet.
Je constate que l’amendement n° 61 rectifié bis a été adopté à l'unanimité des présents.
L'élaboration de la trame verte et bleue associera l'État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. Cette élaboration se fera en cohérence avec les travaux menés par les commissions locales de l'eau.
La trame verte est constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces protégés en vertu du droit de l'environnement, auxquels s'ajoutent les territoires nécessaires pour assurer leur connexion ainsi que le fonctionnement harmonieux et global de la biodiversité. Elle sera élaborée d'ici à 2012 et pilotée dans chaque région en association avec les collectivités territoriales et en concertation avec les acteurs de terrain dans un cadre cohérent garanti par l'État.
La trame verte sera complétée par la trame bleue, son équivalent pour les eaux de surface continentales et leurs écosystèmes associés.
À l'issue d'un audit général qui aboutira en 2009, les modalités de prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme et les schémas d'infrastructures, ainsi que les conditions de sa prise en compte par la fiscalité locale et par la dotation globale de fonctionnement seront précisées.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'État se fixe comme objectif la création, d'ici 2012, d'une trame verte constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces protégés en application du droit de l'environnement et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité, et d'une trame bleue, son équivalent pour les eaux de surfaces continentales et leurs écosystèmes associés.
Leur élaboration associera l'État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. L'élaboration de la trame bleue s'effectuera en cohérence avec les travaux menés par les commissions locales de l'eau.
Leur pilotage s'effectuera dans chaque région en association étroite avec les collectivités territoriales et en concertation avec les acteurs de terrain dans un cadre cohérent garanti par l'État.
Les modalités de leur prise en compte par les documents d'urbanisme, les schémas d'infrastructures, la fiscalité locale et les concours financiers de l'État seront précisées à l'issue d'un audit qui aboutira avant fin 2009.
La parole est à M. le rapporteur.

Aux termes de cet amendement de clarification et de simplification, il est précisé que les modalités d'élaboration de la trame verte et de la trame bleue seront contractuelles, mais que leur principe ne le sera pas.
Autre précision importante : seule l'élaboration de la trame bleue concernera les commissions locales de l'eau.

Le sous-amendement n° 808, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 62 rectifié, après les mots :
des espaces protégés en application du droit de l'environnement
insérer les mots :
, des zones jouant un rôle fondamental pour les espèces et habitats menacés
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Nous proposons de ne pas réduire la trame verte aux seuls espaces protégés et de l’étendre aux zones jouant un rôle fondamental pour les espèces et habitats menacés. En effet, la rédaction actuelle, trop restrictive, ne prend pas en compte les découvertes de la science ou les consensus qui se font jour sur le terrain entre les acteurs. Ceux-ci peuvent en effet considérer que telle zone qui n’est pas une ZNIEFF – zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique –, ni un espace protégé, ni un cœur de parc, n’en présente pas moins un intérêt extraordinaire et mérite d’être associée au réseau des trames verte et bleue.
Notre rédaction ouvre la porte aux extensions possibles, sans s’enfermer dans une définition trop précise.

Le sous-amendement n° 806, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 62 rectifié, remplacer les mots :
leur connexion
par les mots :
la mobilité des espèces
La parole est à M. Paul Raoult.

Nous défendons là une idée extrêmement importante.
Il existe des sites de nature exceptionnelle et qui sont souvent classés. L’objet de la trame bleue et de la trame verte est de les relier entre eux, c’est-à-dire de créer une connexion. Mais peut-être la notion de « mobilité des espèces » permet-elle de mieux traduire l’idée selon laquelle les espèces doivent pouvoir se déplacer d’un cœur de nature à un autre.

Le sous-amendement n° 151 rectifié bis, présenté par M. Le Grand, Mme Procaccia et M. Frassa, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 62 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
La trame verte et bleue devra être régulièrement actualisée, en fonction des connaissances acquises.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 807, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 62 rectifié, après les mots :
prise en compte
insérer les mots :
et de leur opposabilité
La parole est à M. Paul Raoult.

La trame bleue et la trame verte doivent-elles devenir des éléments de planification et de gestion de l’espace ? Le sujet a fait l’objet de vastes discussions, tant au sein du COMOP que lors du Grenelle.
Le texte dispose que les trames seront « prises en compte » : c’est vraiment le degré le plus faible de protection qui puisse exister en matière d’urbanisme ! Ce que nous souhaitons, nous, c’est rendre opposables les trames bleue et verte aux plans locaux d’urbanisme et aux schémas de cohérence territoriale.
Au cours du vaste débat qui a eu lieu, les avis ont pu diverger. L’opposabilité suppose sans doute une connaissance scientifique plus approfondie. Il faut néanmoins aller plus loin pour mettre vraiment en relief l’intérêt de la trame bleue et de la trame verte.
C’est dans cet esprit que nous versons cette proposition au débat.

Les sous-amendements n° 150 rectifié et 542 rectifié sont identiques.
Le sous-amendement n° 150 rectifié est présenté par M. Le Grand.
Le sous-amendement n° 542 rectifié est présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 62 rectifié, après le mot :
urbanisme
insérer les mots :
, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Le sous-amendement n° 150 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter le sous-amendement n° 542 rectifié.

L’élaboration des trames bleue et verte ne doit pas être subordonnée aux travaux conduits par les commissions locales de l’eau. Elle doit être effectuée au regard des enjeux environnementaux et des réalités territoriales, seules sources de sa légitimité. Une obligation de mise en cohérence de la trame avec les travaux de la commission établit, de plus, une sorte de hiérarchie qui n’est nullement fondée.
En revanche, une fois élaborée, la trame doit être intégrée dans les programmes de commissions locales de l’eau, ainsi que dans les règlements des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau, les SAGE, bizarrement absents du projet de loi, alors que ce sont des documents opérationnels et de planification établis par ces mêmes commissions.
C’est un débat difficile parce que les SAGE, en particulier les SDAGE, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau, doivent normalement être remis pour la fin de l’année, alors que la loi Grenelle I et, , la loi Grenelle II ne sont pas encore votées.
Il est évident que la trame bleue est fondamentalement liée aux travaux réalisés au niveau des SAGE et des SDAGE. Il faudra bien qu’il y ait une coordination, étant entendu que ce sont les comités de bassin et les agences de l’eau qui seront les porteurs de la trame bleue.

Le sous-amendement n° 511 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement n° 62 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
À cet effet, l'action des conservatoires d'espaces naturels sera confortée par une reconnaissance spécifique.
La parole est à Mme Françoise Férat.

Les conservatoires d'espaces naturels constituent aujourd'hui un outil régional de préservation, de gestion, de valorisation, voire d'acquisition des espaces naturels.
Alors que les premiers d'entre eux ont été créés voilà une trentaine d'années, ils sont maintenant présents sur l'ensemble du territoire métropolitain et, depuis 2008, en outre-mer. Constituant un véritable réseau de sites et d'acteurs de la biodiversité, ils gèrent désormais plus de 2000 sites, représentant une superficie d'espaces naturels supérieure à 120 000 hectares.
Ils mettent en place une stratégie d'intervention sur les espaces et les milieux prioritaires, mais également sur ceux qui présentent un caractère « ordinaire », ce qui leur confère un véritable rôle de protecteur de la biodiversité. Ils se sont dotés de conseils scientifiques qui valident leur stratégie et veillent à sa bonne mise en œuvre.
C'est pourquoi il serait opportun d'officialiser leur rôle et de renforcer ce réseau en accordant une reconnaissance spécifique aux conservatoires d'espaces naturels.

L'amendement n° 541, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa de cet article :
La trame verte et bleue sera élaborée et mise en œuvre dans chaque région en association avec les collectivités territoriales et en concertation avec les acteurs de terrain, dans un cadre cohérent, notamment sur le plan méthodologique, garanti par l'État ; sa gestion se fera sur une base contractuelle.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Nous vous proposons là une rédaction un peu plus fidèle à l’esprit des travaux des ateliers du Grenelle.
Le groupe de travail sur la biodiversité s’était d’abord accordé sur le terme « réseaux » pour désigner les zones protégées et leurs connexions entre elles. Mais le mot a provoqué une poussée d’urticaire chez tous les représentants des agriculteurs… Ils ont protesté en expliquant que cela leur rappelait fâcheusement Natura 2000, qu’ils ne voulaient pas se voir imposer des traits au feutre sur une carte, et encore moins retrouver des écologistes dans leurs pâtures à faire mine de compter les champignons sans même avoir demandé à la grand-mère ou au conjoint l’autorisation de rentrer sur les propriétés ! Bref, il y a eu un refus catégorique du mot « réseaux ».
Au terme d’un long débat entre ONG, syndicalistes, employeurs, etc., c’est le mot « trame » qui a été retenu parce qu’il apparaissait comme le plus neutre aux uns et aux autres.
La rédaction proposée ajoute la trame bleue pour inclure les rivières.
Elle prévoit une mise en œuvre dans chaque région, parce que c’est l’espace pertinent : il faudra connecter les régions entre elles, et prévoir aussi des trames transfrontalières. Par exemple, dans ma région, il faudra évidemment établir la connexion avec la Wallonie belge, qui a déjà fait tout son travail.
Les cinquante acteurs du groupe de travail sur la biodiversité ont absolument tenu à agir en concertation avec les acteurs de terrain : pour eux, l’élaboration de la trame verte est un facteur de dialogue. C’est le contraire d’un schéma à la façon de la DATAR, qui impose des zones strictement délimitées.
La gestion se fait évidemment sur une base contractuelle et en toute cohérence avec le plan méthodologique que garantira l’État.

L'amendement n° 543, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le mot :
scientifiques,
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article :
des zones repérées comme jouant un rôle fondamental pour les espèces et habitats menacés et des zones de continuités, indispensables à la mobilité des espèces et aux échanges génétiques.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Comme je l’ai déjà expliqué, il s’agit d’aller au-delà des zones protégées et des façons de les relier entre elles.

Les amendements n° 211 et 544 sont identiques.
L'amendement n° 211 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 544 est présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :
de prise en compte
insérer les mots :
et d'opposabilité
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 211.

Cet amendement vise à respecter l’engagement n° 73 du Grenelle de l’environnement. Il s’agit de prendre en compte la conclusion de l’audit général et de faire en sorte que les collectivités territoriales aient la possibilité de définir précisément en quoi la trame verte et bleue sera opposable.
En effet, la nature contractuelle de cette trame devrait plaider en faveur de son caractère opposable, l’État ne s’engageant pour sa part qu’à garantir la cohérence du cadre dans lequel elle sera mise en œuvre.
Si l’audit prévu pour affiner les conditions de son intégration dans les documents d’urbanisme et les schémas d’infrastructure participe de cette cohérence, ni la procédure ni l’intégration de la trame dans les documents d’urbanisme et d’aménagement ne garantissent cette opposabilité, en particulier aux projets d’infrastructures avec lesquels elle risque d’entrer en concurrence.

L'amendement n° 544, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :
de prise en compte
insérer les mots :
et d'opposabilité
La parole est à M. Paul Raoult.

La commission n’a pas pu examiner le sous-amendement n° 808 ; à titre personnel, j’y suis défavorable, car il paraît préférable de s’appuyer sur les nombreuses dispositions de protection qui existent déjà.
La commission n’a pas davantage pu examiner le sous-amendement n° 806 : toujours à titre personnel, j’y suis également défavorable, car la notion de connexion me paraît plus facile à définir.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 807, il me semble extrêmement prématuré de faire référence à l’opposabilité éventuelle des trames verte et bleue aux documents d’urbanisme, d’une part, parce que le comité opérationnel n’a pas rendu ses travaux, d’autre part, parce que cette question aux implications très lourdes pour les élus locaux sera examinée dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l’environnement. J’émets donc un avis défavorable.
Sur le sous-amendement n° 542 rectifié, la commission a émis un avis favorable.
Sur le sous-amendement n° 511 rectifié, estimant que l’action des conservatoires d’espaces naturels doit effectivement être reconnue, elle s’en est remise à la sagesse, en espérant que celle-ci s’exprimera de manière tout à fait bienveillante.
L’amendement n°541, qui vise à réparer une ambiguïté du texte transmis par les députés, est largement satisfait par l’amendement n° 62 rectifié de la commission, qui lève cette ambiguïté en séparant clairement, d’une part, le principe même de la création de la trame verte, fixée pour 2012, et, d’autre part, les modalités concrètes de son élaboration.
Sur ce dernier point, la rédaction du texte respecte les conclusions du groupe de travail sur la biodiversité qui indiquent que son élaboration et sa mise en œuvre sont portées par les collectivités territoriales en étroite concertation avec les acteurs de terrain, dans un cadre cohérent garanti par l’État.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Enfin, elle est défavorable à l’amendement n° 543, identique au sous-amendement n° 808, ainsi qu’aux amendements n° 211 et 544, qui ont le même objet que le sous-amendement n° 807.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 62 rectifié.
Il est en revanche défavorable au sous-amendement n° 808, qu’il vient également de recevoir.
Si nous nous entendons avec ses auteurs sur le principe de la prise en compte des zones jouant un rôle fondamental dans la trame verte et dans la trame bleue, nous estimons que ce sous-amendement est, en effet, prématuré : les composantes de la trame verte et de la trame bleue seront précisées dans le cadre de la loi Grenelle II, et les COMOP sont en train de travailler sur ces différentes questions.
S’agissant du sous-amendement n° 806, nous pourrions accepter que la notion de mobilité des espèces s’ajoute à celle de connexion, mais non qu’elle la remplace.
Nous sommes également défavorables au sous-amendement n° 807 : une fois encore, c’est plutôt dans le cadre du Grenelle II qu’il faudra creuser l’idée d’opposabilité, le COMOP poursuivant actuellement ses travaux sur la trame verte et la trame bleue, avec pour priorité d’établir les principes de gestion de ces trames avant de définir les zones.
Comme la commission, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 542 rectifié.
S’agissant du sous-amendement n° 511 rectifié, le Gouvernement est, sur le principe, favorable à une reconnaissance des conservatoires régionaux des espaces naturels, mais il lui semblerait préférable d’en étudier les modalités dans le cadre de la loi Grenelle II, car d’autres acteurs qui méritent aussi une reconnaissance législative pourraient ne pas comprendre que ces conservatoires soient spécifiquement visés dans le présent projet de loi alors qu’eux-mêmes ne le seraient pas. Je pense, par exemple, aux parcs naturels ou aux centres d’éducation à l’environnement.
Sur ce sous-amendement, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
Je demande le retrait de l’amendement n° 541, qui devrait normalement être satisfait par l’amendement n° 62 rectifié.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 543, qui appelle le même argumentaire que le sous-amendement n° 808.
Enfin, je suis défavorable aux amendements identiques n° 211 et 544, qui appellent quant à eux le même argumentaire que le sous-amendement n° 807 : nous renvoyons au Grenelle II, sachant que les travaux du COMOP se poursuivent.
Le sous-amendement n'est pas adopté.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 806 rectifié.

Mme la secrétaire d'État vient en quelque sorte de nous faire une proposition : elle est défavorable au remplacement des mots « leur connexion » par les mots « la mobilité des espèces », mais, si je l’ai bien comprise, elle ne serait pas opposée à ce que la trame verte soit constituée des espaces protégés et des territoires « assurant leur connexion, la mobilité des espèces et le fonctionnement global de la biodiversité ».
Je rectifie par conséquent notre sous-amendement n° 806 en ce sens, monsieur le président.

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 806 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul et Courteau, Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Ries et Teston, Mme Bourzai, MM. Guillaume, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, qui est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 62 rectifié, après les mots :
leur connexion
insérer les mots :
, la mobilité des espèces
Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

Même ainsi rectifié, le sous-amendement de Mme Blandin va très loin et, au vu de ce qui a déjà été pratiqué sur le terrain – et qui ne correspond pas toujours à ce que l’on peut en dire ici –, il nous paraît dangereux, raison pour laquelle la commission maintient son avis défavorable.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

De quoi M. le rapporteur a-t-il peur ? La mobilité des espèces, c’est une donnée : tout le monde sait que les cigognes sont mobiles, et il en va de même pour les autres espèces ! Si l’on veut préserver l’habitat de chacune d’entre elles, on ne peut pas ne pas tenir compte de leur mobilité. Ou alors ce n’est plus la peine de parler de trame bleue et de trame verte !
Je voudrais être sûr que chacun a bien compris que la trame bleue et la trame verte doivent justement avoir pour objet la gestion de la mobilité des espèces. Sinon, il y aurait contradiction dans les termes et, à cet égard, je m’inquiète un peu du réflexe de M. le rapporteur…
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 511 rectifié.

Madame la secrétaire d'État, j’ai bien entendu vos propos et je vous en remercie, mais il me semble que le signal sera d’autant plus fort qu’il sera inscrit dans la loi Grenelle I. C’est pourquoi je maintiens ce sous-amendement.
Le sous-amendement est adopté.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 62 rectifié.

Comme à l’article 20, la réécriture intégrale d’un amendement de la commission rédigeant un article entier du projet de loi sur lequel nous travaillons depuis trois semaines nous a obligés à tout refaire, et je puis vous dire, mes chers collègues, que « raccrocher » nos propositions sous forme de sous-amendements à cet amendement rectifié a été un exercice complexe !
C’est ainsi qu’en voulant argumenter sur l’opposabilité de la trame nous avons laissé passer le sous-amendement correspondant et je profite du vote sur la « re-rédaction » du rapporteur pour dire que ce que nous demandions, nous, c’est que l’audit général aboutisse à définir « les modalités de prise en compte et d’opposabilité ».
Mes chers collègues, vous n’avez pas voté sur l’opposabilité ou non de la trame, et il était donc inutile de se défendre en disant : tout sauf l’opposabilité ! Vous avez voté contre la mise à l’étude, dans un audit, de la prise en compte du critère d’opposabilité, ce qui me semble tout de même regrettable, car il s’agissait d’une idée partagée.
Pour cette raison, je ne voterai pas la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je ne sous-estime pas le travail auquel vous avez dû, les uns et les autres, vous astreindre pour déposer ces sous-amendements ou amendements et je vous imagine sans peine en train de les rédiger, dans votre bureau, tard le soir.
Sourires
Nouveaux sourires.

Cela étant, vous avez eu quinze jours pour le faire, après que la commission a déposé ses amendements.
Peut-être étiez-vous trop absorbés par cette tâche et n’avez-vous, par conséquent, pas prêté attention à l'amendement rédactionnel de la commission, ce qui vous a contraints à transformer vos amendements en sous-amendements !
En fait, le travail auquel nous nous livrons en ce moment est une sorte de répétition générale du déroulement futur de nos débats, une fois que nous aurons tiré les conséquences de la révision constitutionnelle sur l’organisation de nos délibérations. En effet, ce sera alors le texte discuté et adopté en commission qui sera examiné en séance publique et c’est au Gouvernement qu’il reviendra d’avancer des arguments pour, éventuellement, faire prévaloir sa vision des choses.

Cela étant dit, madame Blandin, je regrette que vous ne votiez pas l’amendement de la commission, qui vise effectivement à rédiger entièrement l'article 21. La commission a été contrainte de procéder ainsi parce que les députés ont apporté à cet article nombre de modifications disparates, qu’il a fallu ordonner. Nécessité fait loi !
Nouveaux sourires.

Ce texte est un compromis ; j’en ai tous les jours l’illustration à l’échelle du COMOP.
Bien sûr, sur certains points, je souhaite que mon point de vue fasse finalement l’objet d’un accord. Par exemple, j’aurais aimé que la notion d’opposabilité soit introduite dans le projet de loi, mais je sais bien que c’est extrêmement difficile.
Pour autant, ce texte me paraît très important : c’est la première fois, dans l’histoire de la protection des milieux naturels, qu’est prévue une prise en compte globale de l’intérêt du milieu naturel. De ce point de vue, les notions de trame bleue et de trame verte constituent un apport décisif. Il faut souligner avec force ce nouvel état de fait.
Nous devons prendre conscience du maillage de la richesse naturelle, l’étudier, poursuivre la recherche scientifique dans ce domaine, l’intégrer dans l’aménagement de l’espace, tel que nous le concevrons demain. Désormais, l'article 1er des SCOT et des PLU mentionnera la prise en compte de la richesse et de la connaissance du milieu naturel de nos territoires.
C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je voterai cet amendement, qui me paraît très positif, malgré les insuffisances qu’il comporte et qui sont inévitables.
L'amendement est adopté.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente.