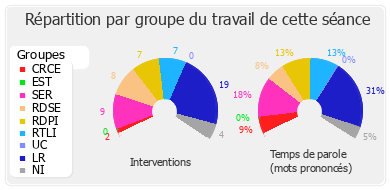Séance en hémicycle du 28 avril 2016 à 10h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (voir le dossier)
- Adoption définitive en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission après procédure d'examen en commission (voir le dossier)
- République numérique (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote, en deuxième lecture, sur le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (projet n° 405, texte de la commission n° 530, rapport n° 529).
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure d’examen en commission prévue par l’article 47 ter du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
La commission des lois, saisie au fond, s’est réunie le mercredi 6 avril 2016 pour l’examen des articles et l’établissement du texte. Le rapport a été publié le même jour.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 ter, alinéa 11, de notre règlement, au Gouvernement, puis au rapporteur de la commission et, enfin, aux orateurs des groupes.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie d’excuser le garde des sceaux, qui est retenu. Son absence me donne l’occasion et le plaisir de retrouver les sénatrices et sénateurs de toutes les sensibilités politiques présents ce matin dans cette belle maison, que j’apprécie tant, pour présenter à nouveau le projet de loi ratifiant l’ordonnance portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, qui avait été adopté à l’unanimité par votre assemblée le 28 janvier dernier.
Ce texte vous est présenté en deuxième lecture, compte tenu de modifications apportées par l’Assemblée nationale. Je rappelle que, en première lecture, le Sénat avait complété le dispositif proposé par le Gouvernement sur plusieurs points. À cet égard, je remercie l’excellent rapporteur, André Reichardt, pour le travail qu’il a réalisé, très méticuleux comme à l’accoutumée.
Pour mémoire, l’ordonnance du 10 septembre 2015 a été prise en application de l’article 23 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Cette mesure est issue des travaux du Conseil de la simplification pour les entreprises. Elle a pour objet de diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, pour le faire passer de sept à deux, et, ainsi, d’aligner ce régime sur la règle de droit commun, prévue à l’article 1832 du code civil. En effet, jusqu’à présent, les sociétés anonymes devaient, en application de l’article L. 225-1 du code de commerce, réunir au minimum sept actionnaires.
Historiquement, cette exigence de sept actionnaires a été introduite en droit français par la loi du 23 mai 1863, sous l’influence du droit anglais. Toujours est-il qu’elle est depuis longtemps contestée, le chiffre de sept ne reposant sur aucune justification économique ou juridique. En outre, elle est en décalage avec la pratique des sociétés familiales et des petites et moyennes entreprises, dans lesquelles les parts sont souvent réunies entre les mêmes mains. Elle n’est pas davantage adaptée à la pratique des groupes de sociétés, au sein desquels les filiales sont parfois détenues à 100 % par la société mère.
Ainsi, cette obligation, qui ne trouve aucune justification, ni juridique ni économique, conduit de nombreuses sociétés anonymes à avoir recours à des actionnaires de complaisance et réduit l’intérêt de cette forme sociale. Aussi, la présente ordonnance a pour finalité de renforcer l’attractivité de la société anonyme. En effet, en raison de la stabilité et de la prévisibilité de ses règles de fonctionnement, celle-ci assure une meilleure protection des associés, particulièrement des associés minoritaires. Elle est, en cela, préférable à la société par actions simplifiée.
Le texte a également pour objectif de renforcer la compétitivité de la France au niveau européen, dans la mesure où notre pays est le seul en Europe à avoir établi et maintenu la règle des sept actionnaires. Il suffit de deux actionnaires pour créer une société anonyme au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie, et d’un seul en Allemagne.
Le Gouvernement a prévu de fixer le nombre minimal d’actionnaires au plus bas, à savoir deux actionnaires, suivant en cela les recommandations des praticiens et des théoriciens du droit. Ainsi, il est apparu que la réduction à deux du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes, en ce qu’elle aligne le régime de ces sociétés sur le droit commun organisé par l’article 1832 du code civil, constitue une simplification attendue.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la procédure ne me permettant pas de m’exprimer après vos interventions, je tiens à remercier par avance le rapporteur, les intervenants des groupes, ainsi que les services du Sénat pour la qualité de leurs travaux. Je veux aussi féliciter les membres de la commission des lois, notamment son président, pour leur travail approfondi sur les ratifications d’ordonnances. Je salue également les trois orateurs des groupes qui interviendront en explication de vote, M. Thani Mohamed Soilihi, Mme Cécile Cukierman et M. Jean-Claude Requier, pour leur participation au travail de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce.
Au nom du Gouvernement, je tiens à vous assurer de mon engagement total sur le chantier de la simplification. Bien sûr, celle-ci ne saurait s’arrêter à la seule réduction du nombre d’actionnaires des sociétés anonymes. Le projet de loi Sapin II prolonge la logique qui inspire cette mesure : il inclura une série d’articles simplifiant le droit des sociétés. Les démarches seront allégées lorsque l’on passe d’une structure sociétaire à une autre, par exemple d’une entreprise individuelle à une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ce texte permettra également de simplifier de manière très significative la procédure de création d’entreprise, en rendant plus simple, plus rapide et plus accessible l’installation des artisans.
Par ailleurs, comme le Premier ministre l’a rappelé lors de ses annonces du 3 février dernier, les procédures de convocation des assemblées générales des sociétés anonymes ont déjà fait l’objet d’une modernisation significative, puisqu’elles seront dématérialisées et simplifiées.
Enfin, dans le cadre de la prochaine vague de simplification, je continue à travailler, en lien avec Bercy, à de nouvelles simplifications du droit des sociétés et à de potentiels allégements des normes comptables et fiscales. Je suis d'ailleurs à la totale disposition des parlementaires qui s’intéressent à ces sujets, de manière à améliorer les choses tous ensemble. C’est notamment ce que j’ai pu faire, hier, avec les membres de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat et la mission de simplification, autour de Jean-Marie Bockel et de Rémy Pointereau.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous dire l’attachement que je porte au Sénat et à la qualité de ses travaux et je tiens vraiment à vous remercier pour l’attention que vous portez à ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je serai très bref.
Nous examinons, en deuxième lecture, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.
Je ne reviendrai pas sur le fond de ce texte, dont nous avons déjà discuté dans cette enceinte. Sur la proposition de la commission, le Sénat y a apporté des modifications et des compléments, que le Gouvernement a acceptés, respectant ainsi le travail réalisé par la commission.
Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est parce que l’Assemblée nationale a dû corriger deux erreurs de rédaction qui résultaient de l’amendement présenté au dernier moment devant le Sénat par le Gouvernement en première lecture, pour assurer une application rétroactive de la disposition particulière, introduite par la commission, concernant les sociétés anonymes dont l’État est l’actionnaire unique.
Monsieur le secrétaire d'État, je me suis demandé si j’allais revenir sur ces erreurs de rédaction et sur les raisons qui nous ont conduits à être saisis une deuxième fois de ce texte. Après avis de la commission, j’ai décidé, par égard pour votre personne, de ne pas le faire.
Sourires.

M. André Reichardt, rapporteur. Je n’en dirai pas davantage. J’invite simplement le Sénat à adopter ce texte sans modification.
Applaudissementssur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, qu’ajouter à ce que vient de dire notre rapporteur, si ce n’est que cette deuxième lecture du projet de loi aurait pu être évitée ? Encore qu’elle nous donne l’occasion de revoir notre ancien collègue, devenu secrétaire d'État… Rien que pour cela, elle en valait peut-être la peine !
Sourires.

M. Thani Mohamed Soilihi. Mes chers collègues, je vous invite à mon tour à adopter ce projet de loi, qui va dans le bon sens – il avait d'ailleurs été adopté à l’unanimité dans cet hémicycle en première lecture.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Sourires.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, dont je salue la première intervention, en cette qualité, dans l’hémicycle du Sénat, mes chers collègues, du fait de la procédure retenue, en application de l’article 47 ter de notre règlement, nous nous prononçons aujourd’hui directement sur l’ensemble du projet de loi de ratification de l’ordonnance du 10 septembre 2015 relative aux sociétés anonymes non cotées.
Le texte adopté en commission des lois ne comporte pas de modifications par rapport à celui adopté par l’Assemblée nationale. La délibération sera donc relativement rapide, d’autant que ce n’est tout de même pas le texte majeur de la session parlementaire…
Sourires.

La réduction de sept à deux du nombre minimal d’actionnaires pour constituer une société par actions non cotée est présentée comme favorisant l’attractivité du régime des sociétés anonymes pour les PME, notamment familiales, et la compétitivité du droit français des affaires.
Les membres du groupe du RDSE, soucieux de défendre les intérêts des petits entrepreneurs, souscrivent au principe de cette mesure. C’est pourquoi nous voterons l’adoption conforme du projet de loi, de même que nous avons voté en sa faveur en première lecture.
Toutefois, comme l’a rappelé le rapporteur, le texte est loin d’épuiser la question de la simplification du droit des affaires. Le Gouvernement affirme que c’est une réforme attendue par les acteurs économiques ; je l’espère sincèrement. Cependant, les modifications ponctuelles, par couches successives et par voie d’ordonnance, ne sont pas forcément le meilleur moyen de simplifier réellement et, surtout, d’améliorer la qualité et la lisibilité du droit.
Compte tenu de son caractère ponctuel, cette réforme risque de désorienter les acteurs ou de passer inaperçue.
En vérité, depuis la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, aucune réforme de grande ampleur du droit des affaires n’a été engagée. C’est pourtant un enjeu majeur de modernisation réelle, de simplification et de dynamisme économique.
Par ailleurs, au-delà de la simplification du droit se pose la question de la simplification de l’accès à ce droit, en particulier pour les petits entrepreneurs, qui critiquent de manière récurrente l’illisibilité des règles applicables en matière de réglementation commerciale ; elles sont donc difficiles à comprendre.
Compte tenu de ces différentes remarques, si nous apportons un accord de principe au présent projet de loi, nous appelons de nos vœux une réforme plus globale du droit des affaires.
Madame la présidente, vous remarquerez que, prenant modèle sur le projet de loi, qui réduit de sept à deux le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, je n’ai utilisé que deux des sept minutes qui m’étaient allouées !
Sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les hasards – ou peut-être les coïncidences – de l’actualité et de l’activité parlementaire font que nous débattons, ce matin, de l’adoption conforme d’un texte modifiant le droit des sociétés, singulièrement le seuil de création des sociétés anonymes, au moment même où des milliers de salariés, d’étudiants, de privés d’emploi, de retraités s’apprêtent à manifester dans les rues des villes de France pour défendre la modernité du code du travail et rejeter le « projet de loi El Khomri », qui consacrerait moult retours en arrière.
Je ne peux que constater que, alors même que le présent texte de loi permet de faciliter la création d’entreprises, tout en préservant, autant que faire se peut, l’intégrité du patrimoine privé des entrepreneurs, nous risquons d’atteindre sous peu un degré supplémentaire en matière de précarité au travail.
Mais revenons rapidement sur les données du texte.
L’article restant en discussion n’appelle pas d’observations critiques particulières, d’autant qu’il ne fait que confirmer une donnée assez évidente, à savoir que les dispositions du projet de loi, qui ratifie lui-même une ordonnance, ne trouvent pas à s’appliquer aux entreprises dont l’État s’avère l’unique actionnaire.
Pour en revenir au fond du débat, nous constatons que nous devrions observer, dès la promulgation du présent texte, un mouvement de « sociétisation » des entreprises et un recul correspondant des exploitations en nom propre, artisanales, industrielles ou commerciales, associé à une certaine rationalisation de l’activité des auto-entrepreneurs. Cela ne manquera pas d’avoir quelque influence, au moins dans deux domaines.
Le premier effet que nous observerons, c’est que le patrimoine des entrepreneurs sera quelque peu préservé en cas de procédure collective, toute liquidation ou cessation anticipée d’activité ne portant en effet que sur le patrimoine destiné à l’exercice de l’activité commerciale.
Le second processus est plus important. La « sociétisation » fera glisser une bonne part des contribuables physiques soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux dans le régime de l’impôt sur les sociétés.
Au moment même où l’on entend modifier le droit en matière de recouvrement de l’impôt, via la retenue à la source sur les salaires, traitements, pensions et retraites, l’opération est finalement assez astucieuse, puisque le passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés emporte le versement d’acomptes provisionnels, qui pourraient alimenter plus sûrement les caisses de l’État que ne le font des versements tardifs de régularisation de l’impôt…
Nous sommes donc face à un texte « gagnant-gagnant » entre les intérêts de l’État et ceux des entrepreneurs, avec, pour ceux-ci, une plus grande sécurité juridique, qui, dit-on, pourrait raffermir l’esprit d’entreprise.
Mais tout cela, évidemment, nous nous en rendrons compte sur la durée, même si le mouvement naturel de l’économie poussait déjà les entrepreneurs à adopter la forme de la société de capitaux plus que celle de la société de personnes.
Cependant, au-delà de cette sollicitude pour les créateurs d’entreprise, qui pourrait presque donner à quelque cadre expérimenté l’envie de créer une société, avec un risque « calculé », voilà que l’air du temps est à la remise en cause des droits acquis et/ou à développer des salariés.
Par commodité, certains opposent les salariés les uns aux autres, en confrontant, par exemple, fonctionnaires et salariés de droit privé, salariés dits « inclus », travaillant sous contrat à durée indéterminée, et salariés dits « exclus », victimes de la précarité et des contrats à durée déterminée, dans une dualité de plus en plus conflictuelle et soigneusement entretenue par un appareil législatif qui traduit souplesse et flexibilité en précarisation, non-reconnaissance des qualifications et sous-rémunération du travail.
Le présent texte protège l’entrepreneur des conséquences que pourraient entraîner les difficultés de son entreprise sur l’intégrité de sa personne et sur son patrimoine non affecté à l’activité, quand le « projet de loi El Khomri » fait porter le risque industriel sur les salariés, dont le licenciement sera rendu bien plus facile s’il était adopté en l’état.
Il nous semble au contraire qu’il serait bienvenu, en revenant sur la philosophie générale de la réforme du code du travail, telle que définie aujourd’hui, de veiller à donner aux salariés de notre pays la même sécurité que celle que le projet de loi dont nous débattons entend donner aux entrepreneurs.
La compétitivité de l’économie française, si chère à certains, ne peut, à notre avis, se construire sur les ruines de la formation et des qualifications de la main-d’œuvre, aujourd’hui précarisée. Des entrepreneurs audacieux et sereins, des salariés pourvus de droits effectifs, voilà ce qui fera avancer notre économie.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, dans ce contexte, nous ne pourrons, hélas ! que confirmer notre abstention vigilante de première lecture.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.
Le projet de loi est adopté définitivement .

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (projet n° 325, texte de la commission n° 535, rapport n° 534, tomes I et II, avis n° 524, 525, 526 et 528).
Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.
TITRE IER
LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
Chapitre II
Économie du savoir
Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre II du titre Ier, l’examen des amendements déposés à l’article 18 bis, dont je rappelle les termes :
Dans les contrats conclus par un éditeur avec un organisme de recherche ou une bibliothèque ayant pour objet les conditions d’utilisation de publications scientifiques, toute clause interdisant la fouille électronique de ces documents pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité directement ou indirectement commerciale, est réputée non écrite. L’autorisation de fouille ne donne lieu à aucune limitation technique ni rémunération complémentaire pour l’éditeur.
La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, aux termes des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes dont la liste est fixée par décret.
Le présent article est applicable aux contrats en cours.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 457, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Qu’est-ce que la fouille automatique de données et de textes, le Text and Data M ining, ou TDM ? C’est une pratique qui vise à rechercher dans une masse de publications des éléments de corrélation pouvant permettre aux scientifiques de mieux comprendre les liens entre des phénomènes en apparence distincts. Elle a pour intérêt de mettre en évidence des corrélations qui ne sont pas visibles de prime abord, puisque, justement, on ne peut les faire apparaître qu’en élargissant massivement le panel des publications étudiées.
Tout le problème réside dans le respect, dans ces conditions, du droit d’auteur, mais aussi des conditions imposées par les éditeurs. Nous retrouvons là encore les mêmes géants en position de quasi-monopole, comme Elsevier. Ce sont ces éditeurs qui imposent des limitations aux outils relevant du TDM et qui, par conséquent, empêchent la recherche de s’exercer. Nous revenons ici à la question, qui sous-tend le projet de loi, du bien commun qu’est la donnée et de l’utilisation que nous pouvons en faire.
En l’occurrence, la recherche scientifique et les données qui en sont issues sont clairement assimilables à du bien commun. La philosophie même de la recherche scientifique n’est-elle pas le partage de la connaissance ?
Dans ces conditions, le droit d’auteur, qui ne profite pas aux auteurs, paraît trop restrictif en France, dans la mesure où il n’autorise absolument pas des consultations de type TDM, même informatisées à grande échelle. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale avait retenu cette rédaction, de manière à créer une exception au droit d’auteur pour toute recherche dépourvue de finalité commerciale. L’encadrement de cette exception était suffisamment large pour empêcher tout abus. Ce compromis avait obtenu l’aval des chercheurs, fortement mobilisés sur cette question.
Le TDM est désormais largement reconnu par le monde académique international comme un outil de recherche et d’exploration efficace. Il s’agit là d’une vraie question d’indépendance et de capacité de notre recherche.
La rédaction actuelle de l’article, privilégiant la contractualisation, est à la fois bancale, trop large et coûteuse pour les chercheurs. Ces derniers continueront certainement d’utiliser librement ces outils à l’étranger.

L'amendement n° 544 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

La rédaction de l’article 18 bis issue des travaux de la commission des lois du Sénat n’autorise pas la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, mais l’organise dans le cadre de relations contractuelles – entre organismes de recherche ou bibliothèques et éditeurs – dont les rapports de force sont déséquilibrés.
Notre amendement tend à prévoir une exception au droit d’auteur en autorisant, en vue de la fouille de textes et de données pour les besoins de la recherche, les copies et reproductions numériques effectuées à partir de sources licites. Il s’agit donc de permettre la libre fouille de textes et de données à des fins scientifiques afin de soutenir une recherche publique française libre, ouverte et présente au meilleur niveau mondial.

Avant de nous séparer un peu tôt ce matin, nous avons débattu de la question du TDM et décidé de maintenir des dispositions permettant aux chercheurs d’effectuer une fouille de texte par la voie contractuelle.
L’amendement n° 457 vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale. Or, comme je le rappelais hier soir lors de l’examen de l’amendement de suppression déposé par le Gouvernement, la rédaction de l’article 18 bis retenue par l’Assemblée nationale revenait à créer en droit français une exception au droit d’auteur non prévue par la directive du 22 mai 2001.
La solution proposée par notre commission me semble constituer un compromis satisfaisant pour développer le TDM sans contrevenir au texte de cette directive. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement analogue n° 544 rectifié.
Il est absolument impossible, tant du point de vue technique que financier, de créer une exception au droit d’auteur en matière de TDM.
Je me suis déjà longuement exprimée cette nuit sur la possibilité de recourir à la technique de la fouille de données par les chercheurs.
Le Gouvernement reste sur sa position et émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Hier, nous avons entendu Mme la secrétaire d’État prononcer une sorte de plaidoirie en faveur du TDM.
Il me semble que la question qui nous est posée est celle de savoir si nous prendrons la responsabilité d’offrir à ceux qui veulent faire de la recherche en France les mêmes moyens que ceux dont ils pourraient disposer dans les grands pays de recherche scientifique – les États-Unis, le Japon, mais aussi la Grande-Bretagne – pour accéder au savoir de manière légale.
Allons-nous accepter un compromis ou essayer de donner à ces chercheurs les moyens d’innover pour que la France puisse être une grande puissance de la recherche ? Or, sur cette question, je crois qu’il n’est pas de compromis possible, au risque de voir les plus grandes capacités scientifiques françaises partir travailler à l’étranger ou rester en France pour mener leurs travaux, veuillez me pardonner cette expression, grâce à des « proxy » étrangers, ce qui reviendrait à renforcer les institutions d’autres pays où il est possible de faire ce qu’il n’est pas permis en France.
Par ailleurs, Mme Gillot a souligné hier combien les responsables des grands instituts publics de recherche tenaient à la rédaction de l’Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle il me semble important de soutenir ces amendements, qui visent à rétablir l’esprit du texte de nos collègues députés. Il ne s’agit pas d’un compromis, mais d’une impulsion. D’une impulsion pour faire en sorte que la recherche française soit au meilleur niveau, que le génie français n’ait pas besoin de s’expatrier pour pouvoir travailler et que la France se dote des capacités de se projeter vers l’avenir.

Je voudrais rappeler ce que nous avons voté hier, je crois, à l’unanimité.
J’ai proposé, au nom de la commission, de rendre obligatoire, dans les contrats conclus entre éditeurs et organismes de recherche ou bibliothèques, l’autorisation d’accès aux données et aux textes du corpus de publications scientifiques appartenant à l’éditeur, à des fins exclusives de fouille électronique pour la recherche publique et à l’exclusion de tout usage commercial.
Cette clause contractuelle ne pourrait donner lieu à rémunération complémentaire pour l’éditeur ni à limitation du nombre de requêtes autorisées.
Enfin, la conservation et la communication des copies techniques issues de ces traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, seraient assurées par des organismes désignés par décret.
Je sais bien que les chercheurs auraient préféré qu’une exception au droit d’auteur soit créée, mais nous ne pouvons pas – pour l’instant – leur donner satisfaction. Nous ne pouvons qu’espérer qu’une nouvelle directive vienne très rapidement conforter leur souhait.
La solution que nous avons proposée me semble un bon compromis, qui pourra s’appliquer immédiatement, de façon transitoire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 bis est adopté.

L'amendement n° 459, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre numérique tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires numériques de cette édition par une bibliothèque accueillant du public, à leur acquisition pérenne et à leur mise à disposition, sur place ou à distance, par une bibliothèque accueillant du public.
« Ces actes de prêt et de mise à disposition ouvrent droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4, en prenant en compte la rémunération équitable des usages et la nécessité de préserver les conditions d’exercice des missions des bibliothèques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :
« La rémunération prévue aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 133-1 au titre du prêt d’exemplaires de livres imprimés comprend deux parts. » ;
3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La rémunération au titre du prêt d’exemplaires délivrés imprimés en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Concernant les livres édités sous forme numérique, les conditions de mise à disposition ainsi que les modalités de la rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133-1 sont fixées par décret, au terme d’une consultation publique nationale conduite par le Médiateur du livre avec tous les acteurs professionnels concernés. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.

Le prêt de livre imprimé en bibliothèque est régi depuis 2003 par un mécanisme de licence légale. En l’état actuel du droit, ce système ne s’applique pas au livre numérique. Ainsi, les éditeurs proposent aux bibliothèques des offres de livres numériques sur une base contractuelle, dans des conditions souvent peu suffisantes.
Les bibliothèques ne peuvent aujourd’hui effectuer leurs achats qu’à partir d’une offre réduite, qui ne représente que 14 % de l’offre commerciale disponible pour le grand public – 86 % de la production éditoriale leur est totalement inaccessible. L’évolution de cette proportion dans les années à venir restera soumise à la volonté des éditeurs.
Le livre numérique ne doit pas occasionner de régression pour les bibliothèques : à l’instar du livre papier, les usagers doivent pouvoir trouver en bibliothèque tous les livres numériques. Ainsi, pour assurer pleinement leur mission, les bibliothèques publiques devront notamment pouvoir accéder à l’ensemble de l’édition numérique dès sa parution, constituer une offre de livres numériques issue de catalogues de tous les éditeurs nationaux, sélectionner les livres titre par titre, y compris dans le cadre du bouquet, et consulter les ouvrages avant de les ajouter à leur collection.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter cet amendement, qui vise à étendre le mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003.

Cet amendement vise à étendre le mécanisme de la licence légale aux livres numériques prêtés par les bibliothèques, afin de développer cette offre, aujourd’hui fort limitée, dans le cadre des contrats conclus avec les éditeurs.
Le dispositif proposé, pour intéressant qu’il pourrait s’avérer, n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact s’agissant de ses conséquences sur la rémunération des auteurs et des éditeurs. Je me tourne donc vers Mme la secrétaire d’État pour connaître l’avis du Gouvernement. En tout état de cause, la commission ne peut que s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre au livre numérique le mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les raisons, déjà évoquées, de calendrier des discussions européennes. Il s’agirait en effet d’une encoche dans le mécanisme du droit d’auteur prévu par la directive européenne. Le droit européen n’offre pas, à ce jour, la possibilité de déroger au droit exclusif de l’auteur pour le prêt public numérique.
Il est important, face à un marché encore en émergence, de ne pas déséquilibrer les modèles économiques. J’aimerais toutefois souligner que le Gouvernement a fait du développement des collections numériques des bibliothèques publiques l’une de ses priorités. Il a, par exemple, signé le 8 décembre 2014 avec les représentants de toute la profession – huit associations professionnelles de la chaîne du livre – et la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture douze recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques, réaffirmant ainsi la nécessité, pour ces bibliothèques, d’accéder à une offre qui soit la plus exhaustive possible au regard de celle proposée aux particuliers.
Très concrètement, ce travail porte ses fruits. Grâce au dispositif PNB – prêt numérique en bibliothèque –, l’offre ne cesse de croître : 60 000 titres, sur les 180 000 disponibles pour les particuliers, sont désormais accessibles.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 460, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les Communs
« Art. L. 141 -1. – Relèvent du domaine commun informationnel :
« 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;
« 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le présent code, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
« 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des articles L. 311-4, L. 321-1, L. 324-1 à L. 324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 dudit code.
« Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l’article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tel, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.
« Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel en cherchant à restreindre l’usage commun à tous.
« Art. L. 141 -2. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l’usage commun d’un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d’une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d’une licence libre ou de libre diffusion. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d’édition tel que défini à l’article L. 132-1.
« Le titulaire de droits est libre de délimiter l’étendue de cette autorisation d’usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L’objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel, tel que défini à l’article L. 141-1, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.
« Cette faculté s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-1 relatives à l’inaliénabilité du droit moral. »
La parole est à M. Patrick Abate.

À travers cet amendement, nous voulons montrer notre attachement à une définition positive des communs informationnels. Cette définition est absente du texte, alors qu’il s’agit d’une question importante, soulevée non seulement par les internautes et les associations, mais aussi par vous-même, madame la secrétaire d’État.
Vous aviez pourtant inscrit dans l’avant-projet de loi la protection pour tout ce qui n’est pas couvert par la propriété intellectuelle – informations, faits, idées, principes, méthodes ou œuvres passées dans le domaine public… Cependant, faute de compromis, vous avez renvoyé cette question à une mission générale, ce dont nous ne pouvons nous satisfaire.
Nous sommes particulièrement convaincus de la nécessité d’inscrire la protection des communs dans le code de la propriété intellectuelle. Comme le résume le collectif Savoircom1 : « Violer le droit d’auteur, c’est porter atteinte aux droits d’un seul ; violer le domaine commun informationnel, c’est porter atteinte aux droits de tous. » En effet, ce que nous appelons les « communs informationnels » appartiennent à tous en ce qu’ils n’appartiennent à personne. Depuis toujours, les biens communs nourrissent la réflexion et la création.
L’un des progrès d’internet fut de permettre la circulation des connaissances, des informations, des données et des œuvres. Les risques d’entrave, d’appropriation excessive de certains biens, de revendication illégitime de droits exclusifs sur une œuvre – ce qu’on appelle le copyfraud – sont de plus en plus grands. Il faut protéger les communs informationnels et empêcher que certains ne trouvent dans ces biens communs une source de profits et d’appropriation.
Je finirai mon propos en évoquant une nouvelle d’Alain Damasio dans laquelle l’auteur imagine que les mots que nous utilisons au quotidien pourraient être restreints parce que soumis à des brevets. Bien que fantaisiste, ce récit doit nous alerter sur le risque d’une société où l’appropriation n’aurait plus de limite.

Les auteurs de cet amendement visent à la reconnaissance, dans le code de la propriété intellectuelle, d’un domaine commun informationnel. Il s’agit d’un véritable serpent de mer depuis la genèse de ce projet de loi. Cette question figurait d’ailleurs dans certains avant-projets. Des débats d’une grande radicalité entre partisans et opposants aux C ommons ont notamment animé la consultation publique préalable au dépôt du texte à l’Assemblée nationale.
Nos collègues députés n’ont pas manqué de poursuivre le débat engagé, et la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale a même adopté la création du domaine commun informationnel contre l’avis de son rapporteur. Finalement, eu égard aux réticences de la commission des lois et du Gouvernement, le texte transmis au Sénat n’en fait nulle mention.
L’introduction d’une telle disposition pose plusieurs difficultés d’ordre politique – les avis en présence demeurent irréconciliables et aucune expertise n’a, à ce jour, réussi à les départager – et juridique – au regard du droit de propriété et compte tenu de la référence à l’article 174 du code civil –, ainsi qu’en termes d’opportunité – le droit positif permet d’ores et déjà à un auteur d’autoriser l’utilisation de ses œuvres. Au reste, en Grande-Bretagne comme en Italie, nos voisins européens peinent également à trouver un équilibre satisfaisant leur permettant de légiférer sur cette question. Il convient donc de continuer à travailler à une traduction juste de ce principe.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Nous avons eu des débats homériques à l’Assemblée nationale sur ce sujet. Monsieur Leconte, vous parliez, voilà quelques instants, de « plaidoirie » ; c’est peut-être à propos de la thématique des communs que ce terme s’appliquerait le mieux.
Les communs, c’est une manière d’embrasser la culture numérique du copartage, de la coconstruction des œuvres, des écrits – en particulier des écrits scientifiques –, des faits et des informations qui correspond à des pratiques que seul le numérique a permis d’amplifier.
Mais entre l’idéal vers lequel nous pouvons souhaiter tendre, en tant que collectif humain, mais aussi pour faire émerger de nouveaux modèles d’innovation porteurs de création économique, et la réalité juridique, le fossé est encore trop grand. Il nous faut le combler avant de faire entrer la notion de « communs » dans nos codes.
Nous n’avons pas trouvé de définition juridique satisfaisante, à la fois stable et sécurisée. Les difficultés techniques ont été trop grandes. Dès lors, le Gouvernement estime que la voie législative n’est pas adaptée. Pour autant, nous soutenons – à l’instar, je n’en doute pas, de l’ensemble des sénateurs – cette vision d’une culture du partage, et pas uniquement de l’appropriation, voire de la privatisation, de la sphère numérique.

Je voudrais d’un mot expliquer les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement et élargir le débat à ce qui reste le droit d’auteur, à tout ce que représente, dans un pays comme le nôtre, dont la pensée a été renouvelée par les Lumières, la protection de l’œuvre intellectuelle.
Le droit au respect de la production intellectuelle est central dans notre vie nationale. Contrairement à certaines approximations que j’ai pu entendre, faire partager à l’Union européenne une conception du droit d’auteur qui donne la priorité au respect de l’œuvre a constitué un très grand succès de la France.
Je me souviens très bien que, en 1984 et 1985, alors que j’étais le rapporteur, à l’Assemblée nationale, de la loi de réforme des droits d’auteur, devant l’essor des entreprises de communication audiovisuelle, beaucoup des partenaires de la vie intellectuelle de notre pays étaient convaincus que la conception commerciale du copyright finirait par l’emporter. Ce ne fut pas le cas.
Aujourd’hui, si l’on respecte pleinement les principes de ce qu’est le droit d’auteur, c’est-à-dire la propriété de l’œuvre et son respect, il existe un commun : tout le reste ! Pourquoi légiférer sur cette question ? Je rappelle que le principe cardinal, l’épine dorsale du droit, c’est la cohérence. Or il n’est pas cohérent, dans un système juridique, d’énumérer, d’un côté, ce qui fait l’objet d’une règle et, de l’autre, ce qui n’entre pas dans le champ de cette règle. Procéder ainsi, c’est la certitude d’aboutir à une incohérence !
Le droit européen pose en principe la protection du domaine du droit d’auteur, c’est-à-dire la protection de tout ce qui a objectivement et authentiquement le caractère d’une œuvre. Tout le reste est libre et nul n’est besoin de légiférer pour affirmer quelque chose que nous savons déjà.

Je ne doute pas, madame la secrétaire d’État, que vous partagiez cette vision.
J’ai également bien entendu les arguments de notre collègue. Nous comprenons la difficulté de faire le droit.
Par cet amendement, nous voulions réaffirmer un principe, rappeler ces engagements et cette richesse de notre histoire et de notre droit. Cela étant, nous le retirons.
Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique par des personnes physiques ou des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial. »

La liberté de panorama, maintes fois évoquée, sujet de maints débats souvent repoussés, doit aujourd’hui nous permettre de poser cette question fondamentale : comment juger le conflit entre les droits d’expression et de création et le droit de paternité ?
Quinze ans après la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, un an avant le probable marché numérique unique, la France fait partie des sept pays du continent – non pas de l’Union Européenne, mais de toute l’Europe – à ne pas avoir légiféré sur cette liberté, se reposant sur une jurisprudence pour le moins étoffée. Or cette dernière ne saurait être aussi précise et stable que la loi. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous féliciter de l’existence de cet article, dont la rédaction, par contre, ne peut nous satisfaire.
Le plus gros problème est aujourd’hui celui de l’exercice à titre gracieux de la liberté de panorama sur des plateformes numériques, lesquelles engrangent sans contrepartie – nous n’allons pas refaire la démonstration « Facebook » – de l’argent sur les œuvres reproduites, par le biais de la vente de données ou d’espaces publicitaires.
Pour revenir sur la portée générale de cet article et sur le conflit de droits qu’entraîne la liberté de panorama, il nous semble important de rappeler la place que doivent occuper la culture et les arts dans notre société. À nos yeux source d’émancipation, ces domaines ne sauraient être restreints par une minorité de personnes du fait d’un droit d’auteur hégémonique, auquel il ne pourrait être dérogé.
Toutefois, si la liberté de panorama permet une dérogation, elle ne doit pas se muer en spoliation de l’œuvre au détriment de l’artiste. De fait, la richesse créée par la liberté de panorama doit être partagée entre le créateur et le bénéficiaire.
Dans ce cadre, nous serons amenés à nous opposer aux amendements tendant à généraliser cette liberté, à ouvrir les vannes de la marchandisation sans contrepartie pour les créateurs.

Il s’agit d’un débat important dont nous devons bien comprendre les enjeux.
Le droit d’auteur est entré dans notre loi fondamentale après un long combat, ce qui a permis de protéger les créateurs et la création française. Aujourd’hui, la révolution numérique vient percuter la façon dont nous appréhendions ce droit.
Nous avons eu le même débat à propos de la musique ou du cinéma. Il s’agit aujourd’hui de la liberté de panorama.
L’Assemblée nationale a été sage en créant une exception au droit d’auteur afin de tenir compte des usages. Car l’objet de ce projet de loi est d’accompagner cette révolution numérique, de ne pas ériger de barrages conservateurs, tout en permettant à la République de continuer d’asseoir ses principes, au sein de cette révolution numérique, et de nous protéger.
L’Assemblée nationale n’a pas voulu qu’un particulier puisse être poursuivi pour avoir pris une photo d’un monument ou d’une œuvre dans l’espace public et l’avoir ensuite postée sur Facebook et envoyée à sa famille ou à ses amis. Nos collègues députés ont voulu mettre fin à cette possibilité, à cette petite hypocrisie, en créant cette exception.
Mais, comme toujours, certains ont voulu utiliser cette liberté donnée aux particuliers pour faire valoir des intérêts visant à spolier et fragiliser les créateurs, les artistes plasticiens, les arts visuels en général. Nous les connaissons tous, je parle de lobbies qui militent depuis longtemps en ce sens – je songe, par exemple, à Wikimedia…
Je rappelle tout de même que les responsables de Wikimedia ont refusé de signer un accord garantissant les droits d’auteur en échange d’un accès à toute la bibliothèque des œuvres. Ils veulent pouvoir bénéficier du dispositif sans se soucier du sort d’artistes qui – je le souligne devant la Haute Assemblée – sont particulièrement fragilisés et ne peuvent vivre que des droits d’auteur. J’aurai l’occasion d’y revenir.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 205, présenté par M. Barbier, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 392 rectifié, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, M. Guillaume, Mmes Blondin, Cartron et D. Gillot, MM. Magner et Manable, Mme D. Michel, MM. Camani, F. Marc, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »
La parole est à M. David Assouline.

La commission de la culture a souhaité étendre l’exception au droit d’auteur décidée à l’Assemblée nationale aux associations à but non lucratif. Certains pourraient trouver cela judicieux, en considérant que ces associations ne font pas d’argent.
En réalité, ce serait un terrible cheval de Troie ! Il y a toutes sortes d’associations à but non lucratif. Et certaines font de l’argent ! Elles ne sont nullement tenues de ne pas faire de bénéfices ; leur seul impératif est de les réinvestir dans leur activité. L'Union des associations européennes de football, l’UEFA, la Fédération internationale de football association, la FIFA, et bien d’autres structures ont un statut d’association. Il y a même des associations dont l’objet est d’éditer des cartes postales ; elles pourraient donc diffuser des œuvres sans que l’auteur en tire la moindre contrepartie.
Nous ne pouvons pas accepter cela. Et il est évidemment encore moins question de procéder à une libéralisation totale en étendant le dispositif aux entreprises.
Je tiens à rappeler que la majorité des professionnels des arts visuels de notre pays vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ne nous laissons pas abuser par le cas particulier des quelques artistes que l’on voit partout et qui vivent tranquillement.
Les droits d’auteur que les artistes perçoivent lorsque leurs œuvres sont utilisées pour la publicité sont importants ; ils représentent 60 % de leurs revenus. En supprimant cela, nous aggraverions la situation d’une profession déjà fragilisée faute de grande organisation pour la défendre, à l’instar de ce qui existe pour la musique ou le cinéma. Imaginez d’ailleurs la révolution qu’il y aurait en France si on prenait une décision similaire pour la musique ou le cinéma !
Nous devons, certes, accompagner une évolution, mais non sacrifier l’ensemble d’une profession par une législation hâtive !
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale qui empêche les poursuites contre les particuliers permet d’éviter tout problème. N’allons pas au-delà.

Le sous-amendement n° 663, présenté par MM. Barbier, Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Amendement n° 392 rectifié, alinéa 3
Remplacer les mots :
particuliers à des fins non lucratives
par les mots :
personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Ce sous-amendement vise à limiter la liberté de panorama aux seules personnes physiques, à l’exclusion de tout usage directement ou indirectement commercial.
Il est nécessaire d’introduire en droit français la liberté de panorama, exception au droit d’auteur par laquelle les reproductions ou représentations de l’image d’une œuvre d’architecture protégée dans l’espace public sont autorisées. Cela permet la communication au public et le rayonnement du patrimoine français. Mais cela doit s’effectuer sous certaines conditions.
D’une part, la liberté de panorama ne doit pas être étendue aux activités commerciales, auquel cas il serait légitime de rémunérer justement les auteurs et de recueillir leur accord.
D’autre part, cette liberté doit être limitée aux seules personnes physiques et exclure – cela vient d’être dit – les associations « loi 1901 », qui regroupent une grande diversité d’entités, dont certaines sont puissantes. Le fait de leur accorder la liberté de panorama pourrait conduire à un détournement d’usage.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 71 rectifié bis est présenté par MM. Chaize, Pellevat, Mandelli et Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, Mouiller, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Savary, Bouchet, Vasselle, P. Leroy et Dallier, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard, Magras et L. Hervé.
L'amendement n° 196 est présenté par MM. Rome et Sueur.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
par des personnes physiques ou des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 71 rectifié bis.

La liberté de panorama permet de reproduire une œuvre, essentiellement architecturale, qui se trouve dans l’espace public, mais qui attend encore son entrée dans le domaine public. Elle permet aussi de publier sur internet des photos de vacances lorsqu’un bâtiment ou une sculpture récente se trouvent au centre du cliché. Elle permet enfin à chacun de publier ses propres photos sur Wikipédia, afin d’enrichir des articles relatifs aux auteurs ou aux œuvres.
Proposée parmi diverses exceptions au droit d’auteur par la directive européenne de 2001 et inscrite dans la majorité des législations européennes, l’exception n’a toujours pas été introduite en droit français.
À ce jour, seule la représentation accessoire de l’œuvre est admise. Selon la jurisprudence, « la représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire au sujet principal représenté ou traité. »
En dehors d’un tel cas de figure, le code de la propriété intellectuelle considère comme contrefacteur toute personne publiant une reproduction photographique d’un espace public comprenant une telle œuvre. C’est tout l’enjeu du débat.
Dès lors que le fait de prendre des photos dans l’espace public devrait être une liberté pleine et entière, celui qui choisit de construire un bâtiment dans l’espace public ou d’y diffuser une œuvre par le truchement de deniers publics ne devrait pas pouvoir privatiser la vue de tous au nom du droit d’auteur. Ce paramètre d’espace public induit par lui-même la potentialité d’une diffusion sans entrave.
Aucune expropriation de l’auteur vis-à-vis de son œuvre ne semble être opérée dans ce cadre. Au contraire ! En outre, l’avantage de nouvelles commandes suscitées par une popularité grandissante et une présence renforcée sur les réseaux sociaux et sur le net est loin d'être négligeable.
Par ailleurs, il est aujourd’hui très difficile de définir la nature commerciale ou non de la diffusion d’une représentation photographique sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes accueillant de la publicité.
À quel moment un site perd-il son caractère non commercial ? Facebook, qui peut utiliser à tout moment à des fins commerciales les photos diffusées par les internautes, rend-il ces derniers contrefacteurs de fait ?
L’introduction d’une liberté de panorama dans la législation française apporterait de la sécurité juridique non seulement à l’échelon national, avec la création d’un cadre légal fixe qui éviterait l’apparition d’exceptions prétoriennes instables, mais également à l’échelle européenne, par l’harmonisation des systèmes législatifs. Cette avancée française vers une liberté de panorama pourrait avoir un effet dans les discussions européennes sur la révision de la directive. À l’heure de l’open data, cela permettrait de faire connaître une avancée significative et cohérente à nos débats.

Le sous-amendement n° 664, présenté par MM. Barbier, Mézard et Requier, est ainsi libellé :
Amendement n° 71 rectifié bis, alinéa 3
Supprimer les mots :
par des personnes physiques
et les mots :
, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Cet amendement vise à étendre la liberté de panorama à toute personne pour tout usage.
Comme cela a été rappelé, la révolution numérique a bouleversé toutes les organisations. Elle crée une insécurité juridique pour les citoyens. En effet, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook ou Instagram, la diffusion de l’image d’une œuvre protégée dans l’espace public est presque quotidienne, et elle est tolérée de facto.
Il y a également un enjeu économique. La libre réutilisation par un écosystème français dynamique des œuvres dans l’espace public peut être un fabuleux levier de croissance. Pour preuve, selon les conclusions du Conseil national du numérique, la valeur des images présentées sur Wikimedia pour des start-up innovantes est estimée à plus de 200 millions d’euros.
L’attractivité de la France pourrait être considérablement renforcée par une telle évolution législative. Sur Wikipédia, une grande majorité de pages relatives aux communes françaises sont mal ou peu illustrées. Or Wikipédia, qui fait partie des dix sites internet les plus visités au monde, constitue une réelle vitrine du patrimoine français pour le reste du monde.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquait M. Assouline, l’enjeu pour les créateurs est d’accroître leur notoriété, qui progressera avec la diffusion de leurs œuvres sur l’ensemble des réseaux sociaux. C’est ce qui leur permettra de s’y retrouver financièrement.
En réalité, pour l’instant, le système favorise les grands créateurs. Je ne pense pas que M. Buren souffrirait d’une plus grande diffusion de l’image de son œuvre… En revanche, les petits créateurs, dont la notoriété serait accrue, seraient les principaux bénéficiaires de la mesure que je propose.
Au demeurant, cela permettrait à notre pays de s’aligner sur ses principaux partenaires européens, dont 60 % ou 70 % ont fait le choix de la liberté de panorama. Je pense notamment à l’Allemagne, au Royaume-Uni et à la Pologne.
Enfin, d’un point de vue philosophique, je considère que ce qui est dans l’espace public appartient à tout le monde. Certes, nous devons prendre en compte l’intérêt des créateurs. Mais nous ne pouvons tout de même pas ignorer la pétition en ligne en faveur de la liberté de panorama qui a recueilli plus de 20 000 signatures !

L'amendement n° 197, présenté par MM. Rome et Leconte, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou indirectement
La parole est à M. Yves Rome.

Je souhaite d’abord apporter une précision. L’article 18 ter inscrit dans la loi ce qui était jusqu’à présent un usage. Le comportement des internautes ne changera pas après l’adoption du projet de loi. Au contraire ! Le dispositif que nous proposons apporte indiscutablement une sécurité juridique.
Par son amendement n° 392 rectifié, M. Assouline suggère de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.
D’abord, l’expression « personnes physiques » nous a semblé plus pertinente que la référence aux « particuliers ».
Ensuite, nous avons jugé souhaitable d’étendre le dispositif aux associations à but non lucratif. Je pense par exemple aux associations qui mettent en valeur le patrimoine local.
Enfin, il paraît judicieux que l’interdiction vise « tout usage à caractère directement ou indirectement commercial ». La mention des « fins non lucratives » pourrait laisser penser qu’une structure ayant une activité commerciale, mais ne gagnant pas d’argent – il y en a – serait concernée par l’exception.
Pour toutes ces raisons, la rédaction de la commission nous semble préférable.
Cela étant, monsieur Assouline, j’entends vos arguments sur les associations. Je pourrais donc me prononcer en faveur de votre amendement n° 392 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 663 et d’une rectification. Je souhaite que les mots « sur la voie publique » soient remplacés par les mots « dans l’espace public ». §Ces deux modifications nous permettraient d’aboutir à une rédaction consensuelle, avec l’expression « personnes physiques », qui est préférable juridiquement, l’interdiction de « tout usage à caractère directement ou indirectement commercial » et la mention de « l’espace public ». Dans ces conditions, je pourrais alors émettre un avis favorable sur votre amendement, mon cher collègue.
Les amendements identiques n° 71 rectifié bis et 196 visent à supprimer toute limitation à l’exception de panorama relative au bénéficiaire ou à l’objectif poursuivi. Cette proposition a déjà été formulée – et rejetée ! – en commission.
Ma position n’a pas varié. L’introduction de l’exception de panorama en droit français, permise par la directive européenne du 22 mai 2001, est utile. Elle prend logiquement acte d’une pratique fréquente, et jamais punie, des particuliers qui photographient à des fins personnelles des bâtiments et sculptures installés dans l’espace public.
L’élargir à tous, y compris à des entreprises, et pour n’importe quel type d’usage, va bien au-delà de l’esprit d’une exception au droit d’auteur. Nous ne devons pas priver déraisonnablement un créateur de ses droits. Comment justifier qu’une entreprise de vêtements ou de cartes postales fasse commerce d’une image pour l’usage de laquelle elle n’aurait pas rémunéré l’auteur ?
À cet égard, le compromis trouvé à l’Assemblée nationale, lequel a été précisé dans sa rédaction et élargi par la commission de la culture, me semble répondre aux défenseurs de la liberté de panorama, dans les limites d’une juste rémunération des auteurs, dont nous devons prendre l’intérêt en compte.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 197 vise à élargir l’exception de panorama aux usages indirectement commerciaux. Une telle modification permettrait à toute personne physique ou morale de récupérer une photographie de bâtiment ou de sculpture extérieure mise à disposition par un particulier dans le cadre autorisé de l’exception pour un usage commercial sur lequel le créateur de l’œuvre ne bénéficierait d’aucune rémunération. La commission de la culture y est hostile.

Monsieur Assouline, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission de la culture ?

Oui, madame la présidente, ce pour des raisons juridiques.
L’expression « voie publique » fait référence à la route ou à l’autoroute. Celle d’« espace public » est plus large. Mais ce n’est pas le « domaine public » ; les musées ne sont donc pas visés. Je tenais à le préciser pour rassurer les professionnels concernés.

Je suis donc saisie de l’amendement n° 392 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, M. Guillaume, Mmes Blondin, Cartron et D. Gillot, MM. Magner et Manable, Mme D. Michel, MM. Camani, F. Marc, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence dans l'espace public, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements en discussion ?
La liberté de panorama est un sujet très discuté. Le Gouvernement a fait évoluer sa position entre le débat à l’Assemblée nationale et l’examen du présent texte par le Sénat.
Nous sommes dans le cas de figure typique d’un décalage entre les nouvelles pratiques permises par les outils numériques et le droit.
Je pense qu’il faut maintenir l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale. La liberté de panorama doit être reconnue pour permettre, par exemple, à des particuliers de photographier des œuvres situées sur la voie publique, mais elle ne doit pas être étendue aux pratiques menées à des fins commerciales.
Le Gouvernement n’est pas non plus favorable à l’extension aux associations.
Face à la transition numérique, le rôle des pouvoirs publics est, certes, d’anticiper et de préparer l’avenir, mais c’est aussi de protéger les publics qui pourraient avoir à subir les conséquences de telles évolutions.
En l’espèce, nous parlons d’une population très fragilisée ; tous les artistes n’ont pas forcément pleinement intégré les innovations les plus en pointe en matière de création. Il s’agit de designers, de graphistes ou de certains photographes, non pas de stars de cinéma ou de grandes maisons d’édition anglo-saxonnes ayant profité des phénomènes de concentration pour se transformer en multinationales !
Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements n° 71 rectifié bis, 196 et 197, ainsi qu’aux sous-amendements n° 663 et 664.
Je comptais émettre un avis de sagesse sur l’amendement n° 392 rectifié. Mais, après rectification, celui-ci est devenu l’amendement n° 392 rectifié bis. Or je n’ai pas été en mesure de faire expertiser juridiquement le remplacement de la référence à la « voie publique » par la mention de l’« espace public », même si j’en comprends l’objectif. Je suis donc contrainte de me déclarer défavorable à cet amendement dans sa nouvelle rédaction. Le débat sur le sujet pourra se poursuivre lors de la tenue de la commission mixte paritaire.

Je constate que, depuis ce matin, notre tropisme libéral est à géométrie variable !
Le TDM était plébiscité par les chercheurs en sciences, la Conférence des présidents d’université, l’ensemble du monde universitaire, ainsi que par un journal aussi révolutionnaire que Les Échos.
Sourires.

Je vais essayer d’avoir un raisonnement pondéré sur la liberté de panorama.
J’appartiens à une famille politique dans laquelle le courant libertaire est très puissant, d’où une vision très généreuse en la matière. En plus, j’adore Wikipédia ; nous sommes tous très contents d’y être mis en avant. Je comprends donc certains arguments.
Néanmoins, nous n’avons pas déposé d’amendements sur cet article. Je tiens à m’en expliquer.
Il se trouve que je suis présidente du groupe d’études Photographie et autres arts visuels, ce qui me permet de faire une minute de publicité. §Ce groupe d’études ne rencontre pas les lobbies ou les artistes riches. Il défend les étudiants des écoles d’art – il pourrait s’agir de nos enfants ! – qui ont besoin de pouvoir vivre du produit de leur travail.
Il faut, me semble-t-il, concilier notre utopie de libéralité avec la situation de ces jeunes étudiants. Il s’agit d’artistes photographes ou de plasticiens, souvent issus de milieux populaires, et non d’architectes fortunés. Or, compte tenu du modèle économique, leurs revenus comprennent aussi le droit d’auteur, ou ce qu’il en reste ! Nous devons trouver un équilibre.
J’ai bien compris que le Gouvernement n’avait pas pu faire expertiser la rédaction retenue après rectification. Mes amis et moi-même assumons nos positions, même quand elles correspondent à l’opinion dominante.
Il faut soit chercher un dispositif équilibré qui préserve les intérêts des uns et des autres, soit inventer quelque chose de totalement nouveau pour nos artistes !
Voilà pourquoi nous n’avons pas souhaité amender cet article. Certes, nous aimons beaucoup Wikipédia. Mais une association « loi 1901 » très vertueuse n’est pas forcément exempte de préoccupations liées à un modèle économique.

Je souhaite faire part de mon étonnement.
Certes, il faut protéger les droits des créateurs. Mais, en l’occurrence, nous parlons d’œuvres architecturales qui se trouvent sur la voie publique, voire, dans le cas de bâtiments, qui ont donné lieu à rémunération.
Ne présentons pas le dispositif envisagé comme une attaque contre la création. Il s’agit simplement de mobiliser les techniques modernes pour promouvoir l’image de notre pays. Cela concerne la création la plus récente, et pas seulement ce qui relève du domaine public !
Si nous voulons donner l’image d’une France moderne et dynamique, faisons en sorte de montrer et de diffuser le plus largement possible ce qui fait sa richesse intellectuelle. Les pays dont la création sera connue et reconnue dans le monde seront ceux qui s’en seront donné les moyens, à commencer par la liberté de panorama.
Il faut en avoir conscience : ce sont les décisions que nous prendrons aujourd'hui qui permettront demain à notre pays d’être, ou non, reconnu à l’étranger ! Il est important d’élargir nos possibilités.

Le sujet est à la fois important et délicat. Je pense que nous allons trouver le point d’équilibre. C’est notre responsabilité collective, à plus forte raison après le débat que nous avons eu sur le TDM.
Veillons à trouver un équilibre entre liberté de l’usager – je pense notamment à la sécurisation des internautes –, valorisation de notre patrimoine, dont nous connaissons aujourd'hui l’importance dans notre pays, et respect du droit d’auteur ! Évitons un jusqu’au-boutisme qui serait motivé par des considérations économiques ou touristiques !
Par ailleurs, l’argument qui vient d’être avancé n’est pas juste. La question du droit d’auteur, c’est celle du lien entre l’œuvre et le créateur.
Certes, il est possible que certains créateurs aient reçu de l’argent public pour installer leurs œuvres sur l’espace public. Mais attention ! Toutes ces œuvres ne sont pas payées sur fonds publics. Il y a aussi des œuvres privées. D’ailleurs, à en juger par les débats que nous avons eus lors de l’examen du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, je pense que ce sera de plus en plus le cas.
Mais, encore une fois, le sujet, c’est le lien entre l’œuvre et le créateur.
Pour terminer, le droit d’auteur n’a jamais été un frein à la diffusion de la culture, à son rayonnement, à son image et surtout à celle de notre pays.
Gardons bien à l’esprit que, en poussant la démarche jusqu’au bout, la privation de revenus des créateurs, singulièrement des plus fragiles d’entre eux dans le secteur des arts visuels – je pense aux photographes –, pourra être un frein réel à la vitalité de la création artistique dans notre pays. Si cela devait se produire, nous ne parlerons même plus de la liberté de panorama ni du droit d’auteur !

Ce combat, au nom des valeurs et du respect de la création, est d’arrière-garde. La ligne Maginot a été franchie ! Les usages que le numérique entraîne sont là. Faute de savoir anticiper, nous ne pourrons que retarder leurs effets, mais pas les empêcher.
Il me semble, au contraire, que tous les créateurs, notamment les plus petits, ceux qui ne vivent pas complètement de leurs créations, auront tout à gagner à une plus large diffusion de leurs œuvres sur les réseaux sociaux.

Qu’il me soit permis de lever quelques préventions, car j’entends encore dire que ce texte, tel qu’il a été rédigé par l’Assemblée nationale, pourrait avoir pour effet d’inquiéter les particuliers et de freiner l’évolution de leurs usages. Je veux le dire clairement : quel que soit le cas de figure, les particuliers ne pourront pas être inquiétés.
Prenons un exemple. Si je poste une photo de la villa Savoye sur Facebook ou Twitter, je ne pourrai pas être condamné, car la liberté de panorama pour les particuliers sur œuvre dans l’espace public que je propose de rétablir ne permet pas de sanctionner un tel fait. Si l’un de mes amis retweete ou partage la photo, il ne sera pas non plus inquiété, car il s’agit d’une utilisation non commerciale.
En revanche, si un producteur ou une association s’empare de la photo pour créer un t-shirt ou une carte postale, l’utilisation sera commerciale et l’un ou l’autre devra acquitter des droits d’auteur. Ce n’est pas moi qui serai sanctionné, contrairement à ce que certains ont affirmé, mais c’est celui qui fait un usage commercial de la photo.
Toutefois, il est certain que j’aurais pu être attaqué avant que l’on inscrive dans la loi l’exception dont nous discutons et que je souhaite rétablir grâce à l’amendement n° 392 rectifié bis du groupe socialiste.
En tout état de cause, j’approuve la rectification proposée par Mme la rapporteur pour avis. Je comprends que le Gouvernement a besoin d’une expertise juridique plus poussée. Nous verrons tout cela en commission mixte paritaire. J’approuve également le sous-amendement défendu par Jean-Claude Requier. Il est plus clair et précis d’inscrire « personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial » plutôt que « particuliers à des fins non lucratives ». Le terme « particuliers », dans la loi, me semble être une abstraction, contrairement à l’expression « personnes physiques » qui est plus identifiable juridiquement.

J’appelle le Sénat à un instant de réflexion. Ce débat dans lequel amis et collègues s’opposent avec une parfaite bonne foi a été suscité par une démarche habile autour du concept de liberté de panorama. C’est très adroit ! Mais c’est trompeur.
Permettez-moi de revenir sur ce que j’ai dit tout à l’heure au sujet du droit d’auteur. Celui-ci comprend deux aspects. D’une part, le droit d’auteur, c’est la protection de l’œuvre et des droits de l’auteur sur son œuvre. D’autre part, le droit d’auteur, c’est aussi un principe d’équité dans l’économie de l’œuvre : celui qui a produit l’œuvre a droit à une rémunération pendant une durée fixée par la loi – il s’agit d’ailleurs d’une loi internationale.
L’enjeu, avec la liberté de panorama, ce n’est pas du tout de savoir s’il est possible ou non de reproduire une œuvre ; il s’agit de savoir si cette liberté est assortie d’une rémunération de l’auteur. L’expression « liberté de panorama » n’est-elle pas en réalité une acrobatie pour dissimuler le fait, sous couvert de défendre une liberté, que l’on ne rémunérera personne ?
Notre assemblée semble faire preuve d’ingénuité sur ce point, alors que nous sommes nombreux à être expérimentés, pour ne pas dire chenus !
Selon moi, l’emploi de cette expression est une tentative habile pour défendre le droit de diffuser une œuvre, avec des avantages économiques, sans rémunérer son auteur. C’est uniquement de ça qu’il s’agit ici !
Je complète mon propos en attirant l’attention de Mme Mélot sur un point : les éléments de la modification qu’elle propose sont tous valables, excepté l’expression « espace public », qui n’apporte rien. La voie publique, en droit, pour appuyer les remarques de Mme la secrétaire d’État, désigne tout espace aménagé pour la libre circulation du public, et non un espace routier ! La voie publique, ce sont par exemple les parcs et jardins, les voies piétonnes, ou encore la cour d’un monument historique. Nul besoin de substituer aux termes « voie publique » qui ont un sens juridique certain, l’expression « espace public » qui est une dénomination courante, mais n’a aucune valeur en droit.

Nous nous attendions à avoir un débat riche et fourni sur la liberté de panorama. Nous sommes sur le point d’atteindre un équilibre certes subtil, mais qui a été travaillé en amont depuis quinze jours au sein de la commission.
À cet égard, je remercie Mme la rapporteur pour avis qui, tant sur le TDM que sur la présente question, a toujours cherché la ligne de crête et la voie médiane, afin de défendre la création artistique et le respect des droits d’auteurs, tout en les inscrivant dans une forme de modernité nécessaire à l’accompagnement de la mutation numérique.
Tenons-nous-en à la proposition de Mme la rapporteur pour avis, afin d’aboutir au texte le plus satisfaisant possible. Je remercie Mme Mélot, qui a réalisé depuis quinze jours un véritable travail de dentelle.

Ce débat fort intéressant fait avancer notre point de vue. C’est un sujet sur lequel il fallait beaucoup réfléchir. Certes, la liberté évoluera encore, mais il convient d’être vigilant en matière de droit d’auteur. La commission de la culture a fait preuve de prudence dans ses travaux.
Toutefois, j’ai bien écouté les propos de M. Richard, dont l’expertise juridique n’est plus à prouver. La commission des lois fait d’ailleurs souvent appel à ses vues expertes. Notre collègue affirmant que l’expression « voie publique » est celle qui convient, je me rallie à sa position et suggère à M. Assouline de rectifier une nouvelle fois son amendement.

Permettez-moi de préciser mes objectifs dans ce débat intéressant.
Tout d’abord, madame le rapporteur pour avis, l’inscription dans la loi peut modifier les usages, j’en suis convaincu. Quand il y a des ambiguïtés, personne ne fait ni ne dit rien. Mais dès lors que le sujet est mis sur la table et que le débat a lieu, les choses évoluent.
Je m’étonne que nos discussions soient si figées sur la liberté de panorama. La France, pourtant pays de liberté, sera l’un des rares pays en Europe à ne pas avoir ouvert droit à cette liberté de panorama. Mon objectif est non pas de protéger Wikipédia, Facebook et autres, ni de surprotéger les auteurs – même si je les respecte profondément –, qui, comme cela a été souligné, ont été rémunérés pour leur œuvre, mais de défendre les particuliers, qui ne sont représentés par personne, si ce n’est par nous.
Entre deux maux, il faut parfois choisir le moindre. C’est pourquoi je maintiens mon amendement, qui tend à protéger de façon certaine les particuliers en cas de diffusion de photos sur les sites.

Monsieur Assouline, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 392 rectifié bis dans le sens suggéré par la commission de la culture ?

J’ai écouté attentivement M. Richard. Ses arguments sont convaincants. L’expertise juridique sera certainement poursuivie, notamment en commission mixte paritaire. L’espace public existe en droit puisque la loi sur le port du voile y fait expressément référence.
Cela étant, le débat reste ouvert, mais à ce stade, je me range à l’avis d’un expert tel que mon collègue Alain Richard. D’ici à la commission mixte paritaire, nous aurons peut-être encore le temps d’aller plus loin.

Je suis donc saisie de l'amendement n° 392 rectifié ter, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, M. Guillaume, Mmes Blondin, Cartron et D. Gillot, MM. Magner et Manable, Mme D. Michel, MM. Camani, F. Marc, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »
Je mets aux voix le sous-amendement n° 663.
Le sous-amendement est adopté.
Je tiens à préciser que le Gouvernement n’a pas changé d’avis : il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement initial de M. Assouline.
L'amendement est adopté.

En conséquence, les amendements identiques n° 71 rectifié bis et 196, le sous-amendement n° 664, ainsi que l’amendement n° 197 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 18 ter, modifié.
L'article 18 ter est adopté.
(Supprimé)
En application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande l’examen en priorité des amendements n° 602 et 603 rectifié, qui tendent à insérer des articles additionnels après l’article 23 ter, à seize heures quinze, au moment de la reprise de la discussion du présent texte, soit avant l’examen des articles 43 à 45, appelés précédemment en priorité.

La commission n’a pas pu se réunir. Je ne demanderai pas de suspension de séance et je prends sur moi de donner mon accord.

La priorité est ordonnée.
TITRE II
LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Environnement ouvert
Section 1
Neutralité de l’internet
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La neutralité de l’internet, définie au q du I de l’article L. 33-1 ; »
2° Le 2° de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : «, y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ;
3° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :
« q) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;
4° Au 3° de l’article L. 36-7, après le mot : « Union », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union » ;
5° Le 5° du II de l’article L. 36-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : «, y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ;
6° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services d’envoi de recommandé électronique mentionnés à l’article L. 100. » ;
b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : «, par un fournisseur de services de communications électroniques, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique : » ;
c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ;
e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : «, un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».

La parole est à Mme la présidente de la commission de la culture, sur l’article.

La neutralité du net est un principe important selon lequel toutes les données qui sont échangées sur le web doivent être traitées à égalité, qu’il s’agisse d’un courriel envoyé à un ami ou d’une vidéo hébergée sur YouTube.
Ce principe est l’objet d’une bataille législative dont les enjeux sont autant économiques – il convient de ne pas privilégier des services payants au détriment de sites gratuits – que démocratiques – il ne faut pas favoriser des groupes ou des opinions politiques ni limiter l’accès et le transfert de données.
Le Parlement européen a adopté au mois d’octobre dernier le fameux paquet de règlements sur les télécommunications. Ce texte établit que « le principe de “neutralité de l’internet” dans l’internet ouvert signifie que tout le trafic devrait être traité de la même manière, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’émetteur, le récepteur, le type, le contenu, l’appareil, le service ou l’application. […] Le caractère ouvert de l’internet est un moteur clé de compétitivité, de croissance économique, de développement social et d’innovation ».
L’article 19 du présent projet de loi est, quant à lui, en grande partie la transposition en droit national de ce règlement européen relatif au marché unique des télécommunications tout juste adopté. Ce règlement vise une harmonisation maximale. Il importe donc que les dispositions se conforment à l’esprit et à la lettre du règlement.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale est conforme, selon nous, au cadre européen et ne doit plus évoluer. Cela est d’autant plus important que les régulateurs européens préparent des lignes directrices sur le règlement. Si la loi devait diverger du règlement, le cadre français risque d’être non conforme à ces lignes directrices, qui serviront pourtant de socle pour le travail des régulateurs.

L'amendement n° 461, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« q) Conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, la neutralité de l’Internet garantie par :
« – le traitement égal et non discriminatoire de tout trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d’accès à Internet sans restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés ;
« – et le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d’accéder et de contribuer à Internet. » ;
La parole est à M. Patrick Abate.

Aujourd’hui, internet est un élément structurant de notre espace public, un bien commun, un lieu d’innovation, de communication, de diffusion des savoirs et des idées.
Lorsqu’on aborde la question de la neutralité d’internet, il s’agit en fait de la neutralité des réseaux. Ce principe de non-discrimination permet à chacun d’avoir un égal accès à internet, et permet aussi qu’aucun contenu ne bénéficie d’un traitement préférentiel. Cette règle empêche le fournisseur d’accès à internet d’influer sur ce que fait l’internaute ou sur la vitesse à laquelle sont transmis les paquets de données sur le réseau. En clair, toutes les données doivent être traitées de la même manière, qu’elles proviennent d’une personne, du Gouvernement, d’une petite ou d’une grosse entreprise.
Nous proposons par notre amendement de donner une définition positive de cette règle au lieu d’un simple renvoi aux règlements européens, qui fixent une définition plus ambiguë et qui contiennent surtout un trop grand nombre d’exceptions à la neutralité.
Si les règlements européens sont d’application directe et qu’ils priment sur la loi nationale, toutefois les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres sont licites si le règlement le prévoit ou si son application efficace l’exige.
À cet égard, le Conseil constitutionnel rappelle que, en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et à l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accès à ces services.
C’est pourquoi nous pensons qu’il faut une définition ambitieuse de la neutralité d’internet. La loi, parce que l’internet est un bien commun, doit garantir à tous un accès absolument non discriminatoire.

Cet amendement vise à reformuler la définition du principe de neutralité du net.
La définition donnée par l’article 19, en l’état, nous semble plus précise et plus sûre. En effet, elle renvoie directement et uniquement au règlement européen relatif au marché unique des communications électroniques dit « MUCE », du 25 novembre 2015.
L’article 3 de ce texte précise de façon très complète et détaillée le contenu de ce principe de neutralité.
Nous préférons donc, M. Abate le comprendra bien, pour des motifs de clarté et de sécurité juridique, nous en tenir à la seule référence à la définition de ce principe par le droit communautaire, plutôt que ne prendre qu’une partie de cette définition, comme le prévoit l’amendement. L’adoption de celui-ci nous exposerait à un risque de divergence avec le règlement européen, qui est bien d’application directe, et dont nous ne pouvons absolument pas nous écarter. Nous serions alors obligés de légiférer de nouveau.
Pour cette raison, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. J’en partage toutefois pleinement l’objet, qui est d’assurer un accès ouvert à l’internet pour un traitement non discriminatoire des types de trafics, et qui garantisse le droit des utilisateurs à accéder aux contenus de leur choix et à les publier.
Le projet de loi pour une République numérique est un texte d’ouverture et de liberté. Il rend accessible les données publiques, il garantit la neutralité du net, il ouvre les codes sources et les algorithmes des administrations, il donne libre accès aux écrits scientifiques des chercheurs. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que le principe de neutralité du net figure dans la loi nationale, bien qu’il ait été discuté à l’échelon européen et que le règlement adopté à la fin de l’année dernière soit d’application immédiate.
Vous aurez remarqué, mesdames, messieurs les sénateurs, que l’expression « neutralité de l’internet » figure dans le texte de loi, ce qui n’est pas le cas dans le texte européen. J’en profite pour souligner à quel point le gouvernement français a été actif pour permettre l’adoption du règlement européen. À partir du moment où la position du gouvernement français a été très clairement affirmée à Bruxelles et que nous avons activement recherché des partenaires en Europe pour parvenir à une position commune, le règlement a été adopté.
Pour autant, à ce stade, il est important d’assurer la sécurité juridique et la lisibilité du cadre réglementaire qui a été trouvé, ce pour deux raisons. D’abord, ce texte sur la neutralité s’appliquera avant tout aux opérateurs de télécommunications. Or ceux-ci sont soumis à une réglementation très largement définie à Bruxelles par des textes européens. Ensuite, lorsque l’on intègre une vision différente sur un sujet comme la neutralité du net dans le droit national, on aboutit potentiellement à un effet contre-productif par rapport à l’objectif.
En effet, l’idée est de faire masse dans les pratiques des usagers. Plus ces pratiques évolueront dans un cadre harmonisé à l’échelon européen, plus elles permettront au principe de neutralité de l’internet de s’affirmer pleinement pour dominer complètement les comportements commerciaux et économiques des entreprises concernées.
Nous sommes allés le plus loin possible. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est, je le répète, défavorable à cet amendement.

J’entends bien l’argument selon lequel il est important de faire masse. Il a évidemment tout son sens.
Je maintiens néanmoins mon amendement. Contrairement à ce que Mme la secrétaire d’État vient d’affirmer, il ne sera pas nécessaire de légiférer de nouveau. Il suffit de considérer qu’il s’agit d’appliquer sur le territoire le droit européen.
Il serait possible de faire masse de manière plus efficace en termes de neutralité. Certes, le règlement européen affirme le principe de neutralité : c’est un fait, il est plutôt protecteur ; mais dans le même temps, il accepte trop d’exceptions. Par exemple, il est possible d’ouvrir des voies rapides contre des rémunérations pour des services spécialisés, comme il est également possible d’intervenir sur la bande passante pour empêcher des encombrements imminents, ce qui permet à un fournisseur d’accès de ralentir le trafic à n’importe quel moment.
Telles sont les préoccupations que nous souhaitons exprimer au travers de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 432, présenté par M. Sido, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services d’envoi de recommandé électronique mentionnés à l’article L. 100
par les mots :
ou des fournisseurs de services de communication au public en ligne
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique
par les mots :
ou par un fournisseur de services de communication au public en ligne
La parole est à M. Bruno Sido.

Sur deux des articles au sujet desquels la commission des affaires économiques a reçu délégation au fond, à savoir les articles 19 et 39, j’ai déposé des amendements à titre personnel, mais ceux-ci ont été validés par la commission.
Il s’agit ici d’un amendement de coordination avec les modifications proposées pour l’article 40 du projet de loi sur lequel la commission des affaires économiques a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 19 est adopté.

L'amendement n° 463, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … – Le domaine public regroupe l’ensemble des œuvres et des idées qui n’appartiennent à personne et dont l’usage et la jouissance sont communs à tous. Les œuvres non-assujetties au droit d’auteur, au droit de propriété intellectuelle ou aux droits voisins et celles dont les créateurs souhaitent leur inscription dans le domaine public entrent de plein droit dans ledit domaine. »
La parole est à M. Patrick Abate.

Le domaine public est aujourd’hui important à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, il est un pendant essentiel du droit d’auteur et des droits voisins ; il permet de borner ces derniers et de légitimer leur emprise.
La question du domaine public pose le débat de ces biens sans maître qui, exemptés des droits patrimoniaux, appartiennent au final à tout le monde. C’est ici une conception noble des arts, créés par l’humanité pour l’humanité.
Par ailleurs, le domaine public permet aussi d’enrichir la création puisque les artistes contemporains n’hésitent pas à s’appuyer sur des œuvres tombées dans le domaine public pour produire de nouvelles créations.
Malheureusement, le domaine public souffre aujourd’hui d’une tare : son absence du code de la propriété intellectuelle. De fait, la seule définition du domaine public est une définition négative, conçue par la doctrine et la jurisprudence, forcément mouvantes et sujettes à des revirements.
Internet et le numérique ont conduit à un intérêt renforcé du domaine public puisqu’ils permettent une diffusion des plus larges d’œuvres historiques. Cette diffusion est d’autant plus facilitée que l’œuvre est modifiable. Je pense notamment chaque année à la liste des nouveaux films entrant dans le domaine public qui peuvent faire l’objet de processus de sous-titrages par des passionnés, ce qui permet une diffusion plus large.
Pour ne donner qu’un exemple, le site archive.org permet de télécharger, gratuitement et légalement, plus de 5 000 films.
Cela étant, le maintien du domaine public dans une définition négative – « ce qui n’est pas protégé par le droit d’auteur » – le fragilise trop souvent. On peut d’ailleurs le considérer, à l’instar de l’universitaire et juriste Michael Birnhack, comme « la tombe des œuvres protégées par le droit d’auteur ».
Actuellement, le risque majeur, qui dépend totalement de l’unique négativité de la définition du domaine public, est la tendance à un rallongement de la durée du droit d’auteur. Ainsi, en limitant le domaine public au néant suivant la protection d’auteur, on entraîne une dépendance du premier vis-à-vis du second.
Cette question, qu’on pourrait qualifier de technocratique, a pourtant des incidences fortes. Ainsi, une véritable bataille politique s’est jouée contre le Copyright Term Extension Act aux États-Unis en 1998, puisque ce dernier a fait retourner dans le giron du droit d’auteur des œuvres entrées dans le domaine public, comme celles de George Gershwin, pour ne citer que lui…

Cet amendement vise à introduire dans le code de la propriété intellectuelle une définition du domaine public.
Cette définition est fort délicate à établir, compte tenu des antagonismes en présence et des différences d’interprétation juridique entre experts, comme je l’indiquais dans mon commentaire relatif à l’amendement n° 460 des mêmes auteurs. De fait, le Gouvernement, après avoir envisagé de traiter cette question dans le présent projet de loi, y a renoncé pour les raisons évoquées précédemment. La réflexion doit donc encore se poursuivre, plus sereinement, pour aboutir à une solution satisfaisante et acceptée par les parties en présence.
L’avis de la commission de la culture est par conséquent défavorable.
Il est également défavorable, pour les raisons évoquées par Mme la rapporteur pour avis.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 336 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 462 est présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 501 rectifié est présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-11. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d'une œuvre entrée dans le domaine public. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 336.

À ceux qui souhaiteraient se documenter davantage sur la définition du domaine public, je signale que notre collègue députée Isabelle Attard a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale une excellente proposition de loi, laquelle recense l’enjeu de débat qui a été précédemment posé.
Le présent amendement vise à permettre – nous sommes très libéraux ce matin ! – aux associations dont l’objet est de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs d’agir en justice contre tout obstacle à la libre réutilisation d’une œuvre entrée dans le domaine public.
Ces associations, de plus en plus nombreuses, sont importantes pour faire cesser un certain nombre d’atteintes au domaine public, tel qu’il a été défini antérieurement, et leurs actions permettraient de faire cesser un certain nombre d’abus manifestes.
Il nous semble que cet amendement représente une avancée et qu’il ne pose pas de difficulté juridique majeure. Des dispositions analogues ont d’ailleurs été adoptées en ces termes, avec des votes très répartis, à l’Assemblée nationale.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 501 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Je suis obligée de dire que cet amendement a été très bien défendu !
Sourires.

Ces amendements tendent à rétablir le texte de l’Assemblée nationale sur la possibilité d’action en justice des associations. Hélas, vous le savez, cette position est contraire à celle de la commission.
La disposition visée avait été supprimée par la commission, car elle est, en premier lieu, quelque peu superfétatoire au regard des règles jurisprudentielles de recevabilité des actions en justice des associations visant à défendre un intérêt collectif, règles qui exigent seulement un intérêt à agir, et non une qualité à agir.
En second lieu, dans un arrêt du 18 septembre 2008 de la chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci a considéré qu’était recevable toute action en justice d’une association se proposant de défendre un intérêt entrant dans son objet social, sans qu’une habilitation législative soit nécessaire.
À des fins d’intelligibilité de la loi, il ne semble donc pas utile de réinscrire des dispositions de principe dans tous les codes, des habilitations législatives pour toutes les associations, dans tous les domaines possibles, lorsque cet objectif est déjà satisfait par le droit existant.
Surtout, contrairement à l’intention de leurs auteurs, telle que j’ai pu la comprendre au travers de ces amendements, l’adoption de ceux-ci aurait pour conséquence de restreindre les possibilités d’action en justice des associations puisqu’elle instaurerait un critère de durée d’existence. C’est une bonne intention, mais il est préférable d’en rester au droit existant, beaucoup plus libéral pour ce qui concerne la recevabilité des actions en justice des associations.
Pour ces raisons, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Ce débat renvoie à celui qui est relatif au bien commun et à la définition d’un domaine public. Tant que ce premier sujet n’est pas totalement réglé et ne trouve pas une définition juridique précise qui soit intégrée dans la loi, on comprendra qu’il soit difficile de donner aux associations un pouvoir d’agir pour faire reconnaître un droit qui ne figure pas dans la loi.
Par cohérence avec l’ensemble de la position gouvernementale, j’émets un avis défavorable.

J’accepte de retirer mon amendement ; quant à mes collègues, ils feront ce qu’ils souhaitent.
Madame la secrétaire d’État, le sujet figurait dans la loi. Or, comme il était sulfureux et compliqué, on l’a retiré. Pour ma part, je souhaite que l’on avance.
Je ne plaiderai pas pour ma cause, car nous croulons ici sous le travail. Mais, sachant qu’Isabelle Attard travaille depuis de nombreuses années sur cette question à l’Assemblée nationale, j’aimerais qu’une mission pluraliste réunissant plusieurs sensibilités soit mise en place et que nous nous engagions à creuser le sujet ; sinon, nous ne progresserons jamais.
Vous me dites que le travail continue ; je l’entends. Je souhaite donc vraiment que des collègues soient missionnés pour y participer. Encore une fois, il faut avancer.
Je retire l’amendement.

Vous avez raison, madame la secrétaire d’État, il faut avancer et travailler sur le sujet.
L’amendement précédent ayant été retiré, par cohérence, je retire le nôtre.

L’amendement n° 462 est retiré.
Madame Laborde, l’amendement n° 501 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Les amendements précédents ayant été bien défendus, puis retirés, je suis dans l’obligation de suivre mes collègues en retirant le mien, ce que je fais avec plaisir.
Sourires.

Cela étant dit, je suis moi aussi d’accord pour que l’on continue le travail.

L'amendement n° 501 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 19 bis demeure supprimé.
(Non modifié)
L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d’accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
« 1° D’accéder, depuis un point d’accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l’intermédiaire du service d’accès auquel il a souscrit ;
« 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »
L'article 20 est adopté.
(Supprimé)
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l’article L. 32-5. » ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, pour l’exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :
« 1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;
« 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;
« 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires ;
« 4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou de ses établissements publics.
« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire. Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.
« III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 32-5.
« Lorsque ces visites n’ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues au même article.
« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d’opposition prévu au présent article ou lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies audit article L. 32-5.
« IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces mêmes personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques. » ;
2° L’article L. 32-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les visites mentionnées au III de l’article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l’avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;
– le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. »

Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle. De portée technique, il est essentiel afin de préserver la cohérence des dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Il nous est apparu que la référence au code de procédure pénale n’était pas adaptée. Il faut rappeler que les enquêtes menées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, en application de l’article L. 32-4 dudit code modifié par l’article 20 bis de ce projet de loi, sont des enquêtes administratives. Les enquêtes ayant pour objet la recherche d’infractions pénales relèvent, quant à elles, d’une autre disposition, l’article L. 40 du code des postes et des communications électroniques.
Il est important de supprimer cette référence au code de procédure pénale, afin de clarifier le droit.

Cet amendement de suppression d’une précision liée à la transposition du droit européen est contraire à la position adoptée par la commission.
Cette précision avait en effet été ajoutée conformément à la directive du Parlement et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, transposée partiellement dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale relatives aux droits du suspect lors d’une audition ne sont pas, en l’état, applicables aux enquêtes diligentées par les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, et qui exercent ceux-ci dans les conditions et les limites fixées par ces lois relevant des dispositions de l’article 28 du code de procédure pénale.
Néanmoins, s’agissant de pouvoirs de police judiciaire, ces polices dites « spéciales » entrent dans le champ d’application de la directive susmentionnée, qui concerne tout suspect, c’est-à-dire toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dont l’appréciation doit se faire in concreto.
Il paraît, par conséquent, nécessaire de compléter la transposition de cette directive dans notre droit interne par des dispositions applicables aux polices spéciales, afin que celles-ci respectent les garanties prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale lorsqu’elles procèdent à des auditions de personnes effectivement suspectées, les procès-verbaux établis étant alors susceptibles de fonder des poursuites.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement du Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements n° 326 et 325, présentés par M. Navarro, ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 635, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 40, les mots : « visées à l’article L. 32-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 32-4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement salue ce nouvel effort de clarification et émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 20 bis est adopté.
(Non modifié)
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle ».

L’amendement n° 189, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, n’est pas soutenu.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.

Je reprends cet amendement, madame la présidente. Il s’agit d’un amendement très important, auquel je tiens tout particulièrement. S’il avait été soutenu par Mme Bouchoux, j’aurais d’ailleurs émis un avis de sagesse très favorable.
Cet amendement vise à introduire la parité au sein de la Commission supérieure du service des postes et des communications électroniques, la CSSPPCE.
Le principe de parité s’applique aux membres des principales autorités administratives et autorités publiques indépendantes, depuis l’ordonnance du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
L’article 20 quinquies du projet de lois’étend expressément à l’ARCEP, mais la CSSPPCE n’était pas soumise à ce principe. Cet amendement vise à le prévoir expressément.
La commission des affaires économiques ne peut qu’être favorable à ce type d’amendement.

Mon cher collègue, en vertu du règlement, seule la commission saisie au fond peut reprendre un amendement non soutenu…

Je fais miens les propos de M. Sido et je reprends cet amendement, au nom de la commission, madame la présidente.

Je suis donc saisie d’un amendement n° 669, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Je vous trouve très sages, messieurs les rapporteurs !
Vous comprendrez que, s’agissant d’une question qui relève de l’organisation interne du Parlement, je m’efface et m’en remette à la sagesse du Sénat. Je ne peux cependant m’empêcher de vous donner mon point de vue personnel sur ce sujet de la parité entre les femmes et les hommes dans le secteur des télécommunications et du numérique.
Je constate que la commission en cause ne compte, sur quatorze parlementaires, que deux femmes, en dépit de la bonne volonté affichée par son président, le député Jean Launay. Il y a donc du travail !
L'amendement est adopté.
L'article 20 ter est adopté.
(Supprimé)

L’amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Sido, Chaize et P. Leroy, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2, au II de l’article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33-2, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 34, au dernier alinéa de l’article L. 35-1, à l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l’article L. 44, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
II. – Aux premier et dernier alinéas du II, à la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du IV de l’article 6 et au dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».
La parole est à M. Bruno Sido.

La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques s’est redynamisée au cours de ces deux dernières années. Les travaux réguliers ont permis d’avoir une meilleure connaissance du secteur.
Telle qu’instaurée par le législateur, cette commission a retrouvé sa place de partie prenante de référence, en rééquilibrage de l’action de l’État, des délégations accordées à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, des entreprises et associations du secteur.
L'originalité de sa création, sa permanence dans le temps, la qualité de ses travaux réguliers et son poids sur le secteur en font le lieu idéal d’échanges, à l’heure où les problématiques numériques sont éparses dans la société. Par « postes », il faut entendre les activités du groupe La Poste, mais également toutes les formes de distribution de proximité dans le domaine du commerce électronique, qui consacre ainsi l’intermédiation sociale et humaine dans les territoires.

Cet amendement a pour objet de modifier le nom de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, afin de l’adapter aux nouveaux enjeux du numérique, et surtout à ceux auxquels doit faire face notre société dans les domaines des communications électroniques et du numérique.
La CSSPPCE deviendrait ainsi la « Commission supérieure du numérique et des postes ».
La commission émet un avis favorable.
Ce sujet relevant de l’organisation interne du Parlement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Je souhaite témoigner du travail qui se fait au sein de cette commission et dire toute l’importance de la modification de son nom en termes de communication.
Il s’agit de l’un des rares lieux où les parlementaires des deux chambres peuvent se réunir pour parler d’un sujet d’importance, qui nous rassemble aujourd’hui, et où ils peuvent améliorer les textes de façon très pertinente.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres de l’autorité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. » ;
3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. » –
Adopté.
(Supprimé)
Après l’article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-4. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux services de l’État, définis par le Premier ministre, lorsqu’ils sont informés de l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données, par une personne agissant de bonne foi et en l’absence de publicité de l’information. »

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 464, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre ou commis le délit prévu au présent article est exempte de poursuites si elle a immédiatement averti l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d’un risque d’atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »
La parole est à M. Patrick Abate.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à protéger « les lanceurs d’alerte de sécurité », et ce en exemptant de peine « toute personne » qui, à travers un accès non autorisé – cela constitue un délit –, découvre une faille et en alerte immédiatement « l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause ».
En revanche, les amendements tendant à exempter de poursuites ces personnes ont été rejetés.
Des poursuites donc, mais sans peine… Cela nous paraît insuffisant.
Les lanceurs d’alerte, lorsqu’ils veillent à avertir les responsables de traitement des failles dans leurs systèmes doivent être exemptés de toute poursuite, sachant que le plus difficile et le plus long à endurer, ce sont les poursuites.
Nous souhaiterions aboutir à un statut général des lanceurs d’alerte, pour éviter notamment des procès scandaleux, comme le procès LuxLeaks, en cours au tribunal correctionnel de Luxembourg. Ces trois Français, dont un journaliste, accusés d’avoir fait fuiter des milliers de pages éclairant les pratiques fiscales de grandes multinationales établies au Grand-Duché, ont agi dans l’intérêt général en permettant de révéler au grand jour l’opacité qui empêchait les pays européens de connaître la situation fiscale exacte d’un certain nombre de grandes entreprises.
Ce projet de loi, on en conviendra, n’est sans doute pas le bon outil législatif pour définir les contours d’un tel statut, mais il pourrait contribuer à l’amélioration de la protection des lanceurs d’alerte en les exemptant de toute poursuite administrative ou judiciaire.

L’amendement n° 541 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre ou a commis le délit prévu au présent article est exempte de peine si elle a immédiatement averti l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d’un risque d’atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.

Il nous semble important, surtout à l’heure actuelle, de protéger les lanceurs d’alerte. Cet amendement peut paraître quelque peu cavalier, mais il vise à interpeller le Gouvernement sur ce sujet.
Nous ne pouvons pas balayer cette question d’un revers de la main. Je n’en dirai pas plus, M. Abate ayant été très clair.

Ces amendements ont pour objet de rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Je souhaite, au préalable, écarter tout doute sur les intentions de la commission des lois et surtout prévenir toute confusion, que l’actualité immédiate pourrait introduire dans nos débats, sur l’article 20 septies.
L’objet de cet article est de protéger non pas des lanceurs d’alerte, mais des « hackers blancs », c’est-à-dire des informaticiens. C’est bien là tout l’enjeu des dispositifs qui vous sont soumis, mes chers collègues, l’un au travers de ces deux amendements, l’autre via les deux qui suivront.
Ces deux dispositifs sont diamétralement opposés, de même que les philosophies qui y prévalent.
J’en viens à l’avis de la commission des lois sur les amendements n° 464 et 541 rectifié.
La commission a supprimé la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, laquelle, sous prétexte de protéger certaines personnes qui, de bonne foi, signalent des failles de sécurité, est une véritable incitation au délit, voire au crime.
Selon ce dispositif, toute personne qui accéderait frauduleusement et intentionnellement à un système de traitement automatisé de données, un STAD, afin de supprimer des données ou d’alerter sur son fonctionnement, par exemple, devrait être exemptée de peine, dès lors qu’elle aurait contacté après son forfait le responsable du traitement en cause. Une telle immunité ne peut qu’encourager le développement des attaques informatiques, puisqu’il suffirait d’un courriel pour échapper à toute peine.
De plus, cette rédaction tend à exonérer également ceux qui tentent d’accéder frauduleusement à un STAD. Or la tentative n’est constituée que « lorsqu’elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
En somme, cela offrirait une immunité même à ceux qui attaquent sans succès un STAD, du fait d’une sécurité convenable, et donc de l’absence de faille informatique, ou de leur arrestation, notamment par les forces de sécurité avant l’accomplissement de leur action.
Je tiens à souligner que, contrairement à ce qui a pu être dit à l’Assemblée nationale, le signalement d’une faille informatique au responsable dudit traitement n’est pas pénalement répréhensible lorsque la vulnérabilité était apparente à tout internaute.
En revanche, la publication en ligne desdites failles est, quant à elle, répréhensible quand elle vise à faciliter d’autres attaques. L’article 323-3-1 du code pénal réprime en effet le fait, sans motif légitime, de « mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptée afin de permettre une atteinte à un système de traitement informatisé des données ».
Si informer le responsable du traitement de l’existence d’une vulnérabilité relève d’un objectif d’intérêt général, il en va autrement de la mise à disposition auprès de tiers d’une information facilitant la commission d’infractions.
Je suis donc très défavorable à ces amendements.
Je considère néanmoins qu’il est essentiel de favoriser le signalement des failles de sécurité. C’est pour cela que la commission des lois a adopté un dispositif de guichet auprès de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI, notamment pour qu’elle ne soit pas tenue de dénoncer des faits illégaux dont elle pourrait avoir connaissance lorsque la personne est de bonne foi et qu’elle n’a pas fait de publicité autour de la faille.
Je propose même d’améliorer encore le dispositif. Ce sera l’objet de mon amendement n° 636.
Dans ces conditions, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements. À défaut, l’avis de la commission sera, je le répète, très défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Ceux que nous examinerons ensuite semblent proposer, en revanche, une piste plus adéquate.
Je rappelle, tout d’abord, que le sujet des hackers blancs, appelés également « pirates blancs » ou « white hats » – par opposition aux chapeaux noirs – a été introduit dans ce débat par la voie d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale. C’est heureux parce que je ne l’avais pas initialement pris en considération, alors qu’il pose une véritable question de droit.
En effet, certaines personnes jouent un rôle absolument primordial dans la détection des failles de sécurité. Or elles ne travaillent pas forcément au sein des organisations et structures concernées. Très souvent, elles sont à l’extérieur : ce sont des développeurs, des informaticiens qui font partie d’une communauté de veille. Ces personnes prennent des risques pour détecter des failles de sécurité, car, en l’absence de protection, elles peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires.
Aujourd’hui, sécuriser les informations, les données personnelles et les infrastructures est un enjeu absolument vital. Le Premier ministre et moi-même avions d’ailleurs lancé au mois de décembre dernier une stratégie nationale pour la sécurité du numérique. Cette démarche d’amélioration constante de la sécurité informatique est au cœur de nos actions. Avec l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, et avec cette nouvelle catégorie juridique que forment les opérateurs d’importance vitale, les OIV, nous avons engagé un travail de fond pour améliorer la sécurité de nos installations.
Un épisode comme celui qu’a vécu TV5 Monde doit tous nous alerter sur les enjeux de la cybersécurité pour nos organisations. En lien avec la CNIL, et grâce à ce projet de loi, nous encourageons ces démarches de sécurité.
C’est dans cet esprit que j’ai lancé un appel à projets visant à promouvoir les technologies qui permettent la meilleure protection des données personnelles. Cet appel à projets a recueilli vingt-sept propositions en matière de recherche et développement qui sont très abouties.
L’objectif du Gouvernement, vous l’aurez compris, c’est d’encourager et de protéger une communauté qui est compétente pour signaler les vulnérabilités. Pour autant, faut-il d’emblée proposer un régime d’exemption pénale ? À notre sens, la réponse est négative, parce que cela serait trop dangereux. Il pourrait effectivement y avoir une forme d’effet d’aubaine bénéficiant à des personnes authentiquement malveillantes, qui pourraient se réfugier derrière le droit pénal pour commettre des actes délictueux.
J’ai d’ailleurs regardé de très près les choix opérés par les Pays-Bas, qui sont très en avance, de manière générale, s’agissant du cadre juridique en matière de numérique : ce n’est pas la voie qu’ils ont choisie.
À ce stade, le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements, mais nous allons poursuivre cette discussion avec l’examen des amendements suivants.

Je me réjouis de l’intérêt désormais porté à ces personnes. Mme la secrétaire d'État a rappelé la situation. Heureusement, une prise de conscience s’est faite, mais du côté des actes et de l’adoption d’un droit vraiment protecteur, c'est encore le grand vide !
J’ai entendu les arguments avancés. Monsieur le rapporteur, vous dites que c'est de l’incitation au crime. On peut effectivement le voir ainsi. Mme la secrétaire d'État a été plus réservée, en évoquant un « effet d’aubaine ».
Je ne suis pas convaincu par ces arguments. À partir du moment où le hacker blanc prévient l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou le responsable du système, même s’il le fait seulement, comme le disait M. le rapporteur, pour s’exonérer, il ne peut plus être dans une démarche délictueuse. Il n’a même pas pu l’être en amont. Selon nous, le fait de prévenir pour s’exonérer l’empêche d’être malveillant.
C'est la raison pour laquelle, même si nous comprenons certains arguments qui nous ont été opposés, nous maintenons notre amendement.

Pour une fois, mon avis sera différent. J’ai bien entendu les arguments. Je n’avais pas bien fait la différence entre hackers blancs, chapeaux blancs et lanceurs d’alerte. Il est vrai que se pose aussi un problème d’immunité. Mais l’expression « incitation au crime » était peut-être un peu forte…
On touche du doigt ici l’enjeu de la cybersécurité, qui soulève des problèmes juridiques spécifiques. Puisque l’on m’a promis que les amendements suivants étaient davantage à la hauteur de la situation, je retire mon amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 232, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2321 -4. – Toute information se rapportant à un risque ou une menace d’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement ou aux données d’un système d’information peut être transmise à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
« Sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale, l’autorité préserve la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« L’autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéaaux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
La parole est à M. Yves Rome.

L’alerte éthique a été récemment introduite dans notre droit et figure désormais dans plusieurs dispositions législatives. Par ailleurs, des projets de directives européennes comprenant des dispositions sur cette question sont en discussion.
Toutes ces mesures ont pour point commun de régir la situation d’une personne qui pense avoir découvert des éléments graves et les porte à la connaissance d’autrui. Ces dispositions ont pour objet de protéger les intéressés s’ils ont agi de bonne foi.
C’est exactement le cas des personnes dénommées les « hackers blancs ». Il s’agit de spécialistes en sécurité informatique qui parviennent à s’introduire dans les failles existantes des systèmes d’informations d’une organisation, non pour se servir des données piratées à des fins mal intentionnées, mais pour avertir le responsable du traitement de leur découverte.
Cette action animée par la bonne foi doit être appréciée à sa juste mesure et mieux encadrée, car la préservation des membres de la communauté informatique qui entreprennent des démarches d’alerte vertueuses permettra d’améliorer le niveau global de sécurisation des systèmes d’information à l’échelle nationale.
Nous convenons que la rédaction retenue par l’Assemblée nationale n’était pas satisfaisante, mais la solution retenue par la commission des lois qui introduit une exception à l’article 40 du code de procédure pénale et supprime l’exemption ne nous paraît pas opportune.
Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons garantir aux lanceurs d’alerte la confidentialité de leur identité s’ils transmettent à l’ANSSI des informations sur des failles de sécurité qu’ils n’ont pas obtenues frauduleusement. L’Agence pourra alors vérifier ces informations et, lorsque leur véracité est avérée, avertir le propriétaire du système d’information.

L'amendement n° 636, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« Les services peuvent procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéaaux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
La parole est à M. le rapporteur pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 232.

Comme je l’annonçais précédemment, l’amendement que je présente, au nom de la commission des lois, vise à compléter le dispositif proposé par celle-ci à l'article L. 2321-4 du code de la défense, en permettant à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, service de l'État désigné par le Premier ministre, de préserver vis-à-vis des tiers la confidentialité de l'identité de la personne leur ayant transmis une information concernant une vulnérabilité – le hacker blanc –, mais également à donner un fondement légal aux opérations techniques réalisées par l'ANSSI.
Il s’agit d’encadrer de manière solide et pérenne le dispositif, afin de supprimer la faille législative, juridique et – à mon sens, la plus dangereuse – philosophique qui subsiste dans la rédaction du texte tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale. Cette faille constitue vraiment une porte ouverte, et même un encouragement, à la commission de délits, voire davantage.
Je ne serai pas plus long sur la présentation de cet amendement. Nous avons repris deux alinéas qui permettent, je le répète, de préserver la confidentialité, ce qui est essentiel pour garantir la sécurité des hackers blancs, et surtout de donner un fondement légal aux opérations de l’ANSSI.
J’en viens à l’avis de la commission sur l’amendement présenté par M. Rome.
Cet amendement est intéressant, mais vous comprendrez que, comme rapporteur, je préfère celui de la commission ! Celui-ci reprend l’idée retenue par la commission des lois dans le texte qui nous est soumis de remplacer une exemption dans le code pénal par un dispositif propre à l’ANSSI lui permettant d’agir en tant que guichet de signalement des vulnérabilités.
Néanmoins, je m’interroge sur la normativité du premier alinéa. Faut-il préciser qu’un tiers peut transmettre une information à l’ANSSI ? Par principe, tout le monde peut envoyer un mail à cette agence.
Monsieur Rome, tout comme le mien, votre amendement vise à préserver la confidentialité de l’identité de la personne signalant la faille vis-à-vis des tiers et à donner un fondement légal aux opérations techniques réalisées par l’ANSSI. Nous nous rejoignons sur ces points, sur lesquels nous avons bien une démarche commune.
Cependant, à la différence de l’amendement que je propose au nom de la commission des lois, le vôtre ne tend à créer aucune dérogation à l’article 40 du code de procédure pénale : il maintient donc l’obligation qui pèse sur l’ANSSI de dénoncer à l’autorité judiciaire les faits illégaux dont elle aurait connaissance. Il n’est par conséquent pas de nature à encourager les personnes de bonne foi à signaler les failles à l’ANSSI.
Il me semble que mon amendement dessine une voie médiane et plus mesurée – pour une fois on ne pourra pas me reprocher le contraire !
Je vous demande donc de retirer votre amendement au profit de celui de la commission des lois.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 232. La rédaction actuelle de l’article 20 septies du présent projet de loi prévoit de déroger aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale. Il exonère l’ANSSI de son obligation d’aviser le procureur de la République lorsqu’un crime ou un délit est porté à sa connaissance par une personne agissant de bonne foi pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information.
Pour dire les choses plus clairement, nous parlons de l’article 40 du code de procédure pénale qui oblige les agents publics, les personnes qui travaillent pour des administrations, à saisir le procureur de la République lorsque sont constatés des crimes ou des délits.
En l’occurrence, ce qui est proposé par le biais de cet amendement, c'est de créer un système de recours à l’ANSSI pour permettre un filtrage des signalements de faille informatique par des hackers blancs, au lieu d’un signalement à la justice qui pourrait les mettre en situation de fragilité.
Pourquoi recourir à l’ANSSI ? D’abord, parce qu’une telle disposition permet de protéger la confidentialité, l’anonymat des personnes qui se tournent vers cette agence.
L’ANSSI est composée des meilleurs informaticiens de notre pays, lesquels sont susceptibles d’un point de vue technique, du fait de leur expertise, de comprendre plus rapidement que ne pourrait certainement le faire le système judiciaire si la détection de la faille avait une intention malveillante ou s’il s’agit d’un signalement sincère et non frauduleux. Il me semble donc logique de soutenir cette proposition de recourir à l’ANSSI.
Monsieur le rapporteur, le raisonnement du Gouvernement diverge sur un point de celui de la commission des lois. Je salue toutefois votre ouverture sur ce sujet et votre volonté de comprendre la problématique – votre proposition est d’ailleurs très constructive. En effet, avec votre amendement, vous créez une exception générale à l’article 40 du code de procédure pénale qui n’a jamais connu de brèche. Vous « sortez » de cet article pour créer un couloir indépendant en lien avec l’ANSSI.
Selon nous, il est préférable que les agents qui travaillent à l’ANSSI aient encore, lorsqu’ils détectent une attention réellement malveillante, l’obligation de saisir le procureur de la République pour en informer la justice.
Le mécanisme qui protège l’anonymat et permet la détection des failles, tout en assurant une bonne articulation avec le système pénal lorsque l’intention est véritablement malveillante, et donc préjudiciable pour la sécurité des systèmes d’information, me paraît plus cohérent.
C'est la raison pour laquelle je soutiens l’amendement n° 232 et demande le retrait de l’amendement de la commission des lois au profit de celui-ci.

Comme pour les deux amendements précédents, nous sommes face à deux approches de la philosophie du droit.
Je ne vais pas faire durer le suspense : je ne retirerai pas l’amendement n° 636, car c'est la protection des hackers blancs qui est vraiment en jeu ici. L’amendement du groupe socialiste tend à imposer à l’ANSSI l’obligation de dénoncer à l’autorité judiciaire. Aux termes de mon amendement, elle peut le faire, mais elle n’y est pas obligée. C’est toute la différence et c'est pour moi un point essentiel.
L’amendement que je propose assure une protection plus forte des hackers blancs : c’est l’ANSSI qui seule peut déterminer si le hacker est ou non de bonne foi ; dans ce dernier cas, il doit alors être dénoncé à l’autorité judiciaire. C’est vraiment là tout l’enjeu. C’est à l’ANSSI de jouer ce rôle, alors que dans le dispositif proposé par le groupe socialiste, l’obligation est systématiquement prévue : le juge est le seul à apprécier si le hacker est blanc, gris ou d’une autre couleur.
Sourires.


Je me réjouis de ce débat. Les deux rédactions sont intéressantes, mais je soutiendrai bien sûr l’amendement qui a été défendu par Yves Rome.
Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur, car je ne crois pas que ce soit exact.
L’expression « sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale », utilisée dans notre amendement pour rédiger le deuxième alinéa de l’article L. 2321-4 du code de la défense, signifie que nous refusons de poser une exception à cet article. Les lanceurs d’alerte, ceux qui vont saisir l’ANSSI, peuvent et, dans certains cas, doivent saisir le procureur de la République. L’ANSSI aura, quant à elle, la possibilité – elle considérera même peut-être que c'est son devoir – d’appliquer l’article 40 précité.
Ce débat qui nous oppose soulève une question de philosophie du droit. Dans notre système juridique, certains articles et certaines lois sont emblématiques. Ainsi en est-il de l’article 40 du code de procédure pénale qui n’a jamais été restreint par aucun article de loi. Il a une portée extrêmement générale. Nous le citons dans notre amendement, ce que vous ne faites pas.
Ce que nous proposons vaut « sans préjudice de l’article 40 ». Nous estimons qu’il est important de préserver cet article.
Par ailleurs, il faut donner le moyen à des lanceurs d’alerte – je préfère utiliser cette expression française – de saisir l’ANSSI, ce qui ne ferme en aucun cas la possibilité pour eux de saisir le procureur de la République, pas plus que cela n’empêche l’ANSSI de le faire.

Pour répondre à M. Sueur – je m’adresse là à mon ancien président de commission, de qui j’ai beaucoup appris en tant que jeune sénateur –, quand on dit « sans préjudice », cela signifie bien que c’est une obligation, et non une dérogation.
Je ne suis pas d’accord avec vous : « sans préjudice de l’article 40 » veut dire qu’il y a une obligation de dénoncer à l’autorité judiciaire.

Ce n’est pas un choix ! On doit forcément transmettre le nom du hacker blanc à l’autorité judiciaire.
Quant aux dérogations à l’article 40, il en existe déjà : je vous citerai celle des médecins lorsqu’ils ont connaissance de cas de maltraitance.

Je mets aux voix l'amendement n° 232.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 202 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 636.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 203 :
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix l'article 20 septies, modifié.
L'article 20 septies est adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures, pour les questions d’actualité au Gouvernement.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.