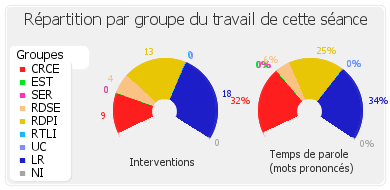Séance en hémicycle du 9 novembre 2010 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.

La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 6.
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
I. – L’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires restitue aux régimes obligatoires d’assurance maladie, avant le 31 décembre 2010, une fraction des dotations qui lui ont été attribuées au titre des exercices 2007 à 2009 égale à 331 630 491 €. Ce montant est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
II. – L’article 60 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Au II, le montant : « 264 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 159 millions d’euros » ;
2° Au IV, le montant : « 44 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 170 millions d’euros ».

L’article 6 porte sur les dotations à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS, et au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, le FMESPP. Les dispositions ici présentes mettent une nouvelle fois en évidence la tendance à utiliser comme variable d’ajustement les besoins de financement réels ou éventuels des établissements de santé en fonction des contraintes budgétaires.
Je ne reviendrai pas sur le rôle du Gouvernement dans la gestion de la grippe H1N1 ; j’ai dit ce que j’en pensais lors de mon intervention sur l’article 4. Madame la ministre, puisque vous n’étiez pas présente à ce moment-là, je vous invite à prendre connaissance de mes propos auprès de votre collègue.
En revanche, je voudrais insister sur le cas du FMESPP. Ce fonds, créé en 2001, est chargé de contribuer au financement des opérations d’investissements nécessaires à la restructuration hospitalière et à l’accompagnement social. Il est proposé, dans cet article, d’annuler 105 millions de crédits non consommés considérés comme déchus.
Lorsque l’on connaît les besoins de restructuration des hôpitaux et cliniques, on ne peut que s’étonner de la non-consommation des crédits. Je connais, sans doute comme chacun d’entre vous, des établissements de santé qui ont demandé des aides à la rénovation. Comment comprendre les refus ou les aides limitées lorsque l’on constate que des crédits votés ne sont pas consommés ?
À cet égard, j’aimerais étayer mon propos d’un exemple qui illustre l’absurdité de la situation actuelle : il s’agit du motif qu’a invoqué le tribunal correctionnel de Bergerac pour relaxer, en octobre dernier, l’ancien directeur de l’hôpital de Sarlat, en Dordogne.
Ce dernier était poursuivi pour le décès, en 2002, d’une septuagénaire victime d’une légionellose contractée dans son établissement. En juin, le procureur de la République avait réclamé dix-huit mois de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende à son encontre. Le problème est que, à sa nomination, trois ans plus tôt, en 1999, le directeur en question avait hérité d’un hôpital vétuste par bien des aspects.
À sa demande de crédits pour améliorer les conditions sanitaires de son établissement, l’administration hospitalière lui avait rétorqué que les sommes sollicitées à des fins d’investissements ne pouvaient lui être octroyées en raison des économies à réaliser sur les budgets à venir. On marche sur la tête !
Cette requête écrite fut d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ce directeur fut disculpé de l’accusation de négligence. C’est une illustration, parmi d’autres, des épées de Damoclès menaçant les dirigeants hospitaliers, qui doivent désormais jongler entre sécurité sanitaire et responsabilité comptable. Quand on sait à quel point les établissements ont besoin d’argent pour se moderniser, on peut s’étonner que la somme prévue, dans cet article, à cet effet dans le budget concerné n’ait pas été utilisée en fin d’année.

Cet article 6, qui vise à réduire de 105 millions d’euros les dotations accordées en 2010 au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, nous interroge.
En effet, ce n’est pas la première fois que, à l’occasion de l’examen d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement propose de réduire de manière importante les dotations attribuées au FMESPP.
Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait ainsi procédé à l’annulation de 100 millions d’euros des crédits destinés au FMESPP pour 2008.
L’exposé des motifs de l’article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 justifiait déjà ce gel par « le décalage croissant entre les montants engagés annuellement par les agences régionales de l’hospitalisation au titre du FMESPP et les montants effectivement décaissés par le gestionnaire du fonds ».
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait fixé la dotation du FMESPP pour 2009 à 190 millions d’euros, soit une nette diminution par rapport aux dotations précédentes – 301 millions d’euros en 2008 –, et ce n’est pas l’augmentation de 74 millions d’euros consentie par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui permet d’équilibrer la situation par rapport à 2008.
Or, avec cet article, on découvre que, les crédits n’ayant pas été utilisés ou réclamés par les établissements, on reviendrait sur la hausse de 2010, à laquelle il faudrait ajouter plus de 25 millions d’euros.
C’est à croire que, en matière de modernisation des établissements publics et privés de santé, le Gouvernement navigue à vue et ne dispose d’aucune remontée de la part des anciennes agences régionales de l’hospitalisation, devenues, depuis l’adoption de la loi HPST, les agences régionales de santé.
Pourtant, dans nos villes, dans nos départements et dans nos régions, nous sommes tous témoins du besoin de modernisation des structures hospitalières. Les besoins sont importants ; ils le sont d’autant plus que, avec l’adoption de la loi HPST, des fusions d’établissements sont prévues, ce qui engendrera des transferts ou des transformations de services, lesquels ne sont pas sans incidences sur les structures et impliquent souvent des travaux importants.
De la même manière, les personnels que j’ai personnellement rencontrés nous ont fait part de leurs difficultés à travailler avec du matériel quelquefois insuffisant et dans des bâtiments parfois vétustes et souvent peu adaptés aux nouvelles pratiques et aux nouveaux outils dont sont équipés les établissements.
Au groupe CRC-SPG, nous avons l’impression que les besoins existent et que, notamment par manque d’information, les établissements ne peuvent en disposer. Nous nous interrogeons donc sur la manière dont les agences régionales de santé communiquent avec les établissements sur les disponibilités de ce fonds et sur la manière avec laquelle elles répondent aux différentes sollicitations.
Cette déchéance, qui nous apparaît prématurée, pourrait avoir pour effet de ralentir les projets en cours ou à venir.
C’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cet article.

Comme vient de le dire mon collègue Françoise Autain, le groupe CRC-SPG s’abstient.
L'article 6 est adopté.
I. – Au titre de l’année 2010, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
En milliards d’euros
Objectifs de dépenses
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)
II. – Au titre de l’année 2010, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :
En milliards d’euros
Objectifs de dépenses
Maladie
Vieillesse
Famille
Accidents du travail et maladies professionnelles
Toutes branches (hors transferts entre branches)

Cet article fixe les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses par branche pour l’année 2010.
Madame la ministre, nous aurions pu vous complimenter sur la baisse des dépenses de l’ensemble des régimes de base et du régime général pour 2010 par rapport aux prévisions initiales. En effet, toutes les branches affichent une baisse de leurs dépenses : 1, 1 milliard d’euros pour la branche maladie, 500 millions d’euros pour la branche vieillesse, 800 millions d’euros pour la branche famille et 100 millions d’euros pour la branche accidents du travail-maladies professionnelles.
Cela étant, nous ne vous ferons pas ce compliment, et ce pour deux raisons.
Premièrement, cette décroissance s’est faite sur le dos des retraités, qui ont vu leurs pensions minorées. En effet, les pensions étant indexées sur l’inflation et non plus sur les salaires, la retraite de base n’a augmenté que de 0, 9 % au 1er avril : faible inflation, modeste revalorisation ! Entre 2009 et 2010, alors que l’inflation a été évaluée à 1, 7 %, les retraites servies par les caisses régionales d’assurance maladie ont augmenté de 0, 9 %, tandis que celles des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC se sont accrues respectivement de 0, 73 % et de 0, 71 %.
Par exemple, du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, l’ensemble des trois retraites précitées ont augmenté de 0, 78 %, soit 220, 68 euros net. Sur la feuille d’impôt, un retraité moyen reçoit 288 euros de plus que l’année précédente, mais le Trésor public prélève 4 % de plus. Dans cet exemple, la personne a reçu un cadeau de 1, 25 % et on lui a prélevé 4 % !
On peut aussi souligner la diminution des dépenses au titre des retraites anticipées pour longue carrière. Le coût de ce dispositif, qui avait augmenté chaque année de 2004 à 2008, connaît une réduction drastique : de 2, 4 milliards d’euros en 2008, il est passé à 2, 1 milliards d’euros en 2009, puis à 1, 5 milliard d’euros en 2010. C’est à croire que les retraites pour longues carrières ont disparu !
Dans ces conditions, on comprend aisément pourquoi les dépenses de pensions ont été très inférieures aux prévisions, d’autant que le montant des revalorisations d’avril 2009 avait été inférieur aux anticipations : les dépenses de pensions ont représenté 43, 5 milliards d’euros, au lieu des 45, 7 milliards d’euros budgétés. Pour 2010, un budget de 46, 7 milliards d’euros avait été voté.
Deuxièmement, les patients sont les autres victimes de cette politique de gribouille. En raison des déremboursements croissants et des franchises sur les médicaments, des forfaits sur les actes médicaux et de l’explosion des dépassements d’honoraires, les Français doivent payer eux-mêmes chaque jour davantage pour les soins courants, c’est-à-dire ceux auxquels ils peuvent prétendre à l’occasion d’une maladie certes bénigne, mais qui n’en reste pas moins une affection.
À cet égard, madame la ministre, je vous remercie de la documentation que vous m’avez fait parvenir sur les honoraires médicaux, mais celle-ci ne répond pas tout à fait à mon attente. En effet, j’avais évoqué, lors de mon intervention au cours de la discussion générale, l’évolution, entre 1990 et aujourd’hui, des honoraires perçus annuellement par les médecins spécialistes et les médecins généralistes, et ce à partir des revenus fiscaux de référence, lesquels permettent d’avoir une connaissance assez fine des ressources de chacun. Et l’on peut constater que, en raison de la généralisation des dépassements d’honoraires, les médecins spécialistes ont des revenus désormais supérieurs de 60 % à ceux de leurs confrères généralistes, contre 10 % en 1990.
Il est vrai, cependant, ainsi que l’indique le document que vous m’avez fait parvenir, qu’il convient d’établir une distinction entre les spécialistes.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, opine.

Tandis que certains généralistes parisiens touchent d’importants revenus, d’autres, par exemple dans mon département, pratiquent le tarif de responsabilité, à savoir 22 euros, peut-être bientôt 23 euros, ce qui ne leur procure pas les mêmes revenus.
Et puis il y a les spécialistes, anesthésistes ou radiologues, que vous aimez beaucoup, me semble-t-il, …

… et les laboratoires, que vous allez taxer, à leur grand mécontentement.
Bref, il existe de grandes différences entre les uns et les autres.
Je crois cependant qu’il faut aujourd’hui diriger nos efforts vers la médecine spécialisée, dont les honoraires sont parfois difficiles à assumer par les patients. C’est en particulier le cas de la chirurgie – n’est-ce pas, monsieur Barbier ? §– et d’autres spécialités que je ne mentionnerai pas, ne voulant stigmatiser personne. Quoi qu’il en soit, je crois qu’il y a là un travail extrêmement important à mener.
Je voudrais conclure mon propos en disant que le rétablissement minime des comptes sociaux, que le Gouvernement estime à 1, 1 milliard d’euros pour cette année, ne correspond qu’aux prélèvements complémentaires, lesquels ont selon nous été effectués au détriment des assurés sociaux.
Le Gouvernement va non seulement faire travailler les Français plus longtemps en amputant le niveau des pensions, mais également renchérir, comme nous l’avons déjà signalé à M. Baroin, l’accès aux soins.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la lecture de l’article 7, on pourrait croire un temps – mais, je vous rassure, un temps seulement – que les politiques menées par le Gouvernement en matière d’efficience et de maîtrise médicalisée des dépenses portent leurs fruits, puisque ce dernier rectifie à la baisse les objectifs de dépenses de l’ensemble des branches du régime général pour l’année 2010.
Ainsi, ce sont 700 millions d’euros qui devraient être économisés sur les branches maladie et famille, 600 millions d’euros sur la branche vieillesse et 200 millions d’euros sur la branche accidents du travail-maladies professionnelles, ou AT-MP.
Mais, en réalité, ces économies, en tout cas cette réduction des dépenses, apparemment heureuse pour les comptes sociaux, se fait au prix d’un transfert financier lourd de conséquences vers les assurés eux-mêmes, que nous ne pouvons que dénoncer, surtout quand on sait qu’il frappe les plus modestes, lesquels sont d’ailleurs ceux qui renoncent, faute de ressources, à se doter d’une mutuelle complémentaire ou même à se soigner.
En effet, la protection sociale joue un rôle de moins en moins important, et nos concitoyens se retrouvent de plus en plus seuls face à leurs difficultés, en l’occurrence de santé.
À titre d’exemple, les économies réalisées par la branche maladie l’ont clairement été sur le compte des assurés sociaux, qui sont de plus en plus nombreux à retarder les soins ou à y renoncer. Selon un sondage Viavoice publié le 12 octobre, 36 % de nos concitoyens ont, ces dernières années, renoncé à des soins ou décidé de les reporter. La moitié d’entre eux ont entre 25 et 34 ans, ce qui s’explique évidemment par le coût desdits soins.
Autrement dit, les mesures adoptées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, en particulier la hausse de 16 à 18 euros du forfait hospitalier, la sortie du dispositif des affections de longue durée pour les personnes guéries d’un cancer, ou encore le déremboursement de 35 % à 15 % des médicaments à service médical rendu faible, ont contraint de nombreux malades à renoncer à des soins médicaux. Mon collègue Guy Fischer l’a très bien expliqué hier, lors de son intervention générale.
C’est donc le désengagement de l'État en matière de santé publique, notamment, qui aura eu un impact sur la baisse de ses dépenses.
Il en est de même pour les prestations familiales, qui n’ont progressé que de 0, 7 %. Dans un contexte de crise profonde et durable, où les premières victimes sont les familles modestes et notamment monoparentales, on aurait pourtant pu s’attendre à ce qu’elles augmentent de manière importante.
Or, le Gouvernement a, une fois de plus, choisi de renoncer à la solidarité, en gelant la base mensuelle des allocations familiales, ce qui a eu pour effet de neutraliser l’augmentation de la demande sociale.
Quant aux prestations vieillesse, le durcissement des conditions de départs anticipés et les mécanismes de décote, qui contraignent de plus en plus de salariés à travailler au-delà de leurs forces, ont eu l’effet comptable escompté, puisque ces prestations connaissent un ralentissement de 0, 5 % par rapport à 2009, mais à quel prix pour la santé des intéressés !
Vous le constatez, les économies ainsi réalisées ne résultent pas d’une politique d’efficience et de maîtrise médicalisée, mais sont la conséquence de la réduction du champ des solidarités.
Par conséquent, mes chers collègues, le groupe CRC-SPG ne peut pas adopter cet article.

Je vais mettre aux voix l’article 7.
La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

L’article 7 est emblématique de la politique menée par le Gouvernement.
Sa volonté est concrétisée à travers l’explication des moindres dépenses, c’est-à-dire la rectification des dépenses de 2 milliards d’euros pour le régime général. Il s’agit en effet de dépenses qui concernent en définitive le plus grand nombre. Ce sont donc les salariés et les travailleurs qui seront les plus touchés.
Au cours de l’examen du projet de loi portant réforme des retraites, nous avons observé que si l’âge légal de départ à la retraite était jusqu’à présent de 60 ans, l’âge moyen de liquidation était quant à lui de 61, 5 ans !
Les personnes arrivant prochainement à l’âge de la retraite ont souvent eu des carrières chaotiques et hachées. Cela aura des conséquences, notamment sur l’âge auquel elles la prendront effectivement. Une partie de la réduction du pouvoir d’achat des retraités s’explique ainsi.
Je souhaiterais maintenant obtenir une confirmation de la part de Mme Bachelot. Nous savons en effet que la revalorisation des salaires des fonctionnaires et d’un certain nombre de prestations sociales a lieu non plus au 1er janvier mais au 1er avril de chaque année, afin de tenir compte de l’inflation. Madame la ministre, les allocations familiales seront-elles revalorisées de 1, 5°% au 1er avril 2011 ?
Par ailleurs, je voudrais évoquer un exemple également relatif à la réduction drastique des dépenses publiques : celui du gel des salaires des fonctionnaires, déjà pénalisés par la hausse de leur taux de cotisation retraite, qui passera progressivement de 7, 85 % à 10, 55 % en dix ans.
De toute évidence, ce gel des salaires aura des conséquences considérables. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer qu’il concernera non seulement l’année 2011, mais également l’année 2012 ? Ce point doit être clarifié. Aujourd’hui, les politiques menées par l’État résonnent pour les salariés du secteur privé, où il est de plus en plus difficile d’obtenir une augmentation de salaire.
Le groupe CRC-SPG s’oppose bien entendu avec véhémence à l’article 7, car la tactique du Gouvernement est de prélever sur le plus grand nombre. Il répercute sur les assurés des dépenses qui devraient être remboursées. Le gel des salaires entraînera une baisse du pouvoir d’achat au cours des années à venir. Nous entrons donc dans une période d’hyperaustérité, qui va peser sur une très large majorité de Français.
Nous tenions à le réaffirmer pour justifier notre vote contre l’article 7.
Mme Annie David applaudit.
Avant d’en venir à la question précise de M. Fischer, je voudrais excuser François Baroin, retenu en ce moment même à l’Assemblée nationale par l’examen du projet de loi de finances pour 2011 et plus précisément des missions « Écologie, développement et aménagement durables », « Économie » et « Recherche et enseignement supérieur ». Cela me donne le plaisir d’être avec vous pour débattre des articles qui le concernent.
Monsieur Fischer, les revalorisations d’allocations familiales ont été repoussées au 1er avril afin de pouvoir construire la constatation de l’inflation à partir de l’ensemble de l’année, en l’occurrence 2010, et faire une extrapolation sur l’année suivante, en la circonstance 2011. Par définition, je ne peux donc répondre à votre question.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Bien sûr, certaines estimations circulent déjà, mais elles seront probablement affinées et corrigées lorsque l’inflation 2010 aura été constatée pour élaborer la revalorisation 2011, qui tiendra bien évidemment compte de l’inflation.
M. Guy Fischer s’exclame.
L'article 7 est adopté.
Au titre de l’année 2010, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :
En milliards d’euros
Objectifs de dépenses
Dépenses de soins de ville
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge
Total

M. Yves Daudigny. Madame la ministre, je voudrais vous poser, de façon très amicale, une question d’une grande actualité : souhaitez-vous rester dans le prochain gouvernement ?
Ah ! sur plusieurs travées de l ’ UMP.

À vrai dire, bousculée l'an passé par la gestion de la grippe A, vous entendez faire valoir des résultats pour y demeurer. Et la providence semble vous y aider. Sachez, madame la ministre, que nous souhaitons très sincèrement que vous restiez au Gouvernement.
Sourires sur les travées du groupe socialiste. – Marques d’ironie sur les travées de l’UMP.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C’est le baiser de la mort !
Rires sur les travées du groupe socialiste.

Les dépenses d'assurance maladie ont donc progressé de 3 % durant les sept premiers mois de l’année, par rapport à la même période en 2009.
Cet équilibre est conforme aux prévisions annoncées l’an dernier. Il s’explique par la bonne tenue des remboursements des soins de ville – hors hôpitaux –, qui représentent moins de la moitié du montant total. En sept mois, les dépenses liées aux soins de ville ont progressé de 2, 9 %.
Mieux : en tenant compte des retards de facturation des médicaments rétrocédés à l’assurance maladie pour les hôpitaux en 2009, elles n’ont augmenté que de 2, 6 %, soit, là encore, moins que l’objectif fixé par le Gouvernement au mois de mars.
En réalité, les dépenses de santé ont crû de 3, 5 % par an. Fixer l’ONDAM à 3 %, comme le préconise le Gouvernement pour l’année 2010, puis à 2 %, est-ce réaliste ? Nous en doutons, comme notre collègue Yves Bur, qui affirmait dans un entretien au journal Le Monde daté du 21 mai 2010 : « Je ne suis pas sûr que l’on puisse imposer un tel niveau en une fois, et de manière durable ».
Rappelons que la baisse de 1 % de la norme d'évolution de l’ONDAM ne fait économiser que 1, 8 milliard d’euros par an, et ce tandis que la dérive naturelle des dépenses de santé est de 7 milliards d’euros. Faire diminuer l’ONDAM, c’est obliger les Français à renoncer aux soins. Enfin, comme l’année dernière, plus de 100 millions d’euros de crédits destinés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ont été victimes d’une sorte de hold-up au profit de l’assurance maladie, sous le prétexte qu’ils n’étaient pas consommés. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois ce point.
En dépit de toutes les mesures prises pour diminuer la couverture maladie, la progression des dépenses de santé remboursées, entraînée par le vieillissement de la population et les progrès de la médecine, s’avérera inéluctable. Pour l’endiguer malgré tout, le Gouvernement souhaite renforcer l’arsenal de dispositifs contraignants. Piochant dans le rapport de Raoul Briet, il reprend la proposition d’abaisser – de 0, 75 % aujourd'hui à 0, 5 % en 2012-2013 – le seuil de dépassement de l'ONDAM à partir duquel est déclenchée l’adoption de mesures d'économies.
Ainsi, le comité d'alerte, instance dépendant de la commission des comptes de la sécurité sociale, verra son rôle étendu, et il pourra désormais se prononcer en amont de la construction de l’ONDAM. Les nouvelles mesures votées dans le cadre de l’ONDAM seront conditionnées au respect de l’objectif fixé l’année précédente. Cet ONDAM consacre le pouvoir de technocrates. Nous ne pouvons pas non plus vous suivre sur ce point.

À l’occasion de l’examen de l’article 8, je voudrais intervenir à la fois sur la question de l’ONDAM hospitalier et sur celle de l’ONDAM médico-social.
En effet, vous vous réjouissez du fait que, pour 2010, l’ONDAM, fixé en progression de seulement 3 %, soit respecté. Or, derrière ce chiffre, se dissimule une réalité autrement moins réjouissante : le déficit à long terme de nos hôpitaux publics. Comment pourrait-il en être autrement quand l’ensemble des dépenses explosent alors que, dans le même temps, vous contraignez les hôpitaux à la rigueur. Qu’il s’agisse des hausses de rémunérations légitimes, mais trop modestes, des personnels hospitaliers, des surcoûts liés aux procédures d’externalisation, de la hausse des tarifs de l’énergie, qui va se renouveler cette année, ou encore des nouvelles inscriptions sur la liste des médicaments pris en charge « en sus » des prestations d’hospitalisation, tout concourt à l’asphyxie des établissements publics de santé.
D’ailleurs, la Fédération hospitalière de France avait tiré le signal d’alarme, considérant que la croissance du budget des hôpitaux était plus proche de 3, 56 % que de 3 %.
Toutefois, vous ne vous êtes pas contentée de cette mise à la diète des hôpitaux, madame la ministre : constatant que l’ONDAM risquait d’être dépassé, vous avez contraint ces derniers à une nouvelle cure d’austérité en empêchant certaines dépenses, comme l’atteste le gel de 105 millions d’euros sur la dotation du Fonds de modernisation des établissements de santé.
Cette politique comptable vous permet en réalité d’affaiblir les hôpitaux publics pour mieux confier une partie de leurs missions aux établissements privés commerciaux. Vous appliquez aux hôpitaux les mêmes règles qu’à l’ensemble de la protection sociale, à savoir la déstabilisation par le manque de ressources financières et la valorisation du secteur privé.
Comble du comble, certains préconisent aujourd’hui d’appliquer aux hôpitaux les mêmes mauvaises solutions qu’à la sécurité sociale : le financement par l’emprunt en recourant, comme l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, à la possibilité d’émettre des billets de trésorerie. Une solution dangereuse quand on connaît l’instabilité des marchés financiers, qui ne répond en rien à leurs besoins de financement.
Ma collègue Jacqueline Fraysse a pris, à l’occasion de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, l’exemple de deux hôpitaux publics allemands, très récemment vendus au privé. Vous avez affirmé, madame la ministre, qu’il s’agissait là d’une folie et que vous ne le feriez jamais.

Mais qu’adviendrait-il à l’avenir si des hôpitaux surendettés ne parvenaient plus à survivre financièrement ?

Enfin, en ce qui concerne la restitution des crédits non consommés dans l’enveloppe médico-sociale, je voudrais être certaine qu’il ne s’agit que d’une mesure temporaire. En effet, les besoins en structures d’accueil tant pour les personnes vieillissantes que pour les personnes en situation de handicap sont grands et ne vont cesser de croître avec le temps. Or, tous les acteurs le disent, l’instauration des agences régionales de santé et des nouvelles procédures d’autorisation ont eu pour effet de ralentir les projets qui sont en cours de validation. Il en résulte effectivement une diminution des crédits utilisés puisque les projets ne sont pas encore finalisés. Or ils le seront prochainement et l’évolution de l’ONDAM à venir, inférieur à celui de 2010, nous interroge sur la disponibilité des ressources pour les mois à venir et pour la finalisation des projets en cours.
Pour compléter la réponse que j’ai faite tout à l’heure à M. Fischer, j’indique, après avoir pris contact avec le cabinet de Mme Morano, que les allocations familiales seront effectivement revalorisées de 1, 5 % le 1er janvier prochain, pour tenir compte de l’inflation.
Vous voyez, monsieur Fischer, qu’il n’y a pas l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarettes entre Mme Morano et moi-même, surtout quand il s’agit de lutter contre le tabac…
Sourires.

Je vais mettre aux voix l’article 8.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.

La fiscalité sociale sera au cœur de la prochaine confrontation présidentielle pour au moins deux raisons.
La première, c’est l’ampleur des déficits des comptes sociaux : 23, 1 milliards d’euros pour 2010, 21, 3 milliards d’euros pour 2011, à peine moins à l’horizon 2012. Non seulement la sécurité sociale vit à crédit, mais une partie des retraites, des dépenses de santé et des allocations familiales est financée non plus par nos cotisations, mais par l’emprunt.
La deuxième raison, c’est l’aggravation des inégalités de soins. Dix mille par an : c’est le nombre de décès prématurés que l’on pourrait éviter si les ouvriers et employés avaient, dans notre pays, la mortalité des cadres supérieurs et des professions libérales. Et il faut savoir que la France fait partie des pays européens où les disparités devant la mort sont les plus fortes.
Il est temps d’engager cette grande réforme que vous aviez tant et tant annoncée. Notre système de prélèvements sociaux est devenu non seulement inique – nul ne sait qui paye, ce que représentent les taux affichés et la réalité de la redistribution opérée –, mais également instable.
Les exonérations de cotisations sociales ont changé de mode de calcul douze fois en quinze ans. Comment les entreprises peuvent-elles, elles-mêmes, faire leurs arbitrages ? Enfin, ce système n’est favorable ni à l’emploi ni à l’investissement, et pas davantage à l’équilibre des comptes.
Face à ce constat, il faut une nouvelle donne. Il convient tout d’abord de taxer tous les revenus sans distinction d’origine, qu’ils proviennent du capital ou du travail, qu’ils soient tirés de l’activité ou des transferts. Tous ces revenus doivent être soumis à l’assujettissement social sur la même base, à savoir des taux proportionnels aux niveaux de rétribution.
Cela suppose de réfléchir à toutes les déductions, tous les abattements, toutes les exonérations et toutes les niches sociales, pour faire en sorte que, dès le premier euro, la règle d’imposition soit commune. Cette conception d’une large assiette avec des taux modérés et progressifs permettrait de financer à la fois la sécurité sociale, la dette et le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV.
Pour les plus-values, nous avons aujourd’hui un empilement d’impositions sur les stock-options, le forfait social et les retraites chapeaux. Nous proposons de recourir au même principe : une assiette large, qui ne doit plus reposer seulement sur les salaires, mais sur l’ensemble de la richesse produite, c’est-à-dire la valeur ajoutée. Le capital dans sa globalité serait ainsi concerné, et aucune part n’en serait exclue selon la situation professionnelle de son détenteur, sa capacité à faire pression ou à trouver des moyens de détourner l’imposition.
Nous sommes pour l’impôt, non pas pour spolier, mais pour préparer, investir, financer, stimuler. S’il est vrai qu’aucun gouvernement n’est sûr de gagner les élections quand il baisse les prélèvements – la démonstration en a été faite –, il est certain de les perdre quand il annonce des hausses.
Le courage n’est pas la témérité. Nous avons à faire des choix, à réformer les prélèvements et à dire qui les paiera et comment. Nous devons aussi regarder du côté de la dépense de l’assurance maladie et être plus efficaces, plus performants, plus économes dans la gestion des caisses, locales ou nationales.
M. Michel Teston applaudit.

Les décisions qui se cachent derrière cet article 8 mériteraient de nombreux commentaires. Je voudrais toutefois insister sur un changement qui va se faire insidieusement et dont les victimes seront, bien évidemment, les salariés.
Le tome VII du rapport de M. Vasselle reproduit, à la page 43, l’avis du comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie du 28 mai 2010, auquel est annexée la lettre ministérielle reçue par les membres du comité. Cette lettre ministérielle traite notamment du calcul des indemnités journalières. Vous n’êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que la lutte contre la fraude qu’entend mener M. Vasselle vise également les abus en matière d’indemnités journalières. On a d’ailleurs pu lire récemment dans la presse des articles qui allaient tous dans le même sens : les travailleurs, qui tirent plus au flanc, seraient responsables de la fraude.

Sauf que lorsque les conditions de travail se dégradent, il arrive que les indemnités journalières augmentent. Nous l’avons d’ailleurs constaté lors de notre déplacement en Suède, avec des départs en préretraite qui s’accompagnaient de versement d’indemnités journalières.
J’en reviens à la lettre ministérielle dont je parlais à l’instant. Elle précise que l’engagement a été pris de mettre en œuvre la mesure de calcul des indemnités journalières prévue en annexe 9 du PLFSS pour 2010, pour un rendement de 70 millions d’euros en 2010.
Je me suis dit que le Gouvernement avait atteint son objectif de réduction des dépenses. Il semblerait que l’explication réside dans un décret, récemment publié, qui modifie le mode de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et maladies professionnelles. Auparavant, le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières maladie, maternité, paternité et adoption était égal à un quatre-vingt-dixième du salaire brut des trois mois précédant l’interruption de travail, et celui des indemnités journalières dues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle à un trentième du salaire brut du dernier mois. Cela revenait donc à calculer ces indemnités sur 360 jours. L’indemnité journalière étant due chaque jour, ouvrable ou non, celle-ci sera désormais calculée sur 365 jours.
Cela aura par conséquent pour effet de réduire le montant des indemnités perçues par les salariés, puisque le montant de l’indemnité sera dorénavant calculé sur 365 jours, au lieu de 360 actuellement. Il semblerait que cela corresponde à une baisse de 1, 4 % des indemnités journalières. Il n’y a pas de petites économies ! Ainsi, pour quelqu’un qui touchait 1 500 euros bruts environ, la perte mensuelle serait de 20 euros, comme l’a évalué Melclalex.
Ce PLFSS est tout entier fait de ces petites mesures qui rapportent des dizaines, des centaines, voire des milliards d’euros, …
Je vous confirme, monsieur Fischer, que le décret est paru voilà quelques jours, et que la base du calcul a bien été fixée à 365 jours, y compris les années bissextiles, parce que, ne vous en déplaise, monsieur le sénateur, l’année compte 365 jours !
L'article 8 est adopté.

Je mets aux voix l’ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
La deuxième partie du projet de loi est adoptée.

Nous allons maintenant examiner la troisième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année 2011.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011
Section 1
Reprise de dette

Je vous rappelle qu’à la demande du Gouvernement les amendements portant articles additionnels avant l’article 9, l’article 9 et l’amendement portant article additionnel après l’article 9 ont été réservés jusqu’au mercredi 10 novembre 2010, après-midi.
Section 2
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

L'amendement n° 445 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III - Le taux de la taxe est fixé à 0, 05 % à compter du 1er janvier 2011.
« Ce taux est majoré à 0, 1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Ce taux est majoré à 0, 5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. » ;
2° Le IV est abrogé.
II. - Selon des modalités définies par la loi de financement de la sécurité sociale, le produit de la taxe prévue au 1° est affecté au fonds de réserve pour les retraites.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gilbert Barbier.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, cet amendement rejoint une proposition de loi déposée au mois de février dernier par le groupe RDSE et tendant à intégrer une taxe anti-spéculative au cœur de nos dispositifs fiscaux.
À mon sens, une taxation additionnelle sur les devises, avec un taux très faible – il avait été fixé à 0, 05 % –, permettrait d’éviter les phénomènes que nous constatons dans les paradis fiscaux plus ou moins coopératifs. D’ailleurs, l’idée d’une telle taxe a été reprise à la tribune de l’ONU par le Président de la République.
Compte tenu du déficit qui existe aujourd'hui au sein du Fonds de réserve pour les retraites, il me semblerait très intéressant d’y affecter le produit de cette taxe.

Monsieur Barbier, cet amendement relève non pas d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais d’un projet de loi de finances. Notre collègue Jean-Jacques Jégou, qui appartient à la commission des finances, serait plus à même de vous répondre que moi.
C’est pourquoi nous n’avons pas pu émettre un avis favorable sur cet amendement.
Je vous invite donc, si vous tenez absolument à continuer de défendre cette idée, à redéposer votre amendement lors de l’examen du prochain projet de loi de finances. Notre collègue Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, se fera un plaisir de vous répondre sur la pertinence d’une telle proposition.
Monsieur Barbier, une disposition similaire a effectivement été repoussée par la Haute Assemblée lors de l’examen de la proposition de loi relative à la taxation de certaines transactions financières.
M. le sénateur Charles Guené avait très justement démontré qu’il serait suicidaire d’instituer une telle taxe si nous étions les seuls à le faire.
Cette argumentation reste tout à fait pertinente, et elle s’ajoute à l’objection de forme soulevée par M. le rapporteur général.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Pour ma part, je ne sais pas s’il serait si catastrophique que cela, dans notre environnement actuel, d’instituer une taxe de 0, 05 %… (Mme la ministre s’exclame.)
J’avais formulé cette proposition en vue d’abonder le Fonds de réserve pour les retraites. M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales m’incite à redéposer mon amendement lors de l’examen du projet de loi de finances. J’espère que M. le rapporteur général de la commission des finances ne me renverra pas à son tour vers vous, monsieur le rapporteur général de la commission des affaires sociales… §
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement.
Marques de déception sur les travées du groupe socialiste.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« 10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ; »
2° À l’intitulé de la section 5 du chapitre VII du titre III du livre Ier, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions » ;
3° Le I de l’article L. 137-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code, » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : «, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » sont supprimés et les mots : « et précomptée par l’organisme payeur » sont remplacés par les mots : «, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes » ;
3° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du II du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l’assiette mentionnée au 1° du I de l’article L. 131-11, l’option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L’employeur qui exerce cette option est redevable d’un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s’il avait choisi l’assiette définie au 2° du même I dans les conditions prévues au II du même article et, d’autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L’employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° du I du même article de l’exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté ;
4° Après l’article L. 137-11, il est inséré un article L. 137-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137 -11 -1. – Les rentes dont la valeur est supérieure à 300 € par mois versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 500 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 300 et 500 € par mois, ce taux est fixé à 7 %. Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »
II

Avec l’article 10, nous allons examiner des mesures visant à élargir les recettes de financement de la sécurité sociale.
Je mentionnerai pêle-mêle l’assujettissement des rentes dès le premier euro, l’instauration d’une contribution salariale de 14 %, la suppression de l’abattement forfaitaire pour les entreprises délivrant des rentes ou encore la modification des modalités de versement et de recouvrement des contributions dues sur ces mêmes revenus. À parcourir un tel inventaire à la Prévert, on pourrait être tenté de tirer son chapeau devant tant de financements !

Cependant, madame la ministre, il suffit de sortir sa calculatrice pour constater que l’ambition est bien mince.
En additionnant les recettes résultant de l’ensemble de ces mesures, on arrive à un total inférieur à 110 millions d’euros en faveur du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV.

Ces mesures étaient présentées comme ambitieuses. Hélas ! il suffit de lire le rapport de M. Yves Bur, …

… qui les qualifiait d’« incertaines », pour comprendre notre scepticisme.

Monsieur le rapporteur général, si vous souhaitez prendre la parole, je vous la cède bien volontiers…

Disons-le clairement, aux yeux des Français, l’année écoulée a été marquée par l’augmentation de l’écart entre les primes de départ des grands patrons et celles de leurs salariés.

Permettez-moi de vous en fournir quelques exemples.
L’ancien président-directeur général de la Société générale, M. Daniel Bouton, a perçu 730 000 euros, contre 800 000 euros pour le patron de la BNP, M. Michel Pébereau, 780 000 euros pour le patron d’EDF, M. Henri Proglio, et 500 000 euros pour le patron de Carrefour, M. Lars Olofsson... Je m’en tiendrai là, mais la liste est loin d’être exhaustive.
Ainsi, au moment où l’on demande aux Français de se serrer la ceinture, par exemple avec l’allongement de l’âge de départ à la retraite, vous continuez au travers de cet article à protéger les intérêts de quelques-uns.
Comme le déclarait Martin Hirsch, qui est, me semble-t-il, très apprécié du Gouvernement
Rires sur les travées du groupe socialiste

Nous demandons que les retraites chapeaux, en particulier pour les hauts revenus, soient sérieusement taxées. D’ailleurs, vous cherchez des financements, madame la ministre…
Au demeurant, c’est ce que prônait M. Philippe Séguin voilà deux ou trois lors de la présentation du rapport de la Cour des comptes.
À cet égard, l’exonération des petites rentes décidée par l’Assemblée nationale, qui l’a justifiée par la volonté de ne pas baisser les pensions, devrait venir encore amoindrir le rendement d’une telle mesure. Ce sont 80 % des bénéficiaires qui en seront partiellement ou totalement exemptés.
Toutefois, il faut bien dire que de telles estimations sont sujettes à caution en raison du manque d’informations – vous allez peut-être nous éclairer à cet égard – disponibles sur les régimes de retraites chapeaux. C’est d’ailleurs ce que souligne le rapport remis par le Gouvernement au Parlement voilà quelques jours à peine, conformément à la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le 1° est ainsi rédigé : « Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, la contribution dont le taux est fixé à 35 % est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes » ;
c) Au dernier alinéa du 2°, les taux : « 12 % » et « 24 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et : « 50 % ».
La parole est à M. Guy Fischer.

L’article 10, que notre amendement tend à modifier, concerne le niveau de taxation des mécanismes dits de « retraites chapeaux », qui permettent à une poignée de dirigeants et de cadres d’accroître considérablement leurs rémunérations. Car ce sont évidemment ces personnes-là que nous visons, et non pas les milliers de personnes qui touchent des petites primes, peut-être parfois assimilées à des retraites chapeaux. Pour notre part, nous refusons de procéder par amalgames et de créer de la confusion, comme le fait la droite.
Certes, la suppression de l’abattement sur les rentes en cas de prélèvement à la sortie ainsi que le nouveau prélèvement prévu sur l’ensemble des rentes dont devra s’acquitter le bénéficiaire vont dans le bon sens. Il n’en demeure pas moins que cela est très insuffisant et que de tels mécanismes bénéficient encore d’une fiscalité plus avantageuse que les salaires perçus par les travailleurs, et ce à hauteur de presque 9 %.
Cela nous interroge sur votre volonté réelle de réformer le dispositif actuel.
En effet, au lieu de rechercher des taux visibles, significatifs, c'est-à-dire donnant véritablement l’impression à nos concitoyens que vous vous saisissez de la question et permettant tout de même de conserver une fiscalité dérogatoire, il aurait été plus facile, mais aussi plus juste, de leur appliquer les taux normaux, c'est-à-dire les taux auxquels sont soumis l’ensemble des salariés.
On pourrait d’ailleurs considérer que ces retraites chapeaux, dont les sommes parfois astronomiques – Bernard Cazeau vient d’en mentionner quelques-unes – sont destinées à une catégorie d’ultra-privilégiés, soient soumises à contribution au-delà des taux applicables aux salaires, tant elles atteignent, parfois, des niveaux indécents.
D’ailleurs, n’est-ce pas François Fillon qui, ministre du travail lors de la réforme des retraites de 2003, défendait lui-même le principe d’une taxation confiscatoire ?
Force est de constater que rien n’a vraiment changé depuis 2003. La taxation reste encore très profitable. Et, contrairement aux engagements du MEDEF sur la moralité du capitalisme et de ses pratiques, via un code dont nous prédisions qu’il serait totalement inefficace, ces mécanismes continuent à alimenter les critiques légitimes de nos concitoyens.
Lors des débats sur les retraites, nous avions évoqué le cas du nouveau directeur général de Carrefour, Lars Olofsson, qui a obtenu le droit de bénéficier d’une retraite chapeau de 500 000 euros à la seule condition de rester à son poste durant cinq ans.
Mais nous aurions également pu mentionner l’exemple de ce grand dirigeant d’une entreprise bancaire qui était encore récemment dans la tourmente et qui a obtenu que sa retraite chapeau puisse être transmissible à son épouse en cas de décès. Autant dire que cet élément de rémunération très particulier s’est ainsi transformé en une super-pension de réversion. Tout le monde en rêverait, non ?
Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Mes chers collègues, je vous invite à considérer notre amendement avec lucidité.
Rien ne justifie que les retraites chapeaux, qui ne sont pas autre chose que des rémunérations distribuées seulement à l’expiration de la relation de travail, se voient appliquer un taux de cotisation dérogatoire au droit commun du fait de cette seule spécificité.

L'amendement n° 286 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont et Mmes Hermange et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Au 1°, les mots : « et précomptée par l'organisme payeur » sont remplacés par les mots : «, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes » ;
La parole est à M. Philippe Dominati.

Cet amendement vise à maintenir l’abattement forfaitaire sur le montant des rentes inférieures au tiers du plafond de la sécurité sociale, soit 11 540 euros par an en 2010, afin de ne pas pénaliser les retraites supplémentaires des plus modestes, sachant que les régimes à prestations définies concernent non seulement les rémunérations les plus élevées dans l’entreprise, mais également en réalité un grand nombre de salariés, qui peuvent ainsi bénéficier d’un complément de ressources modéré pour leur retraite, à hauteur de 470 euros par mois en moyenne.
La réforme des retraites a montré que le taux de remplacement était appelé à diminuer dans les années à venir, d’où l’importance des mesures votées à l’Assemblée nationale sur le fléchage de l’épargne salariale vers des produits d’épargne longue, afin de garantir le niveau des pensions. Les retraites d’entreprise relèvent de la même logique.
Il convient de ne pas être en contradiction avec un tel objectif.
Ainsi, la contribution patronale de 16 % serait due non pas dès le premier euro, mais à partir de 11 540 euros par an sur les rentes versées, ce qui, dans ces conditions, maintient le droit existant.

Avant de donner l’avis de la commission sur ces deux amendements, je voudrais informer l’ensemble de nos collègues sur quelques éléments du dispositif des retraites chapeaux.
Les auditions auxquelles nous avons procédé et les nombreux courriers que j’ai reçus de la plupart d’entre vous font apparaître une certaine confusion entre les retraites supplémentaires liées à un accord collectif et les retraites chapeaux. Vous êtes plusieurs à considérer que le dispositif mis en place par le Gouvernement est pénalisant pour les bénéficiaires de retraites chapeaux d’un faible montant.
Cela mérite que je vous apporte quelques précisions. Les sommes en question viennent s’ajouter aux pensions versées par les régimes de base et complémentaires. C’est pour cette raison qu’on les appelle « retraites chapeaux ».
Il s’agit de régimes à prestations définies, sans cotisation préalable, j’y insiste, les bénéficiaires des rentes concernées n’ayant jamais cotisé pour obtenir les sommes qui leur sont allouées. En vertu de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ces sommes sont conditionnées à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. Elles présentent donc un caractère aléatoire : achever sa carrière dans ladite entreprise constitue une contrainte importante.
Les fonds versés ou provisionnés par les entreprises pour assurer le paiement de ces sommes ne sont pas individualisables.
J’ai été sensibilisé par certains d’entre vous sur ces régimes très particuliers, différents des régimes collectifs d’entreprise.
Un rapport, demandé l’an dernier dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, dresse un premier bilan de ces régimes. Il en ressort que nous avons une connaissance très imparfaite de la situation. Les difficultés rencontrées pour définir le périmètre exact de l’assiette concernée rendent les prévisions malaisées.
Aujourd'hui, on sait que 10 % des entreprises acquittent la contribution « à l’entrée » sur les primes ou versements. La quasi-totalité des entreprises, environ 97 % d’entre elles, ont externalisé leur mode de gestion auprès d’un organisme assureur. Dans notre pays, environ 90 000 retraités sont concernés.
D’après les données qui nous ont été transmises par le Gouvernement, 80 % des rentes versées sont d’un montant inférieur à 500 euros par mois.
J’en reviens maintenant aux deux amendements qui nous ont été présentés et qui sont de deux ordres : l’amendement n° 216 défendu par notre collègue Guy Fischer vise à accentuer la taxation des employeurs, tandis que l’amendement n° 286 rectifié bis tend à l’alléger.

L’Assemblée nationale a déjà modifié le texte initial, en instaurant une exonération totale ou partielle des petites retraites chapeaux : aucune taxation pour les retraites chapeaux de moins de 300 euros par mois, une taxation de 7 % pour les pensions comprises entre 300 euros et 500 euros et de 14 % au-delà de 500 euros. Pour une retraite de 301 euros, le salarié supportera la taxe à partir du premier centime d’euro.
La commission a choisi d’en rester à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve de l’adoption de l’amendement n° 210 rectifié bis de Catherine Procaccia, qui prévoit un lissage des effets de seuil.
En effet, cet amendement vise à exonérer le salarié du paiement de la taxe jusqu’à 300 euros. Ainsi, une personne qui bénéficierait d’une retraite chapeau d’un montant de 301 euros paierait 7 % d’un euro, alors qu’elle paierait 7 % de 301 euros avec le dispositif retenu par le Gouvernement.
Sur ce sujet, nos collègues ont déposé de très nombreux amendements, et nous allons sans doute avoir un débat riche en la matière. Après que le Gouvernement aura donné son avis, et en fonction du débat, nous verrons s’il y a lieu d’apporter de nouvelles modifications.
Pour ce qui la concerne, la commission s’en est tenue aux propositions que je viens de développer.
Elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 216 de M. Fischer, qui vise à doubler les taux de taxation. Je vous rappelle, mon cher collègue, que nous avons déjà doublé ces taux l’année dernière, faisant passer la participation des employeurs de 6 % à 12 %, de 8 % à 16 % et de 12 % à 24 %. Ici, vous nous proposez de faire passer le taux de 12 % à 20 %, celui de 16 % à 35 % et celui de 24 % à 50 %. Il ne nous paraît pas judicieux de procéder à ces doublements.

À ce propos, nos collègues de l’opposition, Guy Fischer et Bernard Cazeau, ont laissé entendre que les actions du Gouvernement, une sorte de catalogue à la Prévert selon eux, seraient des mesures d’affichage, laissant accroire que les revenus du patrimoine ou les ressources telles que les retraites chapeaux allaient enfin être sollicités, alors que les prélèvements sur ces niches sociales seraient dérisoires par rapport aux besoins !
Or sur les 10 milliards d’euros de niches fiscales et sociales que le Gouvernement mobilise – M. le ministre l’a dit et Mme la ministre le rappellera peut-être tout à l'heure –, ce ne sont pas moins de 8 milliards d’euros qui vont venir alimenter le budget de la sécurité sociale ! Non, les sommes en cause ne sont pas anodines ! Je ne vous parle pas de quelques millions ou de quelques dizaines de millions d’euros ! J’ai bien dit 8 milliards d’euros !

Je le dis à l’intention de ceux qui suivent nos débats, nous avons essayé de trouver un équilibre entre les contributions assises sur le revenu du travail et celles qui proviennent des revenus du patrimoine ou d’autres ressources.

Quant à l’amendement de notre collègue Philippe Dominati, il vise à rétablir purement et simplement l’abattement aujourd'hui en vigueur.
Dès lors que le Gouvernement a élaboré un dispositif puisant dans les niches fiscales et sociales pour alimenter le financement des retraites résultant de la réforme que nous avons adoptée en la matière et celui de la sécurité sociale à concurrence des montants que j’ai indiqués, il est difficile pour la commission d’adhérer à cette proposition.
En conséquence, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales a été très complet sur le sujet et je le rejoins.
Les objectifs poursuivis, d’un côté par M. Fischer et les membres du groupe CRC et, de l’autre, par M. Dominati, sont orthogonaux : l’amendement n° 216 tend à augmenter le taux des contributions patronales existantes, alors que l’amendement n° 286 rectifié bis vise à maintenir l’abattement actuel.
M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales a rappelé que nous avons déjà doublé la contribution sociale à la charge de l’employeur l’année dernière. Cette année, nous allons plus loin encore.
En effet, les employeurs qui avaient opté pour le système de taxation sur les rentes des retraites chapeaux ne payaient aucune contribution en deçà d’un certain niveau de rente. Nous mettons fin à cette dérogation : les employeurs concernés paieront désormais une contribution dès le premier euro versé. L’abattement de 1 000 euros par mois sera supprimé. En la matière, nous devions agir, et c’est précisément ce que nous faisons !
Toutefois, à côté des retraites chapeaux de quelques dirigeants, qui font la une des journaux, je tiens à rappeler qu’il existe, souvent dans des entreprises auparavant nationalisées, des niveaux de rentes plus modestes. Leur niveau est plus raisonnable puisque 85 % d’entre elles ne dépassent pas 7 000 euros par an.
Quant à M. Dominati, il propose de maintenir l’abattement sur les rentes. Le Gouvernement y est opposé, car nous voulons mettre fin à une anomalie.
Aujourd'hui, 90 % des employeurs n’acquittent aucune contribution sur cette forme d’avantage octroyé au salarié, ce qui est sans équivalent !
Par là même, nous mettons également fin à une situation paradoxale dans laquelle le régime social était plus favorable aux retraites chapeaux qu’aux retraites supplémentaires classiques, qui présentent de meilleures caractéristiques, notamment en ce qui concerne la portabilité des droits et le choix des bénéficiaires. Or, depuis 2003, le Gouvernement a fait le choix de favoriser ce dispositif.
En outre, l’amendement adopté par l'Assemblée nationale visant à autoriser les entreprises à ré-opter pour la contribution à l’entrée permettra de régler le problème des anciens régimes, qui couvrent de nombreux ex-salariés et sont normalement en phase d’extinction progressive.
Les solutions que nous vous proposons sur les retraites chapeaux sont d’ailleurs issues des travaux d’analyse réalisés par la Haute Assemblée, qui ont fait l’objet d’un rapport du Gouvernement auquel Alain Vasselle a fait allusion et dont vous avez été destinataires.
Ces solutions ont permis de trouver un équilibre entre les deux préoccupations qui ont été exprimées par votre assemblée dans la mesure où elles permettent d’assurer une juste contribution de ces éléments de rémunération au financement de notre système de protection sociale.
En conséquence, à l’instar de la commission, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 216 et demande à M. Dominati de bien vouloir retirer l’amendement n° 286 rectifié bis.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 216.

Je veux revenir sur les retraites chapeaux évoquées par mon collègue Guy Fischer.
J’ai bien entendu vos explications, monsieur le rapporteur général. Sur les 10 milliards d’euros d’économies réalisées sur les niches fiscales, 8 milliards d’euros seront versés à la sécurité sociale. Mais, sur ces 8 milliards d’euros, les mesures relatives à la taxation des retraites chapeaux ne représentent que 110 millions d’euros ! Soyez donc modestes !

Certes ! Mais, l’eau des petits ruisseaux, vous venez toujours la tirer du même puits, la poche des travailleurs les plus modestes !

Mais si bien sûr !
En l’espèce, j’en conviens, ces 110 millions d’euros, vous n’allez pas les prendre dans les poches des travailleurs. Mme la ministre a fait allusion aux quelques personnes qui touchent de petites retraites chapeaux. Eh bien, on pourrait vous reprocher de les faire échapper à toute cotisation sociale !
C’est pour cette raison que l’on prend ces mesures !

Pour notre part, depuis de longues années déjà, nous vous proposons, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et nous l’avons encore fait lors de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites, des ressources pérennes pour notre système de protection sociale.
Plutôt que d’accorder des retraites chapeaux d’un montant inférieur à 300 euros par mois, faisons en sorte que les sommes correspondantes soient incluses dans le salaire des personnes concernées et donc soumises aux cotisations sociales !

Non, les retraites chapeaux, vous ne les touchez pas forcément lorsque vous êtes à la retraite ! Elles visent à fidéliser les hauts managers dans les entreprises et sont inscrites dans le contrat de travail.
Plutôt que de les fidéliser de la sorte, en évitant ainsi toute cotisation sociale sur les sommes versées, faisons en sorte de les fidéliser en les indemnisant à hauteur de leurs qualifications, c'est-à-dire en intégrant ces primes aux rémunérations, afin de les soumettre aux cotisations sociales.
Il faut revoir toute la politique que vous mettez en œuvre en matière de retraites chapeaux, de primes, d’intéressement, – si Mme Debré était présente ce soir, elle parlerait sans doute, elle aussi avec fougue, mais pas dans le même sens que moi, de la participation, de l’intéressement ! Il faut mettre fin à cette politique de détournement de salaires pour intégrer ces éléments aux revenus déclarés des salariés, qu’ils soient cadres ou non, et ce quel que soit leur statut, agent de la fonction publique ou salarié du privé, afin de les réinjecter dans notre système de protection sociale. Voilà comment obtenir des ressources nouvelles !
D’ailleurs, la Cour des comptes n’a de cesse de dénoncer, en des termes certes différents des miens, les 172 milliards d’euros de niches fiscales qui échappent aux cotisations sociales.
Madame la ministre, tant que vous poursuivrez cette politique, vous réduirez les recettes dévolues à notre système de protection sociale, et l’issue sera toujours la même : vous en viendrez à proposer de diminuer les taux de remboursement des médicaments et d’augmenter le forfait hospitalier, et ce, bien évidemment, contre l’intérêt général. En effet, ce seront bel et bien les assurés eux-mêmes qui paieront le déficit que vous organisez par ce détournement d’argent !
Nous ne saurions trop insister sur le fait que ces 110 millions d’euros représentent vraiment une goutte d’eau eu égard aux 8 milliards d’euros que vous allez tirer de la suppression d’autres niches fiscales !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.

Monsieur le président, je note d’abord avec satisfaction une évolution, soulignée par M. le rapporteur, par rapport aux travaux de la commission.
Un certain nombre d’amendements que nous allons examiner dans quelques instants portent sur les petites retraites et les retraites modestes, lesquelles concernent 85 %, voire 90 % des retraites chapeaux.
Je note, ensuite, toujours avec satisfaction, que nous commençons à disposer de quelques chiffres en ce domaine. Tel n’était pas le cas du rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale, qui débattait de ce sujet sans pouvoir mesurer l’efficacité de la mesure prévue.
Mme la ministre nous ayant proposé d’atteindre un équilibre entre les deux analyses en présence, j’espère que nous y parviendrons au cours de l’examen des amendements suivants. Par conséquent, je retire mon amendement.

L’amendement n° 286 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 49, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Remplacer la référence :
L. 131-11
par la référence :
L. 137-11
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.
L'amendement est adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 est présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 219 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Le IV du même article est abrogé ;
La parole est à M. Claude Jeannerot, pour présenter l’amendement n° 9.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du débat qui vient de s’ouvrir et dans le droit-fil des explications développées tout à l’heure par mon collègue Bernard Cazeau. Nous souhaitons, en effet, vous proposer, madame la ministre, des pistes inédites pour trouver des ressources supplémentaires.
L’exigence de justice sociale et l’impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement, en mettant à contribution tous les revenus, quelle qu’en soit la nature. Il n’est pas acceptable que certains d’entre eux soient exonérés de l’effort de solidarité nationale.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l’exonération de CSG et de cotisations sociales prévue dans le cadre des contributions des employeurs au financement des régimes de retraite dits « chapeau » relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale – il a été largement cité tout à l’heure – et à remettre ainsi ces dispositifs dans le droit commun.
Cette mesure s’inscrit dans un plan global de financement de 25 milliards d’euros de recettes nouvelles pour notre système de sécurité sociale à l’horizon 2020. Elle n’est que l’un des aspects du projet alternatif porté par les sénateurs de notre groupe, projet qui comprend, vous l’avez entendu, de nombreuses autres mesures à caractère non fiscal.
Le présent amendement vise donc à mettre fin à une injustice fiscale et sociale.

Cet amendement pourrait apparaître comme un amendement de repli puisqu’il vise seulement à supprimer l’exonération de CSG et de cotisations sociales dont bénéficient les retraites chapeaux.
À nos yeux, il n’en est pas moins important tant ces régimes sont injustes, qu’il s’agisse de leurs montants, du nombre de leurs bénéficiaires et de leur fiscalité pour le moins avantageuse. En effet, en 2009, 826 entreprises ont mis en place au moins une retraite chapeau, et moins de 10 % seulement des bénéficiaires de ladite retraite perçoivent un montant supérieur à 5 600 euros. C’est dire que ce dispositif ne concerne qu’une minorité de dirigeants et de cadres, ceux-là mêmes qui perçoivent les rémunérations les plus importantes !
On a coutume de dire que l’argent va à l’argent. Vous donnez raison à l’adage en faisant adopter des législations qui, sur le plan social ou fiscal, continuent à favoriser ces modes de rémunérations au détriment des salaires, lesquels pourraient tout à fait, d’un point de vue légal, intégrer les montants faramineux des retraites chapeaux, à cela près que les cotisations sociales leur seraient alors applicables.
C’est donc bien pour permettre à une minorité de personnes de contourner les cotisations sociales, c’est-à-dire les mécanismes qui alimentent la solidarité, que vous refusez de prendre les mesures qui s’imposent. C’est d’ailleurs très certainement cette raison qui vous conduira à repousser l’amendement n° 219, comme vous l’avez déjà fait en commission.
Vous ne manquerez pas d’arguments pour justifier le fait que les plus riches puissent continuer à être proportionnellement moins solidaires que ne le sont les salariés ! Il faut le dire, c’est bien cette logique qui a conduit à l’instauration du bouclier fiscal.
Vous ne manquerez pas non plus de nous objecter, comme vous l’avez d’ailleurs fait en commission, que si notre amendement était adopté, il participerait à l’évasion fiscale de nos meilleurs cadres et dirigeants. Cet argument, que nous avons déjà entendu maintes fois, notamment en commission, appelle toutefois quelques observations de notre part.
Tout d’abord, certains bénéficiaires des retraites chapeaux n’ont pas brillé par leur réussite, ce qui ne les a pas empêchés d’empocher les sommes en question ! Par ailleurs, qui peut réellement croire que nos entreprises, visiblement très soucieuses de garder ces hauts dirigeants, ne prendraient pas les mesures nécessaires pour les inciter à rester, y compris en augmentant leurs salaires ?
Ensuite, vous qui parlez souvent de « moraliser l’économie », comment pouvez-vous encore justifier une mesure aussi injuste, qui profite à une minorité de personnes en mesure de choisir l’exil fiscal – elles jouent, d’ailleurs, la carte de ce chantage à votre égard –, alors que l’immense majorité des salariés, celles et ceux qui subissent chaque années vos mesures, ne peuvent pas vous opposer cette arme ?
Pour conclure, mes chers collègues, je rappelle que ces retraites chapeaux s’adressent bien évidemment à celles et ceux qui disposent déjà de revenus très intéressants. Je vous invite à réfléchir à la situation de nos compatriotes qui, une fois à la retraite, n’ont, pour vivre, que le minimum vieillesse. Pour eux, 300 euros de retraite chapeau représenteraient un apport bien plus bien plus intéressant qu’il ne l’est pour les personnes qui en profitent actuellement.
Je suis, du reste, persuadée que les bénéficiaires du minimum vieillesse seraient, si elles bénéficiaient d’une retraite chapeau, tout à fait favorables à ce que celle-ci soit soumise, si ce n’est à l’ensemble des cotisations sociales, du moins à la CSG. Car ces personnes savent ce que signifie la solidarité !
M. Guy Fischer applaudit.

Sur ces deux amendements identiques, la commission a émis un avis défavorable.
Leurs auteurs veulent, en effet, appliquer le droit commun des cotisations sociales et de la CSG aux retraites chapeaux. Or le Gouvernement a fait un autre choix, que nous avons soutenu, la création d’un prélèvement spécifique.
N’ayant pas l’intention, du moins pour le moment, de changer de pied sur ce sujet, nous vous invitons, mes chers collègues, à rejeter les amendements identiques n° 9 et 219, sous réserve que le Gouvernement partage cet avis.
Je ne rappellerai pas toutes les avancées réalisées pour mettre à contribution les systèmes de retraite chapeau au profit du financement de la sécurité sociale.
Par ailleurs, ces amendements préconisent une procédure qu’il n’est pas possible de mettre en pratique. En effet, les retraites chapeaux ne peuvent pas être intégrées dans l’assiette des cotisations de droit commun.
Ces dispositifs donnent lieu à la constitution d’un fonds au sein duquel, en principe, les droits des salariés ne peuvent, pas être individualisés par bénéficiaires, ce qui est très problématique, en particulier lorsqu’il s’agit d’asseoir des cotisations et contributions sociales. En effet, les bénéficiaires ne peuvent pas être désignés à l’avance, car l’octroi des retraites chapeaux est conditionné par la présence du salarié dans l’entreprise jusqu’à son départ en retraite. C’est d’ailleurs pour cela qu’a été créée une contribution spécifique en 2003.
Par conséquent, pour des raisons de fond, même si je partageais votre point de vue, monsieur Jeannerot, madame David, la disposition que vous proposez serait techniquement impossible à mettre en œuvre.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Madame la ministre, vous nous dites qu’on ne peut pas préjuger de l’attribution de ces retraites chapeaux. Or, chacun le sait, celles-ci sont l’un des éléments du contrat de travail qui lie le salarié et, bien évidemment, le manager à son entreprise.
À partir du moment où il existe un lien contractuel, il semble tout à fait possible d’établir un lien entre les sommes attribuées au titre des retraites chapeaux et les cotisations sociales qui pèsent sur les salaires.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 217, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 137 -11 -1. - Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
« Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour un montant allant jusqu'à deux fois le plafond de la sécurité sociale, à 30 % pour un montant compris entre deux fois le plafond de la sécurité sociale et trois fois le plafond de la sécurité sociale et à 50 % pour un montant supérieur à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
« Cette contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. »
La parole est à M. François Autain.

Avec l’article 10, il nous est proposé de soumettre à une très modeste cotisation sociale les émoluments correspondant aux retraites chapeaux.
Pour aller dans le bon sens, la création d’un nouveau prélèvement à la charge du bénéficiaire, cette disposition n’en reste pas moins, à notre sens, bien trop modeste. Vous auriez pu aller beaucoup plus loin !

En quelle année ? Je ne me souviens plus très bien ! Il y a vingt ans, voulez-vous dire ? La situation était quand même bien différente !
Vous restez très timide en la matière. Vous allez d’ailleurs au-delà de la timidité puisque vous tirez fierté d’un système de prélèvements particulièrement avantageux – il n’est pas inutile de le répéter –, tant pour les bénéficiaires des retraites chapeaux que pour leurs employeurs.
Pour justifier votre attitude, vous avancez l’argument, certes fondé, que ces retraites sont versées à des salariés dont les situations sont très variées. Il conviendrait donc de ne pas trop les taxer, afin de ne pas les pénaliser.
Cet amendement a précisément pour objet de faire varier le taux de la contribution mise à la charge du bénéficiaire d’une rente versée dans le cadre des régimes définis par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
En effet, comme cela a déjà été maintes fois souligné aussi bien ici qu’à l’Assemblée nationale, les mots « retraites chapeaux » recouvrent des réalités très diverses qui vont du salarié devenu cadre au fil des années et qui perçoit une petite retraite « maison » au cadre dirigeant qui bénéficie ainsi de sommes colossales non soumises à cotisations.
L’objet de cet amendement est précisément de tenir compte des différences entre les bénéficiaires des rentes servies par les régimes à prestations définies. Cependant, dans un premier temps, nous voulons réaffirmer que tout ce qui est issu du travail, quelle qu’en soit la forme, devrait, selon nous, être réintégré dans le salaire, ce qui permettrait d’améliorer la situation des salaires et des comptes sociaux.
Or avec les taux prévus dans le projet de loi, nous sommes très loin du niveau des cotisations qui pèsent sur les salaires en règle générale. Par ailleurs, je tiens à souligner que nous visons en priorité les scandaleux dévoiements que ce régime, qui s’apparente aujourd’hui à un super privilège, a permis et permet encore.
Par conséquent, nous vous proposons de fixer le taux de cette contribution à 14 % pour un montant allant jusqu’à deux fois le plafond de la sécurité sociale, à 30 % pour un montant compris entre deux et trois fois le plafond de la sécurité sociale et à 50 % pour un montant supérieur à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Ce mécanisme devrait rendre beaucoup moins attractives les énormes retraites chapeaux versées aux dirigeants du CAC 40.
Tel est l’objet de cet amendement que je vous demande, mes chers collègues, d’accueillir favorablement.
M. Guy Fischer applaudit.

L'amendement n° 304 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, de Montesquiou et Detcheverry et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Art. L. 137-11-1. – Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.

Nous entamons une discussion quelque peu délicate, au cours de laquelle nous devrons, bien entendu, garder raison.
J’ai étudié avec beaucoup d’attention les diverses propositions formulées en ce domaine, notamment par la commission.
Les amendements déposés sur cet article, par Mme Catherine Procaccia, en particulier, mettent en avant le problème des « petites » retraites. L’Assemblée nationale est déjà intervenue à ce propos, en créant une espèce de machine compliquée pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 300 et 500 euros.
Les amendements que nous sommes sur le point d’examiner visent à instaurer une taxation progressive, par le biais de dispositifs un peu complexes.
Il faut tout de même rappeler, comme l’a fait brillamment M. le rapporteur général, ce que sont les retraites chapeaux. Elles ne constituent pas l’unique retraite mensuelle perçue par les salariés ! Il s’agit de retraites surcomplémentaires qui reposent sur des droits aléatoires prévus à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale : pour bénéficier de la retraite chapeau, l’intéressé doit avoir terminé sa carrière dans l’entreprise.
Ne nous attendrissons pas sur ces petits montants de 300 euros ou de 500 euros ! Revenons, comme je le propose, à la rédaction initiale, en taxant toutes les retraites chapeaux à 14 % dès le premier euro. Cela nous évitera de mettre en place les mécanismes compliqués que prévoient certains amendements déposés sur cet article, qui seraient de toute façon aussi injustes que le dispositif instauré par l’Assemblée nationale.
Je n’ai aucun doute sur le fait que vous m’apporterez votre soutien, madame la ministre, puisque je défends votre texte !

L'amendement n° 206 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, MM. Gournac et P. Dominati, Mme B. Dupont, MM. Milon et Laménie, Mmes Desmarescaux et Rozier, M. Leroy, Mmes Hermange et Bout et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer (deux fois) le montant :
par le montant :
et le montant :
par le montant :
La parole est à M. Philippe Dominati.

Les uns et les autres n’avons manifestement pas reçu les mêmes correspondances ! Sachez que les retraites chapeaux qui nous préoccupent concernent les agents de maîtrise, les ouvriers et les personnes de condition très modeste. Elles ont généralement été créées par les grandes entreprises après la Seconde Guerre mondiale.
En l’occurrence, nous pensons que les seuils proposés sont trop faibles. Nous souhaitons donc prendre comme référence le minimum vieillesse.
L’amendement présenté par Mme Procaccia et plusieurs de nos collègues, que je défends aujourd’hui, vise donc à relever ces seuils. Le taux de la contribution serait fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 euros et 700 euros par mois, ce qui est quand même inférieur au minimum vieillesse, et à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 700 euros par mois.
Pour bien saisir la nécessité d’un tel amendement, il faut comprendre comment s’exercerait une taxation différente. Ainsi, une retraite chapeau de 499 euros taxée à 7 % aboutirait à un prélèvement de l’ordre de 14 euros. Il resterait donc 585 euros au bénéficiaire. Si ce dernier perçoit 2 euros de plus, c’est-à-dire 501 euros, le prélèvement s’élèverait à 14 %, soit 70 euros. Le solde s’établirait alors à 431 euros.
Vous voyez qu’une différence de seulement 2 euros peut donner un écart significatif. Voilà pourquoi nous proposons d’augmenter les seuils en nous référant, par exemple, au minimum vieillesse.

L'amendement n° 210 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, B. Dupont, Bout, Hermange, Rozier et Desmarescaux et MM. Cambon, Laménie, Leroy et J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° La première phrase est complétée par les mots : « sur la fraction excédant ce montant » ;
2° Aux deuxième et troisième phrases, les mots : « les rentes » sont remplacés par les mots : « la fraction des rentes ».
La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Cet amendement de Mme Procaccia, que M. Vasselle a évoqué tout à l’heure, vise à remplacer les mots « les rentes » par les mots « la fraction des rentes ». Nous souhaitons, en effet, que le prélèvement s’effectue à partir de l’euro supérieur à la somme plancher, qui s’établit à 300 euros, à 500 euros ou à 700 euros, afin d’éviter les effets pervers dont parlait Philippe Dominati.

L'amendement n° 287 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 11, deuxième et troisième phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
« Le taux de cette contribution est fixée à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 900 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est fixée entre 500 et 900 euros par mois, ce taux est fixé à 7 %.
La parole est à M. Philippe Dominati.

En commission, nombreux furent nos collègues à être d’accord avec Mme Procaccia pour fixer le seuil aux alentours de 500 euros. Ils furent, en revanche, un peu moins nombreux à se retrouver sur le seuil de 900 euros que je propose ici.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 218 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11, deuxième phrase
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 10.

Avec l’article 10, nous avons plus que le sentiment que vous vous donnez bonne conscience, madame la ministre !
Vous augmentez les prélèvements opérés sur les retraites chapeaux à 14 %. Ainsi, vous donnez le sentiment de faire un pas en direction des Français qui, dans leur immense majorité, ne bénéficient pas de ces dispositifs, en leur faisant croire que vous mettez ces revenus à contribution pour assurer l’équilibre du système de retraite.
Mais, en vérité, vous expliquez en catimini au très petit nombre de personnes qui bénéficient de ces retraites chapeaux qu’elles n’ont pas grand souci à se faire et que ces revenus continueront à bénéficier d’une fiscalité dérogatoire, qui sera plus avantageuse que celle pesant sur les revenus du travail.
Nous l’avons dit à plusieurs reprises, il est absolument anormal que ces revenus soient soumis à des prélèvements inférieurs à ceux dont font l’objet les revenus du travail. Nous continuons inlassablement à défendre l’idée de prélèvements sociaux identiques pour tous les types de revenus, en particulier pour ceux qui profitent à des personnes dont les rémunérations sont déjà élevées. Elles vont bénéficier de garanties de retraite particulièrement favorables, et ce n’est pas tolérable !
S’agissant des taux intermédiaires sur tous les prélèvements, ils sont fixés à 2 %, à 4 % ou à 14 %. Pourquoi 14% ?
Il existe aujourd’hui des taxations normales dans le droit du travail, des cotisations employeurs qui sont reconnues. Pourquoi ne pas appliquer le droit commun des taxations et des cotisations patronales et salariales à ces produits ?

Il devient de plus en plus difficile d’y voir clair dans ces taxations qui subissent une légère augmentation tous les ans, leur taux passant de 2 %, à 3 %. On ne sait plus à quelle logique cela correspond.
Je tiens simplement à rappeler à ceux qui semblent l’oublier que les retraites chapeaux bénéficient aujourd’hui d’une fiscalité plus avantageuse, de près de 9 %, que le taux de droit commun appliqué aux revenus du travail.
Je me permets de vous citer le rapport de la Cour des comptes, qui n’est pas un quelconque document émanant d’un parti politique ! Il y est indiqué que si le Gouvernement acceptait d’aligner les taux de prélèvement sur les retraites chapeaux sur ceux du droit commun, le rendement serait de 820 millions d’euros par an environ.
Pour 60 millions d’euros, vous n’hésitez pas à remettre en question le versement aux familles les plus modestes de la prestation d’accueil du jeune enfant, la PAJE. Pour 100 millions d’euros, vous n’hésitez pas à supprimer le versement rétroactif des aides au logement. Vous n’hésitez pas non plus à diminuer le niveau de prise en charge des médicaments ou à multiplier les franchises sur le dos des plus précaires et marginaux d’entre nous. Et, pour 820 millions d’euros, vous vous gardez bien de toucher aux retraites chapeaux ! Nous voyons qui vous voulez défendre et quel est le sens de votre politique !

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 218.

Par notre amendement précédent, nous proposions un mécanisme composé de trois taux distincts s’appliquant en fonction du montant de la retraite chapeau perçue au regard du plafond de la sécurité sociale. L’objectif était évidemment d’augmenter la contribution sur les retraites chapeaux d’un montant élevé, voire exorbitant, comme il en existe malheureusement.
Par ce nouvel amendement, nous proposons d’augmenter la contribution à hauteur de 20 %.
Nous estimons que ce taux resterait raisonnablement bas au regard de l’ensemble des prélèvements sociaux qui pèsent sur les salaires. En effet, ces retraites chapeaux sont une forme de salaire différé. En tant que tel, elles doivent donc être soumises à cotisations sociales. La réintégration de ces sommes dans le giron de celles qui sont soumises à cotisations sociales participerait à la réduction des déficits de notre protection sociale.
Comme nous ne cessons de le dire, notre sécurité sociale souffre d’une insuffisance chronique de ses ressources. Or le Gouvernement n’est pas allé assez loin sur la mise à contribution de certains revenus du capital, tels que les stock-options et les retraites chapeaux. Il aurait dû être beaucoup plus ambitieux dans ce domaine. Mais nous ne sommes pas surpris !
Nous estimons que les taux avancés par ce PLFSS sont beaucoup trop faibles. Ce qu’il aurait fallu combattre, ce sont surtout les abus flagrants et les détournements du droit commis au profit des mieux informés et des plus riches. En effet, certaines retraites chapeaux, celles qui défraient la chronique, ont été détournées de leur objectif premier.
À la base, les retraites maison avaient été créées au sein des grandes entreprises, au lendemain de la guerre, pour permettre à des salariés modestes de percevoir une retraite convenable. Aujourd’hui encore, elles sont perçues par des ouvriers, des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, ETAM, et des cadres. Le seul reproche que nous faisons à ces retraites, c’est qu’elles ne sont pas assez soumises à cotisations sociales.
Les retraites chapeaux que nous dénonçons, ce sont celles qui sont versées, en toute opacité, aux cadres dirigeants et qui représentent parfois jusqu’à plusieurs centaines d’années de SMIC. Elles sont si scandaleuses qu’elles devraient être interdites ou a minima taxées d’une manière telle qu’elles tomberaient en désuétude.
En attendant, nous proposons de relever le taux de leur contribution à 20 %, ce qui aurait au moins pour conséquence de mieux alimenter les comptes de la sécurité sociale grâce à ces recettes nouvelles.
Tel est le sens de notre amendement.

L'amendement n° 295 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont et Mmes B. Dupont, Hermange et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 11, avant la dernière phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les rentes versées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’une institution ayant fait l’objet d’un agrément ministériel sont exonérées de la contribution.
La parole est à M. Philippe Dominati.

Cet amendement concerne les régimes de retraite maison, qui nous préoccupent réellement. Il y a un moyen beaucoup plus simple d’éviter l’effet de seuil, je veux parler de l’exonération de la contribution pour les institutions ayant fait l’objet d’un agrément ministériel.
Si tel est le cas, c’est obligatoirement parce que le montant des pensions versées aux retraités est modeste. Dès lors, pourquoi ceux-ci devraient-ils en plus pâtir de l’effet de seuil ?
Le moyen le plus simple de l’éviter est d’exonérer lesdites institutions de la contribution.

Ces différents amendements partent dans des directions totalement opposées.
L’amendement n° 217 vise à relever de façon très substantielle le taux de la contribution à la charge des bénéficiaires.
La commission n’a pas jugé bon de suivre M. Autain sur ce point. L’avis est défavorable parce qu’elle considère que le taux de 14 % constitue déjà un effort non négligeable demandé aux bénéficiaires des retraites chapeaux.
Par l’amendement n° 304 rectifié, vous défendez, monsieur Barbier, une position beaucoup plus radicale en proposant de revenir au texte initial du Gouvernement. Vous estimez, en effet, que la progressivité mise en place par l’Assemblée nationale ne serait pas très heureuse. La retraite chapeau venant en plus de la retraite de base et de la retraite complémentaire, la taxer dès le premier euro au taux de 14 % ne serait, en définitive, que justice.
La commission des affaires sociales comprend votre raisonnement, mais le compromis trouvé par le Gouvernement et l’Assemblée nationale semble a priori satisfaisant. Elle n’a donc pas jugé bon de retenir votre proposition. Après avoir entendu les explications de Mme la ministre, j’espère que vous accepterez de retirer votre amendement.
L’amendement n° 206 rectifié bis de Mme Procaccia vise à faire passer de 300 euros à 500 euros et de 500 euros à 700 euros les montants qui avaient été retenus par l’Assemblée nationale. M. Dominati va encore un peu plus loin avec l’amendement n° 287 rectifié bis, puisqu’il tend à fixer le seuil à 900 euros.

La commission des affaires sociales, au nom de laquelle je m’exprime, demande aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer, car elle estime que le dispositif actuel est suffisamment équilibré. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Concernant l’amendement n° 210 rectifié bis défendu par Mme Bernadette Dupond, la commission des affaires sociales y trouve une sagesse dans laquelle le Sénat se reconnaît. Après avoir procédé à un large échange de vues, elle s’est donc prononcée pour un avis de sagesse favorable.

La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 287 rectifié bis. À défaut, l’avis serait défavorable.
Sur l’amendement n° 10, défendu par Mme Schillinger, je me permets de relever quelques erreurs d’appréciation dans votre analyse, ma chère collègue. À plusieurs reprises, vous avez fait valoir que les bénéficiaires de retraites chapeaux bénéficiaient d’une fiscalité dérogatoire. Il n’en est rien ! La fiscalité appliquée aux bénéficiaires de la retraite chapeau est de droit commun. Ce qui est dérogatoire, ce sont les cotisations sociales. Cette précision est destinée à dissiper les malentendus entre nous. Je voudrais éviter que nos concitoyens n’aient le sentiment qu’il existe un système dérogatoire sur le plan fiscal.
S’agissant de l’amendement n° 218, vous voulez, monsieur Fischer, faire passer le taux de 14 % à 20 %. Votre proposition est, certes, plus modérée que celle du groupe socialiste, qui s’établissait à 25 %. Mais malgré cette modération, la commission ne vous suit pas et émet un avis défavorable.
J’en viens, enfin, à l’amendement n° 295 rectifié bis, qui fait référence au régime retraite maison. Vous demandez, monsieur Dominati, une exemption en raison d’un taux trop élevé. Je vous rappelle que nous sommes parvenus à un équilibre dans le dispositif de taxation. Votre proposition ne peut donc être retenue. Je vous demande, au nom de la commission, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Je répondrai d’abord sur les amendements n° s217, 304 rectifié, 10 et 218. Ils visent à augmenter, sous des formes différentes, les taux des contributions à la charge des bénéficiaires.
Le taux de 14 % que nous avons fixé pour cette contribution due par les bénéficiaires des retraites chapeaux n’est pas le fruit du hasard, je tiens à le rappeler. Il permet de tenir compte du fait que les salariés bénéficiaires de ces retraites ne contribuent pas, pour des raisons inhérentes à la construction de ces dispositifs, au financement de cette partie de leurs droits à la retraite au moment où ils sont en activité. Nous rétablissons donc en quelque sorte les choses a posteriori. Il n’y a pas de raison pour que ces personnes contribuent moins, mais il n’y a, à l’inverse, aucune raison pour qu’elles contribuent davantage. C’est donc un point d’équilibre.
Je vais en venir aux amendements n° s206 rectifié bis, 210 rectifié bis, 287 rectifié bis et 295 rectifié bis, qui visent à alléger cette contribution principalement en exonérant les petites rentes. Je dois rappeler ici l’objectif d’équité qui sous-tend la création de cette nouvelle contribution. Il s’agit de se rapprocher du prélèvement auquel sont assujettis, lors de la constitution des droits, les bénéficiaires de rentes issues d’autres formes de retraites supplémentaires instituées par les entreprises. En s’éloignant de cet objectif, votre proposition creuse ainsi l’écart avec les autres bénéficiaires de retraites supplémentaires, y compris lorsque des rentes très importantes de retraites chapeaux sont assujetties.
En outre, il faut garder à l’esprit que ces rentes constituent un troisième étage de retraite. Elles s’ajoutent à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Les comparer à de petites pensions n’a donc pas de sens.
Enfin, nos propositions sur les rentes inférieures à 300 et 500 euros me semblent largement à même de régler les situations que vous visez. J’ajoute que ces décisions vont évidemment être très pénalisantes pour le rendement de la mesure destinée à financer les retraites.
C’est ainsi que l’adoption de l’amendement n° 210 rectifié bis se traduirait, à cet égard, par une perte de rendement de 20 millions d’euros. Or la mesure que nous avons acceptée à l’Assemblée nationale coûte déjà 17 millions d’euros et instaure une franchise de 300 euros pour tous les bénéficiaires, y compris les plus aisés.
J’avoue ma perplexité sur les notions de « sagesse défavorable » ou « favorable ». Peut-être ces éléments intéressants révèlent-ils une certaine gêne de M. le rapporteur général. Quoi qu’il en soit, je retiens la suggestion, formulée
Monsieur Dominati, l’amendement n° 295 rectifié bis pose des problèmes en termes de droit et en termes d’équité. Il n’est, en effet, pas totalement équitable de délimiter le champ des personnes exonérées en fonction de la manière dont leur ancien employeur a institué les systèmes de retraites chapeaux. Ici encore, les abattements que nous avons mis en place sur les rentes inférieures à 300 et 500 euros répondent à vos préoccupations.
À l’inverse, la rédaction que vous proposez, qui englobe les accords d’entreprise, pourrait conduire, dans certains cas, à exonérer des rentes très élevées, ce que personne ne souhaite.
Je voudrais le redire, les propositions que nous avons faites sur ces retraites chapeaux nous ont permis de trouver un équilibre entre la volonté de taxer des retraites qui échappent pour l’instant à toute taxation – dont il convenait de rapprocher la taxation des autres modalités de la retraite tout en préservant les petits retraités. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n ° 295 rectifié bis.
L'amendement n'est pas adopté.

Je m’étonne que Mme Roselyne Bachelot-Narquin ne se soit pas exprimée sur l’amendement n° 304 rectifié, d’autant plus que c’était la proposition initiale du Gouvernement. Je pensais que vous aviez formulé cette proposition de taxation à partir du premier euro en vous fondant sur un certain nombre de principes que vous aviez suffisamment étudiés. Passer sous silence, au cours de cette discussion, notre demande, qui consiste à revenir à une proposition du Gouvernement, me paraît un peu étrange. En attendant d’y voir plus clair, je maintiens, bien sûr, cet amendement.
Je prie M. Gilbert Barbier d’accepter mes excuses les plus complètes. Il arrive que face à une salve d’une dizaine d’amendements, certains échappent à mon attention, surtout à cette heure un peu tardive !
Vous avez raison de le signaler, lors de la rédaction initiale du projet de loi, nous avions instauré un taux uniforme de 14 % sur toutes les rentes de retraites chapeaux. Pour autant, l’amendement qui a été voté par l’Assemblée nationale et qui exonère ou allège le prélèvement sur les petites rentes, me semble juste.
C’est aussi la raison d’être d’une discussion parlementaire au cours de laquelle nous enregistrons l’avis de sagesse, favorable ou non, des uns et des autres. Nous constatons que sur les 90 000 retraités bénéficiaires de ces rentes chapeaux, le montant moyen de rente est de l’ordre de 3875 euros par an et que 80 % des bénéficiaires de rentes perçoivent moins de 6000 euros par an, en plus des deux étages qu’ils reçoivent par ailleurs. Il faut tenir compte de ces éléments, et nous sommes ainsi arrivés à un bon équilibre.
Je vous demanderai donc, monsieur Barbier, au nom du Gouvernement, de retirer votre amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l’amendement n° 287 rectifié bis n’a plus d’objet.
Madame Dupont, l’amendement n° 210 rectifiéest-il maintenu ?
Évidemment, ils sont compatibles, mais l’un majore l’autre. Si, non contents de relever les seuils, on adopte cet amendement, cela mérite un rapide calcul. Nous avions dit que la mesure venait s’ajouter aux 17 millions d’euros votés par l’Assemblée nationale et réduisait de 20 millions d’euros la contribution pour nos régimes de retraites. Le coût total s’élèverait donc à plusieurs dizaines de millions d’euros. Je ne sais pas si les auteurs de l’amendement ont fait les calculs, car il serait utile qu’ils nous communiquent les chiffres !


Je remarque que dans notre Haute Assemblée, nos « sages » sénateurs n’ont pas hésité à repousser de deux ans l’âge légal de départ à la retraite pour faire faire des économies à des travailleurs déjà usés par leur travail. Ils n’ont pas hésité à assimiler le départ anticipé et la pénibilité à l’invalidité des travailleurs, pour faire faire des économies à notre système de protection sociale.
Et voici qu’à l’occasion d’un seul amendement, on perd plus de 20 millions d’euros, qui viennent s’ajouter à la perte déjà enregistrée à l’Assemblée nationale sur les 110 millions d’euros que cette mesure rapportait. Je m’aperçois encore que chacun se bat pour les siens, et sans doute est-ce normal. On aura bien compris que vous défendez ceux qui ont déjà pas mal d’argent et qui en auront encore un peu plus avec ces retraites chapeaux !
Je vous rappelle que, aujourd’hui en France, plus d’un million de nos retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Un grand nombre d’entre eux sont des femmes, qui perçoivent le minimum vieillesse. Soyez en certains, elles n’auront pas, elles, de retraites chapeaux !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 10 est adopté.
I. – À la première phrase du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, le taux : « 2, 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Avec cet article, nous abordons le débat sur la taxation des fameuses stock-options. Leur régime n’a pas été modifié depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2008. La Cour des comptes a publié sur cette question, voilà deux ans, des pages très intéressantes, qui nous permettent de nous appuyer sur des chiffres et un bilan, ce qui est toujours plus satisfaisant qu’un débat purement idéologique.
Philippe Séguin, alors Premier président de la Cour des comptes, n’y était pas allé par quatre chemins. Il avait qualifié d’« assez largement illusoires » les dispositions limitant les stock-options prises dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2008. Celles-ci ne s’appliquaient qu’aux « dirigeants des grands groupes et pas à ceux des filiales, ce qui rendait possible de nombreux contournements ». Pour lui, il n’y avait donc pas de doute. En cas d’écarts de conduite, le Gouvernement devait prendre ses responsabilités en « taxant socialement et fiscalement » ces bonus. M. le président Séguin avançait en son temps le chiffre de 3 milliards d’euros.
Manifestement, vous n’avez pas pris cette voie en déclarant à l’Assemblée nationale, le jeudi 28 octobre : « Beaucoup a été fait par le Gouvernement concernant les stock-options. Beaucoup a également été fait par le patronat, il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître, avec la mise en œuvre opérationnelle d’un code de bonne conduite, sa déclinaison dans les entreprises, un suivi et des comptes rendus. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a été hostile, la semaine dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances, aux amendements visant à durcir le régime fiscal des stock-options. » À cet égard, le rendement de ces relèvements est ici modeste : 70 millions d’euros en 2011, 82 millions en 2012, 113 millions en 2013 et 125 millions en 2014.
Le message est clair. Vous préférez évoquer l’argutie de l’éthique chez les dirigeants pour mieux nous faire oublier le caractère discriminant des stock-options. En effet, les plus-values générées par celles-ci peuvent se chiffrer en millions, voire en dizaines de millions d’euros, contre quelques centaines d’euros pour les petits salariés actionnaires. N’invoquons donc pas l’argument d’une atteinte à leur pouvoir d’achat pour être attentifs à ce sujet !
La fiscalité sociale de ces revenus est arrivée à un tel stade d’illisibilité et de complexité que plus personne n’y comprend rien ! Ce constat est évidemment, pour les plus hauts revenus, une bonne raison de crier au loup quand on évoque la taxation ! Cela leur permet d’échapper à la fiscalité de droit commun. La solidarité doit être un effort partagé !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. - La première phrase du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le taux de cette contribution est fixé à 14 % lorsqu’elle est due sur les options mentionnées au I et à 10 % lorsqu’elle est due sur les actions mentionnées au I. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « de 2, 5 % » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : «, dont le taux est fixé à 8 % pour les premiers et à 2, 5 % pour les seconds ».
La parole est à M. Gérard Dériot.

Les attributions gratuites d’actions, qui constituent un véritable outil de ressources humaines dans nombre d’entreprises, sont attribuées à des catégories très larges de salariés.
C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir les prélèvements sur ces attributions gratuites d’actions, au taux pratiqué actuellement.

L'amendement n° 220, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
1° Alinéa 1
Remplacer le taux :
par le taux :
2° Alinéa 2
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Guy Fischer.

Avec cet amendement, nous proposons d’accroître les prélèvements sociaux qui pèsent sur les stock-options en portant la part patronale à 40 %, au lieu des 14 % visés par l’actuel projet de loi, et la part salariale à 10 %, contre les 8 % qui sont actuellement prévus.
Nous sommes logiques avec notre ligne de pensée.
Cette question de la taxation des stock-options et des distributions gratuites d’actions n’est pas sans importance, puisque, comme l’avait préconisé le rapport de la Cour des comptes remis en 2007, cela devrait permettre de récupérer 3 milliards d’euros au bénéfice de la sécurité sociale. Moins, me direz-vous, puisque, entre-temps, le Parlement a déjà adopté certaines mesures à l’égard des bénéficiaires de ces stock-options et actions gratuites.
Mais ces mesures demeurent très légères, et, en dépit de la crise, les montants distribués aux plus hauts dirigeants des entreprises sous ces deux formes n’ont eu de cesse d’augmenter de manière considérable, je dirai même scandaleuse quand on sait que, dans le même temps, les entreprises du CAC 40, dont les bénéfices ont explosé de 85 % au premier trimestre, sont parmi les premières responsables de la hausse du chômage.
Ainsi, pendant que les uns gagnent beaucoup et toujours plus, les autres, les salariés, perdent leur emploi, ce qui ne manque pas d’affecter négativement les comptes de la sécurité sociale.
Ces rémunérations déguisées, qui permettent de contourner la législation sociale, profitent, bien entendu – comme c’est souvent le cas avec les règles dérogatoires – à une extrême minorité de personnes, qui sont d’ailleurs généralement celles qui perçoivent déjà les plus hauts revenus.
Ainsi, selon le rapport de la Cour des comptes, sur 10 000 détenteurs de stock-options en 2005, en moyenne, les dix principaux bénéficiaires des entreprises concernées s’étaient attribué le quart des titres distribués, et les chefs d’entreprise 6, 7 % ! Autrement dit, un tiers des stock-options revenait à une dizaine de hauts responsables ! D’ailleurs, M. Alain Vasselle le reconnaît lui-même dans son rapport : « Les bénéficiaires des stock-options sont souvent les salariés les mieux rémunérés ».
Dans ce contexte, il nous semble important de tirer les conclusions qui s’imposent et d’augmenter les cotisations sociales pesant sur ces éléments qui, toujours selon le sénateur Alain Vasselle, « s’apparentent à une rémunération », comme s’il s’agissait d’une partie intégrante du salaire.
Malheureusement, connaissant l’opposition du MEDEF à cette mesure, nous craignons qu’elle ne soit pas adoptée.
Pourtant, contrairement à ce qui peut être dit, un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, qui concerne la taxation des employés et bénéficiaires de stock-options, fait la démonstration que le système fiscal français reste très inférieur à ce qui est appliqué dans d’autres pays.
Il reste donc de la marge pour avancer vers une fiscalité plus juste, ce que tend à prévoir notre amendement.

L'amendement n° 481 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer le taux :
par le taux :
II. - Alinéa 2
Remplacer le taux :
par le taux :
Cet amendement n’est pas soutenu.
Les amendements n° 11 et 387 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 11 est présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 387 rectifié bis est présenté par M. Fouché, Mme Bruguière, MM. Doublet, Laurent, Pierre et Gilles, Mmes Henneron et G. Gautier, MM. B. Fournier, Pointereau et Bailly, Mme Hummel, MM. Houel, Milon et Laufoaulu, Mme Sittler, MM. Beaumont, Lefèvre et Braye, Mme Mélot et M. Lardeux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Jacky Le Menn, pour présenter l’amendement n° 11.

L’exigence de justice sociale et l’impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant à contribution toutes les formes de revenus – cela a déjà été dit, mais il n’est pas inutile de le répéter. Il n’est pas acceptable, en effet, que certaines soient exonérées de l’effort de solidarité nationale.
C’est pourquoi le présent amendement tend à prévoir le relèvement de la contribution patronale sur les stock-options et sur les attributions d’actions gratuites de 14 % à 20 %, qui a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2008. Cette contribution permet de faire participer au financement de la protection sociale des éléments de rémunération accessoires aux salaires qui ne sont pas soumis à cotisation sociale.
Ce prélèvement est actuellement dérogatoire par rapport au taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires, qui s’élève à 38 %. Il convient donc de corriger cette injustice en portant le taux de la contribution de 14 % à 20 %.
Ce débat, récurrent, prolonge celui que nous avons engagé à l’article précédent. Nous l’avons largement eu, aussi, à l’occasion de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites, comme nous l’avons, année après année, lors de la discussion de chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Au fond, la question est la suivante : avez-vous la ferme volonté de faire contribuer à l’équilibre de nos comptes sociaux l’ensemble des revenus dont peuvent bénéficier les salariés, quelles que soient l’origine et la nature de ces revenus ?
Cela est d’autant plus important que, après nous avoir accusés voilà quelques années d’être totalement irresponsables et d’empêcher les salariés les plus compétitifs sur le marché international de venir travailler dans les entreprises françaises, vous nous expliquez aujourd’hui qu’il faut prévoir une fiscalité, mais raisonnable !
La vérité, c’est que vous cherchez tous les moyens possibles pour préserver des niches qui favorisent les plus hauts revenus. Mais, au-delà de l’équité et de la justice sociale, il y a la lisibilité et l’acceptation de votre politique par les Français.
Si vous voulez que les Français acceptent vos réformes, vos projets, ils doivent s’y retrouver et comprendre qui est taxé et à quel taux.
Comme vient de le souligner fort justement notre collège Yves Daudigny, la fiscalité sociale de ces revenus est parvenue à un tel niveau d’illisibilité et de complexité que plus personne n’y comprend rien, ce qui est évidemment une bonne occasion pour les plus hauts revenus et leurs conseils de trouver des niches et des moyens d’échapper à la fiscalité de droit commun.
Encore une fois, puisque vous prétendez aller dans le sens d’une meilleure contribution de ces revenus aux comptes sociaux, allez jusqu’au bout et alignez leur fiscalité sociale sur le droit commun, comme nous vous le demandons à travers cet amendement.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° 387 rectifié bis.

Le présent amendement tend à prévoir, comme le précédent, le relèvement de la contribution employeur sur les stock-options et sur les attributions d’actions gratuites à 20 %, au lieu de 14 %.
L’objectif est, d’une part, de moraliser une pratique qui permet à certains dirigeants d’obtenir des rémunérations de plusieurs millions d’euros, d’autre part, de faire contribuer suffisamment et équitablement les stock-options et actions gratuites au financement de notre système social.

L'amendement n° 12, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Face à la dégradation des comptes sociaux, votre gouvernement a choisi de faire peser l’effort sur les assurés par des prélèvements non solidaires qui rapportent peu mais grèvent essentiellement le budget des Français, cela a été rappelé tout à l’heure. Après le recul des bornes d’âge de la retraite, on est en train de donner un deuxième coup de massue sur la tête des Français !
Cet amendement, qui a le même objet que l’amendement précédent, présenté par Jacky Le Menn, tend à relever la contribution salariale.
Nous n’avons de cesse de rappeler que la solidarité est un effort partagé. Mais encore faut-il qu’il soit consenti de manière équitable.
C’est pourquoi le présent amendement tend à prévoir le relèvement de la contribution salariale sur les stock-options et sur les attributions d’actions gratuites à 10 %.
Sans me lancer dans une explication aussi complète et brillante que celle de M. le rapporteur général sur les retraites chapeaux, je voudrais tout de même compléter les propos de notre collègue Yves Daudigny et dire quelques mots sur les stock-options.
Cela a été dit, les stock-options constituent une forme de rémunération. Je tiens à souligner que celles-ci, achetées à un prix plus bas que le marché, permettent de très gros bénéfices lors d’une revente rapide. Nous l’avons constaté à travers des exemples récents dans la presse.
Nous ne devons pas avoir peur d’une mesure qui s’inscrit dans un plan de financement de 25 milliards d’euros de recettes nouvelles à l’horizon 2020.
La contribution salariale sur les stock-options et les actions gratuites a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2008. Son taux, qui était de 2, 5 %, a été augmenté – peut-être un peu laborieusement – par l’Assemblée nationale à 8 %, mais il reste encore très insuffisant. Un chemin reste à faire. C’est pourquoi nous proposons de porter cette contribution à 10 %.
Cela permettrait de faire contribuer au financement de la protection sociale des éléments de rémunérations accessoires aux salaires qui ne sont pas soumis à cotisations sociales.
Ce prélèvement est actuellement dérogatoire par rapport au taux de droit commun des cotisations sociales sur les salaires, qui s’élève à 38 %. Il convient donc de corriger cette injustice.
Enfin, en adoptant cet amendement, madame la ministre, mes chers collègues, je vous propose tout simplement de revenir aux fondamentaux de la sécurité sociale, qui consistent à payer selon ses moyens et à recevoir selon ses besoins.

L’amendement n° 149 rectifié vise à revenir au texte initial du Gouvernement, qui exemptait les actions gratuites de la taxation mise en place à l’occasion de ce texte de loi.
Je voudrais rappeler au Gouvernement et à nos collègues qu’en 2008, lorsque nous avons décidé de taxer les stock-options, reprenant une proposition formulée par la commission des affaires sociales en 2007 et approuvée par les membres de la commission, proposition que le Gouvernement n’avait pas retenue mais qu’il avait reprise l’année suivante dans le PLFSS avec le soutien de l’Assemblée nationale, nous avions taxé de manière équivalente les stock-options et les actions gratuites.
Cette année, pour la première fois, le Gouvernement a décidé de disjoindre les deux sujets en accroissant les taux sur les stock-options, mais en maintenant les taux sur les attributions d’actions gratuites.
Ainsi sur les stock-options, le taux passera de 10 % à 14 % pour la part employeur et de 2, 5 % à 8 % pour la part salariée, alors que pour les options gratuites, nous resterons à 10 % pour la part patronale et à 2, 5 % pour la part salariale.
J’avoue que je recherche la cohérence dans une telle disposition, qui déconnecte les actions gratuites des stock-options. Je suis d’autant plus perplexe qu’un autre amendement, présenté par notre collègue Antoine Lefèvre, tend à faire passer le taux de 14 % à 20 % pour la part employeur à la fois sur les stock-options et les actions gratuites.
La majorité va devoir se déterminer et se positionner soit sur l’amendement n° 149 rectifié de M. Dériot, soit sur l’amendement n° 387 rectifié bis défendu par M. Lefèvre, car ils expriment des positions opposées. Je me permets d’en faire la remarque. C’est la raison pour laquelle la commission avait émis un avis de sagesse.
Nous recherchions tout à l’heure la nuance dans la sagesse : faut-il lui donner un sens négatif ou positif ? Comme Mme la présidente de la commission considère que la sagesse doit être entendue dans un sens favorable et jamais négatif, je vous laisse interpréter vous-même cet avis de sagesse ! §
Avec l’amendement n° 220, M. Fischer propose de faire un bond en avant extraordinaire en portant la part patronale des prélèvements qui pèsent sur les stock-options de 14 % à 40 %. La hausse de la part salariale serait un peu plus mesurée, passant de 8 % à 10 %. La commission émet un avis défavorable, car une telle proposition ne correspond pas du tout à l’équilibre trouvé par le Gouvernement dans l’échelle des taxations.
S’agissant des amendements identiques n° 11 et 387 rectifié, la commission émet un avis défavorable, car elle considère que le taux de 14 % est suffisamment élevé, tout du moins à ce niveau actuel de notre conjoncture.
Quant à l’amendement n° 12, qui s’apparente pour partie à l’amendement n° 220 et qui vise à faire passer le taux de la part employeur de 8 % à 10 %, la commission émet également un avis défavorable.
Je répondrai sur l’ensemble des amendements. En effet, hormis l’amendement n° 149 rectifié de M. Dériot, sur lequel je m’exprimerai à la fin de mon propos, les divers amendements tendent à augmenter les prélèvements sur les stock-options.
Je tiens à rappeler, mais chacun le sait ici, que les stock-options ont trouvé un cadre propice pour se développer entre 1997 et 2002, même si je reconnais que l’idée de contribution spécifique sur ce type de revenus ne date pas d’hier.
Il n’empêche que cette idée a vu le jour depuis le début de cette législature, puisque pas moins de trois dispositions législatives ont abordé ce sujet. Nous avons instauré deux contributions employeurs et bénéficiaires sur les stock-options et les actions gratuites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Dans la loi dite « TEPA » de 2007, nous avons instauré la transparence sur l’attribution de ces avantages aux dirigeants, moralisé les pratiques en imposant l’établissement de critères de performance pour l’octroi de ces avantages. La loi en faveur des revenus du travail du 3 décembre 2008 est venue, quant à elle, conditionner le bénéfice des stock-options aux dirigeants au fait que celles-ci soient attribuées à l’ensemble des salariés ou que ceux-ci aient accès à un dispositif d’intéressement.
Pour accompagner la réforme des retraites, nous irons au-delà : nous portons le taux de la contribution patronale sur les stock-options de 10 % à 14 % et nous triplons le taux de la cotisation salariale, qui passerait – si elle est acceptée – de 5 % à 8 %.
Il s’agit de faire le point sur la taxation des stock-options.
S’agissant des prélèvements sociaux, ces dispositifs sont soumis à des contributions spécifiques dont le taux sera, avec les mesures qui font l’objet du présent article, de 14 % à la charge de l’employeur et de 8 % à la charge du bénéficiaire. Ils sont naturellement soumis aux prélèvements sociaux, CSG et autres contributions sur les plus-values réalisées par ces dispositifs, au taux global de 12, 3 %. Cela fait donc, en matière sociale, 34, 3 %.
Sur le plan fiscal, les taux appliqués sur les bénéficiaires passent, selon le cas – montant et durée de détention – de 18 % à 40 %. Je tiens évidemment à votre disposition le détail des calculs. Cela vous convaincra que nous mettons en place des mesures d’équité entre les différentes formes de rémunération, et ce au bénéfice du financement solidaire de la protection sociale. Au total, les stock-options vont y participer pour 480 millions d’euros au moins.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 220, 11, 387 rectifié et 12.
En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 149 rectifiéde Gérard Dériot, qui vise à maintenir les taux actuels sur les actions gratuites. Le maintien des taux de la contribution patronale à 10 % et de la contribution salariale à 2, 5 % sur les actions gratuites se justifie par leur diffusion plus large aux salariés comparée aux stock-options.
Ainsi, France Télécom a annoncé qu’elle verserait, d’ici à la fin de l’année, entre 1250 et 1870 euros d’actions gratuites à 160 000 salariés du groupe. Récemment, la Société générale a annoncé qu’elle verserait quarante actions gratuites à chacun de ses 161 000 salariés, soit 5, 4 millions d’actions nouvelles créées pour l’occasion.
Les stock-options et les actions gratuites sont deux dispositifs proches, mais on ne peut pas les confondre. D’un côté, on a un outil, les stock-options, utilisé de manière privilégiée pour apporter des compléments de rémunération aux dirigeants en alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. De l’autre, les actions gratuites répondent davantage à une logique de rémunération plus large et d’association des salariés à la performance de l’entreprise. Il s’agit donc de deux philosophies différentes.
J’insiste également sur le caractère moins spéculatif du gain que les actions gratuites génèrent comparativement aux stock-options. Je réponds ainsi à l’observation de M. le rapporteur général. Oui, c’est vrai, les actions gratuites se développent dans les entreprises. C’est un outil de management utile et c’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 149 rectifié. Il est, en effet, pleinement justifié de réserver un sort différent aux uns et aux autres.
Bien entendu, les attributions d’actions gratuites seront assujetties aux contributions aux taux de 10 % et de 2, 5 %. Nous considérons donc, comme vous, que la majoration du taux de cette contribution ne doit pas, cher Gérard Dériot, s’appliquer à ces actions gratuites.

Mes chers collègues, vous êtes plusieurs à demander la parole pour expliquer votre vote sur les amendements encore en discussion. Compte tenu de l’heure, je vais lever la séance, car vous n’aurez pas le temps de tous vous exprimer ce soir. Or, je ne me reconnais pas le droit de priver d’explication de vote ceux qui souhaitent intervenir.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

J’informe le Sénat que la question orale n° 993 de M. Roland Courteau est inscrite à l’ordre du jour de la séance du mardi 16 novembre 2011.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 10 novembre 2010 à quatorze heures trente :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011 (n° 84, 2010-2011).
Rapport de M. Alain Vasselle, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. André Lardeux, Dominique Leclerc et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 88, 2010-2011) ;
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (n° 90, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.