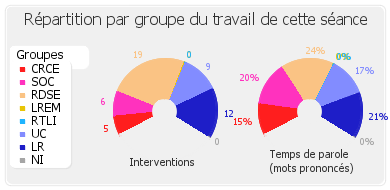Séance en hémicycle du 29 octobre 2008 à 15h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidatures à des commissions mixtes paritaires
- Modification de l'article 3 du règlement du sénat (voir le dossier)
- Crise du logement et développement du crédit hypothécaire (voir le dossier)
- Assurance récolte obligatoire (voir le dossier)
- Nomination de membres de commissions mixtes paritaires
La séance
La séance est ouverte à quinze heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.
J’ai reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail.
J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à cette commission mixte paritaire.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.


Monsieur le président, mes chers collègues, mon intervention sera brève, car la proposition de résolution déposée par M. le président du Sénat n’appelle pas de longues digressions. Il s’agit de faire passer de six à huit le nombre des vice-présidents, et de douze à quatorze celui des secrétaires.
Je rappelle que nous avons déjà connu un précédent historique en 1991, lorsque le nombre des vice-présidents du Sénat a été porté de quatre à six.
Quelles raisons ont-elles incité le président du Sénat à déposer cette proposition de résolution ? Elles sont à mon avis nombreuses, et je vais m’efforcer de les résumer.
Il s’agit, en premier lieu, d’assurer une meilleure répartition de nos travaux.
Chacun a pu s’apercevoir, au cours des derniers mois, que la surcharge de travail a été considérable. Nous avons souvent dû siéger du lundi au samedi, jour et nuit, pour examiner une multiplicité de textes, dont beaucoup après déclaration d’urgence : les vice-présidents ont donc dû se succéder au « plateau » afin d’assurer le bon déroulement de nos travaux. On peut légitimement se demander, dans ces conditions, si le nombre de six vice-présidents est suffisant pour faire face à la tâche.
De même, monsieur le président, vous avez souhaité à bon escient faire passer le nombre des secrétaires de douze à quatorze. Il est en effet arrivé à plusieurs reprises qu’aucun des douze secrétaires, tous pris par de nombreuses obligations, ne soit présent en séance. Avec l’augmentation de l’effectif, la présence de certains secrétaires en séance sera donc garantie de façon plus satisfaisante.
Cette meilleure répartition du travail va de pair avec le souci d’assurer une meilleure représentation des groupes parlementaires au sein du bureau du Sénat.
Si nous appliquions un système strictement proportionnel, il est à craindre, du fait de l’importance numérique du groupe de l’UMP et du groupe socialiste, que les petits groupes comptant une quinzaine de membres ne disposent pas du nombre de représentants qu’ils souhaitent au sein d’un bureau comprenant seulement six vice-présidents et douze secrétaires.
Il faut noter que la préoccupation exprimée par le président du Sénat au travers de cette proposition de résolution correspond parfaitement à l’article 4 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 51-1 qui vise à assurer une meilleure représentation des groupes politiques au sein des différentes instances des assemblées parlementaires.
Il s’agit là, plus globalement, des prémices des révisions constitutionnelle et parlementaire qui doivent intervenir jusqu’au mois de juin prochain.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République nous impose d’adopter sept lois organiques, une révision de notre règlement, ainsi qu’un certain nombre de lois ordinaires. Ce travail considérable doit aboutir à la modification finale du règlement du Sénat sans doute en deux temps, en mars, puis en juin. Il ne serait donc pas opportun d’adopter d’ores et déjà des dispositions tendant à modifier trop en profondeur notre règlement.
C’est la raison pour laquelle j’émettrai un avis défavorable sur les amendements déposés sur cette proposition de résolution, car ils tendent à transformer profondément l’organisation du bureau et de la conférence des présidents, ainsi que le mode de désignation des dignitaires du Sénat. Je propose donc que ces amendements, qui soulèvent des questions aussi importantes que la parité et la représentation des groupes au sein du bureau ou des commissions, soient renvoyés à plus tard, en même temps que l’examen en profondeur de la révision du règlement du Sénat.
Je tiens enfin à souligner, afin de rassurer les uns et les autres, que le passage de six à huit vice-présidents et de douze à quatorze secrétaires se fera à dépenses constantes : pas un centime supplémentaire ne sera déboursé et nul nouveau crédit ne sera imputé au budget du Sénat. Ces modifications interviendront grâce à une meilleure répartition entre les dignitaires des indemnités et du pool automobile. La création de ces nouveaux postes ne coûtera donc pas un sou au budget sénatorial.
Mes chers collègues, je vous demande donc d’adopter sans modification cette proposition de résolution déposée par le président du Sénat.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste.

Monsieur le président, mes chers collègues, compte tenu de la conjoncture actuelle, dans notre pays et ailleurs, on peut s’étonner de la rapidité avec laquelle nous est soumise cette proposition de résolution, dont la discussion va nous prendre un certain temps, et ce alors même que le président du Sénat nous avait annoncé le lancement d’une réflexion générale sur le règlement.
Pourquoi anticiper cette réflexion en créant, comme par un coup de baguette magique, deux postes supplémentaires de vice-président et deux postes supplémentaires de secrétaire ?
La modification de notre règlement devrait avoir pour but – mais ici, rien n’est jamais gagné d’avance ! – de faire une plus juste place à l’opposition et d’assurer à cette dernière l’exercice de ses droits, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
En réalité, monsieur le président, vous avez choisi la voie de la facilité, faute de pouvoir arbitrer entre les deux groupes de votre majorité, celui de l’UMP et celui de l’Union centriste. En récupérant quatre vice-présidences, le groupe de l’UMP a privé l’Union centriste du poste qui aurait dû lui revenir dans le cadre de la représentation proportionnelle.
Voilà pourquoi on nous soumet cette proposition, résultat de petits arrangements entre amis, …

... afin qu’il n’y ait pas trop de déçus.
En 1991, déjà, le Sénat avait modifié son règlement en faisant passer de quatre à six le nombre des vice-présidents et de huit à quatorze, puis à douze, celui des secrétaires. Cette discussion avait d’ailleurs retenu le Sénat durant une longue séance de nuit, tant les oppositions à cette proposition étaient nombreuses.
Notre collègue Jean Arthuis, qui se tait bien entendu aujourd’hui car il préside une commission, avait alors fustigé les arrangements et les compromissions qui avaient présidé à cette modification du règlement.

Par ailleurs, cette proposition introduit une dissymétrie choquante entre le bureau de l’Assemblée nationale et celui du Sénat.
L’Assemblée nationale, avec 577 députés, ne compte que six vice-présidents et douze secrétaires quand le Sénat, avec 343 sénateurs pour l’instant, comptera huit vice-présidents et quatorze secrétaires car, paraît-il, la surcharge de travail serait trop lourde ! Le doyen Patrice Gélard arguerait-il de la moyenne d’âge des sénateurs pour tenir de tels propos ?
En réalité, il ne s’agit pas du tout de cela !
Le Sénat ressemblera donc à une armée mexicaine composée surtout de dignitaires, avec nombre de vice-présidents, de présidents de commission et de secrétaires. Quant aux soutiers, ils assureront la présence en séance et feront le travail !
Le groupe socialiste est fidèle à la position qu’il a toujours défendue et qu’il a soutenue en 1991, par la voix de notre collègue Guy Allouche, en faveur de la représentation proportionnelle des groupes dans toutes les instances, c’est-à-dire au sein tant du bureau du Sénat que des bureaux des commissions. S’agissant de ce dernier point, monsieur le président de la commission des lois, l’adjonction de vice-présidents supplémentaires ne résout pas la question.

La représentation proportionnelle est un système objectif. Elle n’est pas dirigée contre un groupe : il s’agit non pas de déplaire ou de plaire à tel ou tel, mais de répartir les postes conformément à la représentation des groupes politiques au sein de cette assemblée. Si un groupe est trop peu important en nombre pour bénéficier d’un poste de vice-président, un poste de secrétaire doit alors lui revenir afin de lui permettre d’être représenté au bureau. Il en est d’ailleurs ainsi à l’Assemblée nationale, où les postes sont affectés d’un coefficient permettant la représentation de tous les groupes au sein du bureau.

Le groupe socialiste représente aujourd'hui un tiers environ de la Haute Assemblée, proportion qui devrait se retrouver au sein du bureau. Or, aujourd’hui, alors que le groupe UMP, qui compte cent cinquante et un membres, dispose de quatre vice-présidents, le groupe socialiste, avec cent seize membres, n’en a que deux. C’est caricatural ! Et je ne parle même pas des présidences de commission, toutes dévolues à la majorité, alors que, à l’Assemblée nationale, depuis le dernier renouvellement, la commission des finances est présidée par un socialiste.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, l’application de la représentation proportionnelle donnerait trois vice-présidents pour l’UMP et trois vice-présidents pour le groupe socialiste.

Si le nombre de vice-présidents était augmenté, ce calcul devrait naturellement être revu en conséquence.
La proposition de résolution soulève plusieurs questions. Comment sera mise en œuvre la réforme du règlement du Sénat ? Allons-nous seulement élire les candidats aux postes nouvellement créés ou devrons-nous réélire l’ensemble des membres du bureau, hormis le président du Sénat ?

M. Jean-Pierre Michel. Si le règlement était appliqué à la lettre, c’est selon moi cette dernière formule qui devrait prévaloir. Bien entendu, il n’en sera rien ! Il ne faut surtout pas prendre le risque de revenir sur les petits arrangements conclus entre les uns et les autres à l’occasion d’une nouvelle élection à bulletins secrets. Les coups de poignard dans le dos pourraient évidemment se multiplier !
Sourires
Nouveaux sourires.

Si seuls devaient être pourvus les nouveaux postes, alors les deux postes de secrétaires devraient impérativement revenir au groupe socialiste, en vertu de l’article 3, alinéa 9, de notre règlement. Le groupe socialiste serait ainsi normalement représenté au sein du bureau. Il compte pour cela sur le président du Sénat, qui a déclaré lors de son allocution du 14 octobre dernier qu’il comptait réformer un certain nombre des pratiques de la Haute Assemblée, ce en quoi il a vraisemblablement raison.
Toutefois, même si ces postes revenaient au groupe socialiste, les droits de ce dernier seraient encore insuffisamment pris en compte. Si la quantité importe, la qualité également !

Nous avons d’ailleurs déposé un amendement n° 3 visant à modifier l’élection des vice-présidents et celle des questeurs. Nous pensons en effet que les responsabilités de vice-président et celles de secrétaire ne sont pas les mêmes. Les postes de vice-président et ceux de secrétaire doivent donc tous deux être attribués en fonction de la représentativité des groupes politiques.
Enfin, la modification de l’article 3 du règlement soulève une dernière question, brièvement abordée par M. le rapporteur, à savoir celle du financement des postes de vice-président et de secrétaire nouvellement créés. Le président du Sénat a indiqué que cette modification se ferait par redéploiement des crédits et à niveau financier constant.
Pour l’instant, nous n’avons eu aucune information supplémentaire à cet égard, ni en commission ni en séance. À partir de quels postes ce redéploiement de crédits se fera-t-il ? Va-t-on diminuer les indemnités des vice-présidents et des secrétaires aujourd'hui élus ? J’en doute, évidemment !

Va-t-on rogner sur les crédits du pool automobile, du matériel, sur lesquels je ne dirai rien afin de ne pas dégrader davantage la mauvaise image du Sénat auprès de nos concitoyens ?
Toutefois, la modification de l’article 3 du règlement ne réglera absolument pas la question essentielle, à savoir le respect de la règle de la représentation proportionnelle, qui prévaut dans la grande majorité des assemblées parlementaires des pays démocratiques, sauf au Sénat !
Selon moi, cette modification n’améliorera pas l’image du Sénat, déjà ternie par un certain nombre d’articles et de livres, souvent inexacts ou caricaturaux, …

… mais qui sont tout de même publiés et lus, qui font la une des quotidiens et des hebdomadaires.
Je ne pense pas que le vote, dans la précipitation, de cette modification du règlement rendra un grand service à notre assemblée. Cela aurait pu attendre que l’ensemble du règlement soit modifié !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, mes chers collègues, je serai aussi bref que les deux précédents orateurs, car nous ne faisons aujourd'hui que commencer à prendre en compte les conséquences de la réforme constitutionnelle votée cet été.

Nous aurons encore souvent l’occasion, jusqu’au mois de mars prochain, …

… de revenir sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles.
La proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui constitue pour le groupe de l’Union centriste un premier pas vers le nouveau règlement du Sénat. Elle vise, comme l’a rappelé M. le rapporteur, à renforcer le pluralisme dans la composition même du bureau du Sénat et à permettre aux groupes politiques d’être mieux représentés au sein de cette instance.
Cette proposition de résolution ne nous pose pas de problème particulier. Nous l’approuvons telle qu’elle nous est soumise. Nous avons d’ailleurs pris acte de la décision du président du Sénat, que nous soutenons, de procéder à cette modification du règlement dans le cadre du budget du Sénat tel qu’il a été arrêté. Cette modification ne nécessitera pas de crédits supplémentaires, ce qui serait d’ailleurs malvenu. Le bureau fera à n’en pas douter les propositions de redéploiement de crédits nécessaires, et il sera fait ainsi qu’il a été déclaré.
Permettez-moi de prendre quelques instants pour rappeler l’esprit de la révision constitutionnelle.
Si j’apprécie en général les propos tenus par notre collègue Jean-Pierre Michel, je dois dire que l’amendement n° 3 qu’il a évoqué me semble totalement contraire à l’esprit de la Constitution et de la révision constitutionnelle. Il est notamment contraire…

Cet article, je le rappelle, dispose ceci : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires. »

D’un amendement pour lequel je me suis un peu battu, avec d’autres, notamment Mme Borvo Cohen-Seat.

Et M. le rapporteur, effectivement !
Tel qu’il est rédigé, l’article 51-1 constitue aujourd'hui notre loi suprême. Il est contraire à l’application de la règle proportionnelle.

Mais bien sûr que si !
L’idée même de « droits spécifiques » va à l’encontre de la répartition mathématique.

Sinon, il serait sans intérêt que la Constitution prévoie que le règlement de chaque assemblée « reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ». C’est parce que nous avons voulu que chaque groupe parlementaire représentant une partie de l’opinion publique de notre pays puisse s’exprimer et avoir des responsabilités que cette disposition a été inscrite dans la Constitution. Il s’agit de reconnaître des droits spécifiques certes à l’opposition – nous sommes tout à fait d’accord sur ce point –, mais également aux groupes minoritaires, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas les groupes dominants de la majorité ou de l’opposition.
Notre assemblée compte trois groupes minoritaires, tout à fait légitimes.
Sourires

M. Michel Mercier. C’est très bien, monsieur le rapporteur, que vous vous rendiez compte que vous êtes minoritaires !
Nouveaux sourires

Le Sénat compte deux grands groupes dominants, et c’est tout à fait normal.

Ces groupes sont le reflet de l’état de l’opinion publique dans notre pays ; mais des groupes plus petits concourent eux aussi à l’expression du suffrage universel. Ils ont par conséquent le droit d’être représentés dans les instances dirigeantes du Sénat.
L’article 51-1 me paraît donc constituer un véritable progrès pour la démocratie. Si la représentation proportionnelle peut parfois sembler être le meilleur mode de représentation en termes de démocratie, elle peut également empêcher parfois la représentation de ceux qui, légitimement, ont à faire valoir telle ou telle position.
Je suis très heureux que, grâce à la proposition de résolution présentée par M. le président du Sénat, proposition que nous allons voter dans quelques instants, nous puissions faire un premier pas vers l’application de la disposition nouvelle que constitue l’article 51-1 de la Constitution. Nous aurons de nombreuses autres occasions d’y revenir.
Le groupe de l’Union centriste votera donc cette proposition de résolution.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, mes chers collègues, ici même, au moment de la révision constitutionnelle, nous avons eu de longs débats sur les pouvoirs du Parlement, sur le pluralisme, sur les droits de l’opposition, ainsi que sur la nature et le fonctionnement de nos institutions. Nous ne sommes pas d’accord sur ces questions, comme l’ont montré nos discussions et le vote qui a suivi.
Votre réforme, chers collègues de la majorité, est tout sauf consensuelle, et vous le savez.
Pour ma part, je continue de penser et de constater que la pratique constitutionnalisée par la révision récente renforce considérablement le caractère présidentiel – pour ne pas dire monarchique – de nos institutions : le Président de la République, chef de l’exécutif, chef de la majorité et chef du parti majoritaire, dispose de pouvoirs très étendus.
Ce que l’on appelle désormais le « fait majoritaire » est donc particulièrement pesant, comme nous le constatons d’ailleurs dans le fonctionnement du couple exécutif – le Président de la République et la majorité –, que ce soit en matière d’ordre du jour du Parlement, de fabrication de la loi, de débats ou de décisions finales.
Néanmoins, la question de savoir si la réforme des règlements des assemblées à la suite de la révision constitutionnelle permettra un tant soit peu de corriger le fait majoritaire ou si, au contraire, elle le confortera, voire l’aggravera, n’est pas négligeable, tout particulièrement au Sénat.
En effet, chers collègues de la majorité, vous êtes arc-boutés contre toute modification du mode de scrutin, au mépris du plus élémentaire souci de démocratie. Au Sénat, assemblée représentant les collectivités locales, la majorité est toujours la même, quand bien même celle des collectivités locales est inverse !
Alors que l’UMP, parti du Président de la République, ne dispose plus au Sénat de la majorité absolue depuis quatre ans et qu’elle s’en est encore éloignée lors du dernier renouvellement, elle règne sans partage, ou presque – elle a le soutien de l’Union centriste –, sur la Haute Assemblée. Aujourd'hui, la majorité détient, outre la présidence du Sénat, quatre postes de vice-présidents sur six, deux postes de questeurs sur trois, six postes de présidents de commission sur six, …

… la présidence de la nouvelle commission des affaires européennes, celle de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que celle de myriades d’officines diverses.
Quant à l’opposition, elle a un poste de questeur et deux postes de vice-président, tous trois attribués au groupe socialiste.
Cette domination, qui est sans commune mesure avec la réalité politique du Sénat, s’exerce notamment au sein de la conférence des présidents. Cette instance, dont la valeur constitutionnelle est incertaine – rappelons qu’aucune référence à la conférence des présidents ne figurait dans le règlement intérieur avant 1986 ! – est le symbole de l’hyperdomination majoritaire. Vice-présidents, présidents de commission et présidents de groupe y entourent le président du Sénat et décident de tout dans des proportions n’ayant rien à voir avec les rapports de force politique au sein de notre assemblée.
Pour notre part, nous estimons que seuls les présidents de groupe devraient participer à la conférence des présidents, comme c’est le cas à l’Assemblée nationale. Comme vous le constatez, les différences avec l’Assemblée nationale portent donc sur plusieurs points.
Monsieur le président, lors de votre allocution du 14 octobre dernier, vous vous êtes engagé à respecter les droits de l’opposition et à accorder toute sa place à cette dernière. Nous en prenons acte et serons vigilants quant à la concrétisation de cet engagement. Il est important de prendre en compte l’ensemble des groupes politiques et non pas les seuls groupes majoritaires, qu’ils soient dans la majorité ou dans l’opposition.
Vous avez décidé de créer un groupe de travail sur l’élaboration de la réforme du règlement qui doit faire suite à la révision constitutionnelle. Je tiens à cette occasion à insister sur deux points essentiels que le groupe CRC défend depuis de nombreuses années et pour lesquels j’ai plaidé lors de la révision constitutionnelle.
Le premier point tient à la reconnaissance des groupes politiques, outils incontournables d’une revalorisation de la politique que vous avez souhaitée. Cette revalorisation prend, vous en conviendrez, un relief tout particulier avec la crise financière, économique et sociale extrêmement grave que nous connaissons. La confrontation des idées est plus que jamais nécessaire au Parlement.
Le second point est le respect du débat public, garantie de la transparence du travail parlementaire pour notre peuple, dont nous ne sommes que les représentants.
La présente proposition de résolution vise à créer deux postes de vice-président supplémentaires afin de maintenir la représentation du groupe communiste républicain et citoyen et celle du groupe de l’Union centriste.
Cette proposition de résolution appelle deux commentaires.
Tout d’abord, ces postes doivent être financés à budget constant, comme cela a d’ailleurs été indiqué. Tout le monde a conscience qu’il s’agit d’assurer une représentation politique et non pas de courir après un quelconque avantage. Cet aspect est important à l’heure où l’on reproche régulièrement au Sénat le manque de transparence de sa gestion.
Ensuite, si nous en sommes là, c’est parce que l’UMP dispose de quatre vice-présidents sur six et se refuse à toute idée de proportionnalité.
Monsieur le président, vous avez souhaité assurer une représentation la plus large possible des groupes politiques. Il ne s’agit pas d’un rééquilibrage politique, contrairement à ce que laisse entendre le titre de la proposition de résolution, puisque, sur huit vice-présidents, sans compter le président, six seront issus de la majorité, soit à peu près 75 %.
Il s’agit néanmoins d’un pas modeste, mais que nous approuvons, vers une prise en compte de la diversité des groupes.
J’adhère à la philosophie de l’amendement du groupe socialiste, qui porte sur la proportionnalité. Nul ne peut reprocher à mon groupe ne pas être favorable à la représentation proportionnelle en toutes circonstances, y compris pour l’élection des assemblées, mes chers collègues du groupe socialiste !
J’ai eu l’occasion de défendre la représentation automatique de chaque groupe pour la désignation des vice-présidents, assortie d’une pondération à la représentation proportionnelle. Je considère d’ailleurs que la proportionnalité devrait concerner l’ensemble des fonctions exécutives.
La réflexion que nous allons entamer devrait nous permettre de trouver un dispositif plus respectueux des groupes et de la proportionnalité que celui qui prévaut aujourd’hui, mais aussi que celui qui nous est proposé par le groupe socialiste. L’amendement n° 1, déposé par le groupe du RDSE, peut également être pris en compte dans cette optique élargie.
Pour toutes ces raisons, ces amendements et les propositions qui seront faites sur ce sujet devront à mon avis être réexaminés à l’occasion de la discussion de la révision d’ensemble du règlement du Sénat. La question de la conférence des présidents constituera un point majeur de cette discussion.
Le groupe CRC votera, avec les réserves que j’ai exprimées, la modification de l’article 3.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l’article unique.
I. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 3 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :
« - huit vice-présidents, »
II. - Le sixième alinéa du 1 du même article est ainsi rédigé :
« - quatorze secrétaires, ».

L'amendement n° 3, présenté par MM. Michel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour et Yung, Mme Klès, M. Tuheiava, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le 7 de l'article 3 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :
« 7. - L'élection des vice-présidents et celle des questeurs ont lieu au scrutin secret et séparé et par bulletins plurinominaux selon les règles de la représentation proportionnelle. Chaque liste est établie selon le principe de la parité et comporte autant de noms qu'il y a de fonctions à pourvoir. »
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Cet amendement, que j’ai amplement évoqué dans mon intervention liminaire, vise à introduire le principe de la parité dans la constitution du bureau.
Le bureau actuel comprend vingt-deux membres, dont seulement six femmes, soit moins de 30°%. On peut y voir un signe de la grande tiédeur du groupe majoritaire sur la question de la parité.
Lors du dernier renouvellement sénatorial, le groupe socialiste est celui qui a le plus contribué à la progression de la parité dans notre assemblée. Cette progression aurait d’ailleurs été beaucoup plus importante si la représentation proportionnelle avait été applicable dès lors que trois sièges étaient à pourvoir au sein d’un département.
Nous devons instituer le principe de la parité chaque fois que nous sommes en situation de le faire. C’est la raison pour laquelle notre amendement vise à introduire la représentation proportionnelle et le principe du respect de la parité pour la désignation des vice-présidents et des secrétaires.

La parité et la proportionnalité sont certes des problèmes réels, mais ils ne peuvent pas être traités à la va-vite, au détour d’un sujet aussi important que celui que nous abordons aujourd’hui, d’autant qu’ils ne pourront vraiment être mis en perspective que lorsque nous adopterons la révision définitive du règlement du Sénat.
Il faudra donc attendre l’adoption des lois organiques, voire des lois ordinaires, pour mettre en place l’article 51-1 de la Constitution qu’a évoqué M. Mercier.
Cet amendement, si nous l’adoptons, risque de tomber sous le coup de la censure du Conseil constitutionnel parce qu’il est en contradiction avec les articles 4 et 51-1 de la Constitution.
C’est la raison pour laquelle, quel que soit l’intérêt des questions soulevées, je demande à M. Michel de bien vouloir retirer son amendement. Nous pourrons y revenir ultérieurement, lors de l’examen de la refonte de notre règlement, c'est-à-dire au mois de mars, voire au mois de juin.

Oui, monsieur le président ! Le groupe socialiste sera attentif au résultat du vote. S’il devait être battu, cela ne l’empêcherait pas de soulever à nouveau ce sujet lors de l’examen de l’ensemble du règlement.

Monsieur le président, j’indique tout d’abord à l’attention de nos collègues socialistes que leur amendement comporte une faute de frappe. Il vaudrait mieux écrire : « L’élection des vice-présidents et celle des questeurs a lieu », plutôt que : « l’élection des vice-présidents et celle des questeurs ont lieu ». Mais passons !

Monsieur le rapporteur, l’article 51-1 de la Constitution est d’application immédiate. Il suffit d’une proposition concernant le règlement pour le mettre en œuvre.

Excusez-moi ! Je lis la Constitution comme vous, monsieur Gélard ! Et lorsque je lis : « Le règlement de chaque assemblée… », je considère que nous discutons bien d’un texte sur le règlement, lequel prévoit le nombre des postes de ce que l’on appelle un peu pompeusement des « dignitaires ». Nous pouvons donc parfaitement aborder ce sujet maintenant. Par conséquent, je ne suis pas de votre avis !
La question qui se pose, monsieur le rapporteur, cher ami Patrice Gélard, c’est que, si nous n’abordons pas le sujet aujourd’hui à l’occasion de la création de deux postes supplémentaires de vice-président et, accessoirement, de deux postes de secrétaire, nous pourrions, sous réserve de ce que nous adopterons dans la réforme ultérieure du règlement, être amenés à délibérer avec la perspective de démission de collègues qui ont été désignés sur des postes actuels pour respecter les équilibres politiques nouveaux s’il y en a. Or, il serait très désagréable de devoir délibérer, demain, d’une réforme ultérieure du règlement en sachant très bien que, dans l’assemblée, deux, trois ou quatre de nos collègues qui n’auront pas démérité devront renoncer à leurs fonctions.
C’est pourquoi, monsieur le président, je considère que, dès lors que vous avez déposé votre proposition de résolution – elle se comprend et j’en partage les motivations –, il faut aller au fond des choses pour appliquer l’article 51-1. Sinon, je le répète, nous nous engageons sur une voie qui pourrait nous conduire à demander à des collègues désignés pour la durée de la législature, c'est-à-dire pour trois ans, de quitter leurs fonctions actuelles, ce qui serait parfaitement désagréable à leur égard.

Monsieur Charasse, sur la forme, s’agissant de l’erreur que vous avez relevée, il semble que l’on puisse employer le pluriel ou le singulier.

Sur le fond, nous tirons, comme nous en avons le droit, une première conséquence de l’article 51-1 de la Constitution.
L’adoption de l’amendement n° 3 serait contraire aux dispositions de l’article 51-1. Mais nous n’avons pas tiré aujourd’hui toutes les conséquences des « droits spécifiques » des groupes d’opposition et des groupes minoritaires que nous devrons faire figurer dans le règlement. Nous pourrons le faire indépendamment de la mise en œuvre des lois organiques relatives à la modification du règlement sur des points particuliers tels que l’ordre du jour. Nous conduirons ensemble une réflexion globale sur les droits spécifiques des groupes d’opposition et des groupes minoritaires.

Aujourd’hui, nous nous exprimons sur un point. Mais nous aurons à envisager toutes les conséquences de cet article dans la révision du règlement.

Moi qui ne peux pas être suspectée de ne pas être féministe, j’observe que, avant de nous pencher sur la parité pour la composition du bureau, il faudrait se préoccuper de permettre l’élection de plus de 22 % de femmes au sein de notre assemblée.

Les groupes doivent être représentés en tant que tels, et je considère qu’il faut réfléchir en appréhendant l’ensemble des fonctions exécutives.
Le groupe CRC adhère à la philosophie de l’amendement du groupe socialiste. Nous sommes favorables à la représentation proportionnelle. Nous avons d’ailleurs très souvent critiqué la surreprésentation majoritaire au Sénat. Nous voterons donc cet amendement.

Monsieur Gélard, je vous écoute toujours avec un grand intérêt. Il faut avoir une grande imagination pour voir dans l’article 51-1 de la Constitution l’origine de nos travaux.
Monsieur le président, votre élection, dont nous vous félicitons à nouveau, est trop récente pour que nous ayons oublié les circonstances qui nous conduisent aujourd’hui à décider, à votre demande, la création de deux postes supplémentaires de vice-président.
Si nous avions procédé à la désignation des six vice-présidents à la représentation proportionnelle, il y aurait eu trois membres de l’UMP, deux membres du groupe socialiste et un membre de l’Union centriste. Le problème est donc non pas la prise en compte des groupes minoritaires, mais la surreprésentation du groupe relativement majoritaire.
Appliquée à huit vice-présidents, la représentation proportionnelle au plus fort reste – ce mode de scrutin déjà appliqué au Sénat favorise les groupes minoritaires, et nous ne nous y opposons pas ! – aurait pour résultat trois membres de l’UMP, trois membres du groupe socialiste, un membre de l’Union centriste et un membre du groupe CRC. Cherchez l’erreur !

Vous vous mettez où vous voulez, mon cher collègue ! Si vous êtes bien sur le carreau, je ne vous disputerai pas ce terrain de jeu !

Le groupe socialiste a voté cet amendement sur la représentation des groupes, et j’en porte témoignage auprès de Mme Borvo et de M. Mercier. J’ai pris une part dans cette révision, et je l’ai défendue.
Mais peut-on parler d’enthousiasme pour les groupes minoritaires ? En fait, nous sommes non pas dans la représentation des groupes minoritaires, mais dans la surreprésentation du groupe majoritaire !
Le groupe socialiste est favorable à la représentation des groupes minoritaires. Le scrutin à la représentation proportionnelle au plus fort reste garantit cette représentation. Pour autant, nous devons veiller à ne pas encourager la multiplication des groupes. Il ne s’agit pas de donner des garanties aux groupes au risque de voir leur nombre s’accroître à l’infini.
Je ne peux que sourire lorsque l’on évoque le caractère anticonstitutionnel de notre amendement. La Constitution renvoie au règlement des assemblées. Nous sommes tous, dans cette enceinte, des groupes minoritaires. Nous le devons uniquement au fait que, en dépit d’un mode électoral dont le caractère injuste n’a pas été changé, la gauche a progressé.
Mes chers collègues, notre souci de la représentation proportionnelle est un souci d’avenir : nous voulons ménager demain votre opposition, lorsque nous serons majoritaires !
Sourires. –Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Certains d’entre nous – peut-être ont-ils fait leurs études chez les jésuites ? – manient la casuistique à la perfection.

Moins bien que vous !
Sur l’initiative de Jean-Michel Baylet, un amendement visant à assurer la représentation de tous les groupes du Sénat a été adopté à la quasi-unanimité. Il est extraordinaire de constater que certains de ceux qui l’ont voté – mais peut-être sont-ils frappés d’amnésie – trouvent aujourd’hui des arguments pour que les dispositions qu’ils ont adoptées ne s’appliquent pas !
Je serai très clair. Il s’agit de « dignitaires » du Sénat, mais je préfère pour ma part parler de « personnes qui exercent des responsabilités ».

Si l’on procède à un saucissonnage par groupes de quatre, il faut nécessairement obtenir 25 % pour être représenté.
En revanche, de quoi s’agit-il aujourd’hui ? Il s’agit de huit présidents de commissions et de huit vice-présidents. La question concerne donc seize personnes. Sur ce nombre, la place du groupe du RDSE me paraît tout à fait légitime. Je vous rappelle d’ailleurs que vous aviez voté une disposition à cet égard !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du RDSE. – M. Jean-Pierre Michel applaudit également.

Je mets aux voix l'amendement n° 3.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 28 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l’article unique.
L’article unique est adopté.

L'amendement n° 1, présenté par M. Collin et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8 de l'article 3 du Règlement du Sénat, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. L'élection des vice-présidents du Sénat et des présidents des commissions visées à l'article 7 a lieu en s'efforçant d'attribuer au moins un poste de vice-président ou de Président de commission à chaque groupe politique. »
La parole est à M. Yvon Collin.

Le débat sur cet amendement a presque commencé, puisque les interventions relatives à l’amendement précédent ont quelque peu défloré le sujet.
Dans le prolongement de la révision constitutionnelle de juillet 2008, et notamment des articles 43 et 51-1 de la Constitution, le président du Sénat propose de porter à huit le nombre de vice-présidents de notre assemblée. Une prochaine réforme devrait encore créer deux nouvelles commissions permanentes.
Ces dispositions sont conformes à la règle, à la lettre et à l’esprit du nouvel article 51-1, qui dispose que le règlement de chaque assemblée reconnaît des droits spécifiques aux groupes minoritaires. Ces droits résultent d’ailleurs d’un amendement du Sénat, adopté sur notre initiative, et ce à l’unanimité.
Dès lors que notre assemblée comptera bientôt huit vice-présidents, huit présidents de commission permanente et trois questeurs, soit dix-neuf de ses membres investis de responsabilités particulièrement importantes, il nous paraît indispensable de préciser dans le règlement que la désignation aux fonctions confiées à ces dix-neuf sénateurs doit avoir lieu de manière à assurer la représentation de tous les groupes à l'une des fonctions visées.
Au-delà de ces postes, divers honneurs viennent compléter les attributs des groupes les plus importants, encore une fois au détriment des formations les plus faibles et néanmoins représentatives de la diversité politique de notre pays.
Mieux prendre en compte la diversité politique et l’attachement au pluralisme du Sénat, assurer la capacité d’expression des groupes politiques et garantir leur pleine participation à la conduite des travaux de notre assemblée, cela nous semble, monsieur le président, tout à l’honneur du Sénat.
Il importe de traduire désormais cette volonté par des actes. Nous nous y efforcerons tout particulièrement. Le groupe que je préside me semble exemplaire en matière d’ouverture, de pluralisme et de tolérance, excluant toute attitude dogmatique et tout propos sectaire encore trop présents dans notre vie politique, et parfois parmi nous, d’ailleurs.
Je vous invite donc à adopter cet amendement, mes chers collègues. Il fixe le principe et les droits qui en découlent pour tous les groupes, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 51-1 de la Constitution.

L’amendement n° 1 vise à favoriser l’attribution d’au moins un poste de vice-président ou un poste de président de commission à chaque groupe politique.
Il entend tirer ainsi les conséquences non seulement de la création des deux postes de vice-président – cela découle de la proposition de résolution –, mais aussi de la mise en place, encore éventuelle, de deux nouvelles commissions qui pourrait intervenir à partir du 1er mars 2009, comme le prévoit la révision constitutionnelle. En effet, l’article 51-1 ne sera applicable dans son intégralité qu’en mars 2009. Pour l’instant, tel n’est pas le cas.

Je vous renvoie, monsieur Charasse, aux termes de l’article 46 de la loi constitutionnelle. Il précise que le présent article, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la même loi constitutionnelle, entrera en vigueur le 1er mars 2009. Je n’y peux rien, c’est la Constitution !

En outre, un problème se pose dans cet amendement. En effet, les vice-présidents ne sont pas de même nature que les présidents de commission. Ces derniers sont élus par la commission et non pas, comme les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs, par l’ensemble du Sénat.
On en revient donc à l’idée suivante, issue du pluralisme tel que vous l’aviez défendu et tel que l’avait défendu M. Mercier : la solution doit venir d’un consensus entre les différents groupes, en amont des élections.

Cela n’a pas à être inscrit dans le règlement, car cela risquerait de figer le processus. C’est au contraire par une négociation entre les groupes que ces questions devraient pouvoir se régler le plus facilement.
C’est pourquoi, dans l’attente d’éventuelles dispositions que nous pourrions prendre à partir du mois de février et de la rédaction définitive d’un nouveau règlement, je vous demande, monsieur Collin, de retirer cet amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.
Ces remarques sont également valables pour l’amendement n° 2, conséquence de l’amendement n° 1.

Je rappelle, monsieur le président, que vous avez constitué un groupe de travail pluraliste sur l’application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. C’est important. Toutes ces questions seront donc débattues au sein de ce groupe, qui travaillera à l’établissement d’un règlement adapté aux nouvelles dispositions constitutionnelles et, de surcroit, à une modernisation nécessaire de nos méthodes de travail.

Ce groupe se réunira pour la première fois mardi prochain. Je rassure ceux qui n’ont qu’un attachement très modéré pour le terme « dignitaire » : ils ne devraient pas être déçus d’un certain nombre de propositions que nous leur ferons le moment venu !
La parole est à M. Jean-Michel Baylet, pour explication de vote.

Monsieur le président, puisque la plupart de nos collègues et la quasi-totalité des groupes semblent avoir une approche plutôt positive de la nécessité d’une représentation équitable de l’ensemble des groupes dans les commissions, les vice-présidences, etc., et que ces questions ne se poseront concrètement qu’au mois de mars, nous retirons l’amendement ; nous rediscuterons de ces points le moment venu.
Par cohérence, monsieur le président, je retire également l’amendement n° 2.

L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 2, présenté par M. Collin et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, est ainsi libellé :
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1 de l'article 13 du règlement du Sénat, après le mot : « nomment », sont insérés les mots : « leur Président, sous les réserves visées au 8 bis de l'article 3, et ».
Cet amendement a été retiré.

Avant de mettre aux voix les conclusions du rapport de la commission sur la proposition de résolution, je donne la parole à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Si le Sénat avait adopté son amendement, le groupe socialiste aurait voté la proposition de résolution. En l’état, il s’abstiendra, car le résultat de son application sera profondément injuste.
M. Baylet a cru devoir retirer son amendement, auquel nous étions favorables puisqu’il visait à poser le principe que les huit postes de vice-présidents et les huit postes de présidents de commission devaient être considérés comme un tout et qu’il s’agissait, au sein de ces seize postes, de parvenir à une représentation équitable pour tous.

Tel ne sera donc pas le cas puisque, lorsque s’appliquera le nouveau règlement, le groupe communiste républicain et citoyen, qui compte 23 membres, obtiendra un poste de responsabilité, probablement une vice-présidence ; le groupe du RDSE, avec ses 17 membres, n’en aura aucun ; le groupe socialiste, avec 116 sénateurs, s’en verra attribuer deux ; le groupe de l’Union centriste, fort de ses 29 membres, en aura trois, en l’occurrence deux présidences de commission et une vice-présidence ; je ne dirai rien de l’UMP.

On voit donc la profonde injustice qui préside à la répartition des postes de responsabilité.
Voilà pourquoi, monsieur le président, je considère que l’adoption de cette proposition de résolution par le Sénat desservira l’image de notre institution.

Je souhaitais, au nom de mes collègues du groupe UMP, féliciter le président du Sénat de son initiative. Il entend, par le biais de cette proposition de résolution, renforcer le pluralisme au sein du bureau de notre assemblée.
Comme l’a rappelé à juste titre M. Patrice Gélard, rapporteur, l’élargissement de la composition du bureau du Sénat répond à deux modifications introduites dans la Constitution par la révision du 23 juillet 2008 : d’une part, la reconnaissance, à l’article 4 de la Constitution, du principe du pluralisme ; d’autre part, l’affirmation à l’article 51-1 de droits pour les groupes parlementaires. La proposition de résolution qui nous est aujourd’hui soumise répond effectivement à cette double exigence.
Nous nous félicitons également que la création de deux postes de vice-président et de deux postes de secrétaire soit financée par un redéploiement des moyens, sans augmentation globale des dépenses ; cela nous paraît être une sage décision.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP du Sénat adoptera cette proposition de résolution, qui constitue, monsieur le président, « le premier pas de la rénovation interne de notre assemblée et de sa modernisation ».
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

M. Philippe Dallier. Monsieur le président, mes chers collègues, je suis heureux d’avoir demandé la parole, car il ne me semble pas que le groupe UMP ait été saisi de cette affaire, si bien que je n’ai pas eu l’occasion d’exposer mon point de vue.
Sourires

Je m’exprimerai donc à titre tout à fait personnel pour dire que, s’il n’en reste qu’un, ou s’il n’en reste que deux, nous serons ceux-là, et nous voterons contre la disposition qui nous est soumise.
Mes chers collègues, ce n’est pas une erreur que nous commettons : c’est une faute.
C’est une faute d’abord contre le bon sens. On ne fera croire à personne – plusieurs de nos collègues socialistes se sont attachés à le démontrer, mais la tâche était facile – que la solution aux problèmes de représentativité passe nécessairement par la création de deux postes de vice-président. Il était possible de procéder autrement.
C’est encore une faute contre le bon sens, parce que jamais on ne fera croire à personne que, alors que l’Assemblée nationale « tourne » avec six vice-présidents, il en faudrait huit au Sénat, pour la même charge de travail – sauf à laisser penser que les sénateurs n’ont pas la même capacité physique que les députés, ce que je conteste énergiquement.
M. Jean-Pierre Michel applaudit.

C’est enfin une faute contre notre institution. Dans le climat actuel, j’aurais eu honte ce soir de retourner en Seine-Saint-Denis…

Cela peut vous paraître « démago », madame, mais je tiens à dire en séance publique, pour que cela figure au compte rendu, que j’aurais eu honte ce soir de retourner en Seine-Saint-Denis…

Et je constate que le groupe socialiste, qui, après avoir critiqué, a décidé de s’abstenir, aura tout de même pris la peine d’indiquer qu’il aurait été d’accord si les postes lui avaient été attribués !
Je le dis : nous sommes en train de commettre une faute contre le Sénat. Vous verrez demain la réaction dans les journaux, vous verrez le « Zapping » de Canal Plus… Plus tard, nous pourrons ensemble pleurer sur le sort injuste qui est réservé à cette institution, qui est bien trop souvent mise plus bas que terre alors qu’elle ne le mérite pas.
Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste. – M. Michel Houel applaudit également.

Monsieur le président, je comprends parfaitement votre proposition de résolution. Néanmoins, elle me semble fort malvenue en un moment où la France traverse une crise économique terrible.
Notre collègue Philippe Dallier vient de le rappeler : comment, demain, expliquerons-nous à la presse que nous avons débattu de la création de deux postes de vice-président supplémentaires alors qu’au même moment des Français sont dans les difficultés et vivent avec moins que le SMIC ?

Vous insistez, monsieur le président, sur le fait que ces créations se feront à dépense constante. Je vous crois, je crois en votre sincérité, monsieur le président, parce que j’ai confiance en vous. Mais la presse le verra-t-elle de la même façon ? Est-elle prête à nous faire confiance ? Je n’en suis pas sûr.
Je considère en outre que multiplier les vice-présidences revient en quelque sorte à dévaluer la fonction, alors que les vice-présidents du Sénat sont excellents et font déjà un travail formidable. Et, si l’on rapporte leur nombre à celui des élus siégeant dans chaque chambre, on constate qu’à l’Assemblée nationale il y a un vice-président pour 96 députés, alors qu’au Sénat il en faudrait un pour 43 sénateurs…
Je crains que tout cela ne donne l’impression d’être de la « cuisine d’officine ».

Mes chers collègues, j’aurais envie de vous dire : sachons raison garder ! Ceux qui s’offusquent à l’idée qu’il y ait huit vice-présidents au lieu de six ne s’offusquent absolument pas devant les douze adjoints que comptent certaines assemblées municipales, les douze vice-présidents que l’on trouve dans certains conseils généraux, les douze ou quatorze vice-présidents qui officient dans certains conseils régionaux… Ces assemblées sont pourtant moins nombreuses que le Sénat !
Dès lors que M. le président a pris l’engagement – que nous saluons et dont nous prenons acte – que la dépense resterait constante, dispensons-nous de ces émotions de rosière effarouchée !
Rires et applaudissements sur certaines travées du groupe UMP et du groupe CRC.

Monsieur le président, je pense que, grâce à votre proposition de résolution, les groupes minoritaires pourront effectivement être mieux représentés, que ce soit par des vice-présidents ou par des secrétaires, puisque nous créons aussi deux postes de secrétaire.
Pour ce qui me concerne, j’adore ceux qui donnent en permanence des leçons de morale.

La réaction est la même !
Il ne faut pas exagérer les enjeux et, mes chers collègues, je suis désolé de devoir vous dire que vos propos ne contribuent pas à la défense de l’institution. Si vous n’êtes pas heureux comme sénateurs, faites autre chose ! §

Moi aussi je suis présent autant que faire se peut, monsieur Repentin !
Démolir l’institution en permanence, ce n’est pas lui rendre service !

Monsieur Dallier, M. le président a avancé des propositions – il en formulera probablement d’autres – pour mettre un terme à certaines pratiques qui ont eu cours dans notre assemblée. Aujourd’hui, ce n’est pas le sujet.
Pour l’instant, il s’agit d’assurer une meilleure répartition des postes de responsabilité entre les groupes, dans un cadre global, comme nos collègues du RDSE l’ont souhaité.
Je voudrais enfin attirer votre attention sur un point : l’Assemblée nationale n’a que six vice-présidents, mais elle compte aussi beaucoup moins de groupes ! C’est notre différence avec l’Assemblée nationale, c’est aussi notre richesse.

Ne nous privons pas de cette richesse et, au contraire, laissons-la s’exprimer – dans le cadre, bien sûr, qu’a défini le président du Sénat, c’est-à-dire sans augmentation des dépenses. Cet aspect me paraît important, et chacun peut faire des efforts : si les vice-présidents sont plus nombreux, chacun aura moins de travail, et moins d’indemnités complémentaires seront nécessaires !

Monsieur le président, quelle que soit l’estime que j’éprouve pour mes collègues qui viennent d’intervenir – et Philippe Dallier sait très bien que nous sommes très souvent en harmonie sur bien d’autres sujets –, je regrette la tournure que prend ce débat.
Venons-en au fond. D’abord, chaque assemblée s’organise comme elle l’entend !

Les députés ont fixé, depuis fort longtemps d’ailleurs, le nombre de vice-présidents, de questeurs et de secrétaires qui leur convenait.

Si aujourd’hui nous faisons un choix différent, c’est parce que nous sommes libres de décider ce qui nous convient et nous ne sommes pas à la remorque ni aux ordres de l’Assemblée nationale.
Au demeurant, lorsque, au moment de la révision constitutionnelle, il est apparu que les Français de l’étranger seraient désormais représentés à l’Assemblée nationale par huit ou dix députés sur 577, alors qu’ils bénéficient de douze sénateurs sur 341, j’aurais aimé entendre s’élever la voix de certains collègues qui regrettent aujourd’hui les discordances susceptibles d’exister entre le bureau de l’Assemblée nationale et celui du Sénat.

Cette discordance, mon cher collègue et ami, aurait justifié d’autres protestations que celles que nous entendons aujourd’hui !

J’en ai assez que l’on passe son temps à vanter les prétendues vertus de l’Assemblée nationale et que l’on reproche au Sénat ses non moins prétendues turpitudes. Il est souvent question de transparence ; mais nous avons publié nos comptes bien avant l’Assemblée nationale ! Nous n’avons jamais rien eu à cacher ! Bien sûr, si les journalistes sont trop flemmards pour aller au service de la distribution retirer les rapports que le Sénat publie sur son budget et ses comptes, nous ne pouvons pas le faire à leur place ! Nous n’allons pas créer des emplois de fonctionnaires spécialement chargés de prendre les journalistes par la main pour les emmener à la distribution pour prendre les documents comptables, pour faire l’effort de les lire et d’essayer de les comprendre, mais là c’est peut-être beaucoup espérer et demander.
J’ajoute, monsieur le président, puisque nous en sommes aux comparaisons, que je n’arrive pas à comprendre pourquoi le budget de l’Assemblée nationale prévoit une augmentation de près de 4 % en 2009 alors que celui du Sénat se contentera de 1, 3 % avant que vous ne rameniez la progression à zéro au moment de la discussion budgétaire, niveau suffisant pour assurer des moyens nécessaires à notre mission.
J’ai fait un rapide calcul pendant notre bref débat : les dépenses supplémentaires résultant de cette réforme du règlement qui ont été évoquées par certains sont vraiment « à la marge », puisqu’elles représenteront à peine 1 ‰ du budget du Sénat ! Un redéploiement très modeste, mes chers collègues, permettra donc très facilement de régler la question sans tomber dans la démagogie ni ameuter à tort un pays qui souffre assez comme cela !
Depuis plusieurs années, le taux d’augmentation des dépenses du Sénat a montré la modération dont cette assemblée fait preuve, ce qui n’a pas toujours été le cas de l’autre chambre.
Enfin, et ce sera mon dernier point, quoi qu’on en pense, il y a au Sénat une majorité et une opposition. La majorité a élu un président qui est aujourd’hui celui du Sénat tout entier. Je ne peux pas imaginer un seul instant que le président ait pris une telle initiative sans qu’elle ait fait l’objet d’une concertation préalable au moins avec ses amis de la majorité !

M. Michel Charasse. Le Sénat vivrait sans doute très mal le fait que son président nouvellement élu et installé subisse dès aujourd’hui un camouflet de la part de sa propre majorité sur une question somme toute assez accessoire !
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur quelques travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix les conclusions du rapport de la commission des lois sur la proposition de résolution n° 3.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 29 :
Le Sénat a adopté.
En application de l’article 61, premier alinéa, de la Constitution, la résolution que le Sénat vient d’adopter sera soumise avant sa mise en application au Conseil constitutionnel.
Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous remercie d’avoir examiné ce texte, et je pense que vous ne serez pas déçus des propositions que je compte vous soumettre dans les prochaines semaines. §
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux en attendant Mme la ministre.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.
(Ordre du jour réservé)

L’ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 21 de M. Thierry Repentin à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la crise du logement et le développement du crédit hypothécaire.
Cette question est ainsi libellée :
« M. Thierry Repentin attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la crise financière à laquelle est confronté notre pays depuis plusieurs jours, qui viendra immanquablement aggraver la crise du logement qui frappe la France. Après des années d’exubérance sans rapport avec la capacité des ménages à suivre les prix, l’immobilier donne des signes de faiblesse.
« Le Gouvernement a annoncé une série de mesures censées soutenir le secteur de la construction : augmentation des plafonds d’accès au prêt à l’accession sociale, subvention à l’achat de 30 000 logements de promoteurs privés qui ne trouvent pas preneurs... Un projet de loi sans rapport avec la gravité de la situation va être discuté au Sénat, et le sera bientôt à l’Assemblée nationale.
« Il souhaite connaître comment le Gouvernement compte résoudre le déficit de construction de logements à prix abordable pour tous les Français, alors que le projet de loi de finances pour 2009 présente une baisse de 30 % des crédits consacrés par l’État à la construction de logements sociaux, que les collectivités locales sont à la peine et que le secteur de la construction annonce déjà une baisse sensible d’activité et donc du niveau d’emploi.
« Au lendemain de la publication par le Conseil d’analyse économique d’un rapport sur le logement des classes moyennes, qui préconise de développer le crédit hypothécaire en France, il souhaite savoir si le Gouvernement souhaite reprendre à son compte cette proposition, alors même que la tempête qui dévaste les places financières depuis plusieurs semaines est née du marché des subprimes, ces crédits hypothécaires risqués accordés sans retenue par les banques américaines. Il souhaite rappeler que cette proposition avait d’ailleurs déjà été avancée pendant la campagne présidentielle par le chef de l’État. »
La parole est à M. Thierry Repentin, auteur de la question.

Le groupe socialiste, madame la ministre – je suis sûr que vous vous en réjouirez – a choisi de consacrer une séance de l’ordre du jour réservé, non pas pour débattre d’une proposition de loi qu’il aurait pu faire inscrire à l’ordre du jour, mais pour interpeller le Gouvernement sur les difficultés des classes moyennes pour se loger dans notre pays, montrant ainsi l’intérêt qu’il porte à ces questions.
C’est une idée fixe !

C’est une idée fixe, en effet, madame la ministre, compte tenu de la situation et des difficultés rencontrées par un certain nombre de nos concitoyens pour se loger.
Un seul chiffre contribue à situer le débat que nous souhaitons aborder ici avec vous : 10 000. C’est le nombre de familles qui ont été expulsées de leur logement en 2006 pour cause de surendettement. Cette situation s’explique entre autres par le fait qu’aujourd’hui un ménage désirant accéder à la propriété doit faire face à des prix qui ont augmenté de 140 % par rapport à ce qu’ils étaient il y a dix ans.

Conséquence : l’endettement des ménages a lui-même explosé. La durée des prêts s’allonge : un tiers des jeunes ménages qui accèdent à la propriété souscrivent un crédit sur trente ans. C’est le cas de 16 % du total des emprunteurs.
C’est au cœur de cette crise des prix du logement que nous sommes aujourd’hui frappés de plein fouet par la crise financière.
Que les choses soient claires : les désordres financiers ne sont pas à l’origine du manque de logements en France.

Mais le déficit de logements – qui atteint aujourd’hui 900 000 unités – est rendu plus critique par les désordres financiers. Une fois le robinet du crédit stoppé net, il ne reste plus ni investisseurs ni particuliers pour réaliser, construire et acheter des logements.
Ainsi, il est évident que la récession a et aura de lourdes conséquences sur la politique du logement que nous nous devons de mener avec le plus grand volontarisme. La crise contribue, en effet, à assécher les liquidités des banques et donc à restreindre les prêts à l’accession. En conséquence, les ménages composant les classes moyennes, soit ne peuvent plus prétendre à l’accession à la propriété, même « aidée », soit doivent faire face à un taux d’effort au-delà du supportable.
Quant aux catégories populaires, il y a déjà quatre à cinq ans que le marché les a exclues de l’accession à la propriété à coup de prix prohibitifs, n’en déplaise à la pensée magique régulièrement répétée par la majorité.
La crise immobilière et financière a aussi des répercussions sur le secteur du bâtiment, les mises en chantier commençant à connaître un fort ralentissement.
Examinons les ressorts de la mécanique qui nous a conduits à la situation actuelle.
Elle trouve son « principe actif », son accélérateur, dans ce que Bernard Vorms, directeur général de l’Agence nationale pour l’information sur le logement, l’ANIL, a appelé le « paradoxe de la baisse des taux ».
Avec le maintien de taux d’intérêt bas, la part des ménages susceptibles de devenir propriétaires s’est certes trouvée élargie, mais les pourvoyeurs de crédits se sont appuyés sur cet « effet d’optique » des taux bas pour endetter plus longtemps les souscripteurs et souvent pour des montants plus élevés, flirtant sans scrupule avec la ligne des 33 % d’endettement.
Il en est résulté une augmentation continue de l’effort global des ménages depuis une dizaine d’années dans tous les pays développés. Ainsi, la très forte progression récente du coût de l’accession résulte principalement de l’effet inflationniste de la baisse des crédits à l’habitat. Dans un premier temps, cette baisse a amélioré la solvabilité des accédants, accru la demande, induit un ajustement de l’offre, mais, sur le long terme, elle a provoqué la hausse des prix.
Résultat : une augmentation considérable et inégalée du poids des dépenses de logement dans le budget des ménages.
À l’appui de mon propos, j’évoquerai deux indicateurs.
Premièrement, entre 2001 et 2006 – soit une période très courte, vous en conviendrez –, le coût moyen des opérations immobilières financées par emprunt est passé, pour un ménage accédant, de 2, 6 années de revenu à près de quatre années.
Deuxièmement, la durée moyenne des crédits s’allonge : 57 % des prêts sont contractés pour une durée de vingt à trente ans, alors que, en 2003, 60, 4 % des prêts étaient contractés pour une durée inférieure à vingt ans.
Voilà pourquoi les classes moyennes sont maintenant, elles aussi, touchées par cette crise. De fait, elles n’ont pas accès au logement social et elles ne sont ni assez aisées pour pouvoir prétendre à l’accession au regard de l’explosion des prix de l’immobilier, ni assez fragiles pour être concernées par les aides personnelles au logement ou à l’accession. Quant à celles qui ont accédé à la propriété quand le marché était « au plus haut », parce qu’on leur a laissé croire que c’était toujours « le moment d’acheter », elles se retrouvent aujourd’hui contraintes de revendre à un prix sensiblement plus bas.
Face à cette situation, quelle est la responsabilité de l’État ?
Non seulement, vous n’avez pas su prévoir ce déséquilibre du marché immobilier, annoncé pourtant depuis plusieurs mois par nombre d’économistes et de spécialistes de la question, mais en outre le Gouvernement a décidé qu’en 2009 pas un seul euro supplémentaire ne serait engagé par l’État dans la mission « Ville et logement ».
Pire, vous prenez l’initiative de ponctionner le budget de nos partenaires du monde HLM et menacez la pérennité du 1 % logement collecté sur la masse salariale des entreprises pour compenser les économies que vous souhaitez réaliser dans le budget de l’État.
Les crédits de paiement vont connaître une diminution très sensible de 6, 9 %, diminution qui va se poursuivre, comme annoncé, dans les années à venir. Or ce choix est difficilement compréhensible à l’heure où la commission Attali estime que, d’ici à 2020, les besoins en termes de construction s’élèveront à 500 000 logements par an. La ligne budgétaire relative aux aides à la pierre – celle qui est significative pour construire et rénover – sera amputée de 30 %, rien que pour l’année prochaine.
Les arbitrages budgétaires de Bercy nous paraissent d’autant plus inquiétants que la mise en œuvre du plan de cohésion sociale et du programme national de rénovation urbaine va nécessiter un effort et un soutien tout particulier. Où est passé l’euro que l’État devait mettre sur la table pour chaque euro dépensé en faveur de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ? Où est passé l’investissement massif nécessaire pour permettre la construction de logements économiquement abordables, que ce soit au sein du parc public ou du parc privé ? Aujourd’hui, qui garantit durablement à l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, un niveau de financement lui permettant de poursuivre ses missions, alors que sa ressource est extrabudgétaire ?
Par ailleurs, vous affichez, madame la ministre, une volonté de quasi-liquidation du plan de cohésion sociale, avec un budget en baisse pour les aides au locatif social : 350 millions d’euros en 2009, contre 362 millions d’euros il y a cinq ans.
Vous avez également refusé de prolonger, au-delà de 2009, l’exonération durant vingt-cinq ans de la TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le plan de cohésion sociale est donc bel et bien remis en cause !
Lorsque le Président de la République avait annoncé qu’il allait faire du logement son chantier prioritaire, aurions-nous dû comprendre qu’il comptait soumettre les politiques publiques du logement aux seules exigences de la RGPP, la révision générale des politiques publiques ? Quelles que soient les circonstances, il semble accorder, coûte que coûte, la primauté au monde de la comptabilité sur celui du logement de nos concitoyens. D’ailleurs, la RGPP ne fait aucune référence à l’efficacité de la dépense publique ; seule compte la réduction, à court terme, des dépenses de l’État. Qu’importe même si cette réduction entraîne des dépenses supérieures dans un autre domaine ou à très brève échéance, dans un ou deux ans !
C’est curieux comme cette myopie rappelle celle des marchés financiers et de leurs produits à terme, que le Président de la République est pourtant le premier désormais à mettre sur le banc des accusés !
Si, au nom du groupe socialiste du Sénat, je vous interroge sur la crise du logement, madame la ministre, c’est parce que la véritable cause de la crise immobilière réside dans l’absence de relance efficace de la construction, notamment dans le parc social.
Au lieu de cette relance, vous avez encouragé les dispositifs d’aide à l’investissement locatif de manière déraisonnable, sans aucune contrepartie sociale à l’engagement financier de l’État. Cette décision est tellement déraisonnable que ces dispositifs ont permis la construction de logements inadaptés au marché local en dehors des zones non tendues. Ne correspondant à aucune demande, certains n’ont pas trouvé preneur, tandis que d’autres ont fini par trouver des preneurs qui n’avaient pas d’autre choix, même si le logement en question ne leur convenait pas en raison de son poids sur leur budget familial.
Quant au Pass-foncier, il procède de la même logique : il conduit à l’endettement des ménages sur des durées si longues que le moindre accident de la vie risque de les entraîner dans une descente aux enfers.
La situation est paradoxale. D’un côté, l’État investit plus de 30 000 euros dans un logement privé, vendu comme produit fiscal, construit en dehors de toute considération des besoins, et loué au-dessus des prix du marché, et, de l’autre, il consacre à peine 20 000 euros pour construire un logement à un prix abordable, correspondant au pouvoir d’achat des foyers populaires, dans une zone où c’est nécessaire !
Dans le même temps, l’État, mauvais payeur, reste le premier créancier des organismes d’HLM, dont il est pourtant si prompt à critiquer la gestion.
À ce budget en baisse s’ajoute une série de mesures annoncées par le Gouvernement dont on peine à comprendre l’objectif, si ce n’est celui d’envahir la presse d’effets d’annonce pour tenter de rassurer l’opinion. La subvention annoncée par Nicolas Sarkozy pour l’achat de 30 000 logements à des promoteurs privés qui ne trouveraient pas aujourd'hui preneur est un exemple parmi d’autres.
D’abord, cette mesure ne doit pas être une aide directe à des promoteurs privés, dont la modération, la sobriété et la recherche d’une réponse pertinente aux besoins n’ont pas toujours été, au cours de ces dernières années, les qualités premières.
Ensuite, cette mesure est une nouvelle occasion, tout comme le soutien aux PME grâce au livret A, de peser sur le budget de nos partenaires, sans pour autant accroître l’effort de la nation en faveur du logement. Soyons clairs : débudgétiser est non seulement une économie pour l’État, mais aussi une manière de réduire radicalement les crédits consacrés au logement. La part du gâteau se réduit !
Je souhaite vous poser plusieurs questions, madame la ministre.
Premièrement, comment comptez-vous – enfin – réagir pour combler le déficit constaté en matière de construction de logements à loyer abordable en France ?
Deuxièmement, qu’allez-vous faire pour les classes moyennes qui ont acheté leur logement au prix fort et se retrouvent aujourd’hui soit avec un taux d’effort ingérable, soit avec un prix de revente sensiblement plus bas, soit étranglées par un prêt-relais désormais insolvable ?
Troisièmement, allez-vous réellement, comme le préconise une publication récente du Conseil d’analyse économique portant sur le logement des classes moyennes, généraliser les emprunts hypothécaires pour financer l’économie ?
Vous ne pouvez pas réellement croire que de telles mesures seront favorables aux 712 000 ménages – ce sont les chiffres de la Banque de France ! – qui se trouvent aujourd’hui en situation de surendettement. Et je ne parle pas des milliers de ménages qui se sacrifient chaque jour pour faire face à leurs échéances. Le développement de ce type de crédit au profit des particuliers présente de graves dangers et produit des effets pervers sur le surendettement des ménages.
Notre inquiétude est d’autant plus légitime que le Président de la République n’a cessé de chanter haut et fort les louanges de ce dispositif.
Ainsi, il expliquait en 2006, dans une interview accordée au journal Les Echos, sa nouvelle stratégie économique en ces termes: « Je veux développer le crédit hypothécaire en France. C’est ce qui a permis de soutenir la croissance aux États-Unis. »
M. Alain Fauconnier se félicite de ce rappel.

Cette proposition se trouvait aussi dans son programme pour l’élection présidentielle : « Les ménages français sont aujourd’hui les moins endettés d’Europe. Or, une économie qui ne s’endette pas suffisamment, c’est une économie qui ne croit pas en l’avenir, qui doute de ses atouts, qui a peur du lendemain. C’est pour cette raison que je souhaite développer le crédit hypothécaire pour les ménages. »
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

C’est vrai, nous ne le contestons pas, le crédit hypothécaire a dopé la croissance américaine.

J’utilise ce terme à dessein : il s’agissait bien de dopage. Et, comme tous les produits dopants, celui-ci a entraîné des performances artificielles et s’est révélé dangereux pour la santé ! En effet, après avoir vécu au-dessus de ses moyens, l’économie américaine a sombré dans l’overdose et est au bord de l’implosion.
Les références, répétitives, au crédit hypothécaire sont donc particulièrement préoccupantes. Je rappelle que l’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, observe que les États-Unis sont sans doute entrés dans « la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale ». Ils ont d’ailleurs dû, il y a quelques semaines, nationaliser – excusez du peu ! – les deux géants du crédit hypothécaire : Freddie Mac et Fannie Mae. En effet, la tempête qui dévaste les places financières depuis plusieurs semaines est née du marché des subprimes, qui sont des crédits hypothécaires gagés sur l’estimation du bien !
Dans ce contexte, il nous paraît inacceptable de proposer aux familles de recourir à ces crédits hypothécaires risqués, dont on a vu les conséquences dans le monde anglo-saxon. La seule croissance qui est ainsi créée est une croissance des risques et de la spéculation, et non une croissance de la richesse.
Au contraire, il est indispensable d’encadrer les systèmes de prêts et de faire preuve de pédagogie pour éviter que des ménages bénéficiaires de plusieurs prêts immobiliers ou à la consommation ne se retrouvent dans des situations inextricables dont ils ne verraient pas comment sortir.
Je citerai un exemple particulièrement emblématique des conséquences de la crise financière. Les ménages soumis aux prêts-relais se retrouvent aujourd'hui étranglés entre leur promesse d’achat et l’impossibilité de trouver un acheteur pour leur propre bien : soit que l’acheteur n’obtient pas lui-même son crédit, soit qu’aucun acheteur ne fait de proposition au prix envisagé dans le plan de financement. D’autres solutions que les prêts hypothécaires paraissent donc plus adaptées.
J’en viens à ma quatrième question.
Pourquoi ne pas encourager le recentrage du prêt à taux zéro en augmentant son montant moyen – il est aujourd’hui de 15 000 euros – pour améliorer son efficacité sociale et faire en sorte qu’il devienne une aide déterminante dans l’acte d’achat ? Le rapport du Conseil d’analyse économique que j’ai cité tout à l'heure montre bien que le prêt à taux zéro a un effet déclencheur sur l’accession à la propriété et qu’il touche les ménages aux revenus moyens. Au regard de ces considérations et des dispositions contenues dans le projet de loi de finances pour 2009, je souhaiterais savoir quel avenir vous lui réservez, madame la ministre.
En effet, dans l’état actuel des textes qui nous sont soumis, le prêt à taux zéro ne sera plus financé en 2010. Son financement par crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés, par exemple, qui avait été inventé à l’époque par M. Daubresse pour le débudgétiser, n’est prévu que jusqu’en 2009. À moins que vous ne comptiez le rebudgétiser, n’est-ce pas le signe que vous allez laisser disparaître ce dispositif ?
Cinquièmement, comptez-vous favoriser la disparition de l’épargne logement ? Pourtant, relancer le produit d’épargne logement constituerait un signal d’encouragement fort envers les primo-accédants ? En effet, il comporte, à nos yeux, plusieurs avantages indéniables.
L’effort consenti pour épargner constitue un apprentissage très précieux pour la phase d’accession à la propriété. L’épargne accumulée contribue à constituer l’apport personnel, même si le droit à prêt n’est finalement pas utilisé. Elle participe à la fois à la sécurité de l’accédant et à celle du prêteur. Enfin, sa contractualisation et sa contribution à une bonne partie des prêts à l’habitat contribuent à la sécurisation du système financier français. Les banques sont ainsi amenées à intégrer dans leurs bilans une forte proportion des risques et des ressources correspondantes. Cela permet de se protéger de situations comparables à celle des États-Unis, conséquence d’un trop grand recours à la titrisation.
Telles sont, madame la ministre, les quelques questions et propositions que le groupe socialiste voulait soumettre à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
Le débat que nous souhaitons avoir ici, vous l’aurez compris, ne consiste pas à être pour ou contre l’accession à la propriété. Nous voulons simplement prévenir les dangers liés à un discours qui viserait l’accession à tout prix.
Il s’agit d’élaborer une vision raisonnée, dont l’objectif premier est de protéger tant les ménages que les collectivités d’un endettement démesuré et insoutenable. Qui plus est, comme l’indiquait l’ANIL, l’Agence nationale pour l’information sur le logement, en conclusion d’une note consacrée au récent rapport d’information présenté par Frédéric Lefebvre, un député qui vous est proche, madame la ministre, sur les emprunts immobiliers à taux variable, « ce n’est pas un excès de réglementation, ni même la fin de toute imagination commerciale que de faire en sorte que des prêts qui engagent des emprunteurs “profanes” pour plus de vingt ans ne puissent être vendus comme des téléphones portables ».
On ne peut que souscrire à cette once de sagesse dans un débat trop souvent obscurci par des arguties techniques.
Il est temps d’envoyer un signe clair à nos concitoyens. À l’heure où la majorité parlementaire fustige les aides personnelles au logement, où le crédit d’impôt prévu par la loi TEPA, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, va coûter 4, 5 milliards d’euros en régime de croisière, alors qu’il n’est pas pris en compte par les banques pour apprécier la solvabilité des acquéreurs, il y a peut-être mieux à faire, en termes d’utilité de la dépense publique, que d’aider sans discernement les accédants les plus aisés à acheter un logement existant. Plus que jamais, il faut encourager la production de logements « abordables » destinés à une majorité de nos concitoyens.
Au moment où la crise atteint les classes moyennes et enfonce un peu plus les familles endettées, il ne saurait être concevable, selon nous, de généraliser les prêts hypothécaires.
Notre interpellation est donc double. Elle concerne à la fois les outils que vous comptez mettre en place et les moyens financiers que vous comptez engager au service de la politique du logement – je devrais dire les moyens que le Gouvernement vous permettra d’engager.
Par ailleurs, quelle suite entendez-vous réserver, madame la ministre, à la proposition dangereuse consistant à généraliser les prêts hypothécaires ?
Tel est l’objet de la question orale que le groupe socialiste a présentée durant les vingt minutes de temps de parole qui lui étaient accordées aujourd'hui.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la question orale de notre collègue Thierry Repentin, qui se veut d’actualité, apparaît pourtant, si l’on y regarde de près, décalée, voire dépassée.
Décalée et dépassée, parce que, voilà moins de dix jours, durant six jours et six nuits, nous avons discuté et adopté le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Nous avons donc eu, les uns et les autres, tout le loisir de nous exprimer sur la crise actuelle et de poser un diagnostic sur l’état du logement en France. Si nous ne faisons pas tous le même constat, il est difficile de dire que nous n’avons pas pu débattre ! Nous avons également eu l’occasion, par le biais du texte proposé par Mme Christine Boutin et des amendements déposés par tous les groupes, d’examiner les voies et moyens pour construire plus de logements, favoriser l’accession sociale à la propriété, permettre l’accès au parc de logements HLM à un plus grand nombre, et lutter contre l’habitat indigne.
J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur tous ces sujets, en tant que rapporteur pour avis de la commission des finances, ainsi qu’à titre personnel. Nombre de nos collègues sont également intervenus, mais, à aucun moment, me semble-t-il, le crédit hypothécaire, qui vous pose problème aujourd’hui, monsieur Repentin, n’est apparu comme un sujet sur lequel le Gouvernement souhaitait changer la donne. D’ailleurs, le projet de loi, dans la rédaction adoptée par le Sénat, n’y fait aucunement allusion.
Je ne pense donc pas qu’il soit aujourd’hui nécessaire de rouvrir le débat, une semaine seulement après l’adoption de ce texte par le Sénat.

Il revient maintenant à l’Assemblée nationale de se saisir de ce texte. Il sera temps, ensuite, pour les deux assemblées, de rechercher les voies d’un compromis équilibré. Laissons donc la procédure législative se poursuivre normalement !
Cette question orale, outre le fait d’être décalée et dépassée, entretient également la confusion entre crédit hypothécaire et subprimes. C’est absolument regrettable, car point n’est besoin d’en rajouter sur des sujets aussi complexes et sensibles, surtout en période de crise.
Je sais bien que l’on a vu récemment certains élus socialistes, notamment le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, se lancer dans une véritable opération d’enfumage, qui n’a probablement d’autre but que de préparer les esprits à une augmentation des impôts locaux, en comparant des emprunts à taux variables, produits somme toute assez banals, fussent-ils libellés en devises étrangères, aux produits toxiques que sont effectivement les titres composés principalement de subprimes américaines.
Cependant, mes chers collègues, nous ne sommes pas obligés de suivre ici, au Sénat, ce mauvais exemple, qui conduirait nos concitoyens à faire cet amalgame et à jeter le bébé du crédit hypothécaire bien utilisé avec l’eau du bain !
Chacun le sait, le Parlement n’a autorisé, en France, le développement du crédit hypothécaire au profit des particuliers qu’avec prudence et en veillant bien à protéger les intérêts des personnes susceptibles d’en bénéficier, comme l’a prévu la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie.
Chacun sait aussi que l’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire sont très peu utilisés depuis la publication de l’ordonnance du 24 mars 2006, qui a traduit la réforme de l’hypothèque et créé ces deux outils.
Selon les informations dont nous disposons, seulement 10 500 hypothèques conventionnelles rechargeables ont été enregistrées au 31 août 2008. En ce qui concerne le prêt viager hypothécaire, seulement 4 400 prêts ont été autorisés sur un an, de juin 2007 à juillet 2008.
Il s’agit donc là de dispositifs marginaux, maniés avec précaution par les banques françaises, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Surtout, les dispositifs existants et ceux dont le développement, à un moment ou à un autre, a été évoqué en France, y compris par le Président de la République pendant la campagne présidentielle, sont très différents des subprimes américaines avec lesquelles certains semblent vouloir entretenir la confusion.
Ainsi, l’hypothèque rechargeable permet, comme son nom l’indique, de «recharger » l’hypothèque qui a servi à obtenir un prêt, au fur et à mesure du remboursement du prêt initial, et d’utiliser celle-ci pour emprunter de nouveau et mener à bien d’autres projets.
Toutefois, en France – c’est un principe de précaution fort utile –, l’emprunteur ne peut réutiliser l’hypothèque que dans la limite de la valeur initiale de son bien, sans tenir compte d’une éventuelle appréciation de la valeur de celui-ci. Certes, en cas d’acquisition d’un bien à un prix élevé suivie d’une dépréciation immédiate, il pourrait y avoir un décalage temporaire entre le montant de l’hypothèque et la valeur réelle du bien, mais il s’agit là d’un cas extrême. Notre système comporte, globalement et intrinsèquement, un solide garde-fou, qui n’existe pas forcément ailleurs.
Notre collègue Repentin fait le parallèle entre les subprimes américaines et le crédit hypothécaire, en reprenant un rapport du Conseil d’analyse économique rendu public ce mois-ci.
Cependant, il oublie de nous dire que les auteurs de ce rapport rejettent un système hypothécaire pur, dont les carences sont aujourd’hui bien visibles, et proposent d’instaurer un encadrement de la distribution de crédits immobiliers qui permette d’exclure les formes les plus risquées d’emprunts.
Au demeurant, ce rapport, élaboré dans un autre contexte et publié aujourd’hui, n’engage que ses auteurs. Il est, lui aussi, en décalage avec la réalité du marché du crédit et du logement.
Les choses doivent être bien claires : personne ne propose d’introduire aujourd’hui en France un système identique à celui des subprimes américaines. Le groupe UMP du Sénat y serait de toute façon totalement opposé.
La question posée par notre collègue Thierry Repentin est également décalée et dépassée par rapport aux enjeux et aux vraies questions qui se posent aujourd’hui.
Notre pays doit en effet faire face à une crise très grave du crédit et à ses lourdes répercussions, en particulier dans le secteur du logement.
Les derniers chiffres diffusés hier montrent une très nette dégradation de l’activité dans ce secteur essentiel pour l’économie et l’emploi. Le nombre de permis de construire s’est ainsi effondré en France de 23, 3 % au troisième trimestre 2008 par rapport à la même période de l’année dernière, et le nombre de mises en chantier a reculé de 8, 1 %.
Sans attendre, le Président de la République a annoncé, au début du mois d’octobre, un plan ambitieux pour soutenir le secteur du bâtiment et répondre aux besoins des Français.
Nous l’avons dit lors de l’examen du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, le groupe UMP salue une telle réactivité et soutient les mesures annoncées : lancement d’un programme exceptionnel d’acquisition en VEFA, vente en l’état futur d’achèvement, de 30 000 logements ; augmentation de 20 000 à 30 000 du nombre d’opérations finançables en Pass-foncier ; augmentation du plafond du prêt d’accession sociale au niveau du prêt à taux zéro pour faciliter l’octroi de prêts immobiliers par les banques ; mobilisation des terrains de l’État et de ses établissements publics, notamment ferroviaires.
Bien entendu, certaines questions se posent sur l’articulation de ce dispositif avec le projet de loi de finances pour 2009 et l’adéquation de ce dernier à la réalité du secteur du logement à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.
Lors de la discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, j’ai évoqué le financement de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, et de l’ANAH, l’agence nationale de l’habitat, les débudgétisations programmées et la mise à contribution du 1 % logement.
Ce sont des questions importantes qui devront être abordées de nouveau lors de l’examen du projet de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, puis du projet de loi de finances pour 2009, en particulier des crédits de la mission « Ville et logement ».
Le débat que nous rouvrons aujourd’hui, entre l’adoption du projet de loi pour le logement et le débat budgétaire, n’a pas de véritable sens, puisque nous allons revenir sur ces sujets d’ici à quelques semaines. C’est la raison pour laquelle il me semble que nous sommes en décalage.
Soyez néanmoins assurée, madame le ministre, que le Sénat, et en particulier sa commission des finances, contribueront activement au débat, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, en cohérence avec les mesures de soutien annoncées par le Président de la République, auxquelles le groupe UMP apporte son soutien.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je comprends la gêne de mon collègue Philippe Dallier, qui évoque un « débat décalé » pour qualifier l’initiative de notre collègue Thierry Repentin.
Pour ma part, je ne crois absolument pas que ce débat soit décalé. En effet, nous sommes au cœur d’une crise financière mondiale. Or une erreur n’est pas grave quand elle est corrigée. S’il y avait persistance dans l’erreur, …

… nous nous « enfoncerions » dans la crise. Pour cette raison, il est important d’aborder la question du crédit hypothécaire et de sa généralisation à outrance de façon claire et sans détour. Si nous ne le faisons pas, la persistance dans l’erreur nous conduira inévitablement au même résultat.
Vouloir à tout prix séparer, d’une part, les subprimes américaines et, d’autre part, le crédit hypothécaire et sa généralisation est, à nos yeux, une erreur. Il faut s’affranchir, dans la situation que nous vivons, d’un corpus néolibéral triomphant, en tirant les enseignements concrets de la réalité des crédits hypothécaires.
Cette crise constitue en effet l’occasion de redéfinir nos priorités. Plus que jamais, dans un contexte très difficile, nous avons besoin de clarté. Celle-ci est indispensable pour nos concitoyens – je pense en particulier, comme Thierry Repentin, à ceux qui ont contracté des crédits et sont en situation difficile –, indispensable pour les établissements bancaires et pour nos négociations internationales.
La position des élus socialistes est nette. Notre responsabilité d’élus aux prises avec les difficultés sociales est non pas de promouvoir à marche forcée le slogan du Président de la République, qui aime à évoquer « la France des propriétaires », mais de prévenir « la France de l’endettement maximum », d’aider des ménages modestes à accéder à la propriété dans des conditions sécurisées. Pour une famille, en effet, il n’y a rien de pire que l’échec d’une accession à la propriété, échec qui se traduit souvent par un endettement important pour, au final, n’aboutir à rien.
Notre responsabilité n’est pas d’inciter, par tous les moyens, à la consommation déraisonnée, à la hausse artificielle du pouvoir d’achat et de nier euphoriquement les éventuels accidents de la vie. Vous connaissez notre position, mais je ne suis pas sûr de comprendre celle que vous entendez défendre sur le long terme.
Je ne vous ai pas beaucoup vu lors de l’examen du projet de loi !

Je crains que la modération que vous affichez aujourd’hui ne soit qu’une façade et que, d’ici à quelques mois, ressortent des projets allant encore plus loin. Nous avons quelques raisons de nous inquiéter. À cet égard, je me permettrai d’effectuer un rappel des textes ou rapports que vous avez soutenus ces dernières années.
En 2005, alors que Nicolas Sarkozy était ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, il avait entrepris « l’import juridique » du système de l’hypothèque rechargeable. Pour éviter le débat, le Gouvernement avait alors choisi de procéder par voie d’ordonnance. C’est ainsi que, dans le but de permettre aux personnes propriétaires de pouvoir dégager des revenus et contracter d’autres prêts, l’ordonnance du 24 mars 2006 relative aux sûretés avait ouvert deux nouvelles formes de crédit. La première, l’hypothèque rechargeable, autorise l’emprunteur qui a déjà constitué une hypothèque pour l’achat d’un bien immobilier à affecter une partie de celle-ci, proportionnelle au montant du crédit déjà remboursé, à la garantie d’un autre crédit. La deuxième, le prêt viager hypothécaire, permet d’obtenir un prêt garanti par un bien immobilier à usage exclusif d’habitation, sachant que le prêt n’est remboursé qu’au décès de l’emprunteur par la vente de son bien.
L’adoption de cette ordonnance, faute de débat parlementaire, avait fait l’objet d’une grande campagne au sein de l’UMP, où la fascination pour des méthodes de distribution de crédit immobilier explicitement inspirées des États-Unis était flagrante. Déjà, à l’époque, le groupe socialiste s’était élevé contre ces propositions.
Autre source d’inquiétude : un rapport sur l’hypothèque et le crédit hypothécaire, commandé par Nicolas Sarkozy, alors ministre d’État, proposait, dès 2004, d’accroître la fluidité du crédit hypothécaire tout au long de la vie du prêt. L’idée exposée était simple : « Une hypothèque initialement inscrite à l’appui d’un premier prêt, le plus souvent immobilier, peut être réutilisée, sans nouvelle formalité de mainlevée ou d’inscription, pour garantir de nouveaux prêts. »
Il s’agissait ni plus ni moins du système américain, à une nuance près : la recharge servait à financer des « dépenses de travaux ou d’équipement ». Aux États-Unis, elle est utilisée pour contracter un autre prêt à la consommation. C’est le crédit revolving sans barrières, où prêts à la consommation et prêts immobiliers se confondent sans limite, pour la plus grande insécurité des emprunteurs.
Là encore, nous avions fait part de très vives préoccupations. Nous savons que le dispositif existant en France n’est pas strictement identique au dispositif américain. C’est peut-être même l’une des raisons pour lesquelles il ne s’est pas développé : le système du cautionnement, combiné au maintien d’une étanchéité entre les prêts à la consommation et les prêts immobiliers, a préservé notre pays des conséquences les plus dramatiques de ce système.
Depuis, il est vrai, certaines personnes ont ouvert les yeux et sont revenues, sinon à un enthousiasme plus modéré, du moins à une position plus raisonnable.
Dans un récent rapport, Frédéric Lefebvre, député UMP, se félicite de l’échec de la mise en œuvre de ces nouveaux produits. Il y voit même l’une des principales explications de la meilleure résistance du marché français à la crise.
Le problème, c’est que plusieurs faits intervenus depuis cette ordonnance de 2006 nous conduisent à penser que ce retour à une position plus mesurée ne peut être que conjoncturelle. Les propositions du candidat Sarkozy en 2007 et la publication d’un récent rapport du Conseil d’analyse économique, le CAE, vont, en effet, dans le sens du développement du crédit hypothécaire.
En septembre 2006, Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidence de la République, et dont l’objectif était de voir 70 % des Français devenir propriétaires de leur logement principal, déclarait : « En France, nous privilégions la garantie sur les personnes, ce qui conduit les établissements bancaires à écarter du marché du crédit tous ceux dont la situation professionnelle n’est pas assez stable pour assurer des revenus durables. Cette tradition n’est pas une fatalité. Il suffit de changer les règles prudentielles imposées aux banques, de simplifier le recours à l’hypothèque et d’en réduire le coût. ».
Avouez quand même, mes chers collègues, qu’un tel discours traduisait une fascination pour le système américain qui, aujourd’hui, paraît pour le moins décalée !
Il ne fait aucun doute que cette proposition visait les ménages les plus modestes. Comme aux États-Unis, il s’agissait d’établir un lien direct entre la valeur du bien estimée sur le marché et la capacité d’accès au crédit.
On sait qu’aux États-Unis, la baisse des prix des actifs immobiliers a d’abord entraîné une diminution des capacités d’emprunt et d’accès au crédit, avant de rendre la demande de logements moins solvable et, enfin, un peu comme un jeu de dominos qui s’écroule, d’entamer la capacité de consommation des ménages. Les ménages les plus modestes ont vu leurs logements saisis, les banques ne pouvant espérer retirer de la vente de ces biens qu’une valeur très inférieure à celle estimée initialement. Finalement, c’est l’économie en général qui en a pâti, et qui se trouve aujourd’hui plongée dans une crise durable.
Le deuxième fait marquant, et qui alimente nos craintes, madame la ministre, c’est le rapport du Conseil d’analyse économique, qui vous a été remis le 30 septembre dernier.
Les auteurs de ce rapport estiment qu’en matière de crédits immobiliers, « la France n’a pas intérêt à défendre à tout prix une exception dont les vertus sont établies, mais qu’il n’est pas illégitime de faire évoluer », que les premiers pas accomplis par l’ordonnance de 2006 « restent pour le moins insuffisants », et que « le développement d’un marché financier de titrisation hypothécaire est la condition du développement du marché de l’hypothèque en France ».
Les propositions contenues dans ce rapport sont-elles encore défendables aujourd’hui, madame la ministre ?
Pour leur part, les socialistes ont une vision du logement qui n’est pas strictement patrimoniale. Dès vos premières propositions, nous avions tiré la sonnette d’alarme et nous nous étions prononcés contre la généralisation du crédit hypothécaire rechargeable. Croyez-nous, madame la ministre, nous aurions préféré ne pas avoir raison sur ce thème ! Aujourd’hui, il est encore temps de réagir avant que le train ne déraille. C’est ce que nous vous invitons à faire !
Aussi, madame la ministre, nous nous permettrons de vous poser plusieurs questions précises.
Souhaitez-vous poursuivre l’œuvre entreprise et importer purement et simplement en France le système américain, dans lequel les crédits à la consommation sont adossés aux prêts au logement ?
Voulez-vous faire des ménages français des spéculateurs malgré eux, qui consommeraient au-delà du raisonnable mais qui vivraient en permanence avec la menace de la dépréciation de leurs biens immobiliers planant au-dessus de leur tête et de celle de leurs enfants ?
Souhaitez-vous continuer à promouvoir un système de retraite par capitalisation, dont il faut rappeler qu’il repose de plus en plus sur les valeurs financières et immobilières, au détriment des valeurs de solidarité entre les actifs et les inactifs ?
Souhaitez-vous persister à n’apporter que des solutions bancaires et financières à la crise du logement, alors que celle-ci est avant tout une crise de la construction, d’où découle un défaut d’adaptation de l’offre à la demande, et une crise du foncier constructible ?
Souhaitez-vous exiger des banques, auxquelles l’État s’apprête à donner 10 milliards, qu’elles recourent avec la plus grande mesure à ces crédits ?
Au fond, madame la ministre, quels risques êtes-vous finalement prête à faire prendre aux ménages les plus modestes ?
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, après l’examen, en première lecture et en urgence, du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, le débat que nous avons aujourd’hui prend une autre tournure.
Cette discussion prend une allure de redite et de bilan des débats qui nous ont occupés la semaine dernière.

Dire qu’il existe une crise du logement dans notre pays relève du lieu commun. Les déclarations triomphales faites, voilà quelques mois, sur le niveau exceptionnel de construction de logements, y compris de logements sociaux, semblent avoir mal supporté l’épreuve de la crise économique, dont l’une des conséquences les plus immédiatement perceptibles est le ralentissement de l’activité du bâtiment et de l’immobilier.
Chute de 25 % des mises en chantier, chute de 30 % des transactions immobilières, émergence d’une situation dramatique pour 30 000 accédants à la propriété victimes des prêts-relais, aggravation de l’endettement des ménages, notamment en raison des prêts immobiliers à taux variable : tout cela concourt à la crise ! Au demeurant, s’il fallait encore se convaincre des désordres constatés dans le secteur, on pourrait rappeler qu’un des principaux opérateurs immobiliers, Nexity, a annoncé l’abandon de 110 programmes et le licenciement de 500 salariés, tandis qu’un important réseau d’agences immobilières, ORPI, s’apprête à fermer 30 agences.
Je donnerai également quelques indications à propos de la situation qui prévaut sur le front de l’emploi. Le secteur de la construction, avec une moyenne de 18, 2 heures supplémentaires sur le second trimestre 2008, continue de solliciter avec une constance avérée le dispositif instauré par la loi TEPA. Mais, dans le même temps, les services du ministère du travail nous indiquent que 8 500 emplois intérimaires ont disparu dans le secteur, tandis que les créations d’emplois n’ont finalement progressé que de 4 000 postes sur la période.
Alors qu’en principe, au deuxième trimestre, les beaux jours favorisent l’activité du bâtiment, le ralentissement est sensible au niveau de la création d’emplois. Il faut dire que la loi TEPA, qui incite les entreprises à arbitrer au mieux entre heures supplémentaires, intérim et embauches fermes, pèse lourdement sur l’emploi. À force de donner priorité au mirage du « travailler plus pour gagner plus », vous allez, par la chute de l’intérim et celle des embauches directes, priver l’industrie française du bâtiment des forces dont elle aura besoin, demain, pour relever les défis, à commencer par celui du logement pour tous et partout.
Cette crise du logement est donc aussi la crise d’un secteur économique. Elle est aggravée par des choix politiques néfastes, et elle appelle un certain nombre d’observations complémentaires.
II y aurait, selon les associations de lutte pour le droit au logement, 2, 5 millions de ménages mal logés, sans-abri, précairement hébergés ou résidant dans des logements insalubres ou surpeuplés.
En guise de réponse, le Gouvernement a essentiellement, ces dernières années, développer l’offre de logements, avant de s’inquiéter des caractères de la demande. Des centaines de millions d’euros ont ainsi été distraits des ressources publiques pour inciter les particuliers à réaliser des investissements locatifs – les régimes « Robien » et « Borloo » – tandis que des millions ont été mobilisés pour permettre aux établissements de crédit d’entraîner des ménages moyens et modestes dans la spirale de l’endettement, sans le moindre risque pour ces établissements.
La dépense publique pour le logement a été profondément dénaturée. Les crédits de la mission « Ville et logement » se limitent désormais à la prise en charge partielle des aides personnalisées au logement. Quant à la part des crédits destinés à la construction de logements locatifs sociaux neufs et à la réhabilitation du parc existant, ils ne cessent de diminuer, par la voie de la régulation budgétaire et des ajustements réalisés par les collectifs de fin d’année.
Je me contenterai d’énumérer quelques signes, bien connus, de cette politique que nous condamnons depuis 2002.
Ainsi, l’État n’a jamais respecté les engagements qu’il avait pris dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, alors même qu’il s’apprête aujourd’hui, avec le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, à solder son découvert en faisant main basse sur le 1 % logement !
Les engagements non respectés trouveront d’ailleurs en 2009 une nouvelle illustration, puisque la prime à l’amélioration des logements à usage locatif, PALULOS, va passer par pertes et profits pour toute opération qui n’entrerait pas dans le cadre des programmes menés par l’ANRU.
La crise du logement, c’est aussi cela, mes chers collègues !
Dans la dernière période, la construction de logements sociaux tient, d’une part, à la montée en charge des logements PLS, peu consommateurs d’aides publiques directes, et, d’autre part, au fait que les communes présentant un déficit de logements sociaux dans leur habitat ont finalement décidé, dans leur majorité, de mettre en œuvre la loi SRU.
C’est pourquoi, remettre en cause la loi SRU, ce serait aujourd’hui prendre le risque d’aggraver les crises du logement, de l’emploi et de l’activité dans le bâtiment ! Madame la ministre, je ne pense pas que le projet du Gouvernement soit d’augmenter le nombre des sans-emploi dans notre pays !
Pensez-y avant de chercher comment vous allez faire rétablir par le Palais Bourbon l’article 17 du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, que le Sénat a massivement, et justement, rejeté !
Pensez-y aussi quand vous laissez croire que l’accroissement de la mobilité des locataires, en mettant dehors les locataires en sous-occupation ou prétendument privilégiés – un couple d’enseignants sans enfant, par exemple -, permettra de répondre aux besoins.
Toutes ces propositions ne font que tourner autour de la solution, à savoir la construction de logements sociaux de qualité, en quantité suffisante pour inverser le processus d’aggravation de la crise du logement.
La construction, parlons-en ! Ce qui pose problème, mes chers collègues, depuis 2002, c’est que la majorité a voté des lois dont il résulte que 70 % de l’offre de logements existante n’est destinée en fait qu’à 30 % des demandeurs de logements.
Les logements « Robien », c’est bien quand ils sont loués ! Mais quand ils ne correspondent pas aux attentes des demandeurs de logement, c’est un gâchis sans nom ! Par quel miracle voudriez-vous qu’un couple, dont les revenus se situent sous les plafonds HLM, soit prêt à payer 1 500 ou 1 600 euros par mois pour se loger dans du « Robien », logement par ailleurs largement défiscalisé ? En revanche, le même couple est autorisé à voir le produit de ses impôts dispendieusement utilisé pour aider des investisseurs immobiliers qui pourraient se contenter des modalités normales d’imposition des revenus fonciers !
S’agissant de l’offre locative, comment ne pas relever encore que la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 ou que la loi relative à l’habitat du 21 juillet 1994 ont favorisé la poussée urticante des loyers et la flambée des quittances ?
De fait, mes chers collègues, le parc social n’existe quasiment plus, la loi de 1948 n’étant qu’un lointain souvenir de temps révolus ! Ce qui existe, en revanche, c’est un parc locatif privé qui n’a pas été véritablement entretenu et dont les loyers ont, eux, pris l’ascenseur !
La crise du logement, ce sont aussi ces studettes parisiennes à 900 euros ou ces studios construits dans les années vingt ou trente, à 700 euros en province ! C’est aussi le développement de copropriétés dégradées, dont certaines procèdent du démembrement, fort rentable pour le vendeur, d’immeubles anciens par congé-vente, dans le droit fil de la loi Méhaignerie.
Devant nos concitoyens, devant les demandeurs de logement, devant les mal-logés, devant les sans-abri, les auteurs de ces lois sont aujourd’hui responsables !
Je me permettrai enfin, mes chers collègues, de faire le point sur l’accession à la propriété, puisque nous sommes passés en quelques années d’un dispositif destiné aux ménages – prêts principaux bonifiés et réductions d’impôt – à un dispositif destiné aux prêteurs !
Notre groupe pense qu’il est grand temps de revenir aux fondamentaux.
Le prêt à taux zéro, s’il doit persister, doit être recentré sur les ménages les plus modestes et couvrir la majeure partie de la valeur d’achat du bien immobilier.
Il est temps, et même grand temps, d’abandonner les prêts à taux variable et de réduire le niveau des taux d’intérêt, en exigeant des établissements de crédit qu’ils réduisent quelque peu leur marge opérationnelle. On n’en prend pas le chemin, faut-il le rappeler !
En rackettant les collecteurs du 1 %, vous privez des milliers de familles de salariés de la possibilité de contracter des prêts à faible taux d’intérêt, qui permettaient jusqu’ici à ces ménages de structurer de manière « supportable » leur dette immobilière !
Madame la ministre, pourquoi ne prenez-vous pas immédiatement une mesure sur les prêts-relais ? Exigez donc des banques des abandons de créances sur les intérêts courus à la mesure des financements consentis dans le récent collectif budgétaire ! Avec 360 milliards d’euros, vous devriez pouvoir trouver, n’est-ce pas ?
Enfin, recyclez le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt prévu par la loi TEPA en le transformant, par exemple, en capacité de remboursement anticipé pour les emprunteurs, sous forme d’une aide budgétaire directe. En effet, en l’état actuel, ce dispositif ne fait qu’encourager la hausse des taux d’intérêt !
La crise du logement que traverse notre pays exige, de notre point de vue, la remise en cause des choix antérieurs, notamment de ceux que vous avez faits, mes chers collègues. En effet, cette crise ne se résoudra pas par le développement de subprimes à la française – c’est bien ainsi qu’il faut appeler le crédit hypothécaire –, mais par la remise en question du cadre législatif et financier qui l’a fait naître.
C’est ce que le groupe CRC tenait à rappeler à l’occasion du débat sur cette question orale relative à la crise du logement.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le thème de la question orale avec débat que pose notre collègue Thierry Repentin est d’une acuité chaque jour plus grande compte tenu de l’ampleur de la crise financière, qui, malheureusement, se transforme en une crise économique qui n’a rien de virtuel.
Les solutions apparaissent très peu nombreuses tant la crise semble frapper durement la construction, et donc le logement. Le ressort paraît brisé. Alors même que, le mois dernier encore, se profilait une reprise d’activité dans le secteur du bâtiment, nous nous trouvons collectivement confrontés à un ralentissement notable des mises en chantier, tandis qu’un doute profond s’installe parmi les professionnels du secteur.
L’annonce, hier, d’une chute de 23, 3 % des demandes de permis de construire et de 8, 1 % des mises en chantier au troisième trimestre nous le confirme.
Pour reprendre l’adage cher aux Auvergnats, qui ont en partie construit Paris, « quand le bâtiment va, tout va ! ». De fait, si les temps s’annoncent durs pour ce secteur et pour l’emploi, on peut craindre que tout aille de plus en plus mal.
Il n’en reste pas moins que, aujourd’hui et depuis plusieurs années, de nombreux Français ont du mal à se loger. Il leur est difficile de devenir non seulement propriétaire, aspiration bien légitime, mais encore de trouver une location.
L’indice du coût de la construction, qui permet d’apprécier la richesse nécessaire pour devenir propriétaire dans du neuf, entre également dans le calcul de l’indice de référence des loyers. Or cet indice a progressé de manière exceptionnelle depuis 2000 : s’il a été valorisé de 13, 4 % entre le premier trimestre de 1990 et le quatrième trimestre de 1999, il a augmenté de 44, 22 % depuis le premier trimestre de 2000. De ce fait, nombreux sont ceux qui n’ont pu trouver un premier logement ou un nouveau logement à un prix suffisamment raisonnable pour leur permettre de faire face à leurs autres dépenses quotidiennes, le fameux « reste à vivre ».
Cette frénésie du marché de l’immobilier s’explique par différentes raisons, les unes tenant à la confrontation naturelle de l’offre et de la demande, les autres à des paramètres que la collectivité pourrait maîtriser.
Des taux d’intérêt bas, une TVA à 5, 5 % dans la rénovation, un désir d’acquérir exacerbé ont eu pour conséquence que la demande a surpassé largement une offre souvent « insuffisante et mal adaptée », pour reprendre les termes du rapport du Conseil d’analyse économique. La croissance à deux chiffres des prix et des loyers a conduit les gouvernements précédents à mettre en place des dispositifs fiscaux qui ont accéléré et amplifié ce mouvement bien au-delà du raisonnable.
Il suffit pour s’en convaincre de voir la très forte croissance de « l’indice du prix des logements rapporté au revenu disponible par ménage et des montants de transactions de logements anciens rapportés à leur tendance longue », disponible dans le rapport du Conseil d’analyse économique. S’il variait depuis les années soixante jusqu’en 2000 entre 0, 9 et 1, 1, il a vu sa courbe s’envoler pour atteindre 1, 7.
L’immobilier d’aujourd’hui participe malheureusement au creusement des inégalités, car, faute de logements sociaux en nombre suffisant, les prix pourraient continuer encore de grimper, excluant les plus défavorisés de toute possibilité de se loger.
Paris symbolise cruellement ce mécanisme qui aboutit aujourd’hui à ce que des employés de plus en plus nombreux soient contraints de trouver des solutions de fortune, pour ne pas dire de misère.
Notre pays connaît déjà des prix supérieurs à ce qu’ils sont dans de nombreux pays de l’OCDE.
En résumé, et ce constat est partagé par tous, les plus défavorisés, ainsi que les classes moyennes, ne trouvent pas de logements correspondant à leur capacité pécuniaire.
Comme je l’expliquais ici-même, le projet de loi dont nous avons débattu dernièrement ne constitue pas une bonne réponse. Existe-t-il d’ailleurs une bonne réponse ? Je ne saurais le dire. À tout le moins, il en existe de meilleures. La réduction, par le Gouvernement, au cours des trois prochaines années, des crédits de la mission « Ville et logement » fait partie de ces mauvaises solutions.
Je fais mien le constat que dresse le rapport du CAE et souscris à certaines de ses préconisations, en particulier l’incitation à libérer du foncier par la captation de plus-values par les collectivités lors du changement de destination d’un terrain, le regroupement à l’échelle intercommunale des compétences « urbanismes », l’amélioration de la gestion du parc social par une adaptation du logement aux évolutions du ménage et du loyer à la rémunération de ses occupants. En revanche, ce serait faire un « cadeau empoisonné » aux ménages que de concentrer les efforts fiscaux de l’État sur le prêt à taux zéro aux dépens du plan d’épargne logement, qui contribue à la responsabilisation de chacun, de faciliter les procédures juridiques de recouvrement des actifs gagés, de permettre le développement de la titrisation hypothécaire, bref, de mettre en place des mécanismes dont les travers ont conduit à la crise des subprimes.
Dans le contexte actuel, ne devrions-nous pas nous concentrer sur des offres de location raisonnables plutôt que de proposer des crédits à des ménages qui, demain, faute de pouvoir les rembourser, seront peut-être contraints de céder leur bien, acquis trop chèrement, à leur banque, devenue seul acquéreur possible ?
L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire, autorisés par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, représentaient déjà un risque non négligeable. Réduire le coût d’une hypothèque et assouplir son cadre juridique, ainsi que le préconise le CAE, ce serait, à mon sens, persister dans l’erreur. Nous recréerions, cette fois-ci dans notre pays, les conditions d’une nouvelle crise. De tels changements sont inenvisageables s’ils aboutissent à une croissance de la demande telle qu’elle conduirait les prix ou les loyers à des niveaux aussi peu réalistes que déraisonnables.
Aujourd’hui, les programmes immobiliers privés basés sur les plans « Robien » ou « Borloo » sont légion. Le Gouvernement s’apprête à se substituer aux promoteurs privés qui ne trouvent plus preneurs. À quel prix ? Au profit de qui ? Madame la ministre, nous apprécierions que cette question orale avec débat vous donne l’occasion de nous apporter des précisions à ce sujet.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je ferai une réponse globale à M. Repentin, Mme Terrade, M. Bourquin et Mme André. Quant à M. Dallier, je le remercie de son intervention. Je n’ai rien à ajouter à ce qu’il a dit du crédit hypothécaire, sinon que l’inquiétude que suscite ce dernier chez certains des orateurs qui se sont succédé à la tribune tient davantage de la propension morbide à échafauder de fausses hypothèses que de la réalité.
Voilà à peine une semaine, la Haute Assemblée s’est prononcée sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Ce fut l’occasion d’un débat riche, dense et de qualité. Et, puisque je suis de nouveau amenée à m’exprimer dans cet hémicycle, j’en conclus que ma présence y est appréciée.
C’est vrai ! sur plusieurs travées du groupe socialiste.
Ce projet de loi a donné lieu à plus de cinquante heures de débat, ce qui prouve l’intérêt que nous portons tous à la question du logement.
Le texte que vous avez adopté, qui sera examiné au mois de décembre par l’Assemblée nationale, conserve la quasi-totalité des dispositions inscrites dans le projet de loi initial. Il a été conçu pour apporter des réponses opérationnelles à la crise du logement par une mobilisation de tous les acteurs, sans opposer inutilement secteurs public et privé, logement locatif et accession. Tous les outils doivent être utilisés !
La crise financière a des effets importants sur l’immobilier. Les réponses proposées dans ce texte sont indispensables, car, pour progresser, il faut d’urgence compléter les instruments à la disposition de l’État, des bailleurs sociaux, des collectivités territoriales et des associations.
Monsieur Repentin, vous avez beaucoup insisté sur la chute du nombre des mises en chantier. Sincèrement, permettez-moi de vous dire que vous ne manquez pas de toupet !
M. Thierry Repentin rit.
J’aurai, pour ma part, l’outrecuidance de vous montrer de nouveau la courbe des constructions de logements neufs que j’ai déjà produite la semaine dernière.
Mme la ministre brandit une feuille sur laquelle est reproduit un graphique.
Pas uniquement, monsieur Repentin ! Vous le savez fort bien ! En 2007, 437 000 logements ont été construits, dont 108 000 logements sociaux !
Bien évidemment, le logement social a son rôle, mais faites preuve un tant soit peu de modestie et sachez reconnaître la vérité ! La seule vision de ce graphique devrait vous dispenser de tout commentaire sur les supposés désengagements de l’actuelle majorité en matière de logement !
L’effort de construction a été fortement accru, le nombre de logements réalisés passant de 308 000 en 2002 à 435 000 l’année dernière, niveau jamais atteint depuis trente ans. Ce résultat a été obtenu en raison de la remarquable mobilisation des organismes de logement social. En outre, grâce aux nouvelles aides de l’État, davantage de particuliers ont investi dans un logement, soit pour l’occuper, soit pour le mettre en location.
De même, le Gouvernement a réagi à l’impact brutal de la crise financière sur l’immobilier. En effet, celle-ci a touché en premier lieu le secteur de l’immobilier : la restriction de l’accès au crédit, tant pour les particuliers que pour les professionnels, bloque le marché.
Le ralentissement sérieux que nous subissons depuis le mois de juin, et que personne ne conteste, nous laisse à penser que nous terminerons l’année avec environ 360 000 mises en chantier. Le retournement est rapide, mais le niveau de construction reste élevé, puisque le nombre de logements mis en chantier cette année sera identique à ce qu’il était en 2004 et bien supérieur à ce qu’il était entre 1997 et 2002.
Comme vous, nous sommes très attachés à la construction de logements. Le nombre des mises en chantier baissera en 2008 en raison de la crise financière, mais, mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité et de l’opposition, nous ne devons pas avoir honte de ce résultat, car, je le répète, il est très supérieur à ce qu’il était lorsque l’opposition actuelle était au pouvoir.
Vous le savez, la non-production d’un seul logement représente deux chômeurs de plus. Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, nous sommes donc obligés de rattraper le retard qui s’est accumulé en matière de construction lorsque vous étiez au pouvoir. C’est indispensable, mais, vous le savez, cela prend du temps. J’ajoute, monsieur Repentin, que le projet de loi que j’ai eu l’honneur de défendre devant la Haute Assemblée participe à l’effort que nous accomplissons en la matière.
Ce projet de loi a trois objectifs majeurs : soutenir l’activité de construction pour la location et l’accession populaire à la propriété ; permettre aux classes moyennes et modestes d’accéder au logement ; enfin, lutter contre le mal-logement, qu’aucun d’entre vous n’a évoqué cet après-midi, bien qu’il s’agisse d’un sujet important.
Mon premier objectif a toujours été de soutenir l’activité de construction. Plusieurs mesures prévues dans le projet de loi serviront de support au plan de relance annoncé par le Président de la République, plan consistant en la mise en œuvre d’un programme d’achat de 30 000 logements en VEFA, vente en l’état futur d’achèvement, qui doit permettre à des opérateurs sociaux d’acheter des programmes n’ayant pu être lancés à ce jour par les promoteurs privés, faute d’une « pré-commercialisation » suffisante.
Des critiques ont été émises tout à l’heure sur cette opération. Mais comment pouvez-vous vous y opposer ? Actuellement, certains programmes ne sont pas lancés, parce que les banques refusent d’octroyer des prêts au promoteur au motif que tout n’est pas commercialisé !
Monsieur Raoul, j’ai parfaitement entendu certains orateurs mettre en cause ce plan !
Ce levier est primordial, puisque, outre les 30 000 logements qui vont être réalisés par les bailleurs sociaux subventionnés par l’État, la totalité des programmes seront finalisés grâce à cette mesure. Je ne comprends pas comment on peut mettre en doute la VEFA !
Monsieur Raoul, peut-être n’étiez-vous pas en séance à ce moment-là, mais j’ai entendu quelqu’un contester le bien-fondé de la décision du Président de la République concernant les 30 000 logements. Et je ne peux pas laisser passer de tels propos !
La disposition du projet de loi qui simplifie et sécurise la procédure de vente en l’état futur d’achèvement aux organismes d’HLM permettra d’accélérer et de rendre pleinement opérationnel ce plan d’achat.
Le plan de relance du Président de la République prévoit également la réalisation de 30 000 logements d’accession populaire à la propriété grâce au Pass-foncier. Là encore, la disposition du projet de loi qui permet d’étendre au logement collectif le dispositif du Pass-Foncier viendra renforcer cette ambition, en particulier en zone urbaine, là où le logement individuel est moins adapté aux besoins.
Le plan de relance vise en outre à accélérer la mise en œuvre du programme de cession de terrains publics décidé lors du Comité interministériel pour le développement de l’offre de logements du 28 mars 2008, afin d’atteindre rapidement l’objectif de production de 70 000 logements sur le foncier ainsi libéré. Ce programme sera complété par des cessions issues des restructurations militaires annoncées en juillet dernier et du plan patrimonial réactualisé de Réseau ferré de France.
Par ailleurs, la « boîte à outils » visant à faciliter les cessions des biens immobiliers de l’État sera enrichie, au-delà de la simple vente, par la possibilité de recourir à des baux permettant un intéressement ultérieur de l’État à la valeur créée.
Enfin, le foncier de l’État cédé pour réaliser des opérations en Pass-foncier pourra faire l’objet d’une décote comme pour la construction de logements locatifs sociaux afin de favoriser l’accession populaire à la propriété.
Une circulaire du 17 octobre signée par le Premier ministre a été adressée aux préfets. Elle prévoit notamment une déclinaison régionale de la mise en œuvre du rachat en VEFA de 30 000 logements. À ce titre, l’ensemble des acteurs concernés ont été réunis par les préfets de région, et des cellules de suivi local les accompagneront dans leur démarche. Comme vous pouvez le constater, nous n’avons pas perdu de temps !
Sur le plan national, un comité du pilotage se réunira dès la semaine prochaine pour faire le point sur les initiatives engagées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, plusieurs d’entre vous ont une nouvelle fois parlé des crédits budgétaires. Comme l’a fort bien dit M. Dallier, nous aurons l’occasion d’y revenir. En attendant, je vais vous répéter ce que j’ai dit la semaine dernière.
La mise en œuvre des dispositions prévues dans le projet de loi pourra s’appuyer sur un budget dont je n’ai pas à rougir. En effet, pour avoir une image exacte du budget du ministère du logement et de la ville, il faut prendre en compte les moyens des agences, qui jouent un rôle essentiel dans la conduite des politiques du logement et de la ville, en particulier l’ANRU et l’ANAH.
En prenant en compte ces moyens, les crédits du ministère passent à 8, 9 milliards d’euros, ce qui représente plus de 200 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2008. Cette augmentation provient en particulier d’une contribution, qui a été négociée avec les partenaires sociaux du 1% logement, de 800 millions d’euros au financement de l’ANRU et de l’ANAH.
Cette contribution, prévue pendant trois ans, a été rendue possible grâce à l’optimisation et à la réorientation des emplois du 1% logement vers les priorités de la politique du logement, en particulier vers les plus fragiles d’entre nous.
Je cite deux exemples : le Pass-travaux est rendu inutile par la création de l’éco-prêt pour les travaux d’amélioration énergétique, qui a été mis en œuvre dans le cadre du Grenelle de l’environnement ; les subventions à la Foncière sont rendues plus efficaces dans la mesure où il n’est pas nécessaire de subventionner à plus de 50 % les logements construits par cet organisme.
Pour être plus précise, je rappellerai que la baisse de 30 % des moyens affectés au financement du logement social, qui a été avancée par certains, n’est pas exacte. En effet, c’est le périmètre de cette ligne budgétaire – la ligne fongible – qui a fait l’objet d’une redéfinition pour 2009. Cette subtilité leur a peut-être échappé …
Certaines actions inscrites sur cette ligne fongible, tels les travaux de réhabilitation du parc existant ou les dépenses d’humanisation des structures d’hébergement, seront financées en 2009, soit par des ressources extrabudgétaires, soit par d’autres lignes. Compte tenu de ce changement de périmètre, ce sont près de 100 millions d’euros de dépenses qui ne relèveront plus de la ligne fongible en 2009. En outre, les organismes de logement social bénéficieront l’année prochaine de ressources extrabudgétaires plus importantes que par le passé.
Les subventions du 1% logement au logement locatif social vont croître de 33 %, conformément à ma demande, pour atteindre 300 millions d’euros.
Par ailleurs, si j’en crois les déclarations du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, une baisse du taux du livret A pourrait intervenir au 1er février, permettant ainsi une baisse des taux des prêts au logement social, qui sont financés, vous le savez tous, sur les ressources du livret A.
En ce qui concerne le budget, je vais simplement vous indiquer quelques chiffres.
Je vous le dis clair et net, les crédits de paiement du logement locatif social augmentent de 5, 63 %. Ceux de l’ANAH augmentent de 23, 06 %. Dans ces conditions, est-ce le budget qui est en baisse ou est-ce que ce sont les capacités de paiement ? Je vous laisse le soin de répondre à cette question.
Pour ce qui concerne le logement locatif social, le budget pour 2009 permettra de financer 120 000 logements, soit 20 % de plus qu’en 2007. Je le rappelle, cette année, 108 000 logements sociaux ont été réalisés, ce qui correspond aux capacités des organismes sociaux.
En matière d’accession à la propriété, monsieur Repentin, je vous rappelle toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années : l’extension à l’ancien du prêt à taux zéro, d’où 250 000 prêts au lieu de 80 000 ; la TVA à 5, 5 % pour l’allocation d’accession sociale, qui est utilisée notamment par les coopératives d’HLM ; la TVA à 5, 5 % pour le Pass-foncier, qui passe de 20 000 à 30 000 ; l’augmentation des plafonds de ressources des prêts d’accession sociale à la propriété, qui a été décidée par le Président de la République et dont j’ai peu entendu parler tout à l’heure.
Toutes ces aides publiques ne figurent pas dans le budget en tant que telles, mais elles favorisent bien l’accession sociale à la propriété.
Vous avez également fait allusion au recentrage du dispositif « Robien ». Je vous indique les chiffres afin que tout le monde les ait bien en tête : sur les 250 000 logements qui ont été réalisés depuis 2003, 5 000 sont vacants.
En ce qui concerne les aides publiques, puisque l’on dit toujours que cela coûte cher, je rappellerai que le dispositif « Robien » correspond à une dépense fiscale de 15 000 euros par logement, et non de 30 000 euros, comme vous l’avez indiqué, et qu’un logement construit grâce au dispositif « Robien » rapporte environ 20 000 euros à l’État par le biais de la TVA.
Il faut donc regarder les choses dans leur ensemble et non de façon sectorielle.
Plusieurs intervenants ont évoqué le rapport du Conseil d’analyse économique intitulé « Loger les classes moyennes : la demande, l’offre et l’équilibre du marché du logement », ainsi que la question du crédit hypothécaire, qui est au centre des préoccupations d’un grand nombre d’entre vous.
Le rapport du Conseil d’analyse économique m’a été remis le 30 septembre dernier. Je tiens à en souligner la qualité. Il aborde de nombreux thèmes de la politique du logement. Tous ont été examinés dans le cadre de la préparation du projet de loi et certains, comme la modernisation du monde des bailleurs sociaux, ont été retenus.
Monsieur Repentin, je n’accepte pas que vous puissiez faire un lien direct entre la crise des subprimes et celle du crédit hypothécaire. M. Dallier l’a très bien dit : les subprimes sont des prêts qui ont été octroyés sans contrôle de la capacité de remboursement des ménages. En France, vous le savez, cette capacité de remboursement est contrôlée et les prêts aux ménages modestes sont sécurisés.
Vous avez cité l’ANIL. À mon tour, je veux vous citer l’un de ses documents d’avril 2007 : « Le système français offre aux accédants à la propriété le crédit le moins cher d’Europe et dans les meilleures conditions de sécurité. » On peut lire plus loin : « … le taux de défaillance est plus faible et les saisies restent exceptionnelles ».
Si vous voulez que je vous rassure encore, voici un passage d’une enquête typologique de la Banque de France sur le surendettement : « Les situations de surendettement dit “passif” demeurent très majoritaires et augmentent de deux points. Mais la part de l’endettement immobilier se réduit. Aujourd’hui, 8 % des dossiers comportent au moins un crédit immobilier, contre 10 % en 2004 et 15 % en 2001. La tendance est à la diminution ». L’enquête typologique de la Banque de France poursuit : « L’endettement immobilier au sein de la population française orientée vers la procédure de rétablissement personnel ne représente qu’une part infime de l’endettement total ».
Maintenant que j’ai apporté toutes ces précisions, je pense que nous n’aurons pas l’occasion de nous revoir la semaine prochaine à votre demande, …
Sourires
Mme Christine Boutin, ministre. Ce n’est pas toujours une bonne chose d’avoir des habitudes, monsieur Raoul.
Nouveaux sourires
Comme je viens de le souligner, le système français de prêts immobiliers a un très bon suivi, avec un nombre très faible de défaillances de la part des emprunteurs. Devons-nous nous en plaindre ? Il serait hasardeux aujourd’hui de nous engager dans des montages complexes pour lesquelles nous devrions attendre le retour d’expérience.
L’urgence est de redonner de la stabilité au système financier, de redonner confiance aux acteurs. Le Président de la République a engagé des actions très fortes pour sécuriser les ressources des banques. On ne peut que le reconnaître. Même s’il est difficile à certains de l’admettre publiquement, la façon dont le Président de la République gère cette crise financière mondiale force l’admiration de tous.
Dans le domaine plus spécifique de l’immobilier, il a été décidé, à la demande du Président de la République, d’améliorer les conditions de garantie du fonds de garantie pour l’accession sociale. Vous le savez, cela fait partie du « paquet ». Le plafond de ressources des ménages bénéficiaires du PAS a ainsi été augmenté au niveau du plafond du prêt à taux zéro jusqu’à la fin de 2009. Outre l’effet de soutien à la demande en matière d’accession, cette mesure est de nature à sécuriser davantage les banques prêteuses et donc à diminuer le coût de leurs refinancements.
Par ailleurs, à la suite de mon appel, les banques ont annoncé la mise en place d’aménagements pour les particuliers ayant souscrit un prêt relais. M. Georges Pauget s’y est engagé et des mesures sont en train d’être mises en œuvre. Il y a en effet des familles qui se trouvent aujourd’hui en grande difficulté. Les banques appliqueront donc leurs procédures en matière de crédits relais avec plus de souplesse pour répondre à mon appel à la clémence.
Je souligne aussi que les banques qui se sont associées au projet de la maison pour 15 euros par jour se sont engagées à prolonger jusqu’au 1e janvier 2009 le taux préférentiel à 5 % pour les prêts aux particuliers.
En conclusion, je vous dirai que, pour faire face aujourd’hui à la crise de l’immobilier et pour répondre en profondeur à la crise du logement qui touche nos concitoyens depuis de nombreuses années, il est nécessaire que tous les acteurs se mobilisent.
Vous avez demandé, monsieur Repentin, que le logement devienne une grande cause nationale. Pour ma part, je vous invite à une véritable union politique. Nous ne devons pas nous opposer les uns aux autres. Au contraire, nous devons être unis pour répondre à ce droit fondamental, qui est celui de chaque homme, de chaque femme et de chaque enfant, d’avoir un logement. Le projet de loi que j’ai défendu devant vous la semaine dernière poursuit cet objectif.
Mon ambition est que chacun donne le meilleur de lui-même et que toutes les énergies soient orientées vers un même objectif : donner un toit à tous en fonction de ses choix et de ses besoins. Pour y parvenir, il est nécessaire d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne du logement, qui est une chaîne de solidarité entre tous les citoyens de notre pays.
C’est pourquoi il est essentiel d’agir tous ensemble. Chacun a son rôle à jouer et il serait contre-productif, voire dangereux, d’opposer les propriétaires aux locataires, le locatif social à l’accession populaire à la propriété, les bailleurs sociaux aux promoteurs privés. La mobilisation de tous est indispensable.
Il faut agir sur l’ensemble des leviers et avec tous les acteurs concernés. Ce n’est qu’à cette seule condition que l’on parviendra à affronter la crise que nous traversons aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

En application de l’article 83 du règlement, je constate que le débat est clos.
Mes chers collègues, en attendant M. le ministre de l’agriculture et de la pêche, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 214, 2007-2008) tendant à généraliser l’assurance récolte obligatoire, présentée par MM. Yvon Collin et Jean-Michel Baylet.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au début de l’année, Jean-Michel Baylet et moi-même avons déposé une proposition de loi tendant à généraliser l’assurance récolte obligatoire.
Nous nous réjouissons d’avoir aujourd’hui la possibilité de défendre ce texte, qui, je le crois, répond à une attente exprimée depuis longtemps par de nombreux agriculteurs.
En effet, le dispositif assurantiel existant, qui comprend l’assurance récolte telle qu’issue de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 et le système d’indemnisation public via le Fonds national de garantie des calamités agricoles, se révèle trop limité pour répondre efficacement aux conséquences des aléas climatiques.
Depuis quelques années, on observe une augmentation de l’intensité et de la fréquence des intempéries. On en connaît les effets dévastateurs sur les récoltes et, in fine, sur les revenus des exploitants. En moyenne, un agriculteur subit une perte de revenu de 20 % tous les trois à quatre ans. S’agissant plus particulièrement des arboriculteurs, leur revenu chute en moyenne de 30 % tous les 3, 6 ans, en raison d’averses de grêle, malheureusement de plus en plus fréquentes.
Bien sûr, l’agriculture est par nature – si j’ose dire ! – fortement dépendante des conditions climatiques, mais c’est là une donnée avec laquelle les agriculteurs ont toujours su qu’ils devaient composer. Il reste que, d’une façon générale, ces derniers sont confrontés à de nouveaux défis susceptibles d’accroître leurs difficultés.
Ils doivent faire face à des risques émergents dans le domaine sanitaire, tels que l’encéphalopathie spongiforme bovine, hier, ou la fièvre catarrhale, aujourd’hui. Il leur faut aussi s’accommoder de la volatilité des marchés qui peuvent, au gré des variations des cours, déstabiliser leurs revenus.
Alors, quand les caprices du ciel s’ajoutent aux aléas d’ordre économique et sanitaire, les agriculteurs les plus fragiles se retrouvent parfois bien démunis pour gérer les risques. C’est pourquoi, avec mon collègue Jean-Pierre Baylet, également sénateur de Tarn-et-Garonne, j’ai souhaité renforcer quelque peu la sécurité des agriculteurs contre l’un de ces risques.
La proposition de loi est simple puisqu’elle tient en deux articles. Le premier vise à rendre obligatoire l’assurance récolte, définie dans son principe par l’article L. 361-8 du code rural, et à l’étendre à l’ensemble des productions agricoles ; le second compense les conséquences financières pour l’État des dispositions du premier.
En réalité, cette simplicité dans la présentation recouvre une situation plus complexe.
Le monde agricole est hétérogène : on n’appréhende pas les risques de la même façon selon le territoire sur lequel on se trouve. On se satisfait plus ou moins de l’actuel système d’indemnisation selon que l’on est dans la monoculture ou dans la polyculture, ou selon que l’on s’occupe d’une grande ou d’une petite exploitation. Cette diversité ne facilite pas la mise en place d’un outil uniforme et accessible à tous.
C’est l’une des raisons – car il y en a d’autres – pour lesquelles, monsieur le rapporteur, vous jugez prématurée l’adoption d’une telle proposition de loi.
Vous avez bien sûr différents arguments pour justifier votre position.
Vous invoquez d’abord un obstacle juridique : les assurances n’étant obligatoires que lorsque se trouve en jeu la responsabilité à l’égard de tiers, l’assurance récolte ne pourrait guère avoir ce caractère obligatoire.
Je ne suis pas, je le confesse, un spécialiste du droit des assurances, mais il me semble que rien n’est figé dès lors que la volonté politique existe, du moins tant que l’on reste dans les limites posées par notre Constitution. Il est vrai que tout cela relève d’un plus vaste débat, qu’il serait impossible de trancher aujourd’hui.
Vous avez raison, monsieur le rapporteur, de mettre en avant la question de la responsabilité de l’agriculteur et d’évoquer le respect de la liberté de s’assurer ou pas. Cependant, venant d’un département confronté aux mêmes problèmes que ceux qui se posent dans le mien, vous savez bien que ce choix n’est pas totalement libre pour l’exploitant : il existe une contrainte, qui est financière.
Sans vouloir mésestimer l’engagement des pouvoirs publics sur le plan budgétaire, convenons que le taux de prise en charge par l’État d’une partie de la prime d’assurance – aujourd’hui 35 %, peut-être demain 40 % – n’est pas suffisamment incitatif. De plus, le montant des primes d’assurance contre les risques climatiques reste trop élevé pour certaines filières. Il en résulte un engouement inégal pour l’assurance récolte selon le type de production.
Sur les 20 % d’exploitations ayant souscrit un contrat, en 2007, la couverture concernait 27 % des superficies pour les grandes cultures et seulement 0, 93 % pour les cultures fruitières. Cet écart montre combien, s’agissant des souscriptions de contrat d’assurance, les disparités sont grandes.
Voilà qui atteste la nécessité de conforter l’assurance récolte et de mutualiser le risque, ce qui fait l’objet de la présente proposition de loi.
Bien entendu, monsieur le rapporteur, j’ai conscience que cette mesure serait coûteuse.

Certes, comme mon collègue et moi-même le précisons dans l’exposé des motifs de notre proposition de loi, la généralisation de l’assurance récolte à l’ensemble des productions permettrait d’élargir l’assiette de cotisants. Cependant, avant que celle-ci atteigne une masse critique, il est vrai que l’État serait plus fortement mis à contribution du fait de la prise en charge partielle des primes et cotisations d’assurance et de l’apport de garanties en termes de réassurance.
Doit-on toujours compter sur l’État ? Il faut reconnaître qu’il est très sollicité en ce moment. Néanmoins, s’agissant de l’agriculture, à laquelle on reproche souvent – et souvent à tort – d’être trop aidée, il ne me semblerait pas anormal que l’État tienne au moins ses engagements, ce qui est loin d’être toujours le cas, comme certains de mes collègues et moi-même avons l’occasion de le rappeler lors des débats budgétaires.
Les articles 62 et 63 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 ont réaffirmé le principe du développement de l’assurance récolte, à côté de l’indemnisation publique au titre des calamités agricoles. Il s’agissait là d’une excellente avancée, sur laquelle je m’appuie pour aller encore un peu plus loin. Mais il est dommage que le soutien au dispositif ne se traduise pas systématiquement en loi de finances initiale et que la commission des affaires économiques, que je félicite au passage pour sa vigilance sur ce sujet, soit obligée, chaque année, de s’élever contre la sous-dotation du Fonds national de garantie des calamités agricoles, qui assure pourtant la gestion des primes prises en charge par l’État au sein de l’assurance récolte.
Espérons en tout cas que, sensibilisé par notre débat d’aujourd’hui, monsieur le ministre, vous ferez le nécessaire pour que soient honorés en 2009 les objectifs de la dernière loi d’orientation. Peut-être – sait-on jamais ! – irez-vous même au-delà en soutenant la présente proposition de loi.
Je rappelle que l’Espagne a consacré 280 millions d’euros au financement de son système d’assurance récolte en 2008. Cette mobilisation considérable permet de fournir une couverture relativement bonne aux exploitations espagnoles.
L’idée de l’assurance récolte n’est donc pas une exception française, ce qui a d’ailleurs permis – et nous avons peut-être là une « fenêtre d’espoir » – son inscription au « bilan de santé » de la PAC. Nous y reviendrons sans doute dans la suite de la discussion générale.
Je souhaite que ce dossier évolue favorablement au niveau européen, car il nous permettra de réorienter une partie des aides communautaires vers l’assurance récolte, tout en mettant celle-ci en conformité avec les règles de l’OMC.
Mes chers collègues, je sais que l’idée d’une extension de l’assurance récolte fait presque l’unanimité dans notre assemblée. Peu à peu, l’usage de la couverture du risque progresse chez les exploitants, et la loi d’orientation du 5 janvier 2006 a de ce point de vue donné un coup d’accélérateur. En revanche, je sais aussi que l’idée de la rendre obligatoire ne recueille pas l’adhésion de la majorité de la Haute Assemblée.
J’ai exprimé les raisons qui ont conduit au dépôt de la présente proposition de loi. Sans y revenir, je conclurai en réaffirmant mon attachement au principe de solidarité nationale et à la mutualisation du risque, qui me paraît nécessaire pour optimiser le dispositif.
La commission des affaires économiques n’est pas cet avis. J’en prends acte, tout en remerciant son président ainsi que notre collègue Bernard Soulage, rapporteur, du remarquable travail d’analyse qui a été accompli sous leur direction. M. Soulage souligne notamment dans son rapport l’intérêt qu’il y a à débattre sur un sujet qui concerne nombre d’entre nous, sur toutes les travées de cet hémicycle.
J’espère, quoi qu’il en soit, faire avancer cette cause, à laquelle sont particulièrement attachés les élus du Sud-Ouest, mais aussi ceux d’autres territoires où se pratique, notamment, l’arboriculture.
Nous serons bien entendu, monsieur le ministre, attentifs aux réponses que vous voudrez bien nous apporter.
Applaudissements sur les travées du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà maintenant trois ans, lors de l’examen de la dernière loi d’orientation agricole, nous décidions, par un amendement de notre collègue Gérard César, vivement soutenu par le président Emorine et notre ancien collègue Dominique Mortemousque, auteur d’un excellent rapport, de prévoir l’extension progressive de l’assurance récolte à l’ensemble des productions. Nous nous étions alors mis d’accord – et une intervention de M. Dominique Bussereau, alors ministre de l’agriculture, l’avait précisé explicitement – pour conserver à l’assurance récolte son caractère facultatif.
Faut-il aujourd’hui aller au-delà, en la rendant obligatoire ? C’est ce à quoi tend la proposition de loi de nos collègues Yvon Collin et Jean-Michel Baylet.
Avant de vous faire part des conclusions de la commission, qui a examiné cette proposition la semaine dernière, je voudrais rappeler en quelques mots le contexte dans lequel elle s’inscrit.
Les exploitations agricoles vivent sous la menace constante d’un accident climatique : coup de grêle ou de gel, période de sécheresse, excès d’humidité, inondation, etc. Le Fonds national de garantie des calamités agricoles, le FNGCA, a longtemps été l’unique moyen d’indemniser les agriculteurs. Il connaît cependant certaines limites : longueur des délais d’indemnisation, nécessité d’une reconnaissance du caractère de calamité agricole, faiblesse des montants versés. Aussi, monsieur le ministre, avez-vous décidé très opportunément de « sortir » progressivement certaines productions couvertes par le fonds et de renvoyer, pour leur couverture, à des mécanismes assurantiels.
En dépit des inconvénients que présente le FNGCA et quelles que soient ses imperfections, il joue et devra continuer à jouer un rôle très important. On pourra certes retirer certaines filières du fonds si les exploitants trouvent effectivement des produits d’assurance adaptés – ce sera d’ailleurs le cas des grandes cultures dès 2009 –, mais on ne saurait le supprimer complètement ; il est en effet seul à même de couvrir les pertes de fonds ou les cultures non assurables. Prenons grand soin de ne pas sortir trop vite du fonds les secteurs de l’arboriculture, de la viticulture et des légumes avant que les assurances récoltes les concernant n’aient été totalement étudiées, tant en ce qui concerne leur mécanisme que le nombre de contrats souscrits. C’est de toute manière un outil à conserver et, à mon avis, il doit constituer un « filet de sécurité » réactivable ponctuellement, en cas de besoin.
Je voudrais vous présenter brièvement le système, à mes yeux indispensable, existant aux États-Unis et appelé « assurance catastrophe » : celui-ci indemnise les agriculteurs uniquement en cas de « coup dur », c’est-à-dire de pertes supérieures à 50 % du rendement historique de l’exploitation. L’exploitant ne paie pas de prime d’assurance, celle-ci étant entièrement prise en charge par l’équivalent du ministère de l’agriculture.
Parallèlement au FNGCA, se sont développés depuis longtemps des produits d’assurance contre la grêle, le gel, puis, plus récemment, contre plusieurs risques combinés – grêle, gel, sécheresse, inondation ou excès d’eau, ainsi que vent –, et ce avec le soutien de l’État, voire des collectivités locales, qui versent une partie des primes d’assurance à des taux variant selon les productions et en fonction de leur situation économique.
À la suite du décret du 14 mars 2005 et de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, l’assurance récolte a démarré en fanfare dans notre pays, avec environ 60 000 contrats signés. Sa progression a ensuite été beaucoup plus lente, puisque moins de 70 000 contrats sont aujourd’hui souscrits, trois ans après le lancement du dispositif.
L’assurance récolte couvre désormais plus du quart des surfaces assurables, avec des différences notables selon les productions : près de 30 % pour les grandes cultures, 12 % pour la viticulture – celle-ci est du reste en progression à cet égard –, mais moins de 1 % pour les cultures fruitières – et elles seraient même en régression !
L’assurance récolte présente de nombreux avantages, notamment par rapport au système d’indemnisation classique. Elle permet en effet des remboursements plus rapides et plus élevés, ainsi qu’une gestion des risques plus responsable de la part de l’agriculteur.
Le soutien résolu des pouvoirs publics à son développement est une condition de son succès. Les risques sont tels, en effet, qu’un grand nombre d’exploitants ne pourraient pas payer la prime d’assurance en l’absence de soutien public.
Par ailleurs, il est indispensable que l’État s’engage et donne de nouvelles possibilités de réassurance pour permettre le développement des secteurs déjà couverts ainsi que celui d’autres secteurs, dont l’élevage.
Le Président de la République a justement annoncé jeudi dernier qu’il demanderait que la Caisse centrale de réassurance, organisme qui bénéficie de la garantie de l’État, intervienne afin de faciliter l’assurance des crédits aux entreprises. Or un engagement similaire au profit de l’assurance récolte est demandé depuis longtemps par les milieux agricoles comme par les professionnels du secteur.
Je voudrais à ce sujet saluer l’action du Gouvernement et surtout votre propre action, monsieur le ministre. À Bruxelles, ces derniers mois, à l’occasion du « bilan de santé » de la PAC, vous avez en effet défendu avec beaucoup d’intelligence et d’opiniâtreté notre modèle agricole. Vous avez également amorcé le débat sur l’après-2013, voilà quelques semaines, à Annecy. Vous avez d’autant plus de mérite que la partie n’est pas facile dans les négociations pour notre pays, bien qu’il assume la présidence de l’Union.
Grâce à votre insistance, en particulier, l’article 69 du règlement du Conseil sur les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs devrait être révisé de telle manière que l’assurance récolte bénéficie d’importants soutiens communautaires. Je vous rappelle, mes chers collègues, que l’actuel article 69 permet aux États membres de réattribuer jusqu’à 10 % des aides qu’ils perçoivent au titre du premier pilier pour financer des mesures liées à la protection ou à l’amélioration de l’environnement, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles. Or, aux termes du nouvel article 68, les États seraient autorisés à réallouer une partie – 2, 5 % au maximum – de ces 10 % sous la forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte. Le nouvel article 69 prévoit les conditions de ce soutien : 60 %, voire 70 % dans certains cas, de la prime seraient pris en charge par les fonds publics, dont les deux tiers par des financements communautaires.
Cette mesure, si elle venait à être finalement adoptée – et nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, pour œuvrer en ce sens – permettrait de renforcer très substantiellement le soutien à l’assurance récolte dès 2010, date de son entrée en application. Par ailleurs, il faut mentionner que le nouvel article 70 permet aux États membres de financer des fonds de mutualisation assurant le paiement aux agriculteurs d’indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale.
Le principe d’une extension de l’assurance récolte fait l’objet, j’ai pu le constater, d’un accord assez large chez tous les acteurs concernés. Il reste à déterminer comment atteindre cet objectif. La proposition de loi qui est soumise à votre examen propose de la rendre obligatoire.
En effet, un système d’assurance ne fonctionne bien que lorsque les risques sont mutualisés entre le plus grand nombre de personnes. Si les seuls qui s’assurent sont ceux qui présentent un risque important, les primes vont être très élevées et même exorbitantes : les assureurs font évidemment un calcul économique et modèlent les primes sur le risque à couvrir. Si tout le monde participe, le coût pour chacun peut être beaucoup moins élevé. C’est la logique suivie par nos collègues MM. Collin et Baylet, qui évoquent dans leur exposé des motifs un « principe de solidarité ».
Pour séduisante que paraisse cette proposition, il me semble que la solution n’est pas si simple que cela. Il faut bien voir que la mise en place d’une assurance récolte obligatoire pose un certain nombre de problèmes. J’en mentionnerai quatre.
En premier lieu, les assurances obligatoires sont une « espèce » très répandue chez nous. Les juristes en ont compté plus de quatre-vingt-dix dans le droit français. Le fondement en est, presque toujours, la responsabilité à l’égard d’un tiers. Quand vous conduisez une voiture, vous devez être assuré parce que, si vous êtes responsable d’un accident, il faut que la victime soit indemnisée, même si les frais dépassent vos capacités financières ; c’est là que l’assureur entre en jeu.
En deuxième lieu, nous allons bientôt examiner le projet de loi de finances pour 2009, et l’on sait que les marges budgétaires de l’État sont extrêmement réduites. Or le financement d’une assurance récolte représente 32 millions d’euros aujourd’hui, mais elle représenterait sans doute dix fois plus si tout le monde devait être assuré, et cela sans compter le secteur de l’élevage.
Au demeurant, puisqu’on parle de solidarité, si certains agriculteurs ne s’assurent pas aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas solidaires à l’égard de leurs collègues et qu’ils se reposent sur le FNGCA, c’est tout simplement parce que les assureurs ne sont pas en mesure de proposer aujourd’hui des produits d’assurance adaptés à toutes les situations. Je pense en particulier aux cultures fourragères, mais aussi à de nombreux arboriculteurs, qui devraient payer des primes d’assurances insupportables.
En troisième lieu, une obligation d’assurance signifie de nouvelles formalités, de nouvelles procédures de contrôle, venant s’ajouter à toutes celles qui existent déjà, véritable fardeau pour les exploitants. Il faudrait en outre vérifier que certains ne trichent pas, et même sans doute prendre des sanctions ; mais lesquelles ? Tous ces points seraient très difficiles à régler et peuvent difficilement l’être dans le cadre de cette proposition de loi.
En dernier lieu, je m’appuierai sur les exemples des États-Unis, où le président Emorine s’est rendu en 1997 avec notre collègue M. Deneux pour étudier notamment cette question, et de l’Espagne, que M. Mortemousque a également très bien décrit. Ces pays sont très en avance sur la France en matière d’assurance récolte. Pour autant, ils ne l’ont pas rendue obligatoire. Les personnes que j’ai auditionnées n’ont pas su me citer un seul pays dans le monde où l’assurance récolte soit obligatoire. D’ailleurs, en Espagne, qui est en quelque sorte le modèle européen, l’État dépense dix fois plus qu’en France pour l’assurance récolte, mais la moitié seulement des exploitations sont assurées ; il semble que l’on se trouve face à un plafond.
D’une manière générale, l’agriculture est aujourd’hui une activité entrepreneuriale. Évitons d’imposer aux exploitants de nouvelles obligations sans avoir la certitude qu’elles vont réellement améliorer la situation.
L’ensemble de ces éléments m’a conduit, en tant que rapporteur du texte, à faire état de conclusions négatives à son égard et notre commission à suivre lesdites conclusions. Il n’en reste pas moins que je juge cette proposition de loi bienvenue aujourd’hui en ce qu’elle permet de faire le point sur ce dossier alors que se fait le basculement entre le système du FNGCA et celui de l’assurance récolte et que vous le défendez, monsieur le ministre, devant les instances de Bruxelles, où il devrait faire l’objet d’un accord le 19 novembre prochain.
Nous souhaitons donc saisir l’occasion de ce débat pour vous appuyer dans ces négociations, monsieur le ministre, mais également pour vous rappeler qu’un engagement ferme des pouvoirs publics et une visibilité à long terme sur l’assurance, ainsi que sur la réassurance, sont les seuls facteurs de réussite pour le développement de l’assurance récolte. Pour aller plus loin aujourd’hui, la France doit pouvoir accorder, comme les États-Unis ou l’Espagne, la garantie de l’État par l’intermédiaire, par exemple, de la Caisse centrale de réassurance.
Notons, à regret, que dès 2009, le taux de subvention par l’État de la prime d’assurance pour les grandes cultures passera de 35 % à 25 % ; on le comprend à la vue des prix du marché pour les céréales l’année dernière, mais la situation est aujourd’hui bien différente puisque leur cours s’est replié de manière catastrophique ; les cours du maïs sont ainsi aujourd’hui inférieurs de moitié à ceux de l’année dernière.
Le signal donné est en revanche positif pour les productions arboricoles et viticoles, dont le taux de soutien devrait être réévalué à 40 %. On peut par ailleurs noter, avec satisfaction, la bonification de 5 % pour les jeunes agriculteurs, ainsi que l’apport de certaines collectivités locales qui aident déjà à la prise en compte de ces risques. En outre, le relèvement de la DPA, la déduction pour aléas, constitue un autre signal positif, même s’il est à nuancer avec la diminution de la déduction pour investissements.
En conclusion, après avoir remercié les auteurs de la proposition de loi de susciter très utilement la discussion sur l’assurance récolte, je vous invite cependant, mes chers collègues, à ne pas l’adopter, pour les raisons que j’ai exposées. Bien entendu, cela ne doit pas nous empêcher, bien au contraire, de faire le point avec vous, monsieur le ministre, sur l’extension de l’assurance récolte ni d’échanger sur les perspectives de son développement.
Permettez-moi enfin, monsieur le ministre, de vous remercier personnellement de votre engagement pour l’agriculture, et de remercier aussi tous ceux qui se sont battus pour l’assurance récolte.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, de l ’ UMP et du RDSE.

M. Yvon Collin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’interviens de nouveau dans la discussion générale, mais cette fois pour exprimer tout le bien que mon groupe pense de la proposition de loi visant à rendre obligatoire la souscription d’une assurance récolte par tous les exploitants.
Sourires

En effet, à nos yeux, une telle solution est seule à même de réduire le niveau moyen des primes exigées par les assureurs, grâce à l’élargissement de l’assiette des cotisants, et de rendre ainsi le dispositif plus accessible et plus protecteur pour le monde agricole.
Apparemment, le Gouvernement et la commission jugent cette proposition inenvisageable ou, plutôt, prématurée. Nous pouvons entendre certains arguments.
Toutefois, tout le monde, y compris M. le rapporteur, s’accorde sur la nécessité d’une extension aussi large que possible de la couverture assurantielle. Or cela exige un soutien massif tant au niveau national qu’à l’échelle européenne. Nous constatons hélas que les crédits consacrés à l’assurance récolte, qui s’élèveront à 32 millions d’euros en 2009, ont jusqu’à présent été insuffisants.
Comment le ministère de l’agriculture entend-il atteindre les objectifs qu’il s’était fixés en termes de taux de pénétration ? Au vu de ce que d’autres pays consacrent au financement de leur dispositif d’assurance récolte, on est amené à considérer que le Gouvernement ne semble pas décidé – c’est le moins qu’on puisse dire – à donner le coup de rein nécessaire en la matière.
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez décidé de réduire de dix points le taux de subventionnement des grandes cultures, alors même qu’elles vont sortir du champ du Fonds national de garantie des calamités agricoles, tout en continuant à y cotiser. Même si ces cultures ne sont pas celles qui ont le plus besoin de soutien, je pense que le dispositif sera difficile à leur vendre sur le terrain.
M. le rapporteur acquiesce.

En outre, sur une demande française, l’assurance récolte a été inscrite au « bilan de santé » de la PAC, qui doit être voté d’ici à la fin de l’année. La Commission européenne propose d’utiliser le régime des soutiens spécifiques pour favoriser le développement de l’assurance récolte, mais également d’un fonds de mutualisation, en cas de maladies animales ou végétales.
Le nouvel article 68 du règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC permettrait aux États d’utiliser 10 % de leurs plafonds nationaux au titre du premier pilier, en vue d’octroyer une contribution financière aux agriculteurs au paiement des primes. Ce niveau de financement est sûrement optimiste ; d’autres politiques seront à financer par ce canal. Une hypothèse de 1 % à 3 % des droits à paiement unique fléchés vers l’assurance récolte me paraît plus réaliste.
Quoi qu’il en soit, le soutien public, prévu par l’article 69 de ce même règlement, pourrait s’élever à 60 %, voire à 70 %, du coût de la police d’assurance. Il serait pris en charge par l’Union européenne pour les deux tiers et, si j’ai bien compris, par les États membres pour le tiers restant.
Dans l’ensemble, cette assurance récolte « à la sauce européenne » est finalement assez proche du système français, à un ou deux détails près, comme le taux de franchise fixé à 30 %, contre 25 % en France. D’ailleurs, cela semble se justifier par le fait que l’assurance récolte proposée par la Commission est calibrée pour être déclarée en boîte verte à l’OMC, ce qui n’est pas le cas de l’actuel système français de l’assurance récolte. Néanmoins, cela reste gênant.
Le principal point d’interrogation a trait au cofinancement obligatoire entre la France et l’Europe. Le budget français sera-t-il à la hauteur ? En tout cas, il semble que le débat s’annonce vif.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dresser un « état des lieux » ? Nous vous demandons instamment de faire de cette question une priorité lors de la dernière ligne droite des négociations du « bilan de santé » de la PAC.
La gestion des risques, notamment climatiques, est un enjeu majeur pour l’agriculture, déjà confrontée à la raréfaction du foncier agricole et à la volatilité des prix. À mon sens, l’assurance récolte est un instrument adapté, répondant à une logique d’entreprise, et je suis convaincu qu’il faut la rendre obligatoire. Encore faut-il lui donner une image forte, exprimant la volonté du Gouvernement de miser sur cette nouvelle formule.
Monsieur le ministre, nous savons que vous vous y emploierez avec toute la pugnacité, l’ardeur et la compétence qui sont les vôtres.
Applaudissements sur les travées du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, de mon point de vue, le sujet abordé par cette proposition de loi est tout à fait d’actualité. En tout cas, il n’est certainement pas « décalé », pour reprendre l’adjectif utilisé tout à l’heure par certains collègues à propos d’une question orale avec débat.
Quatre raisons au moins justifient que nous nous saisissions d’une telle question.
Premièrement, nous sommes confrontés à une fragilité accrue des revenus des agriculteurs, phénomène illustré par l’ensemble des accidents survenus ces dernières années du fait des intempéries et des épizooties, qui se multiplient. Selon certains scientifiques, une accélération liée aux changements climatiques est d’ailleurs à prévoir.
Deuxièmement, comme cela a été souligné par M. Yvon Collin et par M. le rapporteur, l’Union européenne a jugé utile de mener une réflexion en ce sens. En effet, chaque année, l’Europe, l’État et les collectivités locales sont sollicités pour faire face à des crises, ainsi qu’à leurs conséquences en termes de perte de revenus.
Troisièmement, seule une mutualisation peut permettre de garantir une solvabilité – j’y reviendrai –, donc de créer une solidarité. Or, et notre collègue Yvon Collin vient de le rappeler, chaque année, les engagements de l’État ont du mal à être respectés et il est difficile de trouver les financements.
Quatrièmement, à mon avis, la présente proposition de loi survient au bon moment, au regard des négociations que vous conduisez au niveau communautaire, monsieur le ministre. Je pense notamment aux articles 68 et 69 du règlement évoqué voilà quelques instants.
Le principe de la généralisation doit être juste, efficace et équitable. Mais deux obstacles se dressent actuellement devant cette généralisation.
D’une part, le milieu agricole est très disparate. Je peux le constater à la seule échelle de mon département. Ainsi, les contraintes financières qui s’imposent actuellement aux agriculteurs ne sont pas vécues de la même manière par tous. En effet, seuls ceux qui disposent de hauts revenus sont en mesure de s’assurer, les petits producteurs ne dégageant pas une marge suffisante pour se le permettre. Même dans les filières où ce serait financièrement possible, seuls les agriculteurs des régions à risques, à fortes variations climatiques, souscrivent une assurance. Mais des productions entières fragiles en sont actuellement écartées.
D’autre part, l’État ne semble pas aujourd'hui en mesure d’assurer les financements nécessaires au bon fonctionnement d’un système généralisé.
Par conséquent, bien que nous soyons favorables à l’instauration d’une assurance récolte obligatoire, nous sommes conduits à penser que la mise en place d’un tel système ne pourrait sans doute être que progressive.
À cet égard, je voudrais vous soumettre deux solutions possibles. La première consisterait à ne généraliser ce mécanisme que sur un type de production, par exemple les céréales, mais en impliquant l’ensemble de la filière. La seconde tendrait à l’expérimenter sur des filières qui, tout en étant indispensables économiquement et écologiquement, n’auraient pas les moyens d’appliquer le dispositif ; je pense notamment à la filière ovine et à celle des fruits et légumes.
Pour notre part, nous sommes favorables au principe qui nous est proposé, mais également réalistes. C'est la raison pour laquelle nous voterons cette proposition de loi en la considérant comme un texte d’appel
M. Yvon Collin acquiesce

et d’appui à la position que vous défendez dans les négociations, monsieur le ministre, négociations que nous espérons voir aboutir.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au regard de son caractère global et impératif, la proposition de loi tendant à généraliser l’assurance récolte obligatoire, déposée par nos collègues Yvon Collin et Jean-Michel Baylet, appelle un certain nombre d’observations.
En posant le principe de l’obligation de l’assurance récolte sans envisager la question de son financement, de ses modalités de mise en œuvre et de son inscription dans le cadre communautaire et international, le texte soulève beaucoup d’interrogations sans y apporter de réponses.
Mais c’est également là sa principale qualité, car elle suscite ainsi, dans notre assemblée, un débat – d’ailleurs nécessaire – sur la prise en compte des difficultés chroniques auxquelles doivent faire face les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers, les arboriculteurs, les viticulteurs, bref, le monde paysan dans sa globalité.
En effet, leur protection contre les aléas climatiques, sanitaires et économiques n’est pas assurée de manière satisfaisante et semble assez disparate, voire inexistante, selon les filières concernées.
Il existe plusieurs produits d’assurance sur le marché contre la grêle, contre le gel ou encore contre plusieurs risques combinés, avec le soutien de l’État et, souvent, des collectivités locales. Malgré ses imperfections, le Fonds national de garantie des calamités agricoles reste un mécanisme nécessaire dans bien des situations de crise. Cependant, si l’assurance récolte a progressé grâce à l’adoption de la loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, c’est surtout en direction des grandes cultures.
À ce titre, selon les indications fournies par le rapport de la commission, le taux de prise en charge de la prime d’assurance par le Fonds national de garantie des calamités agricoles a été le même pour toutes les cultures de 2005 à 2008. Compte tenu de la disparité des revenus et des risques entre les cultures, on peut s’interroger sur le bien-fondé d’une telle décision. C’est pourquoi il est heureux que, pour 2009, soit prévu un taux différencié favorisant les cultures les plus exposées.
Avant d’entrer dans le détail des difficultés posées par l’assurance récolte, dont le constat semble être largement partagé, j’aimerais soulever le problème du revenu des agriculteurs et, à travers lui, évoquer la notion d’« assurance revenu ».
La question de l’assurance récolte ne peut être déconnectée de la question de la garantie des prix aux agriculteurs. Il serait nécessaire de réfléchir à la mise en place d’un mécanisme assurant les volumes produits, peut-être même les prix, afin de tendre vers une régularisation des revenus.
Si le revenu net par actif de l’ensemble de la branche agriculture a augmenté entre 2006 et 2007, ce résultat positif est essentiellement dû à la forte progression de la valeur de la production agricole, qui s’explique à 85 % par les céréales oléagineuses et protéagineuses, dont le prix avait augmenté de 51 % par rapport à 2006. Cette augmentation a notamment entraîné une forte hausse du coût de production de l’alimentation animale, ce qui a mis en difficulté nombre d’éleveurs, parfois déjà affaiblis par des crises sanitaires.
Il faut noter de fortes disparités dans les revenus non seulement entre les grandes cultures susmentionnées et l’élevage, mais également entre celles-là et les autres productions végétales. Or ce sont également ces grandes cultures qui sont le mieux assurées.
Vous le voyez, on ne peut pas traiter la question assurantielle sans prendre en compte les difficultés économiques de bon nombre d’exploitations. Si certains agriculteurs ne s’assurent pas, c’est tout simplement qu’ils n’en ont pas les moyens !
C’est pourquoi, selon nous, il devient urgent que les sénateurs se saisissent de la question d’un prix rémunérateur des produits agricoles dans le cadre de la réflexion sur l’assurance récolte.
Nous le sentons bien, le véritable obstacle à la proposition de loi déposée par nos collègues réside dans l’engagement financier de l’État. En effet, un soutien budgétaire beaucoup plus important que celui qui est prévu aujourd'hui serait nécessaire si l’assurance récolte devenait obligatoire.
Ainsi, les 32 millions d’euros qui sont mobilisés aujourd'hui seraient à multiplier par dix. L’Espagne, pays cité en exemple, a consacré 280 millions d’euros au financement de son dispositif assurantiel.
Dans le contexte actuel de crise économique et financière, alors que le Gouvernement a vidé les caisses de l’État au profit des ménages les plus aisés, alors que le sous-engagement financier de l’État s’accompagne d’une sous-dotation du Fonds national de garantie des calamités agricoles, il serait illusoire de croire que la puissance publique est disposée à engager les sommes nécessaires à la viabilité du système d’assurance obligatoire.
De plus, les décisions relatives au soutien financier d’origine communautaire et à la compatibilité du soutien interne des États membres, c’est-à-dire à la participation aux primes d’assurance, n’ayant pas encore été définitivement prises, il nous semble opportun de ne pas imposer aux agriculteurs des obligations qui les mettraient en difficulté financière.
Lors des débats en commission, M. le rapporteur a souligné que, si certains agriculteurs ne s’assurent pas aujourd’hui, c’est en raison de l’absence d’un produit assurantiel adapté à leurs besoins. Nous partageons cette idée. Avant de rendre l’assurance obligatoire, peut-être serait-il intéressant de réfléchir sur ses modalités et d’envisager des solutions par filières.
La question de la concurrence entre les assureurs se pose également. Comme le notait déjà le rapport de Dominique Mortemousque, deux assureurs proposent des contrats d’assurances multirisques : Groupama, qui détenait, en 2005, les neuf dixièmes des contrats, et Pacifica, filiale du Crédit agricole. Selon le même rapport, si la bonne diffusion de l’assurance récolte pour les grandes cultures peut s’expliquer en partie par la bonne concurrence entre les deux opérateurs, cet élément ne sera certainement pas durable, a fortiori dans un système d’assurance obligatoire.
Il ne faudrait pas non plus sous-estimer le risque que les assureurs profitent de la subvention publique pour augmenter leurs primes, autrement dit que des tarifs prohibitifs consomment l’aide.
Enfin, la présente proposition de loi reste muette quant à la mutualisation puisqu’elle renvoie pour l’essentiel à un décret, et le rapport n’envisage la question qu’en quelques lignes, au travers du principe de l’extension progressive de l’assiette des cotisants.
Il est essentiel de déterminer quel niveau de mutualisation nous voulons dans le cadre d’un système d’assurance récolte obligatoire.
Si nous ne sommes pas catégoriquement opposés au principe d’une assurance obligatoire, nous estimons que sa mise en œuvre est quelque peu prématurée.
À l’heure de la réforme de la politique agricole commune, la présidence française n’a pas su proposer de mesures fortes pour défendre les cultures les plus fragiles et assurer un revenu décent aux agriculteurs. Les politiques européennes de suppression des quotas, de réforme des aides à la production vont dans le sens d’une déstabilisation des revenus et renforcent les inégalités au sein du monde agricole.
Nous considérons donc qu’il convient d’approfondir cette réflexion en prenant en compte un traitement assurantiel par filière, un haut niveau de mutualisation des risques, une participation substantielle de l’État et de l’Union européenne, sans oublier des prix rémunérateurs, une régulation des volumes de production et des marges de la grande distribution.
Or, si j’ai bien compris, notamment à la lecture du rapport de Dominique Mortemousque, ce qui se prépare, c’est le désengagement total de l'État dans ce domaine et son abandon aux appétits des assurances privées.
Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s’abstiendra sur cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous assistons depuis quelques années à une multiplication des incidents climatiques, qui a entraîné des difficultés croissantes de financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles, fonds qui indemnise les agriculteurs dans le cadre du régime « calamités naturelles ».
Les pouvoirs publics ont donc souhaité que le relais de ce régime soit pris par des mécanismes d’assurance récolte couvrant non pas un, mais plusieurs risques, conformément aux préconisations du rapport du député Christian Ménard, intitulé : « Gestion des risques climatiques en agriculture », remis le 11 février 2004 à M. Hervé Gaymard, alors ministre de l’agriculture.
Le dispositif d’assurance récolte, lancé par le Gouvernement dès février 2005, vise cet objectif en combinant un financement provenant, pour l’essentiel, des exploitants sur une base volontaire et, d’autre part, des subventions incitatives de l’État.
Cependant, s’il amorce de façon très opportune un développement progressif de l’assurance récolte, ce dispositif reste, en l’état, insuffisant. En effet, il laisse la souscription de contrats d’assurance à la seule initiative des agriculteurs. Or seul un dispositif reposant sur une assiette de cotisants aussi large que possible aurait une réelle portée.
Dans cette perspective, j’avais proposé, en ma qualité de rapporteur du projet de loi d’orientation agricole et avec le soutien appuyé du président de la commission des affaires économiques, Jean-Paul Emorine, d’inscrire dans la loi le principe d’une extension progressive du mécanisme d’assurance récolte à l’ensemble des productions agricoles, un décret devant en fixer les conditions d’application.
En adoptant l’amendement que j’avais déposé au nom de la commission des affaires économiques, le Sénat a étendu de manière progressive le mécanisme d’assurance récolte à l’ensemble des productions agricoles, ce qui a donné lieu à l’article 68 de la loi d’orientation agricole de février 2006.
Développer le recours par les exploitants agricoles à des polices d’assurance multirisques couvrant les sinistres occasionnés à leurs récoltes par des aléas climatiques, telle est la voie dans laquelle le Sénat a demandé que l’on s’engage. Le but de l’initiative de notre commission des affaires économiques était de favoriser une montée en puissance rapide des instruments d’assurance mis en place par le Gouvernement.
En permettant de mutualiser les sources de financement et de responsabiliser les exploitants, le dispositif d’assurance récolte a vocation, à terme, à prendre le relais du mécanisme de solidarité nationale, mécanisme qui, s’il a fait la preuve de son utilité jusqu’à présent, est désormais considéré comme insuffisamment efficace.
Un second rapport, rendu public le 28 février 2007, émanant de mon ancien collègue du groupe UMP, Dominique Mortemousque, parlementaire en mission, est venu compléter la réflexion sur le développement de l’assurance récolte, dressant un nouveau bilan. Intitulé : « Une nouvelle étape pour la diffusion de l’assurance récolte », ce rapport préconise trois grandes orientations.
Premièrement, la gestion des risques et des crises sera un élément majeur des prochains rendez-vous communautaires, notamment s’agissant du « bilan de santé » de la PAC pour l’après-2013 et les propositions françaises en vue d’un cofinancement ne seront crédibles que si l’assurance récolte continue vigoureusement sa progression selon une feuille de route claire et, surtout, consensuelle.
Deuxièmement, les lourds investissements que l’entreprise agricole doit consentir pour une adaptation plus étroite au marché de l’après-2013 nécessitent une couverture plus forte contre les aléas, donc mieux individualisée, tant par une amélioration de la déduction fiscale pour aléas que par l’assurance récolte, plutôt que par la procédure forfaitaire du régime des calamités agricoles, qui correspondait aux besoins de premiers secours d’une agriculture en cours de modernisation.
Troisièmement, les aléas économiques, climatiques et sanitaires n’étant pas indépendants, l’organisation de producteurs est la base logistique appropriée pour bien raisonner s’agissant de l’adaptation au marché, des investissements, des pratiques de prévention, ainsi que des prises de risque individuelles mesurées.
Pour choisir un objectif raisonnable de diffusion de l’assurance récolte, trois scénarios ont été étudiés suivant qu’elle reste cantonnée aux grandes cultures, qu’elle est étendue aux cultures spécialisées, comme la vigne ou les fruits et légumes, ou que l’ensemble des productions, fourrage compris, de la « ferme France » soient couvertes.
Le rapport Mortemousque conclut que, en tout état de cause, l’assurance récolte doit être non pas obligatoire, mais incitative.
Les années qui viennent de s’écouler ont montré que les problèmes rencontrés par les agriculteurs concernent non pas seulement les récoltes, mais également les troupeaux.
Au cours de la dernière décennie, les productions animales ont été touchées par des crises sanitaires majeures. Dans la quasi-totalité des cas, les crises sanitaires ont eu pour origine des contaminations extérieures aux élevages, que les mesures d’hygiène et de prévention appliquées par les éleveurs n’ont pas permis d’éviter.
Ces risques sanitaires, accentués par l’augmentation des échanges à l’échelle de la planète, deviennent des facteurs prédominants de déstabilisation économique et de déséquilibre des marchés. L’influenza aviaire et la fièvre catarrhale en sont des exemples, malheureusement plus que jamais d’actualité.
Il est donc essentiel aujourd’hui de pouvoir couvrir tous les risques, tant climatiques que sanitaires, ces derniers s’étant considérablement accrus ces dernières années du fait de la globalisation.
La question est posée : comment les Américains ont-ils mis en place l’assurance obligatoire ? Le rapporteur l’indiquait tout à l’heure, selon le système américain, l’assurance est obligatoire pour ceux qui empruntent de l’argent auprès des banques. Il faudra sans doute entamer une réflexion en France sur ces problèmes.
C’est la raison pour laquelle il faut englober tous les risques et parler d’« assurance aléas ».

À cet égard, l’échéance de 2013 sera l’occasion de dresser un premier bilan de l’assurance récolte et d’étudier plus sérieusement l’opportunité de la relayer par un mécanisme d’assurance plus globalisé, et ce à l’échelon communautaire, comme Mme Fischer Boel et vous-même, monsieur le ministre de l’agriculture, l’avez proposé, précisément dans le cadre des articles 68 et 69 du règlement européen.
L’entreprise agricole doit pouvoir désormais être accompagnée plus étroitement dans les nouvelles évolutions qui l’attendent, notamment après 2013. Il s’agit de repositionner les financements de l’État et la mutualisation professionnelle sur un investissement d’avenir pour l’agriculture, qui doit mobiliser toutes les énergies.
La nouvelle étape qui s’ouvre aujourd’hui est celle de la transition du régime des calamités agricoles vers la diffusion d’une « assurance aléas » dans les différentes catégories de productions ou d’élevage.
Si nous adhérons pleinement à l’objectif d’extension de l’assurance récolte, nous ne pouvons toutefois souscrire à la proposition de loi de nos collègues Yvon Collin et Jean-Michel Baylet, qui vise à rendre l’assurance récolte obligatoire.
Sans reprendre les arguments développés par notre excellent rapporteur de la commission des affaires économiques, Daniel Soulage, il est certain qu’une telle mesure se heurte dans l’immédiat à de fortes objections, tenant notamment au coût supplémentaire qu’elle induirait pour l’agriculteur.
En conclusion, le groupe UMP se rallie aux conclusions négatives de la commission.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l’examen aujourd'hui par votre assemblée de cette proposition de loi déposée par Yvon Collin et Jean-Michel Baylet, et tendant à rendre obligatoire l’assurance récolte, nous donne en réalité l’occasion de débattre d’une question centrale.
Même si, je le dis d’emblée, je ne souhaite pas que l’on ferme la discussion aujourd'hui en approuvant ce texte orienté dans une seule direction, je veux vous remercier, monsieur Collin, ainsi que M. Baylet, d’avoir soulevé, par votre initiative, un sujet névralgique, celui de l’exposition des entreprises agricoles aux risques, permettant ainsi au Gouvernement de donner une indication assez précise de ce qu’il souhaite faire à cet égard.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous partageons le même constat, celui de la nécessité de développer les outils de couverture des risques, à commencer par les risques climatiques, et d’en faire, le plus rapidement possible, bénéficier le plus grand nombre. C’est une priorité de mon action depuis dix-huit mois, tant sur le plan communautaire qu’à l’échelon national.
Vous vous en souvenez, sous l’impulsion de votre assemblée, grâce à la force de conviction du président de la commission des affaires économiques, Jean-Paul Emorine, le Gouvernement, par les voix successives d’Hervé Gaymard et de Dominique Bussereau, s’était engagé dans le développement de l’assurance récolte. Le principe de l’extension progressive de cette dernière à l’ensemble des productions agricoles a été ainsi introduit dans la loi d’orientation agricole de 2006 grâce à un amendement de Gérard César, alors rapporteur du texte.
La question qui nous est posée aujourd'hui, par le biais de la présente proposition de loi, est simple : il s’agit de savoir si la meilleure des solutions pour aller plus vite ne consisterait pas à rendre l’assurance récolte obligatoire.
Je serai tout à fait franc : le Gouvernement s’était lui-même posé cette question dès 2005, et je me la suis posée lorsque le Président de la République, à Rennes, m’a fixé comme priorité dans ma feuille de route « la généralisation de l’assurance récolte ».
Finalement, le Gouvernement n’a pas retenu l’obligation d’assurance. Il entend privilégier la responsabilisation des agriculteurs en renforçant de façon significative l’incitation à l’assurance et en inscrivant l’assurance récolte dans le cadre de la politique agricole commune.
Pourquoi avons-nous fait le choix de l’incitation ?
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai acquis une double conviction, renforcée depuis dix-huit mois.
En premier lieu, notre environnement a changé, devenant plus incertain. M. Raoul l’a excellemment dit, les risques se multiplient et s’amplifient. Les aléas climatiques, les crises sanitaires, l’explosion n’importe où, n’importe comment, de multiples agents pathogènes émergents sous le double effet du réchauffement climatique et de la mondialisation des échanges sont encore aggravés par le récent retournement des marchés. M. Le Cam a évoqué la situation économique liée à cette volatilité.
Tel est le quotidien des entreprises agricoles, qui sont, dans l’économie française, parmi les plus exposées et les plus vulnérables, et en même temps les moins bien protégées de nos entreprises.
Nos outils ne sont plus adaptés. C’est ce que je constate chaque semaine à l’occasion des échanges que j’ai, crise après crise, avec les agriculteurs, avec mes services, avec les élus.
En second lieu, seule une politique globale cohérente de la gestion des risques peut offrir aux agriculteurs une couverture complète. C’est d’ailleurs ce que votre ancien collègue Dominique Mortemousque avait mis en lumière dans son rapport.
Nous allons donc combiner épargne de précaution défiscalisée, assurance récolte volontaire, mais subventionnée, et indemnisation des risques sanitaires, à partir d’un cofinancement des agriculteurs que les pouvoirs publics pourront rendre obligatoire. Gérard César l’a bien rappelé, tous les risques sont liés.
C’est cette double conviction qui m’a conduit, dès mon arrivée rue de Varenne, à plaider l’introduction de la couverture des risques au sein de la politique agricole commune. C’est une première.
Nous avions une occasion avec le « bilan de santé » de la PAC, pour lequel nous abordons la dernière ligne droite. J’ai présidé hier et avant-hier le Conseil des ministres à Luxembourg. J’ai réuni dans des « triangulaires » mes collègues au cours de vingt-six réunions successives avec la Commission pour essayer de trouver les chemins du compromis et du consensus. Je pense pouvoir annoncer que nous sommes sur la voie d’un accord politique concernant ce « bilan de santé » pour le 19 ou le 20 novembre prochain, après avoir pris en compte l’avis du Parlement européen.
Cette grande politique qu’est la PAC – la première politique économique européenne – ne peut pas se réduire à des aides découplées et à un renforcement de la politique de développement rural. Elle doit intégrer cette montée des risques, notamment climatiques et sanitaires. Alors que la Commission avait initialement envisagé de les prendre en compte dans le cadre du second pilier de la PAC, nous avons obtenu que leur couverture devienne un des outils du premier pilier de la PAC.
Je veux dire à Gérard César et à Daniel Raoul, que je remercie de leurs encouragements, que je compte bien mobiliser tous les articles du règlement qui est en discussion dans cette boîte à outils pour aboutir à ce résultat.
C’est pour moi, une avancée importante et une perspective pour l’avenir.
Je rappelle le calendrier : la boîte à outils du « bilan de santé », nous en disposerons, si tout se passe bien, dès le mois de novembre ; il nous faudra six mois pour décider, après un débat franco-français auquel le Parlement sera associé, de la façon dont seront utilisés les outils et dont seront réorientées les aides à l’intérieur du premier et du second piliers ; les décisions que nous prendrons en 2009 seront applicables en 2010.
Nous allons donc pouvoir, dès 2010, mobiliser des moyens prélevés sur les aides pour financer le développement de l’assurance récolte et mieux indemniser les conséquences économiques des crises sanitaires. Nous en négocions dans le détail les modalités pour en améliorer l’efficacité.
Voilà pour l’avancée.
C’est également une perspective pour l’avenir, car nous avons ouvert la voie à d’autres dispositifs assurantiels pour l’après-2013. Nous avons ainsi mis le pied dans la porte pour demain. Monsieur Le Cam, on ne peut envisager pour l’avenir une « assurance revenu » dans la politique commune, puisque c’est ce que vous appelez de vœux, sans avoir préalablement développé, dans cette même politique commune, l’assurance récolte ; de mon point de vue, c’est la première étape.
La double conviction que j’ai acquise m’a également conduit à réorienter fondamentalement notre dispositif national parce que, même si son bilan est positif, il montre des signes d’essoufflement.
Quels enseignements peut-on tirer de ce bilan ?
Le premier est que les mécanismes actuels se « vampirisent » les uns les autres. Coexistent à la fois l’indemnisation publique et l’assurance privée subventionnée, avec en plus une déduction pour aléas qui ne fonctionne pas réellement. Il faut, donc, les clarifier et proposer aux agriculteurs un ensemble cohérent, mais diversifié dans ses outils.
Le deuxième enseignement est que l’assurance s’est développée, mais sa diffusion a été très inégale selon les secteurs. Vous avez donné les chiffres, monsieur le rapporteur : l’assurance récolte est restée concentrée sur les productions les moins risquées. Les secteurs les plus exposés aux risques – les fruits et légumes, ainsi que la viticulture – se sont peu assurés ou ne se sont pas assurés. On sait en outre que, pour les fourrages, l’offre de produits d’assurance n’en est qu’au stade d’une expérimentation, chez un seul assureur.
Il faut, donc, une approche différenciée et inscrite dans le temps, avec une vraie progressivité.
Le troisième enseignement est que la voie du contrat, en l’occurrence du contrat d’assurance, reposant sur la responsabilisation des agriculteurs et un engagement des pouvoirs publics est la voie plus efficace. Elle permet d’atteindre les objectifs de couverture chez le plus grand nombre tout en participant à l’intégration des risques dans la gestion des entreprises agricoles. Je serais tenté de dire : le contrat plutôt que la contrainte !
Il faut, donc, dans un contexte budgétaire tendu – disons la vérité ! –, mobiliser les moyens suffisants.
Au regard du bilan que je viens d’exposer sommairement, notre dispositif évoluera profondément en 2009. Ce sera, mesdames, messieurs les sénateurs, la première étape d’une refonte substantielle de la couverture des risques.
Ainsi, le soutien à l’assurance récolte sera renforcé dans le secteur des fruits et légumes et dans celui de la viticulture ; il passera à 40 %, et à 45 % pour les jeunes agriculteurs. En contrepartie, il sera ajusté à 25 % pour les grandes cultures.
Par ailleurs, les grandes cultures, dont le taux de surfaces assurées est supérieur aujourd'hui à 27 %, ne seront plus indemnisées au titre du Fonds national de garantie des calamités agricoles pour la perte de récolte, mais elles continueront à l’être pour les pertes de fonds.
De surcroît, la déduction pour aléas, la DPA, qui permet aux agriculteurs de constituer une épargne de précaution défiscalisée sera réformée. Son plafond de 23 000 euros sera indépendant du plafond de la déduction pour investissement, la DPI, dont le montant sera de 15 000 euros.
Enfin, pour assurer la cohérence entre les différents outils, le niveau de la DPA sera conditionné à la souscription d’une assurance. Cette épargne pourra être mobilisée pour prendre en charge la franchise non couverte par l’assurance.
Le Gouvernement a donc fait le choix d’une politique ambitieuse de la couverture des risques climatiques en l’inscrivant dans la durée et en augmentant significativement les moyens qui lui sont consacrés.
Ainsi, en 2009, les moyens publics affectés à l’assurance récoltes s’élèveront à 38 millions d’euros. Ils passeront à 100 millions d’euros en 2010, financement communautaire compris et hors FNGCA. À ces sommes, il convient d’ajouter l’impact de la DPA sur les rentrées fiscales, estimé, lui, à 80 millions d’euros.
Pour répondre à Yvon Collin sur la question du financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles, je rappelle que le Gouvernement le dote chaque année en loi de finances rectificative, la moyenne sur dix ans s’établissant à environ 90 millions d’euros. Pour mémoire, la sécheresse de 2003 a coûté, elle, plus de 600 millions d’euros.
Je souhaite doter le Fonds national de garantie des calamités agricoles en loi de finance initiale, ce qui a toujours été mon idée. Cependant, cela n’a pas été possible compte tenu des contraintes qui pèsent sur le projet de loi de finances pour 2009 et de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Ce sera prévu en 2011, dans le plan triennal budgétaire, à hauteur de près de 40 millions d’euros.
Pour répondre encore à une question de M. Collin, je précise que ce n’est qu’en 2010 que le coût budgétaire du développement de l’assurance jouera à plein, en raison du décalage entre le paiement des primes et la souscription des contrats.
En 2010, le financement de l’État est prévu à hauteur de 60 millions d’euros, soit le double de ce qui est actuellement payé. En 2011, le coût total sera supérieur à 100 millions d’euros, mais le financement européen en assurera plus de la moitié. Je négocie actuellement, je vous le répète, dans le cadre du « bilan de santé » un taux de cofinancement européen aussi élevé que possible pour accroître nos marges de financement.
Pourquoi, en fin de compte, n’avons-nous pas opté pour l’obligation d’assurance ?
Selon les auteurs de la proposition de loi, si j’ai bien compris leur intention, l’obligation d’assurance amorcerait un cercle vertueux : tous les agriculteurs étant assurés, les risques seraient mutualisés et le coût de l’assurance en serait réduit.
Cela me paraît relever d’une vision un peu idyllique.
Sourires
Elle sous-estime les questions de fond et les difficultés qu’une telle obligation engendrerait et que votre rapporteur a rappelées avec pertinence.
Je voudrais revenir brièvement sur les objections qu’appelle une telle proposition.
D’abord, l’assurance récolte n’est pas une assurance responsabilité. La rendre obligatoire, c’est interférer avec la responsabilité individuelle de l’agriculteur dans l’appréciation du risque de son entreprise. C’est peut-être aussi la fausser.
Ensuite, l’obligation d’assurance suppose, pour être efficace, que tous les agriculteurs aient accès à des contrats. Or le faible taux de souscription dans certains secteurs est le résultat de l’insuffisance, voire de l’inexistence – je pense aux fourrages – de l’offre des assureurs. L’obligation ne réglerait pas cette question.
Par ailleurs, l’obligation d’assurance ne sera efficace que si des sanctions sont prévues et appliquées. C’est une simple règle de droit : il n’y a pas d’obligation sans sanction. Mais cette sanction serait-elle acceptée aujourd'hui par les agriculteurs, qui pourraient argumenter que leur refus de s’assurer ne concerne qu’eux et qu’ils ne causent aucun tort à autrui ?
Enfin, l’obligation d’assurance exige la mise en place d’une réassurance publique et de mécanismes publics garantissant à tous la possibilité de s’assurer.
J’ai bien lu, monsieur le rapporteur, votre analyse sur les limites de la réassurance privée et j’ai pris bonne note de votre demande de réassurance publique, à l’instar de ce qui se pratique aux États-Unis ou en Espagne. C’est un point que nous avons discuté avec les assureurs et le ministère de l’économie. Nous sommes convenus de faire le point au fur et à mesure du développement de l’assurance.
Nous n’avons donc pas fermé la porte de la réassurance publique, mais nous devons miser aujourd’hui sur le développement de la réassurance privée, avec le souci de l’évaluation régulière.
J’ai bien entendu votre proposition relative à la Caisse centrale de réassurance, à laquelle le Président de la République vient de demander de faciliter l’assurance des crédits aux entreprises. Cette annonce ne vous avait certainement pas échappé, monsieur Soulage ! Je serai évidemment très attentif au suivi de cette question.
J’ajoute que l’obligation d’assurance, telle qu’elle est envisagée par les auteurs de la proposition de loi, se traduirait, comme M. le rapporteur l’a rappelé, par un coût inscrit en loi de finances multiplié par dix.
Je ne voudrais pas sous-estimer les risques d’exclusion que vous avez mis en avant, monsieur le rapporteur, en soulignant que, malgré ses imperfections, le FNGCA, qui indemnise en moyenne 30 % des dommages, avait été en quelque sorte une caisse d’« assurance coups durs ».
J’ai bien compris vos craintes d’une sortie trop rapide de certaines filières de l’indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Je veux vous rassurer : la décision n’est prise que pour les grandes cultures. Nous serons très vigilants quant à la sortie des autres secteurs, surtout s’ils sont très exposés aux risques.
Nous allons aussi travailler avec les assureurs au contenu des contrats d’assurance pour en améliorer les conditions. Une « assurance coups durs » pourrait avoir sa place dans une palette de contrats offerts aux agriculteurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, sachez que, en tout cas, nous ne laisserons pas d’agriculteurs au bord du chemin. L’engagement du Gouvernement repose sur le principe de la solidarité, qui se manifeste, premièrement, par un taux de subvention des contrats d’assurance plus élevé pour les secteurs les plus exposés – notamment la viticulture et les fruits et légumes – et, deuxièmement, au travers du Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Nous avons déjà cette préoccupation : les exploitations victimes d’orages de grêle, qui ne sont pas éligibles aux indemnisations du FNGCA, peuvent actuellement, sous condition de revenu, bénéficier d’une prise en charge de leurs cotisations sociales ou d’un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il me semble ainsi plus judicieux d’orienter de telles exploitations vers ces dispositifs pour ne pas entraver l’incitation à souscrire une assurance récolte.
Enfin, le Comité national de l’assurance en agriculture devra chaque année faire le bilan du dispositif que je viens de décrire à grands traits, et nous en tirerons les conséquences pour l’adapter.
Si le Gouvernement partage l’objectif de la proposition de loi, s’il remercie ses auteurs d’avoir soulevé cette question, il ne souscrit pas au moyen envisagé pour l’atteindre, c’est-à-dire l’obligation d’assurance. Mais, en la matière, je n’ai pas d’idéologie : pour les risques sanitaires, nous nous orientons vers une contribution obligatoire des professionnels et une indemnisation publique.
Pour toutes ces raisons, tout en considérant que cette proposition de loi nous ait fourni une bonne occasion de faire le point, jouant un rôle de levier pour la réflexion politique et les décisions à prendre dans le cadre du « bilan de santé » de la PAC, je souhaite que votre assemblée suive les conclusions de la commission des affaires économiques et n’adopte pas cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

La discussion générale est close.
Y a-t-il des explications de vote sur les conclusions de la commission des affaires économiques tendant à ne pas adopter la proposition de loi n° 214 ?...
Je les mets aux voix.
Ces conclusions sont adoptées.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : M. Nicolas About, Mmes Bernadette Dupont, Brigitte Bout, Françoise Henneron, Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, M. Guy Fischer.
Suppléants : MM. Gilbert Barbier, Jean Boyer, Yves Daudigny, Mmes Annie David, Isabelle Debré, M. Jean Desessard, Mme Christiane Kammermann.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : M. Nicolas About, Mmes Isabelle Debré, Brigitte Bout, Catherine Procaccia, Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Annie David.
Suppléants : M. Gilbert Barbier, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Guy Fischer, Mme Françoise Henneron, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Bernard Frimat.