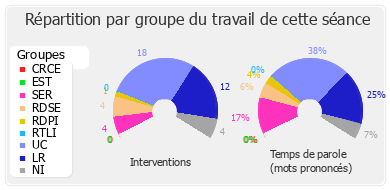Séance en hémicycle du 15 décembre 2014 à 10h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Amélioration du régime de la commune nouvelle (voir le dossier)
- Discussion en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Mise au point au sujet d'un vote (voir le dossier)
- Amélioration du régime de la commune nouvelle
- Suite de la discussion en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Communication relative à une commission mixte paritaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (proposition n° 77, texte de la commission n° 145, rapport n° 144).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la commune, nous le savons tous, est un pilier de notre République. De nombreux élus locaux nous relaient sur le terrain, et ce n’est pas le président de l’Association des maires de France, François Baroin, qui me démentira !
C’est l’échelon d’évidence, un point de repère, celui auquel l’ensemble de nos concitoyens s’identifient.
C’est l’échelle de base de notre démocratie, celle où se noue le lien entre les citoyens et la chose publique ; celle où des élus, souvent bénévoles ou quasi bénévoles, engagés pour leurs administrés, font vivre le dialogue et le débat démocratiques.
C’est le niveau où sont résolus les problèmes du quotidien, celui où les citoyens ont le sentiment d’être protégés. C’est au maire qu’on s’adresse pour débloquer une situation lorsqu’on a besoin d’aide, qu’on cherche à se loger, à trouver une place en crèche ou un travail.
En cette période de crise, sans doute encore plus qu’à n’importe quelle autre période, c’est le lieu de la confiance : celui où les élus peuvent comprendre les attentes, rapprocher les points de vue, expliquer les décisions.
Ce sont autant de raisons qui nous conduisent à vouloir préserver les communes et conserver cette spécificité française. Pour ce faire, il nous faut également répondre à certaines difficultés des communes. Même si la commune est une richesse, cette richesse est aussi une forme d’« émiettement », si j’ose dire. Aussi, il nous faut parfois avancer.
En effet, cet émiettement ne permet pas à toutes les communes de faire face aux obligations qui sont les leurs, ni de développer les services publics nécessaires à la population locale. Il conduit parfois les communes à manquer de compétences en matière d’ingénierie essentiellement, ce qui les rend également captives des bureaux d’études privés dans la concrétisation et la mise en œuvre de leurs projets de territoire.
Depuis la création de nos communes et les dernières grandes réformes de notre organisation territoriale, nos territoires, les enjeux auxquels doit répondre l’action publique ainsi que les attentes de nos concitoyens ont profondément évolué : des problèmes plus complexes, des territoires plus interdépendants, des personnes plus nombreuses et plus mobiles, plus éduquées, plus exigeantes aussi à l’égard de la puissance publique, des bassins de vie et d’emplois plus vastes. Ces mutations appellent une action publique repensée et, sans aucun doute pour les communes, des rapprochements.
Tel est le sens de la montée en puissance de l’intercommunalité, que les gouvernements successifs ont encouragée depuis les années quatre-vingt-dix, une intercommunalité que le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit projet de loi NOTRe, dont la Haute Assemblée débattra demain, généralisera et renforcera, afin de repenser la présence physique des services publics au sein de nos territoires et de garantir partout où cela est possible un niveau de services adaptés aux besoins.
Tel est aussi le sens de la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui.
Comme je l’ai indiqué à vos collègues députés, Jacques Pélissard et Christine Pires Beaune, qui sont à l’initiative de ce texte, la fusion de communes n’est pas une alternative à l’intercommunalité. Bien au contraire !
D’abord, la fusion des communes ne répond pas aux mêmes enjeux.
L’intercommunalité, c’est penser l’action publique à l’échelle des territoires vécus, offrir aux communes des perspectives de mutualisation efficaces et opérantes pour créer des services qu’elles ne pourraient offrir seules à leurs habitants.
La fusion de communes, c’est permettre aux communes historiquement ou géographiquement liées, à celles qui n’ont plus les moyens de faire face à certaines contraintes juridiques ou financières ou encore à celles qui souhaitent constituer une véritable « centralité » de se regrouper. Il s’agit de créer des communes plus fortes, pour une efficacité plus grande de l’action municipale.
La commune nouvelle est un complément de l’intercommunalité et un outil au service de la dynamique d’intégration intercommunale. Elle permettra aux communes de peser au sein des nouveaux ensembles et elle garantira, grâce à des communes fortes, des intercommunalités fortes. Ce n’est pas Jean-Pierre Sueur qui défend ce projet depuis longtemps qui me démentira…
Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est bien pour répondre aux difficultés des communes les plus petites et pour accompagner la montée en puissance de l’intercommunalité que l’Assemblée nationale a souhaité donner un nouvel élan à la commune nouvelle.
Aujourd’hui, force est de constater que la procédure de fusion n’offre pas encore toutes les facilités ni tous les leviers pour que les élus locaux se saisissent pleinement de ce dispositif. Malgré les améliorations apportées en 2010, seule une douzaine de communes nouvelles ont jusqu’à présent été créées. Pourtant, nombreuses sont celles qui pourraient en bénéficier. Je pense à celles qui peinent à faire face à leurs dépenses de structure incompressibles, à celles qui n’ont pas pu participer, faute de candidat, au premier tour de scrutin lors des élections municipales ou encore à celles qui n’ont aujourd’hui quasiment plus, voire plus du tout, d’habitants.
Nombreuses sont les opportunités offertes par la commune nouvelle en termes de fonctionnement, de finances et d’investissement, le rapporteur Michel Mercier en a fait l’expérience.
À ce sujet, le 31 octobre dernier, nous avons eu avec les députés un débat très riche. Je sais que vous êtes dans les mêmes dispositions s’agissant de ce texte. Le Gouvernement étant, lui aussi, favorable aux incitations qu’introduit cette proposition de loi, l’avenir des communes nouvelles me semble pouvoir être sereinement assuré.
L’avenir des communes nouvelles sera assuré grâce, notamment, à un renforcement de la place et du rôle des maires délégués, à une simplification des procédures en matière de fusion et, enfin, grâce à une consolidation des incitations financières, ce qui, dans la période actuelle, me semble être un signe relativement fort.
Lors du débat qui s’est tenu à l’Assemblée nationale, des ajustements ont été réalisés, des précisions ont été apportées et quelques mesures, comme celles qui sont relatives au nom de la commune, ont été ajoutées, mais l’esprit général du texte n’a pas changé. Le Gouvernement aura donc une position similaire : il apportera un soutien global au texte, aura la préoccupation de l’améliorer et ne formulera seulement que quelques objections.
Ces objections, ce sont les mêmes que celles qu’il a faites à l’Assemblée nationale. Elles concernent, en premier lieu, la prolongation du nombre dérogatoire de conseillers municipaux dans les communes nouvelles, et le risque d’inconstitutionnalité que cela pose.
Je le redis, s’il semble opportun de créer une dérogation pour la période transitoire courant entre la date de création de la commune nouvelle et le renouvellement municipal suivant, il ne me paraît pas possible d’envisager que la dérogation soit prolongée au-delà. C’est pourquoi le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir sur cette disposition.
Concernant les travaux de votre commission, le Gouvernement est largement favorable aux précisions et améliorations que vous avez souhaité apporter, car celles-ci vont dans le sens d’un meilleur fonctionnement du dispositif des communes nouvelles. C’est pourquoi nous partageons votre objectif.
Néanmoins, un ou deux ajustements nous semblent nécessaires. Il ne faudrait pas, par exemple, que le régime des communes nouvelles conduise à des modifications substantielles des codes de l’urbanisme ou de l’environnement sans évaluation préalable ni étude d’impact. Ce n’est pas le sens des mesures que nous prenons par ailleurs, pas plus que ce n’est l’intérêt de nos territoires ni de nos concitoyens.
C’est la raison pour laquelle la proposition que vous faites concernant l’application de la loi Littoral ne nous semble pas devoir être maintenue.
M. le rapporteur s’étonne.
Enfin, concernant les amendements que vous avez déposés, il n’y a pas de problème majeur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est un texte de confiance et de coopération.
Dans son élaboration d’abord, il procède d’une confiance entre le Gouvernement et les parlementaires et d’une coopération transpartisane au sein du Parlement.
Dans son objet ensuite, il vise à faciliter les coopérations entre les communes et entre les élus. Il s’agit de faire confiance aux élus, en leur donnant les moyens de sortir de l’impasse dans laquelle ils se trouvent parfois, en mettant à leur disposition des outils pour garantir le devenir de leurs communes.
Ce texte est donc un texte d’avenir : c’est par la confiance et la coopération que nous assurerons ensemble, État partenaire et collectivités libres, autonomes, le développement de tous les territoires de France.
À ce titre, je sais que certains sénateurs sont déjà mobilisés sur leur territoire pour présenter et expliquer le nouveau dispositif des communes nouvelles. Les rencontres, les conférences et les débats qui sont envisagés me semblent parfaitement concrétiser sur le terrain l’objet de cette proposition de loi. Sachez que le Gouvernement est tout à fait disposé à venir vous soutenir dans ces démarches, s’il en était besoin. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’une des richesses de la France, nous le savons bien, réside dans ses 36 000 ou 37 000 communes. Si celles-ci constituent, il est vrai, une richesse pour le développement de nos spécificités et l’engagement de nos concitoyens, un nombre trop important de communes peut apparaître parfois comme un handicap. Aussi est-il normal de proposer des solutions à celles qui désirent se regrouper.
L’expérience le montre, toute tentative autoritaire de procéder à un regroupement des communes dans notre pays est voué à l’échec. Nos communes sont profondément enracinées dans notre histoire – dans notre histoire politique et dans notre histoire tout court, si je puis dire – ainsi que dans notre vie quotidienne.
Lors de la création des communes en 1789, l’État nouveau n’a fait que reprendre et consacrer des bourgs, des villes, des paroisses qui existaient depuis des siècles et des siècles. On ne peut donc pas faire disparaître d’un coup de baguette magique quelque chose qui a plus de 1000 ans et qui correspond à une réalité humaine profonde.
Néanmoins, les choses changent. Aujourd’hui, certaines communes peuvent avoir envie de se regrouper ou en éprouver la nécessité. Dès lors qu’elles ont fait ce choix, il appartient au législateur de les aider de la façon la plus efficace et la plus démocratique qui soit.
J’ai dit que les tentatives antérieures de regroupement autoritaire des communes avaient échoué. C’est si vrai que notre pays, qui comptait 36 551 communes en 1971, avant la loi Marcellin, en compte aujourd’hui 36 767 ! Non seulement, donc, les communes ne se sont pas regroupées, mais certaines se sont scindées, de sorte que les communes sont plus nombreuses aujourd’hui qu’au moment du vote de la loi Marcellin.
Cette réalité prouve combien la commune est enracinée dans notre vie. Le législateur en a tenu compte, en fondant la loi du 16 décembre 2010 sur un principe différent de celui de la loi Marcellin, du reste fort simple : le volontariat. En d’autres termes, si les communes veulent se regrouper, elles peuvent le faire, la loi organisant une procédure pour le leur permettre.
Permettez-moi d’enjamber les considérations historiques qui figurent dans mon rapport écrit pour insister sur la situation qui résulte du vote de cette loi de 2010.
Les communes nouvelles peuvent être créées à la demande des conseils municipaux de toutes les communes concernées. Certes, trois autres hypothèses ont été envisagées par le législateur, mais il faut bien reconnaître que seul ce cas de figure a une valeur réelle. En effet, si la procédure est lancée sur l’initiative du préfet seul, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux, c’est que l’idée même d’une commune nouvelle n’est pas acceptée, et qu’il convient d’attendre ou de renégocier.
L’attrait du régime de la commune nouvelle issu de la loi du 16 décembre 2010 réside essentiellement dans l’organisation prévue pour la nouvelle entité ; il tient, en particulier, au statut de commune déléguée reconnu aux communes préexistantes, auxquelles est maintenu un maire délégué. En fait, on applique aux communes nouvelles le schéma prévu par la loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, dite loi PLM, les maires délégués disposant des mêmes pouvoirs que les maires d’arrondissement de ces trois villes. Cette reconnaissance accordée aux anciennes communes est importante ; c’est un argument qui peut parfois jouer.
En somme, la commune nouvelle, qui est l’unique sujet de droit, compte un seul maire et un seul conseil municipal, mais les communes déléguées conservent un maire délégué, qui symbolise la communauté villageoise maintenue et offre à chaque citoyen la possibilité de continuer à disposer d’un interlocuteur de proximité.
Le régime de la commune nouvelle a été instauré, en 2010, au milieu de réticences nombreuses.
MM. Hervé Maurey et Henri Tandonnet approuvent.

Elle l’était d’autant moins qu’aucune incitation financière n’était mise en place pour encourager la création de communes nouvelles : celles-ci devaient simplement se voir appliquer le droit commun, ce qui, du reste, peut être très intéressant : souvent, la commune nouvelle comptant par définition plus d’habitants que les communes antérieures, le changement de strate de population s’accompagne d’une augmentation parfois importante de la dotation globale de fonctionnement. Comme l’on connaît mieux ce que l’on a fait, je prendrai l’exemple de la commune nouvelle que j’ai créée : nous avons bénéficié d’un supplément de dotation de l’État de 150 000 euros, sans aucune majoration, mais du seul fait de l’application du droit existant.
Quel est le bilan de la loi du 16 décembre 2010 ? En vérité, il est extrêmement faible : au 1er janvier prochain, il y aura en France seulement dix-huit communes nouvelles.
Toutefois, on observe, de manière paradoxale, un intérêt pour la formule de la commune nouvelle. J’en veux pour preuve le nombre de participants aux réunions des communes nouvelles, qui se tiennent une fois par an : de soixante à la première réunion, ce nombre est passé à quatre cent cinquante-sept, il y a quelques semaines, à Baugé-en-Anjou ! En outre, au dernier congrès de l’Association des maires de France, six cents personnes ont assisté à une réunion organisée sur le thème des communes nouvelles, sous la présidence de notre collègue Mme Jacqueline Gourault.
Comment expliquer l’intérêt des maires pour la commune nouvelle ? Selon moi, il résulte d’au moins deux motifs.
Le premier de ces motifs est très paradoxal. Il faut se représenter, mes chers collègues, que les intercommunalités ont été créées pour protéger l’existence de la commune, pour la conserver.

Le nombre des communes peut parfois sembler trop élevé, a-t-on pensé, mais après tout, il est une richesse, et, du reste, on ne peut rien y changer.
Dès lors que les évolutions actuelles, initiées par la loi du 16 décembre 2010 et peut-être prolongées par la future loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe, tendent à la construction d’intercommunalités plus larges, cet échelon va perdre en proximité, et la commune – mais la commune forte – va retrouver de l’intérêt. De là l’utilité de la commune nouvelle, au sein d’intercommunalités agrandies.
Le second motif de l’intérêt que les maires marquent pour la commune nouvelle est, bien entendu, la baisse des dotations de l’État. En effet, les petites communes, et certaines communes moyennes parmi les moins importantes, voient avec crainte la baisse à venir de leurs moyens, qui sont déjà comptés. Dans ces conditions, l’idée de se regrouper pour rendre la gestion publique plus efficace apparaît comme une évidence dans un grand nombre de cas.
De fait, dans ma commune nouvelle, nous avons réalisé des économies de gestion très substantielles grâce à l’effet masse : je pense aux commandes de fournitures scolaires, aux contrats d’assurance et à de nombreuses autres dépenses de fonctionnement. Au total, nous avons gagné plus de 100 000 euros par an, dans une commune qui reste petite. Cet avantage ne peut manquer de susciter l’intérêt des maires.
C’est dire si la présente proposition de loi, fruit des initiatives de nos collègues députés MM. Jacques Pélissard et Bruno Le Roux et destinée à faciliter la création de communes nouvelles, est la bienvenue. La commission des lois du Sénat a reconnu le bien-fondé de la plupart des dispositions du texte transmis par l’Assemblée nationale, visant à rendre plus attractif le dispositif instauré en 2010.
La proposition de loi vise d’abord à faciliter le passage de plusieurs communes à une seule en ce qui concerne la composition du conseil municipal. Cet aspect est relativement important et présente une différence fondamentale avec le régime issu de la loi Marcellin. Alors que celle-ci instaurait un sectionnement électoral de droit, de sorte que certains électeurs ne votaient jamais pour élire le maire, la loi du 16 décembre 2010, tout en prévoyant la présence d’un bureau de vote dans chaque commune déléguée, établit une circonscription électorale unique et des listes de candidats uniques à l’échelle de la commune. Ainsi, tous les électeurs de la commune éliront le maire, ce qui constitue un progrès évident par rapport à la loi Marcellin.
Seulement, des mesures transitoires doivent être prises s’agissant du nombre de conseillers municipaux. En effet, lorsque la commune nouvelle est créée, dans la mesure où la loi du 16 décembre 2010 prévoit que les conseillers ne peuvent pas être plus de soixante-neuf, certains conseillers municipaux des anciennes communes sont nécessairement laissés de côté. La présente proposition de loi prévoit que l’ensemble des conseillers municipaux resteront en fonction jusqu’au renouvellement général du conseil municipal.
Au surplus, la proposition de loi étend la période transitoire au mandat qui suit le premier renouvellement général après la création de la commune nouvelle : au cours de ce mandat, le nombre de conseillers municipaux sera porté au niveau prévu pour la strate de population supérieure, ce qui représente deux ou quatre conseillers municipaux supplémentaires. Cette disposition fera l’objet d’une petite discussion avec le Gouvernement, même si les raisons qui l’ont inspirée sont relativement simples : chacun comprend que passer d’un conseil municipal qui compte soixante-neuf membres à un conseil municipal qui en comporte vingt-trois pose un certain nombre de problèmes humains.
Je précise que ces mesures s’appliqueront à enveloppe constante en matière d’indemnités à verser aux élus, de sorte qu’aucune charge supplémentaire ne sera créée.
Ensuite, la proposition de loi confère aux maires délégués, qui jouent un rôle essentiel et sont, dans le cadre des anciennes communes, les premiers représentants de la commune nouvelle auprès de la population, le statut d’adjoint au maire de droit de la commune nouvelle, hors quota.

Cette mesure sera mise en œuvre, comme les dispositions relatives à la composition du conseil municipal, dans le cadre d’une enveloppe d’indemnités fermée.
Les maires délégués voient donc leur rôle conforté, d’autant plus que la conférence des maires, qui existait déjà de fait dans les communes nouvelles, est reconnue sur le plan légal. Cette place renforcée du maire délégué est, je le crois, de nature à faciliter la création de communes nouvelles, car elle rassurera la population sur le maintien de sa communauté villageoise.
Par ailleurs, la proposition de loi fixe une procédure pour le choix du nom de la commune nouvelle. De fait, après qu’on s’est mis d’accord sur tout, il faut bien trouver un nom à la commune ! Or, si cela va parfois de soi, il y a des cas où il y faut un peu de temps…
M. Henri Tandonnet approuve.

D’autres dispositions répondent à la nécessité de prendre en compte les spécificités urbanistiques des communes déléguées. Nous en parlerons dans la discussion des articles, notamment en ce qui concerne la question extrêmement importante de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite Loi littoral, dont la commission des lois souhaite que le périmètre d’application ne soit pas modifié par la création d’une commune nouvelle.
La proposition de loi vise également à garantir les ressources budgétaires des communes nouvelles, ce qui est extrêmement important, et prévoit l’attribution à ces communes, pendant une durée transitoire de trois ans, d’une bonification de 5 % de la dotation globale de fonctionnement forfaitaire.
La garantie du niveau de la DGF constatée lors de la création d’une commune nouvelle jusqu'au 1er janvier 2016 est extrêmement forte, puisqu'elle dure trois ans. C’est une garantie pérenne, car elle assure le maintien d’un montant identique de DGF. Les communes nouvelles ne supporteront pas les diminutions de dotations prévues en 2016 et en 2017. Telle est la disposition adoptée par l’Assemblée nationale, à laquelle la commission vous propose de souscrire.
Voilà l’essentiel des dispositions de la proposition de loi qui vous est soumise, mes chers collègues, et qui vise ainsi à faciliter la création de communes nouvelles tout en respectant un principe de base, celui du volontariat : n’en créeront que les communes qui en auront envie ! Certaines communes s'y sentiront poussées pour améliorer la gestion publique ou pour mieux répondre aux attentes de leurs administrés ; elles pourront alors le faire dans le cadre d’une procédure simple et claire, qui préserve les communautés villageoises installées depuis toujours dans notre pays.
Ce texte, dont les petites ou moyennes communes semblent avoir principalement vocation à s'emparer, permet donc un équilibre entre maintien des communautés villageoises et impératif d’une meilleure gestion.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l'UMP . – M. le président de la commission des lois applaudit également.

Lors du scrutin n° 73 relatif à la proposition de résolution sur la reconnaissance de l’État de Palestine présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, MM. Didier Robert et Alain Fouché ont été déclarés votant contre, alors qu’ils souhaitaient s'abstenir.

Ma chère collègue, acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François Baroin.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce jour est directement issue des travaux de l’AMF, l’Association des maires de France. Je veux rendre hommage à Jacques Pélissard, mon prédécesseur à la tête de cette association : c'est lui qui, en première lecture à l’Assemblée nationale, a mené le débat autour des enjeux qui nous rassemblent ce matin.
Voilà un an, la résolution générale du congrès des maires de France avait pris acte de la nécessité d’une relance de la commune nouvelle, dont, je le rappelle, M. le rapporteur avait été à l’initiative lors de l’adoption de la loi du 16 décembre 2010.
Dans un premier temps, l’AMF avait obtenu l’inscription de mesures incitatives dans le projet de loi de finances pour 2014. Puis une proposition de loi, dont les dispositions avaient été validées par le bureau pluraliste de l’Association, fut déposée à l’Assemblée nationale au mois de janvier dernier par Jacques Pélissard, alors président de l’AMF.
Ce rappel devant la Haute Assemblée de la filiation de la présente proposition de loi me semble utile, non pour faire preuve d’une approche corporatiste, mais pour souligner le caractère de ce texte à la fois innovant et complémentaire des débats qui animent nos territoires autour d’une nouvelle organisation territoriale – débats qui vont d'ailleurs un peu dans toutes les directions, vous me permettrez de le dire !
Il s’agit en effet de la seule réforme structurelle soutenue par une association d’élus locaux qui a toujours préféré l’intérêt général au repli catégoriel.
Dans cet esprit, je citerai la résolution générale du congrès de l’AMF du mois de novembre dernier : « La commune a toujours su s’adapter au cours des siècles et une fois encore la réforme territoriale ne pourra être réussie que par la mobilisation des communes. L’engagement de l’AMF pour la création volontaire de ″communes nouvelles″ prouve que c’est avec la volonté des élus locaux que les grands changements sont possibles ».
Par ailleurs, lors du bureau que j’ai présidé jeudi dernier, l’Association des maires de France a mis en place un groupe de travail destiné au suivi et au soutien de cette réforme. Ce groupe sera coprésidé par l’estimé et respecté rapporteur du présent texte au Sénat, dont l’expérience et la compétence permettront d’éclairer utilement les travaux de l’AMF et, dès maintenant, de projeter une lumière singulière et utile sur les enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui.
Cela dit, toute réforme de décentralisation devrait reposer sur la confiance et la liberté.
Tout d’abord, la confiance et la liberté, c’est laisser le choix des périmètres. Il s'agit ainsi de donner aux plus petites communes les moyens d’exercer la clause générale de compétence, de conforter une ville-centre qui pratiquera la mutualisation avec sa périphérie immédiate, de transcender les fractures périurbaines et de transformer une intercommunalité en commune nouvelle. Ce sont là autant d’enjeux qui nous réunissent.
La confiance et la liberté, c’est aussi laisser le choix du ou des objectifs. Il s'agit de faire face aux nouveaux enjeux du XXIe siècle, de mettre en synergie les compétences et le périmètre, de moderniser sur la base du volontariat la gouvernance et les politiques locales, d’écarter les tutelles techniques et financières, de prendre part à l’effort de redressement des comptes publics par la mutualisation renforcée des moyens – le mandat démarré depuis le mois de mars sera celui de la mutualisation accélérée, voulue et non subie par les élus – et de redonner du souffle à la vie démocratique locale, notamment là où sont apparues de réelles difficultés d’établissement des listes – d’ailleurs plus nombreuses – lors du dernier renouvellement.
Il n’y a pas, il ne doit pas y avoir de schéma, de directive, d’obligation, de circulaire. La présente proposition de loi ouvre des potentialités à travers une conception moderne du droit, un droit incitatif et facilitateur. C'est une véritable révolution culturelle ! Et votre présence ainsi que vos propos, madame la ministre, permettent aussi d’espérer un regard positif de l’État sur ces problématiques.
Le fameux principe de subsidiarité constitue un autre mur porteur de cette réforme. Ce n’est pas qu’un terme technique utilisé à l’échelle locale, nationale ou européenne ; c'est une réalité, celle d’un principe de vie en commun dans des bassins de vie, dans des bassins démographiques et dans des structures de partenariat.
Car l’idée est bien qu’il soit permis, avec les communes nouvelles, de replacer le bloc communal au cœur de l’édifice institutionnel et du grand mouvement de décentralisation qui se poursuit.

Cette réforme exprime une fidélité à la commune, tant appréciée de nos compatriotes. À cet égard, je me permets de rappeler, en ces temps incertains, que la commune et le maire sont les institutions non seulement les plus respectées, mais aussi envers lesquelles la confiance existe encore : le taux que celle-ci atteint figure d’ailleurs parmi les plus élevés. C'est précieux ; il ne faut donc pas tourmenter les communes au-delà du raisonnable.
Cela étant, les principales dispositions de la présente proposition de loi répondent à l’analyse et à la stratégie que je viens de développer.
D’abord, il est proposé d’améliorer la gouvernance des communes nouvelles. La période transitoire est particulièrement délicate, d’où une série d’améliorations et de souplesses concernant la composition des conseils municipaux.
Ensuite, les conditions d’une stimulation financière et d’un pacte financier sont mises en place.
Enfin, le droit de l’urbanisme est adapté à l’équation personnelle de la commune nouvelle.
La commission des lois a apporté la plus-value territoriale du Sénat sur certaines dispositions du texte. Quant à moi, je vous propose, mes chers collègues, d’enrichir ce dernier en vous soumettant trois propositions : la prorogation du délai de rattachement ; la non-pénalisation, dans le cadre du FPIC, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, des communes nouvelles, ce qui constitue un enjeu financier important ; la prolongation du délai d’application de la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
À grand trait et en cinq minutes, je me suis ainsi efforcé, mes chers collègues, de résumer l’esprit, la philosophie, la méthode et les objectifs qu’un grand nombre d’entre nous partagent.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE . – M. le président de la commission des lois et M. Jean-Pierre Sueur applaudissent également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, fusions de communes, communes associées, maires délégués, transformations d’établissements publics de coopération intercommunale en communes, tout a été essayé : la panoplie des dispositifs inventés depuis la célèbre loi Marcellin de 1971 est très riche ! Comme l’ont expliqué plusieurs orateurs, notamment M. le rapporteur, la loi Marcellin n’a pas eu beaucoup de succès – vous-même l’avez montré avec talent, madame la ministre.
Pourquoi en a-t-il été ainsi ? Et pourquoi en sommes-nous encore là aujourd'hui ? Je le crois, chacune et chacun d’entre nous connaît la réponse à cette question.
Pourquoi est-il si difficile de réunir et de fusionner des communes en France ? Pourquoi y a-t-il parfois plus de « défusions » à la suite de fusions que de divorces dans la vie civile, ce qui n’est pas peu dire ? Pour une raison très simple, mes chers collègues : depuis la loi du 14 décembre 1789, l’une des grandes lois de la République, les Françaises et les Français ont la commune dans leur cœur, et les brillants réformateurs qui se succèdent butent sur cette réalité ! §
On nous répète à l’envi que ces 36 767 communes sont en nombre excessif, que notre pays en compte davantage que toute l'Europe réunie. Mais la France est la France ! C’est un pays où la diversité se rencontre dans de nombreux domaines… De cela, il faut tirer les leçons.
D'abord, il convient de rendre hommage à la commune, comme M. Baroin vient de le faire.
Plutôt que de présenter un inconvénient – ou une multiplicité d’inconvénients –, ces communes, ce sont 550 000 conseillers municipaux, soit autant de citoyens qui, eux, procurent un avantage incomparable : connaître chaque route, chaque chemin, chaque commerce, chaque ferme, chaque entreprise, chaque école, chaque maison… Et lorsque ces diverses réalités sont abordées autour de la table du conseil municipal, alors ces élus savent de quoi ils parlent ! Cette connaissance du terrain, aucune structure technocratique ne saurait l’atteindre.
À cet égard, je veux également rendre hommage à ces 550 000 conseillers municipaux, véritables fantassins de la démocratie et de la cohésion sociale, dont le dévouement est sans limites. Je le dis souvent, rapporter les indemnités que certains d’entre eux perçoivent – et ils constituent une minorité ! – au nombre d’heures passées à l’exercice du mandat montre que la tâche qu’ils assument est assez peu payée.
Pour avancer, la voie française, c'est l’intercommunalité – je le répète depuis deux décennies et demie. Autant la loi Marcellin a rencontré peu de succès, autant les lois de 1992 et de 1999 relatives à l’intercommunalité en ont connu un formidable. En effet, toutes les communes de France, sans exception, appartiennent aujourd'hui à une intercommunalité ! Et n’oublions pas, mes chers collègues, que la plus grande part du chemin – au moins 90 % – a été accomplie grâce au volontariat.
La loi de 1992 n’aurait jamais été adoptée si M. le préfet – et Dieu sait le respect que nous avons pour les préfets de la République – avait dû avoir la charge d’établir les périmètres des intercommunalités. Elle n’aurait jamais été votée si l’on n’avait pas affirmé haut et clair que l’intercommunalité allait de pair avec le maintien des communes et le respect qui leur est dû, et que l'intercommunalité était au service des communes, non l’inverse.
Ce chemin constitue, je crois, la voie française, une voie efficace, puisqu'elle a montré que l’on pouvait mutualiser, associer les efforts et aller de l’avant, notamment dans une intercommunalité de développement, tout en respectant cette cellule de base de la démocratie, où bat le cœur de la République, qu’est la commune.
Cela dit, il faut, selon moi, aller plus loin dans le sens de l’intercommunalité. Mes chers collègues, nous examinerons dès demain le projet de loi dit « NOTRe ». Bien que ce soit un drôle de titre, madame la ministre, on peut sans doute considérer qu’il s’agit d’un pluriel, donc d’une forme de solidarité et d’un refus de l’individualisme. S’il est une mesure de ce texte dont je me félicite, c’est bien celle qui concerne le renforcement de l’intercommunalité.
Je pense en effet que l’intuition première de ce projet de loi est excellente. Cette intuition première – je sais que vous y tenez tout autant que moi, madame la ministre –, c’est la volonté d’aller vers des régions et des intercommunalités fortes. C’est pourquoi il me paraît logique de renforcer les intercommunalités. Pour ma part, le seuil de 20 000 habitants me paraît convenir, dès lors, bien sûr, que la commission départementale de la coopération intercommunale puisse prévoir les exceptions qui s’imposent lorsque sont en cause des secteurs ruraux très peu ou peu peuplés, des vallées de montagne ou des territoires insulaires.
Selon moi, l’avenir de notre pays se dessinera à partir de régions fortes. Je le précise, ces régions ne sont pas uniquement celles dont la superficie est importante : ce sont des régions qui ont les compétences et les moyens appropriés pour aller de l’avant.
Je vois une bonne articulation entre des régions fortes et des intercommunalités de projet fortes, qu’il s’agisse de métropoles, de communautés urbaines, de communautés d’agglomération ou de communautés de communes, le sort du département pouvant être considéré de manière très pragmatique et diversifiée, selon les différents contextes.
Madame la ministre, pour aller dans ce sens, il faut rester le plus fidèle possible à l’intuition de départ de ce projet de loi. Je le répète, je sais combien cette intuition vous est chère.
Je crois que l’avenir est dans cette double articulation entre des régions fortes et des intercommunalités fortes, dans le respect des communes, qui sont le cœur battant de la démocratie.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour saluer Jacques Pélissard, avec qui Jacqueline Gourault et moi-même avons eu l’occasion de travailler sur un certain nombre de propositions de loi adoptées par les deux assemblées. J’ai également plaisir à évoquer Bruno Le Roux, avec qui je partage un certain nombre d’idées et de valeurs. Mes deux collègues députés ont bien fait de déposer la présente proposition de loi, qui permettra d’améliorer les choses dans un certain nombre de cas, et qui n’est nullement contradictoire avec le mouvement que je viens de décrire en faveur de régions fortes et d’intercommunalités fortes et auquel je crois beaucoup.
À mon sens, ce texte s’adresse surtout – c’est son intérêt principal – aux petites et moyennes communes. Certes, il peut être tentant, pour des agglomérations de 200 000 ou 300 000 habitants, de vouloir réaliser des économies en créant une commune nouvelle. Très franchement, mes chers collègues, un tel projet me semble irréaliste.
Quand on connaît la réalité des communes de ce pays, on constate bien que la grande agglomération qui ferait fi de la réalité communale dans laquelle les Français se reconnaissent depuis plus de deux siècles ne peut être qu’une illusion.
En revanche, il existe dans le monde rural, dans le tissu des petites et moyennes communes, des situations où, à l’évidence, des rationalisations sont nécessaires. J’ai infiniment de respect pour les communes de moins de 100 habitants non seulement du département dont je suis l’élu, mais aussi des autres départements français. À vrai dire, si ces communes peuvent être incitées à se regrouper dans le respect de la spécificité de chacune qui pourrait être marquée par l’existence de maires délégués, ce sera une bonne chose.
Par conséquent, facilitons une telle évolution, mais sans trop d’illusions. Au demeurant, les réunions auxquelles M. Mercier a fait allusion montrent un véritable intérêt en la matière de la part d’un certain nombre d’élus. Encourageons donc ce qui va dans le bon sens.
Pour finir, j’évoquerai les incitations financières prévues dans ce texte. Toutefois, pas plus que pour l’intercommunalité, elles ne seront, selon moi, décisives. Les élus de ce pays ont institué des communautés de communes ou des communautés d’agglomération parce qu’ils y croyaient. De la même manière, les communes nouvelles se feront si les élus et les habitants y croient, s’ils perçoivent que c’est un plus. Cela dit, les incitations financières seront bien entendu les bienvenues.
Je le souligne également, l’une des dispositions de ce texte qui permet le maintien des conseils municipaux en l’état jusqu’au prochain renouvellement, ou plutôt le maintien, monsieur le président de la commission, de l’effectif des conseils municipaux, peut entraîner quelques conséquences singulières.
Par exemple, si dix communes décident de fusionner, il faudra sans doute requérir la salle des fêtes de la plus grande d’entre elles pour réunir une importante assemblée, qui sera une sorte de petit parlement. Il y aura peut-être là quelque expérience étonnante, dont nous pourrons tirer profit et parti.
Mes chers collègues, une fois replacée dans le dessein qui est le nôtre, à savoir des régions et des intercommunalités fortes, cette proposition de loi due à Jacques Pélissard et à Bruno Le Roux comporte des avancées incontestables, dont les élus et les habitants pourront tirer parti s’ils le veulent. Ce texte n’aura d’effet, vous le savez bien, que s’il respecte pleinement – tel est le cas, j’en donne acte à ses auteurs et à M. le rapporteur – la souveraine liberté des Françaises et Français. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avec 36 681 communes, la France métropolitaine regroupe 40 % du nombre de communes de l’Union européenne.
Parmi ces communes, 31 539, soit plus de 85 %, ont moins de 2 000 habitants. La population moyenne d’une commune française est de 1 750 habitants, contre 4 100 habitants pour le reste de l’Europe. Comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, il peut se poser un problème si les communes sont trop petites. Il en résulte en effet un émiettement de l’action publique locale, les collectivités n’ayant pas assez de moyens financiers et humains pour répondre aux attentes de leurs habitants.
Une telle situation, tous nos voisins européens l’ont vécue. Mais, à partir des années soixante, ils ont mis en œuvre un mouvement de réduction du nombre de communes. Celui-ci s’est traduit de manière spectaculaire dans certains pays.
Ainsi, entre 1950 et 2007, la Suède, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne, pour ne citer que ces pays, ont respectivement réduit le nombre de leurs communes de 87 %, 79 %, 75 % et 41 %. En France, en revanche, sur la même période, la réduction n’a été que de 3 %.
Ces évolutions sont dues, cela a été dit, à une différence de méthode. Les pays du nord de l’Europe ont fondé leurs réformes communales sur l’autoritarisme. La Suède et la Belgique ont, par exemple, fusionné de force les communes de moins de 500 habitants et les Länder allemands se sont dotés de compétences larges pour redécouper les frontières communales.
En France, en matière de fusion, nous avons préféré privilégier le volontarisme. Au cœur des dispositifs de la loi Marcellin de 1971 et de la loi portant réforme des collectivités territoriales de 2010 se trouve le droit des citoyens à choisir librement les fusions, que ce soit par référendum local, avec le premier de ces deux textes, ou par délibération de leurs représentants élus aux conseils municipaux, avec le second.
Dans notre pays, l’attachement des citoyens à leur commune est fort. Le maire est une personne connue, les services municipaux sont au plus proche de la vie des populations et les communes ont conservé des compétences de premier plan dans l’organisation territoriale de la République. C’est pourquoi les fusions n’ont pas trouvé beaucoup d’écho. L’intercommunalité a ainsi été privilégiée plutôt que le regroupement.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit très clairement dans la continuité de ce volontarisme. Elle vise à faciliter les fusions de communes, en mettant en place plusieurs dispositifs incitatifs, sur le plan aussi bien de la gouvernance que des finances.
Il est ainsi prévu que l’ensemble des conseils municipaux des communes fusionnées se retrouvent dans le nouveau conseil jusqu’aux élections municipales suivantes et que chaque maire délégué ait la qualité d’adjoint au maire de la commune nouvelle, pour assurer une transition institutionnelle souple.
Concernant l’aménagement du territoire, les plans locaux d’urbanisme devront prendre en compte les spécificités relatives aux anciennes communes via l’utilisation de plans de secteur.
Du point de vue financier, les taux de fiscalité des communes fusionnées sont maintenus pendant une période transitoire et les dotations de l’État ne sont pas modifiées pendant les trois ans suivant la fusion.
Il s’agit de mesures pragmatiques, pour accompagner en douceur les fusions de communes.
Si les écologistes sont favorables au renforcement du triptyque intercommunalités-régions-Europe, cela ne veut pas dire qu’ils sont pour la disparition de l’échelon communal.

Nous estimons en effet qu’il s’agit d’un espace démocratique incontournable de notre société, au plus proche des préoccupations des citoyens, conformément à votre description, madame la ministre.
La présente proposition de loi vise à préserver cet espace et à inciter aux regroupements sans empiéter sur la libre administration des collectivités territoriales. C’est pourquoi les écologistes voteront ce texte. §

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons ce matin la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, et, pourrait-on ajouter, bientôt disparues.
Pour commencer, et quitte à remettre en cause la belle unanimité qui règne aujourd'hui dans cet hémicycle, je tiens à rappeler que le consensus n’existe pas. En effet, nous refusons pour notre part de nous inscrire dans ce climat visant à faire de ce débat éminemment politique une simple question de bon sens.
Le texte dont nous discutons aujourd’hui, et qui résulte de deux propositions de loi présentées parallèlement par MM. Pélissard et Le Roux à l’Assemblée nationale, s’inscrit dans la continuité directe de réformes dont l’échec n’est plus à démontrer et visant à faire accepter la disparition des communes.

En 1971, la loi Marcellin avait permis la fusion de communes et créé le statut de « commune associée ». Mais, au cours des décennies suivantes, le nombre de communes a diminué de 5 % seulement.
Pis encore, les quelques communes qui avaient été fusionnées au cours de la période 1971-1972 continuent aujourd’hui de se « défusionner ». Preuve, s’il en est, du succès de cette loi !
En 2010, avec la réforme territoriale voulue par Nicolas Sarkozy, cette logique de fusion a été approfondie, par le biais de la proposition d’un nouveau régime se voulant plus simple, plus souple et plus incitatif.
Quatre ans plus tard, treize communes nouvelles ont vu le jour, soit un regroupement de trente-cinq communes au total. Là encore, l’échec est patent !
Or que nous propose-t-on aujourd’hui à travers cette proposition de loi ? Rien de plus que de « remettre le couvert », si vous me permettez cette expression.
L’objectif affiché est de rendre plus attractives, mais surtout plus incitatives, ces fusions dont personne ne semble vouloir, en mettant en place un certain nombre de mécanismes qui, pour reprendre les mots de Mme la rapporteur à l’Assemblée nationale, visent à lever « certains obstacles institutionnels, financiers, voire psychologiques, qui expliquent les hésitations des élus locaux et des populations. »
Au sein de l’Association des maires de France, j’ai entendu – et ce n’est pas M. Baroin qui pourra me contredire – des maires protester contre cet acharnement à vouloir faire disparaître les communes.

Mais le présent texte ne se fonde pas uniquement sur la volonté d’améliorer le régime de 2010 ; il se place dans le cadre d’une analyse de la situation et des enjeux contemporains, sur lesquels je souhaiterais revenir.
Parmi ces enjeux, le premier est la baisse des dotations financières qui mine l’investissement local et détruit les services publics, lesquels restent pourtant – tout le monde le dit – les derniers remparts face aux conséquences économiques et sociales de la crise systémique que nous vivons.
Cette diminution, nous le savons, n’est pas ponctuelle, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre du projet de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui prévoit une réduction de 27 % des dotations aux collectivités locales.
Le deuxième enjeu pour nos communes est, nous dit-on, la vitalité démocratique, laquelle décroît, ce qui se traduit par des difficultés lors des élections municipales à trouver des candidats, mais surtout – et ceux qui n’étaient pas favorables à la parité insistent sur ce point – des candidates.
Enfin, l’élargissement des périmètres intercommunaux prévu dans le projet de loi NOTRe va contraindre à des adaptations structurelles importantes.
Ces difficultés sont réelles et représentent des dangers majeurs pour nos territoires et nos populations.
Ces faits, nous ne les remettons pas en cause. En revanche, ce que nous contestons, ce sont les solutions proposées. Comment imaginer que la réponse aux problèmes que rencontrent nos communes puisse être la suppression de ces mêmes communes ?
Et ce débat n’est pas nouveau. Déjà, en son temps, le marquis de Condorcet prônait le regroupement de plusieurs villages, afin de pouvoir justifier une « notabilisation » des élus et une réduction de leur nombre. Face à cela, Mirabeau, avec d’autres, était partisan d’un découpage administratif transformant les 44 000 paroisses de l’époque en autant de communes.
Aujourd’hui, la France compte plus de 36 000 communes et 600 000 élus. Pourquoi voir dans cette caractéristique un problème ? Ce maillage territorial est au contraire la force de notre pays. Les communes sont la base de notre démocratie, de la proximité. À l’instant, M. Sueur leur a rendu un bel hommage. Ce n’est pas un hasard si le maire reste l’élu le mieux reconnu par nos concitoyens.
Les communes sont l’échelon de base de notre organisation territoriale et assurent, au plus près de nos concitoyens, un rempart contre l’exclusion, l’isolement et le déclassement.
Oui, les communes doivent être de notre temps pour répondre aux besoins des populations et aux exigences économiques, sociales et environnementales. Cela implique davantage de coopération entre les collectivités. Mais pour coopérer, il faut exister. La fusion, ce n’est pas la coopération !
Je voudrais, pour terminer, revenir sur un aspect de la présente proposition de loi qui va encore aggraver la situation financière des collectivités locales.
La section 4 prévoit en effet de nouvelles dispositions fiscales et des incitations financières pour encourager le processus de fusion. Cela passe, notamment, par la garantie, pendant les trois ans qui suivent la fusion, que les communes nouvelles ne connaîtront pas de baisse de leur dotation par rapport à la somme allouée aux anciennes communes alors séparées.
De la même manière, les nouvelles communes continueront de percevoir des financements au titre de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale.
Ces dispositifs, outre le fait qu’ils ne garantissent nullement le maintien des dotations au-delà de la période transitoire, vont conduire mécaniquement à une baisse des dotations des communes qui ne s’inscrivent pas dans un processus de fusion.
On peut donc prévoir que plus le processus de la commune nouvelle rencontrera de succès, plus la dotation des autres collectivités diminuera, puisque le montant de l’enveloppe demeurera le même.
Cela étant, le découpage géographique et administratif de notre territoire doit faire l’objet d’un débat permanent. Mais celui-ci doit être abordé sous l’angle de l’utilité sociale, du dynamisme économique et des enjeux démocratiques. En aucun cas ce découpage ne peut être compris comme une variable d’ajustement ou d’adaptation à des politiques d’austérité visant à la mise en concurrence des territoires et à la dégradation des services publics, afin de les livrer au privé.
C’est pourtant dans ce cadre que se situe la proposition de loi que nous examinons. C’est pourquoi nous ne voterons pas en sa faveur.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Nous devons considérer qu’il est difficile de bousculer ce qui correspond à un fait historique, géographique et sociologique.
Au début des années soixante-dix, la loi Marcellin sur les fusions et regroupements de communes a été un échec retentissant et souvent les fusions en découlant se sont transformées en divorces conflictuels.
En 2010, sur l’initiative du gouvernement Fillon, de notre collègue Michel Mercier, alors ministre, …

… et d’Alain Marleix, un nouveau dispositif de fusion a vu le jour : la commune nouvelle.
Au 1er janvier prochain, ce dispositif aura entraîné la création de dix-neuf communes nouvelles sur plus de 36 000 communes. Autant dire que, malheureusement, il n’a point soulevé l’enthousiasme que l’on espérait, d’où l’initiative de Jacques Pélissard et d’autres collègues députés, qui conduit à la discussion de la présente proposition de loi visant à améliorer ce régime de la commune nouvelle, initiative que le groupe du RDSE soutient, sous le bénéfice des observations que je vais formuler.
Tout d’abord, il serait erroné de penser que la commune nouvelle aurait plus de succès dans les territoires ne s’inscrivant pas dans le fait urbain. Il est plus facile de créer une commune nouvelle en périphérie d’une ville-centre, d’un bourg-centre, que dans le cadre de communes peu peuplées situées à plusieurs kilomètres de ce bourg-centre. Car la peur d’être définitivement abandonnés est très présente chez les quelques élus locaux et habitants déjà privés d’école, de commerces, de services publics : ils imaginent, pas toujours sans raison, que, au sein d’une commune nouvelle, la voirie comme les bâtiments communaux seront délaissés ; ils estiment également que, au lieu de dynamiser leur territoire, la commune nouvelle absorbera définitivement le peu de vie qu’il leur reste.
Ce sentiment – j’y ai été confronté lors des dernières élections sénatoriales – doit être respecté. C’est une réalité. Il faut la prendre en compte et essayer de trouver des solutions adaptées.
À l’opposé, l’opinion de nombre de nos collègues élus locaux évolue positivement vers des fusions de bon sens leur permettant de mieux répondre aux besoins de leurs concitoyens. Pour cela, nous devons simplifier davantage les procédures et respecter impérativement la liberté des conseils municipaux existants, comme l’a dit M. le rapporteur.
Faire confiance à l’intelligence territoriale chère au Sénat, c’est l’aider sans la contraindre.
Les élus locaux ne sont pas forcément conservateurs : ils ont plébiscité le développement de l’intercommunalité, ils sont toujours demandeurs de nouvelles technologies de communication, ils sont prêts à mutualiser.
Aujourd’hui, ce qui les contraint le plus, madame la ministre, ce qui freine les initiatives, c’est l’accumulation de normes, …

… le poids insupportable de la bureaucratie, l’empilement sur le bureau des élus de textes réglementaires, les schémas nationaux et régionaux, les multiples comités de pilotage, les réunions à la préfecture, et j’en passe.

Mettre un coup de pied dans ce fatras administratif : telle est la vraie urgence pour les élus locaux. En dépit des discours à finalité médiatique, on n’en prend pas le chemin !
La création des communes nouvelles se fera très lentement, non seulement parce que le système est encore trop lourd, trop compliqué administrativement, mais aussi, et ce n’est pas une contradiction, parce que la montée en puissance de l’intercommunalité répond à une grande partie des problèmes posés par le nombre des communes.
Sans remettre en cause l’objectif et le bien-fondé de la commune nouvelle, je suis de ceux qui considèrent que l’avenir, c’est l’intercommunalité, et que le vrai moyen de simplifier, de mutualiser, c’est de faciliter le transfert des compétences aux intercommunalités, d’augmenter le nombre de compétences obligatoires avec un dispositif fiscal bonifiant la mutualisation.
Pour cela, les intercommunalités doivent coller aux bassins de vie, ce qui est incompatible avec les seuils de population arbitraires que veut imposer le Gouvernement, décision se surajoutant au désastreux binôme cantonal.
Reste pour les communes nouvelles la question importante de leurs dotations. On n’attire pas les mouches avec du vinaigre et le présent texte prévoit non seulement une garantie de dotation, mais une friandise, par le biais d’une bonification de dotation forfaitaire.
Monsieur le rapporteur, il y a là une contradiction intellectuelle évidente : la commune nouvelle correspond à un objectif de rationalisation et d’économie, économie que devrait entraîner la fusion de communes. Il est alors peu cohérent d’augmenter la dotation globale des communes fusionnées, lesquelles, contrairement à ce qui s’est passé lors de la création des intercommunalités avec la loi Chevènement, ne procurent pas de nouveaux services à la population.
En outre, les dotations qui seront garanties en supplément aux communes nouvelles seront inscrites au débit des autres communes, ce qui n’est ni juste ni équitable.
En conclusion, les membres du RDSE voteront la présente proposition de loi, qui constituera un progrès, mais sans avoir trop d’illusion sur son efficacité.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste . – M. le président de la commission des lois applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, tout d’abord, je souhaite saluer le travail de Michel Mercier, rapporteur, initiateur du dispositif « commune nouvelle » datant du mois de décembre 2010. Il l’a d’ailleurs mis en œuvre par la suite à l’échelon local en créant la commune nouvelle de Thizy les Bourgs, dont il est maire.

Non seulement il a écrit la loi en cause, mais il s’est également soumis à l’épreuve du suffrage universel avec succès.
L’exercice est original et l’on ne peut trouver meilleur rapporteur.
Le nombre et la taille des communes en France sont très critiqués. Je ne partage pas ces critiques, car elles reviennent à ignorer le lien social et démocratique que constitue ce maillage communal, lequel constitue à mon avis une force pour la France. Je ne reviendrai pas sur ce point, les orateurs précédents l’ayant fort bien exposé.
Dans la réforme territoriale qu’il nous propose, le Gouvernement n’aborde pas la question du regroupement des communes. Je souhaite qu’il s’en tienne au concept de « commune nouvelle », qui laisse une grande liberté à celles-ci.
C’est pourquoi je salue cette proposition de loi, qui apporte de nouveaux éléments clairs et lisibles pour la création d’un cadre communal rénové, fondé sur le volontariat, il est important de le rappeler. En quelque sorte, ce texte permet de consolider le positionnement des communes.
Même si, jusqu’à présent, le dispositif a connu un succès modeste, avec la création de douze communes nouvelles et de sept autres d’ici au 1er janvier prochain, il reste sans conteste un outil d’avenir pour préserver et défendre l’existence de l’échelon communal.
Il permet d’abord de tendre vers plus d’efficacité dans les dépenses publiques en regroupant volontairement des moyens financiers, humains ou immobiliers, afin de rationaliser le fonctionnement et de réaliser des économies substantielles tant sur les achats groupés que sur les assurances, ou encore les fournitures scolaires.
Ce dispositif permet également de sauvegarder les identités communales, puisque nous ne parlons aucunement de fusion de communes, mais que nous discutons bien du regroupement de celles-ci.
Comme avait déjà pu le dire notre collègue Michel Mercier, c’est un nouvel équilibre entre « une gestion mutualisée intégrée et la préservation des identités historiques et culturelles ».
Alors que les capacités de financement se réduisent d’année en année, les équipes municipales qui ont été élues restent pourtant chargées de maintenir leur patrimoine, de soutenir des projets et de veiller au maintien des services. C’est pourquoi il est nécessaire d’encourager cette nouvelle organisation, afin de répondre aux difficultés des très petites communes mitoyennes, en leur offrant les compétences et les moyens financiers propres à leur assurer un avenir.
On ne le dit pas assez, mais c’est aussi libérer les maires délégués des petites communes des contraintes administratives afin de leur assurer une plus grande disponibilité vis-à-vis des administrés et des projets communaux.
Ce dispositif présente un autre aspect essentiel : permettre à nos communes rurales de peser davantage à l’échelon intercommunal.
Loin de penser que la réforme territoriale actuelle ne concerne que les zones urbaines, les métropoles ou les régions, j’estime que le monde rural sera aussi touché lourdement.
Il est réellement nécessaire de faire évoluer l’échelon communal face aux intercommunalités géantes qui risquent de nous être imposées du fait de la révision de leur seuil de constitution inscrit dans le projet de loi NOTRe.
En effet, les petites communes auront d’immenses difficultés à exister et risquent d’être diluées dans des ensembles démographiques très importants. Les communes nouvelles peuvent constituer un bon moyen de restructurer et de démocratiser ces « poids lourds intercommunaux » en rééquilibrant le dialogue au sein de l’agglomération.
C’est l’occasion également pour de petites intercommunalités bien structurées autour d’un bourg-centre et de son bassin de vie de ne pas perdre cette avancée dans le cadre d’une grande intercommunalité, qui en réalité éclaterait la mutualisation de moyens humains et matériels déjà organisés. Effectivement, l’intégration de ces petites structures, qui ont déjà fait l’objet d’une forte mutualisation, dans une grande intercommunalité pourrait conduire à la dispersion des petites communes, des outils – un service de voierie bien organisé, par exemple –, ou encore des moyens humains en les renvoyant au sein d’une grosse agglomération.
La réforme qui nous est soumise constitue une innovation intéressante en raison de la souplesse qu’elle propose, puisqu’elle est fondée uniquement sur une démarche volontaire et qu’elle répond également à la diversité des territoires.
Ces raisons m’amènent à souscrire à l’intérêt de renforcer l’attractivité du système mis en place par la loi de 2010, comme le propose le texte que nous discutons aujourd’hui.
En premier lieu, la présente proposition de loi permet de clarifier certains points relatifs aux communes nouvelles qui pouvaient encore paraître flous, allant de la détermination du nom de la commune nouvelle – sujet sensible – aux dispositions concernant les documents d’urbanisme.
En second lieu, elle vise à améliorer la gouvernance des communes nouvelles. Notons à ce titre des assouplissements à propos, notamment, des conditions de composition du conseil municipal pendant la période transitoire, allant de la mise en place de la nouvelle collectivité au renouvellement de son conseil municipal sans créer de rupture, ou encore de la possibilité pour le maire délégué d’être adjoint de la commune nouvelle. Cette faculté apportera sûrement efficacité et cohésion. Il s’agit d’un élément extrêmement important du texte. À mon avis, ce sera une incitation forte pour l’instauration de communes nouvelles.
Je n’insisterai pas sur les mesures financières favorables : toujours opportunes, elles ne doivent néanmoins pas être le ressort de cette démarche.
Le dispositif de la commune nouvelle offre des solutions novatrices. Dans un contexte de réforme des collectivités et de baisses des dotations de l’État, c’est une réforme territoriale qui peut se fonder sur l’initiative du terrain. Six cents élus ont participé à l’atelier sur les communes nouvelles lors du dernier congrès des maires. Ils ont manifesté un grand intérêt et peu de craintes, en raison du volontariat sur lequel est basée la démarche.
Les membres du groupe UDI-UC voteront ce texte qui donne de nouvelles marges de manœuvre aux élus pour moderniser les collectivités territoriales.
Applaudissements sur les travées de l’ UDI-UC, du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je me félicite de l’examen du présent texte, qui est attendu par les élus. Il est vrai que les communes nouvelles instaurées par l’excellente loi de 2010 – les zigzags, si je puis dire, que nous connaissons depuis quelques mois montrent à quel point celle-ci comporte des dispositions importantes –, même si elles sont peu nombreuses, sont au cœur des réflexions.
Dans mon département, le Maine-et-Loire, trois communes nouvelles ont été créées au 1er janvier 2013 : Beaugé-en-Anjou, qui regroupe cinq communes, Clefs-Val d’Anjou et Chemillé-Melay qui regroupent chacune deux communes. Dans le cas présent, le nombre des communes est ainsi passé de neuf à trois.
Je voudrais à ce propos saluer l’excellent travail du conseiller général-maire de Beaugé-en-Anjou, ardent défenseur de ce dispositif, aussi bien localement qu’au sein du comité directeur de l’AMF.
La commune nouvelle doit être un outil. Cela a été dit, elle est un instrument de simplification de gestion administrative. Sa constitution doit être volontaire, et absolument non contrainte, non obligatoire. Ce dispositif doit être souple, adapté au territoire et au paysage intercommunal.
En Maine-et-Loire, de nombreux projets de communes nouvelles sont en cours d’élaboration, même à l’échelle des communautés de communes existantes. À chacune de mes rencontres avec les 160 nouveaux maires du département, le sujet de la commune nouvelle qui les préoccupe et les intéresse est abordé.
Cela étant, la proposition de loi que nous examinons est importante du point de vue tant du dispositif mis en œuvre pendant la période de transition depuis les dernières élections jusqu’à la création de la commune nouvelle que du choix du nom, de la conférence des maires, du volet urbanisme et du rattachement à un EPCI.
Mais je souhaite, pour ma part, insister sur deux points.
Le premier concerne les maires délégués. En effet, bien souvent, l’une des critiques qui est opposée à ces communes nouvelles est la perte d’identité, de spécificité, d’histoire des communes qui pourraient se regrouper. À cet égard, le fait qu’un maire délégué puisse devenir adjoint est un bon point. L’une des dispositions importantes du texte est celle qui permet, en cas d’extension d’une commune nouvelle récemment créée – c’est le cas, par exemple, de la commune nouvelle de Beaujé-en-Anjou que d’autres communes souhaitent rejoindre –, aux maires des communes préexistantes de demeurer maires délégués au sein de la « nouvelle commune nouvelle » ainsi constituée.
Le second point a trait aux compensations financières. Celles-ci sont incitatives. Certes, cela ne fait pas tout, mais elles sont néanmoins essentielles en cette période difficile pour les collectivités.
Dans mon département, certains se sont alarmés du laps de temps assez court visé, à savoir d’ici au 1er janvier 2016. Dans la mesure où les équipes municipales sont totalement nouvelles, cela peut se comprendre. En effet, une commune nouvelle ne se bâtit pas en quelques semaines : il faut à la fois une volonté des maires et des conseils municipaux de se regrouper, et, surtout, il convient de faire accepter le nouveau dispositif par la population, ce qui peut parfois s’avérer délicat. Je tenais donc à me faire l’écho de ces maires qui auraient souhaité disposer d’un délai plus long d’un an.
En ces temps difficiles pour les collectivités de budget contraint, marqué par la baisse des dotations et l’alourdissement des charges, et compte tenu de la charge de travail qui pèse sur les épaules non seulement des maires et des élus locaux mais également de l’intercommunalité dont on annonce un élargissement – je rappelle les réticences de mon groupe à l’égard des seuils et des grandes intercommunalités –, le dispositif proposé aux maires me semble bon. Il l’est d’ailleurs particulièrement dans un département comme le mien où le fait intercommunal est très ancien. Nous devons donc l’encourager.
C’est la raison pour laquelle les membres du groupe UMP voteront la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si un maire a pour mission de dessiner un avenir pour sa commune, le Sénat, lui, a vocation à veiller à celui de toutes les communes de France. La proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes tombe donc à point nommé pour redonner des perspectives et peut-être même un nouveau souffle à l’institution communale.
Je ne m’étendrai pas sur le détail des dispositions de ce texte brillamment développées par les orateurs qui m’ont précédé, en particulier par M. le rapporteur.
À l’heure où, au prétexte d’éclaircir le jardin à la française qu’est devenue notre organisation territoriale, on invente de nouvelles géométries complexes, cette proposition de loi présente le grand intérêt de redonner de sa légitimité à la cellule de base de notre organisation territoriale : la commune.
Car on peut le déplorer ou s’en réjouir, mais c’est un fait : l’attachement de nos concitoyens pour l’institution communale ne s’est jamais démenti. Le plus souvent, ils la perçoivent moins comme une entité administrative que comme une communauté humaine, dans l’histoire de laquelle ils inscrivent leur propre existence. Ils y cultivent fréquemment l’attachement à leurs racines et entretiennent des liens sociaux favorisés par la présence d’élus de proximité.
Un Français en déplacement à qui l’on demande d’où il vient ne répondra jamais qu’il a sa maison dans la communauté de communes de Rhône-Crussol ou de l’Ouest Rhodanien ; il dira, madame la ministre, qu’il est originaire de Loudéac, ou monsieur le rapporteur, de Thizy-les-Bourgs, ou encore de La Mure, de Guilherand-Granges, voire de Paris.
Mais il est vrai que cet attachement de nos compatriotes à leurs villes et à leurs villages ne doit pas nous distraire des réalités. Chacun, dans cette enceinte, a pu mesurer que, en dessous d’un niveau critique, la mutualisation des moyens est nécessaire pour continuer à rendre à la population les services qu’elle est en droit d’attendre. C’est tout l’intérêt de la chance historique que représente cette proposition de loi, qui offre aux communes des conditions financières inespérées en ces temps de restrictions budgétaires, pour, comme l’a expliqué M. le rapporteur, réorganiser leur bloc communal.
Utilisant le dispositif de la loi Marcellin, une vingtaine de communes de l’Ardèche ont déjà fait ce choix précurseur de la fusion depuis 1971, parmi lesquelles Saint-Alban-Auriolles, Berrias-et-Casteljau, ou encore Saint-Pierre-Saint-Jean. Autant de noms composés qui témoignent d’une volonté de voir perdurer l’identité des communes fusionnées. Sur ce point aussi, je soulignerai la grande sagesse du présent texte qui, me semble-t-il, est parvenu à trouver le juste équilibre entre l’efficacité de la commune nouvelle aux prérogatives affirmées et les communes déléguées, garantes de la proximité et, disons-le, gardiennes de la mémoire.
Voilà pourquoi miser sur l’intelligence et la bonne volonté des maires et de leur conseil municipal me semble être la meilleure voie.
Il n’y a rien de plus estimable que d’aider des communautés humaines à faire le choix de se fédérer pour bâtir quelque chose qui les dépasse sans les dissoudre. Cette approche est diamétralement opposée de celle du projet de loi NOTRe, dont nous commencerons l’examen dans cet hémicycle dès demain, visant, parfois par la contrainte, à fabriquer des intercommunalités de 20 000 habitants qui enjambent les réalités humaines, géographiques et démographiques.
Tous les partenaires en jeu gagneraient à travailler en suivant ces principes : inciter plutôt que contraindre ; encourager les évolutions plutôt que dicter un modèle éloigné des réalités.
Depuis 2003, l’article 72 de la Constitution dispose que les collectivités s’administrent librement. Allons au bout de cette logique et offrons-leur de s’associer entre elles librement.
Je le disais voilà un instant, nous aurons très prochainement l’occasion de débattre et de faire état de désaccords – peut-être d’ailleurs moins entre nous qu’avec l’Assemblée nationale. Savourons donc aujourd’hui la satisfaction de voter ensemble le présent texte, qui est le fruit d’un consensus nourri par l’expérience et les réalités locales.
Je veux à mon tour rendre hommage à Jacques Pélissard, qui, avant de quitter l’AMF, a non seulement su transmettre le flambeau en des mains hautement qualifiées, mais a également été à l’initiative de ce texte intelligent, pragmatique et qui réunit l’ensemble des élus de bonne volonté.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur les travées du RDSE.

Lors du scrutin n° 73 sur la proposition de résolution présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution sur la reconnaissance de l’État de Palestine, M. François Grosdidier a été déclaré votant pour, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Section 1
Le conseil municipal de la commune nouvelle

L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Commeinhes, Berson et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que » sont supprimés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. – L’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113 -7 . – I. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :
« 1° De l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
« 2° À défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II.
« L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau fixé par l’article L. 2121-1.
« Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au même II.
« II. – Lorsqu’il est fait application du 2° du I du présent article, l’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.
« Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.
« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires. »
II. – L’article L. 2113-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113 -8 . – Lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »
III. – L’article L. 2114-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 » sont remplacées par la référence : « au chapitre III du présent titre Ier » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ces » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

L’article 1er traite de la composition transitoire du conseil municipal de la commune nouvelle. Il garantit une représentation des communes déléguées, puisque les conseils sont maintenus jusqu’au renouvellement.
Pour autant, à l’issue de ce renouvellement, qui pourrait par exemple intervenir en 2020, rien n’assure l’effectivité du maintien d’une représentation des communes déléguées au sein du conseil municipal.
Certes, le bon sens politique devrait conduire les listes qui se présenteront à afficher leur représentativité sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle et des communes déléguées.
Cependant, le législateur n’a, à ce stade édicté, aucune règle particulière pour garantir à long terme cette représentation. À court terme, tout ira bien, j’en conviens comme nombre d’entre vous, mes chers collègues, car les fondateurs de la commune nouvelle auront vraisemblablement à cœur de maintenir le pacte moral qui les lie.
Il existe donc encore, me semble-t-il, un petit angle mort dans la proposition de loi, car rien ne certifie qu’une part significative des nouvelles communes déléguées, si ce n’est l’ensemble d'entre elles, puisse continuer à être représentée au sein du futur conseil municipal de la commune nouvelle, « en mode de croisière ».
Dans l’Yonne, département que j’ai l’honneur de représenter, de nombreuses collectivités réfléchissent à leur regroupement au sein de communes nouvelles. Néanmoins, l’absence de mesures législatives relatives à la représentation des anciennes communes dans la commune nouvelle peut constituer un frein à la conclusion de regroupements.
J’ai notamment en tête les débats au sein de la communauté de communes de l’Orée de Puisaye regroupant quatorze communes qui ont engagé cette réflexion en vue d’un passage à la commune nouvelle.
Ne pourrait-on pas imaginer un dispositif qui, à l’instar du fléchage des conseillers communautaires, prévoirait, par exemple, que 50 % des communes au moins – le quantum doit bien sûr être étudié – seraient représentées dans la première moitié de la liste déposée en vue des élections municipales dans la commune nouvelle ?
Je n’ai pas la solution juridique parfaite, mais il s’agit d’une première contribution au débat. À ce propos, puisque le président de l’Association des maires de France a évoqué tout à l’heure la mise en place d’un groupe de travail de suivi qui serait coanimé par M. le rapporteur, ce sujet pourrait éventuellement être inscrit à l’ordre du jour de ses travaux
Si rien n’est fait, nous risquerions de nous retrouver dans une situation un peu paradoxale : pourrait être nommé maire délégué d’une commune déléguée un conseiller municipal qui ne serait pas lui-même issu de la commune déléguée si celle-ci n’est pas représentée dans le conseil municipal de la commune nouvelle à l’issue du premier renouvellement.
On ne peut pas laisser ce sujet totalement de côté. C’est pourquoi je lance un appel à poursuivre le travail et à imaginer des solutions afin de ne pas entraver les collectivités volontaires qui souhaiteraient se transformer en commune nouvelle, mais qui peuvent éprouver quelques réticences par rapport à l’absence de garanties sur la représentation à long terme. À court terme, je suppose que l’intelligence des hommes pourvoira à tout cela.

L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 12
Supprimer les alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Le Gouvernement craint l’inconstitutionnalité de la disposition en cause. Le surclassement démographique est prolongé jusqu’à la fin du mandat en cours. Si la demande de prorogation durant le mandat suivant ne pose pas de problème majeur sur le fond, il faut néanmoins faire attention à éviter toute rupture d’égalité. Je tenais à vous en avertir, mesdames, messieurs les sénateurs, pour que chacun puisse se prononcer en pleine connaissance de cause.

Madame la ministre, je vous remercie de nous permettre de choisir en toute connaissance de cause.
L’Assemblée nationale a décidé de maintenir un régime transitoire sur deux mandats, l’un avec la totalité des conseillers élus, et le second simplement avec le nombre de conseillers de la strate démographique supérieure à celle à laquelle donne droit au conseil municipal sa population, soit un gain de deux ou quatre sièges suivant le cas.
Pour sa part, le Conseil constitutionnel rappelle dans toutes ses décisions que son pouvoir n’est pas de même nature juridique que celui du Parlement. Nous pourrions d’ailleurs nous appuyer sur la décision du Conseil relative à la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : il a alors considéré que le fait que les conseillers communautaires de Lyon deviennent ipso jure, dans douze jours maintenant, conseillers métropolitains – les premiers de France – était conforme à la Constitution, même si l’opération n’est pas très régulière, compte tenu de l’objectif recherché. En l’espèce également, eu égard à la finalité visée, le risque d’inconstitutionnalité est faible.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
L’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – En l’absence d’accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle sur le nom de celle-ci, le représentant de l’État dans le département soumet pour avis à chacun d’entre eux une proposition de nom. À compter de sa notification, le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Les mots : « en détermine la date » sont remplacés par les mots : « détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création ».

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il a été fait application de l’article L. 2113-16 du même code dans sa rédaction issue du I de l’article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de sa commune. Après consultation du conseil général qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, le préfet décide du changement de nom de la commune par arrêté préfectoral. »
La parole est à Mme la ministre.
La procédure de changement de nom d’une commune n’étant pas suffisamment étayée en droit, le Gouvernement propose de l’encadrer, afin que nos nouvelles communes aient un nouveau nom.
Après avoir discuté avec quelques candidats à la fusion de communes, je peux dire que ce sujet n’est pas secondaire ; il est même extrêmement important. J’encourage les maires à travailler en lien avec leur population.

La commission est convaincue par le Gouvernement et sait faire preuve de grande ouverture d’esprit en émettant un avis favorable sur son amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er bis est adopté.
I A – Après le mot : « délégué », la fin du 1° de l’article L. 2113-11 du même code est supprimée.
I. – Après l’article L. 2113-11, il est inséré un article L. 2113-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-11-1 . – Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.
« Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa. » ;
II. – Le second alinéa de l’article L. 2113-13 du même code est ainsi rédigé :
« Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. »
III. – Le second alinéa de l’article L. 2113-16 du même code est supprimé.
IV. – Le second alinéa de l’article L. 2113-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux adjoints d’une commune appartenant à la même strate démographique que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les communes déléguées. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 2113-12 du même code, il est inséré un article L. 2113-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113 -12 -1 . – Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l’action publique sur le territoire de la commune nouvelle.
« La conférence municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. » –
Adopté.
L’article L. 2113-10 du même code est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;
b) À la fin, lesmots : « délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l’article L. 2113-2 ont exclu leur création » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle ».
II
« La création d’une commune nouvelle par fusion de communes dont une au moins est une commune nouvelle est sans effet sur les communes déléguées existantes, sauf décision contraire des conseils municipaux dans les conditions prévues au premier alinéa. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 2113-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « après accord » sont remplacés par les mots : «, en l’absence de délibérations contraires et motivées » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
3° Au début de la dernière phrase, les mots : « À défaut d’accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un conseil général ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification ». –
Adopté.
Section 2
Mieux prendre en compte les spécificités de la commune nouvelle dans les documents d’urbanisme
L’article L. 321-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, seul le territoire des anciennes communes la composant considérées comme communes littorales au sens du présent article est soumis aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme. »

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de supprimer l’article 5 A, qui limite le champ géographique d’application de la loi Littoral au seul périmètre des anciennes communes concernées avant la création de la commune nouvelle.
Si l’on regarde de près les dispositions de la loi précitée, se pose tout d’abord la question de la bande des cent mètres du littoral, laquelle ne sera pas modifiée, qu’il y ait ou non fusion, car les communes visées ne sont pas au bord du littoral.
Ensuite, se pose le problème de la densification en continuité avec le bâti existant. Je suis convaincue qu’il nous faudra évoluer à l’égard d’un certain nombre de petites friches existantes entre des constructions anciennes, dès lors que les services de l’eau, de l’assainissement, du ramassage des ordures ménagères sont assurés, bref la lutte contre la pollution d’origine tellurique. Ce sujet est très important, mais il n’a rien à voir avec la fusion de nos communes.
Pour ma part, j’estime que les dispositions de la loi Littoral doivent plutôt faire l’objet d’adaptations, si elles sont naturellement bien délimitées et entérinées par le Parlement. En effet, même si, aux termes d’une ordonnance, dans telle ou telle région, le pouvoir réglementaire change, il faudra que le Parlement y soit attentif. En réalité, ce point relèvera de l’adaptation du pouvoir réglementaire des régions dans le cadre de la future loi NOTRe.
Cela étant, comme est concerné un document qui est unique, on trouvera de part et d’autre de l’ancienne frontière deux règlements différents, ce qui entraînera sans doute des contentieux. C’est pourquoi je propose de conserver pour l’instant les dispositions de la loi Littoral qui visent essentiellement la densification et de les réexaminer dans le cadre de la discussion du projet de loi NOTRe.
À cette occasion, si nous sommes raisonnables, si nous luttons contre ces grands murs de bétons qui défigurent notre littoral et si, en même temps, nous défendons une densification respectueuse des terres agricoles riches qui deviennent souvent des lieux de construction « en deuxième rideau », aurais-je envie de dire, des communes littorales – la pression est telle que des centaines d’hectares sont absorbées par l’habitat –, nous pourrons sans doute être plus efficaces.

La commission n’a pas été convaincue par le présent amendement. Madame la ministre, je vous remercie par conséquent des explications complémentaires que vous venez de nous apporter et de l’ouverture intéressante que vous avez évoquée sur la future loi NOTRe. Au demeurant, il me semble impossible d’élargir de manière subreptice le champ d’application de la loi Littoral du fait de la fusion de communes.
En attendant l’examen du projet de loi NOTRe, la commission émet un avis défavorable.

Je voudrais tout d’abord remercier Mme la ministre de l’ouverture qu’elle vient de proposer au sujet de la future loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Cela étant, s’agissant de l’application de la loi Littoral, il reste encore beaucoup à faire ! En effet, les interprétations qui en ont été données par un grand nombre de tribunaux administratifs font preuve de rigidités, qui peuvent contrarier la réalisation de projets utiles de développement ou de construction, notamment dans ce que l’on appelle communément les « dents creuses » dans des hameaux qui ne sont pas préjudiciables à l’environnement.
Mais il ne s’agit pas de cela en l’espèce, M. le rapporteur l’a fort bien dit. Il est simplement question d’éviter que, à la faveur de la création d’une commune nouvelle, le champ d’application de la loi Littoral ne soit soudain étendu aux territoires des communes qui s’agrégeraient à une commune littorale. Or à l’intérieur des terres, dans une commune littorale, on pourrait déjà parfois construire à certains endroits sans polluer le paysage, en raison du relief. Tel est le cas dans certains creux, les constructions n’étant pas visibles depuis le littoral.
À dix, quinze ou vingt kilomètres à l’intérieur des terres, l’instauration de la commune nouvelle risquerait de provoquer des interdictions de construire en nombre, ce qui constitue aujourd’hui une contre-indication majeure à cette création
Mme Catherine Deroche s’exclame.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois n’a pas eu à délibérer très longtemps, je vous le dis à regret, madame la ministre, pour émettre un avis défavorable sur votre amendement.

Les écologistes soutiendront l’amendement du Gouvernement. Au reste, si la commission des lois n’a pas hésité longtemps avant d’émettre un avis défavorable à son sujet, la commission du développement durable aurait peut-être pu délibérer plus longuement. Il s’agit tout de même d’une question qui la concerne !
Mes chers collègues, je vous donne lecture de l’objet de l’amendement n° 10 : « Le Gouvernement n’est pas favorable à ce que le régime de la commune nouvelle conduise à des modifications substantielles des codes de l’urbanisme et de l’environnement sans évaluation préalable ni étude d’impact. » On le comprend bien, il est question non pas d’aller plus loin, mais de mesurer précisément, avant toute décision, l’incidence environnementale des mesures envisagées.
Cette disposition est très sensée. Elle me semble même relever de la précaution élémentaire. Voilà pourquoi, je le répète, les écologistes y sont favorables.
Je comprends l’inquiétude exprimée par la commission. Le fait est que la loi Littoral fait peur, ce que l’on ne peut que regretter.
J’ai bien pris connaissance des travaux que la Haute Assemblée a consacrés à cette question et qui ont été publiés il y a peu : il faut sans nul doute examiner ces dispositions de près.
M. le président de la commission acquiesce.
Toutefois, le fait de scinder une future commune en deux n’est pas sans poser problème. En effet, en pareil cas, la tentation serait de construire en priorité dans la seconde commune, celle qui serait éloignée du littoral : près du front de mer, les procédures sont plus compliquées et plus lourdes. Or, dans de nombreuses régions de France, la bande de terre agricole constituant cet arrière-pays est d’une très grande qualité.
Aujourd’hui, sous l’effet de la pression foncière, du développement touristique, du renchérissement du coût du foncier autour des grandes villes, on voit déjà les constructions se multiplier de plus en plus loin autour des agglomérations. Ce mouvement n’est pas bénéfique à la France. Nous avons perdu l’équivalent d’un département en terres agricoles en l’espace de dix ans, et ce processus est toujours à l’œuvre.
J’aurais préféré que l’on étudie ce problème dans sa globalité.
Pour les grandes intercommunalités, j’avais d’ailleurs proposé que l’on puisse réfléchir précisément à l’élaboration du plan local d’urbanisme, ou PLU, en fonction de la présence d’un littoral, d’un site classé, d’un périmètre de captage, d’un espace ou d’un parc naturel, etc. La commission des lois n’a pas repris ma suggestion. Au demeurant, il n’est pas possible d’examiner deux textes de loi en même temps.
Quoi qu’il en soit, nous devons impérativement réfléchir aux moyens d’améliorer nos modes de construction, afin d’éviter la densification du bâti dans les arrière-pays, ou, plus généralement, à la périphérie des espaces remarquables, au rang desquels figurent les littoraux. Ces territoires perdent souvent de très bonnes terres.
N’oublions pas que les mots « commune » et « commun » ont une seule et même racine. La base de la commune, c’est la mise en commun. Je le répète, il aurait été plus réaliste et plus raisonnable de réfléchir à l’avenir de ces espaces dans leur ensemble. Dans le futur, nous pourrons d’ailleurs réexaminer la loi Littoral, pour voir si elle peut autoriser des densifications du bâti, ce qui me semble possible.
Certes, on ne peut limiter ses analyses à sa propre expérience. Je ne ferai qu’évoquer la région dont je suis l’élue, laquelle est irriguée par de nombreuses rias.
La mer remonte, en empruntant leur cours, jusqu’à vingt-cinq kilomètres à l’intérieur des terres. Ainsi, la loi Littoral s’applique extrêmement loin dans l’arrière-pays, ce qui, aujourd’hui, ne pose plus aucun problème : face à cette réalité géographique, les acteurs concernés ont été conduits à réfléchir aux paysages, aux périmètres de captage, aux pollutions d’origine tellurique qui, malheureusement, entraînent, entre autres problèmes, la prolifération d’algues vertes sur certains littoraux. La densification et la préservation des terres agricoles riches ont partant été prises en compte. Le fait d’être inclus dans le périmètre de la loi Littoral n’est donc pas nécessairement un handicap !

Mes chers collègues, les membres du groupe socialiste s’abstiendront sur cet amendement.
Certes, Mme la ministre l’a rappelé avec raison, la loi Littoral ne doit pas être considérée comme un inconvénient, comme un facteur négatif. Mais, parallèlement, et en l’état actuel des choses, il semble assez logique de dire que cette législation s’applique à un espace donné, en vertu d’un certain nombre de considérations liées à ces espaces naturels spécifiques que sont les littoraux, et qu’il n’y a pas lieu que cela change.
Aussi, cette question mérite réellement d’être approfondie. Il me semble difficile de la trancher aujourd’hui. À court terme, il serait préjudiciable de modifier les espaces définis par le biais de la loi Littoral. Toutefois, à moyen et long termes, il est clair que, dans la mesure où une commune nouvelle sera définie, les dispositions en question s’appliqueront à l’ensemble de son territoire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 A est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme comprend des communes déléguées, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Le conseil de la commune déléguée ou le conseil municipal de la commune nouvelle peuvent demander à ce que le territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées soit couvert par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant chargé de l’élaboration du plan local d’urbanisme, cet organe délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. »

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
La parole est à Mme la ministre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, quoique portant sur un sujet différent, cette disposition relève du même esprit que la précédente. Elle est sans doute beaucoup plus simple.
L’article 5 permet la création d’un plan de secteur sur le territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées relevant d’un même PLU. Au nom du Gouvernement, je vous propose de supprimer la possibilité d’élaborer un plan de secteur au sein du PLU pour les communes déléguées. À tout le moins, il y existera un PLU commun.
Cette mesure me semble relever du bon sens.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 123-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées, selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d’élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu’un des plans locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé. »
II. – L’article L. 124-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées jusqu’à l’approbation d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. » –
Adopté.

L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Baroin, Mmes Deroche et Cayeux et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Une commune nouvelle créée en application de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et regroupant plus de 5 000 habitants bénéficie d'un délai de vingt-quatre mois au plus après sa date de constitution pour mettre en œuvre les obligations prévues au présent article. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.

Les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues de disposer d’une aire d’accueil ou de grand passage pour les gens du voyage. À l’origine, l’amendement déposé tendait à prolonger le délai d’application de cette obligation, après la création de la commune nouvelle, jusqu’en 2020, date de renouvellement général des conseils municipaux. À la demande de la commission, nous avons réduit ce laps de temps à vingt-quatre mois passé la date de création de la commune nouvelle.

Sur le plan des principes, un report trop lointain de l’obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants d’aménager une aire d’accueil pour les gens du voyage constituerait, à mon sens, un mauvais signal. Il en résulterait, de surcroît, des problèmes d’application technique.
Cela étant, il est nécessaire de laisser un certain délai d’action aux communes qui se regrouperaient, surtout s’il s’agit de nombreux petits villages qui, réunis, en viendraient à atteindre le seuil de 5 000 habitants. Voilà pourquoi la commission a demandé la rectification de l’amendement initial. Ainsi, une commune nouvelle créée en 2015 devra, au cours du mandat municipal, se soumettre à cette obligation.
Cette modification étant apportée, la commission émet un avis favorable.
Rectifiée, cette disposition devient plus acceptable.
Toutefois, les compétences relatives aux gens du voyage vont prochainement être confiées, à titre obligatoire, à l’échelon intercommunal.
M. le rapporteur opine.
On conçoit la nécessité de donner un délai aux communes, mais, dans cette perspective, je ne vois guère l’intérêt d’une telle mesure. Aussi, je demande le retrait de cet amendement.

Madame la ministre, j’en suis bien consciente, cette compétence devrait prochainement être attribuée à l’échelon intercommunal.

Je note simplement que tel n’est pas encore le cas.
Cela étant, je suis prête à retirer mon amendement.

On le sait très bien, certaines collectivités n’ont pas encore appliqué la loi de 2000, …

… alors même qu’obligation leur en est faite. Elles prendront le temps nécessaire, car ces dispositions sont difficiles à instaurer – il faut notamment trouver un terrain adéquat.
Quoi qu’il en soit, la fixation d’un tel délai est totalement inutile. Je l’indique à mon tour : dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence dont il est question échoit nécessairement aux intercommunalités.
I. – L’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les trois premières occurrences du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
2° Les mots : « peut adhérer » sont remplacés par le mot : « adhère » ;
3° À la fin, les mots : « à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création » sont remplacés par les mots : « avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création ».
II
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté...
le reste sans changement
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du ou des établissements publics » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « pris par l’établissement public » sont remplacés par les mots : « pris par le ou les établissements publics » ;
4° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « conclus par l’établissement public » sont remplacés par les mots : « conclus par le ou les établissements publics » ;
5° À l’avant-dernier alinéa, le début de la première phrase est ainsi rédigé :
« L’ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale...
le reste sans changement
6° Au dernier alinéa, les mots : « substituée à l’établissement public », sont remplacés par les mots : « substituée à ou aux établissements publics ».

L'amendement n° 3, présenté par Mme Gourault et MM. Tandonnet, Baroin et Guené, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois et par dérogation à l’alinéa précédent, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et répondant aux objectifs du 1° du III de l’article L. 5210-1-1 ou aux autres règles démographiques fixées par la loi, peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale. Sur décision prise à la majorité de ses membres, la commission départementale de la coopération intercommunale peut autoriser la commune nouvelle à adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au plus tard lors de la prochaine révision du schéma départemental de coopération intercommunale. Elle se prononce dans un délai de trois mois suivant sa saisine par la commune nouvelle. »
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Cet amendement tend à revenir sur le délai de deux ans accordé aux communes nouvelles pour rejoindre une intercommunalité.
La finalité est de garantir la souplesse nécessaire pour débattre, au sein de la commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI, d’une éventuelle prolongation de ce délai.

M. Michel Mercier, rapporteur. Madame Gourault, cet amendement a suscité un long débat au sein de la commission, qui, au final, ne l’a pas retenu. Aussi, vous l’avez déposé de nouveau en vue de la discussion en séance publique avec MM. Tandonnet, Baroin et Guené. La liste des signataires nous permet de savoir l’origine de cet amendement
Mme Jacqueline Gourault hausse les épaules.

Toutefois, je vous le dis en toute honnêteté : il ne me semble pas possible de vouloir, d’une part, généraliser l’intercommunalité, selon des dispositions que nous avons inscrites, sur votre initiative, dans la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM », et, d’autre part, repousser l’application de cette mesure !

Aussi, je vous invite à retirer cet amendement. À défaut, je serai, malheureusement, …
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
Madame Gourault, en imposant aux dernières communes isolées de rejoindre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en rattachant à l’intercommunalité pertinente les communes enclavées ou placées dans une situation de discontinuité, le législateur a tenu à favoriser l’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale.
D’ailleurs, par sa décision du 26 avril 2013, le Conseil constitutionnel a élevé ce travail au rang d’objectif d’intérêt général. Ajouter un délai à un autre n’irait qu’à l’encontre du but que vous n’avez cessé de viser.

Mme Jacqueline Gourault. Devant tant de sollicitude et de logique, je retire mon amendement, madame la présidente.
Sourires – M. Jean Desessard applaudit.
L'article 7 est adopté.
La seconde phrase du troisième alinéa du II et la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2113-5 du même code sont ainsi modifiées :
1° Après le mot : « Jusqu’à », sont insérés les mots : « l’entrée en vigueur de » ;
2 Après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : «, par dérogation à l’article L. 5210-2 » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public ».

L'amendement n° 16, présenté par M. Boulard, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 2113-5 du même code est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du II, après le mot : « distincts » sont insérés les mots : « mais relevant d’une même catégorie » ;
B. – La seconde phrase du troisième alinéa du II est ainsi modifiée :
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
C. – Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de catégories distinctes, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale relevant de la catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8.
L'article 8 est adopté.

L'amendement n° 2, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par l'année : « 2016 ».
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Comme nous proposons de l’amender de sorte à reporter le délai pour la clause de revoyure, il nous semble normal d’inscrire le même délai dans le texte en discussion aujourd’hui.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre III du livre III de la cinquième partie du même code et situées dans un des départements cités au VII de l’article L. 5210-1-1 du même code sont appelées à se prononcer sur l’un des deux choix suivants :
1° La création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;
2° La transformation dudit établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération.
Le choix entre ces deux solutions s’effectue dans les conditions de majorité requises au cinquième alinéa de l’article L. 5321-1 dudit code.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Cet amendement tend à régler le problème des syndicats d’agglomération nouvelle, les SAN. À terme, leur suppression est prévue et offre l’occasion de la constitution d’une commune nouvelle. Cela pourrait advenir dans deux cas au moins.
Je m’aperçois que cet amendement doit être rectifié, madame la présidente, afin de prévoir des solutions dans le cas où l’unanimité ne se fait pas autour du choix mentionné au 1°, c'est-à-dire la création d’une commune nouvelle : alors, les deux premiers alinéas de l’article L. 2113–3 du code général des collectivités territoriales s’appliquent.
Si la majorité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2113–3 n’est pas atteinte, le 2° du présent article s’applique, c'est-à-dire la transformation du SAN en communauté d’agglomération.
Cela me semble très important, car les SAN survivent encore, alors qu’une loi Rocard prévoyait déjà leur transformation en communautés d’agglomération. Il est maintenant temps de passer à l’acte. Je connais, en Seine-et-Marne, un exemple de SAN qui souhaite vivement se transformer en commune nouvelle, même si l’une des communes actuelles n’y est pas favorable. C’est tout à fait cohérent car, rassemblées dans un SAN, ces communes constituent déjà un ensemble très intégré, beaucoup plus que dans toute autre forme de coopération intercommunale.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux en séance quelques instants afin de permettre à la commission de prendre note des modifications apportées par M. Hyest à son amendement.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à douze heures dix.

La séance est reprise.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Hyest, et ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre III du livre III de la cinquième partie du même code et situées dans un des départements cités au VII de l’article L. 5210-1-1 du même code sont appelées à se prononcer sur l’un des deux choix suivants :
1° La création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;
2° La transformation dudit établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération.
Le choix entre ces deux solutions s’effectue dans les conditions de majorité requises au cinquième alinéa de l’article L. 5321-1 dudit code. À défaut d'unanimité pour le choix mentionné au 1°, les deux premiers alinéas de l'article L. 2113-3 du même code s'appliquent. Si la majorité prévue au deuxième alinéa du même article n'est pas atteinte, le 2° du présent article s'applique.
Quel est l’avis de la commission ?

Compte tenu des rectifications apportées à cet amendement, l’avis de la commission est très favorable.
Pour les mêmes raisons, l’avis du Gouvernement est favorable.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.
Section 4
Dispositions fiscales et incitations financières
Avant l’article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-55 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-55. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant le rattachement d’une commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des II et III de l’article L. 2113-5, les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci. » –
Adopté.
L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) (Supprimé)
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations mentionnées au présent I sont prises avant le 15 avril de la première année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, dans les conditions prévues à l’article 1639 A.
« Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive n’est pas mise en œuvre, les taux respectifs de chacune des taxes mises en recouvrement en application des 1° à 4° du I de l’article 1379 ne peuvent excéder les taux moyens des communes préexistantes constatés l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, pondérés par l’importance relative des bases de ces communes. » ;
d) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans le cas…
le reste sans changement
2°
Supprimé
3°
Suppression maintenue

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions prévues dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014. L’article 18 dudit projet de loi a pour objet de permettre une modulation de la durée d’intégration fiscale progressive à la suite d’une modification du périmètre de l’EPCI.
Il permet notamment aux communes nouvelles de fixer librement la durée d’intégration qu’elles souhaitent voir appliquer, dans la limite de douze ans, afin qu’elles puissent adapter la durée d’harmonisation des taux à leurs besoins et aux enjeux locaux.
La procédure ainsi proposée permet également de prévenir tout ressaut de la pression fiscale, le mécanisme de réduction des écarts de taux prévoyant une évolution par parts égales sur la durée choisie.
C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement me semble répondre à vos préoccupations, d’autant qu’il est déjà entré dans l’ordre du droit.

Cette mesure est importante. La loi de 2010 prévoyait une durée fixe de zéro ou de douze ans pour harmoniser les taux de fiscalité de la commune nouvelle. Le projet de loi de finances rectificative va plus loin que le texte proposé, puisqu’il laisse toute liberté à la commune nouvelle pour choisir un délai d’harmonisation fiscale. C’est donc une excellente disposition, qui recueille un avis favorable de la commission.
L'amendement est adopté.
I. – Les trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant, soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.
II. – Les trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant, soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.
III. – Les trois premières années suivant leur création, la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, calculée selon les règles prévues aux I et II de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, est majorée de 5 %.
IV. – Les trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.
V. – Les trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.

L'amendement n° 4, présenté par M. D. Laurent, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer le nombre :
par le nombre :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La deuxième phrase du I de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de supprimer l’exonération de la contribution au redressement des finances publiques introduite par la loi de finances pour 2014 dans le code général des collectivités territoriales, et qui a suscité dans cette enceinte un enthousiasme fort, dans la mesure où cette garantie est moins favorable que les dispositions de la présente proposition de loi.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 17, présenté par M. Boulard, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les dispositions du présent article sont applicables à toute commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2017 quelle que soit sa taille.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
L'article 10 est adopté.
Le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant, soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014. »

L'amendement n° 18, présenté par M. Boulard, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à toute commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2017 quelle que soit sa taille. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 11.
L'article 11 est adopté.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 rectifié bis est présenté par Mme Gourault et MM. Tandonnet, Baroin et Guené.
L'amendement n° 12 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 ».
La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.

Il s’agit de traiter du cas dans lequel une commune nouvelle est créée sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. De nombreux calculs ont montré que ceux-ci pouvaient être pénalisés en termes de péréquation horizontale.
La contribution au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, ou FPIC, est recalculée à l’échelle du nouveau périmètre, alors que les potentiels financiers agrégés, les PFIA, des ensembles intercommunaux et des communes isolées prennent en compte la dotation forfaitaire des communes, et donc la part « consolidation » égale à la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’EPCI la même année, ce qui implique une hausse mécanique du PFIA.
Dans la mesure où la dotation d’intercommunalité n’est jamais prise en compte dans le calcul du FPIC, il est logique d’exclure la part « consolidation » du calcul du potentiel financier agrégé des communes nouvelles lorsqu’elles se substituent à un EPCI à fiscalité propre.

L'amendement n° 12 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 5 rectifié bis ?

Cette disposition est importante.
Madame la ministre, vous aviez pris devant l’Assemblée nationale l’engagement de déposer un tel amendement. Le Gouvernement a tenu sa promesse, et je l’en remercie.
Je constate d’ailleurs que vous avez su inspirer, madame la ministre, par des chemins probablement détournés que nous ignorons, Mme Gourault, qui a recopié à l’identique votre amendement, soutenant par là même la volonté du Gouvernement de respecter la parole donnée aux députés.

Devant cette unanimité, la commission se confond en remerciements et émet un avis très favorable !
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 11.
Je constate, par ailleurs, que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 20, présenté par M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Avant l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de l’article L. 2113-26 », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
Section 5
Application outre-mer
La parole est à M. le rapporteur.

Il s’agit d’un amendement relatif à l’application du texte à la Polynésie française.
Le Gouvernement est bien évidemment favorable à cette extension.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 12.
(Suppression maintenue)

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

Les membres du groupe UDI-UC voteront en faveur de la présente proposition de loi, dont ils se réjouissent. Ce texte améliore le dispositif retenu lors de l’adoption de la loi de 2010.
Je me félicite du large consensus qui s’est dégagé aujourd'hui, ce qui n’était pas le cas au mois de février 2010. Je me suis amusé à me replonger dans les débats de cette époque. M. Mercier était alors au banc du Gouvernement. Il s’en souvient et sourit d’ailleurs… Que n’avait dit notamment l’opposition ! M. Sueur avait employé des mots extrêmement durs pour dénoncer le caractère autoritaire des communes nouvelles et avait exprimé sa volonté d’en revenir à la loi Marcellin. Heureusement, le dispositif a été adopté et tout le monde s’en félicite aujourd'hui !
Pour ma part, j’avais souligné que le mécanisme était suffisamment enserré pour limiter la création des communes nouvelles. C’est effectivement ce qui s’est produit puisque, au 1er janvier prochain, on en dénombrera uniquement dix-neuf.
Le dispositif qui nous est soumis aujourd'hui va dans le bon sens, puisqu’il vise à mettre en place des incitations financières absentes dans la loi de 2010. Parmi les dispositions, je citerai la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire, le fait que les baisses de dotations ne s’appliqueront pas pendant trois ans dans les communes nouvelles, le renforcement du rôle du maire délégué, ainsi que certaines mesures spécifiques, notamment en matière d’urbanisme.
Toutes ces mesures sont bonnes, d’autant qu’il y a fort à parier, comme l’a souligné M. Mercier, qu’un certain nombre de communes se tourneront vers cette solution dans les années à venir car elles n’arriveront plus à équilibrer leur budget en raison de la baisse des dotations. Ainsi, dans mon département, comme dans beaucoup d’autres, certaines communes n’ont pu équilibrer leur budget de fonctionnement en 2014 qu’en diminuant le montant des indemnités des élus. Quand une collectivité en est réduite à une telle extrémité, il y a fort à parier que, en 2015, 2016 et 2017, elle n’arrivera plus à l’équilibre budgétaire ! Par conséquent, les élus opteront pour la commune nouvelle sur la base du volontariat, mais d’un volontariat quelque peu contraint.
Madame la ministre, je demande au Gouvernement de faire attention à ne pas étrangler nos communes. Cette crainte a été exprimée au cours des débats et je la reprends à mon compte.
La commune est l’échelon de la proximité, de la démocratie, du lien social et de la bonne gestion. Contrairement à ce que certains prétendent, le nombre de communes n’est pas une source de dépenses ou de gaspillage. Je l’avais d’ailleurs dit à un précédent Premier ministre, les petites communes ne gaspillent pour une raison très simple : elles n’ont pas d’argent ! Je crois, bien au contraire, que le bénévolat formidable dont font preuve 500 000 conseillers municipaux est une source d’économie.
Soyons donc vigilants : quelle que soit leur utilité, tous ces dispositifs ne doivent pas porter atteinte à l’existence même de nos communes !

Après l’avoir annoncé lors de la discussion générale, je le confirme, les membres du groupe écologiste voteront en faveur de la présente proposition de loi, après un débat serein qui n’aura pas apporté de modification substantielle. Nous avons réalisé du bon travail et nous avons su créer un cadre sécurisant pour les regroupements. Nous nous en réjouissons.

En effet, j’ai eu le privilège de voter à l’Assemblée nationale les lois de 1981 alors que, mon cher collègue, un certain nombre d’éminents représentants du mouvement centriste n’avaient pas de mots trop durs pour vilipender ces textes – je pense à un élu de l’Ille-et-Vilaine, tout particulièrement. Ces élus ont par la suite reproché le manque de décentralisation… Pourtant, ces lois ont été de grandes lois de liberté, de même que les lois relatives à l’intercommunalité de 1992 et 1999, qui ont toujours fait appel au volontariat des collectivités. C’est ce qui a été positif et productif.
Ensuite, il y a eu des tendances recentralisatrices. Je me suis toujours élevé, monsieur Maurey, vous avez raison de le souligner, contre ce qui apparaissait comme des tentatives autoritaires, qui en l’espèce ne fonctionnent pas.
Monsieur Mézard, j’en conviens, il y a eu la volonté, mais elle a été largement partagée, de boucler le schéma de l’intercommunalité à partir du moment où pratiquement plus de 95 % des communes avaient volontairement fait ce choix.
Ce qui me semble extrêmement positif dans cette proposition de loi, mes chers collègues, c’est qu’elle est totalement fondée sur le volontariat. Comme plusieurs orateurs, je ne nourris néanmoins pas d’illusions excessives. Je l’ai dit au cours de mon intervention liminaire, s’agissant en particulier des grandes agglomérations urbaines, ce serait une profonde erreur que de vouloir imposer ou susciter la création de communes nouvelles, qui se substitueraient à quinze, vingt ou trente communes. En effet, ces communes existent fortement et l’intercommunalité sous forme de communautés d’agglomération, de communautés urbaines et, demain, de métropoles fonctionnera si elle respecte les communes et leur droit à mutualiser les compétences qu’elles souhaitent partager.
En revanche, la loi que nous allons adopter sera précieuse pour les petites et moyennes communes, car elle permettra à celles d’entre elles qui le veulent d’opérer les fusions pouvant leur sembler nécessaires.
Mais quelle que soit la taille de la commune, il est clair que rien ne sera imposé. De toute façon, ce serait illusoire.
La leçon que l’on peut tirer, quelques décennies après le vote de la loi Marcellin de 1971, c’est qu’un certain nombre de discours qui ont été à l’envi répétés sur l’inconvénient majeur que représentait le grand nombre de communes ne correspondent pas à la réalité de notre pays. En effet, je le répète – et ce sera ma conclusion –, les Français ont la commune dans le cœur depuis le 14 décembre 1789.
M. André Gattolin applaudit.

Cela dure depuis deux siècles, et c’est important. La commune est et restera le cœur battant de la démocratie et de la République !

A contrario, rien dans le débat ne peut nous amener à changer de position.
Évidemment, on a entendu de beaux éloges des élus, de la commune, cœur de la démocratie, la référence à 1789… Mais je considère, et le débat vient de le montrer, que tout pousse, au contraire, à la disparition des communes.
Les références à la loi de 2010, dans la mesure où nous y étions opposés, sont pour nous problématiques, de même que l’insistance des uns et des autres à vouloir que les communes s’adaptent à l’austérité. Vous avez moins de moyens ? Eh bien, fusionnez ! Vous avez des difficultés à trouver des élus ? Fusionnez ! La fusion serait la réponse aux difficultés rencontrées par les communes.
Même si l’on met en avant la notion de volontariat, cela dissimule mal le mouvement incitant, je le répète, à la disparition des communes, notamment parfois en les vidant de leur contenu, de leurs compétences par le biais de l’intercommunalité.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes
La proposition de loi est adoptée.
Je souhaite remercier l’ensemble des sénateurs qui ont activement travaillé sur cette proposition de loi, qui, il faut le souligner, est issue de l’Association des maires de France. Je remercie, bien sûr, le rapporteur, Michel Mercier, le président de la commission des lois et tous ceux qui ont participé à ce débat.
Je voudrais préciser, après l’explication de vote de M. Bosino, que ce sont bien les maires de France qui ont réclamé ce texte sur les communes nouvelles. Certaines communes, en effet, dans lesquelles il n’est plus possible de trouver des candidats aux élections ou les moyens de gérer un minimum de services, expriment à cet égard une vraie demande. Et comme tout est fondé sur le volontariat, il faut soutenir ces maires qui n’ont pas la chance d’être à la tête de communes suffisamment vastes pour se prévaloir d’une démographie importante, donc d’un potentiel financier leur permettant de répondre aux besoins de leurs citoyens.
Le fait que ce texte ait été adopté à l’unanimité, à l’exception d’un groupe qui ne l’a pas voté, est donc vraiment un encouragement pour eux, et je pense que son adoption définitive interviendra rapidement. §

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Hervé Marseille.