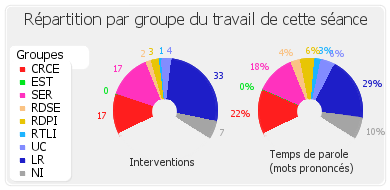Séance en hémicycle du 26 janvier 2021 à 21h30
La séance
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.

La séance est reprise.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Cécile Cukierman.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur le contexte dans lequel s’inscrit cette discussion et sur le profond mépris dont fait preuve le Gouvernement à l’égard du Parlement s’agissant de la méthode. Je voudrais tout de même souligner que ce mépris s’étend aussi à l’ensemble des professionnels de la justice. Ces derniers ne s’estiment pas prêts matériellement à travailler sous l’empire de ce nouveau code, pour l’élaboration duquel ils n’ont obtenu qu’un semblant de concertation.
Nous reviendrons lors de l’examen des amendements sur la question des délais intenables. Nous proposerons un délai d’un an – c’est plus que ce qui est envisagé par la commission –, pour l’entrée en vigueur effective de la réforme, qui est actuellement prévue par le Gouvernement au 31 mars prochain, c’est-à-dire « demain » !
Sur le fond, en présentant ce texte, monsieur le garde des sceaux, vous avez expliqué : « Le répressif avec les gamins, ça ne marche pas. » J’aurais envie de vous répondre que cela ne marche avec personne ! Vous avez ajouté qu’il fallait « d’abord l’éducatif » et une « réponse rapide ». Permettez-moi de vous dire que cela ne marche pas non plus : l’éducatif ne peut pas être une réponse rapide !
La question n’est pas de se satisfaire des délais de plus en plus longs qui existent aujourd’hui. Ces délais sont aussi le fruit d’une situation d’engorgement des différentes procédures et du manque de moyens, notamment pour la construction du temps éducatif. S’il ne faut bien évidemment pas les allonger davantage, il ne faudrait pas les raccourcir à l’excès, sous peine de fragiliser ce temps éducatif.
Le temps est aussi une composante essentielle de la personnalité des mineurs. Or ce que ce texte propose est, par exemple, de pouvoir juger en audience unique – c’est le « tout en un » – les mineurs récidivistes alors que ce sont eux qui justifient à nos yeux le plus une intervention éducative lourde et inscrite dans la durée. Il semblerait que le pari soit fait de leur échec futur au regard de leur échec passé…
C’est un exemple, mais il est révélateur de la philosophie globale de cette réforme, qui, au lieu de s’orienter vers un code général de la protection de l’enfance, s’emploie à rapprocher la justice des enfants de celle des adultes. Malgré la couche de vernis qui est bien appliquée ici et là pour faire coller cette réforme point par point à nos principes constitutionnels, à la primauté de l’éducatif et à l’intérêt supérieur de l’enfant, plusieurs mesures illustrent un tel rapprochement.
Aucune avancée effective n’est notable sur la présomption d’irresponsabilité pénale, puisque le seuil d’âge de 13 ans est associé à une présomption simple, donc susceptible d’être renversée. Cela n’est pas conforme aux textes internationaux, notamment à l’article 40 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Ce nouveau code rend possible le prononcé de peines en cabinet à juge unique et insuffisantes les garanties procédurales offertes aux droits de la défense.
En parallèle est instaurée une procédure de césure qui, à moyens constants, n’est simplement pas tenable quant aux délais et portera atteinte au principe éducatif.
Quelques amendements de Mme la rapporteure vont dans le bon sens, en tout cas de notre point de vue. Je pense notamment à celui qui tend à supprimer la compétence en matière de justice des mineurs du tribunal de police, ou encore à celui qui vise au report du délai d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Cependant, sur le fond, le texte reste inchangé, et l’économie générale est pour le moins partagée par la majorité sénatoriale : aller plus vite et à moindre coût, même pour la justice des mineurs.
Cela n’est pas la vision de la société que nous défendons. Alors que la priorité devrait être accordée à la lutte contre la pauvreté et à la protection de l’enfance en danger, un glissement inquiétant s’opère avec ce texte : celui de l’abaissement des garanties éducatives pour toute une partie de notre jeunesse qui – je le dis sans angélisme – est bien souvent en proie à d’autres difficultés que celles purement judiciaires ici considérées et auxquelles on voudrait répondre sans ambages.
En matière d’éducation de jeunes mineurs en difficulté, et donc pour ce qui concerne cette réforme de la justice pénale des mineurs, le plus important, selon nous, ce n’est pas la peine et la sentence finale, qui n’ont que peu de sens pour des êtres en construction ; c’est bien le chemin parcouru à leurs côtés et le « pouvoir » et l’aura qu’auront sur eux les explications des magistrats, des avocats, des éducateurs qui les accompagneront dans la compréhension du système judiciaire qui est le nôtre, celui qui permet de vivre en société, de faire du commun, dans un État de droit.
Le cadre que leur offre cette réforme n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Le Sénat s’honorerait à modifier le texte en profondeur, même si sa marge de manœuvre est, nous le savons, parfois infime. Pour notre part, nous serons évidemment attentifs au sort qui sera réservé à nos amendements. Mais, pour l’heure, nous ne pouvons pas soutenir une telle réforme.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de commencer par ces quelques mots de votre illustre prédécesseur Robert Badinter : « Un mineur, c’est un être en devenir. […] L’objectif premier de la justice des mineurs, c’est de les intégrer ou de les réinsérer dans la société. » Alors, oui, au nom de ce noble objectif, l’ordonnance de 1945 se devait d’être remise à plat, réécrite, enrichie et, enfin, codifiée !
En effet, comme l’a précisé Mme la rapporteure, une quarantaine de réformes depuis 1945 ont rendu ce texte fondateur bien complexe, difficile à appréhender, y compris pour les professionnels, et parfois en incohérence avec le code pénal. Sur un aspect purement formel, le présent projet de loi est donc tout à fait bienvenu.
L’ordonnance de 1945 nous donne en héritage un socle de principes : la primauté de l’éducatif sur le répressif, la spécialisation des juridictions pour mineurs et l’atténuation de leur responsabilité pénale. Ce sont des principes fondamentaux qu’il était indispensable de ne pas perdre de vue : juger les mineurs, c’est avant tout trouver un équilibre délicat entre la nécessaire protection de la société et l’indispensable prise en compte de l’intérêt de l’enfant, ce citoyen en devenir. Un enfant est un enfant, et on ne peut pas lui prêter la même compréhension du monde qui l’entoure et de ses actes qu’un adulte. Ainsi, en cette matière, et peut-être plus que dans d’autres, gardons-nous des raisonnements simplistes et des jugements hâtifs.
Si l’enfant n’a pas la même compréhension du monde, il n’a pas non plus la même temporalité qu’un adulte. Lorsque l’on a cinquante ans, un an, c’est un cinquantième de sa vie ; lorsque l’on a dix ans, c’est un dixième, soit beaucoup plus. Six mois, douze mois, deux ans pour un adulte peuvent équivaloir à trois ans, cinq ans, dix ans pour un enfant. Bref, c’est long… C’est pourquoi le raccourcissement des délais et la création d’une césure avec une première audience sur la culpabilité dans les trois mois qui suivent le début de la procédure devraient apporter une véritable amélioration pour l’enfant jugé, mais aussi pour la victime, qui pourra ainsi voir sa demande prise en compte rapidement.

Ce temps judiciaire long, c’est aussi un grand nombre de mineurs en détention provisoire. À la fin de l’année 2020, 80 % des mineurs détenus l’étaient en détention provisoire. Pour les majeurs, c’est de l’ordre d’un tiers. Cela pourrait laisser entendre que beaucoup de ces mineurs n’auraient pas dû passer par la case prison, ladite case n’étant pas, on le sait, le meilleur lieu d’éducation et de réinsertion.
Après cette première audience, si le mineur est déclaré coupable, viennent six à neuf mois de suivi éducatif devant lui permettre d’intégrer sa culpabilité et de comprendre la portée de ses actes et devant surtout permettre de prendre des mesures évitant toute réitération. C’est alors qu’interviendra une seconde audience, qui décidera de la sanction, en tenant compte du comportement et de l’implication de l’adolescent durant son parcours éducatif.
Nous ne pouvons que saluer cette volonté d’aller plus vite, monsieur le garde des sceaux. J’appelle cependant votre attention sur l’importance de donner à notre justice les moyens de vos ambitions ; je dirais même de nos ambitions ! En l’état actuel, il est à craindre que ces délais ne puissent pas être respectés, tout comme ils ont du mal à être tenus aujourd’hui.
Permettez-moi de prendre ici un exemple très concret : en vertu du troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines, les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont tenus de prendre en charge le mineur ayant fait l’objet d’une décision judiciaire au plus tard cinq jours après. L’intention est louable. En pratique, les services convoquent bien les mineurs dans ce délai, afin d’être en conformité avec la loi, mais c’est seulement pour lui fixer un rendez-vous ultérieur, souvent un mois après, faute de moyens. La réalité des cinq jours, c’est trente-cinq jours ! Là encore, il y a un problème de temporalité. Simplement, il est lié non pas à l’âge des protagonistes, mais plus sûrement, à mon avis, à leur nombre, que ce soit coté mineurs ou côté PJJ.
Lors d’une audition, notre collègue Maryse Carrère vous a interrogé sur les moyens de la PJJ et le besoin de renforcement par rapport à la réforme. Vous lui avez répondu qu’il n’y aurait pas plus de mineurs et que le travail de la PJJ ne serait pas très différent. C’est juste ! Mais les difficultés de la PJJ resteront également les mêmes, et ce sera tout aussi compliqué pour eux d’accompagner les mineurs et de les prendre en charge dans un temps court, chose qu’ils ont du mal à faire aujourd’hui, si vous ne les aidez pas.
Alors, monsieur le garde des sceaux, au regard de l’ambition de ce texte, ne partons pas du principe qu’une fois de plus « l’intendance suivra » ! Donnons à notre justice les moyens humains et matériels – je pense ici, vous vous en doutez bien, à l’informatique – pour s’assurer du succès de cette réforme.
Je ne reviendrai pas sur la présomption simple de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Voilà qui nous met en conformité avec le droit international. Je salue tout de même à ce sujet le travail de notre rapporteure – vous l’avez fait vous-même, monsieur le garde des sceaux –, qui apporte quelques pistes permettant de définir le discernement, afin d’éviter que, selon la juridiction dont dépend le mineur, voire selon le juge auquel il est affecté, la disparité du concept ne soit trop forte.
Je voudrais en revanche revenir sur le juge des libertés et de la détention. Paris n’est pas la France. La France est maillée – pourvu que ça dure ! – de petits tribunaux ne disposant pas de pléthore de juges des libertés et de la détention. Vous indiquez que nous n’avons pas beaucoup de juges des enfants non plus ; je pense que nous en avons tout de même un peu plus que de juges des libertés et de la détention.
M. le garde des s ceaux le conteste.

Les juges des enfants que nous avons rencontrés, comprenant parfaitement qu’il fallait dissocier les deux fonctions, ont plutôt proposé que ce soit un autre juge des enfants qui statue de la liberté et de la détention. Nous aurions alors bien une dissociation, doublée d’une vraie spécialisation.
Enfin, je ne peux également que souscrire à la proposition de la commission de repousser l’entrée en application de ce texte au mois de septembre 2021. J’ai bien entendu les discours sur le thème : « Rendez-nous le JLD, et peut-être qu’on vous donnera du temps.. »
M. le gard e des s ceaux sourit.

Monsieur le garde des sceaux, vous qui nous dites régulièrement de faire confiance aux juges, à votre tour, faites-leur confiance ; donnez-leur pleinement le temps de se préparer à cette réforme, qui le mérite !
Vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste votera ce texte, mais restera vigilant sur son application concrète.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le garde des sceaux, lors de votre audition, vous déclariez : « Je ne connais pas de réforme qui ne suscite pas de larges oppositions. » Pour qui s’amuse des joutes oratoires, nous pourrions répondre que c’est logique au regard du proverbe chinois : « Qui réforme souvent déforme. »
Plutôt que de balayer d’un revers de main les oppositions, nous nous sommes attachés à déterminer qui dit quoi, pourquoi, comment, à quel moment et au nom de quelles réalités ou de quels principes. Nous l’avons fait pour répondre à une question simple : « Pourquoi une réforme ? » Nous avons tenté d’y trouver le sens et la légitimité. Prendre une réforme comme seule réponse à un problème posé, c’est se réformer de toute autre action possible.
Nous retenons de ce travail une certaine unanimité sur la nécessité d’une réforme et, pourtant, des blocages importants.
Pour notre part, nous souscrivons au principe de la réforme. Il s’agit de permettre – plusieurs orateurs l’ont indiqué – une meilleure lisibilité d’un corpus législatif amendé près de quarante fois depuis 1945, avec des modifications qui, au fil des années, ont fait perdre en cohérence et en clarté le texte d’origine.
Nous sommes également favorables à une réaffirmation des trois principes de l’ordonnance de 1945 : primauté de l’éducatif sur le répressif, ce qui ne signifie pas pour autant absence de sanction ; spécialisation de la justice des mineurs ; atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge.
De même, nous souscrivons aux trois attendus de la réforme : instauration d’une présomption d’irresponsabilité avant 13 ans, qui permet au droit français de se mettre en conformité avec les conventions internationales ; accélération du jugement via une procédure en deux temps, audience de culpabilité, puis audience de sanction avec mise à l’épreuve entre les deux ; volonté de remettre la victime au centre.
Au-delà de ces attendus louables, une analyse plus fine montre que la réforme acte en fait la remise en cause progressive de la philosophie de l’ordonnance de 1945. En effet, peu à peu, du fait des mutations sociales et de la perception du jeune dans la société, l’impératif de la prise en compte de la personnalité des auteurs d’infractions et de leur contexte de vie a été abandonné, en particulier pour les mineurs les plus âgés, et ce au profit de la notion de « trouble de l’ordre public », qui, lui, doit être rétribué par une sanction pénale, avec un abandon progressif de la référence à l’enfant et à son intérêt. La question était à l’origine : « Pourquoi punir ? » Elle devient : « Comment punir ? » La perception est importante sur ce plan.
Cette évolution est particulièrement marquée dans les années 2000. Entre 2001 et 2008, pas moins de huit textes, dont sept de nature législative, se sont traduits par trois tendances lourdes, que l’on retrouve dans votre texte : un renforcement du volet répression ; un alignement progressif sur les textes concernant les adultes ; un renforcement du pouvoir du parquet et de la police en liaison directe avec les autorités politiques locales.
Cette évolution est interrogée par les chiffres. En effet, 93 % des affaires connaissent une réponse pénale s’agissant des mineurs, contre 88 % pour les majeurs. En revanche, 82 % des mineurs incarcérés ne sont pas jugés et relèvent de la détention provisoire. D’où une interrogation sur le renforcement du volet pénal : ne fallait-il pas plutôt se poser la question des moyens consacrés à la justice des mineurs et éviter ces fameux 82 % ?
Cette analyse nous conduit à mettre l’accent sur trois divergences de fond qui justifient nos amendements.
La première est sur la méthode, mais c’est bien une divergence de fond. Ainsi que Mme la rapporteure l’a rappelé, avoir procédé par ordonnance pour un texte aussi important est largement contestable. Si l’on peut comprendre le recours à l’ordonnance dans le contexte de 1945, l’enjeu de ce code pouvait mériter mieux, avec une réflexion beaucoup plus large.
La deuxième divergence tient au fait que, contrairement à ce que vous affirmez, ce texte privilégie – ce n’est peut-être pas le cas dans les attendus, mais cela le sera en pratique – la répression au détriment du temps éducatif, du fait de trois insuffisances. D’abord, si l’objectif est, certes, de raccourcir les délais, ceux qui sont inscrits dans le texte sont des délais indicatifs qui ne sont pas encadrés. Faut-il rappeler que, dans l’ordonnance de 1945, il y avait une obligation que les mesures éducatives soient mises en œuvre dans les cinq jours ? Par conséquent, si le délai n’est pas respecté, c’est qu’il y a des problèmes ailleurs. Ensuite, une place trop large est laissée aux procédures d’exception ne respectant pas la phase éducative, ce qui conduira immanquablement à un durcissement des mesures prononcées et, de fait, à un rapprochement de la justice des mineurs avec celle des majeurs. Enfin, la question des moyens est une vraie question de fond, car elle détermine la crédibilité même de la réforme.
La troisième divergence – elle a été largement soulignée par Mme la rapporteure – concerne la faisabilité matérielle en amont et en aval d’une crise sanitaire qui est venue aggraver les difficultés de la justice des mineurs. Sur ce point, la quasi-totalité des acteurs soulignent les difficultés. Quand la quasi-totalité des acteurs soulignent des difficultés, c’est bien qu’il y a un problème ! Dire que tout sera prêt relève pour nous de la méthode Coué.

Ces divergences fondent nos propositions d’amendements, qui reposent sur trois points de vigilance.
Le premier est le report de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs. Mme la rapporteure a fait des propositions à cet égard.
Le deuxième point de vigilance concerne la question de la responsabilité atténuée en fonction de l’âge, notamment le caractère irréfragable de l’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 13 ans. Nous considérons que seule une présomption irréfragable aurait permis de répondre aux engagements internationaux de la France et d’assurer aux mineurs en conflit avec la loi une égalité de traitement. Cette question est liée à celle de la définition du discernement, qui ne nous semble pas satisfaisante dans le texte. En l’occurrence, monsieur le garde des sceaux, nous vous rejoignons, puisque nous avons présenté un amendement qui va dans le même sens que vos propositions.
Le troisième point de vigilance est lié à la question de l’audience unique pour les réitérants, qui, pour nous, reste problématique, car elle tend à se confondre avec une comparution immédiate. Cela porte atteinte à la fois au principe de spécialisation des juridictions et à celui de la primauté de l’éducatif.
Les divergences sont donc non pas sur les attendus, mais bien sur la situation actuelle de la justice des mineurs et sur ce qui risque de se passer.
Pour conclure, je dirai que l’on peut regretter que cette réforme ne soit essentiellement que procédurale et concentrée sur le volet pénal. Il est permis de se demander en quoi cette réforme s’attaque plus qu’hier aux carences éducatives que l’on prétend combattre. Une piste n’a malheureusement pas été suivie : la déjudiciarisation de nombre de procédures au profit de systèmes civils construits pour distraire du judiciaire les infractions se rapprochant des incivilités. Je pourrais également évoquer les autorités politiques locales, qui jouent un rôle particulier dans la réinsertion et dans la prise en compte de la délinquance des mineurs. Un code de l’enfance incluant les dispositions civiles et pénales aurait ainsi permis de mieux prendre en compte la volonté, si toutefois elle existe toujours, de considérer le mineur en conflit avec la loi comme un enfant à protéger.
Vous l’aurez compris, notre position sur ce texte est, pour l’instant, relativement distante. C’est pourquoi nous avons déposé des amendements : nous espérons que la rédaction du projet de loi pourra évoluer.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l’ordonnance de 1945 sur la justice pénale applicable aux mineurs a fait l’objet de près de quarante modifications au cours de son histoire. Au fondement du droit pénal spécifique aux mineurs se trouve l’idée centrale de discernement, de même que l’importance de travailler à remettre le mineur dans le droit chemin.
Malgré les nombreuses modifications que j’ai évoquées, un principe a toujours guidé la réponse pénale que notre pays applique aux mineurs délinquants : favoriser les mesures éducatives lorsqu’il est possible d’éviter le recours à des mesures répressives. Il me semble que nous nous retrouvons tous autour de cette philosophie, centrée sur la nécessité d’assurer l’insertion ou la réinsertion de ces jeunes.
La réforme que nous examinons aujourd’hui est nécessaire. Nous aurions néanmoins souhaité qu’elle soit menée dans un contexte plus apaisé. Le recours à une ordonnance, qui plus est en procédure accélérée, contraint légèrement le débat parlementaire. Cette réforme doit néanmoins se faire, non seulement pour permettre à la France de respecter ses engagements internationaux, mais aussi pour rendre cette justice plus efficace et plus juste.
Notre groupe soutient l’extension de la spécialisation des juridictions pour mineurs. Ces derniers ne sont pas des justiciables comme les autres, et les magistrats en charge doivent donc avoir une connaissance fine et spécifique de ces affaires. La commission des lois a encore accru cette spécialisation en renforçant la compétence du juge des enfants.
Cette spécialisation ne dispense pas du respect des conditions du procès équitable. Nous nous réjouissons que la phase de mise en examen soit supprimée et que la procédure satisfasse maintenant pleinement au principe d’impartialité. C’était indispensable.
Nous nous félicitons aussi que les mineurs entendus dans le cadre de l’audition libre soient désormais accompagnés d’un avocat, comme c’est le cas pour les majeurs.
Les mineurs doivent bénéficier d’une protection renforcée. C’est pourquoi nous soutenons également l’interdiction de principe du recours à la visioconférence pour les audiences concernant leur détention provisoire.
En plus d’une justice équitable, les mineurs ont besoin d’une justice rapide. C’est un point crucial pour l’ensemble des justiciables français, mais il l’est encore plus pour nos jeunes. Nous saluons donc l’objectif de réduction des délais de la justice pénale des mineurs. Il est important que le jugement d’un mineur puisse intervenir rapidement et, si possible, évidemment, avant sa majorité.
Au-delà de l’amélioration de la célérité de la procédure, nous saluons aussi sa simplification. La décomposition en quatre modules de la mesure éducative judiciaire provisoire apporte une utile clarté et permet de prononcer la mesure la plus adaptée possible à la personnalité du mineur.
Se pose néanmoins la question de l’entrée en vigueur de cette réforme nécessaire et attendue. Suivant l’excellent travail de notre rapporteur Agnès Canayer, la commission des lois a reporté la date de son application du 31 mars au 30 septembre 2021. L’objectif de ce report est de permettre aux services de finaliser les préparatifs en vue d’une application de la réforme dans les meilleures conditions possible.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, notre groupe Les Indépendants soutiendra l’adoption de ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, songeons un instant à cette phrase écrite dans le préambule de l’ordonnance du 2 février 1945 : « La France n’est pas assez riche de ses enfants pour en négliger un seul. » Gardons-la à l’esprit alors que nous débattons aujourd’hui de ce projet de réforme. À la lecture de ces mots, il est difficile de douter de la philosophie initiale, claire, qui présidait au texte fondateur de la justice pénale des mineurs.
Au-delà de la sanction, cette justice spécifique vient protéger les mineurs d’eux-mêmes, de leur immaturité et de leur méconnaissance des nombreux pièges et embûches de nos sociétés modernes, des maux contre lesquels leur jeune âge ne les prémunit pas toujours, mais auxquels il tend au contraire plutôt à les exposer.
Il s’agit aussi d’une justice bâtisseuse et non punitive, qui, parce qu’elle prend en charge des personnes naturellement en pleine construction, repose sur le principe fondateur de la primauté de l’éducatif sur le répressif.
Ce projet de réforme par ordonnance, quarantième modification législative en la matière, a été engagé par le Gouvernement en mars 2019. Il se donnait pour objectif de construire « une justice pénale des mineurs plus lisible et efficace ». Cet objectif n’est apparemment pas atteint.
Les syndicats de magistrats et les chefs de juridiction vous avaient alerté, monsieur le garde des sceaux : le délai prévu avant l’entrée en vigueur de la loi, fin mars au mieux, était bien trop court pour permettre la mise en place de la réforme dans de bonnes conditions. Vous vous êtes prononcé en faveur du report du délai d’application au 30 septembre 2021, introduit par la commission des lois. Dont acte !
Ce projet de loi met non seulement l’accent sur le répressif, mais il s’engouffre aussi dans le rapprochement problématique entre la justice des mineurs et celle des majeurs. À cet égard, certaines dispositions nous interpellent.
Nous demandons la suppression de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, qui prévoit une exception à l’excuse de minorité, ainsi que celle de l’article L. 413-1, qui prévoit la retenue par un officier de police judiciaire, pour une durée allant jusqu’à douze heures, d’un mineur âgé de 10 à 13 ans.
Le texte gouvernemental ne prévoit qu’une présomption simple, à savoir que le juge des enfants pourra, à l’issue d’un débat contradictoire, déclarer un mineur de moins de 13 ans responsable s’il a fait preuve de discernement au moment des faits. C’est inacceptable, juridiquement et moralement.
Nous proposons que la présomption d’irresponsabilité s’appliquant à ces enfants soit irréfragable et que le seuil de 14 ans, déjà appliqué dans plusieurs pays européens, soit retenu en France. Ajoutons que la convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU prévoit un seuil d’irresponsabilité pénale, qui n’a jamais été mis en place en France.
Enfin, nous refusons l’application du principe de la surveillance électronique, ou bracelet électronique, au mineur.
Plutôt que d’être coercitive, la justice des mineurs a surtout besoin de moyens.
Ce texte est loin de nous satisfaire. Nous tenterons de l’amender, espérant qu’une bonne réforme de la justice pénale des mineurs soit encore possible. Si nous n’y parvenons pas, nous voterons contre.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945, à laquelle se substitue le code dont nous examinons le projet aujourd’hui, énonçait que « la question de l’enfance coupable est l’une des plus urgentes de l’époque ». Bien sûr, ces mots sont l’expression d’un contexte particulier, que nous avons encore tous à l’esprit. Il me semble toutefois qu’ils conservent leur plein sens aujourd’hui.
À leur lecture m’arrive avec gravité l’image de mon département, marqué depuis plusieurs mois par des attaques de groupes de jeunes armés. Mayotte a de nouveau été ébranlée ce week-end par le meurtre de trois personnes, dont deux enfants âgés de 14 et 16 ans, paroxysme d’affrontements tristement répétés qui concernent des mineurs et qui ne cessent de rappeler l’impérieuse nécessité d’une célérité de la réponse pénale, laquelle motive également la création du présent code.
L’exposé des motifs de l’ordonnance de 1945 affirmait également la gravité des problèmes relatifs à « l’enfance traduite en justice ». Je crois que cette formule donne bien à voir le cœur des débats qui nous réunissent aujourd’hui. Elle peut tout autant renvoyer, dans son sens littéral, à une justice qui s’adapte à l’enfant justiciable en se spécialisant qu’au relèvement et à l’évolution possible de l’enfant dans et par la procédure judiciaire. Cette formule condense bien, finalement, les principaux axes de la réforme, fruit de plus de dix années de travaux et de concertations.
La réaffirmation des grands principes de la justice pénale des mineurs, énoncés en 1945 et consacrés par le Conseil constitutionnel, nous semble bienvenue. Fragilisés par près de quarante réformes successives, qui ont rendu la législation peu lisible, ces principes sont déclinés au sein d’un article et d’un titre préliminaires.
Afin de se conformer aux engagements internationaux, le code introduit en outre utilement une présomption simple de non-discernement au-dessous de 13 ans. Cette disposition permettra que le débat sur le discernement du mineur puisse se tenir effectivement.
Je pense également à la simplification de la procédure par la suppression de la phase d’instruction préalable par le juge des enfants, qui n’était pas limitée dans le temps.
La nouvelle procédure de mise à l’épreuve éducative, au terme de laquelle la césure du procès deviendra le principe, permettra d’accélérer la réponse pénale, dont la durée moyenne – dix-huit mois – est actuellement trop longue. Elle permettra également de renforcer le « sens » de cette réponse pour tous les acteurs en présence. Ce terme, marqueur important de la réforme, n’est pas un vain mot ni une incantation teintée d’idéalisme ou de laxisme. Il constitue au contraire le vecteur des perspectives de réinsertion du mineur, qui saisira mieux la portée de mesures éducatives fondées sur une déclaration de culpabilité et intervenant avant le prononcé d’une sanction. De son côté, la victime sera désormais convoquée dès la première audience, pour qu’il soit statué plus rapidement sur son indemnisation.
Je pense enfin à l’encadrement du recours à la détention provisoire du mineur et à la rationalisation des mesures éducatives, rassemblées en une mesure éducative judiciaire unique qui pourra être prononcée aux différents stades de la procédure.
Ces deux apports marquent bien la nécessité de la réponse pénale et du relèvement éducatif du mineur, qui constituent un défi pour l’ensemble de notre société.
Madame la rapporteure, je veux saluer votre travail et votre approche de ce texte.
Sur le fond, vos propositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit précité et prolongent les travaux entrepris depuis la commission Varinard jusqu’à l’ordonnance présentée le 11 septembre 2019 par Mme Nicole Belloubet.
Vous avez ainsi maintenu la majorité des apports de l’Assemblée nationale, tels que la référence à l’intérêt du mineur dans l’article préliminaire, le renforcement des garanties dans le cadre de l’audition libre, l’interdiction du recours à la visioconférence pour statuer sur le placement en détention provisoire ou encore la simplification du cumul des mesures éducatives et des peines pour garantir leur adaptation. Certaines de ces modifications bienvenues sont également portées par M. le garde des sceaux, ce que je veux également saluer.
Vous avez en outre enrichi le texte, en précisant notamment qu’une date de mise en place des mesures éducatives devrait être communiquée à l’issue de l’audience de culpabilité, ou encore en proposant une définition de la notion de discernement.
Bien sûr, certains points de discussion demeurent. Je pense notamment à la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes ou à celle du juge des libertés et de la détention pour le placement en détention provisoire avant l’audience de culpabilité.
Ces discussions vont se poursuivre ce soir, mais force est de constater que les principaux apports de la réforme, qui ont été largement approuvés par l’autre chambre, sont bien présents dans le texte que nous examinons. Le groupe RDPI, saluant à nouveau l’approche retenue et espérant vivement qu’un accord sera trouvé entre les deux assemblées sur cette réforme attendue, votera ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Mme Maryse Carrère. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaite pour commencer apporter tout le soutien du groupe du RDSE à notre collègue Annick Billon, qui a fait l’objet ces derniers jours d’un traitement absolument injustifié et injustifiable dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Applaudissements.

La tragédie de la petite Évaëlle, qui avait 10 ans lorsqu’elle a mis fin à ses jours après avoir été harcelée par ses camarades, ou le lynchage du jeune Yuriy, qui nous a tous émus ces derniers jours, résonnent en nous au moment de l’examen de ce projet de loi. Ces actes viennent nous rappeler que l’enfance n’est pas toujours synonyme d’insouciance et que les victimes, même si les coupables sont mineurs, ont droit à une réparation. À cette nécessaire réparation font écho nombre d’interrogations sur le chemin que nous voulons pour nos enfants, les sanctions que nous devons apporter à leurs fautes, mais également la manière d’éviter que certains ne récidivent et ne plongent dans la délinquance.
Ces nombreuses questions auraient mérité que nous en débattions plus longuement et plus largement que dans le cadre permis par la législation par ordonnance.
L’ordonnance du 2 février 1945 a longtemps répondu aux interrogations que je partageais à l’instant. Les principes cardinaux qu’elle pose – spécialisation des juridictions, recours a minima à la privation de liberté, atténuation de responsabilité par rapport aux majeurs – ne sauraient être contestés. Toutefois, au gré des réformes, mais aussi de l’évolution de la société, elle devait être modifiée et clarifiée. À ce titre, l’instauration d’une césure, dont l’objectif est de raccourcir les délais entre le prononcé d’une peine et son application, est bienvenue. Combien d’exemples avons-nous de jeunes sanctionnés après leur majorité ? Au mieux, certains sont déjà sortis de la délinquance ; au pire, ils y ont sombré faute de mesures éducatives prises assez tôt. Pour être efficace, ce système de double audience, l’une d’examen de culpabilité, l’autre de sanction, devra s’accompagner de moyens. J’aurai l’occasion d’y revenir.
Je suis en revanche plus partagée sur l’audience unique. Bien qu’elle soit très encadrée, ma crainte est de voir cette procédure, censée être un outil d’exception, se généraliser. Selon la directrice de la PJJ, ce sont près de 20 % des dossiers qui pourraient être traités en audience unique, ce qui viendrait mettre à mal le principe de spécialisation des juridictions.
Pour en venir à la sanction et à la notion de discernement, la fixation d’un seuil s’apparente toujours à un jeu d’équilibriste, tant un même âge peut recouvrir des réalités et une maturité différentes.
La fixation à 13 ans de l’âge de discernement nous permettra de remplir nos obligations à l’égard de la convention internationale des droits de l’enfant. Le fait que les présomptions de discernement comme de non-discernement ne soient pas irréfragables permet d’éviter les effets de seuil et laisse toute latitude au juge de les renverser si la situation l’exige.
S’agissant des sanctions prévues par ce code de la justice pénale des mineurs, je regrette que l’accent soit davantage mis sur la privation de liberté que sur les mesures éducatives. Les centres éducatifs fermés sont une solution, mais ils ne peuvent être l’alpha et l’oméga de la réponse juridique que nous apportons à nos jeunes délinquants. Si beaucoup d’entre eux sont très mobilisés sur les mesures éducatives, ce n’est pas le cas partout, monsieur le garde des sceaux, et il nous faut garder à l’esprit le principe du recours a minima à la privation de liberté.
Pour conclure, je dirai que l’on peut écrire de bonnes lois, mais, si la pratique est défaillante, l’effort sera vain. C’est pourquoi nous sommes favorables à un report de l’entrée en vigueur de ce texte au 30 septembre 2021, comme le propose Mme la rapporteure, ce qui semble beaucoup plus réaliste.
Pour que ce texte soit bien appliqué, il faudra inévitablement davantage de greffiers, de magistrats et, donc, davantage de moyens pour la justice de notre pays. La récente hausse de 8 % du budget global semble aller en ce sens. Toutefois, en ma qualité de rapporteure pour avis du budget de la PJJ, je rappellerai que les budgets consacrés à la formation y sont en baisse, ce qui suscite des interrogations sur la mise en place de la réforme.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, malgré toutes ces réserves, la majorité du groupe du RDSE votera ce texte, tout en gardant un œil très attentif sur sa mise en œuvre à l’avenir.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en reprenant le texte original de l’ordonnance de 1945 pour préparer cette intervention, je lisais, dans le rapport de présentation signé du général de Gaulle, la phrase suivante : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’on en perde un seul. » Il est bon de garder cette inspiration des auteurs de l’ordonnance de 1945 dans une période si difficile.

La situation de la délinquance des mineurs reste inquiétante. En 2018, on a dénombré 9 200 condamnations pour agression, dont 110 homicides ou blessures involontaires, 200 viols, 6 400 coups et violences volontaires. On a enregistré par ailleurs 23 000 condamnations pour atteintes aux biens et 5 600 condamnations pour trafic de stupéfiants.
La part des mineurs dans la délinquance semble pourtant avoir diminué au cours des vingt dernières années, passant de 22 % à 18 % des mis en cause. Elle demeure toutefois à un niveau beaucoup trop élevé, comme les chiffres que je viens de citer en attestent.
Les principes de l’ordonnance de 1945, notamment la primauté de l’éducation sur la répression, demeurent pertinents. Mais la pratique de la justice des mineurs révèle des dysfonctionnements importants ; elle n’est pas à la hauteur des ambitions de 1945.
Certes, au fil des années, de nouveaux outils ont fait la preuve de leur efficacité. C’est le cas par exemple des centres éducatifs fermés, créés par le Président Jacques Chirac et son garde des sceaux de l’époque, Dominique Perben, qui sont un réel succès : seuls 10 % des mineurs qui y sont affectés sont finalement incarcérés, ce qui veut dire que 90 % des autres sont remis, cahin-caha, sur un meilleur chemin.
Cependant, l’insuffisance des places d’accueil est réelle. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu l’ouverture de vingt centres, la Chancellerie a engagé un travail important pour permettre leur construction… Malheureusement, seuls quatre d’entre eux ouvriront d’ici à la fin du quinquennat.
Les travaux d’intérêt général sont également un instrument qui n’existait pas en 1945. Ils ont été introduits dans notre droit en 1983, se sont développés seulement au cours des années 1990 et ont été réformés en 2014. Ils n’apportent toutefois pas les résultats escomptés.
En 2019, 4 300 travaux d’intérêt général ont été prononcés, mais 3 200 seulement ont fait l’objet d’un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Actuellement, un jeune doit attendre treize mois lorsqu’il est orienté vers un travail d’intérêt général. C’est beaucoup trop long !

Tous gouvernements confondus, nous ne nous sommes pas donné jusqu’à présent les moyens de nos ambitions.
Les jugements sont tardifs en cas de poursuites. Savez-vous, mes chers collègues, qu’il faut en moyenne dix-neuf mois pour qu’une condamnation soit prononcée ? Comme les mineurs délinquants ont souvent entre 16 et 18 ans, il arrive fréquemment que les condamnations soient prononcées quand les auteurs sont devenus majeurs.
Certains sont sortis de la délinquance depuis longtemps quand ils doivent purger leur peine, d’autres au contraire ont eu le temps de commettre de nombreuses récidives sans avoir été arrêtés par la moindre sanction, les derniers enfin font l’école de la délinquance dans des détentions provisoires qui portent mal leur nom, puisqu’elles deviennent interminables. Ces détentions provisoires ont augmenté de 40 % entre 2015 et 2019, ce qui donne une idée de la gravité de la situation et du scandale de la situation de la justice des mineurs dans la période actuelle.
Révisée trente-neuf fois, l’ordonnance de 1945 est par ailleurs devenue inaccessible aux magistrats et aux avocats – sauf aux meilleurs d’entre eux, monsieur le garde des sceaux, bien entendu
Sourires.

Convenons tout d’abord, mes chers collègues, que notre valeur ajoutée en matière de codification n’est pas aussi grande que nous pourrions l’espérer. Il faut le reconnaître : le travail de codification est tout destiné aux ordonnances. Si nous nous sommes opposés à celles-ci, c’est parce que, au-delà de la nécessaire codification, nous avions à réformer le régime de la justice des mineurs, ce qu’a fait d’ailleurs l’ordonnance qui nous est soumise.
Cette réforme des règles de la justice des mineurs est, me semble-t-il, présentée à la représentation nationale dans le respect des principes de 1945 et avec des innovations que nous pourrons approuver moyennant l’adoption des amendements qui ont été approuvés par la commission des lois, sur la proposition de notre excellente rapporteure. Ce sont des choix politiques essentiels, que l’on peut approuver ou rejeter, mais dont la représentation nationale doit délibérer. C’est pourquoi nous étions opposés à l’habilitation.
Nous sommes d’accord avec le principe de la césure, qui permettra d’avoir un jugement sur la culpabilité dans le respect – je l’espère – du délai de trois mois inscrit dans le texte.
Nous sommes d’accord sur la mise à l’épreuve éducative dans un délai de six à neuf mois et sur le fait que le jugement de sanction, quand il est nécessaire, intervienne au plus tard neuf mois après le début de la procédure.
Nous sommes d’accord avec la simplification des sanctions autour de l’insertion, de la réparation, de la santé du mineur et, en dernier recours, du placement.
Nous sommes d’accord avec la simplification de l’organisation, renforçant le rôle du juge des enfants.
Nous ne pouvons également qu’être d’accord avec la prévention de la détention provisoire, qui ne doit être décidée qu’en cas de violations répétées ou d’une particulière gravité des obligations mises à la charge du mineur.
Notre commission des lois a cependant souhaité trois types d’améliorations, qui ont été parfaitement présentées par notre rapporteure : la précision de la notion de discernement du mineur, qui ne se réduit pas à la constatation de son âge ; la spécialisation des acteurs, en renforçant encore le rôle du juge des enfants – c’est à lui, et à nul autre, de prononcer la détention provisoire avant l’audience de culpabilité – ; la prolongation du délai, car nous considérons, monsieur le garde des sceaux, que vous aurez trop de mal à tenir le délai que vous vous êtes vous-même assigné.
La commission des lois vous a proposé d’allonger le délai, et je constate que vous êtes d’accord sur le principe de prendre un peu plus de temps. En effet, dans la période que nous venons de vivre, de nombreuses instances n’ont pas été traitées. Par ailleurs, vous avez des problèmes matériels, de procédures et informatiques, à résoudre. Je vois bien qu’un effort est fait pour recruter des magistrats, des greffiers, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais tout cela ne peut pas donner son plein effet en quelques semaines. Si la réforme est mise en œuvre alors que les conditions matérielles de son application ne sont pas réunies, elle risque fort d’échouer. C’est la raison pour laquelle notre commission a insisté sur la nécessité de se donner un peu de marge.
Voilà, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire en apportant le soutien de mon groupe au travail accompli par la commission des lois pour améliorer une réforme dont les principes nous paraissent conformes à ce que nous pouvons attendre de la justice des mineurs.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs est ratifiée.

L’article L. 311-2 du nouveau code de la justice pénale des mineurs prévoit l’accompagnement des mineurs aux auditions et interrogatoires. Ceux-ci doivent toujours être accompagnés par un adulte au cours d’une procédure afin de leur permettre de recevoir toutes les informations nécessaires sur les décisions les concernant. Lorsque le mineur ne peut être accompagné par ses représentants légaux, ce qui est en grande majorité le cas pour les mineurs isolés étrangers, le procureur de la République ou le juge des enfants devrait désigner un adulte approprié afin d’assister l’enfant dans ses nombreuses auditions.
Je souhaiterais, mes chers collègues, appeler votre attention sur les difficultés que rencontrent les magistrats pour désigner cet adulte approprié. Ni les administrateurs ad hoc, ni les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ni les avocats n’acceptent de tenir ce rôle, qui ne leur paraît pas compatible avec leurs fonctions. Les mineurs se retrouvent ainsi privés du droit d’être accompagnés, et rassurés, par un adulte lors des audiences.
Aujourd’hui stigmatisés, les mineurs isolés ont subi pendant leur parcours migratoire de nombreux traumatismes et sont très souvent les victimes de réseaux et du trafic d’êtres humains. Ils devraient, à ce titre, être davantage protégés. Une clarification sur la qualité de l’adulte approprié nous semble donc nécessaire dans le nouveau code, afin de préserver l’accès de ces mineurs à leurs droits. Cette demande va dans le sens du rapport du député Jean Terlier sur la ratification de l’ordonnance sur la justice des mineurs.

L’amendement n° 3, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Nous ne sommes pas favorables au recours aux ordonnances, à plus forte raison sur un sujet de cette ampleur. Cela prive le Parlement d’un véritable débat de fond sur un pan essentiel de notre droit, celui qui sera applicable demain aux mineurs de notre pays. Nous avons eu en outre toutes les difficultés, ici comme à l’Assemblée nationale, à dégager des parties de l’ordonnance pour les amender.
Nous ne sommes pas les seuls à être privés de ce débat puisque, comme je l’ai dit dans la discussion générale, l’ensemble des professionnels de la justice des mineurs en ont, eux aussi, été privés. Ces derniers le rappelaient dans une tribune au Monde en décembre dernier : l’enjeu était non pas de modifier la loi, mais plutôt de la faire appliquer.
Le recours à l’ordonnance permet de prendre des décisions rapidement, mais, je le répète, cela nous prive d’un débat. Certes, j’entends vos arguments, monsieur le garde des sceaux – vous les aviez déjà avancés lors de votre audition et vous les avez repris dans votre intervention liminaire – : cela fait maintenant plusieurs années que le texte est en débat. Mais entre un texte attendu de tous qui ne fait pas l’objet d’un débat et un texte qui ferait l’objet d’une réelle concertation pour engager véritablement la réforme de l’ordonnance de 1945, qui nécessitait d’être retravaillée, il y a un large fossé ! C’est ce que nous dénonçons ce soir.

Ainsi que je l’ai dit précédemment, nous regrettons comme vous, madame Cukierman, d’avoir à travailler sur un code de la justice pénale des mineurs et non pas sur un code de l’enfance. Comme vous également, nous regrettons que ce soit une loi de ratification qui nous soit soumise ce soir, car cela veut dire que le travail parlementaire a été court-circuité.
Maintenant la loi de ratification est là. Nous pourrions certes défendre une position jusqu’au-boutiste et nous y opposer, mais, au fond, nous pensons vraiment, comme nous l’avons dit, que ce projet de loi est un bon texte. Les avancées qu’il contient permettront à la justice pénale de répondre plus vite à la problématique des mineurs délinquants, qui, aujourd’hui, faute de réponse rapide, sont entraînés dans une spirale de la délinquance.
Je le répète, nous pensons que c’est un bon texte et que, grâce aux améliorations apportées par le débat parlementaire, ce projet de loi peut devenir un très bon texte. C’est la raison pour laquelle notre avis est défavorable.
Je me suis déjà longuement expliqué sur ce point. Sans surprise, le Gouvernement est défavorable à l’amendement que vous avez présenté, madame la sénatrice.

Nous ne voterons pas cet amendement, parce que nous pensons que le débat est nécessaire. Cela ne signifie pas que, pour nous, ce soit un bon ou un très bon texte, au contraire ! Nous estimons que le débat peut apporter un certain nombre de clarifications.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un enfant ou un adolescent s’entend de tout être humain, âgé de moins de dix-huit ans. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Au-delà de la symbolique – cet amendement fait également suite à votre réponse à l’Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux –, nous voulons choisir le terme le plus adapté. Nous préférons donc celui d’enfant à celui de mineur.
Nous ne souhaitons pas tout réécrire, mais rappeler, par notre définition, qu’une personne de moins de 18 ans est un enfant à part entière. Nous pensons que le choix des mots est important : un mineur n’est pas une sorte de mini-majeur, mais d’abord un enfant auquel sont attachés des droits particuliers et qui doit donc faire l’objet d’une protection particulière. C’est d’ailleurs le sens de nombreux textes fondateurs qui consacrent les droits de l’enfant.
Tout enfant en conflit avec la loi est un enfant en danger. La justice pénale des mineurs ne devrait être considérée que comme une modalité de la protection de l’enfance. Tel est le sens de cet amendement.

Nous adhérons à l’idée que la justice pénale des mineurs doit être une justice humaine. Néanmoins, la notion de minorité, et en creux celle de la majorité à l’âge de 18 ans, est clairement définie à l’article 388 du code civil. Ajouter une définition différente viendrait complexifier les choses et serait redondant. Nous demandons donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Madame la sénatrice, nous écrivons la loi. Nous savons ce qu’est un mineur ; en revanche, il n’y a pas de définition précise, juridique, des termes « enfant » et « adolescent ». Vous préférez ces deux derniers termes ; quant à nous, nous préférons celui de « mineur », qui est plus clair. L’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
À la fin de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ».

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 49 est présenté par M. Sueur, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer la date :
30 septembre 2021
par la date :
31 mars 2022
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 5.

Je ne vais pas allonger le débat, car j’ai déjà évoqué la question du délai dans la discussion générale.
Monsieur le garde des sceaux, les parlementaires ne sont pas les seuls à vous le dire : l’ensemble du système judiciaire – vous le savez mieux que nous – se dit aujourd’hui dans l’incapacité de mettre en œuvre concrètement la réforme le 31 mars prochain. Mme la rapporteure a proposé de la reporter de six mois. Nous nous en contenterons comme solution de repli, mais nous pensons qu’un report d’un an ne serait pas de trop, ne serait-ce que pour éviter – parce que nous sommes dans une situation particulière – la superposition d’instructions version « ordonnance de 1945 » et version « texte dont nous débattons ».
Rappelons que l’année 2020 a été marquée par l’engorgement de nombreuses juridictions, en raison notamment d’un début de l’année ralenti par la mobilisation d’un nombre non négligeable d’avocats dénonçant la réforme des retraites, puis par le confinement et les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons. Nous pensons donc qu’un délai d’un an permettrait a minima un premier désengorgement, avant un retour à la normale, même si toute réforme doit être mise en œuvre à une certaine date et qu’il existe toujours un temps de chevauchement entre un ancien système et un nouveau système.
Pour une plus grande clarté de la justice des mineurs qui sera rendue demain, nous estimons nécessaire – j’y insiste – de prévoir un délai supplémentaire.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 49.

C’est parce que nous voulons que la réforme réussisse, même si nous avons des critiques, parfois lourdes, sur le texte qui nous est présenté, que nous demandons, comme l’a fait Mme Cukierman, que l’application du texte soit reportée d’un an.
Mme Maryse Carrère, que nous avons écoutée avec attention précédemment, écrivait dans son avis relatif à la protection judiciaire de la jeunesse, établi au nom de la commission des lois, sur la loi de finances pour 2021 : « La commission des lois avait constaté […] que tant les juridictions pour mineurs que les services de la protection judiciaire de la jeunesse ne seraient pas prêts à mettre en œuvre la réforme à la date initialement prévue. Les développements informatiques ont également pris du retard, de même que le travail de formation des personnels qui doit précéder l’application de la réforme. […] Le risque d’une mise en œuvre plus formelle que pratique de la réforme et d’importants temps de transition au cours de l’année 2021 paraît donc réel. » Je cite simplement le rapport de notre collègue, qui a été adopté par l’ensemble de la commission.
J’ajoute, monsieur le garde des sceaux, que nous avons reçu les représentants des magistrats, des avocats, des éducateurs spécialisés, des SPIP et de la PJJ : ils nous disent tous qu’il faut du temps pour mettre en œuvre cette réforme.
Nous voyons ce qui se passe : le recours à l’ordonnance, la procédure accélérée – plus aucun texte, mis à part celui sur la bioéthique, n’a droit à la procédure normale, qui devrait pourtant être en vigueur pour un texte comme celui-là –, la précipitation avec laquelle les textes d’application sont parus avant même le vote du projet de loi… Si nous défendons cet amendement, ce n’est pas du tout contre la réforme : c’est pour que celle-ci soit efficace.

Nous avons émis des réserves sur une entrée en vigueur de la réforme le 31 mars prochain. C’est pourquoi nous l’avons reportée de six mois. Prévoir un report d’un an ne servirait pas la réforme : au contraire, cela démobiliserait les acteurs, ce qui n’est pas le but. L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.
Madame la sénatrice Cukierman, vous avez essayé de supprimer l’article. N’y étant pas parvenue, vous essayez le dilatoire…
J’ai déjà dit dans mon discours liminaire que je n’étais pas insensible au délai envisagé par la commission des lois, mais, à la vérité, pour des raisons différentes. Je vais m’expliquer une fois pour toutes sur cette question, ce qui me permettra également de vous répondre, monsieur le sénateur Sueur.
Vous ne pensez tout de même pas que nous avons préparé cette réforme dans le but qu’elle ne fonctionne pas. Accordez-nous au moins cela au nom d’un minimum de cohérence !
Je veux également dire ici que c’est non pas la DACG (direction des affaires criminelles et des grâces) qui porte ce texte, mais la DPJJ, qui est composée de professionnels de la justice pour mineurs impliqués, comme ils le démontrent chaque jour – qu’il me soit permis de leur rendre ici hommage.
Nous avons fait expertiser par les services – l’inspection générale de la justice –, à ma demande, le niveau de préparation des juridictions pour mettre en œuvre cette réforme, dont on peut s’accorder à dire que c’est une bonne réforme. Les services nous ont répondu que dix juridictions connaissaient des fragilités. Nous les avons traitées. Je ne vais pas répéter ici quels moyens humains nous avons déployés pour régler ces questions, mais nous l’avons fait.
J’avais la certitude que cette réforme pourrait entrer en application à la date que nous avions envisagée. Seulement, voilà, la réalité, c’est que le texte a été, comme vous le savez, modifié pour faire intervenir le JLD. J’ai consenti à cela pour des raisons qui tiennent à l’impartialité. Nous avons eu cette discussion devant la Haute Assemblée, et j’y reviendrai le moment venu. Nous nous sommes rendu compte le 15 janvier dernier, et pas avant, qu’il y aurait une difficulté dans les applicatifs, en raison de « l’intrusion » – pardonnez-moi ce terme – du JLD dans la procédure.
J’ai déjà eu l’honneur de le dire à Mme la rapporteure : effectivement, nous faisons une concession en reportant la date, et ce n’est pas, comme vous le dites, madame Cukierman, en raison de l’impréparation des juridictions. M. Sueur a évoqué les représentants des magistrats ; un certain nombre de magistrats m’ont dit qu’ils étaient parfaitement prêts. Je le répète, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse m’a dit la même chose. J’ai tendance à croire mes services !
En revanche, s’agissant de cette difficulté inhérente à l’introduction du JLD dans la procédure, nous nous sommes retrouvés confrontés à une réalité. J’ai dit et redit dans mon discours que nous étions d’accord pour un report, mais pour un report qui ne nous amène pas aux calendes grecques. Il faut que la réforme prenne corps et qu’elle soit applicable.
Nous sommes en train de régler la question du JLD, et je retiens la date qui a été proposée comme tout à fait réaliste. Voilà pour quelles raisons je suis totalement défavorable aux deux amendements qui ont été présentés.

Monsieur le garde des sceaux, nous allons passer au minimum deux soirées à débattre de ce projet de loi. Pour éviter une certaine méconnaissance l’un de l’autre, je préfère tout de suite vous prévenir : je ne suis pas marchande de tapis, mais sénatrice. Je ne cherche pas à faire passer un amendement à un article parce que je n’aurais pas eu satisfaction à l’article précédent. J’ai un engagement politique et je suis constante – c’est cela la démocratie !
Je l’ai déjà dit, notre groupe est opposé, pas plus sur votre texte que sur un autre, au recours aux ordonnances, qui est de plus en plus systématique, non seulement par votre gouvernement, mais aussi par tous les gouvernements successifs, d’où notre amendement de suppression de l’article 1er.
Si nous proposons, avec l’amendement n° 5, un report de la réforme, ce n’est pas parce que nous n’avons pas eu satisfaction précédemment. Être élu, c’est représenter. Quand un projet de loi comme celui dont nous discutons aujourd’hui arrive avec toute l’ambition qui lui est donnée, les uns et les autres, nous auditionnons, rencontrons, échangeons, téléphonons, recevons des courriers… Pour défendre nos projets de société, qui ne sont pas les mêmes que les vôtres – il en va ainsi en démocratie –, nous nous appuyons sur tel ou tel organisme, collectif d’associations, groupement professionnel, organisation syndicale, etc. Nous ne nous appuyons évidemment pas toutes et tous sur les mêmes.
Vous savez tout aussi bien que moi, et même mieux, qu’il y a aujourd’hui un débat chez un certain nombre de professionnels de la justice quant à la faisabilité de l’application de la réforme. Par ailleurs, nous savons – en tant que parlementaires, nous n’avons pas découvert la problématique de la justice ce matin – qu’il y a des retards, notamment dans le domaine informatique, et des engorgements. Je ne jette la pierre à personne, l’année 2020 a été ce qu’elle a été. Il y a eu aussi, pendant des années, des retards en termes de personnels et de moyens, ce qui a alourdi les procédures, qui prennent aujourd’hui plus de temps que nécessaire.
Je le redis, si nous avons déposé cet amendement, ce n’est pas parce que nous n’avons pas eu satisfaction sur le précédent. Même si vous refusez celui-ci, nous en avons encore une vingtaine dont nous débattrons pour continuer le débat, car le texte le mérite.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 1 er bis A est adopté.
(Non modifié)
À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « compte », sont insérés les mots : «, dans leur intérêt supérieur, ». –
Adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Harribey, MM. Sueur et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Bourgi, Marie, Leconte, Kerrouche, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « rechercher leur relèvement éducatif et moral » sont remplacés par les mots : « garantir le droit à l’éducation ».
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Le principe fondamental de l’ordonnance de 1945 – la primauté de l’éducatif – est réaffirmé dans ce texte. Reste qu’il est surprenant d’y maintenir l’expression « rechercher leur relèvement éducatif et moral ».
On fait le reproche à l’ordonnance de 1945 d’être quelque peu obsolète – le mot « admonestation », par exemple, a été remplacé par « avertissement solennel ». Or le terme « relèvement » renvoie à une conception du redressement qui est, elle aussi, quelque peu obsolète. C’est la raison pour laquelle nous proposons cette modification rédactionnelle.

L’amendement n° 63 rectifié, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures » sont remplacés par les mots : « recourir prioritairement à des mesures éducatives ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Selon des études scientifiques, la délinquance juvénile n’a pas augmenté depuis quinze ans. Pourtant, le nombre d’enfants privés de liberté n’a jamais été aussi élevé en France que depuis ces deux dernières années.
Plutôt que d’être révisée dans un sens plus coercitif, la justice des mineurs mériterait surtout, au-delà de moyens supplémentaires, de revenir à son sens initial : une justice spécifique qui comprend et traite des situations particulières de délinquance juvénile plutôt que de chercher systématiquement à réprimer.
Le présent amendement vise ainsi à consacrer dans l’article préliminaire la primauté du recours aux mesures éducatives. La rédaction actuelle de cet article n’est pas suffisamment explicite à ce sujet. L’ordonnance de 1945 ne doit pas être réformée sans retour à une philosophie bienveillante, comme l’ont affirmé une cinquantaine de spécialistes dans une tribune parue dans Le Monde le 12 février 2019.
Voilà pourquoi il nous paraît primordial que la primauté des mesures éducatives soit inscrite dans cet article préliminaire.

On pourrait penser que la formule « relèvement éducatif et moral » est un peu désuète. Je pense, au contraire, qu’elle est porteuse d’avenir. Le jeune qui est un mineur délinquant a toute la vie devant lui. C’est pourquoi on lui fixe des objectifs : apprendre les règles individuelles et collectives de la vie en société, ce à quoi renvoie cette notion, peut-être ancienne mais toujours utile, de relèvement moral.
« Garantir le droit à l’éducation » me paraît quelque peu réducteur. Certes, la notion de droit à l’éducation est consacrée dans les conventions internationales, mais elle concerne avant tout l’enseignement. L’objectif d’une justice pénale des mineurs et de l’accompagnement éducatif des jeunes est plutôt de leur donner, au-delà de l’éducation, la capacité d’intégration et de respect des règles de la vie en société. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 24 rectifié.
Avec votre amendement n° 63 rectifié, il me semble, madame Benbassa, que vous confondez les moyens et le but. Le relèvement éducatif et moral, c’est le but, ce vers quoi il faut tendre pour une justice pénale des mineurs adaptée ; les mesures éducatives, ce sont les moyens pour atteindre ce but. L’avis est donc également défavorable.
Même avis que ceux exprimés par Mme la rapporteure, pour les mêmes raisons.
« Garantir le droit à l’éducation » est une expression redondante, car ce droit est déjà garanti aux enfants.
On peut considérer que la formule « relèvement éducatif et moral » est un peu obsolète, mais c’est le but des mesures éducatives et parfois des mesures punitives. Quand un gamin est délinquant, cela signifie qu’il y a un certain nombre de failles auxquelles il est de notre devoir de remédier.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le parquet, eu égard aux faits et à la personnalité du jeune, prend les mesures d’assistance éducative qui s’imposent ou s’assure auprès des autorités territoriales qu’un suivi social est mis en place. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Cet amendement vise à s’inscrire pleinement dans l’esprit, la lettre et le fond de l’article 40 de la convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire, qui déjudiciarise autant que faire se peut les réponses apportées à l’enfant en conflit avec la loi.
On le sait, la convention internationale des droits de l’enfant exige que les États adoptent un seuil d’âge en dessous duquel un enfant ne peut pas être tenu pour délinquant. Jusqu’ici, le droit français ne s’est pas engagé dans cette voie ; de ce fait, on renvoie aux grands principes du droit pénal, selon lesquels, pour que la responsabilité d’un enfant soit engagée, celui-ci doit jouir du discernement au moment des faits, ce qui était habituellement estimé à 7 ou 8 ans ; un enfant de cet âge-là peut donc se voir imputer une infraction.
Selon l’ordonnance du 19 septembre 2019, un enfant ne peut pas, avant 13 ans, être tenu pour délinquant, faute de jouir de son discernement – c’est un changement réel –, mais cette ordonnance ouvre la possibilité, pour le parquet, d’apporter la preuve contraire, sous le contrôle du juge. C’est un point important de désaccord entre nous, par rapport au texte qui nous est proposé.
Cette disposition introduit indéniablement une avancée, puisqu’il reviendra au parquet de tenter d’apporter cette preuve alors que, aujourd’hui, la question n’est qu’exceptionnellement posée ; pour autant, il ne s’agit que d’une présomption relative. Par conséquent, la France ne répond toujours pas aux attentes du comité des experts de l’ONU, non plus qu’aux termes ni à l’esprit de la convention internationale des droits de l’enfant.
Je pense que nous aurons l’occasion de revenir, à la faveur d’autres amendements, sur ce point central pour nous.

La primauté de l’éducatif sur le répressif est un principe fondamental, cardinal, de la justice pénale des mineurs. L’inscrire dans les premiers articles du code serait redondant ; nous n’en voyons donc pas l’utilité.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Harribey, M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Marie, Leconte, Kerrouche, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « relèvement éducatif et moral » sont remplacés par les mots : « garantir le droit à l’éducation ».
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Dans la mesure où mon amendement précédent n’a pas été adopté, celui-ci n’a plus d’objet. En conséquence, je le retire.
L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée. »

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 62 rectifié, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :
« Les mineurs de moins de quatorze ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. Ils ne peuvent faire l’objet que de mesures d’assistance éducative. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 14 ans.
Dans sa rédaction actuelle, le code de la justice pénale des mineurs pose le principe d’une présomption simple de non-discernement pour les enfants de moins de 13 ans, que le magistrat peut facilement écarter. Or, avec une telle rédaction, la France demeure en contradiction avec la convention internationale des droits de l’enfant, qui recommande aux États de fixer un seuil clair d’accessibilité à la sanction pénale. Il convient de tenir compte de la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle de l’enfant, dont la personnalité est en construction.
Ainsi, au travers de cet amendement, nous proposons de retenir le seuil de 14 ans, déjà appliqué dans plusieurs pays européens, comme l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie.

L’amendement n° 6, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Cet amendement va dans le même sens.
Nous proposons de remplacer la présomption simple, selon laquelle l’enfant de moins de 13 ans ne dispose pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée, par une présomption irréfragable. Cette disposition répond à une exigence essentielle à nos yeux : le droit pénal des mineurs doit respecter le principe selon lequel chacun a le droit de bénéficier d’un procès équitable.
Pour exercer ce droit, l’enfant doit avoir pleinement la capacité de participer à son procès ; cette compréhension constitue un aspect fondamental du discernement. Cela a d’ailleurs été rappelé, en 2018, par Jacques Toubon, alors Défenseur des droits ; ce dernier expliquait que, « pour que l’enfant bénéficie d’un procès équitable, il doit avoir pleinement la capacité de participer à son procès, il doit comprendre pourquoi il est là, les sanctions pénales susceptibles d’être prononcées contre lui, mais aussi les mécanismes des recours judiciaires ». Or, au-dessous d’un certain âge, un enfant, s’il peut avoir compris et même voulu son acte, peut en revanche difficilement comprendre la procédure pénale dans laquelle il se trouve impliqué.
En outre, l’actuelle Défenseure des droits, Claire Hédon, souligne que la responsabilité pénale continue de reposer sur la notion de discernement sans que celle-ci soit pour autant définie. Cela implique que des enfants de moins de 13 ans pourront toujours faire l’objet d’une procédure pénale. Ainsi, il n’y aura pas de réel changement par rapport au régime applicable aujourd’hui ; des enfants de 7 ou 8 ans pourront encore, comme cela existe actuellement, faire l’objet de poursuites pénales.
Pis – cela est rappelé par de nombreux acteurs –, cette notion de discernement laisse place à une grande diversité de pratiques selon les magistrats et rompt donc le principe d’égalité devant la loi et devant la justice. Bien que Mme la rapporteure ait tenté, en commission, de définir cette notion, celle-ci demeure encore assez floue à nos yeux, alors que son appréhension est centrale pour définir la culpabilité d’un mineur. Les voies de recours contre une telle appréciation ne sont pas précisées.

L’amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- La première phrase du second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « Les mineurs de moins de treize ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

L’amendement que je présente va dans le même sens que les précédents.
Selon la convention internationale des droits de l’enfant, chaque État partie doit fixer « un âge minimum au-dessous duquel » un mineur ne peut être poursuivi pénalement. Or la rédaction actuelle de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, résultant de l’ordonnance du 11 septembre 2019, ne permet pas de répondre à cette exigence, dans la mesure où, pour les enfants de moins de 13 ans, la présomption d’irresponsabilité pénale est simple et non pas irréfragable.
Le Comité des droits de l’enfant, à Genève, a été très clair à ce sujet ; il s’est exprimé à de nombreuses reprises. Il indique que, pour ces enfants, il ne peut pas y avoir de poursuites pénales, il ne peut y avoir que des mesures éducatives. Or ces mesures, tout le monde en conviendra, ne sont pas purement cosmétiques, elles sont très réelles, très fortes, et l’objectif du texte est de leur donner le primat.
Par ailleurs, prévoir l’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 13 ans ne signifie pas une absence de réponse.
Enfin, pour ce qui concerne les jeunes de plus de 13 ans, la responsabilité pénale doit être présumée mais liée à la capacité de discernement, qu’il appartient au magistrat de déterminer.
Les choses me semblent donc très claires quant à notre point de désaccord sur ce sujet.

L’amendement n° 51 rectifié ter, présenté par Mmes V. Boyer, Deroche et Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec et Panunzi, Mme Dumas, M. Bascher, Mme Garnier, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac et MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier et Boré, est ainsi libellé :
Au début
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, les mots : « d’au moins treize » sont remplacés par les mots : « de treize à seize » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs de seize à dix-huit ans sont pénalement responsables. »
…. – Au premier alinéa de l’article 122-8 du code pénal, les mots : « capables de discernement » sont remplacés par les mots : « âgés de dix à seize ans capables de discernement et ceux âgés de seize à dix-huit ans ».
La parole est à Mme Valérie Boyer.

Cet amendement vise à répondre en partie aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, en particulier celles qui sont liées aux mineurs ultraviolents et à ce que le ministre de l’intérieur appelle « l’ensauvagement de la société ». Ces termes ont peut-être été contestés lorsqu’ils ont été prononcés, mais, malheureusement, du fait de l’actualité, ils sont aujourd’hui partagés par tous.
Je veux rappeler une affaire sordide et particulièrement triste : les mineurs qui ont frappé Marin – ce courageux jeune qui était venu au secours d’un couple s’embrassant et qui a été tabassé jusqu’à être handicapé à vie – avaient été interpellés dix-huit fois, si ma mémoire est bonne, monsieur le garde des sceaux.
Cet amendement tend donc à instaurer un âge minimal de responsabilité pénale des mineurs à 16 ans, tout en conservant l’exigence morale du discernement en deçà de cet âge.
L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, relatif à la responsabilité pénale des mineurs, prévoit une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans et une présomption d’irresponsabilité en deçà, afin de rapprocher le droit français des règles de droit international, notamment de la convention internationale des droits de l’enfant, laquelle exige un « un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».
Ainsi, dans le respect de ces fondamentaux, je vous propose de compléter ce dispositif en rendant responsables les mineurs de 16 à 18 ans, tout en maintenant une présomption de responsabilité pour les mineurs de 13 à 16 ans.

L’amendement n° 52 rectifié ter, présenté par Mmes V. Boyer, Deroche et Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec et Panunzi, Mme Dumas, MM. Bascher et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac et MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier et Boré, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, les mots : « d’au moins treize » sont remplacés par les mots : « de treize à seize » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans sont capables de discernement et pénalement responsables. »
La parole est à Mme Valérie Boyer.

Ces amendements en discussion commune posent plusieurs questions.
La première est celle de l’âge pivot. J’ai eu l’occasion de le dire dans la discussion générale, il n’y a pas de consensus à ce sujet. Si l’on considère l’ensemble des pays de l’Union européenne, on constate que certains ont choisi 8 ans quand d’autres vont jusqu’à 18 ans. Même parmi ceux que nous avons entendus en audition, l’âge proposé varie.
Dans le droit positif français, l’âge de 13 ans est reconnu, et ce seuil nous paraît bon ; il semble correspondre à l’état de développement des enfants. Nous sommes donc favorables plutôt à l’âge de 13 ans qu’à celui de 14 ans.
En ce qui concerne la présomption irréfragable de non-discernement ou l’irresponsabilité pénale, c’est le même raisonnement. Nous considérons que le dispositif de la présomption simple, tel qu’il figure aujourd’hui dans le texte, permet de faire confiance au juge. Dans le cadre de la justice pénale des mineurs, il nous paraît important que les juges des enfants, qui sont des juges spécialisés et qui connaissent bien – c’est un principe de base – le développement des enfants, puissent adapter la réponse pénale en fonction du développement de l’enfant.
La présomption simple de non-discernement avant 13 ans et de discernement après cet âge permet de faire glisser la réponse pénale en fonction des situations. Il ne faut pas légiférer par rapport à des situations précises, et le droit ne doit pas répondre à telle ou telle situation, mais certaines situations permettent d’expliquer, d’éclairer nos débats. Ainsi, si l’on considère l’affaire de la jeune Évaëlle, on voit bien que les auteurs avaient moins de 13 ans et que la question du discernement se pose très clairement pour eux.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 62 rectifié et 6. Elle a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 50 rectifié, qui concerne l’irresponsabilité pénale, car ses effets sont les mêmes que pour la présomption irréfragable de non-discernement.
En ce qui concerne l’amendement n° 51 rectifié ter de Mme Boyer, je ne suis pas sûre que la création de trois seuils simplifierait les choses et apporterait véritablement une solution, notamment pour la responsabilité pleine et entière de 16 à 18 ans, même quand il s’agit d’un groupe important de jeunes mineurs délinquants, souvent enfermés dans cette spirale. Aujourd’hui, le juge peut renverser l’excuse de minorité, et, là encore, je pense qu’il faut lui faire confiance. Ce n’est pas la peine de complexifier les choses en créant des strates supplémentaires.
La commission a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement de repli n° 52 rectifié ter.
C’est le même avis.
Tout d’abord, le mineur de 13 ans ne peut pas faire l’objet d’une mesure coercitive. Il faut le rappeler, pour qu’il n’y ait pas de confusion.
Ensuite, nous partons du principe qu’il faut faire confiance au juge des enfants, qui fait face à des gamins de 12 ans ayant davantage de discernement que certains gamins de 14 ans.
Nous souhaitons également qu’il y ait une réponse judiciaire adaptée à l’âge mais encore au discernement du mineur.
Je pense avoir tout dit, et je me joins aux explications de Mme la rapporteure. J’ajoute toutefois que, dans quelques instants, le Gouvernement proposera un amendement visant à mieux définir le discernement, afin de donner un certain nombre d’assurances, car la loi pénale doit être strictement encadrée. Vous le verrez, nous nous servirons de la définition proposée par la Cour de cassation.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les amendements n° 51 rectifié ter et 52 rectifié ter sont retirés.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 27, présenté par M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Marie, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les mineurs sont capables de discernement lorsqu’ils ont voulu et compris l’acte. »
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Il s’agit de définir le discernement ; j’en ai parlé dans de mon propos lors de la discussion générale.
Selon nous, le mineur est capable de discernement lorsqu’il a voulu et compris l’acte qu’il a commis. Nous reprenons ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation, à savoir l’arrêt Laboube de 1956, qui a été confirmé plusieurs fois.
Nous irions même plus loin ; selon nous, les mineurs devraient également être en mesure de comprendre la procédure applicable et ses enjeux.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 71 rectifié est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° 75 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée
par les mots :
qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 71 rectifié.

La rapporteure a utilement introduit dans le texte une définition du discernement ayant vocation à figurer dans le code de la justice pénale des mineurs. Cette définition procède d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, remontant à 1956. Elle repose sur la compréhension qu’a le mineur de son acte, mais également sur sa volonté de commettre celui-ci. Afin de ne pas affaiblir, dans la définition qui sera inscrite dans la loi, la portée de cette jurisprudence, le présent amendement vise à y intégrer une référence expresse à la volonté du mineur et à sa compréhension de la procédure pénale.
Mon amendement n° 70, qui viendra ultérieurement, est un amendement de repli, que l’on peut considérer comme défendu.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 75.
Le Gouvernement présente cet amendement, identique à celui de M. Thani Mohamed Soilihi, de précision sur la notion de discernement ; je l’ai évoqué précédemment.
Nous avons choisi de recopier servilement – les adverbes sont utiles – la définition du discernement donnée par la Cour de cassation – belle référence s’il en est, vous me l’accorderez – dans un vieil arrêt, datant du 13 décembre 1956, et qui a fait consensus depuis lors : le discernement implique que le gamin ait compris et voulu son acte et qu’il soit apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.
Le dernier volet de la définition est extrêmement important, parce qu’il faut évidemment que la réponse pédagogique apportée par la justice puisse être comprise ; sinon, ça n’a strictement aucun sens et la justice tourne à vide pour elle-même ; ce n’est quand même pas le but…
Voilà la définition du discernement que nous proposons. C’est plus précis que la notion de maturité, par exemple. C’est un mot qu’on a beaucoup utilisé, ici, il y a quelques jours, et sur lequel nous avons déjà disserté.
Le Gouvernement se réfère donc à cette définition, qui fait aujourd’hui référence pour définir le discernement.

L’amendement n° 70, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après les mots :
lui permet de
insérer les mots :
vouloir et
2° Supprimer les mots :
et sa portée
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?

Vous l’aurez compris, nous sommes tous attentifs à ce qu’il y ait, dans le code de la justice pénale des mineurs, une définition de la notion de discernement, pierre angulaire de la responsabilité pénale du mineur. Celle que nous avons proposée s’articule autour du concept, certes peu juridique – nous en avons bien conscience –, de maturité. En effet, il nous paraissait important que les sanctions prononcées à l’égard des mineurs délinquants prennent véritablement en compte l’état d’évolution et de compréhension des mineurs, notamment de leur aptitude à comprendre.
Vous l’avez dit, monsieur le garde des sceaux, il y a clairement une base – la jurisprudence constante fondée sur l’arrêt de principe Laboube, que tout le monde a cité –, à laquelle il est nécessaire de se référer. Néanmoins, nous sommes aussi très ouverts – c’est l’intérêt des débats parlementaires, qui permet l’enrichissement mutuel – à l’ajout relatif à l’aptitude à comprendre le sens de la procédure. Il nous paraît important que le jeune puisse s’inscrire dans la procédure et puisse en comprendre les enjeux, même si, selon nous, ce n’est pas tant la procédure qu’il doit comprendre que la sanction qui va être prononcée à son encontre. Nous craignons en effet que la notion de procédure soit un peu plus absconse que celle de sanction, qui parlera peut-être plus aux jeunes.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 27, dans lequel manque la précision relative à l’aptitude à comprendre la procédure, et un avis favorable sur les amendements identiques n° 71 rectifié et 75 ; par conséquent, elle a émis un avis défavorable sur l’amendement de repli n° 70.

Je veux bien que l’on s’amuse à émettre des avis favorables ou défavorables à tel ou tel amendement, mais je ne peux pas vous laisser dire, madame la rapporteure, que notre amendement serait incomplet parce qu’il ne comporterait pas la notion de compréhension ; nous avons bien précisé qu’il y a discernement lorsque l’acte est voulu et compris. Vous vous êtes peut-être mal exprimée ; nous voulons bien admettre que notre amendement n’est pas complet et que les amendements n° 71 rectifié et 75 le sont un peu plus, et nous acceptons de les soutenir, mais ne dites pas que le nôtre ne parle pas de compréhension.

Je me suis peut-être mal exprimée ou vous m’avez mal comprise ; je parlais de l’aptitude à comprendre le sens de la procédure. Les amendements identiques de M. Mohamed Soilihi et du Gouvernement nous semblent plus complets, puisqu’ils intègrent cette aptitude à comprendre la procédure. Le jeune ne doit pas simplement comprendre ce qu’il a fait ; il doit également comprendre ce qu’il encourt et ce qu’il se passe.
Cela nous paraît important et nous semble se rapporter à la notion de maturité. C’est pour cette raison que la commission préfère ces amendements identiques, le vôtre étant une bonne base, puisqu’il reprend la définition jurisprudentielle issue du socle, l’arrêt de principe Laboube.
Les amendements sont adoptés.
L ’ article 1 er ter A est adopté.
Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 12-1 et L. 12-2, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa de l’article L. 111-2, les mots : « Le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « Pour les contraventions de la première à la quatrième classe, le juge des enfants » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « tribunal de police » sont remplacés par les mots : « juge pour enfants » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 121-7, les mots : « tribunal de police » sont remplacés par les mots : « juge des enfants appelé à statuer sur une contravention de la première à la quatrième classe » ;
5° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2. – Le juge des enfants connaît des contraventions et des délits commis par les mineurs. » ;
6° L’article L. 231-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -6. – La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire connaît des appels formés contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants. » ;
7° Au cinquième alinéa de l’article L. 422-4, les mots : « ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police » sont supprimés ;
8° L’article L. 423-1 est abrogé ;
9° À l’article L. 511-2, les mots : « et le président du tribunal de police » sont supprimés et la première occurrence du signe «, » est remplacée par le mot : « et » ;
10° L’article L. 513-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le président du tribunal de police » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du tribunal de police » sont supprimés ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « le tribunal de police ou » sont supprimés ;
12° À l’article L. 531-1, les mots : « du tribunal de police prononcés à l’égard d’un mineur, » sont supprimés ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 532-1, les mots : « mentionnées à l’article 545 du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du tribunal de police prononcés à l’égard d’un mineur. Celles » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

L’amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Il s’agit de rétablir la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes s’agissant des mineurs. Je connais la position de la commission des lois et la vôtre, madame la rapporteure. Pourtant, je ne désespère pas de vous convaincre, pour différentes raisons.
Ces contraventions de faible gravité ne nécessitent ni l’intervention d’un magistrat spécialisé ni la mise en place d’un suivi éducatif prolongé. Il s’agit, le plus souvent, de l’absence du port du casque, d’un refus de priorité, de la circulation à scooter dans une voie de bus ou encore d’un défaut d’assurance. Ce n’est pas le signe d’une délinquance naissante ! C’est pourquoi il peut y avoir une rupture entre le tribunal pour enfants et le tribunal de police.
Puisque l’une des préoccupations de la commission est l’engorgement des tribunaux pour enfants, au point que vous demandiez le report de l’application du texte, contrairement à mon avis sur cette question – je suis d’accord avec vous, mais pour d’autres raisons –, je tiens quand même à vous indiquer que les mineurs représentent 2, 5 % des personnes jugées devant le tribunal de police. Cela peut paraître peu au regard de la totalité des justiciables, mais considérons le nombre que cela représente : ce sont 5 000 mineurs qui devront être jugés non plus, si le Sénat vous suit, par le tribunal de police mais par les juges des enfants. Il y a alors un risque d’engorgement.
Vous ne pouvez pas, d’un côté, affirmer que les juridictions ne sont pas prêtes et qu’il faut renvoyer l’application à une date ultérieure et, de l’autre, ne pas prendre en considération les 5 000 mineurs qui seraient désormais jugés par le juge des enfants pour les infractions que je viens de rappeler. Il y a là une petite contradiction.
En outre, je le répète, on ne se situe pas sur les premiers barreaux de l’échelle de la délinquance ; il s’agit d’infractions routières ou de cette nature.
Je vous demande donc respectueusement, mais avec insistance, de réfléchir à deux fois avant d’attribuer tout ce contentieux aux juges des enfants qui – pardon de vous le dire – n’en ont pas besoin.

Votre plaidoirie pour le maintien du tribunal de police repose, monsieur le garde des sceaux, sur des arguments qui peuvent être contestés.
Au Sénat, nous tenons à la cohérence en matière de spécialisation des juridictions pour mineurs. Vous nous indiquez que les contraventions des quatre premières classes sont avant tout des contraventions routières. Certes, c’est le gros du contentieux, mais ce n’est pas seulement cela ; il y a aussi les violences volontaires, les injures publiques, les messages injurieux appelant à la violence ou les menaces de violence. On trouve donc, dans ces infractions, les prémices de la montée en puissance d’une délinquance malheureusement probable.
Il nous paraît important que le juge des enfants puisse, le plus tôt possible, dès la plus petite infraction, mettre en place les mesures éducatives, les actions visant à éviter cette spirale en ayant une vision large du comportement du jeune. C’est pour cela que nous sommes favorables à la suppression du tribunal de police.
Vous nous dites aussi que cela représente 5 000 affaires, soit 2, 5 % des dossiers ; c’est vrai que, même si c’est peu, cela peut déstabiliser les juridictions pour mineurs. Toutefois, si nous pensons qu’il est nécessaire de reporter la réforme, c’est parce que ces juridictions ne sont pas prêtes, ce n’est pas uniquement parce qu’elles sont en nombre insuffisant. Selon nous, il y a encore besoin de temps pour assimiler la réforme et pour mettre en place les outils permettant d’arriver à une réforme performante, qui atteigne ses buts.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je me suis, à l’évidence, mal exprimé parce que ma plaidoirie était non pour le tribunal de police, mais pour le juge des enfants. Je ne souhaite pas que celui-ci ait à connaître d’un contentieux dont la plupart des contraventions – je tiens à le rappeler, ce n’est pas rien – sont forfaitisées, délivrées par la police et payées par les parents. Si vous pensez qu’il est utile de charger, voire de surcharger, le tribunal pour enfants de ce genre d’infractions et du traitement qu’il connaît dans la réalité, cela me semble, pour ma part, inutile.
En outre, je me permets d’y insister, l’un de vos souhaits était que la justice des enfants fonctionne bien ; c’est l’une des raisons pour lesquelles vous souhaitez le report de la réforme. Est-il utile de leur donner 5 000 dossiers de plus ? Non, d’autant que – j’ouvre une dernière petite parenthèse – la protection du mineur est également assurée devant le tribunal de police, avec, notamment, l’intervention de l’avocat. Il y a donc une véritable garantie des droits des mineurs.
Pour moi, il y a une différence entre la délinquance traitée par le juge des enfants et celle dont connaît le tribunal de police.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : «, le tribunal de police » sont supprimés.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Je suis conscient que notre commission a tranché cette question. Néanmoins, si j’insiste, c’est pour qu’un débat se tienne en séance sur la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes s’agissant des mineurs et sur la charge de travail du juge des enfants. Ce débat a d’ailleurs commencé.
Le présent amendement peut être vu comme un amendement de repli par rapport à la suppression pure et simple de la compétence du tribunal de police. Il vise à rétablir cette compétence en se limitant, toutefois, au cadre de l’ordonnance du 2 février 1945. C’est la différence avec l’amendement du Gouvernement, qui ne fait pas référence à la faculté pour le tribunal de police d’écarter l’atténuation de responsabilité.
Voilà ce que mon amendement propose de plus par rapport à celui du Gouvernement. J’espère que vous serez sensibles, chers collègues, à cette argumentation, car la charge de travail du juge des enfants reste un sujet de préoccupation.

Par cohérence, l’avis est défavorable. À ce stade, nous sommes en effet favorables à la suppression de la compétence du tribunal de police, même si nous avons conscience que la faculté d’écarter l’excuse de minorité doit être aussi possible devant le tribunal de police.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous allez me dire, madame la rapporteure, que cette intervention a quelque chose d’un peu revanchard – je vous le concède. Vous avez dit que les violences traitées devant le tribunal de police étaient les prémices de la délinquance… Pourquoi pas ? Sachez cependant que les parquets les gèrent en alternative aux poursuites. C’est un peu tard pour vous le dire, mais je vous le dis quand même. Cela vaudra pour la suite de nos débats…
Sourires.
Par cohérence également, je demande le retrait de l’amendement.

Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 10 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 33 est présenté par M. Sueur, Mme Harribey, M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi, Marie, Leconte, Kerrouche, Kanner, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 61 rectifié est présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° L’article L. 121-7 est abrogé ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n °10.

En droit, il y a des règles qui fixent des repères et des seuils qui, parce qu’ils sont respectés et non négociables, donnent toute leur force aux procédures. Ainsi, avant 18 ans, on est mineur et, après 18 ans, on est majeur.
L’histoire de notre droit a été de faire une justice spécifique pour les mineurs. Vous allez me répondre, monsieur le garde des sceaux, et peut-être n’avez-vous pas tort, que certains jeunes de 17 ans ont beaucoup plus de discernement que certains jeunes majeurs de 21 ans. Néanmoins, soit on fixe des règles, soit on n’en fixe pas.
Nous sommes attachés au fait que la justice des mineurs s’applique jusqu’à 18 ans. Aussi, nous n’acceptons pas l’exception à l’excuse de minorité pour les plus de 16 ans.
Nous observons depuis plus d’une décennie un durcissement de la réponse pénale. Nous pensons que l’exception à l’excuse de minorité participe pleinement à ce durcissement, qui ne fait pas toujours ses preuves. Bien au contraire, ce durcissement peut même parfois aggraver la situation des jeunes en perdition. Rappelons-le, les jeunes mineurs qui ont été incarcérés éprouvent les plus grandes difficultés à reprendre des études ou à exercer tout simplement leurs droits civiques et citoyens, tant l’enfermement les a fait décrocher de la vie en société. Or la justice des mineurs est précisément fondée sur le principe qu’ils ne sont pas perdus et qu’il faut, par les mesures éducatives et parfois pénales, les accompagner pour leur permettre d’être les citoyens de demain. C’est ce pari qu’a besoin de faire la société pour que nous puissions réussir tous ensemble.

Cet amendement vise à supprimer l’article permettant d’écarter l’excuse de minorité et la diminution de moitié de la peine encourue. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec une présomption irréfragable de non-discernement au-dessous de 13 ans.
L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que « le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines ». Cet amendement vise donc à supprimer cet article au motif qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’excuse de minorité.
Si le quantum des peines est divisé par deux, les sanctions demeurent très sévères. Comment justifier qu’un jeune puisse être tenu psychologiquement pour majeur avant ses 18 ans pour être condamné à trente ans d’emprisonnement, mais soit incapable de demander son émancipation ? Cette mesure revient à traiter des enfants de plus de 16 ans comme des adultes, ce qui n’est pas acceptable.
Rappelons que le Défenseur des droits recommande que l’excuse de minorité s’applique à tout mineur de 13 à 18 ans, sans aucune exception. La CIDE établit clairement, dans son premier article, qu’un enfant est une personne de moins de 18 ans et que, en vertu de l’article 40, un enfant a droit à une justice spécifique.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 61 rectifié.

L’amendement n° 58 rectifié ter, présenté par Mmes V. Boyer, Deroche et Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec et Panunzi, Mme Dumas, M. Bascher, Mme Garnier, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac et MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier et Boré, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
… Le même premier alinéa de l’article L. 121-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire » sont remplacés par les mots : « ne font pas » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
La parole est à Mme Valérie Boyer.

Toujours dans l’esprit des amendements que j’ai défendus précédemment, il s’agit des mineurs très violents récidivistes.
L’un des rôles de la justice est de protéger la société. Je voudrais donc, à la lumière de l’actualité, poser une question : une fois qu’elle aura été arrêtée par la police, comment fera-t-on pour réinsérer la personne qui a donné des coups de marteau sur le crâne du petit Yuriy ? Cette question de l’hyperviolence à laquelle nous sommes confrontés nous taraude, et il nous faut y répondre.
L’ordonnance prévoit que, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, « le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines ». Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.
Je propose d’inverser cette logique et de dire que, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne font pas application des règles d’atténuation des peines. Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considérant les circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et les garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Les trois amendements identiques visent à supprimer la possibilité donnée au tribunal d’écarter l’excuse de minorité.
Il nous paraît opportun de laisser le juge apprécier s’il doit ou non lever l’excuse de minorité et, donc, prononcer des peines plus sévères pour des actes particulièrement violents ou sordides. Nous pensons, là encore, qu’il faut faire confiance au juge des enfants. L’avis est donc défavorable.
L’avis sur l’amendement n° 58 rectifié ter est également défavorable, parce que nous pensons qu’il n’est pas utile d’aligner le droit des mineurs de 16 à 18 ans, qui est plus protecteur, sur le droit des majeurs. Le principe est que l’excuse de minorité peut être levée. Néanmoins, le mineur reste mineur jusqu’à ses 18 ans.
L’exception à l’excuse de minorité est utilisée dans les cours d’assises de notre pays entre neuf et dix-sept fois par an. Entre neuf et dix-sept mineurs sont donc concernés : voilà les statistiques ! Par conséquent, il est rare que cette exception soit appliquée.
L’un de nos grands principes fondamentaux est de distinguer entre mineurs et majeurs.
Madame la sénatrice Boyer, utiliser une affaire en cours pour en tirer un certain nombre de généralités est toujours extraordinairement dangereux. Vous ne savez pas ce qui s’est passé ; la justice est saisie et fera son travail.
Je n’entends pas commenter cette affaire, parce que je ne le peux pas. Vous ne devriez pas le faire non plus, parce que vous ne savez pas un certain nombre de choses que seuls, à cet instant, connaissent les enquêteurs et la justice.
Permettez-moi de vous dire qu’on ne peut pas se servir d’un fait, qui nous émeut forcément, pour écarter les grands principes fondamentaux qui sont les nôtres. Un mineur de 16 ans, même quand il commet un acte grave, reste un mineur de 16 ans, que vous le vouliez ou non, d’où le distinguo entre les peines que l’on peut lui appliquer et les peines que l’on applique à un majeur. Un acte grave commis par un mineur est un acte commis par un mineur !
L’avis est défavorable sur tous les amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 76, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 14 et 15
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal de police, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du tribunal de police ou » sont supprimés ;
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er ter B est adopté.
(Supprimé)

L’amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; »
2° L’article L. 423-9 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant : » ;
c) Au début du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;
d) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;
e) Au début du 3°, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « c) » ;
f) Le 4° est ainsi modifié :
- au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
- la première phrase est ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d’au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique en application du troisième alinéa de l’article L. 423-4, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. » ;
g) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu’il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l’article L. 423-10. » ;
h) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « juge des enfants », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;
- à la dernière phrase, les mots : « Le juge des enfants » sont remplacés par le mot : « Il » et les mots : « parents du mineur, ses » sont supprimés ;
i) À l’avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « a) et b) du 1° » ;
j) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ;
3° À l’article L. 423-10, après la référence : « L. 423-9 », sont insérés les mots : « ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins » ;
4° L’article L. 423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -11. – Le juge des enfants est compétent, jusqu’à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la mainlevée ou la modification des mesures d’investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté, d’office, à la demande du mineur ou de son avocat, ou sur réquisitions du procureur de la République conformément aux dispositions des titres II et III du livre III.
« Lorsqu’il constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire.
« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l’évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues par aux troisième et avant dernier alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Votre commission a adopté l’amendement déposé par Mme la rapporteure visant à supprimer l’intervention du juge des libertés et de la détention avant l’audience de culpabilité, contrairement à ce qui avait été voté par les députés.
La modification apportée par la commission des lois du Sénat vise à ménager la spécialisation du juge des enfants en supprimant le JLD, tout en garantissant l’impartialité au moment du jugement, puisqu’elle prévoit que le juge des enfants qui aura mis le mineur en détention ne pourra pas le juger par la suite. C’est une fausse bonne idée, parce que cette solution revient, en réalité, à méconnaître le principe de spécialisation dans la mesure où ce n’est pas le juge qui connaît le mineur qui statuera sur sa détention ou qui le jugera. De surcroît, dans les petites juridictions, où un seul juge des enfants est affecté, la mise en œuvre de cette disposition sera purement et simplement inapplicable.
L’amendement que je présente vise à rétablir l’intervention du juge des libertés de la détention, qui, je vous le rappelle, devient un juge spécialisé pour le placement ou le maintien en détention provisoire des mineurs avant l’audience de culpabilité. Cette disposition avait été introduite à l’Assemblée nationale, afin de garantir l’impartialité du juge des enfants qui aura à juger le mineur, tout en sauvegardant le principe de spécialisation et de continuité de l’intervention du juge des enfants auprès du mineur.

La suppression de la place du JLD n’a pas été décidée par le Sénat par simple opposition à l’Assemblée nationale, mais parce que, lors de nos visites de juridictions, plusieurs magistrats ont soulevé devant nous les difficultés du recours au juge des libertés et de la détention ainsi que l’atteinte que cela constituait au principe de spécialisation des juridictions des mineurs. On le voit bien, il y a, d’un côté, le principe d’impartialité et, de l’autre, celui de spécialisation des juridictions. Comme souvent en droit, il faut arriver à les concilier et à faire jouer la balance.
Je rappelle à mes collègues que l’intervention du JLD se fait avant l’audience de culpabilité ; pour les mineurs qui sont emprisonnés, le suivi de leur détention est fait par le juge des enfants. Il s’agit donc uniquement de la phase première, avant l’audience de culpabilité.
Monsieur le garde des sceaux, quand il y a peu de juges des enfants, notamment dans les petites juridictions, il y a aussi peu de JLD. Il faudra donc habiliter ou spécialiser tous les JLD, ce qui va faire perdre de la puissance à cette notion d’habilitation et de spécialisation du JLD. C’est pour cette raison que nous avons prévu que, s’il n’y a pas suffisamment de juges des enfants, le président du tribunal judiciaire puisse désigner un autre magistrat qui a une appétence particulière pour les questions éducatives. Cela nous paraît mieux concilier le principe de spécialisation et celui d’impartialité. Notre avis sur cet amendement est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 12-4, les mots : « l’effectue » sont remplacés par les mots : « effectue ce choix » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 13-1, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « en matière ». –
Adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 7, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 12-…. – Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mineurs ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Nous sommes opposés à ce que l’outil numérique devienne la norme pour la justice des majeurs. Nous ne souhaitons donc pas, bien évidemment, qu’il se généralise pour la justice des mineurs.
Même si nous comprenons qu’il est compliqué de déplacer des jeunes placés en centre fermé ou en établissement pénitentiaire pour mineurs, nous pensons que le caractère éducatif réside également dans la fréquentation des lieux, dans la rencontre des différents acteurs, comme les magistrats.
À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : c’est bien pour cela que, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures sont dérogatoires. Dès lors que nous sortirons de cette situation sanitaire, nous ne pensons pas que l’outil numérique doive devenir la norme.

L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 12-…. – Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, les enfants ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite inscrire l’interdiction de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, c’est-à-dire la visioconférence, tout au long de la procédure lorsqu’un mineur est en cause. Nous formulons nos craintes quant au déploiement massif d’un mode de gestion dématérialisé des auditions impliquant des enfants.
En premier lieu, des dysfonctionnements informatiques peuvent nuire à la qualité des débats.
En second lieu, la dématérialisation ne permet pas d’assurer pleinement la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. La solennité des audiences est fortement réduite lors des procédures par écrans interposés.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’utilisation de ces moyens de télécommunication audiovisuelle va à l’encontre des principes cardinaux de la justice des mineurs et de l’intérêt supérieur des enfants. Nous nous opposons donc au maintien de l’utilisation de la visioconférence au cours d’une procédure concernant un mineur.

Il faut bien avouer que nous faisons tous aujourd’hui une overdose de visioconférences. Néanmoins, on le voit bien, ce moyen peut parfois être utile, et pas simplement dans le cas d’une crise sanitaire. En effet, il peut permettre de simplifier des procédures et d’améliorer leur rapidité, à condition que ce ne soit pas un moyen exclusif.
Il me semble donc que ce peut être utile, dans certains cas, d’avoir recours à ces moyens de communication audiovisuelle, qui permettent de ne pas forcément extraire le jeune et de simplifier la procédure.
Nous émettons donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
Le titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-3 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peine. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « l’ » est supprimé ;
b) Le 7° est ainsi modifié :
– le mot : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « 22 » ;
– la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le nombre : « 6 » ;
3° L’article L. 112-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « L. 112-2 », sont insérés les mots : « et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 112-10, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil » ;
5° À la fin du 1° de l’article L. 112-14, les mots : « ainsi qu’au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
6° Le troisième alinéa de l’article L. 112-15 est ainsi modifié :
a) Le signe : «, » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Après le mot : « durée », il est inséré le signe : «, » ;
c) Après le mot : « an », il est inséré le signe : «, » ;
d) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
7° L’article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui en avait la garde » sont remplacés par les mots : « à laquelle il était confié » ;
b) Le dernier alinéa est complété par le mot : « public » ;
8° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 113-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -8. – À chaque entrée d’un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l’établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité. »

L’amendement n° 8, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
… L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « enfant ou un adolescent » ;
b) Avant le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … La remise à parents ; »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Nous proposons de réintroduire la mesure de remise aux parents. Nous considérons que les parents sont des acteurs fondamentaux de la justice des mineurs et qu’il est nécessaire de les intégrer dans le processus de sanction et dans l’échelle des peines.
La remise aux parents est bien évidemment la mesure la plus clémente que peut prononcer le juge des enfants. Elle apparaît parfois hautement symbolique, puisqu’elle a vocation à rappeler aux parents leurs responsabilités. Elle vise aussi et surtout à réhabiliter la place des pères et mères auprès du mineur et de la justice. Elle permet également, parfois, de faire un état des lieux, de pointer des difficultés et d’apporter des premières réponses. On voit bien là que l’on change de paradigme : une mesure qui peut apparaître comme hautement symbolique devient l’une des réponses éducatives.
La place des parents ainsi que leurs responsabilités est un débat que nous avons depuis plusieurs années, plus encore ces derniers temps. L’objectif est non pas de leur faire payer les actes du mineur, mais de les réintégrer dans l’ensemble du processus, afin qu’ils y prennent toute leur place.

Il est vrai que le rôle éducatif des parents et la place qu’ils ont à tenir dans la justice pénale des mineurs sont essentiels. De la même manière, la responsabilisation des parents est un enjeu important.
Nous nous étions posé la question de la suppression de cette notion de remise à parents, qui peut parfois paraître inutile. Je pense qu’elle est très accessoire. Néanmoins, cela peut être un signal symbolique envoyé aux parents pour souligner leur rôle éducatif. C’est pour cette raison que nous donnons un avis favorable.
Vous savez ce que je pense du fait de remplacer le terme « mineur » par le terme « enfant » ; je me suis déjà exprimé à ce sujet.
Le code de la justice pénale des mineurs vise un objectif de simplification et de lisibilité pour tous les mineurs. C’est pourquoi nous avons supprimé cette mesure de remise à parents. Allez expliquer à un gamin que le juge le remet à ses parents… Vous trouvez peut-être cela clair, moi, pas du tout. On ne peut pas considérer qu’il s’agisse là d’une sanction. Vous me direz que cela dépend des parents, mais ce serait de l’humour de mauvais aloi. S’il s’agit d’une mesure éducative, alors elle est totalement redondante dans sa sémantique : « Je te remets à tes parents »… En ce qui nous concerne, nous voulons simplifier les choses.
Nous évoquions, à propos d’autres mots, le fait qu’ils étaient obsolètes. En l’occurrence, la formule l’est totalement. Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Cela ne simplifie rien, au contraire. D’ailleurs, regardez comme les choses sont cohérentes : nous évoquions précédemment le discernement – dispositif que vous avez voté – en disant qu’il fallait que l’on soit en mesure de comprendre ce qui se passe sur le terrain procédural.
Je le répète, parce que cela me paraît frappé au coin du bon sens, allez dire à un gamin qu’on le remet à ses parents, vous verrez si ses yeux ne vont pas totalement s’écarquiller d’incompréhension.

J’entends ce que vous dites, monsieur le garde des sceaux, mais je ne fais pas partie de ceux qui cherchent à simplifier la justice des mineurs, mais à la rendre plus efficace.
Par ailleurs, je ne sais pas si cela est obsolète ou pas, mais, si cela répond à des besoins, la question de l’obsolescence ne se pose pas. L’exemple que vous avez pris est réel, mais je crois qu’il y a de nombreuses mesures que le mineur ne comprend pas forcément. Si, dans la réponse pénale, il fallait uniquement en rester à des mesures que comprend le jeune, on pourrait tout arrêter et, au moins, on n’aurait plus de problème d’engorgement des tribunaux.
Plus sérieusement, l’argument que je partage, c’est que ce n’est pas que du symbole. Parce que, oui, il s’agit peut-être de simplification pour vous, mais, supprimer la remise à parents, c’est aussi sortir les parents de tout un système.
Bien évidemment, la question n’est pas de faire de la remise à parents une torture qui serait imposée. Vous le savez mieux que moi par votre pratique professionnelle, la remise à parents permet parfois de déceler un certain nombre de choses dans les comportements et d’identifier les difficultés. Je ne dis pas que c’est la réponse magique. Je dis simplement que ce serait envoyer un mauvais signal que de supprimer cette mesure-là, fût-elle désuète, obsolète ou réac. En tout cas, je pense qu’elle a encore son efficacité dans la justice des mineurs.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Les 5° à 9° sont abrogés ;
II. - Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thierry Cozic.

Cet amendement vise à maintenir la distinction entre éducatif et répressif en supprimant les modules coercitifs de la mesure éducative.
Les mesures éducatives doivent impérativement se distinguer des mesures répressives : il y va de leur efficacité. En effet, l’essence même de la relation éducative est de se fonder sur un lien de confiance, lien qui est, par principe, distendu dans le cadre d’une mesure coercitive. A contrario, les mesures coercitives perdront de leur solennité et seront totalement banalisées, et donc peu respectées, si leur contenu peut être prononcé à l’identique, sans sanction, dans le cadre d’une mesure éducative.
Aussi, quel que soit le point de vue duquel on se place, la confusion sur le contenu de la mesure a des effets pervers. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer purement et simplement l’ensemble des interdictions et obligations qui ont été prévues dans le cadre de ces mesures – article L. 112-2, 5° à 9° – afin de privilégier un véritable accompagnement éducatif.

Plusieurs interdictions existent dans le cadre des mesures éducatives : l’interdiction de paraître dans certains lieux, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, la confiscation de l’objet qui a servi à commettre l’infraction ou encore l’obligation de suivre un stage de citoyenneté. Je pense que ces interdictions peuvent jouer un vrai rôle éducatif. Il n’y a donc pas lieu de les exclure de la mesure éducative.
Par conséquent, l’avis est défavorable.
Je veux ajouter un autre exemple de mesure tout à fait utile pour l’éducation d’un adolescent : l’interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre 22 heures et 6 heures du matin.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi afin d’aller plus avant dans l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 54 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Deroche et Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec et Panunzi, Mme Dumas, MM. Bascher et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac et MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier et Boré, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa de l’article L. 112-4, la référence : « L. 112-9 » est remplacée par la référence : « L. 112-8 » ;
…° L’article L. 112-8 devient l’article L. 112-9 et l’article L. 112-9 devient l’article L. 112-8 ;
La parole est à Mme Valérie Boyer.

Ce n’est pas tout à fait un amendement rédactionnel : il inverse, dans le code, la définition du module de réparation et la possibilité pour le juge de le prononcer.
Nous considérons qu’il vaut mieux, en droit, définir avant d’envisager l’application.
Par conséquent, nous sollicitons le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 54 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 23, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Les mots : « en fixe la durée qui ne peut excéder un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée de six mois renouvelable » ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Ce n’est pas qu’un amendement de sémantique. En effet, si nous ne sommes pas opposés à la possibilité d’un placement pénal d’un an, nous souhaitons qu’un bilan intermédiaire soit obligatoirement réalisé à l’issue d’une période de six mois.
Certes, la réalisation d’un tel bilan avant une éventuelle prolongation conduira à accroître la charge de travail et à alourdir les procédures. Elle nous semble toutefois impérative, parce que c’est l’avenir du mineur qui est en jeu.

Une durée de placement de six mois ne nous paraît pas pertinente : nous pensons qu’il faut de la durée pour mettre en place une mesure éducative de long terme. Le jeune a besoin que le travail éducatif soit marqué par la stabilité.
Pour cette raison, nous émettons un avis défavorable sur l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 2, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Nous nous opposons au dispositif qui vise à confier un pouvoir de police jusqu’à présent uniquement détenu par les forces de police ou de gendarmerie aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et au secteur associatif habilité.
Les fonctionnaires de la PJJ ne sont nullement habilités à exercer ces prérogatives. Les salariés du secteur privé, dont le niveau de formation en matière éducative est parfois faible, le sont encore moins.
Les agents de la PJJ ont une mission éducative. Pour l’exercer, il leur appartient d’instaurer un climat de confiance et de créer une relation humaine entre l’enfant confié et l’ensemble de l’équipe professionnelle, ce qui peut parfois prendre du temps.
Nous pensons, à l’instar d’organisations syndicales de ce secteur, que l’extension de ce pouvoir de police pourrait remettre en cause ce lien de confiance.

La possibilité de contrôler que l’amendement tend à supprimer consiste en un simple contrôle visuel. Ce dernier est nécessaire dans certains centres éducatifs fermés (CEF).
L’avis est donc défavorable.
C’est une posture dogmatique que de considérer que les éducateurs ne pourraient pas surveiller les gamins qui entrent dans les CEF, alors que certains y introduisent des couteaux !
Ce pouvoir de police est une demande des éducateurs eux-mêmes, pour leur propre sécurité et pour celle des autres mineurs. Ils ont tout de même le droit de se protéger !
Je suis totalement défavorable à cet amendement.

Je ne retirerai pas l’amendement.
Monsieur le garde des sceaux, peut-on débattre de manière respectueuse ? Je ne pense pas que ma posture soit dogmatique.
J’entends que vous n’êtes pas d’accord. Cependant, je pense qu’un véritable débat existe sur l’extension du pouvoir de police, y compris, comme je l’ai dit, au sein des personnels.
On ne saurait balayer d’un revers de manche ce que peuvent exprimer des organisations syndicales ou caricaturer les propos en ramenant l’éducatif à un laxisme débridé. Bien évidemment, un éducateur se doit de rappeler les règles et les interdits.
Toutefois, monsieur le garde des sceaux, le dispositif qui a été ajouté à l’Assemblée nationale va bien plus loin qu’un simple rappel du cadre : il élargit une mesure existante.
Pour terminer, permettez-moi de vous faire remarquer que je ne vous accuse pas de dogmatisme quand vous vous opposez systématiquement à tous nos amendements… Nous avons un débat. Nous avons des désaccords. C’est ainsi que fonctionne la démocratie !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 est adopté.

L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Deroche et Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec et Panunzi, Mme Dumas, M. Bascher, Mme Garnier, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac et MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier et Boré, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par les mots : « mais également de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du trouble à l’ordre public qui en est résulté ».
La parole est à Mme Valérie Boyer.

Le code de la justice pénale des mineurs définit la mesure éducative judiciaire comme « un accompagnement individualisé construit à partir d’une évaluation » de la « situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale » du mineur.
Pour autant, nous ne devons pas oublier les faits reprochés au mineur. Les mesures éducatives prévues doivent également en tenir compte.
C’est pourquoi il me semble nécessaire d’évaluer de la manière la plus proportionnée possible la mesure éducative à prendre. Il convient également de prendre en compte la gravité des faits reprochés au mineur et du trouble à l’ordre public qui en résulte.

Les mesures éducatives sont les moyens qui doivent permettre d’accéder au « relèvement éducatif et moral » des jeunes. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre précédemment.
Ces mesures éducatives sont centrées autour du jeune, de sa personnalité et de son environnement. En revanche, les sanctions prennent en compte la gravité des faits.
Nous pensons que cibler les mesures éducatives sur la gravité des faits apporterait une confusion, alors que le code de la justice pénale des mineurs a pour objectif de simplifier les sanctions et les mesures prononcées.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Comme la commission, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
En effet, il est extrêmement important de distinguer l’éducatif du reste.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 28, présenté par Mme Harribey, MM. Sueur et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Bourgi, Kerrouche, Marie, Leconte, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-8 du code la justice des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section…
« Des centres éducatifs renforcés
« Art. L. 113-9. – Les centres éducatifs renforcés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ils ont vocation à prendre en charge des mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel déjà lourd. Ils se caractérisent par des programmes d’activités intensifs pendant des sessions de trois à six mois selon les projets et un encadrement éducatif permanent. Ils visent à créer une rupture dans les conditions de vie du mineur et à préparer les conditions de sa réinsertion. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Le chapitre III du code de la justice pénale des mineurs concerne le régime du placement.
Nous devons constater que les seuls lieux de placement mentionnés sont les centres éducatifs fermés. Les centres éducatifs renforcés (CER) ne figurent pas du tout dans le code, alors qu’ils s’inscrivent dans un dispositif global de réponse pénale graduée. Ils participent à la nécessité de gradation et de diversification des réponses éducatives. Ils sont reconnus pour offrir un encadrement éducatif renforcé par la mise en place d’un accompagnement permanent dans les actes de la vie quotidienne comme dans les démarches de remobilisation des mineurs.
Par ailleurs, inscrire les CER dans le code permettrait de lutter contre d’éventuels placements décidés indifféremment en CER ou CEF.

Cet amendement vise à définir le rôle des centres éducatifs fermés.
Il pose tout d’abord un petit problème d’imputation : « après l’article L. 113-8 » ne nous paraît pas le bon endroit pour insérer ses dispositions.
Cet amendement, déposé à la demande de la Convention nationale des associations de protection de l’enfant (Cnape), fait référence aux centres éducatifs renforcés, qui sont à la fois différents et complémentaires des centres éducatifs fermés. Il existe, en effet, une gamme dans le placement, le centre éducatif renforcé intervenant souvent en amont ou en aval du placement en CEF.
Néanmoins, les contraintes ne sont pas les mêmes : un jeune qui ne respecterait pas son placement en centre éducatif fermé serait probablement mis en détention. Il serait donc compliqué d’intégrer les centres éducatifs renforcés dans le code de la justice pénale des mineurs au même titre que les centres éducatifs fermés.
L’avis de la commission est défavorable.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable à l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 31, présenté par Mme Harribey, MM. Sueur et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi, Marie, Leconte, Kerrouche, Kanner, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et aux établissements du secteur associatif habilité ».
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Cet amendement vise à intégrer la référence aux établissements du secteur associatif habilité, qui ne sont pas cités dans le texte.
Il ne faut pas oublier que le secteur associatif habilité est chargé, aux côtés des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, de mettre en œuvre un grand nombre de décisions prises par les magistrats.
Or l’article L. 241-1 ne mentionne que les établissements de la protection judiciaire, alors que, sur les 52 centres éducatifs fermés existant actuellement, 34 ont un statut associatif et que, dans le projet d’ouverture de 20 CEF supplémentaires, 15 seraient associatifs.
Il s’agit véritablement de reconnaître la participation du secteur associatif habilité au dispositif.

Comme le souligne Mme Harribey, auteur de cet amendement, la mise en œuvre des décisions prises en application du code de la justice pénale des mineurs est confiée avant tout « aux services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse », mais en lien avec les établissements du secteur associatif habilité.
Il ne nous paraît donc pas complètement inopportun de citer ces derniers dans le texte du code. La commission émet un avis favorable.
Madame la sénatrice, vous avez raison, le secteur associatif habilité n’est pas visé dans l’article. Cependant, les dispositions du code de la justice pénale des mineurs qui sont consacrées aux mesures éducatives, au sein du livre Ier, mentionnent les établissements ou services de ce secteur.
Le secteur associatif habilité continuera bien évidemment à intervenir pour prendre en charge les jeunes, notamment dans le cadre des mesures de réparation et des placements, y compris en centres éducatifs renforcés et en centres éducatifs fermés.
Dans ces conditions, nous estimons que l’ajout proposé n’est pas nécessaire. L’avis du Gouvernement est défavorable.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
(Non modifié)
L’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant sept jours, l’établissement accueillant le mineur concerné saisit d’une demande de mainlevée spécialement motivée le magistrat chargé de l’exécution de cette décision, qui statue sans délai.
« Des activités culturelles et socioculturelles sont organisées dans les établissements mentionnés au premier alinéa. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des mineurs placés dans des centres éducatifs fermés. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Voilà une semaine, j’ai effectué une visite du centre éducatif fermé de Savigny-sur-Orge. Je crois que M. le garde des sceaux l’a lui aussi visité récemment.
Ce centre est l’un des 51 CEF de France. Les jeunes placés y pratiquent des activités éducatives et sportives et bénéficient d’un accompagnement privilégié.
En outre, à Savigny-sur-Orge, des programmes novateurs ont été mis en place. Cela mérite d’être salué.
Il est indéniable que ces centres marquent une volonté positive d’alternative aux établissements pénitentiaires pour mineurs, à l’image de ces femmes, très nombreuses, mais aussi de ces hommes qui sont investis et dont le dévouement envers ces jeunes est incontestable.
Cependant, nous ne pouvons ignorer que certains dysfonctionnements peuvent parfois exister dans les CEF – ce n’est pas du tout le cas du centre de Savigny-sur-Orge. Abus, mauvais traitements, violences sont quelques-unes des dénonciations les plus graves provenant de ces centres. Par exemple, l’année dernière, à Marseille, le centre éducatif des Chutes-Lavie a été fermé par le préfet des Bouches-du-Rhône, car celui-ci s’est retrouvé visé par une enquête judiciaire après une agression sexuelle sur mineur.
Par ailleurs, l’efficacité des CEF est loin d’être démontrée par rapport au coût qu’ils représentent. La documentation et les données sur les centres d’éducation fermés sont extrêmement faibles. Cette opacité est problématique pour leur évaluation, alors même que de nombreuses difficultés de gouvernance sont à relever et que la gestion de la sortie des jeunes qui y sont placés est parfois critiquable.
Sur la survalorisation annoncée des centres éducatifs fermés dans le budget de la PJJ, alors qu’ils y occupent déjà une place importante, au regard du nombre de jeunes placés en leur sein, la sénatrice Maryse Carrère écrivait, dans son avis du 19 novembre 2020 : « Les frais de gestion et d’entretien de ces structures, qui font d’elles la plus coûteuse des formes d’hébergement, ne doivent pas obérer le développement des autres types d’accueil et du secteur ouvert ».
Nous regrettons également que les seuls lieux de placement sur lesquels le Gouvernement ait misé soient les centres fermés.
L ’ article 3 bis est adopté.
Le titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 121-1, les mots : « jour amende » sont remplacés par le mot : « jours-amende » ;
2° À l’article L. 121-2, la référence : « 132-65 » est remplacée par la référence : « 132-62 » ;
3°
Supprimé
4° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
5° L’article L. 122-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « Respecter », il est inséré le signe : «, » ;
a bis)
b) La seconde phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Lorsque » est supprimé ;
– les mots : « a été prononcée à l’égard d’un mineur, ce placement » sont supprimés ;
5° bis
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-6, les mots : « s’ils exercent la garde du mineur » sont remplacés par les mots : « chez lesquels le mineur réside » ;
7° L’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 521-26 » est remplacée par les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article L. 423-4 » ;
8° À l’article L. 124-1, la troisième occurrence du mot : « mineurs » est remplacée par le mot : « mineures ».

L’amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante.
3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les peines complémentaires mentionnées au 7° de l’article 131-16 du code pénal. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Je retire l’amendement, compte tenu des votes intervenus à l’article 1er ter B.

L’amendement n° 69 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 9 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 32 est présenté par Mme Harribey, MM. Sueur et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Bourgi, Marie, Leconte, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° L’article L. 121-4 est abrogé ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 9.

Nous nous opposons à la suppression de la collégialité pour la justice des mineurs. Nous pensons en effet qu’un enfant ne doit pouvoir être condamné à une peine que par une juridiction collégiale, et non par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, seul.
Le présent amendement traduit cette opposition, qui n’est pas que de principe.

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’une audience en cabinet.
L’article 4 permet au juge des enfants statuant seul sur la sanction de prononcer certaines peines. Ce recul de la collégialité nous semble dangereux.
Cette disposition s’écarte même des règles en vigueur pour les majeurs, posant ainsi des règles moins favorables pour les mineurs, ce qui n’est pas acceptable.

La possibilité pour le juge des enfants de prononcer des peines en chambre du conseil, c’est-à-dire seul, est une innovation du code de la justice pénale des mineurs.
Cela nous paraît une bonne mesure. Il s’agit, en effet, de répondre à un souci d’efficacité : nous avons vu que le prononcé de sanctions rapides était l’un des enjeux majeurs de l’efficacité de la réforme visant à lutter contre la délinquance.
Enfin, les peines concernées sont très limitées : confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction, stage ou travail d’intérêt général (TIG) pour les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment du prononcé de la peine.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements. J’ajoute que le juge des enfants a toujours la possibilité de renvoyer les situations les plus complexes au tribunal.
Au reste, le fait que le juge statue seul n’est pas forcément inquiétant a priori : cela peut, au contraire, favoriser une relation privilégiée avec le mineur.
Je ne reviens pas sur les mesures que le juge peut prendre seul, en chambre du conseil, car Mme la rapporteure les a rappelées.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 11, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après les mots : « mineurs âgés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’au moins seize ans au moment de la date de commission de l’infraction. » ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Si les TIG ne peuvent pas être réalisés par des jeunes de moins de 16 ans, l’article 4 institue la possibilité de condamner à un TIG un mineur ayant commis une infraction avant cet âge, dès lors qu’il est âgé d’au moins 16 ans au moment du jugement.
Nous pensons que cette faculté remet en cause le principe de la légalité des peines et l’égalité entre jeunes. En effet, selon l’importance de la juridiction, un jeune pourra, pour une même infraction et dans une même situation, être jugé soit avant soit après ses 16 ans, donc être ou non condamné à un TIG.
Je le dis sans porter de jugement sur l’opportunité de la condamnation à un TIG. C’est une question d’égalité.

Considérant que son adoption reviendrait à réduire la possibilité de recourir au TIG, qui est une bonne mesure, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je rappelle simplement que l’objectif est de favoriser les TIG, qui constituent une alternative à l’incarcération.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

J’ai peut-être présenté cet amendement rapidement. Je veux répéter qu’il ne s’agit pas de s’opposer aux TIG.
Monsieur le garde des sceaux, je vous invite à vous rendre dans deux communes de mon département, notamment en milieu rural, qui ont signé des conventions pour accueillir des personnes condamnées à des TIG. Aujourd’hui, elles n’en accueillent pas, pour de nombreuses raisons : éloignement trop important, capacités d’encadrement trop faibles…
Ce n’est pas le principe du TIG qui nous pose problème. Nous nous interrogeons simplement sur le fait que, à âge égal, un jeune pourra être condamné à un TIG et un autre non. J’aurais souhaité obtenir une réponse à cette question de l’égalité entre les juridictions. Permettez-moi d’y insister de nouveau.
Je ne doute pas que votre désaccord avec notre amendement n’a rien à voir avec un quelconque dogmatisme. Au reste, excusez-moi si je n’ai pas été suffisamment claire… peut-être est-ce lié à l’heure avancée de la soirée !

Chère collègue, je vais moi aussi développer plus longuement ma position.
Le recours au TIG pose problème aujourd’hui. En effet, les magistrats et les avocats ont une mauvaise connaissance des possibilités de TIG offertes dans le ressort de leur tribunal, ce qui ne facilite pas le prononcé de cette sanction.
Il y a également une difficulté dans la mise en œuvre des TIG. Nous l’avons déjà évoquée : les délais entre le prononcé de la mesure et sa réalisation véritable sont souvent trop longs. Or on sait que l’efficacité de la réponse dépend de son instantanéité. Comme nous l’avons dit, le délai doit être le plus court possible pour que la mesure ait du sens.
Néanmoins, je ne pense pas que prévoir qu’il faut avoir 16 ans au moment de la commission des faits, et pas seulement lors du prononcé de la sanction, permettra le développement de cette bonne réponse qu’est le TIG, véritable alternative à l’incarcération.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 64 rectifié, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° L’article L. 122-6 est abrogé ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de l’article L. 122-6 du code de la justice des mineurs, lequel fixe les conditions de mise en œuvre de la peine de détention à domicile avec surveillance électronique.
La normalisation de cette peine de détention à domicile avec surveillance électronique est une violation du principe de primauté de l’éducatif dans la réponse pénale à la délinquance des enfants, principe que nous souhaitons par ailleurs réaffirmer dans l’article préliminaire de ce code.
De surcroît, cette mesure n’est pas adaptée aux enfants et adolescents, quel que soit leur âge. Ce sont les professionnels du droit qui le disent, notamment le Conseil national des barreaux et le Syndicat de la magistrature.
Enfin, elle fait craindre un alignement de la justice des mineurs sur celle des majeurs. N’oublions pas, encore une fois, le sens initial de la justice des mineurs, qui est celui d’une justice spécifique.
Ainsi, une réforme de la justice des mineurs bien conçue ne peut avoir pour unique but d’accélérer les procédures, en traitant, au passage, des mineurs comme des délinquants majeurs.

Nous avons vu que l’un des enjeux de la réforme du code de la justice pénale des mineurs était de lutter contre la détention provisoire et contre la détention plus globalement.
La détention à domicile sous surveillance électronique est une alternative à l’enfermement des jeunes dans des lieux qui, généralement, ne leur sont pas forcément adaptés et ne sont guère protecteurs.
Je pense ainsi qu’une restriction de sa liberté à domicile est beaucoup plus protectrice pour un jeune qu’un enfermement dans une prison, un centre de détention, voire dans un CEF, d’autant plus que cette mesure de détention à domicile sous surveillance électronique est particulièrement encadrée, notamment avec l’accord des représentants légaux, et qu’elle doit être assortie d’une mesure éducative.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
Je ne vois pas comment on peut être opposé à cette peine alternative à l’emprisonnement quand on veut privilégier l’éducatif.
Comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, la peine de détention à domicile sous surveillance électronique permet au jeune condamné de demeurer auprès de ses proches, autrement dit à la maison, de maintenir sa scolarité, sa formation ou son suivi éducatif.
Je suis défavorable à cet amendement.

Je comprends bien les arguments de notre rapporteur et de M. le ministre, mais je rappelle que les mineurs concernés sont encore des enfants et que, quelles qu’aient été ses défaillances préalables, l’autorité parentale s’exerce encore.
Or la mesure que l’amendement tend à supprimer est clairement susceptible de remettre en cause la crédibilité et l’autorité parentales. À cet égard, sauf à renier l’autorité parentale en matière d’éducation, l’amendement défendu par notre collègue me semble tout à fait correct.
Surveiller un enfant chez lui, c’est nier l’autorité parentale.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 12, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine d’emprisonnement ne peut être prononcée à l’unique condition que celle-ci soit assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. » ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Loin de tout angélisme, force est de constater que, parfois, une peine d’emprisonnement doit être prononcée à l’égard d’un mineur. Bien évidemment, nous ne pouvons que souhaiter que cette situation se produise le moins souvent possible.
Pour autant, nous pensons que, dès lors que cette peine est prononcée, elle doit être assortie d’une mesure éducative qui inscrit le jeune, dès le premier jour de son emprisonnement, dans un « parcours éducatif » – pardonnez-moi, mes chers collègues, si la formule vous semble inappropriée.
La privation de liberté doit être une parenthèse dans la vie du mineur. La mesure éducative doit lui apporter d’emblée une perspective de sortie, lui permettre de repenser sa place et d’envisager une réinsertion pleine et entière. On peut espérer qu’elle aidera le jeune à construire et réussir sa vie et l’éloignera du camp des récidivistes.

Cet amendement nous paraît superfétatoire dans la mesure où l’article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit déjà que les mineurs détenus, soit dans les quartiers pour mineurs, soit dans des établissements pénitentiaires pour mineurs, bénéficient de l’intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Outre la PJJ, l’éducation nationale est également présente dans ces établissements, la scolarité étant obligatoire jusqu’à 16 ans.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ article 4 est adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 27 janvier 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire (texte de la commission n° 300, 2020-2021) ;
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (texte de la commission n° 292, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 27 janvier 2021, à zéro heure trente.