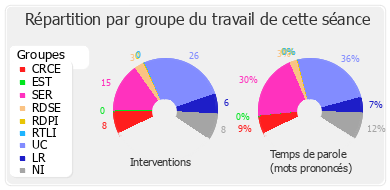Séance en hémicycle du 26 mai 2016 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (proposition n° 446, texte de la commission n° 519, rapport n° 518, avis n° 505), en examen conjoint avec la proposition de loi relative à l’indépendance des rédactions, présentée par MM. David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain (proposition n° 416, rapport n° 518).
Mes chers collègues, je vous rappelle que nous avions commencé l’examen de ces deux propositions de loi le 6 avril dernier.

La commission demande la réserve jusqu’à cet après-midi, seize heures quinze, de l’article 1er ter et de l’amendement n° 11 rectifié portant article additionnel après l’article 1er ter, afin de permettre à M. Portelli, rapporteur pour avis de la commission des lois à laquelle nous avons délégué au fond l’examen de cet article et de cet amendement, de pouvoir nous rejoindre.

Je suis saisi par la commission de la culture d’une demande de réserve, jusqu’à la reprise de la séance, à seize heures quinze, de l’article 1er ter et de l’amendement n° 11 rectifié portant article additionnel après l’article 1er ter.
Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la réserve est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande formulée par la commission ?

La réserve est ordonnée.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 1er.
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.
« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice.
« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles qui en sont dénuées se dotent d’une charte déontologique avant le 1er juillet 2017. Pour les entreprises ou sociétés éditrices audiovisuelles, le comité institué à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté dans le cadre de l’élaboration de la charte. »

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice
par les mots :
charte des droits et devoirs des journalistes de Munich et à la charte d’éthique professionnelle des journalistes
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Patrick Abate.

Nous craignons que les discussions qui présideront à la rédaction des chartes déontologiques que l’on qualifie de « maison » ne soient pas toujours favorables aux journalistes. Un encadrement international nous paraît donc préférable.

L'amendement n° 38, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
dénuées
par le mot :
dépourvues
La parole est à M. David Assouline.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Barbier, Collombat et Guérini, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
déontologique
insérer les mots :
rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes
La parole est à Mme Mireille Jouve.

La charte déontologique dont doivent se doter les entreprises de presse ou audiovisuelles avant le 1er juillet 2017 est un texte en vertu duquel le journaliste ne peut être contraint à accepter un acte qui y serait contraire.
Le contenu de la charte déontologique est de première importance pour les journalistes, car il fonde en partie leur droit d’opposition. C’est pourquoi cet amendement a pour objet de rétablir la disposition prévoyant que la charte déontologique est élaborée conjointement par la direction et les représentants des journalistes.

L'amendement n° 39, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner, Manable, D. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
déontologique
insérer les mots :
élaborée par les journalistes et l’équipe dirigeante
La parole est à M. David Assouline.

Qu’est-ce qui fonde le droit d’opposition du journaliste ? Lors de la rédaction de notre proposition de loi relative à l’indépendance des rédactions, nous, sénateurs socialistes, avions répondu son « intime conviction dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle ». Cette formule nous avait semblé plus précise, plus explicite que celle néanmoins très proche d’« intime conviction professionnelle » retenue dans la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias issue de l’Assemblée nationale.
Cette dernière rédaction reprend mot pour mot le dispositif prévu au paragraphe VI de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986, qui s’applique aux journalistes de l’audiovisuel public. Ce dispositif a d’ailleurs été introduit dans la loi de 1986, en 2009, par le biais d’un amendement que j’avais proposé au nom des sénateurs socialistes. Toutefois, on peut comprendre que ce qui s’applique dans le cas d’un service de télévision publique ne puisse être généralisé à l’ensemble des journalistes de l’audiovisuel ou de la presse. La ligne éditoriale d’un titre d’un groupe privé requiert en effet une adéquation totale des journalistes à celle-ci et, donc, une marge d’exercice du droit d’opposition davantage encadrée que dans une grande chaîne généraliste du service public.
Lors des travaux de la commission, notre rapporteur a indiqué que le caractère intime de la conviction professionnelle lui posait problème. Elle a ainsi souhaité que le droit d’opposition d’un journaliste ne puisse s’exercer que par référence à la charte déontologique de son entreprise.
À travers cet amendement, je souhaite proposer une voie médiane entre la rédaction issue des travaux de notre commission et celle de l’Assemblée nationale. Il me semble que l’exercice du droit d’opposition repose tout de même sur la conviction de celui qui l’exerce. En revanche, il est évident que cette conviction doit se former au regard de la charte déontologique de son entreprise. Je demande donc qu’aucun journaliste ne puisse être contraint à accepter un acte qui serait contraire à sa conviction formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise.

L'amendement n° 41, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
juillet
par le mot :
janvier
La parole est à M. David Assouline.

Cet amendement a pour objet d’avancer la date de mise en place des chartes déontologiques au 1er janvier 2017, soit environ six mois après l’entrée en vigueur du texte de loi dont nous débattons.
La date du 1er juillet 2017 nous semble en effet très lointaine et déraisonnable au regard des échéances qui nous attendent d’ici à ce terme. Fixer un tel délai reviendrait à enterrer la réforme.
Je suis bien conscient que, dans le secteur de l’audiovisuel, un délai très bref pourrait s’avérer problématique puisqu’il faudra adapter toutes les conventions. C’est pourquoi notre amendement n° 40 tend à créer un garde-fou au cas où surviendrait un litige : les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste pourront être invoqués.
Je le répète, il me semble préférable de fixer la date au début de l’année 2017. Cela enverra un signal fort tout en laissant six mois aux entreprises qui n’ont pas de charte à l’heure actuelle pour s’atteler au travail de rédaction d’un tel texte.

L'amendement n° 40, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À défaut de conclusion d’une charte avant le 1er janvier 2017 et jusqu’à l’adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige.
La parole est à M. David Assouline.

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de règlement de litiges internes à la profession en l’absence de charte après le 1er janvier 2017. Il prévoit ainsi une possibilité d’invocation des déclarations et des usages relatifs à la profession de journaliste au cas où surviendrait un litige.
Les dispositions que cet amendement tend à introduire constituent la contrepartie des dispositions précédemment évoquées visant à anticiper de six mois la date d’élaboration de la charte.

L'amendement n° 59, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice ne peut minorer les engagements de la charte des droits et devoirs des journalistes signée à Munich le 24 novembre 1971 et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Notre collègue Abate a parlé de charte « maison ». Si nous concevons que les spécificités de telle ou telle publication justifient des déclinaisons spécifiques dans la rédaction des chartes déontologiques, nous pensons toutefois nécessaire que soit respectée une forme de hiérarchie des normes. C’est pourquoi nous voulons préciser que la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice ne peut minorer les engagements de la charte des droits et devoirs des journalistes signée à Munich le 24 novembre 1971 et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes.
Ce seuil d’exigence me semble très utile compte tenu des affaires qui défraient actuellement la chronique en France. Près de chez moi, en Belgique, le licenciement d’une journaliste, dont j’apprécie beaucoup la clarté d’expression, suscite l’émotion. Correspondante au Caire, cette journaliste couvrait la disparition de l’avion de la compagnie Egyptair. Elle a reçu l’ordre de son éditeur d’insister sur la tristesse des familles et de remettre en cause la sécurité de la compagnie égyptienne. Or elle n’avait rencontré aucune famille à l’aéroport, ces dernières ne souhaitant pas parler aux médias, et la cause de l’accident n’étant pas connue au moment des faits, elle ne pouvait savoir si l’accident était effectivement dû à une déficience technique ou à un acte de terrorisme. Elle a donc refusé d’écrire ce que son éditeur exigeait et a été remerciée au motif qu’elle n’était pas « opérationnelle ».
Si la charte de Munich constituait un seuil d’exigence commun à toutes les rédactions, cette journaliste serait toujours correspondante du journal en question.

Après avoir consacré le droit d’opposition du journaliste lors de notre débat au mois d’avril, nous abordons maintenant la charte déontologique. Je rappelle que le principe de cette charte a été introduit à l’Assemblée nationale par le groupe Les Républicains. Ces amendements en discussion commune ont pour objet d’en préciser le contenu, les modalités et le délai imparti à son élaboration.
L’amendement n° 1 tend à imposer la charte de Munich et celle de 1918 à l’ensemble des entreprises de presse ou audiovisuelles. Permettez-moi de rappeler que beaucoup d’entreprises se sont déjà dotées d’une charte et qu’une première tentative d’imposer une charte unique à l’issue des états généraux de la presse de 2009 avait déjà échoué.
Si je rejoins votre souci, monsieur Abate, qu’un référentiel commun permette de guider la rédaction des chartes, nous avons pu constater lors de nos auditions que la plupart des nombreuses chartes existantes découlent de fait d’un même référentiel. Imposer a posteriori une charte identique ne me semble respectueux ni de l’histoire ni de la culture des entreprises qui ont pris soin, avant même que cela ne leur soit imposé par la loi, de faire ce travail. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 38 vise à remplacer le mot « dénuées » par le mot « dépourvues ». Ces deux mots ont exactement le même sens dans le dictionnaire, mais si ce changement peut vous faire plaisir, monsieur Assouline, je n’y vois pas d’inconvénient.
Les amendements n° 33 rectifié et 39, bien que différents dans leur rédaction, visent tous deux à ce que la charte soit établie par les journalistes et l’équipe dirigeante.
La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements, mais, personnellement, je n’y suis pas très favorable. Si une majorité d’entreprises, notamment celles qui comptent des sociétés de journalistes, se sont déjà dotées d’une charte, je ne vois pas très bien comment ce travail de coélaboration pourrait être mené dans une entreprise où les journalistes, qui peuvent être des centaines, ne seraient pas organisés en société de journalistes. En outre, l’ensemble des représentants des entreprises que nous avons auditionnés ne sont pas favorables à une telle disposition, demandant à ce que l’on fasse confiance au dialogue au sein de leur rédaction.
L’amendement n° 41 vise à avancer la date à laquelle doit être rédigée la charte. Notre commission a émis un avis favorable, mais, personnellement, j’y suis défavorable, parce que je pense qu’il faut laisser aux entreprises le temps de s’organiser pour s’acquitter de cette obligation nouvelle.
Monsieur Assouline, je le répète, les chartes déontologiques ont été introduites dans le texte sur l’initiative du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale. Le sujet ne sera donc pas enterré. Par respect pour les entreprises de presse qui, je le rappelle, n’étaient pas demandeuses d’un texte législatif sur ce sujet, laissons du temps au temps.
L’amendement n° 40 tend à introduire une précision tout à fait utile. J’émets donc un avis favorable. Toutefois, par cohérence, il conviendra de rectifier la date du 1er janvier 2017 dans le cas où le vote de notre assemblée rejoindrait mon avis personnel sur l’amendement précédent.
Enfin, sur l’amendement n° 39 du groupe écologiste, pour les raisons précédemment évoquées concernant l’amendement n° 1, j’émets un avis défavorable.

Madame la rapporteur, la commission a émis un avis favorable sur les amendements n° 33 rectifié et 39, auxquels vous êtes personnellement défavorable. Les deux amendements n’étant toutefois pas identiques, pourriez-vous préciser la position de la commission ?

Vous avez raison, monsieur le président, ces deux amendements ont le même objet, mais leur rédaction diffère. La commission a une préférence pour l’amendement n° 39.
À travers l’amendement n° 1, M. Abate soulève la question de la valeur normative qu’il convient de conférer à la charte de Munich et à la charte d’éthique professionnelle des journalistes établie en 1918 et révisée en 2011. Dans la mesure où il existe déjà des chartes déontologiques, ces références doivent rester d’ordre doctrinal et non être consacrées par la loi. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable. Toutefois, en l’absence de charte – ce point important est visé dans l’amendement n° 40 de M. Assouline –, les journalistes doivent pouvoir se référer à ces textes en cas de litige.
Concernant l’amendement n° 38, qui est rédactionnel, le Gouvernement y est favorable.
Je partage la préoccupation des auteurs de l’amendement n° 33 rectifié, qui tend à prévoir une concertation entre la direction de l’entreprise et les représentants des journalistes pour l’établissement de la charte. Il me semble néanmoins que la rédaction proposée à l’amendement n° 39, qui fait référence non pas aux représentants des journalistes mais aux journalistes eux-mêmes, est plus équilibrée en termes de concertation. Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement n° 33 rectifié au profit de l’amendement n° 39.
L’amendement n° 41 vise à modifier la date à partir de laquelle les entreprises doivent être dotées d’une charte déontologique. Je comprends la volonté d’assurer une mise en œuvre rapide de la mesure, mais, comme cela a été dit, adopter une charte déontologique prendra du temps, d’autant que nous demandons à ce que celle-ci soit rédigée en concertation avec les journalistes. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat pour déterminer si la date doit être fixée le 1er janvier ou le 1er juillet.
L’amendement n° 40 tend à permettre aux journalistes, à défaut de conclusion d’une charte, d’invoquer les déclarations et les usages professionnels en vigueur en cas de litige. Cette précision me semble utile, et j’y suis tout à fait favorable. Toutefois, compte tenu de la référence à la date du 1er janvier 2017, le Gouvernement s’en remet, comme pour l’amendement précédent, à la sagesse du Sénat.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 59, qui tend à conférer une valeur normative à la charte des droits et devoirs des journalistes de Munich et à la charte d’éthique professionnelle des journalistes.

Comme l’a dit Mme la rapporteur, il est préférable de ne pas imposer de charte unique, comme le prévoit l’amendement n° 1. Chaque structure doit en effet pouvoir rédiger sa propre charte en référence à son histoire, tout en respectant éventuellement un référentiel commun.
Je partage l’avis donné à titre personnel par Mme la rapporteur sur les amendements n° 33 rectifié et 39, dont il a été précisé qu’il divergeait du vote émis par la commission lors de sa dernière réunion.
Je partage également la position de notre rapporteur sur l’amendement n° 41, qui vise à raccourcir le délai pour se doter d’une charte déontologique, car il faut laisser aux entreprises le temps de la rédiger et d’y réfléchir en profondeur.

La nuit dernière, notre assemblée a adopté le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Le premier mot de son titre était déjà « liberté ». À la fin de la discussion générale, Mme la ministre a indiqué dans sa réponse aux orateurs que toute liberté devait être régulée. Je partage totalement ce point de vue, mais, entre régulation et encadrement, il peut y avoir des niveaux de contrainte différents. Or je ne suis pas loin de penser que, à l’usage, on s’apercevra que le niveau de contrainte est relativement élevé.
Si je fais référence à ce texte, c’est parce que nous retrouvons exactement la même problématique avec la proposition de loi dont nous reprenons l’examen ce matin. Le premier mot de son titre est également « liberté » et, dans le cadre de cette notion de liberté, une charte déontologique est proposée. Certes, une telle charte va bien dans le sens de la liberté de la presse. Mais, par pitié, ne cherchez pas à préciser ce qu’elle doit contenir, ce qu’est la déontologie, qui doit négocier et dans quel délai, sinon vous allez rajouter des éléments normatifs qui vont à l’encontre du principe de liberté que vous souhaitez défendre.
Si je l’exprimais autrement, je dirais que la société française a perpétuellement un manque de confiance en elle-même qui est très étonnant. Pour ma part, je voudrais exprimer ma confiance à l’égard des journalistes et des entreprises de presse. C’est pourquoi je soutiens notre rapporteur, qui plaide pour l’introduction de la charte déontologique mais sans chercher à rajouter encore une couche normative ou administrative pour la définir.
Permettez-moi pour conclure de dire que je trouve quelque peu paradoxal d’avoir cette discussion sur le terrain de la liberté de la presse en ce jour où nous sommes privés de presse… Je ne demande pas à cette occasion qu’une nouvelle réglementation soit édictée mais simplement qu’on fasse confiance aux acteurs.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 33 rectifié est retiré.
La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'amendement n° 39.

J’interviens pour rectifier mon propos, parce que, lorsque cet amendement a été appelé, je me suis certes exprimé sur le sujet, mais pas précisément sur cet amendement.
Nous avons bien compris que l’élaboration d’une charte posait problème à de nombreux acteurs. Certains ne veulent pas avoir à s’asseoir autour de la même table pour s’y atteler. Ici, on nous dit que la rédaction doit accomplir cette mission, mais représente-t-elle l’ensemble des personnes concernées par la charte ? Ailleurs, on pense que seules les organisations représentatives ont compétence pour le faire, mais s’agit-il de défendre des droits sociaux ? Non, ces questions touchent à la déontologie des journalistes ! En outre, certaines équipes dirigeantes ne voudraient pas se mêler de cette élaboration.
Si j’ai proposé cette rédaction, c’est parce que je pense que la proposition de loi ne peut s’exonérer d’une référence précise aux auteurs de la charte déontologique. Certains nous ont d’ailleurs alertés sur les problèmes de blocage qui risquent de se poser si les modalités de rédaction de la charte ne sont pas clairement établies.
Cet amendement tend à prévoir que la rédaction se charge de l’élaboration de la charte conjointement avec l’équipe dirigeante de l’entreprise concernée. Cette formule, « la rédaction », permettra en outre d’octroyer une certaine reconnaissance aux rédactions, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans notre droit. Elle permettra d’ouvrir une concertation sur un sujet qui ne relève pas de la représentation sociale et d’en charger les premiers intéressés par le contenu de la charte.
Ce point peut sembler annexe, mais de nombreuses personnes auditionnées ont indiqué qu’il s’agissait d’un sujet sensible. Aussi, cette formulation permettra aux organisations représentatives ou aux sociétés de journalistes, par exemple, en fonction de l’organisation de l’entreprise, d’être parties prenantes. L’adoption de cet amendement est de nature à débloquer certaines situations.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.


Par cohérence, la date figurant dans l’amendement n° 40 devrait effectivement être modifiée, monsieur le président. Aussi, je me tourne vers l’auteur de l’amendement pour savoir s’il souhaite procéder à cette rectification ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Ce qui est en train de se passer est un peu surréaliste. Alors que la commission s’est prononcée favorablement sur des amendements, Mme la rapporteur – en l’occurrence, la présidente de la commission – donne du bout des lèvres, en séance publique, l’avis de la commission et exprime immédiatement après son avis personnel, qui est contraire. Elle est ensuite confortée par ses collègues de la majorité sénatoriale. Mais c’est là outrepasser un peu les règles du jeu, et c’est regrettable !
Je ne conteste absolument pas le droit à nos collègues de droite d’être hostiles à de tels amendements. Mais il faut avoir l’esprit sportif, si je puis m’exprimer ainsi : quand on a perdu en commission, il faut être capable de le dire et il faut laisser la démocratie s’exercer.

Pour tout vous dire, madame la présidente de la commission, je suis un peu choqué par cette méthode.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 7111-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 7111-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 7111 -5-… – Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la charte par cette entreprise ou cette agence. »
La parole est à Mme Sylvie Robert.

Cet amendement a pour objet de porter à la connaissance de tout journaliste la charte déontologique négociée dans son entreprise. Il nous semble en effet opportun de prévoir sa transmission aux journalistes lors de leur embauche et quand ils sont déjà en place dans les trois mois suivant l’adoption de la loi. Ce document deviendra en quelque sorte une annexe du contrat de travail, ce qui lui conférera un véritable poids au sein de l’entreprise.
Notre commission ayant émis un avis favorable sur cet amendement, je ne doute pas de son adoption…

L’avis de la commission est tout à fait favorable : cette précision est très utile.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111 -11. – Le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle est destinataire de la charte prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et informé des modifications qui y sont apportées. »

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Avant les mots :
Le comité d’entreprise
insérer les mots :
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Cet amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission, je le précise, prévoit de transmettre la charte et ses modifications au comité d’entreprise, comme le souhaitent notre rapporteur et le Gouvernement, mais seulement lorsque l’entreprise ou la société concernée ne dispose pas de conseil d’administration ou de conseil de surveillance. Ces organes existent principalement dans les groupes audiovisuels, mais également dans de grands quotidiens.
À mon sens, les comités d’entreprise n’ont pas pour vocation première de s’occuper de déontologie. C’est pourquoi il m’apparaît préférable, lorsqu’ils existent, de transmettre ces documents d’éthique et de déontologie aux organes exécutifs des entreprises audiovisuelles ou de presse.

Par cohérence avec l’avis rendu sur l’amendement n° 42, la commission approuve cette proposition.
J’observe que les auteurs de l’amendement ont procédé à une rectification en remplaçant les termes « à défaut » par la conjonction de coordination « et », comme l’avait suggéré la commission. Nous estimons en effet que le comité d’entreprise doit demeurer informé, parallèlement aux instances dirigeantes.
En conséquence, l’avis est favorable.
Il me semble tout à fait utile que soient également informés les organes de décision des entreprises. J’émettrai une seule petite réserve, celle d’introduire cette précision dans le code du travail. Mais, dans le même temps, c’est là que l’on va parler du texte.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette charte est intégrée à la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8. Le comité d’entreprise est informé annuellement des conditions d’application dans l’entreprise de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à assurer une parfaite information du comité d’entreprise sur l’application de la charte déontologique prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le comité d’entreprise doit pouvoir avoir annuellement connaissance des conditions d’application de la charte déontologique et de la mise en œuvre effective des protections apportées par la proposition de loi aux journalistes dans l’exercice de leur profession. Dans le texte actuel, l’information est limitée aux éventuelles modifications apportées à la charte.
Pour répondre aux craintes qui ont pu être exprimées en commission, j’ajoute qu’il s’agit non pas de créer une interférence entre le champ de la déontologie et le champ du droit du travail, mais de veiller à l’information du comité d’entreprise et des organes de gouvernance, qui viennent d’être ajoutés, sur la mise en œuvre éventuelle du droit d’opposition des journalistes, ce qui me semble tout à fait conforme à leur vocation.
Enfin, afin que les membres du comité d’entreprise puissent avoir accès à la charte déontologique et s’y référer, celle-ci serait intégrée à la base de données économiques et sociales prévue par le code du travail. Cette base de données, qui est régulièrement mise à jour, rassemble les informations que l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, ce qui est en cohérence avec l’amendement qui vient d’être adopté.

Notre commission a estimé qu’il ne revenait pas au comité d’entreprise, non exclusivement composé de journalistes, de juger de l’application de la charte déontologique et du respect du droit d’opposition ; d’autres orateurs l’ont indiqué. Nous voulons limiter son rôle à l’information.
En conséquence, si la première phrase de l’amendement ne pose pas de difficulté, tel n’est pas le cas de la seconde, qui redonne une mission déontologique au comité d’entreprise. Aussi, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir supprimer la seconde phrase ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Je ne puis malheureusement pas accéder à cette demande : nous demandons non pas que le comité d’entreprise porte un jugement ou délibère sur la charte déontologique, mais qu’il soit informé annuellement de l’application de cette charte dans l’entreprise.

Je pense que c’est bien, mais il faudrait mettre cet amendement en corrélation avec l’amendement précédent, qui a été adopté. Le conseil d’administration et le conseil de surveillance devraient avoir la même information que le comité d’entreprise visé à cet amendement.

Ce sont les termes « conditions d’application » qui nous posent problème. Ni les éditeurs ni les journalistes ne souhaitent cette mesure. C’est pourquoi nous maintiendrons notre avis défavorable sur cet amendement s’il n’est pas modifié tel que nous l’avons demandé.

Mme la ministre nous dit qu’il n’y aura pas d’interférences entre les dispositions déontologiques et le droit social. Mais bien sûr que si ! Sinon, pourquoi consulter ?
Si le fait de consulter le comité d’entreprise ne donne pas la possibilité d’apporter une réponse ou de prendre position, cela n’a pas de sens.

Les mots ont – fort heureusement ! – un sens : en prévoyant la consultation du comité d’entreprise, vous introduisez des interférences. Je me permets de le rappeler – mais Mme la ministre le sait bien –, les modalités d’information d’un comité d’entreprise sont non seulement extrêmement normées, mais encadrées par un dispositif pénal.
Par pitié, n’intégrons pas des contraintes à des dispositions destinées à favoriser l’information !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur Assouline, il y a au moins un point sur lequel vous pourrez être d’accord : les dispositions relatives à l’information d’un comité d’entreprise prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect.

Prenez-le dans le sens que vous voulez, mais vous introduisez ici des éléments de contraintes supplémentaires, alors qu’il s’agit d’un texte visant à renforcer la liberté de la presse. Je le répète, en ce jour où la liberté de la presse n’est pas assurée, ce qui semble ne déranger personne, voilà un paradoxe que je trouve, à titre personnel, un peu excessif.

Je m’exprimerai en des termes probablement légèrement différents de ceux qui viennent d’être prononcés par notre collègue Bonnecarrère.
Je comprends le souci de transparence du Gouvernement : tout le monde doit avoir connaissance de la charte déontologique. Toutefois, il est dangereux d’entrer dans ce mélange des genres. La charte déontologique est une affaire de journalistes.
Mme la rapporteur opine.

Veillons vraiment à ne pas mélanger les genres : la déontologie est, je le répète, l’affaire des journalistes ; cela n’a rien à voir avec le comité d’entreprise. Que les membres du comité d’entreprise soient informés de la charte, soit ! Mais qu’ils débattent des conditions d’application, j’y suis aussi personnellement défavorable.

On en arrive à une situation bizarre.
On était pratiquement d’accord avec l’esprit qui a prévalu en commission, et nous nous sommes félicités des relations entre la commission et le Gouvernement. Nous n’avons pas de divergence fondamentale sur la charte, même si nous aurions aimé aller peut-être un peu plus loin. Mais nous avons compris qu’il y avait un niveau au-delà duquel nos collègues de la majorité sénatoriale ne souhaitaient pas aller. Alors, ne faisons pas ici de faux procès !
Je ne reprendrai pas les termes employés précédemment par Mme la rapporteur sur l’amendement visant à remplacer le terme « dénuées » par le terme « dépourvues ». Je suis assez d’accord avec elle, la différence est mineure.

Chers amis, je ne jouerai pas à celui qui sait face à ceux qui ne savent pas. Mais enfin, informer ne veut pas dire consulter ! On a peur d’informer le comité d’entreprise alors que, dans le même temps, on est d’accord pour indiquer que cette charte est intégrée à la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail. Je ne comprends plus rien !

Cette proposition permet d’être en adéquation avec l’intitulé même de la proposition de loi : liberté, indépendance et pluralisme des médias. Je ne vois donc pas comment on pourrait s’opposer à cette information, qui, je le répète, est très différente d’une consultation ou d’une concertation.

M. Pierre Laurent. On agite des chiffons rouges qui n’ont pas lieu d’être ! L’amendement du Gouvernement, que nous soutenons, n’est pas à proprement parler révolutionnaire.
Rires.
Sourires.

Il vise tout simplement à donner au comité d’entreprise un droit d’information.
Il y a quelque chose de bizarre dans notre discussion. À vous écouter, on a l’impression que les entreprises de presse sont peuplées d’instances dans lesquelles les journalistes ont énormément de pouvoir. Pour connaître assez bien ces entreprises, je peux vous dire que ce n’est pas tout à fait la réalité.
Vous citez les conseils d’administration. Le pouvoir des journalistes dans les conseils d’administration des grandes entreprises de presse, parlons-en ! Ceux qui nous opposent cet argument devraient être favorables à un renforcement considérable du pouvoir des journalistes et des salariés au sein d’une telle instance. Mais, à chaque fois que nous faisons des propositions en ce sens, elles sont repoussées. Quand nous proposerons d’accroître la place et le pouvoir des sociétés de rédacteurs, ceux-là mêmes qui ne sont pas d’accord aujourd’hui pour que le comité d’entreprise s’en mêle vont s’y opposer ! Il faut être un peu logique.
Où et quand va-t-on enfin donner un peu plus de pouvoir et de droit d’information aux journalistes, mais aussi aux autres personnels ? Parce qu’on fait comme si les autres personnels n’avaient rien à voir avec le travail des journalistes. Mais, là aussi, c’est bien mal connaître les entreprises de presse. Dans une entreprise de presse, tout le monde concourt – et heureusement, pas seulement les journalistes ! – à un seul objectif : la qualité de l’information. Aussi, cet amendement, c’est le minimum, ai-je envie de dire, que nous puissions faire en la matière.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er bis est adopté.

Je rappelle que l’article 1er ter et l’amendement n° 11 rectifié portant article additionnel après l’article 1er ter sont réservés jusqu’à seize heures quinze.
(Supprimé)

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 12, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre I du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Protection dans le cadre de l’alerte
« Art. L. 2415-… – Est qualifiée de « lanceur d’alerte » toute personne physique qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
« Art. L. 2415-… – Est qualifiée d’« alerte » tout signalement ou révélation d’une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, acquise dans le contexte d’une relation de travail, rémunérée ou non, présente ou passée.
« Art. L. 2415-… – Dans le cadre d’une transmission d’information à l’autorité judiciaire, les dispositions prévues à l’article 226-13 du code pénal et les obligations de confidentialité faisant obstacle au signalement ou à la révélation d’un crime, d’un délit, d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général, sont nulles.
« Art. L. 2415-… – I. – Le lanceur d’alerte est protégé, le cas échéant, contre toutes mesures de rétorsion faisant suite à son signalement ou sa révélation.
« II. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, révoquée ou licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ; notamment en matière de traitement, de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de notation, de discipline, de titularisation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir de bonne foi signalé ou révélé une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
« III. – Toute rupture de la relation de travail ou révocation, toute disposition ou tout acte contraire au II du présent article, qui ferait suite à un signalement ou une révélation est nul de plein droit. La nullité emporte la réintégration du salarié dans son emploi, ou sa réaffectation à un poste équivalent qui ne peut être inférieur ni en termes de rémunération ni en termes d’ancienneté ni en termes de droit à la retraite, ou le dédommagement intégral de sa perte de revenus.
« IV. – En cas de rupture de la relation de travail résultant d’un signalement ou d’une révélation, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés. Le conseil de prud’hommes doit statuer dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise, ou en cas d’impossibilité du maintien du salarié dans l’emploi, il peut ordonner le maintien du salaire jusqu’au prononcé du jugement.
« V. – L’agent public lanceur d’alerte peut demander au juge administratif d’intervenir en référé afin de préserver ses droits. Dans ce cas, le juge statue conformément aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative.
« Art. L. 2415-… – I – Le fait d’entraver ou de sanctionner le signalement ou la révélation d’une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« II. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du code pénal, le signalement ou la révélation d’informations relatives à un crime, un délit, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. L. 2415-… – Lorsqu’une alerte a été entravée par un agent public l’autorité investie du pouvoir peut engager les poursuites disciplinaires des faits dont elle a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
« Art. L. 2415-… – Toute personne qui signale ou révèle une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude de l’information est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
La parole est à M. Patrick Abate.

La France a souvent été pionnière dans le domaine de la liberté d’expression et d’information. Or, aujourd'hui, on ne peut que constater le retard considérable que l’on accuse à la fois au regard des recommandations européennes et de certaines législations étrangères pour ce qui concerne les lanceurs d’alerte. À ce titre, nous ne pouvons que souscrire à la volonté affichée dans le futur projet de loi porté par Michel Sapin, en attendant avec intérêt les effets qui en découleront.
Cela étant, il nous paraît très difficile, voire inconcevable, qu’un texte relatif à l’indépendance et au pluralisme des médias ne comporte pas de dispositions visant à protéger plus sûrement les lanceurs d’alerte. Ces derniers constituent une réelle plus-value pour notre démocratie. Aussi, par voie d’amendement, nous avons décidé de leur accorder une protection générale, car celle-ci est, on le sait bien, largement insuffisante aujourd'hui.

Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 36 rectifié bis est présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Collombat et Guérini, Mme Laborde et M. Vall.
L'amendement n° 50 est présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 64 est présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l'article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sanctionnée », il est inséré le mot : «, licenciée » ;
2° Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : «, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions » ;
3° Après le mot : « employeur, », sont insérés les mots : « soit à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».
La parole est à Mme Mireille Jouve, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié bis.

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er quater issu des travaux de l'Assemblée nationale, qui prévoit de conférer le secret des sources aux lanceurs d’alerte dans le domaine de l’environnement ou de la santé publique. Cet article a été supprimé par notre commission pour des motifs qui ne nous ont pas convaincus.
L’importance des révélations issues des lanceurs d’alerte a été prouvée à maintes reprises. Combien de scandales ne pourront pas être dévoilés si nous attendons le bon véhicule législatif, s’il vient un jour… Pour cette raison, il me semble essentiel d’étendre la protection des lanceurs d’alerte aux situations où ceux-ci veulent transmettre leurs informations à un journaliste.
L’importance des révélations dues aux lanceurs d’alerte n’est plus à démontrer, qu’il s’agisse du Mediator, des pesticides ou de la mortalité des abeilles. Il était donc important d’étendre la protection des lanceurs d’alerte aux situations où ils souhaitent transmettre leurs informations à un journaliste et non plus simplement à leurs employeurs ou aux autorités publiques.

Le nombre d’amendements déposés sur les lanceurs d’alerte montre à ceux qui, en dépit de l’actualité récente, en doutaient encore l’importance de ce sujet, qui a été peu exploré. Il convient de protéger ces citoyens qui, en prenant courageusement leurs responsabilités et en exerçant pleinement leur citoyenneté, courent des risques pour l’intérêt collectif.
Cet amendement tend à réintroduire le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. On a vu l’efficacité d’une alerte lancée auprès des journalistes, et non pas seulement auprès d’un employeur ou des autorités administratives ou judiciaires. On le sait, c’est parfois par ce biais que ces autorités se sont saisies d’un certain nombre de problèmes ; cette efficacité n’est plus à démontrer. En témoigne l’affaire dite des « Panama papers ». À l’avenir, d’autres affaires seront probablement dévoilées grâce à ces citoyens qui, à un moment donné, sans engagement militant ou organisé, prennent le risque de communiquer des informations, dans l’intérêt général. Dans le cadre d’un texte relatif à l’indépendance des médias, on ne pouvait occulter ce rôle très important des lanceurs d’alerte. Tel est l’objet de cet amendement.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 64.

La vertu des lanceurs d’alerte est de pallier, à un moment donné, le dysfonctionnement des agences, des autorités ou d’une hiérarchie. Les textes de loi précisent bien les canaux normaux pour permettre à un salarié de faire remonter une information au sein de son entreprise ou à un usager auprès d’une préfecture ou d’une direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Mais si ça coince, si la hiérarchie ou les institutions ne veulent pas savoir, ne comprennent pas ou si le lanceur d’alerte est menacé de pénalités, d’être placardisé ou subit des humiliations, il faut protéger cette personne qui travaille dans l’intérêt de tous.
Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de cinq textes relatifs à la protection des lanceurs d’alerte qui sont en vigueur. Nous construisons le dispositif brique par brique, et nous ne le faisons pas parfaitement.
En 2012, j’ai déposé une proposition de loi relative à la santé et à l’environnement, qui faisait suite aux travaux réalisés par nos collègues Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy sur l’amiante. On a alors vu les dysfonctionnements possibles et comment le lanceur d’alerte devait être protégé.
Ces textes sont imparfaits. Dans le texte relatif à la santé et à l’environnement, tous les canaux ont été prévus pour faire remonter l’information, mais nous avons oublié – j’en suis la première confuse – le canal de la presse. Aussi, cet amendement vise à réparer en quelque sorte cet oubli et à apporter quelques précisions. Nous mettons les points sur les « i » : non seulement il ne faut pas sanctionner le lanceur d’alerte, mais il ne faut pas non plus le licencier ! De même, les mesures d’intéressement ou de distribution d’actions sont quelquefois utilisées pour l’intimider ou le décourager.
Je regrette beaucoup que la commission ait supprimé l’article 1er quater. Aussi, nous proposons de le rétablir.

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1351-1, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : «, soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5312-4-2, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : «, soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : «, soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
III. – Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « ou aux autorités judiciaires ou administratives », sont remplacés par «, aux autorités judiciaires ou administratives ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée », sont insérés les mots : « soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».
La parole est à Mme la ministre.
Le sujet des lanceurs d’alerte est majeur, et vous aurez l’occasion d’en discuter dans le cadre d’un autre texte.
S’agissant de cette proposition de loi, votre commission a écarté l’amendement adopté par l'Assemblée nationale non pas, me semble-t-il, en raison d’un désaccord de fond, mais parce qu’elle a estimé la rédaction incomplète.
Nous souhaitons tous, je l’espère, mieux protéger les lanceurs d’alerte compte tenu du rôle qu’ils jouent dans les sociétés démocratiques d’aujourd'hui. Nous avons tous en tête des exemples récents. Grâce à eux, nos sociétés ont pu être informées de graves dangers menaçant notre santé ou notre environnement ou bien encore d’infractions portant atteinte au bon fonctionnement de nos règles collectives, notamment en matière de fiscalité.
Le Gouvernement est déterminé à apporter aux lanceurs d’alerte la protection qu’ils méritent. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, que Michel Sapin s’apprête à présenter au Sénat, apportera aux lanceurs d’alerte des protections générales, fortes et claires.
Des recommandations du Conseil d’État qui viennent d’être rendues publiques éclairent la construction juridique de cette protection.
Mais, sans attendre, j’ai souhaité défendre dès maintenant un amendement gouvernemental qui vise à répondre à une préoccupation spécifique, celle de protéger les lanceurs d’alerte qui s’adressent à des journalistes, conformément à l’objet de la proposition de loi.
Dans certains textes, le lanceur d’alerte qui relate ou transmet de bonne foi une information est protégé, car le texte ne précise pas quelle personne ou quelle autorité est destinataire de l’alerte. Mais, dans d’autres cas, le lanceur d’alerte n’est protégé que s’il informe son employeur ou l’autorité administrative ou judiciaire.
En conséquence, je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter un amendement du Gouvernement, afin de corriger cette disparité dans la protection des lanceurs d’alerte s’adressant à des journalistes, en modifiant le code de la santé publique, pour les alertes en matière de sécurité sanitaire, ainsi que pour les risques graves pour la santé publique et l’environnement, le code du travail, pour les dénonciations de faits de corruption, et la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les dénonciations de situation de conflit d’intérêts.
En créant ce nouveau droit, il nous faut aussi prévoir les cas d’abus et ne pas oublier le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l’article 226-10 du code pénal, qui doit être complété lorsque les faits relatés sont inexacts et susceptibles d’entraîner des sanctions contre la personne dénoncée.
Mme la rapporteur approuve.
Dans tous les cas, par cohérence avec les recommandations du Conseil d’État et les dispositions du socle commun qui figurent dans le projet de loi relatif à la transparence, est prévue une mise en jeu d’abord de procédures internes, puis de transmission à l’extérieur, afin de garantir une solidité juridique et une protection complète du lanceur d’alerte.
Par cet amendement, nous avons, me semble-t-il, un régime juridique solide, qui ouvre de nouveaux droits protecteurs aux lanceurs d’alerte, lesquels sont essentiels au bon fonctionnement de la démocratie. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement et sollicite, en conséquence, le retrait de l’amendement n° 12 et des amendements identiques n° 36 rectifié bis, 50 et 64 à son profit.

Le sous-amendement n° 88, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Abate et P. Laurent et Mme Prunaud, est ainsi libellé :
Amendement n° 73 rectifié
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : «, de bonne foi, » sont insérés les mots : « à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».
La parole est à M. Patrick Abate.

Ce sous-amendement a suscité en commission une discussion un peu compliquée. Je rappelle simplement qu’il a été rédigé et déposé sur le fondement de la première version de l’amendement n° 73, déposée voilà plus d’un mois. Or, il y a trois jours, le Gouvernement a procédé à une rectification de son amendement. Nous sommes donc évidemment ouverts au débat.
Dans sa première version, l’amendement n° 73 ne comportait aucune gradation entre les différents destinataires auxquels une alerte peut être adressée : autorité judiciaire, autorité administrative, journalistes. Il s’agissait d’introduire la formule «, soit à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » dans les codes de la santé publique et du travail, ainsi que dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et dans le code pénal, sans la précision « en dernier ressort » qui figure dans l’amendement n° 73 rectifié et dont nous souhaitons discuter, car elle ne nous paraît ni très claire ni très solide sur le plan juridique.
Par ailleurs, dans l’objet de l’amendement n° 73 non rectifié, le Gouvernement expliquait ceci : « L’amendement ne modifie pas les textes comme le statut de la fonction publique dans lesquels n’est pas précisée la liste des personnes ou autorités auxquelles le lanceur d’alerte relate ou témoigne de bonne foi des faits qu'il dénonce. Dans ce cas en effet, la rédaction actuelle de ces textes permet déjà d'inclure la communication des faits à un journaliste. »
Cette analyse valait lorsque la première version de l’amendement a été déposée, au début d’avril. Seulement, quelques jours plus tard, la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été adoptée définitivement, puis promulguée. Or l’article 4 de cette loi modifie l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, qui fixe le statut de la fonction publique évoqué dans l’objet de l’amendement n° 73, pour y ajouter la référence aux autorités judiciaires ou administratives, mais pas aux journalistes. Il s’agit apparemment d’un oubli, que l’adoption de notre sous-amendement permettrait de réparer.
Le jour où nous avons entamé l’examen de cette proposition de loi, le 6 avril dernier, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires avaient été adoptées la veille à l’Assemblée nationale et devaient l’être le lendemain au Sénat.

En tout cas, je souhaite que nous progressions en ce qui concerne les fonctionnaires. Nous considérons que, pour qu’ils soient protégés, madame la ministre, il faut viser la loi du 13 juillet 1983.

Je tiens avant toute chose à récuser certains mauvais procès. On a dit que votre rapporteur était hostile à la création d’un statut général du lanceur d’alerte. Qu’il me suffise de rappeler que j’ai proposé la constitution d’une mission commune d’information à la suite des révélations d’Edward Snowden, qui a mis au jour les écoutes massives de la NSA, et que j’ai déposé une proposition de résolution visant à proclamer Edward Snowden Citoyen d’honneur de la République française et à lui accorder l’asile politique. C’est dire combien je suis sensible à la question des lanceurs d’alerte, dans quelque domaine qu’elle se pose.
Seulement, en prenant connaissance des dispositions de la proposition de loi qui étendent la protection existante aux lanceurs d’alerte ayant relaté des faits à un journaliste, nous avons identifié une vraie difficulté, que j’ai signalée au Gouvernement : les journalistes ne sont pas mentionnés à l’article 226-10 du code pénal, relatif aux sanctions applicables en cas de dénonciation calomnieuse. L’amendement n° 73 rectifié réparant cette lacune, la commission invite le Sénat à l’adopter et, comme Mme la ministre, suggère aux auteurs des autres amendements de les retirer au profit de celui du Gouvernement, qui est le plus complet.
Je m’appesantirai un peu plus longuement sur le sous-amendement n° 88, qui vise à étendre la protection des lanceurs d’alerte aux fonctionnaires se confiant à un journaliste. En effet, la proposition de nos collègues du groupe CRC soulève plusieurs difficultés.
D’abord, comme je l’ai déjà fait observer en commission, le régime des fonctionnaires lanceurs d’alerte vient d’être entièrement révisé par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, à laquelle M. Abate a fait référence. Les canaux d’alerte ont été explicités, et à aucun moment il n’a été question d’y inclure les journalistes.
Ensuite, les fonctionnaires ne sont pas des salariés comme les autres, dans la mesure où ils sont déjà astreints à l’article 40 du code de procédure pénale, qui leur fait obligation de transmettre au procureur de la République les informations en leur possession concernant des crimes ou des délits. Par ailleurs, ils ont des devoirs spécifiques, conférés par leur position statutaire et réglementaire : en particulier, ils sont tenus, en vertu de l’article 28 du titre Ier du statut général de la fonction publique, d’obéir aux instructions de leur supérieur hiérarchique, sauf, bien sûr, si elles sont manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; ils sont également soumis, conformément à l’article 26 du même titre, à un devoir de discrétion et au secret professionnel s’agissant des informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Si le supérieur hiérarchique n’entend pas l’alerte, le fonctionnaire pourra s’adresser au référent déontologue ; ce nouvel acteur, créé par l’article 28 bis de la loi du 20 avril 2016, est justement chargé, entre autres missions, d’aider les lanceurs d’alerte. Le référent déontologue sera lui-même astreint à l’article 40 du code de procédure pénale, ce qui n’est pas le cas des journalistes.
Enfin, le sous-amendement ne comporte aucune gradation des canaux d’alerte. Pis, si nous adoptions l’amendement n° 73 rectifié modifié par le sous-amendement n° 88, il résulterait de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire préviendrait les journalistes, puis seulement son autorité hiérarchique. Or, comme le Conseil d’État le souligne dans un rapport récent, une gradation des canaux d’alerte est nécessaire, prévenir le public devant être un ultime recours. Le Conseil d’État fonde cette analyse sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, d’ailleurs, pourrait être reprise dans le projet de loi Sapin II.
La commission est donc défavorable au sous-amendement n° 88.
Monsieur Abate, vous posez une vraie question : de quelle protection bénéficie un fonctionnaire qui lance une alerte en direction d’un journaliste ?
Comme Mme la rapporteur vient de l’expliquer, les fonctionnaires évoluent dans un cadre très particulier, du fait de leur position professionnelle, de leur statut et des règles spécifiques qui s’appliquent à eux, comme l’article 40 du code de procédure pénale et les dispositions relatives au référent déontologue, tout juste créé.
Pour autant, il n’est pas certain que la question ait été complètement réglée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. À l’issue de discussions au niveau interministériel, il a été convenu de traiter cette question complexe, qui n’aurait pas pu l’être complètement dans le cadre de cette proposition de loi, à la faveur du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En effet, ce texte, qui sera débattu au Parlement dans les jours qui viennent, a vocation à devenir le socle commun des règles de protection des lanceurs d’alerte ; il précisera l’articulation entre la procédure d’alerte et la protection des secrets pénalement protégés.
Il était délicat pour nous d’intégrer ces dispositions dans la présente proposition de loi, pour des raisons de coordination. Pour la même raison, je vous demande, monsieur Abate, de bien vouloir retirer votre sous-amendement, étant entendu, je le répète, que la question soulevée sera traitée dans un autre cadre législatif.

J’entends bien les arguments qui viennent d’être exposés, mais il faut se figurer que, en près de neuf ans, il y a eu, je crois, six rendez-vous législatifs sur les lanceurs d’alerte… C’est dire à quel point nous avançons de manière hachée !
En outre, le régime législatif et réglementaire de protection des lanceurs d’alerte qui existe actuellement est très fragmenté, parce qu’il a été mis au point en réaction à des « affaires ». Or on s’apprête à aggraver encore cette fragmentation en visant l’ensemble des travailleurs, sauf les fonctionnaires.
Madame la ministre, madame la rapporteur, je regrette, mais le statut des fonctionnaires et les règles spécifiques qui peuvent s’attacher à certains fonctionnaires dans certaines de leurs activités ne sont pas exclusifs des protections générales ni, surtout, de la manifestation de l’intérêt général. Nous pensons, nous, que le lanceur d’alerte est un peu comme celui qui porte assistance à une personne en danger. Ne pas lancer l’alerte devrait être une faute pénale, à l’instar de la non-assistance à personne en danger ! Il faut inverser la logique.
Je récuse donc les arguments qui nous sont opposés et je vous répète très fermement, madame la ministre, qu’il faut viser la loi du 13 juillet 1983 si l’on veut inclure les fonctionnaires ; nous en sommes absolument convaincus, et il serait aisé de s’en assurer au plan technique.
En ce qui concerne le problème du « dernier ressort », je comprends bien la prudence de Mme la rapporteur, même si nous n’avons pas la même philosophie. Seulement, que signifie cette expression ? Pour que l’alerte transmise à un journaliste soit jugée sincère et, surtout, pour qu’elle soit légale, le fonctionnaire devra s’être adressé d’abord à son supérieur hiérarchique ou à une autorité administrative ou judiciaire. Mais de quel supérieur parle-t-on : du supérieur immédiat ou du supérieur du supérieur ? Et de quelle autorité : l’expression « en dernier ressort » signifie-t-elle qu’il faudra aller jusqu’à une décision de la Cour de cassation ?
En vérité, je pense que le Gouvernement avait eu raison de ne pas faire figurer cette expression dans la première version de son amendement. Au point où nous en sommes, et même s’il faudra discuter encore, nous pourrions peut-être l’accepter et attendre le projet de loi Sapin II ; mais, en tout cas, nous ne comprendrions pas que les fonctionnaires soient exclus d’un dispositif que nous trouvons déjà bancal, du fait de l’expression « en dernier ressort ».

Je soutiens tous les amendements ayant pour objet de protéger les lanceurs d’alerte. D’Edward Snowden à l’association L214, menacée de poursuites pour avoir filmé dans certains abattoirs, en passant par une infinité d’autres acteurs, les donneurs d’alerte rendent service à la société tout entière ; ils doivent donc être protégés.
Reste que le cas des fonctionnaires est très particulier, dans la mesure où ils sont censés dénoncer tout délit dont ils auraient à connaître. Le principe est inversé : c’est s’ils ne le font pas qu’ils peuvent être inquiétés. Au contraire, les salariés du secteur privé et l’ensemble des citoyens qui ne sont pas fonctionnaires, lorsqu’ils dénoncent un acte délictueux dont ils ont eu connaissance, risquent des poursuites ou des conséquences fâcheuses sur le plan professionnel.
Dans ces conditions, l’urgence me paraît être de protéger l’ensemble des donneurs d’alerte. La question des fonctionnaires se pose avec beaucoup moins d’acuité, compte tenu de la situation spécifique dans laquelle ils se trouvent : pour eux, je le répète, l’obligation de dénoncer les délits est la règle générale.

Je salue à mon tour le courage des lanceurs d’alerte. Permettez-moi de prendre l’exemple d’une affaire qui date maintenant, mais dont, malheureusement, les conséquences ne sont pas terminées. Je veux parler d’Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, qui, en 2007, a lancé les premières alertes à propos du Mediator, après avoir constaté que 500 décès étaient survenus. La procédure s’est d’abord déroulée au sein des instances spécialisées, jusqu’à ce que, en 2009, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide le retrait du Mediator, en dépit des recours et des référés déposés par le laboratoire Servier.
Je pense que, sans les journalistes et sans le livre Mediator 150 mg, combien de morts ?, les morts auraient malheureusement continué.
Mes chers collègues, il faut vous représenter que la vie des lanceurs d’alerte change complètement lorsqu’ils décident de pratiquer cette assistance à personne en danger dont M. Abate a parlé. En vérité, leur vie bascule : ils sont soumis à des pressions de leurs collègues et de certains intérêts, par exemple des laboratoires, et leur vie professionnelle comme leur vie personnelle s’en ressentent.
Un article paru dernièrement au sujet de Mme Frachon explique que celle-ci ne peut plus s’endormir sans avoir en tête toutes les victimes du Mediator et qu’elle est épuisée, son énergie étant complètement absorbée par ce travail-là, mais qu’elle continue malgré tout. Continuons nous aussi notre travail de législateur au service de la protection des lanceurs d’alerte et de ceux qui les soutiennent, pour que les affaires puissent sortir au grand jour !

Il est vrai que l’élaboration d’une législation en matière de lanceurs d’alerte est très longue, mais, au fond, cette lenteur est assez légitime, car chaque décision que le législateur prend dans ce domaine doit correspondre à une position d’équilibre. Or l’équilibre, dans ces matières délicates, n’est pas toujours facile à trouver.
L’amendement n° 73 rectifié du Gouvernement ne traite évidemment pas de l’ensemble du sujet, mais, dans le cadre de cette proposition de loi, il me paraît être un amendement d’équilibre, en particulier parce qu’il prévoit la sanction pénale des dénonciations calomnieuses. En effet, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, et il peut arriver que certains aient des intentions malveillantes, ce qu’il faut prévoir. Cet amendement étant fondé sur un équilibre, j’invite nos collègues à le voter et les auteurs des autres amendements à s’y rallier.
La question des fonctionnaires, qui est particulière, mérite certainement d’être examinée, mais le sujet n’est pas mûr et, en tout cas, la rédaction du sous-amendement n° 88 n’est pas satisfaisante ; en ce qui me concerne, je ne le voterai donc pas.

L’amendement n° 73 rectifié revêt une importance particulière, d’autant que, comme il est souligné dans son objet, qui est très pédagogique, il vise à la fois le code de la santé publique, le code pénal, le code du travail et la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Son importance tient aussi au rôle des lanceurs d’alerte, que Mme la rapporteur a fort justement souligné.
Sur une question aussi complexe, je fais confiance à l’ensemble de nos collègues de la commission de la culture, qui ont accompli un travail remarquable sur des sujets particulièrement importants dans la société actuelle.
Je comprends ceux de nos collègues qui se réfèrent à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, étant entendu que nos fonctions publiques sont très complexes et leurs missions particulièrement difficiles.
L’amendement n° 73 rectifié du Gouvernement opère une bonne synthèse ; il est de nature à répondre aux attentes en matière de transparence de la vie publique. Je suivrai donc l’avis de Mme la rapporteur.

Pour saluer le progrès qui va être accompli en ce qui concerne les sources et les journalistes, je tiens à rappeler que les quatre éthers de glycol les plus dangereux ont été dénoncés par un chercheur, M. Cicolella, qui travaillait dans une institution publique, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, l’INERIS.

Il a lancé des alertes internes à destination de sa hiérarchie, ainsi que doit le faire un fonctionnaire, mais il n’arrivait pas à se faire entendre. C’est un journaliste, Stéphane Foucart, du Monde, qui a révélé au public le problème de ces éthers de glycol.

M. Cicolella a été licencié, et il a fallu que ce soit le Conseil d’État qui, après plusieurs années, le rétablisse dans son poste.
La loi du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, issue d’une proposition de loi que j’ai déposée, garantit que ce genre de choses ne se produira plus.
Ma loi prévoit une sanction en cas de dénonciation calomnieuse, mais elle ne traite pas des journalistes. De son côté, l’Assemblée nationale a réintroduit dans la présente proposition de loi les journalistes comme canal possible pour lancer une alerte, mais elle a oublié la dénonciation calomnieuse. Voici que Mme la ministre propose de réintroduire dans la proposition de loi la dénonciation calomnieuse, de sorte que l’édifice sera complet.
Dans ces conditions, je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement.
MM. Jean-Lou is Carrère et André Gattolin applaudissent.

L’amendement n° 64 est retiré.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Je voudrais illustrer le débat sur les fonctionnaires à l’aide d’une expérience personnelle vécue dans ma région.
En décembre 2014, j’ai reçu la visite dans ma permanence parlementaire d’un inspecteur des impôts, qui s’est présenté à moi sans me donner son nom, mais en m’annonçant qu’il voulait me parler de la question des lanceurs d’alerte. Il m’a raconté pendant une heure comment se passait son travail. Comme je lui disais qu’il était protégé par l’article 40 du code de procédure pénale, il m’a répondu : oui, mais les choses ne se passent pas tout à fait ainsi ; il y a le souci de la carrière et le devoir d’obéissance des fonctionnaires, parfois le poids de la hiérarchie, parfois aussi des dossiers un peu sensibles concernant des personnes quelque peu exposées. Et lui de conclure : « Je n’ai pas les moyens d’exercer mon métier. » Je vous certifie que c’est vrai !
Je lui ai demandé de mettre son témoignage par écrit, dans un courrier anonyme. J’ai reçu ce courrier au Sénat un an plus tard, en décembre 2015. Il m’y explique en douze pages, de manière très documentée et argumentée, son expérience d’inspecteur des impôts de la fonction publique française. J’ai été très interpellé par ce récit, absolument authentique – j’ai le visage de ce monsieur en mémoire, à défaut de connaître son nom, qu’il ne m’a pas donné.
Mes chers collègues, il y a donc un vrai problème qui se pose, même dans l’administration fiscale française. Je transmettrai ce courrier au ministre compétent et, j’imagine, nous reprendrons ce débat au moment de l’examen du projet de loi Sapin II, ou en une autre occasion. En tout cas, ce témoignage m’a profondément interpellé.

Mme Blandin a parfaitement résumé la situation : l’amendement du Gouvernement opère une synthèse des différents amendements qui ont été déposés. Nous allons donc retirer aussi le nôtre, l’amendement n° 50, au profit de l’amendement n° 73 rectifié.
Un sujet reste en débat, soulevé par M. Abate : dans cette synthèse, les fonctionnaires n’auraient-ils pas été oubliés ? Il est exact qu’un problème se pose à cet égard et qu’il n’est pas traité dans le cadre de cette proposition de loi. Seulement, la manière dont les auteurs du sous-amendement n° 88 proposent de le traiter n’est pas satisfaisante, compte tenu de la complexité du statut de la fonction publique et des implications nécessaires dans la loi pour assurer la solidité juridique du dispositif, qui sont extrêmement importantes. Mme la ministre l’a bien démontré : dans le cadre du travail de dentelle que nous accomplissons, ce sous-amendement ne peut pas s’intégrer à l’amendement n° 73 rectifié.
Mme la ministre nous a assuré que le projet de loi Sapin II, qui sera examiné par le Parlement dans quelques jours, traiterait de cette question et aborderait la situation des fonctionnaires. Le débat n’est donc pas remis aux calendes grecques. Dès lors, il serait préférable que le sous-amendement soit retiré et que nous réalisions l’unanimité la plus forte possible.
Mme la ministre n’est certes pas de ceux qui pensent que les fonctionnaires devraient être en dehors du circuit de lancement d’alertes, parce qu’ils ont un statut particulier et que, en définitive, ils sont presque protégés par leur fonction, le signalement étant pour eux un devoir. Nous avons entendu tout à l’heure des arguments visant à nier qu’il faille aborder le cas des fonctionnaires. Nous, nous ne le nions pas, mais je crois que cette question doit être abordée à la faveur d’un autre texte. En effet, rien ne serait pire que de mettre au point un dispositif qui ne tiendrait pas sur le plan juridique et qui serait cassé, car on dirait alors que ce n’est pas le dispositif qui a été cassé, mais l’intention même dont il procède.
Je retire l’amendement, monsieur le président.

À M. Leleux, qui s’inquiète très justement des malveillances auxquelles pourraient se livrer de faux lanceurs d’alerte, qui seraient en réalité de sombres bandits, je fais observer que le cadre général défini par cet amendement prévoit des sanctions.
Cet amendement visant à fixer un cadre global, nous ne serions pas cohérents avec nous-mêmes en le retirant purement et simplement.
L'amendement n'est pas adopté.

L’amendement n° 36 rectifié bis est retiré.
Monsieur Abate, le sous-amendement n° 88 est-il maintenu ?

Nous ne pouvons pas retirer ce sous-amendement, vu que nous n’avons pas cessé d’évoquer l’importance des journalistes dans le dispositif – souvenons-nous de l’exemple dont a parlé Mme Blandin – et celle des alertes au sein du secteur public.
Il est vrai, madame la ministre, que le dispositif que vous proposez marque un progrès ; nous en convenons et nous serions un peu embarrassés de bloquer une avancée.
En revanche, j’aimerais obtenir une réponse à la question que je vous ai posée en ce qui concerne l’interprétation de l’expression « en dernier ressort ». Cette formulation ne porte-t-elle pas en germe, même si telle n’est pas votre volonté, l’impossibilité absolue d’une vraie protection ? En effet, quelle sera la protection s’il faut d’abord s’adresser à son chef de bureau, puis au supérieur de celui-ci, puis à son président-directeur général ? Il est tout de même un peu ennuyeux que nous n’ayons pas de réponse à cette question.
Je remercie l’ensemble des orateurs qui se sont exprimés ; tous ont reconnu le progrès juridique manifeste qui sera accompli si l’amendement n° 73 rectifié est adopté.
J’en viens à votre question, monsieur Abate. La procédure de dernier ressort vise à accorder notre droit avec une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, reprise par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui sera bientôt soumis à l’examen du Parlement.
Plus précisément, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans son arrêt du 12 février 2008 Guja c. Moldavie, que, « s’il importe que la personne concernée procède à la divulgation d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité compétente, la divulgation au public peut être envisagée en dernier ressort en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement ». À la lumière de cette décision, le Conseil d’État recommande une adaptation de notre droit visant en particulier à donner la priorité « aux canaux internes de diffusion, à l’intérêt public de l’information divulguée, à la pesée des risques que cette divulgation ferait encourir aux autorités publiques et aux intérêts qu’elles servent » ; il estime que la voie médiatique ne doit « être actionnée que de manière subsidiaire ».
En aucun cas cette procédure ne doit être un frein ; elle ne signifie nullement qu’un accord serait nécessaire pour passer à l’étape supérieure. Il s’agit seulement d’affirmer que la voie de l’alerte médiatique ne doit être empruntée qu’après qu’une autre a été tentée.

Monsieur Abate, compte tenu de la réponse de Mme la ministre, que décidez-vous ?

Nous aurons de toute façon un rendez-vous législatif important sur le sujet. Nous ne sommes pas absolument convaincus que, sans viser la loi du 13 juillet 1983, on assure aux fonctionnaires une protection effective, mais nous entendons l’analyse de Mme la ministre. L’histoire et les citoyens jugeront…
Je crois comprendre de votre interprétation de la jurisprudence européenne, madame la ministre, qu’il ne faut pas entendre l’expression « en dernier ressort » au sens d’une gradation. Si un lanceur d’alerte juge en toute indépendance qu’il est dans l’incapacité de faire autrement, il n’aura pas à attendre pour avertir un journaliste. Sommes-nous bien d’accord sur ce point ?

On l’aura compris, nous ne sommes pas complètement satisfaits par la rédaction de votre amendement. Toutefois, le débat a été intéressant et nous n’allons pas nous opposer à une disposition qui représente un progrès ou freiner sa mise en œuvre au motif qu’elle ne répond pas complètement à nos aspirations.
Lors des prochains rendez-vous, nous serons particulièrement vigilants à ce que le dispositif soit mis en œuvre de manière très précise et résolue. Pour ce faire, il faut inverser la charge de la preuve, c’est-à-dire qu’il faudrait, à la limite, que le fonctionnaire ou le salarié, s’il ne lance pas l’alerte, soit poursuivi pour non-assistance à personne en danger. C’est dans cet esprit que nous avons déposé notre amendement et notre sous-amendement.
Cela étant, je retire le sous-amendement.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'article 1er quater est rétabli dans cette rédaction.
Titre Ier
LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve de l’article 1er. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

L'amendement n° 14, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Laurent.

Cet article est mal ficelé. On nous le présente comme un dispositif tendant à renforcer la protection des médias audiovisuels. Or on pourrait l’interpréter autrement : en confiant de nouveaux pouvoirs au CSA, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, on renforce le contrôle exercé sur les médias. Dans un texte consacré à l’indépendance de la presse, c’est un problème…
Sous cette forme et sans autre précision, l’article tel qu’il est rédigé ne nous convient pas. Il comporte un flou qu’il convient de dissiper. Le renforcement de l’indépendance des médias suppose en effet une autre disposition que celle-là.
Si notre amendement de suppression n’est pas adopté, nous présenterons un autre amendement tendant à renforcer l’indépendance des médias.

L’article 2 précise la nature des compétences du CSA en matière d’indépendance de l’information, tout en tenant compte bien entendu de l’objet de la proposition de loi.
Monsieur Laurent, vous exprimez la crainte d’un contrôle excessif du CSA sur les entreprises audiovisuelles. Vous préféreriez confier le contrôle de la déontologie aux journalistes eux-mêmes.
Vous avez raison de vous interroger sur le sujet, puisque les diffuseurs audiovisuels ont eux-mêmes évoqué le risque d’un contrôle ex ante du Conseil supérieur de l’audiovisuel. C’est pour limiter le risque d’un contrôle inopportun du Conseil que nous avons modifié le texte de l’article 2 en commission. Parce qu’il me semblait important de bien préciser les compétences du CSA, nous avons notamment substitué le mot « veille » au mot « garantit » : désormais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel « veille » à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’actuelle rédaction de l’article 2, tout comme sa version initiale, se contente d’apporter des précisions sur le pouvoir général de recommandation que le CSA détient déjà. En effet, l’autorité de régulation fixe d’ores et déjà aux éditeurs un ensemble d’obligations déontologiques par le biais de son pouvoir de recommandation et de son pouvoir conventionnel.
Par cet article, le CSA est intégré dans le dispositif prévu en faveur de la protection de l’honnêteté, de l’indépendance et du pluralisme de l’information. Il me semble que la précision est utile : dans ce domaine, le CSA doit jouer le même rôle que celui qu’il remplit de façon plus générale en matière de respect des obligations déontologiques.
Je ne peux donc être que défavorable à l’amendement.

Il faut être conséquent : maintenir l’article 2 implique de renforcer le dispositif. Sinon, comment le CSA fera-t-il pour garantir l’indépendance et le pluralisme de l’information ? Sur quoi s’appuiera-t-il pour remplir sa mission ? Rappelez-vous du débat que nous venons d’avoir au sujet des chartes, mes chers collègues !
Si les moyens d’action des rédactions restent insuffisants et ne sont pas renforcés par la proposition de loi, le CSA ne pourra pas exercer sa compétence. Il ne suffit pas d’écrire dans un texte qu’il détient une compétence pour qu’elle s’exerce ; il faut lui donner les moyens de pouvoir l’exercer, sinon cela n’a aucun intérêt. J’entends d’ailleurs défendre un amendement allant en ce sens.
En attendant, après avoir entendu les explications et compte tenu des intentions, je retire cet amendement.

L’amendement n° 14 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2-…ainsi rédigé :
« Art. 2 -… – Une société des rédacteurs ou une société des journalistes est constituée dans toutes les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique employant au moins quinze journalistes ou rédacteurs. Le livre IV de la deuxième partie du code du travail s’applique aux membres de ces associations. Dans les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle employant moins de quinze journalistes ou rédacteurs, des sociétés des rédacteurs ou une société des journalistes peuvent être créées par convention ou accord collectif de travail.
« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions applicables à toute personne ou structure s’étant rendue coupable d’obstruction à l’instauration d’une société des rédacteurs ou une société des journalistes dans le cas d’une instauration obligatoire. »
La parole est à M. Pierre Laurent.

Je serai bref, dans la mesure où je viens d’expliquer pourquoi nous avons déposé cet amendement.
Pour renforcer l’indépendance des médias, nous voulons rendre obligatoire la création de sociétés de rédacteurs. Le contrôle de l’indépendance des rédactions ne peut pas être du seul ressort du CSA, il faut y associer un dispositif plus complet.

L'amendement n° 65, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :
« Art. 2 … – Il est institué une commission nationale paritaire de déontologie du journalisme chargée de veiller à l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions. À cette fin, elle donne un avis sur les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de service de télévision et de radio prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour garantir le respect de l’article 2 bis de la présente loi. Elle veille à ce que les intérêts économiques des éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs actionnaires et de leurs annonceurs ne portent pas atteinte au respect de ces principes. Elle peut émettre des recommandations et demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’adresser des mises en demeure ou des sanctions aux éditeurs de service qui ne respectent pas ces principes.
« Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation à la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme, ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire des représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des femmes et des hommes. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

L’amendement a pour objet de confier à une instance nationale paritaire plutôt qu’au Conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de garantir l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions. En effet, sans remettre en cause le travail du CSA, il n’en demeure pas moins que le pouvoir politique intervient dans la nomination de ses membres. Surtout, le nombre de ses missions ne cesse de s’accroître !
Confier la tâche de garantir l’indépendance de l’information à une instance comprenant des représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des représentants de l’État, sur le modèle de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, éviterait tout risque de soupçon, contribuerait à établir un cadre et à retenir des critères et constituerait le modèle le plus pertinent pour faire respecter les règles de déontologie et contrôler les éventuelles pressions politiques ou économiques que pourraient subir les journalistes.

L’amendement de Mme Blandin vise à créer une instance nationale chargée de la déontologie des journalistes.
Tout d’abord, je voudrais faire remarquer que cette mesure ne correspond pas au choix initial des auteurs des deux propositions de loi.
Ensuite, et surtout, cette piste n’a fait absolument l’objet d’aucune expertise. Dans le temps qui nous était imparti, c’est-à-dire depuis que ces textes ont été inscrits à l’ordre du jour des assemblées, nous n’avons pas eu les moyens d’étudier le sujet plus en détail.
Je note également qu’une telle disposition ne fait pas l’objet d’un accord unanime. En effet, elle n’a pas été évoquée par les directeurs de l’information des médias que la commission a auditionnés, même si elle résulte d’une demande exprimée par de nombreux syndicats de journalistes.
Le dispositif proposé soulève en outre un certain nombre d’interrogations. D’une part, on ne connaît pas les moyens dont cette instance pourrait disposer. Disposerait-elle de services spécifiques ? D’autre part, on ne connaît pas les pouvoirs dont elle pourrait se prévaloir pour déterminer si, par exemple, les chaînes sont bien indépendantes des actionnaires et des annonceurs.
Je ne pense pas non plus que l’heure soit à la création de nouvelles autorités indépendantes.
Enfin, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est une autorité indépendante dotée de services et de pouvoirs de contrôle. Une simple commission nationale paritaire ne pourrait pas exercer sa mission de la même manière que le Conseil sauf, encore une fois, à créer une autorité dotée de moyens importants, ce qui aurait pour effet de mettre cette instance en concurrence avec le CSA, du moins pour ce qui concerne l’audiovisuel.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, tout comme sur l’amendement n° 13.
Le Gouvernement préfère s’en tenir à la logique retenue dans la proposition de loi : le CSA doit veiller à l’existence des chartes et des comités d’indépendance ou de déontologie, selon la dénomination retenue ; il doit également disposer d’un pouvoir de sanction en cas de non-respect de ces obligations de moyen. Il faut que ces chartes existent et que ces comités soient mis en place.
Le Gouvernement n’est donc pas favorable à ce que la mise en place de sociétés de journalistes au sein de chaque entreprise de presse ou audiovisuelle soit rendue obligatoire, dans la mesure où ces sociétés doivent pouvoir conserver la liberté d’organiser leur rédaction selon leur volonté.
Le Gouvernement est également défavorable à la création d’une commission nationale paritaire de déontologie, d’autant qu’il semblerait, d’après le dispositif de l’amendement, que des représentants de la presse puissent en être membres, ce qui en ferait un conseil de presse. Or ce sujet a déjà suscité des débats et n’est absolument pas mûr.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l’amendement n° 65.

Je vais maintenir mon amendement pour le principe, même si j’ai parfaitement entendu les propos tenus par Mme la rapporteur sur l’absence d’expertise dont aurait fait l’objet ce dispositif.
J’ajoute être complètement d’accord avec ceux d’entre nous qui considèrent qu’il ne faut pas mettre en place de nouvelles autorités ou des comités Théodule, dans la mesure où nous nous trouvons dans une période où il faut faire des économies.
Cela étant, mes chers collègues, je vous alerte sur le fait que l’on crée de nouvelles missions, qu’on les confie à des autorités existantes, sans pour autant leur fournir des effectifs supplémentaires. Et, après, on parlera des difficultés au travail !
Je comprends qu’il faille refuser de créer des organismes supplémentaires, mais il faut avoir en tête que l’instauration de nouvelles missions sans effectifs supplémentaires est synonyme pour ces autorités de nouvelles difficultés en perspective.

Les deux amendements qui ont été présentés, même si l’un d’entre eux a déjà été rejeté, renvoient à des débats anciens.
Il faudra certainement que la profession soit capable de se rassembler pour faire des propositions concrètes en matière de déontologie. Cela fait des années que j’entends sans arrêt des avis différents sur le sujet. On peut, par exemple, créer une commission, comme vous le proposez, ma chère collègue. J’ai reçu à plusieurs reprises des personnes qui m’ont suggéré la même chose. Les assises de la presse auraient pu faire émerger une instance de ce type.
On a également abordé la question du statut des rédactions. On a même parlé d’une loi. Si les rédactions étaient constituées en entités juridiques, cela simplifierait en effet beaucoup nos débats.
Pour autant, déposer des amendements sur un dispositif qui a sa propre cohérence ne me paraît pas pertinent. Et la cohérence dans cette loi, mes chers collègues, c’est le CSA ! Je sais qu’il existe une certaine méfiance à son égard, mais attention à ne pas trop charger la barque ! Il faut arrêter de répéter qu’il n’est pas une autorité indépendante, alors même que nous avons restauré son indépendance en prévoyant que ses membres sont forcément désignés de façon consensuelle grâce à un vote à la majorité des trois cinquièmes.
Cela étant, les amendements posent des questions importantes. S’il faut réclamer davantage d’effectifs pour le CSA, madame Blandin, faisons-le au moment de l’examen du budget. Ce sera en effet à l’ordre du jour. En attendant, je pense sincèrement que créer une instance dont les missions seraient à peu près identiques à celles du CSA ne tient pas la route dans le contexte actuel, qui plus est si personne n’en définit la composition ou les missions et ne consulte l’ensemble de la profession concernée.
À mon sens, votre amendement est plutôt un amendement d’appel, et j’invite nos collègues à ne pas l’adopter.

Il me semble dommage de ne pas adopter ces amendements, parce que, je le répète, ils constituent le meilleur moyen pour que l’article 2 ne demeure pas un vœu pieux.

En l’occurrence, l’amendement de Mme Blandin n’a pas pour objet de créer une autorité indépendante de plus, puisqu’il est question de créer une commission nationale paritaire de déontologie.
Pour vraiment avancer sur le sujet, il faudrait marcher sur nos deux pieds. On peut certes faire jouer un rôle à l’autorité indépendante qu’est le CSA, mais il faut aussi donner des pouvoirs supplémentaires aux journalistes pour qu’ils puissent exercer leur rôle au sein de la profession.
Comme je l’indiquais précédemment, je note là une contradiction : lorsqu’on évoque les comités d’entreprise, on nous répond que ce n’est ni le lieu ni le moment d’en parler mais que les journalistes doivent vraiment disposer de davantage de pouvoir ; quand on débat de la manière de leur en donner davantage, on nous rétorque que ce n’est pas non plus le moment d’en discuter !
Quitte à adopter un article qui confie au CSA la mission de garantir l’indépendance et le pluralisme de l’information, faisons en sorte de voter un dispositif qui lui donne vraiment les moyens de l’exercer en accroissant le pouvoir d’autorégulation de la profession sur ces questions.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 51, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
à l'honnêteté,
La parole est à M. David Assouline.

Il n’est pas opportun de confier au CSA le soin de veiller à l’honnêteté de l’information et des programmes, au même titre qu’il veillera à l’avenir à leur indépendance et au pluralisme. Un tel contrôle par l’instance de régulation me semble de nature à permettre la remise en cause d’une ligne choisie, par exemple, par la presse d’opinion. On peut parfois juger cette presse malhonnête, mais elle doit pouvoir jouer son rôle !
Rien n’est moins subjectif que le terme « honnêteté » appliqué au traitement de l’information. D’ailleurs, il n’est nulle part prévu dans la loi de 1986 que le CSA a, au titre de ses missions, le devoir de contrôler l’honnêteté de qui que ce soit ou de quoi que ce soit !

Nous avons déjà eu ce débat en commission. Il nous est apparu difficile de confier au CSA la mission de veiller à l’honnêteté de l’information. Malgré tout, ce principe doit rester un objectif incontournable.
La commission a donc décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat et souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.
L’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que « la délivrance des autorisations d'usage […] pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre […] est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation ». Avant de lister les différents points sur lesquels portent les conventions, la loi prévoit bien que celles-ci doivent être conclues « dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi ». Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs souligné que ces conventions devaient impérativement respecter cette obligation.
La notion d’« honnêteté » appliquée à l’information vise évidemment à créer, non pas un contrôle sur la presse d’opinion – cela n’a jamais été appliqué en ce sens –, ce qui serait par ailleurs absolument en dehors du rôle du CSA, mais une obligation de vérifier le bien-fondé et les sources de l’information et d’être comptable du fait que l’information incertaine doit être présentée au conditionnel. Elle vise aussi à créer l’obligation pour l’éditeur de services, par exemple, de ne pas modifier le contenu et le sens des images grâce aux procédés technologiques dans le cadre des émissions d’information et d’en avertir le public, lorsqu’il le fait, dans le cadre des émissions qui ne sont pas des émissions d’information. Ce sont des engagements auxquels souscrivent les éditeurs au moment de la signature d’une convention avec le CSA et qui sont déjà prévus par notre droit.
À mon sens, le respect de l’honnêteté des programmes et de l’information figure déjà de façon générale parmi les missions du CSA lorsqu’il conclut des conventions avec les éditeurs. C’est pourquoi le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Le problème est que le passage de la loi de 1986 que vous venez de nous lire, madame la ministre, vise les conventions passées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. L’article 2 de la présente proposition de loi que je souhaite amender vise, quant à lui, l'honnêteté « de l'information et des programmes ». La rédaction retenue laisse entendre que le CSA pourra agir à l’avenir de manière plus réactive et plus régulière, ce qui peut susciter de sa part un certain interventionnisme. Or on a déjà pu voir combien les journalistes, les syndicats, voire les responsables d’entreprises de presse ont du mal à accepter que le CSA dispose d’une compétence en la matière. On a également pu l’entendre dans cet hémicycle.
Quand il est question de confier des missions au CSA en matière d’indépendance, de pluralisme ou de liberté de l’information, les choses sont relativement claires. Tout le monde souhaite également que l’honnêteté de l’information et des programmes soit garantie. Néanmoins, on peut craindre que le CSA ne se livre à des interprétations sur l’honnêteté des programmes qui ne conviennent pas à tout le monde.
En d’autres termes, madame la ministre, vous n’avez fait que décliner dans votre intervention ce qui est communément accepté dans le secteur audiovisuel, comme le fait qu’il est interdit de réaliser des montages en utilisant des images tronquées ou qu’il est obligatoire de vérifier ses sources.
S’agissant de la presse, il m’arrive fréquemment de penser, compte tenu de mes idées politiques, que certains titres sont tout simplement malhonnêtes. Pour autant, c’est leur droit de l’être d’une certaine façon, puisqu’ils relèvent de la presse d’opinion. Je ne voudrais pas que l’introduction du terme « honnêteté » dans le texte puisse entraîner des abus.
Cela étant, puisque vous me le demandez, madame la ministre, je retire mon amendement. J’ai posé le problème. J’espère qu’aucune controverse ne naîtra demain d’avis pris par le CSA sur le fondement de ce texte et qui porteraient atteinte à la liberté des journalistes et de la presse d’opinion.


Comme je l’ai indiqué précédemment, nous avons déjà modifié la rédaction de l’article 2 en commission. Je souhaite désormais apporter une précision à la notion de « programmes », car celle-ci vise de très nombreux contenus qui n’ont pas nécessairement de rapport avec l’information, comme la fiction, les jeux, l’animation ou certains documentaires.
Le présent amendement a pour objet de mieux circonscrire le rôle du CSA en faisant référence aux seuls programmes qui concourent à l'information, ce qui permet de prendre en compte les magazines, les documentaires sur l'actualité, la politique et l'histoire, ainsi que les émissions de divertissement qui reçoivent des personnalités politiques ou qui donnent lieu à des débats politiques.
La commission propose de circonscrire le champ d’application de cet article en précisant qu’il ne s’applique qu’aux programmes qui concourent à l’information. Je la remercie, car elle fait ainsi avancer les choses.
Nous faisions face à une difficulté jusqu’à présent. En effet, je m’étais opposé à l’Assemblée nationale à un amendement qui tendait à supprimer la référence aux programmes pour ne maintenir que la notion d’information. Or, nous le savons, il existe des programmes qui concourent à l’information, comme les documentaires ou les magazines. En réalité, l’amendement visait ces cas célèbres d’émissions, que chacun a à l’esprit, qui ne sont pas de pure information et qui sont produites par des sociétés extérieures pour différentes cases et sous différents formats.
Dans le même temps, la notion de « programmes » sans autre précision était probablement trop large et pouvait susciter des craintes chez d’autres responsables, comme ceux des programmes de divertissement, par exemple.
L’amendement contribue à lever une ambiguïté tout en visant bien la catégorie de programmes que l’on souhaite toucher, c’est-à-dire l’information, quel que soit son mode d’expression : journal d’information, magazine, documentaire, bref tout ce qui concourt à l’information. Le Gouvernement y est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
(Non modifié)
Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 80, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre pour l’application de l’article 30-8. »
La parole est à Mme la rapporteur.

Un consensus existe sur la nécessité de veiller à l'application par les médias audiovisuels des principes d'honnêteté – nous venons d’en débattre –, d'indépendance et de pluralisme de l'information et des programmes, sans pour autant confier au CSA la mission d'exercer sur eux un contrôle ex ante par le biais des conventions qu'il négocie avec eux.
Les comités de déontologie constituent l'outil privilégié pour faire respecter ces principes. Ce sont donc leurs modalités de fonctionnement qui ont vocation à figurer dans les conventions, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les différentes chaînes d'information. C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à remplacer la référence à l'article 3-1 par la référence à l'article 30-8 de la loi de 1986 relatif aux comités de déontologie.

L'amendement n° 15, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
principes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. La société des journalistes ou la société des éditeurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Nous sommes opposés à l’idée que le CSA soit le garant de l’indépendance, de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes dans les services audiovisuels et radiophoniques.
Par cet amendement, que l’on pourrait qualifier d’amendement de coordination, et au travers de ceux que nous défendrons aux articles suivants, nous proposons de modifier le texte qui nous est soumis.
L’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que la délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, ce qui équivaut de facto à l’autorisation d’émettre et donc d’exister pour les services concernés, est conditionnée à la passation d’une convention entre ledit service et le CSA.
Il convient à nos yeux de créer les conditions contribuant au respect des compétences de chaque partie, tout en maintenant le principe selon lequel la convention conclue doit retranscrire les mesures à mettre en œuvre ou les pratiques à préserver en vue du respect par les services de l’indépendance, de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes.
C’est dans ce cadre qu’il est proposé que la convention soit bien signée entre le CSA, compétent en matière de gestion de la ressource radioélectrique, le représentant de l’État en la matière et les services concernés, demandeurs d’un droit d’usage.
Toutefois, il convient de laisser aux sociétés des journalistes et aux sociétés des rédacteurs le soin de donner un avis motivé sur les mesures figurant dans la convention en vue du respect des principes d’indépendance, d’honnêteté et de pluralisme.

Comme cela fait plusieurs fois que j’entends que le CSA « garantit » l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes, je tiens à rappeler que j’ai modifié la rédaction de l’article 2 en commission en substituant le mot « veille » au mot « garantit ». Cette modification a pour objectif de nous prémunir contre le risque d’un contrôle ex ante du CSA sur les entreprises de l’audiovisuel.
L’amendement n° 15 vise à donner aux sociétés des journalistes un droit de regard institutionnalisé sur la convention signée entre l’éditeur de services et le CSA. Je rappelle que l’article 7 tel qu’il a été adopté en commission, et dont nous aurons à débattre tout à l’heure, prévoit déjà que les comités de déontologie pourront être saisis par les sociétés des journalistes dans le cadre du fonctionnement des rédactions.
L’amendement tend également à donner un rôle aux sociétés des journalistes dans les échanges entre l’éditeur de services et le régulateur. Je pense que celles-ci n’ont pas vocation à intervenir de manière institutionnalisée dans cette négociation, qui fixe les obligations du média vis-à-vis du CSA.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
L’amendement n° 80 vise à supprimer l’obligation de préciser dans les conventions les mesures nécessaires au respect des principes mentionnés à l’article 3-1, c’est-à-dire l’indépendance, le pluralisme et l’honnêteté de l’information et des programmes, ainsi que l’absence d’atteinte à ces mêmes principes par des annonceurs.
Or, depuis 1989, les conventions du CSA comportent de nombreuses précisions en la matière. D’ailleurs, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le Conseil constitutionnel en a fait une obligation pour l’instance de régulation dans une décision de 1989. Il a estimé que les dispositions des conventions relatives à l’honnêteté et au pluralisme de l’information avaient un caractère impératif.
Depuis plus de trente ans, toutes les conventions comportent des précisions permettant de garantir, par exemple, le bon déroulement des campagnes électorales, le recours aux images d’archives, les procédés de micro-trottoir, les références à l’antenne aux produits et services des actionnaires de la chaîne, le témoignage de mineurs, etc.
Il nous semble donc légitime que le CSA continue de poursuivre cette action, qui n’est pas contestée. Le Conseil pourra s’appuyer sur les nouveaux comités, mais ceux-ci ne se substitueront pas à lui.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 15 soulève deux difficultés.
D’une part, compte tenu de sa rédaction, son adoption reviendrait à supprimer la protection des éditeurs contre les pressions exercées par les actionnaires ou les annonceurs.
D’autre part, dans le cadre des modifications d’une convention entre le CSA et les éditeurs, il est proposé que la société des journalistes ou à la société des éditeurs émette un avis motivé. Or – je partage l’avis de la commission sur ce point –, il ne me paraît pas opportun que des tiers, fussent-ils des journalistes de la chaîne, puissent interférer dans la négociation des conventions entre le CSA et les éditeurs.
Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
(Non modifié)
Le huitième alinéa du I de l’article 33-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

L'amendement n° 16, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
principes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. La société des journalistes ou la société des éditeurs concernée donne un avis motivé sur les mesures proposées et peut faire des recommandations. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Cet amendement a les mêmes motivations que celui que nous avions déposé sur l’article 3.
Si nous récusons la légitimité du CSA pour contrôler l’indépendance, l’honnêteté et le pluralisme de l’information et des programmes, nous reconnaissons son importance capitale dans la gestion de la diffusion des programmes. Ce n’est pas noir ou blanc !
En ce sens, nous proposons que la convention, toujours signée entre le CSA et les services, fasse l’objet d’un avis motivé des sociétés de rédacteurs et des sociétés de journalistes, du moins s’agissant des mesures à mettre en œuvre pour le respect des principes d’indépendance, de pluralisme et d’honnêteté.
Cela nous semble un compromis tout à fait acceptable pour laisser à chaque partie le soin de gérer son champ d’intervention.
En effet, les sociétés de journalistes et les sociétés de rédacteurs sont les plus à même de donner leur avis sur la pratique journalistique au sein de leur rédaction. Il semble donc normal que ces structures puissent émettre un avis sur des mesures ayant des répercussions directes sur leur pratique quotidienne.
Partant d’un tel principe, et souhaitant l’appliquer à la convention prévue dans le cas de services utilisant les ondes hertziennes, il est cohérent de présenter cet amendement en vue d’une application pour les opérateurs de services diffusés par câble, satellite et dispositifs ADSL, en dehors des opérateurs reprenant intégralement les programmes de France Télévisions, de La Chaîne parlementaire et d’Arte.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons j’ai déjà avancées à propos des précédents amendements du groupe CRC.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
Après le 5° du I de l’article 28-1 de la même loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 sanctionné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° En cas de mises en demeure répétées du titulaire de l’autorisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour manquement aux principes et obligations définis au troisième alinéa de l’article 3-1. »
La parole est à M. David Assouline.

Nous proposons une voie médiane entre le texte adopté par l’Assemblée nationale et la solution retenue par la commission.
Le texte permet au CSA de s’opposer à la reconduction automatique de l’autorisation d’un diffuseur n’ayant pas respecté ses obligations légales d’indépendance et de respect du pluralisme sur plusieurs exercices.
L’Assemblée nationale avait prévu un simple constat de la part du CSA, ce qui ne signifie pas grand-chose juridiquement. S’agit-il d’un appel informel d’un conseiller du CSA au patron d’une chaîne ? D’une interpellation lors d’une audition publique ? Ou lors d’un entretien privé ? On ne le sait pas très bien.
Notre commission a donc souhaité encadrer juridiquement ces manquements et poser une condition de « sanction ». Or, comme nous le savons très bien, une sanction du CSA obéit à une procédure très lourde, est très rare et, surtout, n’intervient qu’après plusieurs mises en demeure ! Et la répétition de la sanction pour un même manquement sur plusieurs exercices est une solution un peu utopique.
Par cet amendement, nous proposons une voie médiane, en appréhendant des « mises en demeure », mais « répétées ».
Contrairement au constat, la mise en demeure constitue une véritable procédure engagée par le CSA, prévue aux termes de la loi de 1986. Sa mise en œuvre est moins lourde que la sanction et semble donc plus réaliste dans le cadre de manquements à des obligations d’indépendance et de pluralisme.
Par ailleurs, la substitution du mot « répétées » à l’expression « sur plusieurs exercices » nous semble préférable. Cela permettra de rendre le dispositif plus souple.
En résumé, nous avons le choix entre un dispositif quelque peu utopique et difficile à mettre en œuvre et une procédure qui serait très lourde. Je propose donc une voie médiane, pour introduire de la souplesse et permettre de rendre la sanction effective.

L'amendement n° 17, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sanctionné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18
par les mots :
constaté par la société des rédacteurs ou la société des journalistes directement concernée
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Cet amendement de coordination a les mêmes motifs que nos amendements visant à modifier les articles 3 et 4.
Il semble essentiel de s’assurer que les garants de l’indépendance, du pluralisme et de l’honnêteté de l’information et des programmes soient les sociétés de rédacteurs et les sociétés de journalistes, et non le CSA.
Encore une fois, c’est une exigence d’efficacité, en vue de respecter des principes démocratiques.
En ce sens, nous ne pouvons que souscrire à la volonté des auteurs de la proposition de loi de permettre des sanctions en cas de violation de ces principes d’indépendance, de pluralisme et d’honnêteté. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné, l’organe choisi, le CSA, n’est ni capable de permettre la concrétisation efficace d’une telle ambition ni légitime dans ce rôle.
Il nous semble alors essentiel de renforcer les pouvoirs des sociétés de rédacteurs et des sociétés de journalistes, qui sont mieux placées pour remplir cette mission.
Il paraît donc nécessaire de maintenir dans le texte la faculté donnée au CSA de ne pas renouveler tacitement une autorisation d’émettre et, ainsi, de réorganiser une procédure d’appel d’offres.
Toutefois, dans ces conditions, la sanction doit se baser sur l’appréciation non pas du CSA, mais des sociétés de journalistes et des sociétés de rédacteurs.

À l’Assemblée nationale comme au Sénat, nous avons réfléchi aux conditions de non-reconduction automatique d’une autorisation d’usage d’une fréquence hertzienne pour entrave aux principes et obligations en matière d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes.
Le texte, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, exigeait que les manquements aient été constatés. La commission de la culture du Sénat a choisi de substituer le mot « sanctionné » à celui de « constaté », les manquements devant se produire sur plusieurs exercices.
L’amendement de M. Assouline vise à trouver une voie médiane entre l’exigence d’une simple constatation des manquements et celle de leur sanction, comme le souhaite la commission.
À mon sens, la gravité du préjudice envisagé, à savoir le non-recours à une procédure de reconduction simplifiée, justifie la recherche d’une proportionnalité entre l’infraction et la sanction. Or le dispositif que M. Assouline propose ne tend pas encore complètement, même s’il s’en rapproche, vers cet objectif, auquel nous souscrivons tous. J’estime que nous devons encore y travailler.
En l’état, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 17, par cohérence avec notre position sur les amendements n° 14, 15 et 16.
La version initiale de l’article 5 permettait au CSA de refuser la reconduction d’une autorisation d’usage de fréquences hors appel à candidatures pour un motif tenant au non-respect constaté sur plusieurs exercices des principes d’honnêteté, d’indépendance, de pluralisme. Votre commission a souhaité en restreindre la portée en prévoyant que son non-respect doit avoir été sanctionné, et non pas seulement constaté.
Compte tenu des procédures de sanction du CSA, telles qu’elles ont été d’ailleurs précisées par le Conseil d’État, une telle restriction me semble de nature à faire obstacle à la mise en œuvre effective de la disposition, dans la mesure où les sanctions prononcées par le CSA sont rares et suivent un mécanisme de gradation qui peut être assez long.
En prévoyant de simples mises en demeure, et non pas nécessairement des sanctions, l’amendement n° 52 permet de faciliter la mise en œuvre de l’article 5.
Toutefois, sa rédaction soulève une difficulté. En principe, les manquements ne font pas l’objet de plusieurs mises en demeure. Après une première mise en demeure, normalement le CSA doit sanctionner la répétition. Aussi, l’hypothèse de mises en demeure répétées pour un même manquement n’apparaît pas évidente.
Par ailleurs, les manquements font plus souvent l’objet de mises en garde ou de rappels à l’ordre. C’est la raison pour laquelle le principe d’un constat par le CSA me semblait plus pertinent. Néanmoins, votre amendement permet de rendre effective la disposition prévue à l’article 5, qui risquerait de ne pas l’être si l’on devait encore attendre. C’est pourquoi j’émets, malgré tout, un avis favorable sur cet amendement.
L’amendement n° 17 tend à faire dépendre la décision du CSA d’un manquement constaté par un tiers, la société des rédacteurs ou la société des journalistes, ce qui me semble juridiquement délicat. En outre, cela placerait les journalistes dans une situation difficile, puisqu’ils auraient à demander au CSA de ne pas renouveler l’autorisation de la chaîne pour laquelle il travaille. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'amendement n° 52.

Honnêtement, quand des parlementaires essaient de faire des efforts pour lever les malentendus, il est dommage de s’en tenir à des positions figées !
J’aimerais bien que nous puissions aboutir sur le sujet. J’ai beaucoup travaillé pour que le dispositif soit acceptable par tous. Je demande donc que l’on entre dans les détails au lieu de reprendre rapidement les arguments avancés en commission.
Vous avez raison, madame la rapporteur : le constat auquel l’Assemblée nationale propose de s’en tenir ne signifie pas grand-chose. Nous avons besoin d’une rédaction plus précise. Vous proposez de substituer le mot « sanctionné » à celui de « constaté ». Toutefois, quand on connaît le processus de sanction par le CSA, qui est long et difficile, on sait qu’il ne se passera rien. Une telle rédaction revient donc à ôter toute portée à cet article ou, à tout le moins, à la restreindre.
Pour ma part, je parle de « mise en demeure » par le CSA. C’est beaucoup plus formel qu’un simple « constat » ; il y a une vraie procédure.
Si nous nous en tenions à un « constat », on nous reprocherait d’avoir légiféré au profit du seul CSA et d’avoir créé un leurre, l’article 5 devenant alors impossible à mettre en œuvre.
Je m’attendais vraiment à ce que ma proposition nous rassemble et soit soutenue par Mme la rapporteur, à laquelle je voudrais demander, dans une dernière tentative, de revenir sur sa position.

Je mets aux voix l'amendement n° 52.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 232 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 17.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° Après le 6° de l’article 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 30, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « et au 7° ».

L'amendement n° 18, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
après avis de la société des journalistes ou de la société des rédacteurs directement concernée
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Cet amendement s’inscrit dans la même logique que nos précédents amendements.
Comme je l’ai indiqué, les journalistes ne sont pas les seuls salariés concernés par le respect, par l’éditeur, des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme. D’autres salariés participent à l’élaboration de la programmation et des intervenants extérieurs conçoivent des programmes.
Aussi, pour les raisons que j’ai déjà exposées, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 83, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l'article 80, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
La parole est à Mme la rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 6 est adopté.
L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30 -8. – Un comité de déontologie indépendant est institué auprès de toute société éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir de sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par la société des journalistes. Il transmet un bilan annuel au Conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi qu’au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à l’indépendance des comités de déontologie dont les modalités de fonctionnement sont fixées par la convention qu’il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.
« Les membres des comités sont nommés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société à l’exception du médiateur lorsqu’il existe qui est membre de droit. La nomination des membres, qui respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel qui dispose alors d’un délai de deux mois pour s’y opposer par un avis motivé.
« Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »

L'amendement n° 19, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Patrick Abate.

L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement n° 20, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30 -8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de journalistes et d’organisations représentatives des salariés est institué auprès de toute société ou entreprise éditrice de presse ou de communication audiovisuelle qui diffuse des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe, par les organisations représentatives des personnels ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.
« La composition de ce comité respecte une représentation à parité. »
La parole est à M. Patrick Abate.

L'amendement n° 20 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner, Manable, D. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
il peut
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
être saisi de sa propre initiative ou par toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, subit des pressions au sens de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou être consulté, pour avis, par le médiateur lorsqu’il existe.
La parole est à Mme Sylvie Robert.

Cet amendement vise à définir les conditions de saisine des comités de déontologie.
Nous sommes opposés, tout comme Mme la rapporteur, à la solution préconisée par l’Assemblée nationale : la saisine des comités par toute personne sans qu’aucun intérêt à agir la justifie.
Néanmoins, nous souhaitons reprendre la solution pour laquelle nous avions opté aux termes de notre propre proposition de loi : autosaisine du comité, bien entendu, mais également saisine par toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions, dans la presse ou dans l’audiovisuel, n’aurait pas pu exercer son droit d’opposition ou n’aurait pas pu accomplir, sans pression, cette fonction.
Ces personnes habilitées à saisir le comité pourraient ainsi être des journalistes, mais aussi des collaborateurs d’une société de production indépendante de la chaîne qui aurait effectué une commande et à propos de laquelle elle serait intervenue de manière illégale ou en situation de conflit d’intérêts.
Il s’agit bien, par l’instauration de ces comités, de proposer aux professionnels de la presse et de l’audiovisuel une voie de recours contre les abus qu’ils pourraient subir dans l’exercice de leurs fonctions.
Bien entendu, le médiateur de la société concernée, quand il existe, pourra lui-même consulter le comité. Comme à l’accoutumée, il fera office de filtre des saisines abusives.
Néanmoins, le médiateur n’existe pas dans toutes les sociétés. Afin de ne pas défavoriser les entreprises qui ne bénéficient pas de sa présence, nous souhaitons que son rôle soit limité à une simple consultation des comités.

L'amendement n° 84, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
de sa propre initiative
insérer les mots :
ou à la demande d'un journaliste invoquant le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
La parole est à Mme la rapporteur.

Afin de permettre à un journaliste de se prémunir contre des interventions remettant en cause son indépendance, cet amendement vise à élargir la saisine des comités d'éthique à tout journaliste qui invoquerait le respect des dispositions de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
ou par la société des journalistes
par les mots :
, par la société des journalistes, par les salariés et leurs représentants ou, s’agissant des programmes fournis à la société, par leurs auteurs ou producteurs
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de compléter la liste des personnes autorisées à consulter le comité institué par l’article 7 de la présente proposition de loi.
Il semble en effet pertinent d’étendre, au-delà des seuls journalistes, à tout salarié de la société, ainsi qu’à ses représentants, la possibilité de consulter le comité sur des faits susceptibles de porter atteinte aux principes de la loi.
Il est également opportun d’élargir une telle faculté à certains intervenants extérieurs bénéficiant d’un réel intérêt à agir en matière d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, selon la logique qui nous a conduits à modifier la définition. Je pense notamment aux auteurs et aux producteurs de programmes fournis à la société.
Tel est l’objet de cet amendement, au profit duquel je sollicite le retrait des amendements n° 53 rectifié et 84.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 53 rectifié et 74 ?

Chacun l’a compris, ces amendements portent sur les modalités de saisine des comités de déontologie.
La commission a reconnu l’utilité de permettre aux journalistes de saisir directement les comités de déontologie ; c’est d’ailleurs le sens de notre amendement. Mais nous jugeons que la rédaction proposée à l’amendement n° 53 rectifié est trop large, ou à tout le moins trop imprécise, puisqu’elle vise tous les salariés.
D’ailleurs, le texte initial de la proposition de loi disposait que ce comité pouvait être saisi par « toute personne ». Lorsque nous avons auditionné les entreprises du secteur de l’audiovisuel, nous nous étions alors fait la réflexion qu’une faculté aussi largement offerte n’aurait pas manqué de susciter une inflation de demandes et qu’il fallait circonscrire le champ des personnes autorisées à saisir ce comité aux journalistes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 74 du Gouvernement a un objet encore plus large, puisqu’il vise également les producteurs. Or le comité de déontologie n’a pas vocation à arbitrer des différends relatifs aux relations du travail ; il doit se prononcer sur les strictes questions de déontologie.
C’est pourquoi la commission a privilégié l’autosaisine de ce comité ou une consultation pour avis par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par la société des journalistes, de même qu’une saisine directe par les journalistes faisaient l’objet de pressions.
Selon nous, le fait d’autoriser la saisine du comité aux producteurs extérieurs à la société qui édite le service audiovisuel constituerait une atteinte sérieuse à la liberté éditoriale. Un prestataire extérieur ne peut pas se voir reconnaître la possibilité de remettre en cause les décisions de programmation d’un éditeur de services. Il est habituel qu’un programme commandé pour un prime time soit finalement diffusé sur une autre tranche horaire.
Si un problème déontologique apparaît, le producteur ou l’auteur auront tout loisir d’alerter la société des journalistes, qui doit, me semble-t-il, être l’interlocuteur privilégié en matière de déontologie et qui a, elle, le pouvoir de saisir le comité de déontologie.
J’attire votre attention sur un point. Dans le cas où un producteur saisirait lui-même le comité de déontologie, on peut s’interroger sur les liens de travail qui subsisteraient entre lui et l’entreprise. Se verrait-il confier d’autres commandes ?
En tout cas, les éditeurs de programmes audiovisuels se sont montrés extrêmement réservés, voire hostiles à cette proposition, invoquant une réelle ingérence dans le fonctionnement habituel.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 53 rectifié et 84 ?
J’ai sollicité tout à l’heure le retrait de ces amendements au profit du nôtre.
L’amendement n° 53 rectifié semble avoir pour objet d’étendre à d’autres personnes que les journalistes la protection de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881. Une telle disposition est contestable, car elle conditionnerait le déclenchement de la saisine au fait d’avoir subi des pressions ou d’être en train d’en subir. La rédaction que nous proposons me paraît plus complète.

La difficulté de savoir qui peut saisir le comité de déontologie tient au fait que la chaîne emploie des salariés pour s’occuper de l’information, mais commande les enquêtes à des sociétés de production dont les employés ne sont pas les siens.
Comment étendre les règles à des non-salariés de l’entreprise ? Nous avons donc décliné l’ensemble de ceux qui pourraient saisir le comité.
Madame la ministre, nos amendements étant quasiment identiques, je vous aurais presque demandé de retirer le vôtre. Néanmoins, si j’ai bien compris, vous proposez que le comité puisse être saisi par un tiers, et pas seulement par les personnes subissant des pressions. Selon vous, mon amendement tend à étendre trop largement une telle possibilité à des personnes qui ne sont pas directement visées.
À mes yeux, votre amendement présente un avantage. Les salariés peuvent éprouver des difficultés à agir directement, et non par le biais de leurs représentants, délégués du personnel ou délégués syndicaux. Mon amendement tend presque à créer une obligation, car seule la personne qui subit les pressions pourrait agir.
Par conséquent, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° 74, qui paraît plus efficace.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 54, présenté par MM. Assouline et Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lors de la nomination des membres des comités de déontologie, veille à leur indépendance. Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
« Les modalités de fonctionnement des comités de déontologie sont fixées par la convention qu’il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

L’idée de la commission, soumettre les comités à un contrôle du CSA comme celui qui est effectué sur les services de diffusion, nous semble dangereuse.
Il ne revient pas à l’instance de régulation de vérifier l’indépendance des décisions des comités et de pouvoir s’immiscer à tout moment dans le fonctionnement d’une instance de contrôle des services qu’elle contrôle.
Nous souhaitons donc que le CSA dispose au départ seulement d’un droit de regard sur la nomination des membres de ces comités et qu’il se borne à vérifier si ceux-ci remplissent bien les conditions légales d’indépendance sur le plan économique et juridique, conditions dont nous rappelons les critères dans le dispositif.

Cet amendement vise à revenir à une rédaction proche de celle de l’Assemblée nationale pour garantir l’indépendance des membres des comités de déontologie, en définissant des règles d’incompatibilité fondées sur l’existence de relations contractuelles depuis un certain nombre d’années avec le groupe de médias concernés.
Je me suis longuement entretenue avec les acteurs concernés, les entreprises audiovisuelles, pour mesurer l’applicabilité d’une telle mesure. La commission a alors proposé une autre méthode, sur laquelle vous souhaitez revenir.
Ainsi rédigé, votre amendement tend à limiter à l’excès les possibilités de nomination des membres des comités, et il ne permet pas de bien identifier les rôles respectifs de la direction de la société et du CSA. Toutefois, il ne prévoit pas d’interdiction particulière d’exercer des fonctions à l’issue du mandat de membre d’un comité, ce qui constitue un progrès par rapport à la rédaction de l’Assemblée nationale.
Notre amendement permet une vraie clarification, en visant à réaffirmer la responsabilité de la société dans la défense de l’indépendance de l’information.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement tend à réintroduire certaines des garanties d’indépendance des membres des comités qui avaient été adoptées à juste titre par l’Assemblée nationale et que votre commission a souhaité supprimer au profit d’un contrôle exercé par le CSA.
Il est tout à fait nécessaire de prévoir de telles garanties, tant les conflits d’intérêts ne sont aujourd’hui plus supportables dans notre société.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Barbier, Collombat et Guérini, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les membres des comités sont nommés pour moitié par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, et pour moitié par les salariés.
La parole est à Mme Mireille Jouve.

Cet amendement vise à instituer une nomination paritaire des membres des comités de déontologie par les représentants de la direction et les salariés.
La proposition de loi prévoit une nomination uniquement par la direction. Cela n'est pas de nature à favoriser l'indépendance de ces comités, qui sont pourtant chargés de contribuer au respect de l’honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme de l'information et des programmes.
Une nomination paritaire des comités de déontologie par la direction et les salariés est davantage en mesure de garantir l'indépendance de ces comités, nécessaire pour faire respecter les principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme.

Comme nous le soulignons depuis le début du débat, les questions de déontologie ne relèvent pas de la compétence des organisations représentatives des salariés.
En revanche, il nous semble nécessaire de responsabiliser le conseil d’administration et le conseil de surveillance, car ils ont rôle à jouer au regard de la défense de l’indépendance de l’information. C’est en tout cas ce que nous a rappelé la présidente de France Télévisions lors de son audition devant la commission ; d’une manière générale, elle nous a beaucoup aidés pour améliorer ce texte.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il me paraît essentiel que la composition des comités reste entre les mains de personnalités extérieures aux entreprises ainsi contrôlées. Cela me semble un gage d’indépendance, sous le contrôle du CSA, évidemment avec un régime de prévention des conflits d’intérêts.
Je crains qu’une telle proposition n’aide pas à renforcer l’indépendance des comités, dès lors que des salariés pourraient y siéger. Cela risquerait de perturber la sérénité des débats, à tout le moins l’indépendance telle qu’elle sera regardée à l’extérieur.
Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.

L'amendement n° 66, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 38 de la même loi, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38 -1. – Toute société détenant des parts dans une société de service de télévision, dont le taux maximal est fixé par décret, est exclue des procédures de soumission aux marchés publics. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Il est essentiel que le monde médiatique soit coupé de la forme de conflits d’intérêts que représentent les liens entre l’information et la commande publique. Or nul ne peut nier l’existence d’une véritable confusion des genres lorsque de grandes entreprises qui s’occupent de l’eau, du secteur du bâtiment et des travaux publics ou de l’armement répondent à des marchés publics tout en possédant des médias importants !
Une résolution du Parlement européen du 21 mai 2013, intitulée Ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l’Union européenne, indiquait : « L’existence de groupes de presse détenus par des entreprises en mesure d’attribuer des marchés publics représente une menace pour l’indépendance des médias. »
Cette proposition de loi, au vu de son titre, ne devrait pas faire l’impasse sur une question aussi cruciale pour la démocratie.
Mon amendement tend donc à prévoir qu’un décret fixe la part maximale d’actions qu’une société peut détenir dans une société de services de télévision. Cette part maximale l’exclurait des procédures de soumission aux marchés publics.
À titre d’exemple, voilà plus d’une décennie, un énorme programme de construction de nouvelles prisons a séduit le soumissionnaire, qui s’occupait de béton tout en possédant un organe de presse ! Je peux vous le dire, les recherches des étudiants ont bien montré que les discours véhiculés par le média dont cette personne était propriétaire, en pleins liens d’intérêts, ne faisaient que l’éloge de la dépense vers le béton.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Cet amendement, en visant à interdire une société détenant un groupe de médias propriétaire d’une chaîne de télévision de concourir à des marchés publics, n’aurait ni plus ni moins pour conséquence de faire racheter certains médias français par des groupes étrangers.
Marquesd’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.

Une telle proposition ne tient pas non plus compte de l’histoire des médias français ; l’émergence de groupes privés spécialisés dans les médias a été empêchée. Je pourrais évoquer les groupes Havas et Hersant.
Il me semble essentiel aujourd’hui que des investisseurs français puissent participer à l’émergence de groupes de taille européenne pouvant investir dans le numérique et la création. Veillons avant tout, comme cela est prévu dans cette proposition de loi, à faire en sorte que ces groupes respectent l’indépendance de l’information et le pluralisme des médias dont ils sont propriétaires.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cette proposition de loi a le mérite de renforcer et de compléter les moyens de garantir l’indépendance de l’antenne, quelle que soit la nature de l’actionnariat, que ces activités le conduisent ou non à soumissionner à des marchés publics.
Ce dispositif, par sa nature transverse, me paraît répondre à la préoccupation de Mme Blandin, sans toutefois cibler certains secteurs et certaines prohibitions. Applicable à tous, il protégera en outre de l’influence des annonceurs.
Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable.

Je ne me faisais pas beaucoup d’illusions. Mais je tenais à ce que le sujet soit abordé.

L'amendement n° 66 est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, su spendue à treize heures quinze, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.