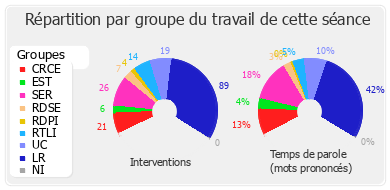Séance en hémicycle du 4 juin 2019 à 14h30
Sommaire
- Rappel au règlement (voir le dossier)
- Mises au point au sujet de votes (voir le dossier)
- Organisation et transformation du système de santé (voir le dossier)
- Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Communication relative à une commission mixte paritaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. David Assouline.

La séance est reprise.

Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 29 ter de notre règlement.
Hier, à Tripoli, un terroriste, qui sortait de prison, a tiré sur les forces libanaises. Cet attentat a été revendiqué par Daech.
Je souhaiterais que la commission des affaires étrangères de la Haute Assemblée organise un débat sur la situation au Liban. En effet, la déstabilisation du pays, en particulier du Liban-Nord, provoquerait un trouble difficilement réparable dans une région si prompte à s’enflammer.
Je souhaiterais également adresser mes condoléances aux victimes et aux Libanais, qui sont nos amis.

Lors du scrutin n° 127 sur l’amendement n° 712 rectifié, MM. Joël Labbé et Roland Dantec ont été enregistrés comme ayant voté contre, alors qu’ils souhaitaient voter pour.
Par ailleurs, lors du scrutin n° 129 portant sur les amendements identiques n° 1 rectifié quater, 542 rectifié quinquies et 762 rectifié, MM. Joël Labbé et Jean-Marc Gabouty ont été enregistrés comme s’étant abstenus, alors qu’ils souhaitaient voter pour.

Acte vous est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Lors du scrutin n° 129, Mme Sonia de la Provôté a été enregistrée comme ayant voté pour, alors qu’elle souhaitait s’abstenir.

Acte vous est donné de votre mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé (projet n° 404, texte de la commission n° 525, rapport n° 524, avis n° 515 et 516).
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du chapitre Ier du titre Ier, l’examen de l’article 2.
TITRE Ier
DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Chapitre Ier
Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie
I. – L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632 -2. – I. – Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;
« 2° Les médecins en exercice.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° A Les modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences ;
« 1° Les conditions et modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au I ;
« 2° Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine, et notamment d’organisation d’échanges internationaux ;
« 3° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants de troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;
« 4° Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées ci-dessus s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au 1° A du présent II ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;
« 5° Les modalités de changement d’orientation ;
« 5° bis Les modalités d’affectation des étudiants sur les postes mentionnés au 3° ;
« 6°
Supprimé
II. –
Non modifié
« Art. L. 632 -3. – Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves. »
II bis. –
Non modifié
III. – Le titre VIII du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1, la référence : « n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : « n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;
2° L’article L. 681-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 631-1 et L. 633-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna. » ;
3° L’article L. 683-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Polynésie française, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. » ;
4° L’article L. 684-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. »
III bis. – Au premier alinéa du III de l’article L. 713-4 du code de l’éducation, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° du II ».
IV. –
Non modifié
V. –
Non modifié
B. – Les modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022 sont précisées par décret.
VI. –
Non modifié
VII. –
Non modifié
1° L’article 20 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
2° Le III de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d’évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l’apport des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d’affectation.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 796, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
de troisième cycle
par les mots :
accédant au troisième cycle
II. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° bis Les modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au 3° permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;
La parole est à M. le rapporteur.

Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de correction d’une erreur matérielle.

L’amendement n° 654 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Celles-ci doivent permettre aux médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires d’être agréés maître de stage et d’accueillir des étudiants en médecine dans la maquette de leur formation de troisième cycle au même titre que les médecins traitants ;
La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Cet amendement vise à ce que les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires, tels que les 1 300 médecins généralistes de SOS Médecins France, puissent avoir toute leur place et être agréés maîtres de stage pour accueillir au sein de leur structure des étudiants, afin qu’ils puissent compléter leur formation à la prise en charge des soins non programmés.
Il ne s’agit pas vraiment d’un amendement d’appel. Je vais probablement m’entendre répondre que cet amendement est théoriquement satisfait. Toutefois, sur le terrain, la disposition n’est pas totalement effective. Il semblerait que ces structures aient des difficultés à se faire agréer maîtres de stage.
Je souhaite donc appeler l’attention de Mme la ministre sur ce sujet, sachant que les soins ambulatoires constituent aujourd’hui un pan important. Au moment où l’on cherche des maîtres de stage sur l’ensemble du territoire, il convient de nous assurer que les médecins de structures telles que SOS Médecins puissent être agréés maître de stages aussi facilement que les autres médecins généralistes.

Mme Guillotin l’a dit, cet amendement est théoriquement satisfait. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Toutefois, nous attendons que Mme la ministre nous fournisse quelques explications.
Le Gouvernement, qui remercie M. le rapporteur pour sa vigilance, est favorable à l’amendement n° 796.
L’amendement n° 654 rectifié est effectivement satisfait, puisque les textes encadrant la formation de troisième cycle des études de médecine prévoient les conditions d’octroi par l’ARS, sur proposition des facultés de médecine, des agréments permettant d’accueillir les internes en stage. Ils sont délivrés sur la base du projet pédagogique qui peut être proposé par le médecin généraliste aux internes qui réaliseraient un stage sous son encadrement.
La proposition d’accueil d’étudiants au sein des associations de PDSA est tout à fait possible en l’état actuel du droit. C’est donc, dans les faits, la présentation de projets pédagogiques par ces maîtres de stage et les demandes d’agrément déposées auprès des facultés de médecine qui permettront à l’ensemble de ces stages de se matérialiser.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mes chers collègues, je vous indique dès à présent que je suivrai la procédure exactement comme elle doit être menée. Ainsi, dans le cadre d’une discussion commune, s’il y a des explications de vote, je donnerai la parole sur chaque amendement. En outre, si l’adoption d’un amendement venait à faire tomber d’autres amendements, je vous préviendrais afin que vous puissiez intervenir au bon moment. En l’occurrence, si l’amendement n° 796 était adopté, l’amendement n° 654 rectifié tomberait.
Je mets aux voix l’amendement n° 796.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, l’amendement n° 654 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 392 rectifié, présenté par Mmes Taillé-Polian et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
, une fois leur nombre global déterminé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Cet amendement a pour objet de maintenir la disposition de l’alinéa 2 de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, afin que les ministres de la santé et de l’enseignement supérieur continuent de fixer le nombre d’internes à former par spécialité et par subdivision territoriale. En effet, certaines spécialités, notamment la gynécologie médicale – mais il en existe certainement d’autres – souffrent d’un manque d’effectifs. Il existe ainsi un risque, pressenti par les professionnels, d’extinction de la discipline. Nous souhaiterions avoir des garanties sur cette question.

Cet amendement prévoit la détermination du nombre de postes d’internes au niveau national préalablement à leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale, ce qui paraît aller de soi aux yeux de la commission des affaires sociales. L’alinéa 9 fait en effet référence à une répartition des postes ouverts aux étudiants de troisième cycle, ce qui signifie que le nombre de ces postes a nécessairement été défini avant de pouvoir être réparti. C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 642 rectifié ter, présenté par Mme Imbert, MM. Charon, Pointereau et Sol, Mme Malet, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Deromedi, Puissat, Deroche et Richer, MM. D. Laurent et Savary, Mme Deseyne, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
déterminés en concertation avec les représentants de la profession dans les départements
La parole est à Mme Corinne Imbert.

Il s’agit d’optimiser l’estimation des besoins en santé en lien avec tous les acteurs régionaux.
La responsabilité des universités à l’égard des départements qui les entourent est insuffisamment énoncée. L’université ne peut plus continuer de former des médecins sans se préoccuper de leur exercice dans les départements.

L’amendement n° 777 rectifié, présenté par MM. Gremillet, D. Laurent et Panunzi, Mmes Thomas, Chain-Larché et Deromedi, M. Pointereau, Mmes Garriaud-Maylam et Malet, MM. Brisson, Bonhomme et Karoutchi, Mme Lassarade et MM. de Nicolaÿ, Chatillon et Magras, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
déterminés en concertation avec les représentants de la profession des territoires
La parole est à M. Michel Magras.

L’amendement n° 642 rectifié ter, présenté par Mme Imbert, préconise la concertation avec les représentants de la profession dans les départements pour la répartition des postes ouverts aux étudiants de troisième cycle.
Quant à l’amendement n° 777 rectifié, il préconise la concertation avec les représentants de la profession dans les territoires au lieu des départements.
Je m’interroge sur la notion de représentants de la profession dans les territoires et celle de représentants de la profession dans les départements. Elles me paraissent beaucoup trop imprécises pour figurer dans la loi. De qui s’agit-il exactement ?
En tout état de cause, j’espère que les professionnels seront en effet consultés pour la détermination des postes d’internat, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi. Mme la ministre pourra nous le confirmer, du moins je l’espère, en nous indiquant quels organismes seront consultés. Dans cette attente, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Le territoire et ses particularités sont évidemment indissociables des choix que nous faisons en termes de démographie des médecins à former.
Les postes ouverts pour l’accès au troisième cycle sont répartis après avis de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé et sa déclinaison régionale. Dans cet organisme, une consultation des comités régionaux, au sein desquels figurent les professionnels du secteur, est prévue. Par conséquent, les acteurs du système de santé et des formations médicales sont représentés dans cet observatoire régional.
Je l’ai dit hier, nous pensons qu’il faut renforcer le pilotage de ces structures, qui évaluent la démographie médicale et les besoins en professionnels de santé. Nous souhaitons ainsi renforcer le pilotage régional des observatoires régionaux de la démographie des professions de santé.
Ces amendements sont déjà satisfaits, puisque les professionnels de santé participent à ces observatoires. Le Gouvernement demande donc leur retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 642 rectifié ter, qui se réfère aux départements, tend à délimiter un champ un peu plus large que celui qui vise les territoires. Son adoption permettrait de régler le problème des départements limitrophes d’une région dans laquelle il y a une université de médecine et un CHU, où les étudiants suivent leurs études.
Ainsi, l’Aisne ne fait pas partie de la région Grand Est, mais les étudiants originaires de ce département s’inscrivent volontiers en médecine à Reims. Il faut donc être attentif à la situation de ces territoires périphériques : il n’y a pas forcément d’adéquation géographique entre la région administrative d’origine et le lieu des études.

Je fais confiance à Mme Buzyn pour associer les acteurs aux décisions, mais il était important qu’elle s’y engage.
Je vais retirer l’amendement n° 642 rectifié ter, mais j’observe que Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a donné hier un avis favorable à un amendement à l’article 1er visant à instaurer une répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé : ma proposition me semblait aller dans ce sens. Il faut que les représentants des départements soient consultés, et je souscris sans réserve aux remarques de mon collègue René-Paul Savary.

L’amendement n° 642 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote sur l’amendement n° 777 rectifié.

Mme la ministre nous ayant expliqué qu’il est satisfait, je retire cet amendement, dont je suis cosignataire, mais j’adhère moi aussi sans réserve aux propos de mon collègue René-Paul Savary.

L’amendement n° 777 rectifié est retiré.
L’amendement n° 295 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette affectation s’effectue en priorité au bénéfice de ceux qui y ont effectué leur premier cycle lorsqu’ils en expriment le souhait dans le cadre de leur projet professionnel ;
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Avec cet amendement, nous nous plaçons au carrefour de trois problématiques : l’augmentation constante du nombre de jeunes qualifiés plus ou moins contraints de quitter leur département d’origine, faute de perspectives suffisantes ; l’aggravation des difficultés d’accès aux soins ; le manque d’infrastructures de formation aux professions de santé dans les territoires ultramarins.
Le dernier rapport de France Stratégie est édifiant : un Antillais sur quatre – et près d’un Guadeloupéen sur deux – âgé de 20 à 34 ans vit en France hexagonale ; 53 % des Guadeloupéens et 50 % des Guyanais diplômés du supérieur partent y chercher un emploi. Il y a là un sérieux problème pour le développement économique de ces territoires, qui vivent une véritable fuite des cerveaux, alors même que le taux de diplômés du supérieur y est encore inférieur à celui de l’Hexagone.
La situation sociodémographique des outre-mer conduit à un paradoxe spécifique : alors que les besoins en offre de soins y sont en moyenne plus élevés, l’accès aux soins y est rendu plus difficile. Cela tient évidemment au départ de nombreux jeunes médecins, mais aussi au vieillissement croissant de la population. Outre la question du vieillissement, il faut aussi prendre en compte les difficultés spécifiques de ces régions.
Je soulèverai par ailleurs, à la suite du député Gabriel Serville, la question des formations de santé dans les outre-mer : notre collègue a rappelé devant l’Assemblée nationale qu’il n’existait pas encore de cursus d’études de médecine complet dans ces territoires. Les étudiants sont donc obligés de partir effectuer leur deuxième cycle ailleurs, ce qui réduit de fait leurs chances d’exercer la spécialité de leur choix dans leur région d’origine.
Telles sont les raisons qui motivent notre proposition d’accorder une priorité d’affectation aux étudiants ultramarins qui le souhaitent.

Il me semble, madame Gréaume, que la préoccupation légitime que vous exprimez est satisfaite par l’alinéa 10 de l’article 2, qui porte sur l’affectation des étudiants sur les postes d’interne, et non sur la répartition initiale de ces postes par spécialité et par territoire.
L’alinéa 10 prévoit en effet que l’affectation des étudiants sur les postes d’internat tient notamment compte du parcours de formation antérieur et du projet professionnel des étudiants. Mme la ministre pourra d’ailleurs nous dire s’il est envisagé de prévoir des dispositions spécifiques aux outre-mer dans le décret prévu par l’article 2.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Madame la sénatrice, les outre-mer sont effectivement confrontés à des enjeux de santé publique et de démographie médicale d’une acuité particulière, dont le Gouvernement tient évidemment compte dans ses décisions. Le Livre bleu des outre-mer contient un chapitre dédié à la santé et à l’offre de soins, qui exprime nos ambitions en la matière. Des dispositifs spécifiques, comme les postes d’assistants spécialistes en outre-mer, financés par l’État, sont déployés.
Inscrire dans la loi une priorité d’affectation sur les postes d’interne pour les étudiants ayant effectué leur premier cycle dans ces territoires constituerait une rupture d’égalité. En outre, la prise en compte du parcours de formation et du projet professionnel permettra de valoriser les étudiants qui ont démontré un intérêt particulier pour ces territoires. Les textes réglementaires préciseront ces points.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Madame la ministre, j’ai bien compris l’argumentation de M. le rapporteur, nous expliquant que notre amendement était satisfait, mais je n’ai pas eu le sentiment, en vous écoutant, que vous alliez dans le même sens que lui. Notre groupe a à cœur d’évoquer les problèmes spécifiques des territoires ultramarins ; il y a vraiment, en la matière, beaucoup à faire. Si notre amendement est satisfait, nous en prendrons acte, mais peut-être pourriez-vous simplement, madame la ministre, repréciser votre pensée.
J’ai simplement relu, sans le dire, l’alinéa 10, que M. le rapporteur avait cité. Votre amendement est bel et bien satisfait par cet alinéa.

L’amendement n° 295 rectifié est retiré.
L’amendement n° 177 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Sueur et Montaugé, Mme Harribey, MM. Vaugrenard, Todeschini et Marie, Mme Lepage, M. M. Bourquin, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Duran, Mme Conconne, M. Lurel, Mme Artigalas, MM. Manable et Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Kerrouche, Courteau et Temal et Mme Monier, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
formation,
insérer les mots :
le fait d’avoir effectué un ou plusieurs stages dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins,
La parole est à M. Joël Bigot.

On le sait, trop de nos territoires sont touchés par la désertification médicale, et nos concitoyens sont trop nombreux à éprouver des difficultés à se soigner et à accéder à des services de soins de qualité. Même en Maine-et-Loire, département plutôt bien doté comparé à d’autres, je suis régulièrement sollicité par des habitants inquiets de voir le cabinet médical de leur commune fermer faute de personnel.
Notre rôle de parlementaires est de nous attaquer à ce problème et de permettre à chacun de pouvoir se soigner quel que soit son lieu de résidence, et ce dans les meilleures conditions possible.
Or force est de constater que le présent projet de loi ne répond pas aux attentes de nos concitoyens en matière de lutte contre les déserts médicaux ; nombre d’amendements en discussion en témoignent.
En cohérence avec la position que nous avons défendue en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, nous proposons une piste intéressante pour inciter les étudiants en médecine à effectuer des stages en zones sous-denses et à venir ainsi renforcer l’offre de soins dans les territoires les moins bien dotés.
L’accès au troisième cycle de médecine est conditionné par l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis des connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Les étudiants sont ensuite répartis sur des postes ouverts par spécialité et par subdivision territoriale. Leurs choix sont satisfaits ou non en fonction de leur classement, qui prend en compte leurs résultats aux épreuves, leur parcours de formation, leur projet professionnel et, le cas échéant, leur situation de handicap.
À ces critères, nous souhaitons ajouter celui d’avoir ou non effectué un ou plusieurs stages en zone sous-dense. Le dispositif de cet amendement n’impose rien ; il n’est qu’incitatif. Il s’agit de valoriser les jeunes qui ont entamé une démarche vertueuse en effectuant leurs stages dans des territoires où l’offre de santé est insuffisante.
Cette mesure suscitera peut-être des vocations chez des jeunes qui, une fois leurs études achevées, viendront s’installer dans nos territoires.

Si je résume, il s’agit de prendre en compte la réalisation d’un stage en zone sous-dense pour l’affectation des étudiants par spécialité et par subdivision territoriale à la fin du deuxième cycle.
Pour l’ensemble des raisons que nous avons déjà évoquées hier, le fait d’avoir effectué un stage en zone sous-dense ne nous paraît pas devoir orienter le choix par les étudiants d’une spécialité.
Si cette proposition était adoptée, un étudiant qui souhaiterait s’orienter vers une spécialité très pointue et qui présenterait des aptitudes en la matière serait défavorisé par rapport à un autre qui aurait fait, sur la base du volontariat, un stage de médecine générale en zone sous-dense. Encore une fois, posons-nous la question du profil que nous souhaitons pour les médecins de demain.
Je suis en revanche tout à fait favorable à ce que l’on valorise le fait d’avoir effectué, sur la base du volontariat, des stages en ambulatoire ou des stages hospitaliers supplémentaires pour l’orientation vers une spécialité. C’est d’ailleurs, semble-t-il, ce que prévoira le décret prévu à l’article 2, d’après les indications que m’a données la DGOS, la Direction générale de l’offre de soins.
Du strict point de vue de la formation médicale, je ne suis pas certain qu’un stage effectué spécifiquement en zone sous-dense apporterait quoi que ce soit. Avis défavorable
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 494 rectifié, présenté par MM. Chasseing, A. Marc, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled et Bonne, Mmes Deromedi, Guillotin et Noël, MM. Bouloux et Gabouty, Mme N. Delattre et MM. Mandelli, Laménie et Bonhomme, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, les modalités d’affectation s’effectuent dans le respect des conditions d’équité au regard des résultats des épreuves.
La parole est à M. Daniel Chasseing.

Afin de minimiser la part de subjectivité dans le jugement des jurys d’admission et d’éviter des distorsions importantes de traitement entre étudiants en fonction de leur région d’origine, ainsi que des disparités entre les facultés de médecine françaises, le poids des résultats aux épreuves devrait être prépondérant.

L’amendement n° 641 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Charon, Pointereau et Sol, Mme Malet, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Morisset, Mmes Deromedi, Puissat, Deroche et Richer, MM. D. Laurent et Savary, Mme Deseyne, M. Mouiller, Mme Gruny, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, les modalités d’affectation s’effectuent dans le respect des conditions d’équité au regard des résultats aux épreuves ;
La parole est à Mme Corinne Imbert.

Cet amendement, presque identique au précédent, est défendu, monsieur le président.

L’article 2 prévoit que plusieurs critères seront pris en compte pour l’affectation des étudiants à un poste de troisième cycle : les résultats à des épreuves spécifiques de compétences et de connaissances, auxquelles les étudiants devront avoir obtenu une note minimale, le parcours de formation des étudiants, leur projet professionnel, ainsi que, le cas échéant, leur situation de handicap.
Animé par la même inquiétude que les auteurs des amendements, j’ai interrogé la DGOS sur la hiérarchisation de ces différents critères. Elle m’a indiqué que les résultats aux épreuves de compétences et de connaissances continueront de tenir une place prépondérante pour l’orientation des étudiants en troisième cycle ; je l’ai d’ailleurs écrit dans mon rapport. Mme la ministre pourra sans doute nous le confirmer.
Il me semble donc inutile d’intégrer ces précisions dans la loi, d’autant que la rédaction des amendements pose plusieurs problèmes – il faudrait notamment définir précisément les notions d’égalité des chances et de conditions d’équité.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
La rénovation profonde des modalités d’accès aux études, manifestée notamment par la suppression des épreuves classantes nationales, ne signifie évidemment pas l’abandon du principe d’égalité entre les candidats.
Les textes réglementaires qui seront issus des concertations en cours préciseront que les épreuves écrites seront bien sûr anonymes. Comme j’ai eu l’occasion de le dire hier, il semble même que l’on se dirige vers des épreuves organisées à l’échelon national. Ces textes détermineront également les procédures permettant d’organiser les épreuves de vérification des compétences en situation, qui, par nature, ne sauraient être écrites, mais qui seront évidemment encadrées dans des conditions garantissant l’absence de liens d’intérêt entre examinateurs et candidats et l’équité de traitement entre ces derniers.
Par conséquent, il ne nous paraît pas nécessaire de faire figurer cette précision dans la loi. Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

L’amendement n° 494 rectifié est retiré.
Madame Imbert, l’amendement n° 641 rectifié bis est-il maintenu ?

Non, je le retire, monsieur le président, en remerciant M. le rapporteur d’avoir levé nos inquiétudes et Mme la ministre d’avoir apporté ces précisions, propres à rassurer tout le monde.

L’amendement n° 641 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Segouin, Mme Eustache-Brinio, M. Lefèvre, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Longuet, Revet et Morisset, Mmes Deromedi et Malet, MM. Genest, Mandelli, Laménie, Pellevat, Rapin, Cuypers et B. Fournier, Mmes Canayer, A.M. Bertrand et Lamure et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités de formation théorique des internes en médecine générale en matière de gestion du cabinet, de comptabilité et de fiscalité ;
La parole est à M. Vincent Segouin.

La gestion du cabinet ne doit pas représenter un frein à l’installation des nouveaux médecins généralistes. Or les futurs médecins n’ont que peu l’occasion, au cours de leurs études, d’aborder les principes économiques, financiers ou managériaux qui régissent la gestion d’un cabinet.
Cet amendement vise, par conséquent, à ce qu’une formation théorique leur soit dispensée au cours du troisième cycle de médecine. Cela répondrait à la demande de nombre d’entre eux.
À l’heure actuelle, un nouveau médecin généraliste préfère souvent s’installer en centre ou en maison de santé afin d’être entouré de confrères déjà installés. La méconnaissance des modalités de gestion d’un cabinet médical peut freiner des projets pourtant cohérents et viables. Dispenser une telle formation permettrait de favoriser les premières installations en cabinet et ainsi d’augmenter le nombre des installations dans les zones rurales, où il arrive que les centres de santé fassent défaut.

L’amendement de M. Segouin a pour objet de préciser que le décret en Conseil d’État qui déterminera l’organisation du troisième cycle des études de médecine devra fixer les modalités d’une formation théorique en matière de gestion des cabinets libéraux, de comptabilité et de fiscalité.
La commission étant opposée à l’inscription du contenu des études de santé dans la loi, son avis sur cet amendement est défavorable.
L’adoption d’une telle proposition pourrait en outre avoir un effet contre-productif, s’agissant de tous les autres contenus essentiels qui, a contrario, ne seraient pas mentionnés dans la loi.
Ce raisonnement et cet avis négatif vaudront pour tous les amendements dont l’objet est d’inscrire dans la loi l’enseignement de sujets comme l’homéopathie, l’aromathérapie, l’herboristerie, etc. Ce n’est pas à la loi de déterminer le contenu des études.

Je voudrais préciser, à l’intention de notre collègue, que certaines régions proposent déjà des modules pour préparer les étudiants à la mise en œuvre de leur projet professionnel et leur permettre d’acquérir des compétences de gestionnaire et de comprendre la fiscalité et l’organisation des territoires.
Ces modules ne sont sans doute pas suffisamment présents sur l’ensemble du territoire national, mais il existe aujourd’hui une volonté réelle de les généraliser, tant ils sont utiles à tous les jeunes qui les suivent.

C’est un amendement très pragmatique, inspiré par la réalité du terrain.
Pourquoi les jeunes médecins ne veulent-ils pas s’installer en cabinet ? Parce qu’entrer dans une SCM, une société civile de moyens, qui est encore la structure juridique régissant nombre de cabinets médicaux, c’est s’ancrer pour longtemps. Sortir d’une SCM, en effet, n’est pas facile ! C’est d’ailleurs pourquoi les professionnels exerçant en maison médicale préfèrent le cadre de la SISA, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
Le second frein à l’installation tient à l’embauche de personnel : les jeunes n’y sont pas du tout formés.
Je partage bien entendu l’avis du rapporteur : une telle formation ne doit pas être intégrée au cursus des études médicales. Pour autant, il faut vraiment que les futurs médecins soient accompagnés et préparés à faire face aux contraintes liées à l’installation. Il reste à déterminer s’il reviendra aux collectivités territoriales, à l’ARS ou à d’autres acteurs d’organiser cet accompagnement.

Je voudrais être sûr d’avoir bien compris : une telle formation, à défaut d’être inscrite dans la loi, sera-t-elle intégrée au cursus ? Fera-t-elle l’objet d’une généralisation au niveau national ?
Ce sont aujourd’hui les doyens des facultés de médecine qui organisent les modules de formation et déterminent quels sujets prioritaires nécessitent un enseignement.
Avec Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, nous avons pris l’engagement devant l’Assemblée nationale de communiquer aux doyens une liste de sujets extrêmement sensibles, évoqués par les parlementaires, qui mériteraient de faire l’objet d’un enseignement : entre autres, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, le handicap, psychique ou physique, les vulnérabilités.
L’idée est de ne pas inscrire ces sujets dans la loi, mais de sensibiliser les doyens des facultés de médecine au fait que vous tenez particulièrement à ce que ces enseignements soient dispensés.
Le thème évoqué ici sera ainsi mentionné dans le courrier qui sera envoyé aux doyens à la suite de nos débats, à charge pour ceux-ci, ensuite, d’évaluer les besoins de leurs étudiants en termes de modules de formation, de nombres d’heures, etc.
Compte tenu des difficultés en matière d’installation, il est évident que la tendance actuelle est plutôt à la généralisation de ce type de modules sur le territoire. Cependant, les étudiants qui ne souhaitent pas s’installer, parce qu’ils s’orientent vers une spécialité hospitalière par exemple, ne doivent pas avoir l’obligation de suivre un tel module. L’idée est donc de proposer ces formations, sans les imposer.

Je suivrai l’avis émis par la commission et par Mme la ministre : la loi ne doit pas fixer le contenu des études.
Reste que le sujet est très important. Il y a là une réelle difficulté que vivent concrètement les médecins, sur le terrain. Il faut que nous y apportions des solutions.
Élisabeth Doineau a expliqué que certaines régions agissaient déjà en ce sens ; il importe que des directives soient prises pour que de tels modules soient organisés dans l’ensemble des régions de France.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par Mmes Lassarade et Micouleau, MM. Brisson, Vogel, Morisset et Panunzi, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud et Bruguière, M. Genest, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pellevat et Piednoir, Mmes Chain-Larché, Thomas, Deroche et A.M. Bertrand, M. Poniatowski, Mme de Cidrac et MM. Laménie et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les modalités de mise en œuvre de la réforme ;
« …° La gouvernance de la réforme associant la représentation des établissements publics de santé. »
La parole est à Mme Florence Lassarade.

La mise en œuvre de la réforme du troisième cycle s’est traduite par l’affectation d’un plus grand nombre d’internes de médecine générale en ville et d’internes de phase socle en CHU.
Les établissements publics de santé ont dû s’adapter à cette évolution. Or force est de constater une hétérogénéité entre les régions en matière de politique d’agrément, et donc de répartition. Les interventions des ARS ont été très variables, s’agissant notamment du recours aux dérogations au taux d’inadéquation.
Il est aujourd’hui fondamental de revoir et de préciser les conditions de mise en œuvre des réformes des études médicales et le rôle des différents acteurs, notamment des coordonnateurs et des sociétés savantes.
Les établissements doivent également être mieux associés à la gouvernance et au suivi des réformes pédagogiques, et à ce titre intégrer la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie, la Cnemmop.

L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Bonne, Sol et Henno, Mmes M. Mercier, Malet, Puissat, Di Folco, Bonfanti-Dossat et Deroche, MM. Bascher, Savary, Hugonet et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Laugier et D. Laurent, Mmes Estrosi Sassone et Deromedi, M. Détraigne, Mmes L. Darcos et Bruguière, MM. Babary, Morisset, Vogel, Saury, Mayet, Genest, Karoutchi, Raison, Perrin, Mandelli, Pellevat, Laménie et B. Fournier, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme Imbert, MM. Rapin, Bouloux, Charon, Sido et J.M. Boyer, Mme Lamure et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La gouvernance de la réforme associant la représentation des établissements publics de santé ;
La parole est à M. Bernard Bonne.

Cet amendement est presque identique au précédent. Il importe que les établissements soient davantage associés à la gouvernance et au suivi des réformes pédagogiques et, à ce titre, intègrent la Cnemmop.

L’amendement n° 294, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités de représentation des établissements publics de santé dans le cadre de la gouvernance de la réforme ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Cet amendement constitue la reprise d’un amendement déposé par nos collègues du groupe de la gauche démocrate et républicaine, à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’associer davantage les établissements de santé à la gouvernance et au suivi des réformes pédagogiques.
Madame la ministre Frédérique Vidal, vous aviez répondu à notre collègue Pierre Dharréville que, « compte tenu du nombre, de l’importance et du caractère éminemment transversal des différentes réformes des études médicales en cours, [vous n’étiez pas] opposée à l’idée d’adapter le dispositif de gouvernance en vigueur pour assurer la représentation des parties prenantes directement concernées et l’articulation avec les réformes relatives aux formations non médicales ».
Je déduis de cette situation que vous vous apprêtez à approuver sans réserve notre amendement…

Ces amendements, quoique légèrement différents, sont inspirés par une même préoccupation.
Leurs auteurs souhaitent qu’il soit précisé que le décret en Conseil d’État qui réglera l’organisation du troisième cycle des études de médecine devra également fixer la gouvernance de la réforme, à laquelle devront être associés les établissements publics de santé.
La commission n’est pas favorable à cette précision, pour une raison de forme et une raison de fond.
Pour ce qui est de la forme, je ne vois pas bien à quoi se réfère la notion de « gouvernance de la réforme ». S’agirait-il de la réforme de l’accès au troisième cycle, et donc de la fin du deuxième cycle, ou de la réforme du troisième cycle ? Cette dernière a déjà été mise en œuvre à la rentrée 2017. La rédaction proposée me semble donc manquer de clarté.
Sur le fond, il me paraîtrait assez inéquitable d’associer à la gouvernance uniquement les établissements publics de santé, au détriment de tous les autres acteurs susceptibles d’être concernés.
Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Il est également défavorable.
Je confirme la réponse que j’ai donnée à l’Assemblée nationale et que Mme la sénatrice Cohen a rappelée, en précisant que ces ajustements pourront être réalisés par voie réglementaire.

L’amendement n° 105 rectifié bis est retiré.
Monsieur Bonne, qu’en est-il de l’amendement n° 30 rectifié bis ?

L’amendement n° 30 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° 294.

Il nous semble essentiel que les établissements publics de santé soient associés à la gouvernance. Il nous a été dit que cela pourrait être fait par voie réglementaire : nous retirons notre amendement, en espérant que cette indication sera suivie d’effet !

L’amendement n° 294 est retiré.
L’amendement n° 672 rectifié, présenté par MM. Labbé, Antiste, Arnell et Artano, Mme Benbassa, MM. Bignon, A. Bertrand, Cabanel et Castelli, Mme M. Carrère, M. Collin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Corbisez, de Nicolaÿ, Dantec et Decool, Mme N. Delattre, M. Delcros, Mme Dindar, MM. Gabouty, Gold, Gontard, Guérini et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde, MM. Laurey, Léonhardt et Moga, Mmes Monier et Préville, MM. Requier et Roux, Mme Tetuanui et MM. Vall et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions et modalités dans lesquelles est délivrée une formation relative à la santé par les plantes, la phytothérapie et l’aromathérapie ;
La parole est à M. Joël Labbé.

Les dispositions de cet amendement sont issues de l’une des recommandations de la mission sénatoriale sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales.
Conforme à l’esprit qui a animé le travail des sénatrices et sénateurs qui ont participé à cette mission et qui continuent de s’impliquer pour la mise en œuvre de ses recommandations, il a été signé par des membres des différents groupes politiques de notre assemblée.
Le rapport de la mission recommande l’introduction d’une sensibilisation aux plantes dans la formation initiale des médecins. Notre travail a en effet permis de constater l’absence totale d’une telle formation aujourd’hui. Pourtant, de plus en plus de patients recherchent des soins à base de plantes, parfois sans en parler à leur médecin, qui, d’ailleurs, n’est souvent pas formé pour répondre à cette demande et ne pense pas nécessairement à interroger le patient sur ses pratiques.
Le médecin ne pourra donc pas prendre en compte les potentielles interactions médicamenteuses.
De plus, de nombreuses plantes sont d’une efficacité reconnue et présentent un véritable intérêt pour la santé publique. Pour ne prendre qu’un exemple, certaines huiles essentielles diminuent la résistance des bactéries aux antibiotiques.
Il est donc essentiel de développer la formation des médecins à l’usage des plantes médicinales, particulièrement répandu dans les outre-mer, où il représente un enjeu important.
L’Ordre des médecins, dont nous avions auditionné des représentants dans le cadre de la mission, avait lui-même déclaré que, « compte tenu effectivement du déficit de formation initiale dans ce domaine, de la demande croissante en matière de plantes médicinales, de l’obligation qu’a le médecin d’apporter une information la plus éclairée possible et d’alerter sur le risque d’interactions médicamenteuses, il y a certainement un volume de formation complémentaire à prévoir dans le cadre de la formation initiale ».

M. Alain Milon, rapporteur. Je voudrais tout d’abord rectifier une erreur que M. Labbé a commise. Il y a effectivement eu une mission d’information officielle sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, dont le rapport a d’ailleurs été adopté malgré l’opposition de certains collègues
M. Joël Labbé fait un signe de dénégation.

Le dispositif de cet amendement est peu clair. S’agit-il de mettre en place une nouvelle filière, voire une spécialité en troisième cycle, ou de prévoir que les étudiants de troisième cycle seront formés à ces thématiques ? Dans le premier cas, la question de la recevabilité financière de l’amendement se poserait. Dans le second, il s’agirait d’inscrire le contenu des études de médecine dans la loi, ce à quoi la commission des affaires sociales n’est pas favorable, pour les raisons que nous avons déjà exposées à plusieurs reprises.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le rapporteur, je n’ai pas du tout commis d’erreur. La mission que j’ai évoquée est bien la mission d’information officielle, et non le groupe de travail informel que j’anime par ailleurs, composé de sénatrices et de sénateurs de toutes tendances politiques. En outre, les conclusions de la mission d’information ont été adoptées à l’unanimité.
Je pourrais retirer mon amendement si le Gouvernement s’engageait – ce n’est pas du tout du chantage ! – à saisir du problème les doyens des facultés de médecine. Comme je l’ai indiqué, il y a une complémentarité de fait entre la médecine par les plantes et la médecine allopathique. Or nombre de médecins ne disposent pas des connaissances nécessaires. Sans donner aucune injonction au Gouvernement, j’estime qu’il faut apporter une véritable réponse aux attentes sociétales tant des médecins que des patients, dans l’intérêt de tous.
Monsieur le sénateur, je comprends bien sûr votre inquiétude relative aux interactions médicamenteuses avec les plantes. En réalité, c’est toujours de la chimie : la plupart des médicaments sont issus des plantes. Les molécules employées dans les chimiothérapies proviennent des écorces d’ifs et donnent de très bons résultats contre le cancer.
Afin d’éviter toute interaction, les plantes comme les médicaments doivent faire l’objet d’une attention particulière. En général, ce sont les pharmaciens qui maîtrisent le mieux les interactions avec les plantes médicinales. Il me semble plus légitime que cela fasse partie de leur formation. Ils sont de plus en plus fortement engagés dans la conciliation médicamenteuse : dès qu’il y a des prescriptions complexes, c’est à eux d’intervenir.
Je propose de sensibiliser les doyens aux interactions médicamenteuses ; c’est un vrai sujet. Libre ensuite à chacun d’entre eux de mettre en place tel ou tel module de formation. Voilà l’engagement que je prends devant vous.

Ayant moi aussi participé à la mission d’information sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales et cosigné cet amendement, je souhaite me livrer à un plaidoyer sincère en faveur de la mise en place d’une formation à la santé par les plantes.
Les travaux de la mission d’information nous ont révélé un monde prometteur, vertueux de soins plus respectueux de notre santé. Il s’agit là tout simplement de l’intérêt général. Comment sommes-nous passés à côté d’une telle richesse ? Comment l’avons-nous ignorée, avec quelque mépris parfois pour des pratiques ancestrales qui avaient fait leurs preuves ? Comment avons-nous pu abandonner ces médications d’équilibre, aveuglés par le mirage du « tout chimique » ? Comment avons-nous pu supporter les effets secondaires des médicaments, dont les listes, longues comme le bras, sont éloquentes et font littéralement peur ?
Bien sûr, la chimie est nécessaire, mais elle ne peut pas tout. Il faut le reconnaître, nous sommes allés trop loin en voulant remplacer ce qui était efficace contre les maux du quotidien. Les plantes sont notre chance ; nous le savons. Depuis la nuit des temps, elles ont permis à l’humanité de se soigner et de traverser les siècles, puisque nous sommes là !
Certes, elles sont à l’origine de nos médicaments. Les travaux de la mission d’information nous ont révélé que la demande de nos concitoyennes et concitoyens, qui s’informent et utilisent les plantes, est très forte.
Nous avons notamment, dans le cadre de la mission, rencontré dans le Diois trois personnes, un médecin, un pharmacien et une herboriste, qui travaillaient ensemble en parfaite harmonie, dans le respect des patients, et qui constituaient une magnifique équipe au service de la santé sur leur territoire.
Les plantes doivent être enseignées, en particulier aux médecins s’ils veulent les prescrire. Elles le sont actuellement insuffisamment. Le module doit être substantiel et absolument scientifique. Ne passons pas à côté du trésor que nous offre la nature. Parfaitement adapté à nos problèmes de santé, il constitue une promesse pour la population de notre pays.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. Joël Labbé applaudit également.

Attention à ne pas tomber dans le piège de croire que la phytothérapie est une médecine douce ! Comme l’a rappelé Mme la ministre, la plupart des médicaments du Codex sont issus des plantes et les propriétés de celles-ci sont loin d’être anodines.
Certes, je n’ai pas participé à la mission d’information. En revanche, voilà bien longtemps, j’avais passé un diplôme universitaire de phytothérapie et d’aromathérapie. Il est clair que les règles de prescription d’une ordonnance pour ce genre de traitements – soit dit en passant plus remboursés depuis les années quatre-vingt-dix – obéissent à des critères très différents de ceux de la médecine dite allopathique.
Par conséquent, que des médecins souhaitent s’orienter vers ce type de prescriptions, pourquoi pas, mais, selon moi, cela relève d’une spécialisation et la prise en charge ne sera pas remboursée.
Je ne suis pas favorable à ce que l’on charge encore la mule, si je puis dire, en enseignant des techniques en effet extrêmement complexes, mais qui sortent complètement du cadre des pratiques médicales habituelles.

Oui, monsieur le président ; les explications qui m’ont été apportées ne me satisfont pas.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 679, présenté par Mmes Rossignol et M. Filleul, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mme Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions et modalités dans lesquelles est délivré un enseignement relatif au continuum des violences sexuelles ou sexistes, à leur détection, aux stéréotypes de sexe, au respect du corps d’autrui et de son consentement ;
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Cet amendement du groupe socialiste et républicain vise à intégrer dans la formation initiale et continue des médecins des modules relatifs aux droits des femmes, aux stéréotypes de sexe et au respect du corps d’autrui. Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la prise en charge de la patientèle et dans la grande cause du quinquennat. Il s’agit de mobiliser tous les leviers de notre société pour éradiquer les violences faites aux femmes.
Nous l’avons souligné à propos d’un précédent amendement, les témoignages de violences médicales à caractère sexiste, de violences obstétricales et gynécologiques se sont multipliés ces derniers mois, à la faveur des mouvements #MeTooou #PayeTonGyneco.
C’est par la formation que nous transformerons les mentalités. Les professionnels de santé ne doivent pas manquer à l’appel. Pour cela, les médecins doivent recevoir une formation sur le repérage des violences sexuelles et sexistes, afin de lutter contre la culture sexiste qui prévaut encore dans de trop nombreux hôpitaux et de soigner correctement les victimes de telles violences.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour toutes les raisons qui ont déjà été exposées.
Nous ne contestons pas l’extrême intérêt du sujet, mais si l’on s’engage dans une telle démarche il faudra instituer des modules de formation sur tous les thèmes qui le méritent, sans en oublier. Cela risque d’être très difficile !
Pour les mêmes raisons qu’hier, nous ne souhaitons pas prendre en compte dans la loi l’ensemble des sensibilités des parlementaires sur des sujets particuliers, même si ceux-ci font l’objet d’une politique publique, comme c’est le cas des violences faites aux femmes. Nous sommes extrêmement mobilisés sur ce thème. Pour autant, si nous faisons la liste des sujets prioritaires, nous risquons d’en oublier. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Au-delà de la sensibilisation politique et des actions qui sont effectivement menées par le Gouvernement, nous ciblons plus particulièrement, au travers de cet amendement, le domaine médical et les professionnels de santé, qui sont les premiers intervenants auprès des victimes de violences sexuelles et sexistes. Il nous semble donc important de prévoir une action de sensibilisation particulière à leur intention. J’attendais une réponse de la part du Gouvernement sur ce sujet.

J’entends bien que nous ne pouvons pas tout mettre dans la loi et que des éléments figureront dans le décret, les règlements… Il appartiendra aussi au conseil des programmes de faire son travail.
Cela étant dit, l’obligation de signalement pour les médecins permettrait peut-être de résoudre un certain nombre de problèmes : je profite de l’occasion pour y revenir, car la répétition est au fondement de la pédagogie ! Les professionnels de santé ne peuvent pas tout savoir, mais ils peuvent signaler et s’entourer de personnes qui savent.

Je ne comprends pas cet avis défavorable : la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est pourtant une grande cause nationale et la grande cause du quinquennat. Faire de la prévention, inscrire ce sujet au programme des études, ce n’est pas la panacée, mais cela permettrait de sensibiliser les futurs médecins. Depuis hier, on peut voir que ce n’est pas vraiment la grande cause du quinquennat…

C’est effectivement une grande cause nationale, dont il faut se préoccuper, mais on peut considérer qu’il en va de même, par exemple, de la santé environnementale, de l’homéopathie…

… et de bien d’autres sujets abordés au travers de divers amendements : cela pourrait nous emmener très loin ! Ce n’est pas à la loi de déterminer le programme des études.
Par ailleurs, madame Laborde, le Sénat travaille beaucoup sur la question de l’obligation de signalement. Vous le savez, pour avoir participé à une mission sur un autre sujet présidée par Catherine Deroche et dont les conclusions préconisent la mise en place d’une mission sur l’obligation de signalement. Le président de la commission des affaires sociales, le président de la commission des lois et Mme Deroche sont d’accord pour créer une telle mission, certainement à l’automne.
La lutte contre les violences faites aux femmes est effectivement la grande cause du quinquennat. Nous avons une feuille de route très précise, qui a commencé à être mise en œuvre par le Gouvernement.
Dans le champ du sanitaire, nous avons lancé un appel d’offres pour la création de dix centres de psychotrauma, chargés notamment de la prise en charge des violences faites aux femmes. Ils devront mettre en place un réseau dans les établissements de santé de leur région, avec obligation de formation des médecins qui prennent en charge ces patients, notamment dans les services d’urgence. Tout cela est déjà organisé. Nous avons financé ces dix centres de psychotrauma : j’ai même inauguré celui de Lille voilà quelques mois. Il s’agit de réseaux territoriaux coordonnés par un centre national de ressources et de résilience, également financé par l’État et implanté à Lille. Ce centre va diffuser les bonnes pratiques en matière de prise en charge des personnes victimes de violences.
Nous sommes donc extrêmement attentifs aux violences faites aux femmes, mais également aux violences faites aux enfants, dont nous avons débattu hier.
Quant à l’obligation, pour les médecins, de déclarer les cas de violences faites aux femmes, elle est enseignée dans le cadre du module « vulnérabilités », qui existe dans toutes les facultés. Il permet aussi un enseignement sur les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, cette obligation de déclaration est également enseignée dans le cadre du module de médecine légale.
Comme M. le rapporteur, nous pensons qu’il ne faut pas chercher à inscrire dans la loi la totalité des thématiques d’intérêt devant faire l’objet d’un enseignement, car nous risquerions d’en oublier. Elles sont toutes d’importance, qu’il s’agisse des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants, de la prise en charge du handicap physique ou psychique, des maladies génétiques, des maladies rares, de la santé environnementale… Il sera souligné, dans le courrier que Frédérique Vidal et moi-même adresserons dès lundi aux doyens de faculté, que les parlementaires sont particulièrement attentifs à ce que ces sujets soient bien enseignés. Nous prenons cet engagement, mais il nous semble que, pour éviter d’être pris en défaut, il faut ne rien inscrire dans la loi concernant le contenu des programmes.

Nous avons bien compris que ni le Gouvernement ni le rapporteur ne souhaitent que l’on inscrive dans la loi des recommandations de ce type.
Néanmoins, si nous le faisons, aucun étudiant en médecine, aucun doyen de faculté n’ira s’imaginer que le contenu des études médicales se limite à ce qui figure dans la loi. Mentionner les violences faites aux femmes ou aux enfants, la santé environnementale ne serait pas exclusif des autres thématiques. Il est évident que l’énumération ne saurait être exhaustive.
Cela étant, il existe tout de même des thématiques transversales. Je me félicite, madame la ministre, des projets d’ouverture de centres de psychotrauma et de l’existence, depuis plusieurs années déjà, de médecins référents dans un certain nombre d’établissements hospitaliers. Cependant, les femmes ne sont pas un public spécifique. Pour nous, tout l’enjeu consiste à faire partager cette culture nouvelle à l’ensemble des professionnels de santé, quelle que soit leur spécialité, et à les amener à prendre en compte la question spécifique des violences faites aux femmes. C’est justement pour sortir d’une logique de publics et changer le regard des médecins que nous proposons ces amendements. Les signaux faibles émis par les femmes victimes de violences ne sont compréhensibles que par les professionnels de santé qui ont été formés à les reconnaître, quel que soit leur mode d’exercice de la médecine.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Même si je partage entièrement les objectifs des auteurs de cet amendement, je ne le voterai pas, parce que je ne suis pas favorable à ce que l’on inscrive dans la loi les différentes thématiques devant faire l’objet d’un enseignement. Pour autant, je ne mets pas sur un pied d’égalité la santé environnementale et les violences faites aux enfants ou aux femmes, par exemple.
Comme l’a dit ma collègue Françoise Laborde, il est urgent de se pencher sur le sujet de l’obligation de signalement. Son instauration sera peut-être la clé pour répondre à ces problématiques.
Par ailleurs, je fais confiance à toutes les femmes qui se sont engagées dans des études de médecine pour faire bouger les choses au sein du corps médical.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 680, présenté par Mme Rossignol, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les modalités dans lesquelles est délivré un enseignement relatif à la santé environnementale. »
La parole est à Mme Angèle Préville.

En juin 1999, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que « l’environnement est la clé d’une meilleure santé ».
De nouveaux défis sanitaires, notamment la gestion des conséquences sur la santé des pratiques et des modes de vie, attendent les professionnels de santé. Il est donc nécessaire d’adapter la formation des futurs médecins, en leur délivrant un enseignement relatif à la santé environnementale et portant, notamment, sur les effets des polluants locaux ou globaux sur notre santé ; c’est un enjeu majeur de santé publique.
En effet, on assiste à l’émergence de nouvelles pathologies. Il faut faire preuve de vigilance. Les médecins doivent disposer des connaissances nécessaires, pouvoir identifier la présence de certains polluants sur un territoire parce qu’ils auront détecté l’occurrence répétée d’une même pathologie. Cela manque cruellement à l’heure actuelle ; il nous faut nous adapter au monde d’aujourd’hui.
Les personnels du corps médical sont des interlocuteurs privilégiés pour les citoyens. Ils doivent pouvoir répondre aux inquiétudes. Ils sont écoutés et seront des leviers puissants de progrès. Ils peuvent mettre en garde leurs patients, les appeler à la vigilance. Ils ont un rôle majeur à jouer. Il est nécessaire qu’ils soient formés, afin de pouvoir mieux informer les populations et participer au changement des pratiques dangereuses pour la santé et l’environnement.
Les professionnels de santé doivent connaître les risques des expositions aux polluants et les solutions à mettre en place. Un enseignement sur la santé environnementale doit être mis au programme des études de médecine. Les futurs médecins sont d’ailleurs eux-mêmes demandeurs de formations sur les effets de l’environnement sur la santé et sur les enjeux à venir, car la jeunesse actuelle se préoccupe particulièrement de ces sujets.

Je ferai la même réponse que pour les amendements précédents. Cette fois, il s’agit d’introduire dans le cursus des études médicales un enseignement sur la santé environnementale. L’avis est défavorable, même si personne ne nie l’importance du sujet : il y va de l’avenir de l’humanité.
Madame Rossignol, si nous mentionnons les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, les maladies rares ou la santé environnementale dans la loi, la prise en compte de ces sujets s’imposera à tout le monde, mais les thématiques ne figurant pas dans la loi risquent d’être négligées. Là est le vrai problème : il y a un risque majeur à inscrire dans la loi des mentions qui devront, par contre, figurer dans le décret ou dans le courrier que les ministres adresseront aux doyens de faculté.
François de Rugy et moi-même sommes très mobilisés sur les enjeux de santé environnementale. Ainsi, nous avons lancé, en janvier dernier, les travaux sur le futur plan national « Mon environnement, ma santé », dont la formation des professionnels de santé constituera un axe important. L’élaboration de ce plan fait aujourd’hui l’objet de groupes de travail réunissant les parties prenantes. Ce plan sera ainsi coconstruit avec l’ensemble des acteurs pendant toute l’année 2019. Il ne faut donc pas anticiper sur les échanges et sur le contenu des modules de formation. Comme je l’ai déjà indiqué, nous ne souhaitons pas inscrire le contenu des programmes dans la loi.

Ce débat m’inspire quelques réflexions. Nous avions souligné en préambule que s’en tenir à la modification du processus de sélection des étudiants et à la suppression des épreuves classantes nationales, les ECN, faisait sens, parce qu’il fallait redessiner le deuxième cycle pour faire partager aux étudiants une autre approche de la santé et de la médecine.
Les contenus ne sont pas du domaine de la loi : je souscris à l’avis du rapporteur sur ce point. Si la part des contenus techniques reste fondamentale, les sujets soulevés au travers de ces amendements, qui d’ailleurs survalorisent le rôle des médecins, ont une dimension sociale et environnementale et ne concernent pas, à ce titre, que les seuls professionnels de santé.
À mon sens, les futurs médecins doivent être formés autrement. On a évoqué hier la nécessité de sortir de la surfiliarisation, de l’hyperspécialisation. Il va falloir retravailler ces questions. Il est très bien que Mme la ministre adresse un courrier aux doyens de faculté pour les sensibiliser à ces sujets, mais, au-delà, il faudra mettre en place d’autres types d’actions. En l’espèce, la prise en compte des problématiques de santé environnementale dans les études de médecine reste tout à fait insuffisante et déconnectée de l’importance des enjeux, y compris sur le plan purement sanitaire. Cette année, nous avons appris que la pollution de l’air était désormais la première cause de mortalité dans notre pays, avec 72 000 décès, contre 48 000 auparavant – et épargnez-nous le débat sur les morts prématurées, madame la ministre…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 827, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 681-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence « L. 632-4 et » et la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
1° bis L’article L. 683-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées et la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence : « L. 632-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
1° ter L’article L. 684-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées et la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence : « L. 632-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
La parole est à M. le rapporteur.

Il s’agit d’un amendement de coordination, relatif à l’application de l’article 2 aux outre-mer.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 291, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles délivrent des enseignements et se déroulent dans un cadre qui respecte le principe de neutralité applicable à l’enseignement. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Madame la ministre, vous êtes sensible aux liens et conflits d’intérêts qui peuvent exister dans le domaine de la recherche, mais vous avez rejeté, à l’Assemblée nationale, un amendement proche de celui-ci, au motif que son adoption conduirait de facto à interdire les stages dans les maisons de santé ou les établissements privés. Nous sommes d’accord sur le fond, et nous espérons donc que vous soutiendrez notre amendement, qui est rédigé différemment.
Il y a aujourd’hui une problématique très importante de neutralité économique et commerciale à l’université. Les politiques successives de restrictions budgétaires et le développement des fondations privées en matière d’enseignement supérieur et de recherche ont conduit les universités à se tourner vers les entreprises privées pour financer leurs projets.
Ainsi, la société de préparation pharmaceutique Genzyme et sa concurrente AstraZeneca ont versé respectivement 46 000 et 31 000 euros à certaines universités. Selon le mensuel Alternatives économiques, la conception selon laquelle « les médecins qui n’ont pas de liens d’intérêts sont des médecins sans intérêt » prévaut trop souvent. C’est ainsi que les universités de Strasbourg, d’Amiens ou de Paris VII ont signé entre 150 et 534 conventions avec des laboratoires privés leur fournissant moyens humains et matériels, pour un montant pouvant atteindre 80 000 euros.
En outre, de nombreux enseignants en médecine sont des praticiens ou d’anciens praticiens qui, après des années d’exercice, parlent parfois plus facilement de tareg ou d’irbésartan que d’anti-angiotensine. Dans le cadre de l’enseignement, ils conditionnent donc leurs étudiants à l’emploi de produits et de marques définis plutôt qu’à celui des substances médicamenteuses contenues dans lesdits médicaments. Cette situation pose forcément plusieurs problèmes majeurs. Elle influence la future pratique des étudiants et elle renforce la porosité entre l’enseignement supérieur et le secteur privé, avec des risques de dérapage : absence d’esprit critique quant à la qualité des produits, influence sur les contenus enseignés, captation des étudiants jugés prometteurs…
Il nous semble donc que le Gouvernement doit aujourd’hui se mobiliser fortement sur la question de la neutralité économique de l’enseignement supérieur et de la recherche, ne serait-ce que pour appuyer les efforts faits par certains enseignants et étudiants en médecine, qui dénoncent ces pratiques douteuses.

Il paraîtrait étrange à la commission de réserver ce principe de neutralité aux seules études médicales, sans l’appliquer à l’ensemble des formations supérieures ni même aux autres formations en santé. Avis défavorable.
Madame la sénatrice, le service public de l’éducation, dont font partie les études de médecine, a vocation à répondre à l’intérêt général et aux missions qui lui sont dévolues en respectant le principe de neutralité dans toutes ses dimensions, dont la neutralité commerciale, à laquelle vous faites référence.
L’indépendance des formations initiale et continue des professionnels de santé est un objectif que nous partageons. Tout ce qui participe à la qualité et à la pertinence des soins, objectifs centraux de l’ensemble des transformations que porte le Gouvernement, est bien sûr au cœur de nos préoccupations. C’est une exigence que nous devons à nos concitoyens.
Cependant, il s’agit ici de ce que l’on appelle des formations « professionnalisantes », inscrites dans des environnements d’exercice. La garantie de cette indépendance ne peut donc pas se limiter à des principes législatifs ou réglementaires ; elle suppose une attention prononcée dans deux directions.
Tout d’abord, il faut exercer une vigilance permanente dans la pratique d’enseignement. Toutefois, cela ne doit pas empêcher de travailler avec le monde de l’entreprise ou les industries. Nous sommes l’un des pays qui produisent le plus de connaissances, mais aussi, pour des raisons multiples, l’un de ceux qui sont le moins capables d’innover à partir de ces connaissances. Or l’une des raisons pour lesquelles l’innovation se heurte à des difficultés en France est la suspicion qui transparaît au travers de votre intervention. Par exemple, si, dans le cadre de la mise en place d’un module d’apprentissage de la chirurgie par simulation, on recourt à telle marque de scialytique, cela peut faire naître le soupçon que l’on veut former les futurs chirurgiens à utiliser cette marque plutôt qu’une autre. Nous nous tirons ainsi parfois nous-mêmes des balles dans le pied !
Il faut, par ailleurs, maintenir une vigilance permanente quant à l’évolution des pratiques. Nos étudiants ont besoin d’une lecture critique des informations scientifiques et de pratiques pédagogiques innovantes. C’est un objectif philosophique qui est très largement partagé.
Cet amendement, qui questionne les liens de la formation des professionnels de santé avec l’industrie, porte un risque majeur de contentieux à terme. Il est très important de veiller au respect du principe d’indépendance, mais il ne convient pas d’inscrire celui-ci dans la loi. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

Cet amendement est peut-être mal rédigé, mais il a le mérite de soulever un vrai problème. Ne fermons pas les yeux sur le fait qu’il existe des risques de conflits d’intérêts. Il faut donc établir un encadrement : quel autre véhicule que la loi pour cela ?
Les exemples évoqués par ma collègue Cathy Apourceau-Poly sont éclairants. Les moyens alloués à la recherche publique étant très faibles, les laboratoires privés s’engouffrent dans la brèche. Leur volonté de réaliser un profit ne serait pas choquante s’il ne s’agissait de la santé, qui ne saurait selon nous relever du secteur marchand.
Nous sommes sensibles aux propos rassurants de Mme la ministre, mais ils ne nous convainquent pas. Que va-t-on faire concrètement pour mettre un coup d’arrêt à des pratiques déviantes ? Telle est la vraie question ! Si nous sommes tous d’accord sur le principe, prenons l’engagement de légiférer afin de préserver l’enseignement et la recherche des risques que ma collègue a soulignés. Cela rejoint d’ailleurs notre proposition de créer un grand pôle public du médicament et de la recherche.
Madame la sénatrice Cohen, vous avez raison d’insister. Nous avons eu ce débat à l’Assemblée nationale, mais l’amendement était extrêmement mal rédigé et nous ne pouvions l’accepter.
Notre vigilance en matière d’indépendance de l’enseignement dispensé aux étudiants à l’égard de l’industrie pharmaceutique ou des fabricants de dispositifs médicaux est en train de trouver une traduction concrète dans toutes les universités. Les établissements de santé, notamment, ont maintenant l’obligation de mettre en œuvre une charte, validée par la Haute Autorité de santé, sur la visite médicale à l’hôpital. Cette charte a été élargie aux dispositifs médicaux et à l’enseignement, en application du dispositif d’un amendement de Mme Fiat, députée de La France insoumise.
Nous sommes donc extrêmement attentifs à ce que l’enseignement soit préservé de l’influence des industriels. Pour autant, inscrire dans la loi une disposition qui risquerait de susciter des recours s’il existait le moindre lien entre une université et des industriels, quels qu’ils soient, entraverait l’innovation, comme l’a souligné Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il nous donc trouver la ligne de crête entre la mise en œuvre de dispositions propres à empêcher qu’un enseignement sous influence puisse être dispensé et le maintien de la possibilité de nouer des coopérations entre les universités et le secteur industriel.

Madame la ministre, l’amendement de Mme Fiat que vous avez évoqué n’a pas été adopté par l’Assemblée nationale, me semble-t-il. Nous l’avons retravaillé pour le rendre acceptable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 342, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 33, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et sur l’évolution des connaissances et des compétences acquises lors des stages professionnels
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Concernant l’évaluation prévue à l’alinéa 33, nous proposons que soit également évaluée la qualité des stages proposés aux étudiants dans le cadre de la future réforme du deuxième cycle, au même titre que l’acquisition des connaissances et des compétences ou la construction du projet professionnel, par exemple.
En effet, il ne faudrait pas que, du fait de l’augmentation du nombre des étudiants, la qualité des stages professionnels s’amenuise, aucun moyen financier supplémentaire ne devant être accordé aux universités.
Je note que, pour une fois, le Sénat a accepté une demande de rapport : c’est la preuve qu’un certain flou entoure les conséquences de la mise en œuvre de cet article !

Madame Gréaume, ce n’est pas un rapport que nous demandons, c’est une évaluation.
Votre proposition n’entre pas exactement dans le champ de l’évaluation prévue à l’article 2 : celle-ci portera, en fait, sur de nouvelles modalités d’accès au troisième cycle, introduites en remplacement des épreuves classantes nationales.
De ce point de vue, proposer une évaluation des stages me paraît peu pertinent, d’autant que l’article 2 bis prévoit déjà l’évaluation du déploiement d’une offre de stages tout au long des études de médecine. Avis défavorable.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat pour définir le périmètre de l’évaluation demandée.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 est adopté.
L’article L. 632-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux.
« Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement. »

L’amendement n° 274, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Après le mot :
territoires
insérer les mots :
notamment dans les zones sous-denses
2° Compléter cette phrase par les mots :
notamment dans les centres de santé
La parole est à M. Éric Bocquet.

Les études médicales théoriques et pratiques doivent permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice.
La rédaction proposée au travers de l’article 2 du projet de loi est plus précise que l’article L. 632-1 du code de l’éducation en vigueur, qui ne fait référence qu’à l’activité hospitalière.
Néanmoins, nous proposons d’être encore plus précis en ciblant plus particulièrement les zones sous-denses, d’une part, et les centres de santé en tant que mode d’exercice, d’autre part. Il nous semble en effet important que lors de leurs études, tant à l’université que pendant les stages, les étudiants puissent disposer des éléments leur permettant de bien comprendre les spécificités d’un territoire sous-doté et le fonctionnement particulier de structures telles que les centres de santé.
La rédaction actuelle de l’article L. 632-1 du code de l’éducation permet sans doute déjà de prendre en compte cette problématique, mais nous préférons que celle-ci soit explicitement mentionnée, d’autant que les déserts médicaux sont une préoccupation majeure pour les parlementaires que nous sommes, sur quelques travées que nous siégions, ainsi que pour les populations concernées. Par conséquent, les étudiants doivent y être particulièrement sensibilisés.
De même, faire référence expressément aux centres de santé nous semble intéressant, dans la mesure où ces structures de proximité, encore insuffisamment développées sur le territoire, répondent aux attentes des jeunes professionnels, en permettant notamment le salariat et l’exercice collectif.

Cet ajout n’apporte rien sur le plan juridique : la formulation large de l’article L. 632-1 du code de l’éducation couvre déjà ces éléments. Qui plus est, il vaut mieux conserver une rédaction très large pour un article fixant les objectifs des études de médecine. Je vous mets encore une fois en garde contre l’effet d’a contrario qui pourrait résulter de l’adoption d’amendements de ce type : l’exercice en centre de santé est-il plus important que celui en maison de santé ou en communauté professionnelle territoriale de santé, structures qui ne sont pas mentionnées dans le texte de l’amendement ? Avis défavorable.

Les mots ont de l’importance, comme on a pu le voir lors de notre échange sur la différence entre évaluation et rapport. Si nous insistons sur les centres de santé, c’est qu’il nous paraît important de favoriser la diversité des modes d’exercice. Je vous rappelle, mes chers collègues, que seuls 12 % des étudiants en médecine souhaitent exercer en libéral. Beaucoup de nos collègues confondent encore centres de santé et maisons de santé.
Pour rassurer notre rapporteur, nous avons introduit l’adverbe « notamment » dans le texte de notre amendement, pour bien signifier qu’il ne s’agit pas d’exclure les autres modes d’exercice.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 31 rectifié bis, présenté par MM. Bonne et Henno, Mmes Malet, M. Mercier, Puissat, Di Folco, Deroche et Bonfanti-Dossat, MM. Bascher, Savary, Hugonet et Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud et Gruny, M. Brisson, Mmes Lassarade et Estrosi Sassone, MM. D. Laurent, Morisset, Vogel, Sol, Saury, Pellevat, Perrin, Poniatowski, Mouiller, Mayet, Mandelli, Laménie, Karoutchi, B. Fournier et Détraigne, Mmes L. Darcos, Deromedi, Chauvin et Bruguière, M. Babary, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Piednoir, Cuypers, Dériot et Rapin, Mmes A.M. Bertrand et de Cidrac, MM. Longeot, Segouin, Bouloux, Charon, Sido et J.M. Boyer, Mmes Lamure et Renaud-Garabedian et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
et modes d’exercice
par les mots :
, modes d’exercice et type de structures
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi qu’en établissement médico-social
La parole est à M. Bernard Bonne.

Le secteur du grand âge souffre d’une pénurie certaine de personnel, due notamment au manque d’attractivité de la filière, mais aussi à la désaffection des étudiants pour ses métiers.
La formation initiale des étudiants en médecine, même si les cursus incluent aujourd’hui une formation en gériatrie et en gérontologie, ne met pas suffisamment en avant les atouts objectifs des carrières dans ce secteur. Aussi faudrait-il encourager les étudiants, et particulièrement les internes, à réaliser des stages dans des lieux d’accueil de personnes âgées, notamment en Ehpad, afin de les sensibiliser à la question de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes.

Le 2° de cet amendement me paraît poser un problème rédactionnel. Surtout, il me semble que la rédaction de l’article L. 632-1 du code de l’éducation telle que modifiée par l’article 2 bis répond déjà à la préoccupation de notre collègue. Cette rédaction fait en effet référence à une formation à différents modes d’exercice : il ne paraît pas nécessaire d’ajouter que les études médicales forment à l’exercice dans différents types de structures, puisque les médecins exercent déjà de fait au sein de structures diversifiées – maisons de santé, centres de santé, établissements hospitaliers, Ehpad –, sans que la loi ait eu besoin de le préciser.
En outre, la notion de « participation à l’activité hospitalière » recouvre nécessairement l’activité en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, puisque ces derniers constituent bien, ainsi que leur nom l’indique, des établissements hospitaliers.
Il n’est donc pas utile de dégrader la rédaction proposée pour l’article L. 632-1 du code de l’éducation en y apportant une précision qui me paraît superfétatoire. La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Même avis. Cet amendement étant satisfait, j’en demande moi aussi le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 31 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 283, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans le respect de la dignité et des droits des patients
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Cet amendement rejoint une proposition faite par l’association Aides pour une santé plus respectueuse.
Nous le savons, depuis quelque temps, des personnels soignants dénoncent un accroissement de la maltraitance institutionnelle, lié à la dégradation de leurs conditions de travail. Pour pallier le manque de soignants et de personnels administratifs, on impose à ces professionnels des cadences inconciliables avec la prise en charge des patients dans de bonnes conditions. Les soignants éprouvent une perte de sens de leur métier.
Lors de notre tour de France des hôpitaux et des Ehpad, nous avons notamment rencontré le personnel du service d’oncologie de l’hôpital Lyon-Sud, concerné par la mise en œuvre d’un plan d’efficience. Il nous a exposé toutes les dérives liées à la réduction des investissements publics dans ce secteur hospitalier. Par exemple, des patients en chimiothérapie ou en sevrage alcoolique ne peuvent pas être examinés certains jours, les visites sont chronométrées, des personnels sont « baladés » de service en service afin de combler les absences, des patients refusent même d’alerter les infirmières malgré leur douleur, car ils les voient courir dans tous les sens à longueur de temps ! Nous connaissons tous, mes chers collègues, des exemples de ce type dans nos territoires.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme a mis l’accent sur le caractère systémique de ces maltraitances institutionnelles. Il est donc important d’inscrire dans la loi que l’objectif même des études de médecine est de former des soignants à une prise en charge humaine et respectueuse des droits des patients. Cela va mieux en l’écrivant !

Ce principe est bien entendu posé, dans une formulation d’ailleurs plus large, par le code de déontologie médicale, qui précise que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Pour des questions de lisibilité et de cohérence des principes, il ne me paraît pas opportun de l’inscrire sous une formulation différente dans le code de l’éducation. Avis défavorable.

Il me semble bienvenu d’inscrire dans le code de l’éducation un tel énoncé de valeurs et de principes. Il ne s’agit pas ici d’une énumération. Nous voterons cet amendement.

Mes chers collègues, quand un membre de votre famille est hospitalisé, vous entendez que le personnel soignant soit disponible ! Or il a du mal à assurer ses missions, à cause, notamment, des réductions d’effectifs dans les hôpitaux. La moindre des choses, aujourd’hui, est donc de voter cet amendement !
Il s’agit bien entendu d’un sujet extrêmement important, souvent très douloureux. Il est évident que le respect de la dignité et du droit des patients fait partie intégrante des études de médecine. Le problème n’est pas tant de l’enseigner que de le mettre en œuvre. Dans cette perspective, nous avons décidé, avec Frédérique Vidal, de modifier le deuxième cycle des études de médecine afin de mettre les étudiants en situation. Ce deuxième cycle comprendra un très grand nombre de formations plaçant les étudiants face à des patients ou à des associations représentant les patients, pour leur apprendre la relation médecin-malade, l’annonce d’un diagnostic difficile, la bientraitance. Tout cela fait partie de la réforme du deuxième cycle.
Par ailleurs, le respect du droit et de la dignité des patients fait évidemment partie du code de déontologie auquel sont soumis les médecins.
En ce qui concerne la formation, l’important n’est pas tant de l’inscrire dans la loi que de réformer le cursus pour que les étudiants puissent apprendre à être en permanence vigilants quant à leurs paroles et à leur comportement.
En ce qui concerne l’exercice des professionnels de santé au sens large, au-delà des études de médecine, M. Piveteau me remettra aujourd’hui un rapport sur la bientraitance et la prévention de la maltraitance dans les établissements de santé et médico-sociaux. Ce rapport est le fruit d’un travail approfondi mené avec des représentants de patients, les fédérations hospitalières et des syndicats de professionnels. Il proposera une feuille de route, que nous mettrons en œuvre.
Il est évident que ces sujets font partie intégrante des études. La réforme que nous mettons en œuvre sera beaucoup plus efficace que les sempiternels vœux pieux ; elle permettra aux étudiants de s’approprier le savoir-être, au-delà du savoir pur.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 682, présenté par Mme Rossignol, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
Elles
insérer les mots :
favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques et
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Cet amendement prolonge la discussion que nous venons d’avoir sur le sujet de la bientraitance, puisqu’il vise à rétablir dans le texte une mesure prévoyant que les études de médecine doivent favoriser la participation des patients aux formations pratiques et théoriques. Adopté à l’Assemblée nationale, ce dispositif a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat.
À côté du savoir scientifique et théorique, il existe un savoir expérientiel, celui des usagers. Le concept de décision médicale partagée, qui a fait l’objet d’une recommandation de l’ARS en 2013, renvoie au processus au cours duquel les médecins et le patient partagent une information médicale pour mieux comprendre les différentes options de soin.
Bien entendu, il n’est pas évident ni naturel de considérer, dans l’exercice de la médecine, que le patient a lui-même un savoir. La disposition adoptée par l’Assemblée nationale nous paraissait donc judicieuse. C’est pourquoi nous proposons de la rétablir.

L’amendement n° 525 rectifié, présenté par M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Manable et Tourenne, Mme Monier, MM. Mazuir et Vallini et Mme Artigalas, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.

La suppression de cette disposition par la commission ne traduisait évidemment pas une opposition de fond à une telle participation des patients, qui peut en effet être encouragée chaque fois que son utilité peut être démontrée.
Pour autant, il ne nous a pas paru opportun d’en faire expressément mention dans la loi, laquelle n’a pas vocation à définir précisément le contenu des formations en santé. Il semble en outre que l’absence de cette mention n’ait pas empêché les universités qui le souhaitaient d’adapter leurs formations en ce sens.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Bien évidemment, la déontologie médicale s’applique aux médecins, mais le respect des médecins s’applique aux patients…
La participation des patients à la formation des professionnels de santé est une des mesures phares du plan « Ma santé 2022 ». Cela témoigne de notre volonté de mettre en place des méthodes d’apprentissage complémentaires, afin de permettre aux professionnels de santé de mieux appréhender le patient dans la relation soignant-soigné.
La participation des patients à la formation des professionnels, qui est aujourd’hui une pratique peu répandue, même si elle est en train de se déployer dans un certain nombre d’universités françaises, nous paraît importante. Elle est déjà largement pratiquée dans d’autres pays – en Angleterre, au Canada, en Australie, en Italie –, et elle permet de valoriser la connaissance acquise au travers de l’expérience du patient. Il n’y a rien de tel, par exemple, que d’entendre un patient raconter son expérience d’une annonce de diagnostic mal faite. C’est très marquant pour les étudiants.
Nous souhaitons donc que cette pratique devienne systématique. Selon nous, elle favorise une meilleure compréhension, par les futurs professionnels de santé, des attentes et des besoins des patients, et elle apporte un éclairage très différent du savoir prodigué par les professeurs. L’inscrire dans la loi constitue une base forte pour que les facultés de médecine intègrent ces méthodes à leurs formations et à leurs pratiques d’évaluation. Nous souhaitons également que les patients évaluent les médecins lors de leur séjour à l’hôpital.
Je regrette que cette mesure ait été supprimée par la commission des affaires sociales ; peut-être y a-t-il une incompréhension sur son objet même. En tout cas, le Gouvernement est favorable à cet amendement tendant à la rétablir.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 458 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Férat et M. Moga, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les étudiants sont également sensibilisés aux théories homéopathiques.
La parole est à M. Michel Canevet.

Puisque nous débattons des compétences dont doivent être dotés les futurs praticiens, il me semble important d’évoquer l’homéopathie.
Un tiers des médecins généralistes de notre pays ont recours quotidiennement à cette pratique, qui est enseignée dans l’ensemble des facultés de pharmacie et dans certaines facultés de médecine, en post-formation. En outre, c’est un domaine d’excellence pour la France, puisque nous disposons d’un grand savoir-faire en la matière.
Il importe que nos futurs professionnels de santé soient sensibilisés à l’ensemble des techniques homéopathiques, et partant que cette discipline soit intégrée dans les cursus de formation. Cela répond également, il faut le souligner, aux attentes de plus de la moitié de la population, qui souhaite pouvoir bénéficier de prescriptions homéopathiques pour faire face à certains problèmes de santé. Il y a là un enjeu sociétal extrêmement important, auquel nous, parlementaires, devons être sensibles.

La commission des affaires sociales, pour les raisons déjà évoquées, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Chaque patient a bien entendu le droit de se faire traiter par l’homéopathie. Toutefois, parler d’intérêt majeur en matière de santé publique me paraît nettement exagéré.
J’en veux pour preuve un article paru récemment, sous la signature du professeur Gentilini, membre de l’Académie de médecine, et relatif à l’organisation non gouvernementale Homéopathes sans frontières. Celle-ci a l’ambition de traiter par l’homéopathie des maladies gravissimes dans le tiers-monde, comme le paludisme. Déjà au XIXe siècle, Hahnemann, qui est à l’origine de l’homéopathie, prétendait traiter par l’homéopathie l’épidémie de choléra qui sévissait à l’époque…
M. Michel Canevet s ’ exclame.

En matière de thérapeutique, il est tout de même nécessaire de faire la part des choses et de ne pas confondre traitement et imposture.
Murmures sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 547, présenté par MM. Amiel et Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles permettent également aux étudiants d’acquérir les compétences en matière de prise en charge des personnes fragiles et vulnérables, notamment les femmes et les enfants victimes de violence, les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
La parole est à M. Michel Amiel.

Je veux rappeler l’importance de la formation à la prise en charge de la fin de vie, qui faisait l’objet de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie, dont Gérard Dériot et moi étions rapporteurs. Malheureusement, force est d’admettre que l’on n’a pas fait de grands progrès depuis lors.
Si je conçois que l’on n’inscrive pas une telle disposition dans la loi – j’ai compris le message de M. le rapporteur –, j’espère que ce sujet crucial ne sera pas oublié dans la lettre que vous adresserez aux doyens des facultés de médecine, mesdames les ministres.
Cela étant dit, puisqu’il n’est pas opportun d’inscrire dans la loi le contenu des formations, je retire l’amendement n° 547, de même que les amendements n° 551 et 552, par anticipation.

L’amendement n° 547 est retiré, de même que les amendements n° 551 et 552.
L’amendement n° 548, présenté par MM. Théophile et Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles délivrent aux étudiants une formation administrative et leur permettent d’acquérir des compétences en matière de gestion du personnel.
La parole est à M. Dominique Théophile.


Les amendements n° 548 et 550 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 550, présenté par MM. Théophile et Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles permettent aux étudiants de se familiariser à la question de la santé environnementale.
Cet amendement a été retiré.
L’amendement n° 185 rectifié bis, présenté par MM. Joël Bigot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Sueur, Montaugé, Vaugrenard, Todeschini et Marie, Mme Lepage, M. M. Bourquin, Mme G. Jourda, MM. P. Joly, Duran et Lurel, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Manable et Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Courteau et Temal et Mme Monier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 4021-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des orientations relatives à la santé environnementale. »
…. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 631-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -…. – Durant les formations de santé, un enseignement relatif à la santé environnementale est dispensé. »
La parole est à M. Joël Bigot.

Cet amendement tend à préciser le contenu des formations initiale et continue des professionnels de santé, en introduisant des orientations liées à la santé environnementale.
Eu égard aux nouveaux défis liés à la pollution de l’air, aux perturbateurs endocriniens, à l’absorption de pesticides, aux radiations, à la contamination des milieux, nous devons améliorer la formation des praticiens de manière continue pour adapter leurs connaissances aux exigences contemporaines en matière de santé.
Pour rappel, l’Organisation mondiale de la santé considère que 20 % des cancers sont d’origine environnementale. L’inscription dans la loi d’un enseignement portant sur la santé environnementale favoriserait une prise de conscience salutaire, plus marquée qu’aujourd’hui. Je ne nie pas l’importance des plans nationaux santé-environnement, mais il s’agit d’accompagner et de renforcer ce mouvement, et de répondre aux nombreuses inquiétudes, justifiées, de nos concitoyens face à la multiplication des pathologies dites environnementales.
Inscrire la dimension de la santé environnementale dans les orientations pluriannuelles prioritaires et dans la formation continue des professionnels de santé me paraîtrait constituer un bon signal.
Mme Valérie Létard remplace M. David Assouline au fauteuil de la présidence.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, car elle est opposée à l’inscription dans la loi du contenu des formations de santé.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 551, présenté par MM. Amiel et Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles délivrent aux étudiants une formation en matière de prise en charge des personnes en fin de vie, d’utilisation des soins palliatifs et de prise en charge de la douleur.
Cet amendement a été retiré.
L’amendement n° 552, présenté par MM. Amiel et Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles délivrent aux étudiants une formation en matière d’imagerie médicale.
Cet amendement a été retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 56 rectifié, présenté par Mme Noël, MM. Dufaut, D. Laurent, Darnaud et Morisset, Mme Deromedi et MM. Laménie, Poniatowski, Perrin et Raison, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants médecins du troisième cycle devront effectuer, parmi les stages de 6 mois d’internat leur étant imposés, au moins un stage situé en zone caractérisée par une offre de soins suffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434 du code de la santé publique.
La parole est à M. Michel Raison.

Cet amendement vise à actionner un levier important pour l’amélioration de la répartition des médecins sur le territoire, afin de mieux doter en personnel soignant les territoires, urbains ou ruraux, où l’accès aux soins est difficile. Il s’agit d’instaurer, pour les étudiants du troisième cycle, une obligation d’effectuer un stage de six mois dans une zone sous-dense. Les effets de cette mesure pourraient être très positifs : le futur médecin pourra être amené à considérer d’une façon différente le territoire où il aura fait son stage.

L’amendement n° 225, présenté par M. Lafon, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que de réaliser des stages pratiques dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
La parole est à M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis.

Cet amendement, le dernier de la commission de la culture, a le même objet que l’amendement n° 56 rectifié.
J’ai une petite idée de ce que sera l’avis du rapporteur au fond sur cette proposition, d’autant que l’amendement n° 1 rectifié quater a répondu en partie au problème soulevé. Néanmoins, j’attends d’entendre le rapporteur et la ministre !

L’amendement n° 499 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled et Vogel, Mmes Deromedi, Guillotin et Noël, MM. Bouloux, Gabouty et Nougein, Mme N. Delattre, MM. Longeot, Mandelli, Laménie et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du deuxième cycle, elles offrent aux étudiants la possibilité de réaliser des stages pratiques dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.

Les stages jouent un rôle déterminant dans le choix de leur lieu d’installation par les professionnels de santé. Cet amendement vise donc à encourager les étudiants de deuxième cycle d’études de médecine à effectuer des stages en zones sous-denses pour se familiariser avec ces territoires de santé.

Nous retrouvons ici la question des stages des étudiants en médecine. Nous avons déjà traité de ce sujet à l’article 2, en inscrivant dans la maquette de formation des étudiants de troisième cycle une dernière année consacrée à la pratique ambulatoire, en autonomie, en priorité dans les zones sous-denses ; je n’ai pas le sentiment que, ce faisant, le Sénat soit tombé sur la tête…
Avec l’article 2 bis, il s’agit de modifier l’article du code de l’éducation qui fixe les principes et les objectifs généraux des études de médecine. Vous le savez déjà, la commission et moi-même ne sommes pas favorables à l’instauration d’une obligation de faire des stages en zones sous-denses. Il nous semble en effet que cela procède d’une confusion dans les objectifs des études de médecine ; celles-ci doivent avant tout servir à former de futurs médecins et non à répondre aux carences territoriales de l’offre de soins.
Je crains que nous n’ayons pas encore toutes les garanties quant au déploiement d’une offre de stages de qualité dans les zones sous-denses, du fait, notamment, du manque de maîtres de stage. En attendant que cette condition soit remplie, la commission ne juge pas opportun de dégrader potentiellement l’encadrement de certains étudiants, et donc la qualité de leur formation. Qui plus est, il n’est pas certain que l’ensemble des étudiants de deuxième et de troisième cycles puissent avoir effectivement accès à un stage en zones sous-denses, notamment en fonction de leur spécialité. Ainsi, il serait à mon avis quelque peu excessif de conditionner la validation de leur diplôme de médecine à la satisfaction d’une telle obligation.
Vous comprendrez donc que la commission soit défavorable à ces trois amendements : à l’amendement n° 56 rectifié, parce qu’il tend à instituer une obligation dont je ne suis pas sûr qu’elle pourrait être toujours observée ; aux amendements n° 225 et 499 rectifié, parce que je ne considère pas que faire un stage en zone sous-dense puisse être en soi un objectif des études de médecine.
Cette observation générale n’entre pas en contradiction avec la priorité que nous avons définie au travers de l’adoption de l’amendement n° 1 rectifié quater.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces trois amendements.
En premier lieu, il ne pourra pas être proposé suffisamment de terrains de stage en zones sous-denses dans toutes les spécialités pour permettre à l’ensemble des étudiants d’une promotion de respecter la prescription obligatoire. En outre, pour certaines de ces spécialités, cela a été rappelé hier par Agnès Buzyn, une telle obligation n’aurait même pas de sens.
En second lieu, eu égard à l’impossibilité de disposer à court terme, de manière générale, d’un nombre suffisant de maîtres de stage en zones sous-denses pour accueillir, au cours d’une même année, l’ensemble d’une promotion – à peu près 9 000 étudiants, toutes spécialités confondues –, il nous paraît déraisonnable d’imposer des mesures que nous n’arriverions pas à faire appliquer.

Je maintiens l’amendement n° 56 rectifié.
Je suis d’accord avec le rapporteur quand il dit que l’objectif premier des études de médecine est de permettre l’apprentissage du métier de médecin, mais, comme dans d’autres professions, un stage peut avoir d’autres effets positifs au regard de l’intérêt public.
Par ailleurs, l’argument relatif au manque de maîtres de stage ne me satisfait pas : l’un des problèmes de la médecine de ville tient au fait que, souvent, les médecins n’ont pas le temps de s’occuper d’un stagiaire.
Le stage est un levier important pour améliorer la répartition des médecins dans notre pays.

Ces amendements me semblent particulièrement intéressants, parce qu’ils permettent de mettre le doigt sur un problème que l’on évoque assez rarement. Les étudiants en médecine préfèrent effectuer leurs stages en zone urbaine, pour être proches de leur hôpital de rattachement : rappelons qu’ils doivent suivre des cours à l’hôpital en parallèle.
Si l’on veut que nos jeunes médecins se fixent dans les zones rurales ou sous-denses, il convient de les motiver. Or quoi de mieux, pour cela, que de leur faire découvrir ces territoires ? Sans imposer que tous les stages soient effectués en milieu rural ou en zone sous-dense, je pense que l’on pourrait prévoir qu’un stage au moins devra être accompli dans ces territoires.

Je voterai ces trois amendements.
On parle beaucoup de désertification médicale, phénomène qui ne touche pas uniquement les zones rurales, mais aussi des zones urbaines ou périurbaines. Il faut tenter tout ce qui est possible pour sortir de la situation actuelle. Si, sur cent étudiants, il y en a un qui s’installe dans la zone où il a fait son stage, ce sera déjà une réussite ! On ne peut tout de même pas laisser 90 % du territoire français sans accès aux soins et sans médecins !

Nous avons adopté hier soir, à une très large majorité, la possibilité pour les étudiants, après dix années d’études, d’effectuer un stage en autonomie, sous la supervision bien sûr d’un médecin référent. Le Sénat n’a pas perdu la tête ; il a pris des mesures importantes pour tous les territoires où il existe des difficultés en matière d’accès aux soins de premier recours. C’était exactement ce qu’il fallait faire !
Ces trois amendements sont relatifs au deuxième cycle des études médicales. Comme mes collègues, je souhaite que ces stages de découverte, de sensibilisation puissent se dérouler dans des zones, rurales ou périurbaines, où l’offre de soins est insuffisante. Je n’ai pas prévu, pour ma part, d’instaurer une obligation : il s’agit d’inciter à découvrir différents territoires de santé, en complément des stages hospitaliers. Les facultés de médecine pourraient dégager quelques jours à cette fin.

Oui, les stages sont importants, partout sur le territoire.
Je citerai l’exemple de mon département, la Mayenne. Voilà plus de dix ans, il comptait parmi les départements les plus touchés par les difficultés de recrutement de médecins. Nous n’avons pas eu besoin de tels amendements pour changer la donne : nous nous sommes simplement demandé, avec les médecins en place, comment attirer de jeunes praticiens.
Beaucoup de nos médecins ont accepté de devenir maîtres de stage universitaire. Je présenterai d’ailleurs un amendement visant à rapprocher la formation des maîtres de stage de leur lieu d’exercice : en effet, si l’université est éloignée de celui-ci, les déplacements à accomplir pour suivre la formation sont un frein important.
Les étudiants en médecine nous le disent tous : ces expériences sont formidables et, généralement, elles les aident à construire leur projet professionnel. Ainsi, en Mayenne, deux tiers des médecins qui se sont installés depuis dix ans avaient fait un stage dans le département.
C’est ainsi que l’on accroche les jeunes : en mobilisant les professionnels, mais aussi les élus, parce qu’il faut offrir aux stagiaires les moyens de se loger et de se déplacer. Aujourd’hui, l’indemnité destinée à couvrir les frais de déplacement ne s’élève qu’à 130 euros par mois, ce qui est trop peu pour des jeunes qui doivent suivre à mi-temps des cours dans une université éloignée de leur lieu de stage.
Nous avons en outre instauré une première année de médecine dans notre département, en lien avec le CHU d’Angers ; cela se fait aussi dans d’autres départements.
En résumé, il n’est pas besoin de ces amendements pour accueillir des stagiaires. Du reste, les adopter serait envoyer un mauvais signal aux étudiants.

Ce n’est pas en les forçant à accomplir des stages dans des territoires sous-dotés que l’on incitera davantage d’étudiants à choisir la médecine générale, au contraire !

Il y a une différence entre ces trois amendements : deux d’entre eux imposent, celui de mon collègue Chasseing propose.
La seule formation suffira-t-elle pour attirer davantage de médecins, notamment généralistes, dans les secteurs hyper-ruraux ? Je n’en suis pas persuadé. Il faut une mobilisation générale, comme notre collègue vient de le dire. En Aveyron, le conseil départemental a organisé une telle mobilisation et, alors que certaines zones ne comptent que cinq ou six habitants au kilomètre carré, les installations sont beaucoup plus nombreuses que les départs à la retraite.
Cela dit, c’est un travail de longue haleine, dans lequel les collectivités locales doivent elles aussi s’impliquer, y compris pour encourager de nombreux médecins à devenir maîtres de stage.

Il est quelque peu paradoxal que le problème de la médecine de ville soit la médecine de campagne…
Il est nécessaire d’attirer des médecins dans nos campagnes, où les Français expriment largement, dans de nombreux scrutins et sur de nombreux ronds-points, leur préoccupation devant le phénomène de la désertification, notamment médicale. Cela mérite d’être entendu, mesdames les ministres !
La solution passerait-elle, paradoxalement s’agissant de la médecine libérale, par la coercition ? Sans doute pas, mais il est nécessaire que vous preniez en compte ce que les Français expriment. Dans la pyramide de Maslow, la santé est la première des préoccupations.
Il est normal que les CHU soient implantés en ville, il est logique que les universités se regroupent dans de grands centres pour que recherche et enseignement supérieur se nourrissent mutuellement, mais la ville doit aussi soutenir la campagne. Il faut donc faire un effort, un geste.
Néanmoins, je suivrai l’avis du rapporteur, car je ne crois pas à la coercition sur ce sujet.

Hier soir, nous avons longuement débattu de la désertification médicale, et tout le monde, au sein de l’exécutif ou du Parlement, partage la même préoccupation ; je ne ferai de procès d’intention à personne.
Encore une fois, la question qui se pose est celle des outils. Nous avons fait à cet égard une proposition importante, qui permet justement d’apporter une réponse non coercitive. Le nombre de médecins généralistes en activité baisse d’année en année : on en comptait encore 800 de moins en 2018 par rapport à 2017. Dans un tel contexte de pénurie, brandir le bâton et frapper ne servirait à rien du tout. On se donnerait bonne conscience, mais les territoires n’y gagneraient rien.
Nous avons la faiblesse de penser que la mesure que nous avons proposée est d’un autre niveau. Elle prolonge le sillon incitatif, mais en le creusant de façon plus volontariste et plus rapide. On reviendra sur ce qu’elle implique du point de vue de l’adaptation du troisième cycle, mais il faut, me semble-t-il, aller dans ce sens.
Le dispositif de l’amendement n° 499 rectifié est relativement souple ; il ouvre une possibilité au niveau du second cycle. Nous n’y sommes pas défavorables.
En revanche, les amendements n° 56 rectifié et 225 ne sont clairement pas en cohérence avec le message envoyé hier soir par le Sénat, qui a tendu la main aux jeunes, en leur indiquant qu’il n’entendait pas les contraindre ; il les a simplement appelés à prendre leur pleine part dans la résolution du problème de la désertification médicale. Nous avons besoin d’eux, et il s’agit donc de prendre en compte leurs besoins. Le groupe socialiste et républicain ne votera pas ces deux amendements.

Je fais un distinguo entre deuxième et troisième cycles, entre formation et formation professionnalisante.
Même si nous n’avons pas remporté un vif succès auprès du Gouvernement avec notre amendement concernant le troisième cycle, il me semble à moi aussi que l’option proposée hier soir est raisonnable. Il ne s’agit bien évidemment pas de la panacée pour résoudre le problème des déserts médicaux – expression d’ailleurs impropre, car les réalités qu’elle recouvre concernent non seulement la France rurale, mais aussi des banlieues, voire des hypercentres où l’immobilier est extrêmement cher, comme à Paris.
Les mesures coercitives peuvent être efficaces, à la rigueur, lorsqu’il y a pléthore : on l’a vu à propos des conventionnements sélectifs des infirmières et infirmiers. Mais lorsqu’il y a pénurie, comme dans le cas des médecins, de telles mesures n’ont absolument aucune efficacité. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables aux amendements.

Nous partageons la même préoccupation pour nos territoires : cela ne peut plus durer ! Dans certains d’entre eux, les gens ne sont tout simplement plus soignés !
Mesdames les ministres, il va bien falloir que vous preniez vos responsabilités, de manière plus marquante que vous ne l’avez fait hier soir.
Nous vous avons tendu la main. Les dispositions de l’amendement qui a été adopté peuvent sûrement être améliorées, notamment en termes d’autonomie des étudiants de troisième année de troisième cycle, c’est-à-dire en neuvième année de médecine. Quand j’étais étudiant, nous commencions à effectuer des remplacements en sixième année. Si, aujourd’hui, les étudiants de neuvième année n’ont pas acquis la maturité nécessaire pour assurer le face-à-face avec le malade, mieux vaudrait qu’ils changent de métier !
Sourires.

La dernière année professionnalisante va nous permettre de mettre à disposition de tous les territoires, en priorité ceux qui sont sous-dotés, des centaines de médecins. Même si ces étudiants ne sont pas encore docteurs, ils sont déjà capables de remplacer un médecin.
Mesdames les ministres, vous qui ne voulez pas, comme la plupart d’entre nous, de mesures coercitives, vous avez là l’occasion d’envoyer un signal fort aux territoires.

Je fais miens, en particulier, les propos de MM. Savary, Amiel et Jomier.
Qu’est-ce qu’un désert médical ? À Paris, on manque de médecins généralistes ; il en est de même en banlieue, pour des raisons différentes, ou à la campagne, pour d’autres raisons encore. Ces différences impliquent que les jeunes médecins doivent être aidés différemment selon l’endroit où ils veulent s’installer.
Si l’on veut instaurer une obligation de réaliser un stage de troisième cycle en zone sous-dense, comme le prévoit l’amendement n° 56 rectifié, encore faudra-t-il déterminer ce qu’est une telle zone.
En outre, comme le soulignait hier soir à juste titre Mme la ministre, les hôpitaux sont en zone sous-dense : de nombreux postes de praticien hospitalier ne sont actuellement pas pourvus, sur l’ensemble du territoire. Un étudiant effectuant un stage de troisième cycle en pédopsychiatrie dans un hôpital de Bretagne satisfait donc aux exigences posées par les auteurs de l’amendement, tandis que, en campagne, on a besoin de médecins généralistes…
Le problème ne pourra être réglé par petits à-coups, en ouvrant par exemple la possibilité aux étudiants de deuxième cycle de faire un stage en zone sous-dense, comme le propose M. Chasseing. Si le lieu de stage est éloigné de la faculté de médecine, qui prendra en charge les frais de transport et de logement de l’étudiant ? Cela devra être l’État ou la faculté ; c’est un autre sujet.
La proposition consensuelle de la commission des affaires sociales, émanant de l’ensemble des groupes politiques, me semble juste et saine. Si le Gouvernement l’acceptait, sa mise en œuvre pourrait avoir des répercussions positives sur l’ensemble des zones sous-denses – hôpitaux, villes, banlieues, campagnes…

La parole est à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Que les choses soient bien claires : l’existence de zones sous-denses n’est pas un phénomène récent, et s’il existait des solutions simples, ce problème aurait été résolu depuis longtemps.
Quelques exemples où un travail de terrain, non coercitif, visant à répondre aux aspirations d’internes faisant le choix de s’installer en secteur libéral au terme de très longues études nous ont été présentés. Par définition, s’agissant d’installations en libéral, la seule action possible est de créer, pour les futurs médecins, des conditions leur permettant d’apprécier de découvrir et d’apprécier le territoire où ils effectuent leurs stages, une certaine façon d’exercer, une certaine qualité de vie, une certaine patientèle.
Je suis persuadée que c’est dans cette direction que nous devons travailler. Le doublement du numerus clausus, en 2005, n’a pas permis de résoudre le problème des déserts médicaux. La question est donc de savoir comment inciter des jeunes à choisir de manière positive, après des études très longues et très difficiles, de s’installer dans des territoires où, j’en suis convaincue, l’exercice de la médecine peut être tout à fait épanouissant sur les plans intellectuel, personnel et professionnel.
Les réformes que nous vous proposons ont pour objectif de remettre en valeur ce qui a longtemps été au cœur du métier de médecin et que nous avons peut-être un peu perdu de vue, parce que la formation est devenue de plus en plus technologique, au détriment du contact humain.
L’ensemble de ce projet de loi vise à améliorer la situation. Nous pourrons, bien évidemment, rediscuter d’un certain nombre de dispositions, mais je tenais à faire cette déclaration de manière très solennelle. Tout comme vous, le Gouvernement est très attaché à la préservation de l’accès à des soins de qualité pour tous nos concitoyens.
Je ne crois pas à la coercition. Je connais de jeunes médecins diplômés qui, si on voulait les obliger à exercer sur un territoire qu’ils n’ont pas choisi, renonceraient tout simplement à s’installer : contre cela, on ne peut rien !
Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.

Je ne voterai pas ces amendements, même si je partage les préoccupations et le diagnostic de mes collègues.
Ne rien faire, ici au Sénat, chambre représentant les territoires, pour tenter d’améliorer la situation de la démographie médicale aurait été irresponsable. La commission des affaires sociales a donc travaillé de façon transpartisane, en tendant la main à la fois aux étudiants en médecine – la mesure que nous avons adoptée hier n’est pas coercitive – et au Gouvernement, pour proposer une réponse pragmatique et efficace à la situation d’urgence de certains territoires, ruraux ou urbains. La transformation de la dernière année de médecine – en médecine générale ou dans certaines spécialités, comme l’ophtalmologie ou la gynécologie – en année professionnalisante, pour permettre aux étudiants d’exercer, en priorité dans les zones sous-denses, pendant une année complète, présenterait en outre l’intérêt, mesdames les ministres, de libérer des places de stage. Ces étudiants en neuvième année de médecine, s’ils exerceront en « autonomie supervisée », ne travailleront pas pour autant seuls au milieu de nulle part : un confrère sera présent dans le cabinet à côté.
Mme la ministre de l ’ enseignement supérieur, de la recherche et de l ’ innovation le conteste.

À nos yeux, l’amendement présenté par la majorité des membres de la commission des affaires sociales qui a été adopté hier était rédigé d’une telle façon qu’il opposait pratique en cabinet et pratique hospitalière. J’avais d’ailleurs attiré votre attention sur ce problème, mes chers collègues.
Par ailleurs, Cathy Apourceau-Poly avait soulevé la question du statut de ces médecins-étudiants de neuvième année, exerçant en pleine autonomie : s’ils ne sont plus dans un cadre de formation, quel sera alors leur statut ? Comment seront-ils rémunérés ? Qui financera, le secteur libéral ou l’hôpital ? Avec humour, un de nos collègues a déclaré qu’il ne devait pas y avoir de questions d’argent entre nous. Toujours est-il que nous n’avons pas obtenu de réponse…
Ces amendements, assez similaires à celui que nous avons adopté hier, n’apportent à mon sens rien de nouveau. Pourquoi revenir sur le sujet à cet endroit du texte ?
Enfin, la Haute Assemblée est certes la chambre représentant les collectivités territoriales, mais on ne se le rappelle que quand cela nous arrange ! La situation que nous connaissons aujourd’hui en matière de santé est la conséquence des politiques menées depuis trente ans.

C’est l’échec de ces politiques qui est cause de l’existence de déserts médicaux, du manque de médecins. Et pourtant, vous continuez de les soutenir en votant, lors de l’examen de chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale, des restrictions de crédits !
Proposer quelques mesures pour se donner bonne conscience, cela ne fait pas une politique de santé à même de répondre aux besoins de tous les territoires, ruraux et urbains.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
De nombreux sénateurs présents aujourd’hui n’étaient pas là hier, lorsque nous avons discuté des stages. Je souhaiterais donc faire quelques rappels.
Tout d’abord, le problème de la démographie médicale est aujourd’hui mondial : aucun pays n’a suffisamment formé de médecins. Eu égard notamment au vieillissement de la population et au fait que les populations de nombreux pays sortis de la pauvreté ont aujourd’hui besoin d’accéder aux soins, le directeur général de l’OMS soulignait, la semaine dernière, qu’il manquait 12 millions de soignants à travers le monde. J’ai réuni les ministres de la santé des pays du G7, voilà quinze jours, ainsi que ceux des pays du G5 Sahel : tous les pays se font aujourd’hui concurrence pour attirer des médecins.
La métropolisation des médecins, qui choisissent de s’installer dans des zones urbaines plutôt qu’en milieu rural, est un autre phénomène de portée internationale : tous les pays cherchent à améliorer l’attractivité des zones rurales. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi l’organisation des soins primaires, la lutte contre les déserts médicaux et l’échange de bonnes pratiques entre pays pour rendre plus attractif l’exercice médical dans les territoires ruraux comme thématiques du G7 Santé qui s’est tenu en France cette année. La situation que nous vivons n’est pas spécifiquement française ; elle est internationale.
Aujourd’hui, les jeunes médecins cherchent à exercer en coordination avec d’autres professionnels de santé. Ils n’ont pas envie d’un exercice isolé. C’est pourquoi nous prévoyons, au travers de ce texte, de doubler le nombre de centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles. Les territoires parvenant à recruter des jeunes médecins sont ceux qui se montrent particulièrement actifs en termes de création de maisons de santé pluriprofessionnelles – je pense notamment à l’Aveyron, exemplaire sur ce plan.
En outre, l’article 2 du projet de loi vise, comme vous le souhaitez, à favoriser la découverte de nouveaux modes d’exercice, en service de PMI, en médecine du travail, en médecine scolaire, en exercice libéral, en zone sous-dense… Nous manquons de médecins partout, dans tous les secteurs, et nous ne pouvons privilégier uniquement l’exercice libéral. Comme l’a souligné Mme Cohen, nous manquons de praticiens hospitaliers : dans les hôpitaux généraux, 27 % des postes sont vacants. Nous devons donc également encourager l’exercice hospitalier.
Les amendements dont nous discutons visent à permettre à des étudiants de découvrir l’exercice libéral en zones sous-dotées. Si l’on veut qu’ils s’y installent au terme de leur cursus, il faut rendre cette découverte attractive. L’objectif n’est pas de contraindre de jeunes internes tout juste formés, avec une qualité de médecine balbutiante, à passer six mois en zone rurale avant de repartir en courant parce qu’ils auront été confrontés à des cas complexes sans pouvoir demander un avis à un spécialiste, sans bénéficier d’aucune supervision. Une telle situation ne pourra que les angoisser et ils n’auront qu’une seule envie : retourner dans un hôpital ou dans une zone où leur exercice sera supervisé.
Afin que ces étudiants puissent être pris en charge dans de bonnes conditions, nous vous proposons, au travers du projet de loi, de diversifier les lieux de stage et de multiplier le nombre de maîtres de stage universitaires, que nous augmentons aujourd’hui d’environ 20 % par an.
Nous partageons le même objectif, à savoir structurer les soins primaires. Le texte vise à donner aux acteurs des territoires des outils à cette fin. Vous ne réglerez pas le problème de la désertification médicale par une unique mesure emblématique, en envoyant de jeunes internes en zones sous-denses, sans accompagnement ni formation : ils n’auront pas envie d’y rester.
Nous vous proposons de mettre en place des outils destinés à renforcer l’attractivité de cet exercice, afin qu’il reprenne toute sa place dans les choix d’installation des jeunes médecins. Le Gouvernement entend la souffrance des territoires : l’ensemble du projet de loi a vocation à y répondre. Je le redis, ce n’est pas par une mesure unique que l’on pourra régler le problème de la désertification médicale, qui est d’ampleur internationale.
M. Philippe Bonnecarrère applaudit.

Monsieur Chasseing, souhaitez-vous retirer l’amendement n° 499 rectifié ?

Oui, madame la présidente. Hier soir, le Sénat a pris une décision très forte pour les territoires sous-denses et ruraux.

L’amendement n° 499 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe La République En Marche.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 130 :
Le Sénat n’a pas adopté.
La parole est à M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis.

J’ai le sentiment que mon amendement n° 225 connaîtra le même sort s’il est mis aux voix. Pour faire gagner un peu de temps au Sénat, je le retire.

L’amendement n° 225 est retiré.
L’amendement n° 772 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, M. Magras, Mme Ramond, M. Courtial, Mme Troendlé, MM. Perrin et Raison, Mmes L. Darcos, Noël et Berthet, MM. Reichardt et Piednoir, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Procaccia, MM. Lefèvre, Chaize, de Legge et Karoutchi, Mme Lamure, MM. Bonhomme, Cuypers, Danesi, Sido, Longuet et Gilles, Mme Morhet-Richaud et MM. Segouin, Dufaut et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du troisième cycle, elles permettent à l’étudiant qui poursuit ses études de médecine dans une autre région que la sienne de réaliser son stage d’internat dans son département d’origine.
La parole est à Mme Pascale Gruny.

Cet amendement vise à permettre à un étudiant en médecine de troisième cycle de réaliser son stage obligatoire d’internat dans son département d’origine, même s’il poursuit ses études dans une autre région.
En effet, le lieu où s’effectue le stage détermine, dans 60 % des cas, le lieu d’installation du futur praticien. Cette donnée est importante pour les départements touchés par la désertification médicale.
Par exemple, la majorité des étudiants originaires du sud de mon département, l’Aisne, qui se destinent à la médecine générale fréquentent la faculté de Reims pour des raisons de proximité. Ils relèvent dès lors, pour leurs études, d’un autre département, d’une autre région, d’une autre agence régionale de santé, et ont aujourd’hui l’obligation de faire leur stage dans le périmètre de leur université, soit le Grand Est. Sans accord pédagogique et sans possibilité de transaction financière entre les agences régionales de santé – le maître de stage étant rémunéré –, les Axonais qui étudient à la faculté de médecine de Reims ne peuvent pas faire leur stage d’internat dans l’Aisne.

Il paraît curieux de vouloir faire figurer cette précision très ciblée à l’article L. 632-1 du code de l’éducation, qui définit les objectifs généraux des études de médecine. Ce point devrait plutôt être renvoyé au décret prévu à l’article 2, qui porte spécifiquement sur l’organisation du troisième cycle.
En tout état de cause, il ne semble pas à la commission que le règlement de ces situations relève de la loi. Elle demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
La possibilité de réaliser des stages hors région, et même hors subdivision de troisième cycle, existe depuis de nombreuses années. De tels stages sont même parfois nécessaires à la réalisation de certains parcours de formation. Très appréciés des étudiants, ils font l’objet de modalités de financement spécifiques, dans le cadre du financement du troisième cycle, afin que la contrainte budgétaire constitue un frein minimal à leur mise en œuvre. Je reconnais néanmoins que l’on doit pouvoir encore simplifier et améliorer les choses.
La réforme du troisième cycle a d’ailleurs conforté ces stages en ouvrant la possibilité aux étudiants de demander deux stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d’affectation au cours de la phase d’approfondissement.
Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; sinon, l’avis sera défavorable.

Que cette précision soit renvoyée à un décret ne me pose pas de problème.
Madame la ministre, vous dites que la question est déjà réglée. Pourtant, l’année dernière, la faculté de Reims n’a pas voulu accéder à notre demande. Ce n’est qu’au début de cette année que le département de l’Aisne a pu enfin signer une convention avec cette dernière : cela a été très compliqué !
Je ne peux pas entendre que la question est réglée, car tel n’est pas le cas. Je ne pense pas que notre département soit le seul à être confronté à des difficultés dans ce domaine. Je retire néanmoins mon amendement, pour les raisons invoquées par le rapporteur, mais j’aimerais que ces situations soient examinées attentivement : le problème n’est pas que nos étudiants aillent faire des stages dans une autre région, il est qu’ils ne reviennent pas chez nous au terme de leurs études, parce qu’ils ont pris des habitudes ailleurs.

L’amendement n° 772 rectifié ter est retiré.
La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Je veux vous rassurer, madame Gruny : je suis tout à fait sensible à votre interpellation, d’autant que d’autres sénateurs et députés m’ont alertée sur ces problématiques de frontières administratives. Rencontrant les directeurs des agences régionales de santé chaque mois à l’occasion de leur séminaire, je leur ai donné instruction orale de prendre bien garde à ce que ces barrières administratives ne soient pas trop rigides et de permettre des conventionnements avec des départements limitrophes de celui où se trouve le CHU pour que des étudiants puissent effectuer des stages hors région. Je le leur redirai. Les choses doivent se mettre en place doucement, sachant que ce n’était pas dans les habitudes. J’y serai vigilante.

L’amendement n° 55 rectifié, présenté par Mme Noël, MM. Dufaut, D. Laurent, Darnaud et Morisset, Mme Deromedi et MM. Laménie, Poniatowski, Perrin et Raison, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les stages en médecine ambulatoire spécialisée comme la gynécologie, la pédiatrie ou l’ophtalmologie sont désormais ouverts aux étudiants du deuxième cycle.
La parole est à M. Michel Raison.

Nous voulons décidément faire faire beaucoup de choses aux étudiants en médecine : au cours du deuxième cycle, ils devraient participer à des échanges internationaux, faire des stages de médecine générale, effectuer des stages en zones sous-denses et maintenant, si l’on suit les auteurs de cet amendement, en médecine ambulatoire spécialisée !
Mon cher collègue, adopter cet amendement ne me paraît pas souhaitable, car il me semble que le problème est pris à l’envers : avant de prévoir d’envoyer nos étudiants auprès de spécialistes libéraux, il faudrait établir les bases pour organiser des stages en ambulatoire, quelle que soit la spécialité, avec un encadrement satisfaisant, ce qui est loin d’être acquis aujourd’hui.
L’article 2 ter et l’amendement n° 1 rectifié quater prévoient cette possibilité pour le troisième cycle : je propose que nous commencions par là. Si cela fonctionne bien, peut-être pourrons-nous envisager, beaucoup plus tard, d’étendre cette possibilité au deuxième cycle.
Je rappelle par ailleurs que les étudiants de deuxième cycle n’ont, par définition, pas encore choisi de spécialité.
Enfin, l’amendement présente d’importants problèmes rédactionnels. La commission demande donc son retrait ; sinon, l’avis sera défavorable.

Il s’agit d’ouvrir une possibilité, et non d’instaurer une obligation. Je maintiens cet amendement.

Madame la ministre, si j’ai bien compris, un étudiant de sixième année ne peut pas effectuer un stage à l’extérieur de l’hôpital parce qu’il n’y est pas préparé. Or, dans le temps, les étudiants de sixième année de médecine assuraient des remplacements seuls, y compris en milieu rural. Étaient-ils plus intelligents que les étudiants d’aujourd’hui ou les études de médecine étaient-elles alors plus pratiques ?

L’amendement concerne les stages en médecine ambulatoire spécialisée pour les étudiants de deuxième cycle. Même dans le temps, les étudiants de sixième année n’en effectuaient pas.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 797, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 632-2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 789 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme L. Darcos, MM. Brisson et Kern, Mme Eustache-Brinio, MM. Henno, Piednoir, Guerriau et Laugier, Mme Deromedi, MM. D. Laurent et Paccaud, Mme Duranton, M. Vaspart, Mmes Ramond, M. Mercier, Lassarade, Bruguière et Raimond-Pavero, MM. Sol, Dufaut et B. Fournier, Mme Noël, M. Moga, Mme Gruny, MM. Houpert et Bouloux, Mme Billon, M. Malhuret, Mme Vullien, MM. Decool et de Nicolaÿ, Mme Imbert, M. Pointereau, Mmes Férat et Gatel, M. Karoutchi, Mme Lamure, MM. Bonhomme, Laménie, Mandelli, Sido, Bouchet, Gremillet et Darnaud, Mme de Cidrac et M. Genest, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Le parcours de formation des étudiants en médecine intègre un module obligatoire relatif à la prescription d’activités physiques adaptées dans une démarche thérapeutique mentionnées à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique.
Les conditions d’application du présent article ainsi que le contenu de cet enseignement sont définis par voie réglementaire.
La parole est à M. Michel Savin.

Cet amendement a pour objet d’intégrer dans le cursus des étudiants en médecine un module de formation obligatoire concernant la prescription d’activités physiques adaptées dans une démarche thérapeutique.
Il s’agit d’inscrire dans la loi la sixième préconisation d’un rapport de l’Inserm publié le 14 février dernier, qui démontre l’importance de la pratique sportive pour les patients atteints d’une affection de longue durée et recommandant la prescription systématique d’activités physiques dans de tels cas.
L’article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet que, dans le cadre du parcours de soins d’un patient atteint d’une affection de longue durée, le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Cette possibilité de prescription d’activité physique adaptée par le médecin traitant a été déclinée par le décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée.
Cette pratique du « sport sur ordonnance » concerne 10 millions de personnes souffrant d’ALD telles que la maladie de Parkinson, certains cancers, le diabète, etc. Elle permet d’améliorer leur condition physique, de diminuer la dépendance du système de soin à l’allopathie, de réduire les risques de récidive et de réhospitalisation.
Mes chers collègues, beaucoup de professionnels soulignent les avantages qu’il y aurait à ce que les médecins connaissent mieux l’intérêt de la prescription d’activités physiques adaptées pour certaines pathologies.

M. Savin et moi avons eu de nombreuses discussions, assez épiques, sur ce sujet. Si nous sommes d’accord sur le fait qu’une activité physique maintient tout un chacun dans un état de santé satisfaisant, il n’est pas obligatoire pour autant d’inscrire dans le programme des études de médecine un module relatif à la prescription d’activités physiques adaptées. Si l’on devait mettre en place l’ensemble des modules d’enseignement qu’il nous a été proposé d’introduire cet après-midi, il ne resterait plus de temps à l’étudiant en médecine pour étudier la médecine ! Il serait peut-être préférable de s’en tenir là : l’objectif est que les étudiants en médecine deviennent des médecins. Une fois médecins, peut-être pourront-ils passer un diplôme universitaire spécifique.
Par ailleurs, je rappelle que, dans certaines villes, la pratique du « sport sur ordonnance » est financée par les collectivités territoriales. En commission des affaires sociales, nous avons discuté du cas de la ville de Strasbourg, qui attribue 1 200 euros à chaque personne malade pratiquant une activité physique sur prescription médicale. Si cette prescription médicale devait être prise en charge par la sécurité sociale, je vous laisse calculer combien cela coûterait, à ce tarif, pour 10 millions de personnes… Le déficit de la sécurité sociale se trouverait aggravé de quelques milliards d’euros supplémentaires !
Il faut sensibiliser les médecins au fait que l’activité physique permet de se maintenir en forme – il faudrait d’ailleurs en faire autant pour les sénateurs
Sourires.
Monsieur le sénateur Savin, encore une fois, nous ne souhaitons pas inscrire dans la loi la liste des thématiques qui devraient être enseignées pendant les études de médecine. Pour autant, il est reconnu que l’activité physique adaptée est effectivement un « plus » dans beaucoup de pathologies. Dans le cadre du changement de mode de tarification que je compte mettre en œuvre, notamment de la forfaitisation du traitement d’un certain nombre de pathologies chroniques, je souhaite que l’activité physique adaptée prescrite en prévention secondaire de ces pathologies puisse être prise en charge globalement. Je pense notamment à la prise en charge de l’activité physique adaptée après un cancer du sein que nous mettons en place dans le cadre du plan Priorité prévention.
Par ailleurs, la Haute Autorité de santé vient de rendre son avis sur l’activité physique adaptée et a fait des recommandations à ce sujet, notamment en matière d’aide à la prescription pour les médecins. N’importe quel médecin peut aujourd’hui, en se référant à cet avis, savoir comment prescrire une activité physique adaptée.
Je le répète, même si ce sujet est extrêmement important, il me semble nécessaire de veiller à ne pas inscrire dans la loi la totalité des thématiques auxquelles nous sommes sensibilisés. L’avis est défavorable.

Les propos de M. le rapporteur et de Mme la ministre sont quelque peu en contradiction avec le fait de reconnaître, avec l’ensemble des professionnels, que la pratique d’une activité physique adaptée est un « plus » dans nombre de pathologies. Aujourd’hui, les médecins, par manque de formation, ne savent à qui adresser ceux de leurs patients qui auraient besoin, en raison de leur pathologie, de pratiquer une activité physique adaptée. Il paraît donc nécessaire de permettre aux étudiants en médecine de suivre une formation, même courte, à la prescription d’activités physiques adaptées. Il s’agirait d’une simple possibilité, pas d’une obligation.
Je maintiens mon amendement, même si je sais par avance quel sort sera réservé.

C’est là un sujet particulièrement intéressant. On sait bien que la pratique d’une activité physique est importante pour les personnes atteintes de certaines pathologies chroniques, mais également pour les patients souffrant de troubles neurodégénératifs. Physiologiquement, l’homme a besoin d’un équilibre entre la tête et les jambes : un peu de bon sens permet peut-être parfois une meilleure prise en charge !
Madame la ministre, je n’ai rien contre la forfaitisation, mais, comme le forfait n’est pas extensible, la prise en charge de l’activité physique adaptée se fera au détriment de celle d’un autre soin… Je tiens à attirer votre attention sur ce point.
Cela montre bien, d’ailleurs, qu’il reste des efforts à faire pour améliorer les soins dispensés aux Français. Un objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé à 200 milliards d’euros, fût-il en progression régulière, ce n’est pas suffisant. Quand j’entends dire, notamment du côté de Bercy, que la sécurité sociale connaîtra des excédents, j’ai envie de répondre qu’il faudrait peut-être, avant de parler d’excédents, couvrir entièrement les besoins qui ne le sont pas encore.
Enfin, comme toujours en matière de prévention, on voit le coût immédiat de la mesure, mais pas son amortissement au fil des ans. C’est la raison pour laquelle, avec ma collègue Catherine Deroche, nous travaillons à la mise en place d’un Ondam pluriannuel, qui prendrait davantage en compte la prévention. À cet égard, le rapport Libault est tout à fait intéressant, mais on voit bien qu’un certain nombre d’améliorations seront nécessaires.
Nous reviendrons sur le sujet lors de l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais il faut véritablement le prendre en compte, car les activités sportives adaptées s’inscrivent désormais pleinement dans le parcours de soins du patient. Leur prise en charge ne doit pas forcément être assumée par les collectivités locales, comme c’est le cas actuellement pour les réseaux Sport-Santé Bien-Être qui ont été créés dans différents départements.
Je voterai contre cet amendement, pour les raisons invoquées par le rapporteur, mais cette question devra être de nouveau abordée au moment de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, me semble-t-il.

Il est évident pour tout le monde qu’une activité physique améliore la santé des patients, si elle est adaptée à leur maladie. Cela dit, dans une perspective de prévention, il vaudrait mieux affirmer carrément la nécessité de pratiquer une activité physique dès l’enfance pour retarder au maximum la survenue de la maladie. L’éducation nationale devrait obliger les enfants à faire du sport à l’école. Je pense en particulier à la pratique de la natation. Actuellement, on manque malheureusement de piscines en France, et nombre de municipalités en ferment parce qu’elles coûtent trop cher. De fait, beaucoup d’enfants n’apprennent plus à nager. Cet été, on a enregistré un nombre considérable de noyades, alors que dans les années soixante-dix et quatre-vingt, à l’époque de la construction des 1 000 piscines, la mort par noyade était devenue beaucoup moins fréquente.
Pratiquons donc d’abord la prévention par l’enseignement d’une activité physique dès l’enfance : cela permettra, j’en suis sûr, que nos compatriotes ne connaissent la maladie que beaucoup plus tardivement qu’aujourd’hui, ce qui profitera aussi à la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’amortissement du coût de la mesure proposée par M. Savin, celle-ci permettrait certes à terme une réduction des dépenses de la sécurité sociale. Pour autant, l’activité physique doit relever d’une démarche naturelle ; elle n’a pas vocation à être prescrite par un médecin ni prise en charge par la sécurité sociale.
La prévention est évidemment la priorité du Gouvernement. Ainsi, le plan Priorité prévention prend en compte toutes les mesures d’éducation à la santé dès l’enfance. Je vous renvoie en outre à tout ce que Mme Vidal et moi-même avons inscrit dans le programme du service sanitaire des étudiants en santé.
Par ailleurs, au cours d’un enseignement portant sur une pathologie telle que le diabète, l’hypertension artérielle ou le cancer, les questions de prévention sont abordées. Un cancérologue enseigne à ses étudiants que l’activité physique adaptée permet de réduire de 30 %, c’est-à-dire tout autant que l’hormonothérapie, la mortalité des patientes atteintes d’un cancer du sein.
La prévention primaire et la prévention secondaire font partie de l’enseignement pour toutes les pathologies. Faites confiance aux enseignants de médecine, faites confiance aux facultés de médecine françaises pour enseigner tout ce qui relève des bonnes pratiques, y compris en matière de prévention, sans qu’il soit nécessaire de prévoir dans la loi un module spécifique.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 bis est adopté.

L’amendement n° 390 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, MM. Vanlerenberghe et Henno, Mmes Dindar, C. Fournier et Guidez et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1435-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec un réseau de santé, un centre de santé, un pôle de santé ou une maison de santé peut, le cas échéant par avenant, lui assigner des objectifs sur le nombre minimal d’étudiants à accueillir en application des articles L. 4131-6 du présent code ou L. 632-5 du code de l’éducation. »
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Cet amendement a pour objet d’inciter les médecins à devenir maîtres de stage.
Nous nous rejoignons tous sur le constat que la réalisation de stages en ambulatoire permet de favoriser l’installation de médecins sur nos territoires. Toutefois, il faut pouvoir disposer de maîtres de stage sur l’ensemble de nos territoires. Je note que le nombre de maîtres de stage augmente ; il faut cultiver cette dynamique.
Respectueux de la liberté des praticiens, les auteurs de cet amendement souhaitent inciter les médecins des réseaux de santé, des centres de santé ou encore des maisons de santé à se former pour pouvoir accompagner un étudiant en médecine lors d’un stage.
D’après les informations dont nous disposons, cet amendement serait satisfait par un arrêté ou une circulaire. Il s’agit donc ici d’inscrire dans la loi un dispositif dont la mise en place est souhaitée à la fois par le Gouvernement et par le Parlement, dans la mesure où nous sommes tous d’accord, ici au Sénat, pour permettre aux étudiants qui le désirent d’effectuer leurs stages en ambulatoire, notamment en zones sous-denses.
L’adoption de cet amendement permettrait aux ARS de se prévaloir de la loi pour utiliser le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le CPOM, de manière incitative. Elles pourraient, par exemple, mettre en place un système de bonus-malus en fonction de la présence de maîtres de stage universitaires dans les structures bénéficiant d’un CPOM.

Le dispositif que vous proposez, madame Guidez, n’est pas contraignant ; il s’agit d’ouvrir une simple possibilité. En l’état actuel du droit, rien ne semble s’opposer à ce que de tels objectifs figurent dans les CPOM, même si ce n’est pas obligatoire. Il n’est donc pas nécessaire de le prévoir expressément dans la loi.
J’émettrai en outre deux réserves sur cet amendement.
La première réserve porte sur le ciblage des structures. Il pourrait également être intéressant, pour des étudiants, de faire des stages auprès d’associations de permanence de soins ou de professionnels constitués en communautés professionnelles territoriales de santé. On peut tout imaginer. Cela ne signifie pas qu’il faudrait prévoir des objectifs d’accueil de stagiaires également pour ces structures ; simplement, il n’est pas nécessairement opportun de viser certaines structures plutôt que d’autres, car cela peut brouiller le message envoyé aux étudiants et aux acteurs de santé.
La seconde réserve tient au fait que le problème me semble avoir été pris à l’envers. Avant d’imposer des objectifs chiffrés à certaines structures de soins seulement, nous devons nous assurer que les conditions du développement de stages extrahospitaliers sont réunies. Cela nécessite, en particulier, de prévoir ces stages dans les maquettes de formation, mais également de former suffisamment de maîtres de stage. À ces conditions, les étudiants pourront faire des stages dans tout type de structure ambulatoire dans des conditions d’encadrement satisfaisantes, ce qui n’est pas encore le cas pour l’instant.
À défaut d’un retrait de l’amendement, la commission émettra un avis défavorable.
Madame la sénatrice, l’avis du Gouvernement est identique à celui du rapporteur. Effectivement, rien ne s’oppose à ce que de tels objectifs figurent dans les CPOM. Notre objectif commun à tous est de développer et de diversifier les terrains de stage en ambulatoire, en zones sous-denses en particulier.

Non, je le retire, madame la présidente, puisque ce que je propose est d’ores et déjà possible.
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le mot : « générale » est supprimé ;
2°
Non modifié

L’augmentation du nombre d’étudiantes et d’étudiants en médecine et de futurs infirmiers pose évidemment la question du nombre de maîtres de stage en mesure de les accueillir.
Concernant la médecine générale, voilà quelques semaines, le Syndicat national des enseignants de médecine générale a publié des chiffres annuels très encourageants en matière de maîtrise de stage. Le nombre de maîtres de stage des universités progresse pour la troisième année consécutive au sein de la filière universitaire de médecine générale, pour dépasser le cap symbolique des 10 000.
Si l’indemnité des maîtres de stage des universités est augmentée de 300 euros par mois pour ceux qui sont installés en zones sous-denses, des difficultés demeurent, l’enveloppe destinée à la formation ayant été divisée par deux, ce qui limite la possibilité de suivre une formation plus fréquemment que tous les deux ans.
Nous pensons donc qu’il faut augmenter les crédits de la formation, pour accroître le nombre de maîtres de stage des universités. Il convient également de revoir leur répartition territoriale, car elle est aujourd’hui inégale.
Nous regrettons que le Gouvernement ne prenne pas en considération ces aspects au travers du présent projet de loi.

L’amendement n° 16 rectifié ter, présenté par Mme Doineau, MM. Vanlerenberghe et Henno, Mmes Dindar, C. Fournier, Guidez et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « étudiants de », sont insérés les mots : « deuxième cycle et de » ;
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de l’agrément des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’agrément peut être accordé aux praticiens installés depuis au moins un an pour une durée maximale de cinq ans. »
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Les stages apparaissent comme un levier d’action essentiel pour faire découvrir aux étudiants en médecine les réalités des territoires fragiles et la richesse des modes d’exercice, et orienter ainsi les vocations. Pourtant, les textes prévoient le suivi obligatoire d’un stage d’initiation à la médecine générale en cabinet libéral, en maison de santé ou en centre de santé pendant l’externat. Ce stage n’est pas effectué partout, en raison d’un déficit de maîtres de stage, mais aussi d’un manque de volontarisme des unités de formation et de recherche en santé. Il n’en constitue pas moins une étape essentielle pour découvrir une spécialité méconnue et trop souvent dévalorisée au sein d’un second cycle qui demeure fortement hospitalo-universitaire.
Cet amendement vise à faciliter l’agrément des praticiens maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycles de médecine, afin de diversifier et de multiplier les lieux de stage, ce qui permettra in fine l’orientation de davantage d’étudiants vers la médecine générale et les territoires sous-dotés.

Cet amendement apparaît intéressant à la commission, à deux titres.
En premier lieu, il tend à compléter la base législative du code de la santé publique ouvrant la possibilité aux étudiants en médecine de réaliser des stages extrahospitaliers, pour étendre celle-ci aux étudiants de deuxième cycle sans l’inscrire dans le code de l’éducation. Cela signifie qu’il sera possible aux étudiants d’effectuer de tels stages sur la base du volontariat, même si le code de l’éducation ne le prévoit pas expressément.
En second lieu, les auteurs de cet amendement soulèvent une question pertinente quant aux modalités concrètes de réalisation de ces stages, en prévoyant un encadrement au niveau législatif de l’agrément des maîtres de stage. À l’heure actuelle, ce régime n’est défini qu’au niveau réglementaire, ce qui est sans doute insuffisant. Il est donc proposé de déterminer cet encadrement à droit constant, tout en fixant le principe d’une formation obligatoire.
L’avis de la commission est favorable.
Je ne reviendrai pas sur l’intérêt de développer et de diversifier la maîtrise de stage ambulatoire, non plus que sur la nécessité de redoubler d’efforts en ce sens ; nos deux ministères sont résolument mobilisés à cette fin. Ces efforts ont débouché sur un certain succès, puisque l’on compte maintenant quelque 10 700 maîtres de stage et que ce nombre augmente d’environ 20 % chaque année.
L’enjeu premier réside tout autant dans le processus de formation des praticiens à la maîtrise de stage que dans l’émergence de candidatures à l’agrément de lieux de stage répondant aux critères pédagogiques requis pour accueillir et former les étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine.
Ces deux processus sont complémentaires, c’est dans ces deux directions que toutes les mesures susceptibles de faciliter la maîtrise de stage doivent être envisagées, avec le souci permanent de préserver la qualité de l’encadrement et de la formation.
Ces mesures relèvent actuellement du niveau réglementaire et doivent être en permanence étroitement concertées. C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à ce que des options soient ainsi préemptées au niveau de la loi, ce qui rendrait leur éventuelle adaptation beaucoup plus compliquée.
Nous sommes néanmoins bien entendu très favorables au développement de la maîtrise de stage ambulatoire et de nouvelles initiatives vont être prises par nos deux ministères pour conforter encore l’augmentation du nombre de maîtres de stage que nous constatons depuis maintenant deux années consécutives.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 350 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les mots : « peuvent être autorisés à effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;
La parole est à Mme Josiane Costes.

Les internes en médecine représentent un vivier de compétences qu’il serait utile de mettre au service des territoires.
Leur statut est particulier, puisqu’ils sont toujours des étudiants, mais des étudiants dont la formation est déjà bien avancée et qui peuvent réaliser toute une série d’actes médicaux. Malheureusement, la formation des internes en médecine est trop tournée vers le secteur hospitalier. Si les stages en cabinet médical ont été rendus possibles récemment, ils sont encore trop peu fréquents et il est nécessaire d’augmenter le nombre de maîtres de stage.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à imposer aux étudiants en médecine de troisième cycle d’effectuer des stages auprès de praticiens exerçant en libéral, en complément des stages en hôpital.
Rendre obligatoires de tels stages pour les internes en médecine permettrait tout d’abord de lutter contre le manque de médecins en zones sous-denses. Les internes en médecine pourraient ainsi assurer des consultations dans le territoire où est situé l’hôpital.
Par ailleurs, cela faciliterait l’ancrage de ces futurs médecins dans un territoire et sa population, et pourrait leur donner envie de s’y installer.

La préoccupation exprimée par Mme Costes est satisfaite par l’amendement n° 1 rectifié quater, que nous avons adopté à l’article 2 et dont la rédaction me paraît préférable, car elle tend à modifier le code de l’éducation, et donc la maquette de formation des étudiants. Cela me paraît plus opérationnel pour parvenir au résultat escompté.
L’article 2 ter porte sur la base législative du code de la santé publique permettant aux étudiants de faire des stages non hospitaliers. Il me semble que ce n’est pas à cet endroit du texte que nous devons instaurer une telle obligation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

L’amendement n° 350 rectifié est retiré.
L’amendement n° 553, présenté par MM. Théophile et Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires peuvent être agréés maîtres de stage et accueillir des étudiants en médecine dans la maquette de leur formation de troisième cycle au même titre que les médecins traitants. »
La parole est à M. Dominique Théophile.

Dans le cadre de la refonte des études médicales, les étudiants de troisième cycle sont appelés à réaliser des stages dans divers services hospitaliers ou en ambulatoire.
Aujourd’hui, tous les étudiants de troisième cycle n’ont pas la possibilité de faire leurs stages au sein d’associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires, ce qui est regrettable.
Le présent amendement prévoit que les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires, tels que les 1 300 médecins généralistes de SOS Médecins France, puissent être agréés maîtres de stage pour accueillir des étudiants en vue de compléter la nécessaire formation de ces derniers à la prise en charge des soins non programmés et urgents.

Il me semble, mon cher collègue, que rien dans la rédaction de l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, qui est très large, n’interdit de tels stages. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Monsieur le sénateur Théophile, les agréments sont délivrés par les ARS sur proposition des facultés de médecine et sur la base d’un projet pédagogique qui peut être présenté par tout médecin généraliste aux internes qui réaliseraient leur stage sous son encadrement. L’accueil d’étudiants au sein des associations en question est donc tout à fait possible en l’état actuel du droit.
Cet amendement étant satisfait, je vous propose de le retirer ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

Je n’ai pas le sentiment que les choses soient aussi claires que l’affirment M. le rapporteur et Mme la ministre. Pourraient-ils apporter des précisions supplémentaires afin de lever mes doutes ?

Si M. Théophile ne retire pas cet amendement, je le voterai. La possibilité d’effectuer de tels stages existe en effet sur le papier, mais, sur le terrain, l’agrément en tant que maîtres de stage de médecins membres d’associations telles que SOS Médecins se heurte à de réelles difficultés.
Lorsque j’ai évoqué ce sujet, on m’a également répondu que mon amendement était satisfait, mais je voudrais attirer de nouveau votre attention sur ce point, madame la ministre des solidarités et de la santé. Il importe d’identifier les freins qui sont à l’œuvre. Cette situation me semble d’autant plus regrettable qu’elle va à l’encontre de la politique visant à permettre aux jeunes médecins d’être à l’aise sur le terrain, en ambulatoire et en médecine d’urgence.

Comment les étudiants en médecine peuvent-ils suivre les cours obligatoires quand ils effectuent un stage loin de l’hôpital ? Mesdames les ministres, peut-être pourriez-vous réfléchir à la possibilité de faire dispenser ces cours par visioconférence. Ainsi, des étudiants pourraient faire plus facilement des stages en zones sous-denses ou à la campagne. Mon intervention n’est pas en lien direct avec l’amendement, mais il me semble qu’elle va dans le même sens.

La parole est à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Nous parlons ici du troisième cycle : la question de la conciliation des stages et du suivi de cours le matin ou l’après-midi ne se pose pas comme en deuxième cycle.
La formation de troisième cycle est très précisément encadrée par des textes qui fixent notamment les conditions d’octroi par les ARS des agréments pour l’accueil d’internes en stage. L’élément clé est le dépôt d’un projet pédagogique par le médecin généraliste ou par la structure qui souhaite accueillir l’étudiant pour un stage. Il ne suffit pas de vouloir être maître de stage et d’être formé pour cela, il faut également proposer un projet de formation, parce que le troisième cycle de médecine fait partie intégrante du cursus de formation, même s’il s’agit alors de formation professionnalisante.
En pratique, strictement rien n’empêche l’accueil d’internes par des associations comme SOS Médecins. Je ne doute pas que des difficultés puissent se présenter parfois, mais la loi ne peut, à mon sens, régler toutes les situations que l’on observe sur le terrain.
Rien ne s’oppose à l’accueil de stagiaires par de telles associations. La preuve en est que, aujourd’hui, en Île-de-France, huit médecins généralistes exerçant au sein de SOS Médecins sont agréés comme maîtres de stage universitaires. Il n’y a aucune difficulté, et il est donc inutile d’inscrire cela dans la loi. Les problèmes rapportés tiennent probablement à l’absence de dépôt de projet pédagogique.

L’amendement n° 553 est retiré.
L’amendement n° 554, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Théophile et Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À Mayotte, les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques dans des dispensaires. »
La parole est à M. Dominique Théophile.

Cet amendement vise à autoriser, à Mayotte, les étudiants de troisième cycle de médecine générale à effectuer une partie de leurs stages pratiques dans des dispensaires. Mayotte se caractérise en effet par une situation sanitaire particulière, à laquelle répond un maillage spécifique de l’offre de soins. Cette mesure permettrait de désengorger le centre hospitalier de Mayotte et de répondre ainsi à une préoccupation forte des Mahorais.

Il n’y a aucune raison pour que les médecins exerçant dans les dispensaires mahorais ne puissent pas devenir maîtres de stage, sous réserve qu’ils présentent un plan de formation. Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.
L ’ article 2 ter est adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 341 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et dans des conditions fixées par décret, les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens spécialistes agréés exerçant dans les collectivités d’outre-mer. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Cet amendement vise à permettre une dérogation à l’article L. 4131-6 du code de la santé, lequel impose actuellement aux étudiants de troisième cycle d’effectuer leurs stages auprès de médecins généralistes agréés.
Au regard de l’urgence sanitaire dans certains territoires, du manque criant de spécialistes et des délais d’attente, nous souhaitons qu’il soit possible, pour les étudiants, de réaliser leurs stages auprès de médecins spécialistes agréés exerçant en outre-mer.
Pour m’être rendue l’an dernier en Guyane et en Guadeloupe avec la commission des affaires sociales, je peux attester de la situation très préoccupante de la médecine de ville et des hôpitaux dans ces régions françaises ultramarines.
Il importe, à nos yeux, de faire évoluer notre droit afin de mieux répondre aux besoins de ces territoires et des patients et, par la même occasion, de diversifier les lieux de stage pour les étudiants.

L’amendement n° 440, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin, Conconne, Lepage et Ghali, MM. Todeschini et Mazuir, Mme Artigalas et MM. Manable et Montaugé, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et dans des conditions fixées par décret, les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens spécialistes agréés exerçant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
La parole est à M. Victorin Lurel.

Cet amendement est très proche de celui que vient d’exposer excellemment notre collègue Laurence Cohen.
J’ai le sentiment que, malgré vos efforts, mesdames les ministres, ce texte n’est pas tout à fait adapté à la situation des outre-mer. Je ne prétends pas que rien n’est fait, mais je n’y trouve pas de dispositions collant à la situation concrète de ces territoires.
Je vais faire ce que les politologues appellent du parochialisme ultramarin… Nos territoires sont sous-dotés au carré, au cube, même à la puissance dix ! Cet amendement vise non pas à créer une obligation, mais à ouvrir le champ des possibles en permettant aux étudiants de faire leurs stages, s’ils le souhaitent, non plus seulement chez les médecins généralistes, mais également chez les spécialistes. Cela accroîtrait les chances des étudiants ultramarins d’effectuer des stages professionnalisants.

Ces deux amendements me semblent satisfaits par l’article 2 ter du projet de loi, dont la portée semble par ailleurs plus large, dans la mesure où il autorise les étudiants de toutes spécialités à effectuer leurs stages auprès de praticiens libéraux, sans restriction territoriale.
La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur et s’associe à sa demande de retrait, ces amendements étant satisfaits. Aujourd’hui, la médecine générale est elle-même une spécialité. La possibilité souhaitée par les auteurs des amendements est déjà offerte.
Monsieur Lurel, nous nous préoccupons fortement des outre-mer. Nous avons d’ores et déjà créé, dans le cadre du plan d’accès aux soins présenté par le Premier ministre à la fin de 2017, 200 postes d’assistant spécialiste pour les outre-mer. Ces assistants des hôpitaux, qui ont la capacité de former des étudiants, sont en cours de recrutement dans tous les départements et dans toutes les collectivités d’outre-mer.
Par ailleurs, l’ensemble de ce texte vise à permettre à tous les territoires de s’organiser en fonction de leurs spécificités. Cette liberté donnée aux acteurs locaux concerne naturellement au premier chef les outre-mer.
Monsieur Lurel, vous ne pouvez donc pas dire que nous ne sommes pas spécialement attentifs à la situation des outre-mer. Au contraire, ce gouvernement, tous ses actes le montrent, a veillé particulièrement à accompagner l’offre de soins en outre-mer et à prendre en compte la question, prioritaire, de la prévention.

Le rapporteur a fait référence à l’article 2 ter, mais je ne vois pas où figure, dans le texte que j’ai sous les yeux, la faculté qu’il a évoquée. Il faudra m’éclairer davantage pour me conduire à retirer mon amendement.
Madame la ministre, j’entends vos propos et je peux même reconnaître vos efforts, mais la situation actuelle outre-mer, en termes de démographie médicale, d’attractivité, d’agrément des maîtres de stage universitaires, s’agissant notamment des médecins généralistes, est un vrai sujet. Des amendements relatifs aux surcoûts seront discutés tout à l’heure ; je veux bien que les fameux coefficients géographiques aient été récemment révisés, mais cela a été fait sans tenir compte de toutes les particularités de nos territoires tenant à l’éloignement et à l’insularité.
Qu’il faille recruter, c’est une évidence, eu égard au déficit considérable de personnel que nous connaissons. Un effort très important doit manifestement être fait. La loi renvoie à des plans d’action, mais j’aimerais voir graver dans le marbre du texte quelques améliorations.
Sous réserve de la réponse de notre rapporteur à propos de l’article 2 ter, dont la rédaction satisferait selon lui mon amendement, je suis disposé à retirer celui-ci.

L’article 2 ter modifie l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, en supprimant le mot « générale » et en remplaçant les mots : « généralistes agréés » par les mots : « agréés-maîtres de stage des universités ».

L’amendement n° 440 est retiré.
Madame Cohen, l’amendement n° 341 rectifié est-il maintenu ?

L’amendement n° 341 rectifié est retiré.
L’amendement n° 140 rectifié bis, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Lefèvre, de Nicolaÿ, Courtial, Vogel et Morisset, Mmes Puissat, Morhet-Richaud, Deromedi, Troendlé et Lopez, MM. Genest et Poniatowski, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mandelli, Bonne, Pellevat, Pierre, B. Fournier et Charon, Mme Lamure, M. Laménie et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « hormis pour le dernier stage de la formation de masso-kinésithérapie ».
La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat.

La maquette de formation des masseurs-kinésithérapeutes a intégré, en 2015, une cinquième année de formation, durant laquelle les étudiants réalisent un stage professionnalisant de trois mois, le clinicat.
Les critères d’évaluation de ce stage intègrent, notamment, la capacité de l’étudiant à concevoir et à mettre en œuvre un projet de soin de manière autonome, sous supervision du maître de stage.
L’autonomisation de l’étudiant dans la gestion d’une prise en charge induit de facto une augmentation de la patientèle, ce qui n’a jamais posé de problème pour les étudiants en médecine stagiaires. Or le cadre juridique actuel n’autorise pas l’augmentation de l’activité pour les masseurs-kinésithérapeutes. Cet amendement vise à remédier à cette situation et à permettre une augmentation de la patientèle dans le cadre du clinicat.

Il n’a pas paru opportun à la commission de réserver cette mesure aux seuls masseurs-kinésithérapeutes, pour des raisons évidentes d’équité entre les professionnels de santé.
L’interdiction de l’accroissement de l’activité rémunérée à l’occasion d’un stage a une finalité protectrice des patients comme des étudiants. Le code de la santé publique dispose que les actes remboursés par l’assurance maladie sont réputés être accomplis par des professionnels diplômés.
À défaut d’un retrait de cet amendement, la commission émettrait un avis défavorable.

Madame Christine Bonfanti-Dossat, l’amendement n° 140 rectifié bis est-il maintenu ?
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue visant à :
1° Créer une procédure de certification permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances, et de valoriser leur évolution ;
2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l’échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de ces conséquences.
II. –
Non modifié
1° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Madame la ministre, par cet article, vous demandez au Parlement d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour créer une procédure de recertification des professionnels de santé en exercice.
Si, une fois encore, nous ne sommes pas opposés par principe aux ordonnances, il est regrettable que le texte de loi ne retranscrive que trop sommairement les recommandations du rapport du professeur Uzan, dont il semble pourtant s’inspirer largement.
Dès lors, cet article 3 baigne dans un flou artistique, qu’il s’agisse du fond de la réforme envisagée ou des moyens qui lui seront dédiés. Nous le regrettons.
Aujourd’hui, l’Agence nationale du développement professionnel continu, l’ANDPC, consacre environ 180 millions d’euros par an au développement professionnel continu, ou DPC, des neuf professions de santé concernées, près de la moitié de cette somme profitant aux médecins. Si le DPC doit être l’une des composantes de la recertification, comme l’a indiqué la direction générale de l’offre de soins devant la commission des affaires sociales, il apparaît clairement que des moyens supplémentaires devront être prévus. Qu’en est-il, madame la ministre ?
Enfin, je me permets d’attirer votre attention sur un autre point : la procédure de recertification devra être bien plus simple que le DPC actuel. Aujourd’hui, rien n’est fait pour faciliter une démarche aussi essentielle qu’exigeante.
Monsieur le sénateur Daudigny, vous le savez, le rapport du professeur Uzan n’était pas suffisamment opérationnel pour que nous puissions inscrire dans la loi la méthode de recertification proposée.
Ce sujet fait l’objet d’une large concertation avec les professionnels. La procédure devra être opérationnelle et simple pour les médecins, parce que ceux-ci ont besoin de temps médical pour soigner. Il ne faut pas ajouter une énième couche administrative empiétant sur leur exercice professionnel.
Les jeunes générations de professionnels sont très intéressées par cette recertification, qui est mise en œuvre dans beaucoup de pays du monde. Nous souhaitons la rendre optionnelle pour les générations les plus anciennes. Nous travaillons avec la totalité des syndicats pour voir si cela est faisable ou pas.
Nous laissons le soin à la concertation de définir ce que contiendra la recertification. Beaucoup souhaitent que le DPC soit un mode de recertification ou intervienne dans les possibilités de recertification. La concertation est de très bonne tenue, laissons-la se dérouler. Toutes les parties prenantes souhaitent aboutir, et j’ai donc bon espoir que nous puissions proposer une ordonnance et un projet de loi d’habilitation au début de l’année 2020. Comme je m’y étais engagée, le projet d’ordonnance sera présenté à la commission des affaires sociales avant que le projet de loi d’habilitation ne soit soumis au Parlement.

L’amendement n° 275, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
certification
insérer les mots :
réalisée par des organismes ou des structures, sans lien direct ou indirect, avec les industries de santé
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Cet amendement vise, après celui qui a été adopté en commission sur l’initiative de notre rapporteur, à améliorer la rédaction de l’article 3, relatif à la certification des professionnels.
L’objectif est de maintenir un haut niveau de compétences tout au long de la carrière professionnelle. Or la formation continue obligatoire des médecins est essentiellement assurée par l’industrie pharmaceutique, qui peut ainsi les inciter à prescrire ses propres produits. Nous avons évoqué ce sujet lors de l’examen de l’article 2, mais il s’agissait alors de la formation initiale.
Le présent article tend à mettre en place une « procédure de certification » permettant de garantir à échéances régulières, au cours de la vie professionnelle, « le maintien des compétences » et « le niveau des connaissances ». Nous souhaitons que les pratiques actuelles en matière de formation initiale ne s’étendent pas aux formations délivrées dans le cadre du développement professionnel continu. Dans cet esprit, il convient d’interdire à des structures et des organismes en lien direct ou indirect avec les industries de santé d’être parties prenantes de ces procédures de certification.
Nous avons pris en compte, dans la rédaction de notre amendement, les remarques que vous aviez faites à l’Assemblée nationale, madame la ministre, en faisant en sorte de ne pas exclure du DPC les organismes à but lucratif sans lien avec l’industrie, tels que les structures émanant de centres de lutte contre le cancer, pour reprendre l’un des exemples que vous aviez cités.

Le sous-amendement n° 822, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 275, dernier alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
indépendante de tout lien d’intérêt
La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Nous sommes favorables à l’amendement de Mme Cohen – inspiré, en effet, par les discussions à l’Assemblée nationale sur l’amendement de Mme Fiat –, sous réserve que son champ soit élargi au-delà des seules industries de santé. Nous pensons nous aussi qu’il est absolument nécessaire de garantir l’indépendance de la procédure de recertification des compétences, mais nous proposons de donner au dispositif de l’amendement une portée plus générale en la matière. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 275, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 822.

Mme Laurence Cohen. Nous nous félicitons de ce double avis favorable, et nous voterons volontiers le sous-amendement !
Sourires.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 297, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
en vue notamment d’assurer la qualité et la sécurité des soins et de favoriser l’accompagnement global des patients
La parole est à Mme Céline Brulin.

Cet amendement vise à compléter l’alinéa 2 de l’article 3 pour préciser les finalités de la procédure de certification des médecins, en mentionnant notamment la qualité et la sécurité des soins, ainsi que l’objectif de promouvoir l’accompagnement global des patients. Cette double perspective mérite d’être inscrite dans la loi, en complément du maintien des compétences, qui est une dimension évidente de la certification des médecins.
Cette proposition fait écho au souhait de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d’établissement que la procédure ne se limite pas aux aspects de qualité et de sécurité des soins, mais aborde aussi, par exemple, le développement des besoins de santé ou l’organisation du système de santé.
Nous tenons à souligner que la réussite de la nouvelle procédure suppose la mise en place de véritables plans de formation continue, accompagnée des moyens appropriés. Les médecins auront aussi besoin de temps pour se former.

Assurer la qualité et la sécurité des soins et favoriser l’accompagnement global des patients, tels sont les objectifs de la future procédure de certification selon l’étude d’impact et le rapport de préfiguration du professeur Uzan. Il ne me paraît pas utile de les préciser dans le cadre de l’habilitation à légiférer par ordonnance, d’autant que cela complexifierait la rédaction de l’alinéa 2. L’amélioration de la formation continue des professionnels aura nécessairement un effet sur la qualité des soins. Retrait, sinon avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 555, présenté par MM. Amiel et Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
professionnels
insérer les mots :
en exercice ou en devenir
La parole est à M. Michel Amiel.

La recertification des médecins permettra de garantir et de maintenir leur haut niveau de qualification ; c’est dans cet esprit que l’article 3 a été écrit. Il ne saurait être entendu qu’il faudrait circonscrire le champ d’application de cette mesure aux seuls nouveaux médecins. Pour garantir la qualité de l’ensemble des consultations médicales, la recertification doit profiter à l’ensemble des patients, et donc concerner l’ensemble des médecins qu’il est possible de consulter.
En l’absence d’égalité de traitement des médecins devant la recertification de leurs compétences, s’établirait un système comportant deux catégories de professionnels : ceux dont les connaissances seraient systématiquement contrôlées et certifiées et ceux qui auraient le choix de se soumettre ou non à cette mesure.
Par ailleurs, plusieurs questions pratiques viennent à l’esprit. Comment la recertification sera-t-elle financée ? À quelle fréquence devra-t-elle avoir lieu et qui la contrôlera ? Quelles en seront les issues : y aura-t-il des sanctions possibles et qu’adviendra-t-il d’un médecin qui ne parviendrait pas valider sa recertification ?

Il est vrai que le cadre de l’habilitation pourrait être plus clair sur le point soulevé par M. Amiel : la nouvelle procédure de certification sera-t-elle applicable uniquement aux nouveaux professionnels de santé ou aussi à ceux qui sont déjà en exercice ? La commission n’a pas réussi à répondre à cette question importante. Elle demande donc l’avis du Gouvernement.
Le rapport du professeur Uzan préconise une certification obligatoire pour les jeunes médecins – le flux – et facultative pour les autres – le stock. Aujourd’hui que la concertation démarre, il faut à mon avis laisser aux acteurs le soin de déterminer s’ils souhaitent s’emparer de cette problématique.
On a parlé de la difficulté de maintenir les médecins dans un exercice libéral, on parle du cumul emploi-retraite. Veillons à ne pas freiner l’envie de certains de poursuivre leur activité, notamment dans les territoires ruraux, en rendant obligatoire la certification.
Je pense en tout cas qu’il ne faut pas trancher la question par la loi : laissons du temps à la concertation, qui a précisément pour objectif de déterminer qui entrera dans le champ de la réforme et à quel degré le dispositif pourra être coercitif. Je fais confiance à la concertation, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Je retire donc l’amendement. Avec vous, faisons confiance à la grande sagesse des professionnels de santé !

L’amendement n° 555 est retiré.
L’amendement n° 397 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mmes Deroche et Bruguière, M. Bonne, Mme Estrosi Sassone, M. Meurant, Mmes Delmont-Koropoulis et L. Darcos, MM. Savin, Perrin et Raison, Mme Deromedi, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Lamure et MM. Laménie, Revet, Bonhomme, Karoutchi et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
, notamment universitaires,
La parole est à M. Stéphane Piednoir.

Le projet de loi prévoit une vérification à échéance régulière de l’état des connaissances et des compétences des professionnels de santé. Dans cette perspective, l’article 3 prévoit que le Parlement autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice de la profession de médecin.
Le présent amendement a pour objet d’intégrer les universités dans la procédure de certification des professionnels de santé en ce qui concerne le contrôle du niveau des connaissances. Il paraît assez légitime et naturel, pour transmettre aux futurs médecins certifiés toutes les connaissances nouvelles et actualisées, et ainsi répondre aux enjeux de santé publique, d’associer les universités.

D’après ce que j’ai compris, les acteurs qui mettront en œuvre la certification pourraient être notamment la Haute Autorité de santé, les ordres et les conseils nationaux professionnels, ainsi que l’Agence nationale de développement professionnel continu. Qu’il s’agisse en majorité d’acteurs professionnels semblait convenir aux personnes que j’ai auditionnées.
Par ailleurs, je ne pense pas qu’il soit pertinent de faire référence à une certaine catégorie d’acteurs dans le cadre d’une habilitation ; on risque en effet d’oublier tous les autres.
La commission a donc décidé de demander au Gouvernement des précisions sur ce point.
La mise en œuvre de la procédure de certification nécessite encore un certain nombre d’arbitrages structurants, qui découleront de la concertation en cours. Identifier dans l’habilitation les organismes susceptibles de jouer un rôle au titre de leurs compétences propres dans la procédure de certification me paraîtrait donc prématuré. On risquerait d’identifier d’ores et déjà certains acteurs au détriment d’autres et de leur attribuer un rôle précis, alors que les arbitrages ne sont pas rendus.
C’est précisément pour permettre à la concertation d’approfondir ces questions que nous avons choisi de procéder par ordonnance. La démarche de préparation des arbitrages et de rédaction de l’ordonnance et des textes réglementaires qui donneront corps à la procédure de recertification s’engagera d’ici à la fin du mois, avec toutes les parties prenantes. Laissons-les travailler, sans inscrire dans la loi plus que le nécessaire. Je suis donc défavorable à l’amendement.

C’est le problème du recours aux ordonnances, coutume désormais bien installée : on signe des chèques en blanc. Je fais confiance au Gouvernement pour ne pas oublier, dans l’écriture de l’ordonnance, que les instances universitaires doivent jouer un rôle dans la certification des compétences et des connaissances. Cela étant dit, je retire l’amendement.

L’amendement n° 397 rectifié est retiré.
L’amendement n° 522 rectifié, présenté par M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Manable et Tourenne, Mme Monier, MM. Mazuir et Vallini et Mmes Harribey et Artigalas, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Développer les formations de maîtres de stage des universités au sein des maisons de santé situées dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telle que définis en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
L’agence régionale de santé s’assure que dans chaque maison de santé subventionnée qu’un médecin au moins suive les formations de maître de stage des universités.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Cet amendement concerne la formation des médecins qui exercent dans les maisons de santé recevant des subventions de l’ARS. Il s’agit de former plus de formateurs, pour permettre l’accueil de stagiaires dans ces établissements de proximité dans les zones sous- denses.

Cet amendement est irrecevable au titre de l’article 38 de la Constitution, l’extension par voie parlementaire d’une habilitation à légiférer par ordonnance étant interdite. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 est adopté.

L’amendement n° 616 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Lepage, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Iacovelli et Daudigny, Mme Conconne, MM. Manable, M. Bourquin, Tourenne et Temal, Mmes Monier et Blondin, MM. Mazuir et Marie et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -1 -…. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant les dispositifs de couverture santé et les conditions financières associées, la prise en charge des personnes en situation de pauvreté ou de précarité, et les problématiques spécifiques rencontrées par les familles monoparentales.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Je tiens à préciser que cet amendement nous a été suggéré par l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, l’Uniopss, sur le fondement d’observations de terrain réalisées par cet organisme au gré de ses multiples activités de soutien et d’aide aux personnes en situation de grande précarité.
Il s’agit d’inscrire dans la loi que la formation des professionnels de santé inclut un enseignement sur les dispositifs de couverture de santé, ainsi que sur la prise en charge des personnes en situation de précarité et des familles monoparentales.
J’ai compris qu’il ne fallait pas préciser dans la loi le contenu des formations, mais cet amendement relève de ce qui semble être une des priorités du Gouvernement : l’accès des personnes les plus fragiles à leurs droits. Les personnels de santé sont en situation d’aider les patients en grande précarité à mieux faire valoir leurs droits. Quand on pratique la médecine, il n’est pas inutile de connaître les systèmes de protection sociale, de soins et d’accès aux droits – bref, la législation sociale et l’environnement de l’exercice médical.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2°
Non modifié
« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »

L’amendement n° 460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article L. 1521-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1110-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, et sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. ».
La parole est à Mme la ministre.
La loi prévoit que les professionnels de santé du secteur médico-social reçoivent au cours de leur formation initiale et continue une formation spécifique sur le handicap. Le code de la santé publique rend cette disposition applicable à Wallis-et-Futuna. L’article 3 bis A du projet de loi précise qu’un décret en fixera les modalités d’application pour chacune des formations initiales et continues. Le Gouvernement souhaite que cette modification s’applique également à Wallis-et-Futuna. Il s’agit d’un amendement technique.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 3 bis A est adopté.

L’amendement n° 169 rectifié ter, présenté par Mmes M. Filleul, Meunier et Lepage, MM. Lurel, Manable, Antiste, Mazuir et Marie, Mme Tocqueville, MM. Duran et Tissot, Mme Blondin, M. Fichet, Mme Guillemot, M. Kerrouche, Mme Rossignol, MM. Tourenne et Leconte, Mme Perol-Dumont, M. Temal et Mmes Monier et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -1 -…. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil, la prise en charge et l’accompagnement des victimes de violences familiales et sexuelles, les enjeux liés aux droits sexuels et reproductifs ainsi que les problématiques relatives aux stéréotypes et violences de genre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent article. »
La parole est à Mme Martine Filleul.

Toutes les études menées sur le sujet convergent : 20 % des femmes qui consultent un médecin généraliste ont subi des violences sexuelles et n’en ont jamais parlé auparavant. Ces violences ont des conséquences graves sur la santé des femmes, et la libération de leur parole permettrait sans doute de diagnostiquer et de traiter des pathologies dont elles peuvent souffrir. Or la détection des violences sexuelles par les professionnels de santé fait défaut, en raison notamment du manque de formation du corps médical à ces questions. Il est urgent, à mon sens, de remédier à cette lacune.
Par ailleurs, des études récentes ont mis en lumière de nombreux cas de violences gynécologiques et obstétricales, d’infantilisation ou de défiance à l’égard de la souffrance des femmes de la part de professionnels de santé. Ces situations ne doivent plus durer. Les femmes doivent pouvoir franchir sereinement le seuil des hôpitaux et des cabinets médicaux.
En outre, en matière de droits sexuels et reproductifs, certains professionnels de santé peuvent se montrer insuffisamment formés à la pratique des actes et à l’accueil des femmes pour des cas d’IVG ou de suivi des contraceptifs, ce qui peut mener à des situations compliquées et douloureuses pour les femmes.
C’est pourquoi nous proposons que la formation continue et l’entretien des compétences et des connaissances des médecins intègrent l’ensemble de ces problématiques.

Il s’agit là encore d’un amendement relatif au contenu de la formation des médecins. Je le répète, ce n’est pas à la loi de déterminer le contenu des études médicales. Aussi importante que soit cette thématique, si on la mentionne dans la loi, on risque d’en oublier d’autres qui méritent également de faire l’objet d’un enseignement. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 673 rectifié, présenté par MM. Labbé, Antiste, Arnell et Artano, Mme Benbassa, MM. Bignon, A. Bertrand, Cabanel et Castelli, Mmes M. Carrère, Conconne et Conway-Mouret, MM. Corbisez, de Nicolaÿ, Dantec et Decool, Mme N. Delattre, M. Delcros, Mme Dindar, MM. Gontard, Guérini et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde, MM. Laurey, Léonhardt et Moga, Mmes Monier et Préville, MM. Requier et Roux, Mme Tetuanui et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -1 -… . – Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant les usages des plantes médicinales, la phytothérapie et l’aromathérapie.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions du présent article dans chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social. »
La parole est à M. Joël Labbé.

Cet amendement est inspiré lui aussi par les recommandations du rapport de la mission sénatoriale d’information sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales. Ce rapport met en avant l’intérêt de la médecine par les plantes, en complément, bien sûr, de la médecine conventionnelle. Il ne s’agit pas d’opposer l’une à l’autre, mais de jouer sur les complémentarités.
Pour la prévention et le maintien en bon état de santé comme pour le soin ou l’accompagnement de traitements conventionnels, les plantes médicinales présentent un véritable potentiel, révélé par le rapport. Dans certains cas, le recours aux plantes est plus efficace que les traitements conventionnels, avec moins d’effets secondaires ; dans d’autres, les plantes peuvent être utilisées en association avec les médecines conventionnelles.
En particulier, le recours aux plantes est une réelle opportunité pour réduire la consommation d’antibiotiques, particulièrement élevée en France, ce qui pose problème à l’heure où les antibiorésistances sont une menace majeure.
Le rapport sénatorial souligne que, malgré l’intérêt des plantes pour la santé, les professionnels de santé ne sont que faiblement formés à l’usage des plantes médicinales, ce qui est regrettable.
Cet amendement s’appuie également sur la stratégie de l’OMS pour la médecine complémentaire, qui établit que, eu égard à l’augmentation de la demande pour ces médecines alternatives, notamment pour les plantes médicinales, il est nécessaire d’assurer une sensibilisation et une information sur ces soins et de mieux intégrer ceux-ci, pour garantir la protection du patient, son information éclairée et sa liberté de choix. L’enjeu est particulièrement important dans les outre-mer, où l’usage des plantes et le recours aux médecines traditionnelles sont très répandus.
Afin de garantir un meilleur accès à l’information des patients et une réponse à leur demande de soins à base de plantes, les auteurs de l’amendement proposent de prévoir dans la loi la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social à la santé par les plantes. Eu égard à la faible intégration des plantes dans notre système de soins, inscrire cette formation dans la loi paraît essentiel pour envoyer un signal fort !

Avis défavorable, pour les raisons déjà exposées à propos des différents amendements visant à préciser le contenu des études médicales.
Monsieur Labbé, j’étais membre de votre mission d’information. Lorsque vous avez présenté votre rapport, j’ai dit ce que j’en pensais, et je confirme que je ne l’ai pas voté…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
Le cinquième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. » –
Adopté.
Le 10° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « et continue » ;
2° Le mot : « ultérieur » est supprimé.

L’amendement n° 674 rectifié, présenté par MM. Labbé, Antiste, Arnell et Artano, Mme Benbassa, MM. Bignon, A. Bertrand, Cabanel et Castelli, Mmes M. Carrère, Conconne et Conway-Mouret, MM. Corbisez, de Nicolaÿ, Dantec et Decool, Mme N. Delattre, M. Delcros, Mme Dindar, MM. Gabouty, Gontard, Guérini et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde, MM. Laurey et Moga, Mmes Monier et Préville, MM. Requier et Roux, Mme Tetuanui et MM. Vall et Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 11° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La promotion de la santé par les plantes, des activités de recherche et de formation des professionnels de santé concernant la phytothérapie et l’aromathérapie, afin de mieux les intégrer dans le système de soins. »
La parole est à M. Joël Labbé.

J’ai entendu M. le rapporteur, mais je suis tenace, et le resterai…
Cet amendement vise à intégrer la médecine par les plantes dans les orientations de la politique de santé. La faible place des plantes dans notre système de santé est, je le répète, très regrettable, parce que nous nous privons de thérapies efficaces, mais aussi parce que les professionnels de santé ne peuvent pas, dans bien des cas, prendre en compte les potentielles interactions médicamenteuses.
Dans les maisons de retraite ou les hôpitaux, les professionnels qui souhaitent mettre en place des protocoles utilisant les plantes rencontrent des difficultés, alors même que certains produits végétaux sont plus efficaces que les thérapies conventionnelles ou en sont complémentaires. Ces protocoles permettent de surcroît des économies substantielles. Ils représentent aussi un moyen de développer une économie locale et durable liée aux plantes médicinales et à leur transformation, bénéfique à la fois pour les territoires, notamment ruraux, la santé de nos concitoyens et la biodiversité.
J’insiste encore sur l’importance de l’enjeu, en termes de santé et de développement économique local, pour les outre-mer, fortement dépendants d’importations de médicaments alors que la biodiversité végétale y est très importante – ils accueillent 80 % de notre biodiversité végétale.
L’inscription de la médecine par les plantes dans les objectifs de la politique de santé serait un signal fort pour remédier à sa faible prise en compte en France. Songez que, au niveau européen, nous sommes les derniers de la classe… Tous nos voisins sont beaucoup plus avancés !

J’appuie le propos de M. Labbé. J’ai moi aussi été membre de la mission d’information sur le développement de l’herboristerie. Pendant six mois, nous avons mené des travaux passionnants, nourris par de très nombreuses auditions et deux déplacements. Peut-être n’avez-vous pas voté le rapport, monsieur le rapporteur, mais il a en tout cas été adopté à une très large majorité.
Il y a une réalité : la population en général a aujourd’hui envie de se soigner et de rechercher un bien-être par les plantes. Or 70 % des plantes utilisées en France sont importées, faute de production locale. Comme M. Labbé l’a souligné, nous sommes les derniers de la classe européenne : les consommateurs achètent à l’étranger via internet, sans conseil.
Notre rapport d’information recommandait l’inscription des soins par les plantes dans la formation des médecins, qui pourraient ainsi avoir un avis éclairé sur la question et conseiller les patients. Au reste, tout le sens de notre travail était de ne pas opposer les médecins et les pharmaciens aux herboristes, mais de promouvoir les complémentarités.
N’oublions pas que les herboristes ont existé dans le passé ; c’est Pétain, en 1941, qui a interdit cette formation. Nous avons une tradition culturelle des plantes, du vivant et de leurs usages pour la santé. Il serait dommage de nous en priver.
M. Jean-Claude Requier opine.

Enfin, ces filières ont un intérêt économique pour des territoires ruraux ou hyper-ruraux. La transformation des plantes permet à de petites exploitations, souvent conduites par des femmes, de vivre. Je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement !

Je confirme qu’il ne s’agit surtout pas d’opposer deux pratiques, mais de prendre en compte une réalité incontournable : il existe, de fait, un marché et une économie, parfois parallèles, via internet, qu’il convient d’encadrer. Il faut aussi que l’usage thérapeutique des plantes soit intégré à la formation de nos professionnels de santé, pour pouvoir jouer les complémentarités. Des médecins non formés aux plantes médicinales ne peuvent pas conseiller les patients, notamment en matière d’interactions médicamenteuses.
Monsieur le rapporteur, j’aime la précision : au moment du vote sur le rapport, vous n’étiez plus là et vous n’aviez pas donné de pouvoir. Le rapport a été voté à l’unanimité des présents. Je tenais à rappeler cette vérité historique !

Je ne voterai pas cet amendement.
Il est vrai qu’un rapport a été adopté à l’issue des travaux de la mission d’information, qui se sont déroulés dans un bon état d’esprit. Toutefois, sur la formation et le diplôme d’herboristerie, il n’y a pas eu l’accord que souhaitaient certains membres de ma mission.
Comme Mme la ministre l’a indiqué précédemment, et ainsi que l’a rappelé notre collègue Michel Amiel, des formations enseignées en faculté de pharmacie sont ouvertes aux médecins diplômés. Il y a évidemment des interactions, mais les professionnels de santé ont dès aujourd’hui la possibilité de se former sur ces sujets.

Permettez-moi de revenir de nouveau sur les propos de M. Labbé. Il est vrai que j’ai assisté au début de la présentation du rapport et que je me suis absenté ensuite pour participer à une autre réunion, mais j’ai voté – j’avais donné mon pouvoir à M. Dériot, qui a voté pour moi.
Notre collègue sénatrice de la Drôme a fait une comparaison intéressante : elle a parlé de « bien-être ». Cela ne pose pas de problème si l’on parle de bien-être, mais il en va différemment pour les soins. Le bien-être, pourquoi pas ? Mais les soins, c’est autre chose !
Permettez-moi de faire une petite comparaison méchante, et je présente mes excuses à tous ceux qui pourraient s’en offusquer : nous sommes les derniers en Europe pour la médecine par les plantes, mais les premiers pour l’espérance de vie… Y aurait-il un lien ?
Exclamations sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 bis est adopté.

Chapitre II
Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires
I. – L’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique » ;
b) Les mots : «, admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « étudiants et internes » sont remplacés par le mot : « signataires » ;
b) La même première phrase est complétée par les mots : « ou odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences » ;
c) À la deuxième phrase, le mot : « étudiants » est remplacé par le mot : « signataires » ;
d) À la même deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2 du présent code, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;
c) Les mots : « un poste d’interne » sont remplacés par les mots : «, au regard des critères mentionnés au 4° du II du même article L. 632-2, un poste » ;
5° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés ;
b) Les mots : « internes ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;
6° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les deux ans précédant la publication de la liste. » ;
7° Le cinquième alinéa est supprimé ;
8° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « médecins ou les étudiants ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;
b) À la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) À la fin de la même première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;
d) Les deux dernières phrases sont supprimées.
II. –
Non modifié
II bis. –
Non modifié
III. – Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie à compter de la rentrée universitaire 2020 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.

Cet article a le mérite de mettre en lumière le contrat d’engagement de service public, le CESP, dispositif qui existe depuis dix ans avec la loi HPST, mais qui est insuffisamment connu, comme l’ont indiqué les organisations étudiantes que nous avons rencontrées.
Ainsi, en dix ans, seuls 2 800 contrats ont été signés par des étudiants et des internes en médecine, avec une montée en charge progressive, puisque ce sont plus de 550 contrats qui ont été conclus en 2017-2018. Pourtant, cet outil incitatif à l’installation de jeunes praticiens en zones sous-dotées aurait dû constituer une réponse plus efficace au problème des déserts médicaux.
Madame la ministre, avez-vous des éléments d’évaluation et de compréhension qui pourraient expliquer les raisons du peu d’attractivité de ce dispositif ?
D’après l’audition des syndicats de jeunes médecins que nous avons menée, cette situation ne serait pas tant due au montant de l’allocation reçue – 1 200 euros bruts – qu’à la situation de ces territoires, victimes des politiques nationales successives, qui ont fermé les services publics les uns après autres : écoles, bureaux de poste, gares, sans parler du manque de commerces et d’attractivité culturelle, ni de l’absence d’emploi pour le compagnon ou la compagne.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur les conséquences concrètes des lois que nous votons ici, ou, pour le coup, que le groupe CRCE ne vote pas. Comment ignorer que la réduction des dépenses publiques a un impact dans nos territoires ? D’où la situation que nous connaissons aujourd’hui : de jeunes médecins hésitent, assez légitimement, à s’installer dans des endroits où il ne reste plus grand-chose. Et dire que le Gouvernement prévoit encore la suppression de 120 000 fonctionnaires… C’est très alarmant et cela devrait nous faire réfléchir.
Rendre le contrat d’engagement de service public plus contraignant, en supprimant la possibilité pour les signataires de modifier leur lieu d’exercice ou en introduisant un classement des candidatures, nous paraît contre-productif. En revanche, nous approuvons le fait que le CESP soit élargi aux Padhue, les praticiens à diplôme hors Union européenne.
Enfin, madame la ministre, pourquoi ne pas réfléchir à des aides pour trouver un logement, des aides pour les transports, etc., autant de petits plus suggérés par les jeunes médecins que nous avons rencontrés en vue d’améliorer réellement ce dispositif ?

Parmi les différentes dispositions prévues par cet article figure l’ouverture des contrats d’engagement de service public, les CESP, aux praticiens à diplôme hors Union européenne.
Tout ce qui va dans le sens d’une meilleure répartition des praticiens sur le territoire mérite d’être soutenu. Néanmoins, cela apparaît nettement insuffisant au regard des besoins, ce qui traduit la légèreté avec laquelle ce projet de loi traite l’enjeu des déserts médicaux.
Le principe du CESP est simple : il s’agit d’un contrat par lequel les étudiants en médecine s’engagent à s’établir dans une zone dans laquelle la continuité des soins est menacée ou à choisir une spécialité moins représentée, en contrepartie d’une allocation mensuelle de 1 200 euros versée durant leurs études. Ils devront s’installer pendant un nombre d’années égal à celui durant lequel ils auront perçu l’allocation, et pour deux ans minimum.
Aussi attractif qu’il puisse paraître, ce dispositif ne suffit pas. Seuls 8 % des étudiants de seconde année ont signé un contrat pour 2016-2017, soit 486 étudiants. Nous touchons là du doigt les limites, pour ne pas dire plus, des dispositifs incitatifs.
Il est urgent de mettre en place des mesures claires, plus volontaristes, de régulation à l’installation des médecins ; je pense, par exemple, au conventionnement sélectif en fonction du niveau de dotation des territoires en professionnels de santé. Finalement, cet article à lui seul ne peut pallier l’accélération de la fracture territoriale et sociale en matière d’accès aux soins.

Voilà un dispositif intéressant, qui poursuit sa montée en charge et commence à produire ses effets.
Son principe est simple : en contrepartie d’une allocation mensuelle, les étudiants s’engagent à s’installer à l’issue de leur formation en zone sous-dense. Depuis sa mise en place en 2010, à la suite de l’adoption de la loi HPST, ce sont plus de 2 800 contrats d’engagement de service public qui ont été signés, dont 550 pour l’année 2017-2018, traduisant une nette progression.
Si un tel dispositif doit bien évidemment être développé – l’extension aux praticiens à diplôme hors Union européenne qui est prévue dans ce projet de loi est une bonne mesure –, il est nécessaire d’en améliorer encore le fonctionnement.
Ainsi, bon nombre d’internes signataires d’un CESP déplorent un manque d’accompagnement tout au long de leur parcours, un retard parfois dans le versement de leur allocation, ou encore des évolutions du zonage qui est défini par l’ARS, l’agence régionale de santé, après la signature, ce qui peut perturber leur projet professionnel.
À cet égard, le délai de deux ans prévu par la loi pour conserver sur la liste des lieux d’exercice proposés à la signature du CESP ne paraît pas suffisant pour permettre aux étudiants d’envisager sereinement leur projet professionnel.
Au-delà des nécessaires perfectionnements du dispositif, je veux le souligner encore une fois, c’est tout le panel des outils destinés à mettre fin aux déserts médicaux qu’il convient d’étendre. Nous en avons parlé, nous ne pourrons pas faire l’économie d’une politique plus volontariste en la matière : il faut redonner à ces territoires l’attractivité qu’ils méritent.

Cet article vise à consolider le contrat d’engagement de service public, le CESP, mis en place par la loi HPST de 2009 afin de favoriser l’installation des jeunes médecins et dentistes dans les déserts médicaux, en contrepartie d’une allocation mensuelle versée lors de leurs études.
Notre groupe y est bien sûr favorable, et nous défendrons un amendement visant à sécuriser le dispositif en alignant la durée du bénéfice du zonage des zones sous-denses sur celles de l’internat de médecine générale.

Avec cet article 4, nous attaquons, si je puis dire, le chapitre II, intitulé « Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires ».
Or répondre aux enjeux des territoires, c’est, me semble-t-il, essentiel pour la chambre qui représente ces derniers. Force est de constater que, depuis dix ans, nous voyons se succéder des projets de loi. Le texte de 2009 de Mme Bachelot promettait de régler la question en dix ans. Puis, est venu le projet de loi de Mme Touraine. Aujourd’hui, Mme Buzyn est devant nous, et demain, sans doute, les ministres qui lui succéderont viendront également dans cet hémicycle.
Tous les dispositifs que l’on nous propose depuis dix ans ont un point commun : ils reposent uniquement sur des dispositifs incitatifs. Mais, nous le constatons, ils ne sont pas suffisants, puisque, au fil des années, les inégalités territoriales s’accroissent, avec des densités médicales extrêmement différentes : de 1 à 3 pour les généralistes, de 1 à 8 pour les spécialistes, de 1 à 24 pour certaines spécialités – je pense notamment aux pédiatres.
En outre, l’accès aux soins, qui est de plus en plus problématique, coûte très cher. La Cour des comptes considère que la différenciation d’accès aux soins selon les territoires représente un coût compris entre 1 et 3 milliards d’euros par an, et le comité Action publique 2022, mis en place par le Gouvernement lui-même, estime que l’on pourrait économiser 5 milliards d’euros avec une politique différente.
Certains des amendements qui vont être présentés au cours des prochaines heures ont pour objet de sortir de cette logique purement incitative, afin de répondre d’ailleurs à ce que demandent les Français. Je ne puis l’évoquer maintenant par manque de temps, mais toute une série de sondages montre que les Françaises et les Français, comme les associations d’élus, demandent des mesures plus fortes.
Aussi, je me réjouis que nous puissions, au cours de la séance, examiner des amendements allant en ce sens. C’est tout à l’honneur du Sénat que de se pencher sur le volet territorial de ce texte, plus que ne l’a fait, notamment, l’Assemblée nationale.
Nous avons déjà amélioré le texte hier soir en adoptant un amendement visant à rendre obligatoires les stages en troisième cycle. Ce soir, il faut que nous allions plus loin.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 384, présenté par Mme Préville, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin de favoriser la mixité sociale, le nombre de places fixé pour la signature d’un contrat d’engagement de service public comporte 50 % d’étudiants boursiers.
La parole est à Mme Angèle Préville.

Le contrat d’engagement de service public doit favoriser la mixité sociale et inciter par l’aide au financement des études les futurs professionnels de santé à s’installer dans les zones où l’offre de soins est menacée.
C’est l’un des leviers pour faire en sorte que, partout sur le territoire, des médecins se déploient, justement parce qu’ils sont issus de territoires situés en zone sous-dense et de milieux défavorisés. Connaissant ces territoires, ils y reviendront naturellement, dirais-je, s’agissant, par exemple, des territoires ruraux et des zones périurbaines.
C’est à la fois une mesure de justice sociale et un devoir d’égalité pour les enfants de la République. Le principe d’égalité figurant dans notre devise doit s’exprimer dans les faits.
Par ailleurs, il paraît logique que ces aides soient en quelque sorte réservées à celles et ceux qui en ont le plus besoin, une logique vertueuse à tous points de vue, car l’ascenseur social, nous le savons, est actuellement en panne en France.
Nous devons remédier à cette situation et faire la publicité la plus large possible à ce dispositif au cas où les candidats manqueraient. Il est sain que davantage d’étudiants issus des milieux ouvriers ou de l’agriculture puissent devenir médecins à leur tour, comme autrefois, car ce n’est plus le cas aujourd’hui. C’est peut-être là l’une des raisons de notre défaite sur ce sujet.
Il y va de la fierté de la République, dont nous devons faire en sorte que tous les enfants trouvent des portes ouvertes.

L’amendement n° 385, présenté par Mme Préville, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin de favoriser la mixité sociale, le nombre de places fixé pour la signature d’un contrat d’engagement de service public comporte 30 % d’étudiants boursiers.
La parole est à Mme Angèle Préville.


Le contrat d’engagement de service public est encore en phase de montée en charge, comme cela a été souligné. Pour 2017, tous les CESP offerts n’ont pas trouvé preneur, et 85 % d’entre eux seulement ont été signés, soit 550 contrats.
Dans ce contexte, ajouter une condition pour le bénéfice du CESP pourrait entraver le déploiement de cet outil, que nous devrions au contraire encourager. Nous pourrons, je pense, et je l’espère, en reparler si, un jour, il y avait plus de demandes que de contrats offerts.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements.
Avant de donner spécifiquement l’avis du Gouvernement sur les amendements de Mme Préville, permettez-moi de dire que ce dispositif est en train de monter en charge, avec des installations dans les territoires.
Ainsi, en 2017, quelque 321 médecins se sont installés dans des zones sous-denses. Sachant qu’il est assez récent, qu’il a mis du temps à être connu et qu’il faut dix ans pour former un médecin, à l’évidence, ce dispositif fonctionne.
Ce n’est pas le seul dispositif incitatif. À cet égard, je suis tout à fait en phase avec les propos de M. Maurey : les dispositifs incitatifs financiers ne sont pas suffisants. En réalité, il faut rendre l’exercice attractif, ce qui va bien au-delà des dispositifs financiers.
En l’espèce, j’ai confié une mission à Mme Sophie Augros, médecin généraliste, dont le rapport est prévu pour cet été, afin d’évaluer l’impact des dispositifs incitatifs financiers mis en place depuis plusieurs années, en vue de connaître ceux qu’il faut privilégier, ou, peut-être, supprimer. En tout cas, nous croyons dans le contrat d’engagement de service public. Il convient de valoriser cette bonne mesure.
Monsieur Jomier, vous avez dit qu’il importe de mieux accompagner les jeunes. On constate effectivement un défaut d’information et d’accompagnement. Aussi, nous souhaitons que ce volet soit aujourd’hui valorisé dans les facultés de médecine. D’ailleurs, les doyens rendent ce dispositif de plus en plus visible, afin que les jeunes s’en saisissent.
Concernant le zonage, l’examen de certains amendements nous permettra de revenir sur cette question dans quelques minutes. En réalité, je souhaite que nous élargissions ce dispositif – c’est ce qui vous est proposé dans cet article –, pour permettre à un plus grand nombre de jeunes encore de s’y engager, en assouplissant peut-être les conditions.
S’agissant des amendements de Mme Préville, je rejoins les propos de M. le rapporteur. Mon objectif est de faire en sorte que 100 % des contrats d’engagement de service public soient signés. Or, plus les mesures seront restrictives, plus grand sera le risque qu’il y ait moins de contrats signés.
Aujourd’hui, l’objet principal du CESP est l’installation en zones sous-denses. Ne soyons pas donc restrictifs. S’il y a, un jour, plus de demandes que d’offres, il sera toujours temps d’envisager des critères restrictifs.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable sur les deux amendements.

Par mes amendements, je voulais en appeler à votre vigilance : il faut faire une grande publicité à ce dispositif, afin de faire changer les choses dans notre pays. Il importe que davantage d’enfants issus des milieux défavorisés puissent devenir médecins.
Évidemment, vous avez raison ! Nous souhaitons une mixité sociale dans les études de médecine, et c’est la raison pour laquelle nous avons modifié l’entrée dans ces études : la Paces, la première année commune aux études de santé, est une autocensure des jeunes, car des familles ne peuvent pas payer des études dans une ville universitaire pendant deux ans, avec un risque d’échec majeur.
Cette diversification des profils dans l’entrée des études de médecine vise aussi à accroître la mixité sociale – c’est ce que nous avons défendu à l’article 1er.
Nous visons donc le même objectif, mais il ne me semble pas logique de l’inscrire dans cet article.

Les amendements n° 384 et 385 sont retirés.
L’amendement n° 76 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Bonne et Sol, Mme Dumas, MM. Daubresse, Guerriau, Morisset et D. Laurent, Mme Deromedi, M. L. Hervé, Mme Lamure, MM. Kennel et Mandelli, Mme Bruguière, MM. Moga, B. Fournier, Cuypers, Genest, Priou et Revet, Mmes Deroche, Ramond, Estrosi Sassone et Gruny, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Savary, Mme L. Darcos, MM. Détraigne et Mayet, Mmes Malet et Chauvin et MM. Poniatowski, Meurant, de Nicolaÿ, Bouloux et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la deuxième phrase du même quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également situés dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis au I du L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
La parole est à M. Philippe Mouiller.

Les contrats d’engagement de service public ont pour objet d’inciter les futurs médecins à s’installer dans des zones en sous-densité médicale. La liste actuelle des lieux concernés proposée par le Centre national de gestion, sur suggestion des agences régionales de santé, les ARS, concerne, pour sa très grande majorité, des centres hospitaliers.
Or, même dans des zones qui ne sont pas considérées comme des zones sous-dotées, les établissements sociaux et médico-sociaux peinent à recruter des médecins. La nécessité par ailleurs de décloisonner secteur médico-social et sanitaire au profit d’une population vulnérable est indispensable.
L’objet de cet amendement est d’ouvrir le bénéfice de l’exercice médical des praticiens signataires d’un contrat d’engagement de service public aux établissements sociaux et médico-sociaux, quel que soit leur lieu d’implantation et non aux seuls établissements situés en zone sous-dotée.

Monsieur Mouiller, je me demande si cette précision est nécessaire.
En premier lieu, j’observe que la phrase à laquelle vous rattachez votre amendement fait référence à la localisation géographique des lieux d’exercice, et non aux structures de soins auxquelles ils seraient rattachés.
En second lieu, rien dans la rédaction de l’article L. 632-6 du code de l’éducation n’empêcherait que ces lieux d’exercice soient situés en établissement médico-social. Il n’est donc pas utile de le préciser dans la loi, à moins de mentionner également qu’ils peuvent être situés en établissements de santé, mais nous rencontrerions alors le problème inhérent à toute énumération législative : le risque d’oubli, avec les conséquences contre-productives qui pourraient en découler.
Je vous propose donc de maintenir la rédaction actuelle de l’article 4, puisqu’elle est de nature à satisfaire votre préoccupation. Mme la ministre pourra certainement préciser les raisons pour lesquelles les lieux d’exercice sont principalement situés dans des centres hospitaliers.
Faute d’un retrait, la commission serait obligée d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur Mouiller, votre amendement est en réalité satisfait.
L’objet du CESP est de permettre à des médecins de s’installer dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante, quel que soit le mode d’exercice, qu’il soit libéral, hospitalier ou intervenant dans le secteur médico-social, tel que défini par le code de l’action sociale et des familles. Cette mesure est en réalité déjà prévue.
C’est pourquoi je suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Je vais le retirer, au regard des arguments avancés. Toutefois, je tiens à préciser deux choses.
Premièrement, il s’agissait de permettre une installation dans une zone qui ne soit pas forcément sous-dotée, la situation des structures médico-sociales étant différente.
Deuxièmement, au travers de cet amendement, nous souhaitions lancer un appel en raison de la pénurie – vous m’objecterez que la pénurie des médecins est généralisée – dans le domaine du handicap, que je connais le mieux, où les diagnostics sont essentiels. Le Gouvernement doit porter une politique d’évolution en la matière, ce que vous appelez de vos vœux, madame la ministre. Il importe de coordonner et de veiller à ce que les structures soient dotées des compétences nécessaires, faute de quoi votre vœu restera pieux.
Je retire donc cet amendement, madame la présidente.

L’amendement n° 76 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 420 est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
L’amendement n° 683 est présenté par MM. J. Bigot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mme Harribey, M. Lurel, Mme Blondin, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mmes Ghali et G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 32 rectifié bis est présenté par MM. Bonne et Henno, Mmes M. Mercier, Malet, Puissat, Di Folco, Deroche et Bonfanti-Dossat, M. Canevet, Mmes L. Darcos et Deromedi, M. Détraigne, Mmes Bruguière et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Genest, Mme Gruny, MM. Hugonet, Laménie, Lefèvre, D. Laurent, Mandelli, Moga, Morisset, Mouiller, Karoutchi, Mayet, Babary, Pellevat, Perrin, Raison, Savary, Saury, Sol et Vogel, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Bouloux, Charon, Sido et J.M. Boyer, Mme Lamure et M. Gremillet.
L’amendement n° 298 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 540 rectifié quater est présenté par MM. Chasseing, Bignon, Capus, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Gabouty et Bonhomme et Mme Noël.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
La parole est à M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 420.

Les contrats d’engagement de service public sont un outil incitatif visant à encourager les jeunes médecins à s’installer en zones sous- denses au début de leur carrière.
Les associations étudiantes que j’ai rencontrées m’ont toutefois fait part des insuffisances de ce dispositif. Il est en effet possible qu’un étudiant ayant signé un CESP au cours de sa formation ne bénéficie plus de la même liste de lieux d’exercice à l’issue de son cursus si le zonage évolue entre- temps.
En 2017, dans leur rapport d’information publié au nom de la commission des affaires sociales, nos collègues Jean-Noël Cardoux et Yves Daudigny soulignaient que, en l’état actuel, les incertitudes autour du CESP étaient de nature à susciter des réticences.
Or le CESP constitue un levier efficace, qu’il convient de mobiliser davantage au profit des territoires en difficulté. Pour preuve, 90 % des signataires se sont installés en activité libérale, et une grande majorité des CESP signés concernent des médecins généralistes.
Cet amendement vise à répondre à une demande pragmatique formulée par les internes de médecine générale avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger ; son adoption permettra aux signataires de se projeter dans un territoire, d’y construire leur projet personnel, sans s’inquiéter de l’évolution du zonage. En pratique, il tend à rendre le dispositif plus efficace en alignant la durée du bénéfice du CESP en cas d’évolution du zonage sur la durée de l’internat de médecine générale, c’est-à-dire trois années.
Il a donc pour objet de conforter les objectifs poursuivis à l’article 4, car il vise à sécuriser davantage les CESP. Une telle mesure contribuera sans nul doute à la montée en puissance souhaitable de ce contrat. Pour rappel, quelque 3 125 contrats ont été signés depuis 2010, et 500 signataires se sont déjà installés.
Mes chers collègues, il s’agit là d’un élément déterminant, d’un élément clé de l’installation de nos jeunes médecins, sur lequel nous sommes capables d’agir aujourd’hui.

Le contrat d’engagement de service public offre une allocation de 1 200 euros par mois aux étudiants et internes en médecine en échange d’un engagement à exercer dans des zones sous-dotées.
Après six ans de mise en place, le dispositif des CESP monte en puissance, avec 521 postes ouverts en médecine pour l’année 2018, et apporte par là même une réponse prometteuse pour lutter contre la désertification médicale.
Malgré ce bilan positif, le dispositif des CESP se heurte à plusieurs freins empêchant un déploiement plus important, notamment au regard des mises à jour régulières des zonages par l’ARS, qui définit les zones où un signataire d’un CESP est éligible pour l’installation.
Ainsi, certaines zones éligibles au moment de la signature ne le sont plus lors de l’installation, ce qui oblige le signataire à repenser en totalité son projet d’installation au dernier moment, voire le conduit, dans certains cas, à une rupture du contrat.
Si le projet de loi prévoit que le Centre national de gestion maintienne sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins dans les deux ans précédant la publication de la liste, ce délai ne semble pas suffisant pour se prémunir véritablement des problèmes constatés.
Aussi, nous proposons que cette liste des lieux d’exercice soit maintenue pendant trois ans, au lieu des deux ans prévus dans le texte actuel.
Le CESP est une mesure incitative, car il favorise l’installation des jeunes médecins dans les zones sous-denses. Il répond aux besoins des territoires et contribue à lutter contre la désertification médicale. Notre amendement a pour objet de le consolider.

La parole est à M. Bernard Bonne, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié bis.

En relisant le texte de cet amendement, je me posais la question de savoir s’il fallait remplacer « deux » par « trois » ou par « trois ou quatre »…
Nous avons discuté hier des mesures d’incitation en faveur des médecins, pour que ces derniers effectuent le dernier stage éventuellement en milieu difficile, voire en zone sous-dense. Si l’internat était prolongé d’une année, il faudrait passer de trois à quatre ans et non pas de deux à trois ans.
Quoi qu’il en soit, cette mesure incitative, qui me paraît extrêmement intéressante, est de nature à produire des effets très positifs sur l’installation des médecins dans ces zones en difficulté. Le fait d’inciter, et non pas d’obliger les médecins à s’installer dans ces zones pendant une période assez longue leur permet de se familiariser avec la clientèle, de se faire accepter et d’accepter cette clientèle, et les conduit à y demeurer. C’est l’objectif le plus important que nous visons au travers de cet amendement.
Il faut donc que les étudiants qui s’engagent dans ces CESP aient la certitude que le zonage ne changera pas quand ils s’installeront. Pour ce faire, prolongeons-le au moins d’une année, voire de deux si la durée de l’internat est de quatre ans.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 298.

Les contrats d’engagement sont un outil pertinent pour conduire des futurs praticiens de santé à se fixer dans des territoires sous-dotés, et ainsi transformer une incitation en projet concret.
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 20 prévoit de maintenir la classification des zones sous-denses jusqu’à deux ans après leur éventuelle évolution positive.
Toutefois, les étudiants qui s’engagent dans ces contrats le font à l’occasion de leur internat, qui dure trois ans, comme l’ont rappelé plusieurs de mes collègues. Il ressort donc de cette formulation que le CESP peut, dans certains cas, perdre de son intérêt ou, à tout le moins, léser les étudiants en médecine ou en odontologie.
Pour cette raison, nous vous demandons de prolonger d’un an la garantie du maintien des zones sous-denses dans le dispositif, afin d’assurer l’effectivité du contrat d’engagement jusqu’à trois ans. Ainsi, un interne de médecine générale commençant son internat sera certain de la zone dans laquelle il pourra s’installer à la fin de son cursus.

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 540 rectifié quater.

Le présent amendement vise à augmenter la durée de maintien sur la liste des lieux à trois ans, soit la durée de l’internat, afin d’améliorer la visibilité des futurs médecins.

L’article 4 comporte une disposition visant à sécuriser le choix du futur lieu d’exercice des bénéficiaires d’un CESP. En effet, les zones sous-denses ne sont pas figées : ainsi, il se peut qu’un étudiant élabore son projet professionnel dans un territoire qui n’est plus, au terme de ses études, considéré comme une zone sous-dotée.
Le projet de loi prévoit la possibilité de maintenir sur la liste des lieux d’exercice qui sont proposés aux signataires à l’issue de leurs études des lieux qui y figuraient deux ans auparavant, mais qui ne sont plus considérés comme des zones sous-denses. Cette mesure a pour objet de sécuriser les projets professionnels des étudiants.
Ces amendements identiques tendent à prévoir que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le CNG, a la possibilité de conserver sur la liste des lieux d’exercice proposés ceux qui y figuraient trois ans auparavant, et non plus deux. Il s’agirait ainsi de s’aligner sur la durée de l’internat.
Je comprends la philosophie de ces amendements. Pour autant, la commission émet deux réserves.
Tout d’abord, l’article 4 prévoit que le choix du futur lieu d’exercice ne se fait plus nécessairement au cours de la dernière année des études : il pourrait se faire au début du troisième cycle, auquel cas les amendements proposés auraient moins de sens.
Ensuite, et surtout, la durée de l’internat n’est pas nécessairement de trois ans pour toutes les spécialités.
Madame la ministre, vous pourrez certainement nous éclairer sur la possible articulation entre le dispositif proposé et la durée actuelle de l’internat. C’est pourquoi nous nous en remettrons, en ce qui concerne ces amendements, à l’avis du Gouvernement.
Je profite également de cette discussion pour revenir sur les débats d’hier soir sur l’article 2 et la durée des études de médecine générale.
La directive de 2005, modifiée en 2013, ne prévoit pas de changement de durée pour le diplôme d’études spécialisées – le DES – de médecine générale, qui est et reste fixée à trois ans. Il me semble, en revanche, que l’application aux étudiants en médecine générale du décret du 3 juillet 2018 relatif au statut de « docteur junior » est une question qui peut se poser. Ce décret n’est en effet applicable qu’aux spécialités comprenant une phase de consolidation et supposant, donc, au moins quatre ans de formation.
Or j’observe que la question du passage de trois à quatre ans du DES de médecine générale constitue depuis quelques années un serpent de mer du débat public. Elle a en dernier lieu été abordée dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur le troisième cycle des études médicales, qui a été rendu public au début de l’année 2018.
Hier soir, notre discussion sur l’article 2 pouvait laisser penser, madame la ministre, que vous n’envisagiez pas d’évoluer sur ce point. Afin que les choses soient claires pour tous les membres de notre assemblée, pourriez-vous préciser votre avis sur le sujet ?
Je le répète, en ce qui concerne ces amendements identiques, nous nous rangerons à l’avis du Gouvernement.
De vos interventions, mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends que la durée de deux ans vous paraît un peu courte pour ne pas mettre en difficulté des étudiants qui auraient choisi une zone sous-dense et à qui l’on interdirait d’exercer dans cette zone, alors qu’ils ont déjà élaboré leur projet professionnel.
En fait, la logique du Gouvernement est d’adosser cette durée à celle de la révision des zonages. Comme vous venez d’adopter en commission un amendement visant à rétablir une révision de ces zonages tous les trois ans, il ne me paraît pas illégitime de fixer à trois ans la durée du bénéfice du zonage pour les étudiants en médecine signant un contrat d’engagement de service public.
Par souci de cohérence et parce qu’ils me paraissent logiques, je suis donc favorable à ces amendements identiques.
Le choix du Gouvernement de retenir une durée de trois ans n’est pas lié à la durée de l’internat de médecine générale, puisque les contrats d’engagement de service public s’adressent à tous les étudiants, quel que soit leur internat. Pour le Gouvernement, j’insiste sur ce point, cette durée doit être alignée sur la durée de révision des zonages.
Désormais, je souhaiterais aborder plus précisément la question de la durée de l’internat de médecine générale et, ainsi, poursuivre le débat qui nous a animés hier soir. Je remercie d’ailleurs M. le rapporteur de nous offrir l’occasion de reparler de ce sujet : je pense en effet qu’il est indispensable de donner accès à toute l’information.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous confirme que, contrairement à ce qui a été évoqué dans l’hémicycle hier soir, aucune directive européenne ne prescrit la durée du DES de médecine générale ni, en conséquence, son passage à quatre ans à compter du 1er janvier 2020. D’ailleurs, il n’existe pas un modèle unique de formation à la médecine générale en Europe.
La durée du DES de médecine générale est définie par l’arrêté du 21 avril 2017, dans lequel figurent les maquettes de formation des quarante-quatre spécialités médicales. Cette durée est aujourd’hui de six semestres.
Pour chaque maquette, au moins quatre des six semestres doivent être réalisés en ambulatoire, notamment un premier semestre chez un médecin généraliste, le stage dit « de niveau 1 ». Des stages en santé de la femme et en santé de l’enfant peuvent être accomplis en ville. Enfin, il est prévu un semestre professionnalisant en autonomie supervisée chez un médecin généraliste : il s’agit du Saspas, le stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisés.
Lors de la finalisation de la réforme du troisième cycle des études de médecine en 2017, le choix a été fait de maintenir la durée de ce DES à trois ans, dans la mesure où aucun consensus ne s’est dégagé pour la faire passer à quatre ans. Le débat est resté ouvert, puisque les discussions se sont poursuivies, sans pour autant que les attentes et les positions exprimées depuis ne soient apparues totalement stabilisées.
Cela signifie évidemment que le sujet n’est pas clos pour l’avenir. Il est toutefois certain que le passage de la durée de la maquette à quatre ans ne pourrait être envisagé que dès lors que les objectifs visés par une telle mesure et les conditions de sa mise en œuvre dans le cadre du nouvel équilibre de la maquette en huit semestres feraient l’objet d’un consensus de tous les acteurs. En outre, il faudrait que les conditions de sa soutenabilité, notamment sur le plan pédagogique, au regard du nombre de maîtres de stage disponibles, soient réunies.
Cela implique, pour le Gouvernement, que la concertation se poursuive, en particulier avec les étudiants en médecine qui sont les premiers concernés. C’est bien l’objectif que le Gouvernement s’est fixé.
En tout état de cause, nous resterions dans l’esprit de la réforme du troisième cycle, qui repose sur un parcours de formation progressif et assure une acquisition progressive des compétences, y compris en termes d’acquisition de l’autonomie, jusqu’à la validation du DES et la reconnaissance du plein exercice.
En l’état actuel, toutes les dispositions dont nous discutons s’appliqueront à une maquette dont la durée est de trois ans. Les amendements votés hier, qui visent à laisser les étudiants, en troisième année de DES, exercer leur activité en autonomie non supervisée sont, pour Frédérique Vidal et moi-même, une forme de dégradation de la formation : en effet, ces étudiants devraient normalement bénéficier d’un stage autonome supervisé.
Voilà les éléments que je souhaitais partager pour éclairer nos débats d’hier sur la médecine générale.
Cela dit, je le répète, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces cinq amendements identiques.

Madame la ministre, nous partageons votre position sur le passage à trois ans de la révision des zonages pour le CESP.
Toutefois, je m’interroge sur la question qu’a posée Alain Milon. Dans votre réponse, vous avez fait référence à l’arrêté du 21 avril 2017. Or un autre arrêté a été pris le 12 avril 2017, qui porte notamment sur le calendrier de mise en œuvre du troisième cycle des études de médecine. Et l’article 70 de cet arrêté, dans sa version consolidée au 21 mai 2019, précise que les dispositions qui prévoient la phase de consolidation pour le troisième cycle de médecine générale entrent en vigueur « à compter du 1er janvier 2020 ».
En l’état actuel du droit, la durée du troisième cycle de médecine générale doit passer à quatre ans au 1er janvier 2020. Il est donc légitime que le Parlement légifère sur cette base.
Je comprends de votre réponse, madame la ministre, que vous allez abroger cet arrêté ou, en tout cas, modifier ces dispositions.
Comprenez que le Parlement prend acte du fait que la mise en place de la phase de consolidation a été reportée au 1er janvier 2020, compte tenu des négociations ayant eu lieu à l’époque et, notamment, de la demande des organisations représentatives d’internes. Il nous paraît cependant nécessaire d’organiser cette phase de consolidation.
Vous ne pouvez pas nous répondre aujourd’hui que cette phase n’existe pas sur le plan réglementaire : elle est en effet de votre responsabilité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous n’avons pas mentionné de quatrième année dans le texte de notre amendement : en effet, il appartient non pas au législateur, mais à la ministre de la santé de déterminer la durée de chacune des trois phases du troisième cycle des études de médecine : la phase de socle, la phase d’approfondissement et la phase de consolidation.
Il est de votre responsabilité, madame la ministre, de dire si vous allez, ou non, mettre en place cette phase. En tout cas, vous ne pouvez pas nous reprocher d’avoir adopté hier des amendements qui ont pour objet de tenir compte d’un arrêté ministériel en vigueur. Maintenant, si vous prévoyez de l’abroger, ce que je crois comprendre, confirmez-le-nous, car cela modifie les termes du débat.

Je laisserai ma collègue Corinne Imbert intervenir sur la question de la professionnalisation de la neuvième année d’étude de médecine. Selon moi, celle-ci ne constitue pas une dégradation par rapport à l’autonomie supervisée. Vous avez employé un terme difficile à entendre, madame la ministre : considérer comme « dégradant » le fait d’être sur le terrain pour exercer véritablement son métier après neuf années d’études m’interpelle !
Pour ma part, je m’exprimerai sur les zonages. Je ne serai probablement pas le seul à le faire, mais je tiens tout de même à vous faire part des remontées de terrain dont je dispose. Ces zonages sont toujours difficiles à définir, parce qu’ils laissent nécessairement des personnes de côté et qu’ils ne durent qu’un certain temps.
De ce point de vue, nous sommes régulièrement confrontés à une administration que je qualifierai de « rigide ». C’est le cas lorsqu’elle examine les critères d’éligibilité aux aides à l’installation des médecins, qui sont des aides incitatives. On observe aussi de nombreuses difficultés quand il s’agit d’appliquer ces critères.
Si une zone sous-dotée dans laquelle un jeune médecin s’est installé est déclassée, ce dernier perd la rémunération sur objectifs de santé publique, la ROSP, que lui versait l’assurance maladie. Pourtant, ce médecin comptait sur cette aide, puisque l’État s’était engagé, au travers d’un certain nombre de dispositions, à lui verser une somme, dont le montant m’échappe au moment où je vous parle. J’ai été directement confronté à ce type de situation dans l’un des cantons de mon département.
En outre, certains engagements des ARS ne sont pas toujours tenus, ce que je déplore.
Je pense toujours à l’aide spécifique à l’installation. Les jeunes médecins concernés touchent une première tranche de cette aide la première année, puis une seconde tranche l’année suivante, en contrepartie d’engagements de leur part : s’installer dans une zone complémentaire, exercer en secteur 1 – ce que je trouve parfaitement normal – et à temps complet, participer au dispositif de permanence des soins – ce qui est, là encore, tout à fait légitime –, et, enfin, exercer en mode coordonné.
En revanche, il ne faut pas exercer dans la zone sous-dense dans les cinq années qui précédent, ni après les cinq années d’installation. Bref, le mécanisme est particulièrement complexe en termes de projet de santé.
Malgré tous ces critères à remplir, les ARS ne tiennent pas forcément leurs engagements, et les médecins ne sont pas toujours rémunérés. J’attire votre attention sur ce point, madame la ministre, parce que les difficultés sur le terrain sont telles que ces mécanismes incitatifs deviennent particulièrement contraignants.

La mise en place de l’année de consolidation est bien de votre responsabilité, madame la ministre, et je sais que vous saurez prendre cette responsabilité dans un sens ou dans l’autre.
Nous avons élaboré les amendements votés hier soir à l’article 2, sur le fondement de l’arrêté qu’a rappelé mon collègue Bernard Jomier. Or le dispositif de ces amendements vise bien la dernière année du troisième cycle des études de médecine générale et d’autres spécialités.
Comme vient de le souligner mon collègue René-Paul Savary, la professionnalisation n’est pas dégradante : elle fait partie de la formation. C’est sur cet aspect des choses que je ne vous suis plus.
Nous partageons le diagnostic et constatons l’urgence de la situation : il y a besoin de répondre à l’attente des médecins, des élus et, surtout, de nos concitoyens. Je pense que la solution proposée au travers de ces amendements est une réponse pragmatique, qui, encore une fois, n’est pas coercitive – il faut prononcer le mot – pour les étudiants. On leur tend la main et on vous tend la main, madame la ministre. Il faut que nous travaillions ensemble.
Encore une fois, ces étudiants ne seront pas lâchés tous seuls au milieu de nulle part : ils travailleront en autonomie, à côté d’autres médecins, qui ne sont peut-être pas des maîtres de stage aujourd’hui, mais qui ont des qualités professionnelles.
Pardonnez-moi, madame la ministre, mais si j’avais un reproche à vous faire, c’est d’avoir laissé sortir tout un tas de médecins de vos radars, de les avoir oubliés, alors qu’il s’agit d’excellents professionnels qui prennent en charge des patients au quotidien et qui travaillent dans l’ensemble du territoire national. Ce ne sont pas de mauvais médecins, parce qu’ils ne sont pas maîtres de stage ! Demain, ils pourront accompagner des étudiants qui seront en neuvième année de médecine, qui se destinent à l’exercice général et à qui l’on demande simplement de venir travailler en renfort.
Pendant un an, l’étudiant exercera aux côtés de médecins qui se dévouent à leur patientèle, qui exercent la médecine aussi bien que beaucoup d’autres, et qui pourront apporter des réponses à des patients parfois dépourvus de médecin traitant.

Mme Corinne Imbert. Ce médecin, que l’on pourrait qualifier de médecin adjoint ou à qui l’on pourrait trouver un autre statut, peu importe, travaillera à côté de l’un de ses confrères, chacun accueillant et prenant en charge un patient. On aura ainsi deux médecins pour deux patients !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – M. Raymond Vall applaudit également.

Je veux dire un mot après avoir entendu Mme la ministre utiliser le terme de « dégradant », car je ne peux pas laisser passer cela.
En neuvième et dernière année de médecine, le futur médecin ne peut pas faire ce métier s’il ne l’aime pas. Ce n’est pas possible ! Pour moi, le fait d’exercer quelques mois comme médecin adjoint auprès de référents – on a toujours parlé de référents, que ce soit des médecins maîtres de stages ou des référents hospitaliers – n’est pas dégradant.
Au contraire, c’est tout à l’honneur du Parlement et du ministre de la santé de prendre ce type de dispositions, et c’est tout à l’honneur des futurs médecins d’aller travailler dans ces zones sous-denses, dans le cadre de stages encadrés par des maîtres de stage, selon des modalités à déterminer, car il ne nous incombe pas d’entrer dans le détail.
C’est tout à l’honneur du Sénat d’avoir voté ces amendements hier soir.
Je vais répondre aux différentes interventions.
Monsieur Jomier, vous êtes revenu sur un arrêté du 12 avril 2017 qui diffère de celui sur lequel nous avons débattu hier. Mes services ont examiné le contenu de ce texte, et d’autant plus attentivement que l’équipe qui l’a rédigé se trouve au banc du Gouvernement aujourd’hui. Je vous confirme donc que les dispositions qui entrent en vigueur en 2020 touchent uniquement à l’organisation et à l’affectation des stages. Nous sommes à votre disposition pour discuter de cet arrêté, mais, objectivement, il n’est pas question de quatrième année d’étude de médecine générale en 2020.
Monsieur Savary, vous avez remis en cause la méthode de zonage. Je concède que beaucoup de médecins reviennent vers moi pour déplorer le fait qu’ils ne se trouvent plus dans une zone sous-dotée, alors qu’ils estiment que la densité médicale est inférieure à ce qu’ils souhaiteraient ou à ce qu’ils imaginent être le cas ailleurs.
Seulement, le zonage ne résulte pas seulement de la densité médicale : il découle d’un algorithme qui prend en compte le temps médical disponible du médecin, par exemple le travail à mi-temps ou à plein-temps, mais aussi l’état de santé de la population, l’âge moyen de celle-ci, les difficultés sociales, les problèmes de santé publique, ainsi que des indicateurs de santé.
Il résulte donc d’un algorithme complexe, qui se rapproche de la réalité du terrain et qui vise justement à s’éloigner d’une vision statique et très brute reposant sur la seule densité médicale, donnée qui ne veut rien dire en réalité.
Par ailleurs, avec un tel degré de raffinement, le nouveau zonage a tout de même permis d’accroître de 9 % à 18 % la population résidant en zone sous-dense. Certes, certains y ont perdu et sont mécontents, mais il faut considérer les 9 % de Français qui sont couverts en plus. Ce nouvel algorithme a donc fait beaucoup de gagnants.
Il convient d’analyser la réalité du terrain en toute transparence, raison pour laquelle je suis favorable à ce que l’on puisse réviser les zonages dans des délais plus courts que les trois ans prévus lorsque l’on observe d’importantes évolutions sur le terrain.
S’agissant des dispositifs incitatifs à l’installation, comme je vous l’ai déjà indiqué, un rapport doit m’être remis par le docteur Sophie Augros. Celle-ci est en train d’évaluer l’intérêt de tous ces mécanismes, qui sont complexes et difficiles à comprendre, j’en conviens, monsieur le sénateur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai demandé ce rapport, qui doit permettre une simplification et rendre ces aides plus attractives et plus lisibles pour les jeunes médecins. Ce travail est en cours et devrait m’être remis en juillet prochain.
Madame Imbert, vous affirmez que la professionnalisation fait partie intégrante de la formation. C’est exact, mais les amendements adoptés hier tendent à substituer cette professionnalisation à la formation actuelle, puisque vous souhaitez substituer à la troisième année de formation supervisée par des maîtres de stage une pratique médicale en pleine autonomie.
Je rejoins d’ailleurs M. Chasseing sur ce point : si le stage faisait l’objet d’une supervision, en présence de maîtres de stage, pourquoi pas ? Mais ce que vous proposez avec les amendements votés hier, c’est en fait une professionnalisation de la dernière année d’études, façon « Docteur junior ».
Personnellement, je considère que cette mesure réduira la durée de formation des médecins généralistes, qui ont obtenu cet internat en trois ans de formation en 2004 ou 2005.
Pour finir, j’entends beaucoup de critiques, mais je rappelle tout de même que je suis favorable aux amendements identiques sur lesquels le Sénat va se prononcer !
Sourires.

Madame la ministre, nous sommes têtus, parce que nous pensons que nous agissons dans l’intérêt général, sur le fondement d’éléments pleinement justifiés. Notre réflexion s’appuie, entre autres, sur le dispositif de l’arrêté du 12 avril 2017. Madame la ministre, je viens d’en prendre de nouveau connaissance et vous confirme que nous ne faisons pas la même lecture que vous de l’article 70 de ce texte.
Cet article précise que « les dispositions du troisième alinéa de l’article 42 et du II de l’article 44 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020 », ce que mon collègue Bernard Jomier a déjà rappelé. Il faut donc se reporter au troisième alinéa de l’article 42, selon lequel « pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région ».

J’espère avoir été clair : cet article, dont les dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2020, porte bien sur la phase de consolidation.
En fait, l’article auquel vous faites référence précise qu’il n’y a pas de phase de consolidation pour les spécialités médicales en trois ans. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas la même lecture de cet article.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 420, 683, 32 rectifié bis, 298 et 540 rectifié quater.
Les amendements sont adoptés.
L ’ article 4 est adopté.

Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 147 rectifié ter, présenté par MM. Raison, Perrin et Darnaud, Mmes Thomas, Chain-Larché et Eustache-Brinio, MM. Joyandet et Gilles, Mme Guidez, MM. Mayet et Revet, Mme Lopez, MM. Charon, D. Laurent, Genest et B. Fournier, Mmes Chauvin et Deromedi, M. Cuypers, Mmes Joissains et Raimond-Pavero, MM. Pellevat, Pierre, Meurant, Saury, de Nicolaÿ, Pointereau, Vaspart et Priou, Mme C. Fournier, M. Laménie, Mme Lamure et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 162-2, après les mots : « liberté d’installation du médecin, », sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-5 et » ;
2° Après le 2° bis de l’article L. 162-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions à remplir par les médecins exerçant à titre libéral pour être conventionnés, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».
La parole est à M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Je dépose le même amendement depuis une bonne dizaine d’années, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Et depuis une bonne dizaine d’années, les différents rapporteurs et ministres, quel que soit leur bord politique, sont d’avis de le rejeter !
Sourires.

Toutefois, je persévère, car il faut bien trouver une solution à la situation actuelle : dans nos villages, au travers des différentes rencontres que nous faisons, nous nous rendons tous bien compte que le problème n’est pas celui du nombre de médecins, mais de leur répartition sur le territoire.

Quand notre collègue Jean-François Longeot a été nommé rapporteur pour avis sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé, en 2015, j’étais encore membre de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
À l’époque, nous avions travaillé ensemble sur ce texte, et la commission avait finalement déposé un amendement sensiblement analogue à celui que je présente aujourd’hui.
Pour en arriver là, Jean-François Longeot n’avait pas agi par hasard et fait n’importe quoi : la commission avait beaucoup auditionné, notamment les représentants du Conseil national de l’ordre des médecins. De mon côté, j’avais également rencontré les représentants des jeunes médecins de ma région, ainsi que le doyen. D’ailleurs, contrairement à ce que j’entends, tous les médecins ne sont pas contre cet amendement. Je dirais même qu’au moins 60 % d’entre eux y sont favorables !
En fait, je propose tout simplement que le mécanisme appliqué aux infirmiers en 2008, pérennisé en 2011 et étendu aux masseurs-kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux orthophonistes en 2012 soit également applicable aux médecins. On ne leur dirait pas d’aller exercer dans tel ou tel endroit, mais simplement de ne pas s’installer dans une zone, dès lors que celle-ci est suffisamment dotée. Ce dispositif présente l’avantage d’être peu coercitif.

Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 179 rectifié est présenté par MM. J. Bigot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Sueur, Montaugé, Vaugrenard, Todeschini et Marie, Mme Lepage, M. M. Bourquin, Mme G. Jourda, MM. P. Joly, Duran et Lurel, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Manable et Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Courteau et Temal et Mme Monier.
L’amendement n° 365 rectifié bis est présenté par MM. Vall, Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Menonville.
L’amendement n° 422 est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
L’amendement n° 437 rectifié ter est présenté par MM. Vaspart, Bizet, Raison et Mandelli, Mmes Ramond et Raimond-Pavero, MM. Nougein, Pellevat, Paul, Perrin, Bascher, Genest, Meurant, Brisson et D. Laurent, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Noël, MM. Bouloux et Pointereau, Mme Lamure et MM. Laménie, Segouin et Gremillet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « liberté d’installation du médecin, » sont insérés les mots : « sans préjudice du respect du principe d’égal accès aux soins et ».
La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 179 rectifié.

Cet amendement ne vise pas à remettre pas en cause la liberté d’installation du médecin. Il s’agit simplement d’introduire une précision au sein de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale relatif aux libertés d’exercice et d’installation des médecins, afin de faire apparaître la nécessité, pour les médecins, de prendre en compte le principe d’égal accès aux soins.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 365 rectifié bis.

Un sondage BVA publié l’année dernière a révélé que plus de sept Français sur dix avaient déjà renoncé au moins une fois à se soigner à cause de délais d’attente trop longs pour obtenir un rendez-vous, d’une part, et en raison du refus de certains médecins de les examiner, d’autre part.
Cet amendement est donc largement justifié.

La parole est à M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 422.

Cet amendement ayant été très bien défendu par Michel Raison, je ne vais pas en rajouter. Il est de concilier la liberté d’exercice et la liberté d’installation des médecins avec un objectif essentiel, qui relève de l’intérêt général, celui de l’égal accès aux soins.
Comme l’a rappelé Michel Raison, un amendement similaire est déposé chaque année depuis une dizaine d’années. Et cette année, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a elle-même défendu une mesure similaire au stade de l’examen en commission.
Je remercie les collègues des différents groupes, que ce soit le groupe socialiste et républicain, le groupe du RDSE ou le groupe Les Républicains, d’avoir repris notre amendement à leur compte.
Mes chers collègues, je vous invite à voter ces amendements, car leur adoption permettrait d’envoyer un signal fort à nos concitoyens, en leur montrant que le Sénat a véritablement pris la mesure du problème de l’accès aux soins et qu’il entend marquer son attachement aux principes constitutionnels qui fondent notre pacte social.
MM. Hervé Maurey et Raymond Vall applaudissent.

La parole est à M. Michel Vaspart, pour présenter l’amendement n° 437 rectifié ter.

Cet amendement ayant déjà été défendu par trois de mes collègues, je voudrais simplement ajouter que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont consacré ce principe à plusieurs reprises, comme corollaire du droit à la protection de la santé résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Je reviendrai également sur notre vote d’hier concernant les stages – je me félicite que ces amendements aient été adoptés –, ainsi que sur certaines réactions entendues à cette occasion, selon lesquelles on mettrait en place une médecine à deux vitesses… La médecine à deux vitesses existe déjà en matière d’accès aux soins, ne serait-ce qu’au niveau des territoires.
Ainsi, quand on obtient un rendez-vous sous huit jours, voire le jour même, dans certains territoires, il faut attendre six à huit mois pour en obtenir un dans d’autres. On peut donc bien parler d’un inégal accès aux soins et, déjà, de l’existence d’une médecine à deux vitesses dans notre pays !

L’amendement n° 366 rectifié bis, présenté par MM. Vall, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ainsi que, le cas échéant, les mesures de limitation d’accès au conventionnement dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ; ».
II. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -6 -…. – I. – En l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions suivantes :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« L’alinéa précédent cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord prévu au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Raymond Vall.

Je m’inscris totalement dans les propos introductifs du président Hervé Maurey sur ce problème de désertification médicale. Effectivement, en dépit de la croissance du nombre des médecins au cours des dernières années, les inégalités territoriales sont toujours prégnantes.
Aussi cet amendement tend-il à renvoyer à la négociation conventionnelle entre les médecins et l’assurance maladie la détermination des conditions dans lesquelles les médecins doivent participer à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins.
En l’absence d’accord, il est proposé de mettre en place un système de conventionnement sélectif, pour limiter les installations de médecins dans les zones surdotées. Un dispositif similaire est depuis longtemps appliqué à d’autres professions, chaque fois avec des résultats satisfaisants.
J’ajouterai que la Cour des comptes préconise d’étendre, dans les zones en surdensité, le conventionnement conditionnel à toutes les professions, y compris aux médecins, pour mieux équilibrer la répartition des professionnels sur le territoire.
Selon la Cour, la régulation des installations est une nécessité pour obtenir un rééquilibrage des effectifs libéraux, en fonction des besoins de santé des populations sur le territoire, et elle peut être recherchée sans remettre en cause la liberté d’installation, en instituant un conventionnement individuel généralisé à l’ensemble du territoire.
Si l’on veut lutter efficacement contre la désertification médicale, il est essentiel de mobiliser l’ensemble des leviers, notamment ceux qui ont fait leurs preuves. Tel est l’objet de cet amendement.

L’amendement n° 232 rectifié quater, présenté par MM. M. Bourquin, Sueur et Tissot, Mmes G. Jourda, Conconne et Préville, MM. Courteau, Duran, Fichet et Marie, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Guillemot, MM. Montaugé, Iacovelli et Tourenne, Mmes Jasmin et Meunier, MM. Temal, Vaugrenard et Houllegatte, Mme Tocqueville, MM. Mazuir et Manable, Mmes Van Heghe et Artigalas, M. P. Joly, Mme M. Filleul, MM. Devinaz et Kerrouche, Mme Monier, M. J. Bigot et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -6 -….– Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Martial Bourquin.

Cet amendement vise à instaurer un conventionnement sélectif ou territorialisé des médecins libéraux, afin d’assurer une meilleure répartition sur le territoire et de lutter contre la désertification médicale.
Nous proposons de conditionner le conventionnement d’un médecin à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone.
Je rappelle tout de même que la Nation prend en charge la formation des médecins, pour un coût qui avoisinerait 11 540 euros par étudiant chaque année. Je rappelle aussi que l’État assure, bien sûr, les revenus des médecins à travers l’assurance maladie.
Or la situation est extrêmement grave. Certains territoires font face à une véritable urgence sanitaire. Bien qu’elle perde chaque jour trois médecins généralistes, la France compte autant de médecins par million d’habitants que les autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE. Mais les déserts médicaux se constituent, faute de pouvoir organiser l’offre de soins sur le territoire.
Il est question, pour nous, non pas de contrevenir globalement à la liberté d’installation, mais de la réguler. Une telle régulation s’applique déjà aux pharmaciens, aux infirmiers, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux orthophonistes. Pourquoi ne pas l’étendre aux médecins généralistes et aux spécialistes ? Expliquez-nous pourquoi, madame la ministre !
Une étude vient de paraître, de l’UFC-Que choisir, selon laquelle 15 millions de Français rencontrent des difficultés pour disposer d’un médecin généraliste à moins de 30 minutes. Plus alarmant encore, les difficultés d’accès aux spécialistes que sont les gynécologues, les ophtalmologistes et les pédiatres concernent jusqu’à 21 millions de nos concitoyens.
La question est simple : va-t-on choisir de changer, de réguler ? Puisque la Nation paie, faisons donc en sorte de changer.
En prenant nos responsabilités, en tant que parlementaires, nous pouvons remédier à la problématique des déserts médicaux en quelques années. Mais il faut avoir le courage de le faire, c’est-à-dire de s’attaquer à une sacro-sainte liberté d’installation qui s’opère n’importe comment, entraînant une surdensité médicale, très onéreuse pour la sécurité sociale, dans certaines régions, et laissant d’autres territoires quasiment sans rien.
Si le Parlement prend ses responsabilités, mes chers collègues, nous pouvons résoudre la situation.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 228 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart, Longeot, Bizet, Raison et Mandelli, Mme Raimond-Pavero, MM. Nougein, Pellevat, Mayet, Paul, Perrin, Bascher, Genest, Meurant, Brisson et D. Laurent, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Noël, M. Guené, Mme Lamure et MM. Laménie et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ainsi que, le cas échéant, les mesures de limitation d’accès au conventionnement dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ; »
II. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -6 -…. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, en l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20 bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions suivantes :
« Le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin général ou spécialiste ne peut intervenir que dans la limite, pour chaque spécialité ou groupe de spécialités, de seuils d’effectifs par zone, définis par les agences régionales de santé, en fonction des besoins de santé des populations.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux médecins libéraux entrants en exercice à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article.
« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue en particulier la contribution de ce dispositif à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
La parole est à M. Michel Vaspart.

Pour ma part, je ne suis pas a priori favorable aux contraintes de toute nature.
Néanmoins, on voit bien que les mesures incitatives n’ont pas résolu le problème. J’entends parler de cette question depuis mon élection au Sénat en 2014, et on en parlait certainement déjà auparavant. Or la situation se dégrade, au lieu de s’améliorer.
En lien avec la position adoptée en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, cet amendement tend à poser le principe d’un renvoi aux négociations conventionnelles entre les syndicats de médecins et l’assurance maladie, leur laissant le choix des moyens, que ce soit un conventionnement sélectif, individuel ou autre, pour aboutir à une solution négociée de nature à traiter efficacement les déserts médicaux.
En outre, il vise à mettre en place un système dit de conventionnement individuel sur l’ensemble du territoire, applicable uniquement aux médecins entrant en exercice : les agences régionales de santé, ou ARS, fixeraient le nombre cible de postes de médecins conventionnés, généralistes et spécialistes, dans chaque région et chaque département, en fonction de critères de densité.
Dans chaque région et département, les médecins commençant à exercer ne pourraient accéder au conventionnement à l’assurance maladie que sous réserve d’entrer dans les effectifs ciblés.
Cette mesure peut sembler moins efficace qu’un conventionnement individuel applicable à tous les médecins, y compris à ceux qui sont déjà en exercice, comme l’évoquait la Cour des comptes, mais elle est aussi moins contraignante.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 178 rectifié bis est présenté par MM. J. Bigot et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Sueur, Montaugé, Vaugrenard, Todeschini et Marie, Mme Lepage, M. M. Bourquin, Mme G. Jourda, MM. P. Joly, Duran et Lurel, Mmes Artigalas et Grelet-Certenais, MM. Manable et Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Courteau et Temal et Mme Monier.
L’amendement n° 421 est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ainsi que, le cas échéant, les mesures de limitation d’accès au conventionnement dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ; ».
II. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -6-…. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, en l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral dans les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine ces zones par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins et après avis du conseil territorial de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article.
« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue en particulier la contribution de ce dispositif à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 178 rectifié bis.

Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à bien connaître la question des déserts médicaux – ceux-ci ne sont pas forcément les zones les moins peuplées, d’ailleurs –, à être confrontés au problème.
Les réformes récentes du numerus clausus et la suppression aujourd’hui proposée ne permettront pas d’enrayer le phénomène de désertification, car je pense que nous n’avons pas tout essayé.
En tant qu’élu, les sollicitations sont quotidiennes ; en tant que sénateur, notre devoir est de représenter les territoires. Or les citoyens crient chaque jour leur détresse face à cette inégale répartition de l’offre de soins. C’est l’égalité des territoires qui est en jeu, ainsi que notre pacte républicain !
Madame la ministre, vous affirmez qu’avec la suppression du numerus clausus la France formera 20 % de médecins supplémentaires. Mais quelle garantie avons-nous qu’ils s’installeront dans les zones déficitaires et dans nos villages ? Ce texte, madame la ministre, manque profondément d’ambition et de courage politique !
Conscient des réalités de nos territoires, et malgré vos affirmations selon lesquelles il est trop tard pour mettre en place une véritable régulation de l’offre médicale sur le territoire, madame la ministre, je défends aujourd’hui cet amendement, reprenant, pour l’essentiel, le contenu de la proposition de loi, défendue par notre collègue Guillaume Garot à l’Assemblée nationale, visant à instaurer un conventionnement sélectif, pour lutter efficacement contre la désertification médicale.
Avec cet amendement, notre objectif est de limiter l’aggravation de ce phénomène, en étendant aux médecins libéraux, à titre expérimental, un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà, cela a été dit par plusieurs de mes collègues, pour plusieurs autres professionnels de santé.
L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement des dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées, mis en place dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et du plan Ma santé 2022.
Madame la ministre, mes chers collègues, il est urgent de mobiliser l’ensemble des solutions à notre disposition pour lutter contre les déserts médicaux, d’autant plus qu’elles sont déjà à l’œuvre, comme je l’indiquais, pour d’autres professions de santé.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

La parole est à M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 421.

Cet amendement a également été déposé dès le stade de la commission ; nous l’avons longuement évoqué lors de la présentation de mon rapport pour avis. Aussi, je tiens à remercier mes collègues qui l’ont repris comme amendement de séance.
Il s’agit de proposer une mesure de régulation, et non de coercition, comme on peut l’entendre ici ou là.
Cette disposition est proche d’un amendement que notre commission avait déposé en 2015, à l’occasion de l’examen du précédent projet de loi consacré au système de santé.
Toutefois, nous y avons apporté un élément, une évolution majeure : le renvoi à la négociation conventionnelle entre l’assurance maladie et les médecins, pour définir les conditions dans lesquelles ces derniers participent à la réduction des inégalités d’accès aux soins et, le cas échéant, les mesures de limitation d’accès au conventionnement dans les zones surdotées.
Ce premier étage du dispositif, que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable vous propose d’adopter, mes chers collègues, correspond exactement à ce que le Sénat a voté en 2015.
Ainsi, l’article 12 quater A, alors adopté sur l’initiative de commission saisie au fond, disposait que « la négociation des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162-5 du [code de la sécurité sociale] doit porter, pour assurer l’offre de soins, sur le conventionnement à l’assurance maladie des médecins libéraux dans les zones définies par les agences régionales de santé, en application des 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ».
Ensuite, si les partenaires ne parviennent pas à se mettre d’accord dans un délai d’un an, un dispositif de conventionnement sélectif est prévu, à titre expérimental, pour une durée de trois ans en zones surdotées, selon le principe d’une arrivée pour un départ. Cela permettrait de réorienter progressivement les médecins vers des secteurs intermédiaires et sous-denses.
Ce dispositif a prouvé son efficacité pour les infirmiers, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes. Nous connaissons tous les chiffres : les installations en zones surdenses ont largement diminué et celles qui concernent des zones très sous-dotées ont augmenté.
Je ne comprends pas pourquoi les médecins ne pourraient pas faire l’objet de dispositions similaires, sous réserve de certaines adaptations, bien entendu, afin de prendre en compte le rôle central qu’ils jouent dans le système de soins en matière de prescription d’actes.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 423 est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
L’amendement n° 438 rectifié bis est présenté par MM. Vaspart, Bizet, Raison et Mandelli, Mmes Ramond et Raimond-Pavero, MM. Nougein, Pellevat, Mayet, Paul, Perrin, Bascher, Genest, Meurant, Brisson et D. Laurent, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Noël, MM. Bouloux et Pointereau, Mme Lamure et MM. Laménie et Gremillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
La parole est à M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 423.

Cet amendement est le dernier que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a souhaité proposer sur ce projet de régulation des installations des médecins et je remercie mes collègues commissaires, en particulier Michel Vaspart, de l’avoir également repris.
En 2015, le Sénat avait adopté un dispositif ambitieux, faisant référence à la négociation conventionnelle et à la limitation d’accès au conventionnement comme mesure de régulation de l’offre de soins.
Dans une logique de compromis, mes chers collègues, je vous propose de voter le premier membre de ce dispositif, à savoir un renvoi simple aux négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les médecins pour déterminer les conditions dans lesquelles ces derniers participent à la résorption des déserts médicaux.
À mon sens, c’est le minimum que puisse faire le Sénat pour adresser un signal politique fort aux élus locaux et aux citoyens, qui nous demandent la mise en place de mesures ambitieuses pour l’accès aux soins.

La parole est à M. Michel Vaspart, pour présenter l’amendement n° 438 rectifié bis.

Cet amendement, identique au précédent, est seulement un amendement de repli. En réalité, j’attends beaucoup plus que cela !

L’amendement n° 233 rectifié quater, présenté par MM. M. Bourquin, Sueur et Tissot, Mmes G. Jourda, Conconne et Préville, MM. Courteau, Duran, Fichet et Marie, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Guillemot, MM. Montaugé, Iacovelli et Tourenne, Mmes Jasmin et Meunier, MM. Temal, Vaugrenard et Houllegatte, Mme Tocqueville, MM. Mazuir et Manable, Mmes Van Heghe et Artigalas, M. P. Joly, Mme M. Filleul, MM. Devinaz et Kerrouche, Mme Monier, M. J. Bigot et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.
II. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
III. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 232 rectifié quater excellemment défendu par Martial Bourquin. Il s’agit de mettre en œuvre ce système de conventionnement sélectif à titre expérimental pendant trois ans.
Si d’aventure, madame la ministre, vous n’acceptiez pas le premier amendement, peut-être accepteriez-vous que l’on expérimente le dispositif pour en voir les effets ?
Vous savez, il est très important que les parlementaires soient des élus de terrain. Permettez-moi ainsi de vous livrer un témoignage, fort de trois campagnes réalisées pour les élections sénatoriales : lors de la première, on me parlait de l’emploi, de l’insécurité et de différents autres sujets ; lors de la seconde, j’ai vu poindre le sujet de la désertification médicale ; lors de la troisième, madame la ministre, les 300 maires que j’ai rencontrés m’ont pratiquement tous signalé cette problématique ! On voit des cantons entiers où il n’y a plus un seul généraliste. C’est la réalité !
Nous entendons bien toutes les mesures incitatives qui sont prises ; nous n’avons rien contre. Simplement, cela ne suffit pas, et c’est, tout le monde le sait, le problème de l’égalité en matière de santé qui se pose, aujourd’hui, dans notre pays.
Nous pouvons bien inscrire le mot « égalité » sur le fronton de nos mairies, en réalité, il existe une très forte inégalité dans l’accès à l’offre de santé.
Dans ce contexte, je ne vois pas en quoi un dispositif s’appliquant aujourd’hui à quantité de professions, y compris médicales – j’entends par là une régulation visant à ce que les professionnels s’installent là où se trouvent des malades, là où des citoyens les attendent –, serait impossible à mettre en œuvre, incongru et inopérant.
Vous avancez le motif que le problème serait mondial, madame la ministre. Mais si c’est un problème mondial, commençons par trouver des solutions effectives dans notre pays, et cela, en effet, demande du courage !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 116 rectifié ter, présenté par M. L. Hervé, Mme Tetuanui, MM. Détraigne, Janssens, Moga et Buis et Mme Létard, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, à partir du 1er juillet 2020, pour une période de cinq ans, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins libéraux sont définis par une convention nationale conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Cette convention détermine notamment :
1° Les mesures incitatives applicables aux médecins libéraux en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes médecins libéraux ;
2° Les conditions à remplir par les médecins libéraux pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4.
L’impact de la convention est évalué par les parties prenantes dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d’évaluation est publié avant la signature de la convention, un autre est publié au plus tard au 1er janvier 2023 et un dernier rapport sera publié dans les six mois suivants la fin de la convention.
La parole est à M. Loïc Hervé.

Afin de lutter plus efficacement contre la désertification médicale, cet amendement vise à transposer aux médecins libéraux le mécanisme de conventionnement applicable actuellement aux infirmiers libéraux.
Cette convention expérimentale, conclue d’ici au 1er juillet 2020 et applicable pour une durée de cinq ans, permettrait à la fois de conforter les mécanismes incitatifs pour l’installation dans les zones sous-dotées et d’instaurer un conventionnement sélectif, afin de limiter l’installation dans les zones surdotées.
L’impact de la convention est évalué par les parties prenantes dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d’évaluation est publié avant la signature de la convention ; un autre est publié au plus tard le 1er janvier 2023 et un dernier rapport sera publié dans les six mois suivant la fin de la convention.
Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, commission mixte paritaire qui s’est réunie aujourd’hui, n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
Exclamations.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.