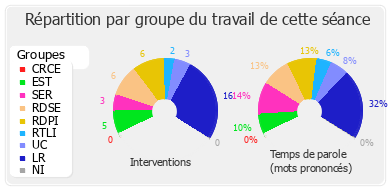Séance en hémicycle du 20 juin 2019 à 10h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Accord avec l'arménie
- Accords avec la suisse et le luxembourg (voir le dossier)
- Adoption définitive en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Agence nationale de la cohésion des territoires (voir le dossier)
- Adoption en nouvelle lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié et des conclusions d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Communication relative à une commission mixte paritaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle l’examen d’un projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, tendant à autoriser l’approbation d’une convention internationale.
Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Accord avec l'arménie
Projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république d'arménie portant application de l'accord signé à bruxelles le 19 avril 2013 entre l'union européenne et la république d'arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Arménie portant application de l’accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 octobre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Arménie portant application de l’accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (projet n° 523, texte de la commission n° 565, rapport n° 564).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
Le projet de loi est adopté.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (projet n° 526, texte de la commission n° 567, rapport n° 566).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

Les zones frontalières – certains parmi vous en sont des élus, mesdames, messieurs les sénateurs – constituent des espaces privilégiés pour le développement de la coopération entre États voisins et répondre de la manière la plus adéquate aux besoins de nos populations sur le terrain.
En favorisant la mobilité des patients et des professionnels de santé dans les régions frontalières, les coopérations développées en matière de santé visent à apporter un bénéfice concret et direct au citoyen, en lui permettant de profiter de soins de qualité au plus près de son lieu de résidence, que cela soit dans un contexte de secours d’urgence, de soins programmés ou encore de pathologies chroniques.
Dans la mesure où les soins médicaux sont une compétence nationale des États membres de l’Union européenne, des accords bilatéraux dans le domaine de la santé demeurent nécessaires, parallèlement aux dispositions européennes existantes, pour éliminer des obstacles à la circulation des patients et des professionnels.
De même, le développement des expériences de coopération entre établissements de santé, de part et d’autre de nos frontières, s’est accompagné de difficultés multiples : à titre d’exemple, on peut évoquer les barrières administratives liées aux différences d’organisation sanitaire de chaque État, ou encore les problèmes de prise en charge des patients. C’est donc pour remédier à un certain nombre de ces difficultés et mieux développer les synergies à la frontière, dans un souci d’optimisation de l’offre de soins, que la négociation d’accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière est nécessaire.
La coopération renforcée avec la Suisse et le Luxembourg, évoquée de longue date dans le cadre des instances de dialogue existantes – je citerai notamment le dialogue sur la coopération transfrontalière franco-suisse et la Commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour le renforcement de la coopération transfrontalière –, a abouti à la négociation de ces deux accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière dès 2014.
S’appuyant sur l’expérience acquise aux frontières belge, allemande et espagnole, et dans un souci de répondre à la demande des acteurs locaux, ces deux accords-cadres signés avec la Suisse et le Luxembourg ont été étudiés dans un objectif de complémentarité de l’offre de soins française, en tenant compte des besoins exprimés dans le cadre de la planification hospitalière et, en aucun cas, de concurrence.
L’accord-cadre avec la Suisse a été signé en septembre 2016, celui avec le Luxembourg en novembre 2016. Ces accords concernent les zones géographiques suivantes : pour l’accord-cadre signé avec la Suisse, la région Grand Est, la région Bourgogne-Franche-Comté, chère à mon cœur, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les cantons frontaliers de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Jura, Neuchâtel, Soleure, Valais et Vaud ; pour l’accord-cadre signé avec le Luxembourg, la zone frontalière entre la région Grand Est et le Grand-Duché de Luxembourg.
Ces deux accords ont trois objectifs principaux.
Il s’agit, premièrement, de permettre l’accès à des soins de qualité, tant en matière de soins d’urgence que de soins programmés ou liés à une pathologie chronique, tout comme la continuité de ces soins aux populations des bassins de vie concernés, qu’ils résident habituellement ou séjournent temporairement dans les régions frontalières visées par les accords-cadres.
Il s’agit, deuxièmement, d’organiser le remboursement des soins reçus sans autorisation préalable dans la région transfrontalière concernée, les soins hospitaliers étant déterminés en fonction des déficits et des besoins constatés de part et d’autre en matière d’offre de soins.
Il s’agit enfin, troisièmement, d’optimiser et d’organiser l’offre de soins en encourageant le partage des capacités telles que les ressources matérielles et humaines et en encourageant la mutualisation des connaissances et des pratiques entre les personnels de santé des deux pays.
Ces accords sont accompagnés de protocoles d’application qui en fixent les modalités de mise en œuvre, notamment les modalités d’intervention des professionnels de santé et des structures de soins, les modalités de prise en charge par un régime de sécurité sociale, la facturation et le paiement.
Les autorités compétentes concluent en outre des conventions locales de coopération entre les structures et les ressources sanitaires dans la zone frontalière, dans un souci de complémentarité, en fonction des déficits et des besoins constatés en matière d’offre de soins. Ces conventions cadrent les conditions et modalités d’intervention des structures de soins et des professionnels de santé. Elles pourront ainsi, par exemple, organiser l’intervention transfrontalière des secours d’urgence ou la coopération hospitalière sur certaines spécialités médicales en fonction des besoins et des déficits constatés sur la zone géographique concernée.
Enfin, pour assurer le suivi de ces accords-cadres et garantir leur bon fonctionnement, des commissions mixtes sont constituées. Elles se réunissent au minimum tous les deux ans et, en tant que de besoin, à la demande des parties. Les autorités compétentes sont chargées de produire tous les quatre ans un bilan ou rapport d’évaluation sur le fonctionnement du dispositif de coopération.
Telles sont les grandes lignes de ce projet de loi, que je tenais à vous présenter au nom du Gouvernement.
Applaudissements sur des trav ées du groupe Union Centriste. – M. Bernard Buis applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, entre 2005 et 2008, la France a conclu trois accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière avec l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne. Les deux accords-cadres que nous examinons aujourd’hui, signés avec la Suisse et le Luxembourg, sont de même nature et de facture similaire. Ils compléteront ainsi le tissu conventionnel en ce domaine avec deux autres pays frontaliers et définiront le cadre juridique de nos relations avec ces États voisins.
Les parlements suisse et luxembourgeois ont chacun adopté l’accord-cadre qui les concerne, respectivement en décembre 2017 et en juin 2018. À noter qu’aucun des neuf cantons suisses concernés n’a demandé une approbation par votation.
L’Assemblée nationale a, quant à elle, adopté ce projet de loi, à l’unanimité, le 23 mai dernier. Son examen au Sénat constitue donc la dernière étape avant la ratification des accords et leur entrée en vigueur.
Dans le domaine sanitaire, notre pays est déjà lié à la Suisse et au Luxembourg par des conventions de sécurité sociale, signées respectivement en 1975 et en 2005. S’agissant de la prise en charge des soins, les modalités applicables sont définies par les règlements européens relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale, qui s’appliquent également à la Suisse. Toutefois, les deux accords-cadres dont nous discutons ce matin vont beaucoup plus loin. Ils ont pour objectif de permettre aux assurés sociaux qui résident dans les régions frontalières d’être soignés au plus près de leur lieu de résidence, aussi bien dans leur pays que sur le territoire d’un État voisin. Ces accords concernent aussi toutes les personnes qui nécessitent des soins urgents et qui relèvent du règlement de coordination de l’Union européenne. Pour ce faire, les accords-cadres veulent favoriser la mobilité des professionnels de santé et des patients dans les régions frontalières et développer des coopérations qui leur sont directement profitables, tant en matière de secours d’urgence que de soins programmés. Il convient de souligner à ce titre que l’accord-cadre franco-suisse règle la question du franchissement de la frontière pour faciliter la circulation des services de secours.
Ces deux accords visent donc à définir le cadre juridique de la coopération sanitaire entre deux États voisins, ouvrant la voie à davantage de mutualisation des savoir-faire, des moyens matériels et, surtout, des moyens humains. Leur champ d’application territorial se limitera aux deux départements limitrophes du Luxembourg, à savoir la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, et aux six départements limitrophes de la Suisse que sont le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, l’Ain et la Haute-Savoie.
L’esprit de ces accords-cadres constitue une réelle avancée pour nos concitoyens frontaliers. Toutefois, ils ne dressent qu’un cadre général qui appelle l’adoption ultérieure d’accords d’application pour fixer les modalités de leur mise en œuvre. La conclusion de conventions locales de coopération entre les autorités sanitaires compétentes sera donc nécessaire pour assurer une complémentarité des offres de soins de part et autre de la frontière, suivant les besoins et les insuffisances préalablement identifiés.
M. Bruno Fuchs, rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale et député de mon département du Haut-Rhin, a conduit un travail très approfondi sur la question, que je tiens à saluer, même si cela a retardé l’adoption du texte de plus d’un an… La commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a en effet constitué un groupe de travail, qui a conduit deux déplacements en Suisse, à Bâle et à Genève, et a procédé à une vingtaine d’auditions – directeurs d’administration, directeurs d’hôpital, élus locaux et, bien entendu, associations de travailleurs frontaliers. En effet, 175 000 travailleurs frontaliers vont en Suisse et 95 000 au Luxembourg.
Le rapport de M. Fuchs, très complet sur le sujet, identifie les lacunes de ces textes trop généraux et établit une liste de recommandations destinées à assurer leur bonne application. Cette application bénéficiera en premier lieu aux travailleurs frontaliers qui sont déjà familiarisés avec le système sanitaire du pays voisin. Plusieurs de ces recommandations méritent d’être soulignées.
Premièrement, l’accord-cadre conclu avec la Suisse désigne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie comme seul « référent » des différentes caisses de sécurité sociale suisses. Or le département du Haut-Rhin bénéficie d’un régime de droit local alsacien-mosellan en matière de sécurité sociale dont les spécificités peuvent échapper à la CPAM de Haute-Savoie. Il serait donc préférable de désigner trois CPAM au titre de la partie française, c’est-à-dire une caisse, évidemment proche de la frontière, par région concernée – Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
Deuxièmement, un effort de communication doit être entrepris au bénéfice de l’ensemble des habitants des départements frontaliers, qu’ils travaillent ou non de l’autre côté de la frontière, pour les informer de leurs droits en matière d’accès aux soins transfrontaliers et d’affiliation. Je précise à cet égard que les litiges relatifs à l’affiliation des travailleurs français en Suisse sont résolus à la suite de l’arrêt du 15 mars 2018 de la Cour de cassation. En effet, les intéressés ont officiellement obtenu leur radiation du système de sécurité sociale français, ainsi que la restitution des cotisations sociales indûment versées.
Troisièmement, sur le plan administratif, les trois agences régionales de santé devront intégrer un volet transfrontalier à leur projet, ainsi que le prévoit déjà la loi. Cependant, il apparaît que ce n’est pas dans leur priorité. En effet, la mobilisation des acteurs institutionnels régionaux est indispensable pour proposer des réponses adaptées aux situations rencontrées par nos concitoyens des zones frontalières.
Quatrièmement, il faudra veiller à la participation de chacune des parties dans la construction d’une offre transfrontalière de soins, afin d’éviter toute concurrence entre établissements de soins ou professionnels de santé. À cet effet, l’analyse des ressources et des besoins de chaque bassin de vie devra intégrer la dimension transfrontalière pour aboutir à des diagnostics partagés, qui permettront à chaque État d’optimiser ses infrastructures, ses équipements et son personnel médical et paramédical. C’est là tout l’intérêt de ces accords-cadres ! Chaque résident frontalier aura alors accès à l’offre de soins la plus adaptée, au plus près de son domicile.
Enfin, cinquièmement, les accords-cadres prévoient la mise en place de commissions mixtes chargées de suivre leur application, composées uniquement de représentants des autorités sanitaires de chaque partie. Il m’apparaît toutefois indispensable d’élargir leur composition aux personnes directement confrontées aux enjeux sanitaires transfrontaliers, à savoir les usagers, les professionnels de santé et les élus locaux. Il s’agit d’éviter l’entre-soi entre administrations et caisses d’assurance maladie.

Pour conclure, je dirais que ces deux accords-cadres devraient, à terme, apporter une réponse aux besoins des populations frontalières en matière d’offre de soins. L’adoption de dispositions complémentaires sera cependant nécessaire pour en fixer précisément les modalités et les contours, en tenant compte des recommandations que je viens d’évoquer.
À la lumière de ces observations, je préconise un vote favorable sur ce projet de loi, adopté à l’unanimité par la commission des affaires étrangères et de la défense.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – M. Bernard Cazeau applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ces accords-cadres ont déjà fait l’objet de nombreux débats au sein de notre chambre et de l’Assemblée nationale. Signés à la fin de 2016, ils avaient été discutés au Palais-Bourbon, une première fois, au début de 2018, mais avaient l’objet d’un renvoi, sur demande du rapporteur. En effet, ces accords étaient trop faibles et inapplicables sur le terrain, et il apparaissait essentiel que le législateur retravaille le document, ce qui exigeait une mission de six mois.
Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Les accords-cadres revus et adoptés par l’Assemblée nationale nous semblent, une nouvelle fois, trop faibles. En effet, on peut déjà regretter qu’une partie des recommandations de la mission d’information de la commission des affaires étrangères du Palais-Bourbon n’ait pas été reprise, notamment en ce qui concerne l’adaptation par la Suisse de l’accord régissant la désignation des caisses primaires d’assurance maladie de référence. Nous savons qu’un accord-cadre n’est pas exhaustif ; il ne fait qu’ouvrir un champ des possibles. Toutefois, la méthode interroge, car elle risque de renvoyer aux calendes grecques les deux défis de la coopération sanitaire transfrontalière.
La première épreuve, c’est celle de la carte de l’offre de soins. La France paie aujourd’hui sa politique d’austérité en matière de soins, et elle le fait encore plus fortement dans les zones frontalières. Car il ne faut pas minimiser le phénomène d’exode des personnels de santé vers la Suisse, où les conditions de travail et de rémunération sont bien supérieures à ce qu’ils trouvent en France. Ainsi, on se retrouve dans la situation où 35 % des personnels diplômés des hôpitaux universitaires de Genève ont fait leurs études en France, quand les centres hospitaliers d’Annecy-Genevois et Alpes-Léman ont un taux de vacance de poste élevé et un turnover des effectifs aux alentours de 23 %.

Ce taux monte même à 103 % pour la spécialité technique « bloc opératoire » d’Annecy-Genevois !
Dans le privé, la situation n’est pas meilleure, puisque 75 % des infirmiers libéraux dans le canton de Genève sont français.

Ces chiffres ne sont guère étonnants quand on voit les conditions d’exercice aujourd’hui dans notre pays.
Par ailleurs, le « panorama de la santé 2017 » de l’OCDE a de nouveau pointé du doigt le fait que la France soit le quatrième pays proposant les salaires les plus faibles à ses personnels paramédicaux, juste derrière la Lettonie, la Hongrie et la Finlande. Pour donner un ordre d’idée, le rapport est du simple au double entre les rémunérations perçues au Luxembourg et en France, avec des conditions d’emplois bien meilleures dans le Grand-Duché.
Au final, ce sont les patients qui pâtissent le plus de cette situation, et c’est ici la deuxième épreuve. Car il ne faut pas omettre non plus le fait que, si de nombreux Luxembourgeois et Suisses viennent se soigner en France, c’est bien parce que les soins médicaux sont plus abordables financièrement. Pour donner un ordre d’idées, il faut compter 60 euros au Luxembourg pour une consultation chez un médecin généraliste, remboursée par la Caisse nationale de santé au Luxembourg à hauteur de 70 %. Considérer que le maintien d’une offre côté français du territoire n’est pas essentiel au vu de la proximité des établissements suisses ou luxembourgeois revient donc à omettre qu’une partie des patients n’est pas mobile, ou qu’elle n’a tout simplement pas les moyens financiers.
Au regard des coûts médicaux induits, il est d’autant plus regrettable que le Gouvernement, sauf erreur de ma part, n’ait pas pris un engagement ferme sur les nombreux litiges concernant les doubles affiliations. Pourtant, la Cour de cassation a été très claire dans son arrêt du 5 mars 2018 : la liberté d’affiliation offerte aux transfrontaliers oblige la sécurité sociale à accepter la radiation d’un résident français travaillant en Suisse et affilié d’office au régime suisse. Notre rapporteur a annoncé que les personnes concernées par une action en justice ont pu voir leur radiation effective et leurs cotisations sociales restituées. Toutefois, de nombreuses personnes continuent de cotiser doublement, faute d’informations suffisantes. À ce titre, les associations de travailleurs frontaliers sont des ressources précieuses, mais elles ne peuvent pas éternellement prendre le relais du ministère, même avec l’implication des élus locaux.
Je l’ai dit en préambule, ces accords-cadres nous semblent une nouvelle fois trop faibles au regard des enjeux. Toutefois, il faut leur reconnaître le mérite de poser la première pierre à l’édifice. C’est pour cela que notre groupe les votera. En effet, si ces accords-cadres ne répondent pas directement à ces deux défis, ils ont le mérite de permettre le développement de conventions locales, par ailleurs déjà existantes dans d’autres domaines au niveau des établissements.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Union Centriste a souhaité qu’un débat en procédure normale ait lieu sur ces accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière.
Ces derniers ont fait l’objet d’une étude approfondie de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, car un accord-cadre, s’il fixe les grands principes, nécessite la conclusion de conventions locales pouvant répondre au mieux aux besoins des personnes résidant dans les régions frontalières avec la Suisse et le Luxembourg.
C’est bien parce que des directives ne font pas de mesures concrètes que le Parlement est en droit d’obtenir des éclaircissements sur leurs conséquences. Le rapport de l’Assemblée nationale est exhaustif sur ces accords, et les recommandations formulées de bon sens. Beaucoup a été dit sur l’intérêt de développer les coopérations transfrontalières. Je me contenterai ici d’insister sur quelques points.
Le premier va dans le sens de l’intérêt de la conclusion de tels accords. Il se trouve que nous avons déjà une expérience de longue date en Moselle, plus particulièrement en Lorraine, de ces conventions locales conclues sur la base d’accords-cadres passés dès 2005, notamment avec la Belgique.
À cela s’ajoute la convention sanitaire Mosar, signée mercredi dernier à Forbach par les partenaires franco-allemands.
Elle va permettre de développer un peu plus la coopération entre les établissements de Sarre et de Moselle-Est.
Cependant, c’est bien le travail au plus près des difficultés et des situations concrètes qui a permis de résoudre des cas complexes, par la mise en place de systèmes ad hoc de coopération entre établissements médicaux frontaliers au plus près des besoins des patients, qui fonctionnent aujourd’hui très bien.
À l’échelon des zones frontalières lorraine – Meurthe-et-Moselle – et belge – province de Luxembourg –, une coopération renforcée a été mise en œuvre entre deux établissements par le biais de conventions et d’une zone organisée d’accès aux soins transfrontaliers, une ZOAST. Les ZOAST sont des zones géographiques au sein desquelles les populations ont librement accès aux soins des deux côtés de la frontière.
L’originalité de cette ZOAST repose sur les modalités de facturation de la prise en charge. Les procédures administratives sont ainsi simplifiées pour les patients français grâce à l’utilisation de la carte Vitale française via des bornes installées dans l’établissement belge, avec transmission des éléments à la CPAM française. Pour les patients belges, une procédure identique est appliquée sur présentation de la vignette de mutuelle.
Autre exemple, la ZOAST dite d’Arlon-Longwy, créée en 2008, permet aux patients de la zone frontalière de recevoir des soins au sein des deux établissements hospitaliers sans démarche préalable. Lorsque l’établissement français a connu des difficultés financières et structurelles en raison de la désertification médicale du bassin de Longwy, l’établissement belge est venu renforcer l’équipe médicale française dans nombre de spécialités.
On peut également citer la création d’un groupement d’intérêt économique dit des « trois frontières », qui permet aux radiologues des établissements belges de bénéficier des infrastructures d’imagerie médicale de l’établissement français situé à proximité.
Notre inquiétude, dans un contexte de rationalisation et de régionalisation plus poussées, est donc plutôt aujourd’hui que la mise en œuvre de ces accords ne soit pas en phase avec des problématiques très locales.
La construction d’une offre transfrontalière de soins paraît, dans le principe, un objectif louable, si cela permet aux frontaliers d’avoir accès à des soins à dix kilomètres de chez eux de l’autre côté de la frontière plutôt qu’à soixante-dix kilomètres dans leur propre pays.
Ce qui peut poser une difficulté, c’est ce que l’on met derrière l’objectif d’éviter toute concurrence entre les établissements de soins ou entre professionnels de santé, ou l’organisation de diagnostics qui permettrait à chaque État d’optimiser l’utilisation de ses infrastructures, de ses équipements et de son personnel médical et paramédical. En effet, ces diagnostics pourraient entraîner la disparition de certains établissements de soins. Cette inquiétude n’est pas sans lien avec les débats qui ont eu lieu dans le cadre de l’examen du projet de loi Santé. Les hôpitaux seront organisés en trois grades, selon les offres qu’ils pourront proposer. Dans le cas des régions transfrontalières, la labellisation interviendra-t-elle avant ou après la définition de l’offre de soins transfrontalière ? Est-ce en fonction de cette offre que certains hôpitaux en France seront classés de grade 3 ou de grade 1 ? Un hôpital français pourra-t-il perdre un grade parce qu’un hôpital situé de l’autre côté de la frontière sera considéré comme de grade 3 et ne pourra fournir qu’une offre de soins limitée ? Quelle garantie sera donnée en matière de continuité des soins et de prise en charge des urgences vitales ? Comment cette démarche vient-elle s’insérer, alors que nos territoires se vident de leurs médecins ?
En réalité, je crains que l’optimisation des infrastructures ne conduise inévitablement à la disparition de certaines d’entre elles. Elle ne doit pas non plus conduire à ce que les territoires se vident de leurs personnels les plus compétents, qui pourraient être attirés, notamment, par des salaires beaucoup plus élevés de l’autre côté de la frontière.
Les commissions mixtes chargées du suivi de la mise en œuvre de ces deux accords, tout comme les agences régionales de santé, devront être particulièrement vigilantes sur ce point, d’autant que, nous le savons tous, comme dans le cas de tous les services publics et régaliens, c’est la dynamique d’un territoire qui peut être touchée par une réorganisation des offres de soins. Il faudra également s’interroger sur les bons niveaux de décision.
Je souhaiterais enfin revenir sur la problématique de l’affiliation au régime de sécurité sociale dans le cas de l’accord passé avec la Suisse, pays non membre de l’Union européenne qui ne peut souscrire aux règles européennes sur les prestations de santé transfrontalières. Cette question mérite une clarification rapide, notamment dans le cadre d’un accord qui valorise la notion de résident. Il faut savoir que 270 000 travailleurs frontaliers pourraient être concernés.
Le principe de primauté de l’affiliation dans le pays d’emploi, finalement fixé par la Cour de cassation le 15 mars 2018, pourrait causer en réalité d’autres difficultés si les travailleurs français cotisent au régime suisse, mais se font soigner en France. Cet arrêt risque-t-il de contraindre le cadre de négociation ? Si ce principe prévaut, je pense que la mise en œuvre de l’accord franco-suisse risque de connaître quelques difficultés. Le développement d’une coopération qui devra concilier des systèmes, une répartition des compétences et des coûts en matière de santé très différents pourrait même être freiné.
Nous devrons ainsi être particulièrement vigilants lors de la mise en œuvre de ces accords de coopération. Il serait souhaitable que des rapports d’étape puissent être transmis aux commissions compétentes des deux assemblées afin de suivre au plus près la conclusion des conventions locales et les difficultés qui pourraient être rencontrées.
Quoi qu’il en soit, le groupe socialiste et républicain est favorable au renforcement de la coopération transfrontalière, indispensable au développement de nos territoires, et votera en faveur de l’approbation de ces accords-cadres.
Applaudissements sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me réjouis de la tenue de ce débat, qui nous permet d’aborder la question de la coopération transfrontalière dans le domaine de la santé.
Voilà deux semaines à peine, nous débattions ici de la question des inégalités territoriales d’accès aux soins, et bon nombre d’entre nous se sont alors inquiétés de l’état d’urgence sanitaire et social que connaissent nos territoires. Ces difficultés concernent notamment nos compatriotes qui vivent dans une zone frontalière française et travaillent dans un pays limitrophe. La coopération transfrontalière dans le domaine de la santé est, pour cette raison, une impérieuse nécessité. Elle répond à une attente forte de nos concitoyens et de l’ensemble des acteurs concernés.
Les deux accords-cadres que nous examinons ce matin – l’un avec la Confédération suisse, l’autre avec le Grand-Duché de Luxembourg – viennent compléter ceux qui ont été passés avec l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne voilà plusieurs années déjà. Ils devraient renforcer la continuité et la complémentarité de l’offre de soins entre pays et permettre ainsi d’assurer un meilleur accès aux soins des populations vivant dans les bassins de vie frontaliers : 175 000 Français traversent quotidiennement la frontière pour aller travailler en Suisse et 100 000 se rendent chaque jour au Luxembourg.
Pour autant, l’accord-cadre ne fait pas la coopération transfrontalière ; celle-ci se tisse sur le terrain avec les élus et les acteurs locaux et elle relève d’une volonté politique forte. Ainsi, les accords avec l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique ont permis de développer des coopérations qui avaient souvent pour origine des initiatives locales prises entre hôpitaux.
C’est pourquoi la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a décidé, il y a plus d’un an, de retarder l’examen de ce projet de loi portant approbation des deux accords-cadres pour constituer un groupe de travail sur la coopération sanitaire transfrontalière avec la Suisse et le Luxembourg. Son rapport a mis en évidence le faible développement de celle-ci, en raison, notamment, de différences importantes de niveaux de vie, de salaires, mais aussi de coûts de santé entre ces deux pays et la France. Les écarts de rémunération incitent fortement les professionnels de santé français à aller exercer de l’autre côté de la frontière. Notre collègue Véronique Guillotin, particulièrement sensibilisée à ce problème en tant que médecin, rappelait par exemple qu’une infirmière en début de carrière touche environ 1 700 euros par mois en France, contre 3 200 euros au Luxembourg.
Le groupe de travail a par ailleurs élaboré plusieurs recommandations en vue d’assurer un développement réel des coopérations locales. J’en citerai quelques-unes : chaque agence régionale de santé frontalière devra intégrer un volet transfrontalier à son projet régional de santé et désigner un cadre de haut niveau référent pour les coopérations transfrontalières ; afin d’améliorer l’information des assurés, des patients et des professionnels, les élus devront être associés aux commissions mixtes de suivi instituées par les deux accords-cadres.
Le groupe de travail a également dégagé les thématiques prioritaires dont devront traiter les conventions locales de coopération pour assurer la qualité et la continuité des soins aux patients et répondre aux besoins exprimés dans les bassins de vie.
Monsieur le secrétaire d’État, ces accords-cadres doivent nous permettre de dépasser les barrières géographiques, comme nous avons su le faire avec l’Allemagne, l’Espagne ou encore la Belgique, pays avec lesquels la coopération sanitaire est particulièrement fructueuse.
S’agissant tout particulièrement de la Belgique, je pense à la création des zones organisées d’accès aux soins transfrontaliers, qui permettent à la population frontalière de se rendre sans autorisation médicale préalable dans un établissement hospitalier situé de l’autre côté de la frontière et d’y recevoir des soins hospitaliers ou ambulatoires. Il s’agit essentiellement d’améliorer l’accès aux soins des personnes éloignées des hôpitaux de leur pays de résidence.
Comme l’a rappelé Mme la secrétaire d’État aux affaires européennes devant les députés, ces accords-cadres « sont à l’image du projet européen, qui vise à construire une communauté de vie collective et apaisée autour de projets concrets ». Parce que l’un des principaux objectifs de l’Union européenne est de promouvoir le développement harmonieux de l’ensemble de son territoire, le groupe du RDSE apportera son soutien à ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et sur des travées du groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c’est à la demande du groupe Union Centriste qu’une discussion générale digne de ce nom a lieu dans l’hémicycle ce matin sur le projet de loi autorisant l’approbation des accords-cadres sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française, d’une part, et le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Je remercie le président Hervé Marseille d’avoir entendu le besoin des sénateurs frontaliers de s’exprimer. J’associe à mes propos nos collègues Sylvie Vermeillet, du Jura, Jean-François Longeot, du Doubs, Jean-Marie Bockel et Claude Kern, d’Alsace, Jean-Marie Mizzon, de la Moselle.
Je veux tout d’abord me réjouir que l’approbation de ces accords-cadres, signés en 2016, au terme de négociations menées depuis 2014, puisse connaître une nouvelle étape devant le Parlement. Il s’agit d’une préoccupation majeure pour nos concitoyens, comme pour les élus de nos territoires, à laquelle il est urgent de répondre.
Ce texte jette les bases d’une nouvelle échelle de coopération. Bien que de portée générale, il constitue un signal politique fort qui, je le souhaite, permettra ensuite, grâce à des volontés politiques locales, de dépasser tous les obstacles et toutes les réticences administratives, de part et d’autre de nos frontières.
Nos concitoyens doivent pouvoir accéder plus facilement et plus rapidement à des soins de qualité au plus près de leur lieu de résidence, qu’il s’agisse de secours d’urgence, de soins programmés ou du traitement de pathologies chroniques. La logique des bassins de vie doit primer. C’est une réalité qui ne se traduit pas encore assez dans les faits en matière de santé.
Vous comprendrez que, sénateur de la Haute-Savoie, élu d’un territoire frontalier, je centre mes propos sur ce territoire.
Il faut savoir que 175 000 Français traversent chaque jour la frontière pour se rendre à leur travail en Suisse, 74 % d’entre eux étant domiciliés en Haute-Savoie.
Nos territoires doivent donc pouvoir relever ce défi de la coopération transfrontalière, pour juguler le risque sanitaire lié aux carences de l’offre de soins.
En effet, la Haute-Savoie doit faire face à de grandes difficultés en la matière. La première est d’ordre démographique, puisque nous connaissons une pénurie massive de professionnels de la santé, nos voisins suisses leur offrant des conditions de travail beaucoup plus avantageuses. Ainsi, 817 médecins français travaillent en Suisse – ce nombre a doublé entre 2008 et 2014 –, et comment ne pas évoquer la situation des autres professionnels de santé, à commencer par les infirmières et infirmiers ?
Le coût de la vie dans nos régions frontalières amplifie largement cette situation qui, en contribuant à un turnover important du personnel, rend complexe la gestion des établissements de santé. Sans prise en compte de la cherté de la vie dans la rémunération du côté français, nous n’apporterons pas de réponse véritablement adéquate et pérenne à cette problématique.
À cela s’ajoute le coût exorbitant des actes de soins pratiqués en Suisse, qui ne facilite pas l’accès de nos concitoyens à leur offre de soins et à un remboursement de la caisse française. Je ne peux passer sous silence ici les nombreux actes médicaux pratiqués en France pour le compte de citoyens suisses qui viennent profiter à la fois de la qualité de notre système de santé et des prix qui y sont pratiqués.
C’est dire l’intérêt pour nous de renforcer la coopération sanitaire entre les deux pays. Développer des synergies dans la médecine de pointe et la recherche pour améliorer les pratiques médicales ; faciliter l’échange d’informations sur les risques sanitaires ; élaborer des réponses aux problèmes d’une démographie médicale et paramédicale insatisfaisante ; favoriser l’échange de bonnes pratiques ; réduire les coûts sociaux en diminuant les distances à parcourir, les déplacements, les interruptions de travail, les durées de séjour hospitalier ; réaliser et mutualiser des diagnostics sur des besoins du territoire pour optimiser les infrastructures médicales et paramédicales des deux versants frontaliers : ce sont là autant d’atouts à déployer.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite que le Gouvernement veille maintenant à la mise en œuvre rapide de coopérations locales, en adaptant au besoin l’organisation hospitalière sanitaire française aux exigences nouvelles de la coopération entre la France et la Suisse. Comment, par exemple, développer vraiment les partenariats entre les hôpitaux universitaires de Genève et l’ensemble des hôpitaux des deux groupements hospitaliers de territoire de la Haute-Savoie, ainsi d’ailleurs que la coopération entre ces deux GHT ?
Nous avons maintenant la possibilité de faire de nos frontières un outil de solidarité, une ressource pour renforcer les potentialités des territoires et leur attractivité de part et d’autre. C’est au niveau local de viser la complémentarité et non la concurrence, en associant l’ensemble des acteurs. Le travail qui reste à accomplir est immense.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les zones frontalières sont des zones d’échanges privilégiées. Vivre près d’une frontière, c’est vivre près de personnes d’une autre nationalité dont on se sent proche non seulement physiquement, mais souvent aussi culturellement.
Au quotidien, il est possible de finir par oublier cette frontière. Elle se rappelle cependant aux citoyens quand des questions administratives se posent, notamment lorsqu’il s’agit de se faire soigner.
Nous examinons ce matin le projet de loi autorisant l’approbation de deux accords-cadres sur la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Suisse, d’une part, et entre la France et le Luxembourg, d’autre part. Cette coopération concerne près de 270 000 Français.
Ces accords visent à permettre aux citoyens vivant près d’une frontière d’être soignés de part et d’autre de celle-ci. Les parlements suisse et luxembourgeois ont chacun adopté l’accord-cadre qui les concerne, les 15 décembre 2017 et 28 juin 2018. Il revient aujourd’hui au Sénat de se prononcer sur le projet de loi d’approbation, après que l’Assemblée nationale l’a adopté à l’unanimité le mois dernier.
De tels accords sont fréquents. La France en a ainsi déjà conclu avec d’autres de ses voisins, dont la Belgique, l’Allemagne ou l’Espagne. Ils traitent de la mobilité des professionnels de santé et des patients dans les régions frontalières. Ils abordent aussi la question de la responsabilité médicale et ont vocation à s’appliquer aussi bien aux soins d’urgence qu’aux soins programmés.
Le cadre juridique de cette coopération permettra à nos citoyens et à ceux des deux pays voisins de bénéficier d’une mutualisation des savoir-faire, des moyens matériels et humains.
Le groupe Les Indépendants considère que ces accords constituent une avancée concrète et directe pour nos concitoyens frontaliers, mais ils ne suffiront pas. Ils établissent un cadre qui devra bien sûr être complété par des conventions locales.
Tous les territoires n’ont pas les mêmes ressources ni les mêmes besoins. Nous devons nous appuyer sur l’échelon local et lui faire confiance pour compléter ces accords et les adapter aux particularités du terrain.
Il faudra également porter une attention particulière à la bonne application de cette coopération. Nous devons veiller à ce qu’une concurrence entre les services de santé ne vienne pas parasiter ces avancées. Ainsi, il sera nécessaire de vérifier qu’un État ne cherche pas à faire assurer par son voisin les soins de ses citoyens résidant en zone frontalière. Équité et équilibre doivent être les maîtres mots pour l’application de ces accords.
La création de commissions mixtes chargées de suivre l’application des accords nous apparaît à cet égard utile. Nous pensons toutefois que la représentation des usagers, des professionnels et des élus au sein de ces commissions améliorerait sensiblement leur efficacité.
Lors des dernières élections européennes, les populistes ont rappelé leur souhait de rétablir des frontières sur le continent. Quel meilleur exemple que la coopération sanitaire pour convaincre de l’intérêt d’avoir des frontières ouvertes au sein de l’Union ?
Le groupe Les Indépendants soutient ce projet de loi. Nous croyons à la coopération et à l’ouverture. Nous savons bien que ces accords-cadres ne règlent pas toutes les difficultés pratiques relatives à cette coopération. Nous sommes toutefois convaincus qu’ils constituent un progrès pour les habitants des zones frontalières, ainsi que le gage d’une meilleure gestion des moyens sanitaires. C’est pourquoi notre groupe votera ce texte à l’unanimité.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons ce matin le projet de loi autorisant l’approbation de deux accords-cadres sur la coopération sanitaire transfrontalière, l’un avec la Confédération suisse, l’autre avec le Grand-Duché de Luxembourg.
Nos trois nations ont une longue tradition de coopération transfrontalière. Depuis des décennies, elles œuvrent pour que les démarcations du Grand Est ne soient pas seulement la marque d’une frontière entre des territoires francophones ; elles coopèrent pour faire en sorte que ce « carrefour de civilisations entre deux cultures latine et germanique », comme le disait si bien Fernand Braudel, devienne le trait d’union entre plusieurs bassins de vie, une zone d’interface et d’échanges.
Permettez-moi, tout d’abord, de rappeler l’esprit et le contenu de ces accords-cadres, qui reprennent les dispositions d’accords antérieurs signés par la France avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, Andorre et Monaco, portant sur deux objectifs essentiels.
Le premier objectif concerne les professionnels de santé : il s’agit de leur permettre d’exercer de part et d’autre de nos frontières.
Le second a trait aux patients : il s’agit de leur garantir d’être pris en charge, quel que soit le lieu de soins.
Les accords-cadres dont il est question aujourd’hui renvoient à des conventions locales le soin de définir les modalités et la mise en œuvre d’actions de coopération sanitaire permettant un accès transfrontalier aux soins pour la population.
Sur ce point, le groupe de travail de l’Assemblée nationale a émis de précieuses recommandations, toutes dictées par la volonté d’appliquer le plus efficacement possible l’accord-cadre avec la Suisse.
Depuis trop longtemps, des faits divers mettent en évidence la méconnaissance réciproque des organisations de soins existant de part et d’autre des frontières. Des difficultés administratives persistent, en dépit de l’intégration de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
D’autres objectifs sont aussi visés au travers de la conclusion de telles conventions, par exemple la mise en place d’un cadre légal en matière de secours d’urgence.
L’amélioration de l’accès aux soins et la garantie de leur continuité pour les populations des zones frontalières seront également acquises, de même qu’un recours facilité aux services mobiles d’urgence, une simplification des procédures administratives et financières, une optimisation de l’offre de soins, avec un partage facilité des moyens humains et matériels, ou la mutualisation des connaissances et des pratiques.
Au-delà des soins ambulatoires, ces accords permettront aux patients des zones concernées de recevoir des soins programmés sans avoir recours à une autorisation préalable dès lors qu’ils rentreront dans le champ d’une convention locale de coopération sanitaire. Il s’agira ainsi de garantir leur prise en charge financière par l’assurance maladie.
De même, ces accords-cadres simplifient le circuit de validation des conventions locales de coopération en autorisant les acteurs de terrain responsables de leur signature, sous la responsabilité des ARS du Grand-Est, de Bourgogne-Franche-Comté et d’Auvergne-Rhône-Alpes, à les conclure et à les mettre en œuvre sans autorisation ministérielle préalable.
En plus des CHU de Lyon et de Metz, qui pourraient entreprendre des coopérations spécifiques en fonction de leurs spécialités, une dizaine d’hôpitaux se sont dits intéressés. Ces optimisations réduiront les dépenses de santé, tandis que la prise en charge au plus près du domicile permettra de limiter les déplacements des patients.
In fine, le vote de ce texte apportera des réponses à un certain nombre d’interrogations des professionnels de santé actuellement pendantes.
Il faut savoir que, respectivement, 175 000 et 100 000 de nos compatriotes se rendent quotidiennement, pour y travailler, en Suisse et au Luxembourg. Avec leurs familles, leurs proches et tous ceux qui vivent à proximité des frontières, même s’ils ne les traversent pas chaque jour, cela fait plus de 14 millions de personnes. La coopération transfrontalière est, pour cette raison, une nécessité. De même que nous avons supprimé les postes-frontière, il nous faut maintenant réduire les frontières bureaucratiques qui compliquent la vie quotidienne dans les zones frontalières. C’est pourquoi nous voterons en faveur de l’adoption de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je me réjouis de l’examen de ce projet de loi autorisant l’approbation de deux accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière. La France a déjà conclu des accords de ce type avec d’autres pays, tels que l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique.
À l’ère de l’ultramobilité et de la dématérialisation des frontières, ces accords permettent des coopérations sanitaires transfrontalières aussi nécessaires qu’attendues, tant par les citoyens français que par les élus.
Je rappelle que, en 2018, l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale avait été repoussé au motif de mettre en place un groupe de travail au sein de la commission des affaires étrangères. Le sujet est important, mais il n’est pas nouveau. Il a donné lieu à des mobilisations sérieuses eu égard à des situations juridiques très complexes pour les ressortissants français.
Ce sont pas moins de 270 000 résidents français qui sont concernés par ces accords. Parmi eux, 93 000 Hauts-Savoyards franchissent la frontière chaque jour. Vous comprendrez ma pleine et entière implication sur ce sujet en tant que sénatrice de la Haute-Savoie.
Nonobstant le caractère international de ce texte, la prise en compte de la dimension territoriale de la problématique est indispensable. Je tiens à saluer le travail réalisé par notre collègue rapporteur René Danesi, issu lui aussi d’un territoire frontalier. Il a parfaitement abordé les enjeux et l’ancrage territorial de la coopération sanitaire transfrontalière. Le Sénat assume pleinement son rôle de défenseur des territoires, et je m’en félicite.
Cependant, ce matin, il ne s’agit pas de nous livrer à une analyse comparée des systèmes de santé et des moyens alloués par la France et ses voisins. Nous savons les différences de conditions d’exercice de la médecine de part et d’autre des frontières ; nous savons les problèmes d’attractivité et de fidélisation des personnes soignants liés à la cherté de la vie dans nos territoires ; nous savons qu’une offre de soins adaptée doit être développée. Nous n’avons pas manqué d’aborder ces sujets récemment, lors de l’examen du projet de loi Santé.
Par ailleurs, nous n’ignorons pas la réalité de la situation en Haute-Savoie. Je sais combien la démographie médicale représente un défi quotidien et une source de préoccupation majeure pour nos concitoyens.
La Haute-Savoie ne fait, hélas, pas exception en matière de pénurie de médecins généralistes et de personnels soignants. Aux contraintes montagnardes s’ajoutent les besoins inhérents au fort dynamisme touristique de ce département. La Haute-Savoie, ce sont en effet 650 000 lits touristiques et deux saisons pendant lesquelles il faut assurer la gestion, l’acheminement, l’accueil et les soins de malades et d’accidentés supplémentaires.
Je profite de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à tous les professionnels engagés dans notre département : personnels soignants, sauveteurs, sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers. Leur professionnalisme fait notre fierté !
Affichant le taux de croissance démographique le plus élevé de France – c’est une chance autant qu’un défi permanent –, la Haute-Savoie doit répondre aux besoins sanitaires de la population locale, qui gagne chaque année plus de 11 000 habitants, tout en étant capable de gérer les pics d’affluence touristique, été comme hiver, qui nécessitent la mise en œuvre de moyens spécifiques, cela, ne l’oublions pas, dans un contexte budgétaire des plus contraint pour les collectivités territoriales.
Cette situation nous oblige à la plus grande vigilance, à la prévision et à l’anticipation, ici et avec nos collègues députés. Notre responsabilité est d’instaurer le cadre juridique d’une coopération sanitaire permettant tant l’accès aux soins de qualité que la garantie du respect des droits des patients.
Notre responsabilité, ce matin, est de permettre l’adoption d’un cadre législatif cohérent et juste, évitant les écueils susceptibles d’être sources de contentieux judiciaires pour nos compatriotes.
Monsieur le rapporteur, en commission, vous avez annoncé le très prochain règlement des litiges à la suite de l’arrêt du 15 mars 2018 de la Cour de cassation. Les frontaliers français travaillant en Suisse devraient obtenir la restitution des cotisations sociales versées indûment. Cela va dans le sens de l’apaisement.
C’est dans cet esprit que je salue la négociation et l’adoption d’accords-cadres qui constitueront une réelle avancée et permettront une simplification des démarches.
Concrètement, l’accord-cadre avec la Suisse réglera la question du franchissement de la frontière, en vue de la facilitation de la circulation des services de secours. Tant pour les urgences que pour les soins programmés, c’est une excellente chose.
Sur le plan administratif, l’accord-cadre définit la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie comme le seul référent pour les caisses de sécurité sociale suisses. Cet effort de rationalisation est notable, mais il faudra que des moyens d’information suffisants soient déployés pour que les spécificités relatives au droit local puissent être prises en compte.
Cet effort devra également s’accompagner d’une mobilisation et d’une intégration, à terme, des acteurs régionaux.
Enfin, cet accord-cadre a pour objectif ambitieux la mutualisation des savoir-faire, des moyens matériels et humains au bénéfice des patients.
Certes, des efforts resteront à accomplir, et je salue la mise en place de commissions mixtes de suivi prévue par cet accord. Je tiens d’ailleurs à préciser que je partage l’avis du rapporteur : ces commissions ne pourront rester composées uniquement de représentants d’autorités sanitaires. Elles devront être élargies à des acteurs locaux et à des professionnels directement intéressés par cette coopération transfrontalière particulière, dont la réussite reposera sur la proximité et le pragmatisme – deux impératifs pour répondre aux besoins de nos concitoyens.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Proximité et pragmatisme sont effectivement les mots d’ordre. Les différents orateurs ont évoqué, entre autres problématiques, l’attractivité, la double affiliation, la pénurie. Les zones frontalières n’échappent naturellement pas à un certain nombre de difficultés touchant nos territoires ruraux, périurbains ou même urbains et dont vous avez débattu il y a quelques semaines, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé.
J’aurais souhaité pouvoir vous apporter des réponses très précises et complètes. Hélas, je ne le peux pas, parce que les directions concernées du ministère des solidarités et de la santé n’ont pas daigné venir ici ce matin. Je tenais à le dire publiquement pour que les choses soient bien claires : lorsque le Sénat délibère d’un projet de loi qui concerne la santé, il est de bon aloi que le ministère des solidarités et de la santé soit représenté !

Je vous incite ardemment, monsieur le rapporteur, à assurer le suivi de la mise en œuvre de la loi pour que le Parlement puisse vérifier qu’elle se déroule conformément aux attentes de nos concitoyens.

Je ne verrais que des avantages à ce que vous convoquiez les personnes concernées afin qu’elles vous rendent des comptes. Cela me paraît de bonne politique.
Quoi qu’il en soit, j’ai entendu, à travers vos interventions, la voix du terrain. Sachez que je relaierai vos préoccupations auprès d’Agnès Buzyn. Je vous remercie de l’approbation unanime de ce texte qui semble se dessiner. Nous partageons une même ambition : que sa mise en œuvre soit exemplaire.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

La discussion générale est close.
Nous passons à l’examen du texte de la commission.
Accords avec la suisse et le luxembourg
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le gouvernement de la république française et le conseil fédéral suisse et de l'accord-cadre entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du grand-duché de luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière
Est autorisée l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, signé à Paris le 27 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
L ’ article 1 er est adopté.
Est autorisée l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Luxembourg le 21 novembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi. –

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière.
Le projet de loi est adopté définitivement.

L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (proposition n° 518, texte de la commission n° 562, rapport n° 561) et des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 432, rapport n° 431).
La conférence des présidents a décidé que ces textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi, tout d’abord, de vous transmettre les excuses de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui n’a pu être présente ce matin, car retenue aux côtés du Premier ministre à la réunion du comité interministériel de la transformation publique.
La Haute Assemblée a adopté en première lecture, en novembre dernier, la proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires, déposée par le groupe du RDSE, dont je salue le président. Nous en débattons aujourd’hui en nouvelle lecture, après l’échec de la commission mixte paritaire réunie le 3 avril dernier.
Le Gouvernement a constaté que, en dépit d’efforts de diplomatie et de dialogue, aucun compromis n’avait pu être trouvé entre les membres de la commission mixte paritaire. C’est dommage, mais c’est ainsi !
Je ne rappellerai pas la genèse du projet de création d’une Agence de la cohésion des territoires, annoncé par le Président de la République en juillet 2017. Je ne referai ni la description de son fonctionnement ni la présentation des bénéfices pour les territoires que nous en attendons tous. Ces sujets ont été abondamment débattus.
La création de l’ANCT marque tout d’abord un changement de méthode au travers de la mise en place d’un outil de coordination des opérateurs de l’État qui constitue, par l’intermédiaire des préfets de département, un guichet unique vers lequel les élus pourront se tourner pour obtenir une aide et un soutien à leurs projets. C’est aussi un changement de méthode en ce qu’elle permet de sortir d’une logique verticale, celle d’un État « prescripteur » qui aménage le territoire sur la base d’appels à projets, pour lui substituer une logique ascendante, celle d’une action de l’État et de ses opérateurs à partir des besoins et projets exprimés et portés par les élus d’un territoire. L’État se met ainsi au service des territoires.
L’ANCT sera également un outil au service de toutes les collectivités, pour tous les territoires, qu’ils soient de métropole ou d’outre-mer, qu’il s’agisse de communes, d’intercommunalités, de départements, de métropoles, de régions ou même de territoires dont les périmètres ne sont pas ceux délimités par les « frontières administratives ».
En l’espèce, nous souhaitons que l’intervention de l’ANCT ne se limite pas aux territoires institutionnels, mais qu’elle profite aux territoires qui portent des projets – je pense aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les PETR, aux pays. Cela n’est pas incompatible avec le fait que l’ANCT déploiera prioritairement son action dans les territoires les plus fragiles, là où les moyens manquent le plus pour réaliser des projets et où les besoins en ingénierie, en copilotage, en soutien financier sont les plus forts.
Enfin, l’ANCT apportera une aide sur mesure, en partant des volontés et des besoins locaux. En coordonnant les services et les opérateurs de l’État, l’agence pourra mobiliser et, surtout, fédérer leurs ressources techniques et financières.
Cet appui sera complémentaire de celui que les collectivités territoriales ou le secteur privé peuvent eux-mêmes en apporter. L’ANCT interviendra en complémentarité, et non en concurrence avec les ressources dont disposent les collectivités territoriales et leurs agences locales.
De cette manière, l’intervention de l’agence ne sera pas uniforme : là où il n’y a pas de besoins, là où les élus locaux ne souhaitent pas qu’elle intervienne, elle n’interviendra pas ; là où il y a des besoins, là où les élus le souhaitent, elle apportera un soutien en complément de leurs éventuelles ressources.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte d’initiative sénatoriale a fait l’objet d’une véritable coproduction législative entre les assemblées parlementaires. De nombreux amendements, déposés par plusieurs groupes et adoptés au Sénat et à l’Assemblée nationale, ont apporté des enrichissements en ce qui concerne tant les domaines d’intervention de l’Agence, ses priorités, son mode de fonctionnement que sa gouvernance.
En la matière, j’insiste pour que cet outil soit le plus souple et le plus adaptable possible. Nous y avons tous intérêt si nous souhaitons le succès de la nouvelle agence.
Cela explique pourquoi le Gouvernement s’est montré particulièrement soucieux que les règles de fonctionnement et de composition des comités locaux de cohésion territoriale, dont la Haute Assemblée avait souhaité la création, ne soient pas fixées avec trop de rigidité.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales l’a affirmé à plusieurs reprises, et je tiens à le réaffirmer devant vous : la définition de la composition de ces comités sera déterminée au niveau local, en concertation entre préfets et élus locaux. Nous adresserons une circulaire en ce sens aux préfets, pour leur demander d’associer à ces comités, dès lors que leur présence est nécessaire, des acteurs tels que les agences de l’eau ou les comités de bassin. En la matière, le Gouvernement est attaché à ce que la loi laisse la souplesse nécessaire aux intelligences locales pour déterminer le bon format et le bon mode de fonctionnement de ces comités.
S’agissant toujours de la gouvernance, nous connaissons le désaccord entre, d’un côté, le Gouvernement et l’Assemblée nationale, et, de l’autre, la Haute Assemblée à propos des équilibres au sein du conseil d’administration.
En première lecture, vous aviez ainsi souhaité que les représentants des collectivités territoriales disposent de la moitié des sièges dans ce conseil. Je tiens à rappeler que le Gouvernement est tout à fait favorable à ce que les représentants des élus locaux disposent d’une large place au sein du conseil d’administration de cette agence. Cela n’est pas incompatible avec la conservation d’au moins la moitié des sièges pour les représentants de l’État. Au demeurant, un tel équilibre est totalement cohérent, au regard du fait que l’ANCT sera une agence de l’État, composée d’agents de l’État et dont le budget fonctionnera à partir des crédits de l’État. Le principe selon lequel « qui paye décide » doit tous nous guider.
Je tiens également à rappeler que, dans le cadre des discussions qui se sont tenues pour tenter de parvenir à une CMP conclusive, les députés ont fait des pas supplémentaires pour renforcer le poids des élus au sein du conseil d’administration :
Tout d’abord, ils ont fait passer le représentant de la Caisse des dépôts et consignations – la banque des territoires – du côté des représentants de l’État, ce qui a permis de donner un siège supplémentaire aux collectivités.
Ensuite, ils ont proposé de donner aux représentants des collectivités le pouvoir de demander une seconde délibération sur un point inscrit à l’ordre du jour du conseil qui ne leur conviendrait pas.
Toutefois, la Haute Assemblée demandait à ce que cette possibilité de demander une nouvelle délibération soit étendue à l’infini, sous la forme d’une nouvelle délibération permanente : dès lors qu’un point inscrit à l’ordre du jour ne recueillerait pas l’avis favorable d’une partie des représentants des élus locaux, ces derniers seraient fondés à demander, autant de fois qu’ils le souhaiteraient, une nouvelle délibération. Instituer ainsi un pouvoir de blocage permanent ne nous paraissait pas acceptable, car cela aurait, dans les faits, permis à une minorité d’entraver le fonctionnement normal de l’agence.
Cela étant, nous voulons être très clairs sur le point suivant : nous n’imaginons pas un seul instant que l’État, dans le cadre du fonctionnement d’une agence au service des territoires entièrement tournée vers le soutien aux projets locaux, ne recherche pas le consensus le plus large sur les questions débattues au sein du conseil. Nous imaginons encore moins que l’État passe en force sur une question qui ferait l’objet d’un large rejet de la part des représentants des collectivités territoriales.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, attaché au dialogue et à la construction de solutions consensuelles, a soutenu l’introduction par les députés du mécanisme de la seconde délibération, dès lors que celui-ci ne saurait être détourné pour en faire un moyen de blocage. Le Gouvernement présentera donc un amendement visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale sur ce point.
C’est sous le bénéfice de ces observations que le Gouvernement vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter la proposition de loi qui vous est soumise en nouvelle lecture, afin que le processus législatif entamé en octobre dernier puisse maintenant aller à son terme dans les meilleurs délais. Le Gouvernement pourra alors passer aux travaux pratiques et mettre très rapidement l’agence en œuvre, au service des territoires et de leurs projets.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis ce matin en nouvelle lecture, après l’échec de la CMP réunie le 3 avril dernier, de la proposition de loi portant création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, déposée au Sénat en octobre 2018 par le président Jean-Claude Requier et les membres du RDSE.
Nous examinons également les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique déposée conjointement par le président Hervé Maurey et le président Requier pour prévoir l’audition du futur directeur général de l’agence par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, en application de l’article 13 de la Constitution, ce texte ayant fait l’objet d’un accord.
Avant de vous présenter la position de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable pour cette nouvelle lecture, je souhaiterais revenir sur les principales étapes de la navette parlementaire.
En première lecture au Sénat, nous avions considéré que si la création de l’ANCT n’était pas une solution miracle au manque de dynamisme que connaissent certains territoires, elle constituait un premier pas pour replacer l’objectif d’un aménagement durable et innovant du territoire au cœur des politiques de cohésion.
En dépit de réserves tant sur la forme et la méthode employée que sur le fond, tenant notamment à des inquiétudes quant aux ressources et à la gouvernance de l’agence, le Sénat avait adopté un texte enrichi sur l’initiative de notre commission selon trois axes : en premier lieu, le renforcement du rôle des élus locaux et nationaux dans la gouvernance de l’agence ; en deuxième lieu, l’amélioration du fonctionnement et de la transparence de l’agence ; enfin, une meilleure prise en compte des territoires les plus fragiles.
Ces trois axes correspondaient d’ailleurs aux orientations retenues par le Sénat lors du vote, le 13 juin 2018, de la proposition de loi de nos collègues Bruno Retailleau, Philippe Bas et Mathieu Darnaud relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, qui comportait un volet dédié à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Concernant la gouvernance, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait instauré, à l’article 3, la parité au sein du conseil d’administration de l’agence entre les représentants de l’État, d’une part, et les représentants des élus locaux et nationaux, d’autre part, position que le Sénat avait confirmée en séance par l’adoption d’un amendement de précision du président Hervé Marseille.
Notre commission avait en outre institué, à l’article 5, un comité local de la cohésion territoriale afin de renforcer l’information et l’association des élus locaux aux actions de l’agence dans les territoires.
Elle avait également prévu, à l’article 7, que les conventions pluriannuelles conclues par l’agence avec d’autres établissements publics de l’État soient transmises pour information au Parlement.
Enfin, des précisions avaient été introduites, à l’article 2, sur les missions de l’agence pour cibler les territoires les plus fragiles, et le Sénat avait rappelé que la vocation urbaine de l’agence ne devrait pas l’emporter sur sa vocation rurale.
L’Assemblée nationale a conforté l’essentiel de ces apports sénatoriaux en première lecture et a apporté des modifications opportunes au texte du Sénat, que ce soit sur la prise en compte des zones rurales mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur l’appui aux porteurs de projets locaux dans leurs demandes de subventions au titre des fonds européens.
Concernant les modalités d’intervention de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, l’Assemblée nationale a introduit plusieurs dispositifs, comme le contrat de cohésion territoriale, à l’article 2, qui aura vocation à regrouper divers instruments contractuels liant l’État et les collectivités, dans un souci de simplification, ou la création, à l’article 8 ter, d’une réserve thématique, qui permettra aux personnes volontaires de s’investir dans des projets soutenus par l’agence.
Malgré ces éléments relativement consensuels, une divergence fondamentale persiste entre nos deux assemblées concernant la gouvernance de l’agence et, plus particulièrement, à l’article 3 du texte, sur les pouvoirs des élus locaux au sein de son conseil d’administration.
En première lecture, l’Assemblée nationale était revenue sur la proposition sénatoriale de parité entre les élus et l’État au conseil d’administration, en rétablissant la majorité pour l’État. Au regard de l’objet de l’agence et des exemples d’établissements comparables, cela n’était pas acceptable pour le Sénat. J’ai donc fait des propositions en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord.
Dans une démarche de compromis, j’ai proposé d’accepter la représentation majoritaire de l’État, à condition que les élus locaux disposent d’un droit de veto si la moitié d’entre eux est en désaccord avec une décision du conseil d’administration. Il était proposé que, dans ce cas, une nouvelle délibération ait lieu, dans les mêmes conditions de vote. Nous avons ensuite proposé que, pour toute nouvelle délibération, un blocage soit possible uniquement si les trois quarts des élus locaux s’opposent à la décision. Cette proposition, pourtant pragmatique et constructive, n’a pas été acceptée. Malgré les tentatives de conciliation du Sénat pour aboutir à un texte commun, ce point de désaccord est apparu insurmontable aux députés et, si j’ai bien compris, au Gouvernement.
En nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, le texte n’a été que peu modifié, mais j’ai deux regrets.
Le premier concerne le rôle des agences régionales de santé, qui ne figurent plus ni au sein du comité d’action territoriale de l’agence ni au sein du comité local de la cohésion territoriale.
Le second concerne le fonctionnement du conseil d’administration de l’ANCT. L’Assemblée nationale a placé, comme nous l’avions fait, le représentant de la Caisse des dépôts et consignations dans le même collège que les représentants de l’État, afin que les représentants des collectivités locales disposent d’un siège supplémentaire dans le deuxième collège. Par ailleurs, elle a donné un pouvoir de veto à usage unique aux élus locaux si la moitié d’entre eux sont en désaccord avec une décision du conseil d’administration.
Cependant, ne soyons pas dupes : ce veto n’ouvre droit qu’à une seule et unique seconde délibération, sans offrir de réelle faculté de blocage aux élus, comme le Sénat le souhaitait ! Autrement dit, sous couvert d’une démarche de compromis, l’Assemblée nationale a adopté une disposition en trompe-l’œil, qui ne changera rien au droit de regard réel des collectivités territoriales sur la gouvernance de l’ANCT.
C’est la raison pour laquelle la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a souhaité, la semaine dernière, reprendre la position défendue en commission mixte paritaire, afin de prévoir une réelle prise en compte des élus locaux. Pour notre commission, il n’est pas possible d’aller plus loin sans renier la volonté du Sénat de faire de l’ANCT un établissement au service des territoires et des collectivités.
Voilà, mes chers collègues, les éléments dont je voulais vous faire part en préambule. Notre vigilance quant au droit de regard des collectivités sur la gouvernance de l’ANCT est primordiale, car il s’agit d’un impératif tant de cohésion que de cohérence.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – M. Joël Bigot applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici parvenus à l’ultime étape de l’examen de ce texte, qui aura connu, entre l’annonce initiale et sa traduction législative, un certain nombre de vicissitudes. Pourtant, si la création de l’Agence nationale de cohésion des territoires suscitait des interrogations, des craintes, elle éveillait aussi énormément d’attentes.
Heureusement, le Sénat, chambre des territoires, a su remplir son office en améliorant significativement la proposition de loi initiale.
Annoncée comme l’antidote aux maux des territoires en difficulté, la création de l’Agence nationale de cohésion des territoires ne représente, en l’état, que la fusion de trois opérateurs, adossée à d’autres, qui seront dedans sans y être. Pour les collectivités, la superposition des acteurs à solliciter persistera donc. On est bien loin des ambitions initialement affichées par le rapport de Serge Morvan !
Le fonctionnement « en silo » des opérateurs de l’État est toujours à l’ordre du jour. Au lieu du « couteau suisse » territorial très attendu par les élus locaux, cette proposition de loi accouche d’un mauvais ustensile qui, de surcroît, sera entièrement à la main de l’État. On pouvait espérer mieux pour les territoires et la décentralisation !
Au-delà des inquiétudes quant aux futurs moyens financiers de l’agence, sur lesquels s’exprimera mon collègue Jean-Michel Houllegatte, je souhaiterais, pour ma part, insister sur les problématiques liées à sa gouvernance et sur le refus obstiné et du Gouvernement et de la majorité à l’Assemblée de donner aux élus locaux un poids significatif dans son fonctionnement.
Hier, une tribune rédigée par une centaine de députés En Marche acclamait une nouvelle fois la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités locales…
L’Agence nationale de cohésion des territoires tient une place particulière dans le discours gouvernemental. Elle concentre beaucoup d’espoirs et est perçue comme le remède au sentiment d’abandon ressenti par bon nombre de nos élus locaux, notamment dans les territoires ruraux. C’est la raison pour laquelle nous avions, comme l’ensemble des groupes politiques de cette assemblée, soutenu le principe de la création d’une telle agence.
Il est vrai que l’ANCT aurait pu constituer ce guichet unique permettant de clarifier enfin le millefeuille d’agences étatiques, de faciliter les projets d’aménagement et d’apporter l’ingénierie nécessaire aux collectivités et à leurs groupements.
Au lieu de cela, l’ANCT se présente comme un nouvel outil préfectoral, dont la mise en œuvre aura pour conséquence de mettre sous tutelle les projets des collectivités. C’est bien la logique descendante et à sens unique qui prime dans ce texte !
On aurait pu aller plus loin, avec une gouvernance qui fasse la part belle aux collectivités. Il y a de réelles craintes d’une recentralisation autour de la personne du préfet, qui sera, conformément à l’article 5, le délégué territorial de l’agence. Tel que défini à l’article 3, le fonctionnement du conseil d’administration de l’agence, point d’achoppement de la commission mixte paritaire, confirme bien cette volonté de l’exécutif.
Au lieu de donner la main aux collectivités, le Gouvernement, par le biais de sa majorité, campe fermement sur ses positions et empêche les collectivités territoriales d’avoir le dernier mot. Les mécanismes de seconde délibération proposés aujourd’hui par le Gouvernement dissimulent mal son souhait de conserver la main en toute occasion.
L’absence de représentants des collectivités territoriales au sein du comité national de coordination de l’ANCT est éloquente de ce point de vue. Pourquoi avoir peur des élus locaux, monsieur le ministre, si cette agence leur est dédiée ? Nous représentons ici les territoires et nous vous le disons de manière quasiment unanime : acceptez un réel partenariat avec les élus ! N’ayez pas peur de l’intelligence territoriale, qui, couplée à l’ingénierie de la future ANCT, pourrait être un atout de développement majeur les prochaines années !
La formule du « qui paie décide », souvent avancée par le Gouvernement et par vous-même à l’instant, ne peut conduire à faire fi de la démocratie locale, d’autant que les collectivités porteuses de projets mettent bien sûr la main à la poche. À l’heure où les collectivités sont les fers de lance de la transition énergétique et écologique, créer une agence couperet pourrait avoir de fâcheuses conséquences.
Par ailleurs, êtes-vous bien sûr de ne pas créer ici un nouvel échelon administratif pour les collectivités ? Êtes-vous bien sûr de ne pas créer une nouvelle complexité pour nos élus, qui renforcerait les frustrations existantes ? Attention aux désillusions !
En outre, pourquoi ne pas accepter que les agences régionales de santé aient toute leur place dans l’organisation de l’ANCT ? Vous connaissez la problématique de la désertification médicale : à l’instar de la raréfaction des services publics en zones rurales, elle est au cœur du sentiment d’abandon de la population face au « déménagement du territoire ». Les ARS pourraient utilement être associées au dispositif de l’ANCT. Or, tout comme la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, vous persistez dans votre refus et dans votre vision technocratique de l’aménagement du territoire.
Ce texte n’est décidément à la hauteur ni des ambitions ni des attentes des acteurs locaux. Il risque d’engendrer de fortes déceptions. C’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons.
M. Alain Fouché applaudit .
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, à ce stade de la navette des deux propositions de loi que nous examinons aujourd’hui, dont le RDSE est à l’origine, je rappellerai tout l’intérêt du Sénat pour les sujets qui les sous-tendent.
Je tiens à vous remercier de nouveau, mes chers collègues, du soutien à la création de l’ANCT que vous avez manifesté, dès la première lecture, en novembre 2018, à une très grande majorité des voix.
La pierre d’achoppement qui nous vaut cette nouvelle lecture est l’article 3 de la proposition de loi ordinaire, portant sur la composition du conseil d’administration. Nous sommes arrivés à un compromis qui nous paraît acceptable.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a, de son côté, proposé que les représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations constituent au moins la moitié des membres du conseil d’administration. Placer le représentant de la CDC dans le même collège que les représentants de l’État permet d’octroyer un siège supplémentaire aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
En commission, le Sénat a validé la composition du conseil d’administration telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, mais en instaurant un pouvoir de blocage par trois quarts des représentants des élus, en cas de deuxième délibération.
Nous soutenons la solution de compromis retenue, qui nous paraît effectivement préserver le pouvoir de décision et les intérêts des représentants des élus.
Mes chers collègues, c’est d’ailleurs dans le même esprit que nous entendons, en tant qu’auteurs de cette proposition de loi, veiller comme à la prunelle de nos yeux à ce que l’esprit initial du texte soit bien préservé.

Nous sommes, en particulier, attentifs à ce que l’ANCT ne soit pas transformée, avant même sa naissance, en une usine à gaz, ce qui pourrait devenir un nouveau motif de désespoir pour nos petites communes. Nous sommes, à ce titre, tout aussi vigilants à ce que l’ANCT, en tant qu’établissement public, soit pleinement utile, accessible et efficace.
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai échangé avec l’Association des maires ruraux de France, pas plus tard que samedi dernier en l’occurrence, et j’ai pris part aux grands débats avec les élus qui se sont déroulés durant ce premier semestre. Croyez-moi, aucun élu ne m’a parlé de la composition du conseil d’administration de l’ANCT !
Les interrogations des élus sont en effet très pragmatiques : à quoi sert l’agence ? Comment fonctionnera-t-elle concrètement ? Comment la joindre ? Comment peut-elle nous aider à préparer nos dossiers de demande de subventions européennes, notamment au titre du programme Leader ? Il faudra, ministre le ministre, apporter une réponse à ces interrogations, si pratiques soient-elles.
Force est de constater que le dispositif l’article 2, qui récapitule les missions de l’ANCT, nous est revenu pour le moins dilué – c’est un euphémisme ! – de l’Assemblée nationale. On ne peut pas reprocher à nos collègues députés de s’être investis dans ce passionnant examen parlementaire, mais nous ne retrouvons pas ce qui fait le cœur même de l’ANCT. Si nous, auteurs de la proposition de loi, ne nous y retrouvons pas, comment nos élus pourraient-ils s’approprier le dispositif ?
Connaissant les enjeux, nous avons fait le choix de réaffirmer, par voie d’amendement, les missions principales et initiales de l’agence, en proposant une réécriture de l’article 2.
La raison d’être de l’ANCT est bien d’apporter une offre d’ingénierie aux collectivités locales les moins dotées en moyens humains et financiers. À ce titre, son rôle est d’accompagner concrètement les collectivités locales dans leurs projets et de veiller à la cohérence des réponses entre les services de l’État et les opérateurs saisis.
Nous avons demandé que l’ANCT puisse ainsi aider les collectivités locales à préparer leurs dossiers de demande de subventions européennes. En effet, dans l’esprit initial de notre proposition de loi, l’ANCT n’était pas une énième structure technocratique de conseil ou une interface de communication sur les politiques publiques d’aménagement du territoire ; elle participait bien d’une politique d’impulsion de cohésion des territoires. Ne nous y trompons pas, chers collègues : il s’agit bien là d’une demande viscérale des élus et des territoires que nous représentons. Nous avons la possibilité de faire simple, concret, accessible et utile. Ne nous en privons pas !
Monsieur le ministre, j’ai bien entendu M. le Premier ministre indiquer, dans sa déclaration de politique générale, que « beaucoup de territoires ruraux se battent, s’équipent en numérique, valorisent leurs atouts, mais s’estiment délaissés, décrochés, dans la rapide transformation du monde ». C’est vrai, et il fallait le rappeler.
J’ai également bien entendu M. le Premier ministre citer l’ANCT comme un outil de cohésion des territoires, aux côtés de la banque des territoires. Or un outil, par définition, doit être utile.
C’est d’autant plus nécessaire que, dans sa circulaire du 12 juin dernier relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État, le Premier ministre écrivait encore que « la création de l’ANCT viendra […] renforcer les compétences d’ingénierie territoriale au plus près des territoires ». Notre amendement visait justement à mettre en musique cette décision.
Monsieur le ministre, en tant qu’auteurs de la proposition de loi portant création de l’ANCT, nous vous demandons de veiller avec nous à la réussite de cette agence, guichet unique pour les collectivités locales.
Les maires des plus petites villes ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils savent que, dans des labyrinthes administratifs, peuvent se nicher la sous-consommation, le report de crédits, ainsi que la baisse de la dépense publique. Le prix en termes de démocratie en vaut-il la chandelle ? Je ne le crois pas.
Nous n’acceptons pas que la difficulté d’accéder aux aides légitimes de l’État soit dévoyée comme un moyen usuel de baisser ou de geler les dépenses publiques.
En effet, la définition de la trajectoire des dépenses publiques est le fait du Parlement. L’aménagement du territoire est décidé par le Parlement. Le regroupement de communes résulte de décisions démocratiques, et non de difficultés technocratiques.
C’est pourquoi nous demandons, très concrètement, que l’ANCT permette bien aux petites communes de parvenir, comme les autres, à consommer des crédits ou à disposer de moyens qui ont été votés par le Parlement et auxquels elles ont droit, au nom de l’équité territoriale.

C’est pourquoi nous demandons qu’un courrier récapitulant toutes les informations pratiques et mentionnant les moyens de joindre effectivement l’agence soit adressé à tous les maires. La pertinence de ces informations devra être testée au préalable.
C’est pourquoi nous suggérons que les sous-préfectures puissent accueillir des permanences de la nouvelle agence.
C’est pourquoi nous demandons que des expérimentations soient très rapidement menées dans des départements pour adapter ce guichet aux demandes.
C’est pourquoi nous proposons que le traditionnel rapport au Parlement, prévu dans la proposition de loi, s’élabore en temps réel et s’enrichisse en permanence des remarques des utilisateurs, les maires et leurs équipes. Nous proposons ainsi de donner un autre sens à l’application des lois, a priori, ici au Sénat, et que l’ANCT puisse en bénéficier. Nous sommes ouverts à cette évolution, pour autant que l’ANCT dispose des compétences et moyens requis.
Monsieur le ministre, la réussite de cette agence nous oblige tous, élus comme Gouvernement !
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici de nouveau réunis pour examiner les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires.
Alors que la première lecture a permis un travail constructif entre les deux assemblées, une question épineuse les a néanmoins divisées, rendant tout compromis impossible en commission mixte paritaire. Elle demeure en nouvelle lecture : la gouvernance prévue par l’Assemblée nationale pour ce qui a vocation à devenir une agence des territoires, au premier rang desquels les territoires les plus fragiles, ne nous convient pas ; elle ferait de cette énième institution une réponse inadéquate à un problème plus qu’actuel.
Mes chers collègues, où en sommes-nous ? De quoi s’agit-il ?
Si l’Agence nationale de la cohésion des territoires ne constitue pas le remède miracle aux inégalités et disparités territoriales que le mouvement des « gilets jaunes » a mises sur le devant de la scène politique, elle représente bien un premier pas pour y répondre sur le long terme et, en ce sens, les élus doivent y être associés.
Le débat, disais-je, a été constructif entre les deux assemblées : les principaux apports du Sénat, qui visaient à améliorer le fonctionnement de l’institution et à définir son périmètre d’intervention, ont été confortés lors de la première lecture du texte par l’Assemblée nationale.
Toutefois, en ce qui concerne la gouvernance de l’agence, il y a discorde. Alors que le Sénat défendait l’instauration d’une parité, au sein du conseil d’administration, entre les représentants des élus locaux et nationaux, d’une part, et les représentants de l’État, de ses établissements publics et du personnel de l’agence, d’autre part, les députés ont redonné la majorité aux représentants de l’État, contre le souhait exprimé par la Haute Assemblée.
De nouveau, au stade de la commission mixte paritaire, les deux assemblées ne sont pas parvenues à un accord concernant la gouvernance de la future institution, malgré la volonté du Sénat d’aboutir à un compromis.
La Haute Assemblée a proposé un amendement par lequel elle acceptait la représentation majoritaire de l’État au conseil d’administration, à condition que les représentants des élus disposent d’un droit de veto en cas de désaccord des trois quarts d’entre eux avec une décision dudit conseil d’administration.
Nous comprenons très bien pourquoi l’État est réticent à accepter une telle solution de compromis : il revient à celui qui finance de décider. Toutefois, dans le cas présent, à la veille d’un nouvel acte de décentralisation censé ouvrir la voie à la différenciation, pour définir avec chaque territoire une réponse adaptée et sur mesure, il serait inopportun de laisser à l’État seul un pouvoir de décision unilatérale au sein d’une agence conçue pour être au service des collectivités, de leurs projets, de leur cohésion.
En nouvelle lecture, le texte n’a été que peu modifié par l’Assemblée nationale ; les députés ont simplement adopté une dizaine d’amendements rédactionnels ou visant à apporter des précisions juridiques opportunes.
Toutefois, à l’article 3, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à modifier la composition et le fonctionnement du conseil d’administration, ces nouvelles dispositions s’inspirant de la position sénatoriale. Mais ne soyons pas dupes : le dispositif introduit en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale est un ersatz de ce que nous attendons et ne changerait rien au droit de regard réel des collectivités territoriales. Si le dispositif accorde un droit de veto aux élus locaux, celui-ci n’ouvre droit qu’à une seule nouvelle délibération, sans vrai pouvoir de blocage pour les représentants des élus par la suite. Cela traduit un manque de confiance dans les bienfaits de la concertation entre les élus et l’État en vue d’une meilleure cohésion territoriale.
C’est donc très naturellement que notre commission, sous la houlette du rapporteur, Louis-Jean de Nicolaÿ, dont je salue au passage l’excellent travail, a incorporé au texte la solution de compromis que nous avons proposée en commission mixte paritaire.
Le groupe Union Centriste, en cohérence avec la position exprimée par le Sénat depuis le début de l’examen de la proposition de loi, soutiendra donc le texte ainsi amendé. En donnant aux représentants des élus la possibilité de s’opposer à une décision du conseil d’administration à la majorité qualifiée, on ne joue pas le rapport de force : on garantit leur association étroite aux décisions de l’agence, pour que celle-ci puisse véritablement assurer sa mission, à savoir accompagner la logique de projets qui anime aujourd’hui la France rurale et développer dans ce domaine la coordination entre l’État et les collectivités territoriales.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, dont je salue l’excellent travail, mes chers collègues, la création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires était évoquée de longue date par de nombreux groupes politiques et diverses associations. Mon groupe l’a déjà indiqué lors de débats antérieurs : l’intention est bonne, mais il faut que l’ensemble du dispositif soit parfaitement défini pour qu’il puisse s’insérer dans une organisation durable de l’aménagement du territoire, en évitant surtout d’alourdir encore le millefeuille institutionnel.
Il est de notre devoir constitutionnel de proposer aux élus locaux une institution utile, pragmatique et conforme à leurs attentes.
La création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires doit permettre de lutter contre les multiples fractures territoriales et, avant tout, de soutenir ceux qui en ont le plus besoin : les zones rurales, bien entendu. L’action de cette agence devra se concentrer sur les territoires le plus en difficulté, en incluant les zones de revitalisation rurale, ainsi que les zones de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
Toutefois, il faudra veiller à ce que ce nouvel acteur n’ajoute pas une couche de complexité bureaucratique au quotidien des élus locaux : nous sommes, en France, des spécialistes de la création d’usines à gaz ! Les élus locaux attendent surtout de l’État une lisibilité globale et un accès facilité, au profit de leurs territoires.
La nouvelle agence devra impérativement faire sienne cette ambition de simplification et de transparence, pour mieux répondre aux besoins et aider les élus de terrain. Elle devra également être aussi déconcentrée que possible, pour agir au plus près des élus et de leurs préoccupations quotidiennes.
Il faudra aussi réfléchir à simplifier davantage le paysage de l’intervention territoriale de l’État, pour tendre vers le guichet unique. En attendant, une coordination renforcée entre la nouvelle agence et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Ademe, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, la Caisse des dépôts et consignations et les agences régionales de santé devra être mise en place.
Je tiens à souligner les améliorations substantielles apportées au texte par le Sénat et l’Assemblée nationale s’agissant de la transparence et du fonctionnement de l’agence, de la parité dans les instances de gouvernance, de la prise en compte des territoires les plus fragiles ou encore du soutien au réseau d’associations dans tous les territoires.
La réussite de l’agence dépendra essentiellement de la représentation des élus locaux au sein de ses instances. Ils devront pouvoir contribuer directement aux choix stratégiques : c’est le point essentiel !
Il est regrettable que les discussions aient échoué en commission mixte paritaire sur la question de la gouvernance, alors même que les élus locaux sont le mieux à même de savoir ce qui convient pour leurs territoires.
Il existe bien un désaccord de fond entre les sénateurs, qui ont souhaité que le conseil d’administration de l’ANCT soit constitué, à parité, de représentants de l’État et du personnel de l’agence, d’une part, et de représentants des élus locaux, d’autre part, et les députés, qui entendent que l’État ait la majorité dans cette instance, parce que l’agence sera une institution nationale publique, financée par l’État.
Le Sénat a fait un pas important en proposant de permettre à l’État, malgré la parité, d’opposer un veto à une décision qui n’irait pas dans le sens qu’il souhaite, mais ce fut en vain !
Quant à la proposition de l’Assemblée nationale de permettre une seconde délibération en cas de blocage, elle ne saurait être satisfaisante. Le fait qu’il soit le financeur ne peut justifier que l’État ait le dernier mot.
Il est regrettable que le Sénat ne soit pas entendu sur ce point, pourtant fondamental pour la bonne relation entre les collectivités territoriales et l’État. Il est évident que la République ne peut pas fonctionner sans une collaboration étroite entre l’État et les collectivités locales.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutient la position de la commission sur la question de la gouvernance de l’agence.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons ce matin la proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires telle qu’adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le 21 mai dernier. La commission mixte paritaire avait abouti à un accord sur le texte organique, mais échoué sur la proposition de loi ordinaire.
L’Agence nationale de la cohésion des territoires doit constituer pour les élus un guichet unique, simple et efficace, permettant de soutenir les projets des collectivités territoriales – une agence au service des projets, donc !
Le texte déposé par M. Jean-Claude Requier et nos collègues du groupe du RDSE porte l’empreinte d’une double ambition : d’une part, faciliter la conception et la réalisation des projets territoriaux envisagés par les équipes municipales, notamment dans les territoires les plus en difficulté ; d’autre part, renforcer les relations entre les services déconcentrés de l’État et les représentants locaux, pour une plus grande efficacité.
Cette structure, dont la création a été annoncée lors de la Conférence nationale des territoires qui s’est tenue au Sénat il y a deux ans, puis devant le Congrès des maires de France voilà un an, est – cela a été rappelé – la traduction législative, d’initiative parlementaire, d’une volonté exprimée par les élus, mais aussi d’un engagement présidentiel. C’est un premier pas en vue d’atteindre l’objectif d’un aménagement durable, innovant et cohérent de nos territoires.
À l’issue de la première lecture au Sénat, l’Assemblée nationale avait repris de nombreux amendements adoptés en commission et en séance.
S’agissant, par exemple, de la prise en compte des territoires les plus fragiles, la liste des territoires prioritaires pour l’intervention de l’agence, figurant à l’article 1er, a été précisée. Elle a été complétée par le Sénat, puis par les députés, afin d’inclure les territoires caractérisés par des contraintes géographiques ou par des difficultés en matière sociale et environnementale. Ont aussi été intégrées à cette liste les zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »
Je ne reviens pas sur l’ensemble des mesures : elles ont déjà été rappelées.
À l’issue de la navette, nous étions parvenus à un quasi-consensus sur le dispositif, s’agissant notamment du champ d’action de l’agence. Reste la problématique des modalités de gouvernance, jugées par certains trop favorables à l’État.
En première lecture, j’avais exprimé ici une conviction : la réussite de l’agence et sa reconnaissance comme outil pertinent par les acteurs locaux dépendront essentiellement du type d’organisation et de gouvernance retenu.
Représentant le groupe La République En Marche du Sénat en commission mixte paritaire, j’ai souligné qu’il était prévu, aux termes de l’alinéa 10 de l’article 3, que la présidence du conseil d’administration soit assurée par un élu local. Ce serait un signe fort, car la présidente ou le président aura une capacité d’action et une faculté d’impulsion et de dialogue importantes. En outre, nous n’imaginons pas que l’État – ou un préfet – puisse s’enferrer dans des propositions qui seraient refusées par les élus locaux. Si, malgré tout, tel était le cas, le dispositif proposé en commission mixte paritaire par la présidente de la commission saisie au fond à l’Assemblée nationale et adopté par l’Assemblée en nouvelle lecture conduirait à l’élaboration d’une nouvelle proposition par l’État, ce qui devrait, en toute logique, débloquer la situation.
En résumé, pour être approuvée par le conseil d’administration, une délibération devra réunir les suffrages de la majorité des membres présents, ainsi que, au sein de cette majorité, ceux de la majorité des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Sans cela, le président ou la présidente, qui sera un élu local, aura l’obligation d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet.
Il me semble que l’Assemblée nationale et le Sénat auraient dû pouvoir s’entendre en commission mixte paritaire. Cette absence d’accord retarde la création de l’ANCT, au détriment des territoires. J’avais déjà déploré la difficulté que nous avons à légiférer dans un délai compréhensible par les citoyennes et les citoyens et efficace au regard de la mise en œuvre des textes concernés.
L’introduction d’un mécanisme de seconde délibération du conseil d’administration, mis en jeu sur l’initiative des représentants des collectivités territoriales, me semble être une proposition pertinente. Il s’agit d’une démarche de compromis, visant à permettre que ce texte soit mis en œuvre le plus rapidement possible ; mon groupe la soutiendra.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons en nouvelle lecture, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, la proposition de loi d’initiative sénatoriale créant une Agence nationale de la cohésion des territoires, présentée par le Gouvernement comme l’outil d’un nouvel acte de décentralisation. Il s’agit d’un sujet important.
Je dirai d’abord quelques mots de la méthode employée. Vous le savez, mes chers collègues, nous regrettons le recours à une proposition de loi pour créer cette agence : cela nous prive d’une étude d’impact et de l’avis du Conseil d’État. Comment nous satisfaire de légiférer à l’aveugle, alors que tous les arbitrages sur les moyens et les contours de cette agence n’ont pas été rendus ?
Ce flou politique vient se télescoper avec la réforme de l’État en cours, qui trouve sa traduction dans les circulaires du Premier ministre appelant à plus de déconcentration et à la suppression des services publics de proximité, ou encore dans le projet de loi de transformation de la fonction publique, qui organise la privatisation de l’appareil de l’État et un grand plan social dans la fonction publique.
Pour l’ensemble de ces réformes, et particulièrement en vue de la création de cette agence, nous pensons que de nombreuses consultations des élus et de la population auraient dû être menées dans les territoires, au plus près des besoins et des réalités.
Au terme de nos débats, nous avons donc le sentiment d’un rendez-vous manqué, d’un texte qui passe à côté des enjeux et des attentes.
Pourtant, le besoin d’ingénierie est criant, notamment dans les territoires ruraux, et ce encore plus depuis la suppression de l’Atesat, l’assistance technique fournie par les services de l’État.
Lors du premier passage de ce texte devant le Sénat, en novembre dernier, notre groupe a fait le pari du débat et de l’intelligence collective au service des territoires. Nous avons ainsi formulé de nombreuses propositions sur les missions, la composition et les modalités d’action de cette agence. Sans obtenir gain de cause sur tout, nous avons participé à l’élaboration d’un texte sénatorial intéressant.
Malheureusement, loin d’enrichir le texte, l’Assemblée nationale en a raboté la portée et a supprimé les avancées adoptées par le Sénat. En définitive, l’agence aurait pour seule fonction de jouer un rôle de guichet unique pour les collectivités, avec l’unique ambition de mutualiser les moyens existants. Ce serait une agence au périmètre restreint, mais pouvant contractualiser avec l’ensemble des opérateurs de l’État et agir sur les services de l’État et leurs directions déconcentrées.
Nous estimons, pour notre part, que l’État ne peut être cantonné au seul rôle de prestataire : il est aussi le garant de l’égalité républicaine, pour tous et partout, ou du moins il devrait l’être.
Les politiques successives de réduction de l’action de l’État marquent un renoncement à cette égalité républicaine. Baisse des dotations, fermeture d’hôpitaux, de maternités, de classes, de bureaux de poste, de gares, suppression de l’ingénierie publique territoriale : on assiste à un renforcement constant des inégalités sociales, environnementales et territoriales. Les territoires sont pourtant des acteurs majeurs de la transition écologique, énergétique et sociale, de la lutte contre le réchauffement climatique, qui sont notre priorité, la priorité !
Il s’agit d’une véritable contradiction avec l’ambition affichée : comment faire mieux dans ces conditions ? Cette agence ne pourra pallier, comme par enchantement, le désengagement de l’État en matière de politiques d’aménagement des territoires.
Cet outil placera, encore une fois, les collectivités en compétition pour obtenir en même temps une aide d’ingénierie et des subsides ; ce n’est pas notre conception de la relation entre l’État et les collectivités. Bien loin des objectifs affichés, ce sont les plus grandes collectivités, qui disposent déjà d’ingénierie et de services spécialisés à même de décrypter les rouages du système, qui en seront les premières bénéficiaires. C’est un contresens au regard des missions que cette agence est censée remplir au profit des territoires les plus fragiles, même si je salue la prise en compte des spécificités des territoires de montagne.
Si l’échelon intercommunal est pertinent, nous regrettons que les communes ne puissent pas saisir directement l’agence. Nous avions déposé un amendement en ce sens.
Concernant la composition du conseil d’administration de l’agence, la suppression par l’Assemblée, avec l’aval du Gouvernement, d’une représentation égalitaire des élus et de l’État, qui relève pourtant du bon sens, est regrettable. Même si un processus de double délibération, utilement renforcé par notre commission, est mis en œuvre, l’État garde finalement la main sur tout et l’on tourne le dos à un rapport équilibré. Nous sommes bien loin d’une décentralisation renforcée et du renouvellement d’un pacte de confiance avec les élus locaux.
Une autre déception tient à la suppression de notre apport concernant la prise en compte, dans les missions de cette agence, de la lutte contre la pollution des sols. C’est pourtant un problème majeur pour les territoires, la santé publique et l’environnement.
L’agence, à moyens constants, ne pourra manifestement pas répondre à la demande : j’en veux pour preuve les baisses de budget et de moyens des entités devant la composer. Il en va de même pour les opérateurs associés par convention : je pense notamment au Cérema, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, qui va perdre un quart de ses effectifs.
L’agence aura des missions tellement larges qu’il est difficile d’en définir les priorités. Dans le même temps, on relève un nouveau recul de la décentralisation, puisque le préfet devient le pivot de toutes les politiques de l’État dans les territoires. C’est une manière de revenir à la verticalité dans l’utilisation des subsides de l’État.
En définitive, il s’agit bien plus d’une réforme de l’organisation de l’État dans les territoires que d’un nouvel acte de décentralisation fondé sur la libre administration des collectivités et leur autonomie financière.
Je veux encore exprimer une autre inquiétude. Alors que le Sénat avait voulu préserver les ressources de l’ANRU et, plus globalement, les crédits de la politique de la ville, l’Assemblée nationale a supprimé cette mesure. Il serait inconcevable d’affaiblir la politique de la ville, ou ce qu’il en reste, pour alimenter la nouvelle agence.
Faute d’ambition politique et de moyens suffisants, nous craignons donc que l’Agence nationale de la cohésion des territoires devienne un « machin » supplémentaire, une simple coquille vide.
Malgré toutes ces remarques de fond, et pour tenir compte de la volonté d’équilibre du Sénat, concernant notamment la prise en compte des représentants des élus locaux dans le processus de décision, nous nous abstiendrons sur ce texte, lançant ainsi un appel à l’Assemblée nationale pour qu’elle revoie sa copie.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, même si l’on peut regretter que la commission mixte paritaire n’ait pu aboutir à un accord, on doit se satisfaire de l’examen en nouvelle lecture de cette proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires, très attendue par les élus locaux. À cette occasion, je veux exprimer, encore une fois, nos interrogations et nos doutes sur le bon fonctionnement de cette agence.
Le texte a été enrichi en première lecture successivement par le Sénat et par l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne les missions attribuées à l’agence. Celles-ci sont marquées par une extrême ambition. Ainsi, à l’article 1er, l’Assemblée nationale a étendu le champ d’intervention prioritaire de l’agence aux territoires caractérisés par des contraintes géographiques ou des difficultés en matière démographique, économique, sociale ou environnementale. De même, une attention particulière est portée, à juste titre, aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir les zones rurales, celles où s’opère une transition industrielle et les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Enfin, l’agence assurera la promotion des projets innovants de ces territoires.
Le champ d’action s’élargit encore plus à l’article 2, aux termes duquel « l’Agence a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales […] dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès au service public, de l’accès au soin […], du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation commerciale et artisanale des centres-villes et des centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique, du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. »
Ainsi, les missions de l’agence sont nombreuses, diverses et variées, cohérentes, certes, mais tentaculaires, touchant à tous les secteurs et domaines des territoires concernés.
La première question à se poser est de savoir si l’agence aura véritablement les moyens de faire face à l’immensité des besoins. Nous savons que les projets sont nombreux et, même si nous nous réjouissons que la mise en place d’un contrat unique de cohérence territoriale, proposée par le Sénat à la suite du rapport Morvan, ait été approuvée par l’Assemblée nationale, on peut penser que la tâche sera immense.
N’oublions pas que l’agence fonctionnera à moyens constants et devra faire face à des missions nouvelles sans abandonner celles qu’assumaient jusqu’à présent le CGET, l’Agence du numérique et l’Épareca, l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Les organismes partenaires tels que l’ANAH ou l’Ademe ont un plan de charge bien rempli, tant les problématiques liées au logement, à l’environnement et à la maîtrise de l’énergie sont importantes. De même, le Cérema est sur une trajectoire de réduction substantielle de ses effectifs, à hauteur de plus de 100 personnes par an jusqu’en 2022. Sans moyens supplémentaires, il sera donc difficile à l’agence de fonctionner.
Une deuxième question concerne le mode opératoire. Là aussi, on peut se féliciter de ce que l’Assemblée nationale ait repris des dispositions que nous avions défendues en vain au Sénat, notamment le recensement des différentes formes d’ingénierie existantes, qui peuvent être mobilisées en appui en faveur du développement des territoires, ainsi que pour faciliter et développer les coopérations territoriales, notamment entre les métropoles, les communautés urbaines et les territoires environnants.
Je pense que les comités locaux de cohésion territoriale que le Sénat a créés dans chaque département devront être constitués rapidement, de façon qu’ils puissent, au-delà de la simple information des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, faire des recommandations pour que cet accompagnement puisse s’opérer dans les meilleures conditions.
Mes chers collègues, la fracture territoriale, qui nous préoccupe tous, ne pourra être réduite que par la conjonction d’actions fortes et cohérentes. En tant qu’ensemblier, l’agence que nous souhaitons créer peut y contribuer. Cela suppose toutefois des moyens importants, qui doivent être mobilisés partout où ils se trouvent, et une organisation réactive et agile, afin de ne pas décevoir ceux qui croient encore à la possibilité d’agir au plus près de nos concitoyens, c’est-à-dire au cœur même des territoires.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. Alain Fouché applaudit également.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires présentée par M. Jean-Claude Requier répond à une demande formulée par les élus locaux et fait suite à une annonce du Président de la République.
La mission première de l’Agence nationale de la cohésion des territoires est le soutien aux collectivités territoriales. L’intention est louable. Toutefois, je rappelle que de nombreux établissements publics ont déjà pour rôle d’apporter un soutien aux collectivités et aux acteurs locaux dans leur mission d’aménagement des territoires. Je pense à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, à l’Agence nationale de l’habitat, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sans parler des différents interlocuteurs transversaux au sein des services préfectoraux. Il est prévu que tous ces acteurs soient associés à la nouvelle agence par le biais de conventions.
Par ailleurs, certaines collectivités territoriales disposent déjà de leurs propres agences locales tournées vers l’aménagement, en particulier des agences d’ingénierie comme celle qui existe dans mon département des Yvelines, l’une des premières structures de ce type à avoir été créée.
Veillons donc à ce que l’ANCT soit efficace dans ses missions et, surtout, à ce qu’elle ne fasse pas doublon avec ce qui existe déjà. C’est l’un de mes souhaits, l’une de mes exigences.
Je comprends bien que cette nouvelle agence vise à fédérer les initiatives pour la cohésion territoriale, mais la pleine justification de sa création ne m’apparaît pas, d’autant que des incertitudes persistent quant à ses moyens de financement et à son fonctionnement. Aucun financement supplémentaire n’est prévu pour une agence qui regroupera trois établissements publics. Or cette nouvelle agence devra faire face à de grandes attentes, ses missions étant notamment tournées vers les territoires en difficulté.
De plus, les contrats de cohésion territoriale verront leurs modalités précisées par décret. J’espère que cela ne se traduira pas par une contractualisation globale qui se ferait au détriment des projets des collectivités. Une nouvelle fois, le devoir de vigilance s’impose.
Un autre point mérite toute notre attention. La création de l’agence aurait pu être l’occasion de donner plus de marge d’initiative aux élus locaux, confrontés quotidiennement aux difficultés de nos territoires. Leur connaissance du terrain est précieuse et permettrait de faire émerger des réponses ancrées dans la réalité, fruits de leur expérience. Or, monsieur le ministre, le refus d’instaurer la parité au sein du conseil d’administration entre les représentants des élus et ceux de l’État est un très mauvais message envoyé aux élus locaux.

Quelle confiance peut-on avoir dans une agence de l’État qui, précisément, refuse de faire confiance aux élus qu’elle est censée soutenir et aider dans leurs missions ?

Vous le savez bien, monsieur le ministre, la proposition, adoptée à l’Assemblée nationale, de créer un mécanisme de seconde délibération permettant aux représentants des collectivités territoriales de reporter une décision est sans poids. Faites confiance aux maires et, à défaut de les rendre décisionnaires, laissez-les peser sur les sujets qu’ils maîtrisent. Le principe de subsidiarité doit prévaloir.
Monsieur le ministre, je ne veux pas croire que l’agence ne sera qu’un instrument pour contrôler et chapeauter les actions et les décisions d’aménagement des élus locaux. Je soutiens donc la reprise de la dernière rédaction de l’article 3 proposée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, prévoyant l’impossibilité de valider une nouvelle délibération si les trois quarts des représentants des élus locaux présents s’y opposent. Cette proposition va dans le bon sens.
Monsieur le ministre, vous avez affirmé que ce dispositif transformera en profondeur l’organisation de l’État dans son action et son soutien aux territoires, mais vous avez omis de dire qu’il suscite également de la défiance.
Vous venez d’entendre les raisons de mes doutes, qui sont partagés par de nombreux élus locaux de mon territoire. Je veux croire, toutefois, que la création de cette nouvelle agence ne se fera pas au détriment de nos territoires et de ceux qui les représentent.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après avoir épuisé les leviers législatifs traditionnels, il semble que le Gouvernement redécouvre l’aménagement du territoire et les élus locaux. Ainsi, nous discutons aujourd’hui de la proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires, et nous discuterons demain de dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux très largement inspirées des travaux du Sénat et d’un texte portant adaptation de la loi NOTRe.
Pendant deux ans, comme l’a rappelé au mois de novembre dernier notre excellent rapporteur Louis-Jean de Nicolaÿ, le présent texte n’a pas semblé être une priorité absolue. Avec la réforme de la taxe d’habitation ou la hausse de la TICPE, nous avions déjà pu constater la légèreté avec laquelle ce gouvernement traitait nos territoires.
Aujourd’hui, c’est donc le retour du concret ! Cependant, ce retour prend une forme singulière. Clairement, il ne s’agit pas de faire renaître de ses cendres la Datar, disparue en 2014 pour engendrer le CGET.
Le format de cette agence, envisagée comme le regroupement sous une seule bannière de l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, de l’Agence du numérique et d’une large partie du Commissariat général à l’égalité des territoires, a tout de suite suscité des interrogations. Le premier à s’interroger a été le préfet Serge Morvan. Son rapport de préfiguration, remis au Premier ministre le 18 juin 2018, prévoyait, en effet, l’intégration de l’ANAH et de l’ANRU à la nouvelle agence, avec la possibilité pour celle-ci d’assurer la pleine gestion des crédits de ces organismes.
À l’origine, cette agence devait être la « start-up des territoires », comme l’évoquait la mission de préfiguration. Il s’agissait alors de promouvoir « une organisation interne profondément novatrice, privilégiant le travail en mode projet pour favoriser, notamment, l’innovation ; son ADN sera celui d’une entreprise au service de ses clients ». Nous nous sommes finalement éloignés de cet esprit, et il est encore trop tôt pour le regretter.
Comme la plupart de mes collègues, je ne suis pas fondamentalement hostile à la création de cette agence. J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur l’opportunité d’y intégrer l’Agence du numérique et, surtout, sur les délais de cette intégration. À ce stade de la discussion, ces questions ne me semblent plus pertinentes.
Toutefois, si je ne suis pas hostile à cette création, elle ne m’exalte pas particulièrement. Je crains surtout que, une fois de plus, au regard d’une absence de résultats, d’un manque de vision et d’une imagination en berne en matière d’aménagement du territoire, on demande au législateur d’actionner sans discernement les leviers qui sont encore à sa disposition. En d’autres termes, je crains que l’on demande au Parlement de fermer les yeux sur le tour de passe-passe opéré à périmètre budgétaire constant par le Gouvernement.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, la crise des « gilets jaunes » est d’abord une crise de la mobilité, donc de l’aménagement du territoire. Par conséquent, il n’est pas étonnant que le Gouvernement cherche des réponses sur ce thème.
C’est exactement, me semble-t-il, ce que notre rapporteur a souhaité faire : trouver une réponse concernant la raison d’être de cette agence. Nous avons très bien compris qu’elle ne serait pas la Datar d’Olivier Guichard. Nous avons compris aussi que la fragmentation des politiques publiques participant à l’aménagement du territoire ne serait pas profondément remise en cause par ce texte.
Le postulat du rapporteur était simple : le Gouvernement doit prendre ses responsabilités sur le plan financier. Un État plus responsable et des élus associés : telle a été la ligne directrice des travaux de notre commission, en première comme en nouvelle lecture, notamment pour améliorer la gouvernance nationale et locale de l’agence. Le Gouvernement ne peut pas, d’un côté, se montrer pusillanime sur les questions financières, et, de l’autre, ostraciser les élus au sein du conseil d’administration de l’agence.
Chacun sait que l’examen de ce texte serait déjà terminé si le Gouvernement avait bien voulu garantir aux élus locaux un droit de veto. Pour le reste, nous ne contesterons pas le bien-fondé des modifications apportées par l’Assemblée nationale. En définitive, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi telle que modifiée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Je conclurai en citant un passage du décret du 14 février 1963 – une belle année ! – créant la Datar : « Cette délégation sera un organisme de coordination et d’impulsion. Son rôle sera, à partir des objectifs généraux définis par le plan, de préparer et de coordonner les éléments nécessaires aux décisions gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et d’action régionale et de veiller à ce que les administrations techniques ajustent leurs actions respectives dans ce domaine. »
Espérons que, demain, à défaut de proximité, l’État redevienne stratège.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Fouché applaudit également.
Monsieur le rapporteur, vous m’avez interrogé sur l’intégration des ARS. Je vous confirme l’engagement pris par la ministre des solidarités et de la santé : les ARS seront bien présentes dans les comités locaux. Ce point figurera dans la circulaire relative à l’organisation locale.
Monsieur le sénateur Chaize, la seule différence entre 1963, belle année, effectivement, où fut créée la Datar, et aujourd’hui, c’est qu’entre-temps est intervenue la décentralisation. L’État n’est plus le seul prescripteur sur le territoire.
Concernant la gouvernance, la représentation des élus est très nettement affirmée dans le texte. La navette a d’ailleurs permis des avancées à cet égard. D’un point de vue général, il est bon que celui qui paye puisse décider.
Monsieur Joël Bigot, je rappelle qu’il s’agit non d’un texte du Gouvernement, mais d’une proposition de loi du groupe du RDSE. On peut nous imputer tous les maux de la Terre, mais telle est la réalité !
M. Joël Bigot sourit.
Vous dites que nous complexifions les choses. Pourtant, il me semble que la création d’une agence nationale, avec une déclinaison locale, traduit plutôt la volonté de regrouper les opérateurs et de les mettre en lumière. Pour l’heure, les élus, dont je suis, ont parfois du mal à accéder aux outils de coopération.
Monsieur Roux, je suis d’accord avec vous pour préserver l’esprit du texte. Il faudra y veiller, car l’application des meilleures lois peut donner lieu à des dévoiements. Nous avons tous la volonté de faire en sorte que la création de cette agence soit utile aux territoires. Cette ambition nous oblige tous, vous avez eu raison de le rappeler.
Concernant la lisibilité du dispositif pour les élus, évoquée par MM. Fouché et Roux, j’indique qu’une information à destination des élus communaux, notamment, sera assurée, afin que chacun puisse s’approprier l’outil. Pour avoir moi-même été gestionnaire de fonds européens, je sais que, souvent, les collectivités territoriales ne connaissent pas suffisamment les outils, financiers et d’ingénierie, existants.
M. Houllegatte m’a interrogé sur les moyens. Les moyens existent ; la difficulté tient à leur mobilisation et à leur allocation. Par exemple, peu d’élus connaissent le Cérema et le sollicitent, alors qu’il joue un rôle fort utile.
Madame Cartron, vous avez raison, des avancées ont été obtenues entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Elles ne sont pas encore suffisantes, mais je pense que nous allons encore progresser.
Monsieur Gontard, l’égalité est une préoccupation que nous partageons tous. En vérité, ce dont ont besoin avant tout les collectivités, c’est d’une égalité d’accès à l’ingénierie pour pouvoir monter des projets. C’est cette égalité que le texte vise à mettre en œuvre.
Madame de Cidrac, la création d’un tel outil était en effet demandée depuis un certain nombre d’années sur le terrain. Il faut faire confiance aux maires, dites-vous ; vous avez raison, mais il faut aussi faire confiance à l’État. Dans le dialogue que nous aurons à construire dans les mois et les années à venir, la principale difficulté tient au fait que la confiance entre l’État et les collectivités locales s’est, depuis longtemps, profondément érodée. Cette agence est aussi un outil pour restaurer cette confiance.
Enfin, monsieur Chaize, à vous entendre, le Gouvernement découvrirait l’aménagement du territoire. Ce n’est pas vrai. En réalité, ce que nous découvrons, c’est le bilan de trente ans d’aménagement du territoire ! C’est pour y remédier que nous délibérons aujourd’hui de la création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires.

La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission sur la proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires.
TITRE Ier
Création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires
(Non modifié)
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
« CHAPITRE I ER
« Statut et missions
« Art. L. 1231 -1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d’un établissement public de l’État.
« Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national.
« Son action cible prioritairement, d’une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, d’autre part, les projets innovants. »
L ’ article 1 er est adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 1231 -2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111-1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.
« L’agence assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.
« L’agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes.
« L’agence coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.
« I bis. – L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.
« I ter. – L’agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.
« II. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.
« À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent II. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux-ci.
« L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent II, notamment :
« 1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;
« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;
« 4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;
« 5° Conclure des transactions.
« III. – L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.
« À ce titre, l’agence :
« 1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;
« 2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.
« IV. –
Supprimé
« V. – L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »
II. –
Non modifié
III. – Les ministres chargés de l’aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l’exercice par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.

Monsieur le ministre, l’objectif premier de l’Agence nationale de la cohésion des territoires est de restituer une capacité locale d’ingénierie au travers d’un guichet unique, de faciliter l’accès des collectivités territoriales aux ressources et aux conseils de l’État et d’améliorer la connaissance des ressources locales disponibles.
La proposition de loi a été enrichie au cours de la navette parlementaire dans sa dimension ingénierie et par l’identification de sujets de préoccupation spécifiques. Ainsi, l’article 2, relatif aux missions, précise le cadre et les champs d’intervention.
Monsieur le ministre, vous n’êtes pas sans savoir que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a mis en place une mission d’information sur les ponts, dont Michel Dagbert et moi-même sommes les rapporteurs. Elle rendra ses conclusions dans les prochaines semaines. Sans en dévoiler le contenu, je dirai qu’il apparaît que la ressource technique est un sujet d’inquiétude et de vigilance.
J’ai bien conscience qu’il s’agit là d’une thématique spécifique. Pourriez-vous néanmoins, monsieur le ministre, confirmer ou infirmer que l’ANCT pourra s’intéresser à la problématique de la sécurité des ouvrages d’art, en particulier des ponts, et apporter aux collectivités territoriales un soutien en ingénierie technique et financier sur ce thème ?
Monsieur le sénateur, je tiens à vous rassurer : l’ANCT pourra notamment mobiliser le Cérema, qui dispose d’une expertise fort reconnue en matière de ponts, et passer avec lui des conventions. La référence aux mobilités, à l’article 2, le permet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Requier et Roux, Mme Costes, MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1231 -2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour missions :
« 1° D’accompagner et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111-1 du présent code, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle propose une offre d’ingénierie juridique, financière et technique en apportant un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements et peut faciliter l’accès des porteurs de projets aux autres formes, publiques ou privées, d’ingénierie, qu’elle recense. Elle accompagne, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes ;
« 2° De favoriser la coopération entre les territoires ;
« 3° De centraliser, et partager les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance et de soutenir les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées ;
« 4° De coordonner l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et d’assister le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale ;
« 5° D’assurer une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.
II. – Alinéa 6, dernière phrase
Remplacer le mot :
intègrent
par les mots :
peuvent intégrer
III. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
assurer
par le mot :
garantir
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

La proposition de loi visait avant tout à répondre à une forte demande des élus locaux, qui déplorent la difficulté de faire aboutir leurs projets par manque d’ingénierie locale, notamment dans les territoires ruraux. Les procédures sont de plus en plus complexes et les responsabilités sont diluées du fait de la multiplicité des intervenants et des opérateurs. C’est le constat que dresse le préfet Morvan dans son rapport. Ce constat a inspiré la déclaration faite par le Président de la République devant le Congrès des maires en 2017: « L’État doit parler d’une voix et d’une voix cohérente dans le montage de vos projets. » Il a alors également indiqué que l’agence aurait « pour vocation d’apporter des compétences en ingénierie territoriale qui seront envoyées sur le terrain là où c’est nécessaire ».
L’article 2 du texte est une illustration parfaite du « bavardage législatif » dont la loi est constamment victime. À l’Assemblée nationale, il a fait l’objet d’un empilement de prétendues précisions et de redondances, au détriment de la clarté du dispositif.
Mes chers collègues, relisez les textes qui ont créé les agences de l’État, par exemple l’Ademe ou l’ANRU : la loi leur a fixé une liste de missions beaucoup plus brève, les précisions faisant l’objet d’un renvoi au pouvoir réglementaire, comme le prévoit la Constitution.
En définitive, le point central de la proposition de loi, c’est le caractère opérationnel de l’ANCT. Qu’apportera-t-elle aux élus qui n’en peuvent plus d’être baladés de service en service ? Cela doit apparaître plus clairement dans la loi.
En tant qu’auteurs de la proposition de loi, nous voulons que cette agence accompagne les collectivités locales dans leurs projets et que l’administration se prononce d’une seule et même voix. Nous voulons également qu’elle apporte une offre d’ingénierie aux collectivités locales qui en ont le plus besoin, celles qui sont le moins dotées en moyens humains et financiers. Si l’ANCT devait se borner à informer les collectivités et à suivre les politiques publiques sans les accompagner, sa création n’aurait aucun sens.
Ainsi, cet amendement a pour objet, sur la forme, d’établir une liste claire des attributions de l’ANCT, et, sur le fond, de mettre l’accent sur l’accompagnement dont pourront bénéficier les collectivités territoriales qui le souhaiteront. Nous avons conservé l’ensemble des formes d’ingénierie dont elles pourront bénéficier.
Enfin, il est prévu que les contrats de cohésion territoriale intègrent tout contrat relevant des compétences de l’agence. Ce contrat unique est la réponse au maquis de la contractualisation État-collectivités, dont l’articulation n’est pas toujours assurée.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Eustache-Brinio, MM. Reichardt et Laugier, Mmes Loisier et Raimond-Pavero, M. Guerriau, Mme Duranton, M. Piednoir, Mme Puissat, MM. D. Laurent et Joyandet, Mmes Vullien, Di Folco et Sollogoub, MM. Chaize, Grosperrin, Savary, Charon, Raison, Perrin, Houpert, Vogel, Kern et Karoutchi, Mmes Ramond et Lopez, MM. Dufaut, Babary, Schmitz et Détraigne, Mmes Férat et Bories, M. B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Moga, Mmes Gruny et Billon, M. Luche, Mme Chauvin, M. Courtial, Mme de la Provôté, M. A. Marc, Mme Noël et MM. Lefèvre, Kennel, Malhuret, Cuypers, Wattebled, Bonhomme, Gremillet et Decool, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
mission
insérer les mots :
, par principe à titre gracieux,
La parole est à M. Michel Savin.

L’Agence nationale de la cohésion des territoires doit apporter un soutien en ingénierie aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans la mise en œuvre de leurs projets locaux.
Compte tenu de la situation financière précaire de nombreuses collectivités, en particulier des communes et intercommunalités, l’amendement vise à clarifier le fait que les prestations assurées par l’agence au titre du I de l’article 2 seront gratuites pour les collectivités qui la sollicitent.

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Dufaut, Kern et Piednoir, Mme L. Darcos, M. Hugonet, Mme Deromedi, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Reichardt, Henno, Laugier et Panunzi, Mme Puissat, MM. Sido, D. Laurent, Guerriau, Longeot, Perrin et Raison, Mmes Malet, Micouleau, Berthet, Billon et Gruny, MM. Grosperrin, Détraigne, J.M. Boyer, Moga, Vogel, Savary, Karoutchi, Milon et Decool, Mme M. Mercier, M. Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, Gatel et Duranton, MM. A. Marc, Bouchet, Saury, Priou, B. Fournier et Mandelli, Mmes Garriaud-Maylam et Chauvin, M. Kennel, Mme Imbert et MM. Laménie, Malhuret, Wattebled, H. Leroy et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
ou du développement des usages numériques
par les mots :
, du développement des usages numériques, de la culture ou du sport
La parle est à M. Michel Savin.

Cet amendement a pour objet d’étendre aux domaines de la culture et du sport le champ d’intervention de la future agence nationale de la cohésion des territoires dans sa mission de conseil et de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Ainsi que le prévoit l’article 2, l’ANCT aura pour mission « de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur […] du logement, des mobilités […], du développement économique ou du développement des usages numériques ». Or les volets sportif et culturel participent directement de la cohésion sociale au sein des territoires. Les initiatives menées autour du sport et de la culture, tant dans les quartiers prioritaires de la ville que dans les zones de revitalisation rurale, débouchent sur de nombreuses réussites.
Aussi paraît-il indispensable que l’Agence nationale de la cohésion des territoires encourage et facilite la mise en œuvre de projets culturels et sportifs sur nos territoires. Il est déterminant que cela figure parmi ses missions.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 5 rectifié. L’article 2 a fait l’objet d’une construction progressive, tout au long de la navette parlementaire, mais, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, certaines priorités d’action pour l’agence ont été affichées. Nous sommes arrivés à un compromis avec l’Assemblée nationale sur cette disposition lors de la CMP et je n’ai pas souhaité rouvrir le débat sur les missions de l’agence dans le cadre de cette nouvelle lecture, préférant me concentrer sur les points de blocage persistants, à savoir la gouvernance et la méthode d’action de l’agence.
En outre, il ne me semble pas opportun de supprimer la référence aux zones de montagne, qui présentent des enjeux très spécifiques en termes d’aménagement du territoire et des besoins importants en ingénierie. L’examen de la loi Montagne II, en 2016, a été l’occasion de le rappeler.
L’amendement n° 4 rectifié tend à apporter une clarification bienvenue concernant le service rendu en matière d’ingénierie par l’ANCT aux collectivités territoriales. Il est important, pour la commission, que l’accès à l’ingénierie de projets de l’agence demeure gratuit pour les collectivités, compte tenu de la situation financière dégradée de certaines d’entre elles, en particulier au sein du bloc communal. Malgré les complexités qui se feront peut-être jour, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Concernant l’amendement n° 1 rectifié bis, monsieur Savin, si je partage votre préoccupation sur le fond – la culture et le sport sont des dimensions essentielles pour l’attractivité des territoires –, la précision que vous proposez d’introduire me semble inutile, car elle est satisfaite par la présence, dans la rédaction de l’article, de l’adverbe « notamment » avant l’énumération des thèmes que vous proposez de compléter.
Par ailleurs, l’agence a vocation à soutenir en priorité des projets complexes nécessitant une ingénierie technique et financière spécifique – je pense aux circuits alimentaires courts, qui impliquent des problématiques juridiques et sanitaires lourdes, mais aussi à des projets de mobilité propre ou d’assistance à l’entretien des ouvrages d’art.
Enfin, comme je viens de le dire à propos de l’amendement n° 5 rectifié, je ne souhaite pas rouvrir le débat sur les missions de l’agence.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement comprend tout à fait l’objectif louable des auteurs de l’amendement n° 5 rectifié de clarifier la rédaction de l’article 2. Toutefois, comme l’a souligné le rapporteur, au terme de nombreuses discussions, nous sommes parvenus à une rédaction suffisamment claire et à un équilibre sur lequel il ne me paraît pas souhaitable de revenir.
Concernant l’ingénierie, la rédaction proposée place l’ANCT dans une position non pas complémentaire par rapport aux offres d’ingénierie existantes, qu’elles soient publiques ou privées, mais au contraire concurrente, voire de substitution. Le Gouvernement ne saurait y être favorable. L’emploi du verbe « centraliser » est d’ailleurs un peu gênant, compte tenu du rôle que nous souhaitons confier à l’agence.
Par ailleurs, l’une des missions de l’agence sera d’informer et d’orienter les porteurs de projets pour leurs demandes de subventions au titre des fonds européens. Des besoins existent en la matière, M. Roux l’a dit, mais l’information des porteurs de projets est faite par les régions, qui assurent aujourd’hui la gestion des fonds européens. Il ne saurait être question que nous nous substituions à elles : vous nous en feriez d’ailleurs grief le cas échéant.
Enfin, certains ajouts de l’Assemblée nationale, relatifs par exemple aux missions assurées par l’agence dans les territoires à travers les commissariats de massif ou aux coopérations territoriales, ne sont pas repris dans l’amendement. Il me semble que ces dispositions étaient bienvenues. Comme l’a dit le rapporteur, il est préférable de ne pas y toucher.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 5 rectifié.
Sur l’amendement n° 4 rectifié, le Gouvernement maintient la position qu’il a déjà exprimée lors des précédents débats : il en demande le retrait. Toutefois, je tiens à vous rassurer, monsieur Savin, concernant la gratuité de l’intervention de l’agence : l’ANCT ne demandera pas de rémunération pour son intervention au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui la solliciteront, sauf pour les opérations dans le domaine de l’artisanat et du commerce, actuellement réalisées par l’Épareca. En effet, ces opérations nécessitent de rechercher des cofinancements des collectivités partenaires afin de faire aboutir les projets, comme c’est d’ailleurs le cas pour les projets de l’ANRU. L’Épareca intervient aux côtés de la collectivité qui le saisit, dans le cadre d’une convention partenariale qui détermine les engagements réciproques de chacun. Nulle rémunération n’est expressément prévue pour l’ANCT, mais il est nécessaire de pouvoir passer des conventions financières dans le cadre de partenariats.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 4 rectifié ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Enfin, j’émettrai un avis défavorable sur l’amendement n° 1 rectifié bis, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur. Le Gouvernement ne souhaite pas que l’on revienne sur la rédaction de l’article 2.

Je comprends très bien le souhait de M. le rapporteur de ne pas rouvrir le dossier et de ne pas revenir sur l’accord intervenu en commission mixte paritaire sur l’article 2. Cependant, cet article nous tient à cœur ; or nous trouvons que son dispositif a été affadi, édulcoré.
À titre d’exemple, le texte initial prévoyait que l’ANCT devrait « mobiliser » une offre d’ingénierie publique ou privée adaptée aux porteurs de projets. L’article prévoit désormais qu’elle « facilite » l’accès des porteurs de projets aux différentes formes d’ingénierie : ce n’est pas la même chose !
En termes de compétences, l’ANCT doit se structurer à l’échelon départemental, alors que le texte de l’Assemblée nationale étend l’action de l’ANCT aux demandes de subventions européennes gérées par les régions.
Nous maintenons l’amendement n° 5 rectifié.

Je remercie M. le rapporteur d’avoir émis un avis favorable sur l’amendement n° 4 rectifié. Je prends bonne note de vos assurances, monsieur le ministre, mais je maintiens cet amendement, car je préfère que la gratuité de l’intervention de l’agence soit inscrite dans la loi.
Concernant l’amendement n° 1 rectifié bis, l’emploi de l’adverbe « notamment » pourrait amener l’agence à se mettre en retrait s’agissant des missions non explicitement mentionnées dans la loi. Or la culture et le sport représentent des thématiques essentielles pour la cohésion des territoires, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en milieu rural. Je maintiens donc également cet amendement.

L’amendement n° 5 rectifié est intéressant, en ce qu’il permet de bien définir les missions de l’agence, mais il me paraît important de maintenir la prise en compte des spécificités des territoires de montagne. Ce point avait été discuté avec l’Association nationale des élus de la montagne.
Je ne pourrai donc voter cet amendement, même si je reconnais la nécessité de clarifier la rédaction de l’article 2.

Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 151 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 est adopté.
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 1232 -1. – I. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.
« II. – Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Toute nouvelle délibération est alors adoptée sauf si les trois quarts des représentants présents des collectivités territoriales et de leurs groupements s’y opposent.
« Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative.
« Le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.
« Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.
« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »

L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il ne peut être procédé qu’à une seule nouvelle délibération sur un même objet.
La parole est à M. le ministre.
Comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, le Gouvernement souhaite le rétablissement de cette disposition de l’article 3 telle qu’elle a été adoptée à l’Assemblée nationale.

La commission n’est pas favorable à cet amendement. Nous souhaitons que les représentants des collectivités et de leurs groupements au sein du conseil d’administration disposent d’un droit de veto.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1232 -3. – Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.
« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »

L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart, Raison et Perrin, Mmes Ramond et Lavarde, M. D. Laurent, Mmes Bruguière, Thomas, Chain-Larché et Duranton, MM. Priou et Chaize, Mmes Morhet-Richaud et L. Darcos, MM. Mandelli et Sido, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Gruny, MM. Nougein, Genest et Kennel, Mme Berthet, M. Lefèvre, Mme Lamure et MM. B. Fournier, H. Leroy et Bonhomme, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce comité réunit les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris, le cas échéant, des collectivités et groupements limitrophes intéressés, un représentant de la région, les députés et sénateurs élus dans le département, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, les représentants des autres acteurs locaux publics ou privés intéressés et des personnalités qualifiées appartenant au secteur de l’enseignement supérieur ou de la recherche.
« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu. »
La parole est à M. Michel Vaspart.

Le grand débat a confirmé l’attention spécifique que les Français portent à la problématique des inégalités territoriales d’accès aux soins. La future agence nationale de la cohésion des territoires ne pourra éluder cette question.
En cohérence avec la position adoptée par le Sénat en première lecture, cet amendement vise à identifier clairement les agences régionales de santé parmi les opérateurs partenaires de l’ANCT. En l’espèce, il précise la composition du comité local de la cohésion territoriale, institué en première lecture au Sénat, dans le prolongement des demandes exprimées par de nombreux collègues des deux assemblées, y compris la rapporteure de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale. Il tend à prévoir, en particulier, la présence du délégué départemental de l’agence régionale de santé.
Enfin, cet amendement tend à rétablir un alinéa introduit au Sénat en première lecture concernant la présidence du comité local de la cohésion territoriale.
« Qui décide paie », disait M. le ministre, mais l’inverse est également vrai : « qui paie décide » ! En cas de financements croisés, lorsque l’apport des collectivités locales est majoritaire, c’est à elles de décider, et non pas à l’État.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Plusieurs tentatives ont été faites, au cours de la navette parlementaire, en vue de mieux associer les ARS à l’action de l’agence. J’avais proposé, en première lecture, que les ARS siègent au comité d’action territoriale de cette agence. La rapporteure de l’Assemblée nationale avait également proposé leur association au comité local de la cohésion territoriale.
L’amendement vise non pas à créer un système complexe et rigide, mais à donner des garanties aux élus et à identifier clairement leurs interlocuteurs ressources. J’y suis favorable. La question de l’accès aux soins est tellement importante dans les territoires qu’il est utile que les ARS soient associées.
Cet amendement vise à faire figurer dans la loi la liste des membres du comité local de cohésion territoriale. Son adoption aurait pour effet, nous semble-t-il, de rigidifier le fonctionnement de ce comité.
La composition et les règles de fonctionnement du comité local de cohésion territoriale, comme la fréquence de ses réunions, doivent être définies par les acteurs locaux, à savoir les préfets et les élus, et non par la loi, si l’on ne veut pas risquer de limiter les marges de manœuvre à l’échelon local et d’obérer les possibilités d’adaptation.
C’est la raison pour laquelle la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s’est engagée devant les députés à demander aux préfets, par voie de circulaire, de consulter les élus de leur département pour définir, en lien étroit avec eux, les modalités les plus adaptées au plan local, en termes à la fois de fréquence des réunions et de composition du comité.
Elle s’est également engagée à demander aux préfets que les services de l’État, tels que les directions départementales des territoires, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les ARS ou les agences de l’eau soient présentes aux réunions de ce comité.
Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Enfin, monsieur le sénateur, en effet, « qui paie décide » et « qui décide paie ». Cela correspond bien à l’orientation qui a été donnée par le Premier ministre. C’est peut-être parce que ce principe n’a pas été suffisamment respecté depuis quelques décennies que nous sommes dans la situation que nous connaissons…
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 5 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l’article L. 1231-2, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -2 -1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’État concluent des conventions pluriannuelles avec :
« 1° L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° L’Agence nationale de l’habitat ;
« 3° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 4° Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;
« 5° La Caisse des dépôts et consignations.
« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d’actions dans les territoires où l’agence intervient.
« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »
II. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l’article L. 1233-2-1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis et 6 ter de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -3. – I. – Le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Des représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 3° Des représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 4° Des représentants du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;
« 5°
Supprimé
« 6° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
« II. – À la demande du directeur général, le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions mentionnées à l’article L. 1233-2-1.
« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. »
(Supprimé) –
Adopté.
II. – §
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter et 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -4. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.
« II. – Sont institués auprès du directeur général de l’agence :
« 1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n’exerce pas les missions confiées au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.
« III. – Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l’article L. 2312-8 et à l’article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »
(Supprimés) –
Adopté.
II et III. – §
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d’une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au I bis de l’article L. 1231-2. » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « en application du présent alinéa ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter, 7 et 8 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -5. – La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à son action.
« La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.
« Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d’engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans cette réserve. »
II. – Après le 4° de l’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales. » –
Adopté.
TITRE II
Dispositions transitoires et finales
(Non modifié)
I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
I bis. – À la date mentionnée au I du présent article :
1° Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Le chapitre V est abrogé ;
b) Le 2° de l’article L. 321-14 est ainsi rédigé :
« 2° Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »
2° Au 9° de l’article L. 411-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la fin du 6° de l’article L. 144-5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
2° bis Après le mot : « artisanales », la fin du 9° du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ;
3° À l’article 26-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l’article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales » ;
4° L’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;
5° À la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
6° Le II de l’article 22 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;
7° L’article 174 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.
II. – Sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires :
1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;
2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;
3°
Supprimé
Les fonctionnaires précédemment détachés auprès des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit auprès de l’Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu’au terme prévu de leur détachement.
(Supprimé) –
Adopté.
III. – §

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Personne ne demande la parole pour explication de vote sur l’ensemble du texte ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 152 :
Le Sénat a adopté.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de Mme Hélène Conway-Mouret.