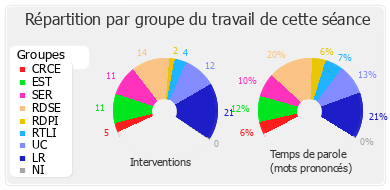Séance en hémicycle du 15 novembre 2022 à 21h30
Sommaire
- Communication relative à une commission mixte paritaire
- Soutien aux édiles victimes d'agression (voir le dossier)
- Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié (voir le dossier)
- Modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Nous reprenons l’examen de la proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Nathalie Goulet.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaite en premier lieu remercier Nathalie Delattre et le groupe du RDSE de cette proposition de loi. En 2022, il est quelque peu regrettable, reconnaissons-le, qu’il faille une loi pour protéger les élus…
Les édiles ne sont plus à l’abri des violences les plus graves. Le président Larcher a l’habitude de dire que les élus locaux et les maires sont « à portée d’engueulade » ; d’accord pour les engueulades, mais les violences physiques et les agressions sont bien sûr tout à fait inacceptables ! Nous avons tous en tête la mort du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, le 5 août 2019. Philippe Bas, alors président de la commission des lois, avait dans la foulée organisé une consultation et rédigé un rapport extrêmement intéressant sur les menaces et les agressions auxquelles sont confrontés les maires.
Nous sommes d’accord avec ce qu’a dit Mme Delattre en présentant sa proposition de loi. Nous sommes d’accord également avec ce qu’a indiqué Mme le rapporteur, et nous approuvons les annonces faites par M. le garde des sceaux et par Mme la ministre Cayeux.
Je veux néanmoins citer quelques témoignages tirés du rapport fait par Philippe Bas en 2019 : « tentative de meurtre » ; « tentative d’étranglement » ; « tentative d’homicide à la hache » ; « agression au couteau de cuisine » ; « un maire pris à partie et bousculé avec force contre un mur » ; « agression avec fourche à deux dents pointée sur le ventre » ; « agression physique en mairie » ; « coups de poing ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours »… « Pour être intervenu sur une nuisance sonore, j’ai été agrippé par la personne qui voulait me casser la gueule », rapporte encore un édile. Un autre raconte : « Un automobiliste roulant à contresens, je lui ai indiqué son incivilité : deux coups de poing dans la figure ».
On est très loin de « l’engueulade » ! Et je passe sur les centaines de pneus crevés, les voitures brûlées, les maisons incendiées ou taguées, les clôtures détruites… Bref, ce rapport de Philippe Bas de décembre 2019 est absolument effrayant. Cette triste réalité touche l’ensemble des territoires, et les zones rurales n’y font pas exception.
La période de la crise sanitaire n’a fait qu’aggraver la situation, et les derniers chiffres sont peu encourageants : les agressions physiques contre les élus ont augmenté de 47 % au cours des onze premiers mois de l’année 2021, par rapport à la même période de l’année précédente.
Aujourd’hui, nous améliorons la protection des élus. J’allais vous demander, monsieur le garde des sceaux, d’être plus vigilant quant à l’accueil que reçoivent les maires qui cherchent à porter plainte, les édiles étant nombreux à déplorer les classements sans suite, une justice bien trop lente et des sanctions inexistantes. Mais vous m’avez enlevé les mots de la bouche, devançant ma demande, …
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Quel bonheur !
Sourires.

… en indiquant que vous aviez, par circulaire, donné des instructions en ce sens. Il revient maintenant aux parquets de faire le nécessaire s’agissant d’un sujet éminemment important.
On dit que les maires sont les élus préférés des Français ; il n’en reste pas moins vrai que le climat de violence qui sévit partout ne les épargne pas. Pour toutes ces raisons, il est indispensable de voter la proposition de loi présentée par Mme Delattre et par le groupe du RDSE, qu’il convient de féliciter et de remercier.
Tout en espérant que la navette conduira à l’adoption du texte par l’Assemblée nationale dans des délais relativement courts, je regrette que nous ne soyons pas allés plus loin : l’élargissement proposé des dispositions de l’article 2-19 du code de procédure pénale ne permettra pas aux associations de contraindre le parquet à engager des poursuites
M. le garde des sceaux le conteste.

Si du moins, monsieur le garde des sceaux, vous avez donné des instructions pour que l’accueil des plaignants et les modalités de l’action judiciaire soient améliorés, c’est déjà un pas très important qui est franchi. Je note d’ailleurs que la quasi-totalité des souhaits qui avaient été émis par Philippe Bas dans son rapport a été satisfaite.
C’est donc avec enthousiasme que le groupe Union Centriste votera cette excellente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDSE. – Mme le rapporteur et M. André Reichardt applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre, cosignée par tous les membres du RDSE et inscrite à l’ordre du jour de notre premier espace réservé de l’année, a pour objet de s’attaquer à une réalité malheureusement vécue par un nombre croissant d’élus.
Plus de 1 000 agressions ont été recensées en 2021 contre des personnes titulaires d’un mandat électif, en majorité des maires et des adjoints, probablement parce que, vitrines de notre République, ils sont en première ligne.
Au Sénat, chambre des territoires, ce phénomène d’ampleur croissante est malheureusement bien connu. Chacun d’entre nous peut citer le cas d’un élu victime d’agression ; pour certains, même, l’histoire est personnelle et le traumatisme vivace.
Je pense, pour ce qui est de mon département, au maire de Lussat, roué de coups, le matin même de l’ouverture du Congrès des maires, par un automobiliste à qui il demandait de rouler moins vite. Je pense aussi à la maire de Valbeleix, qui, lors d’une cérémonie, a reçu des menaces de mort pour une histoire de conflit de voisinage, ou à deux autres maires du département, qui ont vu leur maison personnelle taguée d’insultes et de menaces et leur famille plongée dans un état de stress et d’insécurité intolérable.
Il n’est pas un jour sans que celles et ceux sur qui repose le bon fonctionnement de nos institutions subissent une défiance qui s’exprime trop souvent par la violence. Dans certaines communes, il n’est même plus rare que tel ou tel membre de la famille d’un élu fasse lui aussi l’objet d’incivilités, de menaces et de violences, du simple fait d’être son conjoint ou sa conjointe, son fils, sa fille, son père ou sa mère.
Il semble que l’on ait enfin pris la mesure de la dégradation des conditions d’exercice des mandats. Le constat est unanime, et certaines dispositions ont même été adoptées en conséquence. Mais la réalité demeure inacceptable et appelle à des actions supplémentaires.
La proposition de loi de Nathalie Delattre prévoit ainsi de répondre à une demande de l’Association des maires de France, qui souhaite étendre la possibilité, déjà accordée à ses antennes départementales, de se constituer partie civile au pénal pour soutenir, avec l’accord de celui-ci, un élu victime d’agression. Le champ des infractions concernées serait également étendu, afin de mieux prendre en compte la diversité des situations vécues sur le terrain.
Rappelons que, d’après la consultation lancée par le Sénat en 2019, les agressions d’élus sont très peu nombreuses à faire l’objet d’une plainte, et encore moins nombreuses à donner lieu à une condamnation. Le manque d’accompagnement est un frein majeur identifié par les élus, notamment dans les plus petites communes.
Les associations d’élus, qui disposent de l’expertise et des ressources nécessaires, semblent bel et bien les mieux placées pour épauler ceux qui souhaitent porter plainte et exercer tous les droits reconnus à la partie civile du point de vue de l’accès au dossier et du soutien global apporté à la victime.
Il semble donc justifié d’étendre le champ de cette possibilité, pour donner plus de poids aux procédures enclenchées, pour permettre à l’AMF de recouvrer les sommes engagées dans le cadre de la défense des élus agressés et pour inciter les autres associations d’élus à mettre en place des accompagnements ciblés analogues.
Faisant le constat que le service public s’apparente, pour une part croissante de la population, à un simple bien de consommation courante, j’avais souhaité renforcer la législation en déposant, en 2019, une proposition de loi visant à lutter contre les incivilités, menaces et violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public.
Je déclinerai une partie des mesures de ce texte au travers de trois amendements, dont l’adoption pourrait utilement compléter les dispositions dont nous débattons ce soir.
L’absence d’action forte face à de telles situations accroît évidemment le sentiment d’abandon et de découragement que ressentent les élus, notamment en zone rurale, où la réponse est insuffisante en matière de constatation des infractions, de conduite des enquêtes, de durée des procédures et de délai de rendu des décisions.
Les débats qui vont suivre nous permettront, je l’espère, d’améliorer la situation de ceux qui sont dans l’attente légitime d’une solution.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – MM. Joël Guerriau et Guy Benarroche applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, comment commencer cette intervention sans remercier très chaleureusement notre collègue Nathalie Delattre d’avoir pris l’initiative de cette proposition de loi ?
Ce texte s’inscrit dans la continuité de diverses initiatives adoptées dans le passé, notamment par le Sénat, lesquelles ont considérablement renforcé la protection des élus en cas d’agression. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler que l’article 2-19 du code de procédure pénale, dont la proposition de loi vise à prévoir une nouvelle rédaction du premier alinéa, est issu d’un amendement sénatorial voté dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.
Toutefois, dans le contexte actuel d’augmentation des agressions contre les maires et plus généralement contre les élus, la proposition de loi de Nathalie Delattre est venue judicieusement « boucher les trous dans la raquette », comme on dit.
Dans sa version initiale, d’une part, elle a étendu la possibilité de se porter partie civile en cas d’agression d’un élu local à trois associations nationales représentant les différents niveaux de collectivités territoriales – l’AMF, l’ADF et Régions de France –, et, d’autre part et surtout, elle a élargi les motifs pour lesquels ces associations pourront désormais se porter partie civile.
Ainsi, aux cas d’injures, d’outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures déjà visés par le code de procédure pénale s’ajouteront judicieusement les destructions, dégradations ou détériorations de biens et la divulgation d’informations dans le but de nuire à une personne, exposant cette dernière à un risque.
En outre, ces infractions seraient prises en compte non plus seulement lorsqu’elles visent des élus investis d’une fonction exécutive, mais également lorsqu’elles concernent des membres de conseils municipaux ou de conseils départementaux et régionaux. Elles pourront même concerner non seulement l’élu lui-même, mais également un membre de sa famille, lorsque c’est en fait l’élu qui est visé en raison de son mandat ou de sa fonction.
On le voit, mes chers collègues, ces élargissements paraissaient bienvenus, car ils sont particulièrement circonscrits et cohérents. On aurait d’ailleurs pu s’arrêter là, mais la commission des lois en a décidé autrement, en enrichissant tout d’abord le texte par des amendements de nos collègues Patrick Kanner et Stéphane Le Rudulier.
M. Kanner a en effet souhaité étendre les infractions au titre desquelles la constitution de partie civile est possible, en prenant également en compte les actes d’intimidation et de harcèlement, les violations de domicile et les atteintes volontaires à la vie. Quant à M. Le Rudulier, il a souhaité permettre aux assemblées parlementaires et aux collectivités territoriales de se porter également partie civile en cas d’agression de leurs membres ou de leurs proches. Désormais, les trous dans la raquette paraissent bel et bien bouchés.
Pour autant, nous étions quelques-uns au sein de la commission des lois à nous demander pourquoi cette possibilité de se porter partie civile n’avait été élargie qu’aux seules trois associations nationales citées.
D’autres associations nationales ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des élus auraient également pu intervenir légitimement à cet égard. Il n’y avait d’ailleurs aucun risque particulier à élargir de la sorte le champ des parties civiles, aucune procédure ne pouvant être engagée sans l’accord de la victime : le nouvel article 2-19 du code de procédure pénale, pas plus que l’ancien, ne permettra aux associations de contraindre le parquet à engager des poursuites.
Lors de sa réunion d’aujourd’hui, avec l’accord de l’auteur de la proposition de loi et après concertation avec le Gouvernement, la commission a décidé de faire droit à cette sollicitation et de proposer un texte qui, à mon sens, peut largement faire consensus dans cet hémicycle.
Pour ma part, je le voterai avec enthousiasme, en saluant tout particulièrement la coconstruction qui a présidé à son élaboration.
M. le garde des sceaux opine.

Je formulerai, enfin, un dernier vœu : je souhaite que ce texte contribue, à terme, au moins un peu, à réduire, voire à supprimer les intolérables agressions dont les élus sont victimes dans notre pays.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et RDSE.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, je ne puis m’empêcher à mon tour, à titre liminaire, de rappeler à cette tribune le dévouement inlassable des élus locaux, notamment des élus municipaux, qui sont au service de nos concitoyens et qui assurent le bon fonctionnement de nos territoires.
Synonyme d’écoute et de proximité, l’élu local, en œuvrant dans l’intérêt général, fait vivre la démocratie au quotidien. Il agit pour la République avec courage et loyauté. Or, depuis plusieurs années déjà, sur l’ensemble de notre territoire, nous constatons une multiplication des atteintes physiques ou verbales auxquelles les élus locaux sont confrontés dans l’exercice de leur mandat. Selon moi, la moindre attaque doit être prise en considération.
Pour illustrer mes propos, je citerai une affaire récente, qui a eu lieu dans mon département. M. Bruno Debray, maire de Sion-les-Mines, une commune de moins de 2 000 habitants, a été interpellé par une habitante lui signalant l’agression d’un petit chien attaché à une poussette par deux gros chiens. Sans une intervention rapide, la situation aurait pu être dramatique.
Le maire rencontre le lendemain la propriétaire des chiens, pour lui demander très poliment de bien vouloir tenir à l’avenir ses animaux en laisse. Que n’avait-il pas fait ! Averti de cette demande, le mari furieux se rend à la mairie, s’introduit dans le bureau du maire et l’insulte. Le maire, bien évidemment, porte plainte, mais l’affaire est jugée sans suite. Quelque temps plus tard, le même individu agresse la coiffeuse de la commune pour se faire rembourser une coupe de cheveux jugée non réussie sur ses enfants. Que peut bien faire le maire ? Isolé, il se sent impuissant dans l’exercice de son mandat et dans sa capacité à faire respecter son autorité. Voilà pourquoi aucun des incidents venant affaiblir l’autorité du maire ne doit être traité à la légère !
Bien sûr, nous gardons tous ici en mémoire, comme l’a rappelé Nathalie Goulet, la tragédie de Signes, en août 2019, dans laquelle le maire, Jean-Mathieu Michel, a brutalement perdu la vie, renversé par une camionnette alors qu’il venait empêcher un dépôt sauvage de gravats.
Face à la recrudescence de ces agissements d’individus défiant l’autorité de la puissance publique, agissements que notre République ne saurait tolérer, nous devons mieux soutenir les élus locaux.
C’est pourquoi l’initiative de notre collègue Nathalie Delattre est la bienvenue. Elle offre la possibilité aux différentes associations nationales d’élus de se constituer partie civile pour accompagner, au pénal, tout édile qui aurait donné préalablement son accord en cas d’agression ou de harcèlement, mais aussi en cas d’infraction, d’exposition délibérée à un risque grave par révélation d’informations privées, de dégradation d’un de ses biens ou lorsque la victime est l’un de ses proches.
En Loire-Atlantique, la maire de Vue est régulièrement harcelée en public devant son conseil municipal par l’ancien maire de la commune ; c’est un cas que nous n’arrivons pas à régler. Peut-être y parviendrons-nous à présent.
Cette initiative est également pertinente, car elle s’attache à mentionner expressément que les associations d’élus peuvent accompagner tous les élus victimes, même ceux qui ne sont pas investis de fonctions particulières.
Des apports opportuns ont permis d’enrichir la proposition de loi lors de son examen en commission. Je me réjouis ainsi que la liste des infractions au titre desquelles la constitution de partie civile est possible ait pu être élargie aux actes d’intimidation, de harcèlement et de violation de domicile, ainsi qu’aux atteintes volontaires à la vie avec l’accord des ayants droit de la victime.
Je me félicite également de la possibilité qui a été donnée aux assemblées parlementaires et aux collectivités territoriales de se porter partie civile en cas d’agression d’un de leurs membres ou de ses proches.

Monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, tous nos élus, dont la mission est de servir le citoyen et d’agir pour la République, méritent d’être mieux soutenus en cas d’agression grâce à l’engagement d’une procédure pénale, afin que justice leur soit rendue. Tel est l’objectif de cette proposition de loi.
C’est pourquoi le groupe Les Indépendants – République et Territoires la votera à l’unanimité.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – Mme Lana Tetuanui applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, il n’aura échappé à personne que notre société se polarise, que les tensions se sont exacerbées et que les élus font fréquemment l’objet d’une colère souvent mal placée et de violences toujours injustifiées.
Selon les chiffres du ministère de l’intérieur publiés en janvier 2021, les violences physiques contre les élus ont augmenté de 47 % sur les onze premiers mois de 2021 : quelque 1 180 élus sont concernés, dont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints. Si les maires restent les élus préférés de nos concitoyens, ancrés dans la réalité et la connaissance de leurs territoires, ils sont comme le veut, hélas, trop souvent le dicton, « à portée de baffes »…
Encore une fois, ni la frustration de l’incompréhension de décisions personnelles ni la fatigue parfois devant la complexité et la lenteur de certaines administrations ne sauraient justifier une quelconque violence à l’égard des élus de notre pays. Plus de 300 plaintes pour « menaces de mort » ont été déposées et plusieurs sources rapportent une hausse de ces violences. Ces élus, qui continuent, malgré les difficultés – c’est une litote –, à se mettre au service des autres méritent une protection.
Certes, de récents textes ont déjà accru cette protection. La présente proposition de loi s’inscrit dans cette démarche, et c’est heureux. Mais permettez-moi quelques remarques. Ce n’est pas le premier texte qui m’interroge sur la volonté d’ultraspécialisation selon les victimes. C’est peut-être naïf de ma part, mais il est important de le répéter : l’égalité devant la loi et la perception de l’égalité devant la loi sont le fondement de notre société démocratique.
Je ne reviens pas sur le besoin de condamner les agressions de manière spécifique pour les représentants des citoyens, les représentants de l’État, les personnes chargées d’une mission de service public, mais j’aurais du mal à justifier auprès de nos concitoyens et même de nos électeurs que l’agression de la famille d’un élu doive recevoir une sanction plus sévère que celle de toute autre famille.

Je ne vous ferai même pas l’offense de souligner l’impraticabilité de cette notion de « famille », dont la définition légale pourrait poser des problèmes, par exemple en termes d’égalité, entre les édiles mariés, en concubinage non déclaré, avec des enfants, enfants de conjoints, etc.
L’amendement déposé par Mme le rapporteur de la commission des lois ne tend pas à arranger les choses en ajoutant la notion de « personne vivant habituellement à son domicile ». Pardonnez cet exemple trivial, mais seraient alors concernés la nounou de la concubine du neveu hébergé ou le jardinier à demeure de la belle-mère du concubin de sa fille !
Sourires.

Nous comprenons et entendons le sentiment de lassitude des élus agressés, qui demandent plus de sévérité, mais la solution ne se trouve pas forcément dans l’aggravation des délits sanctionnés de manière plus importante ou dans l’extension d’une « plus grande protection » aux personnes relevant de la sphère privée des élus.
L’insuffisance des moyens humains et matériels de la justice, responsable souvent de sa lenteur, reste structurelle et profonde. Elle appelle un accroissement substantiel des budgets : il s’agit d’augmenter le nombre de magistrats et de greffiers pour pallier ces dysfonctionnements.
Pour autant, nous accueillons favorablement l’idée d’élargir la protection à l’ensemble des élus. Il est aussi essentiel de mieux accompagner les élus, et nous partageons la pertinence de la constitution comme partie civile des associations d’élus. Leur intérêt à agir est déjà reconnu au niveau de leurs filiales locales ; il apparaît opportun d’élargir cette action aux associations nationales.
Nous défendrons deux amendements, l’un afin de mieux prendre en compte les outrages sexistes, l’autre pour élargir la possibilité de se constituer partie civile au-delà des grandes associations nationales comme l’Association des maires de France. Ce dernier désir semble partagé sur plusieurs travées, puisque de nombreux amendements ont été déposés en ce sens.
L’idée d’un monopole de l’accompagnement ou de l’intérêt à agir nous paraît problématique, sans déjuger la qualité de l’AMF.
Voilà, mes chers collègues, notre sentiment profond et nos inquiétudes réelles sur un sujet essentiel, mais dont tout débordement s’apparentant à une volonté de justice corporatiste serait nuisible et contre-productive dans l’ambition d’une meilleure protection des élus.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Guylène Pantel et M. Henri Cabanel applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, en septembre 2021, l’hôtel de ville de Koungou dans mon département a été la cible d’un incendie volontaire après des manifestations contre la destruction d’un bidonville.
Un mois plus tard, les véhicules du maire d’Ouangani, de sa femme et d’un autre élu de la municipalité ont connu le même sort. Plus récemment, le maire de Bandrélé a fait l’objet de plusieurs menaces de mort.
D’après les chiffres du ministère de l’intérieur publiés en janvier 2022, plus de 1 100 élus, majoritairement des maires ou leurs adjoints, ont subi des agressions, et 400 outrages ont été recensés.
Lors du congrès de l’AMF de novembre 2021, le Président de la République rappelait la nécessité d’être « intraitable face au retour et à l’augmentation de la violence » envers les élus et particulièrement les maires, dépositaires de l’autorité publique. Le chef de l’État avait estimé que « la sanction devait être décisive par devoir envers nos élus ».
La proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre, que nous examinons aujourd’hui, s’inscrit dans cet état d’esprit, en apportant une réponse à une demande de l’AMF de se porter partie civile lors d’agressions d’élus. Initialement composée d’un article unique, elle a été enrichie lors de son examen par notre commission des lois.
Ainsi, les principales associations nationales d’élus – AMF, AMRF, ADF et Régions de France – pourront se constituer partie civile pour accompagner, au pénal, tout édile de l’Hexagone et des outre-mer qui aurait donné préalablement son accord, notamment en cas de dégradation d’un de ses biens, d’agression, d’acte d’intimidation, de harcèlement et de violation de domicile. Ses proches pourront également en bénéficier.
Je me permets de saluer la rédaction de compromis qui a été trouvée sur l’article 1er entre notre rapporteur et le Gouvernement.
En outre, la divulgation d’informations dans le but de nuire à une personne, adoptée dans le cadre de la loi confortant le respect des principes de la République, constituera une infraction.
Les assemblées parlementaires, les collectivités territoriales et le Parlement européen auront la possibilité de se porter partie civile en cas d’agression de l’un de leurs membres ou de ses proches.
Enfin, grâce au travail réalisé par notre rapporteur, ce texte s’appliquera en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Le présent texte viendra étoffer les actions d’ores et déjà menées par le Gouvernement, notamment par le ministère de la justice, avec la direction des affaires criminelles et des grâces, ainsi que par le ministère chargé des collectivités territoriales.
Je pense à la circulaire du 7 septembre 2020 adressée aux parquets mettant en œuvre une politique pénale ferme, ou encore à celle du 15 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de la justice de proximité pénale, pour une justice plus proche des partenaires locaux.
Je pense également à l’article 104 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui est venu renforcer la protection juridique et la formation des élus locaux face aux violences et aux incivilités.
Enfin, je salue l’initiative du Sénat de mettre en place une formation organisée par la direction générale de la police nationale (DGPN) sur la sensibilisation des sénateurs à la gestion des comportements agressifs et à la désescalade des conflits. En tant que vigies des territoires, nous pourrons, grâce à cela, accompagner et aider nos élus face aux agressions.
Les élus de la République doivent être protégés dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur vie privée. Nous devons les accompagner et renforcer la réponse pénale.
C’est pourquoi le groupe RDPI votera en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a pour objectif de soutenir les élus dans les démarches judiciaires qu’ils peuvent engager à la suite de violences commises contre eux. Elle permettra aux associations d’élus de les accompagner dans ces démarches au pénal.
On ne peut que saluer cette initiative portée par notre collègue Nathalie Delattre, car les élus sont très régulièrement la cible d’attaques, dont la violence s’intensifie d’année en d’année.
Je pense ici particulièrement aux maires, qui semblent être au centre de nombreuses revendications de nos concitoyens et qui représentent la grande majorité des victimes. Je ne puis que citer à mon tour la terrible attaque commise contre le maire de Signes, mortellement renversé par un véhicule, qui nous a tous marqués.
La violence dont les élus municipaux font l’objet peut s’expliquer par leur rôle de premier plan dans la vie des Français : ils exercent des responsabilités et prennent des décisions pas toujours populaires, qui affectent directement le quotidien de leurs administrés, et leur visibilité les rend facilement identifiables. Comme l’un de mes collègues l’a souligné à juste titre, ils sont « à portée de baffes ».
Dès lors, ils cristallisent les critiques, les revendications et peuvent faire l’objet, dans les cas les plus graves, d’agressions. Ces actes, nous devons les condamner, tous sans exception, car la violence n’est jamais la solution. Pour cela, la justice doit être saisie, mais les élus ont besoin de soutien, de moyens et de ressources. Certaines associations d’élus possèdent ces ressources et peuvent apporter un accompagnement bienvenu en pareilles circonstances.
La rédaction initiale de cette proposition de loi prévoyait que seules l’AMF, l’ADF et Régions de France pouvaient se constituer partie civile. Je reconnais évidemment le travail de ces trois grandes associations, mais il me semble que chaque élu doit pouvoir se faire représenter par l’association qu’il juge la plus adaptée pour défendre ses intérêts. J’ai donc déposé un amendement en commission pour élargir le champ des associations concernées à toutes celles qui le prévoient et qui sont régulièrement enregistrées, mais il a été rejeté.
Peut-être ai-je eu raison trop tôt ? Une semaine plus tard, le Gouvernement semble avoir entendu mon appel et a souhaité que Mme le rapporteur dépose un amendement dont les dispositions vont dans le même sens que le mien. Nous en discuterons tout à l’heure, mais je m’en réjouis !
Le champ des infractions visées doit être le plus large possible, car nos élus sont la cible d’attaques physiques contre leurs biens ou à leur encontre directe, mais aussi d’attaques verbales. Un amendement a été intégré en ce sens dans la proposition de loi, ce que je salue.
Mes chers collègues, un point d’actualité nous a tous marqués, voire choqués, me semble-t-il. L’exemple de Louis Boyard, député de La France insoumise insulté par Cyril Hanouna, est le dernier en date, mais il est ô combien révélateur de la « vulgarisation » de notre audiovisuel.
Murmures sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE.

L’escalade d’absurdités et de violence à laquelle nous avons assisté lors de cette séquence n’a existé que pour répondre à cette soif de la petite phrase qui fait le buzz, ce qui n’est digne ni de la classe politique ni de la classe journalistique.

Je ne puis que regretter que tout soit érigé en polémique pour que l’on en parle. À ce petit jeu, auquel les politiques ne devraient pas se prêter, …

… les gagnants sont toujours les mêmes : ce sont les extrêmes.
Notre discussion du jour porte sur une proposition d’amélioration de l’accompagnement des élus lorsqu’ils décident d’engager des poursuites contre les auteurs de l’agression. On ne peut qu’y souscrire. D’ailleurs, le calendrier nous y invite : quelle belle occasion à une semaine du Congrès des maires !
Les élus locaux jouent un rôle essentiel dans notre pays, ils sont actuellement plus de 500 000 à exercer un mandat local, à nous représenter et à défendre l’intérêt général au travers de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques publiques, lorsqu’on leur en donne les moyens.
J’ouvre ici une parenthèse qui devrait faire consensus : les élus locaux, particulièrement les maires, se sentent actuellement fragilisés dans l’exercice de leur mandat, car on leur en demande toujours plus avec toujours moins de moyens. Ils sont inquiets de l’augmentation de leurs charges fixes du fait de l’inflation. Ils sont préoccupés par la suppression de certaines dotations.
Dans le cadre du projet de loi de finances, nous pourrons bientôt répondre à leurs légitimes inquiétudes. Il faut des recettes pour que les budgets d’investissement et de fonctionnement puissent exister, afin, notamment, de mettre en place les projets souhaités par nos concitoyens. Lorsque les élus ne peuvent agir, cela participe de la fragilisation de leur image. Je le dis au Gouvernement : il existe une grande inquiétude, qui s’exprimera à l’occasion du Congrès des maires de France.
Mes chers collègues, l’action des élus locaux irrigue l’ensemble de notre vie quotidienne. Elle doit être respectée. Sans élu, aucune organisation de notre société n’est possible. En cas de violence, il faut mettre à leur disposition toutes les ressources qui pourraient les aider dans la défense de leurs intérêts.
Vous l’aurez compris, mon groupe votera cette proposition de loi, enrichie par nos débats à venir.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est présentée vise à permettre aux différentes associations nationales d’élus de se constituer partie civile pour accompagner, au pénal, tout édile qui aurait donné préalablement son accord.
Les élus, plus spécifiquement les élus locaux, sont les premiers contacts de nos concitoyens avec l’autorité publique.
Aujourd’hui, l’article 2-19 du code de procédure pénale n’autorise l’action des associations qu’en cas de faits commis contre l’élu « à raison de ses fonctions » particulières, et non de son mandat. La proposition de loi que nous examinons est sur ce point utile et égalitaire. En effet, grâce à son apport, les associations d’élus pourront accompagner tous les élus victimes de harcèlement ou d’agression, même ceux qui ne sont pas investis de fonctions particulières. C’est en cela qu’elle nous semble pertinente.
Néanmoins, nous ne pouvons l’ignorer, le climat politique, économique et social actuel est tendu. Notre société va mal ; de plus en plus d’hommes et de femmes sont inquiets et en colère contre les responsables politiques. Dans ce contexte, nous ne pouvons faire l’autruche. Un élu incarne des idées, des prises de position, des revendications. Nous sommes dans une démocratie, et il est tout à fait sain de ne pas faire l’unanimité.
Pour autant, cette nécessaire opposition dans le débat d’idées ne doit pas justifier une attaque personnelle, physique ou verbale. C’est bien parce qu’un mandat expose personnellement l’élu que cette proposition de loi est à notre sens objective.
Si la qualité d’élu est depuis longtemps une circonstance aggravante pour plusieurs infractions, il convient également de se soucier de l’accompagnement des élus victimes tout au long d’une procédure devant le juge pénal.
Cet accompagnement ne sera pas exorbitant du droit commun, nos concitoyens victimes pouvant également être soutenus dans leurs procédures pénales par des associations à but non lucratif. Il est donc adéquat, pour répondre à cette attente d’accompagnement, d’étendre le champ des associations susceptibles de se constituer partie civile.
Au-delà du soutien à l’élu lui-même, nous considérons qu’une telle action participe de la lutte en faveur d’un exercice serein des mandats locaux, donc au bon fonctionnement des assemblées locales. Un élu ne doit pas craindre pour sa personne dans l’exercice de son mandat. Le risque d’une agression ne doit pas être dissuasif dans l’expression de ses opinions politiques ; à défaut, l’existence même de la démocratie pourrait être compromise.
En droit pénal général, le fait qu’une personne chargée d’une mission de service public, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit victime d’une infraction constitue une circonstance aggravante pour la majorité des infractions contre les personnes. Cette aggravation des peines permet une réponse pénale satisfaisante en cas d’agression.
Aujourd’hui, le propos est celui non pas de l’efficacité de la justice, mais de l’accompagnement de l’élu, qui, en tant que personne, peut être traumatisé à la suite d’une agression. Or aucun citoyen ne doit être isolé dans une procédure pénale qui pourrait le dépasser. L’enjeu sous-jacent est de garantir le droit des élus à la liberté d’expression.
L’exercice de nos mandats ne saurait être un motif de crainte. Le débat politique ne doit pas être vecteur de violence. L’art du débat doit être respecté en toute décence.
Permettre aux associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression est utile à un exercice serein des mandats électoraux. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les tr avées des groupes CRCE et RDSE. – M. Bernard Buis applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, mon propos sera redondant, mais, si cela va sans dire, cela va encore mieux en le martelant…
La proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre visant à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression a donc été inscrite à notre ordre du jour, et c’est tout à fait heureux.
Au travers de cette inscription à l’ordre du jour, nous voulons tous ici redire notre mobilisation sur le sujet. En effet, en tant que représentants des élus locaux, nous sommes les témoins des violences que peuvent subir au quotidien les maires et les élus de nos territoires. Puisque les orateurs précédents ont fait état de leur liste, voici la mienne : dans les communes de Lapalud, Oppède, Caderousse, Vaugines, Castellet-en-Luberon et Sainte-Cécile-les-Vignes, des élus ont été récemment victimes d’agressions. Mais cette liste pourrait être plus longue si l’on y intégrait les affaires passées.
Aujourd’hui, les agressions sont d’une violence inouïe : injures, menaces de mort, agressions physiques. Elles sont de plus en plus fréquentes et touchent l’ensemble des communes, quelles que soient leur taille et celle du territoire où elles se trouvent. Il y a des agressions physiques, mais aussi – on n’y insistera jamais assez – celles que l’on subit sur les réseaux sociaux, où l’on se fait souvent agresser via de faux profils, lesquels viennent parfois de l’étranger. On peut véritablement parler de « cyberharcèlement des élus ».
Dans son rapport de 2019, Philippe Bas avait très bien mis en lumière cette situation. Les élus attendent donc que nous posions des actes forts et immédiats, surtout si nous souhaitons qu’il y ait encore des candidats lors des prochaines élections municipales…
Force est de constater que le dépôt de plainte à la suite d’une agression est loin d’être systématique, particulièrement dans les petites communes, ce qui traduit une véritable autocensure, le souci de ne pas envenimer les choses, la volonté de privilégier le dialogue et, de manière plus préoccupante, la peur de représailles ou le sentiment que le dépôt de plainte est trop rarement suivi d’effets.
Trop souvent encore, les maires et les élus se sentent seuls face à ces agressions. Ils préfèrent se taire et faire comme si cela n’était jamais arrivé, en espérant ainsi oublier le traumatisme.
Or nous sommes tous ici collectivement convaincus qu’il ne faut rien laisser passer et que le dépôt de plainte doit être systématique. Ces édiles, corvéables à merci dans leurs communes, méritent d’être davantage soutenus lors de l’engagement d’une procédure pénale, pour que justice leur soit rendue. Les associations d’élus, y compris celles des élus ruraux, semblent être les mieux placées pour leur apporter ce soutien.
Par conséquent, l’adoption de cette proposition de loi permettant aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile constituera un signe fort envoyé à tous les élus du territoire. Nous avançons, peu à peu.
Vous-même, monsieur le garde des sceaux, publiez des circulaires invitant notamment les parquets à mettre en œuvre une politique pénale ferme et diligente pour réprimer les actes commis à l’encontre des élus locaux, ainsi qu’un suivi judiciaire et un renforcement des procédures pénales. Il faudra aussi que les juges s’approprient et intériorisent tous ces textes et s’habituent à voir des élus dans les salles d’audience.
Je vous remercie, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, de prendre à bras-le-corps ce sujet. Nous serons à vos côtés pour défendre la République !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE et RDPI. – M. Jérôme Durain applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, « à portée de baffe », tels sont les mots que répète souvent mon maire, Jean Leonetti, au sujet des élus. Si j’ai souhaité intervenir sur ce sujet, comme vous tous ici présents, c’est pour dire tout haut ce que certains avouent tout bas !
En cette année 2022, ce sont 956 élus qui ont été pris pour cible en France entre le 1er janvier et le 9 mai, soit en moins de six mois. Combien seront-ils à la fin de l’année ?
Ces chiffres sont en nette augmentation, puisqu’ils sont déjà aussi élevés que ceux de 2021, année où l’on enregistrait déjà une hausse de 40 % des violences envers les élus par rapport à 2020. À cette époque – faut-il le rappeler ? –, nos collectivités territoriales et nos élus locaux étaient plus que jamais mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire. Pourtant, paradoxalement, pas moins de 80 % des victimes sont des élus municipaux. Ce pourcentage invite à la réflexion, puisque les maires restent les élus en qui les Français ont le plus confiance.
La proximité physique ne doit pas ouvrir un quelconque droit à la violence gratuite. Chaque intimidation vise, en tout état de cause, à ce que les élus ne se sentent plus libres d’agir en leur âme et conscience.
Ces chiffres doivent nous alerter collectivement : nous, parlementaires, ainsi que le Gouvernement et l’ensemble des Français.
La forte recrudescence de la violence envers les édiles est actée, obligeant l’AMF à créer, en octobre 2020, un observatoire des agressions envers les élus. Mais il y a plus alarmant : l’AMF a formé récemment 15 000 maires et adjoints, avec l’aide des formateurs du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), à la gestion des menaces et des situations de crise. Quand un maire reçoit une formation du GIGN ou du Raid, cela veut dire que le pays ne va pas très bien !
L’excellent rapport d’information de notre collègue Philippe Bas…

… mettait d’ores et déjà cette triste réalité en lumière : un faible niveau de plaintes, associé à un très faible niveau de condamnations.
Cette violence progresse, plus globalement, à l’encontre de l’ensemble des détenteurs de l’autorité en France. Ce dénigrement de l’autorité est au demeurant très inquiétant, l’abstention électorale étant à mon sens l’une des manifestations de cette crise civique des plus criantes.
Si cette violence est difficile à comprendre, elle est – c’est certain – impossible à tolérer.
Il y a pis encore : c’est souvent par pudeur, mais aussi par peur de voir les menaces s’intensifier, que certains élus préfèrent se taire sur le fait que leur permanence a une nouvelle fois été vandalisée, sur l’énième insulte reçue en pleine rue, sur la violence graduelle de ceux qu’ils servent au quotidien. Enfin, ils se taisent pour ne pas déranger, pour ne pas être pointés du doigt et stigmatisés.
Un drame est toujours possible, nous le savons. Aussi, ne banalisons pas ces incivilités qui peuvent conduire au pire ! C’est pourquoi je soutiens ce texte défendu par notre collègue Nathalie Delattre, qui vise à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour accompagner au pénal tout édile qui aurait donné préalablement son accord.
Enrichi par le travail de la commission des lois, cette proposition de loi répond aux attentes des élus victimes de harcèlement ou d’agression, qui méritent d’être mieux soutenus, pour que justice leur soit rendue !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et RDSE.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
L’article 2-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Association des maires de France et toute association départementale des maires qui lui est affiliée dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans toute instance introduite par un élu municipal pour injure, outrage, diffamation, menace ou acte d’intimidation, violences, harcèlement, exposition à un risque dans les conditions prévues à l’article 223-1-1 du code pénal, destructions, dégradations ou détériorations de bien, violation de domicile commis, en raison de ses fonctions ou de son mandat, à son encontre ou à l’encontre d’un membre de sa famille. L’Assemblée des Départements de France peut exercer ces mêmes droits pour les élus départementaux et Régions de France pour les élus régionaux, territoriaux et de l’Assemblée de Corse. » ;
1° bis
« Les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteinte volontaire à la vie d’un élu commise en raison de ses fonctions ou de son mandat. » ;
1° ter
2° Au dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ».

Je suis saisie de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 19 est présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.
L’amendement n° 23 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’infractions prévues par les livres II ou III du code pénal ou par le chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et avec l’accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit :
« 1° Pour les élus municipaux, l’Association des maires de France, toute association nationale, reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;
« 2° Pour les élus départementaux, l’Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale, reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
« 3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l’Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale, reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
« 4° Au titre d’un de ses membres, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.
« Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l’élu ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l’élu ou de son mandat. » ;
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 19.

Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er.
Issu du dialogue mené avec le Gouvernement, cette proposition de loi tend à permettre à toutes les associations d’élus bénéficiant d’une ancienneté suffisante de se porter partie civile, tout en reconnaissant le rôle et l’implication de l’AMF dans la défense des élus municipaux. Ce dernier point n’était pas tout à fait perceptible, monsieur Kanner, dans l’amendement que vous aviez présenté en commission, puisque vous y faisiez fi, alors, de cette association.
Cette rédaction paraît cohérente avec l’intention de l’auteure de la proposition de loi. Elle respecte l’esprit initial de ce texte, ce qui compte beaucoup pour moi, tout autant que l’intention des auteurs des amendements adoptés en commission sur l’article 1er.
Par ailleurs, la commission a accepté d’inclure le Parlement européen – en l’occurrence, les députés européens de nationalité française et les députés étrangers victimes d’une agression en France – parmi les assemblées susceptibles de se porter partie civile lorsque l’un de leurs membres est agressé.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 23.
Je ne surprendrai personne en disant que je suis totalement en phase avec Mme le rapporteur.
Ces deux amendements identiques visent aussi à rappeler qu’il était constitutionnellement risqué de permettre à une seule association de se constituer partie civile. Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause ce que l’AMF représente pour de nombreux élus ; personne n’a l’intention de la malmener, mais ne pas considérer les autres associations revenait, j’y insiste, à prendre un véritable risque constitutionnel.
Ces amendements identiques ont par ailleurs le mérite d’harmoniser et d’étendre le champ des infractions dont les élus sont victimes.

L’amendement n° 4, présenté par MM. Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
L’Association des maires de France et toute association départementale des maires qui lui est affiliée dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans peuvent
par les mots :
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre et représenter les intérêts matériels et moraux des élus locaux peut
et le mot :
municipal
par le mot :
local
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Patrick Kanner.

Nous savons, comme les collègues qui présentent les amendements suivants faisant l’objet de cette discussion commune, que l’adoption des amendements identiques n° 19 et 23 aurait pour conséquence de faire tomber tous les autres. Nous avons donc bien compris la démarche engagée, laquelle, quoi qu’en dise Mme le rapporteur, va dans notre sens.
Il est vrai que l’amendement que j’avais porté au nom de mon groupe ne mentionnait aucune association, car nous estimions que les associations dûment déclarées et ayant plus de cinq années d’existence pouvaient légitimement revendiquer la possibilité de défendre leurs élus, quels qu’ils soient.
L’AMF, l’ADF et Régions de France sont encore mentionnées dans l’amendement de Mme le rapporteur, sans qu’il soit fait mention des autres associations. Nous pensions, pour notre part, qu’il aurait été plus simple de faire référence à toutes les associations d’élus, même si, je le sais, tel n’était pas tout à fait le sens du texte initial de Mme Delattre. Cette simplification aurait permis d’éviter toute forme de concurrence entre les secteurs associatifs, à laquelle nous allons, de fait, contribuer.
Pour autant, nous adopterons l’amendement présenté par Mme Di Folco : ses dispositions nous semblent aller globalement dans la direction que nous souhaitions indiquer lorsque nous avons présenté notre amendement en commission.

Les dix amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 5 rectifié bis est présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet et MM. Canévet et Détraigne.
L’amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mme Noël, M. Laménie, Mme Thomas, M. Perrin, Mme Muller-Bronn, MM. Pointereau, Rietmann, Paccaud, Houpert, B. Fournier, Anglars, Bascher, Regnard et Savin, Mmes Richer et Joseph, M. Chatillon, Mmes Drexler, Micouleau et F. Gerbaud, MM. Paul, Joyandet et Pellevat, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Dumont, M. Bouchet, Mme Estrosi Sassone, M. J.B. Blanc, Mme Lopez, M. Belin, Mme Belrhiti, M. Lefèvre et Mme Raimond-Pavero.
L’amendement n° 9 est présenté par M. J.M. Boyer.
L’amendement n° 10 rectifié quater est présenté par M. Mizzon, Mmes Sollogoub et Vérien, M. Maurey, Mme Guidez, M. Kern, Mme N. Goulet, MM. Louault, Bonnecarrère, Laugier, Masson, Bonneau, Calvet et Saury, Mmes Gatel et Saint-Pé, M. Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud, Duffourg, Cigolotti et Frassa et Mmes Dindar, Gacquerre, Herzog et Chain-Larché.
L’amendement n° 11 est présenté par M. Longeot.
L’amendement n° 12 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Wattebled, Guerriau, Decool et Chasseing, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue et A. Marc.
L’amendement n° 14 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 15 est présenté par M. Ravier.
L’amendement n° 16 est présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 18 est présenté par Mme Havet.
Ces dix amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
L’Association des maires de France et toute association départementale des maires qui lui
sont remplacés par les mots :
Les associations nationales représentatives des maires ainsi que toute association départementale qui leur
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.

Le présent amendement vise à étendre à l’Association des maires ruraux de France (AMRF) et aux associations départementales qui lui sont affiliées les droits qui sont ouverts par la présente proposition de loi aux autres associations nationales représentatives d’élus.
Cela dit, je voterai les amendements identiques n° 19 et 23, qui ont pour objet d’élargir cette possibilité à d’autres associations d’élus.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.

L’amendement n° 9 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié quater.

L’amendement n° 11 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Dany Wattebled, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié ter.

Nous soutenons ces amendements identiques à cause des mots suivants, qui figurent au 4° des amendements de la commission et du Gouvernement : « Il en est de même lorsque ces infractions sont commises […] sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile ».
Ces termes vagues et flous peuvent donner lieu à de nombreuses exagérations, voire à des manipulations, nous semble-t-il. En l’absence de ces mots, j’aurais volontiers voté les amendements identiques n° 19 et 23, même s’ils tendent à mentionner ADF et Régions de France.

L’amendement n° 15 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 16.

Nous avons tous évoqué, avec force et sincérité, les expériences que nous vivons dans nos départements et la difficulté d’être élu local. Si nous sommes nombreux à déposer le même amendement, ce n’est pas pour faire durer le plaisir ! En fait, nous devons, en toute humilité, nous garder d’opposer les uns aux autres. L’agression envers un édile, quel qu’il soit – élu local, national ou européen –, est indigne.
Mme le rapporteur propose une formulation qui, je l’espère, fera consensus. Mais nous devons veiller à deux éléments.
Tout d’abord, une agression dont est victime un élu local ne saurait être source d’interprétation et servir à justifier l’existence de telle ou telle structure. Nous devons rester vigilants sur ce point.
Ensuite, si le débat politique a ses forces et ses faiblesses, nous ne devons pas renvoyer devant la justice ce qui relève du débat contradictoire et démocratique, lequel est parfois virulent.

L’amendement n° 6, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
supprimer les mots :
qui lui est affiliée
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

L’amendement n° 13, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
outrage,
insérer les mots :
outrage sexiste,
La parole est à M. Guy Benarroche.

Le présent amendement a pour objet d’inclure l’outrage sexiste, inscrit à l’article 621-1 du code pénal, dans la liste des agressions et violences commises sur les élus pouvant donner droit à la constitution de partie civile des associations nationales d’élus.
Nous visons, au travers de cet amendement, les réflexions sur le physique, la suspicion d’illégitimité et les commentaires haineux liés au genre.
J’ouvre à cet égard une parenthèse. Participant avec les Verts de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à la réunion portant sur le contrat de planification territoriale écologique passé entre la Première ministre et le président du conseil régional, j’ai constaté qu’étaient montés sur scène pour signer ce contrat 19 élus : 17 hommes et 2 femmes. Rien n’est donc réglé, contrairement à ce que l’on entend dire !
Le sexisme perdure en politique, et il est important d’offrir toutes les garanties de protection aux femmes politiques qui subissent ces agressions. Le réseau Élues locales a notamment révélé, en 2021, que plus de 74 % des femmes élues locales subissaient des comportements et des remarques sexistes dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Le cybersexisme à l’encontre des femmes politiques est également en nette augmentation. Elles sont exposées à des formes de violences amplifiées en ligne, en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Ces violences dissuadent des femmes de s’engager durablement en politique. Pour ces raisons, il est nécessaire d’aider les femmes élues qui souhaitent engager des procédures judiciaires. Il faut que les associations nationales d’élus les accompagnent tout au long de leur parcours judiciaire.
Même si cela vous semble redondant, il me semble utile de mentionner clairement l’outrage sexiste.

Mon avis est bien sûr favorable sur l’amendement n° 23 du Gouvernement, identique à celui de la commission : il s’agit d’une coproduction fructueuse.
En ce qui concerne l’amendement n° 4, l’avis de la commission est défavorable, puisqu’il est satisfait par les amendements identiques n° 19 et 23.
Je demande le retrait des amendements identiques n° 5 rectifié bis, 7 rectifié bis, 10 rectifié quater, 12 rectifié ter, 14, 16 et 18, qui seraient satisfaits par nos deux amendements identiques précités.
Je demande également le retrait de l’amendement n° 6, pour la même raison.
S’agissant de l’amendement n° 13 présenté par M. Benarroche, qui vise les outrages sexistes, je rappelle que, au travers de son amendement n° 19, la commission a fait le choix de ne pas établir de liste des infractions, afin que le texte soit le plus large et le plus clair possible. L’inclusion nominale d’une infraction ne nous paraît pas souhaitable. Pourquoi viser les outrages sexistes et pas d’autres formes d’outrage ?
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Je tiens à saluer l’esprit de responsabilité des sénateurs et les synergies qui se sont établies entre le Sénat et le Gouvernement.
Les amendements identiques présentés par Mme le rapporteur et par le Gouvernement ont été rédigés de concert. Notre avis est donc évidemment favorable sur l’amendement n° 19.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 4, présenté par le président Kanner, je précise que la mention de l’AMF ne crée pas de rupture d’égalité, d’autant qu’elle figure dans le code de procédure pénale depuis qu’elle y a été introduite par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.
Notre critère de décision est l’efficacité. L’AMRF pourra-t-elle soutenir les élus victimes en se constituant partie civile ? La réponse est oui.
Je demande donc le retrait de cet amendement, au profit des amendements identiques de la commission et du Gouvernement.
Les sept amendements identiques suivants étant satisfaits par les amendements n° 19 et 23, j’en demande également le retrait, même si je partage la volonté de leurs auteurs d’étendre la possibilité de se constituer partie civile.
Je sollicite enfin le retrait des amendements n° 6, et 13.

Je n’étais pas opposée par principe au fait de mentionner l’ensemble des associations d’élus.
Je souhaite remercier l’AMF, l’ADF et Régions de France, qui ont travaillé avec moi depuis le début sur cette proposition de loi, un texte que nous avons amélioré grâce à Mme le rapporteur et au Gouvernement. Telle est l’utilité des niches parlementaires et du travail approfondi que nous effectuons au sein de nos commissions !
Je salue le travail de coconstruction mené avec le Gouvernement et l’élégance de Mme le rapporteur, qui a bien voulu me demander mon avis, en tant qu’auteure de la proposition de loi, avant de déposer son amendement.
Je suis d’accord avec toutes les améliorations que nous avons apportées, ensemble, quel que soit le groupe du Sénat auquel nous appartenons. J’espère qu’elles seront défendues avec la même force et la même conviction à l’Assemblée nationale, au nom de l’efficacité de la loi et pour que justice soit rendue à nos élus.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter les amendements identiques n° 19 et 23.

Je vais retirer mon amendement n° 4, qui est globalement satisfait par les amendements identiques de la commission et du Gouvernement. Permettez-moi néanmoins de souligner une petite originalité desdits amendements.
La proposition de loi de Mme Nathalie Delattre, sauf erreur de ma part, visait en premier lieu à protéger les élus locaux. Or, au 4° de l’amendement de la commission, cette protection est étendue aux membres du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Parlement européen.
Si vous voulez être efficaces, mes chers collègues, n’oubliez pas les membres de la troisième chambre de la République, le Conseil économique, social et environnemental (Cese), …

… ou les membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui, eux, sont élus !
Étendre la protection prévue dans un texte dont l’objectif initial était de défendre les élus locaux pourra susciter des interrogations. Je tenais à le faire remarquer.
Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.

L’amendement n° 4 est retiré.
La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour explication de vote.

Je souhaite soutenir l’amendement n° 13 de mon collègue Guy Benarroche.
Mes chers collègues, pardonnez-moi pour la violence des propos que je vais citer : il ne s’agit pas de mes mots, ce sont des extraits des messages que je reçois quotidiennement via les réseaux sociaux : « Grosse pute » ; « Pute woke » ; « Retourne à la cuisine, connasse » ; « Retourne sucer de l’enturbanné, connasse islamo-gaucho » ; « Connasse de laïcarde de Lesbos » – vous le voyez, c’est assez équilibré ! – ; « T’as un problème avec la religion chrétienne ? » ; « Ferme ta gueule, écologiste de merde » ; « Les gens comme toi, vous êtes cuits, vos têtes seront sur des piques » ; « Mange-merde que tu es, tu chies là où tu manges » – là, je comprends moins… – ; « Les gens comme moi n’attendent qu’une chose : le signal pour faire la peau aux gens comme toi »…
Vous avez sans doute eu envie de me couper, madame la présidente, et je vous comprends. C’est inacceptable et, comme toutes et tous ici, je considère que ces propos sont intolérables. Pourtant, ce n’est qu’un infime échantillon des insultes et des menaces que je reçois quotidiennement, notamment sur les réseaux sociaux. Et je suis très loin d’être la seule !
Oui, quand on est une femme en politique aujourd’hui, on se fait harceler dès que l’on existe un peu – exagérément, selon certains – dans l’espace public. Cela pose un problème démocratique, parce que cela conduit de nombreuses femmes à s’autocensurer et à disparaître des réseaux sociaux, par peur pour leur vie ou pour se protéger mentalement, et parce que les femmes élues, qui sont déjà minoritaires partout, sont moins visibles et audibles à cause de ces violences.
J’entends très bien que vous considériez l’inscription dans la loi de l’outrage envers un ou une élue comme étant, sur le plan juridique, suffisante. Mais, vous venez de l’entendre, cet outrage est spécifique tant par sa violence et sa fréquence que par sa nature même, qui est d’être le fruit de la domination patriarcale.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Voilà pourquoi je vous demande de voter cet amendement porté par le groupe écologiste, visant à inclure les spécificités de l’outrage sexiste dans la liste des agressions et violences dont vous entendez, au travers de cette proposition de loi, protéger les élus.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, je me rallierai bien entendu à l’avis de Mme le rapporteur de la commission des lois, et retirerai donc l’amendement n° 7 rectifié bis.
Je souhaite néanmoins dire quelques mots de l’amendement n° 13, qu’a présenté M. Benarroche et que l’on peut comprendre.
Le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes est réellement d’actualité, et l’on peut partager ces préoccupations, surtout lorsque l’on est membre, comme moi, de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Pour autant, il y a eu tout de même une évolution au sein des conseils municipaux, départementaux et régionaux : la place des femmes y est importante, tout comme au Sénat, où nous avons des collègues sénatrices de très grande qualité.
Exclamations amusées. – Mmes Françoise Gatel et Nathalie Delattre applaudissent.

Cette évolution est positive, même si, il faut le dire, l’égalité n’est pas encore complète.
Je salue l’initiative de notre collègue Nathalie Delattre, ainsi que le travail de concertation qui a été réalisé sur ce sujet. Beaucoup critiquent les élus, de tous niveaux ; or ceux qui le font parlent bien souvent sans savoir et sans connaître toutes les formes d’agressivité et de violence dont les édiles sont victimes, et qui ont été soulignées.
Le combat permanent et collectif contre les violences mérite d’être respecté et reconnu !
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE.

L’amendement n° 7 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Je vais peut-être casser l’ambiance, mais j’assume… À toujours vouloir détailler et faire des listes à la Prévert, on bascule dans des excès que nous voudrions pourtant empêcher.
M. Philippe Bas approuve.

Je partage votre indignation, ma chère collègue Mélanie Vogel, quant aux propos que vous venez de rapporter. Ces mots relèvent d’une attaque personnelle à l’égard d’une sénatrice. Face à cela, il y a deux solutions.
La première est le combat politique. Quand nous allons au combat, nous donnons des coups et, par conséquent, nous acceptons d’en recevoir.
La seconde est de considérer, ma chère collègue, qu’il s’agit d’une attaque personnelle, injustifiée dans le cadre de l’exercice de votre mandat, et alors il faut porter plainte.
Toutefois, ce ne peut pas être l’un ou l’autre ! Je vous le dis, il n’est pas possible d’alterner, selon ce qui nous arrange, entre dénoncer nos accusateurs et se servir de ceux qui chantent nos louanges.
Oui, il est difficile de faire aujourd’hui de la politique dans une société fracturée, dans laquelle la violence n’a jamais été aussi forte, car nous sommes inévitablement les catalyseurs de cette violence !
Je m’emporte, mais nous vivons toutes et tous des situations similaires. Chacun d’entre nous a un rapport différent aux réseaux sociaux, parce que nous gérons différemment la violence qui peut s’y exercer. Ce que je ressens à un moment donné pourrait être vécu comme un non-événement par un autre.
Les propos que vous rapportez sont violents. Je pourrais aussi vous raconter mon histoire, et vous dire que j’ai davantage souffert en arrivant ici d’avoir été une jeune sénatrice qu’une femme sénatrice… À chacun sa vie !
Sachons raison garder. S’il s’agit d’une attaque personnelle contre un élu, la justice est là, et les associations d’élus doivent être au rendez-vous. En revanche, si cette attaque appartient au champ et au combat politiques, alors l’arène démocratique nous est ouverte : affrontons-nous, menons nos combats et ne renonçons jamais à nos idéaux !
Vifs applaudissements.

Notre débat est extrêmement important, parce que, grâce à Nathalie Delattre, que je remercie, nous revenons sur un sujet qui nous a déjà fort occupés lors de l’examen de la loi Engagement et proximité : l’attaque physique d’élus dans l’exercice ordinaire de leur fonction normale, qui est de porter la voix de la loi. Nous évoquons aussi bien sûr aujourd’hui d’autres violences à l’égard des élus.
Je félicite Cécile Cukierman de son intervention, passionnée, certes, mais très juste. Nous pourrions dresser la liste des mots haineux et insupportables que nous recevons les uns et les autres via les réseaux sociaux et qui ne sont pas acceptables, comme ceux que vous avez évoqués, madame Vogel, même s’ils relèvent d’un autre registre.
Néanmoins, Cécile Cukierman a raison, nous devons nous en tenir au sujet dont nous parlons, celui de l’outrage, qui recouvre l’outrage sexiste, mais également l’outrage racial.

J’aimerais en effet que l’on parle tout autant du second que du premier.
La rédaction générique proposée par Catherine Di Folco apporte une réponse dans laquelle, je le crois, chacun peut se retrouver. Le reste relève du combat politique, et nous pouvons porter plainte pour diffamation.
Ma chère collègue, je compatis à ce que vous vivez. Je le redis, si nous mettions en commun les commentaires que nous recevons sur les réseaux sociaux, nous pourrions faire un florilège de plaisanteries de très mauvais goût ou haineuses. Tout cela relève d’abord, selon moi, de la dérive des réseaux sociaux.
J’aurai un dernier mot pour Patrick Kanner. Mon cher collègue, j’ai beaucoup de respect et d’amitié pour vous, mais je suis en total désaccord avec votre propos sur l’émission de M. Hanouna – je regrette même de prononcer son nom, mais il existe et il fait de la télévision.
J’ai regardé l’émission dont vous avez parlé lors de la discussion générale, et je n’en ai pas la même analyse que vous. Quand on est provocateur et que l’on va chercher les coups, on en reçoit, y compris des coups maladroits ou impardonnables. Je ne pense pas que l’on puisse comparer ce qui s’est passé au cours de cette émission avec ce que le maire de Signes ou d’autres ont vécu : c’est d’une autre nature.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE et Les Républicains.

Je me félicite de la rédaction du nouvel article 3, qui rend applicables aux trois collectivités du Pacifique les dispositions de cette proposition de loi.
En revanche, madame le rapporteur, monsieur le ministre, j’aimerais, pour ma parfaite compréhension, savoir pourquoi, dans vos amendements, vous avez précisé « l’Assemblée de Corse » dans le 3° sur les élus régionaux et territoriaux. Quid des élus de l’Assemblée de Polynésie française, du Congrès de Nouvelle-Calédonie et de l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ?
Madame la sénatrice, je comprends, votre légitime inquiétude sur ce point. Mais nous n’avons pas oublié d’élus. Soyez rassurée, ceux que vous avez cités, qui ne sont pas métropolitains, sont pris en considération dans le texte : aucun élu n’est exclu.

L’ajout a été fait sur la suggestion de Régions de France, car l’Assemblée de Corse est un cas spécifique. La mention « élus territoriaux » recouvre quant à elle justement les élus de vos territoires.
Ne vous faites aucun souci, ma chère collègue : l’énumération est complète. Faites-nous confiance !

L’amendement n° 5 rectifié bis est retiré.
Monsieur Mizzon, l’amendement n° 10 rectifié quater est-il maintenu ?

L’amendement n° 10 rectifié quater est retiré.
Monsieur Wattebled, l’amendement n° 12 rectifié ter est-il maintenu ?

L’amendement n° 12 rectifié ter est retiré.
Monsieur Benarroche, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?

Oui, madame la présidente, je le maintiens, de même que l’amendement n° 13.

Mme Cécile Cukierman. Non, je le retire, madame la présidente. C’est la sagesse sénatoriale !
Sourires.

L’amendement n° 16 est retiré.
Madame Havet, l’amendement n° 18 est-il maintenu ?

L’amendement n° 18 est retiré.
Madame Goulet, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?

L’amendement n° 6 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 19 et 23.
Les amendements sont adoptés.

En conséquence, les amendements n° 14 et 13 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, ».
La parole est à M. Éric Gold.

Nous avons tous partagé le constat suivant lors de la discussion générale : le phénomène des violences à l’égard des élus, qui grandit, est hélas trop bien connu des maires et des personnels municipaux.
Or ils se retrouvent souvent seuls à devoir faire face, d’une part, à un nombre grandissant d’infractions, et, d’autre part, à des agressions, menaces, intimidations, insultes et injures qui les touchent dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions, mais qui affectent également les membres de leur famille.
Pour apporter une réponse à ce problème, j’avais déposé une proposition de loi visant à lutter contre les incivilités, menaces et violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public. Elle avait pour objet de renforcer la réponse pénale en cas d’agression d’élus ou de dépositaires de l’autorité publique.
Les amendements que j’ai déposés visent à compléter la proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre.
Ce premier amendement vise l’article 85 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles une personne peut se constituer partie civile. Nous proposons d’y ajouter une dérogation, pour que les conditions de recevabilité d’une constitution de partie civile, notamment le délai de trois mois, ne s’appliquent pas aux personnes dépositaires de l’autorité publique.
Cette nouvelle disposition permettra aux victimes de faire ouvrir une instruction sans tarder.

Cet amendement tend à prévoir que les agressions contre les élus pourront permettre la constitution immédiate de partie civile.
Je rappelle que, pour toutes les victimes, cette constitution n’est possible qu’en cas de refus d’engager des poursuites ou après trois mois. Des exceptions sont déjà prévues, notamment pour les crimes et les infractions commises lors des élections.
Il ne paraît pas nécessaire d’aller au-delà, au risque de faire des élus des victimes à part, ce qui n’est pas du tout la volonté de l’auteure de la proposition de loi.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Il ne s’agit pas de faire des élus une catégorie particulière. Néanmoins, je comprends parfaitement le sens de votre amendement, monsieur le sénateur. Vous pensez rendre le dispositif plus efficace, mais nous allons dans le même temps perdre en réactivité et en rapidité.
Je l’ai dit lors de la discussion générale, un certain nombre de directives ont été données pour que toutes les infractions concernant les élus soient traitées très rapidement. Mettre en branle immédiatement l’instruction par le truchement d’une plainte avec constitution de partie civile, c’est ajouter de la lourdeur. Nous risquons donc de perdre le bénéfice d’une enquête qui est parfois ultrarapide.
Dans le cadre d’une infraction flagrante, les constatations immédiates peuvent être faites en quelques heures : si le parquet est saisi, il fait preuve de diligence, et les choses vont très vite. La constitution de partie civile nécessite quant à elle une consignation et la désignation d’un juge d’instruction ; elle fait aussi courir le risque d’une disparition de la preuve.
Si je comprends parfaitement, je le redis, le sens de votre amendement et si je vous suis sur le principe, il me semble en revanche que votre proposition ne permettrait pas, en pratique, d’aller vers ce que vous souhaitez, c’est-à-dire une répression plus rapide ou davantage de fluidité, car nous perdrions sur ces deux points. Je crois même qu’elle ajouterait un risque de dépérissement de la preuve.
Nous partageons votre objectif, comme nous l’avons tous démontré en travaillant de concert. Néanmoins, monsieur le sénateur, je vous incite – je ne puis naturellement pas employer l’impératif lorsque je m’adresse à vous ! – à bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

J’ai entendu les arguments de Mme le rapporteur et de M. le garde des sceaux et je retire donc mon amendement, madame la présidente.

L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 465-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
La parole est à M. Éric Gold.

Avec cet amendement, qui est dans le même esprit que le précédent et qui recevra certainement les mêmes avis, il s’agit de nuancer le principe de l’aménagement des peines en s’assurant que, en cas de jugement aboutissant à une peine d’emprisonnement, le juge puisse prononcer un mandat de dépôt contre le coupable, même si ce dernier fait appel, afin que la peine s’applique sans délai.

Les dispositions de cet amendement posent plusieurs questions, mais celui-ci paraît satisfait dans son esprit par l’article 397-4 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il tend à revenir sur le principe de l’aménagement des peines de moins d’un an, ce qui ne paraît pas du tout souhaitable.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, « obligatoire » et « mandat de dépôt » sont des mots, des concepts et des principes qui ne vont pas ensemble, même si, là encore, je comprends parfaitement le sens de votre amendement.
Aujourd’hui, le tribunal correctionnel peut décerner un mandat de dépôt contre le prévenu qui comparaît libre s’il prononce une peine d’emprisonnement d’au moins un an ou en cas de récidive, quelle que soit la durée de la peine. S’il prononce une peine d’au moins six mois, il peut décerner un mandat de dépôt à effet différé. Voilà ce que prévoient les textes.
Aller au-delà serait déraisonnable. Comme la raison est notre boussole dans le cadre de l’examen de ce texte, de la même façon que précédemment, je vous propose de retirer cet amendement ; sinon, le Gouvernement se verra dans l’obligation de vous dire qu’il y est défavorable.

L’amendement n° 2 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République, par dérogation à l’article 40-1, est tenu de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal lorsque les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont remplies. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »
La parole est à M. Éric Gold.

Toujours dans le même esprit, ce dernier amendement a pour objet de prévoir une traduction du prévenu sur-le-champ en cas d’infraction commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou sur un membre de sa famille.
Je ne vois pas, dans ce cas de figure, ce qui justifie que le parquet dispose d’une marge de manœuvre, d’autant que le garde des sceaux a fait part, dans sa circulaire du 7 septembre 2020, de la nécessité d’une réponse pénale systématique et rapide.
Aussi, pourquoi ne pas prévoir ce point dans la loi, ce que permettrait l’adoption de mon amendement ?

Cet amendement tend à prévoir la comparution immédiate dans tous les cas de flagrant délit d’agression d’un dépositaire de l’autorité publique ou de ses proches.
En l’état du droit, il s’agit effectivement d’une faculté pour le procureur. L’adoption de cet amendement rendrait la comparution immédiate obligatoire. Mais l’appréciation portée par le procureur nous semble importante pour la qualité des poursuites. Cette mesure pourrait dès lors nuire à la qualité de la réponse pénale.
Vous venez de le dire, monsieur Gold, vous souhaitez une réponse rapide. Pour ce faire, nous pensons que la réponse se trouve dans l’application de la circulaire du garde des sceaux, que vous avez signalée, laquelle demande aux procureurs d’agir systématiquement et rapidement.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Dussé-je lutter contre ma modestie naturelle, monsieur le sénateur, je pense que la circulaire est largement suffisante.
Là encore, on comprend le sens de votre amendement : il faut aller vite, il ne faut pas perdre de temps, il faut une réponse immédiate et efficace – c’est notre vœu commun. Mais de là à contraindre par un texte le procureur de la République à ne plus avoir de choix, il y a une distance qui me paraît excessive.
Je vous demande encore une fois de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi je me verrais contraint, avec tristesse, de vous indiquer que le Gouvernement y est défavorable.
Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-26 ainsi rédigé :
« Art. 2 -26. – En cas de crimes ou délits prévus aux livres II ou III du code pénal ou au chapitre III du titre III du livre IV du même code commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électoral public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et alors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, le Sénat, l’Assemblée nationale ou la collectivité territoriale dont est membre cet élu peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Le premier alinéa du présent article s’applique également pour les mêmes infractions commises à l’encontre du conjoint ou du concubin de l’élu, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou ses descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile, lorsque l’infraction est commise en raison des fonctions exercées par l’élu. »

L’amendement n° 20, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.

Il s’agit de supprimer l’article 2, dont l’ensemble du dispositif a été intégré à l’article 1er.

Je voudrais revenir sur les amendements déposés par mon collègue Éric Gold.
Je comprends tout à fait la démarche qui est la sienne et la réponse qui lui a été faite, mais, dans des cas beaucoup trop nombreux, la réponse aux agresseurs n’a pas été assez rapide.
Dans mon département, comme dans d’autres d’ailleurs, nous pouvons citer des cas pour lesquels la réponse à des agressions sur des élus a traîné pendant six mois, un an, voire deux ans… Vous avez évoqué le risque d’un alourdissement et d’un retardement des procédures, mais il faut donner des consignes aux procureurs pour que les choses aillent plus vite.
Au cours d’une réunion récente de l’association des maires de mon département, un certain nombre d’élus se sont plaints de la lenteur des procédures en cas d’agression contre les élus. Il faut prendre conscience du problème. Je sais que les procédures existent déjà, mais les choses doivent aller plus vite. On voit d’ailleurs que dans certaines situations – je ne serai pas plus précis –, la réponse pénale est très rapide…
L ’ amendement est adopté.
Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

L’amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression
par les mots :
assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression
La parole est à M. le garde des sceaux.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 3 est adopté.

L’amendement n° 21, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :
1° Après le mot :
permettre
insérer les mots :
aux assemblées d’élus et
2° Remplacer les mots :
un édile
par les mots :
une personne investie d’un mandat électif public
La parole est à Mme le rapporteur.

Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à mettre le titre de la proposition de loi en adéquation avec la réécriture du texte.
Je suis favorable à cet amendement, mais je souhaiterais dire un mot, madame la présidente, si vous m’y autorisez.
Je veux rassurer tout le monde. Nous nous sommes félicités d’avoir travaillé ensemble – le Sénat, le Gouvernement, Mme le rapporteur et Mme Delattre – sur ce texte. Nous avons eu raison de le faire, et je constate que, au-delà des divergences politiques ou politiciennes, nous pouvons aborder certains sujets de façon transpartisane, ce dont je me réjouis également.
Au-delà de notre volonté commune d’aller de l’avant, j’ai pris un certain nombre de mesures que j’ai évoquées précédemment. Nous avons notamment envoyé des contractuels dans toutes les juridictions, et je voudrais vous rappeler, mesdames, messieurs les sénateurs, que de nombreux procureurs ont souhaité dédier un contractuel aux élus. Certains tribunaux ont créé une ligne téléphonique ou une boîte mail spécifique.
Ces contractuels dédiés – il s’agit parfois d’un substitut, parfois du procureur lui-même – rencontrent les élus. J’ai été frappé de constater qu’un jeune élu de la région de Dijon ne savait pas ce qu’impliquait pour un maire de devenir officier de police judiciaire. Ces réunions entre élus et procureurs ont donc lieu, et le dispositif fonctionne plutôt bien, parce que les magistrats du parquet sont très investis dans cette mission que j’ai souhaité renforcer.
Pour autant, il y a, comme on le dit en employant une métaphore sportive, quelques « trous dans la raquette ». De temps à autre, des élus viennent me dire qu’ils n’ont jamais rencontré le procureur ou ne savent pas qui est le contractuel dédié.
J’ai un exemple très précis en tête, celui du maire d’une petite commune – je ne dirai pas laquelle –, qui a accepté la construction d’un établissement pénitentiaire sur son territoire, ce qui n’est pas rien quand on connaît les réticences de nos compatriotes à voir ce type d’établissement s’implanter près de chez eux. Lors d’une visite dans sa mairie, autour d’un café qu’il m’a gentiment offert, il m’a dit qu’il ne connaissait pas le procureur…
Comme vous le savez – mais certains l’oublient parfois –, il m’est interdit de donner des directives individuelles aux procureurs ; en revanche, je puis rappeler les termes d’une circulaire comminatoire.
Lors des questions d’actualité au Gouvernement, vous venez souvent, les uns et les autres, me dire que certains maires de vos territoires rencontrent des difficultés. N’hésitez pas à le faire, car la Chancellerie est ouverte aux élus. Bien sûr, je suis moins proche que vous des maires, mais certains d’entre eux me parlent de problèmes qu’il faut prendre en considération et régler. Comment faire ? Ce n’est pas très compliqué : il faut rappeler au procureur général les termes de ma circulaire et lui demander de veiller à ce qu’elle soit mise en œuvre.
D’ailleurs, lors du prochain salon des maires qui se tiendra dans quelques jours, il y aura pour la première fois un stand du ministère de la justice en face du stand du ministère de l’intérieur.
Mme Nathalie Goulet opine.
En plus de ce que nous faisons dans le cadre de l’évolution normative, il y a donc les bonnes pratiques. Je puis vous assurer que les magistrats du parquet sont tout à fait investis auprès des élus, même s’ils ont parfois quelques hésitations, pour le dire de façon euphémique et ne heurter personne, ou quelques tergiversations…
Je le répète, le garde des sceaux, et c’est son rôle, intervient alors pour leur rappeler de prêter une attention et un soin particuliers aux élus, car ils sont la République.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, RDSE, UC et Les Républicains.
L ’ amendement est adopté.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Je dirai un mot pour remercier une dernière fois tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce compromis, notamment Mme le rapporteur et les membres du Gouvernement. Qu’ils soient encore remerciés de ce travail coconstruit !
Madame la ministre, monsieur le garde des sceaux, je vous demande de parrainer cette proposition de loi auprès de l’Assemblée nationale. Nous la ferons défendre par nos élus là-bas, mais nous comptons sur vous pour porter la parole du Sénat auprès des députés, afin que le texte puisse être examiné et entrer en vigueur le plus vite possible.
Encore une fois, les élus réclament depuis longtemps ce texte, qui permet simplement de rendre justice.

Vous pouvez compter sur nous, madame Delattre, madame le rapporteur.
Je vais veiller, avec M. le garde des sceaux, à ce que l’un des groupes de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale assume la présentation de ce texte, à l’occasion, par exemple, d’une niche parlementaire, afin que cette proposition de loi suive son parcours législatif. Comptez sur nous !

Cela a été rappelé par de nombreux collègues, nous vivons dans une société nerveuse et agressive, où toute personne porteuse d’une autorité peut être à un moment attaquée. Il en est ainsi des élus et, comme chacun, j’ai une pensée particulière pour les élus locaux. Je remercie de nouveau Nathalie Delattre et ses collègues de nous permettre d’aller au-delà de ce que nous avons fait dans la loi Engagement et proximité.
Je me souviens du jour où nous avons appris le décès du maire de Signes : quel choc violent que de nous rendre compte soudain qu’un élu pouvait mourir dans l’exercice normal de ses fonctions, un jour ordinaire !
Je voudrais, monsieur le garde des sceaux, vous rendre hommage. À la suite de la loi Engagement et proximité, il y a eu un silence, même si un changement de gouvernement était intervenu. Or, s’il est important de voter la loi, il est tout aussi important de s’assurer de son suivi. Il se trouve que, à l’époque, je vous ai écrit, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, pour savoir ce que devenait la loi que nous avions votée. Vous avez répondu en adressant des circulaires aux procureurs.
Je vous avais également invité à présenter devant la délégation le bilan de votre action. Mes chers collègues, je vous invite à demander au garde des sceaux ce qui a été fait pour chacun de vos départements, car il avait fourni une fiche à chaque membre de la délégation.
Je salue ce qui a été décidé dans cette proposition de loi pour améliorer le rendu de justice à la suite de l’agression d’un élu. En outre, je souligne tout ce que vous avez fait, monsieur le garde des sceaux, pour qu’il y ait aujourd’hui, dans de nombreux territoires, un dialogue normal et naturel entre les procureurs et les maires, alors que les premiers ignoraient les seconds et que ceux-ci avaient parfois peur des procureurs.
Vous avez également évoqué l’ensemble des moyens que vous avez mis à disposition, auxquels s’ajoute la mobilisation des associations d’élus pour la formation.
C’est terrible et tragique, mais aujourd’hui, les élus doivent être préparés à vivre des situations difficiles et à se retrouver confrontés à des agressions fortes.

Je remercie encore une fois nos collègues pour cette proposition de loi. Je vous remercie également, monsieur le garde des sceaux, et je vous invite à continuer de nous fournir des fiches de suivi, car celles-ci sont très précieuses.

Je souhaite à mon tour remercier Nathalie Delattre et me réjouir des progrès accomplis depuis les tragédies de 2018-2019 grâce au rapport de Philippe Bas, à la loi Engagement de proximité et à vos engagements – Françoise Gatel les rappelait à l’instant –, monsieur le garde des sceaux.
S’il convient d’œuvrer dans la durée auprès des élus, on ne réglera véritablement ces difficultés qu’en luttant contre les actes de violence et de délinquance, et contre les incivilités en général.
Il est également nécessaire de mener un travail de prévention auprès des maires, qui sont les élus de proximité dans nos territoires. Nous sommes très attachés à nos édiles et je crois que ce qui s’est passé ce soir dans cet hémicycle est de nature à les rassurer sur l’accompagnement dont ils bénéficient, de la part non seulement des parlementaires, mais aussi du Gouvernement, pour la poursuite sereine du mandat qu’ils exercent.
Nous avons besoin de nos maires : ils assurent le maillage de la France, et ils sont le premier échelon de la démocratie.
Depuis plusieurs années, grâce à l’investissement de Françoise Gatel, de Philippe Bas et à votre engagement, monsieur le garde des sceaux, j’estime que nous avons fait du très bon travail et que celui-ci est utile à l’exercice serein d’une mission indispensable pour la République.

Chacun connaît l’adage : « Nécessité fait loi ». Malheureusement, cette proposition de loi se révèle nécessaire.
Je tiens donc à remercier notre collègue Nathalie Delattre, auteure de ce texte, ainsi que le groupe RDSE, qui l’a inscrit à l’ordre du jour dans le cadre de sa niche.
Je tiens également à saluer l’avancée de la commission ouvrant la possibilité pour les assemblées parlementaires, le Parlement européen et les collectivités territoriales de se porter partie civile en cas d’agression d’un de leurs membres ou de ses proches. Face à ce fléau intolérable, chacun doit pouvoir prendre sa part.
Les chiffres ahurissants de la recrudescence des violences à l’endroit des élus ont été rappelés. L’écrasante majorité des agressions sont perpétrées à l’encontre de maires et d’adjoints au maire. Ces derniers sont en première ligne face au déchaînement de colère de certains de leurs concitoyens. Leur courage et leur pugnacité invitent tout un chacun au respect.
Puisque le sentiment d’impunité contribue à augmenter la violence verbale et physique, la question des délais d’instruction et de la traduction des prévenus est centrale. Face à ces violences, les élus s’inquiètent et appréhendent d’exercer leurs pouvoirs de police avec le peu de moyens dont ils disposent.
Il est de notre devoir de les soutenir non seulement en cas d’agression, mais également au quotidien, avant que le pire se produise. C’est pourquoi, avec mon collègue du Nord Jean-Pierre Decool, nous proposons depuis plusieurs mois, dans tous les arrondissements de notre département, des réunions visant à aider les élus locaux à se saisir des moyens qui existent pour réagir face aux incivilités et aux comportements violents.
Ces réunions sont organisées en coopération avec les préfectures, les procureurs de la République, les gendarmeries et les commissariats.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera bien évidemment ce texte.

Je remercie à mon tour Nathalie Delattre, dont je salue l’initiative.
Toutefois, mes chers collègues, la plus belle des lois ne produira aucun effet si on ne lui en donne pas les moyens.
Le Sénat et le Gouvernement ont travaillé de concert pour parvenir à ce résultat. Il appartient désormais au Gouvernement de poursuivre dans cette voie.
Monsieur le garde des sceaux, vous évoquiez précédemment l’exemple d’un maire du secteur de Dijon qui ne connaissait pas le procureur. Je puis témoigner que de nombreux maires sont dans le même cas.
Les procureurs sont souvent très occupés et ils n’ont pas le temps de prendre attache avec les maires. Je forme le vœu que demain, maires et procureurs puissent échanger plus souvent.

Cette proposition de loi visant à soutenir les édiles victimes d’agression est nécessaire, utile et salutaire. Prétendre le contraire reviendrait à se voiler la face.
Dans notre société de plus en plus violente, la bienveillance et le respect des êtres humains – cela vaut non seulement dans le cas des élus, mais aussi dans celui des migrants et de l’accueil qui leur est fait – deviennent aléatoires, voire surprenants. Cette évolution est en partie imputable aux réseaux sociaux – nous l’avons évoqué.
Dans ce contexte, toute avancée permettant de venir en aide aux personnes qui sont victimes de violences et d’agressions ne peut être que salutaire.
J’ai fait part de nos réserves sur la méthode. Celles-ci tiennent à une sorte d’ultra-spécialisation de la justice qui consiste à adapter les règles en fonction des victimes ou d’une catégorie de victimes. Le mot « corporatisme » que j’ai employé est peut-être un peu fort, mais il exprime notre refus que des processus ou des règlements soient adaptés spécifiquement à une catégorie de personnes, fût-elle particulièrement visée.
Néanmoins, nous comprenons la nécessité de protéger les élus et les représentants de la Nation et de les aider dans leurs démarches, comme le prévoit ce texte.
Pour cette raison, et parce que nous souhaitons que cette proposition de loi soit adoptée à l’unanimité, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires la votera.
Je me permets de revenir sur une dernière réserve : l’élargissement du périmètre à toutes les personnes vivant sous le même toit nous paraît excessivement aléatoire.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi, dont le Sénat a rédigé ainsi l’intitulé : proposition de loi visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 53 :
Le Sénat a adopté.
Mes chers collègues, je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité.
Applaudissements.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, la discussion de la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises, présentée par M. Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues (proposition n° 647, texte de la commission n° 110, rapport n° 109).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Claude Requier, auteur de la proposition de loi.

M. Jean-Claude Requier, auteur de la proposition de loi. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je le dis sans détour : cette proposition de loi a tout d’un texte aride, strictement juridique et procédural. Elle ne soulèvera sûrement pas les foules.
Sourires.

Cependant, elle tend à réparer un rouage non négligeable de notre institution judiciaire, puisqu’elle modifie l’article 367 du code de procédure pénale afin de clarifier les conditions dans lesquelles l’arrêt rendu par la cour d’assises peut valoir titre de détention.
En effet, cet article a fait l’objet d’une réécriture il y a un an par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, plus spécifiquement par son article 6 comportant diverses dispositions relatives à la cour d’assises.
L’une de ces dispositions prévoit d’abandonner l’obligation, pour la cour, de décerner un mandat de dépôt à l’encontre de l’accusé ayant comparu libre, lorsque celui-ci est condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans.
À défaut de cette obligation, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit que si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention sans qu’il faille décerner un mandat de dépôt spécialement motivé.
Pour obtenir ce résultat, il a fallu réécrire l’article 367 du code de procédure pénale. En toute transparence, cet article est difficile à lire, et il l’est encore plus pour qui n’est pas juriste. Toutefois, c’est dans sa réécriture que se trouve le nœud du problème. Je m’efforcerai donc d’être le plus synthétique possible, mes chers collègues.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 367 prévoit d’abord qu’une personne condamnée à une autre peine que la prison n’est évidemment pas incarcérée, non plus qu’une personne condamnée à une peine de prison déjà couverte par la durée de sa détention provisoire.
Cet article prévoit ensuite qu’une personne condamnée à plus de dix ans de prison, c’est-à-dire à une peine de réclusion criminelle, se verra immédiatement incarcérée à la suite du jugement, qu’elle soit détenue au moment de la décision ou non.
Il prévoit enfin qu’une personne condamnée à moins de dix ans de prison, si elle n’est pas détenue au moment du jugement, pourra se voir délivrer un mandat de dépôt directement par la cour d’assises, et ainsi être incarcérée dès le jour du jugement.
Tels sont les trois seuls cas visés par le texte. Or un autre a été oublié : celui d’une personne détenue au jour du jugement et condamnée à une peine de prison de moins de dix ans.
Ce détail a échappé aux députés, aux sénateurs, aux membres du Gouvernement et à l’ensemble de nos collaborateurs. Et comme – vous vous en doutez – je ne lis pas chaque matin les revues d’actualité juridique de droit pénal, c’est un article d’un journal satirique paraissant le mercredi, que le général de Gaulle appelait « Le Volatile », à savoir Le Canard enchaîné, en date du 27 avril 2022, qui m’a mis la puce à l’oreille.
Sourires.

Quelle est la conséquence d’un tel oubli légistique ? Elle peut être radicale, puisqu’elle peut entraîner la libération d’une personne condamnée à une peine de détention. Le groupe du RDSE est certes favorable à la liberté, mais il y a des cas où celle-ci n’est, hélas ! plus possible.
Sourires.

Le Gouvernement a remédié à cette bévue en prenant le décret du 25 février 2022 portant application de l’article 367 du code de procédure pénale. Ce décret règle la difficulté en autorisant expressément la cour d’assises à délivrer un mandat de dépôt lorsqu’une personne est condamnée à moins de dix ans de prison, quelle que soit sa situation au jour de la condamnation.
Cependant, je n’apprendrai à personne la teneur de l’article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant […] la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ».
On ne peut donc pas remédier à cette carence de la loi par un décret, sauf à prendre le risque que celui-ci soit déclaré inconstitutionnel et légitimement annulé par le juge administratif.
La détermination des conditions dans lesquelles l’arrêt rendu par la cour d’assises peut valoir titre de détention relève du domaine législatif.
Le groupe du RDSE étant attaché à ce que la lettre de la Constitution soit respectée, je vous propose d’adopter cette proposition de loi, que notre rapporteure Maryse Carrère a améliorée en simplifiant encore sa rédaction pour que notre droit soit lisible et efficace.
Avant de lui laisser la parole, je souhaite dire un dernier mot sur la cause réelle et profonde qui justifie que nous examinions ce texte. Au-delà des questions de mandat de dépôt, de comparution et de réclusion criminelle, l’autre sujet en jeu est celui de l’inflation législative et de la surcharge du calendrier parlementaire.
Nous indiquons souvent dans cet hémicycle qu’il est de plus en plus difficile de bien écrire la loi. Les procédures accélérées n’ont plus rien d’exceptionnel. Pour ne prendre qu’un exemple, qui se souvient encore que le délai normal entre l’examen d’un texte en commission et en séance publique est, non pas d’une semaine comme c’est désormais toujours le cas, mais bien de deux semaines ? La dérogation est devenue la règle.
Dans ces conditions, les amendements sont rédigés trop rapidement et les articles examinés sans repos. Voilà comment, dans un texte comprenant soixante articles, une telle erreur a pu être commise. Elle est peut-être due à un défaut de vigilance de notre part, mais elle est certainement aussi la conséquence d’une tendance qui jusqu’au mois de juin dernier, était particulièrement flagrante.
Nous examinons trop de textes, ces derniers sont trop longs et ils sont traités dans des délais toujours trop courts. C’est aussi de cela qu’il est question au travers de cette proposition de loi.
J’espère que nous l’adopterons et je forme le souhait que nous n’ayons pas à nous réunir trop souvent pour apporter ce type de correction.
Applaudissements sur les t ravées des groupes RDSE et SER. – Mme Marie Mercier et M. Marc Laménie applaudissent également.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par le président Jean-Claude Requier et plusieurs membres du groupe du RDSE porte sur un sujet assez technique puisqu’elle concerne les règles d’incarcération d’un accusé condamné par la cour d’assises, tant que l’arrêt n’est pas définitif, dans l’attente d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Cette proposition de loi vise plus précisément à corriger une malfaçon législative figurant à l’article 367 du code de procédure pénale dans un souci de sécurité juridique.
Cette malfaçon s’est produite à l’occasion de l’examen, l’année dernière, du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. L’Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté comme rédactionnel, qui est à l’origine de la difficulté que je vous exposerai dans un instant.
Lors de l’examen du texte au Sénat, nous n’avons pas bien mesuré la portée de cet amendement, passé relativement inaperçu au milieu de dispositions plus substantielles que contenait le projet de loi.
Depuis 2011, l’article 367 du code de procédure pénale prévoit que l’arrêt de la cour d’assises condamnant l’accusé à une peine privative de liberté vaut titre de détention. S’il est condamné, l’accusé est donc incarcéré à l’issue de l’audience sans qu’il soit nécessaire de décerner un mandat de dépôt, à moins bien sûr que la durée de la peine soit déjà couverte par la détention provisoire.
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a assoupli le principe selon lequel l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention afin de tenir compte de la situation des personnes qui comparaissent libres devant la cour d’assises et qui ne sont finalement condamnées qu’à une peine correctionnelle.
Pour ces personnes, une incarcération systématique à l’issue de l’audience n’apparaît pas forcément nécessaire. Dans cette hypothèse, la loi a donc prévu que l’incarcération ne serait plus automatique et elle a laissé le soin à la cour d’assises de décerner un mandat de dépôt si celle-ci estime que les éléments du dossier justifient une mesure particulière de sûreté.
Dans l’hypothèse où l’accusé comparaît détenu, il était en revanche envisagé de maintenir le principe selon lequel l’arrêt vaut titre de détention. Si l’accusé a été placé en détention provisoire, il paraît en effet logique de l’incarcérer à l’issue de l’audience s’il est condamné à une peine privative de liberté.
Le problème tient à la modification introduite par l’Assemblée nationale, qui a restreint l’application de ce principe à l’hypothèse d’une condamnation à une peine de réclusion criminelle. Plus rien n’est prévu, en revanche, dans le cas où l’accusé qui comparaissait détenu est condamné à une peine d’emprisonnement de nature correctionnelle, c’est-à-dire à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement.
Une lecture littérale de l’article 367 du code de procédure pénale pourrait conduire à libérer l’accusé qui était jusqu’alors placé en détention provisoire, alors que celui-ci vient d’être condamné à une peine de prison ferme. Une telle solution n’est ni cohérente ni conforme à l’intention du législateur.
D’après les informations que j’ai recueillies au cours des auditions, cette malfaçon législative n’a pas entraîné à ce jour de conséquence fâcheuse. Aucune libération inopportune n’est à déplorer, et aucun contentieux contestant une mesure d’incarcération n’a été recensé.
Le 25 février dernier, le Gouvernement a pris un décret qui a clarifié les règles applicables, en rappelant que l’accusé qui est détenu au moment où l’arrêt est rendu et qui est condamné à une peine d’emprisonnement ferme doit être incarcéré.
Cette disposition est cependant fragile juridiquement, puisque la procédure pénale relève en principe du domaine de la loi.
C’est la raison pour laquelle je vous invite à adopter la proposition de loi que nous examinons ce soir, en espérant que celle-ci sera inscrite rapidement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
J’indique pour terminer que la commission des lois a adopté, en accord avec l’auteur de la proposition de loi, deux amendements.
Le premier vise à proposer une rédaction plus concise du texte. Les auteurs de la proposition de loi s’étaient inspirés de la rédaction du décret, qui énumère de manière très pédagogique toutes les hypothèses pouvant être rencontrées. Il nous a semblé préférable d’apporter une correction plus ponctuelle afin d’éviter que la loi ne soit redondante avec le décret.
Le second amendement tend à encadrer l’application du texte outre-mer.
Sous des dehors techniques, vous aurez compris, mes chers collègues, que ce texte a un objectif concret, puisqu’il s’agit d’éviter que des personnes condamnées, potentiellement dangereuses, ne soient remises en liberté de manière intempestive.
Je ne doute pas qu’il recevra pour cette raison un large soutien sur toutes les travées de notre assemblée.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI. – Mme Agnès Canayer et M. Marc Laménie applaudissent également.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, la procédure de jugement des crimes par la cour d’assises présente – nous le savons tous – une importance toute particulière en raison non seulement de la gravité des faits sur lesquels la cour doit se prononcer, mais également des conséquences de cette décision pour les justiciables, qu’ils soient accusés ou victimes.
Cette procédure doit donc être aussi satisfaisante et juste que possible.
C’est la raison pour laquelle la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, que j’ai eu l’honneur de porter dans un esprit de coconstruction avec le Sénat et votre commission des lois, monsieur le président François-Noël Buffet, a modifié en profondeur les règles relatives au jugement des crimes par la cour d’assises.
L’objectif était de rendre ces règles plus cohérentes, d’assouplir les modalités de composition de la cour d’assises, de simplifier le déroulement des audiences, de renforcer le rôle du jury populaire et d’accroître les possibilités d’individualisation des sanctions prononcées.
Par ma profession, mon expérience et mes convictions – vous le savez –, je suis extrêmement attaché au respect de la souveraineté populaire du jury.
C’est également grâce à cette loi que le président de la cour d’assises, à l’occasion de son rapport introductif à l’ouverture des débats, expose désormais les éléments à charge et à décharge, non pas tels qu’ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, mais tels qu’ils résultent de l’information.
C’est enfin grâce à cette loi qu’ont été modifiées les règles relatives à l’incarcération à l’audience de l’accusé condamné, prévues par l’article 367 du code de procédure pénale, afin de renforcer l’individualisation des décisions rendues par la cour.
Auparavant, l’incarcération d’une personne qui comparaissait libre était automatique, y compris lorsqu’elle était condamnée à une peine inférieure à dix années d’emprisonnement, et alors même que l’accusé pouvait faire appel de la décision, ou, en appel, former un pourvoi en cassation.
Désormais, si l’accusé est libre au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, par exemple, pour une durée d’un ou deux ans, la cour doit, par décision spéciale et motivée, décider ou non – c’est là tout l’intérêt de cette évolution – de décerner un mandat de dépôt.
La cour doit donc se pencher spécifiquement sur la question de savoir si l’incarcération automatique de l’accusé, alors qu’il comparaît libre à l’audience, laquelle se tient souvent plusieurs années après les faits, est nécessaire. Cela peut être, par exemple, dans le cas où l’accusé a respecté à la lettre son contrôle judiciaire.
Cette évolution renforce l’œuvre de justice, en donnant les moyens à la cour d’apprécier au cas par cas si l’incarcération immédiate du condamné est nécessaire, si elle permet de le sanctionner à la juste hauteur et si elle permet de favoriser sa réinsertion, car – je le rappelle – la peine doit impérativement répondre à ces objectifs.
Toutefois, à la suite de modifications apportées lors de la discussion parlementaire, le texte définitivement adopté comportait une ambiguïté puisqu’il ne traitait pas de la question des accusés détenus, condamnés pour crime ou délit à une peine d’emprisonnement.
J’ai complété la partie réglementaire du code de procédure pénale par un décret du 25 février 2022, qui a levé cette ambiguïté en indiquant que pour les accusés détenus, il n’était pas nécessaire de décerner un titre de détention. Ainsi, si l’accusé comparaissant détenu devant la cour est condamné à une peine d’emprisonnement, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention.
Toutefois, il est pertinent que cette ambiguïté soit aussi levée par la loi, comme le prévoit le présent texte du président Requier – je supposais qu’il avait été alerté du problème par des praticiens de la cour d’assises, mais en réalité il l’a été grâce à un hebdomadaire que nous sommes très nombreux à lire.
Sourires.
L’article 1er de cette proposition de loi modifie ainsi l’article 367 du code de procédure pénale afin de clarifier l’hypothèse de l’accusé détenu, condamné à une peine d’emprisonnement par la cour d’assises. Il prévoit que ce dernier doit demeurer détenu après sa condamnation – tel est d’ailleurs l’esprit du texte.
Le Gouvernement est d’accord avec l’évolution normative que vous proposez. Je tiens donc à remercier chaleureusement le président Requier de sa vigilance, ainsi que l’ensemble du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Pour conclure, je tiens également à saluer le travail d’amélioration rédactionnelle mené par Mme la rapporteure Carrère sur cette disposition, qui permet d’aboutir à un texte plus concis, mettant davantage en valeur la modification apportée.
Applaudissements sur les tr avées des groupes RDPI et RDSE. – Mme Agnès Canayer et M. Marc Laménie applaudissent ég alement.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j’aimerais tout d’abord saluer la vigilance aiguë dont a fait preuve le président Jean-Claude Requier sur un sujet qui, malgré sa technicité, n’en reste pas moins important.
Je n’entrerai pas dans les détails de sa complexité ; tout a déjà été dit, avec une grande virtuosité juridique, tant par l’auteur de la proposition de loi que par notre rapporteure, Maryse Carrère.

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 367 du code de procédure pénale. Ainsi a-t-elle fait évoluer, une nouvelle fois, les conditions d’incarcération ou de libération des personnes jugées par une cour d’assises, en particulier celles dans lesquelles l’arrêt rendu par la cour d’assises peut valoir titre de détention.
Au cours de cette réécriture, un oubli rédactionnel aux conséquences potentiellement graves a été décelé, ce qui nous rappelle que la procédure pénale n’est pas une affaire technocratique. Cet oubli concerne le cas où la personne jugée par la cour d’assises est déjà en détention et se voit condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure à dix ans.
Il est donc nécessaire de reformuler une partie de l’article 367 du code de procédure pénale afin que la cour d’assises puisse, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, lorsque l’accusé est détenu au moment du prononcé de l’arrêt et est condamné pour crime à une peine d’emprisonnement ferme, sans pour autant que la peine prononcée constitue une peine de réclusion criminelle.
Je salue la rédaction adoptée par la commission des lois, qui s’inscrit dans l’esprit du texte initial, tout en lui offrant plus de simplicité et de lisibilité.
Cette solution s’inspire du décret du 25 février 2022 portant application de l’article 367 du code de procédure pénale, que le Gouvernement avait adopté afin de pallier ce vide législatif.
Comme cela a été souligné, ce dispositif actuellement en vigueur risque d’être frappé d’inconstitutionnalité, puisqu’il ne respecte pas la définition des domaines de compétence respectifs du législateur et du pouvoir réglementaire, issue des articles 34 et 37 de la Constitution.
Heureusement, à ce jour, aucun recours direct ou indirect n’a été formé contre le décret. Néanmoins, nous ne saurions laisser le droit dans un tel état de précarité. Naturellement, le groupe RDSE est favorable à l’adoption du dispositif législatif proposé.
Il apparaît donc essentiel que cette proposition de loi arrive au terme de la navette parlementaire, durant les prochaines semaines, afin d’éviter toute déconvenue.
Enfin, pour faire écho aux propos introductifs du président Requier, je veux, à mon tour, souligner que nous sommes confrontés à l’une des conséquences de l’encombrement du calendrier parlementaire. Les lois sont trop nombreuses, trop longues, parfois bavardes ou redondantes. Le rythme parlementaire nous conduit à mal travailler sur des dispositifs, certes techniques, mais non dépourvus d’implications concrètes.
Les conditions qui ont conduit à la rédaction de ce texte n’illustrent, hélas ! que trop bien les effets de cette méthode.
Cette situation rappelle, dans un autre registre, les mesures successives sur l’élection des juges consulaires, un texte venant corriger l’autre. Sur ce sujet aussi, le Sénat s’est montré vigilant, grâce à la mobilisation de notre collègue Nathalie Goulet.
En conclusion – vous l’aurez compris –, le groupe RDSE votera, sans réserve, cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI . – M. Marc Laménie applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, …
Sourires.

… si « la loi n’a plus tous les droits », comme le souligne la juriste Mireille Delmas-Marty, elle a néanmoins une utilité et une place certaines au sein du droit, consacrées par l’article 34 de la Constitution.
Le droit a besoin de la loi et surtout d’une loi claire, intelligible et réfléchie. Le législateur a donc une grande responsabilité, celle de faire de bonnes lois. Tel est aussi l’objet de l’examen de ce texte.
La proposition de loi, présentée par le président Jean-Claude Requier et douze de nos collègues, complète les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises.
Surtout, cette proposition de loi corrige une malfaçon, introduite à l’Assemblée nationale, dans la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dont mon collègue Philippe Bonnecarrère et moi-même étions les rapporteurs.
En effet, cette loi ne prévoyait pas le cas où un accusé détenu, est condamné par la cour d’assises à une peine inférieure à la réclusion criminelle, soit moins de dix ans d’emprisonnement ; il aurait alors fallu que la cour puisse décerner un mandat de dépôt afin de l’incarcérer immédiatement.
Cette omission dans la loi signifiait qu’un condamné pouvait être remis en liberté immédiatement après le rendu du jugement.
Pour clarifier la situation, le ministère de la justice a comblé cette carence en prenant le décret du 25 février 2022, solution temporaire et fragile.
Si l’on peut saluer cette tentative réglementaire, il fallait une disposition législative, en vertu de l’article 34 de la Constitution, pour réparer cet oubli. En effet, seul le législateur peut jeter des bases solides et apporter une solution pérenne, qui comble cette lacune.
Aussi la proposition de loi que nous examinons reprend-elle l’esprit du décret précédemment cité, mais dans une volonté de simplification, nourrie par une rédaction concise et claire. En effet, la rapporteure de la commission des lois, Mme Maryse Carrère, a tenu à clarifier le texte afin de le rendre plus accessible. C’est ainsi que la proposition de loi modifie le code de procédure pénale.
Si nous pouvons nous féliciter d’être parvenus à résoudre, une fois pour toutes, par la bonne voie législative, cette carence regrettable, il n’en reste pas moins que nous devons aussi nous interroger sur les raisons qui nous conduisent à nous réunir, une fois encore, à une heure tardive, pour combler l’un de ces trous dans la raquette qui résultent de lois établies dans la précipitation.
En effet, l’urgence ne permet pas d’apprécier les conséquences réelles des mesures adoptées, comme on aurait pu le faire en menant au préalable une véritable étude d’impact. C’est uniquement lors de leur application effective qu’apparaissent les erreurs législatives.
L’inadéquation avec la pratique est aussi souvent due – nous le savons – à l’enchevêtrement complexe des règles. La justice pénale en est, en France, une parfaite illustration.
Depuis plusieurs années, le Sénat déplore la complexification des lois, des codes et des procédures, ainsi que l’inflation normative et législative. En effet, lorsque la loi devient bavarde, l’essentiel disparaît au profit de l’accessoire.
M. le garde des sceaux approuve.

La superposition des textes juridiques, sans aucune refonte globale, contribue elle aussi à l’opacité des règles. Le chantier de la simplification de la procédure pénale reste un véritable serpent de mer. Les États généraux de la justice ont mis l’accent, avec acuité, sur la nécessaire refonte du code de procédure pénale devenu peu praticable. En effet, entre 2008 et 2022, le nombre des articles de la partie législative de ce code est passé de 1 722 à 2 403.
En conséquence, je forme le vœu que cette réforme essentielle de la procédure pénale puisse être engagée. Celle-ci est d’autant plus nécessaire que les délais de jugement des crimes sont toujours proches de cinquante mois.
Mon groupe votera donc en faveur de cette utile proposition de loi du président Jean-Claude Requier, largement améliorée par la rapporteure Maryse Carrère.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en 2021, sur 32 000 affaires suivies par des juges d’instruction, 1 700 arrêts ont été prononcés par les cours d’assises à la suite d’un procès, pour environ 2 800 auteurs de faits mis en accusation.
Les affaires portées devant une cour d’assises ne représentent qu’une part minoritaire de la totalité des affaires pénales. Toutefois, elles concernent les infractions les plus graves de notre droit. La procédure relative à ces affaires se doit d’être irréprochable.
La proposition de loi que nous examinons porte sur les dispositions de l’article 367 du code de procédure pénale qui règlent le sort de l’accusé une fois que la cour d’assises a rendu son arrêt.
Par souci de simplification, une loi de 2011 prévoyait que l’arrêt de la cour d’assises valait titre de détention, sans que celle-ci ait besoin de décerner un mandat de dépôt.
Alors que la loi du 22 décembre dernier visait à apporter plus de nuances à ce principe, ceux qui en ont examiné le texte ont, sans le vouloir, laissé subsister un vide juridique s’agissant des hypothèses dans lesquelles l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention.
En effet, un cas a été omis : celui où l’accusé, détenu au moment où l’arrêt est rendu, est condamné à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement. Heureusement, cette situation ne s’est jamais présentée – mes collègues l’ont rappelé.
C’est pourquoi, pour éviter des libérations inopportunes, le décret du 25 février dernier a remédié à cet oubli. Cependant, en vertu de l’article 34 de la Constitution, les règles de procédure pénale doivent être fixées par la loi. La proposition de loi reprend donc toutes les hypothèses visées dans ce décret.
Cette initiative est essentielle à plusieurs égards Tout d’abord, la loi pénale doit être précise et prévisible, chacun étant en droit de savoir à quoi il s’expose et dans quelles conditions.
Ensuite, dans une démocratie, l’existence d’un lien de confiance entre la société et la justice est indispensable. Or, pour les victimes, comme pour l’ensemble des citoyens, il serait inconcevable qu’un détenu condamné à une peine d’emprisonnement soit remis en liberté, même de façon temporaire, en raison de lacunes rédactionnelles ou législatives.
En outre, la rédaction simplifiée du texte de la commission complète parfaitement les dispositions du décret pris par le pouvoir exécutif.
Enfin, il semble tout à fait légitime d’appliquer ces mesures en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux de la rapporteure et à remercier le président Requier pour cette initiative.
Ainsi, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera cette proposition de loi à l’unanimité.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je remercie l’auteur de cette proposition de loi, qui à l’époque de la concentration des médias, continue de soutenir la presse indépendante en la lisant ; je remercie également Mme la rapporteure pour ses explications limpides qui ont éclairé notre regard sur un sujet important et très particulier.
Nous voilà donc devant un texte qui n’a d’anodin que la simplicité de son objectif et qui relève – et révèle – plusieurs aspects cruciaux de notre système.
Il s’agit – disons-le clairement –, comme l’a rappelé la rapporteure, de corriger une « malfaçon législative ».
L’enfer est pavé de bonnes intentions. On pourrait aussi dire qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ces adages, trop souvent répétés, trouvent pourtant corps dans notre processus décisionnel.
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a permis la mise en œuvre des recommandations issues d’un rapport de 2008, préconisant une simplification des modalités d’incarcération ou de libération, à la suite du prononcé de l’arrêt des cours d’assises.
Vous connaissez ma méfiance – je ne suis pas seul dans ce cas – envers le terme de « simplification » qui sert parfois de prétexte, dans les modifications apportées à notre système pénal, à la mise à l’écart d’un juge ou à une restriction des droits de la défense.
Mais, ici, la simplification ne peut – et ne pouvait – que faire l’unanimité, dès lors qu’elle s’exprime ainsi : la décision de la cour d’assises et du tribunal correctionnel vaut titre de détention.
Pourtant, la mise en œuvre de cette possibilité, à savoir que la décision de la cour soit considérée comme nécessaire et suffisante s’agissant de l’incarcération d’un justiciable condamné, a souffert d’une erreur rédactionnelle, puisque l’on en a limité le champ au cas d’une condamnation criminelle sans l’appliquer à celui d’une peine correctionnelle. Or errare humanum est, perserverare diabolicum. L’erreur est humaine, mais persévérer dans son erreur est plus problématique.
Sourires.

M. Guy Benarroche. Pour corriger cette difficulté, le Gouvernement a publié un décret. Comment a-t-on pu croire, monsieur le garde des sceaux, que l’on pouvait clarifier la situation par un simple décret ? Vous nous en avez expliqué les raisons
M. le garde des sceaux le confirme.

Toute l’acceptabilité du droit pénal et de sa procédure s’enracine dans le fait que la loi est votée par des pairs, puis que l’on est jugé par ses pairs via des jurés populaires dans les cours d’assises. Ce principe risque d’ailleurs d’être mis à mal par la généralisation des cours criminelles départementales, objet d’un rapport qui vient de vous être remis par le comité d’évaluation et de suivi où siègent des parlementaires, dont Maryse Carrère et moi-même.
Je sais combien le Président de la République et ses gouvernements successifs sont friands de légiférer par ordonnances et la multiplication inquiétante de celles-ci fait l’objet d’un suivi justifié par la Haute Assemblée. Toutefois, la procédure pénale relève bien, selon l’article 34 de la Constitution, du domaine de la loi.
Je profite de cette intervention pour encourager le Gouvernement à concentrer son action sur la publication des décrets nécessaires à la bonne application de la loi et ce, quel que soit le texte voté par le Parlement.
Afin d’éviter tout recours visant à contester une incarcération au motif d’absence de base légale, le groupe RDSE – que je remercie – a inscrit l’examen de ce texte, dans le cadre de sa niche parlementaire. Nous le voterons de manière unanime afin de corriger l’erreur initiale introduite dans un précédent texte de loi, à laquelle nous avons tous contribué, ainsi que celle du Gouvernement dans sa tentative de réparation inadaptée au travers d’un décret.
Le groupe GEST votera donc en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, vous l’avez rappelé, cher président Requier, l’objet de cette proposition de loi est simple, mais n’en reste pas moins essentiel, puisque le texte corrige une malfaçon issue de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Celle-ci n’avait rétabli l’obligation pour la cour d’assises de décerner un mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, que lorsque l’accusé comparaissait libre et qu’il était condamné à une peine d’emprisonnement ferme, laissant un vide s’agissant des accusés comparaissant détenus.
Un décret du 25 février 2022 portant application de l’article 367 du code de procédure pénale palliait cette incongruité, afin d’éviter que certains accusés ne soient remis en liberté par les juridictions, en prévoyant le cas dans lequel l’accusé comparaissait détenu et était condamné à une peine d’emprisonnement ferme.
La commission des lois a, par la voix de sa rapporteure Mme Maryse Carrère, retenu une rédaction plus concise pour préciser que l’arrêt vaudra titre de détention, lorsque l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle, ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises. Ces dispositions seront également étendues à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le groupe RDPI votera donc la proposition de loi ainsi modifiée.
L’examen de ce texte démontre une nouvelle fois que le législateur n’est pas infaillible. Je suis moi-même intervenu, il y a tout juste un mois, en tant que rapporteur d’une proposition de loi visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, dont l’objet était de réparer des malfaçons législatives introduites par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, du 22 mai 2019, à l’occasion de la réforme du régime électoral de ces juges.
Ce n’est finalement qu’une illustration supplémentaire des limites de la procédure accélérée et de notre propension à légiférer dans l’urgence, elles-mêmes induites par la densité de nos travaux.
Compte tenu de l’ordre du jour chargé du Parlement, peut-être serait-il opportun d’envisager de regrouper au sein d’un seul et même texte des corrections comme celles-ci.
Enfin, nonobstant la malfaçon législative qu’elle renfermait, je tiens à souligner – rapidement, rassurez-vous – les avancées de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Je pense notamment aux procès filmés, aux enquêtes préliminaires limitées à deux ans, au secret professionnel des avocats ou encore à la généralisation des cours criminelles au 1er janvier 2023, qui sont en expérimentation dans quinze départements depuis septembre 2019.
Je suis conscient de la réticence que cette dernière mesure suscite chez certains, étant moi-même très attaché à la persistance des jurés populaires, qui sont l’expression de la participation des citoyens à la justice.
Néanmoins, je rappelle que les réformes des cours d’assises ont toujours été réalisées avec parcimonie – c’est la quatrième en vingt ans – et que la mise en place de ces cours a déjà permis l’abaissement du taux d’appel, la réduction du délai d’audiencement ainsi que d’éviter que certains crimes sexuels ne soient correctionnalisés.
En outre, les jurés populaires subsisteront au sein des cours d’assises traditionnelles, pour toutes les infractions punies de plus de vingt ans de réclusion criminelle, ainsi qu’en appel.
Si l’on se réfère aux crédits alloués à la justice ces trois dernières années, je ne vous ferai pas offense, monsieur le garde des sceaux, en vous disant que sans moyens, tant pour ce qui est des magistrats et du personnel judiciaire qui mènent ces audiences qu’en matière de locaux pour les accueillir, ces cours criminelles n’auront qu’une utilité relative sinon nulle.
M. Jean-Claude Requier applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

M. Patrick Kanner . Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je remercie Jean-Claude Requier d’avoir identifié – que ce soit par le biais d’un « canard déchaîné » ou d’un conseiller juridique, peu importe !
Sourires.

En effet, constitutionnellement, la détermination des peines relève du domaine de la loi, selon l’article 34, le domaine du règlement étant défini par l’article 37 – mes collègues l’ont rappelé à de multiples reprises. Or, dans ce cas précis, aucune disposition législative suffisante n’existe.
Actuellement, le cas d’un accusé, déjà détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, qui par définition ne peut pas excéder dix ans, est réglé par décret, selon un procédé que je qualifierai d’« aléatoire », d’un point de vue constitutionnel.
Cette solution palliative ne fait que masquer un défaut et n’existe que pour éviter que certains mandats de dépôt ne soient privés de fondement légal. Il est d’ailleurs prévu de reprendre dans la loi le dispositif existant, défini par le décret du 25 février 2022 pris par vos soins, monsieur le garde des sceaux.
L’objet de notre discussion n’est donc pas le fond, mais la forme, car on ne saurait se satisfaire de cette méthode, qui ne respecte pas les dispositions de notre Constitution.
En l’espèce, cette situation – qu’on ne peut que regretter – nous contraint à avoir un débat qui n’en est pas un, puisque personne sur ces travées ne remet en cause le respect des définitions des domaines législatif et réglementaire.
En effet, priver une personne d’une liberté publique, en l’occurrence celle d’aller et venir, ne peut relever que du domaine de la loi. N’en déplaise à certains, le domaine du pouvoir réglementaire est heureusement circonscrit. Tout ne peut pas être réglé par voie d’ordonnances et de décrets.
Toutefois, je profite de cette intervention pour vous faire part d’un sentiment – également évoqué par d’autres collègues – quant à la fabrique de la loi. Le vide juridique qui nous occupe aujourd’hui a été créé par les modifications apportées au code de procédure pénale par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
À l’époque, les débats ne nous ont pas permis d’identifier cette situation, qui relève donc d’un oubli. Sans gloser sur les raisons qui l’expliquent, le manque de temps que l’on invoque souvent est à mes yeux essentiellement dû à une pratique devenue la norme. Depuis plusieurs années, l’examen de la majorité des projets et propositions de loi par le Parlement est soumis à la procédure accélérée. Or celle-ci, que l’on a appelée « procédure d’urgence » jusqu’en 2008, avait vocation, comme le terme initial l’indiquait, à n’être utilisée qu’exceptionnellement, en cas d’urgence.
Sa transformation en « procédure accélérée » est révélatrice de l’objectif visé pendant le quinquennat de son créateur, M. Sarkozy : son utilisation n’était plus liée à l’urgence, mais à la volonté d’écourter les débats. Sa banalisation participe de l’affaiblissement du Parlement, puisqu’elle abrège le débat parlementaire.
Cette pratique a pu aussi être utilisée par des gouvernements auxquels j’ai appartenu. Mea culpa !
Mme Françoise Gatel s ’ en amuse.

Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, en a même fait un argument de campagne en 2017, indiquant dans son programme qu’il ferait de la procédure accélérée « la procédure par défaut de l’examen des textes législatifs afin d’accélérer le travail parlementaire ». Cette promesse de campagne a été manifestement tenue. Pourtant, tout juste intronisé, fort d’une majorité de soutien très large à l’Assemblée nationale – à l’époque – et disposant de tous les instruments du parlementarisme rationalisé pour mener à bien ses réformes, le Président de la République, Emmanuel Macron, n’avait pas besoin d’accélérer le temps de la délibération parlementaire.
En l’espèce, le temps d’examen nous a manqué, de sorte que, si j’étais cynique ou facétieux, je dirais que nous devons aujourd’hui prendre le temps d’examiner une proposition de loi, qui ne fait que corriger les effets d’un manque de temps.
Alors, prenons le temps de la réflexion, mes chers collègues, interrogeons-nous sur la manière dont nous souhaitons travailler. Ne confondons pas l’urgence d’une situation et l’empressement de nos gouvernants, car in fine la qualité de nos travaux en pâtit.
Comme le disait le professeur de droit constitutionnel, Guy Carcassonne, que nous sommes nombreux à avoir connu, « pour faire de bonnes lois, on n’a pas encore inventé mieux que le Parlement » – à condition bien sûr de lui laisser le temps de travailler.
Mme Françoise Gatel apprécie la référence.

Vous l’aurez compris, nous souscrivons au rétablissement prévu dans cette proposition de loi et le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l’unanimité, votera en sa faveur.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDSE . – M. Marc La ménie applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’irai à l’essentiel, sans pour autant tomber dans la caricature. La précision apportée par la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises est intéressante. Comme cela a été abondamment rappelé, celle-ci permet de clarifier les dispositions de l’article 367 du code de procédure pénale, dont la rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire restait lacunaire.
Je ne rouvrirai pas le débat sur la meilleure manière de faire la loi, mais je rappelle qu’à l’époque, le groupe CRCE s’était opposé à la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Bien que nous puissions envisager la pertinence d’un mandat de dépôt dans les cas les plus graves, tels que ceux relevant de la cour d’assises, notre groupe se doit d’être cohérent.
C’est pourquoi, tenant compte de notre opposition à la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire en 2021 et de notre engagement à mettre fin à la surpopulation carcérale, dont témoigne la proposition de loi déposée par notre collègue, la présidente Assassi, en septembre 2022, nous nous abstiendrons sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, chers collègues, le Parlement votait, en 2011, la simplification des modalités d’incarcération des accusés jugés par la cour d’assises. La condamnation à une peine privative de liberté, supérieure à la durée de la détention provisoire subie, pouvait alors valoir titre de détention de l’accusé.
En 2021, le Parlement s’est de nouveau penché sur cette question. Le législateur a introduit une exception dans l’hypothèse où l’accusé comparaissait libre et était condamné à une peine correctionnelle. Malheureusement, cette modification, opérée à l’occasion de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, a introduit une erreur rédactionnelle en modifiant les modalités d’incarcération prévues par le code de procédure pénale. L’article 367 de ce même code précise que l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention « si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle », écartant ainsi l’hypothèse où l’accusé comparaît détenu et est condamné à une peine d’emprisonnement inférieure à dix ans.
La rédaction actuelle de l’article 367 du code de procédure pénale entraînerait – malheureusement ! – la remise en liberté d’un accusé placé en détention provisoire avant l’audience, lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement ferme. Il est donc nécessaire d’adapter notre droit.
Un décret du Gouvernement, pris en février dernier, a tenté de clarifier les règles applicables à cette situation en précisant chaque cas pouvant être rencontré par la cour d’assises. L’arrêt de la cour d’assises vaut ainsi titre de détention si l’accusé comparaît détenu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement inférieure à la réclusion criminelle. Cependant, bien que le décret ait probablement paré au plus pressé en tentant de lever l’ambiguïté qui s’était glissée dans l’article 367 du code de procédure pénale, les mesures relatives à la procédure pénale relèvent constitutionnellement du domaine de la loi. Ce décret ne pouvait donc régler durablement ce problème de droit.
La proposition de loi que nous examinons ce soir – ou plutôt ce matin ! – a pour objet d’intégrer dans la loi les dispositions prises par le décret du Gouvernement. Elle vise à corriger la malfaçon législative, introduite à l’article 367 du code de procédure pénale lors de sa dernière réforme. Elle précise les mesures applicables lorsque l’accusé est condamné par la cour d’assises, non à une peine de réclusion criminelle, mais à une peine d’emprisonnement ferme.
La commission des lois a adopté deux amendements, présentés par Mme la rapporteure, tendant à introduire des modifications d’ordre rédactionnel afin de simplifier la lecture du texte. En effet, la rédaction initiale comprenait de multiples similitudes avec un article figurant déjà dans la partie réglementaire du code.
Cette redondance et l’allongement de l’article 367 du code de procédure pénale auraient pu prêter à confusion quant aux intentions des auteurs de la proposition de loi Les modifications introduites par la commission ont abouti à une rédaction plus brève pour une clarification ponctuelle de l’article.
Enfin, il est prévu que les précisions apportées aux dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises soient appliquées dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, concernées par le principe de spécialité législative.
Il était indispensable de corriger rapidement cette erreur pour le bon fonctionnement de nos institutions judiciaires. C’est donc, sans surprise, que le groupe UC votera en faveur de cette proposition de loi, telle qu’issue des travaux de la commission.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Au deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ».
L’ article 1 er est adopté.
Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». –
Adopté.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 16 novembre 2022 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente, le soir et, éventuellement, la nuit :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2022 (texte n° 113, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 16 novembre 2022, à zéro heure quinze.