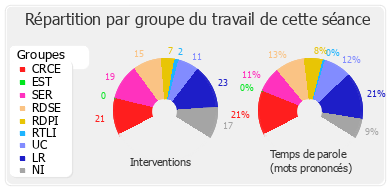Séance en hémicycle du 20 mai 2015 à 14h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Moratoire sur l'utilisation des armes de quatrième catégorie (voir le dossier)
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire
- Moratoire sur l'utilisation des armes de quatrième catégorie
- Débat sur le rétablissement de l'allocation équivalent retraite (voir le dossier)
- Dépôt de documents
- Candidature à une délégation sénatoriale
- Communication d'un avis sur un projet de nomination
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi
- Conditions de saisine du conseil national d'évaluation des normes (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe CRC, de la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation d’armes de quatrième catégorie, et à interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations, présentée par Mme Éliane Assassi et plusieurs de ses collègues (proposition n° 2, résultat des travaux de la commission n° 432, rapport n° 431).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Éliane Assassi, auteur de la proposition de loi.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les problèmes soulevés par l’utilisation d’armes comme le Flash-Ball et le Taser par les forces de l’ordre sont de plus en plus évidents. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons demandé l’examen de cette proposition de loi dans le cadre de notre « niche ».
Ces armes dites « sublétales » sont dangereuses. Leur tir a souvent des conséquences dramatiques. Notre groupe, notamment par la voix de Nicole Borvo Cohen-Seat, qui m’a précédée à la présidence du groupe communiste, républicain et citoyen, a interpellé à plusieurs reprises et depuis de nombreuses années les différents gouvernements à ce sujet.
Dans la continuité de ces interventions et ce cet engagement, le groupe CRC et le groupe écologiste ont déposé la première version de la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui.
Cette proposition de loi vise, comme son intitulé l’indique, à mettre un terme à la multiplication des incidents qui révèlent la dangerosité et la banalisation des armes incorrectement qualifiées de « non létales ».
Trop souvent, ces armes sont utilisées comme moyen offensif pour la dispersion des attroupements et des manifestations.
Ce constat de la dangerosité de ces armes, nous ne sommes pas les seuls à le dresser : de nombreuses associations de défense des droits de l’homme, en particulier, le dressent également.
Concernant le Flash-Ball, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, avant d’être dissoute, avait elle aussi souligné la dangerosité totalement disproportionnée de cette arme en regard des usages pour lesquels elle a été conçue. La CNDS recommandait « de ne pas utiliser cette arme lors de manifestations sur la voie publique, hors les cas très exceptionnels qu’il conviendrait de définir très strictement ». Elle mettait par ailleurs en cause « l’imprécision des trajectoires des tirs de Flash-Ball, qui rendent inutiles les conseils d’utilisation théoriques, et la gravité comme l’irréversibilité des dommages collatéraux manifestement inévitables qu’ils occasionnent ».
Le Défenseur des droits propose quant à lui, notamment, de restreindre l’usage du Flash-Ball en mode contact, c’est-à-dire à bout touchant, et d’étendre aux policiers l’interdiction d’utilisation pour des opérations de maintien de l’ordre qui vaut déjà pour les militaires de la gendarmerie.
Concernant le Taser, la CNDS écrit, dans son rapport concernant les événements des 11 et 12 février 2008 au centre de rétention de Vincennes, qu’« il est permis de s’interroger très sérieusement sur l’utilité du dispositif d’enregistrement vidéo, qui ne permettrait en aucun cas de vérifier a posteriori les circonstances dans lesquelles le pistolet à impulsion électrique a été utilisé ».
Dès 2007, le Comité contre la torture de l’ONU, dans son rapport sur le Portugal, rendait une décision sans appel sur le Taser, qui équipe les polices de ce pays : « Le Comité s’inquiète de ce que l’usage de ces armes provoque une douleur aiguë, constituant une forme de torture, et que dans certains cas il peut même causer la mort, ainsi que l’ont révélé des études fiables et des faits récents survenus dans la pratique. »
Dans une note interne datant de 2008, la préfecture de police de Paris rappelle la vulnérabilité particulière au Taser des personnes aux vêtements imprégnés de « liquides ou de vapeurs inflammables », des « femmes enceintes et [des] malades cardiaques ».
Le Conseil d’État confirme, lui aussi, le 2 septembre 2009, que leur « emploi […] comporte des dangers sérieux pour la santé, résultant notamment des risques de trouble du rythme cardiaque, de syndrome d’hyperexcitation, augmentés pour les personnes ayant consommé des stupéfiants ou de l’alcool, et des possibles complications mécaniques liées à l’impact des sondes et aux traumatismes physiques résultant de la perte de contrôle neuromusculaire ; que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées ».
Le groupe Taser lui-même, dans un guide d’utilisation publié le 12 octobre 2009, reconnaît que l’usage de cette arme fait courir un risque cardiaque à la personne visée.
En 2007 également, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, institution indépendante du Conseil de l’Europe, dans son rapport sur la France, indique qu’il est plus que réticent à l’introduction d’une telle arme en détention, vu la nature particulière des fonctions assumées par le personnel pénitentiaire.
En outre, des négligences et des manquements professionnels graves ont été constatés à maintes reprises quant à l’utilisation de ces armes dites « sublétales ».
Pas plus tard que le 2 avril dernier, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné un policier qui, en tirant avec son Flash-Ball, avait blessé un adolescent de 17 ans pour usage disproportionné de la force, hors de toute légitime défense.
Après ces rappels qui me paraissaient importants, j’en viens à la question de l’efficacité de ces armes en matière de maintien de l’ordre.
Voyons d’abord ce qu’en dit l’autorité de tutelle.
Le ministre de l’intérieur, en réponse à une question écrite concernant le Taser et le Flash-Ball, indiquait le 17 octobre 2013 que « d’autres voies doivent être étudiées […] pour améliorer la sécurité des forces de l’ordre ». Il va de soi que nous sommes, nous aussi, très attentifs à la sécurité des forces de l’ordre. Dans la même réponse, le ministre indiquait qu’il s’agissait « d’être plus efficace dans la prévention de la délinquance et dans la lutte contre les violences, pour éviter chaque fois que possible les situations justifiant le recours aux armes de force intermédiaire » et faisait le lien entre le nécessaire renforcement des « effectifs de police et de gendarmerie et leur présence sur le terrain » et les actions engagées pour « améliorer le lien de confiance entre les forces de l’ordre et la population », afin de ne pas avoir besoin d’employer ces armes.
Si l’on ne peut qu’adhérer à ces déclarations d’intention, force est de constater qu’elles ne se traduisent pas en actes et qu’il y a une inflation dans l’utilisation des armes par la police et la gendarmerie. Selon les dernières données rendues publiques par le Défenseur des droits, le nombre de tirs a augmenté de 65 % en trois ans chez les policiers.
L’inflation de cette utilisation et de la dotation des personnels – 5 000 en 2013 – nécessiterait d’être mise en perspective avec l’insuffisance des moyens mis à disposition d’une police de proximité.
En la matière, la responsabilité de la droite est écrasante : 12 000 postes de policier et de gendarme ont été supprimés par elle à partir de 2007.
À défaut d’une police de proximité pourvue de moyens suffisants, la possibilité offerte par les armes dites « non létales » de neutraliser un individu plus facilement et moins dangereusement qu’en employant les méthodes conventionnelles favorise, de fait, un recours plus fréquent à la force et radicalise la confrontation entre les protagonistes au détriment de la négociation et du dialogue.
Mais force est de constater aussi que, au lieu d’inverser radicalement cette tendance, l’actuel gouvernement, malgré ses déclarations d’intention et bien qu’il ait rétabli, nous en convenons, quelques moyens, qui demeurent néanmoins très insuffisants, participe à cette escalade et tente de se reposer de plus en plus sur les collectivités territoriales et le privé en matière de sécurité.
Nous sommes dans un engrenage dangereux, et l’on assiste à un surarmement, y compris des polices municipales, dont l’équipement en armes sublétales n’est qu’une étape.
Ainsi, près de 8 000 des 20 000 policiers municipaux sont aujourd’hui dotés d’armes à feu, et un décret signé le 29 avril dernier par le Premier ministre et le ministre de l’intérieur vient d’autoriser par dérogation les polices municipales à porter un revolver chambré pour le calibre 357 Magnum à titre expérimental durant cinq ans, avec des munitions de calibre 38 Spécial. Excusez du peu !
Selon nous, la sécurité doit rester une mission régalienne de l’État et nous pensons même, avec d’ailleurs les policiers municipaux et un certain nombre de leurs syndicats, qu’il faudrait au contraire une renationalisation des polices municipales, assortie d’une harmonisation des statuts, des formations et des salaires par rapport à ceux des policiers nationaux.
Pour l’heure, ne faudrait-il pas réactiver la police de proximité plutôt que d’envoyer les CRS, les brigades anticriminalité et les groupes d’intervention régionaux dans les quartiers dits « sensibles », armés de Taser, de Flash-Ball et de je ne sais quelle arme dernier cri ?
Une lutte efficace contre, par exemple, les phénomènes de bandes, qui hélas ! se développent, y compris dans des territoires qui étaient jusqu’alors épargnés, suppose en amont que soient menés des actions de prévention et un travail de police de proximité afin de mieux connaître ces bandes et d’identifier leurs membres, puis que des mesures soient prises pour assurer la sécurité dans les établissements scolaires et, enfin, que des actions pédagogiques soient menées.
Il est plus que temps de retisser et de renforcer le lien de confiance entre le citoyen et la police, sa police, oserai-je dire. C’est une question à la fois d’éthique et d’efficacité.
En ce sens, la mise en place d’une police de proximité et le rétablissement des commissariats au cœur des quartiers – et l’élue séquano-dionysienne que je suis est bien placée pour en parler, croyez-m’en ! –, avec des policiers bien formés, bien encadrés, est une urgence absolue.
Il est également plus que temps de ne plus asphyxier budgétairement les dispositifs de prévention et de réparation de la délinquance tout en surpeuplant les prisons, ce qui tend à les transformer en véritables écoles du crime.
Le rapporteur de la commission des lois va vous demander, mes chers collègues, de ne pas adopter cette proposition de loi.
Il est vrai que, depuis la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les armes qui nous intéressent sont classées en catégorie B pour l’essentiel, catégorie qui comprend certaines armes à feu. De ce point de vue, le texte de la proposition de loi doit être modifié.
Je pense toutefois qu’il serait coupable d’en rester au statu quo, comme le propose la commission, qui reconnaît pourtant qu’il s’agit d’une vraie problématique. Je remercie M. le rapporteur, qui s’est montré très attentif à certaines de nos propositions, même s’il a plaidé pour le rejet de notre texte.
Le groupe de travail commun à la police et à la gendarmerie sur les techniques du maintien de l’ordre et leur évolution envisageable, lancé par le ministre de l’intérieur à la suite des événements du barrage de Sivens, confirme, s’il en était besoin, l’importance de cette question.
Monsieur le rapporteur, même si vous ne partagez pas notre point de vue, vous avez pu vous-même constater que « la formation habilitant au port de cette arme demeure insuffisante », qu’ainsi « un fonctionnaire de police ou de gendarmerie peut ne pas s’être formé à cette arme pendant une période allant jusqu’à vingt-six moi » et que « par ailleurs, comme l’ont souligné les syndicats, la formation s’avère essentiellement théorique, les tirs étant réalisés sur des cibles statiques ».
Vous avez également souhaité, et nous nous en réjouissons, qu’un nombre maximal d’utilisations du Taser X 26 sur la même personne soit établi sur le fondement d’analyses provenant du corps médical.
Toutefois, ces armes posent de nombreux autres problèmes.
Souvenons-nous que, à la fin de 2010, lorsqu’un homme de 38 ans est décédé à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, après avoir reçu plusieurs décharges de Taserlors d’une intervention de la police nationale, les associations des droits de l’homme n’ont pas été les seules à réagir et à demander un moratoire.
En effet, cet événement avait aussi fait réagir le Syndicat national des policiers municipaux qui demandait, comme nous le réclamons aujourd’hui au travers de cette proposition de loi, l’instauration d’un moratoire sur l’utilisation du Taser chez les fonctionnaires de police municipale et avait estimé qu’il s’agissait d’un outil de plus qui défavorisait les forces de l’ordre. Je me permets de citer le représentant de ce syndicat qui, en réponse à des questions de la chaîne Toulouse Infos, tenait notamment les propos suivants : « Il faudrait se souvenir que les policiers travaillaient uniquement avec un bâton de défense et une arme à feu, et avec ça ils savaient se débrouiller. Aujourd’hui, on nous donne beaucoup, et avec ce beaucoup, on s’aperçoit qu’on fait de moins en moins, ou alors de moins en moins bien. »
Ces propos d’un homme de métier résument assez bien nombre de nos préoccupations concernant ces armes.
J’espère que nous aurons, sur ce sujet, un débat serein et constructif. Quoi qu'il en soit, pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, il me semble que notre proposition de loi, modifiée pour tenir compte des changements législatifs qui sont intervenus, est tout à fait opportune et, en particulier parce qu’elle permettrait d’instituer un moratoire sur l’utilisation du Taser, mérite d’être adoptée.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la vice-présidente de la commission des lois, mes chers collègues, notre assemblée est aujourd’hui saisie de la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation d’armes de quatrième catégorie et à interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations, présentée par Mme Éliane Assassi et plusieurs de ses collègues.
Selon les auteurs de cette proposition de loi, les incidents engendrés par l’usage de ces armes, notamment le Flash-Ballsuperpro, appellent leur évaluation approfondie, et donc la suspension de leur utilisation.
Leur argumentation se fonde en particulier sur un incident survenu le 8 juillet 2009, au cours duquel une personne a perdu l’usage d’un œil à la suite d’un tir provenant d’un Flash-Ball superpro.
Le texte de cette proposition de loi se compose de deux articles.
L’article 1er vise à suspendre la commercialisation, la distribution et l’utilisation des armes de quatrième catégorie.
L’article 2 tend à modifier l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure afin de restreindre les circonstances dans lesquelles ces armes peuvent être utilisées par les forces de l’ordre.
Cette proposition de loi pose plusieurs difficultés formelles, mais qui n’en sont pas moins substantielles.
D’une part, elle se réfère à une classification des armes obsolète. En effet, depuis la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, l’ancienne classification en huit catégories, de 1 à 8, a été remplacée par une nouvelle classification plus lisible de quatre catégories, de A à D, fondée sur la dangerosité des armes.
Les armes de quatrième catégorie, dont la suspension de la commercialisation, de l’utilisation et de la distribution est proposée, ont été essentiellement requalifiées en catégorie B, dont le régime de détention est soumis à autorisation préalable. Néanmoins, il n’existe pas de correspondance stricte entre l’ancienne quatrième catégorie et la nouvelle catégorie B.
Deux amendements ont été déposés qui tendent à modifier le texte de manière qu’il ne se réfère plus à la classification devenue obsolète.
D’autre part, il convient de relever une certaine contradiction entre les deux articles de la présente proposition de loi. En effet, si un moratoire est décidé à l’article 1er, ce qui est conforme avec le titre de la proposition de loi comme avec son exposé des motifs, cela semble rendre caduc, ou du moins contradictoire, l’objet de l’article 2, qui est de restreindre les possibilités d’utilisation de ces armes par les forces de sécurité en situation du maintien de l’ordre.
La commission des lois s’est par ailleurs interrogée sur les conséquences juridiques et opérationnelles de ce texte.
Tout d’abord, je souhaite rappeler que, en l’état actuel du droit français, le rétablissement de l’ordre public par les forces de l’ordre s’inscrit dans un régime très contraignant : le recours à la force doit répondre à un double critère d’absolue nécessité et de proportionnalité, l’emploi de la force étant toujours conditionné à une stricte gradation dans les moyens utilisés.
L’utilisation des armes, qui n’est qu’une des modalités de l’emploi de la force, est seulement autorisée pour disperser un attroupement à la suite d’au moins deux sommations.
Par exception, l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que les représentants de la force publique peuvent faire directement usage de la force, sans sommation ni ordre exprès des autorités habilitées, uniquement lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
C’est exclusivement dans ce cadre et à titre exceptionnel que peut être autorisée l’utilisation de lanceurs de balles de défense et de leurs munitions.
En dehors du cadre du maintien de l’ordre, les armes de force intermédiaire telles que le Flash-Ball superpro ou le Taser peuvent être utilisées dans des circonstances où l’usage de l’arme individuelle serait légalement justifié, c’est-à-dire lorsque l’emploi d’une arme s’avère nécessaire afin de dissuader ou neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui. L’usage de ces armes relève alors des dispositions pénales de droit commun relatives à la légitime défense – l’article L. 122-5 du code pénal – et à l’état de nécessité – article L. 122-7 du même code – et permet d’éviter le recours à des armes létales, plus dangereuses.
Aussi l’adoption de l’article 1er, qui vise à interdire un grand nombre d’armes sans pour autant proposer d’armes de substitution, aurait-elle deux conséquences opérationnelles pour les forces chargées du maintien de l’ordre. Ces dernières n’auraient plus d’autre choix que de se retirer et de laisser le terrain, ce qui n’est pas sans effet la crédibilité de l’autorité de l’État, ou au contraire d’aller au contact, ce qui pourrait entraîner de très lourdes conséquences tant pour les forces de l’ordre que pour les manifestants.
Pour ma part, j’estime qu’il est nécessaire de conserver une capacité de riposte mais aussi de dissuasion à la hauteur de la gravité des troubles à l’ordre public provoqués par des attroupements.
De plus, les armes telles que le lanceur de balles de défense présentent l’avantage d’être discriminantes en permettant de cibler spécifiquement les fauteurs de troubles, à la différence des gaz lacrymogènes par exemple.
Par ailleurs, il semble paradoxal d’interdire des armes de force intermédiaire de catégorie B tout en maintenant l’utilisation d’armes létales de catégorie A.
Je rappelle que le ministère de l’intérieur organise de manière permanente et régulière une évaluation de l’utilisation de ces armes, mais aussi une veille concernant les nouvelles technologies qui pourraient les améliorer, voire les remplacer. Ainsi, la direction générale de la police nationale a lancé un appel d’offres afin de permettre l’utilisation par le lanceur de balles de défense dit LBD 40 de munitions de courte portée permettant un emploi dans des distances similaires au Flash-Ball superpro.
J’en viens aux remarques concernant spécifiquement l’article 2 de cette proposition de loi.
Actuellement, l’alinéa 6 de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure restreint l’usage direct de la force à des circonstances où des violences ou voies de fait sont exercées contre les forces de l’ordre ou lorsque celles-ci ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent.
L’article 2 de cette proposition de loi vise à compléter cet alinéa afin de préciser que des armes telles que le Flash-Ballsuperpro ne pourront être utilisées « à cette fin […] que dans des circonstances exceptionnelles où sont commises des violences ou des voies de fait d’une particulière gravité et constituant une menace directe contre leur intégrité physique ».
Je m’interroge sur l’interprétation de ces dispositions. En particulier, la notion peu précise de « violences d’une particulière gravité » présente un risque d’insécurité juridique en ce qu’elle relève d’une interprétation subjective de la situation a posteriori. Il semble très difficile, voire impossible, pour les forces de l’ordre d’anticiper les conséquences des violences qu’elles subissent afin de déterminer les armes susceptibles d’être utilisées.
Je rappelle enfin que l’emploi des armes, y compris en légitime défense, reste soumis à un principe d’absolue nécessité, de proportionnalité et de gradation dans l’emploi des armes.
Complexifier le cadre de l’emploi de la force en légitime défense pour soi ou pour autrui présente un risque certain, tant pour la sécurité des forces de police et de gendarmerie que pour les citoyens.
Telles sont les différentes raisons pour lesquelles la commission n’a pas adopté la proposition de loi.
Elle a néanmoins fait siennes les légitimes interrogations soulevées par ce texte. Elle a notamment insisté sur la nécessité d’une meilleure formation des personnels habilités au port du Flash-Ball superpro et souhaité – personnellement, j’y tiens beaucoup – que les lanceurs de balles de défense LBD 40 soient équipés dans les meilleurs délais de munitions de courte portée pour remplacer le Flash-Ball superpro, trop imprécis et par là même trop dangereux.
Sous le bénéfice de ces observations et au regard des difficultés posées par ce texte, je vous invite donc, mes chers collègues, à ne pas adopter la présente proposition de loi, même si celle-ci a le mérite de soulever de vraies questions.
Mme Catherine Troendlé, vice-présidente de la commission des lois, applaudit.
Madame la présidente, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre de l’intérieur.
La proposition de loi relative à l’usage et à la commercialisation des armes de catégorie B, présentée par la présidente Éliane Assassi et les membres du groupe CRC, porte sur un sujet sensible, qui mérite donc d’être traité avec une grande rigueur.
Ces dernières années, quelques polémiques médiatiques ont pu naître à la suite d’accidents impliquant l’usage de telles armes. Or le rôle des dirigeants politiques, au Gouvernement comme au Parlement, n’est point de céder à l’esprit de polémique, mais bien de faire preuve de responsabilité.
La proposition de loi présentée par les élus du groupe CRC vise, d’une part, à instituer un moratoire sur la commercialisation et l’utilisation des armes de catégorie B, autrement dit des armes intermédiaires telles que les lanceurs de balles de défense, dont les Flash-Ball font partie, ou les pistolets à impulsion électrique, souvent appelés Taser, du nom de leur principal fabricant.
D’autre part, cette proposition vise à compléter l’avant-dernier alinéa de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure en précisant que lesdites armes de catégorie B ne peuvent être utilisées par les forces de l’ordre « que dans les circonstances exceptionnelles où sont commises des violences ou des voies de fait d’une particulière gravité et constituant une menace directe contre leur intégrité physique ».
Je tiens d’abord à vous dire, mesdames, messieurs les membres du groupe CRC, que le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, partage naturellement votre souci d’encadrer avec la plus grande rigueur l’usage des armes auxquelles ont recours les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions.
Chaque jour, policiers et gendarmes risquent leur vie pour protéger nos concitoyens et faire respecter les lois de la République. Nous connaissons tous le prix que, trop souvent, ils paient dans l’accomplissement de leurs missions.
Ainsi, l’année dernière, quatre policiers ont été tués en opération, et près de 9 000 ont été blessés. Depuis le début de l’année 2015, la police nationale déplore la perte de deux agents en mission, tandis que plus de 850 ont été blessés.
La gendarmerie nationale, quant à elle, a perdu en 2014 trois des siens en opération ; cette même année, plus de 1 750 gendarmes ont par ailleurs été blessés au cours d’interventions, et déjà plus de 360 l’ont été depuis le début de cette année.
Depuis plusieurs mois, de nombreux faits de percussions volontaires des policiers et gendarmes sont constatés sur la voie publique, leur causant des blessures graves, parfois même leur décès comme ce fut le cas, voilà quelques semaines, d’un policier de Decazeville. Je peux évoquer aussi les nombreuses embuscades tendues aux forces de l’ordre ou encore les agressions dont les patrouilles font l’objet.
Nous devons tous avoir cette réalité à l’esprit lorsque nous posons la question de l’armement des forces de l’ordre, confrontées à plusieurs formes de délinquance et de criminalité, de plus en plus violentes d’ailleurs. Il nous faut être prudents chaque fois qu’il est question de modifier le cadre juridique qui leur permet d’en faire usage, qu’il s’agisse des armes à feu ou bien, comme c’est le cas aujourd’hui, des armes intermédiaires.
Le Gouvernement, le ministre de l’intérieur au premier chef, comprend la préoccupation qui est celle des auteurs de cette proposition de loi. Comme je l’ai dit, l’utilisation de certaines armes de force intermédiaires a pu, par le passé, provoquer des accidents. Il ne nous semble donc pas anormal que nous posions la question de leur usage.
Pour autant, le Gouvernement ne peut soutenir une telle proposition de loi, qui pose plusieurs problèmes de fond.
Je voudrais dire quelques mots de l’actuelle réglementation en la matière.
Celle-ci encadre déjà très strictement la commercialisation, la distribution et l’utilisation des armes de catégorie B, qui comprend aussi bien des armes à feu de poing et des armes d’épaule – à l’exception des fusils de chasse – que des lanceurs de balles de défense, des armes à impulsion électrique et des aérosols lacrymogènes.
En effet, l’article L. 2332-1 du code de la défense dispose que les entreprises de fabrication et de distribution de telles armes sont soumises à l’autorisation de l’État et placées sous son contrôle.
De même, l’article L. 311-1 du code de sécurité intérieure indique que l’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation.
Les articles L. 312-3 et L. 312-4 du même code précisent les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations d’acquisition et de détention de ces armes. Outre les forces de l’ordre, seuls les tireurs sportifs, les entreprises du secteur des activités privées de sécurité et toute personne qui, en raison de ses activités professionnelles, voit sa vie exposée à des risques sérieux, peuvent être autorisés à recourir à ces armes de catégorie B.
Vous le constatez, l’État exerce un contrôle très rigoureux et très poussé sur ces armes, et cela de leur production à leur utilisation. De ce fait, aucune autorisation de détention de pistolets à impulsion électrique, ou Tasers, ou de lanceurs de balles de défense de type Flash-Ball n’a jamais été délivrée à des particuliers.
En conséquence, en vertu de la réglementation actuellement en vigueur, n’importe qui ne peut vendre, acheter, fabriquer ou détenir des armes de catégorie B.
Pourtant, via cette proposition de loi, les sénateurs du groupe CRC entendent interdire la commercialisation et l’utilisation de ces armes « par toute personne », ce qui est déjà le cas ! J’ajoute que, en aucune circonstance, les particuliers ne peuvent détenir des armes de type Taser ou Flash-Ball. À cet égard, le présent texte apparaît donc, en réalité, superfétatoire.
J’en viens à l’usage spécifique que font les forces de l’ordre de ces armes intermédiaires. Sur ce point également, la réglementation en vigueur est très claire.
Je rappelle que les articles D. 211-19 et suivants du code de la sécurité intérieure indiquent notamment que les forces de l’ordre peuvent utiliser, lors d’une opération de maintien de l’ordre public, des lanceurs de balles de défense de type Flash-Ball.
Les forces de l’ordre peuvent également avoir recours à des pistolets à impulsion électrique agissant à distance pour neutraliser des personnes violentes et menaçantes.
Au demeurant, l’usage des pistolets de type Taser est interdit dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre public, par instruction commune des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Certes, les forces de l’ordre sont autorisées à employer le Flash-Ball en vue du maintien de l’ordre. Toutefois, les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, et les unités de gendarmerie mobile ne sont pas pourvues de tels équipements.
M. le rapporteur acquiesce.
Vous observez que l’usage des armes de catégorie B par les forces de l’ordre est, lui aussi, rigoureusement encadré. Or ces forces, si la présente proposition de loi était adoptée par le Parlement, se trouveraient privées du recours à ces armes intermédiaires, qui, je le répète, sont non létales. De ce fait, toute gradation dans l’usage qu’elles font de la force deviendrait impossible.
L’article 1er du présent texte priverait ainsi, de droit, l’ensemble des forces de sécurité intérieure de toute arme de ce type, quel que soit le cadre juridique de leur utilisation. C’est donc tout un éventail de réponses graduées et proportionnées que les forces de l’ordre n’auraient plus à leur disposition. Or celles-ci peuvent être placées dans des situations impliquant qu’elles fassent usage de la force : l’emploi de cette dernière peut être légitime et nécessaire pour dissuader ou neutraliser une personne violente et dangereuse, tout en évitant de recourir à une arme à feu.
En conséquence, une telle disposition législative laisserait les agents des forces de l’ordre, dans des situations de violence où leur vie même serait menacée, face à l’alternative suivante : ou bien recourir à une arme à feu, c’est-à-dire à une arme létale ; ou bien être dans l’impossibilité de riposter, de se protéger ou de protéger les tiers. Une telle alternative n’est pas acceptable.
De surcroît, s’il était adopté, ce texte remettrait en cause la doctrine française de maintien de l’ordre, laquelle repose sur le refus du contact entre les forces de l’ordre et les personnes menaçant l’ordre public.
Je rappelle que, dans le cadre de cette doctrine, l’usage des armes intermédiaires permet de lutter avec efficacité contre les débordements violents qui accompagnent certains rassemblements organisés ou spontanés sur la voie publique.
Dès lors, adopter cette proposition de loi conduirait à priver les forces de l’ordre des moyens adaptés aux missions de maintien de l’ordre qu’elles doivent assumer. Ce faisant, nous les contraindrions à employer des moyens moins discriminants. Une telle situation ne manquerait pas de nuire à leur capacité de neutraliser et d’interpeller les fauteurs de troubles. J’ajoute que la sécurité d’autres manifestants ou du public s’en trouverait menacée.
Non seulement nous exposerions les forces de l’ordre à des situations de violence pouvant menacer leur intégrité physique, mais nous les placerions dans une position impossible, les contraignant, là encore, à faire usage d’armes létales pour se défendre.
En réalité, au regard du but visé, cette proposition de loi paraît contreproductive. En effet, interdire les armes intermédiaires revient à autoriser l’usage des armes à feu, donc des armes létales.
Depuis une quinzaine d’années, on constate que l’utilisation par les forces de l’ordre des armes non létales a entraîné une nette diminution, un recul continu de l’usage des armes létales. Et l’on prendrait le risque d’inverser une telle tendance, de revenir sur un tel progrès ? Je ne peux l’imaginer. En tout cas, ce n’est pas la volonté du Gouvernement.
Le risque serait d’autant plus élevé que l’on constate parallèlement – je l’ai dit au début de mon intervention – une augmentation des agressions dirigées contre les forces de l’ordre au cours des dernières années. Dans un tel contexte, il n’est pas opportun de réduire les moyens dont celles-ci disposent pour y faire face.
Nous devons donc faire confiance aux femmes et aux hommes qui composent nos forces de l’ordre, ces femmes et ces hommes qui nous protègent au quotidien contre toutes les menaces et toutes les violences susceptibles de miner la société. Confrontés à des situations de plus en plus difficiles, ils font preuve d’un grand sang-froid dans l’exercice de leurs missions.
En effet, les conditions juridiques de l’usage des armes, qu’il s’agisse d’ailleurs des armes à feu ou des armes intermédiaires, ont été parfaitement intériorisées par les agents des forces de l’ordre, selon trois principes cardinaux. Premièrement, le danger doit être réel et actuel. Deuxièmement, la riposte doit relever d’une absolue nécessité. Troisièmement, elle doit être proportionnée à la menace.
Je ne puis manquer d’évoquer les accidents provoqués par les armes intermédiaires, notamment les Flash-Balls et les pistolets de type Taser, lesquels sont à l’origine de cette proposition de loi.
Il est inutile de le nier, il y a eu des accidents, mais, en réalité, ils sont rares : leur nombre est très faible. En 2013, l’Inspection générale de la police nationale, l’IGPN, a ainsi été saisie de neuf faits, trois concernant l’usage d’un Taser et les six autres concernant des lanceurs de balles de défense.
En outre, l’année dernière, dix-sept procédures judiciaires ont été diligentées par l’IGPN. Parmi elles, dix concernent l’usage d’un lanceur de balles de défense et les sept autres l’usage d’un pistolet de type Taser. Enfin, depuis le début de l’année 2015, trois procédures judiciaires ont été ouvertes par l’IGPN. Toutes ont pour objet l’usage du pistolet de type Taser. Le nombre d’accidents reste donc faible. Toutefois, si les armes intermédiaires sont non létales, c’est-à-dire non destinées à tuer, elles n’en sont pas moins des armes. Leurs effets ne doivent pas être sous-estimés.
Madame Assassi, je le répète, le Gouvernement comprend l’esprit dans lequel vous avez déposé votre proposition de loi.
C’est ce même esprit qui a conduit le ministre de l’intérieur à engager une réforme de l’armement intermédiaire dont disposent les forces de l’ordre. Vous l’avez souligné vous-même, les lanceurs de 44 millimètres de type Flash-Ball manquent de précision, ce qui a parfois pu provoquer des accidents. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement procède à leur remplacement progressif par des lanceurs de 40 millimètres à visée laser, qui permettent à nos agents de gagner en précision lorsqu’ils procèdent à un tir de balle de défense.
La réforme est donc en cours : dans des délais réduits, le Flash-Ball ne sera plus du tout utilisé. Pour autant, dans l’intervalle, un moratoire sur les armes intermédiaires serait contre-productif et pourrait avoir des conséquences extrêmement dangereuses : nous ne pouvons pas nous permettre de désarmer nos forces de l’ordre.
Enfin, je tiens à vous apporter quelques précisions quant au dossier du rapprochement entre la police et la population. En tant que secrétaire d’État chargée de la politique de la ville, je me consacre à ce travail depuis plusieurs mois, ainsi que Bernard Cazeneuve.
À ce titre, MM. Cazeneuve et Kanner et moi-même avons cosigné une circulaire le 25 mars dernier et lancé un appel à projets de plus d’un million d’euros en direction des territoires, pour faire remonter des propositions de rapprochement entre la police et la population, notamment de la part du tissu associatif.
Parallèlement, nous avons décidé la création d’une cellule nationale. Cette structure, inédite, permettra de réunir des représentants des associations et des forces de l’ordre, afin d’étudier toutes les problématiques émergeant des territoires et de valoriser au mieux les initiatives qui portent leurs fruits – je songe notamment aux délégués police-population, que nous avons déployés dans plusieurs commissariats. Ces personnels viendront en appui des fonctionnaires de police, dons nous renforçons actuellement les effectifs par la voie de nouveaux recrutements.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis heureuse de saluer, en votre nom, la présence dans notre tribune d’honneur d’une délégation du Parlement du Ghana
Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

La délégation a été reçue par le président du Sénat. Elle a également rencontré M. Jacques Legendre, président du groupe d’amitié France-Afrique de l’ouest, que je salue, et plusieurs autres membres dudit groupe d’amitié.
Au nom du Sénat tout entier, je me réjouis de la création, par le Parlement du Ghana, d’un groupe Ghana-France, qui contribuera au renforcement des relations entre nos deux assemblées. Je souhaite naturellement à la délégation la plus cordiale bienvenue.
Applaudissements prolongés.

Nous reprenons la discussion, à la demande du groupe CRC, de la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l'utilisation et la commercialisation d'armes de quatrième catégorie, et à interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Cécile Cukierman.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, s’agit-il d’un paradoxe ou d’un hasard du calendrier ? Comme l’a relevé le réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme, le RAIDH, le président des États-Unis, Barack Obama, conscient de l’effet délétère, vis-à-vis de la population, du surarmement des forces de police, vient d’interdire la dotation des forces de l’ordre américaines en équipements militaires. C’est là une première leçon tirée des récentes émeutes de Ferguson.
Quand elle porte ses regards de l’autre côté de l’Atlantique, la France préfère-t-elle s’inspirer des erreurs commises ou des corrections qui leur sont apportées ?
Bien sûr, notre pays n’a pas connu de drames comparables à celui de Ferguson, ni d’actes racistes commis par les forces de l’ordre assimilables à ceux qui ont, il y a peu de temps encore, frappé les États-Unis. Toutefois, de telles situations ne peuvent manquer de nous interpeller.
Les armes dont nous débattons aujourd’hui ont officiellement pour fonction de tenir à distance un attroupement devenu source de violence ou de neutraliser une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui, en minimisant les risques et en évitant le recours, incomparablement plus dangereux, aux armes à feu.
À condition d’être convenablement utilisées, ces armes seraient conçues pour que la cible visée ne soit ni tuée ni blessée grièvement, mais « impressionnée » – c’est là le terme employé par le ministère de l’intérieur, qui, en 2002, a généralisé l’usage de ces dispositifs. Pourtant, la multiplication des incidents met au jour la dangerosité de ces armes. Ma collègue Éliane Assassi a exposé en détail ce risque sanitaire, et je n’y reviendrai pas.
Ces armes servent de plus en plus souvent comme moyens offensifs, pour la dispersion des attroupements et des manifestations.
En principe, la police ne peut les employer qu’en cas de légitime défense ou en « état de nécessité », à une distance définie selon leur type. Or force est de constater que, dans l’écrasante majorité des cas, les forces de l’ordre n’emploient ces armes ni en position de légitime défense ni dans cet état de nécessité que considèrent prioritairement les procédures internes.
Depuis plusieurs années, l’armée, la police et la gendarmerie nationales disposent de ces équipements. Depuis 2008, les polices municipales sont également habilitées à employer ces armes, au rang desquelles figurent le lanceur de balles de défense et les pistolets à impulsion électrique. Ces armes sont devenues une source permanente de dérapages, voire de bavures.
Il nous semble donc absolument nécessaire d’encadrer strictement toutes les formes d’utilisation de ces armes non létales, afin de prévenir les dérives et les risques sanitaires auxquels leur utilisation donne lieu. Il s’agit notamment de retisser et de renforcer le contrat de confiance, indispensable en République, entre la population et la police, la seconde étant présente avant tout pour protéger la première. Un autre texte de loi nous donnera bientôt l’occasion de revenir sur ce sujet.
Cet impératif est d’autant plus fort qu’il faut protéger le droit imprescriptible de manifester et le droit d’expression des mouvements sociaux, qui ne sauraient être soumis à une pression policière tendant à les marginaliser, voire à les criminaliser. On a pu constater cette tentation en diverses circonstances. En tant que sénatrice de la Loire, j’ai bien entendu à l’esprit la bataille des « cinq » de Roanne.

À cet égard, nous regrettons que la commission n’ait pas auditionné des représentants d’associations de défense des droits de l’homme, comme Amnesty international, la ligue des droits de l’homme ou encore le RAIDH, que j’ai cité en ouvrant mon propos.
Tout au long de ces dernières années, ces acteurs ont émis des critiques au sujet de ces armes et pointé du doigt les dangers qui leur sont propres. Ils ont alerté les parlementaires et, plus largement, la population, quant à l’usage qui doit en être fait et quant aux dérives observées. Ces débats ne concernent donc pas seulement les forces de l’ordre, mais bien toute la société.
Je relève d’ailleurs, monsieur le rapporteur, un point intéressant : vous vous faites, dans votre rapport, le relais des syndicats de policiers et des représentants du ministère de l’intérieur – il est important qu’ils soient entendus – quand vous affirmez que le bilan de ces armes est plus que satisfaisant. Pourtant, quelques lignes plus loin, vous invitez également les forces de l’ordre à communiquer « le bilan des armes de force intermédiaire permettant d’établir un ratio d’accidents en fonction du nombre de tirs ». N’y a-t-il pas là une légère contradiction, et surtout la preuve que les choses sont loin d’être aussi claires que vous voulez le laisser croire ?
On voit bien en tout cas que cette problématique requiert davantage de transparence, plutôt que des affirmations qui dépeignent celles et ceux qui voudraient interdire l’utilisation de ces armes comme de gentils rêveurs inconscients des menaces qui existent dans notre société…
Pour toutes ces raisons, nous pensons que notre proposition de loi reste valable, même si elle mérite bien évidemment d’être mise à jour. C’est le propre de toute proposition de loi ou de tout projet de loi : on acte à un moment donné des principes et des engagements, quitte à ce que, dans les mois ou les années qui suivent, le texte puisse évoluer pour rester à jour et toujours répondre aux besoins de sécurité collective et individuelle de notre société.
Enfin, je ferai remarquer que les catégories d’armes définies à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont désormais désignées par des lettres et non plus par des chiffres. Nous avons voulu tenir compte de cette évolution et apporter la preuve qu’une proposition de loi peut être adaptée avant même d’être débattue ; elle pourrait donc, une fois adoptée, faire l’objet d’autres adaptations. Nous déposerons des amendements en ce sens, que nous vous proposerons bien évidemment d’adopter, dans la logique de notre texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, de l’autre côté de l’Atlantique, les policiers américains ont jusqu’à présent accès à des équipements militaires tels que des véhicules blindés à chenilles, des armes à feu de très gros calibre, des armes d’assaut ou encore des uniformes de camouflage. Le mélange des genres entre l’armée et la police a brouillé le message pour les citoyens et a causé un véritable schisme entre la population et les forces de police, qui sont pourtant censées être gardiennes de la paix. Nous connaissons les débordements qui en ont découlé.
En France, nous sommes évidemment bien loin de cette situation. Nos forces de l’ordre sont elles aussi armées, afin de mener à bien leurs missions essentielles. Toutefois, leurs moyens restent proportionnés aux objectifs visés.
Être armé est loin d’être anodin, nous le savons. Lors de rassemblements, comme il y en a eu récemment encore, les forces de l’ordre sont amenées à intervenir de manière d’abord préventive, et parfois plus active, contre des individus qui peuvent se révéler violents ou constituer une menace sérieuse pour les biens et les personnes.
Malheureusement, cela peut parfois avoir des conséquences dramatiques, tant il est difficile de répondre avec la bonne mesure et de façon parfaitement adaptée à la violence des manifestants, tout particulièrement dans des situations d’extrême confusion. Il semblerait par ailleurs que la violence envers les forces de l’ordre s’accentue, notamment dans un certain nombre de quartiers de nos zones urbaines.
Nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen soulèvent par cette proposition de loi des difficultés bien réelles quant au degré d’armement des forces de l’ordre en cas d’attroupement sur la voie publique. Ils nous proposent d’instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation d’armes de catégorie B et d’interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations.
Ce moratoire concernerait notamment les Flash-Ball, dont les policiers municipaux aussi peuvent être équipés depuis 2008. Si ces armes sont considérées comme « sublétales », c’est-à-dire conçues pour ne pas tuer, elles restent potentiellement dangereuses et peuvent causer des blessures graves.
Cependant, on ne peut pas non plus exposer les forces de l’ordre à la vindicte parfois très violente des manifestants.
Rappelons qu’un fonctionnaire de police vient d’être condamné pour avoir gravement blessé un lycéen d’un tir de Flash-Ball au visage. Il s’agit d’une des premières condamnations depuis l’introduction, il a plus de dix ans, du lanceur de balles de défense. Ce fonctionnaire avait tiré, hors de toute légitime défense, sur un adolescent de seize ans lors d’une manifestation devant un lycée de Montreuil en 2010.
Le droit de se rassembler constitue une liberté fondamentale et constitutionnellement garantie des citoyens. Nous devons bien entendu nous attacher, quelles que soient nos sensibilités, à protéger ce droit. La liberté doit rester la règle ; la restriction, l’exception.
Toutefois, un rassemblement sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public constitue un attroupement. L’usage de la force devient de ce fait légitime afin d’opérer, si besoin est, sa dispersion.
Dans ce cas précis, le rétablissement de l’ordre public par les forces de l’ordre s’inscrit dans un régime très contraignant dont les modalités sont proches de celles de la légitime défense : l’utilisation de la force doit être proportionnée et répondre à un critère d’absolue nécessité.
Nous ne pensons pas que l’instauration d’un moratoire sur les armes de force intermédiaire soit la solution à un problème qui relève à la fois de la bonne formation des agents de police et de leur déontologie, mais aussi de la responsabilité des manifestants.
Comme le soulignait M. le rapporteur, il semble paradoxal de continuer dans le même temps à permettre l’utilisation des armes létales de catégorie A.
De surcroît, cette mesure introduirait une rupture dans la gradation des moyens puisqu’elle obligerait les forces de l’ordre, en cas d’attroupement, soit à se retirer, ce qui est difficilement justifiable en termes d’ordre public, soit – bien pire solution – à aller au contact des manifestants. La stratégie française du maintien de l’ordre pour la police et la gendarmerie nationales, qui a fait ses preuves jusqu’à présent, repose sur un principe tout opposé : éviter le contact physique avec les manifestants par la mise à distance.
Le groupe RDSE se prononcera donc contre cette proposition de loi, qui aurait pour effet de fragiliser le maintien de l’ordre public, lequel nécessite encore et toujours que l’État conserve le « monopole de la violence physique légitime », pour reprendre la formule bien connue de Max Weber. Toutefois, à l’instar de M. le rapporteur, nous appelons le Gouvernement à renforcer la formation des personnes habilitées à utiliser des pistolets à impulsion électrique et à préciser la doctrine de leur emploi.
J’ajouterai enfin qu’il est normal que force reste à la loi. Il peut y avoir quelques débordements, qu’il faut éviter autant que possible. Toutefois, on ne peut quand même pas transformer les forces de police, qui ont une conception républicaine de l’ordre public, en chair à canon, ou du moins en chair à Flash-Ball.
Applaudissements sur les travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la violence légitime dont peuvent faire usage les forces de l’ordre est, selon la devise qui était gravée sur les canons de Louis XIV, l’ultima ratio – en ces temps, un peu de latin ne fait pas de mal ! – que l’État peut utiliser dans sa puissance pour se protéger et protéger les citoyens.
On ne peut certes nier la notion de violence des forces de l’ordre, qui est intrinsèque à certaines de leurs missions. Cette violence n’est jamais sans conséquence, même si, heureusement, elle n’entraîne que rarement de très graves blessures ou la mort. Or cette violence légitime passe par différents vecteurs qui vont de l’ordre verbal au pistolet, en passant par la contravention, la matraque, ou encore la grenade lacrymogène.
En outre, il est facile de discuter de ces choses confortablement assis dans nos fauteuils moelleux, alors que les situations opérationnelles que vivent les forces de l’ordre sur le terrain sont souvent très complexes. Sans aller jusqu’à invoquer le brouillard de la guerre clausewitzien, il n’en reste pas moins que, bien souvent, les forces de l’ordre doivent prendre des décisions de façon extrêmement rapide pour mener à bien les missions qui leur ont été confiées par le pouvoir politique.
Pour que cette violence puisse s’exercer de façon juste, il est nécessaire qu’elle soit proportionnée à celle dont font preuve les personnes qui s’attaquent à l’État ou aux autres citoyens. Il est donc indispensable que les forces de l’ordre, auxquelles l’État a délégué sa mission régalienne d’assurer la sécurité, ce qui peut éventuellement passer par l’usage de la violence légitime, disposent d’un panel de moyens pour exercer de façon juste et proportionnée la violence en fonction de celle, souvent moins légitime, voire totalement illégitime, dont font montre certaines personnes ou groupes de personnes.
Les armes telles que le Flash-Ball ou le Taser participent pleinement à cet échelonnement de moyens. Entre la matraque et le pistolet automatique, ces armes non létales permettent une gradation de la violence. Certes, elles restent des armes et sont donc dangereuses ; elles ont donc également, ô surprise, des effets sur les personnes qui y sont confrontées… Cela tombe bien, c’est pour cela que les forces de l’ordre les emploient !
Nous ne voulons donc à l’évidence pas de ce moratoire, mais nous nous associons bien volontiers à M. le rapporteur pour demander davantage de formation pour les personnels. Malheureusement, qui dit « formation » dit « temps » et « moyens ». Or les gouvernements successifs de l’UMPS ont diminué les effectifs et les moyens ; il n’y a donc plus ni argent ni temps pour former les personnels ; entre Vigipirate ou la lutte contre les trafics de drogue, d’une part, et une formation supplémentaire sur le Flash-Ball, d’autre part, les responsables de forces de l’ordre ont donc vite fait leur choix, bien sûr.
Je souhaiterais par ailleurs rappeler à notre collègue auteur de cette proposition de loi qu’on ne l’a pas tellement entendue lorsque le Gouvernement a ordonné aux forces de l’ordre de réprimer sévèrement les manifestants pacifiques – aucun dégât n’a été à déplorer malgré l’ampleur des manifestations – qui sont descendus dans la rue pour demander le retrait de loi sur le mariage pour les personnes de même sexe.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Vous voulez la liste des violences policières ? Je vais vous la donner !

La France est d’ailleurs dans le collimateur du Conseil de l’Europe pour ces faits. Voyez-vous, utiliser des grenades lacrymogènes contre des poussettes et des jeunes enfants me semble légèrement plus grave que d’utiliser un Flash-Ball ou un Taser contre des individus qui menacent les forces de l’ordre ou s’en prennent aux biens !
Enfin, même si, pour certains membres du Gouvernement, le « sauvageon » doit être protégé contre la prétendue brutalité policière, permettez-moi de ne pas souscrire à ce discours.

Je veux plutôt profiter de cette tribune pour apporter notre soutien total aux forces de l’ordre dans leur diversité, aux gendarmes et aux policiers nationaux et municipaux, qui œuvrent chaque jour à la protection des Français dans des conditions très difficiles et, le plus souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, de façon juste et proportionnée !

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme les orateurs précédents l’ont confirmé, le sujet traité par ce texte recouvre un enjeu important et particulier, entre souci de protection des populations et adéquation des moyens mis en œuvre face aux menaces identifiées.
L’équilibre n’est pas toujours aisé à trouver en ce qui concerne l’utilisation par les forces de l’ordre des Tasers et autres Flash-Ball.
Depuis que les forces de l’ordre ont accès à ces instruments, des faits divers font régulièrement l’actualité. Ces armes non létales n’en restent pas moins redoutables, et de nombreux incidents ont été recensés, qui ont même parfois une issue fatale.
Rappelons que, en 2013, le Défenseur des droits, M. Dominique Baudis, a rendu un rapport dans lequel il recommandait un meilleur encadrement de l’usage des armes dites « incapacitantes ».
À la suite de la publication de ce rapport, notre groupe avait d’ailleurs interpellé le ministre de l’intérieur de l’époque, M. Manuel Valls, sur les suites qu’il comptait donner à ces propositions.
Le rapport étant resté lettre morte, cette proposition de loi déposée par nos collègues du groupe CRC a le mérite de remettre le débat sur la table, et nous mesurons tous ici la complexité du problème. Cette complexité est telle que, dans leur lucidité collective, les membres du groupe UDI-UC ne peuvent soutenir la solution proposée, tant elle est simpliste et inaboutie.
De fait, la présente proposition de loi nous semble d’une pertinence limitée, pour des raisons à la fois de forme et de fond.
Sur la forme, tout d’abord, la rédaction de ce texte est impropre. Elle fait référence à une nomenclature des armes qui est obsolète depuis trois ans. En effet, la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a modifié de manière substantielle la classification des armes.
Cette nouvelle classification des armes est désormais fondée sur leur dangerosité : déclinée jusqu’à présent en huit catégories, la nouvelle nomenclature répartit les armes dans quatre catégories, de A à D. Or il n’y a pas de réelle correspondance entre la quatrième catégorie initialement visée et la nouvelle catégorie B.
Sur le fond, ensuite, ce texte manque de pondération. Il convient de trouver un juste équilibre entre, d’une part, la sécurité des citoyens, et, d’autre part, celle de nos forces de l’ordre. Or l’adoption de la proposition de nos collègues CRC conduirait à fragiliser de manière disproportionnée nos agents de police et de gendarmerie.
Rappelons que la vocation première du maintien de l’ordre consiste à permettre le plein exercice des libertés publiques dans des conditions optimales de sécurité, tant pour les personnes qui manifestent que pour les forces de l’ordre.
Les forces de sécurité de l’État ont donc pour mission de faciliter l’expression de ce droit. Elles le font dans un cadre juridique strict et en application des instructions ministérielles, c’est-à-dire dans le souci de l’apaisement, afin d’éviter autant que possible toute espèce d’affrontement. Ce n’est que dans l’hypothèse de situations extrêmes, celles du trouble grave à l’ordre public, de l’émeute, voire de l’insurrection, qu’il sera fait usage de la force, laquelle peut entraîner le recours à certaines armes.
La stratégie du maintien de l’ordre consiste à éviter autant que faire se peut le contact physique ; cette préoccupation s’est développée au fil des expériences et des événements. En effet, les manifestants, parfois très agressifs et radicalisés, sont tapis au sein de populations pacifiques.
Le principe qui gouverne l’action de nos forces de l’ordre est celui de la gradation des moyens mis en œuvre conformément au cadre juridique, en vue de permettre une adaptation permanente et une prise en compte différenciée des comportements au sein des attroupements.
Or la proposition de loi qui nous est proposée interdit des armes de force intermédiaire de catégorie B, mais maintient le recours d’armes létales de catégorie A. Où est donc la logique ?
Par ailleurs, et notre collègue Jean-Patrick Courtois le rappelle dans son rapport, « les armes de force intermédiaires, telles que le LBD 40 – un lanceur de balles de défense –, présentent l’avantage […] de cibler spécifiquement les fauteurs de troubles, à la différence des bombes lacrymogènes ». Les armes incapacitantes comportent donc des risques, mais elles ont aussi des avantages certains qu’il nous faut reconnaître.
Aussi malheureux ou tragiques que puissent être les faits divers que nous connaissons tous, il nous faut, mes chers collègues, rester très clairs et sérieux sur ce sujet. En la matière, nous le savons, le risque zéro n’existe pas. Les forces .de l’ordre ont pour mission de protéger nos concitoyens, et elles s’efforcent de le faire dans des situations très difficiles et complexes.
Oui, des changements sont nécessaires. Les différentes institutions sont d’ailleurs conscientes de cet enjeu et tentent d’y répondre. Aussi le ministère de l’intérieur a-t-il constitué un groupe de travail commun à la police et la gendarmerie sur les techniques du maintien de l’ordre et les évolutions envisageables. Dans la même veine, la direction générale de la police nationale a organisé un appel d’offres pour équiper le LBD 40 de courte portée, afin qu’il soit plus précis que le Flash-Ball superpro.
Plus globalement, nous devons nous interroger sur les formations dispensées aux agents habilités à l’utilisation des armes à létalité atténuée, et c’est l’un des mérites de cette proposition de loi. Une réflexion sur ce sujet se révèle indispensable au regard des incidents qui ont pu être observés au cours de ces dernières décennies.
Cependant, ce texte ne prévoit aucune solution de rechange. Nos collègues nous proposent simplement de déposséder nos forces de l’ordre de moyens de défense, ce qui est, bien entendu, inacceptable. C’est là toute la limite de cette proposition de loi.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, bien qu’il soulève des questions importantes sur l’usage des armes à létalité atténuée et, surtout, sur la formation nécessaire à leur utilisation, dont les syndicats de police eux-mêmes constatent les lacunes, les membres du groupe UDI-UC ne peuvent souscrire à ce texte, eu égard à sa rédaction.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui, présentée par notre collègue Éliane Assasi et les membres du groupe CRC, a pour objet d’instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation d’armes de quatrième catégorie et d’interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations.
Cette proposition de loi est constituée de deux articles.
L’article 1er, « dans l’attente d’une nouvelle législation en la matière », vise à instaurer « un moratoire sur la commercialisation, la distribution et l’utilisation par toute personne des armes de quatrième catégorie, dont la liste est définie par décret en Conseil d’État. » Cet article renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de son application.
L’article 2 interdit l’utilisation de telles armes par la police ou la gendarmerie contre des attroupements. Plus précisément, il complète l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, qui permet à un préfet, un maire ou un officier de police judiciaire, lors d’un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public, de procéder à des sommations de se disperser, sous la seule condition que celui-ci leur paraisse susceptible de troubler l’ordre public.
Dans ce cas, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper l’attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
Dans ce cas, l’article 2 de proposition de loi limite l’emploi par les représentants de l’ordre des armes de quatrième catégorie, dont la liste est définie par décret en Conseil d’État et qui ne peuvent être utilisées « que dans les circonstances exceptionnelles où sont commises des violences ou des voies de fait d’une particulière gravité et constituant une menace directe contre leur intégrité physique. »
Ainsi qu’on peut le constater, l’article 1er relatif au moratoire rend l’article 2 relatif à l’encadrement de l’usage des armes précitées superflu. C’était d’ailleurs le sens de notre réflexion lors de la réunion de la commission des lois du 12 mai dernier, ainsi que l’a rappelé M. le rapporteur.
En outre, les deux articles composant la présente proposition de loi visent les armes de quatrième catégorie. Bien qu’elle ait été enregistrée à la présidence du Sénat le 1er octobre 2014, la présente proposition de toi ne tient pas compte de la réforme de la réglementation des armes intervenue lors de l’adoption de la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et de son décret d’application du 30 juillet 2013. Depuis cette réforme, la nomenclature des armes repose sur quatre catégories d’armes – les catégories A, B, C et D –, au lieu de huit.
Les armes mentionnées dans le titre et les deux articles de la proposition de loi relèvent aujourd’hui de la catégorie B, « armes soumises à autorisation ».
À la lecture de leur exposé des motifs, les auteurs de ce texte entendent viser particulièrement trois types d’armes : le pistolet à impulsion électrique de marque Taser et deux lanceurs de balles de défense, le Flash-Ball superpro et le LBD. Ces armes appartiennent à la catégorie des moyens de force intermédiaire, également dénommés « armes non létales », « sublétales», « semi-létales » ou encore « à létalité réduite ».
Ces armes peuvent être définies comme des équipements spécifiquement conçus et mis au point afin d’améliorer la capacité opérationnelle des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie, en leur permettant de faire face de façon graduée à des situations dégradées pour lesquelles la coercition physique est insuffisante. Elles viennent compléter les matériels usuels en dotation dans les forces de l’ordre, tels que les menottes, les bâtons de défense, les gaz lacrymogènes, les dispositifs manuels de protection et les armes de poing.
Je tenais à rappeler ces précisions, qui sont importantes pour éclairer nos débats sur ce sujet complexe.
En premier lieu, je tiens à souligner que la proposition de loi de nos collègues a le mérite de soulever une question primordiale : comment assurer au mieux l’ordre public et garantir l’autorité de l’État, tout en limitant autant que possible les risques induits par l’utilisation des armes de la police et de la gendarmerie lors des manifestations et rassemblements ?
C’est là que réside la question centrale posée par le texte de nos collègues, qui estiment que la gravité des dommages corporels parfois occasionnés par l’utilisation de ces armes justifie l’adoption de celui-ci.
Le Parlement doit être à l’écoute des victimes de ces accidents, qui subissent des traumatismes importants dans leur chair. Tous ces accidents, sans exception, sont regrettables, et tout doit être fait pour les éviter. Toutefois, malheureusement, le maintien de l’ordre public n’a jamais été et n’est pas une science exacte. Quelle que soit l’arme utilisée, les opérations de maintien de l’ordre comporteront toujours des risques.
Par ailleurs, chaque année, plus de douze mille policiers et gendarmes sont blessés et plusieurs d’entre eux trouvent la mort dans l’accomplissement de leur devoir. La protection des policiers et des gendarmes est donc un souci constant pour les autorités publiques. L’introduction de ces moyens de force intermédiaire au sein des forces de l’ordre a donc été rendue nécessaire pour protéger le droit à la vie lors de leurs interventions.
Je rappelle que le modèle français repose sur la dissuasion, donc la volonté d’éviter le contact physique, qui risque davantage de provoquer des accidents. Ce modèle semble le plus pertinent, mais, je le dis une nouvelle fois, aucune technique n’est exempte de risque.
En second lieu, cette proposition de loi répond également à une obligation conventionnelle. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Turquie pour violation du droit à la vie, posé par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux motifs que ce pays n’avait pas doté ses forces de police d’autres armes que les armes à feu et, par conséquent, n’avait pas laissé aux policiers d’autre choix que de tirer lors d’une manifestation au cours de laquelle ils avaient subi des violences.
En outre, le ministère de l’intérieur a eu l’occasion de le rappeler, si l’usage des Flash-Ball superpro et lanceurs de calibre 40 mm a augmenté en 2013 par rapport à 2012 au sein de la police nationale, il a diminué de 28, 2 % dans la gendarmerie. Ces chiffres sont également à mettre en perspective avec la baisse de l’usage de l’arme à feu dans la police nationale et la gendarmerie nationale.
Dès lors, comment concilier les impératifs de sécurité publique et la protection des manifestants lorsque les forces de police ou de gendarmerie sont contraintes d’utiliser ces armes ?
Je souhaite rappeler ici avec force que le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, est très attentif à la prévention et aux conditions d’utilisation de ces armes. Après le drame de Sivens, les grenades offensives utilisées par la gendarmerie ont été interdites. Les grenades lacrymogènes à effet de souffle, utilisées dans le cadre du maintien à distance, pourront être utilisées non plus par un gendarme seul, mais en binôme – un superviseur et un lanceur –, afin de renforcer la précision du tir.
Enfin, toutes les opérations de maintien de l’ordre à risque seront filmées.
En septembre dernier, une instruction commune des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales a limité le recours à l’utilisation des armes visées par la proposition de loi de nos collègues. Le Gouvernement a donc pris toute la mesure du problème qui nous occupe aujourd’hui et a adopté toutes les précautions nécessaires pour parvenir à la situation la plus équilibrée possible.
Sans nul doute, les décisions du ministre participent de l’amélioration des relations entre la population et les forces de l’ordre. Car c’est bien là le problème : on ne peut pas démunir la police et la gendarmerie des armes dénoncées par nos collègues.

Pour autant, je le répète, leur utilisation doit être encadrée au maximum, afin de prévenir les drames qui, immanquablement, détruisent la vie des victimes.
Il nous faut affronter le dilemme entre le respect de l’ordre public et la garantie du droit de s’exprimer, de protester ou de manifester qui, s’il n’est pas explicitement consacré par le constituant, n’en est pas moins essentiel dans une démocratie. J’insiste sur ce point, car il s’agit au fond de la motivation essentielle des auteurs de cette proposition de loi. L’intention véritable et supérieure qui sous-tend ce texte suscite de la part de la représentation nationale une réaction de principe, pour que ne soit pas portée une atteinte excessive à la liberté de manifestation et à la liberté individuelle.
La solution réside dans la poursuite d’une formation plus soutenue des policiers et des gendarmes, afin que le recours à de telles armes et à la force ne s’exerce que dans le cadre de leurs missions, et seulement en cas de nécessité, en respectant une attitude humaine, même durant les affrontements. Sans doute conviendrait-il de réduire l’écart entre deux séances de formation, actuellement fixé à trois ans pour le pistolet à impulsion électrique et à deux ans pour le LBD.
Insister dans la formation des agents sur la nécessité de viser uniquement le bas du corps avec ces armes constituerait également un progrès. Poursuivre le renouvellement de l’équipement, avec un matériel plus moderne et plus précis, est tout autant nécessaire. Ce sont là, je crois, des pistes de réflexion intéressantes pour le Gouvernement.
En conclusion, je tiens à remercier une fois encore nos collègues d’avoir ouvert le débat. Toutefois, pour l’ensemble des raisons que j’ai développées, le groupe socialiste s’abstiendra sur cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de notre collègue Éliane Assassi, visant à instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation d’armes de quatrième catégorie et à interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations.
Depuis plusieurs années, les écologistes souhaitent encadrer, voire interdire, toutes les formes d’utilisation de ces armes. À cet égard, je salue le travail des députés Noël Mamère, Yves Cochet et François de Rugy, d’une part, et de notre ancienne collègue sénatrice Dominique Voynet, d’autre part, qui ont déjà engagé cette réflexion en déposant deux propositions de loi similaires, respectivement en 2009 et en 2010, qui sont désormais caduques.
Mes chers collègues, le groupe écologiste se réjouit que nous soit donnée l’occasion de débattre de ce sujet grave. En effet, ces dernières années, de nombreux incidents ont mis en lumière la dangerosité des armes de catégorie B dont nos forces de police sont équipées – depuis 2002 pour le Flash-Ball et depuis 2006 pour le Taser. Il est temps que la représentation nationale se saisisse d’un problème devenu récurrent.
Depuis que le Flash-Ball est utilisé pour disperser des manifestants, plus d’une dizaine de personnes ont été grièvement blessées à l’œil, et ce malgré l’interdiction des tirs au-dessus de la ligne d’épaule. À Marseille, un homme est mort par arrêt cardiaque après avoir été touché au thorax. La gravité des blessures et des handicaps causés met ainsi en évidence un recours disproportionné à cet armement.
Compte tenu de l’imprécision des trajectoires des tirs, ainsi que de la gravité et de l’irréversibilité des dommages collatéraux manifestement inévitables que ces armes provoquent, il convient, selon les termes du Défenseur des droits, de « proscrire ou limiter très strictement l’usage du Flash-Ball dans le cadre de manifestations ».
Plus généralement, la commercialisation et l’usage de telles armes doivent être suspendus, de sorte que soient redéfinies les conditions de leur utilisation par rapport à leurs spécificités. En effet, d’une part, plus les tirs sont rapprochés, plus ils sont dangereux, et, d’autre part, plus ils sont éloignés, moins ils sont précis.
Il en est de même du pistolet à impulsion électrique, le Taser, employé en France par la police nationale et la gendarmerie depuis 2006 et par la police municipale depuis 2010. Les risques et les accidents liés à son utilisation sont nombreux.
Le premier risque est celui d’un usage abusif de l’arme. Le comité contre la torture des Nations unies a ainsi rappelé en 2010 que « l’usage de ces armes provoque une douleur aiguë, constituant une forme de torture ». Or l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le second risque est lié aux conséquences de l’usage de cette arme sur la santé des personnes. Selon les données recueillies par Amnesty International et figurant dans un rapport publié en décembre 2008, quelque 334 personnes seraient mortes, depuis 2001, au cours de leur arrestation ou en détention aux États-Unis, à la suite de décharges infligées par des pistolets paralysants, un chiffre qui aurait augmenté pour atteindre les 500 morts en 2012.
En raison de ces risques, du manque de formation des agents et des conséquences que peut entraîner l’emploi d’un tel armement, il convient non seulement de suspendre l’utilisation de ces armes dangereuses et de réaliser un état des lieux, mais aussi de protéger le droit imprescriptible de manifester en interdisant l’utilisation de ces armes par la police et la gendarmerie nationales contre des attroupements et des manifestations.
Le tragique décès de Rémi Fraisse, venu manifester contre le barrage de Sivens, est la triste illustration de la disproportion des moyens parfois engagés par les forces de police – en l’occurrence, il s’agissait d’une grenade offensive – et nous oblige à prendre des mesures restrictives, sinon prohibitives !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, déposée par notre collègue Éliane Assassi, nous invite à nous interroger sur la question de l’emploi de la force, mais également sur la confiance que nous plaçons en celles et ceux qui sont en première ligne pour faire respecter l’ordre républicain.
Je tiens avant tout à rendre hommage au remarquable travail accompli par M. le rapporteur de la commission des lois, Jean-Patrick Courtois, qui nous permet d’en appréhender tous les effets juridiques et pratiques.

Tout d’abord, je crois qu’il faut savoir reconnaître la bonne foi qui a présidé à l’élaboration de ce texte et la volonté de ses auteurs d’éviter les drames qui ont suscité une émotion légitime. Toutefois, nous ne vivons pas, tant s’en faut, dans un pays de non-droit où les policiers agiraient – pardonnez-moi l’expression – comme des cow-boys !

Au contraire, comme l’indiquait notre rapporteur, les règles d’utilisation des armes de catégorie B sont strictement encadrées par le code de la sécurité intérieure ou le code pénal.
Adopter cette proposition de loi constituerait une première difficulté. En effet, cela remettrait en cause toute la doctrine et la pratique françaises en matière de maintien de l’ordre. Or, s’il reste toujours des progrès à accomplir et des drames à déplorer, nous ne devons rougir ni de nos pratiques en la matière ni du professionnalisme des forces de l’ordre. Dans son rapport, Jean-Patrick Courtois a opportunément rappelé que la « doctrine Grimaud », en vigueur depuis les années soixante, a permis à la France de ne déplorer que de rarissimes décès lors d’affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre.
L’article 1er de la proposition de loi, qui institue un moratoire sur l’utilisation des armes de catégorie B, pose problème, car il ôte aux policiers et gendarmes les armes non létales dont ils ont besoin pour répondre de façon graduée et proportionnée à une menace immédiate. Sans ces équipements, il ne leur resterait que le choix entre la passivité totale, qui n’entre pas dans la mission des gardiens de la paix civile, et l’engagement disproportionné avec des armes de catégorie supérieure, ce que personne ne souhaite.
L’article 2 de la proposition de loi n’est pas davantage satisfaisant, puisqu’il prévoit que ces armes ne pourront être utilisées qu’en des « circonstances exceptionnelles ». Non seulement ces dispositions donneront lieu aux interprétations très incertaines que M. le rapporteur a évoquées, mais, de fait, elles commandent aux forces de l’ordre de rester attentistes, jusqu’au moment où la situation deviendra tout à fait incontrôlable.
Enfin, à l’aune des auditions menées, nous ne pouvons qu’approuver les préconisations de M. le rapporteur : si le Taser X26 et le Flash-Ball superpro sont des équipements performants et utiles, le ministère de l’intérieur doit proposer aux fonctionnaires amenés à les utiliser des sessions de formation plus fréquentes et qui se rapprochent davantage des conditions réelles d’engagement.
Il est donc nécessaire, à mon sens, d’aider nos forces de police et de gendarmerie à assurer leurs missions, dans des conditions qui leur permettent de protéger les biens et les personnes, et de se protéger elles-mêmes, afin de les prémunir contre des situations qui se révéleraient de véritables « guets-apens juridiques ».
Par conséquent, le législateur doit avoir comme priorité, non pas d’exprimer sa défiance à leur encontre, mais, au contraire, de leur fournir un accompagnement dans leurs difficiles missions et de leur assurer le soutien de la République !
Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, questionner l’usage des armes dans notre société résonne de manière particulière dans les temps que nous connaissons.
Aujourd’hui, des conflits armés, dont certains se déroulent sur notre continent, sévissent dans de nombreux pays. Ensuite, le terrorisme menace directement les pays occidentaux, notre pays en ayant profondément souffert en ce début d’année. Enfin, la commercialisation des armes est réglementée dans notre pays, alors qu’elle est libre dans certains autres, ce que l’actualité vient d’illustrer tragiquement outre-Atlantique.
Ces problématiques qui concernent le législateur, bien qu’à des échelons très distincts, me semblent néanmoins les préalables indispensables à la mise en perspective de notre débat. De quoi discutons-nous en réalité dans la proposition de loi examinée aujourd’hui ?
Nous débattons de l’usage par nos forces de l’ordre d’armes de dissuasion, qui a été généralisé par la loi en 2002 et dont la classification ne correspond plus désormais à celle qui figure dans le présent texte.
Les armes évoquées, qu’il s’agisse de lanceurs à balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique, sont aujourd’hui regroupées sous les catégories B et D, en fonction de leur composition – mécanique ou plastique, par exemple, pour les Flash-Ball.
Qu’en est-il, aujourd’hui, de l’utilisation de ces armes de dissuasion par les forces de l’ordre ? En France, tous les policiers ne sont pas armés. En 2013, sur près de 20 000 policiers municipaux que compte notre pays, quelque 82 % sont armés et seuls 39 % sont équipés d’une arme à feu.
N’oublions pas, par ailleurs, que l’ensemble des équipements est attribué nominativement, à la demande de chaque maire, et après validation des services de la préfecture. Les critères d’attribution d’armes sont stricts et définis par le code de la sécurité intérieure. Toute arme détenue par un policier est donc soumise à autorisation.
Mes chers collègues, s’il nous prenait l’envie de vouloir acheter une arme de catégorie D en vente libre, rien ne nous en empêcherait et nous pourrions quitter l’armurerie avec, par exemple, une bombe lacrymogène en poche ! Rien de tel pour un policier, qui, pour la détention du même type d’armes, sera soumis – il le faut, dans l’intérêt de tous ! – à une autorisation en préfecture, accompagnée d’un certificat médical d’aptitude de moins de deux semaines.
Croyons-nous, enfin, que l’usage de ces armes par les forces de l’ordre soit hasardeux ?
Malgré, d’une part, les conditions de formation spécifiques aux armes utilisées – seuls ceux ayant obtenu la formation ad hoc sont ainsi autorisés à faire usage d’un Flash-Ball par exemple –, et, d’autre part, les conditions de formation continue obligatoire annuelle pour les armes des catégories B et D, il semblerait que les auteurs de la proposition de loi aient oublié que les policiers sont strictement limités dans l’usage de leurs armes aux cas de légitime défense.
En employant ces mots, je ne peux m’empêcher de saluer la mémoire des policiers lâchement assassinés lors des attentats de janvier dernier. Aurait-il pu en être autrement s’ils avaient eu les moyens de se protéger et d’assurer leur défense ? J’évoque ainsi la question de la protection que nous accordons à nos forces de l’ordre, absente du texte dont nous discutons, et pourtant fondamentale. Selon les secteurs, et à la discrétion du maire, il conviendrait, à mon sens, d’armer notre police pour qu’elle assure tant notre protection que la sienne.
Les responsables publics doivent donc s’interroger en conscience sur les moyens qu’ils décident de consacrer à la protection de leurs agents, alors que le coût d’un gilet pare-balles oscille entre 700 euros et 1 000 euros.
Si la « protection de la liberté de manifestation et d’expression des mouvements sociaux », telle qu’elle est rappelée dans l’exposé des motifs de la proposition de loi dont nous débattons, me semble primordiale, elle est néanmoins garantie en l’état actuel de la législation. En revanche, c’est peut-être moins le cas pour la protection effective de nos forces de l’ordre !
Je souhaiterais évoquer le cas de la ville d’Évreux, dont je suis élue. La protection de la population, qui avoisine 50 000 habitants, y est assurée par une police municipale, composée seulement de vingt-deux policiers municipaux, de sept agents de surveillance de la voie publique, de deux agents affectés à la vidéosurveillance et de quatre agents administratifs.
Pour l’ensemble de ces agents, la police municipale d’Évreux dispose de six Flash-Ball de catégorie B, ainsi que de diverses armes de catégorie D, en particulier des aérosols lacrymogènes et des bâtons de défense. Aucune de ces armes n’a été utilisée depuis le début de l’année.
Mes chers collègues, vous ne serez pas surpris que, au terme de ce propos, je me prononce en défaveur de tout moratoire qui reviendrait à interdire aux forces de l’ordre de faire usage des armes que la loi leur permet d’utiliser, y compris contre des attroupements ou manifestations. À mes yeux, c’est la protection qui prime : celle de la population, mais également celle des hommes et des femmes chargés de veiller sur elle, lorsqu’eux-mêmes se sentent en danger.
S’il est une question dont la Haute Assemblée devrait se saisir, me semble-t-il, c’est celle du contrôle de la commercialisation, de la détention et de la circulation des armes dans notre pays !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.
Je remercie le groupe CRC du Sénat d’avoir provoqué ce débat important et je me félicite de l’esprit serein et apaisé dans lequel celui-ci s’est tenu. L’enjeu est de concilier la protection des forces de l’ordre, mais aussi celle du public, avec la liberté de manifester.
Mesdames, messieurs les sénateurs, puisque nombre d’orateurs ont soulevé la question de la formation, permettez-moi de vous apporter à cet égard quelques précisions qui dessinent une piste d’amélioration.
Seuls les policiers habilités ayant suivi une formation spécifique sont autorisés à faire usage d’un Flash-Ball. La formation initiale, qualifiante, s’étend sur plusieurs jours ; elle est complétée par des stages de qualification périodiques, dits « stages de recyclage », qui doivent être suivis tous les deux ans. Faute de suivre ces stages, les fonctionnaires perdent leur habilitation.
Par ailleurs, l’utilisation du Flash-Ball est très encadrée : chacune de ses utilisations fait l’objet de déclarations spécifiques par les fonctionnaires, qui doivent expliquer les conditions dans lesquelles ils s’en sont servis. Les mêmes principes valent pour le Taser : les fonctionnaires doivent avoir suivi une formation qualifiante, être habilités et suivre tous les trois ans un stage de recyclage.
Certains orateurs ont déploré que les formations soient trop théoriques. Soyez certains que le ministre de l’intérieur sera très sensible aux propositions d’amélioration qui ont été avancées. En particulier, il est prêt à lancer un travail pour rendre les formations aussi proches que possible des conditions réelles, en prenant davantage en compte les contextes de tir et les cibles mouvantes. Sans doute faut-il aussi que les stages de recyclage soient plus réguliers.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tenais à vous assurer que le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité, soulignée par tous les orateurs, d’améliorer la formation des fonctionnaires !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
Moratoire sur l'utilisation des armes de quatrième catégorie
Proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l'utilisation et la commercialisation d'armes de quatrième catégorie et à interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations
Dans l’attente d’une nouvelle législation en la matière, il est institué un moratoire sur la commercialisation, la distribution, et l’utilisation par toute personne des armes de quatrième catégorie, dont la liste est définie par décret en conseil d’État.
Un décret précisera les conditions d’application de cet article.

Ayant été le rapporteur de la proposition de loi dont est issue la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle moderne, simplifié et préventif des armes, je tiens à présenter plusieurs observations au sujet du présent article, qui vise les armes communément appelées Flash-Ball et Taser, d’après les noms de leurs fabricants, en se référant à une classification obsolète depuis plus de trois ans. Ces armes à létalité atténuée ou « sublétales » suscitent des interrogations depuis leur apparition.
En janvier 2011, au cours d’une séance de questions cribles thématiques consacrée à l’utilisation du Flash-Ball et du Taser par les forces de police, j’ai appelé l’attention du gouvernement de l’époque sur les règles en vigueur encadrant l’emploi de ces équipements de substitution aux armes à feu.
En effet, de récents événements ayant ému nos concitoyens, des précisions sur les procédures de contrôle, en amont et en aval de l’utilisation de ces équipements, s’avéraient nécessaires. J’ai insisté notamment sur la nécessité d’assurer la traçabilité de chaque utilisation, au moyen de puces et de caméras intégrées, afin de prévenir les litiges.
Je rappelle que ces armes de force intermédiaire relèvent du cadre juridique général de l’usage de la force, qui repose, entre autres principes, sur la légitime défense et l’état de nécessité, et qu’elles sont soumises aux principes de nécessité et de proportionnalité.
Les auteurs de la proposition de loi se sont notamment inspirés de recommandations formulées par le Défenseur des droits en 2013. Or celles-ci ont été soit satisfaites, soit jugées trop restrictives de l’usage des armes en cause, qui serait devenu trop limité, voire impossible, en sorte que les forces de l’ordre auraient été désarmées de fait. Le rapport établi par notre collègue Jean-Patrick Courtois fait apparaître que l’application de l’article 1er de la proposition de loi aurait le même résultat.
Outre que cet article fait référence à l’ancienne classification des armes, il n’apporte pas les solutions auxquelles les auteurs de la proposition de loi aspirent : ceux-ci réclament un moratoire, mais ils ne font pas de propositions !
Reste que, comme le ministre de l’intérieur d’il y a quatre ans l’avait reconnu en réponse à ma question, la communication sur la réglementation relative à l’usage de ce type d’armes est encore trop en deçà des attentes du public, ce qui entraîne une méfiance grandissante, alimentée par les événements tragiques que plusieurs collègues ont rappelés.
Il faut donc améliorer la transparence de l’utilisation de ces armes, mais non l’interdire, ce qui reviendrait quasiment à désarmer nos forces de maintien de l’ordre, alors même qu’elles sont de plus en plus victimes d’agressions mortelles, commises de plus en plus avec des armes de guerre. Ces armes intermédiaires sont d’autant plus utiles qu’elles évitent le recours aux armes à feu, ô combien plus dangereuses.
Parce qu’il faut protéger nos forces de l’ordre au même titre que tous nos concitoyens, je ne voterai pas l’article 1er de cette proposition de loi, non plus d’ailleurs que son article 2.

L'amendement n° 1, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
quatrième catégorie
par les mots :
catégorie B
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Cet amendement vise à opérer une rectification dont il a déjà été largement question, afin de tenir compte de l’évolution législative. Je signale d’ores et déjà que l’amendement n° 2, portant sur l’article 2, a pour objet une modification du même ordre. Je l’ai donc d'ores et déjà défendu.

Sourires.
Le Gouvernement a la même position que M. le rapporteur : étant opposé à la proposition de loi, il est défavorable aux deux amendements.

Les propos que viennent de tenir Mme la secrétaire d’État et M. Antoine Lefèvre m’inspirent plusieurs observations.
Madame El Khomri, vous êtes secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, mais, cet après-midi, vous êtes chargée tout autant de la campagne, car la question de l’utilisation des armes de quatrième catégorie se pose partout.
En effet, les territoires ruraux ont aussi leurs petites villes, leurs quartiers sensibles et leurs problèmes d’ordre public et de délinquance. J’y insiste, car il semble que, gouvernement après gouvernement, on oublie un peu la campagne ; je me permets de le souligner, quoique je soutienne le gouvernement de Manuel Valls. Qu’il s’agisse de sécurité ou de politiques sociales, la campagne est tout autant concernée que la ville !
Il faut rendre hommage à notre police républicaine, notre gendarmerie et nos forces armées, qui sont d’un très haut niveau, pénétrées des principes républicains et soucieuses des droits de nos concitoyens.
Dans nos campagnes, un rôle irremplaçable est joué par les petites polices municipales – dans ma ville, on parle de « police de tranquillité » –, qui sont conduites à remplir tout un éventail de missions. Par exemple, dans le cadre des opérations « tranquillité vacances », elles font le tour des quartiers pour surveiller les villas dont les occupants sont partis et, lorsqu’elles aperçoivent une fenêtre ou une porte ouverte, vont voir les choses de plus près. Ce travail ne peut pas être accompli par des policiers désarmés, ne portant rien d’autre qu’une chemisette bleue marquée « Police municipale » et des rangers.
Sourires.

Quand un gouvernement précédent a supprimé la police de proximité, nous, les maires, préoccupés par cette décision, sommes allés voir nos commissaires divisionnaires de police, notre directeur départemental de la sécurité publique ou notre préfet. Ils nous ont demandé de les aider en faisant un effort pour nos polices municipales, afin qu’elles puissent, par exemple, faire des rondes à onze heures du soir, à minuit ou à une heure du matin. Or, lorsqu’ils servent la nuit, pour des rondes ou des contrôles sur les ronds-points, nos policiers municipaux peuvent tomber sur des délinquants dangereux.
Bien entendu, on peut rêver d’un monde de bisounours, comme disent les jeunes ; mais, dans le monde réel, il faut que toutes nos polices soient convenablement armées. Toutes les missions que nos forces de l’ordre assurent, au service de nos concitoyens, requièrent des armes et des techniques régulièrement améliorées et des fonctionnaires bien formés.
Mes chers collègues, je sais que nos collègues du groupe CRC sont animés des meilleurs sentiments – il m’arrive d’ailleurs souvent de souscrire à leurs initiatives –, mais nous devons être très vigilants : ne laissons pas penser qu’il y aurait, d’un côté, les méchants policiers, et, de l’autre, les gentils manifestants.

Le droit de manifester – Dieu sait si j’ai manifesté dans ma vie ! – est le droit de défiler calmement, dans l’ordre et sans violence, dans un esprit citoyen.
L’équilibre qu’il convient de trouver n’est pas celui sur lequel repose la présente proposition de loi. Les sénateurs du groupe RDSE, hostiles à celle-ci, ne voteront pas l’amendement n° 1, non plus que l’amendement n° 2.

S’il est évident que les polices doivent être armées comme il convient, il l’est tout autant que les armes doivent être bien utilisées. C’est pourquoi des efforts doivent être réalisés en matière de formation à l’utilisation des armes. Désarmer la police pourrait avoir des conséquences terribles, mais il est indispensable d’améliorer sa formation, et je soutiens le Gouvernement dans ce domaine.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er n'est pas adopté.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne peuvent utiliser à cette fin les armes de quatrième catégorie, définies par décret pris en Conseil d’État, que dans les circonstances exceptionnelles où sont commises des violences ou des voies de fait d’une particulière gravité et constituant une menace directe contre leur intégrité physique. »

L'amendement n° 2, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
quatrième catégorie
par les mots :
catégorie B
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement ont déjà émis leur avis, qui est défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 2.
L'amendement n'est pas adopté.

Mes chers collègues, avant de mettre aux voix l’article 2, je vous rappelle que, si ce dernier n’était pas adopté, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi dans la mesure où les deux articles qui la composent auraient été supprimés. Il n’y aurait donc pas d’explications de vote sur l’ensemble.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l’article.

Je voulais avant toutes choses remercier Mme la secrétaire d’État de la modération de ses propos et de sa volonté de laisser le débat prospérer. Je voudrais également remercier tous les sénateurs étant intervenus dans ce débat, à l’exception d’un orateur, dont je ne citerai même pas le nom.

Je regrette seulement le manque de rigueur intellectuelle de quelques-uns d’entre eux, qui tend à leur faire confondre moratoire et interdiction. Que je sache, mes chers collègues, ces deux mots ne sont pourtant pas synonymes.
D’autres orateurs ont également tenté de faire croire que les élus du groupe CRC n’ont pas confiance dans les forces de police. C’est tout le contraire, évidemment ; notre formation politique est très proche des forces de police et des syndicats de policiers, qu’ils soient municipaux ou nationaux.
Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.

Monsieur Gournac, je vous rappelle que, sous l’ancienne majorité sénatoriale, j’avais l’honneur d’être le rapporteur pour avis, au nom de la commission des lois, des crédits de la mission « Sécurité » !

Mme Éliane Assassi. Je tenais alors à auditionner rigoureusement toutes les personnes compétentes, à travailler avec toutes les associations et toutes les organisations de policiers, nationaux ou municipaux. J’ai toujours défendu l’idée selon laquelle nos policiers devaient avoir les moyens nécessaires pour assumer leurs fonctions et assurer, notamment, leur propre sécurité. Il y a donc, mes chers collègues, des propos que je ne peux pas accepter.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Cela dit, je me félicite du débat qui s’est instauré cet après-midi ; le dépôt de cette proposition de loi avait aussi cette ambition. Ce débat, d’ailleurs, se poursuivra sous d’autres formes, sans doute à l’occasion de l’examen au Sénat d’un prochain projet de loi sur le sujet.
Pour toutes ces raisons, je tenais donc à remercier les différents orateurs, sauf l’un d’entre eux, de leurs propos

Divers élus écologistes – à l’époque, ce n’était pas encore un groupe –, députés et sénateurs, avaient déposé il y a quelque temps un texte similaire à celui dont nous discutons aujourd’hui. Ainsi que l’a souligné Éliane Assassi, la présente proposition de loi a ouvert le débat, ce qui semble une nécessité. Nous devons en effet nous intéresser davantage à l’encadrement des policiers, aux armes qu’ils utilisent et à leur formation, cela afin qu’ils ne tirent pas à mauvais escient.
Ces questions intéressent nos concitoyens. Dès lors, même si cette proposition de loi ne sera pas adoptée aujourd’hui, il me semble que l’on ne peut pas ne pas en débattre. Mieux vaut cela que d’occulter les problèmes, comme nous en avons trop souvent l’habitude.
Notre idée, qui est aussi celle du groupe CRC, n’est pas d’abolir le port d’armes ; nous partons seulement du même constat, me semble-t-il. Divers incidents récents, ainsi que plusieurs rapports sur le sujet, l’ont d’ailleurs montré : il s’agit bien d’une question de société, qui mérite débat.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

Au moment où nos policiers et nos gendarmes sont partout, dans les rues, pour nous protéger, je voudrais leur rendre hommage. Le plan Vigipirate, maintenu à son niveau le plus élevé, implique des cadences de travail absolument incroyables, dont témoignaient d’ailleurs ce matin sur les ondes plusieurs représentants des CRS, notamment.
Je ne discute pas du tout, chers collègues du groupe CRC, de la légitimité de débattre de ce sujet ; c’est le propre des discussions que nous pouvons avoir dans cet hémicycle. En revanche, je suis en désaccord total avec la position que vous avez exprimée. Moi, j’aime la police ; j’aime la gendarmerie !

Qu’arrivera-t-il si on ne donne pas aux policiers et aux gendarmes la possibilité de se défendre ? Voyez ce qui s’est passé sur les terrains d’un fameux aéroport, celui dont on ne sait s’il verra le jour ; voyez la violence, tout à fait phénoménale, de l’attaque – j’ai visionné les trois vidéos – dont ont été victimes nos forces de police et de gendarmerie !

Certes, il y a eu un accident, ce que je regrette vivement. Néanmoins, moi, quand j’aime, je soutiens.

J’apporte donc mon soutien le plus total à la police et à la gendarmerie ; je leur fais entière confiance.
Mme la secrétaire d’État a néanmoins raison de dire que des dispositions doivent être prises quand du matériel dangereux est distribué. Cela, nous en sommes parfaitement conscients. Cependant, instaurer un moratoire, dans ce moment si particulier que nous vivons, et quand on connaît les menaces auxquelles doit faire face notre pays, serait terrible.
Je le répète, je soutiens la police et la gendarmerie ; c’est donc sans aucune hésitation que je voterai contre le présent texte.
M. David Rachline applaudit.

Les dernières interventions m’incitent à réagir.
Je puis comprendre l’avis défavorable émis par la commission comme par le Gouvernement sur les deux amendements présentés. Néanmoins, cette proposition de loi a le mérite d’installer le débat sur ce problème de société : la sécurité, notamment intérieure.
Un orateur nous a éclairés sur la situation prévalant dans les communes rurales. Il est vrai que les problèmes d’insécurité existent partout. On parle beaucoup des villes, des quartiers difficiles, sensibles, au sein des grandes villes. Toutefois, nous ne sommes nulle part, même dans le plus petit village, vraiment à l’abri du danger.
Alain Gournac a fait part de son soutien aux forces de sécurité. Il me semble que tous les membres de cette assemblée sont unanimes pour défendre les notions de respect et de reconnaissance à l’égard des gendarmes, dans le monde rural, mais aussi des policiers nationaux et municipaux. Tous ici respectent ceux qui font face au danger : l’ensemble des forces de sécurité, à tous les niveaux, les pompiers, et ceux qui œuvrent à la sécurité des personnes et des biens.
Chaque année, nous sommes associés en tant qu’élus à la journée d’hommage rendu aux gendarmes, policiers et pompiers victimes du devoir.
La sécurité des personnes et des biens est donc une priorité en tous lieux. Dès lors, si je rejoins les positions exprimées par la commission et le Gouvernement, la présente proposition de loi a au moins le mérite, selon moi, de nous interpeller sur les problèmes existants en la matière.
M. Alain Gournac applaudit.

Je ne voudrais pas abuser du temps imparti à l’ordre du jour réservé du groupe CRC, mais je ne peux que réagir à l’intervention d’Alain Gournac, qui a lancé le thème des amours : il aime les gendarmes, les policiers, les pompiers !

M. Jean Desessard. Moi aussi, j’aime les postiers, les cheminots et les infirmières !
Sourires sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

La question ne se pose pas ainsi, cher collègue ! Nous tenons tous en effet à ce que la police et la gendarmerie garantissent notre sécurité.

La vraie question est de savoir si, dans certaines circonstances, les forces de l’ordre n’utilisent pas leur arme au détriment de la sérénité et de la sécurité publiques.
Dominique Voynet a donné l’exemple, à ce sujet, d’une grève des lycéens qui s’est déroulée à Montreuil. Un jeune, sorti de son établissement pour aller manifester, et n’ayant rien fait d’autre que de remuer une poubelle, de la déplacer, sans attaquer personne donc, a reçu un projectile de Flash-Ball dans l’œil, et l’a ainsi perdu.
Ce n’est qu’un exemple, me direz-vous, mais on pourrait en citer d’autres. Convenez que, dans ce cas, l’arme a été utilisée de façon manifestement abusive. Il convient donc de se demander pourquoi. Or c’est bien l’ambition de la présente proposition de loi que de nous interpeler sur ce point : l’arme est-elle toujours utile ?

M. Jean Desessard. En l’espèce, mal utilisée, elle a causé un dommage grave au lycéen.
Protestations sur les travées de l’UMP.

Attention au « tout sécuritaire », mes chers collègues ! Il n’est pas réaliste de penser que c’est en armant toujours plus les forces de l’ordre que nous réglerons les problèmes de violence et de banditisme.

M. Jean Desessard. Le groupe CRC et le groupe écologiste, qui voteront cette proposition de loi, ont une autre conception des choses : la sérénité et la sécurité publiques passent d’abord par une plus grande justice sociale.
Exclamations sur les travées de l’UMP.

La tranquillité dans les quartiers ne peut pas être uniquement le fait de la police : elle vient de la justice sociale ; elle implique que chacun soit reconnu à sa juste valeur et puisse trouver un emploi.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC. – Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.

Mme Cécile Cukierman. Je tiens à souligner, à la suite d’Éliane Assassi notamment, la qualité du débat que nous avons eu sur ce texte lors de son examen en commission des lois et de la discussion générale, ainsi que le respect ayant prévalu à nos échanges avec M. le rapporteur et les sénateurs des différents groupes. Cela tranche nettement avec l’emportement auquel nous assistons depuis quelques instants. Finalement, j’en suis presque rassurée : il suffit de gratter un peu pour que, chez certains, le vernis s’écaille.
Protestations sur les travées de l’UMP.

Je m’associe aux propos de Jean Desessard : si, au cours des dix dernières années, le Parlement avait autant débattu du bien-être social qu’il l’a fait des problèmes de sécurité, il aurait certainement pris des dispositions allant dans la bonne direction, pour notre pays, d’abord, mais aussi pour la sécurité de tous.

La reconnaissance du travail des policiers, personne n’en a le monopole. Il est évident pour tout le monde que les policiers sont nécessaires. Au groupe CRC, nous sommes attachés à la présence de la police sur nos territoires ; nous sommes attachés à la police de proximité, qui travaille avec les populations, cette police – vous la connaissez, mes chers collègues – qui a été supprimée par la droite il y a quelques années.

Or la police, au travers de ses représentants, nous interpelle aujourd’hui. Certains de ses agents, ceux à qui vous avez déclaré votre amour, monsieur Gournac – soit dit en passant, j’espère que vous ferez de même quand nous débattrons d’autres catégories de fonctionnaires ! –, nous font part de leur usure et de leur fatigue, qui ont été amplifiées par la mise en œuvre du plan Vigipirate. Ils nous font part de leur exaspération à l’égard de la politique du chiffre, à laquelle, malheureusement, il n’a pas été mis fin, et qui ajoute encore de la pression à leur métier.
C’est dans ce cadre précis que nous avons déposé la présente proposition de loi ; ce sont aussi les conditions de travail qui poussent à la bavure, au manque de discernement, au manque de recul. L’exemple cité par Jean Desessard n’est pas isolé ; les personnels de police et de gendarmerie sont en effet amenés à réagir beaucoup plus rapidement qu’il ne le faudrait au vu de la situation.
Peut-être l’objectif est-il de satisfaire l’idéal de bien-être dont certains rêvent devant le journal télévisé, celui d’une société sécuritaire ? Nous vivrions, paraît-il, dans un monde où l’insécurité est présente partout.
Nous en parlions avec ma collègue Évelyne Didier : chaque vie compte
M. René Danesi opine.

Dans une bavure, il y a deux vies brisées : celle de la victime et celle du policier, qui aura toujours un mort sur la conscience ! N’opposons donc pas les uns aux autres !
Notre proposition de loi visait à soulever des interrogations sur la pertinence et l’efficacité du recours aux armes concernées.
Comme nous l’avons indiqué, ces armes ne répondent pas à l’objectif. Leur présence rassure peut-être certains, mais elles sont parfois à l’origine d’événements pour le moins malencontreux !
Peut-être notre proposition de loi ne sera-t-elle pas adoptée.

Mais elle aura au moins eu le mérite de susciter un débat sur la pertinence et l’efficacité du recours à de telles armes.
Il faudrait également disposer d’éléments, notamment statistiques, sur l’utilisation de ces armes, ainsi que sur les conséquences sur la population, madame la secrétaire d’État.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.

Mes propos seront très modérés. En France, contrairement à d’autres pays, les policiers et les gendarmes sont souvent présentés comme les « méchants » dans les médias, qui cherchent régulièrement à les prendre en défaut. Je trouve cette attitude regrettable.
Monsieur Jean Desessard, nous sommes tous d'accord sur la justice sociale ; les Verts n’en ont pas le monopole ! Mais vous oubliez de parler des violences que les policiers subissent parfois de la part de manifestants. Lors des manifestations, le préfet donne des consignes de modération aux forces de l’ordre, afin d’éviter d’éventuels incidents. Mais les policiers sont quand même bien obligés d’intervenir en cas de violences !
Un de nos collègues faisait tout à l’heure référence aux risques dans notre pays. Chaque jour, il y a des meurtres à la kalachnikov !
Par conséquent, nous avons besoin d’une police, certes bien formée, mais aussi bien armée ! C’est essentiel.
Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP. – M. Claude Kern applaudit également.

M. David Rachline. Je comprends mieux pourquoi le Parti communiste fait moins de 3 % aux élections !
Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Je signale juste qu’il y a deux sénateurs d’un côté et dix-huit de l’autre !

Le Parti communiste est totalement déconnecté des réalités de ce pays !
Notre pays traverse des difficultés sans précédent, en matière non seulement économique et sociale, mais aussi sécuritaire ; nous connaissons la situation ! Et c’est ce moment particulièrement douloureux pour les Français et notre République que le Parti communiste choisit pour s’attaquer, de manière totalement idéologique, une fois de plus, aux forces de l’ordre ! Par le passé, il prétendait déjà que nous vivions dans un État policier, sous prétexte que la justice était sans doute un peu plus dure à l’égard des délinquants !
Vous allez devoir accepter que certaines personnes soient du côté de la police, et non pas, comme vous, du côté des délinquants ! §Acceptez que nous soyons favorables à un renforcement des dispositifs permettant de condamner ceux qui contreviennent à la loi et troublent l’ordre !
Malheureusement, vous avez pris depuis plusieurs dizaines d’années le chemin inverse, celui qui consiste à défendre les délinquants ! Nous voyons aujourd'hui le résultat de cette politique démagogique et laxiste. La délinquance est endémique. Il y a des quartiers où les Français sont obligés de baisser la tête. Certains de nos concitoyens sont agressés seulement parce qu’ils sont Français, blancs et catholiques !
Exclamations sur les travées du groupe CRC.

D’autres sont agressés seulement parce qu’ils sont homosexuels ou étrangers !

M. David Rachline. Il faut le dire ! Je sais bien que ce n’est pas le Parti communiste qui va en parler !
Mme Cécile Cukierman s’exclame.

Nous nous faisons les avocats de cette majorité silencieuse, de ces Français qui se taisent et qui doivent subir vos déclarations et vos propositions scandaleuses !
À titre personnel, je me félicite du rejet de cette proposition de loi !

J’écoute le débat avec attention. Ne sombrons pas dans la caricature. Il n’y a pas, d’un côté, les soutiens de la police et, de l’autre, les amis des manifestants. Cela ne se passe pas ainsi.
Je suis maire d’une ville de 15 000 habitants. Une politique solide repose sur le triptyque éducation/prévention/sécurité. Quand on néglige l’un de ces trois volets, cela ne fonctionne pas !
Les efforts en faveur de la cohésion sociale sont donc indispensables. Ne baissons pas la garde ! Les problèmes risqueraient de ressurgir avec acuité. Croire que l’on pourra tout régler seulement avec des réponses sécuritaires, c’est une impasse !
M. David Rachline s’exclame.

Pour être efficace, une politique doit trouver l’équilibre entre éducation, prévention et sécurité.
En tant que maire, j’observe l’importance des problèmes de sécurité. Certaines nuits, avec les forces de l’ordre, nous sommes confrontés à des situations de violence extrêmement aiguë.

Notre groupe aura donc une position équilibrée sur cette proposition de loi.
À nos yeux, l’utilisation de ces nouvelles armes par les forces de l’ordre est déjà bien encadrée et réservée à des circonstances exceptionnelles. J’ai assisté à des situations de violence extrême où la police a dû avoir recours au Flash-Ball ; elle est tenue de respecter un règlement extrêmement strict. §Si des forces de police doivent parfois se servir de telles armes, c’est parce qu’elles sont en difficulté !
L’équilibre consiste à combiner le renforcement de la cohésion sociale et les politiques de prévention et d’éducation. Mais évitons tout angélisme ! Dans certains quartiers, nos forces de l’ordre sont soumises à rude épreuve ! Nous ne suivrons donc pas nos collègues dans leur volonté de modifier le code de la sécurité intérieure.
J’ai refusé d’armer la police municipale de ma commune ; selon moi, cette option n’est pas à l’ordre du jour. Dans les situations extrêmement tendues, je préfère que la police nationale et la gendarmerie viennent en aide à nos policiers municipaux !

Faisons attention à ne pas adresser de signaux négatifs aux policiers, qui sont déjà soumis à rude épreuve ! Veillons à ne pas les démotiver !
Nous ne voterons donc pas la présente proposition de loi.
Certains collègues ont fait référence à des incidents liés à l’utilisation de ces armes. J’y ai moi-même été confronté dans ma ville. De tels événements sont regrettables. Mais il existe des recours juridiques – ils sont par exemple mis en place dans ma commune –, y compris dans les cas d’utilisation abusive de certaines armes. Les procureurs de la République y font très attention.
Sachez qu’il est parfois très difficile d’être policier aujourd'hui. Je suis heureux d’avoir retrouvé des effectifs de police à la hauteur des besoins dans notre ville et notre agglomération, après des années de baisse. Mais soyons vigilants ! Veillons à ne pas mettre en accusation les policiers quand ils font leur travail, parfois dans des conditions très difficiles.
Un État de droit a besoin d’une police, une police formée, qui puisse exercer ses prérogatives et faire son devoir.
Mme Evelyne Yonnet applaudit.

Je suis maire d’une ville de 32 000 habitants depuis 2001, que j’ai conquise dans le cadre d’une alternance démocratique. Nous avons travaillé dans la commune, et le taux de délinquance a été ramené de 74 pour mille à 45 pour mille. Pour une ville de banlieue, ce n’est pas mal du tout !
Nous avons aussi développé une politique de prévention. Vous le voyez, cher collègue socialiste, il n’y a pas que la gauche qui prône la prévention ; tout élu responsable est convaincu de cette nécessité !
Je suis en désaccord avec M. Bourquin sur l’armement des polices municipales. Chez nous, la police municipale travaille parfois jusqu’à minuit, voire au-delà, et doit mener des personnes en garde à vue. Il est donc indispensable qu’elle soit armée.
En réalité, les auteurs de la présente proposition de loi posent mal le problème. La vraie question, ce n’est pas l’armement des policiers municipaux, c’est l’usage qui est fait des armes !

L’armement doit être diversifié. Les agents doivent disposer de toutes les armes légales, afin de pouvoir effectuer leur travail dans les meilleures conditions.
Certaines situations sont effectivement très difficiles. Comme cela a été rappelé, nous sommes au plus haut niveau du plan Vigipirate.
Le véritable sujet, et je rejoins Mme la secrétaire d’État, c’est bien celui de la formation et de l’entraînement des policiers, ainsi que celui du contrôle qui est fait de l’usage des armes.
Aussi, je ne voterai pas la présente proposition de loi.

Le débat a un peu dérapé. La mise en cause de nos amis du groupe CRC n’a pas lieu d’être. Nos collègues agissent selon leur sensibilité, et je n’ai aucun doute quant à leur attachement aux valeurs républicaines.

Notre collègue Martial Bourquin a insisté sur la nécessité d’avoir une position équilibrée.
Je n’ai guère ressenti ce souci dans les propos de Jean Desessard lorsqu’il a évoqué le cas d’un individu blessé par un tir de Flash-ball.

Mon cher collègue, il n’y a pas, d’un côté, les « salauds » insensibles et, de l’autre, les humanistes qui se soucient du malheur d’autrui !
Même avec une simple matraque en plastique, un accident est toujours possible ! Cela peut toujours arriver, même si personne ne le souhaite sur ces travées.
Le risque d’accident est toujours présent lorsque les forces de l’ordre font leur travail. À nous de faire en sorte qu’il soit le plus faible possible !
Quoi qu’il en soit, nous avons fait le tour du débat. Il n’y a pas dans l’hémicycle les méchants d’un côté et les gentils de l’autre.
M. Martial Bourquin opine.

J’évoquerai un dernier point. Pour ma part, j’ai été scandalisé par des images vues à la télévision à l’occasion de manifestations récentes visant à défendre, dans un département du Sud-Ouest, une zone humide. Je suis président d’une fédération départementale agréée de pêche et de pisciculture. Je défends donc à ce titre les zones humides. Certes, il est légitime de manifester. Ma fédération de pêche a d’ailleurs intenté 200 procès devant les tribunaux contre des pollueurs de tout crin, y compris d’importantes sociétés de l’industrie chimique. Mais là, il s’agissait uniquement de redoutables casseurs, mélangés avec des gens de bonne foi voulant défendre un dossier qui leur paraissait défendable. Joël Labbé, également sensible à la problématique « eau, rivière et territoire », comprend de quoi je parle…
Tous ces débordements ne sont pas acceptables. Il convient donc que les forces de police et de gendarmerie puissent les réprimer avec une grande fermeté. On peut être très républicain tout en défendant une République de droits et de devoirs !
L'article 2 n'est pas adopté.

Mes chers collègues, les deux articles de la proposition de loi ayant été successivement supprimés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a plus de texte.
En conséquence, la proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l’utilisation et la commercialisation d’armes de quatrième catégorie, et à interdire leur utilisation par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations n’est pas adoptée.

L’ordre du jour appelle le débat sur le rétablissement de l’allocation équivalent retraite, organisé à la demande du groupe CRC.
La parole est à M. Dominique Watrin, orateur du groupe auteur de la demande.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 6 novembre dernier, le Président de la République a déclaré refuser « qu’une personne de soixante ans vive avec moins de 500 euros par mois. Pour les seniors qui ont toutes leurs annuités et qui ont plus de soixante ans il sera mis en place une allocation leur permettant d’aller jusqu’à la retraite dans de bonnes conditions. Pour ceux qui n’ont pas toutes leurs cotisations, un contrat aidé ».
Ces propos tenus devant 8 millions de téléspectateurs nous avaient alors donné bon espoir que le Gouvernement décide de rétablir l’allocation équivalent retraite, l’AER, supprimée par Nicolas Sarkozy en 2011.
L’allocation équivalent retraite était le minimum social majoré versé aux demandeurs d’emploi ayant la durée requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein, mais n’ayant pas encore l’âge d’ouverture des droits pour la liquidation de leur retraite.
Or la création en urgence de l’allocation transitoire de solidarité, l’ATS, et son extension en 2013 par décret n’a pas permis de remplacer le dispositif antérieur.
En effet, l’ATS est censée bénéficier à tous nos concitoyens nés en 1952 ou en 1953, inscrits à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et justifiant de 165 trimestres d’assurance.
Cependant, de nombreuses Françaises et de nombreux Français, nés en 1952 ou en 1953, inscrits à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et justifiant des 165 trimestres nécessaires ont été exclus du dispositif, car les trimestres validés au titre du bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique ne sont pas pris en compte.
C’est d’ailleurs un comble puisque ce sont précisément ces publics en fin de droits qui ont besoin du dispositif et que l’on pénalise par cette règle. Ce constat aurait dû conduire le Gouvernement à une refonte du système pour revenir à l’ancienne allocation équivalent retraite ou à tout autre système produisant les mêmes effets.
Lors d’une question orale sur le sujet le 14 octobre 2014, M. le ministre du travail m’avait répondu, en se fondant sur un rapport du Gouvernement, qu’il était plus juste et efficace d’étendre davantage l’allocation transitoire de solidarité plutôt que de rétablir l’allocation équivalent retraite.
Je voudrais signaler que ce rapport dont M. le ministre du travail faisait état dans sa réponse, qui devait être rendu public, selon lui « dans la semaine », est, sept mois après, toujours introuvable sur le site du ministère et n’a jamais été présenté à la commission des affaires sociales du Sénat.
Le 26 mars 2015, M. le ministre déclarait que pour les années 1954, 1955 et 1956 le Premier ministre annoncerait « dans les jours à venir » la mise en place de l’extension de l’ATS. Or, à ce jour, elle ne bénéficie toujours qu’aux chômeurs nés entre 1952 et 1953, et sous les conditions restrictives que j’ai expliquées.
En attendant, nous sommes en mai 2015 et malgré le million de chômeurs âgés en France, le Gouvernement n’a toujours pas décidé de rétablir l’AER, qui leur permettrait de vivre décemment jusqu’à la liquidation de leur pension. Un pays aussi riche que la France, qui sait dégager des dizaines de milliards d’euros pour exonérer de cotisations sociales les entreprises, en premier lieu celles du CAC 40, serait-il donc incapable d’assurer un revenu décent à ceux qui ont créé durant des années cette richesse ?
Comme nous l’a écrit le collectif AER-ATS « des seniors au chômage de longue durée et arrivés en fin de droit d’indemnisations se trouvent en situation de grande précarité avec seulement l’allocation spécifique de solidarité, soit 477 euros par mois pour se loger, assumer leurs charges et se nourrir ».
C’est le cas, par exemple, de Florence, citée dans le journal l’Humanité du 13 mars 2015, qui percevait 900 euros par mois d’assurance chômage. Aujourd’hui, la chômeuse doit se contenter de 477 euros d’allocation spécifique de solidarité. Alors l’été, pendant la période des récoltes, Florence retrousse ses manches et trie les grains de maïs à la chaîne huit heures par jour.
Je suis moi-même saisi dans ma circonscription, le Pas-de-Calais, de situations dramatiques tels ces salariés licenciés en février 2013 par la société Meca stamp international à Hénin-Beaumont. Une douzaine de personnes ayant travaillé à la forge dans des conditions très difficiles, soumises pendant plus de vingt ans au bruit, à la chaleur, à la poussière, aux travaux répétitifs, aux vibrations, aux postes en 3x8, aux postes de nuit, se retrouvent au Secours populaire ou aux Restos du cœur. Voilà l’avenir que promet la France à des familles qui ont cotisé plus de trente-sept ans ! Cela ne peut plus durer !
Cette illustration du quotidien de milliers de Françaises et de Français devrait conduire le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le secrétaire d'État, à prendre enfin les décisions nécessaires.
Alors oui, j’ai bien compris ce que m’a répondu M. le ministre du travail le 14 octobre 2014 : il renvoyait aussi cette question à l’amélioration de l’emploi des plus de cinquante ans et à la lutte contre le chômage de longue durée. Il parlait de cibler les contrats aidés dans le secteur marchand sur ce public. Il parlait de combattre les discriminations dont sont victimes, dans le maintien à l’emploi, les salariés au-delà de quarante-cinq ans. Il parlait du développement des contrats de génération et de l’amélioration de la formation de ces seniors via 100 000 formations prioritaires à Pôle emploi.
Mais quelle est la réalité aujourd’hui ?
Les contrats de génération ont toujours du mal à être signés malgré le doublement des aides accordées aux entreprises. Ces contrats de génération étaient censés permettre aux entreprises de moins de 300 salariés qui embauchent un jeune de moins de vingt-six ans en CDI tout en maintenant un senior de plus de cinquante-sept ans dans l’emploi de toucher une aide annuelle de 4 000 euros pendant trois ans. Malgré le doublement de l’aide depuis septembre, seuls 33 000 contrats ont été enregistrés depuis deux ans, loin de l’objectif initial de 75 000 contrats signés.
Selon une étude récente de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, le nombre de contrats aidés dans le secteur marchand a certes progressé. Mais les contrats uniques d’insertion, qui représentent la majeure partie des contrats aidés, et qui sont censés bénéficier aux plus éloignés de l’emploi, ont reculé de 8, 1 % tandis que les signatures d’emploi d’avenir ont, elles, nettement progressé.
Quant aux formations assurées par Pôle emploi pour la reconversion des seniors, il n’en est fait mention dans aucune des communications récentes du Gouvernement. Faut-il en conclure qu’il s’agit d’un renoncement supplémentaire ? Nous attendons des précisions de votre part, monsieur le secrétaire d'État. Car, enfin, le taux d’emploi des seniors en France était en 2014 de 44, 5 %, alors que la moyenne dans l’OCDE est de 54 %. Ainsi, le nombre d’inscrits à Pôle emploi de plus de cinquante ans et sans aucune activité a augmenté de 12, 3 % entre décembre 2012 et décembre 2013.
Le groupe communiste républicain et citoyen, je le dis très solennellement, refuse de laisser les personnes ayant travaillé et cotisé toute leur vie continuer à se retrouver dans une situation de grande précarité, contraintes de vivre avec l’allocation de solidarité spécifique ou le revenu de solidarité active, dont le montant est, faut-il le rappeler, largement inférieur au seuil de pauvreté.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les seniors concernés ne réclament pas l’aumône. Ils réclament tout simplement leurs droits, notamment celui du départ à la retraite anticipé pour carrières longues ou travaux pénibles.
On voit ici tous les dégâts des lois de réforme des retraites de 2010 et 2013 que les parlementaires communistes ont combattu toutes deux, et qui se traduisent par un report de l’âge de départ en retraite particulièrement injuste pour ceux qui ont travaillé le plus dur.
Certes, des dispositifs existent pour les personnes ayant commencé à travailler avant seize ans et justifiant de longues carrières. Il y a aussi les départs anticipés en cas d’inaptitude ou d’invalidité. Dans la fonction publique, des règles particulières s’appliquent.
Je voudrais tout de même souligner, quant à la pénibilité, les informations qui nous reviennent des salariés. Depuis la mise en place du compte pénibilité, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT, n’auraient plus de textes sur lesquels s’appuyer afin de traiter les retraites anticipées à soixante ans pour pénibilité. Elles sont ainsi contraintes de refuser tous les dossiers, prolongeant de deux ans les difficultés des chômeurs seniors.
Il y a donc urgence, monsieur le secrétaire d'État, à régler les problèmes dans leur ensemble, à faire en sorte que des salariés qui ont tant donné pour leur pays ne soient plus victimes d’une injustice sociale.
C’est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen vous demande de rétablir l’allocation équivalent retraite ou de nous expliquer quelles mesures vous comptez prendre pour arriver au même résultat et, a minima, tenir les engagements pris publiquement par le Président de la République, et restés à ce jour sans effets.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Jean Desessard applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la suppression de l’allocation équivalent retraite, ou AER, survenue le 1er janvier 2011 a engendré une grande précarité pour de nombreux seniors, épargnant seulement ceux dont les droits à cette allocation avaient été ouverts avant cette date.
Revenons aux racines de l’histoire : pourquoi l’AER a-t-elle été créée ? Mise en œuvre en 2002, elle visait initialement à rétablir davantage de justice sociale pour les seniors ayant cotisé suffisamment de trimestres pour toucher leur pension de retraite mais n’ayant pas acquis l’âge minimum pour y avoir droit, se trouvant ainsi dans une situation de grande précarité.
Cette allocation permettait de pallier les injustices en matière d’emploi des seniors, souvent considérés à tort comme des « poids » et non comme de réels atouts par les entreprises, les rendant ainsi davantage exposés aux licenciements économiques et aux ruptures conventionnelles.
Souhaitant supprimer l’AER dès 2009, Nicolas Sarkozy avait été contraint de la reconduire exceptionnellement en 2009 et en 2010 en raison de la « détérioration du contexte économique ». En 2011, il l’a en quelque sorte rétablie de façon partielle et pour un nombre très limité de bénéficiaires en créant l’allocation transitoire de solidarité, l’ATS.
En 2011, l’AER concernait près de 800 000 seniors. Selon un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale par le député Jean-Patrick Gille, en 2012, le coût annuel de l’AER pour l’État était d’environ 229 millions d’euros, somme qui aurait fortement augmenté si le dispositif était resté ouvert.
On ne peut nier qu’il s’agit d’une charge importante pour l’État. En comparaison, l’ATS représentait en 2012 environ 10 millions d’euros. L’État a donc réalisé une économie importante.
Cependant, cette économie n’a pas été sans incidence pour de nombreux seniors, comme je le rappelais au début de mon intervention, qui se sont trouvés dans une grande précarité. Pour la seule année 2010, on estime qu’environ 45 000 anciens salariés supplémentaires auraient pu bénéficier de l’AER si le dispositif n’avait pas été supprimé. Nous ne pouvons pas laisser ces personnes dans la précarité. Dans ces conditions, le rétablissement de l’AER se pose.
Dès novembre 2012, le Gouvernement, par la voix notamment de Michel Sapin, s’y était opposé, considérant ce dispositif comme une mesure « passive » très coûteuse, ne favorisant pas un réel retour à l’emploi pour les seniors. L’objectif du Gouvernement est ainsi de restaurer l’employabilité des personnes, notamment des seniors, via la formation, l’accompagnement des projets et la sécurisation des parcours professionnels.
Un certain nombre de mesures concrètes ont d’ailleurs été prises, parmi lesquelles on peut citer la création de contrats aidés dans le secteur marchand pour ce type de salariés, la création de 100 000 formations prioritaires de Pôle emploi destinées aux seniors, le doublement en 2015 de la prime de contrat de génération en cas d’embauche d’un senior et d’un jeune, incitant au maintien et à l’embauche des seniors.
La politique du gouvernement actuel en matière de précarité des seniors est donc davantage tournée vers la lutte contre le chômage de longue durée et vers un réel retour à l’emploi, « qui reste le meilleur rempart contre les difficultés financières et la précarité ». Je partage bien évidemment cet objectif.
Toujours d’après le rapport de Jean-Patrick Gille, le rétablissement de l’AER serait estimé à 500 millions d’euros par an. Il est clair que nous ne pouvons pas prévoir de telles dépenses en période de restrictions budgétaires, à moins qu’elles ne soient directement tournées vers la création d’emplois. Néanmoins, nous devons agir pour nos seniors au chômage, le temps que les dispositifs mis en place par le Gouvernement fassent leurs preuves et qu’ils provoquent un réel regain d’employabilité.
Le 11 mars dernier, l’allocation transitoire de solidarité a été étendue aux demandeurs d’emplois nés en 1954, en 1955 et en 1956 n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite mais justifiant des trimestres requis ; concrètement, cela signifie que les personnes âgées de 58 ans ou plus susceptibles de bénéficier d’une retraite à taux plein peuvent percevoir cette aide.
Cette situation me semble loin d’être inacceptable. Bien entendu, on peut encore assouplir les critères, afin qu’un nombre plus important de citoyens de plus de 55 ans puissent bénéficier de ces mesures.
Si je suis contre le fait de prévoir structurellement une allocation pour pallier le défaut d’employabilité des seniors, il m’apparaît indispensable de la maintenir en période de conjoncture économique difficile ; aussi l’ATS est-elle à mon sens un outil en adéquation avec la situation et doit être renouvelée tant que la situation du marché de l’emploi ne sera pas meilleure.

M. François Fortassin. J’ajoute que c’est un honneur pour nous, gens de gauche, de ne pas laisser trop de nos concitoyens au bord du chemin. Nous devons faire en sorte que la solidarité sociale s’exerce dans notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le chômage des 50 ans et plus affecte plus de 800 000 personnes dans notre pays. Selon les derniers chiffres de Pôle emploi, il est, avec le chômage des jeunes, celui qui a le plus augmenté sur la dernière période : 8, 6 % par rapport à mars 2014.
Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans mettent en moyenne deux fois plus de temps à retrouver un emploi que les 25-49 ans. Notons qu’ils sont dans des situations différentes en termes de nature d’emplois, de niveaux de compétences et de conditions salariales. Les plus de 50 ans sont les principales victimes de la conjoncture économique et du chômage de longue durée, et beaucoup voient leur situation se dégrader lorsqu’ils arrivent en fin de droits. C’est ce constat qui avait conduit à la création, en 2002, de l’allocation équivalent retraite, ou AER, dont nous débattons ce jour le rétablissement éventuel.
Pour mémoire, l’allocation équivalent retraite assurait un revenu minimum aux demandeurs d’emploi de plus de 55 ans ayant commencé tôt leur carrière professionnelle. Versée sous conditions de ressources, elle bénéficiait aux demandeurs d’emploi ayant validé l’ensemble des trimestres requis au titre de l’assurance vieillesse, sans toutefois pouvoir liquider leur pension de retraite faute d’avoir atteint l’âge légal de départ en retraite. Elle pouvait être versée aux allocataires du régime d’assurance chômage percevant une allocation d’un montant modeste ; le plafond de ressources pour prétendre à l’AER était plus élevé que celui de l’allocation de solidarité spécifique, l’ASS, et la plupart des bénéficiaires de l’AER n’étaient pas astreints à une recherche active d’emploi.
Cette allocation équivalent retraite a été mise en extinction à partir de la loi de finances pour 2008 et a totalement disparu le 1er janvier 2011.

À l’époque, compte tenu d’un contexte économique différent, notre groupe avait accepté cette suppression. En effet, le dispositif de l’AER ne semblait ni pertinent ni cohérent avec les politiques menées en faveur de l’emploi des personnes âgées de 50 ans et plus.
Aujourd’hui, le taux d’emploi des 55-64 ans est en passe d’atteindre 50 %, remplissant les objectifs du plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors de 2006. Ce taux d’emploi a en effet progressé de plus de 15 points entre 2000 et 2013, de manière continue et supérieure à l’ensemble des autres catégories de demandeurs d’emploi. Un rapport du Gouvernement remis au Parlement en octobre 2014 attribue ce bond à l’impulsion des politiques gouvernementales successives en faveur du maintien et du retour à l’emploi des seniors.
Pour autant, les seniors en fin d’indemnisation au régime d’assurance chômage et ne pouvant liquider leurs droits à la retraite n’ont pas été totalement oubliés. Afin qu’ils ne soient pas piégés par la suppression de l’AER et la réforme des retraites, un décret du 3 novembre 2011 a institué à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Il s’agissait de prendre en compte la situation des personnes immédiatement affectées par la réforme des retraites et licenciées avant le 31 décembre 2010 et qui, ayant validé le nombre de trimestres nécessaires, pensaient pouvoir percevoir l’AER entre la date d’expiration de leurs droits à l’assurance chômage et celle de leur départ à la retraite parce que le dispositif existait lors de la rupture de leur contrat de travail.
Même s’il a été assoupli par le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le secrétaire d’État, …

… ce dispositif est plus restrictif que ne l’était l’AER. Par exemple, les trimestres d’allocation de solidarité spécifique ne sont pas comptabilisés comme des trimestres cotisés pour pouvoir bénéficier de l’ATS, alors qu’ils l’étaient pour l’AER.
La question qui se pose est de savoir combien de chômeurs ont été concernés par ce resserrement des critères de l’ATS comparativement à ceux de l’AER. Le Gouvernement a remis au Parlement, en octobre 2014, un rapport faisant état des personnes exclues du bénéfice de l’ATS en 2013. Ainsi, environ 25 % des 11 232 demandeurs d’ATS ont été exclus du dispositif au motif qu’ils ne remplissaient pas la condition de ressources ou la condition de trimestres nécessaires. Plus spécifiquement, le nombre de personnes qui auraient pu potentiellement bénéficier de l’ATS en 2013 si leurs trimestres d’ASS avaient été pris en compte approche le millier. Même si on double ce chiffre avec l’adjonction d’autres critères, le chiffre global demeure modeste.
Dans le cadre d’une politique de l’emploi pour les seniors, un tel dispositif de perfusion se trouve il est vrai un peu décalé et parfois peu valorisant pour les personnes concernées en termes de transmission d’expérience ou tout simplement de dignité. Il convient néanmoins de tenir compte du contexte économique et de la situation de l’emploi à court et à moyen terme, qui diminue fortement les chances de certains seniors de retrouver un emploi dans des conditions acceptables, comme l’illustre d’ailleurs, pour coller à l’actualité, le film de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, La Loi du marché, présenté hier soir au Festival de Cannes.
Il faut, pour cette raison, écarter l’analyse de l’ex-ministre du travail Michel Sapin, qui déclarait en octobre 2012 : « La situation est effroyable pour un certain nombre de personnes qui tombent dans la trappe ». Il ajoutait cependant : « mettre 800 millions, 900 millions, 1 milliard d’euros dans des dispositifs de cette nature qui sont, comme on dit dans le jargon, passifs par rapport à des dispositifs d’encouragement à l’emploi actifs, il y a quelque chose d’un peu rageant du point de vue de l’action gouvernementale ». Et le ministre de renvoyer le sujet à la concertation prévue en 2013 sur les retraites.
Dans un article du 7 novembre 2014, il était mentionné que le Président de la République avait déclaré la veille, dans une émission sur TF1 : « J’ai décidé pour les personnes qui ont toutes leurs annuités, qui ont plus de 60 ans, et qui ne trouveront plus d’emploi jusqu’à 62 ans [...] pour ces personnes, on pourra avoir cette prestation » afin de « les conduire à la retraite ».
S’agit-il d’un retour partiel à l’AER ? Si telle est l’intention du Président de la République et du Gouvernement, pourriez-vous nous communiquer, monsieur le secrétaire d’État, des éléments sur les conditions d’éligibilité à ce dispositif en projet, son coût et les modalités de son financement ?
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans un monde idéal ou tout du moins dans une France sur la voie du redressement, ce débat, à l’initiative de nos collègues du groupe CRC, sur le rétablissement de l’allocation équivalent retraite n’aurait aucune raison d’être.
Car, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d’une allocation créée en 2002 et attribuée aux demandeurs d’emploi en fin de droits justifiant de tous leurs trimestres de cotisation retraite, mais n’ayant pas atteint l’âge légal de cessation d’activité. Autrement dit, nous parlons d’un mécanisme de protection sociale venant pallier le difficile, ou plutôt l’impossible retour à l’emploi des plus de 50 ans dans notre pays.
Finalement, poser de nouveau la question de l’allocation équivalent retraite, c’est une nouvelle fois reconnaître l’échec de notre société et de nos politiques dans la lutte contre le chômage des seniors.

Les chiffres sont accablants ! À la fin du mois dernier, le nombre des plus de 50 ans en quête d’un emploi avait progressé de 8, 6 % en un an. Une augmentation, hélas, dans la lignée des 70 % de hausse les quatre années précédentes !

Certes, l’allongement de la durée d’activité, indispensable, je vous le rappelle, pour préserver notre système de retraite par répartition, n’a pas été sans conséquence sur cette envolée, mais il ne suffit pas à masquer la principale caractéristique du chômage des seniors : celui d’être un chômage de longue durée.
Ainsi, quand une entreprise ferme, nous savons très bien que les salariés âgés de plus de 55 ans n’ont, aujourd’hui, quasiment aucune chance de retrouver un emploi.
Qu’avez-vous proposé ? Les contrats de génération, dont on connaît le triste bilan, en matière tant de création d’emplois pour les jeunes que de maintien dans l’emploi ou de recrutement pour les seniors. En réalité, le dispositif est trop complexe à mettre en œuvre, et les 20 000 emplois conclus avec des jeunes, au lieu des 75 000 prévus, ont surtout répondu à des effets d’aubaine.
Si notre société est incapable de permettre à ses jeunes seniors, comme le souhaitent d’ailleurs la plupart d’entre eux, de retravailler, elle ne peut pas, en plus, les priver d’un revenu décent lorsqu’ils n’ont plus le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ce ne serait là qu’une injustice, voire une double peine.
Signe de votre impuissance en matière d’emploi, vous avez alors fait le choix, en 2013, d’étendre le dispositif de l’allocation transitoire de solidarité destinée aux demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953.
Tout le monde se souvient que, en novembre dernier, devant les caméras, le Président de la République avait annoncé une nouvelle extension de l’ATS. Le ministre du travail, M. François Rebsamen, avait même précisé le lendemain qu’elle concernerait les générations nées en 1954, 1955 et 1956.
Depuis, il ne s’est rien passé, si ce n’est une indiscrétion de RTL laissant entendre, à la fin du mois de mars, que cette promesse n’était pas, comme tant d’autres, définitivement tombée dans l’oubli... J’aimerais tellement le croire, monsieur le secrétaire d'État, oui, tellement le croire, tant il me semble essentiel de ne pas oublier les potentiels bénéficiaires de cette disposition, qui sont, encore et toujours, aujourd'hui dans l’attente !
Ces personnes ont, durant toute leur vie, contribué au développement économique de notre pays ; aujourd'hui, faute de mieux, faute d’un emploi pérenne, elles doivent pouvoir bénéficier d’un traitement leur permettant de vivre décemment en attendant leur retraite.

Mme Brigitte Micouleau. Élue à Toulouse et étant chargée des seniors, je suis confrontée à des situations difficiles, souvent même catastrophiques. Monsieur le secrétaire d'État, nous ne pouvons pas laisser les seniors sur le bord de la route : ils comptent sur vous !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis malheureusement un habitué des débats concernant l’allocation équivalent retraite. J’ai en mémoire cette fameuse soirée où le Sénat avait voté, à la quasi-unanimité, le rétablissement de cette allocation.
Depuis sept ans, depuis la suppression de l’AER par le gouvernement Fillon, des dizaines de milliers de salariés – dont des femmes –, qui avaient parfois eu des emplois extrêmement pénibles dans le secteur industriel et qui disposaient de toutes leurs annuités de cotisations pour partir à la retraite, sont devenus sans statut, sans revenus et ont été plongés dans la misère et la précarité la plus absolue.

Effectivement, et je voudrais rappeler comment ces personnes ont quitté leurs entreprises. Des compressions d’emplois avaient été décidées, et on a alors dit à ces salariés qui étaient à quelques années de la retraite qu’ils pouvaient partir car ils toucheraient l’allocation équivalent retraite. Ils ont même quelquefois quitté leur emploi avec un document de Pôle emploi – avant, c'était l’ANPE – leur assurant qu’ils bénéficieraient de cette allocation. Et, tout d’un coup, le gouvernement Fillon supprime l’AER de façon arbitraire !

Dans quelle situation sommes-nous aujourd’hui ? L’AER avait été instituée par un amendement socialiste à l’Assemblée nationale en 2001, supprimée en 2008, prolongée pendant une année, et remplacée par l’allocation spécifique de solidarité, puis par l’allocation de transition de solidarité.
Un autre événement est intervenu : l’âge de la retraite a été reporté de deux ans, soit 62 ans, sans que la situation de ces personnes ait été prise en compte.

Il y a des vérités qui ne sont pas faciles à entendre, et pourtant il faut bien les entendre !

Vous avez supprimé cette allocation, et c'est le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, notre majorité, qui a rétabli l’allocation équivalent retraite sous la forme de l’ATS. Il faut le dire !

Cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises, les personnes de plus de 60 ans disposant de leurs annuités ne trouvent pas de travail. Aujourd’hui, dans l’économie telle qu’elle fonctionne, lorsque l’on a 55, 57 ou 58 ans et que l’on vit dans des bassins d’emploi défavorisés, trouver un emploi est une gageure, un exercice quasi impossible. Alors qu’elles avaient souvent beaucoup travaillé, eu des carrières longues, ces personnes se sont retrouvées dans une situation de grande pauvreté.
Par un amendement voté en 2013, nous avons trouvé les ressources nécessaires – il le fallait bien ! –, en créant une taxe sur l’hôtellerie de luxe, afin de l’affecter à ces allocataires potentiels.
Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a rétabli l’AER sous la forme de l’ATS par un décret. Restent aujourd’hui environ 38 000 personnes, nées en 1954, 1955 et 1956, qui se trouvent toujours dans un triangle des Bermudes juridique et social : elles ne sont pas bénéficiaires de l’ATS et attendent un dispositif qui leur soit spécifique.
Cela a été rappelé par les orateurs précédents, le 6 novembre dernier, le Président de la République a pris un engagement fort dans cette direction. Il a annoncé la création d’une prestation destinée « aux personnes qui ont droit à leur retraite, pour aller jusqu’à la retraite ». Le Président de la République tiendra cet engagement. Comme nos collègues du groupe CRC, nous aimerions accélérer le tempo tant l’urgence sociale est grande.
Avec des collègues sénateurs, comme Alain Néri, ou ancien sénateur, Ronan Kerdraon, et des députés – Christine Pires Beaune, Christophe Sirugue, Christophe Castaner, Michel Issindou, Frédéric Barbier et Olivier Faure –, nous nous sommes rendus à plusieurs reprises à Matignon non seulement pour manifester notre souci de voir ce dossier avancer, mais également pour faire des propositions.
Je vous en livre ici certaines. Nous avons tout d’abord plaidé en faveur de l’instauration d’une nouvelle prestation seniors. En effet, les carrières longues vont malheureusement disparaître au fil des années. La question aujourd’hui est donc non plus de garder l’AER ou l’ATR, mais d’avoir une prestation nouvelle pour une situation nouvelle.
Nous avons bien évidemment manifesté notre volonté que la prestation proposée soit d’un montant décent ou qu’elle puisse être cumulée avec d’autres allocations. Le Président de la République l’avait lui-même dit lors de l’émission télévisée, « Je ne peux pas accepter qu’une personne de 60 ans vive avec 500 euros par mois. » C’est peut-être l’objectif de certains, mais ce n’est pas le nôtre. Nous avons proposé une prestation médiane entre l’ASS et l’AER, dont le montant devrait être à peu près celui du minimum vieillesse, soit avec le cumul des autres prestations.
Par ailleurs, nous avons veillé à ce que la prestation seniors n’oppose pas les allocataires potentiels entre eux. Nous sommes pour la rétroactivité aux allocataires nés en 1954 et la prise en charge des allocataires nés en 1956 également.
Nous sommes aussi favorables à ce que les cotisations à l’ASS soient prises en compte – c'est une question très importante – dans le calcul des droits à la retraite.
Pour bien connaître le monde de l’entreprise – j’ai été syndicaliste dans une entreprise pendant de longues années –, je sais que ces personnes ont beaucoup travaillé et ont beaucoup donné à notre pays, à notre économie. Un jour, on leur a demandé de partir pour que des salariés plus jeunes ne soient pas touchés par des suppressions d’emplois. Lorsqu’elles ont accepté, elles avaient la garantie non seulement qu’elles toucheraient l’allocation équivalent retraite, mais aussi que les cotisations à l’AER, et ensuite à l’ASS, seraient comptabilisées dans le calcul de leurs droits à la retraite.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un phénomène particulier, celui de la multiplication du nombre de retraités pauvres. Ces personnes sont parfois obligées d’aller aux Restos du cœur parce que leur retraite n’est pas suffisante, en raison de maladies ou d’interruptions importantes dans leur parcours professionnel.
M. Alain Néri opine.

Monsieur le secrétaire d'État, il est important que nous ayons une discussion sur ces questions. Nous devons faire en sorte que l’ASS soit prise en compte pour le calcul des droits à la retraite. Cela n’avait pas été prévu dans le décret de 2013. Or il est très difficile d’avoir des retraites décentes avec des parcours hachés.
Nous souhaitons également que soit éclaircie la situation des personnes dont la fin de l’indemnisation est intervenue avant le 31 décembre 2012.
Dernier point, et non des moindres, je veux évoquer l’art et la manière. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues, il s’agit d’assurer – c’est une grande décision – un revenu à près de 38 000 personnes et de leur redonner un statut social.
Ces 38 000 personnes ne sont actuellement ni véritablement demandeurs d’emploi ni pleinement retraités. Vous le savez très bien, dans notre société, quand on est dans le ni-ni, on est souvent dans le rien ! Elles subissent une situation intolérable. Pour avoir rencontré, depuis plusieurs années, les représentants des comités AER, qui ont été évoqués précédemment, je peux vous dire qu’ils ont l’impression d’avoir été injustement frappés, abandonnés et humiliés.

Comme le disait très justement Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental, « Quand c’est la révolte des affamés ou des humiliés, […] c’est beaucoup plus violent et imprévisible parce qu’elle n’est portée par aucune espérance ». L’intervention du Président de la République leur a redonné de l’espoir.
À ce titre, je propose, avec mes collègues, que les nouveaux prestataires seniors ne soient plus comptabilisés comme des chômeurs. §Il faut sortir de l’hypocrisie. Ils ne retrouveront plus de travail, car ils sont dans cette situation depuis des années.
De la même manière, il me paraît tout aussi nécessaire de leur proposer de dispenser leur savoir-faire auprès des plus jeunes par des dispositifs de tuilage, qui peuvent permettre à des entreprises de bénéficier de l’accompagnement de ces seniors.
Je crois enfin indispensable que des agents de l’État, dûment mandatés, interviennent directement pour aider certaines personnes à régler leurs problèmes de banque ou de crédits, qui les conduisent parfois devant des commissions de surendettement.
Monsieur le secrétaire d'État, nous avons un devoir de clarté et de précision sur cette question. Nous avons des leçons à tirer de l’application du décret du 4 mars 2013. L’imprécision de ce texte avait conduit à des interprétations différentes selon les agences de Pôle emploi.
Il faut faire en sorte d’éviter que ne se reproduise une telle situation, en diffusant rapidement des instructions nationales claires et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à interprétation.

De la même manière, je demande que dès la publication du décret, un document très simple soit adressé aux personnes concernées afin de leur fournir des informations pratiques répondant précisément aux questions qu’elles se posent : qui sera éligible ? Quelles seront les pièces à fournir ? Qui sera leur interlocuteur ? Quel montant toucheront-elles ? Quand ? Quelles en seront les conséquences fiscales ? Y aura-t-il des cas dérogatoires ? L’ASS sera-t-elle prise en considération ? Quelles dispositions couvriront le cas des frontaliers ?
J’estime, en outre, que si nous voyons enfin le bout du tunnel sur ce sujet, un courrier personnalisé d’accompagnement d’un ministre, voire du chef du Gouvernement, constituerait un beau geste afin de remercier ces travailleurs pour tout ce qu’ils ont donné à l’économie, à notre pays ; pour leur dire que nous rétablissons leurs droits, et qu’ils sortiront de la précarité et de la pauvreté ; en quelque sorte, pour leur annoncer que nous leur redonnons une dignité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’allocation équivalent retraite, ou AER, instaurée par le gouvernement de Lionel Jospin en avril 2002, garantissait un minimum de ressources aux demandeurs d’emploi n’ayant pas atteint l’âge de la retraite mais justifiant des trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Cette mesure partait d’un constat : le système d’assurance chômage ne protège pas suffisamment les personnes âgées, dont le retour à l’emploi est difficile. Il est donc nécessaire de mettre en place un soutien plus important en leur faveur.
En effet, plus les demandeurs d’emploi sont âgés, plus il leur est difficile de trouver un emploi. L’âge est, de loin, le premier critère de discrimination à l’embauche et les plus de 50 ans représentent 31, 6 % des chômeurs de longue durée. Dès lors, la logique assurantielle pure du chômage ne suffit plus pour ces personnes, puisqu’elles sont insuffisamment indemnisées.
La solidarité nationale doit entrer en jeu pour garantir un minimum de ressources. C’est précisément ce que permettait l’allocation équivalent retraite. Cependant, lors de l’examen de la loi de finances pour 2008, le gouvernement de l’époque a fait voter la suppression de ce dispositif dont le coût, 500 millions d’euros par an, était jugé trop élevé.
Face à la dureté de la crise économique et à son impact sur le marché de l’emploi, le gouvernement a choisi toutefois de prolonger le versement de cette allocation, à titre exceptionnel, en 2009, puis en 2010, avant de la supprimer définitivement le 1er janvier 2011.
Pour atténuer les effets sociaux de cette suppression, l’AER a été remplacée depuis le 1er juillet 2011 par l’allocation transitoire de solidarité, ou ATS. Celle-ci vise uniquement les ayants droit de l’AER avant sa suppression, c’est-à-dire les personnes nées en 1952 et 1953, afin de limiter les conséquences sur leurs ressources.
Disons-le clairement, ce statu quo n’est pas satisfaisant. Il induit une discrimination fondée uniquement sur l’année de naissance entre les ayants droit de l’ATS et les autres, ces derniers devant se contenter de l’assurance chômage et de ses carences.
Comme beaucoup ici, j’ai noté que le Président de la République, lors d’une interview télévisée du 6 novembre 2014, a reconnu qu’il fallait agir dans ce domaine et a annoncé le retour d’une allocation pour les chômeurs ayant suffisamment cotisé mais n’ayant pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Les écologistes profitent donc de ce débat pour affirmer leur soutien à cette proposition et pour appeler à sa mise en œuvre rapide afin de soutenir les chômeurs seniors.
Néanmoins, même sous sa forme initiale, l’allocation équivalent retraite n’est pas exempte de défauts. Le fait que tous les revenus de la personne au-dessus de 631, 62 euros par mois soient déduits de l’allocation peut freiner la recherche d’emploi. La prise en compte de la situation du conjoint est également problématique et renforce la dépendance financière des personnes envers leur conjoint. Enfin, la concentration de l’aide financière sur les seules personnes âgées occulte la situation des autres chômeurs de longue durée, qui ont, eux aussi, besoin de solutions nouvelles et pérennes.
Voilà pourquoi je profite de ce débat pour défendre, de façon plus globale, le revenu de base, universel, inconditionnel et individualisé permettant de donner les ressources financières suffisantes à tous les citoyens pour vivre dignement, quelle que soit leur situation.
Plutôt que de morceler les soutiens, de saupoudrer les aides et de catégoriser les publics visés, il est temps, au contraire, d’adopter une démarche universelle de solidarité en unifiant tous les minima sociaux et les aides d’État.
Les écologistes, mais aussi d’autres formations politiques de gauche comme de droite, des chercheurs, des universitaires, des économistes, demandent la mise en place de ce revenu universel, comme en témoigne un colloque organisé hier au Sénat et qui a connu une certaine affluence.
Un tel dispositif offrira aussi une plus grande clarté et une simplicité de gestion incomparable pour les services publics. Plus besoin d’autant de moyens humains et techniques pour traiter les demandes, vérifier les dossiers et rechercher les fraudes : le versement sera automatique.
Ainsi, le revenu de base se définit comme un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement.
Pour autant, dans l’attente d’une mise en œuvre de ce revenu de base, les écologistes sont favorables au rétablissement de l’allocation équivalent retraite et remercient le groupe CRC d’avoir attiré, par ce débat, l’attention du Sénat sur cette question.
Et puisque nous sommes tous d’accord
Sourires.

, nous attendons avec impatience, monsieur le secrétaire d’État, non pas un accord sur le principe, mais les modalités de mise en œuvre de cette mesure.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’allocation équivalent retraite, dont mon groupe a demandé que nous débattions aujourd’hui, est un dispositif qui a été créé en 2002 par le gouvernement Jospin.

Son objectif était alors simple : garantir aux seniors au chômage un niveau de vie décent à partir du moment où ils arrivaient en fin de droits et le moment où ils pouvaient bénéficier de leur pension de retraite. L’AER s’établissait autour de 1 000 euros par mois. Or, lors du vote du projet de loi de finances pour 2008, la nouvelle majorité a choisi de supprimer ce dispositif.
Toutefois, au vu de la crise économique et sociale que connaissait alors le pays, l’AER a été maintenue en 2009 et 2010, avant d’être définitivement supprimée le 1er janvier 2011.
Depuis cette date, nous n’avons cessé, avec nos collègues socialistes d’ailleurs, d’interpeller le gouvernement par des courriers ou des questions écrites, afin de permettre sa restauration. Nous avons même déposé une proposition de loi visant à rétablir l’AER dans sa forme antérieure à 2011.
En effet, la suppression de cette allocation, qui bénéficiait à environ 50 000 personnes, a engendré de graves conséquences sur le plan social. Des personnes ayant cotisé toute leur vie se sont ainsi retrouvées à vivre, ou plutôt à survivre, avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, de l’ordre de 500 euros, par exemple, pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, l’ASS.
Elles ont en outre été victimes d’une réelle injustice. Certaines d’entre elles avaient en effet accepté un départ volontaire dans le cadre d’un plan social, avec la garantie du maintien de leur revenu jusqu’à la retraite grâce à l’AER. Cet élément avait d’ailleurs été pris en compte dans le calcul de leur indemnité de départ. Or la suppression de l’AER et le report de l’âge légal de départ à la retraite leur a infligé une double peine, les contraignant à vivre plusieurs mois avec les minima sociaux pour seuls revenus.
L’urgence sociale a conduit le gouvernement Fillon, et son ministre du travail, M. Xavier Bertrand, à introduire, six mois après la suppression de l’AER, l’allocation transitoire de solidarité, l’ATS. Or cette allocation est beaucoup plus restrictive : elle ne s’adresse qu’aux salariés privés d’emploi de plus de 60 ans, soit quelque 11 000 personnes, au lieu de près de 50 000. Pour les autres, le gouvernement d’alors ne proposait que la plongée dans la précarité, ou un hypothétique retour à l’emploi, sans lendemain.
Trop restrictive, et entraînant des situations d’urgence sociale préoccupantes, l’ATS a été revue par le gouvernement Ayrault dès janvier 2013, et élargie aux seniors nés en 1952 et en 1953.
Si le décret de mars 2013 constitue une avancée, le dispositif continue d’exclure les seniors nés entre 1953 et 1957. Ainsi, au lieu de réintroduire l’allocation équivalent retraite dans sa forme antérieure, le gouvernement a préféré aménager le dispositif créé par la majorité précédente et fortement critiqué, à l’époque, par le parti socialiste.
En novembre 2014, le Président de la République et son ministre du travail ont finalement annoncé que l’ATS serait élargie aux personnes nées en 1954, 1955 et 1956, soit entre 10 000 et 30 000 bénéficiaires. A été évoquée alors l’idée de mettre en place une allocation spécifique aux chômeurs seniors, dont les contours seraient précisés par décret d’ici au mois de février 2015, date qui me semble maintenant dépassée. Or, depuis cette annonce, sauf erreur de notre part, aucun décret n’a malheureusement été publié.
Nous restons dans l’attente de précision sur le périmètre retenu, ou encore sur le montant de l’allocation qui sera versée. De même, nous ne savons pas si cette mesure est appelée à être pérenne ou si le décret précisera les années de naissance des allocataires, comme cela a été le cas pour le décret pris en 2013.
Ces questions ont leur importance. Depuis 2008, le taux de chômage des seniors n’a cessé d’augmenter, passant de 4 % en 2008 à 7 % en 2014. Ainsi, la mise en place d’une mesure dynamique, et non pas d’un simple correctif de l’AER, paraît nécessaire.
D’autant plus, lorsque l’on sait que le coût du rétablissement d’une allocation pour les chômeurs seniors serait de l’ordre de 100 millions à 200 millions d’euros par an. C’est très peu, comparé aux milliards d’euros d’exonérations accordées aux entreprises au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi – CICE – ou du pacte de responsabilité !
C’est également une somme faible au regard de l’enjeu, qui est important : il s’agit de ne pas laisser sombrer dans la pauvreté et la précarité des personnes qui ont travaillé toute leur vie, souvent depuis leur plus jeune âge.
Il s’agit, tandis que leur entreprise les a remerciés après des années de bons et loyaux services, de faire vivre la solidarité dans notre société. Il ne s’agit pas de garantir un revenu de survie, de subsistance ou d’aumône, mais bien de reconnaître la contribution de ces personnes à notre économie nationale, pendant, souvent, près de quarante ans. Il s’agit tout simplement de leur garantir un niveau de vie digne, et mérité, preuve de notre attachement à la justice.
L’allocation équivalent retraite a été créée par un gouvernement de gauche, pour répondre à un devoir de solidarité avec les plus faibles. Ensemble, nous avions ensuite combattu pour son maintien. Nous attendons avec impatience et insistance que cette allocation soit rétablie par votre gouvernement, dans le respect de vos engagements récents.
En effet, en cette période de crise économique et sociale il est primordial de maintenir les garde-fous à l’extrême pauvreté afin de protéger au maximum nos concitoyens.
D’abord, parce que, étant dans le camp du progrès, nous défendons les acquis sociaux obtenus au fil des années, tout au long des combats menés par nos prédécesseurs pour ne laisser personne sur le carreau, car c’est bien là le sujet : nous voulons obtenir de nouveaux droits sociaux qui répondent à l’intérêt des plus fragiles.
Ensuite, parce que notre pays a les moyens de se doter de ce filet de sécurité et nous ne cessons de proposer en ce sens des sources de recettes supplémentaires, comme la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
Enfin, parce qu’il est dans l’intérêt de notre économie et de notre société de maintenir le pouvoir d’achat des ménages et de réduire les inégalités sociales.
Monsieur le secrétaire d’État, nous attendons la décision du Gouvernement et nous serons vigilants. En effet, d’une part, le Gouvernement doit respecter ses engagements et, d’autre part, l’allocation proposée ne saurait être inférieure à l’AER de 2002. Rien ne justifiait sa suppression, tout appelle donc à son rétablissement !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur plusieurs travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de saluer cette initiative sénatoriale qui nous permet de débattre aujourd’hui du rétablissement de l’allocation équivalent retraite annoncé par le Président de la République. Malheureusement, je crains que cette annonce ne soit effectivement qu’une annonce de plus et non un acte concret.
L’AER permettait aux personnes privées d’emploi et ayant suffisamment cotisé pour percevoir une retraite à taux plein de bénéficier d’un revenu en attendant d’atteindre l’âge légal de départ en retraite. Elle a été supprimée par la majorité précédente
M. Alain Néri opine.

Au fond, mes chers collègues, la vraie question ne serait-elle pas plutôt de réduire le chômage des seniors qui ne cesse d’augmenter ? Plus de 830 000 seniors sont aujourd'hui au chômage, après une augmentation de 9, 1 % en un an, et les plus de 50 ans représentent un quart des inscrits à Pôle emploi. Alors que nous devons faire face à une crise sans précédent, alors que nous devons faire face au problème majeur et spécifique du chômage des seniors, le Gouvernement a rétabli partiellement cette allocation, avec l’allocation transitoire de solidarité, l’ATS, et il envisage son extension, qui pèserait encore sur le budget.
À mon sens, on se trompe d’objectif : notre débat porte ici sur la forme du problème alors que nous devrions en traiter le fond. Oui, nous devons faire face à un problème spécifique, puisque la durée moyenne du chômage s’élève pour les seniors à 459 jours, soit près d’un an et demi, contre 158 jours pour les moins de 25 ans. Voilà le véritable problème ! Aussi, rétablir une allocation n’est pas la solution.
Il y a bien eu les contrats de génération, qui visaient un triple objectif : favoriser l’accès des jeunes à un emploi en CDI, faciliter la transmission des savoirs et des compétences et mettre en place des actions concrètes en faveur du maintien en emploi des seniors. François Hollande avait annoncé 75 000 contrats de génération. Qu’en est-il réellement ? À peine 20 000 contrats ont vu le jour, et ils sont, à l’évidence, le pur fruit d’un effet d’aubaine.
Dès le départ, il était évident que ce contrat manquerait sa cible. Il s’appuyait en effet, d’une part, sur l’idée, très théorique, selon laquelle on pouvait institutionnaliser le remplacement des seniors par des juniors et, d’autre part, sur l’idée, fausse, selon laquelle la transmission des savoirs et des compétences dans les entreprises ne se faisait pas, ou se faisait mal. Quant au maintien des plus de 57 ans dans l’emploi jusqu’à leur retraite, ce n’est pas une carotte de 4 000 euros qui peut constituer un élément déterminant.

et ne vous contentez pas de rétablir une mesure, pour la simple raison qu’elle fut supprimée par la droite ! Pis encore, il ne s’agit pas là de l’annonce d’une nouvelle mesure mais d’un recyclage ! Ce n’est pas ainsi que s’administre dignement et efficacement un pays qui a besoin de mesures courageuses pour lutter contre le chômage, en particulier celui des seniors !

Ainsi, après le véritable échec des contrats de génération, monsieur le secrétaire d’État, le Président de la République annonce le rétablissement de l’allocation équivalent retraite ! On se demande vraiment où va le Gouvernement. Par ailleurs, aux chômeurs seniors qui n’auront pas droit à l’allocation équivalent retraite faute d’avoir suffisamment cotisé, le Président de la République avait proposé un contrat aidé ciblant les plus de 50 ans. Qu’en est-il ? Quelle est la concrétisation de ce mécanisme ? Nous n’avons aucune précision sur le comment et sur le financement de cette mesure.
Toujours est-il que ce recours aux contrats aidés coûte, lui aussi, très cher à l’État : plus de 3, 2 milliards d’euros en 2015.
Dans tout ce flou, mes chers collègues, nous avons beaucoup de mal à percevoir la cohérence du Gouvernement. Existe-t-elle ? D’abord, des contrats de génération, mal pensés, et une promesse de 75 000 contrats signés, alors que nous n’en comptons timidement que 20 000. Ensuite, des contrats aidés, sans précision quant aux moyens alloués ni aux modalités du ciblage prévu des plus de 50 ans. Enfin, ce débat sur le possible rétablissement de l’allocation équivalent retraite, faisant ainsi suite à une énième annonce du Président de la République.
Des annonces et des promesses en faveur de l’emploi des seniors, nous en entendons depuis le débat présidentiel de 2012.

Des actes, des mesures phares et du courage pour réformer notre pays en crise, nous en attendons depuis plus de trois ans maintenant.
« Un bon ouvrier a de bons outils », affirme un dicton populaire. Je crains que la boîte à outils gouvernementale ne soit remplie de mauvais outils.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie, tout d’abord, d’excuser l’absence de M. François Rebsamen, ministre du travail, retenu à l’Assemblée nationale pour l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.
Je remercie, ensuite, le groupe CRC d’avoir proposé un débat sur le rétablissement de l’AER, débat qui permet de revenir sur les différents dispositifs visant à accompagner les demandeurs d’emploi qui sont à la veille de leur retraite.
Avant sa suppression, l’AER, instaurée en 2002, visait à garantir la solidarité de la nation envers les demandeurs d’emploi seniors. Elle visait à garantir un niveau de ressources aux demandeurs d’emploi se trouvant dans une situation très particulière : ils avaient validé le nombre de trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein mais sans avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite. Très concrètement, cette situation pouvait concerner des salariés ayant commencé leur carrière professionnelle très tôt dans leur vie.
Cependant, la précédente majorité a décidé – comme cela a été rappelé précédemment – de supprimer le dispositif à la fin de l’année 2010 et, concomitamment, elle a conduit une réforme des retraites qui a relevé l’âge légal de départ à la retraite.
Certaines personnes ont donc subi une « double-peine » :…
… celle de ne plus pouvoir bénéficier de l’AER, puisqu’elle était supprimée, et de ne pouvoir non plus partir à la retraite, l’âge légal ayant été relevé.
Face à ce constat, l’allocation transitoire de solidarité, l’ATS, a été mise en place afin de lisser les effets de la réforme des retraites. Elle a été instaurée en novembre 2011, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2011, pour atténuer les effets du relèvement de l’âge légal de départ en retraite décidé par la réforme de novembre 2010. Il s’agissait d’assurer un revenu ou un complément de revenu aux demandeurs d’emploi d’au moins 60 ans qui avaient validé tous leurs trimestres mais qui ne pouvaient liquider leur retraite faute d’avoir atteint l’âge légal.
L’ATS se distinguait ainsi de l’AER par le ciblage des demandeurs d’emploi d’au moins 60 ans, c'est-à-dire nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953. Ces personnes étaient en effet indemnisées au titre du chômage au moment du vote de la réforme des retraites, et elles auraient pu liquider directement leur pension à l’extinction de leur indemnisation chômage si l’âge légal de départ n’avait pas été relevé.
Le gouvernement Ayrault a ensuite assoupli les conditions nécessaires pour bénéficier de l’ATS : à compter du 1er mars 2013, il a supprimé la condition de détention de droits à l’assurance chômage après 60 ans.
Pour bénéficier de l’ATS ainsi réformée, et qui s’élevait à 1 029 euros par mois, il fallait remplir quatre conditions : premièrement, être né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1953, la génération née en 1951 ayant déjà atteint l’âge légal de retraite en 2013 ; deuxièmement, être éligible aux indemnités de l’assurance chômage au 31 décembre 2010 ; troisièmement, avoir validé le nombre de trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein à l’extinction de ses droits à l’allocation d’assurance chômage ; enfin, quatrièmement, n’avoir pas atteint le nouvel âge légal de départ à la retraite.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoyait qu’un rapport sur la situation des générations nées en 1952 et 1953 serait remis au Parlement. Ce rapport a été remis en octobre 2014 ; il explique que l’élargissement de mars 2013 mis en œuvre par le gouvernement a permis d’inclure dans le bénéfice de l’ATS la quasi-totalité des chômeurs nés en 1952 ou en 1953 et pouvant y prétendre.
MM. Martial Bourquin et Alain Néri opinent.
Je tiens toutefois à le rappeler : l’objectif de l’ATS était bien d’apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les personnes affectées par la réforme des retraites de 2010. Cette mesure revêtait un caractère exceptionnel. Puisque les personnes en bénéficiant sont aujourd’hui à la retraite, il n’y a plus de dépense associée à l’ATS.
Plus généralement, la question des fins de carrières et de la transition entre emploi et retraite est au cœur des préoccupations du Gouvernement.
Au-delà de la mise en œuvre de l’ATS, je veux souligner l’engagement de Manuel Valls d’assurer une fin de carrière décente aux actifs seniors. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites contient ainsi plusieurs mesures favorables aux seniors, notamment l’élargissement des critères d’accès au départ anticipé pour carrière longue et la mise en place d’un compte personnel de prévention de la pénibilité.
Le plan d’actions qui figure dans la feuille de route de la grande conférence sociale de 2014 fait également une large place aux difficultés que rencontrent les seniors sur le marché du travail.
Par ailleurs, près d’un tiers des emplois aidés, qu’il s’agisse des contrats initiative emploi, les CIE, ou des contrats d’accompagnement dans l’emploi, les CAE, ont bénéficié à des demandeurs d’emploi seniors en 2014, les objectifs que nous nous étions fixés ayant même été dépassés, et plus de 45 000 demandes d’aides – et non 20 000, madame Duranton – ont été enregistrées dans le cadre des contrats de génération depuis leur création.
Ainsi que beaucoup d’entre vous l’ont rappelé, lors de son entretien télévisé du 6 novembre 2014, le Président de la République a annoncé, à propos des personnes « qui ont toutes leurs annuités et plus de 60 ans », qu’« une prestation permettra de les conduire à la retraite dans de bonnes conditions ».
La mise en œuvre d’une telle mesure s’inscrit, vous le savez, dans un contexte particulièrement contraint sur le plan des finances publiques. En effet, la mesure doit être financée sur un budget de l’emploi qui, par ailleurs, finance aussi les mesures d’activation des demandeurs d’emploi, telles que les contrats aidés ou la garantie jeunes.
Par conséquent, un équilibre difficile, délicat doit être trouvé entre, premièrement, la protection de certains demandeurs d’emploi seniors, deuxièmement, les contraintes financières dont je viens de parler et, troisièmement, la cohérence d’ensemble des politiques de l’emploi en faveur des seniors.
Le Gouvernement a donc souhaité prendre en compte les situations individuelles les plus difficiles, tout en menant parallèlement une politique de l’emploi très active en faveur des seniors. Il souhaite tenir un discours de vérité : le rétablissement d’un équivalent de l’AER est, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, financièrement inenvisageable.
M. André Vallini, secrétaire d'État. Il coûterait 500 millions d’euros si l’on retient les personnes des générations 1954 et 1955 indemnisables entre janvier 2011 et décembre 2014, et 865 millions d’euros si l’on inclut la génération de 1956. Cette dépense supplémentaire serait impossible à financer dans le contexte actuel des finances publiques.
M. Jean-Claude Gaudin s’exclame.
Le Gouvernement s’est donc attaché à proposer un dispositif ciblé qui permet de résoudre les situations individuelles les plus difficiles sur le plan du retour à l’emploi tout en n’apparaissant pas contradictoire avec les mesures de soutien à l’emploi des seniors.
Le scénario retenu consiste ainsi à verser une prime mensuelle de 300 euros aux bénéficiaires de l’ASS ou du RSA socle qui satisfont cumulativement aux quatre conditions suivantes : être demandeur d’emploi âgé d’au moins 60 ans né en 1954 ou 1955 ; avoir validé le nombre de trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein avant la fin de droit à l’assurance chômage ; avoir été indemnisable par l’assurance chômage – au titre de l’allocation d'aide au retour à l'emploi, l’ARE, de l’allocation spécifique de reclassement, l’ASR, de l’allocation de transition professionnelle, l’ATP, ou de l’allocation de sécurisation professionnelle, l’ASP – au moins un jour sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ; ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Cette prime va concerner 37 900 personnes, pour un coût estimé à 185, 7 millions d’euros sur la période 2015–2017.
En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l’a très bien expliqué Martial Bourquin, le Gouvernement a bien conscience des grandes difficultés dans lesquelles se trouvent certains demandeurs d’emploi seniors, voire de l’injustice qui les frappe. Comment accepter qu’une personne ayant travaillé pendant de nombreuses années et ayant validé tous ses trimestres ne bénéficie que d’allocations de solidarité, parce qu’elle se retrouve au chômage et dans l’impossibilité de liquider sa retraite, faute d’avoir atteint l’âge légal ?
Nous avons pris nos responsabilités, en proposant un dispositif juste, tout en maîtrisant la dépense publique. Je le répète, ce sont près de 40 000 personnes, nées en 1954 et 1955 et allocataires du RSA ou de l’ASS qui bénéficieront d’une prime mensuelle de 300 euros.
Un décret en ce sens sera signé dans les tout prochains jours, après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Cette mesure résume la politique du Président de la République, que met en œuvre le Gouvernement et qui consiste à rétablir la situation financière de notre pays, sans oublier la justice sociale et la solidarité, lesquelles restent au cœur de nos préoccupations et de l’action gouvernementale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Nous en avons terminé avec le débat sur le rétablissement de l’allocation équivalent retraite.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :
- d’une part, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014–1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
- d’autre part, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet de modernisation et mise en sécurité du CHU de Limoges, accompagnée de l’avis du Commissariat général à l’investissement.
Acte est donné du dépôt de ces documents.
Ils ont été respectivement transmis à la commission des affaires économiques et à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires sociales.

J’informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la délégation à la prospective, en remplacement de Mme Natacha Bouchart, démissionnaire.
Cette candidature va être publiée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 2013–907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la commission des lois, lors de sa réunion du 19 mai 2015, n’a pas émis, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, un avis conforme – 22 voix pour, 15 voix contre – sur le projet de nomination, par M. le président du Sénat, de M. Jean-Michel Lemoyne de Forges aux fonctions de membre de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à dix-huit heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-huit heures.

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ainsi que pour l’examen du projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part.
Ces deux projets de loi ont été déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale le 20 mai 2015.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande des groupes UMP et UDI-UC, de la proposition de loi simplifiant les conditions de saisine du Conseil national d’évaluation des normes, présentée par MM. Jean-Marie Bockel et Rémy Pointereau (proposition n° 120, texte de la commission n° 436, rapport n° 435).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Marie Bockel, auteur de la proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, adoptée sur l’initiative de Jacqueline Gourault et de Jean-Pierre Sueur, la loi du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics a destiné cette instance à prendre la succession de la Commission consultative d’évaluation des normes dans la foulée des états généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat en octobre 2012. De très nombreux élus locaux avaient saisi l’occasion de ce rassemblement pour exprimer leur exaspération à l’égard de la prolifération normative. Il faut rappeler que le remplacement de la CCEN par le CNEN a marqué une étape importante dans la prise de conscience des défis que posait la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
Le problème, en soi, est identifié depuis longtemps, et ce n’est pas d’hier que le Sénat, attentif aux remontées des élus locaux signalant l’impact de plus en plus lourd des normes et procédures de toutes sortes, se préoccupe de mettre en place les moyens de desserrer l’étau normatif qui enserre l’action des élus locaux dans d’innombrables contraintes. Celles et ceux qui sont chaque semaine sur le terrain ou qui l’étaient l’année dernière, dans le cadre du renouvellement sénatorial – et j’en fus –, peuvent témoigner qu’il s’agit de l’une des interpellations récurrentes que nous adressent nos collègues élus locaux. On peut même parler d’une véritable complainte.
Le stock des normes en vigueur représente une masse énorme que l’on ne sait trop comment aborder. Est-il seulement besoin de rappeler que 400 000 normes – je me réfère au rapport d’Alain Richard fait au nom de la commission des lois – s’appliquent aux collectivités territoriales, pour un coût annuel de 3 points de produit intérieur brut ? La France se positionne ainsi à la 121e place sur 144 en termes de compétitivité administrative.
Pour l’essentiel, la CCEN avait reçu la mission d’examiner les textes réglementaires créant de nouvelles normes applicables aux collectivités ou modifiant ces normes. Aucune instance n’était chargée de la simplification du stock de normes. Il n’existait aucune procédure pérenne de simplification d’un stock que, du reste, personne n’avait entrepris d’aborder de manière systématique. Le CNEN a poursuivi, avec l’aide des associations d’élus locaux, en particulier celle de l’Association des maires de France dont il faut souligner l’implication active dans les travaux d’évaluation des normes, un vrai travail d’analyse, de critique et de proposition.
Cependant, l’évaluation du flux des normes nouvelles au regard du principe de simplicité, si essentielle soit-elle, ne peut répondre pleinement aux attentes des élus locaux quotidiennement confrontés à la complexité du droit en vigueur. Aussi des initiatives ont-elles été prises au sein du Sénat pour s’attaquer au stock des normes applicables aux collectivités territoriales. En 2011, notre collègue Éric Doligé a déposé une proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Elle traduisait certaines propositions du rapport consacré au poids des normes sur l’activité quotidienne des collectivités territoriales qu’il avait élaboré dans le cadre de la mission que lui avait confiée, la même année, le Président de la République de l’époque. Je sais que notre collègue Rémy Pointereau, premier vice-président de la délégation aux collectivités territoriales, chargé de la simplification, saura s’inspirer du rapport Doligé ; il en parlera sans doute dans quelques instants.

Les initiatives issues de cette démarche, comme d’autres démarches sénatoriales, ont eu entre autres mérites d’accentuer la prise de conscience de la gravité du problème des normes. Elles n’ont pas eu les suites espérées, d’où la création du CNEN, dont nous essayons aujourd’hui de parfaire l’efficacité. Ce ne sont sans doute ni Mme Gourault ni M. Sueur, lesquels ont réalisé un gros travail sur le sujet à l’époque, qui s’en plaindront.
À l’origine de la création du CNEN par la loi du 17 octobre 2013 se trouve la nécessité de prendre en compte l’ensemble des demandes des élus locaux et de leur donner une réponse complète, concrète et efficace. C’est pourquoi il a reçu deux missions, l’une portant sur le flux, l’autre sur le stock de normes. Ce dernier point est le plus innovant et peut-être le plus prometteur de la loi d’octobre 2013. En effet, l’évaluation du flux des normes nouvelles est en principe permanente tout au long du processus d’élaboration de chaque norme.
En principe, la question du flux des normes nouvelles devrait être de mieux en mieux prise en main. Le CNEN fait, dans ce domaine, de son mieux. Son président, Alain Lambert, qui fut par le passé le premier président de notre délégation aux collectivités territoriales et avec lequel nous sommes en dialogue permanent, fait un travail tout à fait remarquable. De son côté, le Gouvernement nous dit être plus attentif – je n’ai pas de raison, monsieur le secrétaire d’État, de douter de l’attention du Gouvernement sur ces questions. Il se serait doté de moyens dédiés, dont vous nous parlerez certainement. En un mot, une nouvelle culture de la norme est en train d’apparaître. Ses effets commencent à se faire sentir, même si les prescripteurs de normes, dont nous autres, parlementaires, ne sommes pas les moins entreprenants, restent souvent plus attentifs à leur nécessité qu’à leurs effets pervers.
Sur ces questions, tout le monde doit balayer devant sa porte, nous y compris, même si la loi est parfois prise de court par des décrets qui ne correspondent pas complètement à son esprit…

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C’est un euphémisme !
Sourires.

Je le dis tout en soulignant bien que chacun doit balayer devant sa porte, nous y compris, sur quelque travée que ce soit. Il s’agit d’une œuvre commune à laquelle nous devons tous nous atteler.
On ne peut dire que la question du stock soit ignorée : la délégation aux collectivités territoriales en a été saisie à la fin de 2014 ; le Gouvernement y consacre des moyens. Nous avons à cet égard noué des contacts aussi bien avec vous, monsieur le secrétaire d’État, qui êtes spécialement chargé de la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, qu’avec Thierry Mandon, secrétaire d’État à la réforme de l’État et à la simplification, que nous avons reçu et que nous reverrons. Nous savons que des initiatives sont en cours de lancement, et nous sommes désireux de nous y associer, tant il est vrai que la simplification est une ambition partagée qui nécessite l’engagement de chacun.
Au sein du Conseil national d’évaluation des normes se déroule un échange permanent entre les représentants du Sénat et de l’Assemblée nationale et ceux des administrations et des collectivités territoriales, au fil des saisines obligatoires ou facultatives. Le CNEN reste ainsi un outil stratégique de la simplification du stock. C’est d’ailleurs pour cette raison que la décision du bureau du Sénat, confiant en novembre dernier à la délégation aux collectivités territoriales – je l’ai déjà souligné – une mission d’évaluation et de simplification des normes, a prévu que ce travail se ferait en liaison avec le CNEN, raison pour laquelle ont été noués les contacts de qualité que j’évoquais voilà quelques instants avec le Conseil national d’évaluation des normes et son président.
Pour donner toute sa portée à cette compétence éminente sur le stock de normes, les conditions de saisine du CNEN sont essentielles. En effet, l’une des principales difficultés en la matière est de déterminer les priorités. C’est pourquoi la démarche de simplification ne peut être efficacement lancée que sous l’impulsion des collectivités territoriales, mieux placées pour identifier les normes les plus invalidantes et nous les faire connaître. Sans leur participation au processus, sous une forme ou une autre, nous n’arriverons pas à construire un programme opérant. La simplification risque alors de tourner en une discussion académique roulant sur le pourquoi et le comment sans déboucher sur des résultats concrets. Je crois que, là aussi, Rémy Pointereau, à travers des amendements que j’ai cosignés avec d’autres collègues, nous dira des choses intéressantes.
La loi prévoit que le CNEN peut être saisi d’une demande d’évaluation des normes en vigueur par le Gouvernement, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette énumération fait à peu près le tour de l’ensemble des instances intéressées par la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Pour autant, ces dernières restent en réalité à l’écart du processus en raison des conditions très restrictives encadrant leur pouvoir de saisine. La faute n’en est pas à la loi – j’y faisais allusion à l’instant –, mais à son décret d’application : le décret du 30 avril 2014 portant application de la loi du 17 octobre 2013 illustre en effet de manière emblématique le processus d’amplification et de paralysie de la norme par les dispositions d’application d’une loi.
Alors que la loi du 17 octobre 2013 prévoit que les collectivités territoriales pourront saisir le CNEN d’une demande de révision portant sur le stock en vigueur sans soumettre cette prérogative à des exigences particulières, le décret d’application fixe des conditions qui sont autant d’obstacles à sa concrétisation. C’est ainsi que l’article 3 du décret exige que la demande d’évaluation d’une norme réglementaire en vigueur soit présentée par au moins cent maires et présidents d’EPCI, ou dix présidents de conseil général ou deux présidents de conseil régional – on peut d’ailleurs s’interroger sur le poids d’un président de conseil général par rapport à un président de conseil régional… L’exigence irréaliste et non prévue par la loi d’une démarche concertée de cent maires rend tout à fait improbable le fonctionnement effectif de cette modalité de saisine. Le décret exige également que la demande d’évaluation comprenne une fiche d’impact présentant, entre autres éléments, « ses motifs précisément étayés », ce qui revient à faire peser sur les collectivités – qui peuvent être des communes petites ou de taille moyenne, dépourvues de tout moyen d’expertiser les normes – une obligation de pré-instruction du dossier coûteuse et non prévue par le texte.
La proposition de loi que j’ai cosignée avec Rémy Pointereau a pour objet d’écarter ces obstacles. Je laisse à ce dernier le soin de détailler le dispositif de notre texte, de le préciser. Je rappellerai simplement, pour conclure mon propos, que l’efficacité de l’action du Conseil national d’évaluation des normes sur le stock de normes dépend très largement de l’impulsion que pourront lui donner les collectivités territoriales, qu’elle soit directe ou qu’elle s’exerce par l’intermédiaire des associations d’élus.
Applaudissements.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au nom de la commission des lois, je veux remercier Jean-Marie Bockel et Rémy Pointereau. Il peut arriver qu’un décret s’écarte de la lettre ou de l’esprit de la loi. Il peut même arriver qu’il les trahisse. C’est le cas de celui du 30 avril 2014. Il est par conséquent salutaire que nos collègues aient pris l’initiative de protester et de nous proposer un texte pour réformer cet état de choses. M. Jean-Marie Bockel a excellemment expliqué la situation.
Le Sénat, depuis maintenant des années et de manière souvent unanime, est aux côtés des élus locaux pour lutter contre la prolifération des normes inutiles. Soyons clairs, il y a des normes indispensables, et nous faisons notre travail lorsque nous en adoptons en matière de sécurité publique, de santé ou de protection de l’environnement. Cependant, il en va des normes comme des lois, celles qui sont inutiles font du tort à celles qui sont nécessaires.
À cet égard, je salue à mon tour, comme je le fais dans mon rapport, les travaux de notre collègue Éric Doligé, qui est l’auteur d’un rapport sur ce sujet, au sein duquel sont présentées des propositions concrètes.

Je salue également les états généraux de la démocratie territoriale, organisés sur l’initiative de Jean-Pierre Bel, notre ancien président, qui a confié à Jacqueline Gourault et à moi-même le soin d’élaborer deux propositions de loi : l’une visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, qui a enfin été promulguée, après avoir attendu quelque temps son examen par l’Assemblée nationale, l’autre relative aux normes, que vous avez bien voulu adopter à l’unanimité, mes chers collègues, et qui prévoyait de créer une instance – elle existe aujourd'hui –, à savoir le Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Le CNEN est doté de pouvoirs beaucoup plus étendus que l’organisme qui l’a précédé. En effet, il peut se saisir en amont de tout projet de loi, projet de décret ou texte réglementaire. Avant que la norme n’existe, posons-nous la question de savoir si elle est nécessaire et si elle n’est pas trop coûteuse ou trop contraignante pour les collectivités locales. En outre, ce conseil national peut se saisir non seulement des nouveaux projets, mais aussi du stock des normes existantes.
Nous avions très clairement prévu – je parle sous le contrôle de Mme la présidente de séance Jacqueline Gourault – que toute collectivité pourrait saisir ce conseil national. Que s’est-il donc passé ? Monsieur le secrétaire d’État, bien que vous n’ayez pas signé ce décret – au demeurant, j’ai beaucoup de respect et d’amitié pour ceux qui l’ont signé –, vous savez que la lettre et l’esprit du législateur n’y ont pas été respectés. En effet, alors que nous avions souhaité que toute collectivité locale pût saisir le Conseil national d’évaluation des normes, nous nous trouvons, comme l’a dit M. Bockel et l’a écrit M. Pointereau, devant un dispositif prévoyant qu’une même saisine doit être signée par cent communes. Ce n’est pas conforme à la loi ! J’ajouterai même quelque chose que vous pourrez aisément vérifier : au cours des débats parlementaires, aucun sénateur, aucun député, n’a imaginé ni proposé cela. Il faut donc revoir ce dispositif.
Nous avons reçu M. Alain Lambert, qui, avec sa sagacité, sa compétence et sa grande courtoisie, préside ce conseil national. Je veux d’ailleurs saluer tous les élus qui y participent et y accomplissent un lourd travail.

Tout à fait, mon cher collègue !
M. Lambert nous a dit : pourquoi, plutôt que de faire une loi, n’écrivez-vous pas tout simplement à M. le secrétaire d’État ? Je m’adresse donc à vous très directement, monsieur le secrétaire d’État, pour vous demander de publier un nouveau décret. Finalement, vous pourriez très vite, sans même que les députés aient à examiner notre proposition de loi – mais nous voulons tout de même qu’ils en soient saisis, j’expliquerai tout à l’heure pour quelles raisons –, changer ce décret, de manière à écrire que toute commune, tout département, toute région et toute institution intercommunale à fiscalité propre pourra saisir le Conseil national d’évaluation des normes.

C’est simple, pratique et tout à fait faisable. En outre, vous réparerez ainsi une erreur et respecterez la lettre et l’esprit de la loi.
La commission des lois s’est saisie de l’opportunité représentée par ce texte pour proposer quelques autres modifications à la loi elle-même.
Premièrement, il avait été prévu que le Conseil national d’évaluation des normes serait saisi de l’ensemble des textes réglementaires applicables aux collectivités locales. Est-ce nécessaire ? La commission des lois a répondu « non ». Dans la mesure où nombre de textes réglementaires concernent les collectivités locales, il nous paraît plus simple et plus réaliste que le Conseil national d’évaluation des normes ne soit saisi que des textes ou des projets de texte ayant un effet en matière de normes.
Deuxièmement, nous avons pensé que la saisine par une collectivité, qui pourra être une commune de petite taille, peu importe le nombre de ses habitants, devait être motivée. Pour répondre à M. Pointereau, qui a déposé un amendement sur ce point, je précise que la motivation de la saisine pourra se limiter à quelques lignes ; il ne sera pas nécessaire qu’elle soit exhaustive.
Enfin, nous nous sommes penchés – je me permets d’appeler particulièrement votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire d’État – sur la question des délais. En effet, la loi prévoit qu’il peut y avoir des situations d’urgence, dans lesquelles le Premier ministre peut demander, sur la base d’une justification précise, au Conseil national d’évaluation des normes de rendre sa décision dans un délai de quinze jours. Et en cas d’extrême urgence, le Premier ministre peut même demander au Conseil national d’évaluation des normes de statuer dans un délai de soixante-douze heures ! C’est cette dernière disposition qui pose problème.
M. Alain Lambert, président du Conseil national d’évaluation des normes, nous a ainsi expliqué qu’il avait reçu une saisine émanant du Premier ministre un vendredi soir, l’analyse exhaustive du Conseil national d’évaluation des normes devant être fournie dans les soixante-douze heures. Chacun le voit bien, c’était absurde et impossible ! Le président ne pouvait pas demander aux membres du CNEN de venir toutes affaires cessantes à Paris. De surcroît, il s’agissait en l’occurrence du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui – vous en conviendrez – n’est pas un petit texte.
La commission des lois a donc prévu que, en cas d’extrême urgence, le Conseil national d’évaluation des normes devrait statuer au cours des quatre jours ouvrables suivant la saisine. Cela signifie que, si le Premier ministre saisit le Conseil national d’évaluation des normes le lundi soir, celui-ci aura jusqu’au vendredi pour rendre son avis. Il statuera ainsi dans des conditions certes difficiles – il faudra organiser une réunion exceptionnelle –, mais faisables. J’espère que le Gouvernement comprendra la nécessité de ce délai de quatre jours ouvrables. D’ailleurs, quand on y réfléchit bien, il n’est pas exorbitant. Quand on sait qu’il a fallu de nombreux mois au Parlement pour examiner le texte relatif à la transition énergétique, on voit bien qu’on n’est pas à quelques heures près…
Deux autres sujets ont été proposés par notre collègue Rémy Pointereau.
Le premier concerne les questions sportives. Avec Mme Jacqueline Gourault, nous avions été prudents sur ce sujet, après avoir pris contact avec les fédérations sportives et le secrétariat d’État chargé des sports. Vous savez qu’il existe une instance appelée la CERFRES, la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, qui donne des avis sur les normes applicables aux collectivités locales.
Au départ, je n’étais pas favorable à l’amendement déposé par notre collègue, car je pensais qu’il fallait poursuivre le dialogue. Toutefois, très impressionné par certaines réalités dont les élus ont été témoins, la commission a décidé de suivre M. Pointereau, après avoir été convaincue par plusieurs de ses arguments. Je prendrai l’exemple d’une fédération sportive, que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtra, ayant décidé un beau jour que les panneaux permettant d’indiquer le score de chaque équipe devaient être modifiés et que, si cela n’était pas fait, le terrain ne serait plus homologué.

Une telle décision, vous le savez, M. Doligé en a parlé, a un coût. Dans un monde idéal, il serait sans doute souhaitable que les panneaux d’affichage fussent modifiés. Toutefois, dans la situation financière à laquelle nos collectivités font face, on peut considérer qu’une telle dépense n’est pas urgente et préférer faire d’autres choix. Tel est l’avis de la commission, que je rapporte, je crois, fidèlement.
Le deuxième sujet a trait à l’expertise nécessaire pour étudier les saisines dont le Conseil national d’évaluation des normes est l’objet. À cet égard, M. Alain Lambert nous a expliqué qu’il ne disposait pas de services.
C’est vrai !

Par conséquent, nous avons prévu dans la proposition de loi, et je crois que c’est très judicieux, que les administrations de l’État apporteront leur concours pour expertiser ces saisines.
J’achèverai mon propos en évoquant la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat à l’unanimité, tendant à joindre les avis rendus par le Conseil national d’évaluation des normes, qui est constitué d’élus locaux et qui les représente parfaitement, aux projets de loi comme c’est le cas pour les études d’impact. Je pense que c’est une bonne idée, que nous partageons d’ailleurs toutes et tous.

Or ce texte n’a toujours pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Peut-être, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous, grâce aux grandes qualités de persuasion qui sont les vôtres, y contribuer. En tout cas, je formule le vœu qu’il puisse être voté par nos collègues députés.
Mes chers collègues, je remercie encore une fois les auteurs de la proposition de loi, qui est une étape de plus, et tous nos collègues qui se sont penchés sur la question. Continuons à être sur ce sujet au côté des élus locaux ! Les normes nécessaires doivent être mises en œuvre, mais évitons celles qui ne le sont pas, car elles ont un coût et induisent des contraintes excessives pour nos collectivités locales.
Applaudissements.

Madame la présidente, monsieur le vice-président de la commission des lois, Jean-Patrick Courtois, monsieur le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Jean-Marie Bockel, monsieur le premier vice-président de cette délégation, plus spécifiquement chargé des normes, Rémy Pointereau, monsieur le rapporteur, Jean-Pierre Sueur, mesdames, messieurs les sénateurs, dès 2012, le Président de la République le disait : « 400 000 normes seraient applicables [aux collectivités territoriales] et on mesure, à évoquer ce chiffre, combien la décentralisation est finalement contournée, détournée, dès lors qu’il y a autant de contraintes qui pèsent sur les collectivités. »
Cette question des normes – ou plutôt de cet excès de normes – qui pèsent sur les collectivités locales est un sujet d’incompréhension et de plus en plus souvent d’irritation des élus locaux, d’autant que cette inflation normative est source non seulement de complexité pour les élus, mais aussi de coûts supplémentaires pour les finances locales. Cela a été clairement démontré par plusieurs rapports. J’en citerai deux : celui d’Éric Doligé sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, remis en 2011, et celui de la mission de lutte contre l’inflation normative de Jean-Claude Boulard et Alain Lambert, remis au Premier ministre en mars 2013.
Pour autant, les politiques mises en œuvre depuis quelques années contre cette inflation normative n’ont pas obtenu, il faut le reconnaître, les résultats escomptés, au contraire ; de 2008 à 2013, le coût brut des normes nouvelles mises à la charge des collectivités territoriales a été estimé à 5, 8 milliards d’euros.
Le Gouvernement a donc fait de la maîtrise des normes une priorité de son action. C’est vrai pour les entreprises, avec Thierry Mandon ; c’est vrai aussi pour les collectivités territoriales, et cela doit l’être encore plus à l’heure où le Gouvernement leur demande un effort important dans le cadre du redressement de nos finances publiques.
Un dispositif opérationnel de maîtrise des normes a donc été mis en place en 2014 pour agir sur le stock comme sur le flux. Il repose notamment sur le Conseil national d’évaluation des normes, installé le 3 juillet 2014 à la suite de l’adoption de la proposition de loi déposée par Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur.
Le Gouvernement est pleinement engagé dans une politique de réduction du stock des normes existantes. Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit « projet de loi NOTRe », que le Sénat examinera en deuxième lecture la semaine prochaine, intègre ainsi quatorze mesures issues de la proposition de loi de M. Doligé, dont je salue à mon tour le travail.
Même si cela peut paraître rébarbatif, je veux citer ces quatorze mesures : assouplissement de la législation relative aux centres communaux d’action sociale, instauration d’une règle de quorum pour les réunions des commissions compétentes en matière d’ouverture des plis pour les délégations de service au public, simplification des modalités de mise à disposition du public des documents relatifs à l’exploitation des services publics délégués, uniformisation des délais d’adoption du règlement intérieur des collectivités locales, dématérialisation des recueils des actes administratifs, transmission du compte de gestion au préfet par le directeur départemental ou régional des finances publiques, alignement du régime des accords-cadres sur celui des marchés publics, possibilité de délégation aux exécutifs de la capacité de modifier ou de supprimer des régies comptables, possibilité de délégation aux exécutifs locaux des demandes de subvention, dématérialisation de la publication des actes administratifs, délai porté à neuf mois pour la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau, d’assainissement et de traitement des ordures ménagères, suppression de la délibération préalable au déclenchement de la procédure d’abandon manifeste d’une parcelle, délai minimum pour la transmission des documents en amont des commissions permanentes, clarification de la procédure de dissolution d’un EPCI.
Par ailleurs, une mission regroupant plusieurs inspections – l’Inspection générale de l’administration, l’Inspection générale des affaires sociales, le contrôle général économique et financier – a été mandatée pour proposer des allégements de normes dont les coûts sont particulièrement élevés. Nous disposerons de ses conclusions probablement en juin.
Enfin, des ateliers thématiques ont été mis en place conjointement par mon cabinet et celui de M. Mandon, en lien avec les associations d’élus et les associations de cadres territoriaux. Il s’agit d’identifier par thèmes des propositions opérationnelles, à partir des observations des acteurs locaux, notamment les directeurs de collectivité territoriale.
Après vous avoir rappelé combien le Gouvernement est engagé dans la lutte contre l’inflation des normes, j’en viens à la proposition de loi que nous examinons cet après-midi.
La loi du 17 octobre 2013 a prévu que le CNEN pouvait évaluer des normes en vigueur, de manière volontaire ou sur demande du Gouvernement, des commissions permanentes des assemblées, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le décret du 30 avril 2014 encadre cependant strictement les demandes émanant des collectivités territoriales par des conditions de recevabilité. Cela a été rappelé par Jean-Pierre Sueur, notamment.
Votre proposition de loi vise à renforcer l’action du CNEN de différentes façons : d’abord, en supprimant les conditions de recevabilité de la saisine des collectivités prévues par le décret ; ensuite, en élargissant la saisine à tout parlementaire ; enfin, en prévoyant que l’évaluation d’une norme par le CNEN s’effectuera sur la base d’une analyse réalisée par l’administration compétente, dans un délai fixé à trois mois.
Le Gouvernement partage ces préoccupations : il faut permettre un accès plus facile des élus au CNEN et créer les conditions d’un examen approfondi des propositions. Il convient toutefois d’éviter un engorgement qui nuirait à l’efficacité du dispositif.
Je le dis à nouveau : le décret du 30 avril 2014 portant application de la loi a organisé les conditions de recevabilité pour la saisine du CNEN en encadrant strictement les demandes, qui doivent porter sur des dispositions clairement identifiées d’une norme, avec des motifs précisément étayés et une présentation par un nombre d’élus minimum – présidents de conseil régional, présidents de conseil départemental, maires, etc. Les raisons de ces nombreuses conditions étaient d’éviter un engorgement du CNEN, qui ne pourrait répondre à un afflux de demandes. À l’usage, ces conditions apparaissent trop restrictives et de nature à restreindre l’accès des collectivités au CNEN, ce qui est contraire à notre objectif que je viens de rappeler d’un accès facilité des élus à ce conseil national afin que des normes jugées inutiles, mal calibrées ou trop coûteuses puissent être évaluées par celui-ci.
La proposition de loi que nous examinons cet après-midi vise notamment à supprimer les conditions de recevabilité de la saisine des collectivités prévues par le décret. La question de l’intervention du législateur dans le domaine réglementaire se pose par conséquent, et je sais qu’elle a donné lieu à des échanges nourris lors de l’examen de ce texte par votre commission.
Jean-Pierre Sueur vient d’évoquer la possibilité pour le Gouvernement de modifier ce décret. Eh bien, je vous annonce que je suis prêt à aller dans ce sens, …
… avec l’accord du Premier ministre, et je m’engage à ce que cette modification intervienne le plus rapidement possible, après un travail mené avec le CNEN – je m’en suis entretenu la semaine dernière avec Alain Lambert – et en prenant en compte nos débats de ce jour.
J’en viens à la question des flux.
La proposition de loi fait écho à la volonté du Gouvernement d’affirmer le rôle central du Conseil national d’évaluation des normes dans la maîtrise des flux des normes applicables aux collectivités locales. Je veux vous indiquer à cet égard que cette maîtrise est encore renforcée depuis la circulaire du Premier ministre du 9 octobre dernier, qui fixe un objectif très clair : zéro euro de charge supplémentaire pour les collectivités territoriales du fait des normes nouvelles, à compter du 1er janvier 2015.
Votre proposition de loi vise à apporter trois modifications à la loi du 17 octobre 2013, qui a étendu le champ d’action du CNEN.
Premièrement, vous souhaitez préciser que le contrôle du CNEN se fera uniquement sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique et financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cela devrait permettre effectivement de réduire le nombre de textes qui lui sont soumis.
Deuxièmement, vous souhaitez encadrer la procédure d’urgence pour l’examen du CNEN. Plutôt qu’une modification législative de cette procédure, nous souhaitons poursuivre les échanges avec celui-ci pour que l’examen des projets de loi se fasse dans de bonnes conditions.
Troisièmement, vous souhaitez rendre obligatoire son avis sur les projets de règlements des fédérations sportives soumis à la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Les règlements des fédérations sportives sont en effet une source non négligeable de normes nouvelles pour les collectivités locales, qui sont les premiers financeurs publics du sport en France. Il faut maîtriser ce flux. Néanmoins, le dispositif a été modifié en 2013, notamment avec l’attribution de la présidence de la CERFRES à un élu local. Par ailleurs, le dispositif actuel permet au CNEN d’intervenir sur une instruction détaillée et une appréciation motivée des élus de la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Inverser l’ordre des saisines aurait donc des inconvénients.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je conclurai sur une note positive. Les résultats pour 2014 et ceux du début de l’année 2015 en matière de maîtrise des flux sont encourageants : 1, 6 milliard d’euros de charges nouvelles en 2013 – c’était beaucoup –, 800 millions d’euros en 2014 et seulement, si j’ose dire, 19 millions d’euros au 22 avril 2015. C’est dire si la décroissance est forte, mais nous devons aller plus loin, plus vite, plus fort.
La proposition de loi que vous examinez participe de cette mobilisation nécessaire pour réduire l’inflation normative, et le Gouvernement, qui en fait une priorité, se réjouit de votre démarche.
Applaudissements.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par MM. Bockel et Pointereau s’empare fort judicieusement de l’inflation normative qui paralyse l’action dans notre pays. Je les en remercie très sincèrement, ainsi que le rapporteur Jean-Pierre Sueur.
Jean-Étienne-Marie Portalis, père du code civil, qui veille sur nous, disait déjà en son temps que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Il nous faudrait ériger ces propos en précepte absolu. Car, si des règles sont évidemment indispensables pour assurer la sécurité et réguler la vie en société, force est de constater que leur accumulation finit par en détraquer le fonctionnement !
Notre époque nécessite souplesse, réactivité, inventivité, adaptabilité, tandis que l’accumulation de règles constitue des freins à l’action et génère complexité, lenteur et surcoût. Beaucoup d’exemples le montrent : des normes sur les vestiaires de foot entraînent dans une ville un déclassement d’un stade de foot, interdit aux matches de CFA parce qu’il faut deux vestiaires d’arbitre de 8 mètres carrés chacun, alors que ce stade dispose de deux vestiaires, l’un de 9, 5 mètres carrés et l’autre de 7 mètres carrés.

Ou encore, comble du comble, un décret de 2011 signé par quinze ministres sur les normes nutritionnelles de restauration scolaire définit notamment la quantité hebdomadaire d’œufs durs selon l’âge de l’enfant ou la température à laquelle doit être servie la macédoine.
Cette inflation de normes touche aussi les entreprises. Je citerai un seul exemple : la nécessité de solliciter l’autorisation de quinze administrations pour ouvrir une simple carrière de pierres.
Cette surenchère normative est un obstacle à l’initiative, à l’efficacité de l’action publique, a fortiori, vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d'État, dans un contexte de crise économique et de baisse des ressources des collectivités. Cette surenchère normative est aussi source de perplexité et de risque pour les élus. En effet, comment hiérarchiser deux normes incompatibles, par exemple en matière de sécurité incendie dans les crèches ou les unités Alzheimer, où il faut s’assurer de l’impossibilité de sortie intempestive des enfants ou des résidents alors même qu’il est nécessaire de disposer d’issues de secours ouvrables à tout moment ?
Aujourd’hui, 400 000 normes réglementaires s’imposent aux collectivités locales et les enferment dans un coûteux carcan juridique. En quatre ans, de 2011 à 2015, le coût induit par les normes nouvelles serait évalué à plus de 1 milliard d’euros.
Je veux saluer ici l’excellent travail de nos collègues Mme Gourault et M. Sueur à l’initiative de la loi de 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes, qui a pour mission, cela a été rappelé, d’intervenir sur le flux et le stock des normes. Il convient aussi de rappeler l’excellent rapport de MM. Lambert et Boulard, rédigé en 2013, qui décrit l’absurdité de ce qu’ils appellent « l’incontinence normative » – ce terme me semble assez juste –, ainsi que le travail de notre collègue Éric Doligé sur ce sujet en 2011.
Oui, mes chers collègues, votre proposition de loi satisfera certainement de nombreux élus locaux confrontés au maquis d’une réglementation qui les désespère trop souvent et les dépasse parfois ! Elle contient quatre mesures significatives.
La première vise à simplifier et à élargir les possibilités de saisine du Conseil national d’évaluation des normes. En ce sens, elle restitue l’esprit initial du législateur. Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, mais aussi les parlementaires pourront saisir ce conseil national sans condition de nombre et sur simple motivation, alors que le décret d’application de la loi exige une saisine émanant d’au moins cent maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La deuxième mesure positive consiste à renvoyer à l’administration la charge de la preuve de la pertinence de la norme qui pesait sur l’auteur de la saisine. Sur ce point, je ne peux m’abstenir de vous faire part de mon étonnement de jeune sénatrice sur la nécessité de devoir corriger par une proposition de loi un décret d’application contraire à l’esprit du législateur. Disons-le franchement, le décret du 30 avril 2014 a totalement détourné les conditions de saisine voulues par le législateur, …

Mme Françoise Gatel. … mais peut-être manque-t-il dans l’arsenal normatif français une norme sur la rédaction des décrets d’application...
Sourires.

La troisième mesure positive vise à améliorer les conditions de fonctionnement du Conseil national d’évaluation des normes en encadrant la procédure d’urgence ; M. le rapporteur l’a déjà évoquée.
Enfin, la quatrième mesure – un vrai bonheur ! – porte sur les normes sportives.
L’agacement des élus locaux est extrême par rapport à ce pouvoir normatif des fédérations, qui confère à celles-ci des prérogatives de puissance publique inacceptables. Le texte que nous examinons va permettre de transformer une exception en règle, à savoir la consultation du Conseil national d’évaluation des normes sur tous projets de règlements fédéraux relatifs à des équipements sportifs, préalablement à la consultation de la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Nos collectivités ne peuvent en effet être condamnées à rester de simples exécutantes de prescripteurs qui ne sont pas les financeurs de leurs prescriptions.
En conclusion, au nom de l’adage « un homme averti en vaut deux », je saluerai la grande sagesse de la commission des lois, qui a supprimé la mention de la nécessité de décrets d’application, nous mettant ainsi à l’abri de nouvelles déconvenues.
Par cette proposition de loi, le Sénat confirme son rôle de représentant des collectivités. Il fait de la chasse à l’inflation normative un combat utile pour la qualité et l’efficacité de l’action publique. Cette proposition de loi salue aussi à juste titre l’excellent travail du Conseil national d’évaluation des normes en facilitant l’exercice de sa mission.
Vous l’aurez deviné, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe UDI-UC votera avec enthousiasme en faveur de ce texte, bel exemple de simplification que nous ne cessons tous d’appeler de nos vœux.
Applaudissements.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, sur l’initiative du président du Sénat, Gérard Larcher, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, présidée par notre collègue Jean-Marie Bockel, a reçu compétence, par une décision du bureau du Sénat de novembre dernier, d’évaluer et de simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales. En tant que vice-président de cette délégation, chargé de la simplification des normes, j’ai souhaité constituer un groupe de travail qui, depuis bientôt quatre mois, s’attelle à la maîtrise de la prolifération normative.
L’effort de simplification engagé par le groupe de travail ne pouvant aboutir sans l’appui des acteurs de terrain, la délégation aux collectivités territoriales a souhaité inaugurer sa nouvelle mission en invitant les élus locaux à répondre à une consultation en ligne à ce sujet à l’occasion de la dernière édition du congrès des maires. Quelque 4 200 contributions ont été recueillies, les trois quarts émanant de maires. Elles ont permis d’identifier les secteurs dont la simplification est jugée prioritaire par les élus locaux : l’urbanisme, pour plus de 60 % d’entre eux ; l’accessibilité, à hauteur de plus de 30 % ; l’achat public et l’environnement, autour de 20 % chacun. En outre, 900 commentaires ont été apportés. Ils sont riches d’enseignements sur l’état d’exaspération des élus face à des normes qui freinent l’action et grèvent les finances des collectivités territoriales.
Fort de ce constat, la délégation aux collectivités territoriales a entendu agir sur le flux de normes ; le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a constitué pour elle une parfaite entrée en matière. Aussi la délégation a-t-elle confié à mon collègue Philippe Mouiller et à moi-même la rédaction d’un rapport sur les dispositions de ce projet de loi applicables aux collectivités territoriales. Au total, huit propositions avaient été satisfaites à l’issue des travaux des commissions saisies au fond, deux amendements ont en outre été adoptés en séance publique. Si ces résultats encore modestes ne sont pas à la hauteur de nos espérances, notre intervention aura au moins permis de faire de la complexité normative un élément incontournable du débat législatif.
Parce qu’il est essentiel de poursuivre cet effort, j’entends défendre quelques propositions de simplification à l’occasion de l’examen au Sénat du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Mais il importe aujourd’hui d’aller plus loin, en se penchant non sur le flux, mais sur le stock de normes. La délégation aux collectivités territoriales prendra toute sa part dans ce travail de simplification du droit en vigueur. Je souhaite d’ailleurs présenter à l’automne prochain quelques pistes de simplification en matière d’urbanisme et d’aménagement, afin de répondre de manière concrète et ciblée aux préoccupations qui ont été exprimées par les élus locaux. Pour ce faire, je m’appuierai sur l’excellent travail de notre collègue Éric Doligé en ce domaine.
La délégation aux collectivités territoriales ne peut, à elle seule, faire avancer le chantier de la simplification du stock de normes ; le Conseil national d’évaluation des normes doit également pouvoir y contribuer pleinement, à condition – j’y insiste – qu’on lui donne des moyens humains et financiers plus importants pour exercer sa mission. Or, comme cela a été rappelé, le décret du 30 avril 2014 pris en application de la loi du 17 octobre 2013 est venu encadrer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent demander au Conseil national d’évaluation des normes d’évaluer une norme réglementaire en vigueur et a rendu impraticable la saisine du CNEN par ces dernières. En résulte une situation paradoxale : les élus locaux sont largement exclus d’un outil que le législateur avait pourtant créé à leur attention, à la suite des états généraux de la démocratie territoriale de 2012. À l’époque, on parlait du « choc de simplification » !
Il est regrettable que la proposition de loi de nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, qui, rappelons-le, fut adoptée dans un fort esprit de consensus au Sénat et dont la lettre est pourtant claire – elle tient en deux articles –, ait vu sa portée ainsi amoindrie. C’est pour remédier à cette situation que nous avons souhaité avec le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Jean-Marie Bockel, présenter la proposition de loi simplifiant les conditions de saisine du CNEN dont nous débattons aujourd’hui.
Le texte qui résulte des travaux de la commission des lois améliore indéniablement la proposition de loi initiale. Il résout en particulier de façon plus efficace la difficulté résultant de l’exigence, imposée par le décret du 30 avril 2014 à l’auteur d’une saisine, de produire une fiche d’impact de la norme contestée. Si l’on admet volontiers que l’auteur d’une saisine ait l’obligation de la motiver, il incombe en revanche à l’administration à l’origine de la norme, et non à l’auteur de la saisine, d’apporter au CNEN les éléments techniques et financiers nécessaires à la conduite de l’évaluation. Dans la mesure où l’administration a réalisé une étude d’impact avant l’édiction de la norme, il est logique qu’elle en mesure également les conséquences a posteriori.
Cette modification de bon sens est de nature à simplifier la faculté pour les collectivités territoriales de saisir le CNEN, les plus petites communes ne disposant souvent pas des moyens humains et des ressources juridiques suffisants pour produire une fiche d’impact étayée. Elle est également susceptible de faciliter l’exercice par le CNEN de sa mission d’évaluation des normes réglementaires, puisque les rapporteurs qu’il désigne afin d’instruire les demandes et d’élaborer un projet d’avis ne bénéficient pas toujours d’une information complète et de qualité. C’est pourquoi il est légitime d’attribuer à l’administration, dans le déroulement de la procédure d’évaluation, une « charge de la preuve » de la qualité et de l’efficacité de la norme. On ne peut donc qu’approuver la formulation adoptée sur ce point par la commission des lois visant à inverser la charge de la preuve vers l’administration.
Le texte issu des travaux de la commission des lois complète également la proposition de loi initiale en matière de normes relatives aux équipements sportifs, à la suite de l’adoption de l’un de mes amendements. Ces dispositions, dont l’incidence financière est souvent élevée, sont une source d’inflation normative bien connue des élus locaux.
Alors que la gestion des équipements sportifs est assurée à hauteur de 85 % par les collectivités territoriales – cette participation financière est donc très importante –, ces normes sont soumises non à l’avis du CNEN, mais à celui d’une structure dédiée que vous avez évoquée, monsieur le secrétaire d’État, à savoir la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Un lien existe tout de même entre ces deux instances, puisque la CERFRES peut soumettre, sur décision de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres, certains projets de normes à l’avis préalable du CNEN. Mais c’est rarement le cas ! Aussi est-il justifié que la remise d’un avis par le CNEN, préalablement à celui de la CERFRES, ne soit plus l’exception mais devienne la règle. On ne peut que souscrire à la disposition adoptée sur ce sujet par la commission des lois. Il y aura donc désormais un double avis.
Si ces deux avancées sont appréciables et compléteront utilement la procédure d’instruction et le champ de compétences du CNEN, le texte proposé par la commission de lois pourrait néanmoins être amélioré sur deux points précis, sur lesquels j’ai déposé des amendements.
Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi introduisait la possibilité de confier aux associations d’élus locaux le droit de saisir le CNEN sur le stock de normes. La possibilité d’une saisine par les associations d’élus me paraît indispensable, puisque celles-ci disposent d’une connaissance des problématiques locales et de moyens d’expertise juridique qui font d’elles des acteurs incontournables de la lutte contre l’inflation normative. Cette saisine aidera le Conseil national d’évaluation des normes à gérer rationnellement l’afflux éventuel de saisines dispersées. C’est pourquoi j’ai souhaité déposer un amendement au texte de la commission, afin de rétablir pour les associations nationales la possibilité d’adresser une demande d’évaluation au CNEN.
Un autre changement intervenu à l’occasion de l’examen du texte en commission est l’inscription, dans le code général des collectivités territoriales, d’un alinéa indiquant que « les demandes d’évaluation sont motivées ». Bien que la codification de cette obligation de motivation ne pose pas problème en soi, elle ne doit pas être perçue pour autant comme un obstacle à la saisine du CNEN par les collectivités territoriales. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement visant à préciser que cette motivation est « succincte », pour éviter qu’elle ne devienne un pensum.
Je forme le vœu que ces deux amendements aient une issue favorable. Les collectivités territoriales attendent que l’effort de simplification, dont tout le monde reconnaît la nécessité, aboutisse à des résultats concrets et visibles sur le terrain. Je sais, monsieur le secrétaire d’État, pour vous avoir auditionné, que vous souhaitez ardemment avancer dans cette voie. Faisons donc du Sénat le moteur de la simplification des normes !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est souvent reproché aux écologistes d’avoir un goût immodéré pour la norme. Force est de l’admettre, il s’agit fréquemment du seul outil dont on dispose pour protéger ce bien commun qu’est l’environnement. Parce que tout le monde peut utiliser ce bien commun pour son profit individuel, il est indispensable que des règles collectives, en l’occurrence souvent des normes, en régulent l’exploitation afin d’en préserver la qualité.
Ce rappel étant fait, je souligne que les normes dont nous débattons aujourd’hui ne s’inscrivent pas réellement dans ce cadre. Elles s’appliquent non pas directement à l’environnement mais aux collectivités territoriales en général. En outre, elles procèdent moins d’une régulation collective que d’une mécanique de gestion administrative et juridique de plus en plus complexe. Y compris dans ce contexte, la norme n’est pas, par principe, un mal à bannir. Elle peut permettre de rationaliser certaines procédures, d’uniformiser des pratiques trop discordantes, de mieux assurer la sécurité de nos concitoyens, voire de protéger les élus locaux dans l’exercice de certaines responsabilités juridiques délicates.
Cela étant, le constat est, aujourd’hui, assez largement partagé : l’usage des normes applicables aux collectivités territoriales est, hélas ! devenu déraisonnable. Certaines normes sont superfétatoires, d’autres sont disproportionnées, et leur volume incontrôlé entrave le respect du principe de subsidiarité, selon lequel toute décision publique doit être prise à l’échelon le plus bas possible. Je ne vous cache pas que les écologistes sont également très attachés à ce principe.
Les précédents orateurs l’ont rappelé, les travaux du Sénat ont, depuis longtemps, fort utilement documenté ce problème. Ils ont également contribué à le résoudre, par la création, en 2008, de la Commission consultative d’évaluation des normes. Toujours sur l’initiative du Sénat, la CCEN a été transformée, via une proposition de loi de 2013, en une instance à l’ambition et aux pouvoirs élargis : le Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
En portant le regard extérieur qui le caractérise sur l’impact et l’intérêt des normes applicables aux collectivités, le CNEN permet d’amorcer un tri entre le bon grain et l’ivraie, non seulement dans les projets de normes mais aussi dans le foisonnement de normes déjà instaurées. Mais, car il y a un « mais », le décret auquel renvoyait la proposition de loi de 2013 a fixé des modalités de saisine restrictives.
Premièrement, les collectivités requérantes ont pour obligation d’asseoir leur saisine sur des « motifs précisément étayés », qu’elles n’ont pas forcément les moyens et l’expertise d’établir.
Deuxièmement, et surtout, elles sont tenues de réunir pour toute saisine au moins cent maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale, ou dix présidents de conseil général, ou deux présidents de conseil régional – en tant que telles, les équivalences établies entre les différents niveaux de représentation ne manquent pas d’intérêt…
Or ces limites à la saisine du CNEN ont été introduites dans le décret d’application sans aucune référence à l’esprit qui avait présidé aux travaux du législateur. On se heurte, de ce fait, à une difficulté de principe à laquelle nous nous trouvons très souvent confrontés. Les limites respectives des domaines de la loi et du règlement, définis par les articles 34 et 37 de la Constitution, sont de fait assez floues. Ainsi, l’exécutif a beau jeu, au cours des débats parlementaires, d’exciper de l’exclusivité de son pouvoir réglementaire pour conserver une marge de manœuvre, dont cette discussion permet de constater qu’elle peut être utilisée à mauvais escient. Il me semble donc important que le Parlement ose affirmer son pouvoir de législateur, même lorsque sa volonté trouve sa concrétisation dans des mesures situées au confluent des domaines de la loi et du règlement.
J’en reviens au fond des dispositions qui nous sont soumises.
La présente proposition de loi vise à revenir sur ces limitations, fixées par décret, à la saisine du CNEN. Toutefois, comme l’a fait remarquer le président de cette instance, Alain Lambert, il convient de veiller à ce que l’assouplissement des conditions de saisine du CNEN ne conduise pas à son engorgement rapide. Plusieurs mesures allant en ce sens ont donc été introduites en commission, cette fois par le législateur.
Tout d’abord, le champ de saisine du Conseil national d’évaluation des normes a été limité aux textes réglementaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités locales.
Ensuite, une motivation « simple », et non plus « précisément étayée », a été préservée pour toute saisine.
En outre, une analyse peut désormais être commandée par le CNEN à l’administration qui est l’origine de la norme, de telle sorte que sa création, et non plus sa suppression, soit justifiée.
Enfin, la proposition de loi limite le recours aux saisines en urgence du Conseil national d’évaluation des normes et, même pour ces procédures d’urgence, elle impose des délais incompressibles plus raisonnables que ceux actuellement en vigueur. Osons le dire : le Parlement lui-même est malheureusement habitué à ces délais déraisonnables, qui lui sont bien souvent imposés pour délibérer sur des projets de loi, alors même qu’il y a très peu de véritables urgences législatives. J’ai encore à l’esprit l’exemple du CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont la création engageait la bagatelle d’une vingtaine de milliards d’euros et qui fut introduit au Parlement par un amendement du Gouvernement, déposé séance tenante sur un projet de loi de finances rectificative...
Les membres du groupe écologiste voteront naturellement la proposition de loi émanant des groupes UDI-UC et UMP, pour la simple et bonne raison qu’elle contient des mesures positives. Reste que j’ai entendu les propos de M. le secrétaire d’État, et je note son intention de nous aider à aller plus vite, en rectifiant le décret. L’unanimité qui semble se dessiner dans cet hémicycle en faveur de cette proposition de loi permettra au Gouvernement, lors de la réécriture de ce décret, de ne plus oublier ce qu’est l’esprit d’un texte voté par le législateur.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et de l’UDI-UC.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis des années, les conséquences de la prolifération normative et de l’insécurité juridique qui en résulte nourrissent un flot croissant de critiques. Nous dressions déjà ce constat en 2013. Aujourd’hui, nous observons que les textes qui nous sont soumis ont de plus en plus d’articles. Le projet de loi Macron, dont nous venons d’achever l’examen, en compte près de 300. Le projet de loi NOTRe, qui, comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, reviendra mardi prochain en deuxième lecture dans cet hémicycle, n’échappe pas à la règle, même s’il ne tombe pas dans cet excès. N’oublions pas non plus les projets de loi de simplification du droit. Ces textes, qui visent à mettre un terme à l’inflation législative, pourraient être résumés par cette formule : pour faire moins de normes, faisons plus de normes !
Ces législations infligent aux collectivités territoriales des obligations toujours plus nombreuses. Ces dernières se traduisent par autant de coûts supplémentaires ou d’allongements des délais de procédure. Néanmoins, cette inflation normative ne nous semble pas due, comme l’indique le rapport, au seul « zèle normatif » des administrations centrales et déconcentrées de l’État, un zèle qui serait fondé sur une « croyance inconditionnelle » dans la capacité des normes à « améliorer l’intérêt général ». Cette vision caricaturale minimise l’exigence de clarté du droit figurant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il n’y a pas de « volonté perverse de quelques administrateurs » mais une volonté de l’ensemble des fonctionnaires, quel que soit le service auquel ils appartiennent, de bien faire, de produire la norme la meilleure, et ce au service de la sécurité juridique.
Nous approuvons la création du CNEN. Toutefois, même si sa saisine est élargie, cette instance ne suffira pas à desserrer l’étau normatif dans lequel les collectivités territoriales sont prises.
Nous l’avons déjà dit lors des débats de 2013 : nos concitoyens exigent toujours plus de sécurité, au sens large du terme. Ces attentes sont elles-mêmes alimentées par des peurs, lesquelles sont entretenues par des discours alarmistes et catastrophistes. Cette demande de sécurité émise par les citoyens est relayée par les pouvoirs publics, lesquels se font l’écho des inquiétudes de la population par l’adoption de nouvelles normes. J’ajoute que les médias ont, en la matière, leur part de responsabilité. Que ce soit dans la presse écrite ou dans les émissions télévisées, cette interrogation est omniprésente : « Mais que font les pouvoirs publics ? » À chaque instant, pour chaque incident de la vie, on exige que l’action publique garantisse davantage de sécurité, ce qui incite à aller toujours plus loin sans jamais revisiter l’existant.
Toutefois, les normes ne sont pas seules en cause dans la perte de liberté des autorités locales. Un autre facteur, ne relevant ni de la loi du 17 octobre 2013 ni de la présente proposition de loi, est la multiplication des cartes, des schémas et autres découpages du territoire.

Nous évoquerons de nouveau cette question la semaine prochaine.
La multiplication des schémas, par exemple, a pour effet de renforcer les obligations et les interdictions, qui, même si elles sont sans incidences financières directes, accentuent la perte de liberté locale en imposant des contraintes dans tous les domaines.

Enfin, comment assurer la simplification administrative attendue sans amoindrir la légitimité de l’action publique, placée « au service d’une société solidaire et de progrès » ?
Ne perdons jamais de vue que, si la norme peut être contraignante à l’égard des uns, elle peut protéger les autres à plus long terme. Parallèlement, nous devons garantir les moyens nécessaires à la mise en œuvre des normes : faute de quoi nous risquons d’aggraver les inégalités dans nos territoires.
Tel est le difficile équilibre qu’il nous faut systématiquement chercher à atteindre. Telle est la problématique à laquelle nous devons répondre.
Les difficultés auxquelles les élus locaux se heurtent au quotidien sont réelles, mais leur exacerbation est, en grande partie, liée à l’insuffisance des moyens financiers dont disposent les collectivités. De surcroît, comme nous l’avions indiqué lors de la création du CNEN, cette évolution est due au retrait de l’État et à la disparition de son soutien technique dans nos départements, depuis la mise en œuvre de la RGPP, la révision générale des politiques publique. En effet, si les collectivités sont en difficulté, ce n’est pas tant à cause de la prolifération législative que du fait du désengagement de l’État, lequel prend diverses formes : suppression de dotations et de subventions, transferts de compétences aux collectivités sans compensation financière pleine et entière, etc. De nombreuses communes sont confrontées à la complexité technique des projets qu’elles ont à mener. Alors que les fonctionnaires de l’État pouvaient jouer un rôle de conseil, de contrôle et d’orientation, les communes se sont retrouvées seules. Aujourd’hui, les directions territoriales de l’État ne peuvent plus répondre aux demandes des collectivités.
La présence de l’État s’est réduite, mais le besoin d’accompagnement et de conseil qu’éprouvent les maires n’a pas diminué pour autant. Ce retrait de l’État a été opéré au bénéfice de consultants, plus ou moins aguerris et formés, d’agences privées qui prolifèrent et facturent, bien entendu, tous les services qu’elles rendent. Le coût des projets s’en trouve renchéri, au titre de l’investissement comme des frais de fonctionnement, les temps d’études rallongés, favorisant la « réunionnite », et l’exacerbation des élus locaux accentuée.
C’est en rendant aux collectivités territoriales les moyens de faire face aux exigences législatives que nous ferons disparaître la principale source du problème – la principale mais non la seule, j’insiste sur ce point. La prolifération législative est réelle, et la concertation et l’alerte sont les meilleurs remèdes contre l’empilement des normes.
J’en reviens plus précisément à la proposition de loi dont nous débattons et qui porte, essentiellement, sur les modalités de saisine du CNEN.
Nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer, nous reconnaissons que des progrès significatifs ont été accomplis au cours des dernières années, notamment grâce au CNEN et à la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs – je ne reviendrai pas sur la question des paniers de basket-ball, dont nous avons déjà longuement débattu… Ces instances ont permis de faire évoluer les méthodes de travail des administrations centrales. Désormais, ces dernières s’interrogent davantage sur l’utilité des textes qu’elles produisent et évaluent les conséquences techniques et budgétaires des prescriptions qu’elles énoncent.
Dès lors, nous souscrivons pleinement à la nécessité de rappeler la faculté de saisine du CNEN par toute collectivité territoriale et par tout EPCI. Nous soutenons l’élargissement de la saisine à l’ensemble des parlementaires et aux associations d’élus, de même que la suppression de toute mention d’un décret d’application, le décret ayant outrepassé l’intention du législateur.

De même, nous approuvons les précisions apportées quant à la motivation des avis du CNEN et à l’encadrement du recours à la procédure d’urgence. Ces dispositions permettront de renforcer le rôle d’expertise et d’alerte du Conseil national d’évaluation des normes.
Néanmoins – je l’ai indiqué en ouvrant mon intervention –, gardons à l’esprit que, derrière le rejet des normes par les élus, se cache la difficulté de mise en œuvre de l’action publique au sein des territoires. Comme en 2013, nous devrons veiller à ce que les recommandations du CNEN n’aboutissent pas à une forme de déréglementation ou de dérégulation, qui conduirait à reléguer les objectifs d’accessibilité ou de sécurité, les normes sanitaires ou de protection de l’environnement.
Ces réserves étant émises, j’indique que les membres du groupe CRC voteront la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et de l’UDI-UC.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, une proposition de loi pour simplifier la saisine du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, c’est le comble du comble. Voilà où nous mène l’édiction de décrets d’application qui vont au-delà de la loi et l’interprètent à leur façon !
Ces décrets, qui méconnaissent l’esprit de la loi, sinon sa lettre, s’apparentent à l’élaboration d’une véritable loi administrative. Ce genre de pratique de l’administration ne devrait pouvoir se répéter encore à l’infini. Aujourd’hui, notre assemblée est contrainte de se pencher de nouveau sur un sujet dont elle a déjà débattu, sur lequel le Parlement s’est prononcé et dont la lettre comme l’esprit avaient été fixés par les débats parlementaires. Si la Ve République a mis en place des mécanismes de parlementarisme rationalisé, peut-être faudra-t-il penser à mettre en œuvre des mécanismes d’administration rationalisée !
Nous avons déjà, lors des cinq lois de simplification qui se sont succédé depuis 2012, soulevé le fait que c’est le plus souvent le fonctionnement de l’administration qui est en cause, du fait de rigidités structurelles, de certains comportements ancrés dans la pratique et même, pourrait-on dire, d’un certain esprit administratif. Une grande majorité des 900 propositions de simplification contenues dans le programme pluriannuel qui met en œuvre le choc de simplification est d’ordre réglementaire. C’est, par exemple, largement le cas en matière d’environnement, d’urbanisme, de fiscalité et de déclarations des entreprises. Ces dernières doivent plusieurs fois par an communiquer leur chiffre d’affaires, leur respect des normes environnementales ou paritaires, tout cela du fait de l’administration !
Au même titre que les acteurs économiques, les collectivités territoriales sont affectées par le fléau de l’inflation normative. Le seul code général des collectivités territoriales compte 3 500 pages, et ce n’est pas, loin s’en faut, l’unique code applicable dans les collectivités locales : il faut y ajouter le code électoral, le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement, le code de la fonction publique… Selon le rapport de M. Belot, « les 163 projets de normes de l’État qui ont donné lieu à une évaluation en 2009 représentaient plus de 580 millions d’euros [...] ; pour 2010, le coût des 176 projets évalués représentait 577 millions ». Il faut aussi rappeler l’impact financier pour les collectivités territoriales des décrets d’application de la loi Grenelle 2, qui a nécessité plus de 250 décrets et arrêtés. Espérons que la future loi relative à la transition énergétique n’aura pas les mêmes effets dommageables. En tout cas, nous sommes sans illusion sur les effets sur nos collectivités de la « clarification » des compétences qu’opère l’actuelle réforme territoriale.
Le Conseil national d’évaluation des normes est issu d’une proposition de loi sénatoriale déposée en novembre 2012 sur l’initiative de nos excellents collègues Jacqueline Gourault, qui préside ce soir la séance, et Jean-Pierre Sueur, qui siège aujourd’hui au banc de la commission. De façon emblématique, comme le souligne l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, le décret portant application de la loi du 17 octobre 2013 méconnaît l’objectif de simplification que cette loi portait. A contrario de la volonté du législateur, ce décret multiplie les conditions de saisine. Il impose, pour qu’une demande d’évaluation soit examinée, la signature d’au moins cent maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale, ou de dix présidents de conseil général, ou de deux présidents de conseil régional, mais aussi la réalisation d’une fiche d’impact présentant entre autres éléments « ses motifs précisément étayés ».
Autant dire que la loi est vidée de sa substance et que le décret d’application fait du Conseil national d’évaluation des normes une simple coquille vide. Autant dire que l’administration craignait des saisines intempestives de la part des élus et tenait à limiter au maximum l’exercice de ce droit créé par la loi. Cette complexification inexpliquée de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes montre une certaine défiance envers les élus locaux. Nous saluons donc l’initiative de nos collègues Jean-Marie Bockel et Rémy Pointereau en même temps que nous déplorons d’être obligés d’y recourir. La navette parlementaire devra être succincte et diligente, puisque nous avons déjà débattu à plusieurs reprises de ce sujet.
Le groupe du RDSE votera à l’unanimité le présent texte. Nous espérons ainsi pouvoir faire mentir la définition humoristique que donnait de l’administration l’économiste Georges Elgozy : « Mot femelle qui commence comme admiration et finit comme frustration ».
Applaudissements sur les travées de l’UMP, de l’UDI-UC et du groupe écologiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les élus des collectivités locales se plaignent depuis longtemps de l’inflation des textes normatifs. Rappelons d’abord que nombre de normes sont justifiées par des raisons tenant, par exemple, à la sécurité, à la santé ou à la préservation de l’environnement. Toutefois, à côté de ces normes nécessaires, d’autres sont plus discutables ou, du moins, leur nécessité peut être remise en cause. Ainsi, beaucoup d’élus se sont plaints de l’édiction de nouvelles normes en matière sportive qui imposent aux communes de modifier les panneaux d’affichage des résultats pour que leur stade soit homologué et puisse accueillir des compétitions d’un certain niveau. De telles décisions peuvent paraître judicieuses aux associations ou aux instances qui les ont prises, mais elles induisent des coûts qui s’imposent aux élus et pèsent sur les contribuables. Autrement dit, si certaines normes sont indispensables, d’autres ne le sont pas et leur mise en œuvre peut très légitimement donner lieu à des discussions au regard des contraintes et coûts qu’elles induisent.
Lors des états généraux de la démocratie territoriale qui ont été organisés au Sénat en 2012 sur l’initiative de Jean-Pierre Bel, alors président de notre assemblée, deux points majeurs sont apparus. Ils reflétaient les préoccupations de milliers d’élus qui, dans chaque département de France, avaient participé à ces états généraux. Le premier concernait les conditions d’exercice des mandats locaux, ce qu’il est convenu d’appeler le statut de l’élu ; le second avait précisément trait aux normes applicables aux collectivités locales. Il fut alors demandé à deux de nos collègues – Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur – d’élaborer des propositions de loi susceptibles de faire évoluer les choses sur ces deux points.
Le premier de ces deux textes, la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, a enfin été adopté en seconde lecture à l’Assemblée nationale, après une trop longue attente. Une commission mixte paritaire a eu lieu. Le texte a été promulgué, et la loi est aujourd’hui en vigueur.
Le second texte, la proposition de loi portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, a été adopté plus rapidement. Il accorde des pouvoirs plus étendus à ce conseil national qu’à l’instance qui existait précédemment. Il lui donne mission d’étudier l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires instituant des normes applicables aux collectivités locales. Ainsi, c’est en amont que de nouvelles normes éventuelles sont étudiées par une instance représentative des élus locaux qui peut faire toute observation utile quant à l’opportunité des projets de normes eu égard aux coûts et aux contraintes qu’elles sont susceptibles d’induire. De surcroît, le Conseil national d’évaluation des normes peut se saisir non seulement des normes qu’il est prévu d’édicter, mais aussi du stock des normes en vigueur dans les lois ou les textes à caractère réglementaire.
Les sénateurs, qui représentent, selon la Constitution, les collectivités territoriales de la République, se sont, à juste titre, réjouis de la promulgation de ce texte, qui avait d’ailleurs été adopté par notre assemblée à l’unanimité. Or il se trouve que le décret publié pour appliquer cette loi n’a respecté, comme cela a déjà été très bien dit par les orateurs précédents, ni l’esprit ni la lettre de la loi votée. Ainsi, aux termes de ce décret, pour que le Conseil national d’évaluation des normes puisse être saisi d’une ou de plusieurs normes prévues ou existantes, il faut que cent maires soient cosignataires de la saisine, ou encore dix présidents de conseil général – aujourd’hui conseil départemental – ou deux présidents de conseil régional. Ni la proposition de loi ni le texte voté au Sénat ne prévoyaient une telle disposition, qui n’a pas même été évoquée au cours des débats parlementaires. Ce décret fixe donc des conditions bien plus restrictives que le législateur ne l’a souhaité pour la saisine du CNEN.
C’est donc à bon droit que nos collègues Jean-Marie Bockel et Rémy Pointereau ont déposé une proposition de loi tendant à inscrire dans la loi que chaque commune, quelle que soit sa taille, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque département, chaque région pourra saisir directement le CNEN. Je tiens à dire ici que le groupe socialiste soutient pleinement cette initiative, qui vise à faire respecter ce que le législateur a voulu.

De même, notre groupe soutient les autres modifications au texte de la proposition de loi qui ont été proposées par le rapporteur et approuvées par la commission des lois. Il faut éviter d’engorger le CNEN, qui est aujourd’hui saisi obligatoirement de tout texte réglementaire relatif aux collectivités locales. Il est donc logique qu’il ne soit saisi que des projets de textes réglementaires ayant un impact sur les normes.
Nous approuvons également les modifications proposées en matière d’examen d’un texte en urgence, sur l’initiative du Premier ministre. Nous ne méconnaissons pas l’urgence qui peut s’imposer pour des circonstances diverses, parfois graves, mais nous considérons que, en tout état de cause, un temps minimal doit être laissé au CNEN pour qu’il puisse s’acquitter correctement de sa mission.
Au total, il s’agit de dispositions pragmatiques. La prolifération de normes discutables et dont la nécessité ne s’impose pas peut porter tort aux normes qui, elles, sont indispensables. La démarche que met en œuvre la présente proposition de loi s’inscrit dans le droit fil de la proposition de loi élaborée par Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, dans le droit fil des conclusions des états généraux des collectivités territoriales et dans le droit fil des débats du Sénat. Il s’agit d’aider les élus locaux à accomplir leur mission. Ce faisant, le Sénat remplit pleinement la mission qui est la sienne, au service du bon fonctionnement de nos collectivités locales, et donc de notre République.
Applaudissements.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, « [les normes], sujet rituel du congrès des maires de France, où chaque année – j’imagine – l’État s’engage avec des formules incantatoires ! “Jamais plus, toujours moins”... Mais je sais aussi que le poids de ces normes est devenu invivable : 400 000, c’est un frein inacceptable à l’initiative et à la compétitivité ». Ainsi s’exprimait le Président de la République devant les élus locaux le 20 novembre 2012. On ne saurait mieux dire. Tous les élus locaux ont naturellement applaudi, emportés par la même adhésion.
Par ailleurs, je pourrais égrener la longue liste de rapports, au demeurant d’excellente qualité, faisant peu ou prou le même constat. Le diagnostic est donc fort ancien pour un mal pernicieux et qui s’accroît au fil des années.
L’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » a pris un sens involontairement ironique ou sarcastique. En effet, comment imaginer connaître toutes les lois, règlements et normes applicables dans un domaine donné ? Pis, malgré les aides en tous genres, les codes, la facilité numérique et un personnel mieux formé qu’autrefois, des interrogations accrues surgissent. On ne sait si telle norme est applicable ou non, ni quelle norme appliquer lorsque deux d’entre elles paraissent contradictoires.
Au bout du compte, il y a matière à réflexion lorsque l’on songe que les lois de décentralisation ont supprimé la tutelle administrative et la tutelle financière, mais pas la tutelle technique et normative. Cette contrainte se voit renforcée depuis peu par la crise économique et le contexte budgétaire tendu, en particulier pour les collectivités locales, qui doivent faire face à la réduction programmée des dotations de l’État.
Dans ce contexte contraint, le Conseil national d’évaluation des normes est un organisme indépendant dont la mission est notamment d’étudier l’impact technique et financier des projets de normes réglementaires, législatives et communautaires applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. II peut aussi se saisir de l’évaluation du stock de normes réglementaires en vigueur.
La loi du 17 octobre 2013 a prévu que le CNEN peut être saisi par les collectivités territoriales ou leurs groupements, le Gouvernement et les commissions permanentes des deux assemblées parlementaires. La proposition de loi qui nous occupe aujourd’hui vient utilement poser la question des conditions de saisine du CNEN. Le décret d’application, publié le 30 avril 2014, a en effet fixé des conditions draconiennes et plus restrictives que celles initialement prévues par la loi. La présente proposition de loi supprime donc ces exigences contraires à la position du législateur. Toute collectivité territoriale ou tout EPCI doit pouvoir saisir le CNEN. Cette saisine est par ailleurs élargie à l’ensemble des parlementaires et associations d’élus locaux qui pourront ainsi consulter le CNEN sur le stock de normes en vigueur. Enfin, la proposition de loi supprime le recours à des mesures d’application par décret.
Au-delà de ces dispositions, la question de fond sous-jacente à la proposition de loi est de savoir si la nouvelle institution du CNEN est en mesure d’accomplir son écrasante mission et si ce conseil national est un instrument efficace de régulation de la production normative. Or la simple évaluation des effets d’une réglementation est une tâche complexe et lourde qui nécessite des études et du temps, d’autant que sa saisine par des collectivités territoriales ou par des associations d’élus amène nécessairement le risque d’être débordé par les demandes. Dispose-t-on des moyens humains et financiers pour faire face à cela ? Non, sans doute, surtout si les méthodes de travail de l’administration centrale restent les mêmes, d’autant qu’on peut douter que l’urgence, si souvent invoquée en l’espèce, soit entendue de la même façon par ces administrations que par les élus.
À ces considérations contingentes s’ajoutent des éléments objectifs : nos concitoyens pensent que la solution à un problème réside dans l’adoption d’une nouvelle norme, de préférence législative, qui entraîne généralement une cascade de normes subordonnées. Il y a là un phénomène d’auto-engendrement tout à fait pernicieux : la norme appelle la norme. Dans ces conditions, il y a fort à craindre que le CNEN se trouve rapidement congestionné.
L’enfer, ici comme ailleurs, est pavé de bonnes intentions. L’heure étant au latin, monsieur le secrétaire d'État, quod infernum sit in bonum intentiones contravit… Les meilleures dispositions d’esprit peuvent conduire aux pires résultats. Et quel résultat ! Aujourd’hui, notre pays a produit une espèce de pachyderme normatif, de plus en plus impotent, qui croule sous son propre poids, et on a le plus grand mal à le mettre à la diète !
Face à cet impératif de régulation de la production normative, un traitement homéopathique est insuffisant là où une thérapie génique s’impose. Car, finalement, cette situation témoigne d’une contradiction difficilement surmontable, entre l’égalité et la liberté locale, et qui a été mise en exergue par d’éminents professeurs de droit : « La décentralisation, comprise comme la recherche d’une autonomie, appelle une différenciation et que celle-ci ne peut que déboucher sur des différences qui sont ou deviennent des inégalités. L’égalité, de son côté, implique que la règle soit la même sur tout le territoire, qu’elle s’impose aux collectivités locales. Et comme l’on ne peut, aujourd’hui, accepter la centralisation, mais que les effets logiques d’une véritable décentralisation ne sont pas plus acceptés, on imagine des solutions de compromis, des équilibres, notamment financiers, avec les compensations et les péréquations de toutes sortes, tout cela avec l’accord implicite des citoyens qui veulent à la fois la liberté locale mais sans abandonner la sacro-sainte égalité. » Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que nous en soyons arrivés à cette situation inextricable.
L’une des hypothèses jusqu’à présent repoussée dans notre pays, qui a la « passion de l’égalité », comme chacun le sait, serait une différenciation de la « norme » en fonction « des » territoires. Nous sommes là au cœur des logiques contradictoires et contrariées. Mais voilà, cette différentiation normative serait un tel bouleversement sur le plan juridique qu’elle reviendrait à abandonner le principe d’uniformité appliqué depuis la Révolution. Les implications en seraient si considérables qu’une telle perspective appellerait inévitablement un débat national bien plus large que celui qui nous occupe aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. le rapporteur et Mme Cécile Cukierman applaudissent également.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I
« Le Conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur les projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes ayant un impact technique et financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. »
II
« III. – La commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumet, avant de prononcer son avis définitif, tout projet de norme d’une fédération délégataire à l’avis du conseil national. »
III
« V. – Le conseil national examine les demandes d’évaluation des normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui lui sont transmises par le Gouvernement, les députés et les sénateurs, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Il examine les demandes d’évaluation de ces normes présentées par un ou plusieurs de ses membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les demandes d’évaluation sont motivées. »
IV
« Cette évaluation est effectuée sur la base d’une analyse réalisée par l’administration compétente à la demande du conseil national, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande par le conseil à l’administration concernée. »
V
1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Sur demande motivée du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, ce délai peut être fixé à deux semaines. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« En cas d’impérieuse nécessité et sur demande motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit sans être inférieur à quatre jours ouvrables. »

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Doligé, Mouiller et Lefèvre, Mme Troendlé, MM. Jarlier et Maurey, Mme Cayeux et M. Bockel, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, et les associations d’élus locaux
La parole est à M. Rémy Pointereau.

L’alinéa 7 de l’article unique de la proposition de loi prévoit que les demandes d’évaluation adressées au Conseil national d’évaluation des normes peuvent être transmises par le Gouvernement, les députés et les sénateurs, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements. Les associations d’élus ne peuvent donc pas être l’auteur de saisines. Nous proposons de leur ouvrir cette possibilité.
Cela étant, nous aurions dû préciser que seules les associations nationales d’élus locaux sont concernées, faute de quoi toutes les associations départementales pourraient aussi saisir le CNEN.

Aussi, je rectifie l’amendement en ce sens, madame la présidente, afin qu’il soit plus précis.

Je suis donc saisie d’un amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, Doligé, Mouiller et Lefèvre, Mme Troendlé, MM. Jarlier et Maurey, Mme Cayeux et M. Bockel, et ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, et les associations nationales d’élus locaux
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

La commission demande à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Avec les modifications proposées par la commission, le Conseil national d’évaluation des normes pourra être saisi par toutes les communes, à savoir les 36 700 communes, y compris une commune de vingt habitants, tous les départements, toutes les régions, …

… toutes les intercommunalités à fiscalité propre, tous les députés, tous les sénateurs. Le Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territorial pourra également s’autosaisir – chacun des membres pourra saisir le CNEN. Dans ces conditions, il ne nous a pas paru nécessaire d’ajouter les associations d’élus, d’autant que l’amendement initial visait toutes les associations, c'est-à-dire également les associations départementales.
J’observe que les associations d’élus sont des organismes de droit privé, qui n’ont pas de consécration législative : elles ne figurent pas dans les textes de loi.
Vous le savez, si l’une des associations que nous connaissons parfaitement, à laquelle nous avons adhéré et que l’un d’entre nous a parfois présidée, souhaite que tel problème soit soulevé devant le CNEN, elle n’aura aucune difficulté à le faire : tous ses membres pourront le faire.

Telle est la position de la commission.
Cela dit, je prends acte, mon cher collègue, de la modification que vous avez apportée : l’amendement n° 2 rectifié bis restreint le champ, mais, en tant que rapporteur, je me dois de maintenir l’avis de la commission. La Haute Assemblée tranchera…
Pour les raisons que vient excellemment d’exposer M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

La logique du raisonnement de M. Sueur est tout à fait respectable. Pour autant, si l’on veut, dans la pratique, que le travail se fasse, il faut impliquer les associations d’élus, qui sont capables de préparer et de suivre les demandes. Bien sûr, on peut toujours s’adresser à un élu, mais c’est une démarche simplifiée que l’on nous propose ici, même si ces associations, dont on peut limiter le nombre, ne figurent pas formellement dans les textes de loi.
Au fond, l’amendement de notre collègue Rémy Pointereau, que nous avons été plusieurs à cosigner, vise à simplifier la méthode.

Je tiens à saluer l’extrême précision du rapporteur. Toutefois, même si je partage le souci de notre collègue de ne pas engorger le Conseil national d’évaluation des normes, il me semble plus simple que la contestation d’une norme portée par dix, vingt, cinquante ou soixante communes ne soit formulée que par le biais d’un seul canal, celui d’une association nationale. C’est pourquoi je soutiens cet amendement, qui constitue un élément facilitateur et simplificateur.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Doligé et Lefèvre, Mme Troendlé, M. Mouiller, Mme Cayeux et MM. Jarlier et Bockel, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par le mot :
succinctement.
La parole est à M. Rémy Pointereau.

La commission des lois a prévu que les demandes soient motivées.
Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, la demande d’évaluation adressée au CNEN par une communauté de communes, par exemple, ne doit pas se transformer en pensum. La motivation doit pouvoir se faire succinctement, en quelques lignes, nul besoin d’un rapport de cinquante pages.
Sourires.

Je veux vous persuader, mon cher collègue, du bien-fondé de la position de la commission des lois, qui n’a pas retenu cet amendement.
Dès lors que l’on écrit dans la loi que la saisine est motivée, cela suffit : le texte peut ne comporter que trois lignes. Mais si vous inscrivez que la demande doit être motivée succinctement, cela signifie que, aux termes de la loi, la motivation devra forcément être succincte. Vous priverez ainsi certaines entités, telle une association d’élus, d’écrire une, cinq ou dix pages. Moi-même, j’estime qu’il serait vexatoire d’empêcher quelqu’un d’écrire cinq pages…
Sourires.

Mon cher collègue, si l’on en reste à la rédaction proposée par la commission, je vous l’assure – le compte rendu fera foi –, la motivation pourra faire l’objet d’un texte très court ou plus long si telle collectivité, telle association ou tel parlementaire souhaite faire valoir davantage d’arguments.
Par conséquent, je sollicite le retrait de votre amendement.

M. Jean-Claude Requier. Sans être du parti socialiste, je propose d’ajouter un petit mot qui pourrait nous permettre de réaliser la synthèse.
Sourires.
Sourires.

Nous passons cet après-midi à examiner une proposition de loi dont l’objet est de contrer la rédaction d’un décret. J’ai toute confiance en M. Sueur, mais ce n’est pas lui qui sera chargé de lire les objets de motivation des demandes de saisine. Or il est tout à fait possible qu’une personne trouve l’un de ces objets trop succinct et écarte, de ce fait, la saisine du CNEN.
Par conséquent, je trouve que l’adverbe « succinctement » est génial en cet après-midi de simplification.

Je trouve que la proposition de M. Requier répondrait à la problématique évoquée par M. le rapporteur. Ainsi, celui qui voudra motiver sa demande en faisant long pourra le faire, quand celui qui voudra faire court n’en sera pas privé non plus.

Malgré toute la sympathie que je porte à M. Requier, je rappelle que nous faisons la loi.
La proposition de loi prévoit que les demandes doivent être motivées. La motivation pourra donc faire l’objet d’un texte de quelques lignes – succinct, donc – ou d’une argumentation plus développée.

Permettez-moi d’intervenir, mes chers collègues. Tout cela n’est peut-être pas fondamental, monsieur Pointereau…

L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
fixé
par les mots :
réduit sans être inférieur
II. - Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
En cas d’impérieuse nécessité
par les mots :
À titre exceptionnel
2° Remplacer les mots :
sans être inférieur à quatre jours ouvrables
par les mots :
à soixante-douze heures
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Il convient de concilier deux impératifs : le Conseil national d'évaluation des normes doit exercer sa mission dans de bonnes conditions – c’est l’objet de la proposition de loi – et le Gouvernement doit pouvoir s’inscrire, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, dans un calendrier resserré, voire parfois très resserré.
Si prévoir une demande motivée du Premier ministre pour la procédure d’urgence nous paraît constituer une bonne mesure, le délai minimum de quatre jours ouvrables pour l’extrême urgence est très contraignant et pourrait gêner le Gouvernement lorsqu’il se trouve confronté à une situation exceptionnelle. De surcroît, la référence aux jours ouvrables introduit un élément mouvant en termes de délai et peut, en pratique, conduire à un délai de six jours.
L’objet de cet amendement est donc d’accorder la gradation définie dans la proposition de loi avec les impératifs de délai auxquels le Gouvernement ne peut se soustraire.

Monsieur le secrétaire d’État, vous jouez votre rôle de membre du Gouvernement, mais vous savez que cet amendement est contraire à la position de la commission. En effet, j’ai évoqué au cours de la discussion générale un événement qui a vraiment eu lieu. Le CNEN, en la personne de son président Alain Lambert, a été saisi du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte un vendredi soir.

Certes, mais cela s’est produit. Le Conseil national d’évaluation des normes a dû rendre un avis dans les soixante-douze heures ! Ce délai ne nous paraît vraiment pas raisonnable. Il convient de laisser le temps nécessaire à cette instance, qui a un rôle important à jouer, de travailler.
Nous sommes tout à fait d’accord avec le délai de saisine de quinze jours dans le cas d’une procédure d’urgence, mais nous demandons un délai de quatre jours ouvrables en cas de procédure d’extrême urgence, car un minimum de temps est indispensable pour examiner un projet de loi qui peut comporter plusieurs dizaines de pages ou un texte réglementaire qui peut être extrêmement complexe.
Mes chers collègues, je vous invite donc à ne pas adopter l’amendement du Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi simplifiant les conditions de saisine du Conseil national d'évaluation des normes.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.