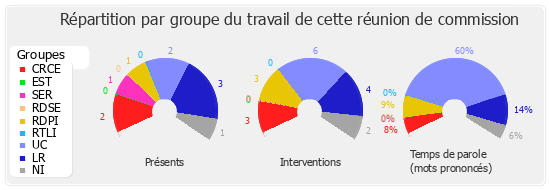Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 28 mai 2014 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède tout d'abord à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 368 (2013-2014) modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles.

Nous examinons les amendements de séance à la proposition de loi déposée le 13 février 2014 par Muguette Dini et Chantal Jouanno, modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles. Quatre amendements se présentent : trois de notre rapporteur, en plus de celui de Mme Dini - contre lequel nous nous sommes déjà prononcés la semaine dernière, à l'issue d'un débat approfondi.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
Article 1er

La semaine dernière, nous avons rejeté la rédaction initiale de cette proposition de loi, tout en nous réservant la possibilité de présenter des amendements en séance publique pour trouver une solution acceptable et juridiquement fiable : c'est que je vous propose aujourd'hui, avec trois amendements que je vous expose ensemble.
En 2004, le législateur avait allongé à 20 ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription des viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs ; je vous propose, avec l'amendement n°2, de porter ce délai à 30 ans, pour tenir compte de ce que nous disent les médecins sur l'amnésie traumatique sans, cependant, aller jusqu'à l'imprescriptibilité de fait qui résulterait aussi bien de la rédaction actuelle de la proposition de loi que de l'amendement de Mme Dini. Cet allongement à 30 ans me paraît un compromis raisonnable qui répond à la question posée, celle de la prise en compte du caractère parfois très tardif des plaintes, lequel apparaît bien comme une spécificité des violences sexuelles sur les mineurs. L'adoption de ce nouveau délai sera aussi l'occasion d'un débat utile sur ce sujet important. Enfin, tout en admettant volontiers qu'il serait plus cohérent de réviser les délais de prescription dans leur ensemble, je sais qu'une telle réforme n'est pas à l'ordre du jour et que nous devrions l'attendre bien longtemps ; aussi me paraît-il préférable d'ajouter une dérogation pour la prescription de l'action publique des violences sexuelles, s'inscrivant dans le cadre du régime dérogatoire déjà existant.
Avec l'amendement n°3, à l'article 2, je vous propose de porter à 30 ans le délai de prescription - qui est aujourd'hui de 20 ans - des violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, des agressions sexuelles aggravées et des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, et de porter à 20 ans - au lieu de 10 ans actuellement - le délai de prescription des infractions en matière de traite des êtres humains commise contre un mineur, de proxénétisme à l'encontre d'un mineur, de recours à la prostitution de mineur, de corruption de mineur, et d'atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans. Pour mémoire, ces délais commencent eux aussi à courir à la majorité de la victime.
Enfin, à l'article 3, je vous propose un amendement n°4 de cohérence supprimant l'article.

La semaine dernière, nous nous sommes prononcés contre la rédaction de ce texte. Je remercie notre rapporteur pour ses efforts et pour être parvenu à cette solution, qui est une avancée.

Je comprends et je salue les efforts de notre rapporteur pour sauver ce texte défectueux ; cependant, le juriste et le praticien que j'ai été ne peut qu'exprimer sa plus grande réserve envers la solution proposée : nous sacrifions à la volonté de victimes dont certaines pourraient vouloir agir pour des motifs tout autres qu'une agression sexuelle, nous le faisons alors que l'auteur présumé, devenu très âgé, aura pu disparaître et alors que nous savons bien, aussi, que les preuves seront souvent impossibles à réunir avec l'éloignement du temps. Avec cet allongement du délai de prescription, les faits remonteront parfois jusqu'à 40 ans en arrière : je comprends qu'on puisse vouloir ouvrir le droit à la justice, mais comment ne pas tenir compte des conséquences et des dégâts que de telles actions judiciaires tardives, alors qu'aucune preuve ne sera possible, feront aux générations suivantes ou adjacentes ? Ces dégâts, parfois irréparables, méritent qu'on s'y intéresse aussi et je suis très réservé sur des délais qui n'autoriseraient finalement qu'à ressasser des choses, des drames dont on ne pourrait prouver qu'ils ont effectivement eu lieu. Je crois donc que cet allongement peut nuire à la cohésion sociale et à d'autres personnes que les plaignants, qui réclament ici une garantie des plus incertaines.

J'irai dans le même sens. Les majorités changent, mais la méthode demeure lorsqu'il s'agit de répondre à l'émotion, quelle que soit la complexité du sujet. Vous nous dites, Monsieur le président, que la solution que nous propose le rapporteur serait une avancée : vers quoi ? En avançant, on ne progresse pas toujours... Un drame serait mieux réparable trente ans, que vingt ans après s'être déroulé ? A-t-on déjà oublié les enseignements de l'affaire d'Outreau, à laquelle nous avons consacré une commission d'enquête très importante ? Nous devons être très prudents.
Ensuite, je m'étonne du changement à 180 degrés dans la position du rapporteur par rapport à la semaine dernière.
À titre personnel, je voterai donc contre ces amendements, aussi bien que contre celui de Mme Dini.

Je salue les efforts de notre rapporteur pour nous convaincre de son changement de position. Cependant, au groupe écologiste, même si nous condamnons au plus haut point les violences sexuelles - c'est une évidence, mais en cette ère de victimisation généralisée, il faut s'en justifier... -, nous pensons que la gravité de ces actes ne justifie pas un droit pénal spécifique. Car ces dérogations alimentent à leur tour la victimisation : aujourd'hui, la « victimité » est devenue une identité, tout le monde se réclame victime de quelque chose, il faut en être conscient. Or, que se passera-t-il quand on aura accusé tel octogénaire sans pouvoir rien prouver, sinon que son honneur sera bafoué à tout jamais, sans réparation pour la victime ?
Ensuite, nous pensons que la loi ne doit pas être dictée par les faits divers, comme c'est malheureusement trop souvent le cas.
Les délais actuels sont déjà dérogatoires, pour tenir compte de la vulnérabilité des victimes de violences sexuelles. Avec l'allongement que vous proposez, vous introduirez une différence de traitement bien difficile à justifier entre la victime d'un viol à 17 ans, qui pourra se plaindre jusqu'à ses 48 ans, et la victime d'un viol à 18 ans, qui ne pourra s'en plaindre que jusqu'à 28 ans.
La groupe écologiste s'abstiendra sur les amendements et réserve sa position en séance.

Le groupe socialiste soutient la proposition raisonnable et nuancée de notre rapporteur.
J'entends les craintes de nos collègues, mais elles me paraissent liée à la justice elle-même : tout procès comporte un risque d'éclabousser la famille tout entière ; cependant, cela ne doit pas interdire à la justice de passer. Pourquoi allonger les délais ? L'imprescriptibilité, d'abord, n'est pas acceptable et ne serait pas toujours dans l'intérêt des victimes, parce que les « acteurs » peuvent avoir disparu, rendant hors d'atteinte bien des témoignages. Cependant, alors que les agressions sexuelles se multiplient en gravité, nous devons donner un signal de sévérité contre ces crimes trop longtemps regardés comme « moins graves » alors qu'ils sont en fait bien plus lourds que les atteintes aux biens, qu'ils ont des conséquences bien plus importantes pour notre vie collective. Les agressions sur mineurs se déroulant le plus souvent dans le cadre de la famille élargie - aux amis -, il faut du temps pour que les victimes libèrent leur parole, il leur faut d'abord gagner en maturité et en indépendance par rapport à ce cercle familial large, pour se convaincre qu'elles peuvent se défendre. A cette aune, un délai de trente ans n'est pas excessif, nous prenons en compte la réalité elle-même.

En faisant courir le délai de prescription à compter du dépôt de plainte, Muguette Dini nous proposait une réponse insatisfaisante à une vraie question, celle de la prise en compte du temps que prennent pour se plaindre les victimes d'agressions sexuelles. Maintenant, avec ses amendements, notre rapporteur change complètement le texte, puisqu'il nous propose d'allonger le délai de prescription à 30 ans pour les violences sexuelles sur mineurs. Ce faisant, il se focalise sur les seuls mineurs, sans répondre à la question posée initialement, qui est plus large. L'allongement des délais ne sera pas efficace non plus contre les violences sexuelles elles-mêmes, car si c'était efficace, on le saurait depuis longtemps.
On nous dit que l'imprescriptibilité n'est pas adaptée, mais à force d'étendre les délais, on y est presque : si c'est l'objectif, pourquoi ne pas en débattre ? S'il faut réprimer plus, pourquoi ne pas le dire ? En quoi les crimes sexuels justifient-ils des délais de prescription plus longs ? Débattons-en, au lieu de recourir à ces artifices, qui ne satisferont personne !
Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce texte et sur les amendements.

La rédaction initiale de Muguette Dini, dans laquelle c'est la victime qui décide du moment d'engager la procédure, est exemplaire de la juridiciarisation de la société, de cette idée que la justice doit tout et qu'elle peut tout réparer - alors que le but du procès n'est pas réductible à la réparation de la victime, il est aussi de réparer une atteinte à la société, à l'ordre social : c'est même le sens profond des délais de prescription. Le dernier rapport annuel de la Cour de cassation en fait état dans une étude sur l'ordre public : des magistrats, anciens présidents de cours, y disent qu'avec l'allongement des délais de prescription, on en est réduit à « parole contre parole » en salle d'audience et que les victimes, faute de preuves, ne sont pas reconnues. La question du report temporel est donc celle-ci : jusqu'à quand doit-il aller ? Et c'est sur ce point précis que notre rapporteur nous fait une proposition raisonnable : un délai de trente ans après la majorité, sans aller trop loin, est suffisant pour mieux tenir compte des traumatismes des victimes et il sera utile, aussi, dans certains cas où la procédure judiciaire elle-même est source de retard, au risque de voir tomber le couperet de la prescription ; voyez par exemple l'affaire des disparus de l'Yonne, où ce sont des lourdeurs procédurales, un changement d'affectation, un dossier perdu, qui ont fait perdre du temps, obligeant la Cour de cassation à des rattrapages pour éviter la prescription.
Le groupe UMP a donc considéré que ce délai de 30 ans à compter de la majorité était une solution équilibrée : nous voterons les amendements de notre rapporteur. L'équilibre, cependant, ne doit pas faire oublier qu'au fond il n'y a pas de solution parfaitement satisfaisante... Quoiqu'il en soit, ce délai plus long est de très loin préférable à l'imprescriptibilité, que je ne voterai jamais pour autre chose que les crimes contre l'humanité. Songez qu'il y a des délais de prescription en matière de crimes de guerre et de bien d'autres actes abominables : il faut respecter une cohérence, ou bien on met à bas notre tradition juridique et, finalement, l'ensemble de notre code pénal et de notre code de procédure pénale.

Il y a deux ans, nous avions rejeté à l'unanimité une proposition de loi de Muguette Dini, que j'avais rapportée, parce que nous refusions une dérogation supplémentaire et que nous demandions une réforme plus globale des délais de prescription en matière pénale, au nom de la prudence et de la cohérence. Je n'ai pas changé de position mais je voterai avec mon groupe, en comptant que cette dérogation sera entendue comme un appel à une révision globale des délais de prescription en matière pénale.

Je fais le même constat que Jean-Jacques Hyest, mais pour parvenir à une conclusion inverse.
Qu'est-ce que la prescription ? C'est un élément-clé de l'outil de régulation sociale qu'est le code pénal - lequel, lointain successeur de la loi du talion, définit l'équilibre entre les sanctions de la société contre les crimes et les limites posées à l'action judiciaire. Tout n'est pas sanctionné : un avocat général à la Cour de cassation me confiait récemment que sur les quelque dix mille infractions punies par le droit pénal, on en punissait effectivement à peine deux cents... Un premier foisonnement à contrôler, c'est donc bien d'abord celui des textes que nous adoptons sans se soucier de leur cohérence avec l'ensemble : c'est le rôle du code pénal.
Or, l'allongement du délai de prescription n'est pas un outil d'aggravation de la peine, mais la reconnaissance de ce que l'action publique continue d'être pertinente au-delà du délai actuel : pour être rationnel, il faut se prononcer au vu de ce seul critère ; or, ce n'est pas dans cette perspective que se place cette proposition de loi. Vouloir reculer le point de départ du délai de prescription, c'est encore autre chose : il s'agit alors de savoir si ce départ plus tardif sera, ou non, utile à l'établissement des faits. Mais pour allonger le délai de prescription dans une matière pénale, il faut se demander si, grâce au délai supplémentaire, on sera plus sûr de parvenir à la manifestation de la vérité. Est-ce le cas en matière de violences sexuelles : est-on plus certain d'obtenir des certitudes sur la commission des faits, trente ans après, qu'en matière de crime de sang ? C'est l'inverse à mon avis. Et c'est pourquoi je crois qu'introduire une telle dérogation, ce serait instaurer un désordre dans notre code pénal.

Le problème posé est celui des victimes d'agressions sexuelles qui ne portent pas plainte à temps et pour lesquelles justice ne sera jamais rendue. Je crois que la solution à ce problème n'est pas de manipuler les délais de prescription. Mieux accompagner les victimes, mieux prendre en compte leurs plaintes - qui sont parfois balayées d'un revers de la main par des policiers ou des gendarmes -, mieux informer les victimes de leurs droits : voilà des actions concrètes qui répondraient mieux au problème qui nous est posé.
La manipulation des délais de prescription se heurte à de nombreuses objections, elles ont été dites. La justice repose sur l'équilibre entre la réparation à la victime et le fait qu'une personne accusée ne puisse voir sa vie bouleversée sans que des preuves aient pu être réunies contre elle du fait même de l'éloignement du temps.
Dès lors, en répondant par l'allongement du délai de prescription à la question qui nous est posée, on est sûrs de faire fausse route.
Mon groupe a préféré, cependant, la solution la moins déraisonnable ; je voterai comme lui, mais en soulignant qu'elle n'est pas satisfaisante.

Je remercie chacun des intervenants.
Mes amendements répondent-ils surtout au voeu de victimes autoproclamées ? Je ne le crois pas, car c'est après avoir entendu des médecins et des associations de victimes nous dire, avec des exemples, que l'extension des délais à 20 ans effectuée en 2004 n'était pas suffisante, que ce seuil laissait de côté des victimes ou encore qu'il empêchait ou atténuait des actions judiciaires, que je me suis résolu à le porter à 30 ans. Ces médecins, ces spécialistes nous ont dit que certaines victimes ne parlent qu'après l'âge de 40 ans et que la prescription actuelle est parfois un couperet. Ils nous ont dit combien le cheminement pouvait être long pour ces personnes agressées pendant l'enfance et que c'était souvent quand elles étaient devenues parents elles-mêmes, qu'elles avaient la force de se plaindre de ce qu'elles avaient enduré. On nous a dit aussi que même en l'absence de preuves certaines, le simple fait qu'il y ait un procès pouvait aider à se reconstruire, à tourner une page. On l'a vu dans l'affaire de l'Ecole en bateau : ce sont d'abord les révélations de victimes qui étaient hors délais, qui ont entrainé le dépôt de plaintes par des victimes qui pouvaient le faire, c'est parce que la parole a été libérée par des adultes plus âgés, plus mûrs, que les plus jeunes, dans la trentaine, ont déposé plainte.
Je crois donc que c'est en tenant compte de la pratique, de la jurisprudence, qu'il faut rechercher la solution la plus juste : c'est ce que je crois faire avec mes amendements.
Ce texte est-il dicté par un fait divers ? Le problème est ancien puisque nous avons déjà allongé les délais en 2004, nous tenons compte de ce qui se passe depuis...

Et Outreau ? Des gens ont été accusés à tort, on l'oublie trop facilement !

Cela n'a guère à voir avec les délais de prescription. Notre propos n'est pas non plus d'alourdir les peines, elles sont déjà très lourdes et appliquées : en allongeant les délais, nous tenons compte du lien spécifique de la mémoire avec les violences sexuelles subies, je m'en suis expliqué.
Mes amendements changent en profondeur le texte initial ? Je le reconnais...
J'assume ces changements, mais l'objectif reste le même, celui de la justice rendue aux mineurs victimes d'agressions sexuelles. Je crois savoir, du reste, que Mme Dini se satisfait de mes amendements...

La droite se retrouve toujours quand il s'agit d'allonger les délais de prescription ou d'alourdir les peines...

Ce sont deux questions bien différentes et avec l'allongement des délais, il s'agit surtout d'aider les victimes à se reconstruire.
Ensuite, les agresseurs sexuels de mineurs sont souvent des prédateurs sexuels qui multiplient leurs crimes ; un délai plus long de prescription permet plus de recoupements, de plaintes pour des faits qui se sont déroulés sur des décennies : c'est utile aux poursuites, mais aussi à l'accompagnement des criminels, qu'il faut soigner.
C'est donc en écoutant les médecins et les associations que j'en suis venu à ma position, pour faire évoluer la loi ; les délais ont déjà été étendus à 30 ans en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, je ne suis pas choqué qu'on les étende également pour les violences sexuelles sur mineurs : ce n'est pas sanctionner à tout-va, mais se prononcer pour plus de justice. Nous pourrons, d'ici quelques années, évaluer ce qu'il en sera advenu.

Vous dites que les agresseurs sexuels de mineurs sont des criminels en série, est-ce bien sûr ? Qu'en sait-on vraiment ? La vérité, c'est que l'inceste était enfoui et qu'on en parle désormais, que la société s'y intéresse : voilà ce qui a changé, mais quant à dire que les actes seraient plus nombreux et davantage le fait de criminels en série, je serais plus prudent.

à laquelle on ne répond pas ici. Ensuite, il semble que le vrai problème sur ce sujet, ce soit, plutôt qu'un délai trop court de prescription, un accompagnement défectueux des victimes de viol, les dénis de la part de policiers, voire leur machisme, et encore le manque de formation des médecins : que fait-on pour résoudre ces problèmes ? Rien, sinon de faire comme si l'acte de justice était en lui-même une réparation, quelles que soient ses conditions.
Je crois, ensuite, qu'il ne faut pas comparer les actes de guerre et les violences sexuelles : on n'y récolte que de la confusion.
Enfin, dans les exemples que j'entends ici où là, on met trop souvent en avant les violences sexuelles sur les garçons mineurs, comme si les filles n'en subissaient pas également : les fillettes aussi sont violées, agressées, ne le passons pas sous silence !
Je vous invite à consulter les réseaux sociaux : les avocats, les juristes, les juges sont contre l'allongement des délais de prescription de violences sexuelles, il faut en tenir compte, c'est l'avis du peuple qui s'exprime là, aussi.

Les réseaux sociaux sont une source d'opinion, d'où ne jaillit pas toujours la volonté ni l'intérêt général... Voyez le déferlement de messages que vous recevez lorsque vous participez à tel ou tel colloque : tout ceci est coordonné, à tout le moins concerté.
Personne ne dit ici, ensuite, que seuls les petits garçons seraient victimes d'agressions sexuelles...

Cet allongement des délais de prescription dispense surtout de faire autre chose...de bien plus utile pour résoudre le problème. Je reprends votre exemple de l'Ecole en bateau : ce qui est le plus choquant, c'est que de tels viols aient pu avoir lieu pendant des années sans qu'ils soient décelés, sans que nos instances de contrôle - nous parlons ici d'école, des contrôles existent - ne se soient aperçues de rien.
Constate-t-on, ensuite, une recrudescence des crimes sexuels ? C'est loin d'être certain mais ce qui est sûr, c'est qu'on en parle davantage, et c'est très bien.
Le procès aide-t-il toujours à se reconstruire ? Là encore, il faut se méfier des fausses apparences et considérer les effets destructeurs que peut avoir, trente ans après les faits, un « grand déballage » qui ne produit aucune preuve.
Enfin, on proclame partout la présomption d'innocence, mais que fait-on pour les innocents accusés à tort ? Quelles leçons avons-nous tirées de l'affaire d'Outreau ? Nous multiplions les possibilités pour les victimes de se plaindre, mais il faut respecter un équilibre, prendre en compte les risques d'erreurs judiciaires.
Je crains donc qu'aujourd'hui, vous ne fassiez que rendre la situation pire qu'elle ne l'est déjà.
La commission adopte l'amendement n°2.
Article 2
La commission adopte l'amendement n°3.
Article 3
La commission adopte l'amendement n°4.
EXAMEN DES AUTRES AMENDEMENTS DE SÉANCE

La semaine dernière, nous avons déjà examiné l'amendement n°1 rectifié, présenté par Mme Dini et qui tend à une imprescriptibilité de fait : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°1 rectifié.
La commission entend ensuite une communication de M. Yves Détraigne sur les travaux du groupe de travail « conducteurs âgés ».

Le 5 juin dernier, j'ai rapporté devant vous une proposition de loi instituant une évaluation médicale à la conduite pour les conducteurs de 70 ans et plus.
Ce texte partait du constat qu'à compter d'un certain âge, probablement 70 à 75 ans, le conducteur est davantage vulnérable, mais aussi, sur le plan institutionnel, que la mise en oeuvre d'un permis de conduire européen allait de pair avec l'abandon du principe d'un permis délivré à vie, ouvrant la possibilité de contrôler régulièrement l'aptitude à la conduite. Ensuite, cette proposition de loi se fondait sur le constat que plusieurs pays prévoient déjà une visite médicale pour les conducteurs âgés, qui peut conditionner la validité du permis au-delà d'un certain âge.
Toutefois, lors de sa séance publique du 13 juin 2013, le Sénat a renvoyé la proposition de loi en commission. Le débat a souligné en particulier que les personnes âgées ne présentent pas le risque le plus élevé pour la sécurité routière, qu'elles se caractérisent plutôt par leur sérieux, qu'elles sont plus prudentes, qu'elles roulent moins vite ; il est également apparu que cette mesure stigmatiserait injustement les personnes âgées, qu'elle risquerait d'accroître l'isolement, notamment en milieu rural, et qu'elle aurait un coût élevé.
Le débat en commission a toutefois montré que la question méritait d'être approfondie. Un groupe de travail a donc été créé, avec Mmes Benbassa, Klès et Troendlé, pour conduire des auditions complémentaires et déterminer si une visite médicale préalable au permis de conduire était une mesure utile.
Nous avons entendu le délégué interministériel à la sécurité routière, le président du syndicat des médecins du permis de conduire et les représentants des assurances et des mutualistes.
Ces auditions nous ont montré que deux motifs s'opposent à l'organisation d'une telle visite médicale. En premier lieu, le lien entre âge du conducteur et accidentologie ne se vérifie pas avant un âge très avancé où il se confond en réalité avec l'état de santé : c'est donc moins une question d'âge que d'état de santé. Ainsi, le professeur Dominique Richter, représentant du syndicat des médecins du permis de conduire, estime que si une visite médicale devait être instituée, elle devrait alors intervenir sans condition d'âge.
La rédaction initiale de la directive européenne relative au permis de conduire imposait un examen médical à compter d'un certain âge, mais cette obligation a été rejetée par les pays où il existait déjà une telle obligation : ils ont expliqué que, mise en place dans les années 1950 ou 1960, elle n'avait pas fait la preuve de son utilité, mais qu'elle était en revanche politiquement très difficile à supprimer. Du reste, la question se pose de l'efficacité d'une telle visite, alors que l'état de santé peut se dégrader très rapidement.
En second lieu, les personnes âgées ne sont guère exposées aux facteurs de risque les plus graves - l'alcool, la drogue, la vitesse. Ce sont des personnes qui prennent peu de risques et s'autorégulent, au point que les assureurs ne les considèrent pas comme une population à risque. Elles limitent leurs déplacements en voiture au strict nécessaire, si elles sont isolées ou que manque une offre de transports publics.
Dans certains cas, la mesure pourrait avoir un effet contreproductif : plusieurs études ont montré que l'instauration d'une visite médicale incitait certaines personnes âgées à cesser de conduire, sans même tenter de passer cette visite, alors même qu'elles conduisent sans danger.
L'action la plus efficace en la matière, ainsi qu'il ressort de nos auditions, est plutôt de sensibiliser les médecins, surtout les généralistes, au fait que certaines pathologies rendent la conduite dangereuse, ou de les inviter à être attentifs lors de la prescription de certains médicaments ayant des effets négatifs sur le comportement des conducteurs. L'ordre des médecins s'y emploie, et cela fait également partie des actions que mène la délégation interministérielle à la sécurité routière : 220 000 brochures ont été envoyées à tous les médecins, généralistes et spécialistes sur le sujet des conducteurs âgés. Dominique Richter, représentant du syndicat des médecins du permis de conduire estime même que cette sensibilisation pourrait être intégrée dans les études de médecine.
En parallèle, il convient de poursuivre les activités de formation en direction des personnes âgées, à l'instar de celles dont les organismes de retraite ont pris l'initiative, et qui visent à leur rendre confiance tout en leur expliquant que dans certaines situations, la baisse naturelle de leurs réflexes doit les inviter à une prudence accrue, lors des traversées d'intersections par exemple.
Les auditions ont enfin montré que les dispositions en vigueur, comme l'article R. 221-14 du code de la route, qui permet au préfet de faire vérifier l'aptitude à la conduite d'une personne et de suspendre, le cas échéant, le permis de conduire, restent mal connues et sous-utilisées, ainsi que l'a relevé le délégué interministériel à la sécurité routière, qui a admis que les préfets pourraient être mieux sensibilisés à ce mécanisme.
En conclusion, j'estime donc, à la lumière du travail que nous avons conduit à la suite de l'adoption de la motion de renvoi en commission, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre sur la voie législative. Il n'en reste pas moins que je suis régulièrement contacté par des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle car le débat refait régulièrement surface dans les départements touchés par des accidents, souvent spectaculaires, mettant en cause des conducteurs âgés. Ainsi, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été contacté par des journalistes à la suite de la pétition lancée par les habitants de la commune de Saint-Jean-le-Vieux, dans l'Ain, contre un automobiliste de 77 ans qu'ils considèrent comme un danger public et à propos duquel le maire déclare, dans Le Parisien-Aujourd'hui en France : « Les députés devraient réfléchir à un texte qui, comme dans de nombreux pays, oblige à passer un examen médical à partir d'un certain âge ou en cas de maladie. »
S'il est vrai, cependant, que ces accidents sont souvent spectaculaires et mortels, ils sont relativement peu nombreux dans les statistiques de l'accidentologie, et c'est pourquoi je vous propose de nous en tenir là.

Merci de ce rapport précis, qui montre bien que le renvoi en commission n'est pas un enterrement de première classe. Le groupe de travail a procédé à des auditions et votre communication fera l'objet d'un compte rendu. Votre rapport, qui comporte des préconisations concrètes, montre assez qu'il est des solutions autres que législatives.

Je vous remercie de la clarté de votre rapport. Il nous fournit de solides arguments pour répondre aux questions qui nous sont posées - parfois après qu'un conducteur âgé, ayant mal intégré les modifications dans la signalisation routière, a pris une bretelle d'autoroute à contresens... Votre rapport montre qu'il n'est pas inenvisageable que sur la suggestion d'un maire, le préfet se saisisse d'un cas particulier jugé dangereux. Nous sommes un peu dans la même logique que celle du permis de chasse, dont le maire, du temps où cela était de sa responsabilité, pouvait refuser la délivrance, comme cela m'est arrivé. Le préfet, de la même manière, pourrait se voir reconnu le pouvoir de prévenir les circulations hasardeuses.

Je remercie M. Détraigne de son travail scrupuleux et méthodique, qui montre qu'il est d'autres outils que la voie législative. Pouvez-vous me confirmer qu'en cas d'accident, le tribunal de police a le pouvoir de prescrire une visite médicale ? Car au vu des conclusions d'une telle visite, on peut mettre en demeure la personne en cause de rendre son permis.
Ce travail nous invite à une méditation sur l'oeuvre législative. Beaucoup de propositions de loi pourraient relever de la même approche. Y a-t-il lieu de légiférer ? Telle est la première question à laquelle doivent répondre les études d'impact. Au cas présent, on constate que l'effet médiatique obtenu est le même que si un texte avait été voté. Preuve qu'un simple débat peut avoir des résultats aussi efficaces que la loi.

Si mon travail peut faire avancer la pratique parlementaire, j'en serais heureux. J'avais à coeur que le renvoi en commission ne soit pas le prétexte pour enterrer cette question et que l'on aille au bout de la démarche engagée. Je confirme à Alain Richard qu'en cas d'accident corporel, le préfet peut prescrire une visite médicale et à la suite de cette visite, suspendre le permis au vu des conclusions de celle-ci.

Ce n'est pas le seul cas où le préfet peut intervenir. Un excès de vitesse peut aboutir au même résultat. J'estime d'ailleurs que dans un tel cas, les droits de la défense ne sont pas respectés. Il n'y a pas lieu d'exiger une visite médicale à la suite d'un excès de vitesse de 10 km/heure. Cela devient une sanction.
La commission entend également une communication de M. Alain Anziani sur le projet de loi n° 544, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'économie sociale et solidaire.

Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, adopté par l'Assemblée nationale le 20 mai dernier, nous revient en deuxième lecture.
S'agissant de la commande publique, l'Assemblée nationale a maintenu l'obligation pour les collectivités territoriales d'adopter un schéma de promotion des achats publics socialement responsables « lorsque le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par décret ». Je vous proposerai, pour plus de lisibilité, et conformément à ce que souhaitait notre commission en première lecture, de prévoir que l'adoption du schéma est obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 70 000 habitants et leurs établissements publics, en retenant ainsi un seuil démographique, plus lisible qu'un montant annuel d'achats.
S'agissant des subventions publiques, l'Assemblée nationale est revenue à la définition proposée dans le texte initial, qui visait les contributions facultatives de toute nature « notamment financières, matérielles ou en personnel ». Cette liste non exhaustive me paraît de nature à fragiliser le dispositif, et je vous proposerai de supprimer ce dernier membre de phrase.
S'agissant de l'information des salariés sur la cession de leur entreprise, l'Assemblée nationale a adopté conformes les dispositions que le Sénat avait adoptées, après d'intenses discussions. Je rappelle qu'en cas de projet de cession d'un fonds de commerce ou de la majorité des parts d'une société dans une entreprise de moins de 250 salariés, le cédant devra informer préalablement les salariés afin de leur permettre de présenter, s'ils le souhaitent, une offre de reprise.
L'Assemblée nationale a ajouté, à l'initiative de M. François Brottes, de nouvelles dispositions, qui font suite à la censure partielle de la loi dite « Florange » par le Conseil constitutionnel. Ecartant la procédure judiciaire qui permettait aux tribunaux de commerce de contrôler et sanctionner d'éventuels manquements à l'obligation de recherche d'un repreneur, elle lui substitue ici un mécanisme limité de contrôle administratif, afin de satisfaire l'objection du Conseil constitutionnel.
En matière de droit des associations, l'Assemblée nationale a beaucoup innové, de façon parfois surprenante. Elle a ainsi prévu que tout mineur, quel que soit son âge, pourra adhérer à une association, et pourra accomplir, à compter de ses 16 ans, des actes d'administration, sans qu'il y ait lieu d'informer ses parents. J'estime que si tout mineur peut participer aux activités d'une association, il ne peut y adhérer que lorsqu'il a atteint l'âge de 16 ans, et je vous proposerai un amendement en ce sens.

Songeons au danger des sectes ! Je comprends mal que l'Assemblée nationale ait pu voter un tel dispositif. L'initiative me paraît d'autant plus choquante à l'heure où l'on retrouve des jeunes gens embrigadés jusqu'en Syrie.

Nos collègues députés ont cherché à faire participer les mineurs à la vie associative. Mais il est vrai qu'il est d'autres moyens.
Je rappelle, ensuite, que les agissements d'un mineur au sein d'une association engagent de plein droit la responsabilité civile des parents. L'Assemblée nationale a certes prévu que les parents pourront s'opposer aux actes du mineur, mais comment seront-ils informés ? Mieux vaut prévoir leur autorisation explicite, comme je vous le proposerai par amendement.
Les députés ont également introduit quelques modifications plus techniques. Ils ont ainsi exonéré les subventions en nature du calcul du seuil à partir duquel les associations ayant une activité économique doivent établir et publier des comptes. Mais une subvention en nature peut être très importante - je pense, par exemple, à la mise à disposition permanente de personnel et de salles. Je vous proposerai un amendement ouvrant la possibilité de faire varier les seuils par décret, selon que la subvention est en nature ou en numéraire. Seules les subventions en nature de peu d'importance donneraient ainsi lieu à exonération.
L'Assemblée nationale a également aligné certaines dispositions du droit des associations sur celles que prévoit le code de commerce en matière de procédures collectives ou de sanction en cas d'omission d'établissement ou de publication de comptes. Ces dispositions me semblent bien inspirées, mais je vous proposerai d'en améliorer la rédaction.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 9

Mieux vaut fixer l'obligation d'élaborer un schéma de promotion des achats publics socialement responsable par référence, plutôt qu'à un montant annuel d'achats fixé par décret, à un seuil démographique, que je propose à 70 000 habitants. Tel est l'objet de mon amendement n°1.

Ce schéma ne sera pas toujours simple à élaborer, mais puisqu'il est voté dans son principe...
L'amendement n° 1 est adopté.
Article 40 AA

Mon amendement n° 2 vise, je m'en suis expliqué, à supprimer de la définition des subventions publiques une liste de qualificatifs dont aucun « notamment » ne saurait venir suppléer le défaut d'exhaustivité.
Article 40 ABA

L'Assemblée nationale a exonéré les associations ne bénéficiant que d'une subvention en nature de l'obligation de publier des comptes annuels et le rapport d'un commissaire aux comptes, sans tenir compte de l'importance que peut avoir une telle subvention en nature. Mon amendement n° 3 y remédie.

Dans le domaine culturel, innombrables sont les associations qui reçoivent des avantages en nature. Les communes mettent à disposition, au bénéfice de nombreux festivals, des locaux, leurs services techniques, leur personnel. Ce serait une faute que d'exonérer ce type de soutien, qui doit être précisément chiffré. Et si exonération il y a, le seuil devrait, à mon sens, être fixé assez bas. Songez, par exemple, que la contribution de la commune au festival de théâtre de rue d'Aurillac équivaut à 600 000 euros. Pour les collectivités locales, l'aide en nature est souvent la forme la mieux adaptée de soutien à une manifestation, mais elle doit être prise en compte. Je voterai l'amendement.
L'amendement n° 3 est adopté.
Article 42 bis

L'Assemblée nationale a prévu que lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire dont l'activité est soumise à agrément, conventionnement ou habilitation, l'autorité administrative compétente doit être consultée, mais en oubliant de préciser qui doit la saisir. Mon amendement y pourvoit en spécifiant que c'est le débiteur, l'administrateur judiciaire ou le repreneur, selon le cas.
L'amendement n° 4 est adopté.
Article 44 ter

Mon amendement n° 5 précise la rédaction des dispositions introduites par l'Assemblée nationale, qui rapprochent, en matière de sanction des obligations de publicité des comptes, le droit des associations de celui des sociétés. Il précise la peine applicable en cas de manquement et prévoit la possibilité d'une injonction.
L'amendement n° 5 est adopté.
Article 44 quater

Mon amendement n° 6 modifie les dispositions introduites par l'Assemblée nationale relatives à la participation des mineurs à une association : un mineur peut participer à une association mais ne saurait en devenir membre qu'à 16 ans révolus. Il ne pourra alors exercer de responsabilités au sein de cette association que sous réserve d'une autorisation expresse de ses représentants légaux.

Important amendement. Alors que l'actualité témoigne assez que des mouvements prospèrent dont les pratiques peuvent être attentatoires aux droits humains, l'Assemblée nationale, en adoptant des dispositions qui autoriseraient une association à recueillir l'adhésion d'un enfant de six ans et, ce faisant, à l'embrigader, ne s'est guère montrée responsable.

L'intention de la commission de la culture de l'Assemblée nationale, à qui l'on doit cette initiative, était généreuse, mais elle n'en a sans doute pas mesuré toutes les conséquences.
L'amendement n° 6 est adopté.

Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité. Il serait bon de témoigner, en séance publique, de l'importance que revêt ce sujet. Je remercie M. Anziani de son amendement salutaire.
Puis, la commission entend une communication de M. Jean-Pierre Sueur sur l'adoption et la transposition des directives européennes relatives à la commande publique.

Je vais vous donner lecture, au nom de notre collègue Gaëtan Gorce, désormais membre de la commission des affaires étrangères, d'une communication qui fait suite à l'adoption par le Sénat, le 13 mars 2012, d'une résolution européenne relative au droit européen de la commande publique.
À la suite d'une concertation et de la publication d'un livre vert en 2011, la Commission européenne avait proposé, le 20 décembre 2011, trois directives pour refondre le droit de la commande publique : l'une sur les concessions, deux autres sur les marchés publics. Ces directives ont été définitivement adoptées le 26 février 2014, soit près de deux ans après la résolution européenne du Sénat.
Notre collègue Gaëtan Gorce, qui avait rapporté la proposition de résolution européenne en mars 2012, au nom de notre commission des lois, a souhaité voir dans quelle mesure les négociations à l'échelon des institutions européennes avaient pris en compte les préoccupations que le Sénat avait exprimées.
Je noterai tout d'abord un motif de satisfaction : la directive sur les contrats de concessions reconnaît que les États membres comme les collectivités territoriales sont libres de retenir, pour exercer leur mission, le mode de gestion qu'ils souhaitent : « les autorités peuvent choisir d'exécuter leurs missions d'intérêt public en utilisant leurs propres ressources ou en coopération avec d'autres autorités, ou de déléguer ces missions à des opérateurs économiques ». En droit français, on dirait en régie, en délégation de service public ou par une coopération public-public.
J'indique d'ailleurs qu'à l'initiative du Sénat, les sociétés publiques locales existent déjà - M. Mézard était le rapporteur de cette proposition de loi sénatoriale - et je note que l'Assemblée nationale nous a également suivis en adoptant en première lecture, le 7 mai dernier, à une très large majorité, la proposition de loi sénatoriale, ici adoptée en décembre 2013, portant création de la société d'économie mixte à opération unique.
Pour le reste, je retiendrais deux points essentiels sur lesquels notre assemblée s'était fortement exprimée.
Tout d'abord, le Sénat s'était interrogé sur le principe même d'un encadrement par voie de directive du régime de passation et d'exécution des concessions - soit, dans notre droit interne, les délégations de service public instituées par la loi dite « Sapin » de 1993. Hormis les principes fondamentaux du marché intérieur énoncés dans les traités européens, peu de règles européennes s'appliquent aujourd'hui à ces délégations.
En droit français, les délégations de service public sont attribuées par une personne publique - l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics - à un partenaire, très souvent privé. Si existe bien une procédure de passation, elle est moins formelle, cependant, que pour les marchés publics. Cette plus grande liberté se justifie par le fait que la personne publique doit pouvoir choisir un partenaire de confiance pour exercer les missions de service public qu'il va lui confier pour une période longue, parfois plusieurs décennies. Pensons aux délégations de service public sur l'eau, à l'exploitation d'un équipement sportif ou d'un établissement culturel. Le pouvoir adjudicateur choisissant ainsi son cocontractant intuitu personae, il est difficile de résumer à l'avance le profil attendu du bon candidat par une formule de critères pondérés.
Pourtant, en 2012, la Commission européenne se proposait de transposer aux concessions, donc à nos délégations de service public, les mêmes obligations qu'aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur aurait dû fixer en amont des critères de sélection, les hiérarchiser et les pondérer.
Le Sénat avait souligné, pour la condamner, cette incongruité qui revenait à nier la spécificité des délégations de service public. Lors des négociations, le Gouvernement français a dû faire comprendre à plusieurs États ce qu'était une concession, car cette notion est étrangère à leur droit. Ce travail de conviction, auquel il a associé les représentants des collectivités territoriales françaises, a porté ses fruits puisque la procédure que prévoyait la directive a été largement allégée. Ainsi, elle n'exige plus qu'une hiérarchisation des critères de sélection, au lieu de leur pondération. L'équilibre de la loi « Sapin » n'est, au final, pas fondamentalement remis en cause. C'est un motif de satisfaction.
Ces directives, ensuite, obligent les États membres à prévoir des règles pour lutter contre le favoritisme, la corruption et les conflits d'intérêts. En cette matière, notre pays, depuis une vingtaine d'années, a développé - parfois dans la douleur - un arsenal juridique désormais bien établi. Les candidats à la commande publique peuvent saisir le juge administratif, y compris en référé, pour obtenir l'annulation des contrats qui résulteraient de tels comportements. De même, des infractions pénales - délit de favoritisme, de prise illégale d'intérêts, etc. - répriment sévèrement ces manquements à la probité. Notre législation répond donc aux attentes européennes.
Plus précisément, les directives obligent les États membres à « prévenir un conflit d'intérêts potentiel ou éliminer le conflit d'intérêts détecté ». En 2012, le Sénat avait émis de fortes réserves sur la définition que les directives donnaient du conflit d'intérêts, exigeant qu'elle soit plus claire et objective. Il y était question, notamment, d'« intérêt sentimental » ou « politique » : allait-il falloir interroger toutes les personnes en charge de la commande publique pour connaître leurs affinités sentimentales et politiques ? Au cours de l'élaboration des directives, ces arguments ont convaincu, et la définition du conflit d'intérêt ne retient plus que les intérêts, directs ou indirects, financiers, économiques ou personnels. La demande du Sénat, relayée par le Gouvernement, a été entendue.
L'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, que vous avez certainement encore en mémoire, prohibe tout conflit d'intérêts, y compris « apparent » - je vous renvoie à nos débats de l'été - dans l'exercice des fonctions gouvernementales, d'élu local ou d'agent public - toutes personnes susceptibles de passer un marché public ou de décider d'une délégation de service public. Là encore, la législation nationale devance, me semble-t-il, les attentes européennes.
En 2012, le Sénat avait également manifesté une forte opposition à la solution qu'envisageait la Commission européenne pour lutter contre les conflits d'intérêts : chaque État membre aurait dû créer un « organe de contrôle » qui, cumulant des fonctions de conseil, de contrôle et de sanction, pouvait même adresser des injonctions aux autorités administratives. Mais qu'aurait pu faire un tel organe face à des milliers de marchés publics conclus chaque année dans le pays ? Surtout, ces dispositions soulevaient un problème constitutionnel : cet organe de contrôle, empiétant sur les juridictions administratives et judiciaires, aurait porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs et contraignant les collectivités territoriales dans leur choix, méconnu le principe de libre administration.
Le Parlement européen a fort opportunément supprimé cette obligation des directives, confiant le soin à chaque État membre de confier les missions que la Commission européenne envisageait de confier à un organe de contrôle ad hoc aux autorités compétentes au niveau national. Cette solution satisfait la sage demande du Sénat, pleinement conforme au principe de subsidiarité.
La France doit désormais transposer ces directives d'ici au 18 avril 2016. Un décret devrait transposer certaines mesures réglementaires dès l'été et le précédent ministre de l'économie et des finances, M. Pierre Moscovici, a annoncé un projet de loi de transposition dès 2015. Le champ de ce texte devrait être plus large que celui d'une simple transposition puisqu'il tendrait à réunir toutes les règles des marchés publics au sein d'un même code et encadrerait, pour la première fois, la commande publique par des principes de niveau législatif. De fait, alors qu'en matière de marchés publics, s'agissant des collectivités territoriales, c'est, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi qui devrait être compétente. Or, les dispositions qui les régissent sont du domaine règlementaire, les gouvernements successifs s'étant reconnus compétents en vertu d'un décret-loi 12 novembre 1938... Pierre Moscovici admettait en mars dernier vouloir mettre fin à cette habilitation « aussi fragile qu'obsolète » : nous ne pouvons que l'approuver.
Selon les annonces de M. Moscovici, ce projet de loi devrait concerner les partenariats public-privé, qu'il souhaite recentrer. Avec notre collègue Hugues Portelli, je mène depuis plusieurs mois une mission d'information. Je souhaite que nos travaux puissent nourrir l'examen parlementaire du projet de loi.
Alors que ce texte devrait permettre au Parlement de se prononcer sur un sujet qui intéresse les collectivités territoriales, le Gouvernement semble privilégier, à en croire les annonces de M. Moscovici, le recours aux ordonnances. Le ministre a depuis changé ; souhaitons que nos paroles fortes relatives à de récents projets d'ordonnances soient parvenues jusqu'à lui.
Je voudrais rappeler ce qui est une position constante de notre commission des lois et du Sénat. Nous ne sommes pas opposés aux ordonnances lorsqu'elles se justifient, notamment pour codifier le droit existant et des dispositions éparpillées entre plusieurs textes. Certains sujets, cependant, ne peuvent pas échapper à la délibération parlementaire. Le droit de la commande publique fait traditionnellement l'objet d'un relatif consensus et ne devrait pas monopoliser outre mesure l'ordre du jour réservé au Gouvernement. Il me semble important d'indiquer dès à présent que le Parlement doit se prononcer sur les partenariats public-privé et débattre des grands principes de la commande publique.
J'indique que l'Inspection générale des finances a produit un rapport sur les partenariats public-privé. Lorsque j'ai été chargé, avec Hugues Portelli, d'en rédiger un au nom de la commission des lois, j'ai écrit au ministre des finances, pour qu'il nous soit adressé. Après plusieurs relances infructueuses, j'ai fini par l'obtenir de M. Moscovici, la veille de son départ. Il est à la disposition des membres de notre commission qui souhaiteraient le consulter.
Je conclurai en relevant qu'il n'aura pas été inutile de voter cette résolution européenne, dont le Gouvernement a su tirer pleinement parti pour peser sur la décision européenne.
Enfin, la commission entend une communication de Mlle Sophie Joissains sur l'évaluation du programme de Stockholm.

Je donne à présent la parole à Mme Sophie Joissains, pour une communication sur l'évaluation du programme de Stockholm.

Cette communication sur les perspectives de l'après Stockholm s'inscrit dans un contexte particulier. Car c'est auprès de responsables européens en fin de mandat que j'ai recueilli les informations que je vais vous livrer. Si bien que le terme de « perspectives », avec ce qu'il comporte d'aléatoire, ne saurait être mieux choisi.
Le Programme de Stockholm adopté par le Conseil européen pour la période 2010-2014, était relativement ambitieux. « Mettre le citoyen au coeur de l'espace de liberté, de sécurité et de justice » : tel est l'objectif autour duquel s'articulaient ses grandes priorités. Le temps est venu d'en dresser le bilan et d'envisager le futur.
Qu'en est-il, tout d'abord, du volet « affaires intérieures » ?
S'agissant de la politique européenne de l'immigration, le bilan reste maigre. La réunion conjointe entre Parlement européen et parlements nationaux, organisée à Bruxelles, le 19 mars dernier, à l'initiative de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dite commission Libé, a bien fait apparaître que la politique européenne en la matière se réduisait, en dépit de grandes déclarations de principe quant à la nécessité d'une approche globale, à une tentative de rapprochement des règles en matière de droit d'asile ou de visas et à une contribution de l'agence européenne Frontex à la surveillance des frontières extérieures de l'Union.
À la Commission européenne, on estime, au demeurant, que les États membres sont, à titre principal, responsables du contrôle de leurs frontières extérieures. Pourtant, la situation est préoccupante. Le dernier rapport trimestriel de l'agence Frontex est, à cet égard, édifiant. En 2013, on a enregistré plus de 107 000 entrées illégales dans l'Union soit une hausse de 48 % par rapport à 2012. Le troisième trimestre 2013 a battu tous les records d'entrées illicites aux frontières extérieures de l'Union, avec 47 400 passages illégaux, contre 20 000 en 2012. Au quatrième trimestre de cette année, on a détecté aux frontières un nombre d'illégaux sans précédent depuis 2009 sur une période équivalente. Sur les quatre premiers mois de l'année 2014, le nombre de traversées recensées entre l'Afrique du nord et l'Italie aurait presque décuplé par rapport aux quatre premiers mois de l'année 2013. Au point que les autorités italiennes n'arrivent plus à faire face.
Il semble qu'on ait dépassé le stade où certains États membres, confrontés à de ponctuelles poussées migratoires, avaient simplement besoin d'être épaulés par l'agence européenne Frontex qui ne dispose, au demeurant, que de 300 agents avec un budget en diminution en 2014 - 89 millions d'euros, soit environ 0,4 % du budget de 24 milliards de dollars que les États-Unis y consacrent, avec 63 000 douaniers et leurs 50 000 garde-côtes.
Un projet de règlement sur la surveillance des frontières extérieures de l'Union est en cours de discussion. Mais il faut maintenant aller plus loin. Chaque État membre de l'Union doit comprendre qu'il est directement concerné par les pressions migratoires qui s'exercent sur les pays de la périphérie.
Le principe de libre-circulation à l'intérieur du territoire de l'Union ne peut plus être remis en cause - ce qui ne serait d'ailleurs pas souhaitable. En conséquence, tous les États membres ont la responsabilité de la surveillance des frontières extérieures. C'est la contrepartie de la création de l'espace Schengen. On ne devrait même plus parler de solidarité entre États membres mais de responsabilité commune.
Il y a plusieurs années, notre délégation aux affaires européennes avait préconisé la création de gardes-frontières européens. Cette proposition est toujours sur la table. Il s'agirait maintenant de l'activer. Contrairement à ce que certains pensent, c'est impérativement de plus d'Europe dont nous avons besoin sur ce dossier. Le repli sur soi serait parfaitement illusoire : les défis à relever en la matière appellent des réponses que chaque État membre seul est bien incapable d'apporter, et qui doivent mobiliser toute l'Europe.
Le règlement de la situation d'urgence que je viens de décrire n'est nullement contradictoire avec la mise en place d'une véritable gestion raisonnée et prospective des flux migratoires, à l'échelle européenne. Les principes qui doivent gouverner cette politique ont été définis depuis longtemps. Mais chacun voit que si l'actuelle crise migratoire ne trouve pas rapidement de solution, toute politique globale d'accueil et d'intégration risque d'être compromise.
J'évoquerai maintenant un dossier voisin du précédent, celui de l'asile.
Un chiffre tout d'abord : d'après Eurostat, les demandes d'asile dans l'Union européenne auraient atteint 435 000 en 2013, soit une hausse de 36 % par rapport à 2012.
En la matière, il existe, au sein de l'Union, de grandes disparités : quant au nombre des États membres qui accordent le droit d'asile, tout d'abord - cinq à six États, au premier rang desquels l'Allemagne, la France, la Suède et les Pays-Bas, prennent en charge 80 à 90 % des demandeurs d'asile - ; quant au taux d'acceptation, ensuite. Ainsi, certains États, accordent le statut de réfugié à 80 % des Irakiens qui en font la demande, quand d'autres ne le délivrent qu'à 3 % des demandeurs de cette nationalité !
Certains États, comme la France, ont une culture et une expérience de l'asile. D'autres en sont totalement dépourvus - c'est le cas des États nouvellement entrés dans l'Union européenne. Les procédures et les pratiques diffèrent d'un pays européen à l'autre. Le statut de réfugié et les aides qui l'accompagnent sont aussi très différents d'un État membre à l'autre.
Un paquet législatif comportant trois directives - la directive « qualification » - relative aux critères d'éligibilité des demandes -, la directive « procédure » et la procédure « accueil » - a été adopté par le Parlement européen au mois de juin 2013. L'adoption de ces textes et leur transposition devraient permettre un certain nombre d'harmonisations. L'actuelle explosion de la pression migratoire sur certains de ces pays pourra peut-être relancer le débat.
Mais ce qui importe avant tout pour l'Europe, c'est de mieux s'investir dans les régions du monde dont les demandeurs d'asile sont originaires. Les États européens devraient, par exemple, s'engager massivement avec des aides financières, mais aussi des programmes d'aide opérationnelle et technique, en faveur de l'Afrique et notamment en direction des pays africains qui accueillent parfois des millions de réfugiés. La Commission européenne appelle de ses voeux des programmes de ce type, qui pourraient être mis en oeuvre par les États membres de concert avec l'Union européenne, pour aider les régions du monde les plus concernées ; certains États européens, en fonction du contexte historique, pourraient d'ailleurs être mieux placés que d'autres pour piloter ce type d'opérations.
Dans le domaine de la sécurité intérieure, les progrès sont lents mais incontestables, notamment en matière de coopération policière. Europol, qu'une délégation de notre Commission des affaires européennes a récemment visité, apparaît à cet égard comme une vraie réussite. Se qualifiant lui-même comme un « méga-moteur de recherche », il facilite, à l'évidence, la transmission des informations entre États membres.
Il reste qu'aux yeux de la Commission, la sécurité intérieure est avant tout affaire des États membres et donc des politiques régaliennes. Elle ne s'en félicite pas moins de l'amélioration constante de la collaboration entre les différentes organisations policières. Cette coopération, au demeurant, a vocation à se renforcer à l'heure où la cybercriminalité et les différentes formes de grande criminalité organisée se consolident.
J'en viens aux perspectives de l'après Stockholm dans le domaine de la justice.
La Commission entend, à l'horizon 2020, renforcer ce qu'elle appelle l'État de droit. Elle a publié, au mois de mars dernier, une communication intitulée « Un nouveau cadre de l'Union européenne pour renforcer l'État de droit ». L'objectif est de combattre les violations du droit de l'Union lorsqu'elles existent, mais aussi la mise en cause des valeurs européennes dans tel ou tel État membre.
Lorsqu'un État membre de l'Union décide de se mettre en dehors de la loi, la Commission propose d'enclencher un mécanisme spécifique qui comprendrait deux étapes : un processus d'établissement des faits, suivi d'un dialogue avec l'État membre afin qu'il en vienne à respecter les règles et les valeurs de l'Union. Si ce dialogue n'aboutissait pas, une recommandation pourrait intervenir qui, si elle n'était pas suivie d'effet, serait susceptible de déclencher - perspective certes un peu illusoire et que la Commission appelle elle-même son arme atomique - l'application de l'article 7 du traité, qui prévoit la suspension du droit de vote au Conseil de l'État récalcitrant.
Des pays comme la Hongrie ou la Roumanie sont, en particulier, dans le viseur de la Commission. Rappelons par exemple que la Hongrie s'est débarrassée de 600 juges, tout simplement en abaissant l'âge de la retraite des magistrats.

Sur le dossier du parquet européen, que j'ai eu l'honneur de rapporter, nous plaidions, suivis en cela par beaucoup d'Etats membres, en faveur de la collégialité, quand la Commission européenne privilégiait un projet très intégré, qui érigeait l'Olaf (Office européen de lutte antifraude) en procureur général unique. Nous avons voté l'exception de subsidiarité, et, avec quatorze chambres nationales, brandi un carton jaune devant la Commission. Ce qui fut fructueux, puisqu'elle a revu son projet et ne se montre plus hostile à l'idée de collégialité. Elle s'attache, en revanche, à faire prévaloir deux aspects qui lui paraissent essentiels : l'efficacité et l'indépendance du parquet européen.
Le schéma qui semble rallier aujourd'hui tous les suffrages, à l'exception de ceux du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, serait le suivant : un procureur en chef avec cinq adjoints ; une formation collégiale de vingt à vingt-cinq membres - un par État. La formation collégiale, qui pourrait être divisée en chambres permanentes ou ad hoc pour traiter les dossiers, serait le lieu du pouvoir stratégique pour toutes les décisions importantes - engager des poursuites ou de classer sans suite une affaire, notamment. Le procureur européen serait quant à lui chargé de faire tourner la structure et d'assurer le suivi des dossiers traités. Dans les États membres, enfin, siègeraient des procureurs délégués.
La Commission européenne restera ferme sur ce qu'elle estime marquer l'indépendance du parquet européen à l'égard des États membres. Si une affaire concerne la Roumanie, par exemple, elle refuse que le procureur roumain du parquet européen soit seul en charge du dossier. Elle accepte toutefois, c'est le bon sens, que ce procureur puisse siéger dans la chambre qui prendra la décision.
En tout cas, tous mes interlocuteurs ont insisté sur le fait que le carton jaune des parlements nationaux a eu un impact psychologique déterminant. Voilà qui ouvre, peut-être, une ère de collaboration plus étroite entre la Commission européenne et les parlements nationaux...
J'en viens au dossier relatif à la protection des données personnelles, sur lequel il convient d'être prudent. La Commission recherche manifestement un hypothétique équilibre entre la protection des données et le développement des entreprises européennes dans le domaine du numérique. Les plus optimistes relèvent que la situation évolue lentement et que le Parlement européen a, pour sa part, bien avancé sur le sujet. Les pessimistes constateront qu'il sera sans doute difficile de trouver une solution avant la fin de l'année 2015, les blocages restant forts sur un certain nombre de points.
Les données personnelles constituent une matière première d'une valeur considérable : le marché mondial des données représente sans doute des trilliards d'euros. L'Europe, estime la Commission, a un puissant intérêt à voir se développer sur son sol des Google européens. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas oublier les enjeux liés aux droits des personnes, auquel la France est très attachée : droit d'accès - qui détient quoi concernant tel ou tel citoyen -, droit au consentement, droit à l'oubli, droit au refus de voir traiter et exploiter des données personnelles, interprétation uniforme des droits des citoyens au niveau européen.
Le projet de règlement sur la protection des données personnelles civiles et commerciales, de même que le projet de directive sur les données pénales et judiciaires s'efforcent de répondre à ces enjeux.
À la suite de l'affaire Snowden, la Commission a adressé treize recommandations au Gouvernement américain pour « assainir » les relations entre l'Europe et les États-Unis en matière d'échange de données et rétablir la confiance. Douze d'entre elles ont un caractère technique ; la treizième touche à une question capitale : qu'advient-il des données européennes transférées aux Etats-Unis ? La discussion n'est pas facile mais les lignes semblent bouger. On se dirige, semble-t-il, vers une restriction d'accès à ces données pour les agences de sécurité, comme la NSA...
Qu'un désaccord persiste sur la treizième recommandation, soulèverait, estime la Commission, un vrai problème politique. Le gouvernement américain, rappelle-t-elle, n'est pas la seule partie prenante en la matière, et le Congrès américain semble plutôt hostile à la position européenne. La Commission invite donc les parlementaires des États membres à nouer le dialogue avec leurs collègues américains.
J'en viens à la formation des juges en Europe. C'est un aspect très important du programme de travail que la Commission européenne souhaiterait mettre en oeuvre pour les cinq prochaines années. La formation des magistrats tient une place importante dans le programme justice de 2015-2020. La moitié des crédits de la Commission dédiés à la Justice y sera consacrée.
J'en tire deux conclusions, non sans avoir au préalable rappelé que les éléments d'information qui m'ont été présentés, et qui constituent la matière première de cette communication, m'ont été fournis par des représentants d'institutions européennes en fin de mandat. J'ai donc été souvent destinataire de réflexions pouvant s'apparenter à des testaments politiques.
J'estime parfaitement fondé le souhait exprimé par la Commission de consacrer le mandat à venir à la simplification, à la consolidation et à la mise en oeuvre des textes législatifs existants au plan européen. Mes interlocuteurs se sont souvent montrés modestes, développant l'idée que les institutions européennes existaient pour apporter une valeur ajoutée aux politiques conduites par les États membres dans le secteur, et s'efforçaient de mettre en place un socle minimal et acceptable par tous de règles et de procédures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile, de l'immigration, des visas, etc.
Ma seconde conclusion sera peut-être plus sévère, en tout cas plus franche. Dans le secteur de la justice et des affaires intérieures, l'Union européenne dispose de moyens fort maigres, voire dérisoires, même si certains investissements ont été substantiels, en particulier pour Europol.
Je vous ai indiqué tout à l'heure que le budget consacré par l'Union à la surveillance de ses frontières extérieures représentait environ 0,4 % du budget que les États-Unis dédient à cette fin. En adhérant à l'Union européenne, beaucoup d'États n'ont pas compris que l'entrée dans l'espace Schengen - la Bulgarie et la Roumanie n'y sont pas encore parties mais pourraient le devenir d'ici peu de temps - impliquait le contrôle de leur portion de frontières extérieures pour le compte de tous les autres États membres. Cette contrainte est d'autant plus forte que les accords de Dublin les obligent à traiter les demandes et à héberger, en cas d'acceptation, les réfugiés qui ont présenté leur requête sur leur territoire. Et pourtant, ces États sont souvent dans l'incapacité d'assurer un contrôle efficace de leurs frontières. Il y faudrait un renfort européen.
Désormais, il faut tirer les conséquences de cette situation. Le repli sur soi n'étant pas une solution, ce sont au contraire les moyens mutualisés de l'Europe toute entière qui doivent être renforcés et mis au service des politiques d'immigration, d'asile et d'intégration, pour le plus grand profit de tous les États membres de l'Union européenne.

Ce rapport a déjà été adopté par la commission des affaires européennes. Nous suivons la question de très près, d'où cette communication. Nous nous sommes rendus plusieurs fois à Bruxelles, et projetons de visiter la Cour de Luxembourg, dès que l'ordre du jour de la séance plénière nous le permettra.

Soyons optimistes : nous nous rendrons prochainement à la Cour de justice.

Ne nous berçons pas d'illusions. Le droit d'asile est régi par un traité international, qu'aucune instance européenne ne peut réécrire. Et il a son économie. La France fournit un échantillon de ce qu'est un droit d'asile respectueux des principes. Reste que 70% des demandes d'asile se révèlent, in fine, infondées : elles étaient, dès le départ, intentionnellement frauduleuses. Tous ceux qui ont travaillé à l'OFPRA ou siégé à la commission des recours des réfugiés le savent.
Nous savons tous que les traités européens sont difficiles à modifier. Ce qui a été obtenu avec Schengen et ses avenants représente le maximum de transfert de souveraineté qu'il soit possible d'obtenir en la matière. On n'obtiendra jamais l'unanimité des vingt-huit Etats membres pour transférer davantage de pouvoir de décision. Aussi déplaisant que cela soit à énoncer, le hit parade des droits sociaux oriente, en partie, les flux. Les Etats peu attractifs sont portés à laisser passer les demandes, quand les Etats dont la législation sociale interne est plus attirante sont moins coulants. Si une directive doit décider des critères, il risque d'y avoir des tiraillements.

La transposition tend à affiner et à harmoniser les critères. Il y a urgence à s'assurer que l'Europe garantisse ses frontières.