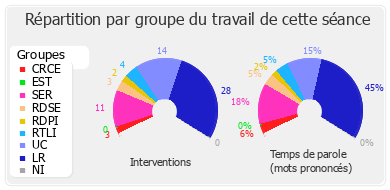Séance en hémicycle du 19 mars 2019 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 14 mars 2019 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

La parole est à Mme Laurence Cohen, auteure de la question n° 582, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la garde des sceaux, depuis plus de vingt ans, les personnels du tribunal de grande instance de Créteil dénoncent la présence d’amiante dans les locaux, laquelle est responsable de nombreuses maladies et, probablement, du décès d’une ancienne magistrate ainsi que de deux autres personnes en 2018. Après plusieurs années de déni de la part des autorités concernées, une expertise a démontré en 2006 que de l’amiante était bien présent dans les dalles au sol, les cloisons de bureaux ou bien encore dans les volets coupe-feu de ce bâtiment construit en 1977.
Dans la salle des archives où sont stockés les dossiers, le taux d’amiante atteignait 38 fibres par litre avant un désamiantage en 2009, puis 22, 6 fibres par litre après les travaux, alors que le seuil réglementaire est de 5 fibres par litre.
La mobilisation syndicale réunissant magistrats, policiers et fonctionnaires du TGI commence à être entendue, puisque les services du ministère ont assuré que tout agent en faisant la demande bénéficierait d’un suivi médical. C’est une bonne chose.
Néanmoins, madame la garde des sceaux, n’estimez-vous pas plutôt qu’il serait indispensable de prévoir un suivi médical obligatoire de toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé au tribunal de grande instance de Créteil ? Quelles sont aujourd’hui les mesures d’urgence mises en place pour protéger les fonctionnaires en poste ainsi que les usagers ?
Par ailleurs, pouvez-vous me confirmer le calendrier des travaux, censés débuter au printemps 2019 ? Une enveloppe budgétaire de 5, 2 millions d’euros pour le désamiantage est-elle bien prévue ?
Enfin, pouvez-vous intervenir auprès du président du TGI, afin qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail extraordinaire commun aux ministères de l’intérieur, de la justice et des armées et au conseil départemental du Val-de-Marne puisse se réunir dans les plus brefs délais ? Il s’agit là d’une demande légitime, qui est jusqu’à présent refusée.
Madame la sénatrice Cohen, le tribunal de grande instance de Créteil, mis en service en 1978, contient des matériaux amiantés, comme nombre de bâtiments de cette période. À ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique visant à protéger la santé des occupants et des travailleurs appelés à y faire des travaux. À cet égard, les diagnostics amiante réalisés conformément à la réglementation depuis 1997 ont conclu que les matériaux amiantés présents dans le bâtiment ne relèvent pas de la liste des matériaux friables exigeant un désamiantage.
Le ministère de la justice n’a jamais nié la présence d’amiante dans ces locaux et la situation du TGI de Créteil retient toute mon attention. À la suite du décès récent d’une magistrate, j’ai demandé à mes services de prendre toutes les mesures qui s’imposent de nature à rassurer les agents.
Ainsi, le 11 octobre dernier, le directeur des services judiciaires et la secrétaire générale adjointe du ministère se sont rendus au TGI de Créteil et y ont rencontré les personnels. Ils ont annoncé des mesures d’empoussièrement généralisées, qui seraient conduites en concertation étroite avec les organisations syndicales et avec les agents, afin de donner aux personnels concernés toutes les informations qu’ils attendent légitimement pour dissiper leurs éventuelles craintes. Ces mesures se sont déroulées entre les mois de novembre 2018 et de février 2019. Le nombre de mesures imposé par les normes a été complété en concertation avec les organisations syndicales. Ce sont ainsi deux vagues successives de 192, puis 144 mesures, qui ont eu lieu, ce qui constitue une densité exceptionnellement élevée de points de contrôle. La totalité des résultats est disponible depuis la semaine dernière et tous sont négatifs : aucune fibre n’a été détectée.
Ces informations fiables et objectives apportent, je le crois, une réponse rassurante.
Mes directeurs ont également indiqué, en accord avec les chefs de juridiction, que toute personne craignant une exposition pourrait se manifester et verrait sa situation portée à la connaissance de la médecine de prévention. Des mesures ont été prises afin de permettre des consultations rapides.
L’opération de désamiantage et de rénovation du site est désormais lancée.
Les travaux préparatoires ont débuté en 2018. Ces travaux vont se poursuivre en 2019 avec la construction du bâtiment modulaire, qui accueillera une partie des services situés dans l’actuel immeuble de grande hauteur. En parallèle sera menée la phase d’appel d’offres des travaux de désamiantage et de mise aux normes. Le financement de l’ensemble de cette opération est assuré grâce aux crédits votés dans le projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice.
Les instances représentatives et le personnel sont régulièrement informés des mesures prises et des travaux réalisés. C’est bien le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental du ministère de la justice qui a l’entière compétence pour assurer le suivi des actions menées pour le bâtiment du tribunal de grande instance de Créteil et pour l’ensemble des personnels concernés. Le président du TGI de Créteil lui a communiqué le diagnostic amiante du tribunal. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se réunir prochainement pour une séance dédiée à ces questions.
Comme vous le voyez, madame la sénatrice, ce sujet retient toute mon attention.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour répondre à Mme la garde des sceaux.

Madame la garde des sceaux, je vous remercie de ces précisions. Mes questions montrent que se pose un problème d’information non seulement des personnels, mais aussi du public qui fréquente le TGI.
Ces travaux sont un véritable serpent de mer ! J’ai alerté plusieurs fois le ministère sur ce point. La vigilance est de mise et il faut un réel suivi.
Je regrette que, sur ce problème de santé publique, la proposition que je formule d’une visite systématique pour tous les personnels n’ait pas retenu votre attention : il faut que ce soient les personnels qui le demandent.

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, auteur de la question n° 687, adressée à Mme la ministre du travail.

Madame la ministre, tous les matins, dans notre pays, les artisans sont plus de 3 millions à faire vivre notre économie : menuisiers, peintres, boulangers… Les secteurs d’activités sont divers, mais tous se réfèrent à une même étymologie : l’artisan, c’est celui qui met son art au service d’autrui. À l’heure où nos concitoyens se tournent vers le « fabriqué en » et s’éloignent des produits mondialisés « made in », nous avons grand besoin d’un tel savoir-faire.
Répartis sur 1, 3 million d’entreprises, réalisant 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires, les artisans constituent un pilier majeur de notre économie, mais sont, souvent, le seul employeur restant dans quelques-unes de nos communes. Dans le département de Lot-et-Garonne, 8 000 entreprises, soit 12 000 salariés, réalisent plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Peut-on se passer d’eux ? À voir l’atteinte qui est portée à leurs droits à la formation, pardonnez-moi, madame la ministre, mais j’ai la faiblesse de le croire ! En effet, depuis le 15 mars dernier, les demandes de financement de formation professionnelle continue de nos artisans ne sont plus prises en compte. N’êtes-vous pourtant pas à l’initiative de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ?
La situation est néanmoins préoccupante, voire injuste : pourquoi nos artisans n’auraient-ils plus droit à la formation continue ? Dans un contexte concurrentiel fort, où les clients ont toujours plus d’exigences, à l’heure des transitions écologiques et numériques et d’un environnement normatif complexe, nos artisans doivent se former pour s’adapter aux défis toujours plus nombreux.
Alors que 700 000 emplois sont à pouvoir et que l’apprentissage constitue un véritable levier pour lutter contre le chômage, pouvez-vous nous assurer, madame la ministre, que vous allez agir pour financer de nouveau la formation de nos artisans ?
Madame la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat, je partage avec vous cette conviction et je le dis tous les jours – pas seulement aujourd’hui ! – : l’artisanat, c’est le tissu économique de proximité qui irrigue tous nos territoires, c’est le savoir-faire à la française. C’est donc très important. Que ce soit les ordonnances Travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les actions que le Gouvernement mène pour développer la filière d’excellence qu’est l’apprentissage : tout concourt à conforter ces professionnels et à renforcer notre tissu d’artisans.
Vous avez souhaité appeler mon attention sur l’annonce récente du risque de suspension du financement des actions de formation des artisans par le Fafcea, le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale, à compter du 15 mars 2019. Cet organisme a fait part à mon ministère de difficultés dans le financement des formations des artisans en raison d’un changement du mode de collecte et d’une baisse importante du niveau de collecte.
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, votée sous le précédent gouvernement, a prévu un transfert de la collecte des contributions des artisans de la DGFiP vers l’Urssaf ; il s’agit là d’une mesure de simplification tout à fait compréhensible, mais qui a révélé un problème de cotisations. Ces difficultés s’expliquent également par une diminution du nombre de cotisants recensés lors du transfert de la collecte des contributions des artisans.
Ces difficultés s’expliquent encore par le fait que de nombreux artisans salariés, assujettis à la fois à la contribution à la formation professionnelle en tant que travailleur indépendant versée au Fafcea et à la contribution à la formation professionnelle en tant que salarié versée à leur opérateur de compétences, ont refusé de s’acquitter à l’automne 2018 de la contribution due en tant que travailleur indépendant, contestant la légalité de ce double assujettissement qui n’existe que pour les artisans.
Afin de garantir la continuité du financement par le Fafcea et les conseils de la formation des actions de formation des artisans pour l’année 2019, plusieurs réunions ministérielles et interministérielles ont été organisées ces dernières semaines, et encore ces derniers jours, avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les dirigeants du Fafcea et les représentants de toute la filière.
Ces réunions ont abouti à la proposition d’un certain nombre de mesures d’ordre financier permettant de poursuivre la prise en charge des actions de formation des artisans, sur l’ensemble de l’année. Les versements de l’Acoss au Fafcea et aux conseils de la formation sont intervenus hier, lundi 18 mars 2019, pour « sauver » la situation à court terme.
Par ailleurs, nous avons lancé une mission de l’Inspection générale des affaires sociales, portant sur le système de collecte et de répartition de la contribution à la formation professionnelle entre les Fonds d’assurance formation des non-salariés et la situation comptable et financière du Fafcea et des conseils de la formation, afin de trouver une solution durable.
J’ai demandé que le rapport de cette mission me soit remis à la fin du mois de juin prochain, afin de pouvoir inscrire les propositions qui seront retenues dans la durée, au plus tard au 1er janvier 2020. Nous avons le même objectif. Nous avons sauvé la situation à court terme ; maintenant, il faut la régler sur le long terme.

La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, pour répondre à Mme la ministre.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse encourageante. Soyez assurée que les 3 millions d’artisans veilleront à ce que la parole donnée soit respectée.

La parole est à Mme Maryse Carrère, auteure de la question n° 644, adressée à Mme la ministre du travail.

Madame la ministre, vous connaissez l’attention particulière que les sénateurs du groupe du RDSE portent au problème de l’illettrisme, notamment l’illettrisme numérique.
Aussi, je me permets de relayer les inquiétudes de l’association #STOPILLETTRISME concernant le financement des formations professionnelles en la matière. En effet, il existe aujourd’hui une forte incertitude sur le financement des formations professionnelles dédiées à l’acquisition et au développement des connaissances et des compétences clés, notamment avec le plafond du compte personnel de formation, le CPF, celui-ci passant d’une logique en heures à celle d’une somme plafonnée à 8 000 euros sur dix ans. Cela crée une insécurité sur les formations prévues pour les prochains mois et dans les années à venir.
Les formations favorisant l’acquisition des connaissances et des compétences clés, d’une part, et les formations de lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme, d’autre part, sont, par nature, des formations longues et coûteuses, qui sont utiles seulement si elles sont déployées sur plusieurs années. Pourtant, on note une tendance au désinvestissement du champ des compétences clés au profit de formations courtes, uniquement qualifiantes, qui ne correspondent pas aux besoins des salariés en situation d’illettrisme.
Madame la ministre, quel avenir réservez-vous à l’accompagnement des salariés en situation d’illettrisme et d’illectronisme dans la gestion de leur CPF et quelles réponses pouvez-vous apporter au problème du financement de ces formations longues et coûteuses pour nos concitoyens les plus fragiles ?
Madame la sénatrice Maryse Carrère, je confirme que le Gouvernement est pleinement engagé dans tout ce qui permet de stimuler la croissance et de la rendre inclusive. La lutte contre l’illettrisme fait partie de ces actions, qu’elles concernent les demandeurs d’emploi ou les salariés, car, nous le savons, les changements de technologie révèlent souvent des situations d’illettrisme jusqu’alors inconnues. Or il faut permettre à tous les salariés de suivre ces évolutions.
La bataille des compétences ne se segmente pas : elle va du plus haut niveau de qualification jusqu’à l’illettrisme. C’est la bataille principale en matière d’emploi.
C’est le sens tant des transformations profondes apportées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel que des 15 milliards consacrés dans le cadre du plan quinquennal d’investissement dans les compétences. Ces mesures s’adressent notamment à ceux qui en ont le plus besoin – chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification… –, où les situations d’illettrisme ne sont pas négligeables.
Le Gouvernement a assuré la continuité du financement des formations de lutte contre l’illettrisme éligibles au CPF, parmi lesquelles le certificat de connaissances et de compétences professionnelles, dit CléA, première marque de la sortie de l’illettrisme que cherchent les salariés concernés, puisqu’il s’agit d’une reconnaissance officielle.
Comment garantir la continuité du financement ? La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a fixé une entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au CPF au 1er janvier 2019. Le décret relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences a été publié le 30 décembre dernier.
Ainsi, les salariés peu ou pas qualifiés bénéficient d’ores et déjà d’un plafond de droits CPF majorés, à hauteur de 800 euros par an, dans la limite d’un plafond de 8 000 euros, ce qui est bien supérieur au montant observé des formations de lutte contre l’illettrisme.
Par ailleurs, je vous rappelle que le CPF n’est pas le seul outil d’accès des salariés à la formation professionnelle. Ainsi, il existe le plan de développement des compétences des entreprises, qui remplace désormais le plan de formation. En outre, et c’est un dossier que nous devons suivre ensemble, des formations collectives organisées dans le cadre de la décentralisation sont mises en place. En effet, en matière de lutte contre l’illettrisme, la compétence formation a été décentralisée voilà plusieurs années, mais les pratiques restent inégales : certaines régions ont poursuivi dans cette voie, d’autres ont presque stoppé, voire complètement stoppé. Il s’agit là d’un véritable sujet de préoccupation, qui fait l’objet de discussions avec les régions, dans le cadre des pactes régionaux d’investissement dans les compétences. Ainsi, des pactes ont été signés ou sont en passe de l’être avec onze régions métropolitaines et trois régions d’outre-mer – je me rendrai d’ailleurs en Occitanie à la fin du mois pour signer l’un d’entre eux avec la présidente de la région.
Il s’agit bien évidemment de toucher les publics les plus vulnérables : cela passe par des plans de lutte contre l’illettrisme ou des parcours de formation aux savoirs de base. Vous l’avez rappelé, par savoirs de base, on entend aussi les savoirs de base numériques et les compétences sociales et cognitives ; tout cela forme un ensemble.
Tous ces dispositifs permettront une logique de parcours plus importante. Évidemment, la lutte contre l’illettrisme fait partie de la bataille des compétences. Chacun doit être en mesure non seulement de lire, écrire, compter, mais aussi de naviguer – sans jeu de mots – dans l’univers d’aujourd’hui. C’est une priorité du plan d’investissement compétences et le compte personnel de formation permettra d’y contribuer pour les salariés comme pour tous les actifs.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Un effort spécifique s’impose sur ces formations sur l’illettrisme et l’illectronisme, qu’il ne faut pas considérer comme des formations classiques dans le cadre du CPF.
Selon le secrétaire d’État chargé du numérique, 13 millions de Français seraient aujourd’hui en situation d’illectronisme : ce sont bien sûr les plus fragiles et les plus isolés d’entre nous, les Français les plus pauvres et les personnes éloignées de l’emploi, mais aussi – et c’est ce qui m’inquiète le plus – les moins de 35 ans les plus socialement défavorisés. Il ne faut pas laisser ces publics sur le bord du chemin.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, auteur de la question n° 575, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous interroger sur le transfert de la gestion des digues au bloc communal, en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam.
À compter du 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, sont devenus gestionnaires des ouvrages de protection ; en d’autres termes, ils sont désormais dans l’obligation de déclarer les ouvrages mis en œuvre sur le territoire communautaire et organisés en système d’endiguement, d’annoncer les performances qu’ils assignent à ces ouvrages ainsi que les zones protégées correspondantes et d’indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d’eau les plus élevées.
Afin de faciliter la transition entre les anciens et les nouveaux gestionnaires, des périodes transitoires sont prévues. L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des digues à la date d’entrée en vigueur de la loi Maptam, continue d’assurer cette gestion pour le contrôle de l’EPCI pendant une durée de dix ans à compter de cette date, soit jusqu’au 28 janvier 2024.
Or, à la perspective de ce transfert, qui interviendra désormais dans cinq ans, de nombreuses inquiétudes subsistent. Aussi, je vous demande quels moyens financiers et techniques ont été programmés par l’État pour l’assurer.
Madame la sénatrice Nadia Sollogoub, vous avez interrogé François de Rugy, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m’a chargée de vous répondre.
Le législateur a confié, à partir du 1er janvier 2018, la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, la Gemapi, aux EPCI à fiscalité propre, concentrant ainsi à l’échelon du bloc communal des compétences jusque-là morcelées. Celui-ci pourra ainsi concilier urbanisme, c’est-à-dire une meilleure intégration du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire et dans les documents d’urbanisme, prévention des inondations, notamment la gestion des ouvrages de protection, et gestion des milieux aquatiques eux-mêmes.
S’agissant des digues domaniales de l’État, le législateur a prévu une période de transition adaptée, qui prendra fin au mois de janvier 2024, pendant laquelle l’État continue d’assurer sans refacturation la gestion de ces ouvrages, pour le compte des intercommunalités concernées.
Les intercommunalités qui le souhaitent peuvent toutefois reprendre la gestion de ces digues avant 2024. Certaines intercommunalités ont d’ailleurs fait ce choix, de manière à avoir la pleine maîtrise des différents leviers d’action de la Gemapi.
Dans cette période transitoire jusqu’à 2024, l’État travaille en étroite collaboration avec les collectivités chargées de la Gemapi, que ce soit pour les modalités de gestion de ces ouvrages, la réalisation de travaux de renforcement ou encore la préparation des dossiers d’autorisation de systèmes d’endiguement. Ces travaux ne seront donc plus à mener par les collectivités par la suite.
La fixation des niveaux de protection des digues revêt en effet un choix structurant pour les territoires et il est nécessaire que les autorités chargées de la Gemapi se prononcent sur ces choix, qui les engageront pour la suite. Le Gouvernement veille à ce que l’État respecte les bonnes diligences de gestion des ouvrages pendant cette période de transition.
Par ailleurs, en liaison avec la collectivité compétente en matière de Gemapi, certaines de ces digues font l’objet de projets de travaux de renforcement afin d’augmenter leur niveau de protection, quand les enjeux exposés le justifient. Afin de faciliter la réalisation de ces travaux, l’État a en particulier prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2019 que les investissements financés sur le Fonds de prévention des risques naturels majeurs ne soient plus limités, comme c’était le cas auparavant, à un plafond annuel inadapté à la réalisation de ces projets.
Ainsi, l’État pourra, sur l’ensemble des cinq prochaines années, mobiliser jusqu’à 75 millions d’euros pour financer les travaux de renforcement des digues identifiés en liaison avec les collectivités. Après 2024, les travaux complémentaires pourront toujours faire l’objet d’un cofinancement par ce même fonds dans le cadre général mis en place par l’État, via un programme d’actions de prévention des inondations, un PAPI.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Madame la secrétaire d’État, je vous donnerai un exemple concret. Dans le sud de la Nièvre, sur les communes de Charrin et Saint-Hilaire-Fontaine, aucun entretien des digues n’a été réalisé par l’État pendant quatre-vingts ans, si bien que les arbres ont poussé et que les digues sont devenues une très agréable promenade.
À la perspective du transfert, une dévégétalisation a été lancée. Cette décision, que je qualifierai de brutale et qui semble avoir été prise dans la précipitation – c’est ainsi qu’elle a été perçue – a été bien mal comprise. Elle a même été vécue comme un « massacre à la tronçonneuse »…
En 2017, un bureau d’études indépendant, mandaté par l’État, a rendu ses conclusions. Pour atteindre un niveau de sécurité 1, il faudrait deux tranches de travaux, pour un montant total de 850 000 euros. Actuellement, l’État a investi 50 000 euros dans ces travaux de dévégétalisation. Qui paiera la différence ? C’est bien l’objet de ma question.
Un programme de confortement des digues après déboisement s’impose. Or ce n’est pas prévu. Les EPCI n’auront pas la capacité financière de réaliser ces travaux ; ils n’en auront pas non plus la capacité en termes d’ingénierie technique. Quid de leurs responsabilités dans ce cas, lorsque l’on sait que, en termes de gestion des risques d’inondation, rien n’est plus dangereux que la rupture de digues ? Que penser, enfin, d’un éventuel impôt supplémentaire qui serait levé pour compenser un défaut d’entretien par l’État depuis quatre-vingts ans ?

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 675, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la secrétaire d’État, la Méditerranée est en danger. Elle est victime des pollutions passées, avec les PCB, les polychlorobiphényles, et des pollutions chroniques, avec les dégazages d’hydrocarbures. Elle est victime des pollutions par les plastiques ou les métaux lourds, des pollutions par les nitrates et les phosphates dues à l’insuffisante épuration des eaux usées, notamment sur la rive sud. Enfin, elle est victime des pollutions dites émergentes, pharmaceutiques et cosmétiques, qui ont des effets reprotoxiques sur les espèces. Elle sera soumise, à l’horizon d’une génération, à une pression accrue de pollutions, dont les conséquences seront démultipliées par les effets du changement climatique.
Ce constat alarmant, je l’ai dressé dans le cadre des travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Opecst. J’ai ainsi publié un rapport d’information dans lequel, fort de ce constat qui n’incite pas à l’optimisme, j’avançais dix grandes catégories de propositions pour lutter contre ces pollutions sur l’ensemble du bassin. J’ai remis ce rapport au cabinet du ministre d’État, le 5 février dernier.
Au mois de juin 2018, j’avais longuement travaillé avec Nicolas Hulot sur les préconisations que j’avançais. Celui-ci s’était alors engagé à les mettre à l’étude et, surtout, via les ambassadeurs de France et des vingt et un États riverains, à mobiliser les ministres de l’environnement concernés afin de mettre à l’étude une nouvelle gouvernance de lutte antipollution, actuellement trop dispersée et peu efficace.
Ma question est simple. Comptez-vous donner suite aux initiatives envisagées par Nicolas Hulot ? Dans le cas contraire, quelles autres démarches comptez-vous engager afin de renforcer l’impulsion supranationale permettant de mieux lutter contre ces pollutions sur l’ensemble du bassin méditerranéen ?
Monsieur le sénateur Courteau, vous avez interrogé François de Rugy, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m’a chargée de vous répondre.
À l’échelon international, la France est déjà très active concernant la lutte contre les pollutions en mer. Elle est en effet partie à la convention de Barcelone et à son plan d’action pour la Méditerranée, le PAM, seule instance politique dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Cette convention regroupe l’ensemble des pays de la région Méditerranée. Elle constitue le principal instrument juridique pour la protection de la Méditerranée contre les différentes sources de pollution et pour la préservation de sa diversité biologique.
Par ailleurs, la France assure une partie du financement du plan Bleu, véritable centre d’analyse et de prospective pour la Méditerranée, dont l’objectif est d’éclairer les enjeux de l’environnement et du développement dans cette région. Près de 20 % du budget annuel du plan Bleu est directement financé par une subvention du ministère de la transition écologique et solidaire.
En outre, dans le cadre du plan Méditerranée pour une croissance bleue, la France s’est engagée à renforcer l’effectivité des mesures prises pour la réduction des pollutions issues des navires, grâce à l’approfondissement des coopérations entre les États riverains, notamment à travers un réseau spécialisé des procureurs, et à un dispositif de sanctions renforcé.
Cette mobilisation est ancienne, car, depuis 1993, la France, l’Italie et Monaco ont établi, dans le cadre de l’accord Ramoge, un plan d’intervention pour la lutte contre les pollutions marines accidentelles en Méditerranée. Il a d’ailleurs été activé par la France lors de la pollution intervenue au mois d’octobre dernier à la suite de la collision des navires Ulysse et Virginia au large de la Corse : des navires italiens sont venus prêter main-forte aux autorités françaises avec une remarquable efficacité.
Pour ce qui concerne la lutte contre les déchets d’origine plastique en mer, la France est engagée dans de nombreux plans d’action relatifs aux déchets marins, que ce soit au travers du G7, du G20 ou de conventions de mer régionales, par exemple la convention de Barcelone. La France a par ailleurs lancé, au mois de novembre 2016, lors de la COP 22 à Marrakech, la coalition internationale « Stop aux déchets plastiques ».
Enfin, dans le cadre européen, la France met en œuvre la directive-cadre sur l’eau et la directive-cadre stratégie pour le milieu marin.
Ainsi, notre pays adopte, dans ses plans d’action pour le milieu marin et ses schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, des programmes de mesures afin de lutter contre la pollution des eaux continentales et les conséquences littorales et marines.
Par ailleurs, lors du comité interministériel de la mer du mois de novembre 2018, le Premier ministre a demandé que soit adopté, d’ici à fin 2020, un plan de réduction de l’apport de macro-déchets et micro-plastiques à la mer à l’échelle de chaque bassin hydrographique, sur la base de l’alerte que vous avez lancée et du rapport que vous avez remis au mois de février dernier, monsieur le sénateur.
Vous le voyez, nous agissons sur tous les fronts pour protéger la Méditerranée.

La parole est à M. Roland Courteau, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je suis un peu déçu de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Vous ne donnez pas suite aux engagements de Nicolas Hulot, qui voulait mobiliser les ministres de l’environnement de tous les pays riverains.
La France doit prendre l’initiative, impulser de nouvelles actions.
L’Union pour la Méditerranée, l’UPM, est encalminée. Les pays des rives sud et est ne se conforment pas toujours aux dispositions de la convention de Barcelone et du plan d’action pour la Méditerranée.
Face aux dangers qui se profilent, la France ne peut-elle pas prendre la tête de l’offensive sur l’ensemble du bassin ? Allons-nous attendre que le point de non-retour soit dépassé sur cette mer petite et fragile ?
J’insiste, madame la secrétaire d’État : il y a urgence à agir !

Mes chers collègues, je vous demande de veiller au respect du temps de parole imparti.

La parole est à Mme Martine Filleul, auteure de la question n° 680, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement a osé ! Il a osé, alors que les Françaises et les Français réclament une meilleure prise en compte de la parole citoyenne, limiter une fois de plus la démocratie participative, sous couvert de simplification.
En effet, un décret du 24 décembre dernier pris en application de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance remplace expérimentalement, pendant trois ans, l’enquête publique, normalement prévue pour les projets soumis à autorisation environnementale, par une consultation en ligne dans les régions Bretagne et Hauts-de-France.
Le choix de ces régions n’est pas anodin : certains projets sur ces territoires ont fait l’objet de fortes oppositions, à l’exemple de la ferme des mille vaches dans la Somme ou de l’installation de parcs éoliens à Villers-Plouich dans le département du Nord.
Ce décret permet d’écarter de toute enquête publique les projets à risque qui feraient l’objet de réticences.
Restreindre le débat public sur des installations ayant une incidence importante sur l’environnement est une erreur, à l’heure où le développement durable et l’écologie constituent un enjeu important et font partie des préoccupations des habitants.
Par ailleurs, le recours à une consultation numérique se heurte à l’illectronisme, qui touche 13 millions de Français. Dans les Hauts-de-France, 11 % de la population est concernée. Cette décision va donc à rebours d’une volonté de participation du plus grand nombre, en excluant de fait de nombreuses personnes.
Une telle expérimentation marque, au mieux, une totale déconnexion de votre gouvernement des réalités et du quotidien de nos concitoyens, au pire, un profond mépris.
Aussi, madame la secrétaire d’État, ne pensez-vous pas qu’il conviendrait de mettre un terme à cette disposition ?
Madame la sénatrice Filleul, vous avez interpellé François de Rugy au sujet de l’expérimentation prévue par le décret du 24 décembre 2018, pris en application de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi Essoc.
Cette loi a acté le principe d’une expérimentation visant à substituer à l’enquête publique une procédure de participation par voie électronique dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale.
Je tiens à vous rassurer : cette substitution ne vise pas à restreindre les possibilités de participation des citoyens, ni à réduire la garantie de la prise en compte de leurs observations de manière transparente et objective.
Le remplacement de l’enquête publique par une participation par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation est conditionné à des garanties visant à renforcer la participation du public en amont – concertation préalable avec garant du code de l’environnement –, sans pour autant négliger la phase aval – participation par voie électronique à proprement parler –, avec le maintien d’une exigence d’accès à tous à l’information et à la participation.
L’objectif de l’expérimentation est bien d’inciter les porteurs de projets à réaliser une concertation approfondie le plus en amont possible, avant le dépôt des demandes d’autorisation, c’est-à-dire au moment où il est encore possible de faire évoluer substantiellement le projet.
En effet, bien que la procédure de participation par voie électronique soit par principe dématérialisée, elle prévoit également un certain nombre de mises à disposition classiques, notamment par format papier, qui permettent un accès du public à l’information par d’autres canaux que la mise en ligne.
Le public peut ainsi demander une communication du dossier sur support papier, dans les conditions définies à l’article D. 123-46-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente peut également prévoir, en fonction du volume et des caractéristiques du projet de décision, des modalités de consultation du dossier in situ. Enfin, l’article 56 de la loi Essoc prévoit, dans le cadre de l’expérimentation, la possibilité de transmettre les observations par voie postale.
Cette procédure de participation par voie électronique ne restreint donc pas la possibilité du public d’opter pour une mise à disposition du dossier papier et de s’exprimer par voie postale. Elle n’empêche pas tous ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent avoir accès à des outils informatiques d’exprimer leur avis sur ce type de projets.
Enfin, madame la sénatrice, je peux vous assurer que nous serons vigilants à ce que l’évaluation réalisée à l’issue de cette expérimentation mette en lumière les avantages et les inconvénients relevés au cours de ces trois années.

La parole est à Mme Martine Filleul, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Elle me rassure en partie.
Vous avez évoqué des dispositifs qui permettent de procéder en amont à des consultations écrites et à des concertations. Il conviendrait toutefois de mieux les faire connaître aux responsables locaux et aux citoyens.
Le décret en question a suscité beaucoup d’émotion dans les territoires et je compte sur vous, madame la secrétaire d’État, pour pallier ce défaut d’information.

Mes chers collègues, madame la secrétaire d’État, encore une fois, j’appelle chacun d’entre vous à respecter le temps de parole imparti.

La parole est à M. Gilbert Bouchet, auteur de la question n° 528, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la secrétaire d’État, ma question concerne les modifications de la desserte ferroviaire de la gare de Valence-TGV dans la Drôme.
À la fin de l’année dernière, la SNCF a annoncé, sans aucune information préalable, la nouvelle grille horaire du trafic des trains, notamment la réduction du nombre de TGV le matin en direction de Lyon.
Cette modification est d’autant plus incompréhensible pour les élus que la SNCF avait sollicité financièrement la communauté d’agglomération et la région pour des projets d’aménagement de cette gare, et que ces derniers s’inscrivaient en théorie dans une logique de progression constante de la fréquentation de la gare de Valence-TGV, dont la situation bénéficie à un large territoire d’usagers potentiels.
Face à cette situation, de nombreux élus ont écrit à la SNCF et à Mme la ministre des transports pour faire part de leurs inquiétudes pour notre région.
Depuis, on a bien voulu nous indiquer les raisons de ces évolutions, qui s’expliquent notamment en raison des importants travaux engagés en gare de Lyon-Part-Dieu.
Les élus que nous sommes auraient grandement apprécié d’en être informés en amont, car la réduction du nombre d’allers-retours entre Lyon et Valence-TGV impacte directement notre territoire, d’autant que cela intervient à la suite d’autres suppressions survenues les années précédentes.
Concrètement, au lieu des trois TGV arrivant à Lyon-Part-Dieu avant neuf heures le matin, il n’y a plus désormais maintenant qu’une seule arrivée, à huit heures vingt.
Avec cet horaire, de nombreux voyageurs ne pourront plus prendre le train pour se rendre à leur travail, et les autres trouveront difficilement de la place pour voyager.
Dans la tranche horaire du soir, s’il y a toujours le même nombre de trains, c’est avec des modifications d’horaires et de gares, puisque le départ s’effectue désormais depuis la gare de Lyon-Perrache.
Nous craignons l’impact néfaste de cette suppression des arrêts en gare de Valence-TGV sur le tissu économique de notre région, avec, à terme, un risque de réduction de son attractivité.
Je tiens à rappeler en effet que de nombreuses entreprises situées sur le parc d’activités Rovaltain ont assis leurs activités et leur développement sur la proximité de liaisons ferroviaires rapides avec des horaires attractifs. Or la suppression de certains trains ne permet plus de faire l’aller-retour dans la journée à partir de la gare de Valence-TGV.
Je dois ajouter que les usagers ne trouveront pas de service de substitution avec le TER, dont le temps de trajet est sans commune mesure avec celui du TGV, et qui part de la gare de Valence-Ville.
L’inquiétude est réelle, certains craignant même que ces nouveaux horaires ne deviennent définitifs.
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous assurer que, face à ces enjeux pour la Drôme, vous veillerez, à l’issue des travaux engagés à la gare de Lyon-Part-Dieu, au rétablissement par SNCF Mobilités des TGV du matin en direction de Lyon depuis Valence-TGV, et du soir en provenance de Lyon-Part-Dieu ?
Monsieur le sénateur Bouchet, vous avez bien voulu interroger Élisabeth Borne sur la desserte de la gare de Valence. Ne pouvant être présente, elle m’a chargée de vous répondre.
Comme vous le savez, à compter de 2019 et au moins jusqu’en 2023, le pôle d’échanges multimodal de Lyon-Part-Dieu va connaître des travaux importants. Ce projet d’ampleur va se traduire par la fermeture temporaire de deux voies sur onze, limitant d’autant la capacité d’accueil de cette gare.
Cette contrainte technique a conduit SNCF Mobilités à travailler à une adaptation de l’offre grande vitesse entre Paris et les régions de l’Est et du Sud-Est, en détournant ou supprimant notamment certains TGV Marseille-Lyon et Languedoc-Paris desservant la gare de Valence-TGV. Au total, le nombre de liaisons quotidiennes entre Valence et Lyon passe ainsi de 15 en 2018 à 12 en 2019. L’évolution est en revanche stable dans le sens inverse, avec le maintien de 15 liaisons quotidiennes en 2019. Valence bénéficie par ailleurs, comme en 2018, de 13 allers-retours quotidiens avec Paris, dont 3 au départ de la gare de Valence-Ville.
Dans le sens Valence-Lyon, les évolutions concernent principalement la période de pointe du matin, puisque, parmi les trois TGV arrivant à Lyon-Part-Dieu avant neuf heures en 2018, un seul est conservé en 2019. La contrainte des travaux est telle sur cette tranche horaire qu’il n’est pas possible d’ajouter de TGV supplémentaire sans créer de conflits de circulation.
Dans le sens Lyon-Valence, SNCF Mobilités a en revanche décalé un TGV en période de pointe du matin, ce qui permet d’offrir désormais trois possibilités d’arriver avant neuf heures, contre deux en 2018.
En fonction de l’avancée des travaux, SNCF Mobilités sera attentive aux possibilités de rétablissement des TGV du matin en direction de Lyon.
À l’issue des travaux de la gare de Lyon-Part-Dieu, SNCF Mobilités s’engage enfin à réétudier le plan des dessertes grandes vitesses entre les territoires de l’Est et du Sud-Est.
En parallèle, SNCF Mobilités finalise le renouvellement de son parc TGV, avec le déploiement de nouvelles rames à deux niveaux ou duplex, non seulement plus confortables et plus fiables, mais surtout en mesure d’accueillir plus de voyageurs.
Conscientes des enjeux liés aux dessertes TGV, Élisabeth Borne et moi-même serons particulièrement vigilantes, durant cette période de travaux, à ce que le niveau de service ferroviaire sur votre territoire soit en mesure de répondre aux besoins de mobilité.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la question n° 627, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur les agréments délivrés aux auto-écoles pour exercer l’apprentissage de la conduite.
Actuellement, auto-écoles classiques et plateformes en ligne se voient délivrer des agréments par les préfets de département, comme le dispose l’article L. 213-1 du code de la route.
Or, de nombreuses décisions de justice issues de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris et du tribunal administratif de Lyon créent une grande confusion auprès des professionnels sur la portée nationale ou départementale de cet agrément.
Selon la partie réglementaire du code de la route, la portée nationale de l’agrément est reconnue puisque « les autorisations mentionnées […] sont valables sur l’ensemble du territoire national ».
Pourtant, la mesure ne semble pas si claire, le rapport d’information de l’Assemblée nationale publié le 29 novembre 2018 et consacré au suivi de la loi Macron recommandant d’inscrire dans le code de la route le caractère national de l’agrément afin de « mettre un terme aux recours contentieux qui se multiplient ».
Dans un autre rapport remis au Premier ministre le 12 février dernier, une députée La République En Marche propose la même mesure, ce qui n’a pas manqué de provoquer la mobilisation des auto-écoles classiques dans nombre de nos territoires.
En effet, ces professionnels constatent que certaines plateformes en ligne, qui ne disposent pourtant que d’un seul agrément, emploient des moniteurs dans plusieurs départements, voire dans toute la France, de façon bien moins transparente que les auto-écoles locales.
Madame la secrétaire d’État, partagez-vous la recommandation suggérant de donner un caractère national à l’agrément ? Seriez-vous favorable à faire clarifier le périmètre géographique de l’agrément préfectoral et sa durée en fonction de la nature du demandeur, entre une auto-école traditionnelle ou bien une plateforme en ligne, ce qui permettrait de réduire le contentieux judiciaire entre ces établissements plutôt que d’imposer à l’un ou à l’autre une décision non concertée ?
Madame la sénatrice Estrosi Sassone, le code de la route prévoit à son article L. 213-1 que l’activité d’enseignement à titre onéreux de la conduite de véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière est soumise à agrément de l’autorité administrative.
L’article réglementaire correspondant précise que ces agréments « sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement ».
C’est à juste titre, madame la sénatrice, que vous attirez l’attention du Gouvernement sur le caractère réglementé de l’activité d’enseignement de la conduite. L’agrément est en effet ce qui fonde la capacité de l’administration à diligenter des contrôles, tant pédagogiques qu’administratifs.
Vous évoquez les contentieux en cours et l’incertitude des professionnels de l’enseignement de la conduite sur la portée de cet agrément. La Cour de cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire, sera amenée dans les prochaines semaines à dire le droit sur ce point.
Le Gouvernement n’envisage pas de définir une réglementation différenciée selon le modèle économique des différents établissements de conduite. Il mettra en œuvre la décision de la Cour de cassation, qui aura matière à faire jurisprudence.
En tout état de cause, et dès aujourd’hui, le titulaire de l’agrément est responsable de la dimension pédagogique et administrative au sein de son établissement, et ce quelle que soit la nature du lien avec les enseignants et le département d’exercice.
La préoccupation du Gouvernement est donc de déployer un cadre de contrôles effectifs, contrepartie de l’agrément, pour l’ensemble des acteurs de l’enseignement de la conduite. Les préfets, qui sont responsables de ces contrôles, doivent ainsi exercer les responsabilités de police administrative qui leur appartiennent.
Dans le cadre des décisions relatives à la mise en œuvre des préconisations du rapport de Mme la députée Françoise Dumas, le Gouvernement procédera aux précisions et évolutions de textes qui seront rendues nécessaires par la jurisprudence qu’énoncera la Cour de cassation, ainsi que les évolutions du régime de contrôle et de sanctions qui vont de pair.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

J’entends, madame la secrétaire d’État, qu’il nous faut attendre la jurisprudence de la Cour de cassation, mais il est très important que l’agrément reste de portée départementale, les préfectures étant les mieux à même, de par leurs pouvoirs de police, de contrôler le respect des obligations légales. J’insiste sur ce point. Il en va aussi de la survie des auto-écoles physiquement présentes sur nos territoires et des emplois qui leur sont associés.

La parole est à M. Jean-François Longeot, auteur de la question n° 634, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la secrétaire d’État, la société TGV Lyria a annoncé la suppression d’un aller-retour Paris-Lausanne via Dijon, Dole, Frasne et Vallorbe à compter de décembre 2019. C’est une grande surprise pour les collectivités concernées, mais également pour les associations d’usagers. Une motion a d’ailleurs été adoptée hier par le conseil départemental du Doubs réuni en session ordinaire.
Cette ligne TGV Lyria Lausanne-Paris est très importante pour le Haut-Doubs, puisqu’elle favorise les échanges quotidiens entre la Suisse et la France. La suppression de cette desserte serait un signal négatif pour l’attractivité de notre territoire, et la fixation d’horaires inadaptés aux besoins des usagers comporterait un risque majeur de fragilisation des dessertes maintenues.
L’ensemble du massif transfrontalier serait alors fortement fragilisé par cette dégradation du transport ferroviaire, qui amorce le contournement de la Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est totalement inacceptable.
Aussi, je vous demande s’il est bien dans les intentions du Gouvernement de faire preuve de fermeté afin d’assurer une desserte ferroviaire équilibrée de ce territoire et de respecter les engagements pris dans le cadre de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire.
Monsieur le sénateur Longeot, vous avez bien voulu interroger Mme Borne au sujet du niveau de service sur la liaison TGV Lyria Paris-Lausanne passant par le Jura.
À compter de 2020 et au moins jusqu’en 2026, la gare de Lausanne va connaître d’importants travaux. Ce projet d’ampleur va se traduire par la fermeture temporaire durant toute la période de deux voies sur huit, et interdira en outre d’accueillir des TGV en unités multiples, ce qui limitera ainsi considérablement la capacité d’accueil de la gare.
Ces contraintes techniques amènent l’opérateur Lyria à reporter ou à supprimer certains TGV assurant la liaison Paris-Lausanne en passant par le Jura, qui comptera trois allers-retours quotidiens avec Paris en 2020, contre quatre actuellement. Les gares de Dijon, Dole et Frasne perdront en conséquence un aller-retour quotidien. Le niveau de service restera en revanche stable pour les gares de Mouchard et de Pontarlier, avec respectivement un et trois allers-retours quotidiens.
Compte tenu de l’ampleur des évolutions envisagées, Lyria a rencontré les élus locaux pour leur présenter les modifications de dessertes et étudier avec eux les meilleures solutions pour ne pas pénaliser les usagers.
Lyria a notamment prévu de remplacer l’ensemble des rames actuellement en service sur cette liaison par de nouvelles rames à deux niveaux, plus confortables, mais surtout en mesure d’accueillir plus de voyageurs. Cela veut dire que la suppression d’un aller-retour sur quatre n’empêchera pas une légère augmentation du nombre de places offertes.
Élisabeth Borne et moi-même avons bien conscience que la capacité n’est pas tout et que la fréquence est également importante. Nous réaffirmons par conséquent la nécessité que les évolutions en matière de desserte TGV s’opèrent en concertation avec les territoires, afin de définir les mesures permettant de maintenir une desserte ferroviaire de qualité dans les gares du Jura, tout en tenant compte des contraintes liées aux travaux en gare de Lausanne.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

J’ai bien entendu votre réponse, madame la secrétaire d’État, mais les arguments que vous avancez ne me semblent pas sérieux. Les travaux en gare de Lausanne ne justifient pas la suppression d’un aller-retour entre Lausanne et Paris.
Les TGV à deux étages vont, certes, permettre d’accueillir plus de voyageurs, mais ils circuleront à des heures qui ne conviennent pas ! La suppression de certains horaires est au demeurant une curieuse façon d’assurer un meilleur service.
Votre réponse ne me satisfait donc pas. La concertation doit se poursuivre.

La parole est à Mme Sabine Van Heghe, auteure de la question n° 640, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la secrétaire d’État, comme mes collègues de la Drôme et du Doubs à l’instant, je souhaite vous interroger sur les perspectives annoncées de fortes diminutions des dessertes TGV du bassin minier du Pas-de-Calais.
Les responsables de la SNCF rencontrent les maires concernés pour les informer des possibilités de changements à compter de décembre 2019. Or ces changements se traduisent par de fortes diminutions des dessertes de Lens, Béthune ou encore Boulogne-sur-Mer. Seul le pôle d’Arras serait préservé.
La mobilisation des élus, des usagers et des syndicats qui a suivi ces annonces a amené la SNCF à revoir sa copie.
Cependant, l’annonce du remplacement des TGV par des « TERGV » est assortie d’une nouvelle grille horaire ne correspondant pas au rythme de travail des salariés de notre département, qui se déplacent quotidiennement vers Paris.
S’y ajoutent des ruptures de charge dues aux changements de train. Or celles-ci entravent ce temps de trajet, que beaucoup utilisent pour travailler et ainsi préserver leur vie de famille en rentrant chez eux.
Si ces orientations se trouvent confirmées, c’est un coup très rude porté à notre région, en particulier au bassin minier, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’État, au cours du mandat précédent, s’est engagé à hauteur de centaines de millions d’euros sur dix ans pour la rénovation de maisons de mineurs.
Les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle sont une magnifique illustration d’une reconversion économique et écologique réussie, qui attire des milliers de touristes.
Le bassin minier, c’est aussi une dynamique culturelle indéniable, avec le Louvre-Lens, qui accueille 500 000 visiteurs par an, mais aussi un lieu de mémoire avec, à Notre-Dame-de-Lorette, le plus grand cimetière militaire français – il attire plus de 400 000 visiteurs par an venus du monde entier et a reçu, à quelques mois d’intervalle, la visite de deux présidents de la République.
Madame la secrétaire d’État, quelle est la position du Gouvernement sur ces perspectives de réduction des dessertes TGV affectant notre bassin minier ?
Madame la sénatrice Van Heghe, vous avez bien voulu interroger Mme Borne au sujet des évolutions de dessertes TGV en région Hauts-de-France au service annuel 2020.
Comme la ministre a eu l’occasion de l’indiquer à plusieurs reprises, elle comprend les inquiétudes concernant les restructurations des dessertes TGV dans les Hauts-de-France et considère que le dialogue entre la SNCF et les territoires est indispensable avant toute décision de ce type.
Au vu des réactions faisant suite à la réunion qui s’est tenue le 28 février dernier, durant laquelle la SNCF a présenté son projet aux élus à la mairie de Douai, il semble évident que ce projet n’emporte pas, en l’état, l’adhésion des territoires concernés.
La ministre a réitéré un message clair : le Gouvernement s’est engagé, dans le cadre de la réforme ferroviaire, à maintenir une desserte équilibrée du territoire par les TGV, notamment pour l’ensemble des villes moyennes aujourd’hui desservies. Une réorganisation des dessertes ne peut se faire que dans le cadre d’une concertation avec les territoires et d’un soutien politique local affirmé.
En l’état, la ministre considère donc que ce projet ne saurait se poursuivre si la région et les collectivités concernées devaient s’y opposer.
La SNCF a annoncé le 1er mars qu’elle renonçait à ce projet en l’état et qu’elle allait faire de nouvelles propositions dans les semaines à venir.
Au-delà du cas des dessertes évoquées, je tiens à réaffirmer que le Gouvernement est très attaché à la qualité du dialogue entre SNCF Mobilités et les territoires. La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire crée ainsi, à partir du service annuel 2021, des procédures de consultation et d’information obligatoires des territoires avant toute évolution de desserte TGV.

La parole est à Mme Sabine Van Heghe, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État, et je ne demande qu’à vous croire, au nom des usagers, des acteurs économiques et des élus de mon département.
À l’heure du défi écologique et de l’incitation à utiliser les transports en commun plutôt que la voiture, au moment où la France connaît des mouvements de contestation sociale et que les citoyens ont l’impression que les territoires périphériques sont abandonnés, il serait inacceptable que la SNCF contribue, par ses décisions, à enrayer le dynamisme économique, culturel et touristique du bassin minier, qu’une volonté et des efforts communs ont réussi à impulser.

La parole est à M. Stéphane Piednoir, auteur de la question n° 568, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la secrétaire d’État, j’aimerais attirer votre attention sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement et des conséquences qui en découlent pour les opérateurs de mobilité partagée.
Depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, les entreprises de location de véhicules ne peuvent plus désigner le locataire responsable d’une infraction au stationnement afin de procéder au règlement du forfait post-stationnement. Cette disposition implique que ces entreprises doivent d’abord acquitter le règlement du forfait post-stationnement, avant de se retourner contre le locataire pour recouvrer la somme.
Une telle situation est préjudiciable aux opérateurs de mobilité et remet également en question la pérennité de leur modèle économique. En effet, les sociétés n’ont aucune garantie qu’à terme les clients prendront réellement en charge le règlement des sommes forfaitaires.
Certes, le Gouvernement a fait un certain nombre de propositions pour remédier à cette problématique : utilisation de la télétransmission des avis de paiement par les entreprises pour répercuter le plus rapidement possible aux clients l’avis des sommes à régler ; adaptation des conditions générales de vente par l’introduction de clauses spécifiques encadrant le paiement des forfaits post-stationnement.
Mais ces mesures ne sont pas satisfaisantes au regard des démarches administratives, longues et lourdes, qui, de toute manière, laisseront les entreprises dans l’obligation de faire une avance de trésorerie, celles-ci étant juridiquement redevables puisqu’elles sont titulaires du certificat d’immatriculation.
Madame la ministre, je souhaiterais donc connaître les intentions du Gouvernement pour corriger cette mesure préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité.
Monsieur le sénateur Piednoir, vous avez bien voulu interroger Mme Borne sur les conséquences, notamment financières, du forfait post-stationnement sur les opérateurs de la mobilité partagée.
La réforme du stationnement que vous mentionnez a pour objectif de donner davantage de compétences aux collectivités locales dans leur politique de stationnement et de mobilité. Pour cela, une redevance d’occupation domaniale fixée par les collectivités est venue remplacer le système pénal national.
Aujourd’hui, les collectivités peuvent décider de soumettre à redevance tout ou partie du stationnement sur leur voirie et peuvent fixer le montant du forfait post-stationnement, dit FPS, dû en cas de non-paiement immédiat ou de paiement partiel de la redevance.
La réforme est construite autour d’un redevable légal unique, le titulaire du certificat d’immatriculation, ce qui est aujourd’hui le droit commun pour toute notification différée d’infraction relative à la sécurité routière. La question du paiement du forfait post-stationnement par le locataire de courte durée d’un véhicule relève donc de la relation contractuelle entre le propriétaire du véhicule et le locataire.
Les entreprises de location de véhicules peuvent adapter les conditions générales des contrats de location pour s’assurer de la récupération du forfait post-stationnement auprès du locataire.
Face à cette situation, des dispositions réglementaires ont été introduites pour accélérer la mise en œuvre de la récupération du FPS par les loueurs auprès des locataires, comme – vous l’avez mentionné – la télétransmission des avis de paiement entre l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions et les loueurs.
Cette réforme, qui a fortement affecté les pratiques des acteurs – collectivités, professionnels, usagers –, nécessite encore un travail d’accompagnement et de pédagogie. Les services du ministère des transports devraient prochainement réunir les professionnels de la location pour les accompagner dans la rédaction de clauses types à insérer dans les contrats et, plus globalement, dans la mise en œuvre de cette réforme.

La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État. J’entends la volonté du Gouvernement de réunir très prochainement les opérateurs de ce secteur pour les accompagner dans l’insertion de clauses spécifiques dans les contrats de location.
Nous sommes à quelques heures de l’ouverture, au Sénat, du débat sur le projet de loi d’orientation des mobilités et vous n’ignorez pas que la pratique de la location de courte durée devrait s’étendre dans les années à venir. Il convient donc de prendre toutes les dispositions de manière à la faciliter.

La parole est à M. Didier Marie, auteur de la question n° 690, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la secrétaire d’État, à quelques heures de l’ouverture du débat sur le projet de loi d’orientation des mobilités, censé apporter des solutions aux Français qui ont le sentiment de vivre dans une France à deux vitesses et qui éprouvent des difficultés quotidiennes de transport, je souhaite attirer votre attention sur l’avenir de la desserte ferroviaire en Seine-Maritime.
Dans mon département, après les réductions de services en gare, après les fermetures de guichets et la diminution du temps de présence des agents, après les réductions de dessertes et la mise en œuvre d’horaires espacés, après la fermeture de petites gares, la dernière en date ayant été Virville à la fin de 2018, une annonce supplémentaire inquiète les usagers et les élus : la suppression actée, d’ici à la fin de l’année 2019, de nouveaux arrêts de trains, notamment dans les gares de Saint-Martin-du-Vivier, Foucart et Bolbec.
Ces décisions sont difficilement compréhensibles pour de nombreuses raisons.
D’une part, elles ne sont pas motivées par un manque de fréquentation. À Saint-Martin-du-Vivier, par exemple, le trafic de la gare, par laquelle passe la ligne entre Rouen et Serqueux, est en augmentation constante. Du côté de Foucart-Alvimare et de Bolbec-Nointot, les gares les plus proches d’Yvetot et Bréauté-Beuzeville sont surchargées, au point que leurs parkings sont saturés.
D’autre part, la suppression de ces arrêts, qui crée dans le cas de Foucart et de Bolbec un couloir de trente kilomètres sans aucune desserte, correspond à un isolement important des usagers concernés et, par voie de conséquence, de ces territoires.
Le train constitue aujourd’hui un moyen de transport indispensable, en particulier dans ces zones rurales. Il s’agit en outre d’un moyen de se déplacer qui répond aux problématiques environnementales, lesquelles se trouvent plus que jamais au centre de notre actualité, comme l’attestent les mobilisations sociales.
Ces questions devraient être au premier rang de nos préoccupations. La majorité des usagers concernés par ces suppressions a recours au train pour se rendre sur son lieu de travail ou d’étude. Les contraindre à utiliser leurs voitures apparaît comme particulièrement déraisonnable d’un point de vue environnemental et social et ne ferait qu’augmenter le risque d’embolisation des agglomérations de Rouen et du Havre.
Madame la secrétaire d’État, à la suite de ces annonces et au vu des nombreuses conséquences néfastes que ces décisions de suppressions d’arrêts risquent d’entraîner, quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour empêcher la fermeture de ces gares et garantir un service public ferroviaire de qualité ?
Monsieur le sénateur, vous avez interrogé Mme Élisabeth Borne sur les dessertes TER dans le département de la Seine-Maritime.
Il convient tout d’abord de rappeler que ces services TER sont exploités par SNCF Mobilités dans le cadre d’une convention avec la région Normandie. En tant qu’autorité organisatrice, la région est donc la seule compétente pour définir l’offre ferroviaire TER en fonction de l’analyse qu’elle fait des besoins de mobilité des usagers. L’État, au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, n’intervient pas dans ces choix.
Dans ce cadre, SNCF Mobilités travaille avec les services de la région Normandie sur la définition d’une nouvelle offre régionale de transports visant à l’amélioration de l’attractivité globale des lignes TER et au développement de leur fréquentation. Les travaux doivent aussi prendre en compte l’intégration, à compter du 1er janvier 2020, des quatre lignes de trains d’équilibre du territoire entre la Normandie et Paris, dont Paris-Rouen-Le Havre.
Afin d’optimiser l’offre, une étude complète des mobilités en Normandie a préalablement été menée pour analyser les déplacements, tous modes confondus.
S’agissant en particulier des services TER proposés en Seine-Maritime, les haltes de Bolbec et de Foucart sur la ligne Rouen-Le Havre, ainsi que celle de Saint-Martin-du-Vivier sur la ligne Rouen-Amiens, sont susceptibles de ne plus être desservies au second semestre 2019. Ces évolutions visent à améliorer la robustesse des services ferroviaires et à proposer au plus grand nombre des temps de parcours plus attractifs.
Ces projets font l’objet d’échanges avec les communes concernées pour construire avec la région les solutions alternatives les plus adaptées aux besoins de mobilité des usagers.
Je le répète, la région est la seule compétente pour définir l’offre ferroviaire TER sur son territoire et je fais confiance aux élus du conseil régional pour prendre les décisions qui préservent au mieux les intérêts des habitants de la région, en pleine concertation avec les parties prenantes.

La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 670, transmise à M. le ministre de l’intérieur.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite appeler votre attention sur l’instauration d’une évaluation médicale de l’aptitude à la conduite, notamment à destination des seniors.
La France est l’un des seuls pays à délivrer le permis de conduire à vie, là où dans la plupart des pays européens il n’est valable que dix ans. À l’exception des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire à durée de validité limitée – la liste de ces affections est fixée dans un arrêté du 31 août 2010 –, il n’existe pas, pour les conducteurs non professionnels, de dispositif permettant de contrôler leur aptitude à conduire dans la durée.
Le sujet n’est pas nouveau et le débat revient régulièrement sur le devant de la scène, dès qu’un accident impliquant un senior survient.
Ainsi, en octobre dernier, à Paris, un conducteur de 92 ans a percuté des piétons, il a encastré sa voiture dans un magasin de fleurs et une jeune femme, âgée de 27 ans, a dû être amputée d’une jambe. Son père a mis en ligne une pétition afin que le dossier de l’aptitude à la conduite soit ouvert et que la France rejoigne d’autres pays européens sur l’obligation d’une visite médicale dans certains cas à risques, notamment le grand âge ou la prise de médicaments. Cette pétition a déjà recueilli plus de 97 000 signatures.
Peut-on encore laisser une personne âgée de 80 ans, qui a passé son permis plus de cinquante ans auparavant, conduire sans un examen de ses capacités physiques liées à son âge ou à un traitement médical ou encore de ses connaissances du code de la route, qui a évidemment évolué depuis le passage de son permis ?
Il s’agit non pas de stigmatiser une catégorie de la population, mais bien d’instaurer un contrôle, bienveillant, pour garantir la sécurité de ces personnes et celle des autres conducteurs et des piétons.
Ce sujet complexe, qui touche à l’impératif de sécurité routière, mais aussi aux conditions de vie quotidienne des personnes âgées, mérite d’être examiné dans le contexte actuel de vieillissement de la population.
En conséquence, je vous demande de m’informer de l’état des réflexions du Gouvernement sur l’opportunité d’un contrôle de l’aptitude à la conduite des seniors.
Monsieur le sénateur Détraigne, en France, c’est l’aptitude médicale à conduire, et non l’âge, qui est susceptible de conditionner la durée de validité du droit à conduire.
Ainsi, les articles R. 226-1 et R. 221-10 du code de la route prévoient un contrôle médical périodique pour les personnes atteintes d’une affection médicale incompatible avec la conduite, ce qui peut fonder la délivrance d’un permis de conduire d’une durée de validité limitée.
Ces affections médicales, recensées dans un arrêté du 21 décembre 2005, doivent être déclarées, y compris lorsqu’elles sont survenues postérieurement à l’obtention ou au renouvellement du permis de conduire. Dans le cas contraire, en cas d’accident, le conducteur peut voir sa responsabilité personnelle engagée.
Ces dispositions sont complétées par l’article R. 221-14 du code de la route, qui permet aux proches, lorsqu’ils estiment que l’état de santé d’un conducteur est incompatible avec le maintien du permis de conduire, de faire un signalement au préfet qui pourra imposer un contrôle médical au titulaire du permis de conduire.
Je souhaite également rappeler que les personnes âgées ne constituent pas la catégorie d’usagers la plus impliquée dans les accidents de la route. Force est de constater qu’elles en sont plutôt les victimes. En outre, se déplacer le plus longtemps possible est un enjeu fort d’autonomie, notamment pour les personnes âgées qui habitent en milieu rural.
Telles sont les raisons pour lesquelles la politique du Gouvernement en ce domaine consiste à favoriser un usage de la route répondant aux besoins de mobilité de ces populations, tout en veillant à leur sécurité et à celles des autres usagers.
En liaison avec les collectivités locales, les assureurs et les associations de prévention routière, l’État soutient des stages destinés spécifiquement aux conducteurs seniors pour qu’ils actualisent leurs connaissances théoriques et pratiques et prennent conscience de leurs limites.
Une large sensibilisation en direction des professionnels de santé et des seniors est également régulièrement menée sur la notion d’aptitude médicale à la conduite.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement n’a pas pour projet d’instaurer un contrôle médical spécifique pour les conducteurs seniors.

La parole est à M. Yves Détraigne, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Vous venez de dire, après avoir lu vos notes, que certaines affections médicales doivent être déclarées ; mais qui le sait ? Je me penche sur ces questions depuis un certain temps déjà et je ne connais pas grand monde qui est au courant de cette nécessité de déclaration. En tout cas, nous voyons bien que certaines personnes conduisent, alors qu’elles constituent de véritables dangers publics !

La parole est à M. François Grosdidier, auteur de la question n° 550, adressée à M. le ministre de l’économie et des finances.

Madame la secrétaire d’État, nous nous sommes fixé un objectif national de fermeture des centrales à charbon, car ce sont celles qui dégagent le plus de gaz à effet de serre. Hélas ! le monde ne nous suit pas, pas même l’Europe et moins encore notre voisin allemand.
À dix kilomètres de la frontière, la centrale Émile-Huchet de Saint-Avold doit cesser son activité charbon d’ici à 2022, selon l’engagement du Président de la République.
Il reste quatre centrales à charbon en France : deux dépendent d’EDF, deux d’Uniper. Celle de Saint-Avold, historiquement liée aux houillères, a été reprise par Uniper France, qui y a investi 1, 2 milliard d’euros et qui est prêt à ajouter 600 millions pour reconvertir la tranche 6 que vous voulez fermer. Il s’agit non pas de maintenir le charbon, mais de convertir au gaz, en réduisant drastiquement les émissions de CO2, d’oxyde d’azote et de soufre.
Or le Gouvernement bloque ce projet. Sur le plan social, c’est une catastrophe ; sur le plan économique, une faute ; sur le plan écologique, un contresens, une absurdité.
Le reclassement des salariés sera impossible au sein d’Uniper, alors même que la centrale se situe dans l’ancien bassin houiller lorrain, déjà sinistré et où, en quarante ans, nous avons déjà exploité la moindre potentialité de reconversion. Tout le contraire des sites d’EDF, puisque le groupe peut assurer sans difficulté le reclassement des salariés concernés.
Pour lutter contre le dérèglement climatique, nous devons tirer la base de la production électrique du nucléaire et du renouvelable. Nous sommes d’accord sur ce point, mais, en l’absence de solution pour stocker l’électricité, il faudra toujours du thermique, qui démarre au quart de tour, pour produire la pointe et répondre aux pics de consommation.
Soit on produit encore du thermique à partir du gaz à Émile-Huchet, soit on achètera en Allemagne de l’électricité produite à partir de charbon et, même, de lignite, ce qui correspondrait à une pollution maximale !
La conversion au gaz d’Émile-Huchet est donc la meilleure solution pour la sécurité de notre approvisionnement, pour l’emploi en France et en Moselle, pour notre balance commerciale, mais surtout pour l’environnement.
Le Gouvernement envisage-t-il de revoir sa position de façon plus pragmatique ?
Monsieur le sénateur Grosdidier, l’urgence climatique nécessite aujourd’hui de réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre, et donc d’arrêter au plus vite la production d’électricité à partir de charbon, fortement émettrice de CO2.
C’est pourquoi le Président de la République a confirmé en novembre 2018, dans sa présentation de la stratégie française pour l’énergie et le climat, que les dernières centrales électriques à charbon de métropole seront mises à l’arrêt ou reconverties vers des solutions moins carbonées d’ici à 2022. Depuis, l’Allemagne a d’ailleurs pris le même engagement de sortir des centrales à charbon.
Afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, aucune autre centrale électrique fonctionnant à partir de combustible fossile, donc en particulier à partir de gaz naturel, ne saurait être autorisée, étant donné la grande durée de vie de ce type d’actif et la quantité considérable d’émissions de CO2 que cela représente.
Les analyses réalisées par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité – RTE – démontrent que la sécurité d’approvisionnement du territoire peut être assurée. À la maille du Grand Est, la région devrait rester, dans les années à venir, fortement productrice et globalement exportatrice d’électricité, y compris après la fermeture de la dernière tranche au charbon de Saint-Avold et des réacteurs nucléaires de Fessenheim.
Compte tenu des impacts économiques et sociaux de cette décision, le Gouvernement est particulièrement attentif à l’accompagnement des territoires et des salariés durant cette phase de transition – François de Rugy et moi-même avons d’ailleurs eu l’occasion de le dire sur le site même de Saint-Avold il y a quelques mois.
Un délégué interministériel à l’avenir des territoires concernés a été désigné en février 2019. En liaison avec les collectivités locales et les acteurs économiques, il pilote l’élaboration de projets de territoire, qui permettront l’émergence d’activités appelées à se substituer à celle des centrales thermiques.
Le projet de territoire de la Moselle a été engagé le 4 février dernier à l’occasion d’une réunion tenue sous la présidence du préfet de département, en présence des élus, de l’employeur et des employés de la centrale, ainsi que de représentants du monde économique. Des groupes de travail réunissant les différentes parties prenantes ont été constitués pour une finalisation du projet de territoire dans les six mois.
Concernant les salariés de l’entreprise, comme pour ceux des autres centrales au charbon, des mesures d’évolution et de reclassement sont étudiées avec les entreprises Uniper et EDF, en liaison avec la branche professionnelle, afin de faire émerger des propositions qui pourront répondre aux situations professionnelles très diversifiées de ces salariés.
Enfin, l’exploitant Uniper ne porte pas de projet de nouvelle centrale à gaz. En revanche, l’entreprise a lancé en novembre dernier un appel à initiatives pour la reconversion industrielle de ses deux sites, pour lequel elle a reçu de nombreuses contributions.
Les services du ministère examinent avec le plus grand soin les projets reçus par Uniper et pourront, le cas échéant, les soutenir.

La parole est à M. François Grosdidier, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Je regrette cette réponse de langue de bois, qui confirme une décision absurde : lors des pics de consommation, la France achètera à l’Allemagne de l’électricité produite à partir de charbon ou de lignite ! Dire que c’est de l’aveuglement idéologique serait reconnaître à ce gouvernement une conviction écologique. En fait, cette décision de principe n’est qu’un affichage politique ! C’est l’arbre qui cache la forêt de vos renoncements en matière environnementale… Et ce sont les Lorrains et l’environnement qui en feront les frais !

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 458, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics.

Madame la secrétaire d’État, ma question concerne les maladies professionnelles provoquées par l’amiante et les conséquences financières pour les collectivités locales.
Un agent public ayant bénéficié de la reconnaissance de sa maladie professionnelle provoquée par l’amiante peut demander son départ anticipé à la retraite.
Or l’article 4 du décret du 28 mars 2017 prévoit que l’allocation spécifique due au bénéficiaire est alors versée par le dernier employeur public. Ainsi, lorsqu’un agent a été victime d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et qu’il a poursuivi sa carrière en changeant d’employeurs, c’est son dernier employeur public qui doit assumer la charge financière de l’allocation spécifique, alors qu’il n’a aucun lien avec cette maladie professionnelle.
Bien qu’il existe un fonds de compensation, la procédure qui permet le remboursement des sommes engagées oblige le dernier employeur public à assumer la charge financière liée au versement de cette allocation durant toute la première année. Or cette charge peut peser lourdement sur l’équilibre financier d’une petite commune.
Une action récursoire de la collectivité employeuse à l’encontre de la structure publique responsable n’est pas possible dans ce cas précis. De ce fait, la collectivité doit avancer les sommes pour une année entière, puis, à partir du 1er mars de l’année suivante, déclarer au fonds de compensation le versement de cette allocation spécifique. Ce fonds détermine alors le remboursement à effectuer.
Autrement dit, comment faire simple quand on peut faire compliqué ! Il est donc nécessaire, selon moi, de modifier l’article 4 du décret du 28 mars 2017, afin que le versement de l’allocation soit assuré par l’employeur responsable de la maladie contractée par l’agent, et non par un employeur ultérieur.
Madame la secrétaire d’État, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette modification, qui relève, selon moi, du bon sens.
Monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard, conformément à l’article 4 du décret du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, il appartient effectivement, comme vous l’avez mentionné, au dernier employeur public ayant rémunéré un agent avant sa cessation anticipée d’activité de lui verser l’allocation spécifique amiante.
Dans la fonction publique territoriale, le versement de cette allocation est ensuite compensé par l’un des fonds de compensation prévus notamment à l’article 106 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vue d’assurer la répartition des charges résultant du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité entre tous les employeurs territoriaux.
Aux termes des décrets d’application de ces dispositifs, le montant de l’allocation spécifique de cessation d’activité versée sur une année fait ensuite l’objet d’une déclaration au fonds de compensation concerné au plus tard le 1er mars de l’année suivante, de sorte que le fonds peut ensuite déterminer le remboursement à effectuer.
Ce dispositif permet aux employeurs de ne pas supporter, à terme, la charge résultant du versement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité amiante, quel que soit le service ou la collectivité dans lequel la maladie a été contractée.
Au regard de cette procédure de compensation, l’employeur doit bien, dans un premier temps, assumer la charge financière liée au versement et cette charge peut peser sur son équilibre financier, mais la compensation, mise en œuvre dès la deuxième année de versement, permet ensuite d’effacer cette charge pendant toute la durée de la cessation anticipée de l’agent.
Au terme de celle-ci, après l’admission à la retraite de l’agent, l’employeur percevra l’année suivante une recette exceptionnelle.
Ainsi, la charge financière exceptionnelle effectivement supportée pendant la première année de versement est compensée l’année suivant le terme de la cessation anticipée par une recette exceptionnelle, effaçant définitivement toute charge spécifique.
En conséquence, même si le dispositif est complexe, il n’apparaît pas opportun de procéder à une modification de l’article 4 du décret du 28 mars 2017 afin que le versement de l’allocation soit assuré par l’employeur responsable de la maladie contractée par l’agent, d’autant que, au regard du temps de latence des maladies liées à l’amiante, il serait compliqué de revenir vers l’ancien employeur ou vers les anciens employeurs en cas de multiexposition. Au surplus, cet employeur a pu disparaître.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Madame la secrétaire d’État, vous avez rappelé ce que j’avais dit précédemment dans mon intervention, mais je pense que vos services ont mal travaillé ou vous ont mal conseillée !
Pourquoi ? Certes, la collectivité locale est effectivement remboursée à terme. Je prends l’exemple d’une ville de Loire-Atlantique de 3 000 habitants, Saint-Malo-de-Guersac, qui doit verser 40 000 euros à une personne, dont la maladie professionnelle liée à l’amiante provient du temps où elle travaillait dans le secteur hospitalier : cette somme de 40 000 euros représente quatre points d’augmentation de la fiscalité locale.
Vous le savez, nous avons trois fonctions publiques : territoriale, hospitalière et d’État. Or les employeurs de la fonction publique hospitalière ont la possibilité d’être remboursés dès le premier trimestre, sans attendre un an. À défaut de trouver un dispositif encore plus simple, il me semblerait logique que la fonction publique territoriale bénéficie du même traitement, ce qui serait déjà un premier pas.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir veillé à respecter votre temps de parole.

La parole est à M. Arnaud Bazin, auteur de la question n° 548, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, au moment où l’accès aux soins figure dans les tout premiers thèmes du débat national, le groupement hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, établissement valdoisien, fait l’objet de graves menaces, tant pour l’hôpital de Beaumont-sur-Oise que pour le site de Saint-Martin-du-Tertre.
Le plan de restructuration proposé, il y a quelques semaines, au comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins, ou Copermo, est en totale contradiction avec le projet médical partagé adopté en 2017. Il prévoit une casse sans précédent des services de cet hôpital : fermeture du service de néonatalogie, disqualifiant de fait la maternité de type II, malgré plus de mille accouchements par an ; fermeture des lits d’hospitalisation pédiatrique ; fermeture de la réanimation.
Si la population et les élus peuvent comprendre l’évolution de la chirurgie traditionnelle vers la chirurgie ambulatoire et la nécessaire et étroite collaboration avec l’hôpital de Pontoise, la disparition de services aussi essentiels est incompréhensible et inacceptable dans un bassin de vie de plus de 320 000 habitants à la démographie particulièrement dynamique, comprenant une importante population fragile, dépendante de l’hôpital public et peu mobile, alors même que ce territoire reste mal relié au site de Pontoise.
La restructuration mettrait à mal la sécurité sanitaire de très nombreux enfants de ce territoire, ainsi que la sécurité des parturientes et de leurs bébés.
S’agissant de Saint-Martin-du-Tertre, ce site est spécialisé dans les soins de suite et de réadaptation et dans les soins de longue durée. Après y avoir investi 35 millions d’euros dans la rénovation complète de deux bâtiments en extrémité, on nous dit aujourd’hui que ces derniers ne sont exploitables qu’en réhabilitant, pour environ 15 millions d’euros, le bâtiment de jonction qui n’a pas été traité.
Je vous pose donc deux questions.
Alors que l’administration semble encourager le départ des médecins de l’hôpital de Beaumont-sur-Oise, allez-vous maintenir, quitte à les redimensionner, les services indispensables à la population, à savoir les hospitalisations pédiatriques, la néonatalogie et la maternité de type II ?
Et avez-vous l’intention de fermer le site de Saint-Martin, après y avoir investi 35 millions d’euros, et d’assumer cet incroyable gaspillage ?
Monsieur le président, monsieur le sénateur, le groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest-Vexin-Val-d’Oise, autrement appelé GHT NOVO, est composé – vous l’avez évoqué – de trois établissements : le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise – CHRD –, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise – GHCPO –, dont fait partie le site de Beaumont-sur-Oise, et le groupement hospitalier intercommunal du Vexin.
Ces établissements connaissent aujourd’hui une situation financière fragile – il est nécessaire de le rappeler. L’inscription au comité interministériel de performance et de modernisation de l’offre de soins, autrement appelé Copermo, a été motivée par la très forte dégradation de la situation d’exploitation de ces établissements, qui se cumule avec une situation de grande vétusté de certaines installations en dépit des réhabilitations qui ont pu avoir lieu sur plusieurs bâtiments.
Le projet de restructuration du GHT NOVO, validé par le passage devant ce Copermo en janvier 2019, repose sur une reconfiguration de l’offre de soins sur le territoire, structurée autour d’un projet médical ambitieux qui vise à garantir à la population la meilleure qualité de prise en charge, car c’est bien cela qui anime cette évolution.
Cette reconfiguration se justifie donc avant tout par des raisons de prise en charge, mais nous ne pouvons pas faire abstraction des aspects médico-économiques.
Cette restructuration du GHT NOVO ne prévoit pas la fermeture du site de Beaumont-sur-Oise, mais elle s’attache à le consolider, en offrant aux habitants une prise en charge de proximité et de qualité : maintien d’un service d’accueil des urgences et d’une activité de médecine pour adultes et enfants ; renforcement d’une maternité publique de territoire, dans la mesure où chaque future maman doit pouvoir accéder, quel que soit son lieu de résidence, à la même qualité de soins et de prise en charge, dans une sécurité totale ; création d’un service pédiatrique et de néonatalogie au sein du pôle femme-enfant de territoire, pôle qui est d’ores et déjà constitué. Je le redis, sur la question des maternités, c’est bien la sécurité qui anime nos réformes.
J’ajouterai deux éléments : la mutualisation des lits de soins critiques de réanimation pour adultes sur un seul site, au centre hospitalier René-Dubos, afin de garantir la qualité de prise en charge par des équipes hyperspécialisées et la poursuite de la structuration d’un pôle de chirurgie territoriale avec une équipe médicale d’anesthésie et de chirurgie qui interviendra sur les deux établissements.
Pour conclure, le GHCPO, en particulier son site de Beaumont-sur-Oise, continuera d’offrir aux habitants une prise en charge de premier recours de qualité et de proximité.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, il ne faut pas confondre le GHT NOVO et l’hôpital de Beaumont-sur-Oise. Le GHT comprend bien une prise en charge pédiatrique, mais, selon les annonces qui ont été faites, elle serait positionnée sur le site de Pontoise. De ce fait, les familles qui ont des enfants, mais sont éloignées de Pontoise, se retrouveront en grande difficulté, voire en danger, car il faudra plus d’une heure à certaines personnes pour s’y rendre. Et encore : une heure pour ceux qui sont propriétaires d’une voiture, ce qui n’est pas le cas de toutes les familles.
L’absence d’urgences pédiatriques sur le site de Beaumont crée donc un véritable danger. Je compte sur vous pour prendre cette situation en compte.

La parole est à Mme Céline Brulin, auteure de la question n° 577, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, la quasi-totalité des hôpitaux de la Seine-Maritime a terminé l’année 2018 en situation de déficit ; le déficit cumulé des hôpitaux normands a ainsi doublé, atteignant 90 millions d’euros, malgré les efforts continus de l’ensemble des personnels.
Il n’est plus possible d’imputer cette situation à une mauvaise gestion ; il convient de reconnaître que nos établissements hospitaliers souffrent d’un sous-financement chronique, et d’y remédier. Je pense en particulier aux moyens humains réclamés par les personnels du centre hospitalier de Fécamp et du groupe hospitalier du Havre, mobilisés depuis plusieurs semaines. Dans ces établissements, le recours aux urgences augmente, en raison notamment de l’affaiblissement de la médecine de ville, affaiblissement lié à la démographie médicale.
Le personnel de l’hôpital de Fécamp évalue ainsi les besoins supplémentaires en équivalents temps plein à 20 % pour les seules urgences. Au Havre, les seize équivalents temps plein demandés ne correspondent même pas aux recommandations de la Société française de médecine d’urgence.
De même, les personnels de la maternité du Belvédère, dans la région rouennaise, sont soumis, depuis l’adoption d’un plan d’investissement et de diversification, à une pression visant le retour à l’équilibre financier, ce qui entraîne des suppressions de postes, le non-remplacement de certains départs à la retraite et une précarisation accrue des contractuels.
Il aura fallu que sept agents de l’hôpital psychiatrique du Rouvray observent, en 2018, une grève de la faim, et que ceux du centre Pierre-Jeanet se perchent pendant plusieurs jours sur le toit de leur établissement pour que des postes soient créés – la situation de ces établissements suscite d’ailleurs de nouvelles inquiétudes. Faut-il en arriver là pour que les moyens suffisants soient octroyés ?
Dans la même logique, je veux aussi évoquer les conséquences de la modification, en mai dernier, du code de la santé publique par un décret. Celui-ci a rendu possible le fait que les urgences se retrouvent sans médecin lorsque l’équipe médicale des urgences est sollicitée pour une sortie du service mobile d’urgence et de réanimation, le SMUR, le temps que le médecin d’astreinte arrive. Cette mesure est vécue avec beaucoup d’anxiété par les acteurs de terrain, qui supportent mal que des réductions de postes mettent ainsi en danger la vie des patients.
Que compte faire le Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État, pour apporter des réponses à ces deux points précis ?
Madame la sénatrice Céline Brulin, permettez-moi de rappeler tout d’abord quelques chiffres. Trois établissements, publics ou privés, du département de la Seine-Maritime, ont bénéficié, en 2018, de crédits nationaux de trésorerie, pour un montant de 1, 3 million d’euros. En parallèle, vingt-quatre établissements, publics ou privés, ont bénéficié de crédits de trésorerie et de soutiens financiers régionaux, pour un montant total de 19 millions d’euros, répartis entre crédits de trésorerie et crédits de soutien à la psychiatrie, dont nous connaissons la situation.
Conscient de cette situation difficile des établissements, le Gouvernement a réattribué pour la première fois, par la voix d’Agnès Buzyn, le montant total du dégel pour 2018 – 415 millions d’euros à l’échelle nationale, toutes enveloppes de financement confondues – pour accompagner les établissements de santé en proie à des difficultés de trésorerie.
En Normandie, ce dégel a représenté 18, 9 millions d’euros, et, pour le département de la Seine-Maritime, 8, 1 millions d’euros : 1, 72 million d’euros pour les établissements publics et privés de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, ou SSR, et 6, 38 millions pour les établissements publics et privés de court séjour.
Par ailleurs, cela ne vous aura pas échappé, pour la première fois depuis dix ans, les tarifs hospitaliers seront revalorisés de 0, 5 % pour l’année 2019. Cette hausse des tarifs hospitaliers, qui est inédite, je le répète, permettra d’accompagner les transformations d’activités engagées et de renforcer le financement à la qualité – vous le savez, c’est ce basculement que nous sommes en train d’opérer dans les hôpitaux.
Nous avons souhaité adresser ainsi un signal fort aux acteurs hospitaliers, en reconnaissance des efforts accomplis et de leur engagement dans la démarche de transformation du système de santé, au travers notamment du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, en cours de débat à l’Assemblée nationale et qui sera bientôt examiné devant la Haute Assemblée.
La volonté du Gouvernement consiste à engager une réforme du financement des établissements, pour favoriser la qualité et la pertinence des soins et ne plus lier les recettes à la seule quantité d’actes – la fameuse tarification à l’activité, la T2A.
L’accessibilité des soins sur un territoire donné représente aussi un enjeu pour le Gouvernement, soyez-en convaincue ; nous voulons répondre aux besoins de soins de proximité. La réforme engagée, dont vous débattrez prochainement, marque un tournant à cet égard. Ainsi, pour la première fois, des médecins libéraux se verront confier la responsabilité populationnelle d’un territoire ; ils auront, par exemple, à assurer eux-mêmes l’hospitalisation de patients au sein d’hôpitaux de proximité, qui seront créés et labellisés, contribuant ainsi à la politique de prévention.
Tous ces sujets, vous aurez l’occasion d’en débattre lors de l’examen du projet de loi Santé.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous prie de respecter votre temps de parole lors de vos prochaines interventions.

La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 622, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, mon attention a récemment été appelée sur le flou juridique qui entoure la situation, au regard de la protection sociale, des journalistes pigistes établis dans les États tiers à l’Union européenne autres que les États membres de l’Espace économique européen.
En vertu du code de travail, les pigistes établis en France sont, d’une part, présumés salariés et, d’autre part, affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à une agence de presse ou à quelque organe de presse que ce soit. Lorsqu’ils résident hors de l’Union, les pigistes ne remplissent généralement pas les conditions permettant de bénéficier d’un détachement. Toutefois, il semble que ces personnes acquittent des cotisations sociales en France, au titre des rémunérations qui leur sont versées par les agences ou par leur employeur de presse.
Cela signifie-t-il que les pigistes sont maintenus au régime français de sécurité sociale et qu’ils peuvent notamment bénéficier, en France, de la prise en charge ou du remboursement des frais engagés en raison des soins reçus dans leur pays de résidence ?
En cas de réponse positive, je souhaite savoir si les pigistes sont dispensés de s’affilier au régime local de sécurité sociale lorsqu’ils résident dans un pays lié à la France par un accord de sécurité sociale. En cas de réponse négative, je souhaite savoir si l’affiliation au régime local de sécurité sociale est compatible avec le paiement, en France, de cotisations n’ouvrant aucun droit aux prestations d’assurance maladie.
Monsieur le sénateur Richard Yung, la situation des pigistes résidant en dehors de l’Union européenne est régie, vous le savez, par des règles différentes selon l’État dans lequel ils résident. Le principe général est celui de l’affiliation dans l’État du lieu d’activité, mais certaines situations dérogent à ce principe, comme celle du détachement.
Sous réserve d’en remplir les conditions, les pigistes résidant à l’étranger hors de l’Union européenne peuvent bénéficier de ce statut exceptionnel, dans le cadre d’un accord bilatéral de sécurité sociale signé par la France. Pour cela, il faut qu’ils aient travaillé en France préalablement à leur départ pour l’étranger, qu’un lien organique soit maintenu avec leur employeur et que leur mission à l’étranger n’excède pas la durée maximale prévue dans l’accord. Les cotisations doivent continuer d’être versées en France, et cela emporte effectivement exemption de cotisations au régime local de sécurité sociale.
Le détachement est également possible dans le cadre de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Cela n’exempte pas pour autant du versement de cotisations au régime local de l’État dans lequel la mission est effectuée.
Dans les deux cas, pendant la durée de leur détachement, les pigistes sont maintenus au régime français de sécurité sociale et leurs frais sont pris en charge comme s’ils résidaient en France. Si les pigistes ne remplissent pas les conditions du détachement, par exemple, parce qu’ils ne résident pas en France ou parce qu’ils n’y ont jamais travaillé, le seul droit applicable est alors celui de l’État dans lequel ils résident et travaillent. L’employeur français est, dans ce cas, tenu de verser les cotisations au régime local de sécurité sociale, sous réserve, évidemment, que ce régime existe ; ces personnes seront prises en charge par le régime local dans les conditions prévues par ledit régime.
Pour les salariés français ou ressortissants d’un État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, il est possible d’adhérer à l’assurance volontaire proposée par la Caisse des Français de l’étranger. Actuellement, les tarifs varient selon les risques à assurer, le pays de résidence ou la composition de la famille. Une réforme des tarifs de cette caisse est en cours ; elle a pour objet de simplifier cette tarification et de la rendre plus attractive pour ces personnes. Toutefois, cette assurance, qui se fonde sur un acte volontaire, ne remplace pas les cotisations dues au régime local et ne se substitue pas au régime général de la sécurité sociale.
Enfin, pour être totalement complet, je précise que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, assises sur le revenu d’activité, sont dues, sous réserve que la personne soit domiciliée fiscalement en France et affiliée à un régime français d’assurance maladie. Lorsque le domicile fiscal se situe hors de France mais que la personne est affiliée à un régime français d’assurance maladie, le revenu d’activité est alors assujetti à une cotisation d’assurance maladie, une Cotam, majorée.
J’espère avoir été complet dans ma réponse.

La parole est à M. Richard Yung, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, tout cela est vrai, mais les conditions du détachement sont difficiles à réunir ; peu de pigistes travaillant à l’étranger en dehors de l’Union européenne les remplissent. Dans cette situation, ils sont amenés à cotiser au régime français, de façon parfaitement inutile puisque cela ne leur ouvre aucune prestation. Le ministère des affaires sociales et la sécurité sociale devraient revoir cette situation, pour la rendre juste.

La parole est à Mme Gisèle Jourda, auteure de la question n° 636, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, les difficultés qu’éprouve le centre hospitalier de Carcassonne à assurer, sur son périmètre, ses différentes missions d’urgence, faute d’un effectif médical suffisant, sont connues. Face à cela, il importe de mettre en place une organisation efficiente des urgences sur l’ensemble du territoire de l’Ouest audois.
Je vous le dis avec conviction, les citoyens de la haute vallée de l’Aude doivent pouvoir bénéficier de l’accès aux soins urgents dans les mêmes conditions qu’ailleurs, c’est-à-dire en moins de trente minutes. Ainsi, le fonctionnement, 7 jours sur 7, de l’antenne du service mobile d’urgence et de réanimation, le SMUR, de Carcassonne, basée à Quillan, est indispensable. Cette ambition légitime, essentielle, est menacée au quotidien dans sa mise en œuvre opérationnelle ; le SMUR de Quillan a été partiellement fermé, de façon récurrente, depuis août 2017.
Trois types de solutions existent pour garantir sa pérennité.
Premièrement, il convient de proposer une organisation qui fasse appel à la solidarité régionale et qui permette d’associer, à tour de rôle, des effectifs d’autres établissements sièges de médecine d’urgence – Foix, Castelnaudary, Narbonne et Perpignan –, en établissant, entre les établissements concernés, des conventions fixant la participation et le tableau des médecins urgentistes.
Deuxièmement, le médecin urgentiste du SMUR pourrait recevoir des patients régulés par le centre 15, dans le cadre d’une structure d’accueil de soins non programmés, en collaboration avec la maison de soins polyvalents, située à Espéraza, et avec les maisons médicales de garde de Quillan et de Limoux.
Troisièmement, il faut chercher et organiser la participation d’un plus grand nombre de médecins généralistes du secteur au dispositif des médecins correspondants du service d’aide médicale urgente, le SAMU.
Ces mesures font l’objet, en conséquence de la mission d’expertise nationale menée par Pierre Carli, d’un plan d’action priorisé et partagé, dont les acteurs de terrain ont pris connaissance en décembre 2018.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de diligenter sans tarder, via l’autorité régionale de santé, l’ARS, la mise en œuvre de ce plan, qui permettra le maintien opérationnel du SMUR de Quillan, c’est-à-dire l’accès optimal à une permanence de soins ambulatoires ou relevant des urgences.
Madame la sénatrice Gisèle Jourda, vous l’avez rappelé, le centre hospitalier de Carcassonne rencontre des difficultés récurrentes pour assurer ses différentes missions d’urgence, faute d’un effectif médical suffisant. Face à cette situation, l’Agence régionale de santé a sollicité le Conseil national de l’urgence hospitalière pour une mission d’expertise relative à l’organisation des urgences sur le territoire de l’Aude.
Cette mission a émis un certain nombre de préconisations, qui ont été traduites, par l’ARS, dans une feuille de route partagée, le 12 décembre dernier, avec les différents acteurs et les élus, dont vous étiez, j’imagine ; ce plan a été validé.
Ce plan d’action a également été adressé par l’ARS au directeur du centre hospitalier de Carcassonne, pilote du projet du groupement hospitalier de territoire Ouest-Audois. Ce directeur a prévu de réunir un comité de pilotage le 21 mars prochain, auquel l’ARS participera.
Vous avez évoqué quelques lignes de ce plan d’action, permettez-moi de revenir sur ses principaux axes.
Il s’agit, premier axe, de refonder une équipe d’urgence au centre hospitalier de Carcassonne, autour d’un projet médical ambitieux, un projet de service qui doit être élaboré en identifiant un responsable médical.
Deuxième axe, il s’agit de recentrer les médecins urgentistes du centre hospitalier de Carcassonne sur leur cœur de métier, en leur apportant les compétences de spécialistes, en vue de libérer le temps médical consacré aux urgences.
Le troisième axe consiste à améliorer les phases situées tant en amont qu’en aval des urgences hospitalières ; l’objectif est, en aval, de décharger les urgentistes de la recherche d’un lit et, en amont, de les libérer de la surveillance des patients en lits-brancards dans la zone d’attente des urgences. Parallèlement, il s’agit d’éviter le recours aux urgences hospitalières pour des soins non programmés ne relevant pas de l’urgence vitale – situation que nous rencontrons dans d’autres endroits du territoire – et, ainsi, d’expérimenter une organisation coordonnée entre ville et hôpital.
Quatrième axe, il convient d’instaurer une régulation supra-départementale des soins en nuit profonde.
Cinquième axe, il s’agit de maintenir l’antenne du SMUR de Carcassonne basée à Quillan. Cela passe par une organisation associant les effectifs des centres hospitaliers de Foix, de Castelnaudary et de Narbonne, et par la mise en place d’une structure d’accueil de soins non programmés, négociée avec les médecins généralistes et régulée par le 15.
Enfin, sixième axe, il faut assurer le fonctionnement autonome du SMUR du centre hospitalier de Castelnaudary, avec une perspective d’ouverture 24 heures sur 24, au moyen d’une révision de son périmètre d’intervention.
Sur l’ensemble de ces actions, l’ARS se situe dans la continuité de la démarche engagée en concertation avec les établissements et les élus locaux ; une nouvelle réunion avec les élus sera organisée avant l’été, afin de partager l’avancement de cette feuille de route, que vous appeliez de vos vœux, et de faire un point de situation avant l’été.

La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Je vous remercie de ces éléments d’information, monsieur le secrétaire d’État. Nous serons vigilants, car il n’est pas acceptable que le SMUR de Quillan soit fermé de manière récurrente, comme il l’est depuis pratiquement deux ans.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, auteure de la question n° 643, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, dans un contexte de forte demande, par nos concitoyens, d’égalité d’accès aux services publics, le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit de mieux structurer l’offre de soins dans les territoires, ce qui aura des conséquences sur l’organisation hospitalière.
Dans mon département, les Hautes-Pyrénées, le centre hospitalier de Tarbes et celui de Lourdes ont une direction commune depuis 2009 ; ils élaborent ensemble leur projet médical depuis 2012. Cette direction commune porte le dossier de construction d’un nouvel hôpital.
L’objectif est de mettre fin à une concurrence mortifère entre les deux établissements, concurrence qui conduit à des déficits structurels, et surtout de doter ce territoire d’un outil moderne, performant et offrant des conditions de travail optimales, à même d’attirer de nouveaux médecins.
Ce type de structure incarne un nouveau modèle de médecine de proximité et de garantie d’accès aux soins de qualité pour tous, une médecine mieux organisée et mieux adaptée pour répondre au problème des déserts médicaux que connaissent de nombreux territoires ruraux.
À propos de ce projet d’hôpital commun, élus locaux et collectivités territoriales, parlementaires, direction et collège médical, personnels et praticiens se sont associés pour maintenir une offre de soins publique de proximité et de qualité, tant pour leurs administrés que pour les populations touristiques.
Ce projet bénéficie également d’un appui fort de l’ARS Occitanie ; à la suite de l’audition de celle-ci devant le comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins, le Copermo, les orientations stratégiques ainsi que le lieu d’implantation du futur hôpital ont été validés.
Monsieur le secrétaire d’État, ma question est simple : compte tenu de l’enjeu qu’il représente pour le maintien d’un service hospitalier de qualité dans les Hautes-Pyrénées, pouvons-nous compter sur la puissance publique pour soutenir financièrement et accompagner techniquement ce projet jusqu’à sa réalisation ?
Vous l’avez rappelé, madame la sénatrice Viviane Artigalas, les centres hospitaliers de Tarbes et de Lourdes, distants de dix-huit kilomètres, constituent, depuis des années, les piliers de l’offre de soins de court séjour dans le département des Hautes-Pyrénées. Avec près de 50 000 séjours en 2017, ces centres hospitaliers assurent près de 58 % de l’activité avec hébergement du territoire de santé des Hautes-Pyrénées. Ils prennent en charge 64 % des passages aux urgences – plus de 57 000 passages par an –, 60 % de l’obstétrique et 70 % de la médecine.
Les orientations stratégiques du projet ont été validées en 2012 ; le projet s’articule autour d’équipes territoriales spécialisées.
Malgré cela, le recrutement médical, bien qu’actif, peine à satisfaire les acteurs qui évoluent sur plusieurs sites. Les locaux, de conception ancienne, ne permettent qu’une adaptation marginale à l’évolution actuelle du système de santé, tournée vers l’ambulatoire et vers les soins externes, malgré une constante recherche d’organisation plus efficiente de la part des directions. Les établissements sont en déficit budgétaire et soumis à un plan de retour à l’équilibre ; leurs bâtiments ne correspondent plus aux normes de sécurité actuelles et leur réfection nécessiterait des budgets importants.
C’est la raison pour laquelle il est apparu, dès 2009, à partir de ce constat partagé par les acteurs hospitaliers, qu’un regroupement des deux établissements sur un site unique était une solution efficiente pour répondre aux différents enjeux de l’hospitalisation du XXIe siècle sur ce territoire. Par un travail conjoint avec l’ARS Occitanie, les travaux ont débuté concrètement au printemps 2017, avec la mise en place de groupes de travail autour de la définition d’un projet médico-soignant commun, s’articulant avec les axes stratégiques, retenus dans le cadre du projet médical de groupement hospitalier de territoire des Hautes-Pyrénées.
Ce projet, fortement soutenu par les acteurs hospitaliers et par les élus du territoire –vous en témoignez –, est fondé sur un projet de santé de territoire qui a du sens à nos yeux. En effet, il permettrait d’apporter une réponse modernisée aux enjeux de ce territoire, notamment l’impact du vieillissement, de renforcer l’attractivité médicale de cet établissement et d’améliorer l’équilibre financier de la plateforme hospitalière nouvellement créée.
Le Copermo a commencé d’examiner ce projet en janvier 2019 ; il a reconnu l’intérêt de sa localisation. Le travail doit encore se poursuivre, afin de consolider le dossier, notamment pour ce qui concerne son dimensionnement et sa trajectoire financière. Ce travail est en cours, avec le soutien réel de l’ARS.
C’est dans ce cadre, un peu plus achevé, finalisé, travaillé, que l’appui financier national, sous la forme d’aides à l’investissement, pourra être clairement apporté au projet.

Je vous demande de nouveau de respecter votre temps de parole, monsieur le secrétaire d’État.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Je constate que l’État, le Gouvernement, se soucie de ces hôpitaux, importants pour nos territoires.
Je veux le rappeler, ce projet ne doit pas être sous-dimensionné pour des raisons uniquement financières. Ne l’oublions jamais, Lourdes est à proximité et elle attire de nombreux touristes et pèlerins. Il y a vraiment besoin de services de soins de qualité, pendant une grande partie de l’année, tant pour notre population locale que pour la population touristique.

La parole est à M. Daniel Chasseing, auteur de la question n° 645, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, je crois utile d’appeler aujourd’hui l’attention du Gouvernement sur un aspect de la réglementation qui pose un réel problème aux responsables départementaux de la gestion des personnels et, par voie de conséquence, aux personnes âgées et aux populations les plus fragiles ; je veux parler des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants sociaux contractuels des collectivités territoriales. Ce problème existe dans le département dont je suis élu, la Corrèze, mais dans d’autres aussi, j’imagine.
Ces agents, majoritairement des femmes, peuvent exercer leur activité sur un poste de remplacement comme contractuel non titulaire, pendant seulement deux ans. Ensuite, il leur faut absolument réussir le concours approprié. Or ces concours sont très difficiles, seul un faible pourcentage de candidats y est reçu ; cela a pour effet d’empêcher des assistantes sociales très appréciées d’accéder à ces postes.
Le phénomène est d’autant plus accentué que, lorsqu’un concours est organisé, un certain nombre de candidats issus d’autres départements s’y présentent – il y a ainsi parfois 800 candidats pour 50 places. On en arrive donc à cette absurdité : une collectivité apprécie le travail d’une de ses employées, mais elle doit s’en séparer au profit d’une autre personne qui, certes, a réussi le concours, mais qui peut connaître moins bien le travail à fournir aux usagers.
Des auxiliaires de soins territoriaux ou des assistantes sociales, diplômées et compétentes, qui ont de l’expérience et qui manifestent de l’humanité vis-à-vis des personnes dépendantes ou fragiles, doivent pouvoir être embauchées en contrat à durée indéterminée, même si elles ne réussissent pas le concours, dès lors qu’elles donnent satisfaction.
Aussi, le moment n’est-il pas venu, monsieur le secrétaire d’État, d’assouplir les règles du concours ou d’institutionnaliser un régime de contractuels permanents pour ces postes, en fonction des besoins et du souhait du maire, du président du conseil départemental ou de l’EPCI ? Votre réponse est très attendue.
Monsieur le sénateur Chasseing, les emplois publics ont par priorité vocation à être pourvus par des fonctionnaires ; c’est ainsi. Cependant, lorsqu’une collectivité est confrontée à l’impossibilité effective de recruter un fonctionnaire, en l’absence de candidats, par exemple, l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 permet de recruter un contractuel pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois. La collectivité dispose ainsi d’un délai de deux ans pour trouver un candidat fonctionnaire ; c’est une formule destinée à apporter une solution qui doit rester provisoire et non permettre un recrutement pérenne.
Pour faciliter le recrutement dans les cadres d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants sociaux éducatifs, le Gouvernement a allégé les épreuves des concours, afin de ne conserver qu’une épreuve unique, qui consiste en un entretien avec un jury. À titre d’exemple, le concours sur titre d’accès au grade d’auxiliaire de soins principal de deuxième classe, un emploi de catégorie C, comporte une épreuve unique d’admission d’entretien avec le jury d’une durée de quinze minutes. Autre exemple, le concours d’accès sur titre au cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs dans la spécialité d’assistant de service social, de catégorie A, consiste également en une épreuve unique d’admission d’entretien avec le jury, d’une durée de vingt minutes.
Le nombre de postes offerts aux concours est déterminé par les centres départementaux de gestion, en fonction du nombre de postes déclarés vacants par les collectivités et du nombre de candidats inscrits sur les listes d’aptitude. De nombreux lauréats du concours étant en recherche de poste, ils doivent être recrutés en priorité. Il appartient aux centres de gestion d’accompagner ces lauréats vers l’emploi et d’approfondir le dialogue avec les employeurs, afin d’améliorer la déclaration de postes vacants.
Dans le cadre du projet de loi de transformation de la fonction publique, qui devrait être prochainement délibéré en conseil des ministres, le Gouvernement propose des assouplissements sur le recrutement des contractuels, notamment dans les petites communes. Ces évolutions devraient permettre de répondre aux préoccupations que vous avez exprimées, et je ne doute pas que vous aurez l’occasion d’y revenir à l’occasion du débat à venir devant la Haute Assemblée.

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Je suis satisfait que le Gouvernement propose un assouplissement en la matière, car il serait normal que les travailleurs sociaux qui donnent satisfaction à leurs responsables, qui habitent, avec leur famille, dans le département, puissent poursuivre leur travail de contractuel au fil des ans. Si cela est nécessaire, il faut faire évoluer la loi ; c’est ce que vous proposez, cela me convient.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, auteur de la question n° 511, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite appeler votre attention sur la question de la priorisation des secteurs à couvrir en téléphonie mobile, dans le cadre du dispositif de couverture ciblée. Je le rappelle, l’enjeu est évidemment d’agir efficacement à l’échelle locale, mais, après plus d’un an de mise en œuvre du dispositif, cela reste très relatif.
En effet, les territoires sont encore aujourd’hui trop souvent confrontés à de réelles difficultés d’identification des « grappes ». De manière très concrète, l’application des critères retenus pour l’identification des zones a pu conduire à des résultats stupéfiants ; en témoigne ce qu’il s’est passé dans le département dont je suis élu, la Sarthe, où, officiellement, il n’y avait pas de grappes pour la dernière remontée de septembre ; soit les communes étaient déjà traitées dans l’arrêté du 4 juillet 2018 reprenant l’ancien programme « zones blanches–centres-bourgs », soit elles relevaient d’une grappe attribuée à un autre département. Or, via la plateforme France Mobile, d’autres communes ont été identifiées au niveau local et retenues en vue d’un traitement prioritaire à la fin de 2017.
Si des solutions ont pu émerger depuis lors, on se rend compte que ces remontées via la plateforme France Mobile, dont on nous a vendu la pertinence en son temps, ne sont donc finalement pas exploitées du tout. Cela acte-t-il de son abandon, monsieur le secrétaire d’État ?
Je l’affirme, me faisant ainsi la voix de nombreux territoires, le problème réside aujourd’hui dans le fait que la couverture mobile ressortit avant tout aux opérateurs, au travers de l’atlas de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Arcep, qui détermine les zones à couvrir en priorité, alors même que ces zones sont parfois très éloignées de la réalité du terrain.
Dans les faits, la voix des collectivités n’est tout simplement pas entendue pour déterminer les « priorisations », alors que c’est tout simplement un point crucial pour une couverture mobile pérenne.
Comment comptez-vous pallier cette difficulté et enfin prendre en considération la voix des territoires, qui restent les premiers concernés ?
Monsieur le sénateur, permettez-moi de répondre au nom de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence ce matin.
En janvier 2018, le Gouvernement a obtenu des opérateurs des engagements contraignants, vérifiables et sanctionnables, visant à déployer une couverture mobile de qualité pour tous les Français, aux quatre coins de notre pays.
Les opérateurs se sont en particulier engagés à couvrir chacun 5 000 nouveaux sites grâce à un dispositif de couverture ciblée, comme vous l’avez rappelé. La mise en œuvre de cet engagement requiert très concrètement la constitution d’équipes « projets » réunissant les acteurs intéressés à l’aménagement numérique de chaque territoire, chargées d’identifier les sites prioritaires à couvrir. C’est une des utilités de la plateforme France Mobile, mais j’y reviendrai.
Un premier arrêté publié en juillet dernier a défini les 485 premiers sites à couvrir, et un second arrêté, publié fin décembre, a retenu 115 sites supplémentaires identifiés comme prioritaires par lesdites équipes « projets ».
Pour l’essentiel, il s’agit de grappes de sites issues de l’atlas des 2 000 zones les plus habitées parmi celles où aucun opérateur n’offrait jusqu’à présent une couverture de bonne qualité.
La Sarthe ne dispose pas de grappes aisément identifiables. Partant de ce constat, il a été proposé à l’équipe de la Sarthe de participer à une expérimentation du processus d’identification de zones à couvrir. C’est ainsi que les trois communes de Louplande, Nogent-le-Bernard et Évaillé ont été reconnues comme prioritaires. Tel est d’ailleurs l’esprit même du dispositif : une identification des territoires à couvrir prioritairement établie par les territoires eux-mêmes, dans un processus de coconstruction entre l’État et les collectivités locales.
Pour l’année 2019, un premier arrêté, qui sera publié début avril, devrait retenir le site de Maisoncelles, et un deuxième arrêté, qui, lui, sera mis en consultation publique d’ici à la fin du mois de mars, devrait inscrire les communes de Chenu, Saint-Pierre-du-Lorouër, Courcebœufs, Joué-l’Abbé et Ruillé-en-Champagne.
Enfin, huit nouvelles zones priorisées par l’équipe « projets » ont été soumises par les services de Mme la ministre de la cohésion des territoires à l’étude des opérateurs.
S’agissant de la plateforme France Mobile, qui est un outil de remontée au service des élus des zones rencontrant des difficultés de couverture, ses informations sont et restent essentielles pour les équipes « projets » en vue d’identifier les zones à couvrir prioritairement. Ces données doivent donc être exploitées afin d’identifier ces zones en difficulté. Mme la ministre estime qu’elle doit être maintenue, et ses services y consacreront les ressources nécessaires.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie au nom des communes sarthoises qui vont bénéficier d’une amélioration de leur couverture en téléphonie mobile. Nous étions inquiets, car les opérateurs traitaient en priorité ce qui venait de l’Arcep, sans aucun dialogue avec les collectivités. Je vois que les choses s’améliorent, et c’est tant mieux !

La parole est à Mme Nathalie Goulet, auteur de la question n° 666, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le secrétaire d’État, nous avons un problème de fraude documentaire – vous le savez, c’est mon petit TOC, mon trouble obsessionnel compulsif
Sourires.

Le nombre de NIR de personnes étrangères ou de Français nés à l’étranger était de 17, 6 millions en 2011. France Info annonçait 21 millions voilà quelques mois. La directrice de la sécurité sociale, auditionnée le 20 février dernier par notre commission des finances, a annoncé 18 millions de NIR pour les personnes nées à l’étranger. Le directeur de la CNAV, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, dans Libération, le 29 janvier, nous expliquait qu’il y avait, en tout, 114 millions de NIR ; or il n’y a pas 114 millions de personnes en France, cela se saurait… Enfin, France Info annonce 112, 3 millions de NIR, étrangers et Français. Bref, cela fait beaucoup de distorsions de chiffres, monsieur le secrétaire d’État.
Mes questions sont donc simples : combien y a-t-il de NIR pour les Français nés à l’étranger ou les étrangers nés en France, et de Français immatriculés ? Autrement, dit quel est le nombre total de NIR ? Par ailleurs, et c’est extrêmement important pour l’évaluation de la fraude, combien de ces numéros sont-ils actifs ?
Madame la sénatrice Nathalie Goulet, votre interrogation porte sur le sujet des fraudes aux prestations qui seraient commises en raison du numéro de sécurité sociale, le fameux numéro d’inscription au répertoire, ou NIR, qui serait parfois attribué sur la base de faux documents à des assurés sociaux, notamment nés hors de France.
Ces chiffres sont souvent relayés, et on comprend l’inquiétude légitime qu’ils peuvent susciter, tant le préjudice subi estimé serait important. Mme la ministre a donc rapidement demandé que ces données soient examinées avec précision.
Au regard des compléments d’information qui lui ont été fournis, je puis vous dire que ces chiffres ne correspondent en rien à la réalité. Il me semble donc nécessaire d’apporter quelques précisions, que vous appelez de vos vœux, pour rétablir la vérité. Il serait en effet regrettable que de fausses informations amènent certains de nos concitoyens à stigmatiser des personnes nées à l’étranger en les associant à des fraudeurs ou à imaginer que les prestations de sécurité sociale sont versées sans aucun contrôle, et donc sujettes à un phénomène massif de fraude, l’une comme l’autre de ces affirmations n’étant pas conformes à la réalité.
Si 18 millions de NIR ont bien été attribués à des assurés, les cas de fraude représenteraient tout au plus 0, 2 % des situations en 2017. Il apparaît que l’écart entre le taux qui a été médiatisé, et que vous évoquiez, et la réalité tient à une mauvaise compréhension des données observées. Le taux repris a été extrapolé à partir de résultats intermédiaires d’une campagne de contrôle interne qui visait à évaluer la conformité des pièces justificatives acceptées par le service administratif national d’immatriculation des assurés au cours du processus d’attribution de ces fameux NIR. Il ne s’agissait donc pas de cas de fraude avérés, puisque les assurés dont les pièces présentaient des anomalies ont été recontactés et ont pu apporter des pièces jugées conformes. Dans la plupart des cas, il n’y avait donc pas d’intention frauduleuse des assurés, soyez-en convaincue, madame la sénatrice.
Une mission sénatoriale d’évaluation et de contrôle sur la fraude à l’obtention de numéro de sécurité sociale, présidée par le rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Vanlerenberghe, est en cours depuis deux mois. Elle devrait rendre de premières conclusions dans les semaines qui viennent. Permettez-moi, pour conclure, d’ajouter deux remarques d’ordre plus général sur l’environnement de contrôle du versement des prestations.
Il est bon, tout d’abord, de rappeler que le NIR ne permet pas à lui seul de bénéficier de prestations. Celles-ci sont conditionnées, vous le savez, par les droits dont disposent les assurés, et la validation de ces droits nécessite la production de nombreuses pièces justificatives spécifiques à chaque situation.
Ensuite, cette vision, que vous relayez, méconnaît l’importance des dispositifs de contrôle à l’œuvre dans les organismes de sécurité sociale. Les mécanismes de maîtrise des risques sont extrêmement complets, et les comptes des organismes de sécurité sociale sont tous certifiés depuis l’exercice 2013.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, je suis extrêmement contente que vous n’ayez pas répondu à ma question, qui portait sur le nombre global de NIR et le nombre de NIR actifs.
Sur les faux documents, je vois que vous reprenez les indications de Mme la ministre, qui m’a à moitié – et même complètement – traitée de menteuse. Je vais donc vous remettre en mains propres §le relevé de conclusions du SANDIA, le Service administratif national d’immatriculation des assurés, en date de décembre 2011, où vos propres services indiquaient que, sur la base du taux de fraude constaté, on pouvait estimer que 1, 8 million de NIR étaient attribués grâce à de faux documents.
Il s’agit, monsieur le secrétaire d’État, d’un document interne de vos services, qui, je l’espère, pourra vous servir. Le sujet de ma question était non pas la fraude, mais le nombre de NIR. C’était une question assez simple, conforme à celles qui sont posées dans le cadre des séances de questions orales du mardi matin.
Si une mission de la commission des affaires sociales du Sénat est en cours, je voudrais surtout vous dire que les propres services de l’État, notamment la police aux frontières, chargés de la lutte contre la fraude documentaire, confirment un taux de fraude très important.
Je vous remets donc ce document
Mme Nathalie Goulet joint le geste à la parole.

La parole est à M. Christophe Priou, auteur de la question n° 667, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, en Loire-Atlantique, certains habitants et exploitants agricoles rencontrent des difficultés avec l’implantation de parcs éoliens et leurs probables répercussions sur la santé, humaine et animale. En effet, différentes observations effectuées par des exploitants agricoles sur le site éolien des Quatre Seigneurs à Puceul et Saffré sont inquiétantes.
En septembre 2012, lors de l’installation du site éolien, sont observés les premiers symptômes comportementaux des élevages, avec une aggravation en 2013, liée à la mise en service : diminution de production de lait, problème de vêlage, perte de bétail. Des témoignages vétérinaires précis font la relation avec la mise en service du parc éolien.
Des symptômes ont également été signalés par les habitants riverains du site : céphalées, vertiges, saignements de nez, brûlures aux yeux, troubles du sommeil. En 2014 et 2015, à la suite de plusieurs échanges avec les services préfectoraux, des rapports et expertises sont diligentés, avec des études complémentaires sur deux élevages proches.
Un relevé de conclusions faisant suite à un audit conduit dans le cadre du groupe permanent pour la sécurité électrique, en coordination avec la chambre d’agriculture de la Loire-Atlantique, fait apparaître une corrélation entre les anomalies relevées par le robot de traite et la production du site éolien.
D’autres investigations sont en cours pour déterminer d’éventuelles incidences des câbles souterrains sur la santé humaine et animale, notamment au niveau des liaisons équipotentielles.
Compte tenu de cette situation et des répercussions sanitaires sur les habitants riverains et les animaux des exploitations agricoles concernées, pouvez-vous nous indiquer si le Gouvernement entend appliquer le principe de précaution et prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas de défaillance électrique constatée et de désordres subsistants ?
Monsieur le sénateur Christophe Priou, je pense que nous sommes d’accord pour dire que le développement de l’énergie éolienne est un enjeu pour la transition énergétique.
Pour autant, et c’est le sens de votre question, les éoliennes soulèvent un certain nombre d’interrogations et des plaintes de la population, notamment s’agissant de l’impact sanitaire que celles-ci pourraient avoir.
Les ministères chargés de la santé et de l’environnement ont saisi à deux reprises l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail à ce sujet. En 2008, l’Agence a conclu que les émissions sonores des éoliennes n’étaient pas suffisantes pour entraîner des conséquences sanitaires directes sur les capacités auditives. À l’extérieur, les bruits peuvent néanmoins être à l’origine d’une gêne, parfois exacerbée par des facteurs autres que sonores, tels que l’impact visuel de l’installation.
En 2017, la revue des connaissances disponibles en matière d’effets sanitaires auditifs et extra-auditifs dus au parc éolien, en particulier dans le domaine des basses fréquences et des infrasons, ne mettait pas en évidence, là non plus, d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets sanitaires autres que la gêne liée au bruit audible et un effet, dit nocebo, qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes liés au stress réellement ressenti par des riverains du parc éolien.
L’Agence souligne à cette occasion la difficulté d’isoler, à l’heure actuelle, en l’état de nos connaissances, les effets sur la santé des infrasons et basses fréquences sonores de ceux du bruit audible ou d’autres causes potentielles qui pourraient être dues aux éoliennes. Elle relève par ailleurs que l’impact visuel des éoliennes est un fauteur de gêne plus important que le niveau de bruit des éoliennes. Elle encourage notamment la réalisation d’études épidémiologiques, compte tenu de la faible qualité, il faut le reconnaître, de la plupart des études recensées.
À cet effet, des études locales reposant sur le recueil de données de santé et de perception des pollutions déclarées, sonores et visuelles, notamment, paraissent de nature à apporter des éléments d’information importants, et la réalisation préalable d’enquêtes qualitatives pour appréhender les inquiétudes des riverains et leurs attentes permettrait probablement de mieux cibler en amont la réalisation de ces recueils. Les résultats pourraient faciliter ainsi la caractérisation de l’impact sanitaire éventuel de ces installations et le lien avec les perceptions des pollutions ressenties par la population.

La parole est à M. Christophe Priou, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Merci, monsieur le secrétaire d’État. Nous resterons vigilants sur ce dossier et sur les autres cas. Vous l’avez rappelé, nous sommes tous favorables aux énergies renouvelables. J’en profite d’ailleurs pour inciter le Gouvernement à accélérer fortement sur l’implantation des champs éoliens en mer. C’est une forte attente, notamment de la filière industrielle. Néanmoins, le principe de précaution et d’évaluation ne peut pas être et ne doit pas être à plusieurs vitesses suivant la nature des dossiers. Nous comptons également sur votre vigilance à cet égard.

La parole est à Mme Christine Lavarde, auteur de la question n° 648, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, je suis heureuse de voir qu’un élu des Hauts-de-Seine va apporter des éléments de réponse à un problème qui préoccupe les élus du sud du département depuis plusieurs semaines. Vous ne pouvez pas ignorer le problème causé par la possible fermeture des urgences de nuit de l’hôpital Béclère, situé à Clamart. Vous avez très certainement déjà reçu de nombreux courriers adressés par nos collègues parlementaires de tous les bords politiques. Les conseils municipaux de plusieurs communes ont par ailleurs voté un vœu en faveur du maintien d’un service public des urgences de qualité.
Cet hôpital dessert un bassin de population de 400 000 habitants, en forte croissance démographique.
Les départs non remplacés de plusieurs médecins urgentistes ne permettent plus d’assurer les gardes de nuit. La solution envisagée initialement, à savoir le recours à des intérimaires, à des internes ou à d’anciens urgentistes partis à la retraite a très vite montré ses limites : les vacataires seraient bien mieux payés que les titulaires encore en poste !
Je vous accorde que le problème de la rémunération n’est pas spécifique aux Hauts-de-Seine : les structures hospitalières publiques offrent une rémunération jusqu’à quatre fois inférieure à celle des structures privées pour une garde de nuit, et ce n’est pas le décret du 24 novembre 2017 relatif au travail des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé qui a réglé le problème.
Au-delà de ce problème structurel, monsieur le secrétaire d’État, quelle solution concrète le Gouvernement propose-t-il pour que la continuité d’accès à des soins de qualité au service des urgences soit assurée 24 heures sur 24 à Béclère ? En effet, le fonctionnement actuel, qui repose sur une assignation des salariés, ne fait que déplacer le problème au sein du service. Autrement dit, pour reprendre ce que disent les médecins concernés, « soit on déshabille la journée, soit on déshabille la nuit ». Pour bien travailler, il faudrait six médecins urgentistes en journée et deux la nuit, contre, actuellement, quatre en journée et un la nuit.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Madame la sénatrice Christine Lavarde, c’est effectivement à la fois le secrétaire d’État et l’élu du nord des Hauts-de-Seine, qui reste tout de même sensible aux problématiques touchant le sud du département, qui va vous répondre. Votre question portant sur plusieurs sujets distincts, j’espère pouvoir y répondre dans le délai imparti par M. le président.
Sourires.
Concernant la situation de l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart, le ministère est informé depuis un certain temps des difficultés du service d’accueil des urgences. Depuis fin 2018, quatre postes de médecins urgentistes sont vacants, comme vous l’avez rappelé, ce qui rend difficile la permanence de soins la nuit. Les postes vacants sont publiés et financés, mais ils ne trouvent pas de candidats. Il est vrai que les difficultés du service ont entraîné une dégradation des conditions de travail et du climat social aux urgences. Nous le savons ; nous le reconnaissons.
Pour autant, permettez-moi ici d’affirmer clairement qu’il n’est pas question de fermer le service d’accueil des urgences de l’hôpital Antoine-Béclère la nuit. La direction de l’hôpital ne le souhaite pas, vous l’avez rappelé, et l’Agence régionale de santé, l’ARS, n’y est pas non plus favorable. Le groupe hospitalier a pris un ensemble de mesures pour renforcer l’attractivité des postes et optimiser le recours aux médecins urgentistes dans un contexte de pénurie sur l’ensemble du territoire.
S’agissant, à présent, de l’accès aux soins urgents et non programmés dans le territoire du sud des Hauts-de-Seine, vous n’êtes pas sans savoir que la ville de Clamart est classée en zone d’action prioritaire par l’assurance maladie en ce qui concerne l’accès à un médecin généraliste, mais n’est pas signalée concernant le recours aux soins non programmés la nuit. Il existe en effet trois services d’accueil des urgences complémentaires à l’hôpital Antoine-Béclère et une maison médicale de garde sur le territoire desservi par le service en difficulté. L’accès aux soins est ainsi toujours possible sur ce territoire grâce à l’articulation de ces différentes composantes de l’offre.
Plus largement, l’ARS a engagé, à la suite des premières assises régionales des urgences qui se sont tenues en mai dernier, une feuille de route visant à renforcer l’appui aux structures d’urgence franciliennes. Le plan d’action porte sur l’ensemble du champ des soins non programmés et vise à rassembler tous les acteurs concernés, à l’hôpital comme en ville, avec cette articulation et ce continuum d’offres de soins que vous évoquiez.
Trois points ont été retenus. D’abord, améliorer la répartition régionale des médecins en formation et étudier la démographie médicale et soignante. Ensuite, améliorer l’organisation au sein des structures et continuer à soutenir l’investissement pour la modernisation desdites structures. Enfin, mieux prédire les flux d’activité de soins non programmés, grâce notamment à l’intelligence artificielle. L’Agence régionale de santé d’Île-de-France va ainsi développer un outil de prédiction des soins non programmés à cet effet. L’objectif est de doter les professionnels de santé, les établissements de santé et l’ARS d’un outil permettant d’anticiper les flux d’activité pour optimiser l’organisation du système de santé et la mobilisation des ressources, au bénéfice de la permanence, de la qualité et de la proximité des soins pour les patients.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Merci, monsieur le secrétaire d’État. Je pense que les élus auront entendu que personne n’est favorable à la fermeture des urgences et que tout va être fait pour maintenir le service public. Il y a véritablement urgence à agir. Vous avez évoqué la tenue d’assises régionales en mai dernier, soit il y a presque un an. Concrètement, on parle d’un sujet où il faut agir vite, puisque les personnes concernées sont parfois en urgence vitale.

La parole est à Mme Annick Billon, auteure de la question n° 613, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Madame la secrétaire d’État, après l’adoption de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la réforme de l’obligation d’emploi des personnes handicapées se poursuit en ce moment dans le cadre de la rédaction des décrets d’application, qui définiront les modalités de cette obligation d’emploi révisée.
Afin de favoriser l’emploi direct des personnes handicapées, la loi prévoit désormais que les contrats de sous-traitance passés par les entreprises ou collectivités avec les établissements et services d’aide par le travail, les ÉSAT, les entreprises adaptées, les EA, ou avec les travailleurs indépendants en situation de handicap, les TIH, qui représentent au total près de 250 000 travailleurs, ne pourront désormais plus être comptabilisés pour remplir leurs obligations d’emploi.
Le Gouvernement indique cependant que les futures modalités de calcul de recours à la sous-traitance seront définies dans le futur décret avec un objectif de neutralité financière. Or il existe de fortes inquiétudes quant à l’effet de cette réforme sur les donneurs d’ordre, qui ne seront désormais plus incités de la même manière à avoir recours à la sous-traitance. Il est à craindre que la réforme ne vienne directement fragiliser le travail des 250 000 personnes en situation de handicap, qui ont aujourd’hui accès à un travail grâce à l’accompagnement proposé par les établissements et services d’aides par le travail, les entreprises adaptées ou le statut de travailleur indépendant handicapé.
Aussi, pourriez-vous, madame la secrétaire d’État, indiquer concrètement comment le Gouvernement compte garantir également une neutralité financière pour les ÉSAT, EA et TIH, dont les activités pourraient être impactées directement et négativement par la réforme de l’obligation d’emploi des personnes handicapées ?
Madame la sénatrice Billon, vous m’interrogez sur l’impact de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sur le secteur adapté et protégé, qui emploie 110 000 travailleurs handicapés s’agissant des ÉSAT, et 40 000 travailleurs s’agissant des entreprises adaptées.
En effet, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a rénové cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Elle va conduire, à compter du 1er janvier 2020, à mieux distinguer l’emploi direct et l’emploi indirect des personnes handicapées, non pour opposer ces deux formes d’emploi, mais bien pour pouvoir décompter, en toute transparence, ce qui est fait par les uns et par les autres. Ainsi, à compter de 2020, les entreprises ordinaires rendront bien compte, via leur déclaration annuelle, du nombre de travailleurs handicapés qu’elles emploient directement, quelle que soit la forme de cet emploi – CDD, stage, intérim, période de mise en situation professionnelle.
Muriel Pénicaud et moi-même avons veillé à ce que cette déclaration leur soit doublement facilitée.
D’abord, les règles de déclaration des effectifs handicapés seront identiques à celles qui sont utilisées par l’ensemble des autres obligations déclaratives. Il n’y avait aucune raison qu’un salarié employé à temps plein six mois de l’année soit décompté de manière différente selon qu’il était handicapé ou pas.
Ensuite, ces déclarations seront automatisées, via la déclaration sociale nominative, pour en finir avec les cinq formulaires actuels et la centaine de rubriques à renseigner – la complexité ne sera plus une excuse –, et pour rapprocher les règles entre secteur privé et secteur public.
Pour autant, je vous confirme, comme je l’ai fait vendredi dernier devant l’ensemble des directeurs d’ÉSAT réunis en colloque, que l’obligation d’emploi va continuer à être très fortement incitative pour le recours à la sous-traitance du secteur adapté et protégé. En effet, le montant des dépenses de sous-traitance, qui était jusqu’à présent transformé, de manière assez incompréhensible, il faut le reconnaître, en équivalent emplois pour l’entreprise commanditaire, pourra être déduit en valeur du montant de la contribution due par les entreprises qui n’atteignent pas la cible de 6 %.
Les concertations sont en cours, mais je veux vous dire que mon objectif est bien de continuer à simplifier le plus possible ce dispositif, par exemple, en arrêtant de valoriser différemment les achats selon le type de prestations ou la taille de l’entreprise. Il faut arrêter de couper les cheveux en quatre, car les acheteurs ont besoin de plus de lisibilité. Les conditions de déduction seront même plus avantageuses, les simulations effectuées par mes services ayant montré que le dispositif proposé permettrait aux entreprises de déduire, par le recours à la sous-traitance, 25 millions d’euros supplémentaires de leur contribution, soit près de 40 % de plus qu’aujourd’hui.
L’intention du Gouvernement est donc très claire : continuer de valoriser le recours à un secteur adapté et protégé, qui joue un rôle majeur dans les parcours d’emploi de quelque 150 000 travailleurs handicapés, et que nous entendons bien renforcer avec le doublement des emplois dans le secteur adapté d’ici à 2022. C’est l’engagement conclu le 12 juillet dernier avec l’Union nationale des entreprises adaptées, l’UNEA, Muriel Pénicaud, l’Unapei, l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, l’APF France Handicap et moi-même. C’est un engagement que nous tiendrons et qui s’accompagne d’un effort financier du Gouvernement de plus de 500 millions d’euros et de 50 millions dédiés à la formation.
Madame la sénatrice, vous pouvez rassurer ce secteur qui fait partie de ces maillons indispensables à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

La parole est à Mme Annick Billon, pour répondre à Mme la secrétaire d’État.

Mme Annick Billon. Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse, apportée dans le temps imparti !
Sourires.

Je me félicite des engagements qui sont pris. L’objectif de décompte est important. L’automatisation et la simplification sont nécessaires. Au Sénat, nous y travaillons depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le rapprochement des règles participe aussi de la simplification.
Concernant l’obligation d’emploi incitative, je vous remercie de vos éléments de réponse. Les établissements et services d’aide par le travail, les entreprises adaptées et les travailleurs indépendants attendaient cette précision.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, auteur de la question n° 646, adressée à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Monsieur le secrétaire d’État, une solution pour les Américains accidentels doit rapidement être trouvée.
En effet, le moratoire qui exonère les banques européennes de leur obligation de collecter les social security numbers auprès de leurs clients identifiés « US Person » prendra fin au 31 décembre 2019.
C’est la raison pour laquelle la Fédération bancaire européenne a adressé, en août dernier, un courrier au département du Trésor américain afin de demander une solution permanente pour résoudre la question des Américains accidentels.
Si aucune solution n’est trouvée au 31 décembre, les banques européennes auront un choix cornélien à faire : soit enfreindre la directive européenne sur les services de paiement et prendre le risque de se voir attaquer devant la Cour de justice de l’Union européenne, soit enfreindre la législation américaine Fatca et risquer des pénalités de 30 % sur tous leurs flux financiers issus des États-Unis.
Le Parlement européen va adresser un courrier au Congrès américain pour l’alerter sur les problèmes rencontrés par les Américains accidentels.
La Commission des pétitions a examiné les allégations de violation par le Fatca des droits de l’Union et les effets extraterritoriaux des lois américaines dans l’Union européenne.
Selon un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2017, le principe de réciprocité n’est pas mis en œuvre dans l’application de l’accord franco-américain du 14 novembre 2013. M. Jacob Lew, ancien secrétaire au Trésor américain, l’a confirmé.
L’Association des Américains accidentels poursuit son combat avec détermination.
Il m’a été par ailleurs signalé que les Américains accidentels sont confrontés à un problème de double imposition lié au passage au prélèvement à la source. L’année blanche les a affectés, en ce qu’ils n’ont pas eu d’impôt à payer sur une partie de leurs revenus français de 2018, ce qui veut dire qu’ils ne pourront pas bénéficier d’un crédit d’impôt aux États-Unis sur les revenus de l’année 2018. Ainsi, en 2019, ils seront redevables tout à la fois de l’impôt français sur les revenus 2019 et de l’impôt américain sur les revenus 2018.
Lors des derniers débats qui ont eu lieu, ici, sur cette question, le Gouvernement avait indiqué qu’il allait entreprendre des actions auprès du gouvernement américain et de notre représentation diplomatique à Washington.
Pourriez-vous nous dire si ces actions ont abouti ? Si tel n’est pas le cas, êtes-vous prêt à utiliser les moyens de pression dont vous disposez pour permettre à ces personnes de vivre dignement, avec une véritable identité ? Ce sont des Français avant tout, et vous leur devez assistance.
Madame la sénatrice Jacky Deromedi, je vous prie d’excuser l’absence du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui m’a chargé de vous répondre sur ce sujet.
Vous avez rappelé la situation extrêmement complexe des Américains accidentels, ces doubles nationaux franco-américains qui ont acquis automatiquement la citoyenneté américaine à leur naissance, sans pour autant avoir conservé de liens étroits avec les États-Unis.
Or la nationalité américaine, comme toute nationalité, entraîne des obligations, notamment fiscales. C’est la spécificité de la loi fiscale américaine qui les affecte, car ils ne se sont pas mis en conformité avec les obligations leur incombant en la matière du fait de leur nationalité américaine.
Par ailleurs, l’application de l’accord Fatca ne soulève aucune difficulté pour les binationaux franco-américains en général. On ne peut pas dire qu’ils sont victimes d’une discrimination. Conscients, cependant, des difficultés que ces doubles nationaux peuvent parfois rencontrer dans le cadre de l’application de l’accord Fatca, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le ministère de l’économie et des finances ont entrepris plusieurs démarches, en particulier auprès des autorités américaines, afin de les accompagner dans la régularisation de leurs obligations auprès du second État dont ils ont la nationalité.
En effet, il n’appartient pas à la France d’indiquer à un autre État comment définir le lien qui unit ce dernier à son ressortissant. Si la France peut encourager les États-Unis à faciliter la procédure de mise en conformité des Américains accidentels, ce qu’elle fait de manière très active, elle ne peut donc être tenue pour responsable des difficultés pratiques dont l’origine ne lui est pas imputable.
Dans le même temps, les Américains accidentels, regroupés en association, ont attaqué l’État l’an dernier, demandant au Conseil d’État, par un recours pour excès de pouvoir, d’annuler les mesures de droit français d’application de l’accord Fatca, accord extrêmement important qui participe à l’éradication de l’évasion et de la fraude fiscales.
Le Gouvernement, quant à lui, continue son action pour porter assistance à ces doubles nationaux en suivant plusieurs voies. Nous avons commencé par établir une série de contacts : via notre ambassade à Washington, une mission interministérielle s’est rendue, à la fin du mois de mai 2018, aux États-Unis pour poursuivre les discussions avec les représentants de l’administration américaine. Ces échanges ont porté sur les moyens de faciliter les démarches auxquelles sont confrontés les Américains accidentels qui cherchent à régulariser leur situation vis-à-vis des autorités fiscales américaines ou à renoncer définitivement à cette citoyenneté. Nous nous employons à simplifier ces démarches et espérons parvenir à les rendre moins onéreuses que celles qui sont actuellement proposées, car telle est bien la difficulté que vous avez rappelée.
De même, après que les agents du ministère ont pris contact, début février, avec l’ambassade américaine à Paris, celle-ci s’est engagée à améliorer l’information à destination des Américains accidentels sur le site internet de l’ambassade. Elle veillera également à améliorer le système de récupération du numéro de sécurité sociale américain, indispensable en cas de démarche de régularisation.
Les échanges vont se poursuivre dans les prochains mois. Soyez assurée que nos administrations continueront de suivre très étroitement cette question.
Considérant qu’une action parallèle doit s’engager à l’échelon européen, nous avons souhaité nous concerter avec les autres pays européens dont certains ressortissants sont confrontés à des difficultés similaires. Cet effort a produit un premier résultat : ainsi, un courrier a été adressé, le 8 mai 2017, par la présidence de l’Union européenne au secrétaire américain au Trésor, appelant son attention sur les difficultés concrètes rencontrées. Il s’en est suivi un assouplissement de la transmission des numéros d’identification fiscale à l’Internal Revenue Service.
Il reste que les services de l’administration américaine, en particulier le département du Trésor, même quand ils sont sensibles à nos arguments et souhaitent faire évoluer la situation en faveur d’une simplification pour les Américains accidentels, de bonne foi, butent sur l’opposition d’un certain nombre de parlementaires américains, notamment des sénateurs qui sont réticents à tout changement législatif dans ce domaine.
En conséquence, l’aide qui pourra être apportée par les parlementaires français grâce aux contacts noués avec leurs homologues américains sera tout à fait utile et appréciable. Je sais, compte tenu de votre mobilisation sur ce sujet, que nous pourrons compter sur vous.

Monsieur le secrétaire d’État, cette fois, je ne vous ai pas interrompu, mais j’espère que vous veillerez dorénavant à ne pas dépasser votre temps de parole.

La parole est à M. Michel Amiel, auteur de la question n° 632, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Monsieur le secrétaire d’État, par cette question, qui pourrait tout aussi bien concerner la ministre de la santé, je souhaitais attirer l’attention du ministre de l’éducation nationale sur la situation problématique de la médecine scolaire dans notre pays.
Alors que le Gouvernement a mis en place un reste à charge zéro, pour permettre aux Français les plus modestes d’avoir accès à une autonomie de relations avec l’extérieur, se concentrant sur leur capacité à entendre et à voir, je souhaitais alerter sur l’impossibilité dans laquelle peuvent se trouver certains de nos enfants à communiquer.
En effet, comment s’assurer de la capacité des enfants de nos écoles à bien entendre, donc, à bien comprendre, à bien voir, donc, à bien lire, ce qui constitue la base d’un apprentissage optimal, si la médecine scolaire n’est pas là pour dépister et évaluer leurs difficultés éventuelles ?
Si la loi prévoit que tous les enfants devraient faire l’objet, à leur arrivée en CP, d’un bilan de santé, moins de 25 % des enfants en ont effectivement fait l’objet, ce qui n’est pas une surprise pour un élu de terrain. L’élu local que j’ai été peut vous affirmer que mes collègues maires, comme mes confrères médecins, sont conscients et choqués du manque de moyens de plus en plus criant dans la médecine scolaire.
Le nombre de médecins scolaires atteint un point critique : 976 pour 12, 5 millions d’élèves, soit 1 pour plus de 12 000 élèves, en sachant que, dans certains départements, il n’en existe aucun. Le plus terrible est que ce sont bien évidemment les personnes les plus démunies qui souffrent le plus de cette situation.
Alors que la politique d’égalité d’accès à l’école fera prochainement l’objet d’une loi « pour une école de la confiance », il apparaît important de promouvoir la bonne santé des élèves afin de leur offrir les meilleures conditions d’apprentissage.
Je vous demande donc quelle est la position du Gouvernement face à la perte de chances subie par toute une génération d’écoliers, alors que la prévention a été choisie comme un point fort de « Ma santé 2022 ». Je souhaite connaître les mesures envisageables – je parle de mesures rapides et concrètes–, dans l’attente de nouveaux médecins scolaires.

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour deux minutes trente maximum.
Monsieur le sénateur Michel Amiel, vous avez eu raison de rappeler les priorités de ce Gouvernement en matière de prévention pour la santé et de lutte contre les inégalités « à la racine ».
On le sait, l’inégalité sociale en matière de santé est très forte et frappe aujourd’hui de nombreux enfants sur le territoire. Nous assurons des missions de dépistage, de diagnostic, d’orientation vers des structures de soins et d’adaptation des contextes de vie scolaire aux besoins spécifiques de nos élèves. Surtout, nous avons conscience et prenons en compte l’importance et les répercussions de la santé sur la scolarité et, réciproquement, de la scolarité sur la santé de l’enfant.
Le déficit des médecins scolaires est un fait, vous l’avez rappelé. Ce n’est pas une question de moyens, car, ce qui est en cause, c’est l’attractivité de la profession, comme le montre la vacance d’un tiers des postes de médecins scolaires. Vous le savez, ces difficultés de recrutement de personnels médecins ne sont pas spécifiques à la médecine scolaire.
Des mesures, notamment financières, ont été prises pour revaloriser l’attractivité financière de cette profession. Elles commencent à porter leurs fruits, produisant déjà un frémissement visible et un certain nombre d’effets sur le terrain. Conscients qu’il nous faut évidemment poursuivre sur cette voie, nous réfléchissons à d’autres mesures financières de nature à remédier à cette situation.
Par ailleurs, pour développer l’attractivité de la profession, nous avons créé une formation spécialisée transversale, ou FST, de médecine scolaire. Elle s’adresse aux étudiants de troisième cycle des études de médecine inscrits en vue de l’obtention d’un diplôme d’étude spécialisée de pédiatrie, de médecine générale ou de santé publique. Les enseignements de la FST doivent débuter en novembre 2019. Le service sanitaire permettra également aux étudiants de découvrir cette profession dès le début de leurs études. Nous nous employons ainsi à renforcer l’attractivité de la médecine scolaire.
Par ailleurs, l’application numérique Esculape, outil moderne de suivi de la santé des élèves et d’organisation des visites avec l’aide des secrétaires médico-scolaires, a été déployée en 2017 dans toutes les académies afin de faciliter le travail des médecins et de disposer des données de santé.
La promotion de la santé en milieu scolaire s’intègre dans la stratégie nationale de santé 2018-2022, vous l’avez dit. Dans le plan national de santé publique « priorité prévention », deux mesures phares portent le développement d’écoles promotrices de la santé et le parcours de coordination renforcée santé-accueil-éducation pour les enfants de 0 à 6 ans.
Ces différentes actions vous montrent bien notre action, destinée à renforcer l’attractivité financière et à permettre aux futurs jeunes médecins de découvrir le métier de médecin scolaire dans le cadre de leur formation. Nous allons poursuivre dans cette voie, conscients qu’il s’agit d’un enjeu absolument fondamental pour la santé de nos enfants.

La parole est à M. Michel Amiel, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, nous partageons le même diagnostic. J’espère que les indications thérapeutiques que vous préconisez seront bien au rendez-vous.

La parole est à M. Édouard Courtial, auteur de la question n° 639, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Monsieur le secrétaire d’État, s’il y a un principe qui me semble fondamental concernant l’école de la République et sur lequel, j’en suis sûr, nous pouvons nous entendre, c’est bien celui d’une égalité des chances entre les écoliers de l’école des villes et ceux de l’école des campagnes.
Si la première a des difficultés réelles et sérieuses, la seconde a, elle aussi, de nombreux défis à relever, parmi lesquels, notamment, le recrutement des professeurs, les difficultés de financement par les communes, confrontées à la fois aux baisses des dotations et à des classes parfois surchargées.
Or, comme pour la rentrée 2018, sur les cinquante fermetures de classes annoncées dans l’Oise pour la rentrée 2019, une grande majorité concerne des écoles rurales tandis que les ouvertures se situent, pour une large part, dans les villes.
Vous ne manquerez pas de nous indiquer que le taux d’encadrement augmente, mais il cache, en réalité, une grande disparité territoriale et permet, surtout, d’assurer le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les REP et les REP+.
Aussi, afin d’éviter une rupture d’égalité et pour tirer l’école de la République vers le haut au bénéfice de tous les élèves, où qu’ils résident sur le territoire, je vous invite à vous saisir de la proposition de loi que j’ai déposée, qui crée des « REP ruraux » et permet aux élus de se faire entendre sur ce sujet.
Cette mesure vise non pas à opposer les écoles, ce qui serait une erreur, mais, au contraire, à prendre en compte les spécificités de « l’école des champs » afin que la politique éducative ne soit pas une réplique des vases communicants, où ce que l’on donne à l’un on le prend à l’autre.
Elle a également l’avantage de mettre à bas la logique démographique purement comptable, qui ne permettra plus, demain, à nos campagnes d’attirer des familles et empêchera celles qui y vivent d’y rester, faute d’école.
Enfin, ce dispositif récompense les investissements parfois très importants que les communes ont consentis pour maintenir l’école ou créer un regroupement pédagogique intercommunal.
Comme ancien maire, je sais ce que représente une école dans un village : un gage d’avenir !
Monsieur le sénateur Courtial, vous avez raison, cette question de l’école, notamment de l’école rurale, est absolument centrale dans le pacte républicain. Une école, c’est souvent ce qui anime aujourd’hui un village. On le sait, une classe ou une école qui ferme, même si le cas est heureusement assez rare, cela peut avoir un impact sur tout un bassin de vie. C’est la raison pour laquelle nous portons, comme vous l’avez dit, une attention extrêmement particulière sur la question du taux d’encadrement.
Compte tenu du fait démographique, un certain nombre de territoires perdent des élèves quand d’autres en gagnent, ce qui impose d’adapter l’encadrement en fonction de cette réalité. Pour autant, Jean-Michel Blanquer et moi-même avons refusé de l’adapter de manière strictement statistique et comptable.
Alors que la baisse démographique s’est traduite par une baisse de 35 000 élèves dans le premier degré public à la rentrée 2018, dans le même temps, nous avons créé 3 881 emplois de professeurs des écoles. Alors qu’une stricte application de la baisse démographique aurait conduit à supprimer 1 438 postes, nous avons choisi, au contraire, d’en créer. Le taux d’encadrement s’améliore et est aujourd’hui en progression partout sur le territoire. Dans les territoires les plus ruraux, il reste nettement supérieur à celui qui est appliqué en zone urbaine.
Vous l’avez dit, la définition de cette politique pose un enjeu et des questions. Je peux y répondre en vous proposant deux perspectives. D’abord, le grand débat national, au cours duquel ce sujet de l’école dans la ruralité est remonté très fortement. J’imagine que tel était aussi le cas dans l’Oise où j’étais, hier, en déplacement et où j’ai pu rencontrer un certain nombre d’acteurs.
Ensuite, la mission que nous avons confiée à Mme Ariane Azéma, inspectrice générale de l’éducation nationale, et à M. Pierre Mathiot, professeur des universités, pour étudier cette question « École et territoires » et se demander comment redéfinir nos politiques scolaires en fonction des différences entre territoires. Cette mission rendra ses conclusions avant l’été 2019. Je pense que nous pourrons nous en inspirer pour prendre un certain nombre de décisions afin d’adapter notre politique en la matière.

La parole est à M. Édouard Courtial, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous ai entendu évoquer l’amélioration du taux d’encadrement ; je m’y attendais et l’avais annoncé en posant ma question. Je veux redire que les disparités territoriales s’accentuent. C’est d’ailleurs, vous l’avez noté, l’un des grands sujets qui remontent régulièrement à l’occasion du débat national.
Je vous renvoie à ce que disait le Président de la République en juillet 2017 : « Les territoires ruraux ne peuvent plus être la variable d’ajustement, il n’y aura plus aucune fermeture de classe dans les zones rurales ».
J’espère que des actes suivront bientôt la parole !

La parole est à M. Yves Daudigny, auteur de la question n° 665, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur l’avenir de l’orientation dans l’Aisne.
Hétérogène, la carte des centres d’information et d’orientation, les CIO, dans l’Aisne est le fruit de l’histoire locale, de partenariats noués, d’engagements passés forts du conseil général.
Cinq des six CIO étaient ainsi hébergés dans les locaux propriétés du département. Aujourd’hui, des menaces pèsent sur les deux derniers CIO encore dans cette situation, ceux de Tergnier et Hirson. Le premier devrait être ventilé dans les établissements scolaires du secteur et rattaché à Saint-Quentin. Le second dessert, à partir d’Hirson, où il est implanté, sept collèges publics, un lycée général, un lycée professionnel, un lycée agricole, une maison familiale rurale, les établissements privés de Thiérache.
En moyenne annuelle, ce CIO d’Hirson conseille et accompagne 800 personnes. Il réalise une quarantaine de validations des acquis de l’expérience et travaille avec un peu moins d’une centaine de décrocheurs, dont 30 % ont repris des études, 18 % bénéficient du programme Compétences+ et autant ont trouvé une solution auprès de la mission locale.
Sur ce territoire rural, en fragilité économique et sociale, et ce malgré les engagements forts des collectivités locales, la proximité répond au récurrent problème d’absence de mobilité. Le démantèlement du CIO d’Hirson, par ailleurs ouvert durant les vacances, marquerait une rupture supplémentaire avec l’égalité territoriale. Il est donc essentiel de maintenir à Hirson les services d’information et d’orientation dans un point d’accueil physiquement indépendant des établissements scolaires.
Monsieur le secrétaire d’État, la question est donc posée de la confirmation, à Hirson, de ce point d’accueil indépendant, de l’avenir des agents concernés, de la prise en charge des frais assumés jusque-là par le conseil départemental. L’enjeu est bien le maintien d’un service public dont chacun s’accorde à saluer la nécessité et l’efficacité.
Monsieur le sénateur Yves Daudigny, vous l’avez dit, l’orientation est un sujet majeur. Elle a en effet été trop longtemps un facteur d’inégalités, notamment sociales, qui frappent des jeunes pas forcément munis du « capital familial » ou de l’environnement apte à leur dispenser les bons conseils en matière d’orientation.
Notre volonté est d’être plus efficace. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité transformer l’orientation afin que chaque élève puisse réussir et s’insérer dans le monde professionnel et la société en ayant accès à la même information, une information claire et assortie d’un accompagnement personnalisé.
Cet objectif passe par un nouveau partage de compétences entre l’État et les régions pour une meilleure éducation à l’orientation dès le collège. Ce partage a été défini par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : les régions, qui sont au contact du tissu économique et des opportunités de l’avenir, ont désormais la responsabilité d’organiser des actions d’information auprès des élèves sur les métiers et les formations. L’État conserve, quant à lui, une compétence pleine et entière dans la définition, au niveau national, de la politique d’orientation des élèves et des étudiants. Il continue de prendre les décisions d’orientation et d’affecter les élèves.
Dans ce contexte, notre objectif prioritaire est que l’État concentre son action dans les établissements scolaires pour renforcer l’accompagnement de proximité des élèves et des équipes pédagogiques, et parvenir à un maillage territorial plus fin.
Certains constats témoignent d’une dynamique déjà enclenchée en faveur d’un investissement plus important des personnels dans les établissements. Ainsi, le public scolaire et étudiant est majoritairement reçu en établissement – à hauteur de 76, 2 % pour la période 2016-2017. De plus, près de 75 % de l’activité des psychologues de l’éducation nationale, les PsyEN, se déroulent dans les établissements publics du second degré.
La nouvelle responsabilité des régions en matière d’information sur les formations et les métiers ainsi que l’objectif de renforcer l’accompagnement de proximité dans les établissements scolaires impliquent un resserrement progressif de la carte des CIO.
Il y a une situation dont nous avons en quelque sorte hérité. Après le désengagement financier de certains conseils départementaux, un tel resserrement est déjà enclenché depuis 2013. L’État s’est engagé, en 2016, à prendre à sa charge 373 implantations au niveau national, dont 12 pour l’académie d’Amiens, soit 4 CIO pour chaque département qui compose l’académie.
Ainsi, dans le département de l’Aisne, 4 CIO sont pris en charge par l’État : Château-Thierry, Soissons, Saint-Quentin et Laon. Ce maillage s’appuie sur le nombre d’élèves scolarisés par CIO sur les bassins d’emploi et de formation. Il tient compte des contraintes de transport et de distance. Il permet de conserver des structures d’accueil ouvertes à tous et d’assurer la prise en charge des publics spécifiques – les élèves nouvellement arrivés en France, les jeunes décrocheurs, les apprentis, les élèves de l’enseignement agricole ou privé, autant de catégories qui ne sont pas forcément scolarisées dans les établissements bénéficiant de cet accompagnement personnalisé.
Au-delà des implantations financées par l’État, que j’ai énumérées pour ce qui concerne le département de l’Aisne, la carte peut évidemment intégrer des implantations supplémentaires, sous forme de points d’accueil – vous avez mentionné celui d’Hirson – financés par une ou plusieurs collectivités locales afin d’accroître le maillage territorial.
C’est la responsabilité des collectivités locales. Pour sa part, l’État s’engage sur les 4 CIO à sa charge. À partir de là, nous souhaitons que les collectivités locales continuent de s’impliquer fortement dans ces questions d’orientation.

La parole est à M. Yves Daudigny, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de cette réponse très complète, mais pas totalement rassurante.
Je veux rappeler que le Président de la République a signé, le 7 novembre 2018, à Sars-Poteries, un pacte incluant de nombreuses mesures touchant l’éducation pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache, territoire aujourd’hui très fragile.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous entends souvent vous exprimer à la télévision avec beaucoup de conviction. Je souhaite que vous mesuriez combien ce sujet du CIO d’Hirson, qui, certes, n’est pas un grand sujet, participe tout de même, d’une certaine façon, à la déstructuration de la proximité et à la mutilation des territoires.

La parole est à Mme Brigitte Lherbier, auteur de la question n° 677, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Monsieur le secrétaire d’État, le projet de loi, intitulé « pour une école de la confiance », qui vient d’être débattu à l’Assemblée nationale, va rendre obligatoire l’école dès l’âge de 3 ans. Il soulève de nombreuses questions chez les parents, dans le corps enseignant et parmi les maires.
Dans ma ville de Tourcoing – où vous êtes venu récemment, monsieur le secrétaire d’État –, de nombreux enfants sont scolarisés tardivement pour la première fois. Cette scolarisation d’enfants avancés en âge pose évidemment des difficultés d’adaptation.
Le cadre éducatif de ces enfants est souvent dépourvu de stimulants intellectuels, limités à la sphère de l’appartement de zone urbaine, n’ayant que la télévision pour seul horizon.
Nous comprenons parfaitement l’intention louable de scolariser les enfants très jeunes, pour qu’une fois arrivés au CP ceux-ci disposent du savoir-être nécessaire à l’assimilation des apprentissages et éviter le décrochage scolaire si fréquent dans les secteurs économiquement difficiles.
Cependant, cette scolarisation obligatoire dès 3 ans doit se faire en respectant l’horloge biologique des enfants. On ne peut pas faire subir à un enfant de 3 ans le même rythme qu’à un enfant de 6 ans. De très nombreux parents choisissent de garder leurs enfants l’après-midi : ces derniers vont à l’école maternelle le matin et font la sieste à la maison l’après-midi. Si l’école devient obligatoire à 3 ans, il est plus que nécessaire de l’adapter aux tout-petits.
Vous fermez des classes en milieu rural. Les maires de nos circonscriptions sont inquiets des restrictions budgétaires de votre ministère.
La scolarisation dès 3 ans a un coût pour assurer de bonnes conditions matérielles d’accueil, telles qu’un local adéquat ou une adaptation des locaux et un équipement en matériel spécifique pour la sieste, définies en accord avec la collectivité compétente.
Les coûts liés à cette nouvelle obligation devraient être pris en charge par les communes dès la rentrée 2019, lesquelles vont logiquement devoir mettre la main à la poche. Les gouvernements précédents ont grevé lourdement leur budget en se désengageant. Le Gouvernement a supprimé leur autonomie budgétaire en faisant disparaître la taxe d’habitation. Dans ce contexte, rendre l’instruction obligatoire dès 3 ans risque d’avoir un effet direct et important sur le financement des écoles privées par les communes.
Monsieur le secrétaire d’État, l’école obligatoire à 3 ans ne sera un succès qu’à la double condition de mettre les moyens nécessaires pour pouvoir accueillir dignement les enfants tout en s’adaptant à leur rythme et de tolérer une assiduité adaptée au jeune âge de l’enfant.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet ?
Madame la sénatrice Brigitte Lherbier, vous posez une question extrêmement importante, celle de l’instruction à l’âge de 3 ans, mesure qui a été votée. Pour vous avoir rencontrée dans votre département du Nord, je sais votre mobilisation sur ces sujets d’éducation.
On peut d’abord s’accorder sur le fait que c’est un grand progrès d’abaisser l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans, un progrès qui s’inscrit dans la lignée des mesures républicaines successives prises en faveur de l’école depuis la fin du XIXe siècle, afin de garantir à chaque enfant un égal droit d’accès à l’instruction.
L’article 2 du projet de loi pour une école de la confiance, qui viendra prochainement en discussion devant le Sénat, vise donc à rendre l’instruction obligatoire dès 3 ans. C’est la concrétisation de notre ambition pour l’école et d’un engagement de campagne du Président de la République visant à élever le niveau général des élèves et à améliorer la justice sociale.
L’école maternelle est le lieu où épanouissement et premiers apprentissages font alliance.
La qualité de vie de l’enfant à l’école – quel que soit le nombre d’heures qu’il y passe – est un sujet essentiel, d’ores et déjà consacré par le code de l’éducation dans ses grands principes. L’école maternelle sait s’adapter aux possibilités cognitives des élèves et à leurs besoins physiologiques afin de créer les meilleures conditions d’apprentissage. Les emplois du temps des élèves sont pensés par les équipes enseignantes dans une progression qui ménage les temps de repos et les temps d’apprentissage et rend ainsi possible une fréquentation de tous les élèves sur la totalité du temps scolaire dès 3 ans.
Dans de nombreuses écoles, l’organisation de la sieste se fait déjà avec toute la souplesse nécessaire à la prise en compte des besoins de chaque enfant. Des aménagements seront prévus dans l’organisation de la scolarité, pour répondre à votre préoccupation.
La formation des professeurs des écoles sera renforcée pour une meilleure prise en compte des besoins des élèves à l’école maternelle, notamment avec la mise en place de conditions scolaires sécurisantes, si nécessaires à leur épanouissement.
Les conditions de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire sont donc réunies afin d’accueillir, dans les meilleures conditions, chaque enfant de la République.
Vous posez également la question du coût pour les collectivités locales.
L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans correspond à une extension de compétence des collectivités territoriales. En vertu de l’article 72-2 de la Constitution, une telle extension doit faire l’objet d’un accompagnement financier de l’État, dont les modalités seront prochainement précisées par un décret en Conseil d’État.
Pour les communes qui connaîtront une augmentation de leurs charges au titre de l’enseignement primaire pour l’année scolaire 2019-2020, les dépenses supplémentaires qui auront été générées par la présente mesure et qui seront constatées à l’issue de la rentrée scolaire feront l’objet d’un accompagnement financier de l’État avec un versement annuel pérenne.
Il sera versé, selon les situations locales, soit à la commune, soit à un syndicat intercommunal ou à une intercommunalité, à qui la compétence de scolarisation a été confiée. J’espère vous avoir rassurée sur ce point.

La parole est à M. Philippe Bas, auteur de la question n° 601, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question intéresse l’intégration des enfants handicapés à l’école de la République.
Depuis la loi de 2005, les enfants handicapés vont, par exception, dans l’éducation spéciale et, par principe, plutôt dans les écoles que fréquentent tous les autres enfants.
J’ai constaté que, dans la manière de décompter le nombre d’élèves d’une école pour attribuer les postes d’enseignant l’année suivante, on ne compte pas les enfants handicapés inscrits dans des classes appelées ULIS, pour Unités localisées pour l’inclusion scolaire, qui sont des classes d’intégration. Cela emporte des conséquences : le fait de ne pas les compter, alors que le nombre d’élèves dans le monde rural est un petit peu juste, a pour effet de diminuer le nombre d’enseignants dans des écoles qui ont, par ailleurs, une ULIS, comme cela limite les possibilités d’intégrer les enfants handicapés dans les différentes classes de l’école de la République.
C’est la raison pour laquelle je voulais vous demander si des instructions pourraient être données pour faire en sorte de tenir compte des enfants handicapés des ULIS dans le décompte des élèves de nos écoles primaires afin d’améliorer la qualité de leur encadrement.
Monsieur le sénateur Philippe Bas, comme vous l’avez dit, c’est la mission de l’école d’accueillir tous les élèves, sans aucune distinction.
Le très bel article L.111-1 du code de l’éducation prévoit que « le service public de l’éducation […] contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. […] Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. »
Le Gouvernement est particulièrement mobilisé sur la question. Sophie Cluzel, qui était au banc du Gouvernement il y a quelques instants, l’aurait affirmé, comme je le fais. Elle est elle aussi très mobilisée. Quand on parle de « service public du handicap », qui sont des mots très forts, cela a un impact très important sur les ambitions de l’éducation nationale.
L’Unité localisée pour l’inclusion scolaire, cette fameuse ULIS, offre aux élèves en situation de handicap la possibilité de poursuivre en inclusion dans les autres classes des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins, et d’acquérir des compétences sociales et scolaires.
Il s’agit d’un dispositif dont l’organisation pédagogique est adaptée aux besoins des élèves qui en bénéficient. Cette organisation permet de mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation de chaque élève.
Dans le premier degré, l’effectif d’une ULIS est limité à 12 élèves, qui sont inscrits dans une classe de référence correspondant au plus près de leur classe d’âge. Ces élèves sont tous pris en compte dans les effectifs globaux de l’école.
Jusqu’à présent, les élèves bénéficiant d’une ULIS n’étaient pas comptabilisés dans les effectifs de leur classe de référence, car l’ULIS était considérée comme une classe à part entière.
Cela permettait de prendre en compte la spécificité des écoles concernées dans le régime de décharge dont bénéficiait le directeur. C’était donc une mesure plus favorable permettant au directeur de consacrer plus de temps à l’établissement.
Désormais, l’ULIS est considérée comme un « dispositif» et les élèves sont donc « répartis » comptablement dans les classes ordinaires. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, l’évolution du système d’information, ONDE, permet en effet la prise en compte des élèves d’ULIS-école dans leur classe de référence.
Pour répondre à votre question, les rectrices et recteurs s’assurent évidemment que les directeurs académiques des services de l’éducation nationale portent une attention particulière aux écoles dans lesquelles sont implantés des dispositifs ULIS lors des opérations de carte scolaire. La prise en compte de ces élèves dans l’évolution de la carte scolaire prend ainsi pleinement en compte les objectifs d’éducation inclusive.
Nous sommes tout à fait attentifs aux difficultés que vous avez évoquées, qui pourraient survenir dans la prise en compte, dans la carte scolaire, de ces classes ULIS, afin que les élèves soient véritablement comptabilisés pour éviter un impact sur les établissements concernés.

La parole est à M. Philippe Bas, pour répondre à M. le secrétaire d’État

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Je pense que, à partir de ce rappel très opportun des nécessités de bien prendre en compte les élèves handicapés de nos ULIS dans le décompte de l’ensemble des élèves de l’école, on arrivera à maintenir le nombre d’enseignants permettant le bon accueil de tous les élèves.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 655, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur l’arrêté du 16 novembre dernier modifiant la liste des pièces d’identité qui peuvent être présentées pour voter.
Dorénavant, non seulement les passeports et cartes d’identité devront être périmés depuis moins de cinq ans, mais en outre seuls les nouveaux permis de conduire, au format « Union européenne », seront acceptés, alors que la plupart des Français n’utilisent que le permis rose à trois volets, pour le remplacement duquel, d’ailleurs, on leur permet d’attendre 2032.
Que comptez-vous faire pour informer rapidement les citoyens, les élus et les bénévoles, très nombreux, qui tiennent les 70 000 bureaux de vote ?
Surtout, allez-vous prendre des dispositions spécifiques pour les personnes âgées ? Un grand nombre d’entre elles ne voient pas l’utilité de remplacer leur carte d’identité et manipulent très mal internet, où se prennent les rendez-vous. Sans parler de celles qui vivent en Ehpad, pour lesquelles il est quasiment impossible, en tout cas financièrement, de faire réaliser une photographie sécurisée.
Enfin, s’agissant des cartes nationales d’identité, le délai de cinq ans court-il à compter de la date d’expiration portée sur la carte ou de la fin de la période de validité, désormais allongée de cinq ans ?
Je m’étonne de cette décision prise à quelques mois des élections européennes et de manière unilatérale : monsieur le secrétaire d’État, par quels motifs est-elle justifiée ?
Madame la sénatrice Catherine Procaccia, vous soulevez une question effectivement très importante ; élu local moi aussi – je l’ai été avant d’être député –, ancien assesseur dans des bureaux de vote, je mesure l’importance de l’enjeu, s’agissant notamment des personnes âgées, ainsi que la nécessité de règles claires et d’une bonne communication, notamment en direction des élus locaux.
La mise en place du répertoire électoral unique nécessitait une révision de l’arrêté du 12 décembre 2013 précisant les pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote, ainsi que celles qui sont admises pour l’inscription sur les listes électorales.
S’agissant de la pièce justificative de l’identité de l’électeur, il a été jugé essentiel que le titre traditionnellement autorisé comporte une photographie, afin de permettre un contrôle effectif par le président du bureau de vote.
Le même objectif de lutte contre la fraude a conduit à fixer à cinq ans la limite de péremption des cartes nationales d’identité et des passeports, suivant la règle qui prévaut généralement pour les réglementations édictées par le ministère de l’intérieur.
Pourront donc voter les électeurs munis d’une carte d’identité délivrée, au plus, vingt ans avant le scrutin, ou d’un passeport délivré, au plus, quinze ans plus tôt. Il sera toutefois demandé aux maires d’appliquer cette règle avec discernement, notamment lorsque les traits de la personne figurant sur le document d’identité sont aisément reconnaissables.
En ce qui concerne le permis de conduire, l’arrêté se borne à reprendre la terminologie européenne prévue par le décret du 9 novembre 2011 transposant la directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Au moment du vote, l’électeur pourra continuer de présenter un permis de conduire en carton rose jusqu’en 2033 – ce qui laisse un peu de marge…
Ces précisions figureront expressément dans la circulaire qui sera prochainement diffusée aux maires en vue de l’organisation des élections européennes.
Ainsi, ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause l’équilibre visant à offrir à l’électeur un nombre important de moyens de justifier de son identité, dans le but de favoriser sa participation, tout en garantissant un juste contrôle de cette identité, afin de limiter les risques de fraude en matière électorale.
De plus, le décret paru le 16 novembre dernier, en même temps que le corpus réglementaire nécessaire à la mise en œuvre du répertoire électoral unique, laisse à tous les acteurs du processus électoral un temps d’adaptation raisonnable.
Madame la sénatrice, j’espère vous avoir apporté les précisions que vous souhaitiez de la manière la plus claire possible.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le secrétaire d’État, vous parlez d’une nouvelle circulaire : pourquoi ne pas abroger l’ancienne ?
Par ailleurs, vous dites : nous aurons le temps. Mais savez-vous combien de temps il faut pour obtenir une pièce d’identité ? En région parisienne, parfois un mois, voire un mois et demi !
Pour ce qui est des personnes âgées, vous ne m’avez pas répondu, si bien que je m’interroge : ces dispositions prises sans que l’on sache pourquoi ne sont-elles pas destinées à « éliminer » un certain nombre de personnes âgées, très mécontentes des décisions du Gouvernement, notamment au sujet de la CSG ?
M. le secrétaire d ’ État s ’ exclame.

En matière d’information, des villes, comme Saint-Maur-des-Fossés, diffusent déjà des renseignements pratiques.
Vous parlez de vingt ans, mais, dans la circulaire, il est question de cinq ans : la confusion est totale… Quant à laisser le président du bureau de vote décider si la photographie représente bien l’électeur ou non, c’est discriminatoire : ce sera le droit de vote à la tête du client !

La parole est à M. Alain Cazabonne, auteur de la question n° 600, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question vient du désarroi qu’éprouvent, en Gironde, les maires de centaines de villes semi-rurales devant des véhicules qui devraient être éliminés : en l’absence de fourrière, ces maires font face à de grandes difficultés administratives et réglementaires.
En particulier, ils ne peuvent pas obtenir l’accord du propriétaire ni la carte grise, pourtant nécessaires pour détruire le véhicule.
Que doivent-ils faire, et sur quoi peuvent-ils s’appuyer pour éliminer ces véhicules, qui non seulement occupent de la place, mais peuvent également être dangereux ?
Monsieur le sénateur Alain Cazabonne, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l’intérieur, qui m’a chargé de vous répondre.
En matière de véhicules abandonnés, le maire peut rencontrer trois cas de figure.
S’agissant d’abord des véhicules en voie d’épavisation, s’ils sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière et livrés à la destruction à la demande du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Si la commune ne dispose pas de fourrière, ces véhicules terminent dans une fourrière gérée par l’État. Si le propriétaire du véhicule est connu, il doit rembourser les frais d’enlèvement, ainsi que les frais de garde en fourrière ; s’il est inconnu, ces frais incombent à l’autorité de fourrière.
Il y a ensuite le cas des épaves : lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie ou le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et ne peut être immédiatement réparé, le maire enjoint le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer dans un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.
Si la personne ne respecte pas le délai imparti, le maire a recours à un expert en automobile pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable : si c’est le cas, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule ; dans le cas contraire, il procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation.
Enfin, certains véhicules peuvent constituer des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Face à cette situation, le maire peut mettre en demeure le dernier propriétaire connu de prendre les mesures nécessaires pour que l’épave soit retirée.
À l’issue d’un délai d’un mois, si l’épave n’a pas été enlevée, le maire peut faire procéder d’office à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans un centre de véhicules hors d’usage agréé. Cette opération est toutefois réalisée aux frais de la commune, en l’absence de propriétaire connu.
Telles sont, monsieur le sénateur, les précisions que le ministre de l’intérieur m’a demandé de vous communiquer.

La parole est à M. Alain Cazabonne, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, pour cette réponse extrêmement détaillée – et néanmoins brève, ce qui nous fait gagner un peu de temps, monsieur le président !

Monsieur le secrétaire d’État, mon cher collègue, je vous en sais gré !

La parole est à Mme Nathalie Delattre, auteure de la question n° 631, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous interroger sur l’avenir du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le FIPDR.
L’article 5 de la loi du 5 mars 2007 a créé ce fonds afin de « financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville ».
Dans les faits, une partie substantielle de ce fonds a été consacrée à la sécurisation d’établissements scolaires, ne relevant souvent pas de la politique de la ville.
C’est la circulaire commune des ministres de l’éducation nationale et de l’intérieur du 29 septembre 2016, complétée par l’instruction du 5 avril 2017 et prolongée en 2018, qui a mis en place l’utilisation d’une partie du FIPDR pour financer la sécurisation des écoles. Les demandes de financement ont été arbitrées par les préfets de région, dans le cadre d’une enveloppe régionale de crédits dédiée.
Ainsi, les collectivités territoriales, associations, sociétés ou organismes propriétaires d’établissements scolaires publics ou d’établissements privés sous contrat ont pu se voir attribuer une aide au financement de la sécurisation périmétrique des bâtiments – vidéoprotection, portail, barrière, clôture, notamment – ou de la sécurisation volumétrique de ceux-ci, à hauteur de 20 % à 80 % du montant des opérations réalisées.
De tels investissements s’appuient directement sur le plan particulier de mise en sécurité des écoles concernées ou sur le diagnostic de sûreté dressé par les référents ad hoc de la police ou de la gendarmerie.
En 2018, ce volet du fonds interministériel a été rapidement épuisé, tant et si bien qu’un très grand nombre de communes candidates n’a pu se voir attribuer une telle subvention. Aujourd’hui, certains services de l’État proposent aux maires de monter des dossiers pour 2019, en attendant la circulaire nationale du ministre de l’intérieur.
Monsieur le secrétaire d’État, cette circulaire est-elle en préparation ? Quel montant de crédits allez-vous y consacrer ? Allez-vous compenser la sous-évaluation de l’enveloppe 2018 et ainsi répondre aux demandes plus que légitimes des communes ?
Madame la sénatrice Nathalie Delattre, je vous sais particulièrement mobilisée sur les questions scolaires ; vous étiez d’ailleurs au côté de Jean-Michel Blanquer dans votre département vendredi dernier.
En 2016, dans un contexte de menace terroriste, le ministre de l’intérieur et la ministre de l’éducation nationale d’alors ont décidé de mobiliser un abondement exceptionnel de 50 millions d’euros sur le fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la sécurisation des écoles et des établissements scolaires.
Dans ce cadre, 10 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 3 millions d’euros de crédits de paiement ont été ouverts par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016, sous la forme d’un report sur la gestion 2017. La loi de finances initiale pour 2017 a ouvert 25 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 15 millions d’euros de crédits de paiement. Dans le cadre de la programmation initiale pour 2018, 6, 9 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 10, 8 millions d’euros de crédits de paiement ont été prévus.
Depuis 2016, ce sont ainsi 38, 02 millions d’euros qui ont été engagés, et 32, 22 millions d’euros effectivement payés. Cet effort exceptionnel a permis de financer 6 504 établissements : l’ensemble des départements métropolitains ont été concernés, à l’exception des Hautes-Alpes et du Loiret ; outre-mer, 88 établissements ont été aidés, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.
Sur ces 6 504 établissements, 5 728 sont publics – 5 283 écoles maternelles et primaires, 402 collèges et 43 lycées – et 776 sont des écoles privées, dont 742 écoles catholiques, 26 écoles juives et 8 écoles musulmanes.
Madame la sénatrice, le ministre de l’intérieur m’a chargé de vous annoncer qu’un effort particulier était prévu cette année : le montant de la dotation sera porté à 12 millions d’euros, ce qui permettra de clore l’engagement annoncé à l’été 2016.
Nous restons particulièrement mobilisés sur cet enjeu majeur. Ainsi, un plan interministériel de lutte contre les violences scolaires, comportant un versant sur la sécurisation des établissements, sera prochainement présenté par les ministres, dans le sillage des annonces faites en décembre dernier par Jean-Michel Blanquer.

La parole est à Mme Catherine Dumas, auteure de la question n° 560, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le secrétaire d’État, lorsque j’ai déposé, à la fin de l’année dernière, cette question orale destinée à interpeller le Gouvernement sur les chiffres de la délinquance à Paris, nous ne savions pas que ceux-ci seraient aggravés par le spectacle affligeant et regrettable auquel nous assistons chaque samedi dans la capitale – je pense notamment à ce qui s’est produit le week-end dernier sur les Champs-Élysées. Nous reviendrons sur cette actualité cet après-midi, lors des auditions des ministres de l’intérieur et de l’économie, convoqués par notre assemblée.
Ce matin, je me concentrerai sur les inquiétudes nées du bilan annuel de l’enquête dite de victimisation de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui fait apparaître une très forte remontée des cambriolages.
Selon les dernières statistiques de la délinquance en France, 569 000 ménages victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage ont été recensés en 2017. Il s’agit d’un pic inédit et d’une augmentation importante, de 21 %, par rapport à l’année précédente, qui avait déjà vu 470 000 cambriolages et tentatives. Plus de 2 % des ménages français ont été concernés par cette problématique en 2017 ! Fort heureusement, le taux d’échec est resté stable, à 49 %.
J’observe que la région parisienne et les grandes villes de plus de 100 000 habitants, comme Paris, sont davantage concernées, et que les mois d’été et le mois de décembre, lors desquels les personnes s’absentent de leur domicile, sont les plus touchés. Il faut remarquer aussi que, dans un tiers des cas, une personne était présente au domicile lors de l’effraction.
Quelle interprétation le ministre de l’intérieur fait-il de cette situation inquiétante, et quelles mesures pourrait-on mettre en place pour y remédier, notamment à Paris ?
Madame la sénatrice Catherine Dumas, la lutte contre les cambriolages est l’une des priorités de la préfecture de police et de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne.
En la matière, commençons par nous réjouir collectivement des bonnes nouvelles. Le bilan pour 2017 sur l’agglomération parisienne fait apparaître une augmentation de 18 % du nombre de faits élucidés : grâce au travail exceptionnel des services de la préfecture de police de Paris, 600 cambriolages de plus ont été élucidés en 2017 par rapport à l’année précédente.
Il faut évidemment poursuivre et intensifier ces efforts. Je pense aux outils cartographiques, qui permettent un déploiement intelligent des patrouilles de voie publique et des brigades anticriminalité : grâce à ces outils, le volume des mises en cause pour faits de cambriolages a augmenté de 32 % depuis janvier 2018.
Le taux de déplacement de la police technique et scientifique sur les lieux de cambriolage afin de relever les traces et indices augmente également.
Les services de la préfecture de police analysent et centralisent les informations recueillies sur les lieux de cambriolage pour permettre aux enquêteurs d’imputer des faits et de diffuser des signalements.
La préfecture de police mène aussi des actions de prévention en direction des professionnels et des particuliers. Dans ce cadre, elle met à la disposition des commerçants, des entreprises et des professions libérales un service d’information et de conseil. Des policiers spécialisés prodiguent régulièrement des conseils personnalisés, doublés parfois d’une visite du bien immobilier du professionnel ou du bailleur qui en fait la demande.
Dans le cadre de l’opération Tranquillité vacances, les forces de police réalisent des visites régulières de domiciles de particuliers et de commerces dont les occupants sont temporairement absents. Les services de prévention des directions territoriales de sécurité de proximité suivent avec attention l’activité des dispositifs de participation citoyenne, qu’il faut saluer.
Enfin, des supports de communication sont diffusés par la préfecture de police en vue d’informer sur la manière d’agir pour protéger ses biens de valeur du risque de cambriolage en cas d’absence de son domicile ou de son commerce.
Les résultats encourageants sur l’élucidation des cambriolages et, en 2018, sur le nombre de mises en cause nous incitent à poursuivre et à intensifier notre action dans les directions que je viens de présenter.

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour répondre à M. le secrétaire d’État.

Merci, monsieur le secrétaire d’État, de votre réponse. Je me félicite, bien sûr, des résultats en matière d’élucidation et des actions menées sur le plan de la prévention. Je vous rappelle toutefois que, l’année dernière, ce sont 12 000 logements parisiens qui ont été visités, soit 1 700 de plus qu’en 2017 : c’est comme si l’ensemble du parc immobilier du premier arrondissement avait été cambriolé en un an… Cela fait encore beaucoup !

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.