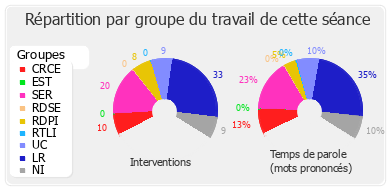Séance en hémicycle du 9 juin 2020 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

La séance est reprise.

Mme Dominique Vérien. Madame la présidente, je suis certaine que vous approuverez cette mise au point : sur les scrutins n° 117, 118, 119 et 120, Mme Valérie Létard souhaitait voter pour.
Sourires.

Acte vous est donné de votre mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique des scrutins concernés.

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger les victimes de violences conjugales.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 8.
Chapitre V
Dispositions relatives au secret professionnel
L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° devient un 4° ;
2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Madame la présidente, madame, monsieur les secrétaires d’État, mes chers collègues, le chapitre V est essentiel dans la lutte contre les violences conjugales et pour la protection des victimes.
Il s’agit de permettre une meilleure prise en charge judiciaire via un meilleur signalement des suspicions de violences, afin que les agresseurs ne bénéficient pas de plus longues complaisances. Ce signalement au procureur, qui est effectué par les médecins et les professionnels de santé, doit être dérogatoire au secret professionnel.
L’article 8 clarifie un point : le médecin qui signale auprès du procureur des violences au sein du couple ne commet pas d’atteinte au secret professionnel, qui est habituellement punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Je ne pense pas que cela entache la confiance entre la victime qui consulte et le généraliste.
Il me semble au contraire urgent de rétablir la hiérarchie des secrets.
D’un côté, le secret de la violence, qui est confiné au sein du foyer familial, est un secret destructeur.
De l’autre, lorsque cette violence est enfin perçue ou palpable au sein du cabinet médical, le secret du médecin qui se bornerait à soigner et à panser les plaies, mais sans accompagner la victime vers un horizon plus protecteur préserve l’agresseur. Il lui permet de recommencer à humilier, anéantir, frapper, violer. Ce secret doit s’effacer. L’enjeu, c’est le lien de confiance, non plus entre une patiente et un médecin, mais entre la victime et le reste de la société, celle qui soigne comme celle qui juge et qui punit.
Protégeons aussi les enfants, qui – cela a été souligné – sont « co-victimes » des violences conjugales. Ils entendent les humiliations et se construisent durablement dans l’idée que l’un des deux parents domine l’autre par la coercition, la menace, la force. Ils assistent aux brutalités. Ils les subissent directement parfois ou s’interposent. Placés dans le rôle de l’arbitre ou du témoin, ils sont les détenteurs d’un secret. Ils se savent menacés, s’ils révélaient le drame familial.
Nous devons faire primer la révélation du secret par le médecin ou le professionnel de santé, qui ne risque rien, pour protéger l’enfant victime. En effet, ainsi que le démontrent depuis tant d’années des magistrats comme Édouard Durand, protéger la mère, c’est protéger l’enfant.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le 3 septembre dernier, le Premier ministre, avec Mme la secrétaire d’État, a lancé le Grenelle contre les violences conjugales, sur la base d’un constat terrible que vous connaissez : en 2018, quelque 149 personnes, soit 121 femmes et 28 hommes, sont décédées sous les coups de leur conjoint. Cette situation n’est pas acceptable, et elle n’est pas une fatalité. C’est tout le sens de nos discussions d’aujourd’hui.
L’article 8 de la proposition de loi est directement issu des travaux du Grenelle. Il a été travaillé en lien étroit avec les associations de victimes et les représentants des professionnels de santé. Son objet n’est pas, comme nous avons pu l’entendre, de lever le secret médical ; il s’agit simplement de ne pas pénaliser les médecins, qui pourraient être hésitants sans cela, en cas de signalement au procureur de la République lorsqu’une vie est en danger.
Nous entendons évidemment les réserves qui ont pu être exprimées sur le sujet. Elles sont tout à fait légitimes au regard des situations de grande souffrance et de détresse que traversent les victimes de violences conjugales. Mais qui peut se satisfaire que 5 % seulement des déclarations soient réalisées par des professionnels de santé, alors que ceux-ci sont en première ligne pour prendre soin des victimes ?
Le secret médical – c’est aussi vrai, plus largement, du secret professionnel – n’est évidemment pas un sujet à prendre à la légère. Il fonde cette relation singulière de confiance d’un patient envers son médecin, liée au serment d’Hippocrate : « Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers […]. »
Ce texte n’altère en rien le secret médical. Le code de la santé publique n’est pas modifié. Le code de déontologie médicale est évidemment maintenu. Et la confiance d’une victime envers le professionnel de santé est ainsi préservée.
Il est proposé dans cet article de respecter une autre partie du serment d’Hippocrate, peut-être moins connue : « J’interviendrai pour protéger [les personnes] si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. »
Ainsi, l’article 8 prévoit, sans modifier le secret professionnel, de ne pas sanctionner le praticien qui fait un signalement au procureur de la République lorsque la vie de la victime est en danger immédiat. Il est issu des discussions avec l’ensemble des parties prenantes, notamment avec l’ordre des médecins, qui, dans un communiqué du 18 décembre 2019, a d’ailleurs publiquement soutenu la rédaction proposée pour l’article 226-14 du code pénal.
Une telle disposition protège à la fois les professionnels de santé, qui, jusque-là, pouvaient hésiter à effectuer des signalements, et les victimes de violences conjugales, pour éviter les scénarios du pire. C’est ce qui fondera notre avis défavorable sur l’amendement de suppression et qui guidera nos prises de position sur les autres amendements.

L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud, Apourceau-Poly et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann et MM. Ouzoulias et Savoldelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Nul ne peut nier l’effet délétère de l’emprise psychologique dans un couple, notamment lorsqu’elle est nourrie par la peur et les pressions morales.
Pour de nombreuses victimes de violences conjugales, la première étape est celle du déni. Une personne battue par le conjoint ou compagnon dont elle est amoureuse refuse souvent de se considérer comme une victime. Elle finit d’ailleurs bien souvent par s’estimer responsable des attitudes violentes de son compagnon à son égard. Cependant, les victimes se rendent parfois dans les hôpitaux pour faire constater et soigner leurs blessures.
Nous ne souhaitons pas que le médecin, comme le prévoit l’article 8, soit autorisé à dénoncer les actes de violence qu’il a pu constater sur sa patiente auprès du procureur de la République. Nous estimons en effet qu’une telle atteinte au secret médical pourrait se révéler contre-productive et pousser les victimes de violences conjugales à renoncer aux soins médicaux. Il est impératif que le lien de confiance existant entre les patients et le personnel soignant soit maintenu.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’article 8.

Ainsi que M. le secrétaire d’État l’a expliqué, le serment d’Hippocrate est quelque chose de très particulier. Quand vous prêtez serment, on vous donne une sorte de toge. Dans mon cas, je me souviens – cela m’avait marquée – qu’elle était usée et crasseuse : nombre de pairs, de confrères, m’avaient précédée.
Prêter ce serment, cela a vraiment une signification : « Mes yeux ne verront pas » ce qui se passe à l’intérieur des maisons. Le secret demeure, afin de protéger non pas le médecin, mais le patient, et de garder ce lien un peu mystérieux qui se tisse au fil des consultations et des années. Il permet de respecter la parole donnée.
Supprimer l’article 8 serait vraiment contraire à la position de la commission. Nous avons amélioré le dispositif, pour que le secret entre le patient et le médecin soit maintenu. C’est une protection.
La loi prévoit la possibilité de déroger au secret médical lorsque c’est indispensable à la survie du patient. Cela ne nous pose évidemment aucun souci. Mais la crainte que vous exprimez ne me paraît pas justifiée. Cet amendement n’a pas véritablement de sens, car il ne tend pas à élargir considérablement le champ du secret.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Avis défavorable, pour les raisons que j’ai exposées précédemment.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud, Apourceau-Poly et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann et MM. Ouzoulias et Savoldelli, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111-17 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le professionnel de santé qui a l’intime conviction que son ou sa patiente subit des violences conjugales peut, avec l’accord de ce ou cette dernière, le ou la mettre en relation avec des associations en charge de lutter contre ces violences ou avec tout organisme susceptible de l’aider. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Ainsi que nous l’avons souligné précédemment, l’article 8 autorise le médecin ayant constaté des marques de violences sur le corps de sa patiente à dénoncer la situation auprès du procureur de la République.
Cela contreviendrait à l’évidence au secret médical, qui constitue pour les patientes et les patients une garantie de liberté d’échanges avec les représentants du corps médical et favorise l’instauration d’une relation de confiance indispensable au bon déroulement des soins et du traitement.
Il n’est donc aucunement souhaitable que le médecin se transforme en un rouage de la procédure judiciaire. Nous préférons que le personnel hospitalier ait un devoir de conseil et d’accompagnement envers la victime, au lieu du rôle de dénonciateur que l’article 8 tend à lui assigner.
Il nous semblerait donc pertinent que le personnel soignant puisse diriger les patientes ayant subi des sévices au sein de leur foyer vers des associations chargées de lutter contre les violences. Ces structures sont les mieux armées pour rassurer les victimes, leur apporter un soutien moral, les éclairer sur leurs droits et, le cas échéant, les accompagner dans le cadre d’éventuelles procédures judiciaires.
Nous proposons donc un substitut à la fin, prévue à l’article 8, du secret médical pour les victimes de violences conjugales.

Un médecin pourra évidemment toujours orienter la personne vers une association ou une structure de prise en charge adaptée. Nous le faisons souvent. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier ces organismes, qui font un travail extraordinaire.
Malheureusement, un tel accompagnement social de la victime n’est pas toujours suffisant. Il faut donc prévoir la possibilité de prévenir la justice, qui est souvent la seule à avoir les moyens de mettre un coup d’arrêt à la violence du conjoint. Notre objectif doit être de stopper l’agresseur. Il faut vraiment, me semble-t-il, conserver la rédaction de l’article 8 que nous avons proposée.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Je regrette que les deux amendements présentés par Esther Benbassa et cosignés par l’ensemble de notre groupe ne fassent pas plus débat.
Outre les problèmes que notre collègue a décrits, un certain nombre de contradictions ont été pointées, notamment par les associations féministes. Et j’ai également entendu Mme la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en relever quelques-unes à l’Assemblée nationale.
Nous sommes toutes et tous conscients du phénomène : une femme sous emprise est parfois paralysée lorsqu’il s’agit de dénoncer les violences ; d’où l’importance du soutien et de l’accompagnement par les professionnels de santé. Évidemment, savoir comment elle va réagir et si elle va le faire suffisamment vite est une autre question. C’est là que réside la contradiction : nous voulons en même temps que la femme ait le libre choix.
En fait, les amendements qui ont été présentés par ma collègue nous appellent, tout en prenant en compte la réalité de l’emprise, à ne pas considérer les femmes comme des êtres mineurs, incapables d’effectuer les choix qui s’imposent : se prendre en main et, grâce à l’accompagnement des personnels de santé, aller porter plainte.
C’était le sens de notre amendement de suppression. L’article 8 n’est pas du tout nuancé, même si la commission l’a amélioré, ce dont je conviens bien volontiers et dont je remercie Mme la rapporteure.
Lorsque ma collègue Esther Benbassa souligne combien il est important de préciser que le médecin ou le professionnel peut donner les coordonnées des associations féministes, les réponses de Mme la rapporteure, qui fait référence à la justice, sont insuffisantes.
Bien évidemment que la justice et la police ont un rôle à jouer ! Mais il faut aussi un accompagnement psychologique. Au demeurant, les associations qui l’assurent ont besoin de moyens humains et financiers. Il ne suffit pas de les saluer seulement quand cela nous arrange.
Madame la sénatrice, j’ai entendu comme vous des associations féministes déplorer qu’un tel article revienne à « considérer les femmes comme des mineurs en incapacité de prendre des décisions pour elles-mêmes », ce qui serait très dérangeant d’un point de vue philosophique.
Certes, le débat s’entend, et vous avez raison de soulever cette question. Mais je rappelle que nous parlons de situations d’urgence et de vies à sauver ! Nous ne pouvons pas répéter sans cesse qu’il ne faut rien laisser passer, lancer des campagnes pour faire intervenir les témoins de violences à l’encontre des femmes et des enfants et rappeler que le problème concerne l’ensemble de la société, tout en continuant d’exposer les médecins et les professionnels de santé au risque de faire parfois l’objet de sanctions – c’est ce que les intéressés nous ont dit – en cas de signalement de violences conjugales.
Il me paraît donc extrêmement important que des médecins ayant face à eux des femmes peu décidées à alerter les forces de l’ordre puissent le faire eux-mêmes.
En outre, et vous le savez toutes et tous, mesdames, messieurs les sénateurs, dans la réalité, des femmes refusent de porter plainte et ne veulent pas que l’on intervienne, alors qu’elles sont en danger de mort. Il faut donc que quelqu’un d’autre agisse dans une telle situation.
Enfin, vous avez évoqué les moyens. Je le rappelle, pendant le confinement, nous avons ouvert un fonds exceptionnel d’un montant d’un million d’euros pour soutenir les associations locales de terrain. Il n’est pas entièrement utilisé.
Encore une fois – je le répète sans cesse –, si des associations ont besoin de plus de subventions parce qu’elles sont en difficulté ou ont un projet à défendre, il faut absolument qu’elles fassent remonter leur dossier au service des droits des femmes, afin de pouvoir en bénéficier.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Je regrette que cet amendement ne soit pas un amendement de complément. En effet, la proposition qui nous est adressée est évidemment pertinente.
Notre collègue Laurence Cohen a raison : nous aurions dû débuter par un débat de fond ; les amendements ont seulement pour objet de mettre en œuvre les choix qui nous paraissent les plus pertinents.
Premièrement, considérons-nous qu’il faut dénoncer les violences conjugales chaque fois que cela est possible ? Au demeurant, le médecin n’est pas le seul à pouvoir venir en aide : tout le monde peut le faire.
Deuxièmement, quid du rapport entre le médecin et sa patiente ? À quel moment est-il le plus efficace de déclarer des faits à la justice ? Est-ce au médecin de le faire ? C’est la bonne question.
N’étant pas médecin, j’ai essayé d’écouter les praticiens confrontés à ce type de problématique. Nombreux sont ceux qui nous alertent : si la patiente n’a plus confiance dans le secret du cabinet, arguent-ils, elle pourrait ne plus s’y présenter. C’est une objection légitime. D’autres, y compris au sein de notre groupe, militent en faveur du signalement.
J’ai tendance à penser qu’il faut l’accord de la patiente ; avec plusieurs collègues de mon groupe, j’ai d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.
Le débat qui a été entamé par Laurence Cohen et Mme la secrétaire d’État Marlène Schiappa est très intéressant. Il faut le savoir, on peut déroger au secret professionnel en cas de violences ou de maltraitances, mais avec l’accord de la victime ; c’est l’article 226-14 du code pénal. Le seul cas où l’accord de la victime n’est pas demandé, c’est lorsqu’il s’agit d’un mineur. Il est donc considéré dans le dispositif qui nous est proposé qu’être sous emprise revient à être mineur ! C’est une question importante.
À titre personnel, je pense que le fait d’être sous emprise nécessite évidemment un accompagnement particulier – c’est le rôle du médecin –, mais que ce n’est pas la même chose que d’être mineur.
J’ai donc proposé, avec un certain nombre de collègues, un amendement tendant à valider l’intégralité du dispositif envisagé, qui a d’ailleurs le mérite d’introduire pour la première fois le terme « emprise » dans le code, à condition que la patiente ait donné son accord, sous peine de détruire le lien de confiance, si utile dans une telle période, entre le médecin et sa patiente.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 49, présenté par Mmes Meunier et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ; »
…° Le 3°, qui devient le 4°, est ainsi rédigé :
« 4° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
La parole est à Mme Michelle Meunier.

Cet amendement vise à préciser explicitement dans la loi l’obligation de signalement par les médecins de suspicions de violences sur mineur.
Je rappelle qu’un amendement identique avait été adopté par le Sénat au mois de juillet 2018 lors de l’examen du texte relatif à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. En revanche, il n’avait pas passé le cap de la commission mixte paritaire. Nous avons donc aujourd’hui l’occasion de rattraper le temps perdu.
Hormis les médecins agents de l’État ou de la fonction publique territoriale, les médecins sont confrontés à un dilemme éthique.
S’ils signalent les violences, ils risquent des sanctions disciplinaires et des poursuites pénales au regard de la levée de leur secret professionnel après avoir appliqué l’article 226-14 du code pénal, comme cela vient d’être souligné. Cela va d’ailleurs pourtant à l’encontre des recommandations de la Haute Autorité de santé.
S’ils ne signalent pas les violences, ils risquent de faire l’objet de poursuites et de sanctions pénales pour entrave à la saisine de la justice.
C’est peut-être ce dilemme qui explique le faible taux de signalement lorsqu’un médecin détecte des signaux d’alerte permettant de suspecter des violences psychologiques, physiques ou sexuelles à l’encontre de mineurs.
L’introduction de l’obligation de signaler permettrait donc de multiplier les taux de cas confirmés de signalements, de réduire le risque pour un enfant de mourir des coups qui lui sont infligés, de réduire un long parcours de souffrance des victimes – le signalement est, je le rappelle, la clé du parcours de soins – et de rompre le cycle de la violence le plus tôt possible, pour prendre en charge les agresseurs, afin qu’ils ne récidivent pas auprès d’autres mineurs.

Cet amendement tend à instaurer une véritable obligation de signalement à la charge des professionnels de santé lorsqu’ils suspectent qu’un mineur est victime de violences.
Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ce sujet, ma chère collègue. Le rapport d’information que nous avons rédigé avec Catherine Deroche et Maryse Carrère est parvenu à la conclusion que l’équilibre actuel, qui repose sur une option de conscience laissant aux professionnels de santé la faculté de signaler, était satisfaisant. Instaurer une obligation de signalement ne mettrait pas fin au dilemme éthique de tout médecin qui suspecte, sans en être certain, que des violences sont commises sur un mineur.
Il faut bien comprendre que le médecin est toujours dans un conflit de devoirs. Doit-il signaler, ou non ? De quelle façon peut-il protéger du mieux possible ? Le vrai problème est là.
Vous avez déjà défendu cette position au sein de notre groupe de travail, ma chère collègue, et je vous félicite de votre constance. Mais nous sommes également constants, dans le droit fil des conclusions de notre mission d’information. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Permettez-moi tout d’abord de saluer à mon tour le travail que vous avez mené avec Catherine Deroche et Marie Mercier. Nous avons eu l’occasion à de nombreuses reprises de converser sur la meilleure façon de protéger les enfants contre les violences.
Cet amendement, qui vise à instaurer une obligation de signalement des violences exercées à l’encontre des mineurs, est en réalité déjà satisfait. Son introduction dans le texte pourrait créer de la confusion, et nous nous accorderons tous pour dire qu’il ne saurait y avoir de confusion en ces matières.
En vertu de l’article 434-3 du code pénal, révéler des maltraitances commises au préjudice de mineurs est une obligation légale. Quant à l’article 226-14 de ce même code, il délivre les professionnels du secret médical en cas de privations ou de sévices infligés à des mineurs.
Il est vrai en revanche que les médecins libéraux signalent très peu les violences sur mineurs. Seuls 5 % à 6 % des signalements sont issus de ces professionnels, qui voient pourtant passer des enfants tous les jours.
Nous avons décidé de traiter ce sujet dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants, que j’ai présenté le 20 novembre dernier à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. L’une des 22 mesures de ce plan prévoit la possibilité de désigner, d’ici à 2022, dans chaque territoire des équipes pédiatriques référentes pour soutenir les médecins libéraux, qui, en réalité, sont trop souvent seuls face à ces situations.
Quand vous êtes installé dans une petite commune et que vous êtes le médecin de famille depuis plusieurs générations, vous n’êtes pas forcément très à l’aise avec ce genre de situations, et vous pouvez avoir besoin d’un service ou d’une personne-ressource pour vous accompagner et, éventuellement, prendre votre relais.
Dans les faits – vous êtes bien placée pour le savoir, madame la sénatrice –, c’est ce qui se passe déjà au CHU de Nantes, où le docteur Vabres est de facto devenu, depuis une vingtaine d’années, une personne-ressource pour les médecins du territoire, qui se tournent naturellement vers l’unité d’accueil pédiatrique « Enfants en danger » pour obtenir un soutien.
Le plan que j’ai présenté en novembre dernier prévoit que, d’ici à 2022…
Ce sera au plus tard à cette date, madame la sénatrice, et nous irons le plus vite possible, car c’est en effet une mesure fondamentale.
Pour le reste, les dispositions du texte nous semblent satisfaisantes, et nous ne voulons pas créer de confusion en les modifiant. Comme je l’ai dit et répété, nous avons obtenu, après concertation avec les professionnels de santé, un équilibre qui satisfait tout le monde.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 48, présenté par Mmes Meunier et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
estime en conscience
par le mot :
suspecte
La parole est à Mme Michelle Meunier.

Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoyait que le secret professionnel n’était pas applicable au médecin ou au professionnel de santé « lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat ».
La commission des lois du Sénat a retenu la rédaction suivante : « Lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat ». Pour ma part, je préférerais employer le verbe « suspecter ».
Le médecin ou le professionnel n’a pas à convoquer sa conscience, qui relève de la déontologie des soignants. L’article R. 4127-44 du code de la santé publique précise d’ailleurs que le médecin « alerte les autorités judiciaires ou administratives sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». Il n’y a donc pas lieu de procéder à ce rappel : il serait redondant à mon sens, dans le code pénal.
De plus, la consultation ne place pas les médecins ou les professionnels de santé dans une situation de témoins. Ni les violences ni leurs conséquences ne peuvent donc leur apparaître directement. En revanche, ces professionnels de santé sont formés à détecter des signaux d’alerte, à repérer des situations, à discuter et à interroger les victimes potentielles. Ils ne peuvent donc que suspecter des faits, dont les conséquences potentiellement graves nécessitent le signalement.
Des poursuites ont déjà été engagées à l’encontre de professionnels ayant effectué un signalement sur le fondement d’une suspicion de violences exercées par le conjoint après l’examen d’un enfant conduit par un parent. Il faut protéger les médecins pour les encourager à signaler. Il revient ensuite au procureur de diligenter une enquête contradictoire.

Ma chère collègue, vous suggérez de modifier l’article 8 pour indiquer que le professionnel de santé peut effectuer un signalement lorsqu’il suspecte des violences.
J’ai moi-même proposé à la commission la rédaction « estime en conscience », pour bien marquer la responsabilité qui incombe aux professionnels et insister sur l’option de conscience qui s’applique en pareilles circonstances. N’oubliez pas qu’un médecin ne doit pas déroger au secret professionnel dont il est dépositaire.
Toutefois, il n’y a pas d’opposition entre nos deux rédactions. La discussion de votre amendement me donne l’occasion de préciser que l’on n’attend pas du professionnel qu’il ait la certitude que des violences sont commises pour pouvoir signaler. C’est en effet l’enquête qui permettra d’apprécier ce qu’il en est véritablement.
Je préfère donc conserver la rédaction que nous avons adoptée en commission. Elle met bien en lumière selon moi le cas de conscience du médecin qui envisage de transgresser le secret professionnel parce qu’il a acquis la conviction que sa patiente est en danger.
Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
La décision de déroger au secret médical est éminemment lourde. Elle doit être prise après une réflexion du médecin, qui conclut à l’impératif de venir en aide à une personne dont la vie est en danger. Nous sommes véritablement là au cœur de la tension éthique entre le respect du secret professionnel et la déclaration au procureur d’une situation dont on estime qu’elle peut mettre en danger la vie d’une personne.
La rédaction « estime en conscience » nous semble bien traduire cette tension éthique, contrairement au verbe « suspecter », qui me semble en réalité relativement neutre, madame la sénatrice.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Vérien, MM. Delcros et Janssens, Mmes Gatel, C. Fournier et Vermeillet, M. Brisson, Mmes Kauffmann, Billon et Perrot, MM. Détraigne et Kern, Mmes Férat, Guidez, Bonfanti-Dossat et Sollogoub, MM. Canevet et Laugier, Mme Vullien, M. Delahaye, Mme A.M. Bertrand, MM. Poadja, Cadic et Lafon et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Supprimer le mot :
immédiat
La parole est à Mme Dominique Vérien.

L’article 8, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’il peut être dérogé au secret médical lorsque « ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat ».
Ces termes renvoient à un risque de mort imminente pour la victime, une temporalité qui ne s’applique généralement pas dans les cas de violences conjugales. C’est plutôt une mort lente qui intervient, et c’est pourquoi on parle d’ailleurs d’emprise.
Le médecin n’intervient pas au moment du danger immédiat. Souvent, c’est trop tard, et la prise en charge se fait plutôt aux urgences dans ce cas. C’est donc lorsque le médecin pense que la victime est sous emprise et qu’elle n’a pas les moyens de se défendre toute seule qu’il doit l’accompagner et effectuer un signalement.
Par ailleurs, nous sommes bien d’accord, ce sera ensuite à la justice de faire son travail, mais, pour laisser le temps de l’enquête, il est préférable que le médecin signale la situation dès qu’il a l’intime conscience d’un danger, sans pour autant que celui-ci soit immédiat.

Je l’ai déjà dit, nous sommes attachés au secret médical, car c’est une garantie essentielle pour les patients.
Si l’on affaiblit ce secret, on court le risque que les patients ne consultent plus leur médecin ou décident de ne plus se confier à lui.
Même lorsqu’un médecin devine qu’il se passe quelque chose, il lui arrive de ne plus revoir sa patiente, parce qu’il est allé un peu loin, que ce n’était pas le moment, qu’il n’a pas trouvé les bons mots, que la patiente s’est sentie découverte et qu’elle a honte d’être battue. J’ai connu des situations de ce genre.
S’agissant de personnes majeures, la dérogation au secret médical ne peut être admise que pour sauver un patient dont la vie est directement menacée. Le médecin peut bien évidemment accompagner sa patiente, l’encourager à porter plainte, mais il n’a pas vocation à se substituer à elle, sauf en cas de péril immédiat.
Le lien de confiance entre les patients et les médecins est fragile ; il faut essayer de l’entretenir, pour garder nos patientes et peut-être les sauver plus tard.
C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
Les situations de dérogation au secret professionnel ne risquent pas d’être trop restreintes, selon moi. Le terme « immédiat » qualifiant le danger, la possibilité de dérogation au secret médical dépasse les seules situations où il existe un risque vital immédiat, comme l’a bien précisé Mme la rapporteure.
Il nous semble toutefois important de caractériser le risque qui pèse sur la victime au moyen de cet adjectif. Je le redis encore une fois : cette formulation est le fruit d’un consensus trouvé avec l’Ordre des médecins.
J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt Mme la rapporteure et j’ai trouvé qu’elle plaidait formidablement bien pour que l’accord de la patiente soit une condition indispensable du dispositif
Sourires.

L’amendement proposé par notre collègue Dominique Vérien tend effectivement à élargir le champ de la dérogation au secret, y compris sans l’accord de la patiente. À titre personnel, je ne puis partager ce point de vue, car cet accord me semble indispensable.
En outre, lorsque Mme la rapporteure explique combien il est important que la patiente ait confiance dans le praticien pour qu’elle revienne à son cabinet, elle plaide, me semble-t-il, pour maintenir l’accord de la patiente, c’est-à-dire pour l’amendement que je vais présenter juste après, et contre le présent amendement, que, par souci de cohérence, je ne souhaite donc pas soutenir.

Une personne sous emprise n’a pas les moyens de se défendre seule. Si elle n’est pas aidée et accompagnée, elle n’y arrivera pas. Le médecin fait partie des professionnels qui peuvent l’aider ou l’accompagner.
Je comprends toutefois que cet article d’équilibre, qui permet de « faire avancer le sujet », comme le dirait Mme la rapporteure, a été négocié avec l’Ordre des médecins.
Je pense néanmoins que l’on ne peut pas demander à une personne sous emprise de prendre une décision éclairée pour elle-même. Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.

L’amendement n° 11 rectifié est retiré.
L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mme de la Gontrie, M. Montaugé, Mme Lepage, M. Féraud, Mme Rossignol, MM. Duran, Tissot, Vaugrenard, Manable, Fichet et Daudigny, Mme Conway-Mouret, MM. Mazuir et Leconte et Mme Perol-Dumont, est ainsi libellé :
Alinéa 4, dernière phrase
1° Supprimer les mots :
s’efforcer d’
2° Supprimer les mots :
en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord,
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

La rédaction de l’article 8 prévoit que le médecin « doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ». Toutefois, s’il ne l’obtient pas, il peut quand même faire le signalement.
La formule a sans doute été introduite pour prier le professionnel d’essayer de convaincre son patient. C’est une bonne chose, sachant que la situation doit aussi se caractériser par un danger immédiat et un état d’emprise.
Toutefois, pour un grand nombre de praticiens, il est important de maintenir une relation de confiance, et donc de secret, entre le patient et son médecin. C’est pourquoi nous proposons, à travers cet amendement, de modifier la rédaction de l’article 8. Le médecin doit obtenir l’accord de son patient pour pouvoir signaler.

Ma chère collègue, je suis parfaitement d’accord avec votre introduction, le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de son patient. J’ajouterai toutefois : « Sauf en cas de danger immédiat et d’emprise »…
L’emprise, c’est une prise de possession du psychisme de l’autre, comme si un vampire venait aspirer sa volonté. Une personne sous emprise subit en permanence une influence abusive, possessive et négative sans pouvoir s’en dégager et sans même s’en rendre compte. Elle est comme possédée et reste sous emprise, même quand le bourreau n’est pas là. Si ce dernier lui a dit : « Tu n’es qu’un déchet ; quand je ne serai pas là, tu mangeras tes déchets », elle le fera même s’il n’est pas là, car elle n’existe plus par elle-même.
C’est quelque chose d’assez mystérieux, en effet. Le médecin doit diagnostiquer la patiente sous emprise et l’aider à s’en libérer. Il est intéressant aussi de comprendre comment l’emprise s’installe, avec d’abord une phase de séduction – « tu es la plus belle » –, puis de dénigrement – « tu es la plus moche » –, et un long chemin qui entraîne la victime vers les bas-fonds que chacun abrite à l’intérieur de soi-même.
Le diagnostic est complexe, mais la victime sous emprise ne pourra jamais donner son accord. Or, pour sauver ces patientes, il faut pouvoir les aider et les orienter vers une thérapie.
Je le redis, la rédaction de l’article 8 repose sur un équilibre, avec cette double condition d’un danger immédiat et d’une emprise. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger au secret professionnel, une avancée qui forme le cœur de cet article 8.
J’en profite pour rappeler que les dérogations au secret médical existent déjà pour les mineurs et les personnes vulnérables. Il faut donc, dans le droit actuel, assimiler les femmes aux personnes vulnérables pour pouvoir déroger au secret.
C’est justement pour échapper à ce renvoi que le texte prévoit une troisième voie de dérogation, établie avec l’Ordre des médecins, qui permet tout à la fois de conserver la confiance du patient envers son médecin et de conférer cette protection supplémentaire, absolument nécessaire, aux victimes de violences.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Nous devons, me semble-t-il, présenter les choses de façon équilibrée.
L’emprise, ce n’est pas un envoûtement démoniaque, comme dans les films d’épouvante ! C’est un bourreau qui, petit à petit, dévalorise la personne avec qui il entretient une relation. En effet, pour que la violence physique soit possible, pour qu’une femme – les victimes sont majoritairement des femmes – se laisse frapper sans réagir, il faut que celle-ci soit sous emprise psychologique. À force d’avoir été dévalorisée, elle va finalement penser qu’elle mérite les coups qui lui sont portés.
Quand nous défendons nos amendements, il arrive que nous nous laissions emporter par la passion. Je suis tout de même très étonnée. En effet, si l’emprise est telle qu’elle vient d’être décrite – je partage ce point de vue, avec les nuances que je viens d’apporter –, je ne comprends pas pourquoi vous avez rejeté l’amendement n° 14 rectifié de ma collègue Esther Benbassa, dont l’objet était simplement que le médecin puisse signaler à sa patiente la possibilité de contacter des associations pour l’aider et l’accompagner.
Je relève tout de même quelques petites contradictions, madame la rapporteure. Vous acceptez certaines propositions qui vont dans le sens des travaux la commission, mais, pour d’autres amendements, vous semblez suivre une logique légèrement différente. Je sais que vous avez l’esprit de justice, et je vous appelle donc à un peu plus d’équité.
Quoi qu’il en soit, nous voterons l’amendement n° 21 rectifié bis, qui permet d’apporter au dispositif les nuances que ma collègue a fort habilement présentées.

En psychanalyse, l’emprise n’est pas diabolique ; c’est une relation perverse. Avant de diriger la personne vers un dépôt de plainte, le médecin doit déjà s’en rendre compte, ce qui nécessite un véritable travail. Parfois, les coups ne se voient pas.
Excusez-moi, mais il me semble difficile de décrire l’emprise comme vous l’avez fait ! L’emprise est diverse, et ses formes sont aussi variées que celles de la perversité. En outre, on peut aussi exercer une emprise sur son employé, ses enfants ou son voisin.
C’est une relation complexe et très difficile à dénouer. Et si elle n’est pas dénouée, vous pouvez bien envoyer le conjoint où vous voulez, l’accompagner, lui proposer un stage ou je ne sais quoi d’autre, cela ne servira à rien, parce que les pervers ne guérissent pas.

Je vais également voter cet amendement, qui me semble mesuré par rapport au précédent.
En réalité, comme cela a été souligné, on note très peu de signalements de la part des médecins. On doit s’en étonner, et peut-être aussi prévoir des mécanismes plus incitatifs. Cet amendement tend à les y inciter, me semble-t-il, tout en préservant le secret médical, puisqu’ils le feront à condition de recueillir l’accord de la victime.
Je voterai donc bien entendu cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 50, présenté par Mmes Meunier et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué le présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué le présent article sans son consentement. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.

Cet amendement était le corollaire de l’amendement n° 48 sur l’obligation de signalement ; celui-ci ayant été rejeté, par cohérence, je vais retirer l’amendement n° 50.
Je donne toutefois raison à Mme la rapporteure sur un point : je suis tenace, et je reviendrai !
Sourires.
L ’ article 8 est adopté.

L’amendement n° 80, présenté par Mmes Cohen, Benbassa, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection à une victime dont le médecin ou tout autre professionnel de santé l’ayant pris en charge aurait porté à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Cet amendement a pour objet de compléter ceux que nous avons déjà présentés et qui ont été rejetés et d’enrichir notre discussion. En effet, la majorité du Sénat estime qu’un médecin peut procéder à un signalement sans accord de la victime, dès lors que celle-ci en est informée. C’est donc l’information de la victime qui prévaut, pas son accord.
Dans un tel cas de non-consentement, il est encore plus important de garantir la mise en sécurité de la personne concernée par le signalement. C’est pourquoi nous proposons que le juge aux affaires familiales puisse délivrer en urgence une ordonnance de protection.
Comme le souligne Gilles Lazimi, médecin et militant associatif, « il faut qu’on soit sûr que tous les moyens de protection seront mis en œuvre ; or aujourd’hui, même quand l’alerte est donnée par la victime elle-même, il y a des ratés ». On peut imaginer a fortiori les ratés que pourrait susciter une alerte, lorsqu’elle ne vient pas de la victime elle-même ! Nous ne pouvons donc pas rester au milieu du gué.
C’est pourquoi nous proposons d’étoffer le dispositif et de garantir une aide effective aux victimes de violences conjugales. Si nous ne les accompagnons pas jusqu’au bout de la démarche, nous risquons de les mettre en porte à faux.

Le présent amendement tend à permettre la délivrance d’une ordonnance de protection en cas de levée du secret professionnel par un médecin qui aurait porté à la connaissance du procureur de la République une suspicion de violences conjugales.
En fait, cet amendement est satisfait par les dispositions de l’article 515-10 du code civil, qui permettent déjà au procureur de la République de demander une ordonnance de protection avec l’accord de la victime.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.

Avant de me prononcer, je souhaite lever une incompréhension.
Nous nous plaçons ici dans la situation où la personne concernée ne souhaite pas déclarer qu’elle est victime de violences et où le médecin l’informe qu’il va passer outre le secret médical. Or Mme la rapporteure me répond que cet amendement est satisfait parce qu’une ordonnance de protection peut être délivrée « avec l’accord de la victime ». Je ne comprends donc pas bien en quoi mon amendement est satisfait…

L’accord de la victime est toujours recherché. Sans cet accord, c’est évidemment plus difficile.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article 10-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 10 -5 -1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. » –
Adopté.

L’amendement n° 15, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violences, la victime qui se présente spontanément, avant toute déclaration aux autorités de police, dans un établissement médical doit systématiquement se voir remettre, par le personnel soignant qui l’a examinée, un certificat d’examen médical constatant son état de santé consécutif aux violences. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.

L’article 8 ter de la présente proposition de loi prévoit la remise d’un certificat médical constatant les blessures d’une victime de violences, lorsque son examen par un médecin a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat.
Cet amendement vise à compléter ce dispositif, en inscrivant dans la loi l’obligation pour le médecin qui reçoit la victime lors d’une première visite de lui remettre un certificat d’examen médical, constatant les blessures qui lui ont été infligées, même lorsque la victime ne s’est pas présentée au préalable aux autorités judiciaires.
Il semble évident que les victimes de violences, plus particulièrement en cas de brutalités dans le cadre conjugal, sont en droit d’être en possession, dès leur premier examen par le personnel soignant, d’un document constatant la nature et la gravité des coups qui leur ont été portés, notamment dans la perspective d’une éventuelle procédure d’indemnisation civile.
Dans les faits, cette pratique est déjà recommandée par la Haute Autorité de santé, mais elle ne trouve pour l’heure aucune consécration législative.
Cet amendement, qui vise à reprendre une mesure issue du Grenelle des violences conjugales, a donc pour objet de faire concorder la pratique et le droit.

Comme vous l’avez signalé, ma chère collègue, si une patiente, indépendamment de toute procédure judiciaire, demande un certificat lors d’un examen médical, le médecin, quelle que soit sa spécialité et même s’il n’est pas le médecin traitant, peut le rédiger et le remettre à la patiente pour faire valoir ce que de droit.
Cet amendement est satisfait. J’émets donc un avis défavorable.
Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement, mais l’avis du Gouvernement sera défavorable, pour deux raisons.
Tout d’abord, rien n’empêche, dans le droit actuel, que le professionnel remette à la victime le certificat médical initial. Vous l’avez dit, il s’agit d’une préconisation de la Haute Autorité de santé, mais celle-ci n’a pas vocation à figurer dans la loi et elle peut être d’ordre réglementaire.
Ensuite, et surtout, la rédaction de la fin de votre amendement laisse penser que le certificat médical préciserait que l’état de santé est le résultat de faits de violence. Or, vous le savez probablement, madame la sénatrice, la déontologie médicale précise que le médecin n’a pas à se prononcer sur les dires du patient, les liens de causalité ou la responsabilité d’un tiers. C’est à l’enquête de le faire, non au médecin.
J’émets donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Chapitre VI
Dispositions relatives aux armes
L’amendement n° 75, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Compléter l’intitulé du chapitre par les mots :
et aux interdictions de paraître ou de contact
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Cet amendement de cohérence rédactionnelle vise à modifier l’intitulé du chapitre VI de la proposition de loi, afin de mieux prendre en compte le champ des dispositions dudit chapitre, en particulier celles de l’article 9 bis.

Ce complément est utile : la commission est favorable à cet amendement.
Cet ajout nous semble justifié à nous aussi. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »

Les articles 9 et 9 bis de la proposition de loi concernent la saisie, dans le cadre d’une perquisition, des armes détenues par une personne suspecte.
Ces dispositions découlent du constat établi par le rapport de l’inspection générale de la justice publié en octobre 2019 sur les homicides conjugaux, selon lequel 68 % des agressions sont commises avec une arme, qu’il s’agisse d’une arme à feu ou d’une arme blanche – dans ce dernier cas, il s’agit le plus souvent d’un couteau. Toute évolution de la loi susceptible d’empêcher des agresseurs de détenir une arme est donc une avancée, vous l’avez d’ailleurs signalé, madame la secrétaire d’État, lors de votre intervention lors de la discussion générale.
Toutefois, la proposition de loi pose deux problèmes.
D’une part, l’article 56 du code de procédure pénale, que modifie l’article 9, concerne les personnes suspectées de crime.
Or, le plus souvent, les féminicides surviennent après une longue suite de violences, psychologiques et physiques, qui ne relèvent pas nécessairement d’agissements criminels. La mesure prévue par l’article 9 n’intervient-elle donc pas trop tard dans le parcours de l’auteur de violences ? Cette disposition est-elle vraiment aboutie ? Ne faudra-t-il pas poursuivre ce débat avec le texte suivant ? Ce ne serait jamais que le quatrième depuis la loi de 2018…
D’autre part, comme le rappelle la récente enquête publiée par le journal Le Monde et intitulée « Féminicides : mécanique d’un crime annoncé », on compte un certain nombre de féminicides par strangulation ou défenestration. Par ailleurs, le catalogue des armes par destination, auxquelles ont recours les criminels et les assassins, est sans limites. De nombreux hommes ont tué leur femme avec des objets du quotidien.
Ces remarques me conduisent à souligner, une nouvelle fois, que le texte dont nous débattons n’est pas l’alpha et l’oméga de la lutte contre les violences conjugales.
Si je me réfère à nouveau au récent rapport de l’inspection générale de la justice, les solutions relèvent aussi et surtout de la généralisation de projets de juridiction ambitieux, d’un suivi sans concession des auteurs des violences, de leur éviction systématique du logement, d’un contrôle strict des interdictions de contact avec la victime, d’une meilleure articulation entre les services de police et de gendarmerie et les parquets et d’un décloisonnement entre les différents services d’une même juridiction.
Les solutions relèvent d’un attirail préventif, plus que de la confiscation des armes. Ces articles représentent une avancée importante, mais qui n’est pas suffisante pour lutter contre les violences.
L ’ article 9 est adopté.
I. –
Non modifié
« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »
I bis
II. –
Non modifié
« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41-1 et du 9° de l’article 41-2 du présent code ; ».

L’amendement n° 81, présenté par Mmes Cohen, Benbassa, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mes chers collègues, cet amendement de suppression de l’article 9 bis ne vous étonnera pas, tant notre position sur ce sujet est cohérente au fil des débats : lutter contre les violences faites aux femmes et protéger les victimes ne peut se résumer à une surenchère répressive.
Certes, modifier notre code pénal, en alourdissant les peines, est aisé à mettre en œuvre, puisqu’aucun moyen supplémentaire n’a besoin d’être engagé. Mais cela ne va pas pour autant dissuader les hommes violents – ils ne cesseront sûrement pas de l’être, même s’ils encourent une peine doublée ou triplée…
Malgré l’échec flagrant d’une telle politique, menée depuis de nombreuses années déjà, nous ne comprenons pas pourquoi nos collègues de droite comme le Gouvernement continuent dans cette voie.
Alors que l’article 9 représente une véritable avancée, en permettant aux officiers de police judiciaire de saisir des armes détenues par des personnes suspectées de violence, l’article 9 bis permet aux juridictions de prononcer des interdictions relatives aux armes et aux contacts avec les victimes en plus d’une peine d’emprisonnement, et non pas à la place d’une telle peine.
Dans le contexte de surpopulation carcérale que chacun connaît et alors que la majorité de nos voisins européens est engagée sur la voie de la décroissance carcérale, en particulier ceux qui constatent une diminution de la délinquance et des violences en général, vous proposez par cet article de supprimer des peines alternatives à l’emprisonnement, ce qui paraît quand même assez aberrant.
Je le répète inlassablement, pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, il faut mener une politique d’éducation et de prévention sur le long terme – je crois que nombre de nos collègues partagent cette idée – et non assembler des dispositions pénales répressives et répéter les erreurs commises par le passé.
Il nous semble, au contraire, que les meilleures réponses à apporter à cette problématique sont de nature préventive et éducative et qu’elles doivent être mises en œuvre dès le plus jeune âge. Il serait d’ailleurs intéressant de faire un bilan des dispositifs existants et des expérimentations qui ont eu lieu – je pense notamment aux ABCD de l’égalité – et de mettre en place de nouveaux outils pour améliorer les politiques publiques menées dans ce domaine.

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de prononcer des peines complémentaires à l’emprisonnement. Nos collègues insistent sur la nécessité d’une politique d’éducation et de prévention en matière de violence, et je suis d’accord sur ce point.
Pour autant, l’article 9 bis est une véritable avancée dans la protection des femmes : il ne supprime pas la possibilité de prononcer des peines alternatives – celles-ci sont maintenues –, il prévoit simplement que, en matière de saisie d’armes et d’interdiction de paraître ou de contact, de telles peines pourront être prononcées cumulativement à une peine de prison. En effet, il est important d’être capable de protéger les victimes pendant et après la détention.
Il s’agit donc non pas d’augmenter la population carcérale, mais, je le redis, de mieux protéger les victimes. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
De notre point de vue, l’article 9 bis présente un intérêt majeur pour la protection des victimes, puisque le tribunal pourra, en plus de l’emprisonnement, faire interdiction à un conjoint violent de rencontrer la victime pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, sans pour autant avoir à assortir la peine d’emprisonnement d’un suivi judiciaire, comme le sursis probatoire.
Cette mesure se révélera particulièrement utile pour les condamnés absents, à l’encontre desquels le tribunal prononce en général peu de mesures de suivi. Or une mesure de suivi est nécessaire au prononcé de l’interdiction de contact.
Par ailleurs, la peine d’interdiction de contact autonome demeurera possible. Cet article ne supprime donc pas une peine alternative à l’emprisonnement ; il permet que les mesures qui sont aujourd’hui des mesures de substitution soient aussi prononcées en complément de l’emprisonnement.
En tout cas, l’ensemble de ces mesures n’empêche pas la mise en œuvre de politiques éducatives, et je partage votre préoccupation sur la nécessité de présenter le bilan de ces politiques.
Le ministre de l’éducation nationale s’était d’ailleurs engagé, juste avant le confinement, à présenter très rapidement les résultats de l’audit qui a été mené sur les trois séances d’éducation à la vie affective et sexuelle organisées l’an dernier – je le rappelle, ces séances ont désormais lieu chaque année. Cette présentation a été bloquée du fait du confinement, mais elle aura lieu, sans nul doute, dans les mois à venir.
Au total, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme Laurence Cohen. Les explications que vient de me fournir Mme la secrétaire d’État m’ont éclairée. Elles me laissent penser que, comme nous, elle est sensible à l’importance de réaliser l’évaluation des politiques qui sont menées. Par conséquent, j’imagine que, quand nous en reparlerons, nous aurons son soutien…
Mme la secrétaire d ’ État opine.
L ’ article 9 bis est adopté.
(Non modifié)
L’article 226-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci. » ;
1° bis Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Cet article tire les conséquences d’un constat désormais classique sur la stratégie des auteurs de violences : l’utilisation des nouvelles technologies pour enfermer leurs proies dans une « camisole de force numérique ».
Le rapport du Haut Conseil à l’égalité sur les violences faites aux femmes en ligne, publié en 2018, est très éclairant sur ce danger qui menace les femmes comme les enfants dans les foyers violents ou dans le contexte de séparations très conflictuelles. La délégation aux droits des femmes avait travaillé sur cette dimension dans son rapport d’information publié en 2018 et intitulé Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société.
Le cybercontrôle dans le couple est devenu – hélas ! – classique. Un logiciel espion permet au conjoint violent de savoir à tout moment où se trouve sa victime et de tout connaître de sa vie. Dans le contexte de la séparation, ce logiciel, installé sur le téléphone portable d’un enfant, permet à l’auteur de violences d’exercer son emprise à distance sur la mère.
Par conséquent, la délégation se réjouit que cette proposition de loi prenne la mesure d’une dérive qui accroît la menace exercée sur les victimes par des conjoints et des pères violents.

L’amendement n° 51, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après les mots :
de solidarité
insérer les mots :
ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Cet amendement, comme les amendements n° 52, 53 et 54 que nous examinerons ensuite, vise à étendre aux anciens conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS la circonstance aggravante qui est prévue dans le cas d’une série d’atteintes à la vie privée – la géolocalisation, la violation du secret des correspondances, l’usurpation d’identité et l’envoi de messages malveillants.
Comme l’a dit à l’instant Annick Billon, ces comportements sont très difficiles à supporter pour les victimes. Or ils sont souvent mis en œuvre après la séparation du couple, et cette situation n’est pas prévue dans cet article.
On me répondra sans doute que le code pénal prévoit déjà que la circonstance aggravante liée au fait que l’infraction est causée par un conjoint peut être étendue à un ancien conjoint, mais il me semble nécessaire de le prévoir explicitement dans ce cas. Nous ne devons pas rater notre cible, d’autant que, comme je viens de le rappeler, les incidents les plus violents interviennent souvent après la séparation.

Nous ne sommes pas défavorables sur le fond à cet amendement, qui a pour objet que la circonstance aggravante s’applique aussi aux anciens conjoints, concubins ou partenaires de PACS.
Cependant, comme je l’ai indiqué ce matin pendant la réunion de la commission des lois, il est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 132-80 du code pénal.
Aux termes de cet article, dans les cas prévus par la loi et le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, et cette circonstance aggravante est également constituée, quand les faits sont commis par les anciens conjoints, concubins ou partenaires, les « ex ».
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Même avis, pour les mêmes raisons : cet amendement est satisfait par le droit en vigueur.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 10 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° de l’article 226-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

L’amendement n° 52, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
de solidarité
insérer les mots :
ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 10 bis est adopté.
(Non modifié)
L’article 226-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

L’amendement n° 53, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
de solidarité
insérer les mots :
ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 10 ter est adopté.
L’article 222-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

L’amendement n° 54, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
de solidarité
insérer les mots :
ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 23, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende
par les mots :
des peines mentionnées à l’article 222-33-2-1
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

L’article 10 quater, adopté lors de l’examen en commission, introduit dans le code pénal une circonstance aggravante, lorsque la victime est le conjoint, du délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés ou d’envois réitérés de messages malveillants. Il prévoit que ces faits sont punis, lorsqu’ils sont commis par le conjoint, le concubin de la victime ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Or l’infraction de harcèlement moral du conjoint par des « propos ou comportements répétés », prévue à l’article 222-33-2-1 du code pénal, est assortie d’une peine de trois ans d’emprisonnement de 45 000 euros d’amende.
Dans une perspective de cohérence, et afin de ne pas créer d’asymétrie injustifiée entre ces deux situations, il est proposé d’aligner par un renvoi les peines pour harcèlement moral entre conjoints et celles qui sont prévues pour appels ou messages réitérés malveillants adressés au conjoint.

Cette mise en cohérence est bienvenue. L’avis de la commission est donc favorable.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement pour les raisons, purement juridiques, que je vais vous présenter. À défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement adopté en commission des lois vise à créer une circonstance aggravante du délit d’envoi réitéré de messages malveillants, lorsque l’auteur est le conjoint ou le concubin de la victime. Dans ce cas, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. En l’absence de circonstance aggravante, ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le texte adopté par votre commission est donc en parfaite cohérence avec l’aggravation, prévue par cette proposition de loi, de la peine d’emprisonnement encourue pour les délits d’usurpation d’identité, d’utilisation des données personnelles ou de violation des correspondances d’une victime par son conjoint, qui passe de un à deux ans.
Pour le Gouvernement, il n’y a pas de raison d’aggraver plus fortement la sanction prévue à cet article, en reprenant la peine de trois ans d’emprisonnement qui est prévue par l’article 222-33-2-1 du code pénal en cas de harcèlement moral au sein du couple.
Nous considérons que ces situations sont différentes. Dans le cas du harcèlement, il doit être démontré que les faits ont « eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale », mais cela n’est pas exigé en cas d’appels téléphoniques répétés. Il nous semble donc normal que le harcèlement soit plus sévèrement réprimé.
S’il est établi que les appels téléphoniques ont provoqué une telle dégradation des conditions de vie de la victime, les faits seront alors poursuivis sous la qualification de harcèlement, et pas sous celle d’appels téléphoniques malveillants.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

J’ai bien entendu les explications de Mme la secrétaire d’État, mais il s’agit d’une question de cohérence dans l’échelle des peines.
Je ne discute pas des éléments constitutifs de telle ou telle infraction, mais il me semble préférable de renvoyer à une peine qui existe déjà dans l’arsenal pénal et qui concerne le même genre de faits contre lesquels nous voulons lutter, plutôt que d’inventer une peine qui serait en quelque sorte intermédiaire.
Nous serons peut-être amenés à réformer cette échelle des peines – nous le demandons depuis longtemps –, mais il ne me semble pas souhaitable, en l’état de notre droit, de nous en extraire. Procéder, comme je le propose, par renvoi est parfaitement cohérent et la commission des lois le fait régulièrement.
Ces motivations sont plus fortes que mon envie de faire plaisir à Mme la secrétaire d’État…
Sourires.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 10 quater est adopté.
I. – Au quatrième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ».
II
L’article 11 A, qui concerne la pédocriminalité, est un article particulièrement important de ce texte.
Le Grenelle des violences conjugales a appréhendé ensemble, pour la première fois avec une telle intensité, la question des violences conjugales et celle des violences faites aux enfants. C’était une nécessité, parce que les enfants ne sont pas seulement témoins des violences conjugales : ils en sont aussi victimes.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite attirer votre attention sur le fait que les actes de pédocriminalité fragilisent les victimes pour toute leur vie, notamment dans leurs rapports aux autres – cela comprend naturellement les rapports avec leurs conjoints. Ces victimes pourront l’être à nouveau, mais elles pourront aussi commettre elles-mêmes des violences.
L’une des grandes avancées du Grenelle et des plans que Marlène Schiappa et moi-même avons mis en place, notamment le plan de lutte contre les violences faites aux enfants que j’ai annoncé le 20 novembre dernier, est d’ailleurs de s’attaquer à cet aspect des violences, en mettant en avant une logique de prévention.
Ainsi, le Gouvernement a annoncé, il y a quelques jours, la mise en place de centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales, et les centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (Criavs) ont ouvert un numéro d’appel destiné aux auteurs potentiels de faits pédocriminels.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la France est malheureusement le deuxième pays européen pour ce qui concerne le nombre de téléchargements de contenus pédopornographiques. Chaque année, les sites contenant des images pédopornographiques font l’objet de plus de 100 000 connexions et téléchargements. On peut y ajouter 50 000 connexions supplémentaires qui proviennent des États-Unis.
Le secrétaire d’État Laurent Nunez et moi-même avons visité hier la plateforme Pharos, la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements. Chaque mois, près de 300 000 tentatives de connexions sur des sites pédocriminels bloqués ont lieu dans notre pays, je dis bien 300 000 chaque mois ! La protection des mineurs doit passer par une répression forte des pédocriminels en ligne qui ont aujourd’hui un sentiment d’impunité derrière leur écran.
Il s’agit d’un marché international, qui est devenu pour certaines organisations criminelles un véritable business au même type que la drogue ou la contrebande. Je rappelle que derrière tout échange d’images ou de vidéos pédopornographiques, il y a un mineur agressé, une victime.
Il existe dans la pédopornographie un culte de l’inédit. On considère que 20 % à 30 % des personnes qui consultent des images pédocriminelles sont aussi des producteurs d’images de ce type. Des enfants victimes se trouvent donc derrière ces images-là.
La protection de l’enfance en ligne est une condition de sa préservation hors ligne, ce d’autant qu’il existe une imbrication de plus en plus forte entre activités en ligne et hors ligne. Aggraver la peine encourue par les pédocriminels qui consultent habituellement des images pédopornographiques, les acquièrent ou les détiennent permettra d’atteindre un objectif auquel je tiens tout particulièrement. L’inscription au Fijais, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, sera automatique ce qui n’était à ce jour qu’une faculté pour le juge.
L’inscription automatique au Fijais concerne les auteurs d’infractions encourant une peine de cinq ans de prison. Or, actuellement, la consultation d’images pédopornographiques n’entraîne une peine que de deux ans d’emprisonnement. Il revient donc au juge de décider si l’auteur doit être inscrit au Fijais, ce qu’il fait dans 50 % des cas. Par conséquent, dans 50 % des cas restants, soit à peu près 500 personnes chaque année, les auteurs de consultations de sites pédocriminels ne sont pas inscrits au fichier des agresseurs sexuels. Le lendemain, ils peuvent donc être embauchés par une structure accueillant de jeunes enfants, par exemple. C’est ce à quoi nous voulons mettre un terme grâce à cet article.
L’inscription automatique durera au moins vingt ans et obligera le condamné à déclarer régulièrement son adresse au commissariat ou à la gendarmerie. Elle permettra donc d’éviter que le condamné ne soit recruté pour exercer une activité en contact avec des mineurs. À cet effet, sachez que, par ailleurs, en février dernier, la garde des sceaux, la ministre des sports et moi-même avons lancé une mission d’audit et d’appui, afin de garantir que la consultation du Fijais soit systématique par l’ensemble des administrations et des collectivités locales. Prévoir des dispositifs, c’est bien, mais encore faut-il que les administrations connaissent ceux-ci et y aient recours.
Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, le sens de l’article 11 A auquel nous tenons particulièrement. Je ne doute pas qu’il en soit de même pour vous.

L’amendement n° 55, présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

M. le secrétaire d’État a parfaitement décrit le mécanisme du Fijais, fichier créé il y a maintenant quelques années. Mais il convient de préciser qui peut y figurer.
La commission a inversé le mécanisme puisqu’elle a décidé – M. le secrétaire d’État a fait l’impasse sur cet aspect particulier –, alors que, actuellement, des personnes non condamnées, mais mises en examen peuvent néanmoins être inscrites au Fijais sur décision du juge d’instruction, que le principe soit désormais l’inscription au fichier, le juge d’instruction disposant simplement de la possibilité de ne pas y avoir recours.
Vous allez peut-être trouver que je suis pointilleuse, mes chers collègues. Évidemment, le Fijais est très utile, si tant est qu’il soit consulté, dès lors qu’il recense les personnes condamnées. Cependant, il s’agit en l’espèce de personnes mises en examen qui vont rester inscrites à ce fichier pendant toutes les années des procédures. Or qui y a accès ? Les policiers, les magistrats, mais aussi les préfets, les maires et les responsables d’associations qui peuvent, par exemple, interroger l’administration sur la personne qu’ils veulent recruter pour savoir si elle est inscrite au Fijais. Bref, le champ des personnes pouvant consulter ce fichier est extraordinairement vaste.
Il convient donc de s’interroger sur la pertinence du Fijais. On veut nous rassurer en nous disant que le parquet a l’obligation de retirer les mentions dès lors qu’elles ne seraient plus pertinentes. Sauf que cela ne se passe pas comme ainsi. Vous vous souvenez sûrement du STIC, le système de traitement des infractions constatées, dans lequel des millions de Français sont inscrits. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), quelques années après la création de ce fichier, a constaté que 40 % des informations qui y figuraient étaient inexactes.
J’attire donc votre attention : si je souhaite que l’inscription se fasse sur décision du juge d’instruction et qu’elle ne soit pas un principe intangible que le juge peut, par exception, refuser, c’est parce que nous allons accepter que des personnes mises en examen et non condamnées figurent pendant de très longues années dans un fichier accessible à beaucoup de personnes et dans lequel le parquet, faute de temps, ne fera jamais le nettoyage.

Le Fijais est un outil précieux de prévention de la récidive. Il peut être consulté par différents employeurs – l’éducation nationale, par exemple – pour s’assurer que les personnes embauchées ne sont pas poursuivies ou condamnées pour certaines infractions commises sur un mineur.
Ce fichier contient déjà le nom des personnes qui n’ont pas été condamnées définitivement. Il est également possible à un juge d’instruction d’y inscrire le nom d’une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire ou assignée à résidence sous surveillance électronique.
Nous avons souhaité faire de l’inscription la règle et de la non-inscription l’exception. Certes, cela peut aboutir à ce que des personnes finalement déclarées innocentes soient temporairement inscrites au fichier. Mais à choisir entre deux inconvénients, nous avons préféré opter pour celui-là plutôt que de prendre le risque d’embaucher à un poste au contact avec des mineurs une personne sur laquelle pèseraient de lourds soupçons. Le principe de précaution doit prévaloir. C’est un principe d’action.
Il appartient au service du casier judiciaire, qui gère le Fijais, de veiller à la mise à jour régulière de celui-ci. Et un individu qui y figure peut toujours demander l’effacement des données le concernant.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie s ’ exclame.
Actuellement, le code de procédure pénale prévoit deux formes d’inscription au Fijais.
S’il s’agit de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, l’inscription, sauf exception pour les délits peu graves – peine encourue, et non pas peine prononcée, inférieure cinq ans –, est automatique.
S’il s’agit de personnes mises en examen, l’inscription n’est possible, à condition qu’ait été décidé un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, que si le juge l’ordonne expressément. Tel est l’état du droit.
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement du rapporteur visant, dans cette seconde hypothèse, à rendre l’inscription automatique, sauf décision contraire du juge. On inverse donc la logique, ainsi que vous l’avez souligné, madame la sénatrice. Votre amendement tend donc à supprimer cette modification.
Comme vous le savez, je reconnais l’importance et l’utilité du Fijais, et je m’en félicite, pour mieux protéger nos enfants. Je l’ai souligné au cours de mon propos liminaire, un travail interministériel a été engagé avec la garde des sceaux, dont je salue l’investissement sur le sujet, pour que le Fijais soit plus systématiquement consulté par l’ensemble des administrations.
Je rappelle également que, dans certains cas qui le justifient, depuis la loi Villefontaine du 14 avril 2016, le procureur peut d’ores et déjà informer par écrit l’administration des décisions de mise en examen rendues contre une personne qu’elle emploie. Veiller à la mise en œuvre effective de cette mesure doit être une priorité, mais le dispositif existe déjà, afin que les administrations soient au courant.
Pour autant, cet amendement de suppression ne me semble pas injustifié. J’émets donc un avis favorable. En effet, rendre par principe automatique l’inscription au Fijais des personnes mises en examen, mais qui sont présumées innocentes à ce stade, et ce quelle que soit la gravité de l’infraction, nous paraît soulever d’importantes questions de principe, qui ont été exposées par Mme la sénatrice.
Il est vrai que les juges d’instruction ordonnent peu d’inscriptions au Fijais, soit moins de 200 chaque année. La garde des sceaux est prête à adresser aux procureurs une circulaire leur demandant de requérir plus fréquemment cette inscription s’agissant des personnes mises en examen.

Je ne voterai pas cet amendement. À quoi sert le Fijais ? Principalement à éviter d’embaucher des personnes soupçonnées – il est évident que les personnes condamnées, elles, ne peuvent être embauchées ! – pour qu’elles travaillent auprès de nos enfants. Imagine-t-on un enseignant soupçonné rester dans sa classe ? Évidemment, il ne doit pas être renvoyé – il n’est pas encore condamné –, mais l’éducation nationale va éviter de le maintenir dans sa classe et va le mettre de côté. De la sorte, on évite un potentiel risque. C’est aussi à cela que sert le Fijais.
Par ailleurs, c’est un fichier que l’on ne consulte pas aussi facilement que vous le dites, ma chère collègue. On interroge l’administration qui informe si l’on peut ou non embaucher la personne, sans livrer plus de détails.
Très sincèrement, quand vous êtes maire, peu vous importe de savoir si la personne que vous voulez embaucher pour la faire travailler dans un centre de loisirs ou dans un club de sport est condamnée ou seulement soupçonnée : un simple soupçon suffit à vous passer l’envie de la placer au contact d’enfants. Voilà à quoi sert le Fijais !
Y a-t-il un risque à changer de paradigme ? Nous n’imposons rien au juge. Ce dernier peut estimer que le risque n’est pas suffisant a priori pour inscrire la personne au Fijais. Il justifie dans ce cas son choix et il prend la responsabilité de remettre cette personne au contact des enfants. À défaut, il est important que nous puissions protéger nos enfants.

Il s’agit d’un sujet d’une extrême gravité. Nous hésitons entre deux bornes : le principe de précaution et la présomption d’innocence.
Monsieur le secrétaire d’État, vous disiez que les magistrats ne procédaient à l’inscription que dans 50 % des cas. Je pense qu’il s’agit d’un chiffre après condamnation, ce qui est extrêmement différent au regard du principe de présomption d’innocence.
J’ai été maire pendant vingt-deux ans et j’ai malheureusement été confronté à ce genre de problème. Je sais donc de quoi je parle.
Effectivement, nous nous devons de protéger les enfants des responsables que nous recrutons et qui sont chargés de les encadrer. Pour autant, ce qui me surprend, j’ai l’impression que l’on ne fait pas la différence entre la condamnation et l’instruction.
En droit du travail, par exemple, à côté du régime de sanctions, des mesures peuvent être prises à titre conservatoire. En l’occurrence, je n’ai pas l’impression que ces deux possibilités existent, ce qui me semble fâcheux. Il est bien sûr très grave de mettre des enfants face à des délinquants, mais il est aussi très grave d’inscrire dans un fichier une personne qui est peut-être innocente.
Je suis très perplexe, je l’avoue, quant à la solution à mettre en place. Cela étant, il me semble assez judicieux de laisser cette responsabilité aux magistrats.

J’ai attiré précédemment l’attention sur le principe de cohérence, que j’aime beaucoup. Faut-il laisser au juge la liberté d’apprécier tous les considérants ou nos prescriptions doivent-elles se montrer plus sérieuses et directives ? Car le juge peut se tromper ; la justice est humaine, comme nous l’avons évoqué avec Mme la garde des sceaux ?
Nous avons adopté des amendements qui relevaient d’une logique et maintenant vous nous proposez de voter des amendements qui relèvent d’une autre. Je suis désolé de vous le dire, madame de la Gontrie, mais vous vous prenez les pieds dans le tapis !
Tout à l’heure, au titre du principe de précaution – je l’admets parfaitement, car c’est un argument auquel je souscris –, vous nous disiez qu’il fallait protéger les femmes battues. Mais ici, a contrario, toujours au titre du même principe de précaution, vous ne voulez pas inscrire dans un fichier ceux qui maltraitent les enfants !
Soit c’est la présomption d’innocence qui prévaut, soit c’est le principe de précaution. En passant d’un argument à l’autre, vous défendez une idéologie, mais ne faites pas preuve de cohérence !
Il faut bien distinguer ce qui relève de la condamnation et ce qui relève de l’instruction.
Dans le cadre de la condamnation, l’inscription est automatique, comme le prévoit le début de l’article 11 A. La peine encourue passe de deux à cinq ans d’emprisonnement pour consultation et l’inscription au Fijais des personnes condamnées sera automatique, passant ainsi de 50 % à 100 % des cas.
En revanche, au stade de l’instruction, le principe de la présomption d’innocence a toute sa place. La liberté est laissée au juge de décider d’inscrire ou pas, à ce moment de l’enquête, une personne au Fijais, étant entendu que si le parquet demande cette inscription, le juge d’instruction ne peut la refuser.
Une fois encore, la loi Villefontaine prévoit qu’à ce stade de l’instruction le juge puisse prévenir les administrations concernées de la procédure en cours. Mme la garde des sceaux et moi-même avons lancé au début du mois de février la mission d’audit et d’appui que j’évoquais. Vous avez cité l’exemple, madame la sénatrice, de l’éducation nationale. Il s’avère que, dans la pratique, une culture commune s’est développée. À côté des référents justice de l’éducation nationale, il y a des référents éducation nationale au sein des parquets. De manière assez naturelle, dès qu’un personnel de l’éducation nationale en contact avec les enfants, dans le cadre des écoles, fait l’objet d’une instruction, immédiatement, le juge prévient l’administration. Cette personne sera alors écartée du contact des enfants.
C’est loin de toute automatisation du système, au niveau des pratiques de chaque administration, à un stade de l’enquête où la présomption d’innocence doit encore avoir toute sa place, que nous voulons agir. Par ce biais, nous pourrons ainsi mettre en place un système protecteur.
Effectivement, nous sommes bien souvent amenés à devoir mettre en balance des grands principes de notre droit, mais la solution que nous avons trouvée, conjointement avec la sénatrice de la Gontrie, nous semble être à la fois équilibrée et protectrice de nos enfants. C’est bien la volonté de protéger nos enfants qui m’anime, et j’espère, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous n’en doutez pas !

Monsieur Allizard, le code de procédure pénale, que nous avons modifié dans le texte de la commission, prévoit déjà l’inscription des personnes mises en examen dans le fichier. La mesure de précaution existe donc déjà.
Dans ce code, il est prévu que l’inscription au fichier de ces personnes se fasse sur décision du juge. Nous avons uniquement déplacé le curseur, afin qu’elle ait lieu, sauf décision contraire du juge.
Vous avez mis l’accent, à juste titre, sur la nécessité de laisser la décision aux magistrats : mais la décision reviendra toujours aux juges, nous y avons veillé. Cela vide donc de toute substance l’objection de principe que l’on pourrait faire au texte de la commission. Or, comme toujours quand on discute, il faut revenir au texte pour s’assurer que les choses sont faites correctement. Quoi qu’il en soit, la question était légitime et nous nous la sommes également posée. Nous y avons répondu en laissant la responsabilité aux juges.
La réponse de principe est que la personne mise en examen pour avoir commis une agression, pas simplement sexuelle, d’ailleurs, car il peut s’agir d’une agression criminelle, délictuelle ou de tout autre nature, à l’égard d’un mineur devra être inscrite pendant l’instruction, sauf décision contraire du juge, au Fijais. C’est un bon équilibre.
Il s’agit, selon moi, d’un élément fort pour faciliter la protection de l’enfance, d’autant que les inscriptions au fichier sont insuffisantes, ce que tout le monde a admis durant le débat. Nous avons eu de longues discussions pour mettre en avant l’intérêt supérieur de l’enfant à chaque fois que nous devions prendre une décision dans le cadre de l’élaboration de ce texte de loi. Malgré notre souci de protéger des adultes injustement poursuivis, nous avons toujours fait passer l’intérêt de l’enfant avant toute chose. Bien évidemment, il faudra effacer immédiatement du fichier toute personne pour laquelle l’instruction se terminera par un non-lieu, car il ne doit pas s’agir d’une tache que l’on portera injustement sur soi pendant des mois ou des années.
Si la commission est défavorable à cet amendement, ce n’est pas parce qu’elle veut faire la révolution, elle n’en a pas l’habitude : elle ne s’est pas encore exercée à ce type de réponse aux problèmes qui lui sont soumis !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 11 A est adopté.
(Non modifié)
L’article 227-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Depuis 2014, la délégation aux droits des femmes tente d’alerter contre l’exposition croissante des mineurs aux images pornographiques, désormais très courante dès le collège au point que l’on parle de « génération YouPorn ».
Or la pornographie véhicule une image dégradante des femmes. Elle ne peut que perturber les enfants et les adolescents, et entraver la construction de leurs propres représentations.
Les codes de la pornographie déshumanisent la sexualité en banalisant, voire en encourageant, des relations sexuelles souvent violentes et mettent à mal la notion de consentement du partenaire.
De plus, certains spécialistes assimilent le traumatisme lié à la vue de ces images à celui que cause l’exposition à des violences. Je suis donc satisfaite que cette proposition de loi se soit emparée de ce problème, car on ne peut laisser la pornographie faire l’éducation sexuelle de nos enfants. Mais la responsabilisation des sites pornographiques, bien que nécessaire, ne saurait être suffisante.
À ce titre, je tiens à rappeler que le rapport de la mission commune d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions plaidait, dans sa proposition n° 11, pour une éducation à la sexualité dans les établissements scolaires, avec une sensibilisation spécifique aux violences sexuelles. La présidente de cette mission commune d’information était Mme Catherine Deroche et ses rapporteurs Mmes Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien, présentes dans cet hémicycle ce soir.
Ce n’est qu’en alliant le volet préventif au volet répressif que nous parviendrons à faire évoluer les mentalités chez les plus jeunes, et à développer une politique publique efficace et pérenne.
Aussi, l’expertise des associations agréées en matière de sensibilisation des enfants et des adolescents au problème des violences sexuelles est une ressource sur laquelle il est judicieux de s’appuyer. Cela rejoint notamment l’une des propositions de cette mission commune d’information.

L’amendement n° 16, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.

L’article 11 fait un lien entre la consommation de pornographie et les violences qui sont perpétrées dans un cadre conjugal. Cette corrélation est pour le moins discutable et hasardeuse. Elle semble par ailleurs fondée sur une perception moraliste et pudibonde de la production pornographique. Celle-ci n’est pourtant pas toujours uniforme et toutes les productions en la matière ne sauraient être perçues comme violentes, forcément dégradantes pour ses protagonistes féminins et masculins.
De nouvelles plateformes progressistes, amateurs et féministes émergent actuellement dans ce domaine, loin des stéréotypes oppressifs avilissants pour la condition féminine.
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que la simple prohibition de la pornographie ne saurait remplacer des cours d’éducation sexuelle bien architecturés, qui seraient dispensés aux adolescents, afin que ceux-ci puissent avoir une vision saine et équilibrée de la sexualité.
Le lien direct entre la pornographie et les violences conjugales intrafamiliales n’étant pas établi et n’ayant d’ailleurs jamais été prouvé, nous estimons que l’article 11 n’a pas sa place dans cette proposition de loi.

Cet amendement vise à supprimer l’article 11, qui a pour objet de codifier une jurisprudence de la Cour de cassation, au motif qu’il n’y a pas de lien évident entre accès à la pornographie et violences conjugales. C’est tout fait exact.
Mais en réalité, la proposition de loi contient, je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, des dispositions qui débordent le champ des violences conjugales et qui s’appliquent à la protection des mineurs. C’est le cas, en l’occurrence, de l’article 11 qui s’inscrit parmi les dispositions visant à protéger les mineurs.
Je suis défavorable à cet amendement de suppression. Le sujet de cet article n’est évidemment pas la consommation de pornographie par les adultes et son lien direct avec les violences conjugales. Il y est question de l’accès par des enfants à des contenus pornographiques. L’article a pour objet de renforcer la législation pour éviter que, grâce à un simple clic sur un bandeau certifiant que l’on est majeur, un enfant de 10 ans ne puisse avoir accès à des sites pornographiques.
Car, madame la sénatrice, c’est bien ce qui se passe aujourd’hui : en ligne, qu’ils le souhaitent ou non, les enfants sont constamment confrontés à la sexualité via des contenus sexuels ou pornographiques. L’âge moyen du premier accès à du matériel pornographique est de 14 ans. Et près de 50 % des enfants voient du matériel pornographique sur internet pour la première fois à 11 ans. Or le cerveau d’un enfant de cet âge n’est pas fait pour voir de telles scènes. C’est une forme de violence ; je définis ce fait comme tel.
Les enfants nous disent eux-mêmes qu’ils reproduisent les scènes qu’ils voient. Accéder à de la pornographie à cet âge-là façonne votre conception de la sexualité, votre rapport à l’autre, votre rapport au corps, votre rapport au consentement, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes.
Près de 75 % des enfants considèrent qu’ils ont été exposés pour la première fois à du matériel pornographique trop tôt, trop précocement, par rapport à ce qu’ils pouvaient supporter.
Contrairement à ce que certains affirment, le sujet des violences sexuelles au sein du couple et celui de la surexposition des jeunes aux contenus pornographiques ne sont pas totalement étanches, pour les raisons que je viens d’exposer.
Le contact répété et précoce des jeunes avec ces contenus de toute nature peut avoir des effets sur leur développement. Il n’est pas sans conséquence sur leurs rapports sociaux, leur estime de soi et les relations entre les filles et garçons. De nombreux médecins, notamment des pédopsychiatres, nous alertent à ce sujet : les attitudes et la conception des relations sexuelles risquent d’en être modifiées, ce qui peut aboutir, in fine, à des violences sexuelles.
Ce renforcement de notre législation doit bien entendu aller de pair avec d’autres actions, que nous mettons en œuvre, notamment dans le cadre du plan de lutte contre les violences que j’évoquais. Il s’agit ainsi de développer des programmes de prévention et d’information pour faire émerger chez les jeunes une pensée critique par rapport à ce qu’ils observent, et leur permettre de développer leur propre conception de la sexualité pour qu’ils la façonnent en temps utile, seuls, au travers de leur propre expérience. Je pense aussi à la meilleure information des parents sur les risques ; nous y travaillons avec l’ensemble des acteurs du numérique, à la suite de la signature en janvier dernier, en présence du secrétaire d’État chargé du numérique, Cédric O, d’un protocole de lutte contre l’exposition des mineurs à la pornographie.

Je voterai contre l’amendement présenté par Mme Benbassa.
Pour autant, je suis très perplexe quant à l’efficacité de l’article proposé par le Gouvernement, ce dont je ne peux lui tenir rigueur.
Vous êtes, et nous sommes, totalement désarmés. Pour le moment, personne ne sait comment empêcher les mineurs d’accéder au matériel pornographique mis à la disposition des adultes.
On peut signer toutes les chartes possibles avec ceux qui veulent bien y adhérer, mais, encore une fois, on ne sait pas comment faire pour empêcher un mineur d’accéder à ces sites. Les raisons en sont nombreuses, parmi lesquelles la localisation de ces sites à l’étranger.
Vous avez dit, monsieur le secrétaire d’État, que vous ne vouliez surtout pas parler de l’accès aux sites pornographiques en général. Mais, un jour, il faudra bien se demander ce que l’on pense de la pornographie qui est accessible, y compris aux adultes ! Elle est, bien sûr, très toxique pour les enfants, mais je considère qu’elle l’est aussi pour les adultes et pour les personnes qui jouent – il est assez indélicat de ma part d’utiliser le verbe « jouer » – dans ces films, ou plutôt qui sont utilisées pour produire ce matériel pornographique.
On l’accepte, au prétexte qu’il s’agit d’affaires entre adultes consentants. Or en quoi consiste le consentement des acteurs et actrices de films pornographiques tournés à l’étranger, dans des pays où il n’y a aucune régulation ? Ceux qui connaissent un peu le sujet dénoncent une augmentation de la violence des scènes et un recul constant des limites dans ces films.
Peut-être cessera-t-on, un jour, de dire que la pornographie fait partie des libertés individuelles !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 11 est adopté.

L’amendement n° 92 rectifié, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal de judiciaire de Paris d’ordonner, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement est très important.
Que ce soit sur un ordinateur ou sur leur smartphone, des mineurs peuvent très facilement visionner des contenus pornographiques disponibles gratuitement en ligne. Ils savent très bien le faire ; il suffit de taper le nom d’un site et huit vignettes apparaissent, proposant l’accès immédiat à des films pornographiques.
En violation de la loi, de nombreux sites internet ont renoncé à mettre en place un véritable contrôle de l’âge des personnes qui visionnent ces images. Il suffit d’un clic par lequel le mineur certifie avoir plus de 18 ans pour que des milliers de vidéos pornographiques lui soient accessibles. Quelquefois même, la question de l’âge n’est pas posée ! Pourtant, il existe des solutions d’identification de l’âge, par exemple en passant par FranceConnect ou en utilisant une carte de paiement.
De nombreux mineurs visionnent ces images dès leur entrée au collège, durant les intercours. Cela conduit à s’interroger sur l’effet que la consommation d’images pornographiques pourrait avoir, à moyen terme, sur leur développement affectif, psychologique et sexuel.
Autre chiffre : on sait que 50 % des moins de 12 ans ont déjà visionné un film pornographique dans sa totalité et que les premières images pornographiques atteignent les enfants dès l’âge de 7 à 8 ans, à l’occasion du visionnage d’un autre type de film durant lequel elles sont bombardées.
Les enfants de 7 ou 8 ans ne s’identifieront pas forcément à ces images. Même si c’est très grave, ça l’est moins que pour les jeunes de 12 ou 13 ans.
En principe, l’article 227-24 du code pénal permet de sanctionner les sites qui diffusent des images pornographiques susceptibles d’être vues par un mineur. La loi existe donc. La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Mais, en pratique, cet article n’est pas appliqué dans l’univers numérique et la justice ne parvient pas à atteindre les éditeurs de ces sites, qui sont souvent basés dans des paradis fiscaux très éloignés et ne coopèrent pas avec la France. Est-ce une raison pour ne pas agir ?
La pornographie est un univers particulier, et ce d’autant plus pour les mineurs. Les jeunes garçons ne sont plus les seuls à s’identifier, les jeunes filles aussi. On sait que, durant la période de confinement, la demande de films pornographiques a explosé, et encore plus celle de films pornographiques violents.
Je vais essayer de vous expliquer la situation simplement.
Autrefois, les films pornographiques violents formaient une catégorie à part. Ils étaient destinés, par exemple, à des personnes sadomasochistes, ce que l’on appelle aujourd’hui les adeptes du BDSM – je ne suis pas familière de ces sujets –, et dont c’est le droit le plus strict d’être attirées par de tels films ou sites pornographiques violents. Même si on ne partage pas cet intérêt, on peut essayer de comprendre… Ces films étaient donc codifiés « violents ».
Désormais, en revanche, la violence fait partie de la pornographie « de base ». Il est devenu normal qu’une femme soit strangulée, serrée, écartelée, et que sais-je encore. C’est tragique !
Les jeunes filles qui vont voir ces images se diront qu’il faut faire pareil, qu’il est normal qu’un jeune homme soit violent avec elles. Or ce n’est pas normal du tout, surtout pour un jeune en construction, comme cela a été expliqué précédemment.
Cet amendement, que je défends avec passion et enthousiasme, vise à instituer une nouvelle procédure, destinée à obliger les éditeurs de sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l’âge de leurs clients.
Tout d’abord, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adresserait à ces sites une injonction de se mettre en conformité avec la loi, laquelle, on l’a vu, existe. Ensuite, il saisirait le président du tribunal judiciaire de Paris, afin que celui-ci ordonne aux opérateurs de rendre impossible l’accès à ces sites, qui ne pourraient donc plus être consultés depuis la France. Enfin, nous proposons la mise en œuvre d’une action – nous savons que ce ne sera pas facile, mais au moins est-ce le début du commencement de quelque chose…
Ce dispositif s’inspire de celui qui a été mis en place pour lutter contre les cercles de jeux en ligne illégaux, lequel repose sur le contrôle exercé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel). Si cela marche pour les jeux en ligne, pourquoi pas pour les sites pornographiques ?
L’adoption de cet amendement permettrait de mettre en œuvre l’engagement pris par le Président de la République le 20 novembre 2019, dans un discours prononcé à l’Unesco. Il avait alors donné six mois aux acteurs de l’internet pour instaurer un contrôle parental par défaut, sans quoi il serait nécessaire de légiférer.
Nous y sommes, les six mois sont passés ! Nous avons là une accroche dans la loi pour répondre à l’exigence du Président de la République. C’est tout de même positif !
Cette question devait être traitée dans le cadre de l’examen du projet de loi de réforme de l’audiovisuel, mais celui-ci a été remis aux calendes grecques et ne sera pas débattu, au mieux, avant 2021. Cela doit nous inciter à prévoir, lors de la discussion de la présente proposition de loi, des dispositions destinées à protéger véritablement les mineurs.
Vous me direz que, ces sites étant situés à l’étranger, si l’on en ferme un, deux seront ouverts dans la foulée. Peut-être, mais ce n’est pas une raison pour ne pas agir ! Cela me rappelle la fable du petit colibri qui n’a dans son petit bec qu’une goutte d’eau pour éteindre l’incendie de la jungle, mais qui fait tout de même sa part. Nous avons la responsabilité de faire quelque chose ! Dire que rien n’est possible, ce n’est pas acceptable !
Lorsque j’ai été élue maire en 2001, je suis allée à la maison des adolescents, où l’on m’a dit qu’il y avait un problème avec l’accès des jeunes à certains sites. C’était il y a dix-neuf ans ! À l’époque, j’avais expliqué à des jeunes de 13 ans qu’il ne fallait pas aller sur ces sites. Ils ont aujourd’hui 32 ans et ils ont le même problème avec leurs enfants, car on n’a rien fait !
L’univers numérique de nos enfants nous dépasse, et on ne peut pas l’accepter. Voilà pourquoi, puisque nous disposons d’une accroche, nous devons nous en saisir tous ensemble pour protéger nos enfants.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Je vais essayer d’être aussi passionné que Mme la rapporteure.
Vous avez raison, madame Rossignol, la seule disposition de l’article 11 ne suffira pas à lutter contre ce fléau qu’est l’accès des mineurs à la pornographie. Nous mettons donc en place un ensemble de mesures, de leviers, ciblant ici les hébergeurs, là les fournisseurs d’accès, là encore les éditeurs de contenus, les plateformes, les réseaux sociaux, afin d’interdire, à chaque niveau, l’accès des mineurs à la pornographie.
Vous avez eu raison, madame la rapporteure, de citer le discours du Président de la République devant l’Unesco, à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la présentation du plan de lutte contre les violences. Il est en effet très fortement préoccupé par la question de l’exposition des mineurs à la pornographie.
Le premier outil, que nous avons évoqué, est le protocole d’engagement signé, en présence de Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, par l’ensemble des acteurs – associations, fournisseurs d’accès, grandes plateformes, constructeurs de téléphones, c’est-à-dire l’ensemble de la chaîne de valeur –, que nous avons mis, pour la première fois, autour de la table des discussions. Nous pensons en effet qu’il est de la responsabilité de chacun de restreindre l’accès des mineurs à la pornographie.
Vous l’avez rappelé, ces acteurs se sont engagés en janvier dernier à agir sous six mois. La crise étant passée par là, bien que les travaux se soient poursuivis, nous avons pris un peu de retard ; nous nous sommes donné rendez-vous au début de l’été.
Nous leur avons demandé, j’y insiste, de nous proposer un dispositif sous six mois, en leur laissant la liberté des moyens, mais en fixant un objectif : restreindre très fortement l’accès des mineurs à la pornographie. Il est vrai que le contrôle parental par défaut nous semblait être un moyen d’action efficace, mais le débat reste ouvert.
Si je puis me permettre, madame la rapporteure, l’adoption de votre amendement ne mettra pas un terme à cet engagement de l’ensemble des acteurs, qui reste nécessaire. Nous continuons à suivre leurs travaux, menés sous l’égide du CSA et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Le deuxième outil est l’article 1er de la loi Avia, que vous avez adopté et qui intègre la question de l’exposition à la pornographie des mineurs comme étant l’un des champs de compétence de cette loi.
Le troisième outil est le présent article 11, que vous vous apprêtez à voter, mesdames, messieurs les sénateurs, et qui inscrit dans le droit « dur » une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les simples disclaimers ne suffisent pas pour garantir le non-accès des mineurs à un site.
Il y a enfin l’ajout prévu dans son amendement par Mme la rapporteure, qui vise à confier au CSA la possibilité de saisir le juge.
Vous aurez l’occasion de débattre du projet de loi portant réforme de l’audiovisuel, peut-être sous une forme quelque peu différente de ce qui était prévu initialement – je ne veux pas préjuger l’avenir. Celui-ci prévoit, vous le savez, la fusion du CSA et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) et la création d’une nouvelle instance, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), dont l’un des champs de compétence sera la lutte contre l’accès des mineurs à la pornographie.
À cet ensemble de dispositifs, l’amendement de Mme la rapporteure ajoute un élément fort utile. J’espère – je vous le dis, madame Rossignol – qu’il permettra de restreindre très fortement l’accès des mineurs à la pornographie.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 11.
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud, Apourceau-Poly et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann et MM. Ouzoulias et Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-… ainsi rédigé :
« Art. 222-14-…. – Le fait d’exposer un mineur à des violences commises sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des peines prévues au b des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. Le mineur exposé est considéré comme victime des violences. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Selon une étude menée il y a deux ans par le ministère des solidarités et de la santé, on estime chaque année que 170 000 enfants sont témoins de violences conjugales et intrafamiliales perpétrées dans les foyers français.
Pour ces mineurs, les conséquences néfastes d’une telle exposition sur le long terme ne sont plus à démontrer. Des syndromes de stress post-traumatique et des effets préjudiciables à leur développement cognitif et émotionnel sont notamment à déplorer. Certains en viennent même, malheureusement, à perpétuer ces schémas comportementaux violents, une fois l’âge adulte atteint. Il semble donc nécessaire de reconnaître les traumatismes et les souffrances endurés par ces enfants.
Actuellement, sur le plan pénal, à moins qu’il n’ait lui-même directement fait l’objet de violences, l’enfant ne peut être considéré comme une victime à part entière des brutalités intrafamiliales.
Pourtant, l’exposition du mineur aux violences conjugales relève indéniablement de mauvais traitements qui lui auraient été infligés. Il est par conséquent nécessaire que le droit pénal français admette que le préjudice moral et physique qui touche le parent violenté se répercute également sur l’enfant qui assiste à ces scènes.
Aussi est-il proposé dans le présent amendement de reconnaître, par extension, que les mineurs exposés aux violences conjugales sont également des victimes directes de ces maltraitances.

Cet amendement prévoit que le mineur qui a assisté à des violences conjugales soit lui-même considéré comme une victime de violence.
Je partage l’idée générale qui sous-tend l’amendement : le mineur exposé aux violences en est indirectement la victime ; il peut en éprouver un traumatisme qui va le marquer durablement ; il peut aussi parfois reproduire, une fois adulte, la violence à laquelle il a assisté.
J’observe cependant que le code pénal prend déjà en compte cette dimension : les faits de violence au sein du couple sont en effet punis plus sévèrement lorsqu’un mineur y a assisté. L’adoption de cet amendement n’entraînerait aucun alourdissement de la peine encourue. On peut donc considérer qu’il est satisfait. L’avis de la commission est défavorable.
Cet amendement vise à faire reconnaître qu’un enfant exposé à des violences conjugales peut être traumatisé par celles-ci et à le considérer comme une victime de ces faits, à côté de la personne, le plus souvent sa mère, qui en a été la victime directe.
Pour autant, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a déjà expressément reconnu la qualité de victime de ces mineurs, en prévoyant de retenir comme circonstance aggravante des violences conjugales le fait qu’un mineur y ait assisté. L’objectif visé au travers de cette disposition est, à la fois, d’aggraver la répression et de permettre la constitution de partie civile.
Du reste, dans la circulaire du 9 mai 2019 relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes, la garde des sceaux a donné pour instruction aux parquets de systématiquement retenir cette circonstance aggravante, « compte tenu de la coloration particulière qu’elle donne au fait ». Elle ajoutait aussi : « La désignation d’un administrateur ad hoc devra par ailleurs être envisagée afin de permettre au mineur d’être reconnu comme une victime des faits. »
Cela dit, l’amendement soulève une importante difficulté juridique : il n’est constitutionnellement pas possible de créer un délit spécifique d’exposition des mineurs à des violences conjugales, alors même que, depuis la loi du 3 août 2018 précitée, les violences conjugales commises en présence d’un mineur sont aggravées. Un même fait ne peut en effet constituer, à la fois, un délit autonome et la circonstance aggravante d’un autre délit, car cela viole la règle bien connue non bis in idem.
Les travaux menés dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, sous la responsabilité de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et du plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants, sous ma propre responsabilité, ont démontré la nécessité de renforcer les unités d’accueil et d’écoute spécialisées et pluridisciplinaires pour recueillir la parole du mineur.
Au sein de mon plan de lutte contre les violences, présenté en novembre dernier, ces unités d’accueil médico-judiciaires pédiatriques (UAMJP), que l’on appelle désormais unités d’accueil pédiatriques pour l’enfance en danger (UAPED), seront généralisées à l’ensemble du territoire – je le dis à Mme de la Gontrie – d’ici à 2022.
Grâce à l’allocation de moyens supplémentaires, ces unités sont aujourd’hui au nombre de 64. L’objectif est d’en avoir 104 d’ici à 2022. Il est prévu que l’audition des mineurs par ces structures, à l’issue de laquelle une prise en charge psychologique pourra intervenir, concerne également les mineurs témoins victimes de violences conjugales.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 113-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II. » ;
2° À l’article 221-5-1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : «, y compris hors du territoire national, » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-6-4 ainsi rédigé :
« Art. 222 -6 -4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222-26-1 ainsi rédigé :
« Art. 222 -26 -1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
5° Après l’article 222-30-1, il est inséré un article 222-30-2 ainsi rédigé :
« Art. 222 -30 -2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. » –
Adopté.
Chapitre IX
Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
(Supprimé)

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 56 est présenté par Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 82 est présenté par Mmes Cohen, Benbassa, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« Art. 20 – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.
« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour présenter l’amendement n° 56.

Nous nous préoccupons de savoir comment les victimes de violences conjugales pourront se faire protéger par la justice, et donc engager des procédures, notamment la requête en vue d’obtenir la délivrance de l’ordonnance de protection (ODP). À cette fin, il faut le plus souvent être assisté d’un professionnel, en l’occurrence un avocat, voire, comme on l’a dit cet après-midi, un huissier, et donc pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle.
À l’Assemblée nationale, des travaux très importants ont été menés conjointement par Naïma Moutchou et Philippe Gosselin, lesquels ont conclu que, dans le cas des violences conjugales, l’aide juridictionnelle devait être attribuée en urgence, sans condition de ressources, dès le dépôt de plainte.
Lorsque la présente proposition de loi est venue en discussion, son article 12, qui a été supprimé par la commission des lois et que je propose de rétablir, prévoyait qu’il soit possible, lorsque la procédure présente un caractère d’urgence, d’attribuer l’aide juridictionnelle à titre provisoire, celle-ci devenant définitive une fois la vérification faite que la personne a réellement le droit d’en bénéficier. Il s’agit de permettre aux personnes concernées d’être assistées d’emblée. Curieusement, la commission des lois a décidé de supprimer cette possibilité, en arguant du fait que l’on pouvait toujours obtenir l’aide juridictionnelle en urgence.
Aujourd’hui, selon les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ), il faut entre 15 jours et 6 mois pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, chaque tribunal étant compétent pour attribuer cette aide. Il y a donc une incroyable hétérogénéité de délais, mais aussi d’objets. En effet, chaque président de tribunal prend sa décision en fonction de la jurisprudence propre de sa juridiction, et selon que l’urgence est déclarée ou non.
Il nous avait paru très sain de définir le cadre dans lequel il est possible de demander l’aide juridictionnelle d’urgence, et de prévoir que la liste des procédures présentant un caractère d’urgence soit fixée par décret en Conseil d’État, pour que les dispositions soient égalitaires sur l’ensemble du territoire français. Cela nous semblait très important.
J’ai le souvenir d’un échange avec le président Bas, en commission… Il est faux de penser que l’on peut obtenir l’aide juridictionnelle en 24 heures. Il existe une circulaire de la garde des sceaux indiquant aux BAJ que ce délai devrait être tenu en cas de violences conjugales, mais telle n’est pas la réalité !
Encore une fois, le renforcement de l’aide juridictionnelle provisoire est essentiel en ces matières. Voilà pourquoi nous demandons le rétablissement de l’article qui le prévoyait, et qui était issu du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Mon intervention sera proche de celle de ma collègue.
Je m’étonne de l’attitude de la commission. On sait pertinemment que les conjoints violents ont aussi tendance à enfermer leur victime dans une grande dépendance économique. Je ne comprends pas que cet aspect ne soit pas pris en compte dans ce cas particulier, car cela aggrave encore les violences infligées aux femmes !
Il est indiqué dans le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, publié en janvier dernier, qu’une telle mesure faciliterait le parcours judiciaire des victimes de violences conjugales et leur permettrait d’avoir accès plus facilement à un avocat. Il y est également précisé – le magistrat Édouard Durand le souligne aussi – que l’aide juridictionnelle provisoire devrait être ouverte dès le début d’une procédure, soit au moment du dépôt de plainte, soit lors de l’enclenchement d’une procédure civile.
Une telle évolution permettrait à la victime de bénéficier d’une aide appropriée pour s’engager de la manière la plus efficace possible dans cette procédure. Elle serait, par exemple, épaulée pour se préparer à une éventuelle confrontation et pourrait, en outre, être domiciliée chez son avocat le temps de la procédure.
Pour toutes ces raisons, nous proposons, dans un premier temps, le rétablissement de l’article 12 dans la rédaction présentée par les députés Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha.

La commission a fait le choix de supprimer l’article 12 qui prévoit d’automatiser l’attribution à titre provisoire de l’aide juridictionnelle, mais qui limite, en contrepartie, le bénéfice de cette attribution provisoire à certains contentieux énumérés par décret en Conseil d’État.
Elle a estimé que cet article ne représentait qu’un apport très modeste au regard de la situation existante, étant rappelé que la solution dépend avant tout de l’organisation des BAJ et de la façon dont ils traitent de manière prioritaire les dossiers des victimes de violences conjugales.
La circulaire publiée le 28 janvier dernier par la garde des sceaux appelle ainsi les BAJ à mettre en place un circuit spécifique permettant l’attribution sous 24 heures de l’aide juridictionnelle au profit de la partie demanderesse, dans le cadre des ODP. Ce faisant, les BAJ peuvent accorder directement l’aide juridictionnelle à titre définitif, ce qui garantit davantage de sécurité au demandeur qu’une admission à titre provisoire, laquelle pourrait ensuite être remise en cause au regard des ressources. En clair, la victime sera de toute façon obligée de payer l’avocat.
La commission a préféré s’en tenir au système actuel, qui donne suffisamment de souplesse aux juridictions et aux BAJ pour traiter toutes sortes de situations dans lesquelles l’admission à titre provisoire est nécessaire. Les juridictions ont pu en faire usage lors de la crise du Covid-19, lorsque certains BAJ étaient fermés.
L’article 12 vise à améliorer l’admission à titre provisoire des femmes victimes de violences conjugales, mais remet en cause l’ensemble de l’actuel système d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en privant les juridictions judiciaires et administratives de leur faculté d’attribuer cette aide au regard de l’urgence de chaque situation, sans avoir à se limiter à tel ou tel type de contentieux.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L’article 12 de la proposition de loi renvoyait à un décret l’établissement de la liste des procédures permettant d’octroyer l’aide juridictionnelle provisoire. Parmi ces procédures, les violences conjugales figurent évidemment en première place, mais il nous paraît préférable de renvoyer au décret pour ajuster plus aisément le périmètre concerné par l’aide juridictionnelle provisoire.
Cette disposition complète une disposition, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, qui concerne les juridictions signataires de conventions avec les barreaux en matière d’aide juridictionnelle. Ces conventions donnent lieu au versement de dotations complémentaires, selon les procédures, lorsque le barreau a mis en place une permanence d’avocats. Or le périmètre desdites conventions intègre désormais les ODP.
La réécriture du régime de l’aide juridictionnelle provisoire, complémentaire de cette modification du régime des conventions locales, va dans le bon sens.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 57, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la revalorisation de l’aide juridictionnelle.
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Il s’agit d’une demande de rapport, donc je serai rapide…
L’idée est de proposer au Gouvernement d’avoir, un jour, un débat consacré à l’aide juridictionnelle. Vous le savez, l’aide juridictionnelle est une condition de l’égalité d’accès à la justice pour tous les citoyens ; elle fait l’objet de nombreuses questions, en particulier relatives aux modes de rémunération différenciée, aux montants de l’aide et aux plafonds de ressources pris en compte. À un moment où l’accès à la justice semble souvent difficile à beaucoup de justiciables, il serait utile que le Gouvernement débatte un jour avec nous, non de ses projets, de ses annonces ou de ses plans, mais de ce qu’il veut faire, de ce qu’il faut faire, en matière d’aide juridictionnelle.

L’aide juridictionnelle mériterait un projet de loi à part entière. Nous avons eu ce débat lors de la discussion de la dernière loi de finances, au cours de laquelle le Sénat s’était opposé à une réforme adoptée, à l’Assemblée nationale, au détour de l’examen d’un amendement.
Cela dit, vous ne serez pas surprise, ma chère collègue, je propose l’application de la « jurisprudence » habituelle de la commission des lois sur les demandes de rapport, en émettant un avis défavorable sur cet amendement.
Nous sommes évidemment à votre disposition pour débattre de l’aide juridictionnelle, madame la sénatrice.
Cela étant, pour ce qui concerne cette demande de rapport, je précise deux choses. D’abord, un premier rapport parlementaire a été publié l’été dernier sur ce sujet et le Conseil national de l’aide juridique en a également produit un en 2019. Ensuite, une commission, présidée par Dominique Perben, a été mise en place ; elle doit rendre ses premières propositions sur cette question d’ici à quelques semaines. Ce sera l’occasion d’en débattre.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
Au 7° de l’article 515-11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l’une d’elles ». –
Adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Cartron et MM. Bargeton, Hassani et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont ainsi admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle les étrangers ayant subi des violences familiales ou conjugales, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour. »
La parole est à M. Richard Yung.

La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que les étrangers en situation irrégulière peuvent se voir accorder l’aide juridictionnelle « à titre exceptionnel […], lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt ». Je le souligne, la notion « digne d’intérêt » est assez vague…
Les bureaux d’aide juridictionnelle disposent ainsi d’un très large pouvoir d’appréciation. Selon le Défenseur des droits, leurs pratiques présentent de telles disparités dans le traitement des demandes que l’effectivité de l’accès au tribunal n’est pas garantie de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. Cette situation est notamment préjudiciable aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales, qui, en raison de leur situation irrégulière, disposent de faibles ressources et qui, à cause de leurs problèmes de langue et de connaissance du droit, ont particulièrement besoin d’être assistés.
Afin d’éviter cette différence de traitement, il est utile de clarifier les règles devant être appliquées par ces bureaux. Par conséquent, le présent amendement vise à faire en sorte que la situation vécue par une victime de violences familiales soit systématiquement considérée comme digne d’intérêt.

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par les mots : « ainsi que pour l’étranger victime des délits et crimes mentionnés aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-22 à 222-22-2, 222-23 à 222-26, 222-27 à 222-31, 222-33-2 à 222-33-2-2 du code pénal ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Plusieurs associations d’aide aux personnes migrantes, notamment la Cimade, nous ont alertés à propos de la double peine que subissent les femmes étrangères sur notre territoire. Ces femmes sont régulièrement victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles, mais, contrairement à celles qui sont de nationalité française, nombre d’entre elles ne peuvent s’adresser à la justice, faute de moyens financiers et d’accès à l’aide juridictionnelle.
En effet, les personnes étrangères ne bénéficient pas automatiquement de l’aide juridictionnelle, qui n’est en principe accordée qu’à condition d’être de nationalité française ou d’avoir des papiers de séjour en règle.
Pourtant, l’article 3 de la loi relative à l’aide juridique précitée a ouvert la voie à un élargissement de son attribution. Ainsi, certaines personnes migrantes en situation irrégulière, notamment celles qui sont présentes en centre de rétention administrative, peuvent en bénéficier. Ce n’est pas le cas, pour l’heure, des étrangères victimes de violences conjugales, de harcèlement moral, de viol ou d’agression sexuelle, dont les droits ne sont ouverts qu’en cas de régularisation de leur situation. Cette position du droit semble particulièrement inique, puisqu’elle laisse les femmes étrangères dans une situation de précarité et de danger, à la merci de leurs agresseurs.
Ainsi est-il proposé, au travers du présent amendement, de garantir l’accès à l’aide juridictionnelle pour toutes les personnes étrangères victimes de violences, dans le cadre de procédures civiles, pénales ou administratives, et ce sans condition de nationalité ou de régularité du séjour.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit passé. Je vous propose de prolonger notre séance, afin d’achever l’examen de ce texte. Il reste 17 amendements.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 9 rectifié et 18 rectifié ?

Les amendements n° 9 rectifié et 18 rectifié sont satisfaits par la rédaction actuelle de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991.
Les étrangers peuvent déjà être admis à bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de résidence, lorsqu’ils sont parties civiles dans un procès pénal ou qu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection. Il n’y a donc pas besoin d’énumérer de manière précise certaines infractions.
La commission demande par conséquent le retrait de ces amendements.
Plus précisément, si la victime est entièrement dépendante économiquement et qu’elle ne dispose pas de ressources, elle est automatiquement admise à l’aide juridictionnelle, mais le recours à l’aide provisoire permet de mettre en place, très rapidement, une assistance par un avocat. Par conséquent, la rédaction proposée dans la proposition de loi nous paraît plus sage et peut-être juridiquement plus solide.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

L’amendement n° 18 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 10 rectifié bis, présenté par M. Yung, Mme Cartron et MM. Bargeton, Hassani et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 121-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative ne peut pas procéder à son retrait lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122-1 est complétée par les mots : «, y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;
3° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313-25 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;
4° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313-26 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 314-8-2 est complété par les mots : «, y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;
6° L’article L. 314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait de la carte de résident prévue au 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales
La parole est à M. Richard Yung.

Il s’agit toujours du problème de la protection des étrangers en France.
Cet amendement vise à compléter le dispositif de protection des victimes de violences familiales de nationalité étrangère. Ce dispositif a été renforcé en 2016 et en 2018 ; il s’applique aux conjoints de Français titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », aux conjoints de Français titulaires d’une carte de résident et aux bénéficiaires d’une ordonnance de protection.
Un certain nombre de victimes étrangères ne sont en revanche pas protégées par ce dispositif. Il s’agit des conjoints d’un ressortissant communautaire, d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation, en prévoyant que ces victimes conservent leur titre de séjour ou bénéficient du renouvellement de ce titre en cas de rupture de la communauté de vie.

Votre amendement, mon cher collègue, tend à accorder au conjoint étranger d’un étranger ayant un droit au séjour spécifique – un ressortissant communautaire, un apatride, un réfugié ou un bénéficiaire d’une protection subsidiaire – le droit de voir son titre maintenu en cas de rupture de la vie commune du fait de violences conjugales.
En temps normal, l’étranger titulaire d’une carte de séjour doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. S’il cesse de remplir l’une de ces conditions, il risque alors un retrait du titre.
En l’espèce, bénéficiant du titre de séjour en tant que conjoint, l’étranger doit normalement pouvoir justifier d’une communauté de vie effective avec son conjoint. Certains dispositifs prévoient expressément des exceptions à cette condition de communauté de vie effective, en cas de violences conjugales. C’est le cas des cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale », de cartes de résident « conjoint de Français » et de cartes de séjour temporaire « regroupement familial ».
Cela dit, rien n’est prévu, si ce n’est parfois à titre réglementaire – ainsi, l’article R121-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile –, pour les conjoints de ressortissants communautaires. L’amendement de M. Yung est donc bienvenu pour harmoniser le traitement de ces cas, quel que soit le titre accordé, et pour exclure le retrait en cas de cessation de la communauté de vie liée à des violences conjugales.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Selon la garde des sceaux, le contenu de cet amendement est déjà satisfait par l’état du droit. C’est le cas pour ce qui concerne les conjoints de citoyens de l’Union européenne et assimilés, puisque leur droit au séjour est assujetti non à une condition de communauté de vie, mais au maintien du lien marital, et cette absence d’exigibilité d’une communauté de vie a été confirmée par une large jurisprudence communautaire. Ainsi, assez paradoxalement, cette disposition aboutirait, par une lecture a contrario, à ajouter la condition de maintien de vie commune, qui n’est pas prévue par la directive 2004/38/CE, dont les articles L. 121-3 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont la transposition en droit interne.
En outre, l’article R121-8 du même code prévoit que le conjoint du citoyen de l’Union conserve son droit de séjour malgré la dissolution du lien conjugal, lorsque les situations particulièrement difficiles l’exigent, « notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu’il a subies ».
En ce qui concerne les conjoints des étrangers reconnus réfugiés, aucune disposition de ce code ne permet de retirer la carte de résident délivrée au motif de la rupture de la vie commune. Le renouvellement du titre, en cas de rupture de la communauté de vie pour violences, est donc d’ores et déjà garanti en l’état actuel de la législation.
Le droit au séjour du conjoint ou partenaire d’un protégé subsidiaire ou d’un apatride victime de violences conjugales ou familiales est protégé par la jurisprudence, qui exige que l’on tienne compte des violences dont il a pu faire l’objet. La directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 s’oppose à la rédaction proposée au travers de l’amendement, qui placerait de fait le préfet en situation de compétence liée.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 12 bis.
L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par M. Yung, Mme Cartron et MM. Bargeton, Hassani et Lévrier, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « de plein droit » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. » ;
2° L’article L. 314-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « de plein droit » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La preuve des violences familiales ou conjugales peut être apportée par tout moyen. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales
La parole est à M. Richard Yung.

Cet amendement a lui aussi trait au thème des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales.
Dans son rapport de 2019, le Défenseur des droits déplore le fait que certaines préfectures continuent de subordonner le renouvellement du titre de séjour à « l’obligation de produire la preuve d’un divorce en cours – voire d’un divorce pour faute – ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences ». Cette pratique ne tient pas compte de la réalité des victimes des violences conjugales.
Elle n’est en outre pas conforme à la volonté exprimée par le législateur au travers de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. En adoptant cette loi, le législateur a clairement entendu rendre automatique le renouvellement du titre de séjour des étrangers victimes de violences conjugales ou familiales, malgré la fin de la communauté de vie.
J’ajoute que les juridictions administratives rappellent régulièrement que la preuve de violences peut être établie par tous moyens et que le renouvellement du titre de séjour n’est, en tout état de cause, jamais subordonné à la condamnation pénale du conjoint violent.

Cet amendement concerne trois types de titres de séjour : les cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale », les cartes de résident « conjoint de Français », après trois ans de vie commune, et les cartes de séjour temporaire « regroupement familial ». Il vise à régler les conséquences d’une cessation de la vie commune pour violences conjugales en prévoyant un renouvellement de plein droit du titre de séjour et en permettant la preuve des violences conjugales par tous moyens.
Toutefois, cet amendement est déjà satisfait, contrairement au précédent. On ne retire pas leur titre aux bénéficiaires de ces titres de séjour du fait de la cessation de la vie commune et les textes en permettent déjà le renouvellement de plein droit.
Par ailleurs, en l’absence de précision dans la loi, les faits de violence peuvent déjà être prouvés par tous moyens.
Il est donc inutile d’apporter les précisions rédactionnelles suggérées, qui risquent de créer des interprétations a contrario peu favorables, dans d’autres articles. Il s’agit d’un problème de pratiques administratives qui peut être réglé par circulaire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 62, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des » sont remplacés par les mots « victime de » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison de la menace » sont remplacés par le mot : « menacé » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « même après l’expiration de l’ordonnance de protection » et les mots : «, pendant la durée de la procédure pénale y afférente » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au terme des procédures judiciaires, les faits de violences conjugales ne sont pas reconnus, la carte de séjour délivrée est retirée sans délai. »
II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Du droit au séjour
La parole est à Mme Claudine Lepage.

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a prévu la délivrance d’une carte de séjour aux seules victimes de violences conjugales qui bénéficient d’une ordonnance de protection. Or il est notoire que très peu de ces ordonnances sont délivrées chaque année ; nous avons débattu du sujet précédemment.
Afin de ne pas limiter la portée de cette mesure, le présent amendement tend à supprimer la condition de l’ordonnance de protection pour autoriser au séjour sur notre territoire toutes les victimes de violences conjugales.
Si, au terme des procédures judiciaires, les faits de violence ne sont pas reconnus, il est prévu que la carte de séjour est immédiatement retirée.

Cet amendement vise à assouplir les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en cas de violences conjugales ou de menaces de mariage forcé.
En l’état actuel du droit, ces violences ou menaces doivent être attestées par l’obtention d’une ordonnance de protection. Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cette condition, arguant du fait que ces ordonnances sont trop difficilement accordées.
Ils apportent en complément la précision que si, au terme des procédures judiciaires, les faits de violence ne sont pas reconnus, alors la carte de séjour est immédiatement retirée.
Il semble souhaitable de s’en tenir au droit existant. En effet, d’une part, la délivrance d’une ordonnance de protection est la garantie qu’un juge a apprécié la vraisemblance des faits et du danger encouru, ce qui évite tout détournement de ce fondement de délivrance d’une carte de séjour temporaire. D’autre part, contrairement à l’intention des auteurs de l’amendement, si l’on transfère l’appréciation aux services de la préfecture, il n’est pas du tout certain que ceux-ci se fondent sur la vraisemblance des faits allégués, comme c’est prévu dans le code civil en matière d’ordonnance de protection ; ils pourraient au contraire exiger une matérialité plus grande des faits.
J’ajoute que les ordonnances de protection sont plus souvent délivrées par les juges aux affaires familiales, qui se les sont appropriées, et que les étrangers sans séjour régulier peuvent obtenir l’aide juridictionnelle à ce titre.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. –
Non modifié
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. –
Non modifié
« Art. 711 -1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
(Supprimé) –
Adopté.
IV. – §
Chapitre XI
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
(Suppression maintenue)

L’amendement n° 19, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les violences administratives dans le cadre conjugal, leurs incidences et les moyens d’y remédier.
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Je souhaite appeler l’attention de la Haute Assemblée sur des violences d’un genre nouveau, encore largement méconnues : les violences administratives. Celles-ci consistent à confisquer ou à détruire les documents administratifs personnels de sa conjointe ou compagne, afin de bloquer cette dernière dans ses démarches et dans l’accès à ses droits. Ces pratiques entraînent une forme d’emprise de l’agresseur sur la victime, qui se trouve totalement dépendante du bon vouloir de ce dernier.
Ces brutalités psychologiques frappent particulièrement les personnes étrangères, plaçant celles-ci dans une situation de grande vulnérabilité sur notre territoire. Pour ces personnes migrantes, la rétention, par leur conjoint ou compagnon, de leurs documents d’identité, titre de séjour, ou encore livret de famille revient à éprouver la peur permanente de ne pas pouvoir mener à bien certaines démarches administratives lourdes de conséquences.
Aux violences physiques et psychologiques pratiquées à leur endroit par leur agresseur s’ajoute ainsi la crainte de la reconduite à la frontière et de la précarité sociale et financière. Cette emprise place la victime dans une situation de soumission et l’empêche d’acquérir une autonomie susceptible de lui permettre de quitter son compagnon.
Les souffrances verbales, psychologiques, physiques et sexuelles tendent aujourd’hui à être reconnues ; il n’en est rien des violences administratives, en raison de l’ignorance des autorités. Ainsi, il est proposé, au travers du présent amendement, que, dans les six mois suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport à ce sujet, permettant ainsi au législateur de bénéficier de données chiffrées et documentées, afin que des solutions soient trouvées en la matière.

Il s’agit d’une demande de rapport sur les violences administratives commises dans le cadre conjugal. Plus qu’un rapport sur ces formes de violence, il convient de sensibiliser les pouvoirs publics à ces situations. Nous demanderons à la garde des sceaux le regard qu’elle porte sur ce sujet.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Madame la sénatrice, je partage votre constat sur le fond. D’ailleurs, ces sujets ont beaucoup émergé du Grenelle contre les violences conjugales, notamment le fait de subtiliser des moyens de paiement ou des papiers d’identité. C’est également un point sur lequel nous ont alertés les associations pendant la période de confinement ; certaines d’entre elles ont évoqué le cas de femmes auxquelles on avait dérobé des attestations de sortie ou de quoi écrire pour sortir.
Ce que vous décrivez est donc une réalité qui doit être mise au jour et débattue. C’est la raison pour laquelle nous avons créé, dans le cadre du Grenelle, un groupe de travail spécifiquement dédié à ce que nous avons appelé les violences économiques, qui incluent évidemment les violences administratives. Je suis persuadée que ce groupe de travail, dont j’ai réuni les pilotes ce matin, sera tout à fait d’accord pour échanger avec vous et pour vous entendre en audition, afin d’envisager ce qu’il est possible de faire à long terme pour avancer ensemble sur cette question, sur le fondement de ce que vous proposez.
Je reçois l’ensemble des banques, jeudi prochain, pour les mobiliser et les sensibiliser, notamment à un fait particulier qui nous a été souvent signalé : lorsqu’une femme souhaite quitter son conjoint, celui-ci téléphone à la banque pour faire supprimer les moyens de paiement de la victime. Cette réalité nous a été rapportée à de nombreuses reprises, j’y insiste.
Je reçois donc les banques jeudi ou vendredi, afin de savoir quelles actions elles comptent mettre en place pour mettre fin à cette pratique, qui est déjà interdite par la loi, mais qui existe encore.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette demande de rapport, mais nous enregistrons votre demande de mettre ce sujet à l’ordre du jour et d’y travailler sérieusement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mmes Monier et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement dans lequel il rend compte de l’état de la situation des 16 départements dépourvus d’intervenant social en gendarmerie et en commissariat (ISCG), des mesures à prendre pour favoriser la généralisation du dispositif en lien avec les collectivités locales ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir dans les territoires ruraux le financement à hauteur de 100 % des ISCG via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

J’imagine aussi, madame la secrétaire d’État, que, lors du Grenelle et des entretiens divers que vous avez eus, vous ont été signalés deux autres éléments.
Le premier est l’efficacité et le soutien que représente, pour les victimes et pour la procédure, la présence d’un intervenant social en commissariat et gendarmerie. Ces intervenants sont salués, partout où ils existent, comme procurant un véritable accompagnement et une aide, tant pour les forces de police ou de gendarmerie que pour les victimes.
Le second est la situation de seize départements dépourvus d’intervenant social en commissariat et gendarmerie.
Dans un monde idéal – un monde où le Parlement aurait une large initiative de proposition en termes de politiques publiques –, nous aurions proposé que, dans les départements à faible budget ou dans lesquels les communes sont peu fortunées et où aucune collectivité locale ne s’engage suffisamment pour créer ces postes d’intervenant social, les communes puissent financer à 100 % ces derniers en utilisant les fonds alloués par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal, nous ne sommes que dans le monde réel. Par conséquent, cet amendement ne vise qu’à proposer un rapport sur la situation de ces seize départements.
Cet amendement est né de l’initiative de Marie-Pierre Monier, sénatrice de la Drôme, qui cherche réellement, auprès du Gouvernement, l’appui nécessaire pour apporter aux victimes de la Drôme le même appui que celui qui est accordé aux victimes dans bien d’autres départements.

Bien sûr, l’accompagnement social des victimes est très important pour nous et nous comprenons bien le problème soulevé, mais, bien que ce soit caché, il s’agit tout de même d’une demande de rapport. Nous appliquons donc la jurisprudence habituelle de la commission sur les demandes de rapport – nous ne sommes pas favorables aux rapports, nous le disons régulièrement et avec beaucoup de constance –, même si nous sommes favorables à l’accompagnement social des victimes.
Effectivement, madame la sénatrice, l’augmentation du nombre de ces intervenants a été, vous l’avez rappelé, prévue dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. Le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a ainsi fait savoir que 80 postes seraient créés au cours l’année 2020. Sur ceux-ci, 15 ont déjà été pourvus avant la crise liée à la pandémie de Covid-19.
Cette mesure fera, comme l’ensemble des autres mesures issues du Grenelle, l’objet d’un suivi annuel, dans le cadre d’un comité composé de représentants de l’ensemble des administrations concernées – ministères de l’intérieur et de la justice, service des droits des femmes, ou encore direction générale de la cohésion sociale (DGCS) –, qui bénéficieront d’un outil de report, renseigné à tout moment par chaque administration pour suivre, territoire par territoire, les implantations. Ce comité est chargé de rendre, en novembre de chaque année, dans la lignée des travaux conjoints entre l’administration chargée du suivi du Grenelle, la DGCS, et ses partenaires, y compris le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, un bilan précis de l’état d’avancement des mesures du Grenelle.
Cela répond à la demande de rapport. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Tous les amendements ont un bien-fondé et ils ont le mérite de poser les problèmes, d’exprimer des préoccupations, même si c’est au travers, notamment avec celui-ci, d’une demande de rapport.
Je me permets d’intervenir sur ce sujet, parce que, au sein de la délégation aux droits des femmes, la présidente, Annick Billon, les autres membres et moi-même avons souvent abordé ce sujet, bien avant la crise sanitaire. On le sait, la tâche des interventions à caractère social est immense pour les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers, bref pour toutes les forces de sécurité civile.
Avant la crise sanitaire, la situation n’était déjà franchement pas simple. Sous l’autorité des représentants de l’État que sont les préfets et les sous-préfets, des bilans étaient établis à l’échelle des départements. Ces problèmes étaient évoqués lors d’entretiens téléphoniques.
Dans mon département, les Ardennes, nous avons la chance d’avoir des intervenants sociaux en gendarmerie et commissariat. Je salue le partenariat avec les collectivités territoriales, qu’il s’agisse du conseil départemental, des intercommunalités, voire des communes.
Bien entendu, le problème du financement se pose – tout est financier –, mais le volet humain a été largement mis en évidence depuis le début de l’examen de cette proposition de loi.
Cet amendement a le mérite de soulever les problèmes. Je me rallierai à l’avis de Mme la rapporteur et de Mme la secrétaire d’État.
Il est vraiment important de poursuivre partout. On sait que la tâche est immense, mais on sait aussi que l’on peut compter sur l’ensemble des partenaires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 59 rectifié, présenté par Mmes M. Filleul et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des lieux des conséquences du confinement sur les violences au sein du couple et un bilan détaillé et chiffré des mesures prises pendant l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre ces violences.
La parole est à Mme Martine Filleul.

Cet amendement vise lui aussi à obtenir un rapport, cette fois pour dresser un bilan des conséquences de la crise du coronavirus sur les violences conjugales.
Mes chers collègues, reconnaissez que les circonstances sont extraordinaires. La proposition de loi que nous examinons a été élaborée et votée à l’Assemblée nationale avant la crise sanitaire relative à l’épidémie de Covid-19 et la période, inédite, de confinement, qui a été un facteur aggravant des violences conjugales. Pour autant, nous ne disposons pas, à ce jour, de bilan sur l’ampleur de ce phénomène. Nous savons cependant que la justice a tourné au ralenti, avec le risque de voir augmenter les délais des audiences, déjà importants.
L’éventail des réponses pénales s’est réduit. Les obligations de soins ont été renvoyées à la fin du confinement, tout comme celles de pointer au commissariat. Les stages de responsabilisation pour les auteurs de violences, normalement organisés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, n’ont plus eu lieu.
Tout cela doit être mesuré, afin de pouvoir éventuellement y remédier. Nous devons pouvoir identifier les difficultés spécifiques qu’ont pu rencontrer ou que rencontrent encore les victimes de violences en raison du confinement.
Par ailleurs, si des mesures ont été prises par le Gouvernement, nous devons pouvoir les évaluer et en tirer des enseignements, soit pour les améliorer, soit pour les pérenniser, si elles permettent de mieux lutter contre les violences faites aux femmes.
Nous devons également pouvoir identifier et analyser les manques ou les failles, afin d’en tirer toutes les conséquences si cette situation était amenée à se reproduire.

Le confinement a été un épisode absolument inédit, sans précédent. Très vite, on a su que son incidence sur les violences conjugales et les violences sur les mineurs serait de première importance. J’espère que le Gouvernement va pouvoir nous communiquer, en séance, des éléments chiffrés et détaillés.
Nous savons, madame la secrétaire d’État, que vous avez mis en place des endroits pour recueillir les plaintes, que ce soit dans les centres commerciaux ou dans les pharmacies. Nous savons également que l’ordre des avocats a ouvert une ligne téléphonique gratuite.
J’espère que vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Nous avons besoin de ce bilan détaillé et chiffré pour savoir ce qui s’est vraiment passé pendant le confinement.
À la lumière de ce que vous allez nous dire, nous pourrons émettre un avis sur cet amendement.
Tout d’abord, j’ai confié, dès la fin du mois de mars, une mission à Élisabeth Moiron-Braud, magistrate et secrétaire générale de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Je lui ai demandé de travailler sur l’évaluation de la prévalence des violences conjugales pendant le confinement. Nous avons mis à sa disposition l’ensemble des indicateurs utiles des administrations. Les résultats de cette mission nous seront remis au mois de juillet prochain. Nous disposerons donc alors d’une évaluation indépendante de la prévalence des violences conjugales.
Comme Mme la garde des sceaux et moi-même l’avons dit dans notre propos liminaire, cinq fois plus de signalements ont été effectués sur la plateforme « arretonslesviolences.gouv.fr » et il y aurait eu 36 % d’appels aux forces de l’ordre supplémentaires. Cependant – je le dis avec beaucoup de précautions –, d’après les premiers résultats dont nous disposons, il y aurait eu moins de féminicides. La mission confiée à Élisabeth Moiron-Braud permettra d’obtenir de véritables résultats, sur la base d’indicateurs les plus précis possible.
Par ailleurs, j’ai présenté publiquement, voilà une quinzaine de jours, des évaluations et des résultats chiffrés des dispositifs mis en place par le Gouvernement. Ces derniers sont à votre disposition, me semble-t-il, sur le site du ministère et, en tout état de cause, sur l’ensemble des réseaux sociaux et dans les médias – j’avais fait cette présentation du bilan à l’occasion d’une interview, justement pour que tous ces résultats soient rendus publics. Nous pourrons vous les adresser, madame la rapporteure, madame la sénatrice. Nous pourrons également les faire parvenir à tout parlementaire ou à toute personne qui en fait la demande, puisqu’ils sont publics.
Je vais en rappeler certains brièvement.
Le dispositif d’alerte des forces de l’ordre dans les pharmacies a donné lieu à plusieurs gardes à vue, à plusieurs comparutions immédiates, au relogement de plusieurs hommes auteurs de violences conjugales dans différents endroits du territoire.
Nous avons aussi ouvert, avec le ministre de l’intérieur, la possibilité de signaler les violences conjugales par l’envoi d’un SMS au 114, pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de téléphoner. Énormément de SMS ont été adressés à ce numéro.
Nous avons également ouvert une ligne téléphonique avec la Fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d’auteurs de violences conjugales et familiales (Fnacav). En effet, dans l’état d’esprit que nous avons évoqué tout à l’heure, sur la prise en charge des auteurs de violences conjugales, nous avons considéré que, pendant la période de confinement, des personnes ne sachant pas gérer leurs accès de violence pouvaient avoir besoin d’un accompagnement. Nous savons que cela ne concerne pas tous les hommes violents : certains prennent plaisir à terroriser leur famille, leur épouse ou leur entourage. Mais il y en a aussi pour qui c’est une souffrance et qui ont besoin d’appeler. La barre des 500 appels passés à cette ligne téléphonique depuis son ouverture au début du mois d’avril a été franchie : à 500 reprises, un homme sur le point de commettre un acte de violence a téléphoné, bénéficié de l’accompagnement d’un psychologue ou d’experts, et, éventuellement, d’une possibilité d’être logé.
Mme la garde des sceaux et moi-même avons d’ailleurs également mis en place une plateforme d’hébergement des auteurs de violences conjugales, en partenariat avec le groupe SOS. D’après les magistrats, cette plateforme a permis de reloger les hommes auteurs de violences conjugales en trois heures en moyenne, contre quarante-huit habituellement. C’est donc un progrès.
Nous allons pérenniser tous ces dispositifs, de même que les 90 points d’écoute et d’accompagnement des femmes que nous avons mis en place dans les hypermarchés et dans les centres commerciaux restés ouverts, grâce à l’engagement des associations locales de terrain, pour lesquels nous avons débloqué davantage d’argent – c’est le fonds que j’évoquais tout à l’heure.
Pour terminer, je veux indiquer que je suis en lien avec mes homologues en Italie, en Espagne, en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays. Partout, le confinement est arrivé de manière imprévisible. Nous sommes en train de travailler, avec l’administration aux droits des femmes, à un plan de confinement pérenne, établi sur la base de l’expérience malheureuse que nous venons de vivre et que les personnes qui seront aux responsabilités pourront mettre en œuvre si d’aventure la France devait connaître une nouvelle période de confinement à l’avenir, que ce soit dans six mois ou dans vingt ans.
J’espère que cela répond à votre question, madame la sénatrice.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Supprimé)

L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Cohen, Prunaud, Apourceau-Poly et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann et MM. Ouzoulias et Savoldelli, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux expertiser ces phénomènes.
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Les violences conjugales touchent tous les pans de notre société. Les couples de même sexe ne font pas exception, hélas ! Pourtant, nous ne sommes pas, pour l’heure, dûment renseignés sur l’ampleur de ce phénomène.
En effet, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains ne communique que des chiffres relatifs aux victimes féminines, sans faire mention du sexe de l’auteur des maltraitances.
Les seules données dont nous disposons à propos des brutalités au sein des couples de même sexe proviennent de l’association AGIR, qui a mené une étude sur le sujet en 2013. Selon ces chiffres, 11 % des gays et des lesbiennes et 20 % des personnes bisexuelles déclarent avoir subi des maltraitances conjugales. Seulement 3 % de ces personnes ont alors porté plainte. Ces éléments ne sont pas récents et manquent de précision, faute d’un échantillon représentatif de la communauté LGBT dans sa globalité.
Il semble évident que toutes les violences conjugales ne sauraient être traitées avec les mêmes outils. L’action publique devrait donc être en mesure de s’adapter au profil de la victime.
Ainsi est-il souhaité, au travers du présent amendement, que l’article 15 soit rétabli dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, afin qu’un rapport visant à rendre compte de la diversité des violences conjugales dans les couples de même sexe puisse être remis au Parlement. Ce rapport permettrait d’adapter les dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des victimes membres de couples homosexuels et lesbiens, en tenant compte de leurs spécificités.

Ma chère collègue, vous savez que la commission est, par principe, réservée sur les demandes de rapport. Elle a donc supprimé la demande de rapport qui figurait à l’article 15.
Cela ne signifie pas que le sujet que vous venez d’évoquer n’est pas intéressant. Bien au contraire, la question mérite d’être abordée.
Cependant, avons-nous réellement besoin d’un rapport au Parlement pour nous donner les moyens de mieux connaître le phénomène ou d’engager des actions de sensibilisation des professionnels concernés ? Je dois dire que nous avons un peu peur que les rapports ne deviennent un alibi pour ne rien faire.
Nous ne faisons pas rien sur cette question.
D’abord, nous avons accompagné le lancement, par l’association FLAG !, d’une application, dont je suis la marraine et que mon service finance en partie. Cette application permet de signaler à des policières et des policiers formés à ce sujet les violences dans des couples de même sexe. L’association FLAG ! regroupe des personnes LGBT+ qui sont membres des forces de l’ordre et qui sont engagées, à ce titre, pour un meilleur accueil des victimes et une meilleure prise en compte de ces questions.
Par ailleurs, ayant été interpellée durant le confinement par des associations de défense des personnes LGBT+, qui, comme vous, madame la sénatrice, demandaient une meilleure évaluation des violences conjugales au sein des couples de même sexe, j’ai décidé d’ajouter à la mission d’Élisabeth Moiron-Braud un volet spécifique sur la question des violences conjugales pendant le confinement au sein des couples de même sexe. Ce sujet sera donc également renseigné dans le rapport qui nous sera remis au mois de juillet prochain par la magistrate.
Enfin, j’entends souvent dire que l’on manquerait de données, notamment sur les féminicides ou sur les morts violentes dans le couple. Je rappelle que, depuis dix ou quinze ans, le ministère de l’intérieur publie, chaque année, une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, qui se penche à la fois sur le nombre de femmes et d’hommes tués par leur conjoint ou leur ex-conjoint et sur les violences au sein des couples de même sexe.
Nous vous rejoignons par conséquent complètement sur le fait qu’il s’agit d’un double tabou, qui doit être levé, et que nous devons agir. Les pouvoirs publics agissent. Cela doit-il toutefois passer par un rapport, comme l’Assemblée nationale en a fait le choix ? Le Gouvernement s’en remet, sur ce point, à la sagesse du Sénat.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 69, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après les mots : « état civil, », sont insérés les mots : « des agents des postes consulaires, ».
La parole est à Mme Claudine Lepage.

Cet amendement vise à étendre l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, qui prévoit une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leur signalement aux autorités administratives et judiciaires.
Cette extension vise spécifiquement les personnels des postes diplomatiques. En effet, les victimes de violences conjugales qui résident à l’étranger sont souvent encore plus isolées que celles qui vivent sur notre territoire. Les ressources et personnes auxquelles elles peuvent s’adresser peuvent être plus difficiles à identifier. Nos postes diplomatiques devraient être un lieu où elles puissent être informées quant à leurs droits.
Le présent amendement vise ainsi une formation pour les agents consulaires, afin qu’ils puissent accueillir au mieux les victimes de violences conjugales.

Cet amendement tend à ce que les agents des postes consulaires disposent, dans leur formation initiale et continue, d’une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi sur les modalités du signalement de tels faits aux autorités administratives et judiciaires, à l’instar de ce qui est prévu depuis 2010 pour d’autres fonctionnaires et pour les magistrats.
Les consulats ont déjà pour mission de conseiller les ressortissants français sur les démarches qu’ils doivent entreprendre vis-à-vis des autorités nationales. La formation devra nécessairement être adaptée à chaque contexte local, et le mécanisme de sa mise en œuvre et de sa prise en charge ne paraît pas évident.
La question est cependant importante et mérite d’être posée. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Nous considérons évidemment qu’il s’agit d’une question éminemment importante, qui doit être traitée.
Néanmoins, nous ne sommes pas sûrs que la formation des personnels des postes diplomatiques relève de la loi. À notre sens, elle relève directement du programme de formation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Plus globalement, nous tenons à rappeler que les questions relatives à la sensibilisation aux violences conjugales et à la formation sur celles-ci font l’objet du suivi réalisé par les comités de suivi des mesures du Grenelle contre les violences conjugales, que j’ai évoqué précédemment.
Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.

La commission se range à l’avis du Gouvernement et émet un avis défavorable sur l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 2 rectifié ter, présenté par M. Regnard, Mme Deromedi, MM. Frassa, del Picchia, Le Gleut et Yung, Mme Garriaud-Maylam, M. Cambon, Mme Deroche, MM. Piednoir, Laménie et Kennel, Mmes Billon et Canayer, MM. Raison, Perrin, Saury et Cuypers, Mme Lopez, MM. B. Fournier, D. Laurent et Pierre et Mme Lherbier, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article 10 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ».
La parole est à M. Damien Regnard.

Cet amendement tend à ce que le rapport annuel sur la situation des Français établis hors de France remis par le Gouvernement aux instances représentatives des Français de l’étranger fasse expressément mention des violences conjugales, en y consacrant une nouvelle subdivision.
La détresse des Français de l’étranger victimes de violences conjugales, dont j’ai parfois pu être témoin, est d’autant plus grande qu’ils résident hors du territoire national. Elle est accrue par cet isolement de fait, sans compter la fragilité de ces personnes, souvent liée à leur statut migratoire.
Pourtant, sur un sujet aussi grave, nous ne disposons que de très peu d’informations. L’objet de cet amendement est donc d’obtenir des données chiffrées, ainsi qu’un suivi du sujet, tout en évitant la rédaction d’un nouveau rapport.
Une meilleure connaissance de cette question permettra une prise de conscience nécessaire à la mise en place d’un accompagnement plus encadré des Français établis à l’étranger victimes de violences conjugales.

Chaque année, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères rend public un rapport sur la situation des Français établis hors de France. Le présent amendement vise à ce que ce rapport comporte désormais des développements consacrés aux violences conjugales chez ces derniers, qui sont aussi concernés par ce phénomène.
L’idée est intéressante. Au reste, je note que des éléments sur la sécurité des Français établis à l’étranger figurent déjà dans ce rapport. Les violences au sein du couple constituent un facteur majeur d’insécurité. Il est donc légitime de consacrer des développements à cette question importante.
L’avis de la commission est par conséquent favorable.

Je trouve évidemment que la demande de M. Regnard est intéressante, mais la réaction de Mme la rapporteure et de Mme la secrétaire d’État ne manque pas de m’étonner.
Un collègue, tout à l’heure, a parlé de cohérence. En l’occurrence, je me demande où est la cohérence : on ne veut pas former les agents diplomatiques à l’accueil des Françaises en situation de violence, mais on veut disposer de statistiques… Il y a là quelque chose qui m’échappe !
Madame la sénatrice, que les choses soient très claires : personne n’a dit que nous ne voulions pas former les personnels diplomatiques. Nous avons dit que cette formation ne relevait pas de la loi. Comme vous le savez très bien, énormément de choses sont faites, qui ne sont pas inscrites dans la loi ! Nous souhaitons évidemment que les personnels soient formés et que l’on avance sur ces questions.
D’ailleurs, l’engagement de Jean-Yves Le Drian sur ces sujets est reconnu dans le monde entier. La France défend notamment des objectifs très ambitieux en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est l’un des trois ou quatre pays dans le monde à porter cette diplomatie féministe. Et elle est reconnue comme telle par l’ONU, puisque nous allons accueillir, en juillet 2021, le Forum Génération Égalité, qui marque les 25 ans de la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin.
Il ne s’agit donc évidemment pas de dire que nous n’allons pas former les personnels en poste diplomatique. Il s’agit de dire que cette formation ne relève pas de la loi et de considérer que l’on peut faire un focus sur le sujet au sein d’un rapport annuel qui existe déjà.
Cette position devrait être de nature à vous réjouir, parce qu’elle signifie que, contrairement à ce que vous affirmiez, nous ne laissons pas tomber les personnes expatriées. Au contraire, nous considérons que c’est un sujet d’importance, qui mérite d’être inscrit à l’agenda.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 15.
L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Cartron et MM. Bargeton, Hassani et Lévrier, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des victimes de violences conjugales françaises établies hors de France.
Ce rapport expose notamment :
1° L’accompagnement par les agences consulaires en cas de violences conjugales, l’accès aux numéros dédiés et la formation des agents ;
2° Les démarches potentielles qui pourraient être menées par la France pour aboutir à des accords multilatéraux ou bilatéraux pour améliorer la situation des parents qui ne peuvent revenir en France en raison des règles locales d’autorité parentale ;
3° Les évolutions nécessaires pour que les Français victimes de violence conjugale et établis à l’étranger dans un pays où la loi locale ne prévoit pas d’aide juridictionnelle puissent bénéficier de cette aide dans le cadre de procédures dans le pays de résidence concernant les faits de violences conjugales ;
4° Les possibilités pour que le droit à l’allocation de soutien familial en raison du non-versement d’une pension alimentaire mise à la charge de l’autre parent par décision de justice soit ouvert aux Français établis hors de France.
La parole est à M. Richard Yung.

Cet amendement a pour objet de demander un rapport au Gouvernement. Puisqu’il existe déjà un rapport – celui que M. Regnard a évoqué –, je le retire.

L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
L’amendement n° 22, présenté par Mmes Lepage, Blondin et Monier, MM. P. Joly et Magner, Mmes Guillemot et Féret, MM. Féraud, Lurel et Duran, Mme Tocqueville, MM. Vaugrenard, Manable, Daudigny et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Bonnefoy et MM. Gillé et Mazuir, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de l’intervention du procureur de la République comme partie au procès civil aux affaires familiales en cas de violences intrafamiliales.
La parole est à Mme Claudine Lepage.

Je retire cet amendement, de même que les amendements n° 66, 67 et 68, qui tendent à des demandes de rapports sur des sujets différents.

L’amendement n° 22 est retiré.
L’amendement n° 66, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, était ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, à l’école primaire, au collège et au lycée.
Cet amendement vient d’être retiré.
L’amendement n° 67, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, était ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant des pistes pour la mise en œuvre d’un signalement en ligne pour les victimes de violences, harcèlements et discriminations et d’une application leur permettant de déclencher l’enregistrement de l’infraction et de signaler par géolocalisation les faits en temps réel.
Cet amendement a été retiré.
L’amendement n° 68, présenté par Mmes Lepage et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, était ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport qui évalue le coût des frais médicaux et para-médicaux à la charge des victimes de violences conjugales et de leur éventuelle prise en charge intégrale par la sécurité sociale, que ces violences soient physiques ou morales.
Cet amendement a également été retiré.
L’amendement n° 83, présenté par Mmes Cohen, Benbassa, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de généraliser le protocole « féminicide » mis en œuvre en Seine-Saint-Denis.
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Nombre des amendements qui ont été déposés à la fin de ce texte tendent à demander des rapports.
Je veux, pour ma part, aborder une question concernant le « protocole féminicide » qui est mis en œuvre en Seine-Saint-Denis. Ce dispositif expérimental et unique en France prévoit que, à la suite d’un féminicide ou d’une tentative d’une particulière gravité, le procureur de la République prenne en urgence une ordonnance de placement provisoire des enfants. Ceux-ci sont confiés au service de l’aide sociale à l’enfance pour évaluation et hospitalisés dans le service de pédiatrie du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger d’Aulnay-sous-Bois pour une durée de trois à huit jours, avec des droits de visite suspendus pendant cette durée.
Nous l’avons dit, 60 % des enfants qui sont témoins de violences conjugales présentent des troubles de stress post-traumatique. En cas de féminicide, ce taux atteint 100 %.
Afin de protéger les enfants et de prévenir l’apparition de troubles du comportement, un partenariat original a été mis en place, en 2014, dans le département de la Seine-Saint-Denis, entre le parquet du tribunal de grande instance de Bobigny, le centre hospitalier Robert-Ballanger et le conseil départemental, via l’Observatoire départemental des violences envers les femmes et le service de l’aide sociale à l’enfance.
Une fois que ces enfants sont présentés dans le service de pédiatrie, une évaluation somatique et psychologique est effectuée par les intervenants du service, qui sont tous formés à la victimologie. Le service de pédopsychiatrie se charge également d’assurer l’interface avec le tribunal, la police et les professionnels des services de protection de l’enfance. Il garantit aussi le suivi de l’enfant après la sortie de l’hôpital, soit en poursuivant les soins, parfois durant plusieurs années, dans l’unité spécialisée d’accompagnement du psychotraumatisme de l’hôpital Robert-Ballanger, soit en organisant le relais thérapeutique auprès d’une autre unité spécialisée.
Cette expérience, qui a fait ses preuves en matière de prise en charge thérapeutique des enfants ayant subi un tel traumatisme, mériterait d’être étendue à d’autres départements, alors que le schéma départemental d’aide aux victimes compte la lutte contre les violences conjugales parmi ses priorités.
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, qui vise tout simplement à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, sur la possibilité de généraliser le protocole féminicide.
Il s’agit, en réalité, d’encourager l’extension de cette expérience très positive sur d’autres parties du territoire.

Ce protocole est effectivement extrêmement intéressant, mais, comme l’indiquent les auteurs de l’amendement, il est expérimental. Il faudrait qu’il soit évalué avant d’être généralisé.
Plutôt qu’un rapport, nous préférons demander au Gouvernement de quels éléments d’évaluation il dispose.
Nous souscrivons évidemment à l’exemplarité de la Seine-Saint-Denis en matière de lutte contre les violences conjugales. Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, d’autres membres du Gouvernement et moi-même nous sommes d’ailleurs rendus à trois reprises à l’hôpital Ballanger.
Le Grenelle contre les violences conjugales a notamment servi à relever les bonnes pratiques que nous pouvons généraliser sur le territoire. Nous avons d’ailleurs commencé à le faire concernant un certain nombre de points du protocole féminicide. Nous en retrouvons aussi des éléments dans cette proposition de loi et dans les autres mesures issues du Grenelle. Je pense, par exemple, à la grille d’évaluation du danger ou à la « roue des violences », qui sont directement inspirées des travaux qui ont été menés en Seine-Saint-Denis.
Pour conclure, je veux dire que le groupe de travail du Grenelle contre les violences conjugales consacré aux violences intrafamiliales, qui associe différentes administrations, sous le pilotage de la direction générale de la cohésion sociale, et qui compte notamment, en son sein, des personnes éminemment engagées en Seine-Saint-Denis, est en train de travailler sur le sujet.
Nous sommes défavorables à la production du rapport que vous demandez, lequel ne viendrait que confirmer ce que vous venez de dire, madame la sénatrice.
En revanche, nous sommes favorables à ce que l’analyse de cette expérimentation se poursuive et à ce que l’on travaille à la manière d’étendre le protocole, y compris en termes de moyens et de partenariats avec les conseils départementaux, les autres collectivités et les différents acteurs sur place.

L’objet de l’amendement était d’abord de faire connaître cette expérience à l’ensemble des collègues ici présents.
Ayant participé, comme d’autres parlementaires, à la clôture du Grenelle, je pense qu’il est important de s’appuyer sur les bonnes pratiques, de les soutenir et d’essayer de les élargir à d’autres territoires.
Dès lors que le Gouvernement partage cet objectif, je retire mon amendement, madame la présidente.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Nous allons voter cette proposition de loi. Pour autant, la tâche devant nous reste grande et je déplore que bon nombre des amendements que nous avons présentés n’aient pas été acceptés par le Gouvernement ou par le Sénat, même si ce dernier en a adopté plusieurs, ce qui est une bonne chose.
Ce texte ne rompt pas avec la philosophie de la justice en matière de violences conjugales. Je regrette qu’il ne tienne pas compte des vingt-quatre recommandations transmises à la garde des sceaux après le rapport de l’inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux.
Surtout, ce texte ne rompt pas avec la philosophie selon laquelle, en toutes circonstances, on cherche toujours à maintenir le lien avec le père. Les droits du père l’emportent toujours sur la protection de la mère et des enfants. Je regrette que l’on n’ait pas décidé d’encadrer davantage le travail des juges au regard de ce que nous considérons aujourd’hui comme un dysfonctionnement dans la protection des victimes de violences conjugales et de féminicides.
Nous voterons donc cette proposition de loi, même si nous n’avons pas l’impression d’avoir participé à une grande œuvre législative. Nous allons voter un texte tout en ignorant quels moyens lui seront assortis. À cet égard, les demandes des associations n’ont toujours pas été entendues. Il s’agit probablement d’un moment de la vie parlementaire entre deux textes sur la lutte contre les féminicides.

Le groupe Union Centriste votera ce texte. Je tiens à remercier Mme la rapporteure, chère Marie Mercier, M. le président de la commission des lois et tous les membres de la commission qui ont travaillé à l’amélioration de ce texte venu de l’Assemblée nationale. Je remercie également les ministres qui sont passés cet après-midi et avec qui nous avons pu débattre.
Comme Mme Rossignol, je regrette que notre hémicycle n’ait pas été suffisamment convaincu pour adopter un certain nombre d’amendements qui embrassaient beaucoup de sujets, à l’instar de ce texte.
L’inflation législative de ces derniers mois va peut-être se poursuivre, ce qui permettra de nouveaux débats parlementaires sur la parentalité, l’inceste, la prostitution des jeunes, la formation des acteurs, l’accompagnement des victimes, la sortie des parcours des agresseurs, la médiation, l’ordonnance de protection… Les sujets ne manquent pas.
Nous visons tous les mêmes objectifs et ne réussirons qu’ensemble. Nous devons nous entendre sur les moyens d’y arriver. Nous atteindrons nos objectifs à condition de disposer d’un arsenal législatif cohérent et complet, à condition que les lois que nous votons soient appliquées uniformément sur le territoire – et ce n’est pas qu’une question de guides et de fiches pratiques –, à condition d’une volonté politique sincère et de budgets suffisants pour la mettre en œuvre.
Travaillons ensemble pour réunir ces conditions et protéger ainsi les victimes de violences conjugales. J’associe à mon propos Dominique Vérien, chef de file de mon groupe sur ce texte.

Comme chaque fois que nous abordons la question des droits des femmes, notamment celle des violences faites aux femmes, le débat a été passionnant.
On voit le chemin parcouru et les évolutions ; on voit aussi les résistances qu’il reste à combattre. Comme je l’ai déjà souligné, je regrette que l’on aborde la question des violences faites aux femmes à travers une succession de textes parcellaires. Je réitère la proposition de mon groupe d’élaborer une loi-cadre qui rassemblerait toutes les problématiques et qui traiterait du travail éducatif de prévention et d’accompagnement.
Nous assistons à une prise de conscience très forte de la société, laquelle réalise que le système patriarcal est à l’origine des violences faites aux femmes. C’est ce système qu’il faut combattre pour en débarrasser la société. Cela passe effectivement par un budget important. Le travail que nous menons ensemble, au sein de la Haute Assemblée, avec nos différences et nos divergences, ne doit pas porter atteinte aux politiques publiques, mais plutôt viser à les renforcer et à accorder un budget digne de ce nom au secrétariat d’État chargé de ces questions, dont je souhaiterais d’ailleurs qu’il devienne un ministère de plein exercice dédié aux droits des femmes.
Malgré les déclarations faites au plus haut niveau – c’est toujours une bonne chose que le Président de la République s’exprime sur ce sujet –, les actes concrets ne sont pas au rendez-vous des engagements. Je le regrette.
Nous avons fait un petit pas. Nous allons également voter en faveur de cette proposition de loi, comme l’avait annoncé en discussion générale Esther Benbassa, qui pilotait ce texte au nom de notre groupe.

Madame la présidente, j’ai déjà annoncé lors de la discussion générale que mon groupe voterait ce texte. Je prends la parole non pas pour le répéter, mais pour mais pour me féliciter de la qualité de nos débats, en commission et en séance publique. Madame la rapporteure y est pour beaucoup.
Le Sénat a tenu son rôle en enrichissant ce texte. Nous sommes loin d’avoir épuisé tous les sujets qui ont été abordés, mais il n’y a pas si longtemps de cela, la question des violences conjugales était négligée. Nous nous en préoccupons beaucoup plus et il faudra certainement y consacrer encore bien des propositions de loi et des projets de loi.
La présente proposition de loi est une nouvelle pierre à cet édifice qui demandera encore énormément de temps avant d’être achevé. Je tiens à remercier tous ceux qui y ont contribué, à commencer par Mme la rapporteure et les membres du Gouvernement.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je veux vous remercier de ce travail collectif qui a permis quelques avancées, notamment sur l’ordonnance de protection, sur le bracelet anti-rapprochement et sur l’accès des mineurs aux sites pornographiques. Sur cette dernière question, vous aurez compris combien l’amendement que j’ai défendu me tenait à cœur.
Tout ce qu’il est possible de faire pour protéger les femmes et les enfants, faisons-le ensemble. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».
Applaudissements.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 10 juin 2020 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze et le soir :
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (texte de la commission n° 479, 2019-2020) ;
Projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires (procédure accélérée ; texte n° 491, 2019-2020).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 10 juin 2020, à une heure dix.