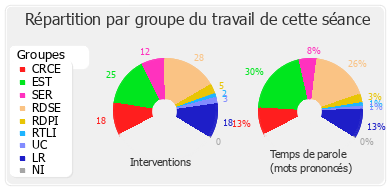Séance en hémicycle du 5 juillet 2021 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

La séance est reprise.

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour du mercredi 21 juillet, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, en lieu et place de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et sur le projet de loi organique modifiant la loi du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Acte est donné de cette demande.

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour renforcer la prévention en santé au travail.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 2.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A
1° Le 2° de l’article L. 2312-27 est ainsi rédigé :
« 2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l’article L. 4121-3-1. » ;
2° L’article L. 4121-3 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : «, dans l’organisation du travail » ;
a) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, conformément au 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés ;
« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur est affilié.
« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « par les dispositions réglementaires prises » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 4121-3, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121 -3 -1. – I. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
« II. – L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
« III. – Les résultats de cette évaluation débouchent :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :
« a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
« b) Identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
« c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention et de protection. La liste de ces actions peut être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
« III bis
« IV. – A. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d’État.
« B
« Sont arrêtés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail, selon des modalités déterminées par décret :
« 1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 2° Les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique.
« En l’absence d’agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B, les mesures d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du premier alinéa du même B sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :
« a) À compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
« b) À compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
« V. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail auquel il est affilié, à chaque mise à jour. »

L’amendement n° 44, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’employeur évalue également les facteurs de risques psychosociaux. » ;
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Les signataires de l’ANI, l’accord national interprofessionnel, que cette proposition de loi est censée transposer, ont souhaité que la prévention des risques professionnels porte également sur les risques psychosociaux liés à l’activité professionnelle, pour prendre en compte tant la santé physique que la santé mentale des travailleurs.
Depuis plusieurs années, les études montrent que ces risques et leurs incidences sur la santé des travailleurs peuvent concerner toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.
Avec la pandémie, l’importance et la visibilité des risques psychosociaux se sont accrues : en mai 2020, ils sont devenus la deuxième cause d’arrêt de travail, soit 12 % des arrêts, après la covid-19 et devant les troupes musculo-squelettiques.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose donc, par cet amendement, d’inclure l’analyse des facteurs de risques psychosociaux, notamment liés aux organisations du travail, auxquels sont exposés les salariés dans l’évaluation des risques dont l’employeur a la responsabilité.

Je voudrais tout d’abord rassurer notre collègue : la commission des affaires sociales est pleinement consciente de l’importance et de la recrudescence des risques psychosociaux.
Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare je me console… En 2019, avec Pascale Gruny, je m’étais rendu au Danemark, et nous y avions constaté les mêmes difficultés qu’en France. Sans nous consoler vraiment, cela montre au moins que tous les pays ont du mal à répondre de manière satisfaisante à la question des risques psychosociaux.
Les risques professionnels font bien évidemment déjà partie du champ de l’évaluation des risques professionnels que doit conduire l’employeur. En outre, l’article L. 4121-1 du code du travail, qui définit l’obligation de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail, prévoit déjà que celui-ci doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Dès lors, nommer les risques psychosociaux n’apportera aucune valeur ajoutée d’un point de vue législatif. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Les arguments de M. le rapporteur sont très clairs.
Madame la sénatrice, je vous le confirme, l’évaluation des risques psychosociaux fait déjà partie des responsabilités de l’employeur dans le document unique.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 43 est présenté par Mmes Taillé-Polian et Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.
L’amendement n° 83 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « tient compte de la charge de travail par salarié et de la pénibilité de son poste. Elle » ;
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 43.

La législation relative à la reconnaissance de la souffrance au travail est au point mort depuis de nombreuses années, malgré l’explosion du nombre de maladies professionnelles nouvelles.
À l’image de la recrudescence de phénomènes de burn-out, de bore-out, ou encore de la résurgence de risques psychosociaux depuis le confinement soudain des Français, le législateur aurait eu matière à agir pour mieux protéger celles et ceux qui travaillent.
Nous regrettons que cette proposition de loi, pourtant le premier véhicule législatif sur la santé au travail depuis des années, ne parle précisément pas de la souffrance au travail et de ses causes profondes, notamment en s’attaquant à l’intensification de la charge de travail et à la grande pénibilité de certaines professions.
Cet amendement vise à permettre aux services de prévention et de santé au travail, ou SPST, des entreprises de prendre en compte la charge de travail des salariés et la pénibilité de leur poste dans les évaluations des risques professionnels.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 83.

Les auteurs de cet amendement proposent que les services de prévention et de santé au travail des entreprises tiennent compte, dans les évaluations des risques professionnels, de la charge de travail des salariés et de la pénibilité de leur poste.
Il apparaît nécessaire d’adapter les mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs en fonction du sexe, eu égard aux conséquences différenciées qu’un même risque peut entraîner selon les individus.
Dans le monde du travail, plusieurs facteurs de risque favorisent la survenance de violences sexistes et sexuelles : conditions de travail précaires, qui se traduisent notamment par des contrats à durée déterminée ou par des contrats temporaires, appartenance à un certain groupe social – femmes, migrantes, personnes LGBT, ou lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres…
En vue de prévenir efficacement une quelconque atteinte aux droits de leur personne, y compris les violences sexistes et sexuelles, il est essentiel que l’employeur tienne compte de la situation spécifique de ces travailleurs dans le cadre de l’évaluation des risques pour leur santé et leur sécurité, afin de mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées et effectives.

Le champ de l’évaluation des risques professionnels comprend déjà les risques associés à la configuration des postes de travail.
L’employeur est ainsi appelé à prendre en compte la répartition de la charge de travail, de même que les différents facteurs de pénibilité qui majorent les risques pour la santé, comme les contraintes physiques marquées, l’environnement physique agressif, le travail de nuit ou encore le travail répétitif.
Ces amendements étant satisfaits, la commission sollicite leur retrait ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Comme l’a souligné le rapporteur, cette question est déjà traitée dans le document unique.
Mon avis est donc également défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 81, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Après le mot :
Apportent
insérer les mots :
obligatoirement et préalablement
II. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, selon un calendrier précis et négocié. Un suivi de la mise à jour du document unique est organisé lors de sa mise à jour ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Le document unique prévu à cet article pour recenser les risques professionnels dans l’entreprise est un document important, à condition que le comité social et économique, le CSE, contribue systématiquement et préalablement à son élaboration.
Depuis la fusion, en 2017, des délégués du personnel, des comités d’entreprise et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, en une instance unique, les prérogatives des représentants des salariés ont été profondément réduites. On leur demande toujours plus avec de moins en moins de moyens…
Il semble nécessaire, a minima, de permettre au comité social et économique de contribuer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques. Il convient de mettre en place un réel suivi des mesures de protection des salariés.

La loi est déjà impérative dans sa formulation. L’adverbe « obligatoirement » ne se justifie donc pas.
Par ailleurs, l’évaluation des risques professionnels est un processus continu au sein de l’entreprise : le CSE doit ainsi y contribuer, en application de l’article L. 2312-9 du code du travail, en amont de la finalisation du DUERP par l’employeur.
Il sera également systématiquement consulté sur le document unique et ses mises à jour et pourra formuler des observations. Il n’est donc pas nécessaire de préciser qu’il sera sollicité « préalablement » à l’évaluation des risques professionnels, car tel est bien le cas, au regard tant du droit que de la pratique.
En outre, il n’est pas opportun de formaliser à l’excès le processus de consultation du CSE par l’employeur en imposant la définition d’un calendrier négocié : sachons faire confiance à l’esprit de dialogue au sein des entreprises sur des sujets qui doivent rassembler la communauté de travail.
Enfin, nous saisissons mal ce que les auteurs de cet amendement entendent par : « Un suivi de la mise à jour du document unique est organisé lors de sa mise à jour »…
S’il s’agit de rappeler que le bilan du DUERP doit être dressé à chaque mise à jour, c’est un principe qui vaut déjà en pratique : chaque réactualisation de l’évaluation des risques tiendra compte de l’évaluation passée.
Attention de ne pas confondre le DUERP et les actions qui doivent en découler : ces dernières seront déclinées, soit dans le programme annuel de prévention, qui comprendra d’ailleurs des indicateurs de résultat pour tirer le bilan de leur mise en œuvre, soit – pour les plus petites entreprises – dans une liste d’actions de prévention et de protection.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Je n’ai rien à ajouter !
J’émets le même avis défavorable, madame la présidente.

Je n’ai pas du tout été convaincue par le rapporteur, qui parle de consultations et d’observations.
J’en prends bonne note, mais nous proposons une élaboration commune, une véritable coproduction, fondée sur un pouvoir de décision du CSE, et non sur de simples observations ou consultations, ce qui est très différent.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 84, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
À ce titre, il répertorie la liste des salariés exposés à des agents chimiques dangereux. Pour ces derniers, l’employeur établit une fiche individuelle d’exposition dont les modalités sont déterminées par décret.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

La réglementation européenne impose à l’employeur de garantir une traçabilité individuelle des risques chimiques auxquels sont exposés les salariés, notamment par l’établissement d’une liste actualisée des travailleurs concernés et en répertoriant la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents chimiques.
À la suite des ordonnances Travail de 2017, l’employeur n’est plus tenu à ces deux obligations, alors que le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux ou cancérigènes concerne 12 % des salariés français.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à rétablir l’obligation de l’employeur de tenir à jour une liste des salariés exposés à des agents chimiques dangereux, ainsi que l’obligation d’établir une fiche individuelle d’exposition pour chaque salarié concerné.

Les travailleurs exposés à une série de facteurs de pénibilité, dont des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, continuent d’être déclarés systématiquement par l’employeur au service de santé au travail.
Ces travailleurs font également l’objet d’un suivi individuel renforcé, avec un examen médical à l’embauche, renouvelé au moins tous les quatre ans, et avec, dans l’intervalle, une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé, au plus tard deux ans après la dernière visite du médecin du travail.
Enfin, la commission a renforcé, à l’article 12, les données d’exposition qui devront être consignées dans le dossier médical de santé au travail, le DMST, par les professionnels de santé des SPST.
Dans la mesure où les objectifs des auteurs de cet amendement semblent déjà satisfaits par le droit en vigueur et par les apports du texte, la commission émet un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.
Permettez-moi de compléter, pour une fois, les propos, en général exhaustifs, de M. le rapporteur.
Nous partageons la volonté de mieux prévenir le risque chimique, madame la sénatrice. En 2017, 32 % des salariés des secteurs privé et agricole, soit un sur trois, étaient exposés à des agents chimiques dangereux. Vous avez souligné l’importance de ce sujet.
S’agissant du DUERP, le sujet de la traçabilité progressera de façon collective – nous l’avons évoqué à plusieurs reprises. La question de la traçabilité individuelle, au sujet de laquelle je me suis exprimé à l’Assemblée nationale à l’occasion d’une question au Gouvernement, sera abordée dans le cadre du chantier de la réglementation sur le risque chimique que le Gouvernement s’est engagé à ouvrir en septembre, en concertation avec les partenaires sociaux.
Je ne souhaite pas préjuger aujourd’hui des travaux de ces derniers, mais je leur envoie toutefois un message d’espoir.
Pour l’heure, je vous invite à retirer votre amendement, madame la sénatrice.

Je maintiens cet amendement, madame la présidente.
Nous attendons bien sûr les travaux que M. le secrétaire d’État vient d’annoncer. Toutefois, rien n’est fait à l’heure actuelle, et nous souhaitons que la question de la traçabilité, à nos yeux très importante, soit sécurisée.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 139, présenté par Mme Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, l’aide du service de prévention et de santé au travail, le concours du salarié référent ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
II. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces méthodes et ces documents ne peuvent se substituer à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention dans l’entreprise.
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Pour éviter que cet article ne serve de fondement à un transfert de responsabilité, il doit être rappelé que les différentes contributions, qu’elles proviennent du comité social et économique, des SPST ou des salariés référents, ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur pour ce qui concerne l’évaluation des risques, ainsi que la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention. Il doit veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires.

L’amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, du salarié référent et du service de prévention et de santé au travail, ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Cet amendement est relatif à la responsabilité de l’employeur.
L’article 2 consacre dans la loi le DUERP, en actualisant ses contenus et en élargissant ses conditions d’élaboration, de conservation et de mise à disposition. C’est une avancée.
Cependant, sa rédaction actuelle suscite la crainte, relayée par le collectif Prévention AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles), qui regroupe des salariés des services de prévention, d’un risque de transfert ou, du moins, d’une dilution de la responsabilité personnelle de l’employeur, qui serait transférée vers le comité social et économique, le salarié référent et, surtout, le service de prévention et de santé au travail.
Dans la droite ligne d’une jurisprudence ancienne et constante qui précise qu’il appartient à l’employeur de veiller personnellement à la stricte application, par ses subordonnés, des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel, nous proposons par cet amendement d’inscrire dans la loi que l’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques.
La proposition de loi n’acte aucun droit nouveau pour les salariés. L’employeur garde seul le pouvoir d’organisation ; il doit donc garder seul la responsabilité.
Le collectif Prévention AT-MP, comme les professionnels de la santé au travail, anticipe l’objection que vous nous ferez peut-être : la remise en cause de la responsabilité personnelle de l’employeur serait une crainte infondée.
Toutefois, de nombreux dispositifs ayant été introduits, visant notamment à étendre la contribution du service de prévention et de santé au travail au DUERP, il n’est pas superfétatoire de préciser que cette responsabilité n’est pas partagée pour autant.

Les obligations de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels et de mise en œuvre des actions de prévention et de protection sont déjà largement développées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.
La rédaction de l’article L. 4121-3 proposée par le présent article ne tend nullement à remettre en cause la responsabilité de l’employeur dans ce domaine, puisqu’il est bien précisé que le CSE, les salariés référents en santé et sécurité au travail et le SPST sont mobilisés pour apporter leur aide à l’employeur dans l’évaluation des risques professionnels et non pour se substituer à lui dans cette démarche. Il en va de même pour les méthodes et outils proposés par les organismes et instances de branche afin d’accompagner l’employeur.
Madame Poncet Monge, si vous pouvez considérer qu’il n’y a aucun droit nouveau pour les salariés, je puis vous garantir qu’il n’y a aucune minoration des obligations de l’employeur, et que ce principe fondamental n’a absolument pas été modifié par l’ANI.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le rapporteur s’est exprimé très clairement, et le Gouvernement le rejoint pleinement.
J’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 173 rectifié quater est présenté par MM. Babary, D. Laurent, Savary, Bouloux, Lefèvre, Le Nay et Canévet, Mme Deromedi, M. Burgoa, Mme Berthet, MM. Chatillon et Bouchet, Mme Chauvin, MM. Chasseing, Longeot et Duffourg, Mmes Billon, Estrosi Sassone, Puissat, Thomas, Lassarade, Garriaud-Maylam, Chain-Larché et Raimond-Pavero et MM. Cuypers, Meurant, Wattebled, Moga, Hingray, Genet, Brisson, Bonnecarrère, Gremillet, Duplomb, J.M. Boyer, Klinger, Sido, Mandelli et Cambon.
L’amendement n° 188 est présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 25 à 33
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées à la première phrase du A du présent IV, le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d’une conservation sous forme digitalisée sous la responsabilité de l’employeur. Les conditions relatives à la conservation et à l’accessibilité de ce document, tout particulièrement dans le cas de cessation d’activité de l’entreprise, sont fixées par décret.
« Le document unique d’évaluation des risques professionnels peut être transmis par l’employeur au service de prévention et de santé au travail qui en organise alors l’archivage dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 173 rectifié quater.

L’obligation pour tous les employeurs d’établir un document unique d’évaluation des risques professionnels remonte à près de vingt ans.
Les outils numériques nous permettent désormais de renforcer la conservation de ce document. Pour autant, il est important que les moyens d’assumer cette conservation digitalisée restent de la responsabilité de l’employeur. Le recours à un portail numérique ne paraît donc pas préférable.
Par ailleurs, le cas de cessation d’activité de l’entreprise, bien que non souhaitable, doit être pris en compte. C’est pourquoi nous proposons par cet amendement qu’un décret fixe les conditions relatives à la conservation et à l’accessibilité dudit document unique, notamment dans ce cas précis.
S’agissant enfin de l’archivage, l’amendement tend à prévoir la possibilité pour l’employeur de transmettre le DUERP aux services de prévention et de santé au travail dans des conditions prévues par décret.
Par ces modifications, la conservation et l’archivage de ce document clé seront assurés de manière efficace pour tous les employeurs, au profit des salariés.

Ces deux amendements identiques sont problématiques.
L’ANI a incité les acteurs à dématérialiser l’ensemble des supports. Vos rapporteurs, en voulant être utiles, ont donc prévu la création d’un portail numérique dématérialisé.
Selon nous, l’adoption de ces amendements ne permettrait pas de garantir une conservation pérenne du DUERP – c’est tout de même l’objectif fixé ! – pour en faire un instrument de traçabilité collective, axe essentiel préconisé par l’ANI.
Tout d’abord, ils tendent à revenir sur le principe du dépôt dématérialisé du DUERP sur une plateforme numérique administrée par les organisations patronales. Or sa conservation sous un format digitalisé par l’employeur ne permet pas d’envisager celle-ci sur une durée suffisamment longue pour l’ensemble des entreprises, a fortiori pour une durée minimale de quarante ans, compte tenu de la durée de vie moyenne de nos entreprises.
Que faire, en cas de disparition de l’entreprise, du disque dur ou du serveur sur lequel auront été stockés les DUERP ? Il faut être pragmatique ! À cette difficulté, les dispositions que ces amendements tendent à introduire n’apportent pas vraiment de solution, la rédaction proposée se contentant de renvoyer le problème à un décret.
Nos discussions avec le Gouvernement ont montré que l’administration n’envisageait d’autre solution que celle qui a été adoptée par la commission, sous réserve d’éléments complémentaires qui nous seraient communiqués par M. le secrétaire d’État.
La seule possibilité serait que le portail de dépôt des DUERP soit un jour mutualisé via la plateforme « net-entreprises.fr ». C’est bien sûr le vœu que nous formons.
Ensuite, ces amendements visent à remplacer l’obligation de transmission du DUERP au SPST par une simple faculté, le SPST assumant le cas échéant la responsabilité de l’archivage. Là encore, les difficultés sont multiples.
La transmission du DUERP au SPST ne doit pas être facultative, car ce document est, selon nous, capital pour permettre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire de disposer d’informations complémentaires à la fiche d’entreprise, et retracer, au fil du temps, les risques auxquels les salariés ont pu être exposés.
Enfin, la responsabilité de l’élaboration du DUERP pèse uniquement sur l’employeur. Par conséquent, il n’apparaît pas opportun de transférer aux SPST l’obligation de sa conservation et de sa mise à disposition, dès lors que seul l’employeur reste maître de sa transmission.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Nous avions déjà abordé cette difficulté lors d’une réunion de travail, et je remercie la commission d’avoir cherché des solutions. Pour autant, notre position diverge de celle de M. le rapporteur : je suis en effet favorable à l’amendement qui vient d’être défendu par M. Lévrier.
Sur le fond, nous poursuivons le même objectif : nous devons trouver la meilleure façon de conserver ces documents, de façon très opérationnelle.
Une part importante de la solution relèvera du décret. Je pense notamment à la possibilité d’avoir recours aux entreprises en la matière.
Pour ma part, je soutiens cet amendement, tout en vous indiquant, monsieur le rapporteur, comme je l’indiquerai au rapporteur de l’Assemblée nationale, que je suis prêt à ouvrir le champ des possibles et à vous associer à la recherche d’une solution. J’en suis en effet tout à fait conscient, l’article 40 de la Constitution a certainement bloqué l’avancement de votre réflexion. Il s’agit d’une sorte d’appel du pied !
Certes, nous avons une divergence concernant l’outil à utiliser, mais nous poursuivons le même objectif. J’ai bien compris votre idée, monsieur le rapporteur, et je la trouve intéressante.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 173 rectifié quater et 188.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 46, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il y annexe également, avec l’accord du comité social et économique, l’analyse des risques professionnels mentionnée au 1° de l’article L. 2312-9.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Cet amendement vise à intégrer l’avis du CSE aux éléments que l’employeur se doit de transcrire dans le DUERP.
L’article 2 prévoit de renforcer l’implication du CSE, des salariés référents et des services de prévention et de santé au travail dans l’élaboration du DUERP.
Il précise que ces acteurs contribuent à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise, et que le comité social et économique est consulté sur le DUERP et ses mises à jour.
Consulter les représentants du personnel quant à l’évaluation des risques professionnels contribue effectivement à la qualité du dialogue social et à la pertinence du programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Toutefois, cet avis n’est pas contraignant.
Il paraît donc nécessaire qu’il soit a minima public et accessible aux salariés, et pas seulement dans un compte rendu du CSE très vite oublié !
Afin de garantir une meilleure visibilité et une meilleure traçabilité, nous proposons donc par cet amendement que l’avis du CSE ainsi consulté soit intégré aux éléments que l’employeur se doit de transcrire dans le DUERP.

L’avis de la commission est défavorable.
L’analyse des risques professionnels réalisée par le CSE ou son avis sur le DUERP, puisque le CSE est consulté par l’employeur, pourront être mis à la disposition des travailleurs dans des conditions définies par le règlement intérieur du CSE.
Par ailleurs, si l’élaboration du DUERP s’inscrit dans une démarche de consultation des instances de dialogue social de l’entreprise, il s’agit d’un document dont la responsabilité incombe au seul employeur, qui doit rester maître de son contenu.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 135, présenté par Mme Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Remplacer les mots :
et instances
par les mots :
professionnels de prévention
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Les rapporteurs ont souhaité introduire un accompagnement par les branches professionnelles dans l’élaboration et la mise à jour des DUERP. Une telle démarche est intéressante, mais la désignation des acteurs susceptibles d’intervenir est beaucoup trop floue.
Cet amendement vise donc à préciser celle-ci. Il s’agit de s’assurer que, conformément au modèle du BTP, seuls des organismes relevant du champ de la prévention peuvent effectuer cet accompagnement.

La précision que vous souhaitez introduire, ma chère collègue, aurait pour effet d’exclure de l’accompagnement des entreprises dans l’évaluation des risques professionnels des instances qui pourraient être constituées à l’avenir par les branches et qui ne disposeraient pas du statut législatif d’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, dont seul bénéficie aujourd’hui l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Or l’ANI du 9 décembre 2020 invite justement toutes les branches à mettre en place des lieux de discussion paritaire sur les questions de santé et de sécurité, tels qu’une commission paritaire dédiée à la santé et à la sécurité au travail, en particulier quand leur comité technique national et les autres instances existantes ne permettent pas de répondre totalement aux besoins.
De notre point de vue, il est donc nécessaire de conserver la possibilité de mobiliser de telles instances, dont la constitution est préconisée par l’ANI.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Pour conforter vos propos, monsieur le rapporteur, je dirai que plus les branches professionnelles s’investiront dans les questions de santé et de sécurité au travail, plus la prévention progressera.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ANI invite les branches à agir en ce sens. Ne rigidifions pas les choses ! Selon moi, cette proposition de loi contient d’ores et déjà une partie, si ce n’est la totalité, de la réponse à votre demande.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 140, présenté par Mme Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 24, première phrase
Remplacer les mots :
tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de
par les mots :
remis aux travailleurs, aux anciens travailleurs ainsi qu’à
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Dans sa version actuelle, l’article 2 de la proposition de loi prévoit que le DUERP et ses versions successives sont tenus à la disposition des travailleurs et des anciens travailleurs.
Une telle disposition ne correspond pas tout à fait à l’esprit de l’accord national interprofessionnel sur la santé au travail.
En effet, l’accessibilité au DUERP par le salarié ayant quitté l’entreprise, prévue au 1.2.1.2 de l’ANI, doit permettre au salarié qui a quitté l’entreprise de constituer un dossier de maladie professionnelle en s’aidant du DUERP.
En ce sens, une simple tenue à disposition ne suffit pas : le document doit être remis à l’ancien salarié, comme cela est proposé par cet amendement.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit effectivement la mise à disposition du DUERP auprès des anciens travailleurs. Or cette mise à disposition n’exclut pas, en soi, la remise, en fonction des situations, d’une copie du document.
Aujourd’hui, le DUERP doit être mis à la disposition de l’inspection du travail ou des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat). On peut imaginer que, dans le cadre des contrôles, cette mise à disposition vaut remise du document ou de sa copie à ces instances. Par conséquent, une telle précision ne nous paraît pas nécessaire.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 47, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 24, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un extrait du document est remis à tout ancien travailleur qui en fait la demande, dans des conditions définies par décret.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Je suis désolée de le dire, une mise à disposition n’est pas équivalente à la remise d’un document.
Le présent amendement, tout comme le précédent, tend à compléter l’article 2. Il vise à garantir la remise du DUERP à toute personne qui en ferait la demande. En effet, il ne suffit pas de permettre à un ancien travailleur de consulter ce document dans l’entreprise.
Dans sa version actuelle, l’alinéa 24 prévoit que le DUERP et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs – il faut entendre ce que cela signifie ! –, des anciens travailleurs, ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier un intérêt à y avoir accès.
Le syndicat CFE-CGC, qui est signataire de l’ANI, nous a alertés sur le fait que cette rédaction ne correspond pas totalement à l’esprit de l’accord national interprofessionnel sur la santé au travail.
Dans la mesure où vous avez le souci de respecter en tout point l’équilibre de la négociation collective, je pense que vous serez attentif à ce point.
En effet – il convient de le rappeler –, l’accessibilité au DUERP par les salariés après qu’ils ont quitté l’entreprise, prévue au 1.2.1.2 de l’ANI, doit leur permettre de constituer éventuellement un dossier de maladie professionnelle en s’aidant du DUERP, lequel retrace les expositions aux risques professionnels.
En ce sens, une simple tenue à disposition du document ne suffit pas. Tout ancien travailleur qui en fait la demande doit se voir remettre un extrait du document unique. Tel est le sens de cet amendement.

Même avis défavorable que précédemment. Cet amendement est déjà satisfait.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 48, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer le mot :
quarante
par le mot :
cinquante
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

L’exercice auquel je m’astreins peut paraître quelque peu stérile !
Dans sa version actuelle, l’alinéa 24 de l’article 2 prévoit que le DUERP et ses versions successives sont conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs, ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier un intérêt à y avoir accès, et ce pour une durée qui ne peut être inférieure à 40 ans.
Si la mention d’une durée minimale de conservation constitue une avancée, la durée retenue, de 40 ans, nous semble trop courte.
En effet, l’âge de départ à la retraite – nous le regrettons ! – est progressivement reculé, si bien que le nombre d’années requises pour une retraite à temps plein est désormais de 42 ans. La durée de conservation du DUERP devrait tenir compte de ces paramètres, certes régressifs, mais effectifs.
Par ailleurs et principalement, dans l’esprit de l’ANI, l’accessibilité au DUERP vise à permettre aux salariés de constituer éventuellement – nous l’avons déjà signalé – un dossier de maladie professionnelle. Il est donc indispensable que la durée de conservation garantisse l’accès à ce document, y compris aux ayants droit des salariés décédés. Je vous le rappelle, les accidents du travail font plus de 500 morts par an !
Nous proposons donc, par cet amendement, d’allonger la durée de conservation du DUERP, en la portant à 50 ans, au lieu des 40 ans prévus par la rédaction actuelle de l’article 2.
Cette durée tient compte de la remarque formulée par M. le rapporteur en commission. Celui-ci avait en effet indiqué que les dossiers médicaux des travailleurs exposés aux risques chimiques et nucléaires devant être conservés pour une durée minimale de 50 ans, la durée de 60 ans, que nous avions proposée initialement, était trop importante.
Les risques chimiques étant l’un des facteurs de risques les plus importants, souvent reconnus avec beaucoup de retard, nous vous proposons donc, mes chers collègues, de retenir une durée de 50 ans.

La durée de 40 ans se justifie par le délai de latence de certaines pathologies dues à l’exposition à des agents dangereux, notamment chimiques. Certains cancers peuvent en effet apparaître 35 ans après la fin de l’exposition.
En outre, la durée de 40 ans correspond en moyenne à la durée d’une carrière professionnelle. À l’inverse, la durée de 50 ans nous paraît excessive.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Permettez-moi d’ajouter un élément auquel vous devriez être sensible, madame la sénatrice. L’article 15 de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail prévoit une conservation des données relatives à ces risques pour une durée de 40 ans après l’exposition.
Dans la mesure où nous devrions pouvoir partager cette référence, je vous invite, madame la sénatrice, à bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Nous soutenons l’amendement de notre collègue.
En effet, de nombreux salariés, une fois qu’ils ont pris leur retraite, découvrent qu’ils ont un cancer. C’est notamment le cas, dans mon département, pour les « cancers de l’amiante ». Je suis donc favorable à un délai de 50 ans.
Les carrières s’étalent aujourd’hui sur 42 ans, 43 ans, voire 44 ans pour les salariés ayant démarré jeunes. Or malheureusement, c’est souvent à la fin de leur carrière qu’ils découvrent qu’ils ont une maladie grave.

Pour ma part, j’ai travaillé dans une entreprise qui a dû reconnaître le préjudice d’anxiété du fait d’une problématique liée à l’amiante.
Vous évoquez une durée de 40 ans après l’exposition. Mais si l’exposition a lieu au cours des 10 dernières années de la carrière, cette durée n’est pas suffisante !
De fait, pour ce qui concerne les cancers liés à l’amiante, mais pas seulement, les tableaux professionnels évoquent une période de latence pouvant aller bien au-delà.
Le risque chimique ne concerne pas uniquement le monde industriel. Il touche aujourd’hui de très nombreuses activités, y compris dans le secteur tertiaire. Il est incroyable de ne pas le prendre en compte !
Les effets de l’exposition à ce risque peuvent se manifester après un délai de 50 ans. Par conséquent, du fait de sa fréquence dans tous les secteurs – le secteur agricole, le secteur secondaire et le secteur tertiaire – soyons prudents et retenons une durée de 50 ans.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 est adopté.

L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mmes Taillé-Polian et Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4121-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4121-2-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4121 -2 -…. – Les actions de prévention prévues à l’article L. 4121-1 comprennent par ordre de priorité :
« 1° Des actions de prévention primaire visant à supprimer ou à réduire les risques d’atteinte à la santé d’origine professionnelle en agissant le plus en amont possible sur les plans organisationnel, technique et humain ;
« 2° Des actions de prévention secondaire visant à agir le plus précocement possible sur les risques à partir des actions de suivi et de dépistage ;
« 3° Des actions de prévention tertiaire visant à limiter les conséquences des dommages et à favoriser le maintien dans l’emploi. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Les actions de prévention au travail pâtissent de leur méconnaissance par de nombreux employeurs. Dans certains cas, il en résulte une défaillance dans l’organisation générale de la prévention, parfois jugée optionnelle, et l’absence de mesures particulières adaptées aux situations vécues par les salariés.
Vous le savez, mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. C’est pourquoi cet amendement vise à définir les trois piliers de la prévention – primaire, secondaire et tertiaire – dans le code du travail. Cette définition aidera le législateur à formuler plus clairement son intention pour chaque type de prévention.

Cet amendement vise à inscrire dans le code du travail les définitions des préventions primaire, secondaire et tertiaire.
Une telle classification est évidemment pertinente et couramment utilisée par les professionnels de la prévention. Les partenaires sociaux signataires de l’ANI ne se sont d’ailleurs nullement interrogés quant aux différences entre préventions primaire, secondaire et tertiaire.
Selon moi, cette terminologie est acquise par tous. La loi n’a pas forcément vocation à informer les employeurs, ni même à aider le législateur à mieux définir ce qu’il souhaite.
En outre, nous ne mesurons pas tout à fait la portée de ces ajouts législatifs, en ce qui concerne notamment l’obligation de moyens et la responsabilité des employeurs. Bien évidemment, nous partageons l’objectif de renforcer la prévention dans ses différentes dimensions, notamment la prévention primaire dont la définition ne fait aucun doute. Pour autant, je considère que sa promotion ne doit pas se traduire par un excès de normes.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2242-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;
2° Au 2° de l’article L. 2242-13, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;
3° La sous-section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, le mot : « au » est remplacé par les mots: « et des conditions » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 2242-17, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de » ;
c) Il est ajouté un article L. 2242-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242 -19 -1. – La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. »

L’amendement n° 223, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
négociation
insérer les mots :
prévue à l’article L. 2242-17
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 50, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
peut également porter
par les mots :
porte également
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

L’article 2 bis de la proposition de loi prévoit que, lors de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail, les échanges entre l’employeur et les représentants du personnel pourront porter sur la qualité des conditions de travail.
Le syndicat CFE-CGC, signataire de l’ANI, nous a alertés sur le fait que cette rédaction, en faisant de ces échanges une simple possibilité, ne traduisait pas l’esprit de l’accord national interprofessionnel, dont les signataires sont parvenus à trouver un équilibre auquel vous êtes sensibles, monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, et qu’il convient de respecter.
En effet, au 2.2 de l’ANI, les partenaires sociaux sont convenus de revoir l’approche traditionnelle de la qualité de vie au travail afin d’y intégrer les conditions de travail, comme cela avait été initialement prévu par l’ANI sur la qualité de vie au travail de juin 2013.
Par l’un de nos amendements adopté en commission, cette ambition commune a été traduite dans le code du travail par le remplacement, en chacune de leurs occurrences, des termes « qualité de vie au travail » par les termes « qualité de vie et des conditions de travail ».
Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose d’aller jusqu’au bout de cette mise en cohérence de l’article 2 bis de la proposition de loi avec cette ambition de l’ANI, en prévoyant que la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte systématiquement, et non éventuellement, en sus de la liste de thématiques visées à l’article L. 2242-17 du code du travail, sur la qualité des conditions de travail.

Nous pensons au contraire que cette proposition de loi va au bout de ce qui a été prévu dans le cadre de l’ANI.
L’article 2 bis prévoit en effet que les partenaires sociaux « peuvent » négocier en entreprise sur la qualité des conditions de travail lorsque cette négociation s’inscrit dans le cadre des dispositions supplétives du code du travail, c’est-à-dire lorsque les partenaires sociaux n’ont pas conclu d’accord de méthode sur le contenu et la périodicité de la négociation.
Cet amendement, qui a déjà été rejeté par la commission, vise au contraire à rendre ce thème obligatoire. Nous considérons, quant à nous, qu’il n’est pas souhaitable de contraindre excessivement la négociation en entreprise, au-delà des thèmes déjà imposés par le code du travail.
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 51, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de l’organisation du travail
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Permettez-moi d’exprimer mon étonnement quant au sort réservé à l’amendement précédent.
Les signataires de l’ANI – je l’ai dit lors de la discussion générale – nous ont montré qu’en plusieurs endroits du texte l’équilibre obtenu n’était pas respecté. Ce sont ces signataires eux-mêmes qui portent ces amendements dans le but de revenir aux termes de l’ANI, et vous faites comme s’il s’agissait d’un fantasme de notre part ! Peut-être certains d’entre eux finiront-ils par regretter d’avoir souscrit à cet accord…
L’amendement n° 51, comme le précédent, vise à compléter l’article 2 bis, qui prévoit la possibilité d’intégrer la qualité des conditions de travail, notamment la santé et la sécurité au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels à la négociation obligatoire en entreprise.
Les partenaires sociaux signataires, en visant les conditions de travail au 2.2 de l’ANI sur la santé au travail, souhaitaient en effet que « l’approche traditionnelle de la qualité de vie au travail soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail » et inclue ainsi davantage l’organisation du travail.
Le fait de réfléchir et d’agir, dans le cadre des négociations en entreprise, sur l’environnement de travail via la question des conditions de travail, constitue une avancée – nous l’avons pointée. Mais il est indispensable, pour remplir pleinement l’objectif de prévention primaire, d’agir plus nettement sur l’organisation du travail, qui a subi de profondes transformations et peut être une cause de stress professionnel.
On ne saurait aborder la santé et la sécurité au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels, comme c’est l’objet de l’alinéa 8, sans aborder l’organisation du travail, qui est souvent un facteur de risques psychosociaux.
Redonner aux salariés, premiers concernés, la possibilité d’intervenir et de s’exprimer sur cette organisation est indispensable pour lutter efficacement contre les risques psychosociaux et redonner sens et utilité aux missions exercées.
Nous proposons donc, par cet amendement, d’ajouter l’organisation du travail aux items sur lesquels la négociation en entreprise doit porter.

L’article 2 bis prévoit une négociation sur les conditions de travail. L’amendement que vous proposez, ma chère collègue, vise à y inclure le thème de l’organisation du travail.
Si cet article incite les partenaires sociaux à se saisir du thème de la qualité des conditions de travail, il ne mentionne qu’une possibilité. Il n’est pas nécessaire d’ajouter à la liste un thème sur lequel une négociation peut déjà avoir lieu.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Comme M. le rapporteur, j’entends vos arguments, madame la sénatrice.
Il reste que l’ANI a été signé par l’ensemble des organisations syndicales, qui ont été évoquées à plusieurs reprises. Je l’ai dit, je le répète : des équilibres ont été trouvés, qu’il faut respecter. Pour ce qui est de la qualité de vie au travail (QVT), des dispositions permettent déjà aux partenaires sociaux de se saisir de ce sujet s’ils le souhaitent – cette option leur est offerte.
Nous avons entamé, en 2017 – mais sans doute divergeons-nous aussi sur ce point – un effort de rationalisation. En entreprise, le calendrier des négociations sociales est déjà extrêmement touffu. Mener à bien ces négociations exige d’ailleurs de s’investir : si négocier veut dire se contenter d’une réunion paritaire et en déduire que tout va bien, cela a peu d’intérêt…
Je préfère que les sujets soient très clairement posés, comme cela est le cas aujourd’hui, sans en rajouter : il y a déjà de quoi faire dans les entreprises. Que ce qui est prévu soit fait à fond ; les entreprises qui le peuvent et le souhaitent ont la possibilité de mener de surcroît des échanges sur l’organisation du travail lorsque cela se justifie.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Les anciennes instances représentatives du personnel – délégués du personnel (DP) et comité d’entreprise (CE) – se réunissaient une fois par mois. Avec la création du CSE, on est passé d’une réunion mensuelle obligatoire à six réunions par an seulement.

Autrement dit, la tendance n’est pas à « ajouter » quoi que ce soit, mais bien à enlever !
Si les choses étaient si évidentes, il aurait été préférable que les ordonnances de 2017 n’en soient pas, et que la loi s’y substitue. Ainsi, on aurait pu en discuter ! Je pense notamment à l’incidence de la disparition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur la prise en compte du travail réel, et non prescrit, au plus près des organisations du travail. Sans le CHSCT, une distance s’est creusée…
Les élus du CHSCT étaient les élus les mieux perçus dans l’entreprise – j’ai assez travaillé en entreprise pour le savoir. Très proches du travail concret, ils n’ignoraient rien des conditions de travail ni des souffrances de leurs collègues, qu’ils faisaient « remonter ». Ils bénéficiaient d’une véritable aura dans l’entreprise, et ce n’est pas pour rien qu’on a supprimé leur instance pour les fondre dans un CSE qui, à défaut d’accord, se réunit seulement six fois par an, et pour traiter de tous les problèmes !
Non, la tendance n’est pas à l’aggravation des obligations : elle n’est pas à « en rajouter ». Il faudrait peut-être cesser, à l’inverse, d’en supprimer !

Je suis surpris par cette considération selon laquelle faire de l’organisation du travail un élément moteur de la réflexion obligatoire reviendrait à complexifier celle-ci.
Intéressez-vous à ce que demandent les 900 médecins du travail qui ont signé une lettre à ce sujet – je me permets d’en parler parce que ma femme a été médecin du travail pendant 40 ans : la prégnance de l’organisation du travail ou des facteurs liés à l’organisation du travail, notamment, sur la réalité de la souffrance au travail des salariés n’a cessé de s’accroître. Ma femme en a été témoin à propos d’une entreprise qui a été mise en cause nationalement à ce sujet, plus particulièrement pour sa gestion de l’un de ses entrepôts.
La nécessité de prendre en compte l’organisation du travail dans le champ de la négociation obligatoire en entreprise s’impose aujourd’hui au monde du travail, et je trouve un peu surprenant que cette nécessité ne vous apparaisse pas comme telle. Inclure ce thème dans la négociation ne saurait être un frein : ce ne peut être que bénéfique pour ladite organisation !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 208, présenté par Mme Poumirol, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 2281-5, au premier alinéa de l’article L. 2281-11 et au premier alinéa de l’article L. 2312-26, le mot : « au » est remplacé par les mots : « et des conditions de ».
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Il s’agit toujours du même thème.
L’article 2 bis prévoit de remplacer, dans le code du travail, la notion de « qualité de vie au travail » par celle de « qualité de vie et des conditions de travail », introduite par l’accord national interprofessionnel pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et de conditions de travail.
Est ainsi visé un élément fondamental de la prévention primaire – mes collègues écologistes viennent d’en développer l’analyse –, à savoir l’organisation même du travail.
Dans le prolongement des modifications apportées par la commission des affaires sociales, cet amendement a pour objet d’harmoniser la terminologie du code du travail en remplaçant, en chacune de leurs occurrences, les termes « qualité de vie au travail » par les termes « qualité de vie et des conditions de travail ».

Votre proposition, madame Poumirol, s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission, qui, sur votre initiative notamment, a sacralisé au niveau législatif la notion de « qualité de vie et des conditions de travail » mentionnée dans l’ANI. Il s’agit donc de procéder, en toute logique, à un certain nombre d’harmonisations dans le code du travail.
J’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d ’ État. Avis favorable également, pour les raisons qui viennent d’être exposées par M. le rapporteur.
On s ’ en félicite sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 bis est adopté.

L’amendement n° 90 rectifié, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 2242-17 du code du travail, après les mots : « accès à », sont insérés les mots : « la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés ainsi qu’à ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Cet amendement a pour objet de reprendre la recommandation n° 7 du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) de décembre 2017 sur la prévention de la désinsertion professionnelle, en intégrant dans la négociation annuelle d’entreprise sur la qualité de vie au travail les mesures permettant de prévenir la désinsertion professionnelle des travailleuses et des travailleurs.
Les actions de maintien dans l’emploi ou en emploi ont pour objectif de permettre à des personnes dont le handicap ou les problèmes de santé restreignent l’aptitude professionnelle à rester en activité ou à reprendre leur activité dès consolidation, soit par un aménagement de leur emploi soit par un changement d’activité ou d’emploi.
Les estimations font état d’une fourchette située entre un et deux millions de salariés menacés à court ou moyen terme par un risque de désinsertion professionnelle, soit 5 à 10 % des salariés. C’est énorme !
Derrière la question de la désinsertion professionnelle se pose celle de l’aptitude professionnelle : actuellement, les salariés les plus concernés sont globalement moins qualifiés et plus âgés que les autres, les métiers ouvriers et des secteurs sanitaires et sociaux étant surreprésentés.
Si le Gouvernement a repris la recommandation de la mission préconisant de mieux définir les ambitions d’une politique de prévention de la désinsertion professionnelle, nous ne comprenons pas pourquoi celle-ci n’a pas été retenue en totalité. En effet, l’IGAS proposait en même temps d’adopter une vision globale orientée vers la sécurisation des parcours professionnels en renvoyant vers la négociation collective et les services de santé au travail. Tel est l’objet de notre amendement.

Le code du travail prévoit que la négociation d’entreprise, lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre des dispositions supplétives dudit code, porte obligatoirement sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Ce thème inclut donc déjà la prévention de la désinsertion professionnelle.
Cet amendement, de notre point de vue, est satisfait. J’en demande donc retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Le maintien dans l’emploi – je préfère cette terminologie – est au cœur de cette proposition de loi ; nous allons y revenir. Et mon sentiment est que nous allons tous y trouver notre compte.
De ce point de vue, la demande de retrait me paraît plus adaptée qu’un avis défavorable.

Je veux bien me laisser convaincre par les arguments qui viennent d’être exposés ; en revanche, monsieur le secrétaire d’État, je doute que nous nous retrouvions toutes et tous dans cette proposition de loi.
En l’occurrence, les arguments de M. le rapporteur et les vôtres nous ont néanmoins convaincues, Cathy Apourceau-Poly et moi-même ; je retire donc notre amendement.
M. Jean-Pierre Corbisez applaudit.
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4412-1 est complété par les mots : «, en tenant compte des situations de polyexpositions » ;
2° L’article L. 4624-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition ou, le cas échéant, » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »

L’amendement n° 199, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Martin Lévrier.

Cet article, inséré en commission par l’Assemblée nationale, vise à prendre en compte les situations de polyexpositions pour les travailleurs exposés à des risques chimiques.
Lors de l’examen de ce texte par la commission des affaires sociales du Sénat, certaines modifications ont été adoptées afin de prévoir que la visite post-exposition ait lieu dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition, et non plus seulement avant le départ à la retraite.
Or le suivi individuel renforcé permet déjà d’assurer un suivi médical périodique pour les salariés exposés à des risques. Le médecin délivre alors un avis d’aptitude ou d’inaptitude, et propose à l’employeur des mesures individuelles telles qu’une mutation ou une transformation de poste.
Le temps consacré aux visites et aux examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est bien évidemment compris dans les heures de travail du salarié sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse être opérée, ou est rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail.
Afin d’éviter que ces nouvelles dispositions ne fassent doublon avec les mesures déjà existantes et afin de garantir la lisibilité de la loi, cet amendement tend à supprimer les alinéas prévoyant ce suivi post-cessation d’exposition.

De notre point de vue – je suis navré de le dire ainsi –, les auteurs de cet amendement confondent deux éléments. Le suivi individuel renforcé, dont bénéficie le travailleur exposé à des risques particuliers, notamment chimiques, couvre toute sa période d’exposition ; le suivi post-exposition vise, quant à lui, à surveiller l’état de santé du travailleur après la cessation de cette exposition.
Le suivi post-exposition s’inscrit dans la continuité du suivi individuel renforcé : il n’intervient donc pas en doublon de celui-ci. Supprimer la possibilité pour le médecin du travail d’engager une surveillance de l’état de santé du travailleur après la cessation de l’exposition priverait le travailleur d’actions de prévention, notamment de dépistage, contre des pathologies différées.
Du reste, ce suivi post-exposition s’inscrit dans la même logique que la surveillance post-professionnelle, introduite par le Sénat en 2018 sur l’initiative de notre collègue Alain Milon, qui intervient avant le départ à la retraite des travailleurs exposés à des risques dangereux pour la santé.
Il est dommage, en revanche, que, trois ans après l’inscription de ce dispositif dans la loi, celui-ci ne soit toujours pas mis en œuvre, faute de publication de textes d’application – mais, visiblement, les choses seraient en préparation…
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Je rebondis sur les propos de M. le rapporteur, qui soulignait un point important en faisant allusion à l’engagement que j’ai pris devant l’Assemblée nationale.
La proposition que porte le sénateur Lévrier consiste à rétablir la rédaction initiale de l’article 2 ter, qui prévoit notamment cette visite avant le départ à la retraite – nous en voyons tous l’intérêt.
Ce qui manque, aujourd’hui, c’est le décret d’application. Je me suis engagé devant l’Assemblée nationale à ce qu’il soit publié à court terme. Les choses avancent et vont aboutir dans les semaines qui viennent ; d’où mon soutien à l’amendement du sénateur Lévrier.
J’émets un avis favorable sur cet amendement.

Je suis quelque peu surprise par cet amendement : le suivi post-exposition à des risques dangereux est une avancée tangible et concrète pour les salariés les plus exposés à des risques professionnels.
Ce suivi est également important du point de vue de la lutte contre les inégalités au travail, car on sait bien que l’inégalité se traduit, en l’espèce, par des écarts d’espérance de vie, et surtout d’espérance de vie en bonne santé, extrêmement significatifs entre les différentes catégories socioprofessionnelles.
Nous sommes donc évidemment opposés à l’amendement de M. Lévrier.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 ter est adopté.
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141 -5. – L’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.
« Lorsque le travailleur dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323-8, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.
« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
« Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour renforcer la prévention en santé au travail, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

L’amendement n° 52, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

L’article 3 prévoit la création d’un « passeport de prévention » qui retracera les formations, y compris obligatoires, que les travailleurs et travailleuses ont effectuées dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques professionnels ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre.
L’existence d’un tel document suscite des craintes chez les professionnels comme chez certains partenaires sociaux, qui s’interrogent sur ses finalités, au-delà de l’intérêt de la traçabilité des formations continues suivies par le salarié.
En effet, si chaque entreprise a par définition connaissance des formations qu’elle organise, il est de la libre décision de chaque salarié de porter à la connaissance d’un de ses employeurs l’ensemble des formations suivies au cours de son parcours professionnel comme de consentir à la transmission des informations qui font l’objet de ce passeport. Mais le refus d’en permettre l’accès peut engendrer un risque de discrimination, à l’embauche notamment.
Par ailleurs, s’agissant de la volonté de créer un tel passeport – pour aller où ? –, la crainte ne peut être écartée d’un report de la responsabilité de l’employeur sur le salarié en cas d’accident, au motif que le salarié était informé d’un risque ou formé à la sécurité, y compris par le biais de formations suivies antérieurement à sa prise de poste.
Ces risques sont à mettre en regard d’une utilité très limitée par rapport aux dispositifs existants : tout salarié, s’il le souhaite, peut d’ores et déjà mentionner des formations à son employeur et, le cas échéant, fournir ses certificats ou attestations.
Nous proposons donc de supprimer cet article.

La création du passeport de prévention est une mesure clé de l’ANI, qui a été voulue par la quasi-totalité des partenaires sociaux, à notre connaissance en tout cas.
Le passeport de prévention est précisément conçu comme un outil au service d’une meilleure prévention en matière de santé au travail. Renforçant la traçabilité des formations en santé et en sécurité suivies par le travailleur, il doit permettre d’objectiver les moyens consentis par l’employeur pour accompagner son salarié.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Cette question a déjà été évoquée précédemment.
Je vous le dis d’expérience, expérience dont je n’ai ici nullement le monopole, je le sais : ce n’est pas parce que vous invitez votre salarié à se former sur les sujets de sécurité et de santé au travail que vous vous déresponsabilisez en tant qu’employeur. Il me semble que les salariés, lorsqu’ils ont connaissance des formations auxquelles ils peuvent avoir accès, en sont au contraire demandeurs – nous sommes probablement tous d’accord là-dessus.
Ce passeport permet précisément une lisibilité des formations, lesquelles peuvent être d’ailleurs, dans certaines entreprises et au regard de certaines conventions collectives, des formations qualifiantes, auxquelles sont indexés des niveaux de rémunérations spécifiques.
Ces éléments sont donc très positifs. La sécurité et la santé au travail, c’est la responsabilité de l’employeur, mais c’est aussi l’affaire de tous ! Quand on est salarié – vous le savez, madame la sénatrice, et vous l’avez dit –, on est acteur de sa sécurité et de celle de ses collègues.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 141, présenté par Mme Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Première et dernière phrases
Remplacer les mots :
passeport de prévention
par les mots :
livret de formation santé sécurité
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
passeport
par le mot :
livret
II. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer les mots :
Lorsque le travailleur dispose d’un
par les mots :
Le livret de formation santé sécurité intègre le
2° Supprimer les mots :
, son passeport de prévention y est intégré
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence du livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention définie à l’article L. 4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L. 4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L. 4121-3.
IV. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
passeport de prévention
par les mots :
livret de formation santé sécurité
V. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer les mots :
passeport de prévention
par les mots :
livret de formation santé et sécurité
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour renforcer la prévention en santé au travail
par les mots :
déterminé par décret
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Nous souhaitons remplacer, en chacune de leurs occurrences, les termes « passeport de prévention » par les termes « livret de formation santé et sécurité ».
Il ne s’agit pas là d’un simple accès de fantaisie sémantique. En effet, l’inspiration qui préside à la création du passeport de prévention pourrait conduire, en matière d’organisation du travail et d’amélioration des conditions de travail, dont l’employeur doit rester le garant, à un glissement de la sécurité collective vers une responsabilité individuelle du travailleur, celui-ci étant censé se former pour s’adapter à des conditions de travail éventuellement néfastes pour sa santé.
On assiste ainsi à une inversion de la logique et de la démarche de prévention, celle-ci consistant à agir prioritairement sur les conditions de travail et l’organisation du travail.
Telle est notre crainte : celle d’un glissement de responsabilité. L’instauration d’un livret de formation ne peut suffire à lever les responsabilités de l’employeur en matière de santé au travail. La satisfaction de ces obligations de formation et la consignation dans le livret des documents l’attestant ne sauraient dédouaner l’employeur.

L’amendement n° 53, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première et dernière phrases, alinéa 3, première phrase, alinéas 4, 5 et alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
passeport de prévention
par les mots :
livret de formation santé sécurité
II. – Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer le mot :
passeport
par le mot :
livret
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence du livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention définie à l’article L. 4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L. 4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L. 4121-3.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Cet amendement est similaire au précédent ; il nous a été inspiré par le collectif Prévention AT-MP, qui a été auditionné. Il s’agit de renommer le passeport de prévention « livret de formation santé sécurité » afin de lever toute ambiguïté quant à la responsabilité personnelle de l’employeur.
En effet, l’intitulé « passeport de prévention » présente deux limites aux yeux des membres de ce collectif.
Tout d’abord, il ne rend pas compte du contenu du document créé à l’article 3 de la proposition de loi : ce document comprend uniquement des attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail, que celles-ci aient été dispensées par l’employeur ou par un organisme de formation, que le salarié les ait ou non suivies de sa propre initiative. De ce fait, le terme « livret de formation santé sécurité » paraît plus approprié et largement suffisant.
Ensuite – cela a été rappelé –, nous craignons que l’intitulé « passeport de prévention » ne participe d’une logique de transfert d’une partie de la responsabilité de l’employeur vers le salarié. Si chacun est acteur en matière de santé, tous n’ont pas le même pouvoir d’organisation, et certains n’en ont pas du tout !
Il y a une différence entre les formations relatives au travail prescrit et le travail réel. Dans ce dernier domaine, c’est l’employeur qui doit rester seul responsable puisque seul il dispose du pouvoir d’organisation.
Le collectif Prévention AT-MP alerte sur un risque d’instrumentalisation du passeport de prévention visant à faire porter une partie de la responsabilité sur le salarié alors même que, subordonné, il n’a aucun pouvoir d’organisation. Quand on dit qu’il est « acteur de sa prévention » au même titre que l’employeur, c’est bien cette situation de subordination qui est niée : il n’a aucun pouvoir d’organisation sur le travail réel.
De nouveaux dispositifs étant créés, il convient de réaffirmer explicitement la responsabilité personnelle de l’employeur quant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. C’est lui, l’employeur, qui doit veiller à l’effectivité de l’application des règles de sécurité, les obligations de formation et d’information ne correspondant qu’à une partie de l’obligation qui lui incombe en matière de mesures de prévention, selon l’article L. 4121-1 du code du travail.
S’il arrive, d’ailleurs, que la responsabilité disciplinaire du salarié soit engagée, cette responsabilité est toujours recherchée après la responsabilité personnelle, civile et pénale de l’employeur, qui doit veiller à l’effectivité de l’application des règles de sécurité.

L’amendement n° 99, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Première et dernière phrases
Remplacer les mots :
passeport de prévention
par les mots :
livret de formation santé sécurité
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
passeport
par le mot :
livret
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention définie à l’article L. 4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L. 4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L. 4121-3.
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
passeport de prévention
par les mots :
livret de formation santé sécurité
IV. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
passeport de prévention
par les mots :
livret de formation santé sécurité
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Cet amendement nous a également été suggéré par le collectif Prévention AT-MP, qui regroupe des salariés syndiqués et non syndiqués des services de prévention des Carsat, de la caisse nationale de la sécurité sociale, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif), ainsi que de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce collectif dénonce une déresponsabilisation des employeurs et une régression historique dans le champ de la prévention des risques professionnels, dont le fondement juridique serait profondément remis en cause.
En effet, sous réserve qu’il réponde à un protocole, l’employeur sera quasiment déchargé de ses obligations à l’égard de la santé de ses salariés, sa responsabilité en la matière étant réduite et transférée au travailleur lui-même ou aux services de santé au travail.
Depuis 2002, la jurisprudence constante donnait à l’employeur une obligation de sécurité de résultat, cette obligation découlant elle-même de la combinaison de deux obligations : prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés, et évaluer les risques professionnels. Deux jugements, en 2015 et en 2016, ont relativisé cette jurisprudence en transformant l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en obligation de moyens.
La création du passeport de prévention laisse penser que les actions de formation et d’information menées par l’employeur lui suffisent à accomplir sa mission de prévention des risques. Pourtant, les obligations de formation et d’information ne correspondent qu’à une partie seulement de l’obligation qui incombe à l’employeur en matière de mesures de prévention.
Ce livret de formation ne saurait suffire à lever les responsabilités de l’employeur en matière de santé au travail.

L’amendement n° 11 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Bonhomme, Chatillon, Daubresse, Cambon et B. Fournier, Mme Demas, MM. Savin et Savary, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bouloux, Milon et Brisson, Mme Malet, M. Rapin, Mmes Di Folco, Imbert, L. Darcos, Garriaud-Maylam et Dumont, MM. Pointereau et Genet, Mme M. Mercier et MM. Husson et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Mouiller.

Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 3, c’est-à-dire l’intégration du passeport de prévention au passeport d’orientation, de formation et de compétences.
L’idée n’est pas de remettre en cause le principe général : c’est surtout une histoire de calendrier. Sur ce sujet, en effet, la négociation avec les partenaires sociaux n’est pas aboutie, ce qui occasionne pour eux de fortes difficultés.

L’amendement n° 97, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations, attestations, certificats et diplômes listés dans le passeport de prévention, n’exonèrent pas l’employeur de sa responsabilité quant à la préservation de la santé des travailleuses et travailleurs.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

J’irai dans le même sens que précédemment à propos de l’amendement n° 99 : nous considérons que les formations, les attestations, les certificats et les diplômes listés dans le passeport de prévention n’exonèrent pas l’employeur de sa responsabilité quant à la préservation de la santé des travailleurs.
En effet, les organisations syndicales et les associations d’accidentés du travail s’inquiètent très fortement et légitimement des conséquences de la création de ce passeport de prévention. Il serait inacceptable que celui-ci devienne un moyen pour l’employeur d’échapper à sa responsabilité en matière de santé au travail et, de fait, à son obligation d’indemniser les victimes.

L’amendement n° 12 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Bonhomme, Chatillon, Daubresse, Cambon et B. Fournier, Mme Demas, MM. Savin et Savary, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bouloux, Milon et Brisson, Mme Malet, MM. Rapin et Pointereau, Mmes Dumont, Garriaud-Maylam, L. Darcos, Imbert et Di Folco, M. Genet, Mme M. Mercier et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Mouiller.

La formation des demandeurs d’emploi à la santé et à la sécurité au travail est essentielle pour assurer leurs compétences en matière de prévention. Elle est aussi un facteur incitatif à l’embauche, dès lors que les demandeurs d’emploi auront suivi les formations adéquates.
Pour autant, il est nécessaire de mettre en place et d’évaluer le dispositif innovant du passeport de prévention avant de procéder, le cas échéant, à son élargissement par voie réglementaire.

L’amendement n° 224, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer les mots :
promulgation de la loi n° du pour renforcer la prévention en santé au travail
par les mots :
publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4141-5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2022.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise à faire courir le délai de six mois imparti au Comité national de prévention et de santé au travail, le CNPST, pour déterminer les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention à partir de la publication du décret qui doit mettre en place ledit comité.
En outre, il tend à fixer une date butoir au déploiement du passeport de prévention qui devra intervenir au plus tard le 1er octobre 2022.

Quel est l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune ?

Les amendements n° 141, 53 et 99 visent à atteindre des objectifs similaires : ils feront donc l’objet d’un commentaire commun.
Ces amendements tendent à renommer le passeport de prévention « livret de formation santé sécurité ». Ils visent en outre à préciser que ce livret ne peut se substituer aux obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité vis-à-vis du travailleur.
La requalification du passeport de prévention ne changeant rien à son contenu, il est préférable de s’en tenir à l’appellation choisie par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI.
Par ailleurs, le passeport de prévention n’a pas vocation à décharger l’employeur de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail : il doit permettre d’identifier les compétences qui ont été acquises et celles qui restent à acquérir ou à renouveler pour assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité du travailleur.
J’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
L’amendement n° 11 rectifié quater, présenté par M. Mouiller, vise à supprimer l’intégration du passeport de prévention dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences.
Or cette intégration est pleinement justifiée : l’objectif est que les deux dispositifs puissent mutualiser les outils développés par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du site du compte personnel de formation. Le Conseil d’État a justement recommandé, dans son avis, de préciser l’articulation entre ces deux passeports.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 97, qui s’inscrit dans la continuité des amendements n° 141, 53 et 99, le commentaire est sensiblement le même. Le passeport de prévention doit permettre d’identifier les compétences qui ont été acquises.
J’ajoute que les quatre organisations syndicales signataires de l’ANI n’auraient pas souscrit à cet accord si le passeport de prévention était conçu comme un moyen d’exonérer l’employeur de sa responsabilité. Une telle chose serait impensable et poserait un véritable problème de démocratie. Il faudrait renvoyer cette responsabilité aux partenaires sociaux.
L’avis est défavorable.
L’amendement n° 12 rectifié ter vise à supprimer la possibilité pour les demandeurs d’emploi de disposer d’un passeport de prévention.
La commission des affaires sociales a introduit cette possibilité pour permettre aux demandeurs d’emploi de renseigner dans ce passeport les formations qu’ils auront suivies en matière de santé et de sécurité au travail.
Ce sera un outil puissant de réinsertion professionnelle pour le demandeur d’emploi, qui pourra faire valoir les habilitations acquises, mais également de visibilité pour l’employeur, puisque celui-ci connaîtra les obligations de formation déjà satisfaites, évitant ainsi un certain nombre de redondances dans les formations qu’il devra organiser pour le candidat si celui-ci est retenu.
Ce dispositif est issu des auditions que nous avons menées, Pascale Gruny et moi-même. Nous nous sommes assurés que cette demande ne posera pas de difficulté. En tout état de cause, elle nous semble pertinente.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Le report de l’entrée en vigueur du passeport de prévention me paraît être une proposition parfaitement étayée. Ce dispositif, qui constitue une évolution majeure, appelle, il est vrai, des travaux de concertation avec les partenaires sociaux. Des instances sont d’ailleurs prévues pour cela – je pense au CNPST.
Des travaux devront également être engagés pour assurer la traçabilité et la confidentialité des données récupérées et traitées dans le cadre de ce dispositif qui sera adossé au passeport d’orientation, de formation et de compétences.
J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 224 de la commission.
En ce qui concerne les autres amendements, M. le rapporteur a encore une fois été très précis. J’émets un avis défavorable, pour les mêmes raisons que lui.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 11 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 97.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je retire également l’amendement n° 12 rectifié ter, madame la présidente.

L’amendement n° 12 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 224.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 3 est adopté.
L’article L. 4622-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° A
a) À la première phrase, le mot : « exclusive » est remplacé par le mot : « principale » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. » ;
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ; »
1° bis Au 2°, la cinquième occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « la qualité de vie et » ;
1° ter
« 2° bis Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ; »
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. »

L’amendement n° 54, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

L’article 4 prévoit la participation des services de santé au travail (SST) à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, notamment via des campagnes de vaccination et de dépistage, et l’incitation à la pratique sportive.
Le rôle de conseil des services de santé au travail était déjà possible, tant auprès de l’employeur que des salariés, tout en devant rester centré sur ses missions propres, rappelées dans un avis du Conseil d’État, à savoir « d’éviter toute altération de la santé du travailleur du fait du travail ».
La formulation et le recueil de conseils par le service de santé au travail à partir de son exercice clinique et des observations effectuées sur le terrain de l’entreprise ne conduit pas à un partage de cette responsabilité et ne saurait l’impliquer au-delà ou au détriment de ses missions.
Le médecin du travail, et lui seul, peut dire le lien entre santé et travail. Il appartient aux professionnels des SST d’étudier des situations réelles de travail et d’organisation de celui-ci.
Les praticiens en médecine du travail suivent de plus en plus de travailleurs – cela a été rappelé. On compte un médecin du travail pour 4 000 salariés, et ce dernier doit se rendre dans des centaines d’entreprises, ce qui occupe normalement un tiers de son temps. Un simple calcul mathématique du niveau d’un élève de sixième nous montre que ce que vous proposez n’est pas possible !
Dans un contexte de baisse de la démographie de praticiens en médecine du travail, de temps hypercontraint et de manque structurel de moyens, le fait de faire peser sur les SST des missions relevant de la médecine générale ou de la santé publique n’est pas dans l’intérêt des salariés, le risque étant réel que cela se fasse au détriment des missions de prévention en matière de santé au travail.

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 au motif que l’élargissement de ses missions à des actions de promotion de la santé risquerait d’éloigner le médecin du travail de son implication dans la prévention des risques professionnels.
La commission des affaires sociales ne partage absolument pas cette analyse, car elle considère depuis 2019, au titre de ses travaux, que la santé au travail constitue l’une des composantes de notre politique de santé publique, conformément à l’approche One Health. La médecine du travail a toute sa place dans la réalisation d’objectifs de santé publique concourant à un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Madame la sénatrice, vous voulez supprimer des dispositions relatives aux missions des services de santé au travail.
Je ferai simplement référence à l’action concrète des services de santé au travail pendant cette crise sanitaire, notamment en termes de vaccination. Nous avons là, de fait, la démonstration de l’utilité de ces services.
Toutes celles et tous ceux qui ont pu échanger avec les services de santé au travail savent que ces derniers ont demandé à participer à la stratégie vaccinale le plus tôt possible. D’ailleurs, beaucoup de médecins du travail se sont rendus dans les centres de vaccination pour se mettre à la disposition de l’intérêt général.
Il est important de mentionner cette participation, en parfaite cohérence avec l’activité quasi actuelle des services de santé au travail.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le secrétaire d’État, vous ne devez pas ignorer que pendant le confinement, les services de santé au travail étaient fermés. Il suffit d’avoir été dans une entreprise pour le savoir. Or, à l’époque, je dirigeais une association.
Qu’ils aient participé, comme tous les praticiens hospitaliers ou autres, à la vaccination est une chose, d’autant qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle. Mais pensez-vous vraiment que, avec un médecin pour 4 000 salariés, ces praticiens auront la possibilité, alors qu’ils visitent des centaines d’entreprises et consacrent un tiers de leur temps aux salariés sur leur lieu de travail, de participer à la promotion de la santé publique, notamment en réalisant des campagnes de vaccination et de promotion de la pratique sportive ?
Certes, ils peuvent toujours donner des conseils s’ils se trouvent confrontés à une personne diabétique ou obèse. Mais ce que vous proposez ne tient pas compte du fait que rien n’a été fait depuis des années, alors que les médecins du travail nous ont alertés, en faveur de l’attractivité de ce métier.
Paradoxalement, on voudrait aujourd’hui que les médecins du travail s’occupent de santé publique et que les médecins généraux s’occupent de médecine du travail. Ce n’est pas sérieux ! L’approche « Une seule santé » ne peut pas consister en cela !
Chacun, à mon sens, doit rester centré sur sa propre discipline. Si les médecins du travail ont pour mission de faire le lien entre le travail et la santé, comment pourraient-ils allouer du temps à d’autres tâches ? Une telle disposition relève de l’hypocrisie !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Bonhomme, Chatillon, Daubresse, Cambon et B. Fournier, Mme Demas, MM. Savin et Savary, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Pointereau, Mmes Bonfanti-Dossat, Dumont, Garriaud-Maylam, L. Darcos, Imbert et Di Folco, M. Rapin, Mme Malet, MM. Brisson, Milon et Bouloux, Mme Belrhiti, M. Genet, Mme M. Mercier et MM. Husson et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Mouiller.

L’article 4 vise à étendre les missions des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) à la santé publique.
Au-delà de l’intérêt que présente la vaccination par les SPSTI, qui fait consensus, cette évolution ne traduit pas la volonté des partenaires sociaux, qui ont réformé ces services pour recentrer leurs missions sur la santé au travail autour d’une offre socle obligatoire.
Pour que cette offre socle soit effective, dans le contexte de pénurie que nous connaissons, il est essentiel de centrer l’action des SPSTI sur leurs trois missions de base, à savoir la prévention, le suivi médical en santé au travail et la prévention de la désinsertion professionnelle. Tel est l’objet de cet amendement.

L’amendement n° 161 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, Doineau, Férat, Saint-Pé, Vermeillet, de La Provôté, Sollogoub et Tetuanui et MM. Canévet, Détraigne, L. Hervé, Laugier, Le Nay, Longeot et Kern, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’à des actions de sensibilisation à la lutte contre les violences conjugales et sexuelles
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Par la violence de la crise sanitaire qu’elle a entraînée, cette pandémie a redonné une visibilité aux acteurs du monde médical.
Les nouvelles façons de travailler, avec l’essor du télétravail, ont eu comme corollaire de déconnecter un certain nombre de salariés de leur réseau professionnel. Le travail émancipe, mais ne protège pas toujours les femmes.
La généralisation du télétravail équivaudrait, dans l’état actuel de nos sociétés, à une aggravation des inégalités entre hommes et femmes. Les filets de sécurité associés au monde professionnel dans les entreprises présentaient les avantages de prémunir, voire de réduire, des actes éventuels de violence commis à l’encontre des femmes.
Le rôle du médecin du travail s’avère donc structurant dans ce type de situations de confinements à répétition.
Cet amendement vise à faire du personnel de santé au travail un nouvel acteur dans la lutte contre les violences conjugales et sexuelles. Ces professionnels sont des rouages essentiels dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Rappelons que les moments passés en dehors du foyer constituent parfois les seuls instants de liberté pour les femmes victimes de violences commises dans le cadre de leur domicile.

Dans la rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, l’article 4 de la proposition de loi fait clairement la distinction entre, d’une part, les missions principales des SPST, qui concernent la prévention de l’altération de l’état de santé du fait du travail et qui se rattachent aux missions essentielles de l’offre socle, à savoir la prévention des risques professionnels, le suivi médical et la prévention de la désinsertion professionnelle et, d’autre part, les missions complémentaires du SPST, qui tiennent à sa contribution à l’atteinte d’objectifs de santé publique qui doivent permettre de maintenir le travailleur dans un état de santé compatible avec son maintien en emploi.
Cette clarification entre des missions principales de santé au travail stricto sensu et des missions complémentaires de santé publique a été demandée par le Conseil d’État. Il n’y a pas de risque que le SPST néglige ses missions essentielles au titre de l’offre socle, puisque la certification et l’agrément doivent justement prévenir de telles dérives.
Estimant que la rédaction issue des travaux de la commission répond aux inquiétudes des auteurs de l’amendement n° 13 rectifié quater, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 161 rectifié ter, bien qu’il ait pour objet la prévention des violences conjugales ou sexuelles, il échappe aux « fourches » de l’irrecevabilité au titre de l’article 45 de la Constitution en empruntant la voie d’entrée de la contribution des SPST à la promotion de la santé dans le cadre d’objectifs de santé publique, possibilité que prévoit effectivement l’article 4 de la proposition de loi dans sa version initiale.
Toutefois, l’amendement reste problématique pour des raisons principalement de deux ordres.
D’une part, son adoption allongerait l’énumération figurant au dernier alinéa de l’article 4 des actions de sensibilisation que le SPST peut mettre en œuvre, énumération qui pourrait être poussée à l’infini. Dans un souci d’intelligibilité de la loi, il est préférable de ne pas complexifier outre mesure cette énumération qui a déjà été considérablement alourdie par l’Assemblée nationale.
D’autre part, l’amendement vise à mettre l’accent non seulement sur la sensibilisation aux violences sexuelles qui prennent leur origine sur le lieu de travail, mais aussi sur la sensibilisation aux violences conjugales.
Cette disposition découle de la convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 2019, qui met en avant les répercussions des violences domestiques sur les conditions de travail. Nous ne nions bien entendu pas cet impact, mais il convient d’être prudent : il faut garder à l’esprit que le sujet des violences conjugales met potentiellement en jeu le partage très délicat d’informations personnelles et familiales, pour lequel le cadre de la promotion de la santé sur le lieu de travail par le SPST n’apparaît pas pertinent.
Les salariés peuvent aujourd’hui déjà solliciter l’assistant social ou le psychologue du service de santé au travail pour échanger sur des problèmes qui dépassent la sphère professionnelle : il est donc préférable de privilégier ce cadre plus protecteur de la confidentialité des informations personnelles du salarié concerné.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 13 rectifié quater est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 161 rectifié ter ?
Je ne conteste pas cet amendement dans son principe. J’en demande néanmoins le retrait, au bénéfice de l’amendement n° 160 rectifié ter que nous examinerons très prochainement, qui a le même objet mais qui tend à introduire une rédaction qui s’inscrit beaucoup mieux dans l’article 4.

Je n’ai pas encore pris connaissance de l’amendement n° 160 rectifié ter. Je m’en tiendrai donc à cet amendement n° 161 rectifié ter, que je voterai.
Il m’est difficile, monsieur le rapporteur, d’entendre parler de complexification quand il s’agit de violences faites aux femmes. Le travail et le cadre professionnel peuvent constituer une protection pour ces femmes victimes de violences.
Nous avons là une occasion de les aider à sortir de leur torpeur et des violences qu’elles vivent au sein du couple. Comment pouvez-vous nous objecter la complexification de l’énumération des missions de SPST alors qu’il s’agit de prendre en compte cette détresse ?
Un tiens valant mieux que deux tu l’auras, je voterai cet amendement.

Je vais retirer cet amendement puisque j’ai l’assurance que l’amendement n° 160 rectifié ter, qui a le même objet, bénéficiera d’un avis favorable. Mieux vaut tenir que courir, pour répondre à ma collègue par un autre dicton !

L’amendement n° 161 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 55, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de ses obligations en matière de santé et de sécurité. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3, l’ensemble des acteurs médecin ou non médecin du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3 et L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risques et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les mêmes que celles prévues à l’article L. 8114-1 ; »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Revoilà la question de la responsabilité des employeurs. Vous ne voulez pas éclaircir ce point dans la loi et lever la crainte du collectif Prévention AT-MP, mais vous avez affirmé à de multiples reprises que rien n’était changé : nous pourrons au moins nous appuyer sur vos déclarations lorsque surviendront les premières difficultés liées à cette proposition de loi !
Bien sûr, une seule disposition de ce texte ne suffit pas à elle seule à induire un risque de dilution de la responsabilité de l’employeur. Mais l’accumulation de plusieurs mesures finit par constituer comme un faisceau de preuves et fait naître nos craintes.
Beaucoup de choses ont été faites en matière de santé publique, ou encore d’aide aux services de prévention et de santé au travail auprès des plus petites entreprises. Il reste que l’attribution de nouvelles missions aux équipes de ces services pourra conduire à leur donner une part de responsabilité réelle dans les risques professionnels.
Tous les ergonomes, tout du moins ceux qui travaillent sur ces questions, soulignent que le DUERP s’appuie sur le travail prescrit et non sur le travail réel. C’est l’écart entre le travail prescrit et le travail réel que les anciens CHSCT permettaient d’analyser, d’où le vide laissé par leur suppression.
Si nous sommes d’accord sur le fait que cette proposition de loi ne doit pas aboutir à une déresponsabilisation des employeurs, la rédaction que cet amendement vise à introduire présente l’avantage de clarifier les choses et de lever toute ambiguïté quant à la volonté du législateur dans la rédaction de cet article. Je sais qu’il ne sera pas retenu, mais son examen vous permettra au moins de reconnaître que rien n’est changé, ce qui pourrait s’avérer utile par la suite…

L’amendement n° 142, présenté par Mme Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3, l’ensemble des acteurs, médecin ou non médecin, du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3 et L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risque et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les mêmes que celles prévues à l’article L. 8114-1 ; »
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Nous avons tous participé aux mêmes auditions, notamment à celle du collectif Prévention AT-MP, raison pour laquelle nous présentons également un amendement à cet article.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 induit un risque de transfert de responsabilité et remet en cause la responsabilité légale de l’employeur en raison des nouvelles missions attribuées aux équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail.
Si nous ne sommes pas opposés à l’attribution de nouvelles missions à ces équipes, il nous semble important que l’exercice de leurs missions essentielles, décrites par M. Mouiller précédemment, soit déjà garanti avant d’en prévoir de nouvelles.
En outre, ces nouvelles missions supposent l’implication d’acteurs non protégés de l’équipe pluridisciplinaire dans la démarche d’évaluation des risques.
Ces missions sont l’objet d’enjeux très forts pour l’employeur. Actuellement, le droit protège le médecin du travail, et lui seul, du licenciement lors du renouvellement d’un CDD ou d’un transfert vers une autre entreprise. De même, la prérogative du médecin d’imposer son signalement de risque et ses préconisations à l’employeur, qui doit y répondre, le légitime, seul, dans ses missions d’évaluation des risques et de prévention.
L’extension de ces missions à l’ensemble des acteurs du service, conjointement à la disparition progressive des médecins du travail, comme cela a été rappelé, notamment lors de la discussion générale, rend nécessaire d’étendre ces protections et ces prérogatives à la totalité de l’équipe pluridisciplinaire, en particulier aux infirmiers en pratique avancée en santé au travail.
À défaut, l’action en entreprise des acteurs du service sera limitée par la pression qu’ils pourront subir, et les annonces de prévention seront virtuelles.
C’est pourquoi cet amendement, inspiré par le collectif Prévention AT-MP, vise à garantir la responsabilité personnelle de l’employeur de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques.

L’amendement n° 100, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3, l’ensemble des acteurs médecin ou non médecin du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3 et L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risque et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les mêmes que celles prévues à l’article L. 8114-1. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Cet amendement, similaire à ceux qui viennent d’être présentés, vise à préciser que l’employeur reste personnellement responsable de la bonne exécution de l’évaluation des risques.
L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, ainsi que dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
Alors que le Gouvernement souhaite élargir les missions des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail à l’accompagnement dans l’évaluation des risques professionnels et à la promotion de la santé sur le lieu de travail, les professionnels demandent une meilleure protection.
Actuellement, le droit protège les médecins du travail dans leurs missions d’évaluation des risques et de prévention. Or, on l’a dit, mais il convient selon moi de le répéter, la réduction du nombre de médecins du travail et l’extension des missions de prévention à l’ensemble des équipes pluridisciplinaires des services de prévention nécessitent de renforcer leur protection et leurs prérogatives.
En effet, l’ensemble des acteurs – médecins ou non – du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques seront soumis à une menace de sanctions par les employeurs. Il est donc important de soutenir ces amendements, mes chers collègues.

Les amendements n° 55, 142 et 100 ont des objets similaires, moyennant quelques différences rédactionnelles.
Ils tendent à préciser que la contribution des SPST à l’évaluation des risques professionnels n’atténue pas l’obligation de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail. Il n’y a pas lieu de prévoir une telle précision, puisque la responsabilité de l’employeur demeure pleine et entière dans ce domaine en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, les amendements visent à étendre à tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire du SPST le statut de salarié protégé, qui est aujourd’hui réservé au médecin du travail, médecin de l’aptitude.
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficie le médecin du travail en tant que salarié protégé est liée aux fonctions qu’il exerce dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs.
Les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire exerçant leurs missions sous l’autorité du médecin, il n’y a pas lieu de leur étendre le statut de salarié protégé.
Par ailleurs, les professionnels de santé qui ne sont pas des médecins du travail sont déjà soumis aux obligations déontologiques et aux principes d’indépendance qui régissent leur profession.
Enfin, dernier argument, eu égard aux conséquences potentielles qu’il emporte, ce point aurait mérité d’être débattu par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI. Sauf erreur de ma part, cela n’a pas été le cas.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
Je partage l’avis défavorable de la commission.
Je confirme que ce point fait partie des équilibres qui ont été négociés par les partenaires sociaux. Si l’on ne peut pas faire grief aux organisations représentatives des salariés de chercher à obtenir pour leurs adhérents la meilleure protection possible, il convient de respecter cet équilibre et de ne pas s’inquiéter au-delà du raisonnable, même si je peux comprendre certaines craintes.
Le médecin du travail est un salarié protégé, et les membres de son équipe pluridisciplinaire interviennent sous sa responsabilité : j’estime que les choses sont relativement claires en l’état.

À partir du moment où les infirmiers en pratique avancée – nous y reviendrons ultérieurement – réalisent les visites d’embauche, appelées désormais « visites d’information et de prévention », un salarié peut ne jamais rencontrer le médecin du travail au cours de son parcours professionnel. Ces infirmiers, qui se trouvent de ce fait au cœur des missions de santé au travail, peuvent donc subir des pressions.
C’est pourquoi ils doivent être protégés, non seulement des licenciements et des discriminations, mais aussi des pressions liées à la nature de leur activité.
C’est à eux de dire s’il faut ou non adapter un poste de travail, car – je le rappelle – c’est au poste d’être adapté à l’employé et non l’inverse ! C’est le médecin ou l’infirmier, lequel dorénavant réalise la majorité des visites, qui a la charge de relever les risques professionnels, de les communiquer à l’employeur et de lui demander d’adapter le poste de travail à la santé du travailleur. On imagine bien, en raison de la nature de leurs tâches, qu’ils peuvent subir des pressions !
C’est la nature de leurs missions qui avait justifié la protection des médecins du travail. À défaut de l’étendre à toute l’équipe pluridisciplinaire, il convient à tout le moins de l’accorder à présent aux infirmiers de santé au travail. Nous défendrons d’ailleurs ultérieurement un amendement en sens.
De loi en loi, les choses changent et les partenaires sociaux doivent faire preuve de pragmatisme, dans un contexte de diminution des ressources humaines.
La visite annuelle a été remplacée par une visite tous les deux ans, puis par une visite tous les cinq ans pour les travailleurs qui ne bénéficient pas d’une surveillance renforcée. Dès lors que cette charge incombe aux infirmiers, eux aussi doivent être protégés de toute pression pouvant résulter de la nature de leurs missions.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 103, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

L’article 4 donne aux services de prévention et de santé au travail la possibilité de réaliser des campagnes de vaccination et de dépistage au profit des salariés du secteur privé. À notre sens, cette mission relève de la santé publique.
Alors que les services de prévention et de santé au travail font face à une pénurie de moyens et de médecins du travail, ajouter une nouvelle mission pourrait surcharger une fois de plus les professionnels et rendre impossible l’accès des salariés à ces services.
L’offre étant très hétérogène dans les territoires, cet article fait peser le risque d’une inégalité de traitement entre les salariés. En effet, les campagnes de vaccination et de dépistage pourraient être à géométrie variable, selon la taille de l’entreprise ou le lieu de travail.
En outre, l’employeur pourrait avoir connaissance d’informations sensibles sur l’état de santé du salarié, par exemple des résultats de test PCR, une pratique déjà en cours dans le contexte de pandémie de covid-19.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.

L’amendement n° 134, présenté par Mme Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après le mot :
Participent
insérer les mots :
, une fois les besoins du suivi médical des travailleurs remplis,
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

La proposition de loi opère un glissement de la santé au travail vers la santé en entreprise, préjudiciable à la santé des travailleurs au travail.
Bien sûr, la santé au travail participe de la santé publique, mais ses objectifs ne doivent pas être dilués dans ceux de la santé publique. C’est pourquoi il convient de circonscrire les actions de promotion de la santé à un complément, une fois la mission première de suivi médical des travailleurs remplie par la médecine du travail.

L’amendement n° 22 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 215 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après le mot :
sportive
insérer les mots :
, des actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

L’amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mme Deseyne, M. Cambon, Mme Lassarade, MM. Burgoa, Laménie, D. Laurent, Chatillon et Cardoux, Mmes Joseph, Chauvin, Belrhiti et Deromedi, MM. Savary, Houpert, Allizard et Lefèvre, Mmes Imbert, Puissat, Di Folco et Bonfanti-Dossat, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Klinger, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et Genet, Mme M. Mercier et MM. Gremillet et Husson, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après le mot :
handicap
insérer les mots :
et de difficultés auditives
La parole est à M. René-Paul Savary.

Cet amendement a pour objectif d’intégrer des actions d’information et de sensibilisation aux difficultés auditives que peuvent rencontrer tous les salariés sur leur lieu de travail.

L’amendement n° 160 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, Doineau, Férat, Saint-Pé, Vermeillet, Sollogoub, Tetuanui et de La Provôté et MM. Canévet, Détraigne, L. Hervé, Laugier, Le Nay, Longeot et Kern, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel de santé au travail contribue aux actions de sensibilisation aux violences conjugales et ou sexuelles. »
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Cet amendement, qui se justifie par son texte même, a été en partie défendu lors de l’examen de l’amendement n° 161 rectifié ter.

Dans une logique de décloisonnement de la santé au travail et de la santé publique, la proposition de loi vise à reconnaître la contribution de la médecine du travail à la réalisation d’objectifs de santé publique, ce qui, de notre point de vue, va dans le bon sens. La mise en œuvre de campagnes de vaccination et de dépistage y participe, comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État.
La pandémie a démontré que le risque infectieux se posait dans tous les milieux de vie, tout particulièrement sur le lieu de travail. En outre, l’origine multifactorielle de certaines pathologies, notamment cancéreuses, liées à des facteurs professionnels et environnementaux, plaide pour une sensibilisation renforcée des travailleurs au bénéfice des dépistages. Maintenir à tout prix une frontière étanche entre la médecine du travail et la santé publique n’est donc plus tenable à l’heure du concept One Health.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 103.
J’en viens à l’amendement n° 134. Les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail s’entendent, bien entendu, comme des missions complémentaires des SPST, dont la vocation principale, comme l’a rappelé la commission des affaires sociales, est de prévenir l’altération de l’état de santé du fait du travail.
En outre, nous avons précisé à l’article 8 que l’offre socle obligatoire des SPST comprenait trois champs : le suivi individuel du travailleur, la prévention des risques professionnels, la prévention de la désinsertion professionnelle. La promotion de la santé sur le lieu de travail relève donc bien des missions complémentaires.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 134.
L’amendement n° 215 rectifié tend à insérer le même type de dispositif que l’amendement n° 161 rectifié ter, ce qui pose deux problèmes principaux.
D’une part, l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence, dans les actions de promotion de la santé conduites par les SPST, de prolonger l’énumération des actions de sensibilisation possibles, laquelle pourrait être poussée à l’infini. Dans un souci d’intelligibilité de la loi, il est préférable de ne pas complexifier outre mesure cette disposition.
D’autre part, l’accent est mis non seulement sur la sensibilisation aux violences sexuelles qui prennent leur origine sur le lieu de travail, mais aussi sur la sensibilisation aux violences conjugales.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 28 rectifié bis concerne le rôle des SPST dans la sensibilisation aux troubles auditifs.
La proposition de loi prévoit déjà que les SPST pourront mettre en œuvre des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap, ce qui comprend celles qui prendraient leur source dans une réduction des capacités auditives. En outre, les SPST assurent un suivi spécifique des travailleurs exposés au bruit, selon des dispositions inscrites dans la partie réglementaire du code du travail, aux articles R. 4431-1 et suivants.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 160 rectifié ter a le même objectif que l’amendement n° 28 rectifié bis. Il est problématique pour des raisons de deux ordres.
D’une part, là encore, son adoption reviendrait, dans le cadre des actions de promotion de la santé conduites par les SPST, à prolonger à l’infini l’énumération des actions de sensibilisation possibles, ce qui n’est pas souhaitable.
D’autre part, cela met l’accent non seulement sur la sensibilisation aux violences sexuelles qui prennent leur origine sur le lieu de travail, mais aussi sur la sensibilisation aux violences conjugales. Cette disposition découle de la Convention n° 190 sur la violence et le harcèlement de l’Organisation internationale du travail (OIT), de 2019, qui met en avant les répercussions des violences domestiques sur les conditions de travail.
Nous ne nions bien entendu pas cet impact, mais il convient d’être prudent : il faut garder à l’esprit que le sujet des violences conjugales met potentiellement en jeu le partage très délicat d’informations personnelles et familiales, pour lequel le cadre de la promotion de la santé sur le lieu de travail par le SPST ne paraît pas pertinent. Les salariés peuvent déjà solliciter aujourd’hui l’assistant social ou le psychologue du service de santé au travail pour aborder des problèmes qui dépassent la sphère professionnelle. Selon nous, il est préférable de privilégier ces interlocuteurs et ce cadre plus protecteur de la confidentialité.
Enfin, une difficulté rédactionnelle se pose, puisqu’il est fait référence au personnel de santé au travail, sans qu’il soit précisé s’il s’agit du personnel recruté par le service de prévention et de santé au travail ou d’intervenants extérieurs auxquels le SPST pourrait avoir recours. Encore une fois, de notre point de vue, l’assistant social et le psychologue sont les professionnels les plus aptes à appréhender ces problématiques qui dépassent la sphère professionnelle.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le rapporteur sait déjà que je ne partage pas son avis sur l’amendement n° 160 rectifié ter de Mme Billon défendu par Mme Doineau.
Comme je l’ai déjà indiqué, notamment à M. Savary, j’apprécie beaucoup la qualité du travail du Sénat et son exigence d’éviter les lois trop bavardes. J’assume cependant, au nom du Gouvernement, la volonté d’envoyer un signal sur ce sujet spécifique. Certes, je ne peux le faire sur toutes les problématiques, mais il me semble que, sur cette question, nous partageons une sensibilité particulière du fait non pas seulement de l’actualité et des circonstances, mais de ce qui se passe dans la société.
Assumant ce geste au nom du Gouvernement, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 160 rectifié ter.
Sur les autres amendements, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Je partage les observations du rapporteur et retire donc l’amendement n° 28 rectifié bis, qui est satisfait. Les troubles auditifs sont pris en compte, cela a été confirmé.
Je suis défavorable à l’amendement n° 103, car – je suis d’accord, là aussi, avec le rapporteur – les campagnes de vaccination et de dépistage sont importantes. Je pense qu’il faut prendre en compte la santé dans son ensemble, globalement. Que l’on soit à son domicile ou au travail, quand on est malade, on est malade ! On peut parfois travailler tout en étant malade, parfois on ne le peut pas… Quoi qu’il en soit, la maladie ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise.
Il faut également valoriser le rôle du médecin du travail au travers d’actes tels que la vaccination et le dépistage. C’est pourquoi je suis favorable à ce que l’on lui accorde une faculté de prescription.
De même, il convient que les médecins généralistes, qui connaissent leurs patients dans leur milieu familial, en tout cas en dehors de leur milieu professionnel, puissent accéder à l’entreprise pour savoir comment les choses se passent et pour établir des « ponts ». Il s’agit ainsi de prendre en compte l’environnement global des patients.
Il faut ouvrir plus largement les barrières, comme le prévoient les accords concernés, et cela semble en bonne voie. Je suivrai donc l’avis des rapporteurs en la matière.

L’amendement n° 28 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 103.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 104, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Contribuent au suivi post-professionnel des salariés licenciés pour une inaptitude d’origine professionnelle. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Dans le prolongement de l’obligation de prévention qui incombe aux employeurs, cet amendement vise à permettre le suivi post-professionnel par les services de prévention et de santé au travail des salariés licenciés pour une inaptitude d’origine professionnelle.
Alors qu’un projet de décret modifiant les modalités du suivi post-professionnel des salariés, afin d’en simplifier l’accès, a été soumis à la mi-juin 2021 au Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT), il semble indispensable que les salariés à la retraite, au chômage ou inactifs puissent bénéficier d’une surveillance médicale, dès lors qu’ils ont été exposés à des produits à effets différés sur la santé.
Jusqu’à présent, un salarié devait présenter une attestation d’exposition cosignée par l’employeur et le médecin du travail pour bénéficier d’un suivi post-professionnel. Il est indispensable de faciliter les démarches des salariés et d’assurer ce suivi post-professionnel des personnes licenciées pour inaptitude par les services de santé.

Le suivi de l’état de santé des demandeurs d’emploi est un véritable enjeu de santé publique, que l’on sous-estime et qui reste l’angle mort de la médecine de prévention. Certaines études montrent qu’ils sont proportionnellement plus touchés par les maladies chroniques, les addictions, voire les suicides.
Pour autant, le suivi post-professionnel des personnes licenciées pour inaptitude ne peut pas être confié aux SPST dont le public recouvre, par définition, les salariés employés par les entreprises qui leur sont affiliées. C’est à ce titre que les ressources des SPST reposent sur les cotisations versées par les employeurs, lesquelles sont calculées en fonction de leurs effectifs salariés.
Par ailleurs, les SPST se sont vu reconnaître une mission dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, pour mieux anticiper l’impact sur la carrière des risques d’inaptitude. Les actions menées à ce titre doivent permettre de favoriser le maintien en emploi des personnes concernées.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 105, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Contribuent au suivi post-professionnel des salariés exposés à des agents chimiques dangereux. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Saisi par l’ancienne ministre du travail Muriel Pénicaud, le professeur Paul Frimat, spécialiste de médecine du travail, a rendu, en 2018, un rapport relatif à la prévention et à la prise en compte de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux. On pense, bien évidemment, au scandale d’État de l’amiante, mais aussi aux mineurs lorrains exposés aux polluants chimiques ou encore aux anciens salariés de Metaleurope, dans le Pas-de-Calais, qui mènent tous un combat pour la reconnaissance du préjudice d’anxiété.
Dans son rapport, le professeur Frimat liste vingt-trois recommandations pour une meilleure prévention et protection et un meilleur soin des travailleurs. Avec cet amendement, nous reprenons l’une de ces préconisations : l’application du suivi systématique des travailleurs exposés à des polluants chimiques après leur activité.
Pris de manière globale, ce changement de méthode est une réduction des coûts pour la sécurité sociale et un gain d’expertise pour les travailleurs, y compris les retraités. Ce suivi par la médecine du travail permettrait également de circonscrire l’anxiété et la difficulté de faire reconnaître le lien entre exposition et complications. Il s’agit d’un progrès pour l’ensemble des travailleurs, qui, par effet rebond, renforce également la responsabilité des employeurs, lesquels sont chargés de limiter les expositions aux produits considérés comme potentiellement toxiques.
C’est le sens du progrès social.

Je tiens tout d’abord à saluer le travail du professeur Frimat dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Son rapport aurait mérité d’avoir beaucoup plus d’écho, tant ses recommandations nous paraissent pertinentes.
Pour autant, le médecin du travail est déjà chargé, par l’article L. 4624-2-1 du code du travail, de procéder à un examen médical de chaque travailleur bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé au titre de l’exposition à des risques particuliers avant le départ à la retraite.
S’il constate une exposition à certains risques dangereux, notamment chimiques, le médecin du travail a la faculté de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant du travailleur.
Cet amendement étant satisfait par le droit en vigueur, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 101, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Après le cinquième alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout travailleur qui a été exposé, au cours de sa carrière, à un ou plusieurs agents chimiques dangereux précisés par décret, et qui a, à ce titre, bénéficié d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, est orienté sans délai vers le médecin du travail afin qu’une surveillance adaptée de son état de santé soit mise en place. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Pour les raisons exposées précédemment, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 106, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Assurent la traçabilité des expositions subies par les salariés. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Les services de prévention et de santé au travail doivent avoir pour mission d’assurer la traçabilité des expositions subies par les salariés.

La constitution par la médecine du travail d’un dossier médical en santé au travail est obligatoire pour chaque salarié suivi.
La commission des affaires sociales a, en outre, rappelé à l’article 12 que devront être consignées dans le dossier médical en santé au travail (DMST) toutes les données d’exposition à des risques professionnels de nature à affecter l’état de santé du travailleur.
L’objectif de cet amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L ’ article 4 est adopté.
(Non modifié)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-12, après les mots : « et sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que de services de prévention et de santé au travail, » ;
2° À l’article L. 6327-1, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 4622-2 du code du travail, ».

L’amendement n° 168 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase de l’article L. 3221-1, après le mot : « psychologues », sont insérés les mots : «, les services de prévention et de santé au travail » ;
La parole est à M. Martin Lévrier.

Il s’agit de prévoir que les services de santé au travail sont exclusivement impliqués en tant qu’acteurs mettant en œuvre les projets territoriaux de santé mentale (PTSM).
Alors que, selon les derniers résultats de CoviPrev, 19 % des Français souffrent d’un état dépressif et 21 % d’un état anxieux, il paraît essentiel que les services de prévention et de santé au travail se saisissent des sujets de santé mentale.
En effet, la notion de burn-out a fait son apparition dans notre langage courant depuis quelques années. Ce syndrome d’épuisement professionnel est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique.
La santé mentale, qui est essentielle à la santé au travail, doit être une priorité pour tous afin que soit assurée sa prise en compte non seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle.

Cette précision est bienvenue, puisqu’elle permet de positionner les SPST parmi les acteurs de la prévention qui participent à la mise en œuvre d’une politique liée à la santé mentale, notamment au regard des projets territoriaux de santé mentale.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 5 est adopté.
Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé. » –
Adopté.
(Non modifié)
La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6, les mots : « aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 4746-1 » ;
2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ;
3° À l’article L. 4314-1, qui devient l’article L. 4314-2, le 1° est complété par les mots : «, de les retirer du marché et de les rappeler » ;
4° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L. 4314-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4314 -1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
5° À l’article L. 4741-9, les références : « L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1 » sont supprimées ;
6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
« Art. L. 4746 -1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende le fait pour un opérateur économique :
« 1° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
« 2° De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement de travail ou un équipement de protection individuel n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable. » ;
7° Le titre V du même livre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
« Art. L. 4755 -1. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d’un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.
« Art. L. 4755 -2. – L’article L. 4751-2 ne s’applique pas au présent chapitre.
« Art. L. 4755 -3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 500 000 € le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314-2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.
« II. – Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
« Art. L. 4755 -4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

L’amendement n° 171, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 4311-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311 -6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314-1 sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.
« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;
II. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4314 -1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 de ce même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 précité, par les agents mentionnés au premier alinéa est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
L’article 7 a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, afin d’adapter le code du travail au règlement européen relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et au règlement européen relatif à la surveillance du marché.
Cet amendement vise à préciser et à compléter ces dispositions sur le volet des pouvoirs et des habilitations des administrations compétentes, l’objectif étant de remédier à des non-conformités de conception et d’éviter ainsi la survenance ou la reproduction des accidents, grâce à l’action de contrôle de l’administration.

Cet amendement, assez long, a en réalité une portée technique et s’inscrit dans les dispositions de l’article 7. Il vise à adapter le code du travail au droit de l’Union européenne en matière d’EPI et de surveillance de marché.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 225, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 5° de l’article L. 4311-7, la référence : « L. 4314-1 » est remplacée par la référence : « L. 4314-2 » ;
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11 à 13
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4746 -1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits :
« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;
« 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;
« 3° Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 euros.
« En cas de récidive légale, les faits mentionnés à l’alinéa précédent sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double ;
« 4° Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque ces faits concernent un équipement d’occasion ;
« 5° Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements visés au présent article pour son propre usage ;
« 6° En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741-10. »
II. – Alinéa 19
1° Remplacer le montant :
par le montant :
2° Après les mots :
opérateur économique
insérer les mots :
au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits
IV – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements visés au présent article pour son propre usage.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement est, là aussi, un peu technique et dans la même veine que celui que je viens de présenter.
Comme je l’ai indiqué, un amendement a été adopté en première lecture, à l’Assemblée nationale, visant à prendre les mesures indispensables à la pleine application du règlement européen relatif aux EPI et du règlement européen relatif à la surveillance du marché. L’objectif est de surveiller ce marché et de permettre les contrôles, afin de disposer de protections individuelles de qualité et d’éviter ainsi les accidents du travail.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 7 est adopté.

TITRE II
DÉFINIR L’OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET de SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 4622-9, sont insérés des articles L. 4622-9-1 à L. 4622-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622 -9 -1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.
« Art. L. 4622 -9 -1 -1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622-9-2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.
« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.
« Art. L. 4622 -9 -1 -2
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.
« II. – S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.
« L’administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s’être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans l’administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l’article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention de santé au travail qu’il administre. »
« Art. L. 4622 -9 -2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :
« 1° La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;
« 2° L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;
« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 du présent code. En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4622-10 est ainsi rédigé :
« Dans le respect des missions générales prévues à l’article L. 4622-2, de l’obligation de fournir l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des agences régionales de santé et, le cas échéant, des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail concernés. »
II. – Après l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 717 -3 -1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1 du code du travail. Celui-ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4641-2-1 du même code.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l’article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
« II. – Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification prévu à l’article L. 4622-9-2 du code du travail, adaptés aux modalités d’organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 du même code. »

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 56 est présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.
L’amendement n° 107 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 56.

L’article 8 crée une offre socle et une offre complémentaire pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), ainsi qu’une procédure de certification par des prestataires privés pour contrôler le service rendu.
Tout d’abord, le principe même d’une offre complémentaire est problématique.
Introduire une distinction entre une offre socle et une offre complémentaire nous paraît dangereux et inapproprié, compte tenu de l’objet même des services de santé au travail : éviter toute altération de la santé des salariés en lien avec leur travail. La santé et la sécurité des travailleurs ne sauraient comporter des composantes optionnelles.
De plus, cela entraînera une rupture d’égalité entre les travailleurs, selon que leur employeur contracte ou non une offre complémentaire.
Comme toute création d’une offre « à plusieurs vitesses » – faut-il rappeler les précédents ? –, l’expérience nous enseigne que la dynamique conduit à bloquer l’offre socle, voire à la réduire, au profit d’un étoffement de l’offre complémentaire, productrice de recettes elles-mêmes complémentaires pour les services de santé au travail.
Par ailleurs, comment cette offre complémentaire trouverait-elle des ressources humaines sans empiéter sur l’offre socle, alors que nous constatons l’espacement continu des visites, notamment pour des raisons de pénurie de professionnels comme d’objectif de baisse des coûts pour les employeurs ?
Enfin, le contrôle par des prestataires privés de la qualité du service rendu, y compris de son efficacité, nous paraît présenter un risque. En effet, la définition du cadre et des objectifs relève de missions d’ordre public social que doit seule définir la puissance publique par le moyen de son agrément.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l’article 8.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 107.

L’article 8 crée une offre socle que vous présentez comme une grande avancée sociale, monsieur le secrétaire d’État.
Si les salariés bénéficiaires de l’offre socle ont accès à des services de prévention et de santé au travail interentreprises, dits premium, qu’en sera-t-il pour les autres ? Quels services seront considérés comme facultatifs ?
Ce texte peut ainsi déboucher sur un système de santé au travail à deux vitesses. L’instauration d’une dichotomie entre offre socle de services et offre de services complémentaires peut conduire à des inégalités de traitement entre les salariés selon leur lieu de travail ou la taille de leur entreprise.
Le risque est également de voir les acteurs de la santé au travail se transformer en simples agents commerciaux.
Enfin, cet article prévoit une certification des services par la mise en œuvre des règles applicables aux services privés. Nous sommes favorables à l’agrément des services par la puissance publique, comme c’est le cas aujourd’hui, et refusons de déléguer la procédure au privé sans contrôle de la puissance publique.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 8.

La définition d’un ensemble socle de services et la mise en place d’une procédure de certification font partie des mesures structurantes prévues par l’ANI du 9 décembre 2020 et reprises par la proposition de loi, pour améliorer la qualité des services rendus par les services de prévention et de santé au travail interentreprises.
La commission a adopté cet article en lui apportant des améliorations, notamment des garanties sur le contenu de l’offre socle et une capacité d’initiative des partenaires sociaux sur le cahier des charges de la certification. Par conséquent, elle ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Je suis étonné et absolument consterné par cet article.
Monsieur le secrétaire d’État, madame le rapporteur, les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail sont censés remplir une mission définie, celle de garantir la santé d’un travailleur à son poste de travail.
Cette mission est inaliénable : rien ne peut en être retiré. Bâtir une offre socle laisserait penser qu’il est possible d’amputer des fonctions remplies par la médecine du travail et ses médecins un certain nombre d’éléments qui deviendront complémentaires. Pouvez-vous me préciser quels sont ces éléments ? Quel est l’objectif de cet article ?
À partir de quel moment pouvez-vous considérer que la médecine du travail remplit trop de fonctions et qu’il convient d’en amputer une partie pour bâtir une offre complémentaire, à l’image des mutuelles complémentaires par rapport aux offres socles de la sécurité sociale ? J’aimerais vraiment que vous m’apportiez des explications. Je le répète, je suis atterré par cette proposition, à l’instar de nombreux médecins du travail, malgré ce que vous en dites.
Par ailleurs, il existe des commissions de contrôle, qui sont constituées depuis des années : elles vérifient que les services de médecine du travail remplissent leur rôle. J’ai connu dans le passé des commissions de contrôle qui, de manière tout à fait légitime, ont retiré leur agrément à des services de médecine du travail.
En quoi l’intervention d’acteurs extérieurs privés permettrait-elle de mieux garantir que les commissions de contrôle que la médecine du travail remplit bien son rôle ? À qui cela va-t-il profiter ? Ni aux employeurs ni aux salariés ! J’aimerais une explication sur ce point.

Mon cher collègue, nous avons justement bien spécifié que l’offre socle reprenait l’ensemble des missions de base de la médecine du travail : elle intégrera donc tout.
Voici un exemple pour illustrer ce qu’est l’offre complémentaire : imaginons qu’un service de santé au travail procède à un audit sur le bruit dans une entreprise ; cette dernière souhaitera par la suite le faire tous les ans. La première fois, cet audit sera intégré dans l’offre socle ; les audits suivants seront inclus dans l’offre complémentaire, et payés différemment.
Nous avons consacré du temps à ce sujet parce que nous ne voulons pas d’une médecine du travail à plusieurs vitesses.
M. Guy Benarroche proteste.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Médevielle, Guerriau et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Menonville, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Decool, Capus, Malhuret, Verzelen, Milon, Klinger, Chatillon, Détraigne et Longeot, Mme Garriaud-Maylam, M. Nougein, Mme N. Delattre et MM. Laménie et Canévet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ses missions, le service de prévention et de santé au travail peut s’appuyer sur des intervenants extérieurs qualifiés.
La parole est à M. Joël Guerriau.

La proposition de loi confère de nouvelles prérogatives au service de prévention et de santé au travail (SPST) : aide à l’évaluation des risques, mise en place d’une offre de services complémentaire pour les salariés, mise en place d’une offre spécifique dédiée aux travailleurs indépendants.
Si le service de prévention et de santé au travail s’appuie sur ses seules expertises internes pour réaliser ces missions, au regard des moyens dont il dispose, ce développement quantitatif fait redouter un risque important sur la qualité des prestations qui seront fournies.
Afin que le SPST puisse répondre aux attentes fortes découlant de ces nouvelles missions, sans négliger les missions préexistantes, singulièrement le suivi individuel, il nous paraît indispensable de prévoir qu’il puisse faire appel à des professionnels indépendants qualifiés, par exemple des ergonomes ou des acousticiens, aussi bien pour le socle de services obligatoires que pour l’offre de services complémentaire.

Cet amendement est selon nous satisfait par le droit actuel. Un service de prévention et de santé au travail peut faire appel à des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) externes pour des missions spécifiques. Nous reconnaissons, bien sûr, le rôle important de ces intervenants, mais le fait de l’inscrire dans la loi n’améliorera pas le droit existant.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, vous avez mis le doigt sur une petite ambiguïté. Il est vrai que les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter l’ensemble des professionnels dont ils ont besoin pour réaliser leurs missions. Toutefois, le recours explicite de façon ponctuelle pour assurer certaines missions n’est pas reconnu en tant que tel. C’est ce que vous avez voulu faire reconnaître, me semble-t-il, et ce point mériterait en effet d’être précisé.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 193, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
après avis du comité régional de prévention et de santé au travail compétent,
La parole est à M. Martin Lévrier.

Cet amendement tend à supprimer l’avis du comité régional de prévention et de santé au travail sur l’agrément visé par l’article 8. Cette mission ne fait, en effet, pas partie des modalités prévues par l’ANI. Il nous paraît préférable de rester au plus près de cet accord, comme nous le soulignons tous depuis le début de la discussion.
De plus, il ne paraît pas souhaitable que les comités régionaux de prévention et de santé au travail aient à se prononcer à ce sujet. Bien que leur rôle prévoie l’élaboration des référentiels de certification, celui-ci ne comprend pas qu’ils se prononcent sur une procédure administrative individuelle.

L’article 8 élève au niveau législatif la procédure d’agrément administratif des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI). La commission a proposé, en cohérence avec la réforme de la gouvernance territoriale de la santé au travail, que le comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST), institué par la proposition de loi au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail (Croct), formule un avis sur cet agrément pour les SPSTI relevant de son ressort territorial. Le CRPST est notamment composé de représentants des organisations syndicales et patronales représentatives.
Avis défavorable sur cet amendement qui revient sur cet apport de la commission.
Concernant l’avis du CRPST sur les demandes d’agrément, ma lecture est différente de celle de la commission.
Monsieur le sénateur, vous proposez de supprimer la consultation du comité régional de prévention et de santé au travail. Cette proposition me paraît souhaitable.
L’agrément est délivré par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), après qu’elles ont procédé à une instruction de la demande. Il existe 720 services de prévention et de santé au travail. Le passage préalable pour avis de l’ensemble des dossiers au sein du CRPST me paraît vraiment chronophage. Traiter 720 demandes est très lourd, ce qui peut entraîner un risque de retard dans le déploiement de ces services.
J’ai examiné d’un point de vue strictement opérationnel la charge de travail qui découlerait de cette mesure avant de faire un arbitrage et je suis favorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 108, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

L’article 8 crée une nouvelle procédure de certification très peu encadrée pour les services de prévention et de santé au travail. L’enjeu est, je le rappelle, la protection de la santé de celles et ceux qui travaillent dans l’entreprise.
Actuellement, les employeurs ont l’obligation d’avoir recours à un service de santé au travail autonome ou intégré, dont les missions sont définies, contrairement à ce que prévoient l’offre socle et l’offre premium. Cela pose un problème d’égalité entre les salariés, qui bénéficieront d’une protection différente selon l’entreprise dans laquelle ils seront embauchés et selon le degré de protection que cette entreprise pourra offrir.
En renvoyant la certification à des organismes indépendants privés non identifiés, vous privatisez l’action publique en matière de santé au travail. Il nous semble au contraire nécessaire de renforcer la procédure d’agrément opérée par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et de donner aux services de prévention et de santé au travail les moyens d’embaucher davantage de professionnels pour exercer leurs missions.
Cet article porte atteinte à la philosophie même du rôle des médecins du travail, qui ne veulent pas mener une intervention a minima si l’entreprise n’a pas souscrit à l’offre premium.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 8.

L’amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
1° Première phrase
Remplacer les mots :
sur proposition
par les mots :
après avis
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le décret mentionné au sixième alinéa de l’article L. 4622-9-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est publié au plus tard au 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail disposent d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement vise à rétablir l’avis du comité national de prévention et de santé au travail sur les référentiels de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises, au lieu de leur confier un rôle de proposition. Il tend également à préciser la date de publication du décret d’application correspondant.
Ce sujet paraît quelque peu technique, mais je veux m’y arrêter quelques instants. Des discussions ont eu lieu à l’Assemblée nationale sur l’avis rendu par le Conseil d’État et c’est la raison pour laquelle je vous présente cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs.
Lors de vos travaux en commission, vous avez modifié les attributions du comité national de prévention et de santé au travail en lui confiant un rôle de proposition, et non plus d’avis, sur les référentiels et les principes qui guident l’élaboration du cahier des charges de certification. C’était le souhait initial des partenaires sociaux : vous êtes donc tout à fait dans la logique que nous avons évoquée à plusieurs reprises ce soir lors de nos débats.
Toutefois, le Conseil d’État a estimé qu’une telle disposition présentait une fragilité juridique. C’est pourquoi l’Assemblée nationale a retenu une rédaction garantissant la sécurité juridique du dispositif que je souhaite voir rétablie. Par ailleurs, il s’agit de fixer la date de publication du décret sur la certification au plus tard le 30 juin 2022. Cette échéance permettra de garantir que la procédure se fera dans le respect du dialogue social, conformément à l’esprit qui a présidé à l’ANI, s’agissant de cette évolution majeure.
Tel est l’objet de cet amendement.

Le sous-amendement n° 226, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 187, alinéas 1 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 226 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 108 et 187.

La commission a prévu de laisser aux partenaires sociaux, par l’intermédiaire du CNPST, l’initiative de la détermination du cahier des charges de la certification introduite par l’article 8. En cas d’absence de proposition du CNPST à l’issue d’un délai déterminé, les référentiels seraient fixés par décret en Conseil d’État.
Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement du Gouvernement revient sur cet apport de la commission en instaurant un simple avis du CNPST. Nous sommes en désaccord sur ce point. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé ce sous-amendement, qui vise à conserver la rédaction de la commission.
J’en viens à l’avis de la commission sur les amendements n° 108 et 187.
L’introduction d’une procédure de certification des SPSTI est l’une des mesures structurantes de la proposition de loi qui doit permettre, devant le constat partagé d’une forte hétérogénéité des services rendus par les SCCI, d’améliorer leur qualité et leur effectivité. C’est véritablement ce qui a animé la commission dans son travail.
On ne peut en effet se satisfaire de la procédure existante d’agrément administratif, dont la portée est en pratique très limitée. La procédure sera encadrée par des référentiels fixés par l’État, sur lesquels les partenaires sociaux auront leur mot à dire au travers du CNPST.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 108.
L’amendement n° 187 a deux objets distincts.
D’une part, il tend à supprimer la modification apportée par la commission dans la détermination du cahier des charges de la certification, réduisant ce rôle à un simple avis pour le CNPST. Le sous-amendement de la commission revient sur ce point.
D’autre part, le décret serait publié au plus tard le 30 juin 2022. Les SPSTI disposeraient ensuite d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification, ce qui suppose une certification de l’ensemble des SPSTI au plus tard le 30 juin 2024. Ce calendrier semble raisonnable si l’on souhaite que la loi soit pleinement appliquée. La commission est donc favorable à la seconde partie de cet amendement.
En conclusion, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 187, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.
Comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 108, tant sur le fond que sur la forme.
Sur le sous-amendement n° 226, je le redis, je ne mène pas ici un combat que j’estime peu productif. Je souhaite seulement ne pas exposer l’élaboration du cahier des charges de la certification à une fragilité juridique – je n’ai aucune autre motivation. Pour cela, je m’appuie sur l’avis du Conseil d’État : il n’est pas possible de lier le Gouvernement comme le prévoit votre rédaction, même si, comme je l’ai rappelé, c’est celle que souhaitent les partenaires sociaux.
J’insiste, je ne poursuis ici qu’une quête de sécurité juridique et je ne cherche pas à attribuer une prérogative particulière au Gouvernement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 226.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 57, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou y mettre fin,
par les mots :
, y mettre fin ou prendre toute autre mesure, y compris des pénalités financières,
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

L’article 8 prévoit de mettre dans la partie législative du code du travail les sanctions prévues dans la partie réglementaire relatives aux services de santé qui dysfonctionnent. Il s’agit du retrait ou de l’absence de délivrance de l’agrément, ou bien de la délivrance d’un agrément pour une durée limitée à deux ans.
Souvent, le refus ou le retrait d’un agrément ne met toutefois pas fin à l’activité du service ou n’entraîne pas sa dissolution. Des services de santé continuent donc de fonctionner en l’absence d’agrément. Par ailleurs, il arrive que certaines Direccte ne soient pas en mesure de refuser un agrément, du fait du monopole territorial du service examiné.
Il paraît donc nécessaire de prévoir la possibilité de prendre d’autres mesures afin de contraindre les services à mettre un terme à leurs dysfonctionnements, compte tenu des conséquences que ceux-ci ont sur les salariés suivis.
Par cet amendement, nous proposons que l’autorité administrative puisse sanctionner financièrement ces services et, beaucoup plus largement, que toute autre sanction puisse être prise pour mettre fin aux dysfonctionnements.
Ainsi, l’autorité administrative pourrait ordonner le regroupement d’un service non efficient avec un service voisin, voire révoquer le président du service.
Cette proposition va dans le sens voulu par les partenaires sociaux signataires de l’ANI, qui se sont prononcés pour des sanctions graduées.

Cet amendement a pour objet de mettre à disposition de l’administration des sanctions graduées, notamment financières, contre les SPSTI qui ne remplissent pas leurs obligations.
Cette proposition semble devoir être écartée : les sanctions ne seraient pas forcément incitatives pour le SPSTI concerné, car celui-ci n’a pas forcément les moyens d’accomplir ses missions. L’administration pourrait également être réticente à recourir à ces sanctions, alors qu’elle devrait, dans le même temps, accompagner la structure.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 192, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Martin Lévrier.

Comme cela a été le cas avec notre amendement précédent, nous souhaitons rester au plus près de l’ANI. Or un système d’administration provisoire des services de prévention et de santé au travail dans les situations où des défaillances graves en termes d’organisation sont constatées n’en fait absolument pas partie.
La possibilité de retirer un agrément existe déjà et constitue un dispositif dissuasif efficace dans les situations précitées. De plus, le dispositif proposé risquerait d’être en inadéquation avec le retrait de certification déjà existant.

Le principe de l’agrément par l’administration des SPSTI est élevé au niveau législatif par l’article 8, mais ses effets ne sont pas renforcés, si ce n’est qu’il tient désormais compte simplement de la certification du service.
Afin de doter l’administration d’un moyen d’action plus efficace et constructif que le retrait d’agrément en cas de difficulté grave d’organisation et de fonctionnement, la commission a proposé l’introduction d’un régime d’administration provisoire qui doit permettre, sans interrompre le service, de lui donner les moyens de se réorganiser. Ce dispositif est inspiré du régime applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Il s’agit bien entendu d’un instrument qui serait utilisé par l’administration en dernier ressort et dans des cas précis, notamment en cas de crise grave de gouvernance ou d’organisation. La commission est bien entendu défavorable à sa suppression.
Nous avons essayé de trouver un système fonctionnel. Si l’agrément est retiré, vers quel service de santé pourraient se tourner les entreprises ? Il n’y en a pas d’autres !
Nous avons réfléchi à cette question lors des auditions que nous avons menées et du travail que nous avons réalisé et n’avons trouvé que cette solution.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je vais expliquer pourquoi.
D’abord, comme on l’a évoqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ne sont pas prévues dans l’ANI. Il faut donc examiner avec soin celles qui n’y figurent pas et que l’on souhaite introduire dans le texte, comme c’est en l’espèce le cas.
Dans le même temps, j’entends bien la réflexion que vous avez menée afin de trouver une solution. Je crois qu’il en existe une – même si elle est lourde, vous avez raison, madame le rapporteur.
L’administration dispose du levier de l’agrément : elle pourra désormais en définir la durée ou y mettre fin en fonction des résultats de la procédure de certification du service. C’est une nouveauté. Cela facilitera le retrait provisoire de l’agrément et permettra d’avoir une approche plus pédagogique, puisqu’il sera nécessaire d’aligner la certification du service sur ce qui sera proposé.
Une administration provisoire pose tout de même quelques questions techniques. J’ai beaucoup réfléchi à cette question, car il me semble intéressant de chercher des solutions aux difficultés qui se présentent. Pour être honnête, je doute qu’il soit juridiquement possible de mettre sous administration provisoire une structure associative de droit privé qui relève de la loi de 1901. Je ne vois pas sur quel fondement juridique s’appuyer : je vous le dis franchement, je pense que cela ne passera pas ! On est au-delà de la fragilité juridique…
J’apporte donc un soutien extrêmement pragmatique, je le redis, à l’amendement n° 192, et ce pour deux raisons. D’une part, avec la certification de service, le risque de retrait de l’agrément sera plus facile à gérer qu’aujourd’hui, d’autre part, la disposition relative à l’administration provisoire d’une société, association de droit privé relevant de la loi de 1901, ne me paraît pas tenable juridiquement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 75 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Bonhomme, Chatillon, Daubresse, Cambon et B. Fournier, Mme Demas, MM. Savin et Savary, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, M. Bouloux, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genet, Mmes Dumont, Garriaud-Maylam, L. Darcos, Imbert et Di Folco, M. Rapin, Mme Malet, MM. Brisson et Milon, Mme M. Mercier et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4622 -9 -…. – Les services de prévention et de santé au travail peuvent comprendre un service de chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l’emploi qui prennent en charge les situations désignées par la cellule maintien en emploi des services de prévention et de santé au travail en collaboration avec le médecin du travail. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.

Les inaptitudes sont l’un des événements les plus générateurs de désinsertion professionnelle et sociale. Avec les restrictions d’aptitude, elles concernent tous types de public, dont un grand nombre ne sont pas reconnus comme travailleurs handicapés. Cela va dans le sens de l’inclusion.
La prise en charge de ce type de dossier est chronophage : ces situations demandent un suivi important qui ne peut être réalisé par le médecin du travail, par manque de temps, de connaissance des acteurs et des dispositifs qui évoluent constamment.
En fonction des besoins, les chargés de mission de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien en emploi pourront prendre ces dossiers en charge et, à ce titre, faire partie de l’équipe médicale. Dans ce cadre, ils devraient être pris en compte dans l’offre socle, tout comme les infirmiers ou les assistantes sociales.
La prise en compte de ces situations et leur traitement par les chargés de mission permettent de limiter les licenciements grâce à la mise en œuvre d’aménagements, d’organisations spécifiques ou d’orientations précoces, de généraliser, dans le cadre de la prévention primaire, les solutions trouvées, d’éviter, pour l’entreprise ou pour la collectivité, de futurs surcoûts liés au licenciement, enfin, de favoriser le développement d’une culture de prévention par la mise en place de nouveaux outils.
Sur le territoire, plusieurs services de prévention et de santé au travail ont fait la démonstration de l’efficacité de la présence de chargés de mission pour maintenir en interne des personnes en activité.
Cela se vérifie notamment pour les services ayant une forte pénurie de médecins du travail.

Nous partageons l’objectif de prévention de la désinsertion professionnelle, et comprenons bien l’intention de M. Mouiller.
Toutefois, rien n’empêche aujourd’hui les services de prévention et de santé au travail de créer des équipes de chargés de mission, qui sont d’ailleurs efficaces. Inscrire cette possibilité dans la loi ne permet pas d’améliorer le droit existant.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui semble satisfait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Sur cet amendement, j’ai la même divergence d’interprétation avec les rapporteurs que sur l’amendement précédent.
Autant les services au travail peuvent aujourd’hui recruter des intervenants, autant il n’est pas du tout explicité qu’ils peuvent s’appuyer sur des intervenants extérieurs occasionnels.
Monsieur le sénateur, vous revenez sur le même sujet. Vous ne serez donc pas surpris que le Gouvernement émette également un avis favorable sur cet amendement.
Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Médevielle, Guerriau et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Wattebled, Decool, Capus, Malhuret, Verzelen, Milon, Klinger, Chatillon et Détraigne, Mme de La Provôté, M. Longeot, Mme Garriaud-Maylam, M. Nougein, Mme N. Delattre et MM. Laménie et Canévet, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Après le mot :
compétents
insérer les mots :
et, le cas échéant, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
La parole est à M. Joël Guerriau.

L’accord national interprofessionnel sur la santé au travail, signé le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux, considère que la branche professionnelle est un cadre privilégié pour formaliser les grandes priorités dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
Cet accord précise, par ailleurs, que les services de santé au travail de branche, qui participent activement à la prévention des risques professionnels dans les secteurs concernés, doivent conserver leurs spécificités. Dans ces conditions, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des services de branche intègrent les priorités par branche professionnelle.
En complément, dans un secteur spécifique comme le BTP, doté de différentes structures « santé prévention », il est nécessaire pour la bonne articulation entre les acteurs que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) soit également conclu avec l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), dont l’existence, l’organisation et le déploiement des missions actuelles sont réaffirmés par l’accord national interprofessionnel.

Cet amendement prévoit de transformer dans le secteur du BTP le CPOM, qui encadre l’activité des SPSTI, en une convention quadripartite incluant la signature de l’organisme professionnel de prévention du BTP, l’OPPBTP.
Si l’OPPBTP peut légitimement avoir un droit de regard sur le cadre de l’action des services actifs dans le secteur du bâtiment, le dispositif proposé est source de complexification. De fait, cette pratique, prévue par une convention en date de 2011, a été abandonnée du fait de sa lourdeur.
Pour répondre aux mêmes besoins, le texte de la commission prévoit un avis de l’OPPBTP sur les CPOM concernant le secteur du BTP, ce qui semble une solution plus opérationnelle.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 8 est adopté.
L’article L. 4622-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer l’ensemble de leurs missions ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail prévus aux articles L. 4622-7 et suivants. »

L’amendement n° 227, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
prévus aux articles L. 4622-7 et suivants
par les mots :
mentionnés à l’article L. 4622-7
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 8 bis est adopté.
I. – L’article L. 4622-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L. 4622-9-1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au-delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622-9-1. » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code. »
II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 717-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à L. 717-3-1. » –
Adopté.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1°
2° Il est ajouté un article L. 4622-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622 -16 -1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622-9-1, son offre de services complémentaires, le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution, ainsi que l’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.
« Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret. » –
Adopté.
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail peuvent accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès à tout ou partie du contenu de son dossier.
« L’accès au dossier médical partagé ne peut être accordé oralement par son titulaire à l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa. La demande d’accès du professionnel de santé est effectuée de façon dématérialisée conformément à une procédure définie par voie réglementaire qui permet, par l’intermédiaire de l’application ou du site internet de consultation du dossier médical partagé, d’alerter son titulaire du dépôt de cette demande et de l’informer quant aux possibilités de ne pas y répondre, ou de refuser ou de restreindre l’accès au contenu de son dossier.
« Les informations consultées dans le dossier médical partagé par le professionnel de santé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111-18 est supprimé ;
3°
II. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du II de l’article L. 4624-7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : «, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, » ;
2° Après l’article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624 -8 -1. – Le travailleur peut s’opposer à l’accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624-1 du présent code à son dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624-4 du présent code. Il n’est pas porté la connaissance de l’employeur. »
III. – Au premier alinéa du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 58 est présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.
L’amendement n° 109 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 150 est présenté par Mme Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 58.

L’article 11 permet aux professionnels de santé des services de prévention et de santé au travail d’accéder au dossier médical partagé (DMP).
Cet accès irait bien au-delà de la pratique, déjà possible, permettant au médecin du travail, après accord du salarié, d’entrer en contact avec le médecin traitant de celui-ci, sans pour autant accéder à l’ensemble des données de santé. Il s’agit d’une pratique très courante, qui suffit pour permettre au médecin du travail d’accomplir sa mission.
L’accès au dossier médical partagé est interdit et les raisons ayant conduit à cette interdiction sont celles-là mêmes qui nous amènent, aujourd’hui encore, à proposer la suppression de cet article, malgré les modifications introduites par la commission.
Une telle faculté présenterait un risque pour l’intégrité des données personnelles de santé des salariés, dont le consentement ne saurait être totalement libre dans le cadre de la relation de subordination qu’est la relation de travail. Elle présenterait également un risque de jugement des habitudes de vie des travailleurs, de discrimination, voire de sélection de la main-d’œuvre, ce qui est totalement éloigné de la logique de prévention, laquelle consiste à adapter le travail et les conditions de travail au travailleur, au cours de son parcours professionnel, et non l’inverse.
Si la médecine du travail doit avoir les moyens de juger des risques d’altération de la santé du salarié en lien avec son travail, notamment via un suivi régulier du salarié et de ses conditions concrètes de travail, l’accès à l’ensemble du dossier médical serait disproportionné au regard de la spécificité des missions dévolues.
En revanche, la possibilité pour le service de prévention et de santé au travail de verser au dossier médical partagé l’étude des expositions du salarié aux risques de l’environnement professionnel peut être utile au médecin traitant, sous réserve de l’accord du salarié.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’accès du service de prévention et de santé au travail au dossier médical partagé.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 109.

L’article 11 donne aux médecins et infirmiers du travail un accès au dossier médical partagé, après accord du salarié.
D’une part, cette disposition entretient une confusion entre santé publique et santé au travail. D’autre part, cette mesure permettrait à la médecine du travail d’avoir accès aux données de santé sensibles contenues dans le dossier médical partagé des salariés, ce qui pose la question de la confidentialité de ces données.
Si la santé publique doit s’intéresser à la santé au travail, la réciproque ne me semble pas opportune. Il est nécessaire que le médecin traitant ait accès aux données du médecin du travail, notamment pour évaluer et étudier les causes professionnelles de certaines pathologies ; en ce sens, les choses sont clairement établies. En revanche, nous ne partageons pas l’idée selon laquelle le médecin du travail doit avoir accès aux données de santé contenues dans le DMP.
Nous nourrissons des inquiétudes notamment pour les informations confidentielles des personnes en affection longue durée. Je pense particulièrement à la séropositivité et à la transition des personnes transgenres ; nous craignons que ces personnes ne fassent ensuite l’objet de discriminations.
Cette disposition étant, selon nous, source de danger, nous proposons de la supprimer.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 150.

Si donner un accès en écriture au dossier médical partagé au médecin du travail, afin de pouvoir y verser des éléments relatifs aux risques propres au salarié, présente un intérêt indéniable, l’inverse n’est pas vrai : les données personnelles de santé des salariés ne doivent pas être visibles par le médecin du travail.
En effet, permettre au médecin du travail d’accéder à ces données, même avec l’accord du patient, risque d’être préjudiciable au salarié, en particulier lors des visites d’embauche et de reprise du travail, lorsqu’une adaptation de l’emploi est nécessaire. L’accès aux données médicales constitue une atteinte aux droits fondamentaux des personnes, de nature à discriminer les salariés ayant une pathologie connue dans leur recherche d’emploi ou dans leur travail.
En outre, comme l’explique le sociologue Pascal Marichalar, cela pourrait conduire des médecins du travail voulant travailler « en paix » à avoir intérêt à s’en tenir à une délimitation consensuelle de l’activité, qui correspondrait aux attentes des employeurs.
Le médecin du travail est aussi conduit à se désintéresser des maladies professionnelles, comme ce fut le cas pour l’amiante, et à focaliser son attention sur les aptitudes propres du salarié à remplir les missions qui lui sont dévolues, et non l’inverse.
Nous insistons donc sur la nécessité que le médecin du travail dispose simplement d’un accès spécifique et cloisonné au DMP, lui permettant de consigner les comptes rendus de visite, l’exposition à d’éventuels risques, les aménagements des situations de travail et les contre-indications médicales, mais rien de plus et surtout sans droits de lecture.
Il convient de prémunir les salariés contre ce risque et de supprimer cette disposition.

Le décloisonnement entre la médecine du travail et la médecine de ville suppose un partage réciproque d’informations dans l’intérêt du travailleur, avec, bien entendu, le consentement de ce dernier et dans le respect de la plus stricte confidentialité des données. Les modifications apportées par la commission des affaires sociales visent précisément à renforcer cet encadrement, afin de préserver la confiance et la relation entre le médecin du travail et le travailleur ; elles devraient répondre aux inquiétudes des auteurs de ces amendements de suppression.
J’ai toujours un peu de mal avec cette question, parce que les médecins, qu’ils soient médecins du travail ou médecins de ville, agissent dans un cadre totalement confidentiel ; ils sont avant tout médecins. Vous soulignez que le médecin traitant doit pouvoir savoir ce qu’il se passe dans l’entreprise ; or je sais d’expérience que le médecin du travail a souvent besoin de connaître également l’état de santé du salarié, afin justement de permettre à celui-ci de conserver son poste.
Nous examinons un texte sur la prévention et le maintien dans l’emploi ; je ne comprends pas ces amendements. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme le rapporteur a raison de rappeler que les médecins du travail et les médecins généralistes ont la même formation : ils sont médecins ; d’ailleurs, les médecins du travail ont une spécialité supplémentaire. Tous sont donc soumis à une totale obligation de confidentialité.
Toutefois, je peux concevoir les réserves qui sont émises – elles l’ont aussi été à l’Assemblée nationale. Je ne trouve pas du tout illégitimes les questions qui sont soulevées et il me semble utile que l’on en débatte.
Le travail accompli par l’Assemblée nationale autour de ces questions vise à garantir que cet accès ne puisse se faire sans un consentement éclairé du salarié qu’il renouvelle à chaque consultation : il ne saurait s’agir d’un consentement que l’on donnerait pour cinq ou dix ans. Au travers de cette démarche, on entend garantir la parfaite information du salarié.
Le risque que vous pointez a trait au lien entre un médecin qui peut prononcer une inaptitude professionnelle et le médecin traitant. Or Mme le rapporteur a bien répondu à cette question : d’une part, si le salarié ne souhaite pas donner d’informations ni consentir à l’accès au DMP, il ne le fait pas, donc rien de nouveau par rapport à aujourd’hui ; d’autre part, s’il souhaite donner des informations pour bénéficier d’un aménagement de poste – nous avons évoqué tout ce qui, dans cette proposition de loi, vise à prévenir la désinsertion professionnelle –, les éléments fournis seront utiles au médecin du travail.
Cela dit, j’y insiste, cela ne sera possible que si le salarié l’accepte ; s’il ne le souhaite pas, cela ne se fera pas.
Je le répète : ces questions, qui ne sont pas du tout illégitimes, ont été soulevées à l’Assemblée nationale et la rédaction de l’article 11 en tient compte. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Mme Émilienne Poumirol. Monsieur le secrétaire d’État, les médecins généralistes ont, comme les médecins du travail, quatre ans de spécialisation !
M. le secrétaire d ’ État acquiesce.

Par ailleurs, que l’on soit médecin généraliste ou médecin du travail, on est tenu par le secret professionnel, c’est indéniable. Il n’empêche ; le diable se cache dans les détails. Aujourd’hui, comme de tout temps, les médecins du travail et les médecins généralistes se téléphonent et discutent de la situation du patient, mais le DMP est un document écrit, qui peut être transmis et qui comporte des traces de ce qui est constaté. Or échanger par téléphone, ce n’est pas la même chose que communiquer des informations par écrit.
Ainsi, permettre au médecin du travail d’accéder au dossier médical partagé pourrait conduire ce praticien à porter une attention particulière sur tel ou tel salarié qui a des problèmes de santé pouvant nuire à son activité et à procéder à une déclaration d’inaptitude.
Je reste donc très méfiante, car un échange téléphonique, par définition oral, est très différent du DMP, qui reste un document écrit. Je persiste à penser qu’il faut supprimer cet article.

Je souhaite lever une ambiguïté.
Mes chers collègues, vous indiquez dans le même temps que le médecin généraliste doit pouvoir connaître ce qu’il se passe dans la vie professionnelle de son patient, lequel doit être traité en tenant compte de son environnement professionnel, mais que le médecin du travail ne doit pas pouvoir savoir ce qui se passe en dehors du travail, du point de vue médical.
Or ce sont tous deux des médecins ! Il y a le serment d’Hippocrate, la déontologie, le secret médical ! Sans doute, ces praticiens peuvent échanger par téléphone, mais le médecin du travail peut aussi avoir besoin de consulter le résultat d’examens complémentaires particuliers. Dans le dossier médical partagé figurera, par exemple, le scanner d’une pathologie de la colonne vertébrale d’un patient et le médecin du travail jugera, en fonction de ces éléments, si le salarié peut ou non porter des charges lourdes et dans quelle mesure son poste de travail doit être adapté. Il a donc besoin de ce document, que le patient n’a plus en sa possession, mais qui est enregistré dans le dossier médical partagé. En outre, le consentement du salarié est requis.
Par conséquent, si l’on veut améliorer la prévention et protéger, du point de vue sanitaire, le personnel des entreprises, il faut profiter de moyens modernes, en ayant accès au dossier médical partagé. Cela me paraît incontournable. On ne pratique plus la médecine du XXe siècle, il est temps d’accepter la médecine du XXIe siècle !
En outre, des garanties de sécurité existent ; les examens figurant dans le dossier sont cryptés ; toutes les mesures de sécurité nécessaires sont prises. Je ne vois donc pas pourquoi on cacherait ce dossier au médecin du travail, à moins de considérer qu’il ne se place pas sur le même plan qu’un médecin de ville ; or ce sont véritablement des médecins. Soyons-y attentifs.
Ainsi, mes chers collègues, si vous me le permettez, je vous invite à retirer vos amendements.

Monsieur Savary, vous demandez vous-même pourquoi les salariés cacheraient quelque chose. Tout est là !
Le salarié doit pouvoir refuser que sa vie soit connue à 360 degrés, il peut penser que cela ne regarde pas le médecin du travail. Ce dernier peut tout à fait, sur un point particulier, interroger le médecin traitant, mais le salarié peut n’avoir pas envie que l’ensemble des résultats de ses examens soient portés à la connaissance du médecin du travail.
Or, s’il refuse de donner son consentement au moment de l’embauche, le médecin du travail se demandera ce qu’il cache. C’est cela qui ne va pas ! Cet accord du salarié est biaisé. Ne croyez pas que toutes les parties soient également libres de refuser ou d’accepter. Personnellement, sans rien avoir à cacher, je ne permettrais pas à un médecin du travail d’accéder aux résultats de tous les examens que j’ai réalisés au cours de ma vie.
Monsieur le secrétaire d’État, vous indiquez que le consentement du salarié sera éclairé, mais ce dernier n’aura pas forcément conscience de tous les enjeux du partage de ses habitudes de vie et de ses problèmes de santé, y compris les dépressions, les hospitalisations pour dépression et les cures de désintoxication.
J’ai été marquée par le fait que vous sous-entendiez que le patient n’aurait rien à cacher. Or, si le salarié refuse, le médecin du travail se demandera justement ce qu’il cache. Comme le dit le philosophe, il vaut mieux que la question ne soit pas posée ! En revanche, le salarié peut autoriser le médecin du travail, sur un problème particulier de santé, contacter son médecin généraliste.
Le médecin généraliste est dans une autre situation. Il s’agit non pas de lui communiquer tout ce qui concerne la vie professionnelle de son patient, mais de lui indiquer, par exemple, son degré d’exposition à certains agents chimiques. Seule une partie des données est communiquée, non toute la réalité du travail.
Vous semblez ignorer que le refus du salarié peut avoir des conséquences et vous faites comme si l’accès aux données de santé n’avait aucun impact.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 59, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
exprès
insérer le mot :
écrit
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Cet amendement, qui a trait à la notion de consentement éclairé, est un amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression de l’article 11, qui permet au médecin du travail d’accéder au dossier médical partagé après accord du salarié.
À défaut de supprimer l’accès à ce dossier, il convient de garantir au mieux l’expression du libre consentement du salarié au partage de ses données personnelles de santé. En effet, l’ouverture du dossier médical partagé au médecin du travail doit recueillir l’accord sans ambiguïté du salarié. Ainsi, après l’ajout par l’Assemblée nationale de la nécessité du recueil du consentement éclairé du salarié – cela ne figurait pas dans la version initiale de la proposition de loi, remercions donc les députés de cette avancée – et en complément des modifications apportées par la commission pour renforcer le consentement du salarié, ce qui est tout à fait positif, il nous paraît nécessaire de mentionner que ce consentement devra être recueilli par écrit.
Mes chers collègues, chaque fois qu’une décision nécessite le consentement éclairé de l’intéressé, cela passe par l’écrit. Quand on doit signer en bas d’une feuille, on lit ce que l’on signe et on réalise l’importance de ce que l’on autorise.
Selon moi, un consentement éclairé doit être délivré par écrit.

Cet amendement tend à prévoir que le consentement du travailleur à l’accès de la médecine du travail à son DMP devra être écrit.
Nous partageons le souci de garantir le libre consentement du travailleur. C’est pourquoi la commission des affaires sociales a modifié l’article 11 pour prévoir que ce consentement ne pourra pas être donné oralement, mais devra emprunter une voie dématérialisée préservant le libre choix du travailleur. Cette voie de consentement nécessitera une intervention de la personne concernée, via l’application ou le site internet de consultation de son DMP.
Puisque cela permet de répondre à votre préoccupation, madame Poncet Monge, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Même avis.
Des dispositions du code de la santé publique prévoient déjà cela. L’alignement retenu par la commission des affaires sociales est bienvenu.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 228, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition superfétatoire.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 11 est adopté.

Mes chers collègues, nous avons examiné 73 amendements au cours de la journée ; il en reste 110.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021 est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 6 juillet 2021 :
À quatorze heures trente et le soir :
Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour renforcer la prévention en santé au travail (texte de la commission n° 707, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 6 juillet 2021, à zéro heure trente-cinq.