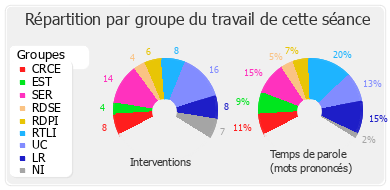Séance en hémicycle du 16 mars 2023 à 9h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (voir le dossier)
- Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur un projet de loi (voir le dossier)
- Allocation logement et habitat non décent (voir le dossier)
- Lutte contre la désertification médicale des collectivités (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (texte de la commission n° 436, rapport n° 435).
La parole est à Mme la rapporteure.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la commission mixte paritaire réunie hier pour examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) pour 2023 est parvenue à établir un texte commun.
Lors de ses travaux, René-Paul Savary et moi-même avons veillé à rester fidèles à l’esprit de la majorité sénatoriale. Cette réforme, qui, nous le savons, demandera des efforts aux Français, doit atteindre pleinement son but : ramener notre système de retraite à l’équilibre à l’horizon de 2030, afin de garantir sa soutenabilité financière au bénéfice des générations futures.
C’est en ayant cet objectif en tête que, tout en inscrivant ses marqueurs dans le texte, le Sénat a veillé, en première lecture, à rester dans une épure financière proche de l’équilibre.
Mes chers collègues, René-Paul Savary vous détaillera certains choix de la commission mixte paritaire, qui se traduiront par des coûts supplémentaires pour le système de retraite par rapport à la version du texte adoptée par le Sénat.
Néanmoins, j’espère que vous serez en mesure de nous confirmer, messieurs les ministres, que le texte issu de la commission mixte paritaire permettra le retour à l’équilibre des comptes en 2030, moyennant peut-être un nouvel ajustement des taux de cotisations patronales des branches vieillesse et accidents du travail et maladies professionnelles.
En tout état de cause, mes chers collègues, vous retrouverez dans le texte qui vous est présenté les principales mesures que nous avons examinées et adoptées tout au long de la semaine dernière et même, pour certaines, depuis plusieurs années dans le cadre de différents PLFSS.
Je pense naturellement au décalage progressif de l’âge d’ouverture des droits à la retraite de 62 ans à 64 ans, ainsi qu’à l’accélération de la réforme Touraine, sur lesquels repose l’équilibre financier de ce PLFRSS.
Je pense aussi à la mise en extinction des principaux régimes spéciaux et à la clause dite du grand-père, aux termes de laquelle les personnes embauchées à compter du 1er septembre 2023 dans les entreprises et institutions concernées seront affiliées au régime général pour le risque vieillesse.
Je pense également à l’abandon du projet de transfert aux Urssaf de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco et de la Caisse des dépôts et consignations, qui a été confirmé par la commission mixte paritaire.
Enfin, je vous précise que la commission mixte paritaire a confirmé l’introduction dans l’annexe A du principe de compensation intégrale par l’État, dès 2023, des surcoûts entraînés par la hausse des cotisations patronales de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les employeurs publics concernés.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. En raison du maintien de ces nombreux marqueurs du Sénat et de l’adoption par la commission mixte paritaire des autres dispositions, que va à présent vous présenter René-Paul Savary, je vous appelle, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains et INDEP. – M. Didier Rambaud applaudit également.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.

Mes chers collègues, je vous présenterai très rapidement les conclusions de la réunion de la commission mixte paritaire. Celle-ci fut particulière : l’Assemblée nationale ayant été empêchée de débattre du texte et de le voter, il nous appartenait de permettre le débat au sein de cette commission, dont la réunion a duré neuf heures et a permis des avancées.
Le compromis qui a été trouvé prend en compte les exigences du Sénat, les mesures auxquelles nous étions particulièrement attachées ayant été retenues. Sur les mesures destinées aux mères de famille ou portant sur l’usure professionnelle, la patte du Sénat a été nette.
Je vous remercie, monsieur le ministre du travail, d’avoir permis que l’emploi des seniors demandeurs d’emploi de longue durée fasse l’objet d’un accord national interprofessionnel. Cette mesure est importante et nous permettra de favoriser l’emploi des seniors.
Il nous appartenait également de prendre en compte des avancées et des propositions de l’Assemblée nationale qui n’avaient pu être débattues jusqu’au bout, en particulier sur les carrières longues. Le projet de loi prévoit à cet égard une avancée significative ; je pense aux 43 annuités minimum pour les bornes d’âge. La durée de cotisation pourra ainsi être prise en compte pour certains.
Au terme de cette réunion, nous pouvons voter cette réforme sans états d’âme.
Exclamations sur les travées d es groupes SER et CRCE.
Mme Cathy Apourceau-Poly ironise.

Les mesures adoptées au Sénat, en particulier les dispositions sur l’usure professionnelle, auxquelles nous sommes attachées, ayant été conservées dans le texte final, je vous invite, mes chers collègues, à voter cette réforme.
Applaudissements nourris sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP. – Mme Véronique Guillotin et M. Bernard Buis applaudissent également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, un accord entre les deux assemblées a donc été trouvé, les deux chambres s’étant retrouvées sur l’essentiel.
Cet accord réaffirme sans ambiguïté l’attachement de la représentation nationale à notre système de retraite par répartition, hérité de l’après-guerre, et permet, enfin, de mettre aux voix un texte profondément enrichi, après plusieurs semaines de débats parlementaires.
Le texte qui est soumis au vote des deux assemblées conjugue le cœur de la réforme et des engagements du Président de la République avec les nombreuses améliorations portées par les parlementaires dans les deux chambres.
Les engagements pris au printemps dernier devant les Français sont tenus : il s’agit de progressivement travailler plus pour équilibrer notre système de retraite, de fermer les principaux régimes spéciaux dans le respect de la clause du grand-père et d’augmenter la retraite minimale pour une carrière complète.
Je pense aussi pouvoir dire que ce texte a été profondément enrichi jour après jour, au fil de nos discussions.
Ainsi, grâce à votre soutien, nous avons concrétisé des demandes formulées de longue date, par exemple pour les sapeurs-pompiers volontaires, les apprentis, les stagiaires, les étudiants, les sportifs ou encore les enseignants du primaire. Je suis certain que plusieurs de ces améliorations – ma liste n’est pas exhaustive – renforceront durablement la justice de notre système de retraite.
Il est difficile, quand on commente les conclusions d’une commission mixte paritaire, d’éviter l’effet d’inventaire, mais je suis convaincu que chaque avancée compte et mérite d’être reconnue en tant que telle.
Je pense à la création d’une surcote avant l’âge légal pour les mères ayant atteint la durée d’affiliation requise avant l’âge d’ouverture des droits, ainsi qu’à l’instauration d’un CDI senior, portée avec force et conviction par votre rapporteur René-Paul Savary, dans le respect de l’article L. 1 du code du travail, cher au président du Sénat.
Je pense également à la création d’une pension de réversion pour les orphelins, en particulier ceux qui sont en situation de handicap, sur l’initiative de Bruno Retailleau ; à la prise en compte des parents confrontés au deuil d’un enfant, sur l’initiative des groupes CRCE, RDPI et GEST ; à la perte de droits familiaux pour les parents violents, sur proposition d’Annick Billon.
Je pense enfin au renforcement des droits à la retraite des élus locaux, porté ici notamment par Mme la rapporteure pour avis Sylvie Vermeillet, ou à la revalorisation des pensions à Mayotte, sur l’initiative de Thani Mohamed Soilihi et d’Hervé Marseille.
Si je me livre à cet inventaire, c’est pour montrer que le texte a été enrichi et amélioré au fil des discussions. Je pense que, tel qu’il résulte de vos travaux, il reflète un équilibre politique.
Cet équilibre est également financier, car laisser filer les déficits serait injuste et irresponsable. Nous maintiendrons donc l’équilibre du système de retraite à l’horizon de 2030, tel qu’il était prévu dans le texte initial.
C’est la raison pour laquelle, dans un premier temps, le Gouvernement lève les gages restant à l’article 2 bis A et à l’article 8.
C’est surtout la raison pour laquelle nous prévoyons un transfert supplémentaire de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour assurer ce financement, tout en laissant cette dernière largement excédentaire. Mon collègue Gabriel Attal, ministre chargé des comptes publics, reviendra sur cette question.
Je ne nie évidemment pas les désaccords qui persistent, pas plus que je n’occulte l’expression de l’opposition à la réforme. Je suis sûr, à l’inverse, que personne ne contestera que le débat a eu lieu.
Exclamations sur les travées des groupes SER et CRCE.
Le débat a eu lieu avec les partenaires sociaux, après quatre mois de concertation qui ont permis de concrétiser des avancées que personne n’aurait pu imaginer voilà seulement quelques mois. Je pense en particulier à l’emploi des seniors et à la prévention de la pénibilité. Alors que nous pensions les positions des uns et des autres irréconciliables sur ce sujet, nous avons su, je pense, les rapprocher.
M. Rémi Cardon s ’ exclame.
Après 74 heures de discussion à l’Assemblée nationale et 102 heures au Sénat, on peut également dire que le débat a bien évidemment eu lieu au Parlement. §Certains diront que c’est trop peu, mais la réalité est que cette réforme a été davantage discutée dans les assemblées que les deux précédentes réformes des retraites cumulées !
D’autres diront qu’ils reviendront sur cette réforme lorsqu’ils arriveront un jour au pouvoir. Mais qu’avons-nous constaté depuis trente ans de réformes des retraites ? Jamais – j’y insiste – une alternance politique n’a remis en cause les efforts demandés dans les réformes précédentes.
Au fond, nous avons suivi un seul fil rouge : celui du débat contradictoire et républicain.
L’opposition, moins ici qu’ailleurs peut-être, a choisi un autre fil rouge : celui de l’obstruction méthodique
M. Rémi Cardon proteste.
, une obstruction qui sacrifie la mission même d’un parlementaire, qui abîme le débat chaque jour un peu plus, une obstruction, enfin, qui aura été assumée dans une confusion inouïe entre la légitimité du Parlement et l’expression de la rue.
Protestations sur les t ravées des groupes SER, CRCE et GEST.
De manœuvres en blocages, d’attaques personnelles en comportements violents, nous avons assisté à une dérive, moins ici qu’ailleurs, certes, …
… mais avec la même volonté d’obstruction, que je trouve dangereuse.
Je veux le dire avec gravité devant vous : la République ne doit pas céder un pouce de terrain face à ces dérives. Nous les combattrons jour après jour, texte après texte.
Beaucoup parmi les opposants à cette réforme ont cité Victor Hugo, tout en foulant parfois au pied son sens aigu du républicanisme, lequel aurait fait honneur à nos débats.
Exclamations sur les travées du groupe SER.
Le Gouvernement a donc surmonté cette obstruction, pour assurer la clarté et la sincérité de nos débats.
Ainsi, en application de l’article 44, alinéa 2, de la Constitution, les amendements ou sous-amendements n’ayant pas été examinés par la commission des affaires sociales n’ont pu être présentés.
Ensuite, en application de l’article 44, alinéa 3, de notre belle Constitution, le Gouvernement a demandé au Sénat de se prononcer par un vote unique sur l’ensemble du texte, après présentation par leurs auteurs de l’ensemble des amendements restant en discussion.
Certains ont voulu faire croire à une procédure inhabituelle, voire totalement inédite, mais répéter le même mensonge n’en fait pas une vérité.
Les choses sont simples : les gouvernements précédents ont eu recours lors des trois précédentes réformes des retraites au même vote unique pour surmonter l’obstruction.
Lors de la réforme dite Fillon, l’examen en première lecture au Sénat a fait l’objet d’un vote unique en juillet 2003. Lors de la réforme dite Woerth, le vote unique a été utilisé en première lecture au Sénat en octobre 2010 sur un quart des amendements. Lors de la réforme dite Touraine, enfin, un vote unique a été utilisé en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale en novembre 2013.
En outre, je ne mentionnerai pas les nombreux votes uniques qui ont eu lieu au Sénat, hors réforme des retraites, sur des projets de loi de finances, des projets de loi de finances rectificative, des projets de loi de financement de la sécurité sociale ou encore des projets de loi ordinaires, comme la loi relative à la sécurisation de l’emploi en 2013.
Alors, oui, pour mettre fin à la négation du parlementarisme et garantir la clarté du débat, le Gouvernement a eu recours à l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, et cela au neuvième jour de ralentissement, voire de blocage, des débats.
Avant que le texte ne soit mis aux voix dans sa totalité et, je l’espère, adopté par votre assemblée, avant que ne s’achève la navette parlementaire, je rappelle l’objectif fixé par le Président de la République, au cœur de ma feuille de route, à savoir le plein emploi.
Pour atteindre cet objectif, nous devons mobiliser tous les leviers à notre disposition. Nous l’avons fait il y a quelques mois avec l’assurance chômage, nous le faisons avec les retraites. Nous allons le faire, surtout, avec le projet de loi sur le travail et le plein emploi qui vous sera soumis dans quelques semaines.
Ce texte portera sur des sujets aussi cruciaux que la mise en place de France Travail, le compte épargne temps universel, le partage de la valeur, la suite des Assises du travail, en particulier pour les conditions de travail et de qualité de vie au travail, mais aussi sur de nombreux autres sujets. Il permettra d’aller vers le plein emploi et le bon emploi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre travail et vous dis à bientôt, je l’espère, …
M. Olivier Dussopt, ministre. … pour de nouveaux textes et pour de nouveaux débats.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP, ainsi que sur des travées des groupes RDSE, UC et Les Républicains. – Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, le vote qui va intervenir ce matin conditionne les quinze prochaines années de la vie de notre pays, le quotidien de nos concitoyens et l’avenir de toute une génération : celle qui travaille et qui souhaite conserver son mode de vie une fois arrivée à la retraite, au terme d’une vie de labeur.
Ce vote, c’est aussi tout ce qui fait notre pays : son modèle social, sa vie politique et parlementaire, la cohérence de ses valeurs politiques, défendues par les représentants du peuple, sa capacité à continuer à aller de l’avant, mais aussi le choix qu’il fait entre le travail et l’impôt.
Ce vote ne vient pas seulement trancher un débat politique et médiatique de plusieurs mois. Il n’est pas simplement le point final d’une séquence difficile, qui, je suis parfaitement lucide, a angoissé et parfois divisé notre pays.
Ce vote, il est également et surtout la réponse à des questions aussi fondamentales que celles que je pose devant vous ce matin.
Voulons-nous, oui ou non, garantir à bientôt 20 millions de retraités qu’ils pourront compter sereinement sur une retraite financée et ainsi préserver leur mode de vie, qu’ils n’ont aucune envie de sacrifier ?
Pensons-nous que c’est le travail qui crée la prospérité d’une nation, ou bien que c’est l’impôt qui crée la richesse ?
Les valeurs et le projet pour lesquels les Français ont élu leurs représentants au Parlement doivent-ils être défendus par leurs parlementaires, au risque sinon d’une fissure encore plus profonde de la confiance entre le peuple et ses élus ?
Mesdames, messieurs les sénateurs, je pourrais m’appesantir sur les réponses que le Gouvernement souhaite apporter à ces questions.
Je pourrais vous redire que l’unique raison pour laquelle nous faisons cette réforme, c’est préserver le patrimoine de ceux qui n’ont que leur travail pour vivre et pouvoir leur dire, sereinement, les yeux dans les yeux : vos pensions ne baisseront pas, vos salaires ne diminueront pas, …
… vos impôts n’augmenteront pas.
Je pourrais vous dire ensuite que la réponse du Gouvernement à la question de savoir s’il faut choisir entre le travail et plus d’impôt est claire : c’est le travail qui crée la richesse, pas les impôts supplémentaires !
Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
Ce choix nous guide et nous oblige. Choisir le travail plutôt que l’impôt, c’est certes choisir l’effort, mais c’est surtout choisir la prospérité.
Je pourrais vous dire enfin que, oui, le respect des engagements pris devant les Français est au cœur du pacte entre le peuple et ses représentants. Mais ce n’est pas à vous, ce n’est pas au Sénat que j’ai besoin de le dire : vous avez toujours respecté vos engagements.
Ce qui se joue aujourd’hui, ce n’est pas le Gouvernement qui en décide, ce sont les représentants du peuple par leur vote. Votre vote, c’est la démocratie. Celle-ci est à la fois encadrée et garantie par notre Constitution, sans laquelle rien n’est légitime.
Notre Constitution est le cœur même du pacte entre les Français et leurs élus, ce pacte qui existe depuis que la France et les Français votent, ce pacte qui a permis des avancées majeures pour les Français, ce pacte qui a conforté à plusieurs reprises la démocratie lorsqu’elle vacillait et que ses institutions ne parvenaient plus à œuvrer pour le pays.
Voilà ce que je tenais à vous dire en préambule de mon intervention, comme marque de respect du Parlement et du Sénat.
Je le disais, mesdames, messieurs les sénateurs, ma conviction, c’est que c’est le travail qui crée la prospérité et que c’est donc par le travail que nous devons financer les évolutions de notre modèle social.
L’une des évolutions majeures auxquelles notre pays est soumis, c’est l’évolution de sa démographie. Les faits sont implacables : notre pays vieillit et comptera plus de retraités qu’il n’en a jamais comptés. Notre modèle social devra donc financer plus de retraites que jamais.
En 2030, nous aurons à payer chaque mois la pension de 20 millions de retraités, soit un quasi-doublement en une génération. Il y avait 12 millions de pensions de retraite à verser chaque mois au début des années 2000. Aucun pays ne pourrait tenir ce choc sans rien faire ! D’ailleurs, presque tous les pays autour de nous ont réformé ou réforment leur système de retraite.
Pour notre part, nous faisons le choix de réformer notre système par le travail. Oui, c’est un effort, mais, non, il ne sera pas porté par tous de la même manière, indifféremment.
Ainsi, quatre Français sur dix partiront à la retraite bien avant l’âge légal, mais dix Français sur dix pourront continuer de bénéficier d’une retraite sans hausse d’impôt ni baisse de pension.
L’autre choix qui a émergé au cours de plus de deux cents heures de débat à l’Assemblée nationale et au Sénat, c’est celui de l’impôt et des hausses de cotisations.
L’impôt toujours, l’impôt tout le temps, l’impôt pour tous : taxer, taxer, taxer, voilà l’autre projet !
Protestations sur les t ravées des groupes SER, CRCE et GEST.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Ce projet-là, nous l’avons combattu, et je remercie la majorité sénatoriale d’avoir contribué à le repousser, non pas par idéologie, je le sais, mais par bon sens.
M. Thomas Dossus s ’ esclaffe.
Qui seraient les premières victimes des hausses d’impôts ? Les Français qui travaillent dur, qui se lèvent le matin, qui font vivre leur famille et tourner le pays.
Protestions sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.
Taxer les plus riches ? Taxer les grands groupes ? Cela paraît toujours séduisant, mais l’impôt de trop commence par toucher ceux qui sont en haut et finit par frapper ceux qui sont en bas.
Exclamations sur les travées des groupes CRC E, SER et GEST.
Voilà pourquoi, avec la majorité sénatoriale, nous avons repoussé avec détermination toute tentative d’instaurer de nouveaux impôts ou d’augmenter des cotisations.
Voilà pourquoi ce texte se fonde sur des valeurs communes : le travail comme condition de la prospérité et la retraite comme horizon bien mérité, après une vie de travail.
Voilà pourquoi, je le dis, le texte qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est aussi le vôtre.
Cette réforme des retraites est aussi celle du Sénat et des sénateurs. Je l’ai dit, il prend ses racines dans des valeurs communes : le travail, la préservation de notre modèle social et le refus de tout impôt supplémentaire.
Ce texte, c’est aussi le vôtre parce que vous l’avez voté et adopté en première lecture.
Ce texte, c’est aussi le vôtre, parce qu’il est le fruit d’un compromis politique construit patiemment au fil de son élaboration, de sa discussion et de son vote en commission, puis en séance publique et, enfin, en commission mixte paritaire hier.
Ces compromis permettent des avancées importantes, que les Français devront aussi à cette majorité sénatoriale.
Je pense notamment, et je le souligne alors que je m’y étais opposé, monsieur le rapporteur, à l’expérimentation durant plusieurs années d’un CDI senior recentré sur les demandeurs d’emploi de longue durée. C’est, je le sais, une idée à laquelle les rapporteurs du texte au Sénat étaient particulièrement attachés, comme d’ailleurs la majorité sénatoriale. Ce contrat figure dans le texte que nous vous proposons de voter.
Je pense aussi au compromis trouvé sur le sujet des carrières longues et à la reprise du dispositif proposé par le groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale. Je précise toutefois que nous avons eu des discussions nourries pour affiner ce dispositif.
Enfin, je dirai un mot du dispositif de surcote pour les mères de famille, introduit par la commission des affaires sociales du Sénat et bien sûr intégré à l’accord trouvé hier.
Cet apport majeur du Sénat permettra aux femmes de bénéficier d’une revalorisation de leur pension pouvant atteindre 5 % au titre des trimestres liés à la naissance d’un enfant ou à leur éducation.
Les derniers ajustements actés hier durant la réunion de la commission mixte paritaire doivent bien sûr faire l’objet d’une traduction financière.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé un amendement à l’article 6 visant à actualiser l’annexe A du texte, c’est-à-dire la trajectoire financière pluriannuelle des régimes de sécurité sociale.
En réponse à la question de Mme la rapporteure, j’indique que, oui, à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire et sous réserve d’un nouveau transfert de taux entre la branche AT-MP et la branche vieillesse, l’équilibre de notre système de retraite en 2030 est garanti par le travail du Parlement et par le compromis qui a été trouvé hier.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je tenais à vous dire, alors que vous vous apprêtez à voter une réforme importante pour l’avenir de notre pays et pour le mode de vie des Français, en particulier pour nos retraités.
Si je devais résumer ce moment en trois mots, je dirais que nous sommes à un rendez-vous important pour nos institutions, pour notre modèle social et pour notre prospérité.
Ce rendez-vous est important pour nos institutions, car elles garantissent à notre pays de continuer d’avancer. Nos institutions, c’est vous, c’est le Sénat, c’est le Parlement, tout le Parlement, rien que le Parlement. Nos institutions, c’est notre Constitution, toute notre Constitution, rien que notre Constitution.
Ce rendez-vous est important pour notre modèle social, car nous sommes les lointains héritiers, nous au Gouvernement, vous sur ces travées, des hommes et des femmes politiques qui ont eu le génie et la générosité de l’inventer.
Vives protestations sur les travées du groupe SER.
En être les héritiers, cela signifie tout faire pour le perpétuer et lui permettre de durer.
Ce rendez-vous est important pour notre prospérité, enfin, car le choix que nous faisons est clair : créer de la richesse par l’activité, non pas par la fiscalité ; aller de l’avant par plus de travail, et non par plus d’impôt.
Nous sommes au rendez-vous de nos institutions, de notre modèle social et de notre prospérité, mais s’il est un rendez-vous qui compte plus que tout, un rendez-vous que nous ne devons pas manquer, c’est celui que nous avons avec nos compatriotes, avec les Français, ceux qui travaillent et qui veulent continuer de faire vivre leur famille et de faire tourner leur pays sans outrance et sans blocage, ceux qui travaillent et qui veulent continuer de penser à la retraite comme une période bien méritée de leur vie, au cours de laquelle on récolte enfin, sereinement, le fruit d’une vie de labeur.
Ce rendez-vous, celui des promesses que nous avons faites aux Français, celui des engagements que nous avons pris et que nous devons tenir, ce rendez-vous, c’est maintenant !
Aussi, il faut voter ce texte, pour continuer d’aller de l’avant.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP. – MM. Pierre Louault, Olivier Cadic et Vincent Capo-Canellas applaudissent également.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Pour l’année 2023, les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique et exprimée en milliards d’euros courants et en pourcentage d’évolution en volume, des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, ainsi que les prévisions, pour la même année, de ces mêmes agrégats, telles qu’elles figurent dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, s’établissent comme suit :
En % du PIB sauf mention contraire
LFRSS pour 2023
PLPFP 2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)
Solde conjoncturel (2)
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)
Solde effectif (1+2+3)
Dette au sens de Maastricht
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)
Dépense publique (hors crédits d’impôt)
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) (*)
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (**)
Administrations publiques centrales
Solde
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)
Administrations publiques locales
Solde
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)
Administrations de sécurité sociale
Solde
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)
§(*) À champ constant.
§(**) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
§(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023
I. – Après l’article L. 2142-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2142-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2142 -4 -2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par. 2. – Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, d’une pension en cas d’invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 5 de la présente loi.
« L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à la caisse, d’une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. »
III bis. – Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 1°, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente loi, » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l’ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ; »
3° À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « visés à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente loi ».
IV. – Le premier alinéa du I de l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « vieillesse, » est supprimé ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d’assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160-17, les mots : « assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et des anciens fonctionnaires de l’État, ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que de leurs ayants droit » ;
2° L’article L. 200-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant de l’article L. 381-32. » ;
3° L’article L. 311-2 est complété par les mots : « ou la nature de leur statut » ;
4° La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rétablie :
« Section 10
« Membres du Conseil économique, social et environnemental
« Art. L. 381 -32. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. » ;
5° À la fin de l’article L. 411-1, les mots : « salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 311-2 » ;
6° Les articles L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 sont abrogés ;
7° Le second alinéa de l’article L. 711-7 est supprimé ;
8° À la première phrase de l’article L. 712-3, après le mot : « décédés, », sont insérés les mots : « sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles » ;
9° L’article L. 712-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « dont bénéficient les fonctionnaires civils » et, à la fin, les mots : « des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l’État » sont remplacés par les mots : « à la charge de l’employeur » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 712-10-1, les mots : « dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 712-3 et L. 712-9 » ;
10° bis A À l’article L. 712-13, les mots : « assurés mentionnés à l’article L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l’État ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi qu’à leurs ayants droit, » ;
10° bis Après le mot : « intéressés », la fin de la seconde phrase de l’article L. 761-5 est supprimée ;
11° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 921-1 est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées à l’article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent…
le reste sans changement
12° Au premier alinéa de l’article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées à l’article L. 381-32 ».
V bis. – Au premier alinéa de l’article L. 722-24-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 4163-4 du code du travail, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : «, les salariés régis par un statut particulier et ».
VII. – Le 4° du V s’applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1er septembre 2023. Les I à IV, les 1° à 3° et 5° à 12° du V et le VI entrent en vigueur à la même date.
(Supprimés)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :
« Section 4
« Indicateurs relatifs à l’amélioration de l’emploi des seniors
« Art. L. 5121 -6. – L’employeur poursuit un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors.
« Art. L. 5121 -7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121 -8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5121 -9. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121-7, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après le 6° de l’article L. 2242-20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121-7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
2° Au 6° de l’article L. 2242-21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.
III. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7 du code du travail.
IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Par dérogation, ils s’appliquent à compter du 1er novembre 2023 aux entreprises d’au moins mille salariés.
V. –
Supprimé
I A
I B
I. – Un demandeur d’emploi de longue durée âgé d’au moins soixante ans, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi et tenu d’accomplir à ce titre des actes positifs et répétés de recherche d’emploi peut conclure avec un employeur un contrat pour la fin de sa carrière.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Une convention de branche ou un accord de branche étendu définit les activités concernées, les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat, les modalités selon lesquelles l’employeur peut, par dérogation aux articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail, mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de mise à la retraite accordées au salarié.
Les rémunérations versées au salarié durant les douze premiers mois d’exécution de ce contrat sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l’article L. 241-6 du même code. Cette exonération n’est pas applicable aux rémunérations versées au salarié percevant une pension de vieillesse servie par un régime de retraite légalement obligatoire.
II et III. –
Supprimés
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I B et I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 du chapitre VII du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;
2° L’article L. 137-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137 -12. – Est instituée, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l’occasion de :
« 1° La mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur mentionnée à l’article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code ;
« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;
3° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : «, qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
4° Le 7° du II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. »
II. – Le présent article est applicable aux indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »
II. – L’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »
(Supprimé)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code du travail », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° L’article L. 213-1-1 est complété par des 5° à 9° ainsi rédigés :
« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133-5-6 ;
« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du présent code ;
« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;
3° Le premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 du présent code en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;
4° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 243 -6 -6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève.
« Dans des conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.
« Art. L. 243 -6 -7. – Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922-4 mettent à la disposition des employeurs, ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalie et les demandes de rectification qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploitation des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
« La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application du deuxième alinéa du présent article, est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 s’agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et des réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
« Les organismes et les institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article. » ;
5° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921-2-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.
III. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
IV. – Les 1° et 2° du I et les II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. Le 5° du I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date.
(Supprimé)
Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
En milliards d ’ euros
Recettes
Dépenses
Solde
Maladie
Accidents du travail et maladies professionnelles
Vieillesse
Famille
Autonomie
Toutes branches (hors transferts entre branches)
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse
I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17, 7 milliards d’euros.
II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée.
Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi modifiant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.
Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020, sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de -39, 7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à -24, 3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à -18, 9 milliards d’euros dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
La reprise de l’activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu’en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l’inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par la présente loi (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l’élévation progressive de l’âge de départ à la retraite et l’équilibre financier global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (III).
I. – La présente loi s’inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, de forte poussée de l’inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1, 0 % en 2023, après 2, 7 % en 2022. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4, 3 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5, 4 % en 2022. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1, 35 % par an et atteindrait 1, 6 % en 2024, puis 1, 7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1, 75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5, 0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
PIB en volume
Masse salariale secteur privé *
Inflation hors tabac
Revalorisations au 1er janvier **
Revalorisations au 1er avril **
ONDAM
ONDAM hors covid
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d ’ achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4, 8 % en 2023.
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1 er juillet 2022 de 4, 0 % .
La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que dans la réforme des retraites présentée dans la présente loi. Le solde atteindrait ainsi -8, 2 milliards d’euros en 2023.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision d’un milliard d’euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l’ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à +3, 8 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3, 5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2, 2 milliards d’euros d’effet cumulé). Cette progression sera également rehaussée par rapport à celle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, alors à 3, 5 %, en conséquence des annonces faites par le Président de la République lors de ses vœux aux acteurs de la santé le 6 janvier 2023. La progression tendancielle de l’ONDAM, c’est-à-dire avant mesures d’économies, atteindrait 4, 4 % cette année, tenant compte, au-delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital et dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3, 8 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d’économies, s’élevant à un total de 1, 7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM hors crise serait ramené à 2, 8 % en 2024, puis à 2, 7 % en 2025 et à 2, 6 % en 2026.
Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de soixante-deux à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également des mesures d’accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront, en premier lieu, à dispenser de la hausse de l’AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l’âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l’activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l’usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023 mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales [CNRACL]) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT-MP. Pour les employeurs publics de la CNRACL, l’État compensera intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances. La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l’horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi aura des impacts financiers qui monteront en charge au-delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires de retraite. Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l’équilibre à l’horizon 2030. Il est également tenu compte des propositions parlementaires tendant à une harmonisation des prélèvements applicables aux indemnités de rupture. Une étude d’impact financière spécifique a été jointe au projet de loi.
Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides-soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d’inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S’agissant de la trajectoire des comptes publics et de l’impact de la réforme des retraites sur l’équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0, 4 Md€ […] est réaliste ».
II. – Au-delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.
Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles aux revenus d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations de retraite et familiales, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
Après un net rebond en 2021, à +8, 0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de +5, 3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au-delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+8, 6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4, 1 % en valeur en 2022. En conséquence, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5, 4 milliards d’euros et s’établirait à 18, 9 milliards d’euros.
En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 8, 2 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (10, 7 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2, 1 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d’euros, mais avec une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4, 1 % de juillet 2022 s’est ainsi ajoutée une revalorisation de 0, 8 % au 1er janvier 2023 pour les retraites et s’ajouterait au 1er avril 2023, pour les autres prestations sociales, une revalorisation de 1, 7 %. Les recettes croîtraient de 4, 0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.
À partir de 2024, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4, 3 % en 2023 à 2, 1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 9, 4 milliards d’euros, les recettes évoluant de +4, 2 %, légèrement en deçà de la dépense (+4, 3 %). En 2025, il atteindrait 13, 3 milliards d’euros, avec une progression des recettes de +3, 1 %, moindre que celle des dépenses (+3, 7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 12, 9 milliards d’euros à cet horizon.
III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
La branche Maladie, qui connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant -21, 9 milliards d’euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à -7, 9 milliards d’euros en 2023, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d’euros provisionnés). L’amélioration du solde de la branche serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d’euros en 2023.
Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l’usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico-sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse de la CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s’améliorer continuellement à l’horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s’établirait à 4, 0 milliards d’euros.
La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à
-0, 4 milliard d’euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5, 1 % et à 5, 2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait -1, 3 milliard d’euros en 2023.
À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0, 15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0, 7 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.
S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2, 0 milliards d’euros en 2022, puis s’élèverait à 2, 2 milliards d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait encore 2, 1 milliards d’euros en 2026.
Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à -1, 2 milliard d’euros.
À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4, 5 %, contre 4, 0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, atteindrait ainsi 2, 5 milliards d’euros en 2023 et jusqu’à 11, 8 milliards d’euros à l’horizon 2026. Les éléments relatifs à l’ensemble des régimes, qui permettent d’atteindre l’équilibre à l’horizon 2030, sont présentés dans l’étude d’impact du projet de loi.
La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2, 6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1, 0 milliard d’euros) supporté par cette branche.
L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2, 0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1, 3 milliard d’euros en 2023.
À l’horizon 2026, l’excédent de la branche diminuerait et s’élèverait à 0, 8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l ’ ensemble des régimes obligatoires de base
En milliards d ’ euros
2022 (p)
2023 (p)
2024 (p)
2025 (p)
2026 (p)
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Autonomie
Recettes
Dépenses
Solde
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
En milliards d ’ euros
2022 (p)
2023 (p)
2024 (p)
2025 (p)
2026 (p)
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
En milliards d ’ euros
2022 (p)
2023 (p)
2024 (p)
2025 (p)
2026 (p)
Recettes
Dépenses
Solde
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023
TITRE Ier
RECULER L’ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D’USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1968 », la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 31 août 1961 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;
c) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
d) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
e) À la fin du 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;
2° bis Au début de l’article L. 173-7, sont ajoutés les mots : « À l’exception des versements mentionnés au IV de l’article L. 351-14-1, » ;
3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois » ;
4° Le I de l’article L. 351-14-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base ; »
5° Au II du même article L. 351-14-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;
6° Le 1° de l’article L. 351-17 est ainsi rédigé :
« 1° L’âge jusqu’auquel l’assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ; ».
II. – Le code des communes est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre IV est abrogé ;
2° Le début de l’article L. 417-11 est ainsi rédigé : « Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent…
le reste sans changement
3° À l’article L. 444-5, les mots : « des dispositions du 3° de l’article L. 416-1 et » sont supprimés.
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article L. 12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du i est ainsi modifiée :
– après les mots : « les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » ;
– après le mot : « invalidité », la fin est supprimée ;
a bis) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux a à i du » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres. » ;
2° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les II et III sont abrogés ;
3° L’article L. 14 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du I, les mots : « la limite d’âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l’âge d’annulation de la décote prévu à l’article L. 14 bis » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’effet en durée d’assurance de l’une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné à la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. » ;
c)
Supprimé
4° Le paragraphe Ier du chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 14 bis. – L’âge d’annulation de la décote est égal :
« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;
« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l’âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;
« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 14 ou les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d’âge de leur grade ;
« 5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d’un droit au départ à l’âge anticipé au titre d’un emploi dont la limite d’âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;
5° Le I de l’article L. 24 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
– les mots : « civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il » et les mots : «, à la date de l’admission à la retraite, » sont supprimés ;
– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;
c) Au début du second alinéa du même 1°, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;
d) Ledit 1° est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l’occupation de certains de ces emplois permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
« a) Dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police ;
« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
« c) En tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
« d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique.
« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.
« Le droit à la liquidation à l’âge minoré est ouvert à la condition d’avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :
« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l’institut médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d’avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l’article L. 13 du présent code ;
« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d du présent 1° ainsi que pour le surveillant ou l’ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.
« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l’âge de départ minoré est celle associée à l’emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
« Bénéficie d’un droit à la liquidation à l’âge minoré l’ingénieur ou l’ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; »
e) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par atteinte de la limite d’âge. » ;
6° Après l’article L. 24, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.
« De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1°. » ;
7° L’article L. 25 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « âge », la fin du 1° est ainsi rédigée : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l’article L. 24 du présent code ; »
b) Au 2°, deux fois, et à la fin des 3° et 4°, les mots : « de cinquante-deux ans » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années » ;
c)
Supprimé
III bis. – L’article L. 921-4 du code de l’éducation est abrogé.
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois » ;
2°
V. – Au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code ».
VI. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 911 -9. – Quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d’inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu’à la fin de l’année scolaire. »
VII. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 556-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.
« Le refus d’autorisation est motivé.
« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. » ;
2° L’article L. 556-7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 556-1 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d’ » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d’ » ;
3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 556-8 est ainsi rédigée : « fixée comme suit :
« 1° À cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application et au corps de commandement ;
« 2° À soixante ans pour les commissaires de police ;
« 3° À soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;
« 4° À soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d’inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l’inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l’administration centrale et de la préfecture de police. » ;
3° bis Après l’article L. 556-8, il est inséré un article L. 556-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 556 -8 -1. – La limite d’âge des fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans. » ;
4° L’article L. 556-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.
« Le refus d’autorisation est motivé.
« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus à l’article L. 556-12 ne peut conduire l’agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. » ;
5° La section 3 du chapitre VI du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :
a) Au 3° de l’article L. 826-13, après le mot : « opérationnelle, », sont insérés les mots : « à partir de l’âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « de la présente section » ;
b) Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous -section 5
« Modalités d ’ application
« Art. L. 826 -30. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »
VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « de soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».
IX. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-7-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;
– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;
– après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer les fonctions de conseiller d’État ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 233-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;
b) Les mots : « pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers » sont supprimés ;
c) Après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;
3° L’article L. 233-8 est abrogé.
IX bis
X. – La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Les agents et les anciens agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, d’une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
« À l’exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article 2 est abrogé.
XI. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours bénéficient, sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d’une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d’une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.
« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
XII. – À l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « aux dispositions » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XIII. – La loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du corps » ;
b) Les mots : « l’âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;
c) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;
d) Les mots : « la limite d’âge qui était en vigueur avant l’intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable » ;
e) Les mots : « fonctions, de » sont remplacés par les mots : « fonctions de » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. » ;
2° L’article 4 est abrogé.
XIV. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est abrogé ;
2° À l’article 5, après le mot : « ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».
XV. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire » et les mots : « s’ils sont radiés des cadres par limite d’âge ou par invalidité » sont remplacés par les mots : « sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. » ;
2° Les III et IV sont abrogés.
XVI. – La première phrase de l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Les mots : « fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;
2° Les mots : « I de l’article L. 24 du même code » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
XVII. – L’article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le II est abrogé.
XVIII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
XIX. – L’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du I, les mots : « soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d’annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans. »
XIX bis. – La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 35, les mots : «, au 1° de l’article L. 25 du même code, au 3° de l’article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire » sont remplacés par les mots : « et au 1° de l’article L. 25 du même code » ;
2°
Supprimé
XIX ter. – La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.
XX. – A. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :
1° Avant le 1er septembre 1961 est celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent XX ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;
4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3.
B. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XX :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d’un droit au départ à l’âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent XX ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;
2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d’un droit au départ à l’âge minoré, cette durée est fixée :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent XX ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.
C. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XX, et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l’âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent XX ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d’un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D. – Par dérogation au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge à compter duquel le coefficient de majoration s’applique est :
1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XX, celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent XX ;
2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XX, à l’âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;
3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du même F, à l’âge défini au même 2° augmenté de dix années.
E. – 1. Pour l’application du 1° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent XX.
2. Pour l’application des 2° et 3° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du F du présent XX est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent XX.
F. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l’âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
b) À compter du 1er septembre 1966, l’âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-neuf ans ;
2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l’âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
b) À compter du 1er septembre 1971, l’âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-quatre ans.
G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :
1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XX ;
2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans.
H
1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;
2° Augmente de trois mois par génération jusqu’à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963.
XXI. – Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, par l’assuré né à compter du 1er septembre 1961 lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
XXII. – Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.
XXII bis. – Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises après sa publication.
Il analyse l’évolution des différents paramètres de l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon de 2040.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d’adaptation de la présente loi.
XXIII. – Le 6° du III est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de la publication de la présente loi.
XXIV. – Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
XXV. – A. – Les VII, IX, XII et XIII entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur.
A bis. –
Supprimé
B. – Les autres dispositions du présent article, à l’exception des VI et VIII, s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
XXVI. –
Supprimé
XXVII
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « avant-dernier alinéa de l’article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « article L. 732-18-4 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341-15, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341-17 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351-7-1 A, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 » ;
4° L’article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de son premier alinéa, » ;
5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est ajouté un article L. 351-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 351 -1 -1 A. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-1-3 et d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-6-1. » ;
6° L’article L. 351-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l’assuré » ;
– sont ajoutés les mots : «, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
6° bis Après l’article L. 351-1-2, il est inséré un article L. 351-1-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351 -1 -2 -1. – Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1-2, sous réserve de l’application du second alinéa du même article L. 351-1-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 351-1-3, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
8° La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 351 -1 -5. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;
9° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° ter est abrogé ;
b) À la fin du 2°, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 » sont remplacés par les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 » ;
c) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les assurés dont l’âge mentionné au même premier alinéa est abaissé dans des conditions prévues à l’article L. 351-1-1 ; »
10° Au troisième alinéa de l’article L. 382-24, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351-1-5 » ;
10° bis
11° L’article L. 643-3 est ainsi modifié :
aa) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I et sous réserve de l’application de la seconde phrase du même quatrième alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même avant-dernier alinéa par les autres régimes. » ;
a) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés au III. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l’assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial. » ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l’article L. 643-4. » ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643-4, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par la référence : « IV » ;
12° bis Le même article L. 643-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des assurés dont l’âge mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 643-3 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 643-3 ; »
13° L’article L. 653-2 est ainsi modifié :
aa) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I, sous réserve de l’application de la seconde phrase du même quatrième alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même avant-dernier alinéa par les autres régimes. » ;
a) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés au III. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l’assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial. » ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l’article L. 653-4. » ;
14° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 653-4, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ;
14° bis Le même article L. 653-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des assurés dont l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 653-2 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 653-2. » ;
15° Après les mots : « l’âge », la fin du dixième alinéa de l’article L. 821-1 est ainsi rédigée : « prévu à l’article L. 351-1-5. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117-3, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262-10, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° A Après le septième alinéa du I de l’article L. 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux assurés dont l’âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l’article L. 25 bis. » ;
1° B Le même article L. 14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance ou de bonification au titre des b et b bis de l’article L. 12 ou des articles L. 12 bis ou L. 12 ter, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 13 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au III du présent article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent IV, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;
1° Le 5° du I de l’article L. 24 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, par rapport à un âge de référence de soixante ans » sont remplacés par les mots : « d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans, par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
2° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « abaissé », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
– les mots : « un âge et dans des conditions déterminés » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés » ;
– après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : «, qui ne peut être supérieure à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ainsi qu’en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
– sont ajoutés les mots : « à la charge de l’assuré ».
IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre III, il est ajouté un article L. 732-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732 -17 -1. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 732-18-2 et d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 732-18-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, », le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « déterminés » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : «, qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l’assuré » ;
– sont ajoutés les mots : «, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du même code et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 732-18-2, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
4° Après l’article L. 732-18-3, il est inséré un article L. 732-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732 -18 -4. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;
5° L’article L. 732-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732 -23. – Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d’une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.
« Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
« Aucune partie de mois n’est prise en considération.
« Les trois premiers alinéas s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. » ;
6° À la fin de la seconde phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33, les mots : « de l’article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret » ;
6° bis Les mêmes articles L. 732-25 et L. 781-33 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux assurés dont l’âge mentionné à l’article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l’article L. 732-18-1. » ;
6° ter Après l’article L. 732-25-1, il est inséré un article L. 732-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732 -25 -2. – Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre des articles L. 351-4 ou L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale étendues au régime d’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l’article L. 732-38 du présent code, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la durée minimale mentionnée à l’article L. 732-25 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 732-25-1, sous réserve de l’application du second alinéa du même article L. 732-25-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;
7° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732-30, la référence : « L. 732-18 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».
V. – Le 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° La référence : «, L. 351-1-4 » est remplacée par les mots : « à L. 351-1-5 » ;
2° La référence : « L. 723-10-1 » est remplacée par la référence : « L. 653-2 » ;
3° La référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».
V bis. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : « 1° ter » est remplacée par la référence : « 2° ».
VI. – A. – Le III s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
B. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du 5° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 5° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant » sont remplacés par les mots : « dans les cas suivants : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant ;
« 2° Sur décision du juge pénal, à la suite d’une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre de l’enfant.
« Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n’a pas encore été liquidée sont attribués à l’autre parent, sous réserve que ce dernier n’ait pas fait l’objet d’une condamnation dans les mêmes conditions. » ;
2° L’article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision du juge pénal, l’assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants. »
II. – L’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants. »
III. – Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l’exercice de l’autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. »
(Supprimés)
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. »
(Supprimés)
Le VI de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres.
« Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d’une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l’article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l’enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. »
Au premier alinéa du III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 221 -1 -5. – I. – Est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1, un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.
« II. – Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du même code.
« III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution de ses financements dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d’orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu d’accord mentionné au même article L. 4163-2-1, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.
« IV. – Le fonds peut financer :
« 1° Des entreprises, notamment celles identifiées par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l’article L. 215-1 du présent code, en vue de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;
« 2° Des organismes de branche mentionnés à l’article L. 4643-1 du même code et ayant conclu une convention avec la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces organismes peuvent faire appel à des organismes nationaux de prévention des risques professionnels ;
« 3° L’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.
« V. – Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d’identification des métiers et des activités exposant aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d’affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 351-1-4 est ainsi modifié :
aa) Au I, les mots : «, dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;
a)
Supprimé
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’assuré justifie d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1, la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s’applique, sous réserve : » ;
3° Le premier alinéa du II de l’article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;
4° L’article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »
II. – L’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «, dans les conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’assuré justifie d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou au titre d’un accident de travail mentionné au premier alinéa du même article L. 752-2, la condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée de deux ans et le II du présent article s’applique, sous réserve : ».
III. – A. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 4162-1, la référence : « L. 2133-1 » est remplacée par la référence : « L. 2331-1 » ;
2° Après l’article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4163 -2 -1. – Dans le cadre d’accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1, en vue de l’application de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;
4° L’article L. 4163-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 6313-1 dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1. » ;
a bis) Le II est ainsi modifié :
– après le mot : « compte », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour la prise en charge d’une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. » ;
– au second alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 4° » ;
b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l’égard des employeurs mentionnés à l’article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. » ;
c)
« Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l’utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n’a pas atteint son soixantième anniversaire. » ;
5° Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous -section 1 bis
« Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle
« Art. L. 4163 -8 -1. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 4° du I de l’article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :
« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;
« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l’article L. 4163-8-4.
« Art. L. 4163 -8 -2. – Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l’article L. 4163-7 fait l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente le salarié et l’aide à formaliser son projet.
« Art. L. 4163 -8 -3. – Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 assurent l’instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 4163 -8 -4. – Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur, dans des conditions précisées par décret, afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion professionnelle.
« Art. L. 4163 -8 -5. – La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;
5° bis
Supprimé
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4163-15, les mots : «, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
7° Après l’article L. 4624-2-1, il est inséré un article L. 4624-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624 -2 -1 -1. – Les salariés exerçant ou ayant exercé, pendant une durée définie par voie réglementaire, des métiers ou des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :
« 1° À l’occasion de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié et relève, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 4624-3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622-8-1. Il informe le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle ;
« 2° Le diagnostic mentionné au 1° du présent article est intégré au dossier médical en santé au travail du salarié mentionné à l’article L. 4624-8 et prévoit, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;
« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire du salarié. À cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité d’être reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et transmet, le cas échéant, un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié. Le professionnel de santé au travail peut orienter le salarié vers le rendez-vous de prévention prévu à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;
« 4°
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
B. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 » ;
2° L’article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de transition professionnelle d’un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre au salarié d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d’activité, déterminée par décret, n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212-13. »
C. – Pour l’application de l’article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l’âge prévu à l’article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l’examen prévu au 1° de l’article L. 4624-2-1-1 dudit code à l’occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l’issue de cet examen.
IV. – Au IV de l’article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128, 4 » est remplacé par le nombre : « 150, 2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9, 7 ».
V. – Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l’article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
VI. – A. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds pour la prévention de l’usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d’une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique et, d’autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 314-3-2 du même code.
B. – Le fonds concourt au financement :
1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle par les établissements et services mentionnés au A du présent VI ;
2° Des dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d’usure professionnelle.
La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l’éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l’employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.
C. – Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.
D. – Les modalités d’application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.
TITRE II
RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Examinant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l’article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 631-1 du présent code et à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein de se voir servir par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, lors de la liquidation de leur pension, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle. » ;
b) Le III est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mesures permettant d’atteindre l’objectif mentionné au 4° du II. » ;
2° L’article L. 351-10 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « assuré », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial, lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. » ;
2° bis Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Pension d’orphelin
« Art. L. 358 -1. – En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l’article 88 du code civil ou d’absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l’ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1, 356 et 358 dudit code, l’orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.
« La pension d’orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l’assuré concerné n’a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.
« Art. L. 358 -2. – La somme des pensions d’orphelin versées en application de l’article L. 358-1 au titre d’un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation.
« En cas d’ouverture d’un droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d’orphelin des autres bénéficiaires est révisé.
« Art. L. 358 -3. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 358-2, la pension d’orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
« Art. L. 358 -4. – La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, personnel de l’orphelin.
« Art. L. 358 -5. – La pension d’orphelin est due jusqu’à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d’un nombre d’années déterminé par décret si les revenus d’activité du bénéficiaire n’excèdent pas un plafond, dans des conditions prévues par décret.
« La pension d’orphelin est due sans condition d’âge aux bénéficiaires qui, à l’âge prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article, justifient d’une incapacité permanente au moins égale au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, sous réserve que leurs revenus d’activité, prévus au premier alinéa du présent article, n’excèdent pas le plafond mentionné au même premier alinéa.
« Art. L. 358 -6. – La pension prend définitivement fin :
« 1° En cas d’adoption plénière de l’orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;
« 2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l’article L. 358-5 n’est plus remplie.
« Art. L. 358 -7. – I. – Le bénéficiaire de la pension d’orphelin est tenu de déclarer à l’organisme qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses liens de filiation et, à compter de l’âge mentionné à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 358-5, tout changement survenu dans ses revenus d’activité. Lorsque le bénéficiaire de la pension d’orphelin justifie de l’incapacité permanente prévue au second alinéa du même article L. 358-5, il est tenu de déclarer au même organisme tout changement au regard de cette incapacité.
« II. – Lorsque le bénéficiaire de la pension d’orphelin est un mineur non émancipé, les déclarations prévues au I du présent article sont effectuées par ses tuteurs. » ;
2° ter Le second alinéa de l’article L. 815-1 est complété par les mots : «, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2 » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 .euros » et, à la fin, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 26, 67 % » est remplacé par le taux : « 26, 02 % » ;
1° bis La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le montant minimum est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. La majoration de pension servie à l’assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 732-54-3, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « fixé par décret et est au moins » ;
2° bis À la fin du troisième alinéa du même article L. 732-54-3, les mots : « les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret » ;
3° L’article L. 732-56 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : «, qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : «, qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
c) Au VI, les mots : « de durée d’assurance » sont supprimés ;
4° L’article L. 732-58 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le taux : « 26, 73 % » est remplacé par le taux : « 27, 38 % » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par les contributions et les subventions de l’État. » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60, les mots : « à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l’article L. 732-56 » et les mots : « II, III, V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « mêmes II, III, V et VI » ;
6° Au 2° du I de l’article L. 732-63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : «, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
7° Au début du premier alinéa de l’article L. 781-40, les mots : « Pour l’application de l’article L. 732-56, la référence à l’article L. 781-33 est substituée à la référence à l’article L. 732-25 et » sont supprimés.
II bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l’application du présent article. »
III. – Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent IV que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime concerné est supérieure ou égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. Lorsque cette durée totale est inférieure à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent IV ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés par l’assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l’assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
L’attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 351-10 dudit code dues à l’assuré.
La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent IV est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent IV est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
V. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Les 2° et 2° ter du I ainsi que les 1° bis, 2° et 2° bis du II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le 2° bis du I s’applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Les 3° et 5° à 7° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Ces mêmes 3° et 5° à 7° s’appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.
Le 1° et le a du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour l’application du 6° du même II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.
I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est supérieure ou égale à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque la durée totale des périodes validées par l’assuré dans le régime mahorais est inférieure à cette durée minimale, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
III. – Les salaires portés au compte avant le 1er septembre 2023 servant au calcul du salaire annuel de base mentionné au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte sont revalorisés à titre exceptionnel pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.
Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 223-1, les mots : « et le régime des exploitants agricoles » sont remplacés par les mots : «, le régime des non-salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats » ;
2° Aux articles L. 643-1-1 et L. 653-3, après la référence : « L. 351-4-2 », sont insérés les mots : « et L. 351-12 ».
II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
I. – Le VI de l’article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé de maternité. »
II. – Le présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’État ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi. » ;
2° Le I de l’article L. 351-14-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale. »
II. – L’État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l’année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l’application du 9° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
II bis. – L’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 4422-22 » est remplacée par la référence : « L. 4422-19 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »
III. – Les I à II bis sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 173 -1 -5. – Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 131-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
2° Le 1° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 17, 19 % » est remplacé par le taux : « 16, 87 % » ;
b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 4, 25 % » est remplacé par le taux : « 4, 57 % » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
4° Au 1° de l’article L. 200-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
5° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé de la section 1, les mots : « – Personnes assumant la charge d’un handicapé » sont supprimés ;
b) L’article L. 381-1 est ainsi modifié :
– les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
– la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
– à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;
c) La section 2 est ainsi rétablie :
« Section 2
« Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie
« Art. L. 381 -2. – La personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l’exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu’ils bénéficient d’un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.
« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8, à l’exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu’ils bénéficient d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée au dépôt d’une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.
« Le travailleur non salarié, mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d’une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.
« La somme des durées d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière.
« En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
« 1° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ;
« 1° bis
« 2° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
« Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas. » ;
6° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 742-1, la référence : « L. 381-1 » est remplacée par la référence : « L. 381-2 » ;
7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie » ;
b) À l’article L. 753-6, les mots : « qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l’allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un article L. 753-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 753 -6 -1. – L’article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. »
II. – Au 1° de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381-1 et L. 381-2 ».
III. – Le présent article, à l’exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
Le 2° du même I est applicable à compter du 1er janvier 2023.
TITRE III
FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 161-17 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351-15 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 ;
b) Il est ajouté un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161-22-2 ;
3° L’article L. 161-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : «, pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200-1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611-1 » ;
c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 » ;
d) Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
– les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ;
– la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;
4° L’article L. 161-22-1 A est abrogé ;
5° L’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161 -22 -1. – La reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
« Le premier alinéa ne s’applique pas :
« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l’article L. 161-22-1-5 ;
« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse. » ;
6° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 161 -22 -1 -1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.
« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17-3.
« Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.
« Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension.
« Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.
« Art. L. 161 -22 -1 -2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.
« Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice :
« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports ;
« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ;
« 3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.
« Art. L. 161 -22 -1 -3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.
« Art. L. 161 -22 -1 -4. – Les plafonds et seuils prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au 2° de l’article L. 161-22-1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et délai et peut en prévoir l’application rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa publication.
« Le décret peut suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond et de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.
« Le deuxième alinéa du présent article est d’ordre public. » ;
7° Après l’article L. 161-22-1-4, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Sous -paragraphe 2
« Retraite progressive
« Art. L. 161 -22 -1 -5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2, déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à :
« 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ;
« 2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ;
« 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.
« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.
« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.
« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.
« Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.
« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.
« Art. L. 161 -22 -1 -6. – Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable :
« 1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;
« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.
« Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique.
« Art. L. 161 -22 -1 -7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis la liquidation de celle-ci, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.
« Art. L. 161 -22 -1 -8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.
« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.
« Art. L. 161 -22 -1 -9. – Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161-22-1-5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5. » ;
8° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161-22-1-5, » ;
– la référence : «, L. 351-15 » est supprimée ;
b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351-15 » sont remplacées par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;
10° La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 341 -14 -2. – La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
11° L’article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 341-17, les mots : « avant-dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant-dernier » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ;
14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 353-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
15° bis Au premier alinéa de l’article L. 357-4, les mots : « L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-8 » ;
16° L’article L. 634-3-1 est abrogé ;
17° L’article L. 634-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 161-22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
18° L’article L. 643-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article L. 161-22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° Le 1° de l’article L. 11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein :
« a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ;
« b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;
« c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;
« d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;
« e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823-1 du même code. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14, dans sa rédaction résultant de l’article 7, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
5° L’article L. 84 est ainsi modifié :
a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Retraite progressive
« Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui :
« 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.
« La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié.
« Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.
« Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 89 ter. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.
« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. »
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A Au 2° du II de l’article L. 254-1, les mots : « de l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du V » ;
1° B À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-64, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du V » ;
1° L’article L. 732-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732 -29. – Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
2° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ;
– le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et la troisième occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « III » ;
f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « Elles ne font » sont remplacés par les mots : « Le I du présent article ne fait » ;
– les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : «, 7° et 9° » ;
g) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention :
« V. – » ;
h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732-29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 732-40 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 161-22 du même code ne s’applique pas aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 742-3 est supprimé.
IV. – L’article L. 5552-21 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5552 -21. – L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code. »
V. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;
2° L’article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;
3° Après l’article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121 -60 -1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;
4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123 -4 -1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
5° bis À l’article L. 3123-16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° À la première phrase du 2° de l’article L. 5312-1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : «, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ».
VI. – Les articles L. 84 à L. 86-1, L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921-2-1 du même code. »
VIII. – L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. »
IX. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la fin du 2° de l’article 11-2, les mots : « la référence à l’article L. 241-3-1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161-22-1-5 du présent code” » ;
2° L’article 14-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :
« 1° À l’article L. 161-22 :
« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711-1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ;
« b) À la fin du a, les mots : “1° de l’article L. 351-8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351-1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ;
« d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;
« 2° À l’article L. 161-22-1-1 :
« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ;
« c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3°
Supprimé
« 4° À l’article L. 161-22-1-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;
« 5° À l’article L. 161-22-1-9, au début, les mots : “Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et, après la référence : “L. 161-22-1-5”, sont insérés les mots : “du présent code”. » ;
3° Après le I de l’article 23-4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23-1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante :
« Au premier alinéa, la référence : “L. 631-1” est remplacée par les mots : “23-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. »
X. – Le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.
XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le premier alinéa de l’article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2023 ;
2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;
3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l’article L. 161-22-1 et de l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;
4° L’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;
6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;
7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;
8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2023.
L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a)
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés mentionnés au deuxième alinéa du présent II dont la durée cotisée est inférieure à dix années ou dont la carrière a été interrompue pendant une période au moins égale à une durée fixée par décret se voient proposer un rendez-vous de conseil sur leur carrière. » ;
2°
TITRE III bis
LUTTER CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES À L’ÉTRANGER ET SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné aux deux dernières phrases du même article L. 161-24-1, et au plus tard le 1er septembre 2023.
TITRE IV
DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
I. – L’article 23-5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1. » ;
2° Après le mot : « base », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : «, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 239, 1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Pour l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
En milliards d ’ euros
Sous-objectif
Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville
Dépenses relatives aux établissements de santé
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement
Autres prises en charge
Total
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14, 8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55, 3 milliards d’euros.
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37, 5 milliards d’euros.
Pour l’année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :
En milliards d ’ euros
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273, 7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.

Sur les articles liminaire à 5, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
L’annexe est ainsi rédigée :
ANNEXE
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.
Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020 sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de - 39, 7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à - 24, 3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à -18, 9 milliards d’euros dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
La reprise de l’activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu’en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l’inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l’élévation progressive de l’âge de départ à la retraite et l’équilibre global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 (III).
I. – Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu en LFSS 2023, de forte poussée de l’inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1, 0 % en 2023, après 2, 7 % en 2022. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4, 3 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5, 4 % en 2022. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1, 35 % par an et atteindrait 1, 6 % en 2024, puis 1, 7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1, 75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5, 0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
PIB en volume
Masse salariale secteur privé *
Inflation hors tabac
Revalorisations au 1er janvier **
Revalorisations au 1er avril **
ONDAM
ONDAM hors covid
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d ’ achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4, 8 % en 2023.
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1 er juillet 2022 de 4, 0 % .
La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la LFSS pour 2023 ainsi que la réforme des retraites présentée dans le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Le solde atteindrait ainsi - 8, 2 milliards d’euros en 2023.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision de 1 milliard d’euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l’ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à + 3, 8 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur », mais également avec la revalorisation de 3, 5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2, 2 milliards d’euros d’effet cumulé). Cette progression sera également rehaussée par rapport à celle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, alors à 3, 5 %, en conséquence des annonces faites par le Président de la République lors de ses vœux aux acteurs de la santé le 6 janvier 2023. La progression tendancielle de l’ONDAM, c’est-à-dire avant mesures d’économies, atteindrait 4, 4 % cette année, tenant compte, au-delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital et dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3, 8 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d’économies, s’élevant à un total de 1, 7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM hors crise serait ramené à 2, 8 % en 2024, puis à 2, 7 % en 2025 et à 2, 6 % en 2026.
Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de soixante-deux à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également des mesures d’accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront en premier lieu à dispenser de la hausse de l’AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l’âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l’activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l’usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023, mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (CNRACL) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT-MP. Pour les employeurs publics de la CNRACL, l’État compensera intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances. La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l’horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale aura des impacts financiers qui monteront en charge au-delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires. Il est également tenu compte des propositions parlementaires tendant à une harmonisation des prélèvements applicables aux indemnités de rupture. Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l’équilibre à l’horizon 2030. Une étude d’impact financière spécifique a été jointe au projet de loi.
Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides-soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° 2023-1 du 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d’inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S’agissant de la trajectoire des comptes publics et de l’impact de la réforme des retraites sur l’équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0, 4 Md€ […] est réaliste ».
II. – Au-delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.
Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
Après un net rebond en 2021, à + 8, 0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de + 5, 3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au-delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8, 6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques, mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4, 1 % en valeur en 2022. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022, de 5, 4 milliards d’euros, et s’établirait à 18, 9 milliards d’euros.
En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 8, 2 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (10, 7 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2, 1 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d’euros, mais avec une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4, 1 % de juillet 2022 s’est ainsi ajoutée une revalorisation de 0, 8 % au 1er janvier 2023 pour les retraites, et s’ajouterait au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales une revalorisation de 1, 7 %. Les recettes croîtraient de 4, 0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.
À partir de 2024, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4, 3 % en 2023 à 2, 1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 9, 6 milliards d’euros, les recettes évoluant de + 4, 2 %, légèrement en deçà de la dépense (+ 4, 3 %). En 2025, il atteindrait 13, 5 milliards d’euros, avec une progression des recettes de + 3, 1 %, moindre que celle des dépenses (+ 3, 7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 13, 1 milliards d’euros à cet horizon.
III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
La branche Maladie, qui connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant -21, 9 milliards d’euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à -7, 9 milliards d’euros en 2023, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d’euros provisionnés). L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité postnatal, de 2 milliards d’euros en 2023.
Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l’usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico-sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s’améliorer continuellement à l’horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s’établirait à 4, 0 milliards d’euros.
La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à - 0, 4 milliard d’euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5, 1 % et à 5, 2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait - 1, 3 milliard d’euros en 2023.
À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0, 15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0, 7 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en Ehpad et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.
S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2, 0 milliards d’euros en 2022, puis s’élèverait à 2, 2 milliards d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche vieillesse, puis de nouveau en 2026. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1, 4 milliard d’euros en 2026.
Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à - 1, 2 milliard d’euros.
À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL, mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche vieillesse et du FSV à 4, 5 %, contre 4, 0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité vieillesse, atteindrait ainsi 2, 5 milliards d’euros en 2023 et jusqu’à 11, 3 milliards d’euros à l’horizon 2026. Les éléments relatifs à l’ensemble des régimes, qui permettent d’atteindre l’équilibre à l’horizon 2030, sont présentés dans l’étude d’impact du projet de loi.
La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2, 6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1, 0 milliard d’euros) supporté par cette branche.
L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité postnatal, pour 2, 0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1, 3 milliard d’euros en 2023.
À l’horizon 2026, l’excédent de la branche diminuerait et s’élèverait à 0, 8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
En milliards d ’ euros

2022 (p)
2023 (p)
2024 (p)
2025 (p)
2026 (p)
Maladie
Recettes
Dépenses
Solde
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes
Dépenses
Solde
Famille
Recettes
Dépenses
Solde
Vieillesse
Recettes
Dépenses
Solde
Autonomie
Recettes
Dépenses
Solde
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
En milliards d ’ euros

2022 (p)
2023 (p)
2024 (p)
2025 (p)
2026 (p)
Recettes
Dépenses
Solde
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
En milliards d ’ euros

2022 (p)
2023 (p)
2024 (p)
2025 (p)
2026 (p)
Recettes
Dépenses
Solde
La parole est à M. le ministre délégué.
Comme je viens de l’indiquer dans mon intervention liminaire, cet amendement vise à modifier l’annexe obligatoire présentant les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre par branche des régimes obligatoires de base pour les années à venir.
Il s’agit d’un amendement de coordination, dont l’adoption permettrait de tenir compte, en conformité avec le principe de sincérité des lois financières, des impacts financiers des amendements adoptés au Sénat, ainsi que des modifications effectuées par la commission mixte paritaire.
Exclamati ons sur les travées des groupes SER et GEST.
Protestations sur les t ravées des groupes CRCE, SER et GEST.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure . Toutefois, à titre personnel, j’émets un avis favorable sur cet amendement, qui est conforme au principe de sincérité.
Mêmes mouvements.

Ses dispositions sont la traduction des accords qui ont été trouvés hier en commission mixte paritaire, mais aussi des votes du Sénat.
Murmures sur les t ravées des groupes SER, CRCE et GEST.
L ’ amendement est distribué.

Monsieur le ministre, nous découvrons cet amendement ce matin. Il vise à corriger le tableau figurant à l’annexe 6, pour tenir compte des travaux de la commission mixte paritaire.
Les conclusions de la CMP sont connues de tous, et il est évident qu’elles ont une incidence sur le tableau. Si vous souhaitez toutefois, mes chers collègues, que la commission se prononce dans les formes, je vous propose de la réunir quelques instants au salon Victor Hugo.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Le texte de cet amendement est long, puisqu’il reprend l’intégralité de l’annexe A. En réalité, il ne comporte qu’une seule modification.
Il s’agit, comme je l’ai annoncé dans mon intervention liminaire, d’un nouveau transfert de recettes entre la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et la branche vieillesse, pour garantir l’équilibre de notre système de retraites. Le montant de ce transfert est de 700 millions d’euros.
C’est la seule évolution notable qui figure dans cet amendement.

Mon intervention se fonde sur l’article 44 de notre règlement.
Je remercie Mme la présidente de la commission des affaires sociales de réunir – enfin ! – la commission. En effet, pendant toute la durée de l’examen de ce texte, malgré nos nombreux rappels au règlement, ce privilège nous a été refusé. C’est dire combien la démocratie a été bafouée…
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Franchement, nous distribuer ainsi un amendement de sept pages, sans suspension de séance à l’origine, en nous disant qu’il n’y a pas de modification notable, n’est-ce pas, également, bafouer les droits des parlementaires ?
Nous acceptons donc les quelques minutes grappillées grâce à la générosité de Mme la présidente. Mais j’attire votre attention, mes chers collègues, sur la façon dont les sénateurs, notamment ceux de l’opposition, sont traités. C’est une remise en cause du parlementarisme !
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER.
La séance, suspendue à neuf heures trente-cinq, est reprise à neuf heures cinquante.

La commission des affaires sociales s’est réunie et a émis un avis favorable sur cet amendement.
Pour autant, je souhaite vous faire part d’un certain nombre de réflexions suscitées par cette suspension de séance. Je crois que notre manière de présenter cet amendement n’a pas été la bonne.
Exclamations ironiques sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.

Nous aurions dû diffuser un tableau informant nos collègues des traductions budgétaires des différents amendements votés au Sénat.
Par ailleurs, il est exact qu’il n’est pas possible de prendre connaissance en quelques minutes d’un amendement de plusieurs pages, même s’il ne tend à apporter qu’un seul changement dans une ligne budgétaire. Nous devons donc employer des méthodes différentes, car celle qui a été mise en œuvre aujourd’hui me paraît en effet très contestable.
M. Pierre Louault applaudit.
L ’ amendement est adopté.

Le vote sur l’ensemble constitué par l’article 6 et l’annexe, modifié, est réservé.

Sur les articles 7 à 20, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote.
J’indique au Sénat que, compte tenu de l’organisation du débat décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de cinq minutes pour ces explications de vote, à raison d’un orateur par groupe, l’orateur de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mmes Annick Billon et Évelyne Perrot applaudissent également.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la CMP qui s’est tenue hier a marqué une étape importante dans le parcours d’un texte qui, après un examen tronqué à l’Assemblée nationale, suivi d’un long examen au Sénat, au terme duquel son volume a plus que doublé, a poursuivi le cheminement ordinaire de la procédure parlementaire.
Réunie pendant plus de huit heures et demie, la CMP a procédé à une revue attentive des différents articles, notamment au fil de différentes propositions de suppression.
Nos collègues députés, empêchés en première lecture de débattre du recul de l’âge légal, des carrières longues ou encore des équilibres financiers du texte ont cette fois pu le faire, ce qui a permis aux différentes sensibilités de s’exprimer avant de passer au vote.
Cela a été rappelé à de nombreuses reprises, le Sénat, soucieux de la pérennité de notre modèle social et de notre capacité collective à en faire bénéficier les générations futures, porte cette réforme de longue date.
Les évolutions démographiques et sociales nous y obligent, car l’émergence de besoins sociaux accrus liés au vieillissement, à la santé ou encore à la nécessité d’investir pour notre jeunesse et l’avenir de notre pays ne nous permet pas de dégager des marges supplémentaires pour le financement des retraites.
Comme je l’indiquais dans la discussion générale, consacrer une part très importante de notre richesse nationale aux retraites relève d’un choix implicite, qu’il nous revient aujourd’hui de clarifier, d’interroger et de discuter. Une part des gains d’espérance de vie qui se poursuivent doit être mobilisée pour le bien commun et la consolidation du financement des retraites.
Deux autres éléments supplémentaires plaident en ce sens.
D’une part, les sexagénaires d’aujourd’hui n’ont que peu à voir avec leurs aînés des années 1950, qui partaient pourtant à la retraite à 65 ans et pour peu de temps.
D’autre part, notre système de retraites s’est enrichi au fil du temps de dispositifs de solidarité qui atténuent les inégalités de carrière et corrigent les effets des règles générales pour les publics qui sont les plus vulnérables pour des raisons de santé, de carrière ou de revenus.
C’est pourquoi la présente réforme pèse beaucoup moins que les précédentes sur les publics fragiles.
Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.

Son examen au Sénat a permis de renforcer cette caractéristique. Nous avons voulu prendre en considération la situation de ceux qui ne peuvent travailler plus longtemps, parce qu’ils ont commencé tôt, parce qu’ils sont en mauvaise santé ou parce que leur fin de carrière manque de perspectives.
Au-delà des atténuations des effets de la réforme, le texte comporte des avancées pour les apprentis, les stagiaires, les étudiants ou les élus locaux. Il s’inscrit dans une tendance, jamais démentie, d’élargissement et d’enrichissement de notre système social.
Finalement, le texte issu de la CMP propose une réforme qui garantit l’avenir de notre système de retraite sans toutefois faire peser l’effort sur ceux qui ne pourraient le supporter.
C’est pourquoi le groupe Les Républicains invite le Sénat à le voter et à prendre ses responsabilités avec courage, comme il l’a fait de manière constante. Nous sommes conscients que ce projet de loi marque une étape et qu’il doit s’accompagner de changements profonds dans la prise en compte des salariés les plus âgés. Dans une économie souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre, il est évident que ceux-ci ont toute leur place.
Ce chantier est celui des entreprises et des partenaires sociaux avant d’être celui de la loi. Néanmoins, si des changements législatifs se révélaient nécessaires, nous répondrions présents, comme nous l’avons fait pour la santé au travail, l’assurance chômage et toutes les réformes affectant le fonctionnement du marché du travail.
La retraite ne saurait être le seul horizon pour les jeunes qui ont, avant de l’atteindre, toute leur vie à construire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions. – MM. Olivier Cadic et Vincent Capo-Canellas applaudissent également.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, plus de cent heures de débats au Sénat, plusieurs milliers d’amendements examinés, dix jours de discussions et, enfin, nous y sommes !
Enfin, ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale trouve une issue. La CMP s’est réunie hier. Nous devons désormais adopter le texte qui en résulte.
C’est pourquoi, je le dis d’emblée, notre groupe votera cette réforme des retraites. Notre objectif est non pas de vendre du rêve aux Français
Exclamati ons sur les travées des groupes SER et CRCE.

Cette réalité, elle est limpide. Il y avait quatre actifs pour un retraité dans les années 1960 ; trois cotisants pour un retraité dans les années 1970 ; et, en 2023, il y a 1, 7 cotisant par retraité… Face à ce constat, qui peut croire que notre modèle social, en l’état, est pérenne ? Il ne l’est pas. Le Gouvernement se devait d’agir.
Le choix était binaire. Augmenter les prélèvements revenait à pénaliser le pouvoir d’achat des Français dans un contexte déjà difficile. Accroître le temps de travail restait donc la seule solution réaliste, alors que l’espérance de vie progresse encore.
Cette réforme permettra de sauver notre régime par répartition et de préserver le pouvoir d’achat des Français. Nous saluons ainsi le report de deux ans de l’âge légal. Il s’agit d’une nécessité pour l’équilibre de notre système.
Nous regrettons toutefois que l’ajout d’une dose de capitalisation collective dans notre système par répartition n’ait pas été retenu. Il nous faudra à l’avenir réfléchir à cette question.
Si de nombreux Français se sont inquiétés de certains aspects de cette réforme, notamment sur les carrières longues, la CMP est parvenue à trouver une solution à ce sujet.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires avait choisi, lors des débats, de porter un amendement visant à favoriser les carrières longues, idée partagée par de nombreux sénateurs. Nous nous réjouissons donc que le dispositif adopté permette à tous ceux qui ont cotisé au moins cinq trimestres avant 21 ans de partir plus tôt, sans avoir à cotiser plus de 43 annuités. Le coût, de l’ordre de 700 millions d’euros à l’horizon de 2030, est important, mais cette mesure a le mérite de donner plus de lisibilité à la réforme et d’en garantir l’équité.
C’est la preuve que le compromis et le consensus sont possibles.
Par ailleurs, ce texte contient plusieurs mesures de justice sociale. Les régimes spéciaux avaient été conçus à des périodes où les circonstances l’imposaient, en raison de mauvaises conditions de travail. De nombreux progrès ont été réalisés en la matière, ce qui justifie leur suppression progressive. Le régime général apparaît désormais plus juste pour l’ensemble des Français. Nous saluons donc le maintien de cette mesure par la CMP.
Nous saluons également la surcote, allant jusqu’à 5 %, pour les mères de famille ayant réalisé une carrière complète. C’était une nécessité. Cette surcote vient combler un manque et rend hommage à ces femmes qui, tout en travaillant pour subvenir aux besoins de leur famille, participent activement à l’éducation de leurs enfants.
Il est d’ailleurs juste d’avoir étendu aux professions libérales la majoration de 10 % de la pension à partir du troisième enfant, tout comme il est juste d’avoir intégré les indemnités journalières de maternité dans le calcul de la pension.
Nous nous réjouissons de l’adoption de l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF), qui va bénéficier à près de 40 000 personnes par an. C’est un dispositif que nous soutenons et qui va dans le bon sens, même si certains d’entre nous auraient souhaité aller plus loin.
De plus, la prise en compte d’une majoration de trimestres au bénéfice des pompiers volontaires représente une avancée tout à fait justifiée, que nous avions nous-mêmes défendue.
Sceptiques quant au CDI senior qui a été proposé, nous sommes rassurés de constater qu’il n’a été maintenu qu’à titre expérimental. Cela permettra d’en juger l’efficacité, avant, éventuellement, de le généraliser. Dans le même registre, l’index seniors peut être un atout.
Nous ne doutons pas que cette politique volontariste en faveur de l’emploi des seniors trouvera son aboutissement dans la future loi Travail. Les échanges entre les générations sont une richesse pour les entreprises et doivent être encouragés.
Ainsi, avec toutes ces mesures, cette réforme est juste et s’inscrit dans le pacte social français. Elle est un moyen de garantir la pérennité de notre système de retraites, ce qui est indispensable.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera donc pour l’adoption de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi qu e sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Bernard Buis applaudit également.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Vifs applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le texte soumis au vote du Parlement aujourd’hui est le fruit d’une CMP sans suspense, au cours de laquelle l’opposition a pris connaissance du résultat de réaménagements à la marge, négociés en amont avec le Gouvernement pour assurer les votes de la droite dans les deux chambres.
Dans le cadre d’un budget alloué aux mesures d’atténuation de la brutalité de la réforme, nous avons assisté au compromis final, troquant une mesure contre une autre, tout en préservant la philosophie générale, qui est de faire travailler plus, par le report de 62 ans à 64 ans de l’âge ouvrant droit à la retraite.
Ainsi, le CDI senior, proposé par le Sénat, a été cantonné à une expérimentation, afin de libérer quelques centaines de millions d’euros pour un meilleur calibrage des carrières longues, dont dépendaient quelques votes de l’Assemblée nationale.
Ne soutenant pas la première mesure, et constatant que la seconde n’a pas atteint son but, nous remarquons néanmoins que la droite sénatoriale a consenti à abandonner une partie de ses amendements et remaniements du texte pour éviter un 49.3 à l’Assemblée nationale, après avoir consenti au 44.3 au Sénat.
Défendue depuis plusieurs années, cette réforme valait bien quelques sacrifices du rôle du Parlement… Son cœur est inchangé, tout comme son injustice et sa brutalité, ou sa dimension productiviste, puisque son impact a été évalué au gain d’un point de PIB.
Un point de PIB, au prix, pour beaucoup, d’un prolongement du sas de précarité et de pauvreté, d’une explosion des arrêts maladie de longue durée, du chômage ou du basculement dans les minimas, soit un coût social inédit et une fracture sociale approfondie, ignorée par les partisans de la réforme, qui n’ont rien d’autre à proposer qu’un index non contraignant, l’expérimentation d’un CDI fin de carrière, prétexte à de nouvelles exonérations, et un peu de surcote, contre la liberté de partir à la retraite.
Un point de PIB, vanté à coups de mensonges sur les 1 200 euros et de marchandages entre les droites et le Gouvernement, pour troquer une mesure d’atténuation contre une autre, avec l’objectif partagé de réaliser l’économie des dépenses sociales qui financera, in fine, les nouvelles baisses d’impôts des plus fortunés.
Un point de PIB, en imposant une augmentation contrainte de l’offre de travail et la concurrence entre travailleurs pour faire pression sur les salaires, après avoir dérégulé le marché de l’emploi, permis la dégradation des conditions de travail et voté une restriction des droits au chômage.
Un point de PIB, à contre-courant, ignorant les transformations sociétales et sociales en cours, la crise de l’attractivité, les vagues de démissions et le ras-le-bol face à la subordination salariale, au manque d’autonomie et de sens au travail.
Un point de PIB, que vous grappillez encore sur le travail, aggravant l’inégalité du partage des richesses, alors que la ponction des dividendes explose et capte, justement, de plus en plus de points de PIB.
Un point de PIB, parce que vous ignorez la diversité et l’utilité des services non marchands et le logiciel nouveau pour relever les défis sociaux et climatiques de notre siècle.
Un point de PIB, contre les préconisations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), arraché à la Terre, alors que la France dépasse déjà six des neuf limites planétaires et que s’aggravent les inégalités de patrimoines inconciliables avec la bifurcation écologique.
Un point de PIB, parce que vous êtes prisonniers d’un logiciel productiviste, incapables d’imaginer une prospérité sans croissance, où serait possible, et même nécessaire, une réduction du temps de travail.
Un point de PIB, enfin, en bafouant les corps intermédiaires, acteurs représentatifs de la démocratie sociale moderne, en brutalisant le Parlement, en ignorant le refus radical de cette réforme par le peuple français, en l’imposant comme si ce n’était qu’un mauvais moment à passer.
Vous vous trompez ! Votre refus de la solution de cette impasse, à savoir le recours au référendum, est un nouvel aveu de faiblesse. Retirez votre projet ou soumettez-le au référendum, car vous n’avez pas de mandat du peuple français pour cette réforme.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera contre ce texte, bien entendu, et il vous appelle, messieurs les ministres, à faire preuve de responsabilité et à retirer votre réforme.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Applaudissements sur les travées du group e RDPI. – Mme Évelyne Perrot applaudit également.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons au terme de ce débat sur la réforme des retraites. Après soixante-quatorze heures de discussions à l’Assemblée nationale, cent neuf heures au Sénat et neuf heures en CMP, personne ne pourra nier que nous avons eu le temps de débattre sur le fond.
Certains ont remis en cause la légitimité des outils prévus par notre Constitution ou notre règlement intérieur. Mais l’obstruction d’une minorité n’aura pas empêché la majorité d’entre nous, qui souhaitions améliorer ce texte, de faire ce pour quoi nous sommes élus : voter la loi.

Je me félicite, mes chers collègues, que nous ayons abouti à ce texte, car c’est le fruit du travail parlementaire – le fruit du travail de toutes les sensibilités de notre chambre.
En trouvant un compromis, nous avons répondu à la nécessité d’équilibrer notre système de retraite tout en assurant des droits et progrès nouveaux.
Le travail est au cœur de cette réforme. Vous l’avez rappelé, messieurs les ministres, alors que certains considèrent que le travail est une contrainte et une soumission à un système qui exploite les citoyens, nous y voyons la possibilité de jouer un rôle et d’occuper une place dans la société.

Le travail crée du lien social et offre les conditions de l’émancipation et de la dignité.

Oui, mes chers collègues, nombre de nos concitoyens s’épanouissent dans leur vie active. Ils y trouvent un sens et une place dans notre société.
Il n’y a pas de déni dans mes propos : certains métiers sont moins épanouissants que d’autres, plus usants et plus pénibles, et il faut donc adapter notre système à ces publics fragiles. C’est ce que nous avons fait dans ce projet de loi.
Nous avons axé nos travaux sur des points essentiels, porteurs d’avancées et de solidarité pour les Françaises et les Français. C’est ainsi que nous avons renforcé les droits familiaux, par la création d’une surcote pour les mères qui auraient atteint la durée d’assurance requise à 63 ans, par l’extension aux professions libérales de la majoration de 10 % de la pension à partir du troisième enfant, ou encore par la prise en compte des congés maternité.
Nous avons aussi souhaité, après en avoir débattu en CMP, conserver la proposition de la présidente Billon, qui consiste à ne pas attribuer de trimestres aux parents condamnés pour violences et maltraitances à l’encontre de leur enfant.

Nous avons fixé un minimum de deux trimestres de majoration au titre de l’éducation des enfants au bénéfice de la mère. Cette mesure, portée par la présidente Rossignol, protégera de fait les femmes.
Nous avons souhaité soutenir les publics les plus fragiles, notamment par la réversion de la pension pour les orphelins, avec des mesures spécifiques pour les enfants porteurs de handicaps, ou par la revalorisation des retraites et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) à Mayotte, défendue par notre collège Thani Mohamed Soilihi.
Nous avons aussi adopté plusieurs mesures pour rendre notre système plus juste, par une meilleure prise en compte des carrières hachées, le renforcement des droits à la retraite des aidants, l’attribution de la durée d’assurance au titre de l’éducation en cas de décès de l’enfant, l’intégration des périodes d’emploi des stagiaires et des apprentis dans le calcul des droits à la retraite et la majoration pour les sapeurs-pompiers.
Nous avons aussi assoupli le dispositif carrières longues, qui a tant fait débat. En créant une barrière d’âge à 18 ans et une autre à 21 ans, qui s’ajoutent à celles de 16 ans et 20 ans, et en supprimant le dispositif de la loi Touraine, qui imposait jusqu’à deux ans de cotisations supplémentaires à ceux qui ont travaillé avant l’âge de 16 ans, nous avons fait en sorte que plus aucune personne ayant travaillé avant 21 ans ne soit obligée de travailler plus que 43 annuités.
Protestations sur les travées des groupes SER et CRCE.

Cette réforme permettra également une prise en compte de l’usure professionnelle, par l’élargissement de l’accès au compte professionnel de prévention et par la création d’un fonds d’investissement dans la prévention doté de 1 milliard d’euros.
Ce texte, mes chers collègues, a été considérablement enrichi par le Sénat, ce qui renforce le rôle de notre chambre dans la fabrique de la loi.
Notre système par répartition tout entier est bien bâti sur la solidarité intergénérationnelle entre actifs et retraités. Nous votons pour une société plus solidaire, prospère et pérenne.
Devant une réalité démographique qui est implacable, cela a été rappelé, nous faisons le choix de la responsabilité.
Face au déséquilibre de nos finances publiques, nous faisons le choix du travail.
Confrontés au risque d’une paupérisation sociale, nous faisons le choix de l’équité.
Parce que nous valoriserons toujours le travail par rapport à la taxation excessive, notre groupe votera en faveur de ce texte et des conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées des groupes CRCE et GEST.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, j’avais travaillé un texte pour mon explication de vote sur l’ensemble de ce texte, comme nous le faisons en règle générale.
Seulement voilà, parce que j’ai entendu les discours des ministres et d’autres propos encore, je ne l’utiliserai pas.
Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur Dussopt, vous avez pris soin d’expliquer à quel point le débat s’était mal déroulé dans nos deux assemblées.
Tout en nuançant vos propos lorsque vous parliez du Sénat, vous avez tout de même critiqué la façon dont nous avons travaillé. Or nous avons œuvré très sérieusement.
Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées des groupes CRCE et GEST.

Les oppositions, comme la majorité, j’imagine, ont préparé leur sujet pendant des semaines.
Oui, monsieur le ministre, nous avons usé de notre droit d’amendement. Si nous ne l’avions pas fait, je ne vois pas bien comment nous aurions pu débattre. Vous avez tout fait, à commencer par le choix du véhicule législatif, pour nous empêcher d’aller au fond du sujet et de discuter. Vous avez tout fait pour réduire le temps du débat.
Alors, oui, nous avons déposé des amendements, parce que nous voulions vous pousser jusque dans vos retranchements. Si nous avons agi de la sorte, c’est parce que nous accompagnons le mouvement social et ces millions de salariés qui ne veulent pas du report de l’âge de la retraite.
Applaudissements sur les mêmes travées.

Quant à vous, monsieur Attal, vous nous promettez, comme d’habitude, l’enfer et la faillite. Tout cela n’est pas sérieux !

Mme Monique Lubin. Nous savons, certes, qu’il y aura peut-être, dans quelques années, des déficits, de l’ordre de 13 milliards d’euros. Nous vous avons d’ailleurs fait des propositions pour les combler.
M. le ministre délégué sourit.

… mais les salariés, eux, n’ont pas envie de rire aujourd’hui.
S’agissant de la commission mixte paritaire d’hier, on nous dit qu’elle a débouché sur un compromis. Mais une CMP, c’est une CMP.
M. Jérôme Bascher ironise.

Les compromis n’ont pas été trouvés hier dans la journée. La CMP a duré, parce que, une fois de plus, nous vous avons contraints à discuter de tous les articles, mais tout était bouclé hier matin.

Mme Monique Lubin. Et tout était bouclé dans l’intérêt non pas des salariés, mais du Gouvernement et du Président de la République.
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST. – Marques d ’ ironie sur les travées du groupe Les Républicains.

Visiblement, ce que je dis doit être drôle, car on rit beaucoup sur les travées…

En réalité, la CMP d’hier n’avait qu’un seul but : sauver la face, tant votre projet de loi est mal engagé depuis des mois, tant il est mal perçu par la population.
S’agissant de la réforme, vous nous avez suffisamment entendus : nous ne voulons pas des 64 ans. Cette mesure va pénaliser ceux qui travaillent depuis longtemps, ceux qui ont les métiers les plus difficiles et ceux qui perçoivent les salaires les moins élevés.
Vous avez apporté des mesures dites d’atténuation, comme les contrats seniors, qui seront en réalité financés par d’autres, en l’occurrence, si j’ai bien compris, par la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale.
Les contrats seniors sont un énième cadeau aux entreprises, comme si on ne leur en faisait pas assez, comme si maintenant les recrutements ne dépendaient que des cadeaux fiscaux et sociaux qu’on leur ferait !
Bravo ! et applaudissements sur les t ravées des groupes SER, CRCE et GEST.

Vous avez instauré également des surcotes pour les femmes. J’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer plusieurs fois : aujourd’hui, une femme qui arrive à 62 ans avec tous ses trimestres et qui décide de travailler jusqu’à 64 ans bénéficie d’une surcote de 10 %. Demain, elle ne décidera plus de travailler jusqu’à cet âge, elle y sera obligée et on lui donnera royalement 5 % de surcote.
Applaudissements sur les mêmes travées.

Les petites pensions, pour leur part, sont un véritable fiasco ! Vous nous avez raconté que les deux millions de Français qui perçoivent les pensions les plus faibles verraient leur retraite s’améliorer. Or nous savons que ce n’est pas vrai.
Quant aux carrières longues, je suis désolé de vous le dire, malgré tous vos efforts, personne ne comprend rien au dispositif prévu.

Nous espérons que le plus grand nombre en bénéficiera, ce texte visant de fait ceux qui travaillent déjà depuis longtemps.
En conclusion, comment allez-vous réparer ce pays que vous êtes en train de fracturer durablement ?
Bravo ! et applaudissements prolongés sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, sans surprise, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur cette réforme des retraites.
À dix heures quatorze, vous avez voté les 64 ans.

Cela n’avait rien d’étonnant, puisque les parlementaires Les Républicains, les centristes et les membres de Renaissance étaient favorables à l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.
Nous examinons les conclusions de la CMP alors même que le rapport n’a pas été mis en ligne, mais qu’importe ! Sur les travées de la droite, plus rien ne vous gêne : rapport ou non, vous voterez ce texte.

Alors que nous n’en étions qu’à l’article 14 du texte et que la CMP était loin d’être terminée, vous avez sorti un communiqué annonçant une CMP conclusive.

Il vous a fallu moins de temps en CMP pour « dealer » l’avenir de notre pays qu’il n’en a fallu au Sénat pour déposer un amendement de réécriture de l’article 7, qui a fait tomber 1 300 amendements.
Nous n’oublions pas non plus que la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale veulent imposer une réforme à laquelle sont opposés 70 % des Français et 90 % des actifs.
Cette minorité politique a décidé de notre avenir, à une majorité de 10 contre 14 en commission mixte paritaire. À la crise sociale et environnementale, le Gouvernement et les droites parlementaires ont donc décidé d’ajouter une crise parlementaire et une crise démocratique.
Vous imposez une régression sociale en ayant recours aux artifices de la Constitution et du règlement du Sénat.
Depuis deux mois, le peuple vous dit non. Ils étaient encore des milliers dans la rue hier, pour la huitième fois, pour dire leur refus de votre projet. Nous avons dénoncé votre réforme injuste, inefficace et impopulaire, mais votre obsession s’est transformée en aveuglement.
Le texte issu de la CMP acte une réforme profondément injuste, qui va s’appliquer dès le 1er septembre prochain et contraindre des milliers de concitoyens à retarder leur pot de départ à la retraite de deux ans.
Le Gouvernement a donc accepté le contrat de fin de carrière des Républicains. En 2006, un contrat du même type avait été instauré, pour un résultat nul.
Le Gouvernement devrait mettre autant d’énergie à lutter contre la fraude patronale aux cotisations sociales et contre l’évasion fiscale. Les sommes recouvrées permettraient de financer notre système de retraite, sans imposer deux années supplémentaires de vie brisée.
Contrairement aux affirmations du ministre Gabriel Attal, l’équilibre du système de retraite n’est nullement garanti par cette réforme. Il est assuré par la baisse de la subvention d’équilibre de l’État au régime de retraite et notamment par le gel du point d’indice des fonctionnaires et la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
Votre dogme libéral vous fait perdre la raison. Ce sont les politiques d’austérité qui ont entraîné le déséquilibre de notre système de retraite.
Je rappelle que le Conseil d’orientation des retraites indique dans son rapport que les mesures d’économies sur la masse salariale publique se traduisent « par une détérioration du solde du système de retraite ».
Les choix réalisés par la droite sous Nicolas Sarkozy permettent aujourd’hui aux parlementaires Les Républicains d’exiger la généralisation de la capitalisation dans notre système par répartition.
Le refus de mettre à contribution les plus riches, le refus de mettre à contribution les dividendes, le refus d’élargir l’assiette de cotisation révèlent les intérêts de ceux que vous protégez.
Vous avez même refusé l’augmentation de la cotisation employeur, pourtant proposée par le Haut-Commissariat au Plan pour garantir la pérennité du système de retraite.
Vous faites passer les intérêts financiers avant la prise en compte de la pénibilité et des inégalités salariales entre les femmes et les hommes.
La suppression des régimes spéciaux offre une vision éclairante de la manière dont vous concevez la prise en compte de la pénibilité des métiers.
En conclusion, nous avons assisté à un marché de dupes entre le Gouvernement et Les Républicains, qui ont renoncé à leurs amendements sur les carrières longues et sur la prise en compte des risques chimiques.
Vous portez un projet de classe contre les travailleurs et les travailleuses.
La fébrilité du pouvoir monte avec la menace croissante du 49.3. Vous aurez beau utiliser, comme vous l’avez fait ici, tous les coups de force antidémocratiques, vous ne convaincrez pas les Français du bien-fondé de votre réforme, qui vise à les faire travailler jusque 64 ans, bien au contraire.
Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste s’opposera jusqu’au bout à cette réforme et soutiendra le mouvement social.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées des groupes SER et GEST. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous y voilà ! Nous abordons la toute dernière ligne droite de ce texte sur la réforme des retraites. Le groupe Union Centriste votera majoritairement ce texte.

M. Olivier Henno. Le Sénat et la majorité sénatoriale ont été à la hauteur de l’enjeu, sourds à la démagogie.
Mme Cathy Apourceau-Poly et M. Éric Bocquet ironisent.

« Le triomphe des démagogies est passager, mais les ruines sont éternelles », disait Péguy.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

J’irai même plus loin. Tel un diapason, le Sénat et la majorité sénatoriale ont donné le la sur ce texte. Je saisis l’occasion de saluer et remercier nos rapporteurs de la qualité de leur travail et de leur connaissance du dossier des retraites. Ils l’ont démontrée tout au long du débat, au cours de la CMP et encore à l’instant en commission.

Je persiste et signe, mes chers collègues : ce texte ne mérite pas l’indignation qu’il suscite.
Il ne justifie pas non plus un enthousiasme démesuré. Ce n’est ni le diable ni la mère des réformes.
Sourires.

Ce texte, et ce n’est pas rien, assure la survie de notre régime par répartition. Surtout, il évite à notre pays de s’endetter pour payer ses retraites.
Souvent, nous entendons dans cet hémicycle qu’il y a une bonne et une mauvaise dette. Je partage cette opinion : s’endetter pour investir dans la recherche ou les infrastructures – en un mot, s’endetter pour l’avenir et l’innovation – peut avoir une dimension vertueuse.
Toutefois, s’endetter pour le fonctionnement, c’est irresponsable ; c’est compromettre l’avenir. Cela nous est d’ailleurs interdit, dans les collectivités territoriales, sous peine de mise sous tutelle. Nous considérons que s’endetter pour payer les retraites est le comble de l’irresponsabilité. C’est une honte eu égard aux plus jeunes générations.
Cette affirmation toute simple donne sens au vote de ce texte. J’ai entendu des choses et d’autres au cours de cette discussion, et cette citation de Shakespeare me revenait à l’instant : « Les mots ne paient pas les dettes », mes chers collègues.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Ce texte consolide pour plusieurs années notre système de retraite par répartition.
Notons les avancées qu’il contient sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ou sur l’emploi des seniors, grâce au dispositif d’incitation et d’octroi.
Notons la prise en compte des trimestres – excusez du peu ! – travaillés au titre des travaux d’utilité collective (TUC), en tant qu’aidants ou pour les élus qui touchent moins de 1 830 euros par mois.
Notons enfin les mesures visant à compenser la pénibilité ou les carrières longues, avec les 43 ans de cotisation.
Aussi, pourquoi ce texte, qui contient des avancées et ne concerne au total que six Français sur dix, à l’exclusion de ceux qui exercent les métiers les plus pénibles, suscite-t-il autant de tensions ?
Nous y voyons plusieurs causes. Notre système de retraite est injuste, mais cela ne date pas d’aujourd’hui. Lorsque la réforme Touraine a été adoptée, nous vous avons peu entendus, mes chers collègues, sur l’injustice du système de retraite…
Notre système est injuste. Il l’est moins à l’issue de cette réforme, mais il faudra continuer à avancer vers plus d’équité.
Par ailleurs, nous attendons peut-être trop de la réforme des retraites, laquelle ne saurait corriger toutes les injustices de la société française et de notre système social.
Enfin, et surtout, notre groupe estime que ces tensions ont pour cause le manque de dialogue social et la crise du paritarisme. La faute originelle de l’exécutif est, selon nous, d’avoir enjambé les corps intermédiaires. C’est pourquoi nous appelons à l’ouverture d’une conférence sociale après le vote de ce texte.
Les sujets sociaux qui sont sur la table sont importants et nombreux. Le travail comme valeur ou contrainte – nous en avons débattu ces derniers jours –, la rémunération des salariés, le cadre de gestion de l’assurance chômage, l’emploi des seniors, la santé ou le logement : autant de questions sur lesquelles la société française a besoin d’apaisement.
Or cet apaisement passe par un paritarisme et un dialogue social refondés et rénovés.
Pour conclure, je veux partager avec vous, mes chers collègues, un sentiment différent de celui qui a été évoqué à l’instant : je pense avoir vécu, ici au Sénat, un beau moment parlementaire.
Merci ! sur le s travées des groupes CRCE et SER.

Le Sénat représente les territoires, et c’est son honneur. Mais nous avons apporté la réponse la plus forte qui soit à ceux qui nous ont parfois caricaturés en Bundesrat.

Nous sommes un parlement de plein droit et, surtout, un pilier de la République.
Mes chers collègues, vive le Sénat, vive la République !
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu e sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Colette Mélot et M. Bernard Fialaire applaudissent également.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
Vives exclamations sur des travées des groupes SER et CRCE.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, aujourd’hui, nous sommes appelés à un vote crucial pour éviter d’infliger de nouveaux sacrifices à nos compatriotes et mettre le Gouvernement face à ses responsabilités.

Ce vote est crucial en vue de réconcilier la démocratie parlementaire avec les Français.

Ce vote est crucial pour la droite, qui peut enfin envoyer le message qu’elle n’est pas là pour servir la soupe à Emmanuel Macron.
Ce vote est crucial, enfin, pour la gauche, en vue d’expier sa faute d’avoir appelé à voter pour le candidat Macron en 2022
Protestations sur les travées des groupes CRCE et SER.

et d’avoir voulu empêcher le vote du texte par une tenue parlementaire d’un aussi mauvais goût que ses tenues vestimentaires.
Mêmes mouvements

En réalité – dois-je vous le rappeler, mes chers collègues ? –, nous sommes des hommes et des femmes libres. Moi, en tout cas, je le suis !
L’exécutif, lui, est piégé, car Bercy a promis cette réforme des retraites à la Commission européenne pour bénéficier du plan de relance et du « quoi qu’il en coûte ».

Il est obligé désormais de faire cette réforme, qui est non pas sociale, mais économique et idéologique. Il la fera sans nous. En tout cas, il la fera sans moi !
Nous voilà livrés pieds et poings liés à Mme von der Leyen et à l’Union européenne, alors que notre participation nette à son budget est de 10 milliards d’euros par an. En voilà des économies !
Je ne nie pas la réalité problématique du système par répartition : on compte aujourd’hui 1, 7 actif seulement pour un retraité. Mais ce n’est pas la faute des Français si, pour se plier aux exigences de l’ultralibéralisme, les gouvernements ont abandonné depuis trente ans notre tissu agricole et industriel à une concurrence étrangère déloyale, jetant des millions de Français au chômage et nous privant ainsi d’autant de cotisants.
Reporter l’âge de départ à la retraite, c’est demander plus d’efforts aux Français pour s’éviter de tailler dans les gisements d’économies tabous.
En effet, des économies, il y en a à faire, sur la fraude sociale – de 20 à 30 milliards d’euros –, sur la fraude fiscale – près de 40 milliards d’euros selon un rapport sénatorial d’information –, sur le recours aux cabinets de conseil – 2, 5 milliards d’euros selon l’inspection générale des finances –, …

M. Stéphane Ravier. … sur la fraude migratoire, enfin – plusieurs dizaines de milliards d’euros !
Exclamations ironiques sur les travées du groupe CRCE.

Dans un pays où les prélèvements obligatoires – 45 % du PIB – représentent un record européen, aucune réflexion n’est engagée par l’État, par facilité, par paresse ou par couardise pour baisser les cotisations qui pèsent sur notre croissance.
Comme les précédents, le gouvernement actuel préfère sacrifier les travailleurs et les mères de famille plutôt que son allégeance européiste en engageant les réformes structurelles nécessaires et urgentes.
De grâce, revenons à un État stratège, qui protège le présent et prévoit l’avenir en soutenant l’industrie et le monde paysan, créons des emplois qualifiés pour les plus jeunes et engageons une politique familiale ambitieuse encourageant la natalité française, et exclusivement française.
Ah ! sur les travées des groupes CRCE et SER.

Puisque le Président de la République fait le tour du monde pour fuir la colère des Français, le Sénat doit lui envoyer un message clair : quand Emmanuel Macron prend une cuite à Kinshasa, ce n’est pas aux Français d’avoir la gueule de bois !
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à refuser le grand déclassement, en faisant un bras d’honneur à cet injuste projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe UC.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, cela a été souligné samedi soir : le Sénat a consacré au texte sur la réforme des retraites un peu plus de cent heures de débat. Il est ainsi allé jusqu’au vote sur l’ensemble, ce que nos collègues de l’Assemblée nationale n’ont pu faire.
Cependant, dans notre hémicycle aussi, la forme l’a trop souvent emporté sur le fond, la politesse en plus. Amendements et sous-amendements déclinés à l’infini et petit livre vert brandi très fréquemment : toute la palette des outils de l’obstruction parlementaire a été utilisée.
Mme Monique Lubin proteste.

Le Parlement ne sort pas grandi de cet épisode. La réforme méritait des débats plus approfondis sur bien des aspects. Il a fallu en passer par l’article 44.3 pour pouvoir se pencher a minima sur tous les articles.
Soyons lucides : une réforme nous semble nécessaire, car la logique démographique à l’œuvre depuis plusieurs décennies menace l’équilibre financier de notre régime de retraite. C’est une évidence.
Le système a un grand défaut : il ne supporte pas une donnée pourtant heureuse, celle de l’allongement de l’espérance de vie. C’est cette équation qu’il nous faut résoudre, tout en tenant compte de certaines situations.
Tous les métiers ne se valent pas. Ce que certains peuvent faire jusqu’à 64 ans, d’autres ne le peuvent pas. Il y a l’exposition au risque. Il y a les accidents de la vie. Il y a le manque d’offres d’emploi pour les seniors. Il y a aussi des gens qui ont commencé trop tôt à travailler et pour lesquels l’expression « une retraite bien méritée » prend tout son sens !
La commission mixte paritaire qui s’est réunie hier a-t-elle réussi à trouver cet équilibre entre nécessité et justice ?
Nos collègues sont parvenus à un accord. C’est assez clair, les travaux de la commission portent la marque du Sénat. Bien entendu, les fondamentaux du texte gouvernemental demeurent, dont le fameux article 7 sur l’âge légal de départ, ainsi que l’index seniors, qui avait été réintroduit par notre assemblée.
Nos collègues rapporteurs ont exposé les principaux apports de notre assemblée. Je n’y reviendrai pas, si ce n’est pour saluer les améliorations concernant les carrières longues, mais aussi pour regretter le recul sur l’usure professionnelle à la suite du retrait du critère d’exposition aux agents chimiques dangereux.
Mes chers collègues, la balle sera cette après-midi dans le camp de l’Assemblée nationale. En attendant, je ne cacherai pas les différentes sensibilités qui existent au sein de mon groupe. Chacun a voté jusqu’à présent selon ses convictions : il en sera de même aujourd’hui.

Tout au long des débats, nous nous sommes toujours rassemblés sur les nombreux défis de la réforme : la pénibilité, les carrières longues, l’emploi des seniors, la compensation de l’engagement citoyen et bénévole, ou encore la possibilité de rachat de trimestres pour différents profils.
Une dizaine de nos amendements ont été adoptés, et certains, qui ont survécu à la CMP, visent à répondre à quelques-unes de nos attentes. Je pense aux jeunes en apprentissage, aux étudiants, aux travailleurs handicapés, aux sapeurs-pompiers volontaires ou encore aux femmes, pour lesquelles des aménagements ont été apportés.
Ce qui nous réunit aussi au groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, c’est l’idée que la solidarité, une valeur républicaine à laquelle nous sommes fortement attachés, continue de guider le régime par répartition que la France a mis en place en 1945 et auquel nos concitoyens restent très attachés.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains et INDEP. – M. Pierre Louault applaudit également.

Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 251 :
Nombre de votants345Nombre de suffrages exprimés307Pour l’adoption193Contre 114Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, INDEP, RDPI et RDSE.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures quarante-deux, est reprise à dix heures cinquante, sous la présidence de M. Alain Richard.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Les Indépendants – République et Territoires, la discussion de la proposition de loi visant à mieux protéger les locataires bénéficiant d’une allocation de logement et vivant dans un habitat non décent, présentée par M. Jean-Louis Lagourgue et plusieurs de ses collègues (proposition n° 821 [2021-2022], résultat des travaux n° 412, rapport n° 411).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, auteur de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – Mme Micheline Jacques applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, dans les territoires d’outre-mer subsistent un grand nombre de disparités, notamment du fait de l’éloignement géographique avec la métropole. La vie y est chère, le chômage y est deux à trois fois plus élevé et le taux de pauvreté avoisine les 40 % en moyenne.
Depuis près de vingt ans, les crises économiques et sanitaires s’y succèdent – chikungunya, « gilets jaunes », covid-19, etc. –, entraînant des conséquences encore plus frappantes qu’en métropole, à l’image de l’augmentation constante des prix, de la suppression de milliers d’emplois ou encore de la diminution du nombre de nouveaux logements construits.
Depuis 2019, les effets de l’actuelle crise sanitaire ont accentué le mal-être social, les inégalités et la précarisation de nombreux concitoyens ultramarins.
Parmi les très nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés, c’est sans aucun doute le logement, au côté de l’emploi, qui figure en haut du classement.
Si le manque de logements est malheureusement une triste réalité qui se ressent chaque jour, un phénomène suscite de plus en plus l’inquiétude des pouvoirs publics et des associations de défense de consommateurs : la non-décence des logements sociaux existants. Bien que toute la France soit concernée, l’outre-mer l’est tout particulièrement.
Le texte que je vous propose aujourd’hui a d’abord été déposé à l’Assemblée nationale par l’ancien député de La Réunion David Lorion, qui a été comme moi interpellé par la situation préoccupante de notre île. Une très grande partie de notre population est confrontée à des malfaçons et à des problèmes d’humidité ou de sécurité électrique, avec toutes les conséquences qui vont avec, notamment pour la santé.
Tant dans les logements anciens que dans les constructions neuves, beaucoup vivent dans des conditions d’extrême insalubrité ou d’indécence.
Aussi, cette proposition de loi vise-t-elle à inciter encore plus fortement les bailleurs à mettre en conformité leurs logements avec les critères de décence fixés par la loi.
Le droit actuel prévoit la suspension des aides personnelles au logement (APL) pour les logements non décents ; nous proposons la consignation des loyers jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.
Le texte de l’Assemblée nationale avait été cosigné par des députés métropolitains comme ultramarins, notamment par deux vice-présidents du parti Les Républicains.
Parce que tous les territoires de la République sont susceptibles d’avoir besoin de ce dispositif, nous avions conservé l’application nationale de la proposition. La commission nous a dit qu’une telle application ferait courir le risque d’effets de bord.
Pour répondre aux inquiétudes, nous proposons, comme la commission l’envisageait initialement, une expérimentation ciblée sur le territoire de La Réunion. En effet, si le problème du logement non décent ne se pose pas qu’à La Réunion, il s’y pose là-bas avec beaucoup d’acuité. La commission a alors estimé qu’une telle expérimentation ferait courir le risque d’une rupture d’égalité.
Pour nos concitoyens qui subissent le mal-logement, pour tous ceux qui vivent dans les moisissures, dans l’inquiétude d’un dégât des eaux ou d’un accident électrique causé par les infiltrations ou les malfaçons, je ne puis me résoudre à ne rien faire.
Tout comme six députés sur sept de La Réunion, tout comme mes trois collègues sénateurs de ce département, j’observe régulièrement la situation de notre territoire.
Des personnes âgées, d’autres en situation de handicap, des familles nombreuses déjà durement touchées par la précarité financière, énergétique et sociale vivent dans des conditions parfois dignes du tiers-monde, alors que nous sommes au XXIe siècle et dans un pays qui figure parmi les premières puissances mondiales.
Nous ne pouvons pas rester sans solution. Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. Si la route est encore longue avant de résoudre toutes les difficultés qui sont au cœur du problème du logement dans nos territoires, je veux faire ce premier pas avec vous.
Il consiste à empêcher que l’on puisse tirer profit des infractions à la loi. Un bailleur qui met en location un logement non décent ne doit pas toucher de loyers. Il ne s’agit pas d’exempter le locataire du paiement, puisqu’il devra continuer de le verser. Mais le bailleur ne percevra les loyers que lorsqu’il aura mis son bien en conformité avec les critères de décence fixés par la loi.
Afin de permettre un suivi de cette loi, je proposerai qu’une commission mixte soit mise en place sur le territoire réunionnais, composée à parité de membres de la société civile et des institutions publiques nommés par décret ministériel, afin d’évaluer de manière totalement neutre la bonne application de la loi, ses limites et les améliorations qui seraient éventuellement nécessaires.
L’inaction, quels qu’en soient les motifs, reste l’inaction. En votant aujourd’hui cette proposition de loi, nous mettrons les choses en mouvement. Nous permettrons à la navette parlementaire d’enrichir le texte. Nous affirmerons aux bailleurs notre détermination à faire respecter la loi.
Cette mobilisation, à laquelle je vous appelle aujourd’hui, mes chers collègues, représente un pas supplémentaire pour faire de la lutte contre le mal-logement une priorité politique essentielle, afin de répondre aux besoins des citoyens mal logés, en souhaitant que toutes les collectivités puissent à terme porter cet enjeu crucial à la bonne échelle.
Il s’agit simplement de garantir le respect d’un droit fondamental pour permettre à chaque citoyen d’accéder à un logement digne et décent adapté à ses besoins et ses ressources et de s’y maintenir.
Cette proposition de loi est une réponse qui devra incontestablement en appeler d’autres. Une réflexion beaucoup plus large devra ainsi être menée, particulièrement dans les outre-mer, notamment sur les questions de production de logements sociaux et de lutte contre le sans-abrisme.
Je demande à l’État de prendre toutes ses responsabilités et de faire de la lutte contre le mal-logement une grande cause nationale. L’abbé Pierre disait : « La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société est l’indifférence ».
Aussi, mes chers collègues, montrons aux plus vulnérables de nos concitoyens que nous agissons pour les protéger !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question du logement non décent est malheureusement un sujet récurrent dans notre hémicycle.
Les chiffres montrent que nous n’avons pas encore trouvé les clés pour résorber ce fléau : en France, il y aurait au moins 420 000 logements indignes. Outre-mer, la situation est encore pire : il n’y en aurait pas moins de 110 000 dans les départements et régions d’outre-mer, soit 13 % du parc. C’est dix fois plus qu’en métropole ! À La Réunion, le département de Jean-Louis Lagourgue, il y en aurait 18 000.
C’est pourquoi je voudrais doublement remercier Jean-Louis Lagourgue : tout d’abord, pour attirer de nouveau notre attention sur la situation de ces ménages qui sont confrontés à des conditions de vie vraiment dramatiques, ensuite, pour nous permettre de nous focaliser sur la situation particulièrement dégradée du logement en outre-mer.
J’en avais déjà dressé le constat il y a un an et demi, dans le rapport d’information sur la politique du logement en outre-mer que j’ai cosigné avec nos collègues Guillaume Gontard et Victorin Lurel au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer.
C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car, au-delà du seul aspect matériel, la dégradation de l’habitat a des répercussions sur tous les aspects de la vie de ses occupants : ce sont des problèmes respiratoires causés par des moisissures, c’est un jeune qui ne peut pas s’isoler pour faire ses devoirs à cause d’une fuite dans le plafond, etc. Face à ces problèmes, les locataires se sentent souvent démunis.
Pour lutter contre l’habitat dégradé, le dispositif proposé est simple et, je dois le dire, séduisant : prolonger le dispositif actuel de retenue temporaire des allocations de logement, lorsque le logement est déclaré non décent, en consignant le reste à charge du loyer. L’idée est de faire pression sur les propriétaires, pour qu’ils engagent rapidement les travaux de mise en décence nécessaires.
Je vois cependant plusieurs écueils à la mise en œuvre de ce dispositif.
Tout d’abord, la notion de non-décence ne s’applique, en droit, qu’aux logements locatifs. Le problème des propriétaires occupants de logements insalubres ou indignes ne fait donc pas partie du champ de la proposition de loi. Or ils sont nombreux, particulièrement dans nos outre-mer.
Ensuite, le dispositif proposé ne concerne que les locataires qui bénéficient d’allocations de logement. C’est donc une petite partie du logement dégradé qui pourrait, en théorie, être traitée par le dispositif proposé.
Or, pour cette petite part, la procédure actuelle de retenue des allocations de logement est déjà très efficace : selon les services de l’État, plus de 95 % des procédures engagées aboutiraient à une remise en état dans les dix mois prévus.
Surtout, tous les acteurs que j’ai interrogés m’ont fait part de leurs craintes quant à des effets de bord négatifs, à la fois pour les propriétaires et pour les locataires.
En ce qui concerne les propriétaires, je voudrais d’entrée de jeu souligner que les possesseurs de logements non décents ne sont pas tous des marchands de sommeil, loin de là.
Les critères de non-décence ont été considérablement renforcés ces dernières années. C’est bien entendu une très bonne chose, mais le sens juridique du mot « décence » s’est ainsi beaucoup éloigné de son acception courante, ce qui brouille quelque peu les repères. Si un logement indigne est forcément non décent, le contraire n’est pas nécessairement vrai.
Par exemple, la dernière évolution en date des critères de décence concerne les performances énergétiques. Vous le savez, mes chers collègues, depuis le 1er janvier dernier, les logements G+ sont interdits à la location.
D’ici à 2034, c’est l’ensemble des logements classés E, F et G qui seront qualifiés de « non décents ». Cela rend nécessaire la rénovation de dizaines de milliers de logements locatifs, ce qui représente des investissements considérables pour les propriétaires. Serait-il raisonnable de les priver, précisément maintenant, d’un complément de revenu qui pourrait justement financer ces travaux de mise aux normes ?
Dans une perspective plus large, ce ne serait d’ailleurs pas forcément rendre service aux locataires : d’ores et déjà, on constate une surreprésentation des passoires énergétiques dans les mises en vente de logements. Ce sont autant de logements qui sortent du parc locatif, temporairement ou définitivement.
Or la tension du marché locatif peut aussi favoriser, indirectement, le maintien dans des logements non décents, lorsque les prix pratiqués sont trop élevés pour que les locataires osent quitter leur logement ou même tenter de faire valoir leurs droits auprès des bailleurs.
En outre, introduire une procédure active de consignation du reste à charge pourrait, si cette procédure était mal comprise par les locataires, amener une partie d’entre eux à cesser purement et simplement de payer leur loyer. Ils se mettraient ainsi en tort et s’exposeraient à une expulsion.
Aussi, loin de protéger les locataires, le dispositif risquerait de les fragiliser encore davantage.
En réalité, la question de la résorption du logement non décent nécessite de prendre en compte tout l’écosystème du logement. Il faut évidemment mieux informer les locataires sur leurs droits. Il faut les encourager à activer la procédure existante de retenue des allocations, qui, je le répète, est très efficace, et les encourager à aller devant le juge pour obtenir une injonction à réaliser des travaux, voire une diminution du loyer si le logement demeure non décent.
Il faut également mieux accompagner les propriétaires, notamment en faisant connaître les aides à la rénovation – elles sont nombreuses.
Je comprends le sentiment d’urgence qui sous-tend cette proposition de loi, particulièrement dans nos outre-mer. Mais à l’écoute de mes interlocuteurs réunionnais, j’ai surtout compris que le sujet dépassait largement le champ de l’habitat indécent : la plupart des cas évoqués lors des auditions relevaient clairement de l’habitat indigne ou insalubre, voire de situations de péril.
Or, pour ces situations, il existe d’autres procédures, bien plus rapides et plus coercitives, pour contraindre le propriétaire à faire des travaux, voire les réaliser d’office. Que ces procédures ne soient pas mises en œuvre par les autorités administratives, qui en ont le pouvoir en temps utile, c’est un autre problème…
On m’a aussi parlé d’immeubles de moins de dix ans tenus par des étais, de bâtiments soudainement sortis « non décents » d’une opération de réhabilitation…
Ce sont les symptômes de problèmes systémiques du secteur du bâtiment et du logement à La Réunion : nombre trop limité d’entreprises de taille critique ; difficultés d’approvisionnement en matériaux de qualité ; déficit d’encadrement intermédiaire des chantiers et de contrôle qualité ; rigidité du mécanisme de la garantie décennale… Sans parler de l’inadaptation de certaines normes aux territoires ultramarins.
En résumé, pour élaborer des stratégies efficaces de lutte contre l’habitat dégradé, que ce soit en métropole ou outre-mer, c’est l’ensemble de l’écosystème qu’il faut prendre en compte, et pas simplement la relation contractuelle entre les locataires et les bailleurs, qui sont en bout de chaîne et pâtissent de ces situations.
Pour toutes ces raisons, la commission n’est pas favorable à cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Daphné Ract-Madoux applaudit également.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat doit aujourd’hui s’exprimer sur la proposition de loi du sénateur Jean-Louis Lagourgue visant à mieux protéger les locataires bénéficiant d’une allocation de logement et vivant dans un habitat non décent.
Dans son article unique, ce texte vise à augmenter la contrainte qui pèse sur les propriétaires bailleurs en vue de procéder aux travaux de mise en décence des logements loués à des personnes bénéficiant des APL.
Même si le Gouvernement partage pleinement l’objectif de cette proposition de loi, nous constatons que le mécanisme actuel de conservation des aides est suffisant pour mettre fin aux situations de non-décence.
À ce jour, la plupart des situations de conservation des APL cessent avant la fin du délai maximum prévu par le code de la construction et de l’habitation.
En moyenne, on constate une sortie de conservation d’environ 320 dossiers par mois, dont 300, soit en moyenne 93 %, au sens où la situation de non-décence a pris fin et le versement de l’APL a été rétabli, et seulement une vingtaine de situations dans lesquelles l’APL n’a pas été rendue une fois la période de conservation écoulée. Dans ces derniers cas, la conservation peut, dans certaines situations, être prolongée, notamment pour finir les travaux.
Vous le comprenez, mesdames, messieurs les sénateurs, l’efficacité du mécanisme actuel de conservation des aides est, à notre avis, avérée.
J’ajouterai que la mise en place de la conservation ne se limite pas à son caractère coercitif ; elle s’accompagne d’une information du propriétaire par l’organisme payeur.
De façon plus globale, l’engagement de ce gouvernement est total pour lutter contre le phénomène de non-décence des logements.
Nous avons souhaité faire évoluer le mécanisme de conservation des aides, pour qu’il s’adapte aux politiques publiques de lutte contre le logement indécent.
Ainsi, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 et la future montée en charge du critère de non-décence énergétique, à la suite de la réforme du diagnostic de performance énergétique et aux dispositions de la loi Climat et résilience, créent une condition d’ouverture supplémentaire d’une mesure de conservation des aides.
Les critères de non-décence et incidemment les causes d’ouverture d’une mesure de conservation des APL englobent la non-décence énergétique. L’obligation qui pèse sur les bailleurs a ainsi été renforcée.
Pour lutter contre le fléau que constitue l’habitat indigne et dégradé, un important arsenal de procédures et de dispositifs, qui reposent la plupart du temps sur des partenariats locaux et associent notamment les collectivités territoriales, a été développé.
Soyez assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement travaille à l’amélioration constante de ces outils. Je le répète, la lutte contre l’habitat indécent est ma priorité – ceux qui connaissent mon parcours le savent bien –, comme c’est celle du Gouvernement.
Parmi les mesures prises, je citerai les dispositifs de déclaration et d’autorisation de mise en location. Pérennisés par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et reposant sur l’initiative des collectivités, ces deux dispositifs continuent de se déployer. Je tiens d’ailleurs à saluer les maires et élus locaux qui sont engagés dans cette démarche – je sais qu’ils sont nombreux.
Le dispositif d’autorisation préalable de mise en location a par ailleurs fait l’objet de modifications en 2021, via la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021.
Je veux également mettre en avant le travail de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui finance l’amélioration de l’habitat des propriétaires bailleurs. En effet, l’Anah octroie des subventions, sous conditions, aux propriétaires bailleurs pour réaliser des travaux de sortie d’indignité ou de forte dégradation, via les aides « Habiter sain », « Habiter serein » ou « Habiter mieux ».
À la fin de l’année 2018, l’Anah a aussi décidé de consacrer des crédits supplémentaires, dans le cadre d’une expérimentation, à la lutte contre l’habitat indigne dans six territoires dits « d’accélération », particulièrement touchés par ces problématiques.
Reconduit jusqu’en 2023, ce dispositif a d’ores et déjà permis de mobiliser plus de 33 millions d’euros supplémentaires en quatre ans sur ces six départements : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l’Essonne, le Nord, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Il a permis la majoration des taux de subvention pour les propriétaires occupants et bailleurs, ainsi que le financement à 100 % hors taxes des travaux d’office à la charge des communes, notamment à la suite de la prise d’arrêtés de péril.
Ce dispositif, qui va se terminer dans sa forme expérimentale, fait actuellement l’objet d’une évaluation. Les résultats dégagés permettront de déterminer des axes d’action sur le champ du financement par l’Anah de la sortie d’indignité à partir de 2024.
L’Anah a par ailleurs majoré depuis 2021 les crédits consacrés au financement des opérations de résorption de l’habitat indigne : ils sont passés de 15 millions d’euros à 23 millions par an. Tous les territoires engagés dans ce type d’opérations sont éligibles à ces financements.
Nous aurons l’occasion, au cours du débat, d’évoquer plus particulièrement le cas des territoires ultramarins.
Pour en revenir à cette proposition de loi, je le redis et vous l’avez compris, nous partageons l’objectif, mais la mesure proposée soulèverait plusieurs contraintes opérationnelles.
En effet, si les organismes payeurs – Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) ou Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) – ne sont pas directement concernés par cette proposition, ils seraient néanmoins placés au cœur d’un tel dispositif, puisque la responsabilité leur reviendrait de transmettre à la Caisse des dépôts et consignations chaque ouverture de conservation des aides et, en toute logique, chaque levée de conservation.
Il est d’ailleurs à noter que le système d’information de la Cnaf est actuellement surchargé, ce qui laisse envisager une difficulté réelle quant à la possibilité d’automatiser un tel signalement, sans compter la question de la sécurisation du transfert de ces données.
Je veux rappeler d’ailleurs que la création du dispositif de conservation a permis d’impliquer davantage les Caisses d’allocations familiales (CAF) dans la lutte contre le mal-logement en tant que partenaires des autres acteurs intervenant dans ce domaine – je tiens à les en remercier.
Enfin, à la lecture de cette proposition de loi, il est permis de s’interroger sur le potentiel effet dissuasif de la mesure proposée. En effet, la suspension du versement direct des loyers aux propriétaires pourrait inciter ces derniers à retirer leurs biens du marché de la location pour les mettre en vente.
De plus, l’absence de versement du loyer résiduel peut priver certains propriétaires des ressources nécessaires pour financer la réalisation des travaux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la détermination est là, les outils sont mobilisés, et nous continuerons de lutter contre l’habitat indigne et dégradé. C’est un enjeu majeur, pour permettre à chacun, notamment aux plus modestes, de vivre dignement dans leur logement.
Nous devons faire en sorte que l’endroit où nos concitoyens se sentent à l’abri et où ils veulent se reposer après une dure journée de travail ne soit pas un logement qui les rende malades ou dans lequel ils ne supportent pas de vivre.
C’est donc bien parce que le mécanisme actuel de conservation des aides est suffisant pour mettre fin aux situations de non-décence que le Gouvernement s’en remettra sur ce texte à la sagesse du Sénat.

Mes chers collègues, je tiens à vous faire observer que deux textes sont inscrits à l’ordre du jour de cette matinée…
La parole est à Mme Colette Mélot.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le logement n’est pas un sujet comme les autres. En 2023, chaque Français de métropole ou d’outre-mer doit avoir accès à un logement décent et à un toit, parce que les conditions d’hébergement doivent être dignes dans un pays civilisé.
Débattre du logement ce n’est pas seulement s’intéresser à des murs, c’est également faciliter l’accès à l’emploi ou élever ses enfants décemment, c’est tout simplement poser la question de la dignité. Notre groupe y est très attaché ; nous avons soutenu l’adoption de la proposition de loi visant à lutter contre l’occupation illicite des logements.
Nombre de nos concitoyens tentent d’accéder à la propriété. Tous n’en ont cependant pas les moyens. Le logement constitue l’un des plus importants postes de dépenses des Français, qu’ils soient propriétaires ou locataires. Cette situation rend encore plus insupportable l’exploitation du besoin de logement.
L’habitat indigne est un fléau. Notre collègue Jean-Louis Lagourgue nous propose aujourd’hui de renforcer la lutte contre les logements non décents mis en location.
En l’état actuel du droit, cela a été rappelé, les critères de décence des logements sont fixés par la loi. Il s’agit notamment de la surface et du volume minimum du logement, de l’absence de parasites et de nuisibles. Il s’agit aussi de critères destinés à la protection de la santé de l’occupant, comme une aération empêchant le développement de moisissures ou la protection du logement contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.
Notre collègue Jean-Louis Lagourgue propose que le loyer d’un logement non décent soit consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que les travaux de conformité soient réalisés.
Le droit actuel prévoit déjà la suspension du versement des aides personnelles au logement (APL) au propriétaire, lorsque les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) constatent qu’un logement ne satisfait pas aux critères de la décence.
Aussi, de deux choses l’une : ou bien nous sommes d’accord pour dire qu’un logement mis en location doit satisfaire aux critères de décence fixés par la loi, auquel cas les mesures portées par la proposition de notre collègue ne constituent que la poursuite de la logique qui sous-tend le droit actuel ; ou bien nous considérons qu’un logement non décent peut valablement continuer à être une source de profits pour des bailleurs peu scrupuleux.
« Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c’est autoriser la chose qu’on veut défendre », selon le cardinal de Richelieu. Nous pensons donc qu’un logement non décent, c’est-à-dire une mise en location illégale, ne doit pas générer de profit. Le dispositif proposé ne prive que temporairement le propriétaire de ses loyers. Ceux-ci seront en effet consignés jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité, et c’est à ce moment que les sommes lui seront reversées.
Certains craignent qu’un tel dispositif ne fragilise la situation de petits bailleurs – ils ne sont pas tous petits, loin de là –, mais suffirait-il d’être un petit bailleur pour être exonéré du respect de la loi ? Par ailleurs, en tout état de cause, le propriétaire bailleur conserve toujours la capacité de vendre son bien s’il ne peut en assumer la décence.
Les difficultés qui pèsent sur le logement sont nombreuses, diverses et complexes. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui ne prétend pas toutes les résoudre. Elle a cependant le mérite d’être simple, claire et de saisir à bras-le-corps l’une d’entre elles.
Nous pouvons comprendre la réticence de certains de nos collègues à l’idée de l’appliquer définitivement à l’échelle nationale. Issue d’une proposition déposée à l’Assemblée nationale par un député réunionnais et, au Sénat, par notre collègue Jean-Louis Lagourgue et l’ensemble des sénatrices et sénateurs de La Réunion, cette proposition est néanmoins le signe que l’île rencontre en matière de logement un problème majeur, qui appelle une réponse rapide.
Jean-Louis Lagourgue a déposé un amendement pour que cette proposition de loi ne s’applique qu’à titre expérimental et temporaire sur le territoire de La Réunion.
L’expérimentation permettrait à la fois d’agir rapidement et de recueillir des données utiles au perfectionnement du dispositif. À l’inverse, ne rien faire reviendrait à prendre encore du retard dans un domaine où l’urgence est déjà là. La loi fixe déjà les critères de la décence des logements ; à nous de les faire respecter !
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout comme l’habitat insalubre et l’habitat indigne, le chantier de l’habitat non décent est gigantesque.
Comme le soulignait notre rapporteur, sur l’ensemble du territoire français, au moins 420 000 logements seraient indignes, dont 110 000 dans les départements et régions d’outre-mer, qui sont particulièrement confrontés à ces difficultés.
Contrairement aux procédures relatives à l’indignité, à l’insalubrité ou au péril, qui relèvent des autorités administratives, la lutte contre la non-décence relève exclusivement d’une action privée, celle du locataire contre le bailleur.
Toutefois, les problématiques de fond sont similaires : l’accompagnement des propriétaires et le reste à charge des travaux, qui est bien souvent hors de portée du budget des ménages modestes. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’entamer des travaux de rénovation globale, qui peuvent être effectués pour des logements qualifiés de non décents, pour renforcer l’étanchéité contre les infiltrations d’eau ou d’air, ou isoler les murs et les fenêtres, etc.
Après l’aide de MaPrimeRénov’, le reste à payer pour les ménages très modestes s’élève en moyenne à 33 % du montant des travaux – 52 % pour les ménages modestes –, d’après les calculs de France Stratégie en 2021.
Je ne reviendrai pas en détail sur le dispositif actuel, car vous l’avez toutes et tous à l’esprit.
L’article unique de cette proposition de loi tend à consigner le reste à charge du loyer auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le locataire continuerait de payer le loyer, mais celui-ci ne serait plus versé au bailleur. Cette mesure semble, de prime abord, aller dans le bon sens pour répondre à l’objectif indispensable de lutte contre la non-décence des logements.
L’examen en commission a toutefois mis en avant un certain nombre d’écueils et le manque d’opérationnalité du dispositif. La commission a également estimé que le dispositif actuel de consignation du montant des APL fonctionnait dans la majorité des cas pour que les travaux soient engagés. Plus de 95 % des procédures aboutiraient à une remise en état dans les dix-huit mois impartis, selon les services de l’État.
Par ailleurs, le risque de priver les propriétaires modestes a été mis en avant lors de l’examen en commission – nous l’entendons –, à cause de la consignation du reste à charge de ressources nécessaires pour engager les travaux de remise en décence de leur bien.
En effet, nombre de propriétaires rencontrent eux-mêmes des difficultés financières et peinent à financer les travaux, comme le démontrent régulièrement les rapports de la Fondation Abbé Pierre. Encore une fois, l’accompagnement des bailleurs est l’un des sujets essentiels !
Le risque que ce nouveau mécanisme rende l’actuel plus complexe et moins lisible a aussi été souligné. Pour l’instant, après le signalement à la CAF, le locataire n’a aucune démarche supplémentaire à effectuer, puisque la CAF procède d’elle-même à la retenue des allocations de logement.
Le dispositif proposé est plus complexe. Il introduit une procédure active de consignation du reste à charge. Une mauvaise compréhension du dispositif pourrait conduire une partie des locataires vers des situations d’impayés de loyer, qui pourraient in fine déboucher sur leur expulsion.
Par ailleurs, le texte n’aborde pas la question épineuse du sort des reliquats des loyers qui resteraient consignés une fois la période de blocage des aides révolue. Qu’adviendrait-il de ces sommes ?
Une fois le délai épuisé, les aides de la CAF sont perdues, cela risquerait donc de faire peser le loyer sur le seul locataire.
Les cas seront certes limités, mais le locataire aura donc tout intérêt à avoir saisi un juge pour obliger son bailleur à réaliser les travaux nécessaires ou à faire réduire son loyer. Cela soulève la question de l’opportunité de saisir le juge. Le plus efficace serait donc de prévoir une procédure simplifiée pour obtenir plus rapidement une décision de justice.
Se pose également la question de la possibilité de remise en location du logement si les travaux ne sont toujours pas effectués, mais le texte n’y répond pas non plus.
Compte tenu de ces éléments, la question de l’opérationnalité du dispositif est posée et sa plus-value n’est pas évidente, dans la mesure où il ne tend pas à améliorer le sort du locataire de manière significative. Il est peut-être même contre-productif, car le risque que le dispositif fragilise les propriétaires modestes et les locataires semble réel, à La Réunion comme en métropole.
La bataille contre l’habitat non décent ne pourra être gagnée qu’une fois la crise du logement enrayée, c’est-à-dire à la suite de la mise en œuvre de mesures réellement structurelles.
Je pense à la production massive de logements sociaux, à l’encadrement des loyers en secteurs tendus, à l’augmentation des APL, à la garantie universelle des loyers, à l’intensification de la prévention des expulsions locatives, au renforcement des moyens pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et, bien sûr, à un réel accompagnement humain et financier des propriétaires pour la rénovation de leur logement.
Il convient également de communiquer plus efficacement auprès des publics concernés sur les différents dispositifs existants qui s’offrent à eux pour la réhabilitation de leur logement.
La procédure actuelle n’est engagée que dans trop peu de situations – quelques centaines de cas avérés par an à La Réunion –, alors qu’il existe plusieurs dizaines de milliers de logements indécents. Même si le taux de réussite s’élève à 95 % dans ce domaine, le dispositif ne concerne que trop peu de personnes.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que notre assemblée examine ce matin vise à augmenter la contrainte qui pèse sur les bailleurs, afin de les inciter à procéder aux travaux de mise en décence et de rénovation des logements loués à des allocataires d’aides personnelles au logement.
Si le sujet des logements non décents et insalubres ou indignes n’est pas nouveau, force est de constater que celui-ci persiste en métropole comme dans les outre-mer.
Aujourd’hui, le constat est sans appel : il y aurait 420 000 logements indignes au sein du territoire national, dont 110 000 dans les outre-mer, selon les chiffres cités par un récent rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer.
La Réunion est particulièrement affectée par ces dégradations de logement, ce qui explique, sans aucun doute, le dépôt de cette proposition de loi par notre collègue, M. Jean-Louis Lagourgue, sénateur de La Réunion, qui reprend ainsi le texte déposé voilà un an, en février 2022, par l’ancien député de ce même territoire, M. David Lorion.
Introduite par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU, la notion de non-décence ne concerne, en droit, que le logement locatif. L’objectif du législateur était clairement de préciser l’obligation faite aux bailleurs de délivrer un logement en bon état et qui réponde à des normes minimales en matière de confort.
Par conséquent, pour être qualifié de décent, un logement doit notamment présenter une surface minimale, une absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire, une absence d’animaux nuisibles et de parasites, ainsi que la mise à disposition de certains équipements nécessaires à le rendre habitable – le chauffage, l’électricité ou le système d’évacuation des eaux usées.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2023, en application de la loi Énergie et climat, les logements locatifs doivent également répondre à des critères de performance énergétique pour pouvoir être qualifiés de « décents ». Ces critères seront progressivement durcis jusqu’en 2034, date à laquelle l’ensemble des logements classés E, F ou G ne pourront plus être loués.
Les transitions écologiques et énergétiques nous imposent de légiférer. Nous avons commencé le travail et nous le poursuivrons ! Autrement dit, mes chers collègues, notre groupe partage bien évidemment l’objet affiché par ce texte, qui vise à protéger davantage les locataires face au fléau que représentent les logements non décents.
Cela étant, je constate à mon tour que le dispositif proposé dans le texte est inadapté et qu’il risque de complexifier et d’aggraver la situation des locataires.
Le mécanisme proposé dans l’article unique est inadapté et inopérant.
Il est inadapté, car faire en sorte que le loyer soit désormais non plus versé au bailleur, mais consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations soulève des interrogations sur le plan opérationnel, en particulier pour les organismes payeurs que sont la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).
Si ces organismes ne sont pas directement concernés, ils seraient néanmoins placés au cœur du mécanisme, puisqu’il leur reviendrait de transmettre à la Caisse des dépôts et consignations chaque ouverture de conservation des aides et, en toute logique, chaque levée de la conservation.
Compte tenu de la surcharge d’activités actuelle du système d’information de la Cnaf, nous pouvons craindre une réelle difficulté quant à la possibilité d’automatiser un tel signalement, sans compter la question de la sécurisation du transfert de ces données et celle du coût que cela représenterait.
Le dispositif est donc inadapté, mais il est également inopérant, car on peut s’interroger sur le potentiel effet dissuasif de la mesure proposée. Je rappelle que la procédure actuelle de retenue des allocations de logement démontre une certaine efficacité, puisque, selon les services de l’État, plus de 95 % des dossiers aboutissent à une remise en état dans les délais impartis.
Contrairement à la situation en métropole, la procédure existante concerne également les bailleurs sociaux dans les outre-mer. Or ces derniers semblent affirmer que la privation du reste à charge du loyer n’influerait en rien sur leur diligence à traiter les cas de non-décence.
De plus, l’absence de versement du loyer résiduel pourrait priver des propriétaires, au moins les plus modestes, des ressources nécessaires pour financer la réalisation de travaux. Ce sont autant de raisons qui démontrent que le dispositif du texte est inadapté et inopérant.
Par ailleurs, le mécanisme risque d’entraîner des conséquences non négligeables sur les locataires. Pour l’instant, après un signalement à la Cnaf, les locataires n’ont aucune démarche à effectuer pour que les allocations de logement cessent d’être versées aux bailleurs. Introduire une procédure active de consignation du reste à charge pourrait amener une partie des locataires à cesser de payer leur loyer, ce qui les exposerait à une expulsion, tout à fait légale, à la demande du propriétaire.
Pis encore, la suspension du versement direct des loyers aux propriétaires pourrait inciter ces derniers à retirer leurs biens du marché de la location pour les mettre en vente.
Mes chers collègues, si l’intention de l’auteur de ce texte est louable, le dispositif me semble inadapté à l’objectif qui fait sans doute consensus au sein de cette assemblée, à savoir un meilleur accompagnement des bailleurs, dans l’intérêt des locataires et de nouvelles solutions face à la dégradation des logements, qui dépasse largement le seul champ du logement non décent.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI s’abstiendra sur ce texte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, selon les sources, le nombre d’habitats indignes en France est estimé à 450 000 logements ou à 600 000, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui ne saurait être accusée d’excès, compte tenu des situations dramatiques qu’elle étudie et suit de près.
Selon ce même rapport, rien ne permet d’indiquer une quelconque évolution positive en 2022, et aucune dynamique n’a été lancée pour les années à venir.
Dans les territoires d’outre-mer, la situation est particulièrement critique. Selon le rapport d’information sénatorial sur la politique du logement en outre-mer, près de 13 % du parc sont jugés indignes.
L’estimation du nombre de logements jugés non décents pâtit d’une définition imprécise du terme.
Faute de chiffres précis, nous pouvons nous référer à plusieurs critères. Selon l’Insee, l’Institut national de la statistique et des études économiques, quelque 2, 3 millions de personnes vivent dans des logements possédant des défauts graves. Il y manquerait au moins un élément élémentaire, tel que l’eau chaude ou le chauffage, et il y aurait des défauts structurels essentiels, liés à une plomberie défectueuse causant des fuites, ou encore à une mauvaise étanchéité.
Un chiffre semble fiable : 600 000 enfants vivraient dans ces conditions aujourd’hui dans notre pays.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à mieux protéger les locataires bénéficiant d’une allocation logement et vivant dans des habitats considérés comme non décents.
Depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite Alur, si le logement est reconnu comme tel, alors la CAF retient le montant de l’allocation logement et le locataire ne verse que le loyer résiduel et les charges locatives au bailleur durant dix-huit mois. Ce délai doit permettre au bailleur d’effectuer les travaux nécessaires pour rendre le logement apte à la location.
Si nous adoptions cette proposition de loi, le locataire d’un logement indécent verserait le loyer résiduel non plus au bailleur, mais à la Caisse des dépôts et consignations. De ce fait, le bailleur ne percevrait plus aucune somme tant que le logement ne répondrait pas aux normes de décence.
Si nous comprenons bien l’intention qui se trouve derrière cette proposition, nous ne pouvons manquer de formuler plusieurs réserves.
En premier lieu, il existe déjà des procédures permettant d’inciter le bailleur à effectuer des travaux de réhabilitation d’un logement non décent.
Comme l’a rappelé en commission Mme le rapporteur, contrairement aux procédures relatives à l’indignité, à l’insalubrité ou au péril, qui relèvent des autorités administratives, la lutte contre la non-décence relève exclusivement d’une action privée, celle du locataire contre le bailleur. Si ce dernier refuse d’exécuter les travaux de remise en état d’un logement en situation de non-décence, le locataire peut en effet saisir le juge.
Le juge peut notamment ordonner l’exécution des travaux, assortie d’une éventuelle réduction du montant du loyer pour toute la durée pendant laquelle le logement demeure non décent.
Cette procédure a concerné 2 647 situations en 2017 et 4 079 en 2019. Le chiffre est en augmentation, ce qui signifie bien que les locataires, mieux informés sur leurs droits, n’ont pas hésité à les faire valoir auprès des autorités compétentes. La grande majorité des travaux ont été effectués dans les dix-huit mois par les propriétaires.
En second lieu, le dispositif proposé par nos collègues du groupe Les Indépendants – République et Territoires pourrait entraîner des conséquences négatives, sans répondre pour autant de manière efficace à la lutte contre les logements dégradés.
En effet, la mesure précitée a peut-être pour objet de sanctionner plus efficacement les propriétaires indélicats qui louent délibérément des logements indécents, mais elle tendrait à priver les bailleurs de bonne foi de ressources utiles pour financer les travaux nécessaires. Cela reviendrait in fine à pénaliser des locataires déjà en situation de précarité.
Ce point me permet d’aborder le sujet de l’accompagnement des propriétaires bailleurs ou occupants : ils n’en disposent pas toujours pour réaliser des travaux d’amélioration de leur logement, notamment pour en améliorer la performance énergétique, afin de lutter contre la précarité.
Depuis la loi Climat et résilience, les logements doivent présenter une performance énergétique minimum. Cela se traduit par l’interdiction de louer les logements les plus énergivores à compter du 1er janvier 2023 et par l’interdiction progressive de louer les logements de catégorie G à partir du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2028 pour ceux de catégorie F.
Outre l’inconfort et le poids financier des factures d’énergie, un logement humide ou mal chauffé risque d’amplifier les pathologies de certaines personnes âgées ou plus fragiles.
Or force est de constater que la politique menée ces dernières années ne produit pas les effets escomptés, car les aides sont mal ciblées.
Rémi Cardon et moi avons déposé une proposition de loi pour recentrer l’effort budgétaire du pays sur l’éradication des passoires thermiques et engager une stratégie de rénovation plus inclusive.
Nous constatons en effet aujourd’hui que la précarité énergétique s’accroît et que le nombre de passoires thermiques ne baisse pas, malgré le vote de la loi Climat et résilience.
Les raisons sont simples. Trop peu de personnes s’engagent dans un parcours de rénovation. Près de la moitié des ménages résidant en passoire thermique ont des revenus modestes, voire très modestes. Quelque 37 % de ces logements sont occupés par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Toujours selon la Fondation Abbé Pierre, le reste à charge des plus modestes serait actuellement de l’ordre de 39 % pour une rénovation globale, ce qui est bien trop important pour les familles les plus précaires, y compris dans le cadre du prêt avance rénovation mis en place par le Gouvernement, dont les résultats ne sont pas aussi bons qu’escomptés. Il y a pourtant urgence !
La hausse générale des prix de l’énergie a des conséquences importantes sur les ménages, tout particulièrement sur les plus vulnérables, qui sont les premiers à en subir les effets.
Il y a urgence, également, car les logements les plus énergivores vont disparaître du marché de la location, faute de rénovation. Cette interdiction est entrée en vigueur au 1er janvier 2023 pour les logements de classe G, c’est-à-dire pour ceux qui ont une consommation supérieure à 450 kilowattheures.
Il y a urgence, enfin, à prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins, à promouvoir les techniques les mieux adaptées et à faciliter le recours à des matériaux de construction et de rénovation produits et utilisés localement.
Ainsi, plutôt que de confisquer, pour ainsi dire, les revenus locatifs des propriétaires, nous pensons qu’il est préférable de mieux les accompagner. Il est nécessaire que les citoyens perçoivent enfin les signes concrets et positifs de la transition énergétique. Celle-ci est encore trop souvent perçue comme inefficace et inégalitaire.
Notre politique climatique et énergétique doit comporter une stratégie de rénovation des logements et de lutte contre la précarité énergétique plus performante et plus inclusive. Notre priorité devrait être de sortir les 5, 6 millions de ménages de la précarité, qu’ils soient propriétaires ou copropriétaires, bailleurs ou occupants.
Les auteurs de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui mettent en lumière un réel problème et partent d’une bonne intention ; nous ne pouvons que partager leurs constats.
Cependant, les solutions qui sont proposées nous semblent inadaptées pour répondre à de tels enjeux. Par conséquent, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a choisi de s’abstenir sur ce texte.

Mes chers collègues, en février dernier, vous étiez nombreux dans cet hémicycle à ne pas avoir de mots assez durs pour condamner les locataires dans l’incapacité de payer leurs loyers. Ce sont d’ailleurs les mêmes à qui vous avez décidé d’ajouter deux ans de travail…
Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour aborder l’autre partie du contrat, si l’on peut dire. Les locataires ne sont pas les seuls à avoir des devoirs ; il y a aussi, et même d’abord, les propriétaires.
La proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui est audacieuse. Elle a le mérite de poser clairement le problème du mal-logement et d’y apporter des éléments de réponse.
En vous attaquant aux logements non décents, vous soulevez aussi, et peut-être même surtout, la question des passoires thermiques.
Plusieurs catégories de logements seront progressivement interdites à la location ; tant mieux pour les locataires et pour la lutte contre le gaspillage d’énergie ! Cela concerne d’abord les logements G+, dès cette année, puis G, à partir de 2025, F en 2028, et ainsi de suite.
Nous sommes tout à fait convaincus qu’il faut développer des mesures fortes contre ces passoires thermiques. Les situations sont très inégales sur le territoire, mais elles sont trop nombreuses. Il sera nécessaire d’agir en profondeur pour mieux isoler les logements et mieux protéger les locataires. Quelque 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique. Cet enjeu doit être prioritaire.
Tous les outils pour mesurer les performances énergétiques des logements ne sont pas toujours concordants. Il est nécessaire d’affiner quelque peu ces instruments, pour qu’aucun logement ne sorte des radars ou ne soit intégré à la mauvaise catégorie.
Il y a un besoin réel et urgent de vérifier la fiabilité de la classification et de déterminer des outils et un référentiel qui soient identiques, quelles que soient la localisation du logement et la nature du propriétaire.
Cependant, il faut distinguer le propriétaire de bonne foi, qui possède un logement mis en location et qui n’a pas les moyens de réaliser les travaux, du multipropriétaire qui empoche de nombreux loyers sans jamais mettre un euro dans l’entretien ou l’isolation du logement.
Il faut aussi faire la part des choses avec les bailleurs sociaux, dont les finances ont été durement ponctionnées, notamment avec la réduction de loyer de solidarité (RLS).
Pour les propriétaires de bonne foi, comme pour les bailleurs sociaux, la réponse selon laquelle il faudrait bloquer leurs ressources pour qu’ils fassent les travaux est un peu contradictoire. C’est à peu près le même niveau de réflexion que de dire que l’on bloque les APL pour les locataires qui n’arrivent plus à payer leur loyer !
Ce n’est pas toujours la volonté qui manque – voilà ce que je veux vous dire aujourd’hui. Ce sont parfois d’abord les moyens qui sont insuffisants.
Je vous le dis, oui, il y a besoin d’un grand chantier de rénovation thermique des logements, pour limiter la consommation et les dépenses d’énergie, ainsi que pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce sera bon pour les finances de nos concitoyens comme pour notre planète. Il faudra donc, avant tout, proposer des moyens aux bailleurs, publics comme privés, pour que chacun vive dignement dans un logement décent.
Telle est notre préoccupation première : que chacun puisse vivre dans un logement digne.
Le groupe CRCE a déposé une proposition de loi visant à garantir l’accès au logement pour tous et la préservation du pouvoir d’achat des ménages. Elle est assez fournie et avance plusieurs idées sur le sujet.
Par exemple, l’article 16 tend à rendre possible la préemption des passoires thermiques. Au travers de notre article 28, nous souhaitons rendre obligatoire les permis de louer. L’article 35, quant à lui, vise à donner au juge la responsabilité de suspendre le bail et de décider du montant de loyer versé, le temps que le propriétaire fasse les travaux de mise aux normes, avec une prise différée du bail pour empêcher la mise à la rue du locataire qui aurait fait valoir ses droits.
Nous nous exprimerons aussi au sujet des logements décents, plus particulièrement des passoires thermiques, dans le cadre de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.
Pour l’heure, votre proposition de loi demeure incomplète, peut-être même contre-productive, et surtout cantonnée à une partie du territoire français, ce qui est à notre avis regrettable.
C’est pourquoi, en l’état, notre groupe s’abstiendra.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’heure où la vie n’a jamais été aussi chère et où la précarité ne cesse d’augmenter, le logement demeure la première dépense contrainte de nos concitoyens, à hauteur de 30 % à 40 % de leur budget. Nous devons plus que jamais nous saisir du sujet et le mettre à l’ordre du jour pour agir concrètement afin d’améliorer le quotidien des Français.
Toutes les initiatives allant dans ce sens sont à saluer. Je tiens donc à remercier notre collègue Jean-Louis Lagourgue et les autres signataires de cette proposition de loi, qui ont ainsi permis de relancer le débat sur la situation du logement dans notre pays, un sujet qui préoccupe tant de nos concitoyens.
Je salue également les apports précieux de la rapporteure Micheline Jacques et de la commission des affaires économiques ; ils rappellent tout l’intérêt et toute la vitalité du travail parlementaire.
Toutefois, avec mes collègues de l’Union Centriste, nous considérons que ce texte n’est pas abouti, à ce jour, et partageons la position de la rapporteure.
Nous souscrivons évidemment à la volonté de protéger plus efficacement les locataires confrontés à des bailleurs malveillants, mais nous tenons également à ce que les propriétaires les plus modestes, qui sont, de surcroît, le plus souvent de bonne foi, ne soient pas pénalisés par un dispositif qui risquerait, en l’état, d’être trop rigide.
Priver un petit bailleur du loyer qu’il perçoit pourrait en effet lui faire perdre une part importante de ses revenus, qui n’excèdent parfois pas ceux de ses locataires. Cela pourrait aussi, tout simplement, l’empêcher de procéder aux travaux nécessaires à la rénovation du logement, ce qui irait à l’encontre de l’objectif des auteurs de la proposition de loi.
De plus, la procédure de constat en non-décence, bien que trop peu usitée, a fait preuve de son efficacité et nous manquons de données pour évaluer d’éventuels dysfonctionnements.
Enfin, le déficit que connaît notre pays en matière d’offre de logements nous astreint à faire preuve de pragmatisme et de nuance. Certains propriétaires ne seront jamais prêts à louer s’ils craignent que la mise en location de leur bien représente, in fine, une charge plutôt qu’une source de revenus. Or nous avons plus que jamais besoin de nouveaux bailleurs.
C’est en ayant ces éléments à l’esprit que, avec une grande majorité du groupe Union Centriste, nous suivrons la rapporteure et la commission en votant contre l’adoption de ce texte.
Je veux profiter du reste du temps qui m’est imparti pour mettre l’accent sur les urgentes priorités qui doivent être les nôtres en matière de logement.
Les chiffres du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre nous rappellent la réalité brutale du mal-logement dans notre pays.
Aujourd’hui en France, on compte 330 000 sans-abri et 4, 1 millions de personnes mal logées ; plus de 12 millions de personnes se trouvent en situation de fragilité en matière de logement.
Or les personnes qui paient le plus lourd tribut au mal-logement, ce sont, comme souvent, les femmes. Il est plus difficile pour une femme, et plus encore pour une mère célibataire, de sortir du mal-logement ; celui-ci renforce la précarité des femmes et les expose, plus que les hommes, au risque de violences sexuelles. Le logement reste malheureusement le creuset des inégalités dans notre pays.
Face à cette situation, il serait faux de dire que le Gouvernement est demeuré passif : 440 000 personnes sont sorties de l’hébergement d’urgence ou du sans-abrisme grâce au plan Logement d’abord au cours du dernier quinquennat ; 250 000 logements sociaux ont été construits entre 2021 et 2022 ; enfin, 6, 7 milliards d’euros ont été consacrés par le plan France Relance à la rénovation des logements privés et sociaux, des bâtiments publics et des locaux des PME-TPE.
Toutefois, pour atteindre les objectifs ambitieux auxquels nous astreint la situation du logement dans notre pays, ces efforts doivent être poursuivis et complétés. L’offre de logements demeure en effet très insuffisante au regard des besoins croissants de la population, en particulier dans les territoires qui connaissent les tensions les plus fortes.
Cela s’explique, tout d’abord, par la raréfaction du foncier. Nous manquons de terrains constructibles et nous devrons veiller à ce que l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols en 2050, le fameux ZAN, ne fasse pas peser de contraintes trop lourdes sur la construction de logements neufs.
Je salue à ce titre l’excellent travail réalisé par la commission spéciale présidée par Valérie Létard autour de la proposition de loi dont nous débattons cette semaine. Ce sont des signes forts envoyés aux acteurs de nos territoires.
En outre, la construction et l’amélioration des logements sont compliquées par le foisonnement des normes qui les encadrent. Entre 2002 et 2022, le code de l’urbanisme est passé de 1 584 à 3 542 pages. La prolifération des normes augmente le coût de la construction et peut en limiter le volume ; parfois, ces normes sont tout simplement absurdes.
Je me réjouis à ce propos que la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, présidée par notre collègue Françoise Gatel, organise ce matin même les États généraux de la simplification.
La crise de l’offre est enfin celle de la location. Il importe à ce titre que les bailleurs soient accompagnés dans la rénovation de leurs logements, afin que les obligations de performance énergétique auxquels ils sont soumis ne représentent pas une charge trop lourde et désincitative.
Au Sénat, la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, proposée par notre collègue Guillaume Gontard et présidée par Dominique Estrosi Sassone, commission d’enquête dont je suis membre, mène à cette fin, depuis plusieurs semaines, de nombreuses auditions.
Nous tentons notamment d’évaluer le service MaPrimeRénov’ et, plus largement, les freins et les dysfonctionnements qui entravent les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique, empêchant à ce jour de massifier ces rénovations et de répondre à cette priorité nationale. C’est l’une des missions du Parlement que d’évaluer et de contrôler les politiques publiques.
Mes chers collègues, gardons toujours à l’esprit ces mots de l’abbé Pierre : « Gouverner, c’est d’abord loger son peuple. »
Le logement est un sujet complexe, qui fait intervenir de très nombreux acteurs et soulève des problématiques variées, qu’elles soient de nature économique, sociale, ou environnementale.
Je souhaite que l’initiative de Jean-Louis Lagourgue, à défaut de constituer à ce stade une réponse viable à la problématique du mal-logement, marque le début d’un vrai débat de fond sur ces questions chères aux Français.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le bailleur doit mettre à disposition du locataire un « logement décent », notion introduite dans notre droit par la loi SRU.
C’est ainsi qu’on garantit que chacun pourra satisfaire l’un des besoins les plus essentiels et qu’on lui apporte sécurité physique et préservation de la santé. La lutte contre le mal-logement doit donc constituer une priorité nationale, quel que soit le territoire concerné.
Quelle réponse apporte-t-on aux territoires ultramarins ? Il est inacceptable que 13 % du parc de logements y relève de l’habitat indigne, soit dix fois plus qu’en métropole. À La Réunion, territoire cité dans l’exposé des motifs de ce texte, 18 000 logements seraient concernés ; la tendance est à la hausse. Les chiffres concernant la non-décence sont plus complexes à obtenir.
La présente proposition de loi procède à une légère modification de la loi en vigueur, de manière à inciter le propriétaire d’un logement non décent pour lequel des allocations de logement sont versées à réaliser les travaux de mise en conformité au plus vite. Elle dispose que le locataire consigne le montant du loyer qui lui incombe – déduction faite des allocations – auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), plutôt que de le verser au bailleur.
Il apparaît que la mise en place de la suspension du versement des allocations de logement au propriétaire pendant ce délai, limité à dix-huit mois, mais prolongeable de six mois, a porté ses fruits. Le droit en vigueur serait donc suffisamment dissuasif pour provoquer la remise en état du bien. En effet, le taux de libération des allocations serait de 95 %, soit une très forte effectivité.
La rapporteure a par ailleurs exprimé ses craintes quant au caractère contre-productif du dispositif proposé, qui retirerait aux propriétaires modestes les moyens financiers nécessaires à la réalisation des travaux. Or, rappelons-le, ces derniers peuvent donner lieu à des aides à la rénovation.
Encore faut-il que le locataire signale à la caisse d’allocations familiales l’état de non-décence de son logement. C’est tout le problème lorsque la demande est loin de satisfaire l’offre. Le locataire est prêt à tout accepter pour dormir sous un toit.
Que le dispositif ne soit pas adapté, soit ! Mais l’argument selon lequel il enverrait au locataire le signal de ne pas payer le loyer ne nous a pas convaincus. Si l’on exclut une minorité de mauvais payeurs, la principale préoccupation des locataires et notamment des plus modestes d’entre eux est de parvenir à régler le loyer, par peur de l’expulsion.
D’ailleurs, il aurait été intéressant de disposer de chiffres plus précis quant aux délais de réalisation des travaux. Est-ce qu’ils sont majoritairement réalisés dans un délai de 6, 12, 18 ou 24 mois ? S’ils sont achevés à la fin du délai réglementaire seulement, le dispositif proposé dans ce texte pourrait s’avérer utile pour accélérer la mise en décence du bien.
Bien que les deux tiers des logements non décents soient traités au bout d’un an dans le cadre de cette procédure, son expérimentation à La Réunion, proposée au travers de l’amendement déposé par M. Lagourgue, pourrait nous éclairer sur ce point.
Certes, les difficultés structurelles de l’accès à un logement décent en outre-mer méritent une réponse plus complète, notamment sur l’île de La Réunion. Nous sommes tous d’accord pour affirmer que, face à une telle hémorragie, il convient d’en traiter les causes plutôt que de proposer des pansements.
L’excellent rapport sur ce sujet de la délégation sénatoriale aux outre-mer, dont notre collègue Micheline Jacques était l’un des auteurs, pointe un certain nombre de défaillances.
Si le contrôle de la qualité des nouvelles constructions demeure déficient, on alimente la machine à produire de l’habitat indigne. Il est ahurissant de constater que la moitié des habitants de La Réunion affrontent des problèmes d’humidité dans leur domicile. La multiplication des malfaçons, notamment sur des constructions de moins de dix ans, alors même que les règles se renforcent, doit être rapidement réglée par les pouvoirs publics.
Nous faisons donc face à un défi à la fois quantitatif et qualitatif. Où en est-on des plans logement outre-mer ? Après l’échec du premier, le bilan en attente du deuxième et l’abandon du troisième, quelles solutions sont envisagées ?
J’espère, monsieur le ministre, que, après le débat qui s’est tenu en janvier dernier au sein de cet hémicycle, vous pourrez nous donner plus de précisions sur les réponses qui seront apportées à la crise du logement en outre-mer, en particulier à La Réunion, mais aussi, en général, sur l’ensemble du territoire.
Au vu des arguments que j’ai développés, le groupe du RDSE se partagera entre vote favorable et abstention sur la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie notre collègue Jean-Louis Lagourgue et le groupe Les Indépendants de donner, ce matin, l’occasion à notre assemblée de faire un point sur la lutte contre le logement indécent dans notre pays et, plus particulièrement, outre-mer.
C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je me suis beaucoup investie, avec la commission des affaires économiques et sa présidente Sophie Primas, notamment après le drame de la rue d’Aubagne, survenu le 5 novembre 2018, très présent encore dans nos mémoires.
Le logement est un bien de première nécessité, avons-nous coutume de répéter. C’est aussi un droit et un élément central de notre pacte républicain. C’est l’abri de la famille, la protection de la vie privée, une possibilité d’épanouissement personnel et, normalement, une garantie d’égalité, car grandir dans un logement délabré diminue les chances de réussite et même l’espérance de vie.
Mais ce droit est également un combat. Il nous mobilise, quel que soit notre groupe politique. Ce combat se fonde sur des principes simples – l’égalité, la justice et l’humanité –, mais il se décline dans des réalités compliquées. Malheureusement, il n’y a pas de martingale, pas de cause ou de responsable uniques, pas de baguette magique pour une solution immédiate.
Cette tension, nous la ressentons aujourd’hui en examinant la proposition de loi qui nous est soumise. La rapporteure de la commission, Micheline Jacques, dont je tiens à saluer le travail de fond, a osé affronter la complexité de la lutte contre l’habitat indécent et ne s’est pas contentée de solutions séduisantes, mais mal adaptées.
En effet, personne, bien évidemment, ne peut s’opposer à la recherche d’une meilleure protection des locataires bénéficiant d’une allocation logement et vivant dans un habitat non décent, comme l’indique le titre de la proposition de loi.
S’appuyant sur le rapport d’information de juillet 2021 de notre délégation aux outre-mer, dont Micheline Jacques était déjà l’un des auteurs, Jean-Louis Lagourgue souligne qu’environ 13 % des logements seraient considérés comme indignes dans les départements et régions ultramarins, soit 110 000 sur 900 000. C’est certainement un problème central et urgent.
Pour y porter remède, l’auteur de la proposition de loi propose, au-delà du mécanisme de retenue des aides personnelles au logement, que les locataires ne versent plus de loyer à leurs propriétaires, et que le montant de celui-ci soit consigné auprès de la CDC.
À première vue, on peut être séduit par la solution qui désigne un coupable et un seul : le bailleur ! C’est malheureusement trop simple. Le rapport de la commission a démonté cette fausse évidence.
On doit relever tout d’abord que le droit actuel, qui prévoit la retenue des APL lorsque le locataire fait valoir une situation d’indécence, est efficace dans 95 % des cas. Il permet donc, d’ores et déjà, d’apporter les solutions attendues.
Aller plus loin en retirant toute ressource aux propriétaires bailleurs aurait donc une dimension plus punitive qu’incitative, approche qui n’est pas justifiée par les faits. À La Réunion, la Fondation Abbé Pierre a estimé que la majorité des logements problématiques appartenaient à des propriétaires modestes dont les conditions de vie sont similaires à celles de leurs locataires. On le sait, à l’échelle nationale, un tiers des propriétaires ne sont pas imposables et deux tiers n’ont qu’un seul bien à louer, souvent pour compléter une retraite.
Par ailleurs, à La Réunion, de nombreux logements indécents sont des logements sociaux ; leur caractère indécent est notamment dû à des problèmes d’infiltrations. On se rend alors compte qu’il s’agit moins d’un conflit de classes entre propriétaires et locataires que d’un problème plus structurel de qualité du bâti, y compris pour les constructions récentes.
Utiliser l’outil de l’indécence des logements, c’est aussi faire reposer le poids de la résorption de l’habitat indigne sur les seuls locataires, dont on sait que beaucoup hésiteront à lancer une procédure face au risque de ne pas disposer d’un autre logement et de perdre le bénéfice des APL après les dix-huit mois de suspension s’ils demeurent dans le logement.
Par ailleurs, centrer la lutte contre l’habitat indigne sur les seuls locataires, c’est laisser de côté un pan important du sujet : les nombreux propriétaires qui vivent dans des logements de ce type et la question des copropriétés dégradées. Je sais que ce problème particulièrement difficile et long à traiter vous tient particulièrement à cœur, monsieur le ministre.
En outre-mer, l’habitat informel, ou spontané, est un sujet souvent important, mais il ne résulte pas de difficultés dans les relations entre propriétaires et locataires.
Enfin, les problèmes de logement indigne outre-mer, et plus particulièrement à La Réunion, ont un caractère structurel qui dépasse largement les défaillances d’entretien des logements.
Le rapport de la commission, sur la base des témoignages des services de l’État, mais aussi des associations de locataires et des bailleurs sociaux, pointe des malfaçons récurrentes, une formation et une qualification insuffisantes des professionnels et des matériaux inappropriés. Ainsi, beaucoup d’immeubles récents, encore sous garantie décennale, seraient aujourd’hui problématiques. Certains de ces défauts pourraient s’expliquer par un usage mal contrôlé des possibilités d’investissement défiscalisé.
Aussi, plutôt que de mettre en cause les seuls propriétaires bailleurs, le problème de l’habitat indigne outre-mer ne pourra trouver de solutions qu’à la suite d’une analyse multifactorielle de ses différentes causes, d’autant que ces départements font face à des risques sismiques et climatologiques spécifiques.
À cet égard, je regrette que l’auteur de la proposition de loi n’ait pas accepté la proposition d’un renvoi en commission, qui aurait permis de procéder à cette analyse conjointement avec la délégation aux outre-mer.
C’est pourtant la solution que nous avions trouvée sur la proposition de loi déposée par notre collègue Bruno Gilles à la suite du drame de la rue d’Aubagne. Nous avions pu mener un travail en profondeur et faire adopter la proposition de loi modifiée quelques mois plus tard.
Une expérimentation du dispositif évoqué dans la seule île de La Réunion ne paraît pas plus pertinente que la rédaction initiale s’appliquant à l’ensemble du territoire national, compte tenu des arguments que j’ai évoqués.
C’est pourquoi le groupe Les Républicains suivra et appuiera les recommandations de la rapporteure et de la commission des affaires économiques, en rejetant, à regret, le présent texte et l’amendement présenté par son auteur.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique de la proposition de loi initiale.
Au dernier alinéa de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « s’acquitte du » sont remplacés par les mots : « consigne à la Caisse des dépôts et consignations le ».

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Lagourgue, Capus, Chasseing, Decool et Dennemont, Mme Dindar, MM. Grand, Guerriau et Longeot, Mme Malet, MM. Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, M. Menonville, Mme Paoli-Gagin et MM. Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, à La Réunion et jusqu’au 31 décembre 2026, durant ce délai, le locataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations le montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. »
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

J’ai entendu les réserves exprimées par Mme le rapporteur quant à l’application du dispositif proposé sur l’ensemble du territoire national.
J’ai aussi entendu que le problème du logement à La Réunion dépasse le sujet de l’habitat non décent, bien que celui-ci en représente une large part.
J’estime que la proposition que je formule au travers du présent amendement répond à ces inquiétudes. Il y est en effet prévu une application limitée, tant dans l’espace – le seul territoire de La Réunion – que dans le temps, du dispositif.
Notre territoire en a cruellement besoin. Nombre de nos concitoyens, parmi lesquels des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, y vivent dans des conditions déplorables. Nous ne pouvons pas les laisser sans solution. Il faut agir dès aujourd’hui. Nous aurons besoin de données pour continuer ce travail : l’expérimentation proposée permettra de les recueillir.
Madame le rapporteur, chère collègue ultramarine, je pense que vous comprenez notre situation. Je veux croire que vous ne vous opposerez pas à la demande de la quasi-totalité des parlementaires de La Réunion, pour leur territoire et leurs concitoyens.

Le présent amendement vise à restreindre l’application du dispositif proposé au seul territoire de La Réunion et à une période courant jusqu’au 31 décembre 2026, à titre expérimental.
Toutefois, les motifs qui font douter de l’adéquation du dispositif proposé à l’objectif de ses auteurs sont tout aussi valables à La Réunion que sur le reste du territoire national.
Concernant l’utilité de la mesure, les acteurs réunionnais que j’ai interrogés, notamment la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal), ont confirmé la grande efficacité de la procédure actuelle de retenue des allocations de logement. Dès lors, pourquoi la durcir ?
Concernant le risque de fragilisation des propriétaires modestes, je me reporte à un récent rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui soulignait justement le manque de ressources des bailleurs privés de La Réunion pour réhabiliter leurs logements. J’ajoute que, si les critères de performance énergétique ne s’appliquent pas pour l’instant dans les outre-mer, ils y entreront progressivement en vigueur à partir de 2028, ce qui induira des coûts supplémentaires pour les bailleurs dès avant cette année.
Enfin, le risque d’exposition à des situations d’impayés de locataires victimes d’une mauvaise compréhension du dispositif a bien été relevé par mes interlocuteurs de la Deal de La Réunion.
Je comprends la tentation de l’expérimentation, face aux situations ubuesques dont je vous ai parlé tout à l’heure, mais, je le répète, le dispositif n’est pas efficient et les risques d’effets de bord sont réels, à La Réunion comme ailleurs.
En outre, étant donné que le régime des allocations de logement diffère entre les outre-mer et la métropole, le bilan d’une expérimentation limitée à La Réunion ne permettrait de tirer aucune conclusion quant à la pertinence d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire national. Ce qui est demandé au travers de cet amendement est donc moins une expérimentation qu’une législation dérogatoire temporaire.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Par constance, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Évidemment, les problématiques d’habitat indigne et insalubre sont particulièrement prégnantes dans les collectivités d’outre-mer. Je me suis rendu outre-mer à plusieurs reprises en tant que président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), notamment à La Réunion. Dans mes fonctions actuelles, je me suis rendu tout récemment à Mayotte, où la situation est encore plus difficile.
Néanmoins, comme Mme la rapporteure vient de l’expliquer, la mise en œuvre du dispositif proposé, même à titre expérimental, me paraît susciter les difficultés que j’avais déjà relevées dans mon intervention liminaire.
Ajoutons que la mobilisation du Gouvernement sur le logement à La Réunion est extrêmement importante. Nous nous y employons notamment avec mon collègue Jean-François Carenco. La ligne budgétaire unique (LBU) a été très largement mobilisée pour une politique du logement plus incitative dans nos territoires d’outre-mer : 20 millions d’euros sont inscrits à ce titre sur la LBU pour 2023. Je peux donc vous assurer, mesdames, messieurs les sénateurs, de notre profonde mobilisation sur la question du logement indigne et du renouvellement urbain outre-mer.
Ces éléments justifient l’avis de sagesse du Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 252 :
Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix, l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi visant à mieux protéger les locataires bénéficiant d’une allocation de logement et vivant dans un habitat non décent.
Je rappelle que le vote sur l’article vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi.
Y a-t-il des demandes d’explication de vote ?…
L ’ article unique n ’ est pas adopté.

En conséquence, la proposition de loi n’est pas adoptée.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à douze heures quinze.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Les Indépendants – République et Territoires, de la proposition de loi relative aux outils de lutte contre la désertification médicale des collectivités, présentée par M. Dany Wattebled et plusieurs de ses collègues (proposition n° 102, texte de la commission n° 414, rapport n° 413).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Dany Wattebled, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la désertification médicale ne cesse de progresser en France. Derrière cette expression, entrée dans le langage courant, il y a une réalité pour 49 millions de Français et de Françaises.
Nous avons tous entendu les mêmes récits et les mêmes questions : comment faire renouveler son ordonnance quand il n’y a plus de médecin généraliste ? Comment accéder à un spécialiste quand ce dernier n’a pas de remplaçant ? Comment se faire soigner s’il n’y a pas de médecin près de chez soi ?
Lutter contre la désertification médicale constitue un enjeu de santé publique pour une population qui augmente, qui vieillit et qui souffre de plus en plus souvent de maladies chroniques.
Dans certains territoires, il faut parfois attendre vingt jours pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. Pour ce qui est des consultations chez un spécialiste, les délais augmentent : il y a jusqu’à cinq mois d’attente pour obtenir un rendez-vous auprès d’un ORL. Il s’agit d’un vrai problème en matière de soins et de dépistage, qui augmente les risques d’aggravation de l’état de santé des patients.
Ce problème affecte également tous les professionnels de santé, qui sont confrontés à une charge de travail très importante, dont une partie n’est pas consacrée à la médecine.
Par ailleurs, cette question accentue le désintérêt des étudiants et des étudiantes pour l’exercice de la médecine générale en libéral.
Pendant cinquante ans, le numerus clausus a contribué à tarir l’offre de soins. Si sa réforme, en 2019, a été une bonne nouvelle, nous savons tous qu’il nous faudra attendre plusieurs années avant d’en voir les premiers effets.
D’autres réponses ont également été apportées, mais la politique qui a été menée associe insuffisamment les collectivités.
En effet, les élus locaux se retrouvent démunis face à des départs de médecins, les moyens dont ils disposent étant insuffisants pour rendre leur territoire attractif afin d’en faire venir de nouveaux. Pourtant, les maires font preuve d’initiatives et proposent des réponses innovantes.
Nous devons leur faire confiance. J’en veux pour preuve que les collectivités se sont systématiquement et pleinement saisies de chacun des outils mis à leur disposition en matière de santé.
Par exemple, les collectivités se sont montrées innovantes en étant à l’origine de 23 % des créations de centres de santé. Elles ont également été pragmatiques et volontaristes, en mettant des locaux à disposition auprès des médecins qui s’installeraient sur leur territoire ou en offrant à ceux-ci des aides financières.
Face au désarroi de nombreux maires, il m’est apparu utile de leur donner de nouveaux moyens d’agir en matière de santé.
Nous savons tous que les médecins croulent sous les tâches administratives. Aussi pouvons-nous comprendre leur inquiétude de s’installer dans un territoire inconnu, auprès d’une patientèle nouvelle, sans personnel administratif. C’est pourquoi j’ai proposé de mettre à la disposition des cabinets médicaux et des maisons de santé situées dans un désert médical des fonctionnaires territoriaux.
Pourquoi des fonctionnaires territoriaux, me direz-vous ? En réalité, cela relève de l’évidence. Imaginons une commune mettant à disposition un agent municipal afin d’officier temporairement en tant que secrétaire d’un cabinet médical. Cet agent serait en parfaite mesure d’accueillir les patients et d’apporter un appui administratif au médecin. Il connaîtrait et les professionnels de santé locaux et les habitants et pourrait ainsi assurer une bonne coordination entre ceux-ci et le médecin nouvellement arrivé. Il s’agit d’une mesure simple, pragmatique et efficace.
Je profite de cette intervention pour remercier très chaleureusement l’ensemble de la commission et le rapporteur Daniel Chasseing de leur excellent travail. Fort de son expérience en tant que médecin généraliste en milieu rural, le docteur Chasseing a parfaitement compris l’esprit que j’ai voulu donner à cette proposition de loi et l’intérêt pour certaines communes de recourir à ce dispositif.
Aussi a-t-il proposé une nouvelle rédaction particulièrement claire afin de délimiter le dispositif avec précision. Le texte de la commission qui est soumis au vote de notre Haute Assemblée ouvre ainsi la possibilité, pour les collectivités territoriales situées dans les déserts médicaux, de mettre un agent à la disposition d’un médecin. Cet agent devra exercer la mission de service public de permanence des soins et sera mis à disposition pour une durée de trois mois, renouvelable deux fois et seulement à l’arrivée du médecin sur le territoire.
Le droit commun prévoit, sauf dérogation, que le salaire de l’agent doit être remboursé par la structure d’accueil. Aussi ce dispositif peut-il se concevoir comme une avance de trésorerie pour les médecins nouvellement arrivés.
Il s’agit de donner aux élus locaux la possibilité d’accueillir dans les meilleures conditions un médecin lorsqu’il n’y en a plus. Une fois lancé, le médecin recrutera son équipe ou bénéficiera des différentes aides proposées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) ou par les agences régionales de santé, et l’agent recouvrera ses fonctions initiales. Les cabinets libéraux doivent bien entendu rester libéraux !
Mes chers collègues, l’urgence de la situation nous oblige à faire feu de tout bois dans la lutte contre la désertification médicale. Je vous sais tous concernés et compte sur vous.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – Mmes Véronique Guillotin et Nadia Sollogoub applaudissent également.
M. Jean-Pierre Decool applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis 2015, l’accessibilité des consultations chez le médecin généraliste a reculé dans 86 départements.
Un à un, nos territoires les plus fragiles se transforment en déserts médicaux, tant et si bien que près de neuf millions de nos concitoyens disposent actuellement d’une offre médicale insuffisante pour répondre à leurs besoins en santé.
Trop de fois déjà, la commission des affaires sociales a eu à diagnostiquer l’origine du mal. Un manque de médecins, lié à l’application aveugle d’un numerus clausus trop restrictif, en est bien sûr la cause principale. Le premier cycle comporte trop peu de stages pour découvrir la médecine libérale et les hôpitaux et cabinets médicaux périphériques ne comptent pas assez d’internes. Cette situation est la conséquence d’une action publique décidée à l’échelle nationale en associant insuffisamment les collectivités.
Nombre d’administrés expriment leur désarroi, leur sentiment d’abandon et parfois même leur colère à leurs élus locaux, qui sont souvent démunis pour faire face à des départs de médecins, faute de disposer de leviers d’attractivité suffisants pour en faire venir de nouveaux.
La proposition de loi que nous examinons a été déposée par notre collègue Dany Wattebled. Son article unique vise à élargir la liste des entités éligibles à la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, en y ajoutant les cabinets médicaux et les maisons de santé situés en zones sous-denses.
Le texte a été adopté par la commission des affaires sociales, modifié par un amendement que j’ai soutenu. Ainsi, tout en restant fidèles à l’esprit du dispositif, nous en avons précisé le champ, encadré la durée et conditionné l’éligibilité à la participation au service public de permanence des soins ambulatoires, répondant ainsi à certaines observations formulées lors des auditions.
La mise à disposition consiste, pour un agent public réputé occuper son emploi, à exercer ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir. À ce jour, la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est ouverte à une liste limitative d’entités, qui sont de droit public, exercent une mission de service public, ou, à titre expérimental et sur un champ restreint, sont des organismes sans but lucratif.
Le texte se situe donc entre rupture et continuité vis-à-vis du droit de la fonction publique. Rupture, tout d’abord, car il marque l’engagement du législateur dans la lutte contre la désertification médicale, puisque le dispositif ouvre la mise à disposition à des entités de droit privé à but lucratif. Continuité, ensuite, dès lors que le texte adopté en commission maintient bien le lien consubstantiel unissant l’agent mis à disposition et le service public, en conditionnant la mise à disposition à la participation à la permanence des soins ambulatoires.
L’objectif de ce texte, madame la ministre, mes chers collègues, est de proposer un accompagnement humain articulé avec les différents dispositifs existants pour aider ponctuellement l’installation de médecins en zones sous-denses.
La plupart des dispositifs existants pour lutter contre la désertification médicale se concentrent sur l’appui financier et logistique aux nouveaux arrivants. Ces dispositifs, s’ils sont une composante essentielle pour revitaliser l’attractivité médicale, ne doivent pas éclipser l’accompagnement humain du médecin libéral dans les semaines suivant son arrivée dans un nouveau territoire, qui demeure un angle mort des politiques conduites jusqu’à présent.
Pourtant, si l’on veut éviter qu’un médecin nouvellement installé ne plie bagage précocement, il convient de ne pas le laisser livré à lui-même lors de ses premiers mois d’exercice, au moment où il a besoin d’appui pour accomplir des démarches d’installation chronophages et des tâches administratives. Ces dernières, qui occupent une part importante du temps des médecins, sont démultipliées, à l’arrivée dans un nouveau territoire, par la constitution d’une nouvelle patientèle.
Le fait de pouvoir partager, voire déléguer une partie de cette charge administrative à un agent mis à disposition répondrait aux préoccupations légitimes des médecins en la matière et pourrait contribuer à lever une barrière à l’installation.
L’aide apportée pourrait également répondre à des contraintes organisationnelles. Exercer la médecine dans un nouveau territoire, dont on ne connaît ni les caractéristiques ni l’écosystème professionnel, peut relever de la gageure, à plus forte raison pour les médecins étrangers.
En effet, les représentants des professions médicales que nous avons auditionnés se sont montrés intéressés par la possibilité offerte au nouveau médecin de recourir à des fonctionnaires territoriaux, qui pourront faciliter la coordination avec les autres professionnels de santé du territoire lors des premiers mois d’installation.
La rémunération du fonctionnaire mis à disposition sera versée par l’administration d’origine, puis remboursée dans les conditions fixées par la convention de mise à disposition. Les salaires du personnel mis à disposition feront obligatoirement, je le répète, l’objet d’un remboursement intégral par l’entité bénéficiaire. À terme, le dispositif est donc neutre pour les finances des collectivités.
Dès lors, ce texte, s’il devait être voté, n’alimenterait pas une quelconque forme de concurrence financière délétère entre collectivités, comme le craignaient certains élus auditionnés. Les personnels mis à disposition pourraient être des agents de municipaux, intercommunaux ou départementaux, qui seraient chargés de l’accueil de la patientèle, de la gestion administrative – classement de dossiers, saisie de documents dans le dossier médical partagé, etc. – et de la coordination avec les autres professionnels paramédicaux.
Ces derniers, qu’ils soient infirmiers, kinés, orthophonistes, pédicures, etc. ont besoin de prescriptions dans le cadre de leur travail auprès du patient. Ainsi, la réception de demandes ou la transmission de documents entre professionnels de santé sont journaliers.
De même, les agents pourront informer les personnes en salle d’attente au cas où le médecin aurait dû s’absenter pour prescrire des soins urgents non programmés. Ils pourront parfois même prendre des rendez-vous auprès de médecins spécialistes.
Ce personnel mis à disposition travaillera bien souvent à mi-temps et de manière temporaire – trois mois renouvelables deux fois – afin que le médecin arrivant trouve ses marques et puisse recruter son propre personnel. À cet égard, ce texte, loin de faire doublon avec les dispositifs existants, notamment celui des assistants médicaux, en est le complément.
Le fonctionnaire mis à disposition a vocation à passer le témoin à un assistant médical ou à un secrétaire médical, qui sera recruté sous un contrat de droit privé par le médecin. Ce dernier aura simplement bénéficié ponctuellement d’un accompagnement personnalisé à son arrivée.
Cette proposition de loi ouvre donc une possibilité, dont pourront se saisir les collectivités qui le souhaiteront. À ceux qui estiment que les communes ne disposent pas de moyens humains ou financiers suffisants pour le faire, je rappelle que le dispositif proposé est bien sûr facultatif et qu’il est remboursé.
Au reste, les collectivités se sont pleinement saisies de l’ensemble des potentialités que leur offre, à date, la loi en matière de santé : elles se sont montrées innovantes en étant à l’origine de 23 % des créations de centres de santé à activité médicale. Elles ont également été pragmatiques et volontaristes, en mettant des locaux à disposition auprès des médecins qui s’y installeraient et en leur proposant des aides financières.
Mes chers collègues, madame la ministre, cette proposition de loi ne résoudra pas le problème de la désertification médicale.

Elle n’en a d’ailleurs pas l’ambition. Toutefois, je demeure convaincu, à la fois en tant que rapporteur et en tant que médecin exerçant en zone sous-dense, que la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux peut apporter une réponse locale intéressante pour accompagner ponctuellement les médecins dans leur installation.
Facultatif, temporaire et neutre pour les finances des collectivités, le dispositif est sans risque et ne fait pas de perdants. Par conséquent, j’espère que ce texte rassemblera une majorité au sein de notre assemblée.
Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et UC, ainsi que sur des travées des groupes RDSE et Les Républicains.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement se réjouit de l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de loi portée par M. Dany Wattebled, avec le soutien de son groupe Les Indépendants – République et Territoires, dont je salue l’initiative.
Elle rejoint pleinement la philosophie du Gouvernement, qui consiste à reconnaître le rôle majeur et décisif des territoires pour faire émerger des solutions issues d’initiatives locales avec l’ensemble des acteurs concernés.
Car l’enjeu majeur, pour les professionnels de santé, dans le contexte démographique tendu que nous connaissons, est bien de mobiliser tous les leviers existants pour trouver du temps médical et augmenter l’attractivité de tous les territoires.
Le Gouvernement est pleinement engagé en faveur de l’accès aux soins, fondant son approche sur la territorialisation afin de construire partout, avec l’ensemble des acteurs, les solutions les plus adaptées aux contextes locaux. Nous sommes tous convaincus que la réponse ne peut pas être unique et identique sur l’ensemble du territoire.
Tout d’abord, en matière de formation, la quatrième année de médecine générale permettra aux internes et aux externes de réaliser des stages en ambulatoire et de découvrir la pratique en libéral. Nous comptons ainsi donner envie à nos étudiants de s’installer et exercer en ville.
Ensuite, pour créer le choc d’attractivité dont nous avons besoin, nous agissons en faveur de l’exercice coordonné, en poursuivant le déploiement des maisons et centres de santé pluriprofessionnels et des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
J’ai d’ailleurs lancé ce mois-ci un grand tour de France des CPTS pour identifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien dans les structures déjà existantes et dans celles qui se créent. Notre volonté est de proposer des leviers d’amélioration pour permettre d’ici à la fin de 2023 un maillage du territoire couvrant l’ensemble de la population.
Nous souhaitons également accélérer le déploiement des assistants médicaux pour atteindre le chiffre de 10 000 en 2025. Pour cela, nous aurons besoin des élus et des collectivités territoriales.
En effet, les cabinets médicaux ne sont souvent pas adaptés pour accueillir ce nouveau métier, dont l’objectif est de libérer du temps soignant. Il nous faut donc anticiper ces questions dès le montage de projets des nouveaux cabinets, mais aussi apporter des solutions concrètes d’adaptation des locaux existants.
Nous travaillons d’ores et déjà avec l’ensemble des parties prenantes – élus locaux, professionnels de santé – au cabinet médical de demain. Il s’agit de l’un des volets du pacte territorial en santé avec les élus qu’a annoncé le Président de la République, qui se déclinera dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR) en santé durant les mois à venir.
Par ailleurs, nous devons répondre au défi de la simplification et de la suppression des tâches administratives, qui empoisonnent la vie de nos médecins. La feuille de route de mon ministère, au côté de François Braun, est de tout faire pour simplifier la vie des médecins.
Le 8 février dernier, nous avons présenté quinze mesures pour réduire le temps administratif des médecins, afin de redonner du temps médical aux médecins et d’améliorer durablement leurs conditions d’exercice.
À titre d’exemple, les certificats médicaux doivent devenir l’exception. Nous savons que les médecins y passent en moyenne entre une heure trente et deux heures par semaine ; supprimer la délivrance de certificats médicaux non nécessaires, c’est autant de temps retrouvé au service des patients.
Il était urgent de clarifier les règles pour les domaines concernés que sont les crèches, les écoles ou les fédérations sportives. Ce sera bientôt chose faite, avec des campagnes d’informations régulières pour mieux informer patients et institutions sur le caractère non nécessaire de certains certificats.
Nous agissons également pour déployer des outils numériques mieux adaptés au quotidien des professionnels de santé, en particulier les médecins libéraux.
La proposition de loi que nous examinons tend à un plus grand partage des leviers mis à la disposition des acteurs, y compris les collectivités territoriales, pour faciliter la vie des médecins et encourager ainsi leur installation dans les territoires.
Elle va dans le sens d’un enrichissement de la boîte à outils que nous souhaitons mettre à la disposition des acteurs locaux et dont pourraient s’emparer certains maires pour agir concrètement sur l’accès aux soins.
De plus, elle s’ajoute aux mesures votées en LFSS pour 2023 en faveur de l’installation des médecins. Je pense notamment au guichet unique départemental et à la simplification des aides à l’installation. L’objectif est bien d’offrir plus de lisibilité et de souplesse pour une efficacité renforcée.
Dans le cadre du CNR en santé, qui se poursuivra dans les prochains mois, la mise en œuvre de ce guichet unique départemental trouvera toute sa place. Ce sera d’ailleurs l’un des volets de la deuxième phase du CNR en santé que nous lancerons d’ici à la fin du mois et qui a vocation à rassembler de façon régulière tous les acteurs, territoire par territoire, pour partager les besoins en matière de santé et construire des solutions adaptées aux réalités du terrain, en utilisant l’ensemble des outils que nous mettons à disposition.
Le dispositif de cette proposition de loi se fonde sur cette même volonté, celle de simplifier la vie des médecins en facilitant les conditions de leur installation dans les déserts médicaux en offrant la possibilité aux collectivités territoriales de mettre à leur disposition un agent administratif, pour une durée limitée.
Pour être pleinement efficace, un médecin doit être accompagné d’un secrétariat médical ou d’un assistant médical. Cette aide est souvent demandée par les médecins en lieu et place d’une aide financière, mais le droit actuel ne permet pas de la leur accorder.
En commission des affaires sociales, vous avez souhaité en préciser le champ, en soulignant le rôle d’amorçage de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, d’où sa limitation dans le temps. Vous avez également souhaité conditionner le dispositif à la participation du bénéficiaire à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires.
Le Gouvernement est favorable à ces ajouts et vous proposera, par souci d’équité, un amendement visant à permettre aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique d’intégrer le dispositif. Sans rien enlever au fond de la proposition de loi, dont nous partageons la philosophie, cela nous paraît de nature à en favoriser l’opérationnalité.
Tout faire, c’est déployer les outils nécessaires. Ce texte, vous en conviendrez, monsieur le rapporteur, a une portée limitée
M. le rapporteur acquiesce.
Je rappelle que le dispositif ne retire rien à personne. Il est facultatif, limité dans le temps et les frais y afférents sont seulement avancés. Il y a deux jours, alors que nous débattions au sein de cet hémicycle, tous les orateurs ont appelé à ce que les collectivités territoriales puissent s’investir pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Vous avez l’occasion de le leur permettre.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est la sixième fois en quelques mois que nous débattons de la question de l’accès aux soins. Cela démontre l’urgence de la situation et le manque de réponses à la hauteur de la part du Gouvernement.
Le constat est connu et s’aggrave un peu plus chaque année, pour atteindre un seuil critique dans certains territoires. Rappelons quelques chiffres : quelque huit millions de Français vivent dans un désert médical, six millions d’entre eux n’ont pas de médecin traitant, tandis que 60 % des habitants de territoires ruraux connaissent des difficultés d’accès à un médecin généraliste.
Depuis les années 2000, de nombreuses politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous-denses ont été mises en œuvre : financement d’assistants médicaux, contrats d’engagement de service public (CESP) passés avec des étudiants, maisons de santé ou encore passage du numerus clausus à un numerus apertus, qui va toutefois mettre plusieurs années à produire des effets.
Bien que ces mesures soient utiles, elles restent clairement insuffisantes. En effet, les écarts entre les territoires les mieux et les moins bien dotés se creusent.
Si les dispositifs de soutien financier aux étudiants, en contrepartie d’engagements de service, permettent d’accroître l’offre à court terme, les résultats à plus long terme sont beaucoup moins probants. Les incitations financières ne suffisent pas à attirer et à retenir les médecins dans les zones sous-denses, et les effets de ces mesures sont assez faibles au regard de leur coût.
Les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 n’offrent pas non plus de réponse satisfaisante. Une quatrième année d’études est certes créée pour les médecins généralistes, mais cette mesure demeure très floue.
Aussi, il nous paraît évident que le dispositif de cette proposition de loi ne répond pas au problème.
Cet article unique prévoit d’ajouter les cabinets médicaux et les maisons de santé à la liste des entités pouvant bénéficier de la mise à disposition d’un agent public, dans le cas où la collectivité se trouve dans une zone sous-dense. L’objectif affiché est d’alléger les contraintes financières et administratives pesant sur l’installation des médecins dans ces territoires.
Nous nous opposons clairement à cette proposition qui flèche des moyens publics vers des cabinets libéraux.

Les fonctionnaires territoriaux n’ont pas à être mis au service des médecins, ou, tout du moins, cela ne peut pas être une priorité.
Par ailleurs, ce dispositif paraît peu opérationnel : la mise à disposition se fonderait certes sur le volontariat, mais une contrainte supplémentaire pèserait sur les petites communes, qui ne peuvent se passer ni d’un de leurs agents ni de l’arrivée d’un médecin.
L’examen du texte en commission a également mis au jour plusieurs écueils. Par exemple, il nous semble un peu risqué, dans les faits, de confier une telle mission à un agent municipal non soumis au secret médical et dont ce n’est pas le métier.
Pour faire face à l’urgence, des mesures de planification de l’offre et de régulation réelle de l’installation paraissent plus efficientes, comme l’a fait valoir le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires à plusieurs reprises, notamment à l’occasion de l’examen du dernier PLFSS.
Les mesures qui nous semblent prioritaires sont les suivantes : la prise en compte par les facultés de médecine du nombre de candidats originaires de zones sous-denses en premier cycle dans l’élaboration de leur capacité d’accueil ; la prise en charge des frais de transport pour lever les difficultés d’accès aux soins ; l’accès effectif aux urgences et à la maternité en moins de trente minutes.
Ces mesures doivent s’inscrire dans des réformes structurelles, qui engagent le long terme. Il nous faut véritablement rééquilibrer notre démographie médicale et mettre fin à cette iniquité territoriale qui ne cesse de croître.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera contre ce texte.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « la France est un désert médical. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 87 % du territoire français est un désert médical. Paris comme la Nièvre sont des déserts médicaux ».
Tels étaient vos mots, madame la ministre, à l’occasion du 104e congrès de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) en novembre dernier.
Notre pays connaît, en effet, de grandes difficultés en matière de démographie médicale. Toutefois, ce n’est pas une fatalité. Cette question mérite un plan Marshall pour apporter à tous nos concitoyens une offre de soins correspondant à leurs besoins.
Nous n’en pouvons plus de voir l’offre de soins se dégrader pour s’adapter aux moyens disponibles, alors qu’aucune perspective d’amélioration ne se profile.
Le constat étant connu, je n’y reviendrai que brièvement. La France a perdu plus de 5 000 médecins généralistes entre 2010 et 2021, alors que la population s’est accrue de 2, 5 millions d’habitants sur la même période. La situation est alarmante : 11 % des Français, soit six millions de personnes, n’ont pas de médecin traitant. Plus de huit millions de Français, faute d’un praticien proche de chez eux, ne peuvent consulter plus de deux fois par an.
Par ailleurs, l’augmentation de la demande de soins liée au vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques et le non-remplacement d’un grand nombre de médecins généralistes partant à la retraite aggravent ce phénomène.
Les inégalités territoriales d’accès aux soins ne cessent de se creuser : vivre dans une zone sous-dense multiplie par deux le taux de renonciation aux soins. Les pertes de chances pour certains d’entre nous sont une réalité inacceptable dans notre pays, où le système de santé se fonde sur la solidarité nationale.
Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), la propension à renoncer à des soins est multipliée par huit lorsque le fait de vivre dans un désert médical se couple à une pauvreté en conditions de vie.
S’ils s’étendent en priorité dans les territoires ruraux, les déserts médicaux existent aussi dans des territoires urbains tels que l’Île-de-France et plus encore dans nos départements et collectivités d’outre-mer.
Qu’elles soient liées à la fermeture des urgences ou à l’absence de praticien à proximité, les difficultés d’accès aux soins entraînent une dégradation de leur qualité susceptible de mettre en péril la santé et la vie de nos concitoyens.
Cette situation dramatique devient insupportable à vivre pour les patients et insoutenable pour les élus, qui se battent sans relâche pour trouver des solutions.
Des réponses concrètes et ambitieuses sont plus que jamais nécessaires pour préserver notre système de soins.
Pour ne pas laisser nos concitoyens dans la détresse, sans solution pour se soigner, et afin de leur garantir un égal accès à la santé, il appartient au législateur et au Gouvernement d’agir.
La proposition de loi de notre collègue Dany Wattebled, présentée au nom du groupe Les Indépendants – République et Territoires, vise à améliorer la situation dégradée que nous connaissons dans nos communes. Elle a pour objet d’autoriser la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès des cabinets médicaux ou des maisons de santé.
Ce texte s’inscrit dans une logique intéressante, puisqu’elle tend à libérer du temps médical et à faciliter l’intégration des nouveaux médecins sur un territoire.
La mise à disposition d’un fonctionnaire territorial permettrait de répondre à la préoccupation de médecins, qui seraient prêts à s’installer dans une zone sous-dense, mais qui s’inquiéteraient des contraintes financières et administratives à supporter.
Bien qu’il prévoie un dispositif facultatif, ouvert uniquement aux collectivités locales volontaires, ce texte suscite l’étonnement des associations d’élus, lesquelles ont émis des réserves.
Le caractère opérationnel du dispositif appelle en effet plusieurs réserves.
Comment s’articulera-t-il avec les dispositifs existants, notamment celui des secrétaires médicaux ou des assistants médicaux, dont l’assurance maladie facilite l’embauche grâce à une aide financière significative, à hauteur de 36 000 euros par an, sous réserve que le médecin traite un minimum de patients et exerce de manière coordonnée ?
Le texte ne prévoit aucun financement de l’État ou des agences régionales de santé. Le dispositif, dont le coût est à la charge des collectivités locales, a été très justement modifié par le rapporteur Daniel Chasseing, qui en prévoit le remboursement par le médecin lui-même. Cependant, cette mesure pose une difficulté au moment où les marges de manœuvre en matière de ressources humaines et financières des collectivités sont restreintes, et alors qu’elles sont elles-mêmes confrontées à des difficultés de recrutement.
Enfin, les personnels mis à disposition doivent pouvoir bénéficier d’une formation adaptée à la terminologie médicale et aux outils de gestion de l’assurance maladie, formation qui est sans lien direct avec celle des fonctionnaires territoriaux. Cette formation minimale, mais essentielle, ne vaudrait que pour quelques mois, compte tenu de la durée maximale du dispositif qui est limitée à trois mois, renouvelable dans la limite de deux fois.
Il nous semble plus adapté de prévoir, dès l’installation du médecin, un recrutement direct sous contrat de droit privé.
L’amendement du Gouvernement, qui ouvre le bénéfice du dispositif aux agents des trois fonctions publiques, dont ceux de la fonction publique hospitalière, pourrait améliorer ce point, mais, au vu de l’état actuel de l’hôpital public, le remède serait pire que le mal : l’hôpital souffre aujourd’hui d’une hémorragie, d’une fuite de ses agents qu’il convient plutôt de colmater !
Permettez-moi également de rappeler que les agents de la fonction publique territoriale sont soumis au devoir de réserve et à la discrétion d’usage, mais qu’ils ne sont pas assujettis au secret médical, contrairement aux assistants médicaux. Cela pose un vrai problème, susceptible de fragiliser la relation de confiance entre les patients et le personnel médical.
Par ailleurs, le caractère optionnel du dispositif risque d’accroître les inégalités territoriales et, ainsi, d’amplifier la concurrence entre collectivités, sans effet global sur l’attractivité médicale.
Lors de son examen en commission, le rapporteur a réécrit, à très juste titre, l’article unique de la proposition de loi.
Il a encadré la durée de recours au dispositif, en la limitant à une période maximale de trois mois, renouvelable deux fois. Les fonctionnaires territoriaux n’ont pas vocation à se substituer durablement au personnel des cabinets libéraux et des maisons de santé libérales.
Le rapporteur a également conditionné le dispositif à la participation des organismes à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires, en cohérence avec le droit en vigueur en matière de mise à disposition.
Pour pallier tout risque de détournement, le dispositif a principalement pour but d’accompagner les médecins lors de leur arrivée sur un nouveau territoire.
Pour autant, nous estimons que d’autres mesures ont déjà été prises par les ARS en lien avec les collectivités, au travers notamment des contrats locaux de santé, des CPTS, ainsi que du soutien et de l’accompagnement accordés aux nouveaux médecins qui s’installent dans une commune – le guichet unique.
Une installation se prépare et doit s’inscrire dans un exercice coordonné, en lien avec les autres professionnels de santé. Les collectivités territoriales sont sollicitées au-delà de leurs compétences pour financer de tels dispositifs incitatifs.
Je rappelle que la santé est une compétence de l’État, à qui il appartient d’établir une offre de soins équilibrée sur l’ensemble du territoire.
L’origine du problème tient au manque de médecins et de professionnels de santé, qui ne résulte pas d’une crise des vocations, car nombreux sont les jeunes souhaitant s’impliquer dans ces métiers, mais de l’inadaptation des recrutements, de la formation et de la désorganisation actuelle de notre offre de soins.
La mise à disposition d’un fonctionnaire est une procédure administrative lourde, qui prend du temps, car elle doit faire l’objet d’une information préalable de l’assemblée délibérante et de l’accord préalable de l’intéressé. Ces démarches, étant donné les trois mois de mise à disposition, posent la question de l’efficacité relative du dispositif pour les communes qui seront concernées.
Pour lutter contre les déserts médicaux, surmonter la crise de l’hôpital, pallier le manque d’attractivité des métiers du soin et de la santé et répondre aux enjeux de santé de la population, il nous faut un grand projet de loi d’orientation et de programmation.
La mise en œuvre d’un plan Marshall pour un accès de tous et de toutes à la santé, partout sur le territoire national, qu’il soit rural, urbain ou ultramarin, devient urgente.
Si l’intention des auteurs de la proposition de loi est louable, le dispositif nous semble être une fausse bonne solution ! Nous partageons les réserves des associations d’élus, notamment celles de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des départements de France.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, pour toutes les raisons que je viens d’énoncer, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne votera pas cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lutter contre la désertification médicale dans les collectivités territoriales est une urgence que personne ne peut contester.
Les chiffres en attestent : il n’est pas acceptable que 30 % de la population française vive dans un désert médical.
Les difficultés pour obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste en secteur 1 ne sont plus spécifiques aux territoires ruraux ; elles concernent désormais les territoires périurbains et urbains. Face à ces difficultés d’accès aux soins, la colère monte chez nos concitoyennes et nos concitoyens.
Cependant, je m’interroge sur cette nouvelle initiative parlementaire. Le Sénat a déjà discuté de six propositions de loi relatives à l’accès aux soins en moins de six mois !
Le présent texte est examiné en séance publique, alors même que votre groupe, messieurs Wattebled et Chasseing, et la majorité sénatoriale ont voté en faveur de l’ensemble des projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui ont entériné la réduction des dépenses de santé.
On peut donc s’interroger sur l’objectif réel que vous visez, d’autant que nous débattons de cette proposition de loi quelques mois avant le prochain renouvellement du Sénat.
Depuis 2017, vous n’avez pas contesté, mes chers collègues, l’insuffisance des moyens mis en œuvre par le Gouvernement et le remplacement du numerus clausus par le numerus apertus, qui n’a augmenté que de deux cents médecins le nombre de praticiens formés chaque année.
Pourtant, on évalue le manque de médecins ou professionnels de santé à 20 % en médecine générale, à 14 % en odontologie, à 8 % en pharmacie et à 4 % en maïeutique.
Sur le fond, le texte vise à lutter contre les déserts médicaux en améliorant l’attractivité des territoires. Il prévoit la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux pour assurer le secrétariat des cabinets médicaux en zone sous-dense, bien que les médecins bénéficient déjà, à ce titre, d’aides financières pour recruter du personnel.
On nie ainsi la réalité du métier de secrétaire médical, dont le quotidien ne se limite pas à la prise de rendez-vous, à la tenue du standard téléphonique et à l’archivage des documents. Ce métier implique, outre sa dimension humaine essentielle, une maîtrise du vocabulaire et de la réglementation des soins et une bonne connaissance des patients. On ne peut donc pas envisager sérieusement que des fonctionnaires mis à disposition pendant seulement trois mois, ce que propose le rapporteur, puissent correctement l’exercer.
On nie également, comme l’ont souligné les associations d’élus lors des auditions, le manque dramatique de moyens des collectivités locales.
J’ajoute qu’un tel dispositif constitue une remise en cause du statut de fonctionnaire.
Dans leur exposé des motifs, les auteurs du texte envisagent de transformer les postiers en secrétaires médicaux et, au passage, de casser encore davantage le service public postal. On marche sur la tête !
En outre, nos collègues proposent une disposition discriminatoire, puisque seuls les maisons de santé et les cabinets libéraux pourraient bénéficier du dispositif de mise à disposition, ce qui exclurait de fait les centres de santé. Cette inégalité de traitement est incompréhensible.
Enfin, la commission des affaires sociales a apporté sa touche libérale à ce texte, en suggérant d’exonérer le personnel territorial de cotisations sociales, certainement pour affaiblir encore davantage la sécurité sociale…
À la lecture de votre amendement, madame la ministre, une question m’est venue à l’esprit : ne trouvez-vous pas que les hôpitaux souffrent déjà suffisamment d’une pénurie de soignants, pour envisager de les mettre à disposition des médecins libéraux ? §Vous pouvez soupirer, vous apportez de mauvaises solutions à de vrais problèmes !
En résumé, cette proposition de loi apporte, je viens de le dire, une réponse simpliste à un problème complexe. Elle créera plus de difficultés qu’elle ne permettra de trouver des solutions.
Nous assistons à une compétition entre territoires pour attirer des médecins, conséquence de l’impuissance organisée par les gouvernements successifs en matière de formation des professionnels de santé. Il s’agit également de la conséquence du refus de s’attaquer au totem de la liberté d’installation, qui s’applique au détriment de l’accès aux soins de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
Pour les professionnels de santé, l’attractivité des territoires découlera moins de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux que de l’existence de services publics – école, transports, sécurité sociale – et de la proximité d’un hôpital public.
Malheureusement, les politiques de restriction budgétaire menées par les différents gouvernements ces vingt dernières années – dont le vôtre, madame la ministre – ont entraîné la fermeture des hôpitaux et des maternités de proximité, ainsi que la disparition des services publics.
Pour moi, comme pour l’ensemble des membres de mon groupe, la réponse politique passe nécessairement par l’augmentation des moyens des universités, qui permettra de former davantage de professionnels de santé, d’un côté et de l’autre, par le développement des centres de santé et le rétablissement de la permanence médicale la nuit et le week-end, la revalorisation des gardes et la réquisition des spécialistes, y compris ceux des établissements privés.
En conclusion, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste voteront contre cette proposition de loi.
Mmes Monique de Marco et Annie Le Houerou applaudissent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à perfectionner les leviers d’action des collectivités territoriales en matière de lutte contre la désertification médicale.
Pour ce faire, elle tend à ouvrir aux maisons de santé et aux cabinets libéraux en zone sous-dense le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux.
Tout d’abord, je tiens à remercier l’auteur de ce texte, notre collègue Dany Wattebled, pour son implication dans ce dossier, ainsi que notre collègue rapporteur, Daniel Chasseing, pour sa persévérance.
L’adoption de l’amendement du rapporteur en commission a permis de clarifier le dispositif, en précisant les publics concernés et en conditionnant la mesure à la participation à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires.
Il a également contribué à limiter la durée de recours au dispositif à trois mois, durée renouvelable deux fois. Ainsi, les fonctionnaires mis à disposition ne sauraient se substituer durablement au personnel des cabinets libéraux et des maisons de santé.
Afin de pallier tout risque de détournement, le dispositif est conditionné à une installation récente, s’agissant des médecins exerçant en cabinet libéral. Cette disposition contribue à accompagner les médecins à leur arrivée sur un nouveau territoire et à les soutenir, en leur faisant bénéficier d’une forme d’avance de trésorerie au cours de leurs premiers mois d’exercice.
Cela ne vaudrait que pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telles qu’elles sont définies par le code de la santé publique.
Il s’agit d’un appui temporaire et facultatif, avant que la maison de santé ou le cabinet n’ait pu recruter son propre personnel ou bénéficier des différentes aides proposées par la Cnam ou les ARS, à commencer par le dispositif des assistants médicaux.
Certes, la mise à disposition de fonctionnaires donne lieu à un remboursement des traitements versés à la collectivité d’origine, mais les conditions de ce remboursement, notamment dans le temps, sont définies par une convention avec l’administration d’origine.
Certains s’interrogent sur la formation et le rôle des fonctionnaires mis à disposition dans ces structures, par exemple les agents de mairie officiant comme secrétaires médicaux. Il me semble qu’aucune formation spécifique n’est nécessaire pour accueillir la patientèle, répondre au téléphone ou classer des dossiers.
Dans leur grande majorité, nos fonctionnaires exercent déjà ces activités. Peut-être pourrait-on simplement convenir de la nécessité du respect du secret médical, ce qui suscite des interrogations et devrait donner lieu à des ajustements ad hoc.
Mes chers collègues, un rapport d’information fait par la délégation aux collectivités territoriales il y a un an a alerté le Gouvernement sur les inégalités d’accès aux soins dans nos territoires. Ces derniers temps, plusieurs initiatives parlementaires ont été examinées par notre assemblée, afin de pallier le manque criant de médecins. Mais cela ne suffit pas !
J’ai la douloureuse impression que nous essayons de panser une plaie ouverte, mal soignée, avec des pansements de premiers secours qui risquent de se décoller…
Force est de constater que nous en demandons de plus en plus aux communes. Certaines collectivités, démunies face au départ de médecins, en viennent à payer la voiture de fonction, le logement et les locaux des praticiens qu’elles souhaitent attirer sur leur territoire.
Cette situation engendre une concurrence déloyale, car toutes les communes n’ont pas les moyens financiers et humains suffisants pour actionner ces leviers. Comment s’assurer que le dispositif n’aggravera pas une compétition déjà bien ancrée dans le paysage médical ? Ce risque existe et pourrait creuser les inégalités territoriales.
Cela étant, compte tenu de l’urgence de la situation, chaque collectivité tente, à sa façon, d’apporter des solutions, qui ne sont pas toujours parfaites. Nombreux sont les élus locaux qui, de manière volontariste, mettent en œuvre des dispositifs innovants et pragmatiques. Cependant, leur cadre juridique d’intervention reste limité.
Même si, je dois l’avouer, j’ai eu quelques doutes – j’aurais certainement voté contre ce texte s’il n’avait pas été modifié par la commission des affaires sociales –, je me prononcerai, comme l’ensemble des membres du groupe Union Centriste, et pour toutes les raisons que je viens d’exposer, en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et Les Républicains.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.