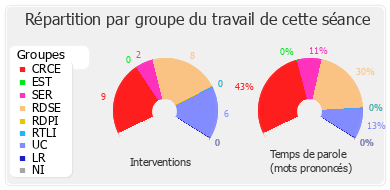Séance en hémicycle du 18 mai 2011 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Monique Papon.

La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 9.
Chapitre IV
Participation des citoyens aux décisions en matière d’application des peines
I. –
Non modifié
« Art. 712–13–1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13, pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712–7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10–1 à 10-13.
« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707. »
II. – Après l’article 720–4 du même code, il est inséré un article 720–4–1 ainsi rédigé :
« Art. 720–4–1. – Pour l’application de l’article 720–4, le tribunal de l’application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10–1 à 10–13.
« Les trois derniers alinéas de l’article 712–13–1 sont applicables. »
III. – Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730–1 ainsi rédigé :
« Art. 730–1. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée, selon les modalités prévues par l’article 712–7, par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10–1 à 10-13.
« Le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou lorsqu’il reste deux ans ou moins de détention à subir, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712–6. »

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 129 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour défendre l’amendement n° 19.

Il s’agit d’un amendement de suppression. Ce qui est en cause, c’est la participation des jurés citoyens dans les tribunaux de l’application des peines.
Vous proposez là, comme pour d’autres dispositions du texte, une mauvaise solution. En effet, le tribunal de l’application des peines est formé du juge de l’application des peines et de deux magistrats auxquels vous voulez ajouter deux citoyens assesseurs. On ne voit pas très bien ce que cela va apporter de plus.
La solution retenue pour la cour d’appel est, selon moi, très mauvaise. En appel, il y a, en effet, deux échevins, si je puis dire : le premier est un représentant des associations de victimes. Et si le rapporteur nous dit ne pas voir ce que cette personne vient faire là, pour ma part, je le vois, car les associations de victimes ont à faire ! Le second est un représentant d’associations de probation.
Avec cet article, on élimine ces gens-là, qui sont très avertis de ce qu’est l’application des peines, matière très technique dans laquelle on doit tenir compte de la façon dont la peine est exécutée en prison. La décision ne contrevient d’ailleurs pas à la décision du tribunal, c’est une décision d’aménagement de la peine. On ne voit pas ce que de simples citoyens assesseurs viendront apporter de plus.
C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 56.

Cet article prévoit la participation de deux citoyens assesseurs au tribunal de l’application des peines et à la chambre de l’application des peines pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté de plus de cinq ans.
D’un point de vue pratique, il vous sera tout de même difficile d’élargir la formation collégiale à des citoyens assesseurs dans une maison centrale. Cette difficulté sera d’autant plus accrue que la réforme de la carte pénitentiaire éloigne encore certains établissements.
Par ailleurs, eu égard à la complexité de l’application des peines, car le juge de l’application des peines ne se contente pas de dire si oui ou non il doit y avoir libération, il paraît tout à fait illusoire de penser que deux citoyens assesseurs recrutés huit jours par an par le tribunal ou la chambre de l’application des peines pourront suffisamment s’investir dans cette mission pour maîtriser les rudiments de ce contentieux.
Au-delà, si vous souhaitez associer les citoyens à ce niveau de juridiction, c’est que vous espérez d’eux qu’ils s’opposent aux libérations conditionnelles.
Or s’il y a récidive, c’est précisément parce que la plus grande erreur commise en la matière ces dernières années par le législateur, ou du moins par ceux qui ont voté les textes, est d’avoir considéré que la récidive ne se traitait qu’au niveau de l’application des peines. La loi Clément de décembre 2005, dite récidive I, nous avait déjà fait bondir. Que l’on prenne en compte la récidive au niveau de la peine prononcée est, certes, compréhensible. Encore faut-il que la prise en compte soit intelligente et que l’on n’agisse pas sur un mode automatique, à coups de peines planchers !
Le renouvellement d’un comportement ayant déjà conduit à une condamnation appelle à une plus grande sévérité. Certes, pourquoi pas ? Mais limiter les possibilités d’aménagement des peines pour les récidivistes, comme l’a fait cette loi Clément, en augmentant les délais avant de bénéficier d’une telle mesure, voire en interdisant purement et simplement les libérations conditionnelles parentales, d’ailleurs assorties de conditions de délais, pour les récidivistes, était une erreur des plus graves. Les récidivistes sont précisément ceux qui ont le plus besoin des aménagements de peine permettant un retour à la liberté progressive et encadré par une insertion définitive.
L’expérience que vous nous proposez est tout de même fort dangereuse. Les chances de réinsertion risquent d’être gâchées par un jury peut-être trop prudent, peut-être influencé par les médias ou par les politiques. La conséquence, ce sera une forte augmentation de la récidive, ce qui n’est pas l’effet recherché, du moins puis-je le supposer, car j’imagine que nous sommes d’accord sur ce point.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.


Ces amendements visent à supprimer l’article 9, qui prévoit la présence de citoyens assesseurs dans les juridictions de l’application des peines.
Votre commission est très attachée au principe de l’aménagement des peines et, en particulier, à la libération conditionnelle, qui permet d’éviter les sorties « sèches » de prison et favorise la réinsertion. Je pense qu’elle l’a d’ailleurs largement démontré lors du vote de la loi pénitentiaire et par la suite.
Elle n’en considère pas moins que les décisions prises par les juridictions de l’application des peines sont susceptibles de modifier substantiellement l’exécution d’une peine prononcée par la juridiction de jugement. De telles décisions appellent, a fortiori lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, un droit de regard des représentants du peuple.
La présence de citoyens assesseurs contribuera, par ailleurs, à éviter la stigmatisation dont les décisions des juges de l’application des peines sont trop souvent l’objet de manière injustifiée.
Aussi, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur ces deux amendements.
Même avis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 9 est adopté.
I. – Après l’article 730–1 du même code, il est inséré un article 730–2 ainsi rédigé :
« Art. 730–2. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
« 2° Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711–3 du code de la santé publique.
« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729.
« Un décret précise les conditions d’application de cet article. »
II. – L’article 720–5 et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 du même code sont supprimés.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 20 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 57 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l’amendement n° 20.

de suppression.
L’article 9 bis, introduit par le rapporteur, tend à renforcer la progression de la libération conditionnelle pour les condamnés à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée supérieure ou égale à dix ans, quelle que soit la durée de la détention à subir.
Les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération, menées par le Centre national d’évaluation de Fresnes, ont été introduites par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.
Par ailleurs, toute libération conditionnelle d’un condamné à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans devra être assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile. À défaut, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu’après l’exécution à titre probatoire d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique.
Enfin, quel que soit le reliquat de la peine à exécuter par le condamné, cette mesure ne pourra être accordée que par le tribunal de l’application des peines dans sa nouvelle composition.
Le présent article abaisse considérablement le seuil de ces mesures puisque d’une condamnation à la réclusion criminelle, on passe sans transition à une peine de dix ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle !
Nous sommes opposés à cette mesure, qui revient à nier le sens de ces mesures de libération conditionnelle, lesquelles sont, on le sait, une motivation indispensable pour les condamnés. Nous refusons de nous engager dans cette voie et nous vous demandons par conséquent la suppression de cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 57.

Nous sommes opposés à cet article, qui tend à limiter les libérations conditionnelles pour les personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à dix ans.
Les praticiens de la matière savent que l’aménagement des peines, notamment la libération conditionnelle, préparée et encadrée, est le meilleur moyen de lutter contre la récidive. En effet, le taux de récidive est bien plus élevé pour les libérations « sèches » et en fin de peine que pour les libérations conditionnelles qui sont suivies et encadrées par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, sous la surveillance des juges de l’application des peines.
Il y a, en effet, pour chaque condamné un moment qui est peut-être le moment optimal où le détenu est prêt pour se réinsérer.
Rater ce moment en refusant une mesure adaptée peut tout gâcher, car la détention sera, dès lors, vécue comme injuste et disproportionnée.
Or une société injuste ne donne guère envie de s’y insérer. Convaincre un jury que ce moment est l’instant propice suppose de lui transmettre une connaissance ou une expérience qu’il n’aura pas.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Ces amendements tendent à supprimer l’article 9 bis qui a été introduit par votre commission.
L’article 9 bis étend l’obligation d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité avant toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans. Cette obligation ne s’impose aujourd’hui que pour la libération conditionnelle des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité.
Ces évaluations, actuellement menées dans le Centre national d’évaluation de Fresnes, sont particulièrement utiles pour les magistrats, car elles sont fondées sur une longue période d’observation, de six semaines, en général, et associent des professionnels de plusieurs horizons – psychiatres, médecins, surveillants pénitentiaires et travailleurs sociaux.
Un deuxième centre national d’évaluation sera implanté dans les semaines qui viennent au sein du centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne et des structures comparables sont prévues dans le cadre du nouveau programme de construction d’établissements pénitentiaires. On reparle, d’ailleurs, d’une régionalisation des centres d’observation.
Le principe d’une évaluation est extrêmement utile pour éviter une récidive. Loin de décourager les libérations conditionnelles, il peut, au contraire, les favoriser en levant les craintes inspirées du principe de précaution qui conduit très souvent à rejeter a priori de telles mesures d’aménagement.
Je me permets de citer un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Dans la ville dont j’étais maire, Marcq-en-Barœul, un crime odieux a été commis voilà quelques mois. Une jeune joggeuse a été assassinée par un délinquant sexuel récidiviste qui avait été condamné à dix ans de prison. La décision de libération avait été prise sur la base de simples avis contenus dans des expertises psychiatriques. Cette personne était un manipulateur. Si elle avait fait l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire, nous en sommes tous entièrement convaincus, ce crime n’aurait pas eu lieu.
Je pense qu’il s’agit d’une très très bonne réforme. Elle permettra, à mon sens, de favoriser la libération conditionnelle, qui, nous le savons, est une chance pour la réinsertion.
Sur tous les amendements de ce texte, c’est donc vraiment le plus défavorable des avis que je suis conduit à émettre.
Je suis tout à fait défavorable à ces amendements pour les raisons que vient d’évoquer M. le rapporteur.
J’ai eu l’occasion, voilà quelques jours, d’aller à Fresnes et de voir le travail qui se fait dans ce centre national d’évaluation. C’est un travail remarquable !
On y trouve des professionnels qui sont des gardiens, des psychologues, des psychiatres, des conseillers d’insertion et de probation, des travailleurs sociaux… On y analyse la situation de chacun des détenus qui va arriver en fin de peine. Cela prend, suivant les cas, entre six et sept semaines. Cette analyse est faite sur un mode à la fois global et transversal. Et il y a, surtout, une observation permanente des détenus. Chaque professionnel, dans sa spécialité, regarde vivre le détenu et donne finalement un avis qui figure dans l’étude de synthèse.
Je considère que c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter la récidive. Voilà pourquoi, dans quelques jours, à Réau, près de Melun, sera ouvert un deuxième centre d'évaluation. Je souhaite pouvoir ouvrir au moins deux autres établissements de ce type en métropole afin d’analyser la situation de ces détenus, de déterminer si des aménagements de peine sont envisageables et lesquels.
Je partage tout à fait l'avis du rapporteur : cet article constitue l’un des points essentiels du projet de loi. C’est pourquoi, à mon sens, les auteurs de ces amendements de suppression devraient les retirer, car nous avons tous intérêt à ce que cette évaluation soit réalisée dans de bonnes conditions.
Retirer deux amendements de suppression ne signifie pas dire oui au texte : c'est dire oui à un bon système pour éviter la récidive. Je pense que nous pouvons tous être d'accord sur ce point.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans
par les mots :
la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru
L'amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru
par les mots :
mentionné à l’article 706-53-13
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter ces deux amendements.
L’amendement n° 169 est un amendement de précision. Quant à l’amendement n° 170, il s'agit d'un amendement de coordination.

La commission n'a pas eu l'occasion d'examiner ces amendements mais, à titre personnel, j'y suis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 9 bis est adopté.
Le deuxième alinéa de l’article 731–1 du même code est ainsi rédigé :
« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio- judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par les articles 763–12 et 763–13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730–2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

L'amendement n° 58, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Cet article prévoit d’assouplir les modalités de placement sous surveillance électronique mobile. On assiste à une véritable banalisation de l’utilisation de ce procédé, qui n’est pourtant pas dénué d’importance et de gravité, au point que le présent texte entend même étendre son utilisation aux mineurs. Ainsi, l’examen de dangerosité ne sera plus nécessaire et le juge de l’application des peines sera neutralisé par une position populaire. Tout se coordonne très bien, finalement, dans votre schéma.
Nous sommes opposés à cette généralisation du bracelet électronique sans conditions. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Le bracelet électronique est actuellement très peu développé. Nous souhaitons qu'il le soit beaucoup plus.
Cet amendement tend à supprimer l’article 9 ter introduit dans le projet de loi par la commission sur l’initiative du Gouvernement. Cet article assouplit les conditions de mise en œuvre du bracelet électronique, en supprimant l’exigence préalable d’un examen de dangerosité lorsque le placement sous surveillance électronique mobile, le PSEM, est mis en œuvre dans le cadre d’une libération conditionnelle. Cette disposition qui ne peut que faciliter les libérations conditionnelles devrait pourtant aller dans le sens souhaité par les auteurs de l’amendement.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 ter est adopté.

L'amendement n° 164, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure ».
2° L'article 741–1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 741–1. - En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le service d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve. »
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement a pour objet de garantir la continuité de l’exécution des décisions de justice en clarifiant les conditions de la saisine du service pénitentiaire d’insertion et de probation en cas de condamnation à un travail d’intérêt général ou à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
Lorsqu'une telle peine est prononcée à l'encontre d'une personne non incarcérée, il est remis au condamné, à l'issue de l'audience, une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou SPIP.
Afin de permettre immédiatement la prise en charge de la mesure par ce service, le 1° de l'amendement précise que la convocation délivrée entraîne la saisine de ce service.
De la même manière, en cas de peines d'emprisonnement assorties en partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est important qu'il n'y ait pas d'interruption dans le suivi du condamné au moment de sa libération. Le 2° de l'amendement prévoit donc qu’il devra être remis au condamné avant sa libération une convocation à comparaître devant le SPIP, convocation qui entraînera saisine de ce service.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement qui répond à une demande des praticiens.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 ter.
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS
Nous allons maintenant examiner les articles 17 et 29, appelés par priorité.
I. – (Non modifié) L’article 8–1 de la même ordonnance est abrogé.
II. –
Non modifié
III. – Après l’article 8–2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8–3 ainsi rédigé :
« Art. 8–3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390–1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.
« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative.
« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.
« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.
« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.
« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, mon intervention porte sur l'ensemble du titre II, qui concerne la justice des mineurs, même si la commission a souhaité que les articles 17 et 29 soient appelés par priorité pour des questions de cohérence.
Selon nous, si ces dispositions étaient adoptées par le Parlement et validées par le Conseil constitutionnel, elles signifieraient la démolition de l'ordonnance de 1945.

Or cette ordonnance a été promulguée par le général de Gaulle qui proclamait solennellement : « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. » Certes, il faut replacer cette phrase dans son contexte historique et tenir compte de la personnalité de celui qui l’a prononcée – peut-être avait-il d'autres idées en tête à ce moment-là –, mais ce sont tout de même ses propos.
Depuis, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, prescrit également dans son article 40 qu'il faut tenir compte de l’âge de l'enfant pour faciliter sa réintégration dans la société. En France, la minorité est déterminée par l'article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. » De fait, tout essai pour abaisser l’âge de la majorité, par exemple à seize ans, est, à notre avis, inconstitutionnel. Plus récemment, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a préconisé le changement des lois qui traitent les mineurs comme les majeurs, en réaffirmant l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale.
Or, monsieur le garde des sceaux, le projet de loi qui nous est soumis s’écarte des principes fondamentaux posés par le Conseil constitutionnel et, surtout, s'éloigne de la philosophie qui a inspiré la France depuis 1945.

En effet, qui a été à l’origine de cette ordonnance, sinon ceux que nous appelions les démocrates-chrétiens ? Voilà qui ne peut manquer de nous étonner venant de vous, personnellement, Michel Mercier.
Le garde des sceaux d’alors était l'un de vos illustres ancêtres. Pierre Ancel était magistrat. Pierre Martaguet à Bordeaux, Pierre Savigneau, Henri Gaillac, alors juges des enfants, ont construit le droit des mineurs par leurs pratiques : ils ont passé toute leur vie dans la magistrature, pratiquement sans bénéficier d’avancement, à défendre l'ordonnance de 1945, puis celle du 23 décembre 1958, c'est-à-dire la protection des enfants et les mesures d'assistance éducative.
Aujourd'hui, vous faites litière de tout cela et vous vous rapprochez ostensiblement du droit des majeurs.
D'abord, vous prévoyez une espèce de comparution immédiate des mineurs devant un tribunal correctionnel nouveau. Actuellement, avant d'être traduits pénalement, les mineurs sont suivis par des éducateurs ; un rapport est remis au juge des enfants, dans son cabinet ou devant le tribunal, sur ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont commis l’acte de délinquance qui leur est reproché. Tout cela est balayé.
Ensuite, vous instituez un nouveau tribunal pour les mineurs âgés de seize ans à dix-huit ans.
Enfin, vous remplacez un certain nombre de mesures éducatives par des peines.
Monsieur le garde des sceaux, tout cela nous paraît totalement contraire à l’esprit et aux dispositions de l'ordonnance de 1945 et aux dernières décisions du Conseil constitutionnel, même si vous prétendez le contraire ! En effet, dans sa décision du 29 août 2002 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la justice, dite « loi Perben I », le Conseil constitutionnel a reconnu le principe fondamental de la justice pénale des mineurs, sur le fondement de la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. Pour le Conseil constitutionnel, ces textes sont intangibles dans leur philosophie. Or vous les bousculez allégrement !
Tout récemment encore, le Conseil constitutionnel a affirmé qu'un essai de comparution immédiate des mineurs était inconstitutionnel. Vous reprenez cette mesure en la présentant autrement, mais personne n’est dupe. Monsieur le garde des sceaux, vous êtes en dehors des règles et, surtout, en dehors de la philosophie qui a inspiré les principes de l'ordonnance du 2 février 1945. Au nombre de ceux-ci, on compte la primauté de l’éducation, car il s'agit d'éviter non pas la récidive des mineurs, mais que les mineurs ne tombent dans la délinquance ; c’est tout de même de cela qu'il faudrait parler d'abord. On compte également l’intervention de professionnels spécialisés de l'enfant. Or ce texte n’en parle absolument plus, puisqu’il prévoit que la comparution immédiate sera décidée par un officier de police judiciaire. Il est par ailleurs question d’un traitement personnalisé du suivi de l'enfant, ce qui disparaît totalement dans la nouvelle juridiction que vous instituez. Enfin, alors que le recours à la détention doit être exceptionnel et limité, ce texte prévoit le contraire.
Tout cela nous éloigne considérablement des principes qui ont jusqu'à présent régi la justice des mineurs et nous rapproche, malheureusement, de la justice des mineurs qui s’applique notamment aux États-Unis. Ce pays est peut-être une grande démocratie, mais, en matière de justice, il lui reste encore beaucoup de progrès à accomplir.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 71 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 137 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 31.

Mon collègue vient de le souligner, nous parvenons ici à un volet important du projet de loi, celui du jugement des mineurs, d'autant plus qu'il est resté assez ignoré, notamment des médias, ce que nous regrettons.
L’article 41 de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », a introduit un article 8–3 au sein de l’ordonnance de 1945 prévoyant que « le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l’article 390–1 du code de procédure pénale » – citation à personne par greffier ou officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République – « si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l’occasion d’une procédure engagée dans les six mois précédents ou d’une procédure ayant donné lieu à une condamnation dans les six mois précédents. »
Le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 10 mars 2011, que « ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son âge, l’état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ; qu’elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d’informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ; que l’article 41 doit être déclaré contraire à la Constitution ».
Le présent article propose une nouvelle procédure censée tenir compte des observations de la décision du Conseil constitutionnel. Elle prévoit que le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants, toujours selon les formes de l’article 390–1 du code de procédure pénale, des mineurs âgés d’au moins treize ans lorsqu’il leur est reproché d’avoir commis des délits punis de cinq ans d’emprisonnement et des mineurs d’au moins seize ans quand il leur est reproché d’avoir commis des délits punis de trois ans d’emprisonnement.
La convocation est délivrée au mineur par un officier de police judiciaire dans les locaux du commissariat, soit directement après une période de garde à vue, soit après que le mineur a été invité à s’y présenter pour la recevoir.
La convocation ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l’occasion de la procédure en cours ou d’une procédure antérieure à un an, le cas échéant en application de l’article 12 de l’ordonnance de 1945, aux termes duquel le « service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative ».
Le mineur doit être assisté d’un avocat désigné par lui ou commis d’office. La convocation est adressée au mineur et aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Quant à l’audience, elle doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.
Cette procédure, qui existe pour les majeurs, consiste, pour le parquet, à faire convoquer en justice un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de cinq ans d’emprisonnement. Si le procureur choisit ce mode de saisine du tribunal, c’est dans le but de favoriser une comparution immédiate du mineur, puisque, je le répète, l’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.
Le dispositif se calque donc sur la procédure pénale applicable aux majeurs : à l’évidence, l’excuse de minorité n’existe plus.
Par ailleurs, le recueil de renseignements prévu à l’article 12 de l’ordonnance de 1945 est le fruit non pas d’une investigation, mais d’une simple enquête rapide, se résumant à un entretien sommaire avec le mineur au dépôt et à une rencontre avec ses parents. Très « judicieusement », monsieur le rapporteur, vous avez préféré au recueil de renseignements de l’article 12 celui de l’article 8 de la même ordonnance, plus complet. Nous ne pouvons que le regretter.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 71.

L’article 17 entend généraliser la convocation des mineurs par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, en lieu et place d’une procédure de convocation devant le juge des enfants.
Il supprime donc la phase d’instruction du juge afin de favoriser une convocation rapide. À l’instar du Conseil constitutionnel, nous sommes fermement opposés à une telle mesure.
La LOPPSI 2 prévoyait déjà qu’une procédure de citation directe, proche de la comparution immédiate, pourrait être utilisée à l’encontre des mineurs.
Jusqu’alors, le droit pénal des mineurs écartait toute procédure immédiate, même si deux réformes, intervenues en 2002 puis en 2007, permettaient de juger dans un délai déjà réduit à dix jours sous certaines conditions, dès lors que les auteurs étaient connus et les faits établis.
Pour autant, le Conseil constitutionnel s’est opposé à ce volet de la LOPPSI 2 et à une justice expéditive ne prenant pas en compte le contexte, notamment éducatif, dans lequel évolue le mineur. Malgré cette défaite constitutionnelle, le Gouvernement a décidé de passer outre et de trouver de nouvelles pistes d’accélération de la justice des mineurs.
Dans le même souci d’accélérer les procédures, le texte prévoit d’insérer, dans l’ordonnance de 1945, un article 8-3 aux fins de permettre la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants.
Seront donc concernés le mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de cinq ans d’emprisonnement ainsi que le mineur âgé d’au moins seize ans quand il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de trois ans d’emprisonnement. Si les faits sont établis et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l’occasion de la procédure en cours ou d’une procédure antérieure de moins d’un an, l’audience se tiendra dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.
A contrario, le projet prévoit de supprimer une procédure rapide datant de 1995 : la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants. Il faut dire que celle-ci ne présente pas l’intérêt espéré par le Gouvernement puisque le juge des enfants ainsi saisi ne peut prononcer que des mesures éducatives, sans pouvoir condamner à aucune peine.
Bref, en supprimant la possibilité d’avoir recours à cette procédure, vous voulez frapper un peu plus vite, voire un peu plus fort. Nous ne voulons pas de cette justice expéditive, et ce d’autant moins qu’elle s’adresse aux mineurs.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 137 rectifié.

Nous proposons également de supprimer l'article 17, avec lequel nous entamons l'examen des dispositions relatives à la justice des mineurs en général et de la trente-cinquième modification de l’ordonnance du 2 février 1945 en particulier.
Nous savons tous, ici, que le droit pénal des mineurs est strictement encadré par le Conseil constitutionnel, qui, récemment encore, en a rappelé les trois grands principes : priorité donnée à l’éducatif avant tout jugement, spécialisation des juridictions et mise en œuvre plus protectrice de la loi et de la procédure pénales.
Or cet article 17 donne un aperçu tout à fait contestable de l’application de ces principes. Par exemple, il est inopportun de supprimer la convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants pour l’instituer devant le tribunal pour enfants.
Ajouté à la procédure de présentation immédiate, ce système confère de fait au parquet la maîtrise de l’audiencement devant les juridictions pour mineurs, à savoir le tribunal pour enfants et le nouveau tribunal correctionnel pour mineurs
Le juge des enfants perd ainsi toute prérogative lui permettant d’audiencer au tribunal pour enfants en fonction des priorités, alors que c’est tout de même lui qui connaît le mieux chaque dossier, parce qu’il suit les enfants soit au pénal, soit dans le cadre de l’assistance éducative. Les décisions seront prises en opportunité et elles n’auront, malheureusement, aucune cohérence globale.
Par votre choix, et j’y reviendrai en explication de vote, il s’agit de dire qu’il y a une grande augmentation de la délinquance des mineurs. Or c’est inexact au vu des chiffres de la délinquance générale.
Au moment où nous devrions avoir un débat d’ensemble sur le statut du parquet, vous faites le choix de l’opportunité. Certes, on le dit souvent, le parquet est juge de l’opportunité des poursuites ; c’est une tradition de notre droit pénal. En l’occurrence, vous allez plus loin, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose.
Qui plus est, l’article 17 vise tous les mineurs âgés de plus de treize ans à l’encontre desquels une peine peut être prononcée, sans qu’il y ait aucune différence selon la gravité de l’infraction : la COPJ pourra être mise en œuvre à l’encontre du multirécidiviste comme du primo-délinquant, sans gradation ni distinction.
Là encore, il s’agit à nos yeux d’une mauvaise innovation, contraire d’ailleurs à la tradition de notre droit. Monsieur le garde des sceaux, être soucieux des traditions et des grands principes de notre droit, c’est faire la preuve d’un bon conservatisme : oui, cela peut exister, et vous-même en êtes souvent l’illustration.

L’article 17 du projet de loi tend, d’une part, à supprimer la procédure de convocation par officier de police judicaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et, d’autre part, à créer une procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants.
La suppression de la procédure de COPJ aux fins de jugement, introduite en 1996, se justifie par le fait qu’elle est peu utilisée. En outre, le juge des enfants a la possibilité, lorsqu’il met le mineur en examen, de le juger en cours de procédure et de prononcer à son encontre une ou plusieurs mesures éducatives. Il y avait donc redondance : le texte clarifie les choses.
La création d’une procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants permettra, quant à elle, d’accélérer le jugement de mineurs déjà bien connus de l’autorité judiciaire. Je précise que, à la différence de la procédure de présentation immédiate, il n’est pas prévu de pouvoir placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire en attendant l’audience de jugement.
Enfin, la commission a bien souligné que cette procédure ne pourrait être mise en œuvre que lorsque la juridiction dispose d’investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur, et non d’un seul recueil de renseignements socio-éducatifs, ou RRSE.
Il semble à la commission que, ainsi définies, ces dispositions permettent de garantir un équilibre satisfaisant entre l’exigence de célérité de la réponse pénale et le respect des principes constitutionnels applicables au droit pénal des mineurs.
La commission émet donc un avis défavorable sur les trois amendements identiques n° 31, 71 et 137 rectifié de suppression de l'article.

Je voudrais faire trois remarques et verser au débat quelques données chiffrées.
Premièrement, si la mesure qui nous est présentée avait existé en 1996, elle aurait été beaucoup moins appliquée. En effet, par le jeu de l’accumulation des réformes et du durcissement du code de procédure pénale auquel nous avons assisté au cours des dernières années, ce sont 75 % des mineurs délinquants qui sont concernés aujourd'hui. Voilà un pourcentage qui est loin d’être anecdotique.
Deuxièmement, rappelons-nous que les mineurs sont avant tout des enfants, des adultes en devenir. De ce point de vue, il n’est pas anormal qu’ils se construisent par des tentatives de transgression de l’interdit. Il est donc tout à fait logique d’y répondre, d’abord, par l’intermédiaire des parents, puis, en cas de défaillance ou de besoin d’une aide supplémentaire, par l’intermédiaire de la société.
Cependant, la réponse se doit d’être adaptée aux faits réels et à visée éducative. Or cela commence à être un petit peu moins le cas dans le projet de loi qui nous est soumis.
Troisièmement, la présentation de ce texte traduit une méconnaissance manifeste des caractéristiques de la récidive des mineurs.
En réalité, 75 % des mineurs délinquants ne sont vus qu’une fois par les services de la justice ; 5 % seulement des mineurs délinquants deviennent des majeurs délinquants.
Par conséquent, pour 5 % des enfants délinquants pour lesquels le dispositif aujourd'hui en place se révèle défaillant, on est en train de mettre en œuvre un système qui concernera, demain, 75 % des enfants délinquants.
J’y vois pour ma part une incohérence et, en tout cas, un risque fort d’inutilité et d’inefficacité, indépendamment du fait que l’on bafoue le droit des enfants et la nécessaire prévalence de l’éducatif sur le répressif.
Au final, on va englober 75 % des enfants délinquants dans un système calqué sur celui qui est réservé aux adultes, lequel a fait la preuve de son efficacité puisque 75 % des adultes, eux, récidivent !
M. Charles Gautier applaudit.

Les dispositifs que vous préconisez, qui rapprochent les procédures pour mineurs de celles qui sont applicables aux majeurs, sont sous-tendus par cette idée qui a cheminé dans votre esprit : la justice des mineurs est trop indulgente, les juges des enfants ont de la jeunesse une vision archaïque, et l’on connaît d’ailleurs les qualificatifs que certains – pas forcément vous, monsieur le garde des sceaux – aiment employer à leur sujet ; il vous faut donc absolument pousser le législateur à faire en sorte que les mineurs soient jugés et sanctionnés pénalement le plus rapidement possible.
Évidemment, monsieur le rapporteur, une telle logique pourrait être retenue si l’on pensait qu’elle avait une quelconque efficacité. Pour connaître suffisamment les professionnels – vous les avez, comme moi, entendus, ou, pour le moins, écoutés –, vous savez qu’ils disent tout le contraire.
Il est déjà permis de considérer qu’un mineur entré, à un moment donné, dans la délinquance n’a pas vocation à y rester pour toujours. S’est tout de même répandue l’idée que, dès lors que l’on est entré dans la délinquance, on n’en sort plus. Du coup, se pose la question : que faire après ?
Au fond, des mineurs qui sont entrés en délinquance préfèrent être jugés très rapidement, éventuellement aller à la case « prison », dont ils ne mesurent sans doute pas la portée, plutôt que d’être pris en charge sur la durée dans la perspective de sortir de la délinquance.
Les observations des professionnels me semblent pertinentes et méritent d’être entendues.
Ceux qui ont vu des mineurs délinquants enfermés, soit en centre éducatif fermé, soit en prison, devraient réfléchir.
Voilà quelques décennies, nous avons fermé les centres de rééducation des jeunes délinquants pour des raisons qui peuvent se répéter aujourd’hui et qui se reproduisent d’ailleurs souvent dans les lieux fermés pour les mineurs. Chacun sait que la prison peut être « éducatrice » dans le mauvais sens du terme pour les mineurs.
Si l’on cherche vraiment à prendre en charge les jeunes qui ont commis à un moment donné des actes délictueux, même graves, et à leur donner une possibilité de sortir de la délinquance pour devenir un jour des adultes insérés dans la société, il faut prendre le temps de la réflexion, au lieu de proclamer bien haut, par volonté d’affichage encore une fois, que l’on va voir ce que l’on va voir, que l’on va les punir et les envoyer à la case « prison » le plus rapidement possible.

Beaucoup de raisons juridiques, constitutionnelles et historiques nous conduisent à récuser l’article 17 et votre conception nouvelle de la justice des mineurs.
À ces raisons, j’ajouterai notre refus de la vision que ce texte propose de l’enfance et de l’adolescence, vision à la fois de peur, comme si notre société était en défense totale à l’égard de ces enfants délinquants, et d’abandon.
À partir du moment où vous alignez la justice pour mineurs sur la justice pour adultes, vous gommez toutes les chances de ces jeunes au cours de cette période de la vie de se rattraper, d’évoluer, de changer, et Dieu sait si leur personnalité bouge d’un mois à l’autre, d’une année à l’autre ; tous ceux, dans cette enceinte, qui ont des enfants savent à quel point c’est vrai.
Vous nous proposez une vision totalement fermée et sans espoir.
Je veux vous dire la contradiction que je vois entre une telle démarche d’alignement sur la justice des majeurs et le comportement général de notre société qui, en raison de ses difficultés économiques et sociales, reporte aujourd’hui de plus en plus tard l’entrée de nos enfants dans l’autonomie
Mme Virginie Klès opine.

Au travers de ce texte, on leur dit : mineurs, vous pouvez le rester jusqu’à vingt, vingt-cinq ans ; vous découvrirez les minima sociaux avant d’avoir eu une quelconque insertion véritable dans la société. En même temps, on leur dit : mineurs, vous pouvez cesser de l’être à treize ans ou seize ans, parce que notre société a peur de vous et qu’elle est incapable d’assumer le devoir de protection et d’éducation, qui est à la base de l’ordonnance de 1945, mais qui aujourd’hui devrait être encore plus présent dans notre vision de l’enfance et de l’adolescence.
Monsieur le garde des sceaux, nous n’avons pas le droit d’opérer un tel glissement insidieux vers la justice des majeurs.
Nous ne nions pas que la délinquance des mineurs soit une vraie préoccupation dans notre société. Nous connaissons et reconnaissons tous la nécessité de la sanction et des mesures éducatives.
En revanche, ce que nous refusons en récusant l’article 17, comme nous le ferons d’ailleurs pour d’autres articles du titre II, c’est de fermer la porte et de quitter une justice spécialisée pour se rapprocher de la justice des adultes.
Les enfants ont droit à ce temps de la vie ; ils ont droit à cet âge d’être traités comme des mineurs, et non comme des majeurs.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mmes Josiane Mathon-Poinat et Anne-Marie Escoffier applaudissent également.

Je ne serais pas intervenu si M. le garde des sceaux n’avait fait preuve, à l’instant, de laconisme, puisqu’il n’a apporté aucun argument en réponse aux interventions de mes collègues, et tout particulièrement à celle de Jean-Pierre Michel, qui a insisté sur la tradition humaniste à l’origine de cette ordonnance de 1945.
Monsieur le garde des sceaux, il existait, aux XVIIe et XVIIIe siècles, à côté du jardin du Luxembourg, une rue qui était dénommée rue d’Enfer – devenue Denfert-Rochereau –, car c’était un lieu de banditisme, de guets-apens et même de délinquance juvénile.
C’est un sujet de préoccupation ancien, car cette dernière a toujours existé. La question, au fond, est de définir l’idée que l’on se fait de l’enfant.
À cet égard, on pourrait citer en particulier Jean-Jacques Rousseau. L’enfant est-il une sorte de sauvage susceptible de commettre des actes irréfléchis et qu’il faudrait sanctionner sans pour autant se préoccuper d’éducation ?
On voit bien la philosophie de ce texte, monsieur le garde des sceaux, et je m’étonne que vous le défendiez.
Avec son dispositif de comparution immédiate – appelons les choses par leur nom –, de substitution du parquet au juge des enfants – là encore, appelons les choses par leur nom –, son refus de la spécialisation de la justice des mineurs en calquant celle-ci sur la justice des majeurs, vous tournez complètement le dos à l’ordonnance de 1945.
Lors d’une visite à la maison d’arrêt de ma ville, j’ai rencontré les représentants des juges des enfants de mon département. Monsieur le garde des sceaux, avez-vous procédé à une concertation avec les juges des enfants ? Lorsqu’on voit le travail extraordinaire qu’ils assument malgré la faiblesse des moyens, il y a de quoi s’étonner vivement de ce que vous nous assénez. Peut-être êtes-vous en service commandé ?
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Nouveaux sourires.

Sincèrement, il est des moments où vous devriez dire non !
Permettez-moi de vous expliquer encore quelque chose. L’ordonnance de 1945 n’est pas contre la sanction : la sanction fait partie de l’éducation, vous le savez. §Pour autant, elle considère le mineur comme un être en devenir.
Ou bien l’on accepte ce principe et l’on en tire toute une série de conséquences – comme l’a d’ailleurs très bien dit le Conseil constitutionnel le 10 mars 2011 à propos de l’article 41 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPPSI –, et vous essayez de manière quelque peu besogneuse de contourner cette disposition, même si vous ne pouvez en méconnaître la lettre ni l’esprit.
Ou bien l’on considère qu’il n’y a plus de spécificité de la justice pour mineurs. C’est le terrain sur lequel vous êtes : vous voulez préserver la société contre ces sauvages, ces monstres, en les jugeant et les enfermant vite, afin de s’en protéger rapidement comme s’ils étaient un poison pour le corps social. Or ce « poison », ce sont nos enfants !
Par conséquent, l’article 17 reflète une conception de l’humanisme et de la société. Tout est difficile, et la tâche des juges des enfants l’est particulièrement, tout comme celle des éducateurs.
De même que je n’ai pas accepté dans cet hémicycle que l’on renonce à des exigences en matière d’éducation quand, par exemple, on a cédé à la décision véritablement démagogique de supprimer l’école le samedi, il faut aussi, selon moi, de l’effort, du travail, énormément de ténacité, beaucoup d’œuvre humaine pour éduquer ces enfants qui vont mal et qui commettent des délits.
Monsieur le garde des sceaux, c’est toute une philosophie qui est en cause. Vous ne pouvez pas vous réfugier dans le laconisme ! Vous devez nous répondre sur le fond et nous dire comment vous argumentez ce changement de philosophie, car c’est bien de cela qu’il s’agit !
Mme Virginie Klès et M. Jean-Pierre Michel applaudissent.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, n’étant pas membre de la commission des lois, je ne pensais pas intervenir ce soir, mais j’y suis incité par les arguments qui ont été développés tant par Mme Catherine Tasca que par MM. Jean-Pierre Michel et Jean-Pierre Sueur. Je pense notamment à l’argument qui consiste à s’écarter de la loi pour évoquer la philosophie.
J’ai bien entendu tout ce qui a été dit sur la démocratie chrétienne en 1945. Comme je me flatte d’être aussi, dans cet hémicycle, un de ses représentants, je souhaite répondre sur certains points concernant la philosophie de ce texte.
C’est une évidence pour tous, nous ne sommes plus en 1945.

J’adhère aux propos tenus par Mme Tasca. On n’est pas mineur de deux façons.
Aujourd’hui, du point de vue de leur mode de vie et sur le plan physique, les jeunes de dix-huit ans ne sont plus des enfants. Mais, si on les compare à ceux de 1945, ils sont plus enfants…

M. Jean-Jacques Pignard. … pour nombre de raisons, en particulier parce qu’à l’époque 80 % de la classe d’âge travaillait dès 14 ou 15 ans.
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.

Nous avons eu aussi ce débat à propos de la réforme des retraites. Je veux bien que l’on évoque à tout moment le Conseil national de la Résistance, et j’ai beaucoup de respect pour les décisions qu’il a prises, d’autant qu’y siégeaient également des démocrates-chrétiens. L’ordonnance de 1945 est de cette époque.
Nous avions deux façons de procéder, la première étant de faire comme si nous étions toujours en 1945 et de ne rien changer. L’autre façon, que je qualifierais de sécuritaire, était de dire qu’on allait s’occuper uniquement de la société, et non des jeunes. Pour cela, il fallait tout simplement baisser l’âge de la majorité. C’est précisément – cela a été exposé au début du débat – ce que le Gouvernement n’a pas voulu.
Entre ne rien faire et faire comme si rien n’avait changé, il existe une voie médiane, peut-être démocrate-chrétienne, peut-être centriste
M. Charles Gautier s’exclame.

Monsieur Sueur, vous dites que le tout-répressif remplace le tout-éducatif. Permettez-moi de vous dire qu’une chose a changé depuis 1945 : je ne pense pas que les conseils généraux – je ne sais si vous êtes ou si vous avez été membre d’un conseil général – dépensaient des sommes aussi élevées en 1945 qu’aujourd’hui en faveur de la protection de l’enfance.

Je peux témoigner – et je reprends votre expression, je ne suis pas « en service commandé » –, pour être vice-président du conseil général du Rhône depuis vingt ans aux côtés de Michel Mercier, que le département consacre un budget énorme à la protection de l’enfance. Je ne peux donc laisser dire ce soir que le tout-répressif s’est substitué au tout-éducatif.
Pour autant, je suis navré de le dire, il est un moment où le tout-éducatif a une limite. Lorsqu’elle a été franchie, que la société a investi tout l’argent et tout le talent qu’elle possédait pour essayer de faire quelque chose, la justice doit dire son mot.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Je suis heureux que le hasard de la discussion me permette d’intervenir après avoir pu entendre les arguments de ceux qui se sont exprimés avant moi.
Lorsqu’il est question de l’ordonnance de 1945, il y a toujours deux sortes de réactions.
Certains, en invoquant 1945, ont à l’esprit la volonté des décideurs de l’époque d’apporter une réponse à un problème précis, qui existait déjà ; je le dis pour ceux qui considèrent que la jeunesse d’aujourd’hui à tous les défauts et que, dans le passé, tout se passait très bien. Pourquoi prendre cette ordonnance en 1945 sinon parce que le besoin s’en faisait sentir et parce que de vrais problèmes se posaient ? Depuis 1945 et jusqu’à aujourd’hui, à chaque génération, il s’est toujours trouvé certains jeunes pour venir troubler l’équilibre de la société.
En 1945, avec la volonté généreuse qui inspirait alors toutes les initiatives, on a décidé de ne pas rejeter les jeunes au moment même où se mettaient en place de nombreuses institutions.
D’autres, à propos de la même ordonnance, disent que les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier, et que 1945, c’était il y a plus de soixante ans. Évidemment !

Il est vrai que les jeunes et la société ont changé. Mais faut-il tout changer pour autant ?
Mes chers collègues, que s’est-il passé depuis 1945 s’agissant de ce texte ?

Il a subi près d’une quarantaine de modifications. Pas une ligne n’est d’origine, et il n’en reste que le titre !

Vous le voyez, on fait référence à 1945 soit pour invoquer un idéal, soit pour se camoufler derrière de bien mauvaises arrière-pensées.
Nous ne partageons pas ces arrière-pensées, car la jeunesse d’aujourd’hui ne mérite pas cela.
Certes, et je l’ai dit dans une précédente intervention, peut-être avec moins de solennité, nous constatons tous que les jeunes sont sans doute adolescents plus tôt.

Mais après, que de difficultés, que d’obstacles à surmonter !
De nos jours, on devient adulte peut-être un peu plus tard, même si la société reconnaît un certain nombre de droits aux jeunes à l’âge de la majorité.
Il se trouve que j’ai présenté, cet après-midi, l’un des rares amendements que la majorité a bien voulu accepter. Il tendait justement à maintenir la condition d’âge minimal pour devenir citoyen assesseur à vingt-trois ans, et non à dix-huit ans. Cette proposition a fait l’objet d’un consensus au sein de notre assemblée, et j’en tire une grande satisfaction.
Dans le même sens, j’estime qu’en cherchant à appliquer aux jeunes les mêmes sanctions qu’aux adultes, nous faisons fausse route. Nous sommes d’ailleurs les seuls à faire ce choix ! D’autres démocraties européennes, comme l’Espagne ou l’Allemagne, se préparent à adopter un certain nombre de textes prévoyant notamment de porter à vingt et un ans l’âge retenu pour le statut pénal des mineurs.
Allons-nous continuer à nous aveugler, au cours de cette nuit printanière, pour répondre à celles et ceux qui attendent des preuves que notre société est capable de se « muscler » ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Il s’agit d’un débat de fond et de principe.
J’ai entendu la référence à la démocratie chrétienne, chère à notre garde des sceaux. Les principes qui ont conduit le législateur, et surtout l’exécutif, à prendre cette ordonnance en 1945, sont au sens propre fondateurs, même s’il est exact qu’il ne reste littéralement plus grand-chose du texte initial. Même son article 1er a été modifié dès 1951.
Il existe donc dans notre République, et c’est heureux, des principes fondateurs. Qui remettrait en cause les principes contenus dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? Chacun considère ici qu’ils sont toujours modernes et fondamentaux. Nous y sommes tous attachés et pensons qu’il convient non seulement de les défendre, mais aussi de les faire vivre et prospérer.
Ce débat est très important. M. Pignard nous a dit que les choses avaient changé et que l’on n’était plus en 1945. Certes ! J’ai pourtant entendu qu’un président de la République, il n’y a pas si longtemps, voulait qu’on lût dans toutes les écoles la lettre de Guy Môquet…

Peut-on ainsi reprocher la référence à 1945 en disant que le temps a passé et, quand cela arrange, se référer au contraire à la dernière guerre ?
Nous devons donc préserver nos principes fondamentaux.
Les mineurs sont différents des adultes. Les mineurs, ce sont nos jeunes, qui évoluent, et de façon parfois considérable, dans un sens qui peut être bon ou mauvais, selon les cas.
Il faut une justice pénale. Lorsque notre collègue Jean-Pierre Chevènement parlait des « sauvageons », on ne peut pas dire qu’il était laxiste. Il tenait un discours sage, à la fois ferme – la fermeté est parfois nécessaire ! –, compréhensif et généreux. En effet, les enfants grandissent, ils évoluent, et nous avons besoin de procédures adaptées, singulièrement de solutions éducatives.
J’entends dire qu’il faut aller vite et frapper vite ; certains ajoutent – pas tous, comme nous le verrons en examinant les prochains amendements – qu’il faut frapper fort. Or les audiences de mineurs auxquelles j’ai assisté, devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, étaient tout entières guidées par l’idée inverse, le magistrat n’hésitant pas à dire au jeune comparant qu’il s’agissait désormais de voir comment il allait évoluer, qu’il reviendrait devant la juridiction dans trois mois, six mois ou même un an, et que, si l’évolution avait été favorable, le juge en tiendrait compte au moment de décider des mesures à prendre. Voilà la véritable sagesse !
Plus vous chercherez à aligner la justice des mineurs sur celle des adultes, plus vous ferez fausse route et plus le résultat sera négatif.
Au surplus, nous le savons tous : pour que les principes soient bien appliqués, il faut des moyens satisfaisants. Nous y reviendrons quand il s’agira de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ce débat, tout à fait intéressant, n’est pas médiocre, même s’il est parfois un peu manichéen...
Je ferai trois remarques.
Tout d’abord, je ne suis pas convaincu que l’extrême lenteur de la justice pénale des mineurs soit systématiquement favorable aux jeunes délinquants. Souvenez-vous des chiffres que nous citions hier : dix-huit mois en moyenne, en matière de délits, entre l’infraction et la réponse pénale. Cela mérite que l’on y réfléchisse, ne serait-ce que sur le plan de la pédagogie.
Ensuite, la réponse pénale aux délits commis par les mineurs est, dans la majorité des cas, une alternative aux poursuites. C’est également, dans un grand nombre d’autres cas, l’intervention du juge des enfants statuant en audience de cabinet. Le tribunal pour enfants n’est immédiatement compétent que dans un nombre de cas limité.
Enfin, il est excessif de dire que l’on aligne le droit des mineurs sur celui des majeurs. Le tribunal pour enfants applique le droit pénal des mineurs et fait respecter la primauté de l’éducation sur la sanction.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Maurey et Zocchetto, Mmes Gourault et Morin-Desailly, MM. Merceron, Amoudry et Biwer et Mme Férat, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Après les mots :
cinq ans d’emprisonnement
insérer les mots :
et qu’il a déjà été condamné au moins une fois pour des infractions similaires ou assimilées
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et qu’il a déjà été condamné au moins une fois pour des infractions similaires ou assimilées
La parole est à M. Yves Détraigne.

Nous n’avons pas voté les amendements de suppression, mais nous ne trouvons pas l’article 17 parfait pour autant.
Le présent amendement vise à ce que la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants ne soit pas applicable à un mineur primo-délinquant. Pour ce faire, le dispositif reprend une formulation identique à celle votée par le Sénat lors de l’examen de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ».
Comme je l’ai rappelé hier dans la discussion générale, je reste convaincu que le mécanisme qui nous est présenté n’est pas satisfaisant sur le fond, notamment au regard du principe du respect de la spécificité de la procédure pénale applicable aux mineurs, spécificité dont chacun convient qu’elle est nécessaire.
Cet amendement ne remet pas en cause le principe de la convocation du mineur par officier de police judiciaire. Il tend simplement à limiter son application à des mineurs qui ont déjà été condamnés au moins une fois pour des infractions « similaires ou assimilées ». Les autres, les primo-délinquants, doivent d’abord être déférés devant le juge des enfants, comme le prévoit la procédure actuelle. En effet, un mineur n’est pas un adulte en réduction, et il convient de le considérer différemment d’un adulte, surtout lors d’une première infraction.

Les auteurs de l’amendement souhaitent restreindre la possibilité de convoquer un mineur devant le tribunal pour enfants aux mineurs récidivistes.
Cet amendement va probablement trop loin. En effet, s’il n’est pas opportun d’utiliser cette procédure lorsque le mineur n’a jamais fait l’objet d’investigations approfondies sur sa personnalité, et le texte de la commission a clarifié les choses sur ce point, l’amendement interdirait d’y recourir, par exemple, lorsque le mineur a déjà fait l’objet de mesures éducatives ou qu’il a précédemment été condamné pour une infraction d’une autre nature.
Il nous semble que le critère essentiel permettant d’envisager le renvoi du mineur directement devant le tribunal pour enfants, sans passer par une phase d’instruction préalable devant le juge des enfants, est le caractère complet des informations dont la juridiction disposera, qui lui permettra de statuer en pleine connaissance de cause.
Je rappelle que seulement 1, 5 % des infractions commises par des mineurs le sont en état de récidive légale stricto sensu.
Pour cette raison, la commission a émis, dans sa majorité, un avis défavorable.
Si, sur d’autres amendements, l’avis du Gouvernement peut diverger de celui de la commission, sur cet amendement n° 151 rectifié, je dois suivre M. le rapporteur.
En exigeant que les mineurs aient déjà été condamnés pour des infractions « similaires ou assimilées », cet amendement réduit en effet considérablement le champ de la convocation par OPJ et ne prend pas en considération un phénomène que les praticiens connaissent bien, celui de ces adolescents qui, dans un bref laps de temps – quelques semaines, parfois deux ou trois mois –, commettent une série d’infractions souvent de plus en plus graves. Dans ces hypothèses, le recours à la convocation par OPJ est tout à fait pertinent, parce qu’il permet d’obtenir un jugement rapide en mesure de mettre fin à cette spirale de la délinquance avant qu’il ne soit trop tard.
Je demande donc à M. Yves Détraigne de bien vouloir retirer son amendement, au bénéfice des suivants.

M. Yves Détraigne. J’ai attentivement écouté la commission et le Gouvernement, et je suis prêt à retirer cet amendement, mais je n’oublierai pas que M. le ministre m’a invité à le faire « au bénéfice des suivants »…
Sourires

L'amendement n° 151 rectifié est retiré.
L'amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Maurey, Zocchetto et Merceron, Mmes Gourault et Morin-Desailly, M. Amoudry, Mme Férat, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l'objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance.
La parole est à M. Yves Détraigne.

Cet amendement, qui tend à prévoir que la procédure de convocation par officier de police judiciaire ne pourra être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de l’ordonnance de 1945, introduit un critère d’application sensiblement différent de celui que je proposais à l’amendement précédent, puisqu’il ne pose plus comme condition exclusive que le mineur ait « été déjà condamné au moins une fois pour des infractions similaires ou assimilées ».
Les délais de jugement étant malheureusement assez longs – ce ne sera peut-être plus le cas demain, monsieur le ministre, le raccourcissement de ces délais étant un des buts de la réforme –, il peut en effet arriver qu’un mineur soit déjà bien connu de la justice sans pour autant avoir encore été condamné.
Le critère proposé dans le présent amendement est donc plus large que celui de la condamnation, mais l’objectif est atteint, puisqu’il s’agit d’exclure de cette procédure un mineur qui ne serait pas encore connu par la justice.

La commission a souhaité, sur cet amendement, s’en remettre à l’avis du Gouvernement.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Sur cet amendement n° 154 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.
Exclamations.
Il apporte en effet une précision qui complète utilement le texte de la commission en même temps qu’une correction nécessaire dans le texte initial du Gouvernement, ce qui démontre, mesdames, messieurs les sénateurs, que je suis toujours réceptif aux débats constructifs menés avec votre assemblée.
Sourires
Grâce à cet amendement, la convocation par officier de police judiciaire ne sera jamais délivrée à un primo-délinquant. Pour autant, il sera possible de recourir à cette procédure à l’encontre de mineurs qui commettent des faits à répétition dans un bref laps de temps.
L'amendement est adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La convocation en justice ne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires ;
« 2° Le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance ;
« 3° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été accomplies ; ces investigations ne doivent pas dater de plus de douze mois ; elles peuvent avoir été réalisées soit sur le fondement de l’article 8, soit sur le fondement de l’article 12, y compris à l’occasion de la procédure en cours, soit, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal pour enfants peut, d’office ou à la demande d’une des parties, s’il estime que des investigations sur les faits sont nécessaires ou que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, en décidant de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d’information ou d’ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Du fait de l’adoption de l’amendement n° 154 rectifié, la première partie l’amendement n° 156 est satisfaite.
La seconde partie est, quant à elle, relative au recueil de renseignements socio-éducatifs.
En l’état de la discussion, il me semble préférable de retirer cet amendement.

L'amendement n° 156 est retiré.
L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Maurey et Zocchetto, Mmes Gourault et Morin-Desailly, MM. Merceron, Amoudry et Biwer et Mme Férat, est ainsi libellé :
Alinéa 5
remplacer les mots :
douze mois
par les mots :
six mois
La parole est à M. Yves Détraigne.

L’article 17 du projet de loi prévoit que la convocation par OPJ « ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents ».
L’amendement n° 150 rectifié s’attache à cette condition des « douze mois précédents ». Il a pour objet d’assurer le caractère suffisamment récent des informations relatives à la personnalité du mineur, laquelle peut être très évolutive. Rappelons que c’est précisément ce qui justifie l’usage de cette procédure, qui reste dérogatoire s’agissant de mineurs.
Le projet de loi ouvre la possibilité de prendre en compte des informations sur le mineur qui peuvent remonter à près d’un an, alors que la situation du jeune aura pu largement évoluer dans un tel délai, négativement aussi bien que positivement.
Aussi le présent amendement vise-t-il à réduire le délai de douze mois à six mois. Il nous semble en effet normal et efficace que le tribunal puisse être en mesure d’utiliser les informations réunies sur le mineur au cours des procédures précédentes, surtout avec le dossier unique de personnalité, qui donnera une vision plus complète de cette dernière, mais il est indispensable que les informations trop anciennes et potentiellement obsolètes parce que ne prenant pas en considération les évolutions récentes soient écartées.
Exiger que les informations sur le mineur soient récentes permet justement de s’assurer d’un passage devant le juge des enfants lorsque ce sera nécessaire.

L'amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Maurey et Zocchetto, Mmes Gourault et Morin-Desailly, MM. Amoudry, Merceron et Biwer, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
de l'article 8
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Yves Détraigne.

Dans le même ordre d’idées, cet amendement vise à garantir que les informations relatives à la personnalité du mineur sont limitées à celles qui proviennent de la sphère pénale.
En effet, la fin de l’alinéa 5 de l’article 17 prévoit la possibilité de prendre en compte des investigations réalisées par un juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. Or cette dernière mission relève du domaine civil, et non du domaine pénal, raison pour laquelle nous proposons la suppression de la fin de l’alinéa.

En exigeant des investigations réalisées au cours des six mois précédents, au lieu des douze mois actuellement prévus par le projet de loi, nos collègues proposent d’introduire une condition plus restrictive pour recourir à la convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants que pour recourir à la procédure de présentation immédiate, alors que la première, qui ne prévoit ni le placement sous contrôle judiciaire ni le placement en détention provisoire du mineur en attendant l’audience de jugement, est une procédure moins restrictive de liberté que la seconde.
La distorsion ne paraît pas justifiée à la commission, d’autant que, s’agissant de la présentation immédiate, le Conseil constitutionnel a validé le délai d’un an.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 150 rectifié.
Sur l’amendement n° 153 rectifié, elle s’en remettra à l’avis du Gouvernement.
S’agissant de l’amendement n° 150 rectifié, le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Un délai de six mois serait trop court au regard du temps judiciaire et le Conseil constitutionnel vient en effet de valider le délai d’un an dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. De plus, le recueil des renseignements socio-éducatifs, qui est actualisé en permanence, fournira si nécessaire les derniers renseignements sur les éléments de personnalité du mineur. J’invite donc M. Détraigne à retirer cet amendement.
Le Gouvernement est en revanche favorable à l’amendement n° 153 rectifié.

Compte tenu des indications qui viennent d’être données et de la position du Conseil constitutionnel, je le retire, madame la présidente.

L'amendement n° 150 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 153 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
Après l’article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Du tribunal correctionnel pour mineurs
« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.
« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.
« Les dispositions du chapitre III relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs, à l’exception de l’article 22. Toutefois, en ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.
« Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.
« Art. 24-2. –
Non modifié
« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ;
« 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8-3 ;
« 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14-2, à l’exception du VI. Les attributions confiées au tribunal des enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.
« Art. 24-3. – §(Non modifié) Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est consulté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12, avant toute décision du tribunal correctionnel pour mineurs saisi selon les modalités prévues à l’article 24-2.
« Art. 24-4. – §(Non modifié) Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.
« Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.
« Art. 24-5. – §(Non modifié) Pour les délits mentionnés à l’article 399-2 du code de procédure pénale le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 399-1 du même code. »

Cet article 29 signe la volonté de déstructuration de la justice des mineurs.
Étant déjà intervenue, je n’ai pas pu leur répondre tout à l’heure, mais d’aucuns se sont référés à l’ordonnance de 1945 d’une façon que je ne peux pas approuver et qui prêterait à rire si ce n’était à pleurer.
Certes, tout a changé depuis – notamment la taille des jeunes – et, nous-mêmes, législateurs, nous ne sommes pas les législateurs d’alors, mais ceux qui insistent sur le fait que nous ne sommes plus en 1945 devraient s’interroger : peut-être la France était-elle alors en avance par rapport à d’autres pays ? Depuis lors, en effet, et souvent bien après 1945, de nombreuses recommandations ou dispositions allant dans le même sens que cette ordonnance ont été arrêtées à l’échelle internationale, par exemple la convention relative aux droits de l’enfant ou encore les règles de Pékin.
L’année 2011 est décidément bien mauvaise pour la protection des mineurs en France ! Nous avions déjà trouvé le moyen de supprimer le Défenseur des enfants, institution dont la convention relative aux droits de l’enfant, justement, recommande la mise en place et qui se développe dans de nombreux pays. Aujourd'hui, c’est à la « casse » de la justice des mineurs et à la disparition de ses spécificités que l’on s’attelle, à rebours de ceux que font nos voisins, puisque la tendance chez certains, pourtant confrontés à des problèmes comparables, est plutôt à l’élargissement aux jeunes majeurs des procédures propres aux mineurs.
L’UNICEF, on le sait, a manifesté son opposition au présent projet de loi. Vérifions, mes chers collègues, si les recommandations de cette organisation, que l’on ne peut qualifier de politique, ont été suivies.
« Éviter une stigmatisation des jeunes » ?... Raté !

Il faut dire que, depuis cinq ans, le Gouvernement et sa majorité ne cessent de montrer du doigt les jeunes, et même les tout jeunes, dès l’âge de trois ans !
« Préférer le terme “enfant” à celui de “mineur” » ?... Raté !
« Considérer les mineurs “dangereux” d’abord comme des enfants en danger » ?... Raté !
« Défendre les grands principes de l’ordonnance » et, surtout, « préserver son esprit » ?... Raté !
Même si vous prétendez conserver à la justice des mineurs ses spécificités, monsieur le ministre, comment pouvez-vous en préserver l’esprit dès lors que vous vous éloignez des principes qui la fondent en cassant l’unité entre le juge des enfants et le tribunal pour enfants et en créant, en plus, un tribunal correctionnel pour mineurs semblable au tribunal correctionnel des majeurs ?
« Fixer l’âge de la responsabilité pénale au-dessus du seuil de l’inacceptable » ?... Raté ! La majorité des pays européens ont fixé l’âge de la responsabilité pénale à quatorze ans ou plus.
« Défendre une justice spécialisée jusqu’à 18 ans » ?... Raté ! Vous vous apprêtez à retourner au droit commun, donc non spécifique, à partir de l’âge de seize ans.
« Déployer les moyens nécessaires » ?... Raté ! Il suffit de voir la misère à laquelle est confrontée la PJJ, par exemple, mais nous aurons l’occasion de reparler de cette question.
« Soutenir les parents plutôt que les accabler » ? … Raté ! Vous faites même tout le contraire ! On n’arrête pas de les culpabiliser ! Et certains s’insurgent même contre ceux qui vivent de l’assistance…
« Enfin, instaurer une politique volontaire de prévention de la jeunesse » ?... Raté ! La prévention, ça suffit, nous répondez-vous, il est temps de passer à la sanction !
Tout cela est bien dommage, d’autant que la France a été l’initiatrice, en quelque sorte, de principes ô combien généreux pour la jeunesse, qui ont été, au fil du temps, repris au niveau international, et il reste encore beaucoup à faire en la matière. Mais nous, enfin, vous, devrais-je dire, vous faites marche arrière !
Vous avez voulu une fois encore nous prouver que vous étiez « dans les clous ». Mais non ! Le Conseil constitutionnel s’est prononcé tant sur la procédure que sur les tribunaux, et vous modifiez la procédure s’agissant de la justice des mineurs, en la rapprochant de celle des majeurs ; si vous gardez le tribunal pour enfants – vous ne pouviez tout de même pas le rayer de la carte des tribunaux ! –, vous lui ajoutez un tribunal correctionnel pour mineurs, compétent pour juger les infractions commises par les mineurs récidivistes âgés de plus de seize ans.
Ce tribunal correctionnel pour mineurs sera donc amené à juger de très nombreux jeunes, mais cette justice des mineurs-là ressemblera à s’y méprendre à la justice des majeurs !

L’article 29 prévoit de créer une nouvelle juridiction spécialisée, compétente pour juger les mineurs récidivistes de plus de seize ans. Juridiction spécialisée ? On devrait bien plutôt parler de juridiction d’exception !
Vous reprenez ici, une nouvelle fois, l’une des propositions issues du rapport Varinard. Cette nouvelle juridiction, réservée aux jeunes récidivistes âgés de seize à dix-huit ans, place le juge des enfants en minorité dans cette nouvelle formation où les juges issus du tribunal correctionnel seront dès lors majoritaires !
Cet article constitue, à nos yeux, une nouvelle manifestation de défiance du Gouvernement à l’encontre du juge des enfants, soupçonné, à tort, de laxisme dans le traitement de ses dossiers ! Ces mesures accablent évidemment également les assesseurs qui accompagnent le juge des enfants…
Le fait que le juge des enfants préside cette nouvelle formation n’est qu’un leurre et ne suffit pas à remédier aux lacunes évidentes ni à la dangerosité d’une telle disposition.
Il s’agit là d’une atteinte inconstitutionnelle au principe de la juridiction spécialisée et, par ailleurs, d’une dévalorisation du travail pédagogique réalisé par le juge des enfants.
Une fois de plus, on tend ici à traiter les mineurs comme des adultes délinquants, en les faisant passer devant une juridiction semblable à celle des majeurs, comme si cela allait suffire à les dissuader, à terme, de récidiver encore ! Il n’en sera rien ! Cette disposition ne tient absolument pas compte de la complexité des situations de délinquance juvénile.
À cet égard, je rappelle les exigences de l’article 1er de l’ordonnance de 1945 : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs. »
La composition de ces nouveaux tribunaux correctionnels pour mineurs, dont vous tentez en vain de nous chanter les louanges, monsieur le garde des sceaux, ne garantit donc en rien la spécialisation de la justice des mineurs, puisqu’un seul juge des enfants est appelé à y siéger aux côtés de deux magistrats qui, eux, ne seront pas spécialisés. Mais il y a pire encore, avec l’expérimentation qui sera faite, dès le 1er janvier 2012, dans des cours d’appel, où deux citoyens assesseurs accompagneront les trois magistrats dans ces tribunaux correctionnels pour mineurs, à l’instar du tribunal correctionnel pour majeurs !
Monsieur le garde des sceaux, aux assesseurs choisis pour « l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et pour leurs compétences », vous préférez deux jurés populaires formés à la va-vite et dont on n’exige pas qu’ils portent un quelconque intérêt à la problématique spécifique des mineurs !
L’article 29 est malheureusement une nouvelle illustration de l’idée reçue, sans cesse rebattue par le Gouvernement, mais dénoncée à maintes reprises au cours de la discussion générale, selon laquelle les mineurs d’aujourd’hui ne seraient pas ceux d’hier.
Il est éminemment regrettable que ce poncif erroné ait guidé la rédaction de cet article, ainsi d’ailleurs que celle de l’ensemble du titre II de ce projet de loi.
Pour toutes ces raisons, nous voterons massivement contre l’article 29.

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 88 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 41.

L’article 29 est important en ce qu’il vise à créer les fameux tribunaux correctionnels pour mineurs, auxquels nous sommes opposés.
Tout d’abord, permettez-moi de revenir à la raison pour laquelle ces tribunaux ont été créés.
J’ai lu le rapport de notre collègue Jean-René Lecerf, ainsi que l’étude d’impact du Gouvernement. Comme l’a indiqué tout à l'heure notre collègue Virginie Klès, aucun élément statistique ne nous permet de considérer que l’évolution de la délinquance des mineurs est aujourd'hui telle que nous devons prendre des mesures nouvelles pour l’enrayer. Nous savons – il n’y a là aucune originalité ! – que la délinquance des mineurs progresse à un niveau sensiblement identique à celle des majeurs.
Selon nous, ce tribunal présente trois défauts majeurs.
Tout d’abord, le tribunal correctionnel pour mineurs est la négation de la spécificité du mineur dans l’essentiel de ses caractéristiques. En effet, les assesseurs devaient avoir, hier, une qualification et manifester un intérêt précis pour les questions relatives à la jeunesse. Or tel ne sera plus du tout le cas demain ! Vous faites donc disparaître cette spécificité.
Certains, sur d’autres travées, reprennent toujours la même antienne : les jeunes d’aujourd'hui ne sont plus comme ceux d’hier ! Permettez-moi de vous faire observer, chers collègues, que vous êtes peut-être les seuls en Europe à le penser !
Pour avoir lu l’intéressante note de synthèse disponible sur le site du Sénat relative à la législation européenne en la matière, je puis vous dire que le droit des mineurs est applicable en Allemagne aux jeunes âgés de dix-huit à vingt et un ans, et que ce pays n’est pas le seul à avoir opté pour cette solution. Il en va de même au Portugal, aux Pays-Bas et même en Espagne, qui souhaite relever de seize ans actuellement à dix-huit ans le seuil pour certain régime applicable aux mineurs.
On le voit donc, la plupart des pays européens considèrent, certes, que le jeune d’aujourd'hui n’est pas le même que celui de 1945, mais qu’il faut justement conserver les prérogatives que l’on accorde en quelque sorte à la jeunesse au-delà de l’âge de dix-huit ans, jusqu’à vingt et un ans.
Ne sommes-nous pas tous européens, monsieur le garde des sceaux ?... Eh bien, tirons-en les enseignements et essayons d’aligner notre législation sur celle des autres pays européens !
Ensuite, nous déplorons l’automaticité du renvoi des mineurs récidivistes.
La notion de récidive fait évidemment peur, mais que veut-elle dire ? Le mineur qui a, un jour, volé des bonbons à l’étal d’un commerçant et qui, demain, sera convaincu de recel de DVD, par exemple, sera en état de récidive et comparaîtra, de ce fait, directement devant le tribunal correctionnel pour mineurs….
Enfin, avec ce texte, on ne change pas simplement de tribunal, non, on change complètement d’approche, pour s’orienter vers une justice des mineurs conforme à celle des majeurs.
Rien de tout cela ne saurait nous convenir, monsieur le garde des sceaux.

Cet article est certes important, mais il est surtout redoutable. En effet, n’en déplaise à certains de nos collègues, il réduit à néant les principes essentiels de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante.
Aujourd'hui, le Gouvernement fait fi du principe constitutionnel de spécialisation de la justice des mineurs dans la mesure où le tribunal correctionnel pour mineurs est, en réalité, en tout point identique à celui des majeurs.
Or le principe de spécialisation de la justice des mineurs n’est pas seulement garanti par la Constitution, il l’est aussi, comme l’a rappelé notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, par un certain nombre de textes internationaux. Il faut citer l’article 40 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que par les règles de Pékin sur le traitement des mineurs délinquants, qui garantissent les droits de l’enfant et qui ont été adoptées par les Nations unies.
Pour avoir beaucoup travaillé sur cette question, je rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011, a invalidé plusieurs dispositions relatives à la justice des mineurs insérées dans la LOPPSI 2, rappelant la nécessité de respecter la spécialisation de la justice des mineurs.
Tentant de vous prémunir contre les critiques d’inconstitutionnalité que l’on ne manquera de formuler contre votre texte, et pour cause, vous prévoyez ici une prétendue procédure spécifique qui se résume, en fait, à la seule présidence de ce tribunal par le juge des enfants, aux côtés de deux magistrats non spécialisés, alors que l’on sait parfaitement que le président ne dispose d’aucun pouvoir particulier.
Cette disposition témoigne d’une ignorance totale : la spécificité de la justice des mineurs ne tient pas à la seule présence du juge des enfants. Elle n’est spécialisée que si le mineur est soumis, dès sa prise en charge, durant le jugement et jusqu’au prononcé de la peine, à une procédure spécifique, par une institution consacrée, et avec des mesures adaptées. C’est seulement ainsi que tout le processus fait sens !
Cet article nie donc le travail pédagogique du juge des enfants, et dénigre la phase présentencielle, dont l’importance est primordiale pour l’appréhension et la compréhension par le mineur du jugement et de la peine. Il porte en lui la fin de la justice pour des mineurs qui « ne sont plus les mêmes qu’hier » ; il instaure une marginalisation des tribunaux pour enfants.
Enfin, ce tribunal correctionnel pour mineurs est d’une incohérence totale : il pourra être composé de citoyens assesseurs non spécialisés, alors que siègent aujourd’hui, au sein du tribunal pour enfants, deux assesseurs choisis pour l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et pour leurs compétences en la matière !

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié.

L’article 29 constitue l’un des points forts de ce texte, avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs.
Si l’on en croit l’exposé des motifs, cette création est justifiée par la volonté de « faire comprendre aux intéressés la nécessité de sortir de l’engrenage de la délinquance ».
Passons sur l’angélisme et voyons le postulat : il faut réprimer !
Pour notre part, nous estimons que cet article ouvre une nouvelle brèche dans la spécificité du droit pénal des mineurs. L’oralité des débats, y compris en séance publique dans cette enceinte, c’est bien, mais il est toujours fort intéressant de lire, et de lire en particulier l’étude d’impact d’un projet de loi, où figure, très objectivement exposé, ce que le Gouvernement entend faire.
Or à la page 83 de l’étude d’impact du présent texte, on peut lire, monsieur le garde des sceaux, que la création d’un tribunal correctionnel pour mineurs « résulte d’une préconisation de la commission de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 présidée par le recteur Varinard ». Pour expliquer votre objectif, vous poursuivez en ces termes : « à la progressivité des sanctions doit correspondre une même progression dans les formations de jugement compétentes pour connaître des mineurs jusqu’à afficher une plus grande sévérité avec la comparution du mineur devant un tribunal correctionnel, dont la charge symbolique et la solennité apparaissent nécessairement plus fortes. »
Selon vous, cette option est la seule envisageable au regard du principe de spécialisation des juridictions des mineurs. « Aussi […], la composition de la juridiction de droit commun a été adaptée afin de prévoir la présence d’au moins un juge des enfants. »
« Le renvoi de certains mineurs devant cette juridiction présente l’avantage de permettre dans ces cas de juger également les coauteurs et complices majeurs. ». Là encore, c’est tout à fait révélateur !
Le dernier paragraphe se termine de la façon suivante : « Il paraissait donc assez justifié que ces mineurs, qui peuvent se voir infliger des peines suivant le régime applicable aux majeurs, comparaissent également devant une juridiction propre aux majeurs. ».
Les mineurs de plus de seize ans ont une situation particulière dans notre ordre juridique. En effet, pour eux, l’excuse de minorité peut être écartée à titre exceptionnel. Mais on vous fait confiance pour que, dérive aidant, l’exceptionnel devienne l’habituel !
Aux pages 83 et 84 de l’étude d’impact, on trouve donc la caractérisation des objectifs réels qui sont les vôtres, puisque c’est vous qui les avez écrites.
Voilà la réalité !
Le tribunal correctionnel pour mineurs ne comptera donc qu’un seul juge des enfants, les deux juges qui étaient des personnes d’expérience dans le domaine des enfants étant remplacés par deux juges professionnels. Mais on comprend mal l’objectif. Dans certains cas, vous ajoutez deux citoyens assesseurs qui, eux, sauf cas exceptionnel, n’auront bien évidemment strictement aucune compétence particulière dans ce domaine particulier !
Pour couronner le tout, le douzième alinéa de l’article 29 précise : « Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est consulté ». Malheureusement, nous connaissons l’état de la protection judiciaire de la jeunesse et le grand manque de moyens qui la caractérise aujourd’hui !

L’article 29 crée une nouvelle juridiction spécialisée, le tribunal correctionnel pour mineurs, compétente pour juger les mineurs récidivistes âgés de plus de seize ans.
L’objectif est de montrer de façon plus solennelle à des mineurs ancrés dans la délinquance la nécessité de sortir de cette spirale et d’engager une démarche de réinsertion.
Quels sont-ils, ces mineurs ancrés dans la délinquance ?
Même si les chiffres ne sont pas parfaitement exacts, il est néanmoins intéressant d’en citer quelques-uns.
Actuellement, 200 000 mineurs sont mis en cause chaque année par les services de police et de gendarmerie. Plus de la moitié d’entre eux, vraisemblablement entre 54 % et 55 %, font l’objet de mesures alternatives aux poursuites ; 75 000 sont renvoyés devant la justice des mineurs, qu’il s’agisse du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou, pour un petit nombre d’entre eux, de la cour d’assises des mineurs. Enfin, 30 000 font l’objet de condamnations par le tribunal pour enfants ou, encore une fois pour un petit nombre d’entre eux, par la cour d’assises des mineurs.
Sont donc susceptibles d’être concernés par la création de ce tribunal correctionnel pour mineurs entre 600 et 700 mineurs, soit une petite partie des 5 % de mineurs délinquants qui, à eux seuls, réalisent plus de 50 % des infractions commises par les mineurs.
Les dispositions créant cette nouvelle juridiction respectent pleinement les principes constitutionnels qui fondent le droit pénal des mineurs : publicité restreinte des débats, primauté des mesures éducatives sur les sanctions et les peines, présidence de la juridiction par un juge des enfants, ainsi que l’a souhaité la commission des lois.
J’attire votre attention sur le fait que, comme la cour d’assises des mineurs, et à la différence du tribunal pour enfants, cette nouvelle juridiction sera compétente pour juger les coauteurs ou complices majeurs du mineur poursuivi pour des faits commis en état de récidive légale.
Cette possibilité pourrait notamment être utile dans le jugement de délits impliquant des « bandes » composées à la fois de mineurs et de majeurs. Dans ce cas, en effet, l’ensemble de l’affaire pourrait être jugée par la même juridiction, sans qu’il soit nécessaire de disjoindre les procédures. Cette disposition constitue incontestablement une mesure de bonne administration de la justice.
Aussi la commission est-elle défavorable à ces amendements identiques de suppression.
Très naturellement, je suis, comme le rapporteur, défavorable aux amendements de suppression. Mais permettez-moi de compléter son propos.
Puisque chacun se réfère, pour ses citations, à des ouvrages particuliers, mon texte de référence sera l’ordonnance du 2 février 1945. Il faut bien que j’en aie un moi aussi !
Sourires
Un certain nombre de mesures paraîtraient un peu sévères aujourd’hui ; c’est normal, car on n’est plus en 1945 et les choses ont changé. Mais la question est de savoir si mes propositions sont ou non en contradiction avec les principes contenus dans ce texte et qui ont été rappelés par le Conseil constitutionnel dans les deux décisions déjà citées à plusieurs reprises.
Voyons ce qu’il en est de ce tribunal correctionnel pour mineurs que vous avez couvert d’opprobre.
Je vous rappelle l’article 1er de l’ordonnance de 1945 : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit [...] ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs. » Vous remarquerez qu’il est question non du tribunal pour enfants mais des tribunaux pour enfants, c'est-à-dire de tribunaux spécialement composés pour juger des enfants, ce qu’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2002.
Or le tribunal correctionnel pour mineurs est un tribunal spécialement constitué pour juger les enfants ; il faut en avoir pleinement conscience. Le texte qui vous est proposé répond donc parfaitement à la définition de l’ordonnance de 1945.
Voyons maintenant le dispositif sous l’angle de la présence de magistrats professionnels.
Il n’est visiblement pas facile de rester toujours sur la même ligne, mesdames, messieurs les sénateurs ! Depuis deux jours, en effet, on m’explique que la présence de magistrats professionnels est absolument indispensable et qu’elle conditionne la bonne marche de la justice.
Le tribunal pour enfants de 1945 comportait un seul magistrat professionnel : le président. La commission propose que le tribunal correctionnel pour mineurs soit présidé par un juge des enfants.
Au sein du tribunal de 1945 siégeaient deux assesseurs nommés par le ministre de la justice. On vous propose aujourd’hui qu’il y ait deux magistrats professionnels aux côtés du juge des enfants.
Vous ne cessez de m’expliquer que ce tribunal correctionnel pour mineurs est une affreuse régression et que je mets à bas les grands principes. C’est totalement faux, car là où il n’y avait qu’un magistrat professionnel, il y en aura désormais trois. La vérité est donc que nous renforçons la présence des magistrats professionnels au sein du tribunal correctionnel pour mineurs.
Il est tout à fait normal que vous ne soyez pas d’accord et je ne critiquerai personne de ce point de vue, mais soyez cohérents ! Si vous pensez qu’il ne faut pas trop de magistrats professionnels pour juger les enfants, c’est le moment de le dire. Nous, nous pensons qu’il en faut. Je comprends parfaitement la position contraire de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est son choix et il est différent du nôtre.
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.
Le tribunal correctionnel pour mineurs est parfaitement conforme non seulement à l’article 1er de l’ordonnance de 1945, car il est spécifique, mais aussi à la décision du Conseil constitutionnel de 2002.
De plus, nous ne changeons pas la procédure d’un iota !
Encore une fois, j’admets tout à fait que l’on soit contre, mais je n’accepte pas que l’on tente d’accréditer le contraire de ce qui est la réalité. La procédure spéciale, celle du tribunal pour enfants, est maintenue. Là encore, nous sommes en conformité avec les principes de l’ordonnance de 1945 et la décision du Conseil constitutionnel.
Je tiens d’ailleurs à la disposition de tout un chacun cet exemplaire du texte initial de l’ordonnance que j’ai fait chercher, car il est toujours intéressant de se référer au texte lui-même plutôt qu’à l’idée que l’on s’en fait !

Monsieur le ministre, je me référais au projet de loi. C’est également une excellente lecture !
Vous aviez tout à l’heure une lecture d’un texte datant de 1809 qui n’était pas mal…

Je crois que vous feriez bien de vous en inspirer plus souvent ! Il y aurait là une vraie cohérence, monsieur le ministre !
Vous ne nous expliquez pas en quoi vos propositions constituent un progrès. Peut-être n’avons-nous pas les mêmes capacités intellectuelles que vous, ...

... mais je vous avoue que nous n’avons pas encore compris l’intérêt de ce changement.
Le tribunal pour enfants était composé d’un magistrat professionnel, juge des enfants, assisté de deux assesseurs choisis en fonction de leurs compétences et de leur intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous ne nous avez pas dit que le système fonctionnait mal et qu’il convenait donc d’en changer. C’est un discours que nous aurions pu entendre s’il était véritablement fondé sur des éléments concrets démontrant que, effectivement, ces juridictions ne donnaient pas de bons résultats, qu’elles étaient trop lentes, que les jugements n’étaient pas assez sévères.

Je reprends le rapport. Il ne date pas de 1809, monsieur le garde des sceaux, …
Il n’y avait pas de tribunal pour enfants !

… et sa rédaction est bien plus lourde !
On lit ceci à la page 130 : « Elles s’inscrivent par ailleurs dans le prolongement de l’adoption d’une série de dispositions tendant à rapprocher le droit pénal applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans de celui applicable aux majeurs : placement sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions que les majeurs, possibilité – dans certains cas – de faire l’objet de gardes à vue dans le cadre des régimes dérogatoires, possibilité de déroger à la règle de l’atténuation de responsabilité ».
Je m’arrête là, mais voilà la vérité, monsieur le garde des sceaux ! §C’est bien écrit dans le rapport et je fais confiance au rapporteur.

Permettez-moi de revenir sur un argument que nous avons souvent entendu depuis le début du débat : les enfants d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux de 1945. Certes, ils ne sont pas les mêmes, et heureusement ! Ils ne vivent pas dans le même milieu, ni dans le même environnement.
En 1945, on sortait de la guerre. Aujourd’hui, on vit dans la société de consommation, dans la culture de l’immédiateté. Alors, évidemment, les enfants d’aujourd’hui sont différents de ceux d’hier !
Pour autant, ils se construisent de la même façon, avec les valeurs d’exemplarité que leur donnent leur famille et la société. Ils passent toujours de l’enfance à une longue période d’adolescence. Ils ne sont pas, d’un seul coup, par miracle ou par je ne sais quelle mutation génétique, devenus des espèces de zombies, enfants jusqu’à treize ans et tout à coup adultes à seize ans, en tout cas adultes responsables de leurs actes devant la loi et devant la justice.
Un autre argument m’a fait sursauter : aujourd’hui, les enfants seraient adultes beaucoup plus tôt du fait que, sur le plan physique, ils sont aussi formés plus tôt. Je crois rêver ! On n’est pas adulte uniquement en raison de sa maturité physique. Il faut aussi l’être dans sa tête, dans ses actes, avoir atteint une certaine maturité intellectuelle pour devenir responsable !
Je conclus de ce raisonnement qu’une gamine réglée à dix ans, et donc capable de devenir mère, est adulte à cet âge ! Il y a bien là un critère physique, et il est vrai qu’aujourd’hui les jeunes filles sont, en moyenne, réglées de plus en plus tôt.
Eh bien, non ! Les enfants ne sont pas adultes plus tôt. Au contraire, ils sont adultes beaucoup plus tard qu’en 1945, en raison de l’environnement qui est le leur et de la société dans laquelle ils vivent aujourd’hui.
Outre l’argumentation de notre collègue Mézard, je constate aussi que le tribunal correctionnel pour mineurs est destiné aux cas un peu plus difficiles, ...

... et pour lesquels on n’est pas parvenu à trouver de bonne réponse.
Et que fait-on pour améliorer la situation ? On remplace les assesseurs qui, sur le plan professionnel, exerçaient des responsabilités dans le monde de l’enfance, dans le monde de l’éducation, bref des personnes qui connaissaient ces milieux-là, par des assesseurs tirés au sort qui n’ont absolument aucune compétence en la matière !
On affaiblit donc la structure qui, placée en face de l’enfant, est destinée à le juger et à l’amener à prendre ses responsabilités.
On a évoqué une plus grande solennité du jugement. Pour ma part, je ne vois pas ce que ce tribunal correctionnel pour mineurs apportera en termes de « solennité » ou de « mieux », pour reprendre les termes de notre collègue Jacques Mézard.

Monsieur le garde des sceaux, vos propos soulèvent un certain nombre de questions. Vous nous dites en effet que vous n’aviez aucune raison, au fond, de créer ce tribunal correctionnel pour mineurs, qui serait, selon vous, en tout point conforme au tribunal pour enfants.
Il est conforme ; il n’est pas identique !

À moins d’être atteints de surdité, nous ne pouvons pas faire abstraction de toutes les raisons invoquées pour justifier les coups de canif qui ont déjà été portés à la justice des mineurs. Je pense notamment aux comparutions de plus en plus rapides et à l’assimilation des récidivistes mineurs aux récidivistes majeurs.
Nous avons tous compris que vous vouliez rapprocher la justice des mineurs de celle des majeurs, les raisons invoquées tenant notamment à la lenteur de la première. Mais n’est-ce pas la conséquence nécessaire de la spécificité de la justice des mineurs ? Et certaines procédures concernant des majeurs peuvent être fort longues aussi…
Il faudrait en outre poser le problème des moyens consacrés à la mise en œuvre de la palette des mesures disponibles. Je rappelle en effet que la réponse pénale est sinon toujours plus rapide en tout cas plus nombreuse s’agissant des mineurs.
Nous avons même entendu des propos fort peu agréables concernant les magistrats spécialisés dans la justice des mineurs. Il avait même été dit que l’un des juges des enfants de Bobigny – tout le monde le connaît - était appelé « le père Noël » par les délinquants eux-mêmes !
Il s’agit d’un très bon magistrat, qui fait un excellent travail !

Certes ! Quoi qu’il en soit, cela fait dix ans que nous entendons en permanence ce discours.
Vous essayez, au fond, de disqualifier les juges des enfants. Pourtant, leur mission est loin d’être aisée, compte tenu des moyens dont ils disposent, non seulement pour prendre des mesures, mais surtout pour que celles-ci soient suivies d’effet.
Telle est donc votre position sur ce sujet. Pour notre part, nous pensons que vous avez tort. Et n’essayez pas de nous faire admettre – ce serait d’ailleurs illogique – que vous voulez améliorer la justice pour mineurs en cassant son unité et en essayant de la rapprocher un peu plus de celle des majeurs. Dites-nous la vérité sur vos intentions ! Ne nous prenez pas pour des amnésiques ou, pire encore, pour des idiots !
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 29 est adopté.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après les mots : « tribunaux pour enfants », sont insérés les mots : «, des tribunaux correctionnels pour mineurs ».

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 59 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
L'amendement n° 130 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l’amendement n° 21.

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. » Ainsi commence l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945.
Avec ce projet de loi, nous sommes très loin de cette préoccupation et de cette volonté de protection des mineurs, ce qui soulève bien entendu de nombreuses questions de notre part : quel est le sens de ce nouveau texte relatif à la justice des mineurs ? À quelle urgence répond-il ? Pourquoi ne pas attendre le projet de code de la justice pénale des mineurs ?
Sur la forme, rien ne justifie une telle précipitation, alors qu’un code de la justice pénale des mineurs est en cours d’élaboration à la Chancellerie. Cette surenchère législative résonne comme un aveu d’impuissance des pouvoirs publics à apporter des réponses adaptées à la délinquance juvénile et remet en cause l’efficacité des dernières réformes. Ce texte tend à introduire un certain désordre au sein de l’ordonnance du 2 février 1945, toujours en vigueur et retouchée à maintes reprises, je le disais tout à l’heure.
Sur le fond, il porte atteinte à cette ordonnance, témoigne d’un dangereux glissement de la justice des mineurs vers celle des adultes et stigmatise le juge des enfants, considéré comme trop laxiste, alors que le taux de réponse pénale de la justice des mineurs est de 92, 9 %, donc supérieur à celui qui concerne les majeurs, qui n’atteint que 87, 7 %.
Pour autant, la délinquance des mineurs semble s’intensifier depuis 2002, en dépit du durcissement des mesures provisoires et des peines pouvant être prononcées à l’encontre des mineurs. Elle a connu une hausse de 7, 94 %, alors que celle des majeurs a augmenté de 12, 04 %. Plusieurs fois, ce différentiel a été évoqué au cours de la discussion : il était important de citer les chiffres exacts !
Alors que nous nous écartons de la philosophie de l’ordonnance de 1945, les autres pays européens, eux – je le disais tout à l’heure –, s’en inspirent. L’Espagne comme l’Allemagne prévoient même de juger les 18-21 ans selon les règles de la justice des mineurs ! Notre collègue Alain Anziani a tout à l’heure fait référence à d’autres pays qui s’engagent sur la même voie.
Le projet de loi reprend, en les toilettant superficiellement, certaines des dispositions de la loi dite « LOPPSI 2 » qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Il vise à instaurer un tribunal correctionnel pour mineurs, pourtant écarté, après arbitrage du Gouvernement, du projet de nouveau code de justice pénale des mineurs. D’autres mesures relèvent d’a priori non vérifiés et ne reposent sur aucune analyse des besoins, aucune évaluation des dernières réformes adoptées.
En vidant de leur sens les principes de priorité éducative et de spécialisation de la procédure applicable aux mineurs, ce projet de loi achève la déconstruction de l’ordonnance de 1945 et la consécration d’une justice des mineurs ne s’intéressant plus qu’aux actes commis et non à l’évolution d’une personnalité en construction.
Une fois de plus, la réforme de la justice des mineurs est utilisée comme un moyen de communication politique partisan, sans aucune volonté de dessiner un projet ambitieux pour l’enfance en difficulté.

Nous estimons, et ce pour plusieurs raisons, que la présence du juge des enfants au sein de la formation du nouveau tribunal correctionnel pour mineurs n’est qu’un écran de fumée.
Tout d’abord, la spécialisation du juge des enfants tient à la spécificité de son mode d’intervention. Dès lors, sa seule présence ne garantit absolument pas la spécialisation du tribunal. Par ailleurs, le fait qu’il soit président de la formation de jugement ne constitue nullement une garantie, puisqu’il ne disposera pas d’une voix prépondérante.
De plus, les magistrats effectuent un roulement dans le cadre d’un tour de service. Un juge des enfants peut, en tout état de cause, se retrouver, s’il est sollicité, dans n’importe quelle formation de jugement, ce qui n’a jamais suffi à emporter spécialisation du tribunal.
Le tribunal correctionnel pour mineurs ne répond donc pas à l’exigence constitutionnelle de composition spécifique du tribunal en matière de justice des mineurs.
De plus, l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, dont notre pays, je vous le rappelle, mes chers collègues, est signataire, précise que, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Cet intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil constitutionnel l’a pris en compte pour rendre sa décision du 10 mars 2011, dans laquelle il s’est opposé, entre autres choses, à l’application aux mineurs de peines planchers, « considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du XXe siècle. »
Par ailleurs, le Conseil d’État a récemment admis l’application directe des dispositions ne nécessitant aucun aménagement de notre droit, ce qu’il a confirmé dans un arrêt du 26 juin 2008, Mme Fatima E. contre le ministère des affaires étrangères et européennes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous voyons que l’institution de ce tribunal correctionnel pour mineurs contrevient non seulement à la Constitution, mais aussi à nos engagements internationaux. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 130 rectifié.

Je considère que cet amendement a été défendu, après les très pertinentes observations que j’ai eu l’honneur de développer devant le Sénat sur l’article 29 !

Nous avions demandé à examiner par priorité les articles 17 et 29 pour que la discussion suive une certaine logique. En adoptant l’article 29, nous venons de créer les tribunaux correctionnels pour mineurs. Par coordination, il convient désormais d’ajouter, au sein de l’ordonnance du 2 février 1945, la mention de ce nouveau tribunal à la liste des juridictions pénales compétentes pour juger des infractions commises par des mineurs. Il ne s’agit que de coordination.
Mes chers collègues, ces amendements identiques ne « tombent » pas, au sens strict, et vous avez bien sûr tout loisir de développer indéfiniment les mêmes arguments !

Mais le débat de fond a déjà eu lieu C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’avais demandé que ces deux articles soient examinés par priorité. Pourrions-nous dans ces conditions, si cela vous convient, limiter les propos répétitifs ?
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 10 est adopté.

L'amendement n° 61, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est abrogé.
II. - En conséquence, la seconde phrase du vingt-neuvième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale est supprimée.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l’application aux mineurs de la procédure de composition pénale, laquelle tend à aligner la procédure de jugement des mineurs sur celle des majeurs et n’assure pas les garanties nécessaires aux droits de la défense.
En 2002 déjà, lors de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice, nous nous étions vigoureusement opposés à l’adoption de la composition pénale pour les majeurs. Aujourd’hui, nous nous y opposons a fortiori pour les mineurs.
Lorsque, en 2007, la loi relative à la prévention de la délinquance a rendu la composition pénale applicable aux mineurs, rien n’était prévu pour garantir que leur âge serait pris en compte, ni pour associer les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse à l’éventuelle enquête de personnalité.
En outre, le juge des enfants commençait déjà d’être déconsidéré, déprécié, et son rôle singulièrement réduit : en effet seule lui demeurait la mission de valider ou non, par ordonnance, la composition pénale.
Cette procédure n’est pas stricto sensu une privation de liberté, mais elle ne constitue pas une véritable alternative aux poursuites. De plus, elle emporte inscription au casier judiciaire. C’est pourquoi nous souhaitons sa suppression.

La commission se déclare surprise par cet amendement, qui tend à interdire au parquet de proposer au mineur auteur d’une infraction une composition pénale.
Cette mesure alternative aux poursuites offre en effet de bons résultats.
S’agissant d’un mineur, elle peut seulement être mise en œuvre avec l’accord des représentants légaux de celui-ci, et en présence d’un avocat. L’intervention éventuelle du juge des enfants est également prévue.
La composition pénale possède une réelle vertu éducative, puisqu’elle ne peut être mise en œuvre que lorsque le mineur a reconnu les faits et qu’il s’engage à accomplir un certain nombre de démarches.
Aussi ne paraît-il pas opportun à la commission de supprimer la possibilité d’y recourir.
L’avis est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 60, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Les quatrième, onzième et douzième alinéas sont supprimés ;
2° Les treizième et quatorzième alinéas sont ainsi rédigés :
« En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de treize ans à seize ans ne peut excéder un mois.
« La détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder trois mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas trois mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l’article 144 du même code, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Cet amendement vise à interdire la détention provisoire pour les mineurs âgés de treize à dix-huit ans en matière correctionnelle, ainsi qu’à limiter la durée de la détention provisoire pour les mineurs en matière criminelle.
Le placement en détention ruine toutes les perspectives d’avenir. La socialisation et l’éducation à la vie en société dans le respect des règles sont incompatibles avec l’enfermement, souvent vécu comme arbitraire et injuste par les plus jeunes. C’est d’autant plus le cas que la plupart des mineurs emprisonnés le sont en qualité de prévenus.
Pour que les jeunes puissent se projeter dans leur avenir, il faut cesser de les stigmatiser en les considérant comme des éléments négatifs !
Nous avons l’obligation morale de prévoir des réponses dont l’objectif soit non pas de les exclure le plus vite possible, notamment en les plaçant en détention, mais de les aider et de soigner leur souffrance.
Le choix de l’enfermement est un choix d’exclusion. C’est la voie que vous avez choisie ; ce n’est pas la nôtre et, par notre amendement, nous proposons une alternative.

Il convient de rappeler que les conditions permettant de placer un mineur en détention provisoire sont d’ores et déjà restrictives.
En particulier, il faut que la mesure soit indispensable et qu’il soit impossible de prendre toute autre disposition moins privative de liberté.
La détention provisoire des mineurs âgés de treize à seize ans n’est pas possible en matière délictuelle, sauf si le mineur s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.
Des garanties existent donc. La commission craint que l’amendement de nos collègues n’aille à l’inverse trop loin, en rendant, par exemple, impossible la détention provisoire de mineurs poursuivis pour des agressions sexuelles ou des violences graves, ce qui, dans certains cas, pourrait représenter un réel danger pour les victimes.
L’avis est donc défavorable.
En complément des arguments présentés par le rapporteur, et puisque chacun invoque à son tour l’ordonnance de 1945, je veux rappeler que son article 11 prévoyait la possibilité de placer un mineur âgé de plus de treize ans à titre provisoire dans une maison d’arrêt !
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
L’article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le tribunal pour enfants », sont insérés les mots : «, le tribunal correctionnel pour mineurs » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative ; »
3° Au dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent ».

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par MM. Michel et Anziani, Mmes Klès et Tasca, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 62 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
L'amendement n° 131 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 22, étant rappelé, mes chers collègues, qu’il nous faut terminer l’examen de cet article avant minuit.

Madame la présidente, je serai très bref.
L’article 11 permet de prononcer cumulativement une peine et une sanction éducative. Il me semble que nous passons ainsi de la subsidiarité prévue par l’ordonnance de 1945 à un cumul, contraire à la fois à l’ordonnance et aux différentes conventions internationales.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 62.

L’article 11 vise en effet à ôter à la peine son caractère subsidiaire, et à faire en sorte que le répressif l’emporte sur l’éducatif.
Vous souhaitez en réalité élargir cette possibilité de cumul, afin qu’elle ne soit plus une exception mais devienne une pratique habituelle.
Si la détention provisoire est bien entendu toujours possible, en particulier dans les cas de crimes et lorsqu’un danger existe pour les victimes, monsieur le garde des sceaux, nous sommes totalement opposés à son extension.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié.

Les dispositions de l’article 11 du projet de loi élargissent la palette des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un mineur délinquant, sans pour autant renoncer, même lorsqu’une peine est prononcée, à la dimension éducative de la réponse pénale.
Elles permettront à la juridiction saisie de prononcer simultanément, par exemple, une peine d’emprisonnement avec sursis et un stage de formation civique ou un placement en internat.
Cette mesure paraissant plutôt utile, l’avis de la commission est défavorable sur ces trois amendements identiques de suppression.
L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 11 est adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 19 mai 2011, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et le soir :
- Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (Procédure accélérée) (n° 438, 2010-2011).
Rapport de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois (n° 489, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 490, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.