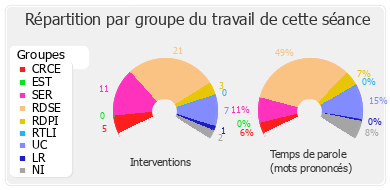Séance en hémicycle du 17 février 2011 à 9h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidature à un organisme extraparlementaire
- Organisme extraparlementaire (voir le dossier)
- Coordination des politiques économiques au sein de l'union européenne (voir le dossier)
- Présomption d'intérêt à agir des parlementaires en matière de recours pour excès de pouvoir (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Ambroise Dupont pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé à la Haute Assemblée de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’orientation stratégique de l’Institut français, en application de l’article 5 du décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010.
Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite la commission de la culture, de l’éducation et de la communication à présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

L’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de résolution relative à la coordination des politiques économiques au sein de l’Union européenne, présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Yvon Collin et certains membres du RDSE (proposition n° 204).
La parole est à M. Yvon Collinauteur de la proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis plusieurs générations déjà, l’Europe est un projet politique de premier plan, qui vise à accroître la prospérité des États et des peuples en créant les conditions d’une paix durable et du progrès économique et social pour tous. L’Europe, c’est encore et toujours une volonté politique au service du bonheur des peuples.
Confrontons un instant ce discours à quelques notions.
La démocratie. La souveraineté des peuples est-elle à ce point redoutée que l’on s’efforce par tous les moyens de se passer de la décision des citoyens sur des choix aussi essentiels que ceux qui portent, par exemple, sur les éléments les plus fondamentaux de la politique économique, à savoir les politiques monétaire et budgétaire ?
La solidarité entre les États. La voyons-nous à l’œuvre quand chacun s’emploie, par des politiques d’attractivité insoutenables – sauf à saper les bases économiques de ses partenaires – à attirer sur son territoire le plus de ressources économiques possible ?
L’économie sociale de marché. Les marchés dictent-ils leur loi aux États en les obligeant à une répartition des revenus au bénéfice prioritaire, et même parfois exclusif, des détenteurs du capital ?
La puissance économique. Est-elle réalisée quand l’Europe est la zone du monde, le Japon mis à part, où la croissance est la plus languissante et où la monnaie évolue au gré des seuls intérêts des autres ensembles économiques ?
La justice sociale. La voyons-nous à l’œuvre quand les inégalités augmentent, quand le taux de pauvreté s’accroît, quand les protections sociales sont démantelées au nom d’une compétitivité toujours brandie comme un étendard, mais sans cesse déclinante ?
Je ne voudrais pas alimenter ici l’euroscepticisme en incriminant l’échelon européen plutôt que celui des nations. Je n’ignore pas ce que le bilan plutôt accablant de la Commission européenne doit à une idéologie qui voit dans la dimension politique un mal presque absolu et qui la fait se détourner de sa mission première de défense de l’intérêt général européen. Surtout, je sais que, quoique l’on prétende, hormis dans les domaines très précis où ils ont délégué leur souveraineté, ce sont les États qui sont les ultimes responsables de l’abandon le plus grave de tous : l’oubli des objectifs de l’Europe et, avec lui, le renoncement à l’idéal européen.
Il ne faut pas craindre de l’affirmer : la crise que nous subissons n’est pas seulement une crise de l’Europe ; c’est une crise en Europe – et du politique en Europe.
À ce propos, nous avons tous entendu les discours complaisants sur l’origine transatlantique de la crise économique, ainsi que bien des lamentations sur la perte d’éthique et la morale défaillante des acteurs de la finance. Ces ritournelles, pour sonner parfois justes, me semblent bien loin de ce qu’il faut dire et penser de la crise. En effet, celle-ci ne fut pas seulement le produit délétère des arrière-salles des banques américaines ni la chose de quelques jeunes apprentis sorciers à la cupidité malsaine. Elle ne fut pas non plus le résultat d’un malheureux concours de circonstances où les événements les plus improbables se seraient déclenchés par l’effet d’un funeste hasard.
Non, cette crise fut bien celle d’un système économique dans son ensemble, à savoir le capitalisme court-termiste globalisé et l’ultralibéralisme, avec ses mots d’ordre dérégulateurs – flexibilité, attractivité, compétitivité –, qui reflètent un monde économique fictif et enfantent l’enfer pour de plus en plus d’individus.
En somme, les déséquilibres sur lesquels ce système danse ne sont pas seulement ceux de la finance mondiale. Ce sont aussi des dérèglements économiques, logés dans la sphère réelle elle-même, où la répartition des revenus se déstabilise tellement que l’ensemble est voué à des incohérences qui mettent le danseur à terre.
L’Europe ne fut nullement l’infortunée victime collatérale de l’un de ces tremblements de terre économiques dont la fréquence s’accroît dangereusement depuis quelques années. Elle fut pleinement un acteur de ce séisme. Tout autant que les autres, elle fut touchée par les conséquences des jeux auxquels elle s’est livrée. Tout autant – et même plus – que les autres, les pays européens peinent à se sortir de cette nasse, qui est particulièrement redoutable quand on sait combien leur avenir dépend de leur capacité à s’extraire vite du trou noir qui semble les absorber.
À cet égard, ce n’est pas de moins, mais de plus d’Europe que nous avons besoin, et d’une autre Europe, celle de la croissance, de la justice sociale, de l’équilibre, où le travail trouve toute sa place, donc d’une Europe qui porte un projet politique partagé.
Beaucoup a été fait pour sauver les banques, et je suis de ceux qui, dans cet hémicycle, ont accepté cette politique. Toutefois, ces secours, dont les modalités auraient dû être différentes, devaient avoir des contreparties. Or celles-ci ne sont pas venues. Et ce sont les États, par leur absence de volonté politique, qui sont ici responsables.
Pis encore, aujourd’hui, c’est avec une coupable complaisance que ces États, avec l’active complicité de la Banque centrale européenne, la BCE, autorisent la finance à dégager des marges d’intérêt faramineuses sur les titres de dette publique de pays européens de plus en plus nombreux à être étranglés par les mains auxquelles ils ont tendu les leurs.

Les conditions de taux faites aux débiteurs excèdent de beaucoup leurs perspectives de croissance économique, et un effet boule de neige de l’endettement est en marche, alors même que l’on prétend avoir comme objectif prioritaire la réduction de la dette publique. Tout cela doit, en bonne logique, mener à un nouveau désastre financier.

La seule façon de l’éviter, ce sont des plans d’austérité budgétaire qui frappent tout particulièrement les ménages européens, salariés, retraités, malades ou chômeurs.
Les rentiers ou les spéculateurs n’ont aucune inquiétude à avoir : la concurrence fiscale en Europe préservera leurs revenus garantis par la Banque centrale. Au fond, rien n’a changé dans la finance européenne. Faute de volonté politique, mais aussi de coopération entre la Banque centrale européenne et les gouvernements, la prédation financière se poursuit sous d’autres formes, mais avec le même résultat : la montée des périls macroéconomiques, l’austérité pour la quasi-totalité des populations d’Europe et le déclin des États et de leur capacité à assurer leurs si nécessaires fonctions.
Alors que la combinaison des politiques économiques devrait s’attacher à mettre en place une coopération entre une politique monétaire accommodante et une politique budgétaire de rétablissement à petits pas des finances publiques sur fond de contribution du capital privé, afin d’en revenir à un sentier de croissance durable, tous les éléments de cet équilibre sont sens dessus dessous.
La BCE assure l’effet boule de neige de la dette qui alourdit les ajustements rendus nécessaires par l’état des finances publiques, délabrées par la crise. Alors que nous sommes en plein choc de demande, nous adoptons des plans d’austérité budgétaire qui pèseront sans doute sur la demande. Déjà, le Royaume-Uni s’enfonce de nouveau dans la récession, et les perspectives de croissance du Portugal, de la Grèce, de l’Irlande mais aussi des autres pays européens se dégradent. Et en France, il n’y a pas plus de relance qu’il n’y eut de baisse du chômage en 2010 !
N’en doutez pas, mes chers collègues, l’austérité budgétaire qui pèse sur la croissance d’aujourd’hui et de demain affectera à long terme la dynamique de l’Europe et détruira encore un peu plus la confiance de nos concitoyens.
Pendant ce temps, aux États-Unis, en Asie – des zones économiques auxquelles, je le note incidemment, les contribuables européens versent de confortables revenus financiers –, on profite qui d’une politique monétaire autrement moins conventionnelle et absurde, qui, sous forme d’investissements directs, des transferts financiers réalisés par les entreprises européennes dans le cadre de la nouvelle division internationale du travail.
Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais vous poser une question simple : pourquoi, quand la FED, la Réserve fédérale américaine, rachète directement la dette publique des États-Unis en maintenant des taux d’intérêt très bas, nous offrons-nous le luxe de payer des commissions élevées aux banques commerciales en Europe pour une intermédiation totalement inutile ?
Ne me répondez pas que c’est pour éviter l’inflation, car, si un risque inflationniste existe en Europe, c’est du fait des spéculations financières sur les matières premières ou de la restriction du crédit aux entreprises, certainement pas par la monétisation de dettes publiques qui plus est souvent portées par des capitaux étrangers. Ne me dites pas non plus que nous y risquerions notre réputation, car ce qui compte pour les créanciers, c’est d’être remboursés tout en trouvant une rémunération acceptable. Toutefois, celle-ci doit l’être aussi pour les débiteurs, et pour cela elle doit être compatible avec la survie de ces derniers. Or, en l’état, tel n’est pas le cas, vous le savez, monsieur le secrétaire d'État.
L’Europe des ordo-libéraux manque décidément de la capacité de vouloir sans laquelle il n’est pas de capacité de concevoir. Point de vision ni de stratégie, sinon sur le papier jauni de Conseils européens prompts à avaler la doxa d’une commission européenne convertie aux rêveries de l’école de Chicago.
Ne nous y trompons pas : au lieu de sortir de la crise, nous sommes en train de nous y enliser ! Ce qui est en cause, au-delà de notre capacité, tragiquement inexistante aujourd’hui, à sortir de la crise dramatique que la France et la plupart des Français traversent, c’est le projet européen lui-même, donc l’avenir de l’Europe.
La crise en Europe, c’est surtout cela. Nous pouvons bien écrire sur le papier toutes les stratégies que nous voulons, ces documents ne pèsent rien en pratique, tant ils négligent les conditions d’accomplissement des ambitions qu’ils affichent. Pis encore, ils jettent les bases de leur propre vanité.
L’Europe se construit sur des fictions : celles de la concurrence pure et parfaite et de l’efficience des marchés. Or, si ces paradigmes ne doivent pas être négligés, une telle pensée est porteuse des graves désillusions qu’enfantent à tout coup les utopies mystificatrices.
L’Europe est victime d’un idéologisme qui lui fait prendre des vessies pour des lanternes, pour le plus grand bénéfice des monopoles dominant les marchés. N’est-il pas temps qu’elle redevienne l’Europe de la pensée pratique et des progrès, modestes mais tangibles ?
Nous n’avons qu’un ennemi ici, ce sont les faux-semblants. Est-il acceptable que les États-nations d’Europe se réclament d’une volonté de coopération et se livrent une guerre économique ? Pouvons-nous nous satisfaire du fait qu’ils affichent une priorité de croissance pour tous et qu’ils jettent les bases d’une domination de la rente patrimoniale, malthusienne et prédatrice ?

L’Europe peut-elle à la fois prétendre adopter un modèle d’économie sociale de marché et verser dans le néo-libéralisme le plus caricatural ?
Une Europe des politiques économiques coopératives doit se substituer à l’Europe des États mis au service des rentes contreproductives. Ce sont la pérennité du projet européen et la prospérité des nations européennes qui sont en jeu !
Dans l’Europe intégrée, les interdépendances entre nations sont fortes : ce que fait l’une concerne toutes les autres. C’est tout particulièrement le cas pour les grandes économies européennes – France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie –, mais cela l’est tout autant pour les pays de plus petites dimensions. Ainsi, la concurrence fiscale exercée par l’Irlande assèche les ressources de ses partenaires : l’activité économique est localisée chez eux, mais les profits et les recettes de l’imposition des sociétés sont dans la verte Erin. Que n’avons-nous obtenu sur ce point des engagements fermes de l’Irlande ?
Dans le rapport d’information adopté en 2007 et fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification présidée par Joël Bourdin, qui vous prie d’ailleurs d’excuser son absence aujourd'hui, rapport que nous avions intitulé Le Malaise avant la crise – titre prémonitoire ! –, nous avions mis en évidence la réalité des antagonismes économiques en Europe. Nous avions alerté sur l’insoutenabilité économique, financière, sociale et, finalement, politique de la confrontation des trois modèles que nous avions identifiés : d’abord, l’économie d’endettement, d’inflation et de bulles du type espagnol ou britannique ; ensuite, l’économie de la déflation salariale à la mode germanique, tirée par ses partenaires ; enfin, le modèle français qui, non exempt de défauts, paraissait malgré tout le plus équilibré de tous sur le plan macroéconomique.
L’analyse économique n’a pas toujours été aveugle, comme on le prétend parfois trop facilement. Il suffisait d’analyser les externalités produites par chacun de ces modèles sur les pays partenaires.
Ainsi, dans ce rapport d’information, nous avions mis en évidence le caractère insoutenable du concert économique européen, des déficits extérieurs et des finances publiques, mais aussi de la finance privée. Nous avions souligné à la fois le caractère tout aussi insoutenable, du point de vue tant social qu’économique, des modes de répartition à l’œuvre dans les économies européennes et l’impossible coexistence de modèles économiques antagoniques.
Le concert européen nous semblait si discordant que nous évoquions comme une probabilité assez forte le déclenchement d’une crise présentant plusieurs visages – les crises globales le sont toujours –, dont l’un était pour nous la montée des menaces pesant sur l’euro. Tiens, tiens !
Nous savons depuis Robert Mundell qu’il existe des conditions de viabilité d’une zone à monnaie unique, comme l’est la zone euro, et nous savons que ces conditions ne sont réunies en Europe que théoriquement.
L’histoire récente a, sous l’effet de l’urgence, permis d’envisager quelques progrès sur ce point avec la constitution, trop poussive, du Fonds européen de stabilité financière. Je n’ai rien contre ce fonds puisque, avec Joël Bourdin, j’en avais proposé la création dès 2009, dans un autre rapport d’information consacré à la crise de l’Europe. D’ailleurs, il faut impérativement en abonder les moyens ; le plus tôt sera le mieux. Mais ce fonds ne sera pas et ne doit pas être la clef de voûte de l’euro. Si nous cédions à cette tentation minimaliste, nous n’aurions fait qu’installer un petit FMI européen ; en d’autres termes, nous n’aurions fait qu’installer une caserne de pompiers au cœur de l’Europe. Or, si nous aimons tous les pompiers, nous préférons tous aussi, dans cet hémicycle, nous en passer. Comme le dit la sagesse populaire, mieux vaut prévenir que guérir !
Il est symptomatique que, plutôt que de s’accorder sur un renforcement du budget européen, les États soient passés par l’instauration d’une nouvelle institution financière pour traiter le grave problème des dettes souveraines en Europe, dont chacun sait qu’il est aussi – et peut-être avant tout ! – celui des établissements financiers privés opérant en Europe.
Ce n’est pas ainsi que la condition tout à fait essentielle, et pourtant toujours négligée, énoncée par Robert Mundell, celle de la convergence des préférences collectives dans une zone monétaire unique, sera respectée. Pour qu’elle le soit, il faudrait qu’un esprit de coopération bien plus fort anime les partenaires réunis dans le projet européen. Une fois de plus cette condition est clairement ménagée par les traités. Mais, en accord avec l’idéologie sur laquelle se construit l’Europe, elle n’est mise en œuvre avec une certaine vigueur que dans le domaine de la surveillance des positions budgétaires.
La coordination des politiques économiques, la concurrence fiscale, les objectifs sociaux que l’Europe a pourtant entendu consacrer, tout cela est traité par prétérition, comme s’il s’agissait de sujets secondaires.
À cet égard, mes chers collègues, je tiens à vous alerter sur les conséquences proprement régressives de ce qui se prépare dans les cénacles européens autour de la réforme de la gouvernance économique et du prétendu « pacte de compétitivité », c’est-à-dire la généralisation en Europe du malthusianisme allemand. Plutôt que d’inciter l’Allemagne à sortir de ce modèle – vous verrez qu’elle en sortira un jour tant celui-ci est insoutenable –, on nous propose de l’adopter.
Je n’insiste pas sur les aspects économiques des orientations qui nous seront détaillées. On en connaît la logique : déflation salariale, hausse de la rentabilité financière du capital, remise en cause radicale de l’État protecteur. On en sait les impasses : disparition de toute perspective de croissance, montée des inégalités de revenus et des patrimoines, exportation des richesses créées en Europe vers les zones où la rentabilité du capital est maximisée par le dumping social et fiscal.
Où est la cohérence avec l’engagement du Président de la République d’être le président du pouvoir d’achat ? Où retrouver trace de l’important débat ouvert par lui sur le partage de la valeur ajoutée ? Nous y reviendrons sans doute dans des débats futurs.
C’est sur des aspects plus politiques extrêmement préoccupants pour tous les démocrates – je sais que nous le sommes tous ici – que je souhaite m’attarder maintenant. Il entre dans ces projets de faire régner les règles plutôt que les décisions politiques. Ainsi, l’on nous annonce un projet de révision constitutionnelle, qui ne vise rien d’autre qu’à « constitutionnaliser » Maastricht.
En effet, si nous n’y prenons pas garde, notre constitution politique sera remplacée par une constitution économique qui nous aura privés de tout pouvoir pour mieux instaurer la tyrannie de prétendus marchés, c’est-à-dire des intérêts des grands oligopoles qui, aujourd’hui, décident déjà de tout ou presque.
Le Président de la République a fondé une partie de son succès il y a quatre ans sur le thème du retour de la politique. Pourtant, hormis quelques grands discours et certaines petites phrases, on attend toujours que cette thématique trouve un semblant de traduction en actes. Il faut dire que le triomphe accepté de l’ordo-libéralisme que représentent les règlements concoctés par le cabinet d’audit qu’est devenue la Commission européenne sur la coordination des politiques économiques européennes – disons le clairement : c’est en fait la disparition de toute politique économique – implique la défaite d’une ambition qui se sera révélée comme une posture, pour ne pas dire une imposture.
Mes chers collègues il faudra expliquer aux Français qu’ils ne seront plus libres demain, parce que le pouvoir de décider des conditions dans lesquelles leur État ou leurs collectivités locales pourront financer leurs interventions nous aura été retiré. Il faudra les convaincre que la prohibition de tout emprunt public que porte le projet de révision constitutionnelle que l’on nous annonce traduit ce fameux retour du politique. J’entends déjà le sophisme résonner : « Échapper à la dette, c’est échapper à la dépendance des marchés financiers. » Étrange défense venant d’un horizon politique qui, sans s’embarrasser de nuances, accepte – revendique même tous les jours ! – le patronage de l’économie de marché.
C’est parce que ce débat démocratique doit avoir lieu et que le politique doit être respecté qu’il est inacceptable de brader notre souveraineté, ainsi qu’on le projette, à un paradigme abstrait et sans cohérence, qui plus est régressif, qui veut qu’une bonne politique économique soit le renoncement par avance de toute politique économique.
Dans ce qui se prépare, rien ne correspond aux principes de notre souveraineté, rien ne correspond aux valeurs européennes. Pas un mot de la croissance économique, nul élan vers des projets concrets pour relever les défis du xxie siècle, l’oubli de toute ambition sociale et même de tout réalisme social.

Dans l’état actuel de l’Europe, la diplomatie économique et sociale doit être au centre des stratégies. La France a le choix entre s’aligner et défendre son modèle, qui fut celui des pères fondateurs de l’Europe. C’est évidemment parce que je suis préoccupé de la défense des intérêts de la France et que j’adhère sans arrière-pensée au projet d’une Europe puissante...

... que j’ai déposé cette proposition de résolution avec plusieurs de mes collègues et amis du groupe du RDSE.

J’espère qu’elle trouvera dans cette assemblée mais aussi dans bien d’autres assemblées politiques de l’Europe l’adhésion majoritaire qu’elle appelle et qui traduit le ralliement au vrai projet européen.
Mes chers collègues, avant de conclure cette intervention en vous invitant à soutenir cette proposition de résolution qui, à tout bien considérer, n’est qu’une exhortation à retrouver l’esprit et la lettre des engagements européens du pays, je rappellerai quelques propos inspirés par le projet européen. « Son modèle, » – il s’agit de celui de l’Europe – « c’est l’économie sociale de marché. Son contrat, c’est l’alliance de la liberté et de la solidarité, c’est la puissance publique garante de l’intérêt général. La dignité de l’homme est au cœur de son projet de société. Renoncer à cet idéal, ce serait trahir l’héritage européen. C’est pourquoi la France n’acceptera jamais de voir l’Europe réduite à une simple zone de libre-échange. C’est pourquoi nous devons relancer le projet d’une Europe politique et sociale, fondée sur le principe de la solidarité. »
À l’heure du chômage de masse et au moment où la Cour constitutionnelle allemande juge contraire à la dignité humaine les aspects les plus radicaux des réformes ultralibérales, cet extrait d’une tribune de Jacques Chirac – vous aurez sans doute reconnu l’auteur de la citation que j’ai faite à l’instant
Sourires sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPC

– nous rappelle utilement à notre devoir collectif de faire prévaloir le seul esprit des traités qui vaille, celui qui fonde notre Europe, une Europe non du renoncement régressif, mais bien de la volonté politique de progrès.
Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sortons progressivement d’une crise économique mondiale de grande ampleur.

Cette sortie de crise se fait dans un contexte marqué par le formidable dynamisme des économies de pays émergents ou de puissances qui, comme la Chine, connaissent des taux de croissance à deux chiffres.
Dans cet environnement, on constate que les politiques des États de l’Union européenne ne sont pas toutes aussi efficaces et que leurs économies sont inégalement compétitives. Ainsi, l’Allemagne s’est rapidement relevée de la crise et dope ses exportations, quand d’autres pays peinent à redémarrer.
Nous savons tous ici ce qu’apporte la compétitivité d’une politique économique en termes d’emplois, de croissance, de résorption de la dette. Nous savons aussi combien il est important que cette compétitivité soit recherchée et partagée par l’ensemble des pays qui ont fait le choix de vivre ensemble dans un marché unique où la monnaie, les capitaux, la main-d’œuvre, les produits et les services sont appelés à circuler librement. Pour des pays qui partagent la même monnaie, faire converger les politiques économiques n’a en tout cas rien d’absurde.
Pour commencer, il est parfaitement raisonnable que l’Allemagne et la France, qui totalisent 70 % du PIB de la zone euro, se donnent pour priorité de rapprocher leurs économies et de le faire en visant la meilleure compétitivité. Il est même indispensable et assez naturel qu’il leur soit demandé d’imprimer un même mouvement à la zone euro, alors qu’elles entendent continuer à assumer ensemble une responsabilité politique générale exigeante au service de la construction européenne, ce dont, personnellement, je me félicite.
Monsieur Collin, le groupe de l’Union centriste ne veut pas partager le scepticisme qui marque la proposition de résolution, au demeurant intéressante, que vous venez de présenter. Nous ne pouvons pas non plus reprendre à notre compte les arguments qui la sous-tendent.
Je vous remercie néanmoins de nous donner ainsi l’occasion de traiter ici de ce sujet passionnant. Nous devons analyser en particulier les efforts entrepris par l’Allemagne qui distance la France en termes de compétitivité. Nous devons développer notre réflexion à partir de ce constat.
Évidemment, il nous faut le faire avec la lucidité voulue pour laisser vivre nos différences de culture, ce qui implique un regard critique sur les moyens à mettre en œuvre pour que notre économie, aux côtés de celle de l’Allemagne, contribue elle aussi à la relance de l’Union européenne.
L’objectif est rappelé, mais l’atteindre n’est pas simple. Le rapport établi par l’institut Coe-rexecode sur le thème de la comparaison des situations économiques française et allemande fait apparaître entre 2000 et 2008 un effet ciseau croissant qui oppose une érosion régulière de notre compétitivité à une consolidation constante de celle que connaît l’Allemagne, notamment en matière industrielle.

La perte relative de terrain de la France sur son partenaire préféré concerne même l’agriculture. Elle transparaît à tous les niveaux, qu’il s’agisse du coût du travail, des dépenses de recherche et développement ou encore du niveau des prélèvements obligatoires, qui font la une de l’actualité.
En 2010, la politique économique allemande porte les fruits de réformes économiques et sociales courageuses. Je pense notamment à la loi Hartz IV, qui accroît la flexibilité du travail. L’Allemagne récolte aussi les fruits d’un climat social qui, au plus fort de la crise, est resté plus réaliste et plus constructif que celui qui régnait en France.
Le résultat semble sans appel. En 2010, la balance commerciale affiche un excédent de 160 milliards d'euros en Allemagne, alors qu’elle accuse un déficit de 50 milliards d'euros de l’autre côté du Rhin. Le déficit public allemand, en pourcentage du PIB, est deux fois moins important que celui de la France et diminue beaucoup plus rapidement. Le taux de chômage au mois de décembre dernier était de 6, 6 % en Allemagne contre 9, 7 % en France. La croissance du PIB y est de 3, 6 contre 1, 6 chez nous. En résumé, après des années d’atonie, la santé de l’économie allemande pourrait paraître insolente si elle n’était pas parfaitement justifiée. Considérons-là simplement comme exemplaire
Mme Nicole Bricq proteste

Avant de suivre cet exemple, prenons tout de même en compte certaines différences de structures. La recette miracle allemande n’est pas immédiatement transposable en France.
L’économie française colbertiste repose beaucoup moins sur les exportations et bien davantage sur la consommation, elle-même favorisée par une importante redistribution de richesses par l’État ou sur son initiative.

Je révère Colbert, dont la statue se trouve juste derrière moi, mais il faut le révérer avec lucidité et réalisme !
Malheureusement, monsieur le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, le développement de notre consommation enrichit aussi la Chine, et pas seulement à la marge. Cela présente certains avantages, mais aussi des inconvénients. En même temps, notre penchant keynésien a permis de lisser les effets de la crise, quand les économies purement libérales étaient à la dérive. Il faut le dire !
Exportatrice, l’économie allemande est également décentralisée, caractéristique si étrangère à notre culture que, lorsque nous nous « appliquons » à décentraliser, nous le faisons toujours de manière centralisée – il nous est impossible de faire autrement – et uniforme, depuis Paris ! Le principe de subsidiarité reste peu lisible, voire incompréhensible, en France. Selon ce principe, les interventions se font au plus près du « terrain », et l’on accepte de fédérer ses efforts, ses difficultés et ses ambitions, à partir du moment où l’on est sûr de ne pas pouvoir être plus efficace autrement. Cela appelle un effort constant de notre part. Il est dommage que ce principe soit peu lisible en France, car il constitue une belle école de responsabilité pour les citoyens comme pour les dirigeants d’entreprise.
Avec ses atouts, l’Allemagne tire le parti maximum de la croissance des pays émergents, même si elle a subi plus fortement l’arrêt brutal de la demande internationale. On ne peut pas tout avoir !
En outre, les relations sociales en Allemagne sont consensuelles, d’autant plus naturellement qu’elles sont, elles aussi, décentralisées. Dans un État fédéral, la décentralisation est en effet la base de toute chose. Les négociations, enfin, sont globales, puisqu’elles portent à la fois sur le temps de travail, les salaires et l’emploi.
Un point est plus encourageant, tout de même, s’agissant des comparaisons entre nos économies : les deux pays partagent une même approche socio-libérale de l’économie. Cette profonde communauté de sensibilités permet déjà de se comprendre, ce qui est précieux. Sans ignorer les différences, il nous faut rechercher puis valoriser toutes les possibilités de convergence !
Des marges de progrès existent vraiment. C’est dans ce domaine que les propositions du pacte de compétitivité franco-allemand sont évidemment les plus intéressantes. Elles peuvent paraître peu ambitieuses. Il nous reste à miser pragmatiquement, « à l’allemande », sur elles, et à avancer. Elles traduisent surtout une volonté politique commune dont l’affirmation même est déjà essentielle et déjà porteuse d’avenir.
La Cour des comptes va rendre publiques ses conclusions sur les problèmes posés en matière de convergence des fiscalités française et allemande. Ces comparaisons vont nourrir le débat, lancé pour ce semestre, sur l’évolution de notre propre fiscalité. J’ai par ailleurs noté que le Président de la République portait une grande attention à la réalité allemande et à tout ce qui pouvait resserrer cette convergence. Tant mieux !
Nous connaissons donc une conjoncture plutôt favorable pour opérer, au moins à l’échelle franco-allemande, une coordination fiscale, premier pas vers une coordination de nos politiques économiques.
Peut-être une telle initiative entraînera-t-elle d’autres économies de la zone euro à appliquer les « bonnes pratiques », telles que le plafonnement de la dette ou le rapprochement des taux d’impôt sur les sociétés, pour ne citer que ces deux exemples.
À terme – il faut l’espérer et y croire –, cette démarche intergouvernementale pourra être consacrée à l’échelon communautaire. C’est bien la méthode Schuman ! Elle se fait pas à pas, par des avancées concrètes. C’est ainsi que nous pourrons le plus solidement et irréversiblement réduire les tentations de dumping fiscal qui subsistent dans l’Union européenne. La solidarité y gagnera et, avec elle, la croissance et l’emploi de tous, au sein du grand marché européen.
La France doit l’accepter, l’environnement mondial a évolué. Que l’on en pense du bien ou du mal, c’est une réalité incontournable. C’est dans ce contexte, d’abord à l’échelle de l’Eurogroupe, puis de l’Union européenne, que de nouvelles voies doivent être ouvertes.
Parce qu’ils se situent dans cette perspective européenne, les membres du groupe de l’Union centriste ne partagent pas le scepticisme qui nourrit la proposition de résolution qui nous est soumise. Du scepticisme au pessimisme, il n’y a qu’un pas. Nous ne voudrions pas nous retrouver entraînés à le franchir, alors que, pour reprendre une formule connue, « le pessimiste se condamne à être spectateur ». Dans la compétition mondiale qui est engagée, nous entendons bien rester acteurs, avec la France et dans l’Union européenne !

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de résolution dont nous débattons aujourd’hui, grâce à l’initiative de notre collègue Yvon Collin, traite d’un sujet capital.
Elle intervient alors que notre continent et le monde traversent l’une des pires crises économiques de l’Histoire moderne et, en tout état de cause, la pire crise que le monde ait connue depuis les années 1920.
Cette crise, d’abord financière, puis économique et sociale, met l’Europe au défi : au défi d’être à la hauteur des enjeux ; au défi de faire face ; au défi d’inventer de nouvelles politiques et de nouveaux instruments de délibération et d’action.
En effet, nous le savons, l’échelon européen est pertinent pour agir et pour obtenir des effets sur l’économie, à condition de le vouloir et de s’en donner les moyens.
Aujourd’hui, la coordination des politiques économiques au sein de l’Union européenne se fait essentiellement – on peut le déplorer – par des interdictions et des sanctions. C’est vrai, en particulier, pour les États membres de la zone euro, soumis au pacte de stabilité et de croissance qui encadre les politiques budgétaires des États et prévoit le déclenchement de sanctions en cas de dépassement des seuils prescrits. Il s’agit d’une sorte de coordination « par défaut ». En effet, la monnaie commune n’est pas accompagnée d’un budget commun ; seules des règles strictes, inscrites dans les textes, fixent un cadre commun pour éviter les tentations de « cavalier seul ».
Cette coordination a fait la preuve de ses limites et de ses insuffisances. Nous l’avons vu au moment de la crise grecque, dont Jean-Pierre Chevènement a écrit dans son dernier ouvrage qu’il s’agissait d’une « répétition générale des crises à venir ». Au moment où cette crise a éclaté, l’Europe était dépourvue de tout moyen de réponse rapide, adéquate et efficace. Nous le voyons chaque jour depuis des années : la coordination, telle qu’elle existe actuellement, ne permet pas à notre vieux continent de tirer le meilleur de lui-même.
Les mécanismes existants ont échoué dans la mise en place de politiques d’avenir. Ils ne permettent pas de conduire, à l’échelle du continent européen, des politiques keynésiennes. Tout le monde reconnaît pourtant aujourd’hui que ces politiques sont les seules capables de surmonter la crise, de soutenir la recherche et l’innovation, et de préparer les emplois de demain !
De nombreuses propositions sont sur la table. Je pense au paquet législatif proposé par la Commission européenne en septembre dernier. Je pense également au rapport du groupe de travail présidé par Herman Van Rompuy et aux propositions du Parlement européen faites en octobre dernier. Je pense aussi aux propositions des socialistes européens qui, sur bien des points, sont proches de l’état d’esprit des mesures proposées aujourd’hui par nos amis du RDSE.
Nous plaidons pour de nouvelles modalités de coordination des politiques économiques au sein de l’Union européenne.
Le premier souci de la nouvelle coordination doit être celui de la démocratie. C’est, me semble-t-il, l’un des messages forts de cette proposition de résolution. Comme je l’ai indiqué, le pacte de stabilité et de croissance encadre fortement les politiques budgétaires nationales.
Le « semestre européen », institué lors du Conseil ECOFIN du 7 septembre dernier, va dans ce sens. Il prévoit en effet une mise en cohérence accrue entre les procédures budgétaires nationales et l’agenda européen.
Indispensable dans son principe, une telle coordination comporte cependant un risque évident : celui de contourner purement et simplement, en fait sinon en droit, comme l’ont dénoncé nos collègues députés européens, le Parlement européen lui-même. Un tel état de fait priverait le « semestre européen » de toute légitimité démocratique et serait, à terme, préjudiciable à sa pérennité. Il faut en conséquence conforter la dimension parlementaire nationale du « semestre européen », et le doter d’une dimension parlementaire européenne clairement assumée.
De cela découle l’importance de la tenue d’une réunion, au moins une fois par an, de représentants des parlements nationaux et du Parlement européen, afin d’avancer ensemble.
Nous devons donc parvenir à concilier deux exigences qui risquent de s’opposer : d’une part, l’exigence de souveraineté, puisque le premier rôle des parlements nationaux est bien de voter le consentement à l’impôt et le budget ; d’autre part, l’exigence d’une coordination des politiques en Europe dans un contexte tendu.
De surcroît, la coordination des politiques économiques doit être, pour nous, un moyen de sortir par le haut de la situation économique actuelle. En effet, la coordination n’est pas une fin en soi. Nous ne la souhaitons pas par simple goût des procédures. Elle doit être mise au service de politiques publiques. Ainsi, la coordination est réussie dès lors qu’elle permet aux Européens de faire face, ensemble, à des défis communs, et de tout mettre en œuvre pour aller de l’avant dans une dynamique collective. À cet égard, plusieurs pistes doivent être explorées.
D’abord, nous devons aller vers la mise en place d’un mécanisme permanent de gestion des crises. Un premier pas a été fait, il faut le reconnaître, avec la mise en place du Fonds européen de stabilité financière. Ses opérations sont encore exclusivement des plans de sauvetage – souvent assortis de contreparties drastiques –, et il ne prévoit pas encore d’instruments de convergence économique.
En outre, la question des investissements d’avenir est essentielle pour notre continent. L’investissement public et le soutien à l’investissement privé, notamment dans les secteurs de la recherche, du développement et de l’innovation, conditionnent la réussite de la stratégie Europe 2020. Leur insuffisance explique, en partie, le relatif échec de la stratégie de Lisbonne.
Pour ces raisons, il nous faut poser clairement la question d’un éventuel emprunt européen. Les États pourraient ainsi procéder collectivement à des emprunts pour financer de grands projets d’investissement d’intérêt européen.
Enfin, nous pouvons imaginer d’aller plus loin encore, en mutualisant les budgets nationaux sur des sujets d’intérêt commun en lien, ici encore, avec la stratégie Europe 2020. De telles mesures ne devraient pas être soumises aux règles du pacte de stabilité.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de résolution aujourd’hui examinée est un marqueur.
Elle acte des principes et des propositions qui nous permettent d’aller de l’avant. À nous de suivre le bon chemin, en démocratisant la gouvernance pour la mettre au service de l’emploi et de la croissance, en remplaçant les procédures de coordination par des politiques publiques ambitieuses, en conciliant souveraineté, démocratie et volontarisme politique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Mme Françoise Laborde et M. Yvon Collin applaudissent.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la crise de l’euro résulte d’une insuffisance initiale de conception tenant à l’hétérogénéité même de la zone euro. Aucune politique coordonnée de croissance économique n’a été prévue pour y porter remède.
Au contraire, l’orientation qui se dégage à l’approche du sommet de la zone euro, le 11 mars prochain, suivi d’un sommet à vingt-sept à la fin du mois, consiste à assortir la pérennisation du mécanisme de stabilisation financière de l’euro – que les traités, il est vrai, ne prévoyaient pas à l’origine – d’un « pacte de compétitivité », élaboré par le gouvernement de Mme Merkel, enrôlant à sa suite M. Sarkozy et le Gouvernement français pour imposer aux autres gouvernements européens une politique de rigueur profondément réactionnaire. Cette politique ne peut qu’enfoncer les économies européennes dans une stagnation de longue durée.
Au lieu de promouvoir, comme l’avait suggéré en 2007 le rapport d’information de MM. Bourdin et Collin sur la coordination des politiques économiques en Europe, une initiative de croissance à l’échelle européenne, qui desserrerait le carcan pesant sur les pays déficitaires, à travers une politique coordonnée de relance salariale, particulièrement en Allemagne, où la déflation salariale impulsée depuis 2000 a exercé un effet déséquilibrant sur le commerce extérieur de presque tous les pays de la zone euro, le « pacte de compétitivité » réclamé par Mme Merkel, en compensation de son acceptation d’un mécanisme de solidarité financière, vise d’abord à casser l’indexation des salaires sur les prix. L’objectif est, une fois encore, de modifier le partage entre les profits et les salaires, au détriment de ces derniers, dont la part a déjà régressé de douze points entre 1975 et 2006, comme le montrait le rapport d’information de MM. Collin et Bourdin.

MM. Junker et Leterme eux-mêmes, les premiers ministres luxembourgeois et belge, que l’on ne peut pas qualifier de « gauchistes », s’élèvent contre cette prétention !
Ledit « pacte de compétitivité » prévoit également d’inscrire dans les constitutions l’interdiction de tout déficit budgétaire ! Keynes peut se retourner dans sa tombe ! C’est le triomphe de Milton Friedman
Croyez-vous, monsieur le secrétaire d’État, qu’une majorité des trois cinquièmes du Congrès sera trouvée, à Versailles, pour approuver une telle régression ? Vous comptez sur les socialistes, mais je ne suis pas sûr qu’ils se comportent comme au moment de l’adoption du traité de Lisbonne. Ils pourraient bien vous faire défaut !

La réglementation de l’euro, imposée en son temps au sein du groupe Delors, par le président de la Buba, Karl Otto Pöhl, était très critiquable. En effet, la Banque centrale européenne, indépendante, s’était vue interdire de racheter des titres d’État sur les marchés, dits secondaires, de la dette.
La Banque centrale européenne a certes été amenée à contourner légèrement cette interdiction en rachetant 60 milliards d’euros – promptement annulés – d’obligations grecques, irlandaises et portugaises.

Mais au lieu d’élargir cette possibilité par une réforme des statuts de la Banque centrale européenne, voilà que Mme Merkel et M. Sarkozy nous proposent que le futur fonds de stabilisation alimenté par les États, c’est-à-dire au premier chef par l’Allemagne et la France, puisse par exemple racheter de la dette grecque ou prêter à la Grèce de quoi le faire elle-même.

De toute évidence, il s’agit de préparer la restructuration de la dette grecque plutôt que d’agir en amont sur la croissance et sur la politique de la Banque centrale européenne. J’aimerais être sûr qu’il ne s’agit pas d’un premier pas pour exclure de la zone euro les pays les plus fragiles.
Le pacte de compétitivité prévoit, par ailleurs, un mécanisme automatique de relèvement de l’âge de la retraite fondé sur la démographie, comme si le problème essentiel n’était pas le rétrécissement de la base productive des économies européennes ni la diminution – à hauteur de 600 000 en France pour la période 2008-2009 – du nombre des cotisants.

Monsieur le secrétaire d'État, cette prétendue « politique de compétitivité » n’a aucune chance de fonctionner. Visez-vous le modèle chinois ?

Si oui, à quel horizon ? Préférez-vous le modèle allemand ? Mais croyez-vous que cela ait un sens ? Si tous les autres pays de la zone suivaient l’exemple de l’Allemagne, ce serait le naufrage collectif assuré, et d’abord pour celle-ci. Si tous les pays de la zone euro voulaient, par une politique de rigueur, augmenter leur compétitivité pour gagner des parts de marché à l’exportation, ce serait la récession générale.

Quant à la France, elle est doublement pénalisée : non seulement elle est le deuxième pays contributeur juste derrière l’Allemagne, mais elle devra faire un effort de rigueur beaucoup plus important, pour faire passer son déficit de 7 % du PIB à 3 %.

La politique inspirée par le gouvernement de nos grands voisins et relayée par la Banque centrale et la Commission européennes, toutes deux prisonnières des dogmes libéraux qui ont présidé à leur fondation, nous conduit droit dans le mur !
Or, aucun exécutif européen ne se sent de taille à contester l’orthodoxie professée par le gouvernement allemand appuyé sur la Commission et sur la Banque centrale européennes Ce serait pourtant le rôle de la France, monsieur le secrétaire d'État : portez ce message à M. Sarkozy ! Mais je passe sur le mystère d’un tel égarement…
À l’évidence, le Conseil a pris la place de la Commission.

À certains égards, c’était inévitable : la légitimité appartient au Conseil et non à une commission où vingt-sept personnes ne peuvent pas définir l'intérêt général européen.
Dans les faits, c’est le couple franco-allemand qui prend le relais. Mais, au sein de ce dernier, c’est l’Allemagne qui paie, et donc elle qui commande ! Elle entend se servir de la troïka composée du FMI, de la Commission et de la BCE pour imposer une rigueur budgétaire sans faille allant jusqu’au blocage puis à la diminution du traitement des fonctionnaires, au recul de l’âge de la retraite, à des coupes sévères dans les dépenses publiques, à la création de nouveaux impôts, à des programmes drastiques de privatisation comme on le voit déjà en Grèce.
Le gouvernement de Mme Merkel préconise, en cas de manquement, une procédure de sanctions automatiques. Il entend également faire peser sur les créanciers privés, c’est-à-dire les banques, le poids d’éventuelles restructurations de dette, les rendant ainsi inévitables. La Chancelière allemande a fait accepter à M. Sarkozy le principe d’un pacte de compétitivité, sur le contenu duquel il semble, monsieur le secrétaire d'État, que vous manifestiez en catimini quelques réticences. En public, on aimerait vous entendre dire clairement où est l'intérêt de l'Europe, de la France, …

… et même de l’Allemagne.
M. Nicolas Sarkozy a déclaré : « L’euro, c’est l’Europe. » Eh bien non ! L’Europe, ce n’est pas l’euro à n’importe quelle condition : ne vous laissez pas instrumenter !
Il est temps que le Gouvernement français cesse de s’inscrire dans la logique du pacte de compétitivité. Il doit, au contraire, changer de cap et proposer, en liaison avec les autres gouvernements européens, un mémorandum mettant l’accent sur trois points : une initiative de croissance européenne fondée sur la relance salariale ; le lancement de programmes de recherche et d’infrastructure financés par un grand emprunt européen ; des pouvoirs nouveaux donnés à la BCE pour racheter sur les marchés secondaires les titres de dette des États que menacerait la spéculation.
L’émission d’Eurobonds garantis à la fois par l’Allemagne et la France pourrait financer des grands programmes d’investissement. Un plan de relance européen, à l’image de celui qui est mis en œuvre aux États-Unis par l'administration Obama, permettrait une sortie coordonnée de la crise. En effet, on ne pourra résorber la dette que par la croissance.
Monsieur le secrétaire d'État, la gestion de la dette elle-même ne devrait pas être abandonnée à un panel de grandes banques qui peuvent se refinancer à coût nul auprès de la BCE et réaliser de scandaleux bénéfices. Il importe de trouver des solutions nouvelles et hétérodoxes : monétisation de la dette ; émission publique d’obligations du Trésor à durée indéterminée, instaurant ainsi un mécanisme de dette perpétuelle.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de résolution déposée par le groupe du RDSE relative à la coordination des politiques économiques au sein de l'Union européenne incite à l’exigence et à l’audace : l’idée européenne est une belle idée, mais on ne la sauvera que par le haut, en la libérant d’un corset néolibéral étouffant !
Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de résolution présentée par nos collègues du groupe du RDSE fait écho à la tournure prise par le Conseil européen du 4 février dernier : alors qu’il devait se focaliser sur les questions d’énergie et d’innovation, le Conseil a surtout été l’occasion pour la France et l’Allemagne de soumettre aux Vingt-Sept leur projet de « pacte de compétitivité ».
La crise économique a plongé le monde et les peuples dans un gouffre de récession et d’incertitudes quant à l’avenir. Si elle a démontré une chose, c’est bien le besoin de mettre fin au système capitaliste et à sa perversité.
D’ailleurs, de nombreux dirigeants européens, à commencer par le Président de la République française, ont même affirmé, en plein cœur de la crise, vouloir « refonder », « réguler » ou encore « moraliser » le capitalisme.
Mais derrière ces effets d’annonce, malgré la disqualification totale du capitalisme, on ne constate aucune volonté sincère de changer. Pis, la teneur du sommet de Davos et le contenu du pacte de compétitivité franco-allemand attestent que les dirigeants européens sont retournés à leurs fondamentaux, qu’ils n’ont jamais vraiment voulu abandonner.
Pour l’Allemagne, soutenue par la France, il n’est en effet plus question de garantir la stabilité financière de la zone euro ni de participer au sauvetage des États membres de l’Union en difficulté sans que ces derniers acceptent des mesures de rigueur.
Ainsi, aux termes du « pacte d’austérité », les pays de la zone euro doivent viser des objectifs communs concernant, entre autres, les pensions, les salaires, les déficits, la flexibilité du travail, l’imposition sur les sociétés.
C’est ainsi qu’il est proposé de mettre fin à l’indexation des salaires sur l’inflation. Les États qui la pratiquent, comme la Belgique, le Luxembourg ou le Portugal, ont déjà fait part de leur refus. Avec une telle mesure, les salaires réels diminueraient. Faut-il rappeler que les salaires sont déjà en quasi-stagnation pour une grande part des salariés ? Faut-il rappeler aussi que la part des salaires dans la valeur ajoutée est aujourd’hui à un point historiquement bas, alors que celle des revenus versés aux actionnaires atteint des sommets ? Dans le cadre de ses travaux préparatoires, la délégation sénatoriale à la prospective le démontre d’ailleurs sans équivoque.
Le « pacte » Merkel-Sarkozy veut aussi généraliser l’âge légal de départ à la retraite à 67 ans. La réforme des retraites qui vient d’être adoptée en France est déjà marquée par une profonde injustice. Il est encore une fois évident que l’on veut demander aux salariés, au plus grand nombre, de payer les conséquences d’une crise dont la responsabilité pèse sur quelques puissants de ce monde.
Jusqu’où la droite poussera-t-elle ainsi le cynisme ?
Le troisième axe central de ce pacte est l’obligation pour les États membres d’inscrire dans leur Constitution une « règle d’or » sur le respect des règles budgétaires européennes.
Une telle mesure aurait pour conséquence de constitutionnaliser l’austérité. En gravant dans le marbre l’obligation d’une politique d’austérité, on cherche à déterminer, d’avance, les politiques des futurs gouvernements, quels qu’ils soient, rendant de ce fait sans objet le vote des citoyens. C’est une très grave atteinte à notre démocratie, à la souveraineté des parlements nationaux qui votent le budget, et à la souveraineté des peuples.
L’inscription de l’interdiction des déficits dans la Constitution marquerait une nouvelle étape, après la mise en place du « semestre européen », qui s’apparente à une véritable mainmise de la Commission sur les budgets nationaux au nom d’une prétendue meilleure gouvernance économique européenne. En effet, à partir de 2011, les gouvernements nationaux devront soumettre leurs projets de budget et de réforme à un examen collectif et à des recommandations préalables de la Commission européenne.
Le pacte de compétitivité s’appliquerait d’abord aux États membres de la zone euro. Mais des États extérieurs à la zone monétaire ou candidats à l’euro pourraient se joindre à ces mesures s’ils le désirent. De ce fait, l’austérité devient une condition nécessaire à l’adhésion à l’euro.
L’argument répété à l’envi et justifiant toutes les politiques d’austérité est indéfectiblement le même : l’ampleur des déficits.
Monsieur le secrétaire d'État, faut-il de nouveau rappeler à la majorité et au gouvernement qu’eux-mêmes sont les créateurs des déficits abyssaux qu’ils critiquent ? En effet, la majorité a une fâcheuse tendance à oublier toutes les mesures prises pour remplir les poches déjà pleines de quelques-uns.
Il en est ainsi des 73 milliards d’euros d’exonérations sociales dont ont bénéficié les entreprises en 2009, sans effet sur l’emploi d’après la Cour des comptes.
Il en est ainsi des centaines de milliards d’euros perdus par l’État du fait que le capital est moins taxé que le travail.
Il en est ainsi des taux d’imposition favorables aux plus hauts revenus, passés, pour ce qui les concerne, de 60 % à 41 % seulement.
Non seulement c’est cette majorité qui a créé le déficit, mais les mesures qui l’ont occasionné n’ont eu absolument aucun effet en termes d’emploi, de croissance ou de niveau des salaires.
Pis, en faisant le choix dogmatique de l’austérité, non seulement vous ne désendetterez pas les États, mais vous appauvrirez la grande masse de la population, ferez tomber notre pays dans la récession et le chômage massif avec, de surcroît, moins de recettes fiscales et donc plus d’endettement public.
Cette thèse est d’ailleurs soutenue par le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz, selon lequel, avec les mesures d’austérité, on court à la catastrophe.
Le pacte de compétitivité choisi comme mode de gouvernance économique européenne est une chasse aveugle aux déficits. Or d’autres logiques doivent prévaloir, d’autant que celles qui ont été mises en œuvre ont démontré leur impuissance.
À l’inverse des politiques de concurrence débridée prônée par les traités européens, la crise économique nous a montré le besoin de mettre en place de nouvelles coopérations et des mécanismes de solidarité.
C’est ainsi que la coopération économique doit se tourner vers l’instauration d’une véritable politique industrielle et de recherche.
À cet effet, la Banque centrale européenne doit jouer tout son rôle ; il convient donc de la réorienter, de la réformer en un outil public propre à venir en aide aux États en difficulté et à financer éventuellement leurs dépenses et investissements sociaux.
En France, les services publics, pourtant malmenés par le Gouvernement, ont joué un rôle d’amortisseur de la crise. La création de services publics européens pourrait ainsi constituer un champ d’action original et efficace.
Même si rien de concret ne devrait être décidé avant une prochaine réunion européenne en mars, laissant le temps au président du Conseil européen de consulter les vingt-sept gouvernements, une chose est certaine : toutes ces mesures inquiétantes seront prises dans un cadre intergouvernemental. Comme cela a déjà été dit, la Commission européenne et, surtout, le Parlement européen sont soigneusement marginalisés.
Dans ce contexte, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au regard des mesures antidémocratiques et antisociales proposées par le couple franco-allemand, la présente proposition de résolution rappelle utilement et à-propos la souveraineté des parlements nationaux en matière de budgets et d’objectifs sociaux.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les conditions qui ont présidé à la création de l’euro, étape essentielle de la construction européenne, éclairent en partie les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui.
Il faut se souvenir de ce que représentait à l’époque, pour nos amis allemands, l’abandon du mark.
À côté de Français qui disposaient d’autres attributs importants de souveraineté et de moyens de rayonnement dans le monde, en particulier un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et une force de frappe indépendante, l’Allemagne était sollicitée pour fondre son seul grand moyen de puissance et de reconnaissance internationale – le mark – dans une monnaie communautaire.
On comprend, dans ces conditions, que l’Allemagne ait prioritairement exigé à l’époque que tout ce qui faisait la force du mark puisse se retrouver dans l’euro, en particulier l’indépendance stricte de la Banque centrale et la lutte contre l’inflation qui rappelait les mauvais moments de la République de Weimar.
Le débat s’est donc alors focalisé sur l’aspect purement monétaire du problème. Certes, le volet économique n’a pas été complètement oublié, avec l’instauration du pacte de stabilité, mais la gouvernance économique n’est pas apparue comme une priorité.
C’est le péché originel de l’euro.
Cela ne l’a d’ailleurs pas empêché de devenir la deuxième devise de réserve mondiale, de renforcer l’intégration des économies européennes, de contenir l’inflation et d’obtenir des taux d’intérêt très bas. Je pense toutefois que l’on n’a pas suffisamment perçu, à l’époque, le fait que la monnaie unique allait autoriser ou camoufler provisoirement le laxisme budgétaire, les écarts de compétitivité, autant de dysfonctionnements qui, sans monnaie unique, apparaissent plus clairement et plus rapidement et qu’il est plus facile de redresser par la dévaluation ou l’inflation. Nous en avons eu un exemple dans notre pays au début des années quatre-vingt.
C’est ainsi qu’il a fallu le tsunami de la crise de 2007, venu des États-Unis, pour faire apparaître au grand jour la dissimulation statistique de la Grèce, les bulles, immobilière en Espagne et financière en Irlande.
Il faut avoir l’honnêteté de reconnaître qu’auparavant des libertés avaient été prises par d’autres États, par l’Allemagne et la France en 2003, par exemple, lorsque ces deux pays avaient demandé l’assouplissement du pacte de stabilité.
Ce couple a, depuis, fait acte de contrition puisque c’est lui qui apparaît aujourd’hui le plus dynamique dans la formulation des propositions pour l’avenir.
Tout a été dit sur ce couple indispensable. On est en droit de se demander où en serait l’Europe s’il n’existait pas. En même temps, il doit prendre garde à deux excès : celui de trop réduire le rôle de la Commission et celui d’indisposer les autres partenaires. Il faut trouver les moyens de mieux associer les uns et les autres dès le départ au processus de réflexion franco-allemand.
Le temps où certains ont pu croire que le pouvoir exécutif européen naîtrait de la Commission est révolu. C’est au sein du Conseil européen que se développe le pouvoir exécutif de l’Union. Mais il faut se garder de deux évolutions exagérées : la Commission ne doit pas être réduite au niveau d’un secrétariat permanent et le Conseil européen ne doit pas prendre prétexte de ce qu’il est l’exécutif pour en rester, dans bien des domaines, au niveau de l’intergouvernemental.
Sur ce point, heureusement, la crise est un bon aiguillon et l’on n’aurait jamais osé imaginer, avant qu’elle n’intervienne, que l’on puisse discuter de tout ce qui est sur la table aujourd’hui : l’instauration du semestre européen, qui établira une meilleure transparence entre les États et vis-à-vis des institutions en incitant à un meilleur autocontrôle, la création du Fonds européen de stabilité financière, la conviction qu’il faut en accroître les moyens et le pérenniser au-delà de 2013 à un niveau suffisant.
Parmi les sujets de discussion figurent aussi la réflexion sur un pacte pour la compétitivité et, ajouterai-je volontiers, pour la convergence, ainsi que la perspective d’inscrire dans la Constitution de chacun de nos États le respect de l’équilibre budgétaire, qui n’est, somme toute, qu’un appel à plus de responsabilité et qui devra tout de même ménager la possibilité d’engager des politiques contracycliques.
Ce sont autant de décisions et de réflexions qui vont dans le bon sens. Elles constituent des acquis que l’on n’aurait jamais obtenus sans la crise.
Certes, des questions importantes restent à régler. Quelles sanctions appliquer ? Quel doit être le montant minimal du Fonds européen de stabilité financière ? L’annonce de son probable doublement me paraît une bonne nouvelle. Dans quels domaines doit s’appliquer le pacte de compétitivité : fiscalité, salaires, retraites, finances publiques ? À quel rythme doit-on faire progresser la convergence ? Je pense que cette question du rythme est aussi importante que celle des domaines à privilégier.
On ne peut pas aider l’Irlande et lui demander, le même jour, de renoncer à son dumping fiscal. Mais, à terme, cette situation devra être revue.
De même, doit-on commencer à interdire l’indexation des salaires chez ceux qui y sont encore très attachés, au point d’en faire un dogme ? Elle est notamment en vigueur dans un pays qui n’a pas de gouvernement depuis de nombreux mois…
Ne faut-il pas aussi que nous balayions devant notre porte en termes de convergence ? À l’intérieur du seul couple franco-allemand, la croissance a été en 2010 de 3, 6 % en Allemagne, qui a touché ainsi les dividendes d’une politique de rigueur instaurée par le gouvernement socialiste de M. Schroeder, et de 1, 5 % en France. Quant au commerce extérieur, il affiche également de fortes disparités auxquelles nous devons remédier.
Enfin, au-delà des sujets sur la table du prochain sommet, n’y a-t-il pas quelques autres questions à se poser, dont certaines ont d’ailleurs été évoquées par notre collègue Richard Yung et moi, dans le rapport que nous avons publié sur ce sujet ?
Ne faut-il pas élargir les objectifs initialement dédiés à la Banque centrale européenne ? La Cour des comptes européenne ne pourrait-elle pas se voir confier un rôle dans la surveillance du respect du pacte de stabilité ? Ne faut-il pas créer un Observatoire de la compétitivité plus indépendant de toutes les institutions ?
Enfin, d’une manière générale, à un horizon plus large et plus lointain, on peut se demander comment faire vivre l’Europe des trois cercles qui existent de fait – le noyau franco-allemand ; l’Europe communautaire de l’euro, qui représente 65 % de la population et 75 % du PIB de l’Union ; l’Europe des Vingt-sept – et, dans le même temps, simplifier l’architecture extrêmement complexe des institutions européennes. Comment assurer à cet ensemble une croissance solide et durable à l’heure de la mondialisation ?
Dans l’état actuel, il n’y a aucune raison pour que la « Stratégie Europe 2020 » n’aboutisse au même échec que la stratégie de Lisbonne.
Si l’on ne choisit pas quelques secteurs privilégiés tels que l’énergie, les transports, les biotechnologies, l’espace, la communication et les technologies de l’information, auxquels on appliquerait une politique plus intégrée que coordonnée dans le domaine de la recherche et du développement, je crains que l’Europe n’ait du mal, dans les décennies à venir, à jouer sa partition dans les affaires du monde. Dans ce cas, c’en serait fini de son modèle social !
Dans ce contexte, pourra-t-on longtemps se contenter d’un budget européen qui représente 1 % du PIB et qui a vu fondre ses ressources propres comme neige au soleil ? Ne doit-on pas s’interroger également sur la capacité d’emprunt de l’Europe ?
Voilà, me semble-t-il, quelques questions auxquelles l’Europe ne pourra échapper dans les prochaines années et dont les réponses vont être déterminantes pour notre avenir.
Je remercie ceux de nos collègues qui ont pris l’initiative de cette proposition de résolution, laquelle nous a permis ce débat. Ils comprendront toutefois que nous n’approuvions pas leur analyse et leurs conclusions.

En effet, nous croyons, pour notre part, que, sur le plan de la construction de l’Europe, cette crise est un puissant accélérateur, pose les bonnes questions et nous oblige à de vraies réponses.
Elle relativise les solutions ultralibérales, qui, selon moi, ont trop dominé la dernière décennie. Et je suis sûr que plusieurs gouvernements socialistes en Europe adhéreront à la démarche en cours. Au-delà des analyses politiciennes, tous ceux qui croient à la nécessité de l’Europe auront à cœur de transformer cette crise en opportunité pour une nouvelle étape de la construction européenne.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à mon tour je remercierai le président Collin d’avoir pris cette initiative. Dans la proposition de résolution qu’il a fort brillamment défendue, il appelle, en effet, à une construction européenne « au service de la croissance et de la prospérité sociale ».
Il considère que, loin d’aller dans ce sens, les projets actuellement en débat sur la gouvernance accroissent, au contraire, l’incohérence de la coopération économique.
Sur ce deuxième point, je crains – nous craignons – qu’il n’ait raison au vu de la situation critique vécue dans la zone euro et les pays qui, en son sein, sont les plus en difficulté. On ne peut que s’inquiéter plus encore si on prend en considération le surplomb donné à la coordination budgétaire.
À cet égard, monsieur le secrétaire d'État, nous vous envoyons un message que nous vous demandons de bien vouloir transmettre au ministre du budget : dans le cadre du semestre européen, nous souhaitons que le programme de stabilité, qui a été envoyé à Bruxelles et dont le principe a été ratifié dans la loi de programmation des finances publiques – que la gauche n’a pas votée, je le rappelle – nous soit soumis avant la reprise des négociations – il faudra mettre au point un calendrier de telle sorte que cela intervienne avant le 30 avril – et nous soit soumis de nouveau à l’issue des négociations, accompagné de l’avis de la Commission. J’espère que vous avez entendu le message. En effet, pour que le semestre européen ait un sens démocratique, les échéances doivent être respectées à l’égard du Parlement national.
Si on analyse de près ce que recouvre la convergence franco-allemande mise en avant par le Président de la République, en plus du pacte de compétitivité qu’il a proposé de concert avec la Chancelière allemande, nous avons des raisons d’être inquiets.
La réunion des ministres des finances du début de la semaine n’a pas marqué une avancée significative dans la réponse globale de l’Union européenne à la crise. Certes, le futur mécanisme européen de stabilité disposera d’une capacité effective de 500 milliards d’euros, mais les sujets clés comme la participation du secteur privé restent en débat. Une série impressionnante de réunions sont prévues jusqu’au sommet des chefs d’État qui se tiendra les 24 et 25 mars prochain. Nous craignons que, comme souvent, le résultat ne soit pas à la hauteur des questions posées.
Je voudrais surtout insister sur le fait que, pendant ce temps, la crise continue. La reprise dans la zone euro marque le pas, sans accélération notable.
Le Portugal a vu son PIB diminuer au dernier semestre de 0, 3 %, alors que le plan d’austérité pèse sur la consommation. Les chiffres de la croissance grecque font ressortir une aggravation de la récession en 2010. À nouveau, les marchés se tendent. L’Institut Bruegel, think thank européen, vient de jeter un pavé dans la mare en déclarant que la Grèce est devenue insolvable et qu’elle ne pourra pas revenir dans l’épure que lui ont fixée les pays de la zone euro.

Croire que l’on pourra se sortir d’une telle crise en resserrant une discipline budgétaire privilégiée sur tout le reste et en revenant à l’équilibre à marche forcée ne fera que réduire la croissance déjà très molle. Surtout, ce n’est pas avec une telle stratégie qu’on préviendra la prochaine crise !
Certes, la Grèce doit réduire son déficit, mais il lui faut du temps. Et ce temps, les marchés le lui refusent.
Au Portugal, le rendement de la dette a atteint des niveaux inégalés et la prime réclamée par les investisseurs pour détenir le papier portugais ne cesse d’augmenter par rapport au Bund allemand.
Pourquoi refuse-t-on de discuter au fond de la proposition Juncker de mutualisation de la dette au niveau européen ? Cet attentisme, qui est mortifère, donne au marché une avance préjudiciable.
Pourquoi ne pose-t-on pas comme objectif de faire de l’Union une zone de croissance durable alors qu’on remet au goût du jour la notion de gouvernement économique ? L’appellation est, au demeurant, bien trompeuse quand on sait qu’il s’agit, d’abord, de coordination budgétaire, de retour en un temps record au pacte de stabilité et, ensuite, d’avancer vers un « pacte de compétitivité » qui propose, par exemple, d’harmoniser l’âge de départ à la retraite, ce qui ne répond absolument pas au problème posé, quand on veut, de surcroît, imposer une règle d’or d’interdiction des déficits publics. Toute règle, fût-elle inscrite dans le marbre constitutionnel, ne tient pas face à des situations exceptionnelles, comme nous l’avons vu, y compris en Allemagne !
Le « paquet gouvernance » qui est avancé présente le risque réel d’occulter les vrais sujets – l’harmonisation fiscale, la croissance, l’innovation, la recherche, l’emploi.
S’agissant de la convergence tant recherchée avec l’Allemagne, il faudrait avant tout se poser la question de savoir s’il existe un « modèle » allemand durable, quand l’économie de ce pays tire essentiellement sa force du marché intérieur. La meilleure phrase que j’ai trouvée est celle de l’économiste allemand Peter Bofinger, très écouté en Allemagne. Il disait tout dernièrement que « le modèle allemand de l’économie compétitive tournée vers l’exportation n’a fonctionné que parce que les autres nations ne l’ont pas adopté ».
Si gouvernement économique il doit y avoir, c’est celui qui présidera à un choix de relance économique européenne.
Le désendettement des États et la réduction des déficits sont, certes, une ardente obligation. Mais que pèseraient-ils sans un dispositif de convergence des politiques économiques ?
Mme Merkel a raison de déclarer que l’euro relève d’un projet politique. Encore faut-il définir lequel ! Cette question doit faire l’objet d’un débat dans notre pays et ne pas être mise sous le tapis, comme c’est le cas depuis 2005. Il s’agit en effet d’un enjeu démocratique, en France et en Europe.
Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur ce point tout au long des mois qui nous séparent de l’échéance majeure de l’élection présidentielle. Je souhaite que ce débat ait lieu, pour la démocratie et pour l’Europe.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’exposé des motifs de la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd’hui me laisse songeur, surtout lorsque je lis que les « projets de “refondation économique” en cours amplifient globalement les incohérences de la coopération économique entre États ».
Je suis chargé, au sein de la commission des affaires européennes, de suivre les problématiques liées à la crise de la dette souveraine. Je me suis ainsi rendu, ces dernières semaines, à Dublin et à Lisbonne. J’irai, dans les prochains mois, à Madrid et à Athènes. Si les raisons de la crise divergent d’un pays à l’autre, j’ai partout observé une réelle attente des gouvernements, mais aussi des opinions publiques, à l’égard de l’Union européenne afin que, justement, elle mette en œuvre les projets que la proposition de résolution paraît dénoncer.
N’en doutons pas, mes chers collègues, les dispositifs d’aide et de surveillance dont les gouvernements veulent doter la zone euro sont de nature à aider les États concernés à répondre aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer, notamment sur les marchés financiers. Ils viennent pallier l’absence existant jusqu’alors de réelle coopération entre les États membres de la zone euro. L’aide accordée par le Fonds européen de stabilité financière à la Grèce et à l’Irlande leur a ainsi permis de consolider leurs budgets sans avoir à lever des fonds à des taux exorbitants. Le filet de sécurité que représente ce fonds permet aujourd’hui au Portugal et à l’Espagne de bénéficier d’une relative détente des taux sur le marché obligataire.
Je vous invite, à cet égard, à observer l’effet sur les marchés des récentes annonces concernant une redéfinition du périmètre de ce fonds. Lisbonne a pu emprunter, le 12 janvier, à un taux inférieur aux prévisions, les places financières étant pour partie rassurées par la consolidation annoncée du mécanisme de soutien européen qui pourrait, le cas échéant, aider le Portugal.
Ce fonds n’a-t-il pas, dès lors, rempli sa mission ? La révision prévue de son mode de fonctionnement en vue de renforcer sa capacité d’intervention, comme sa pérennisation à l’horizon 2013 me semblent aller dans le bon sens. Je ne comprends donc pas les réserves exprimées à ce sujet par les auteurs de la présente proposition de résolution.
Les mécanismes critiqués dans la proposition de résolution n’apparaissent pas « insusceptibles d’efficacité », pour reprendre la formule tout aussi technocratique que celle des fameux « conclaves fermés » cités dans l’exposé des motifs. Au contraire, ces dispositifs participent plutôt d’une réflexion jusqu’alors inédite sur une véritable gouvernance politique de la zone euro.
Jusqu’à présent, l’Union économique et monétaire ne marchait que sur une jambe, pour reprendre la formule de Jacques Delors. Cette situation instable a permis la poursuite, par certains pays, de stratégies en solitaire, à rebours des impératifs de solidarité qu’impose une zone monétaire unique.
La réponse de l’Union européenne à la crise de la dette souveraine constitue, de fait, une opportunité indéniable pour permettre à la zone euro de fonctionner convenablement, en corrigeant notamment ce que je serais tenté d’appeler « les excès de souverainisme économique ». Celui-ci a revêtu plusieurs formes, de part et d’autre de l’Union européenne, qu’il s’agisse de la dérégulation et de la défiscalisation en Irlande, du mensonge budgétaire grec, de l’absence assumée de réforme de son économie par le Portugal ou de l’investissement, qualifié d’ « insensé » par certains, de l’Espagne dans l’immobilier. Ces aventures économiques ont abouti à des impasses, dont souffrent en premier lieu les peuples concernés, soumis à des politiques d’ajustement drastiques.
Soyons précis, mes chers collègues : ce n’est pas l’Union européenne qui impose l’austérité, mais bien les situations économiques nationales. Dans le cas irlandais, on observera que l’appel à l’aide européenne n’est intervenu qu’après la présentation d’un plan d’austérité. En ce qui concerne le Portugal, comme l’Espagne d’ailleurs, les mesures de rigueur sont accompagnées d’une communication gouvernementale axée sur le refus de l’intervention conjointe de l’Union européenne et du Fonds monétaire international.
Comme l’a dit Pierre Bernard-Reymond, notre groupe ne peut, en conséquence, voter en faveur de cette proposition de résolution, qui semble condamner la plupart des solutions innovantes aujourd’hui sur la table, notamment celles soutenues par le couple franco-allemand.
Certes, les auteurs de ce texte appellent de leurs vœux une meilleure coordination des politiques économiques au sein de l’Union, mais ils se gardent bien d’en préciser les contours ! Cette déclaration de bonnes intentions ne peut masquer des réflexes, pour ne pas dire des crispations, souverainistes, qui empêchent ces mêmes auteurs de déterminer les responsabilités de certains États dans la crise actuelle et les poussent à dénoncer, de façon quasi-pavlovienne, toute initiative de l’Union européenne, fût-elle intergouvernementale.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Christine Lagarde étant retenue à Bercy en raison de la réunion des ministres des finances du G20, le Premier ministre m’a fait l’honneur de me désigner pour présenter devant vous la position du Gouvernement sur la proposition de résolution relative à la coordination des politiques économiques au sein de l’Union européenne.
Même si les arguments développés par le président Collin nous paraissent contestables, et parfois un peu surprenants, pour reprendre la formule de M. Humbert, le sujet soulevé est à l’honneur du Sénat, car il pose des questions essentielles : l’avenir de la zone euro, la nécessité de politiques économiques au service de la croissance, l’impératif du contrôle démocratique...
Permettez-moi de faire, tout d’abord, une remarque d’ordre général.
Bien que l’observation de l’évolution des finances publiques des pays de la zone euro fasse apparaître une situation plutôt moins dégradée en Europe que dans d’autres grandes économies avancées, comme celles des États-Unis et du Japon, l’Europe a dû faire face, depuis janvier 2010, à une crise de défiance à répétition de la part des marchés financiers, qui vise, tour à tour, l’un ou l’autre des États membres, et nous a contraints à réagir vigoureusement.
Bien entendu, nous devons rester vigilants. Les tensions persistent sur les marchés financiers, alors que la zone euro, et notamment la France, présente des fondamentaux solides et s’est placée sur une trajectoire de consolidation de ses finances publiques. Par ailleurs, la stabilité financière de la zone euro continue à être remise en cause, en raison de la crise de liquidités que traversent plusieurs États vulnérables.
Face à cette divergence entre la réalité économique et la perception des marchés, nous avons tous un devoir de fermeté absolue pour réaffirmer notre détermination à défendre la stabilité de la zone euro, notre solidarité avec les États membres les plus vulnérables et notre engagement intangible vers la consolidation budgétaire. En effet, le défaut n’est pas une option, tout simplement parce qu’il n’est pas une solution.
Le Président de la République a déclaré à Davos, il y a quelques semaines : « Je peux vous assurer que, aussi bien Mme Merkel que moi-même, jamais, vous m’entendez jamais, nous ne laisserons tomber l’euro. Jamais ».
Je vais maintenant répondre point par point aux questions que vous avez soulevées.
Premièrement, vous indiquez que « la situation économique et sociale de l’Europe ainsi que les mesures prises ou envisagées contreviennent manifestement » aux « engagements des États européens dans les traités convenus entre eux et les actes pris pour leur application dans les domaines économique, social, financier et monétaire ».
Je ne comprends pas très bien cette affirmation. La crise de 2007-2008, importée des États-Unis, s’impose à nous : c’est une réalité ! Je ne vois pas en quoi elle serait contraire aux traités, avec lesquels elle n’a pas grand rapport ; elle a à voir avec la réalité économique du monde.
Nous devons plutôt nous demander, monsieur Collin, si l’Europe s’en est plutôt mieux sortie grâce à la construction européenne, ou non. Le précédent de la crise de 1929, caractérisé par l’éparpillement des ripostes nationales à la crise, montre bien que l’Europe a agi comme un écran de protection pour l’ensemble de nos sociétés.
Grâce à l’Europe, depuis le début de la crise économique et financière survenue il y a trois ans, nos États – et notamment la France, qui était chargée de la présidence de l’Union européenne ! – ont pris, ensemble, des mesures qui nous ont permis d’en limiter les effets sur nos économies, et donc sur la vie de nos concitoyens. En outre, la France a œuvré avec force pour que la réponse mondiale soit coordonnée dans le cadre d’une institution nouvelle, le G20, qui regroupe les grandes puissances établies et émergentes. Je trouve donc votre critique excessive.
Deuxièmement, vous insistez, à juste titre, sur la nécessité de respecter les processus démocratiques. Le vieux parlementaire que je suis ne peut que vous approuver. Cette exigence, loin d’être remise en cause, me semble pourtant largement mise en œuvre.
M. Badré, grand partisan de l’Europe, sait bien que le traité de Lisbonne a largement contribué à une prise de décision plus démocratique dans l’Union européenne ; M. Bel, lui-même, a évoqué les pouvoirs des parlementaires européens.
Tout d’abord, le rôle du Parlement européen, institution élue au suffrage universel direct, a été considérablement renforcé – certains d’ailleurs le déplorent, à l’instar de M. Chevènement ! –, notamment par l’extension de la procédure de codécision législative, qui donne au Parlement des pouvoirs législatifs comparables à ceux du Conseil des ministres, à près de cinquante nouveaux domaines. Par ailleurs, la participation directe des citoyens a été rendue possible par l’introduction dans le droit communautaire d’un droit d’initiative citoyenne. Celui-ci permet à un million de citoyens provenant d’un nombre significatif d’États membres de demander à la Commission de proposer un projet de texte législatif.
Les parlements nationaux sont également de plus en plus impliqués : le Parlement est déjà systématiquement saisi des projets de directives et de règlements européens, mais nous sommes allés encore plus loin.
J’attire votre attention sur une réforme fondamentale qui a été évoquée, à plusieurs reprises, par des orateurs de toutes sensibilités : le « semestre européen ». Le principe est d’informer les parlements en amont des envois à Bruxelles des documents relatifs à la gouvernance économique de l’Union européenne et de la zone euro.
Je précise, pour Mme Bricq, que le conseil pour les affaires économiques et financières, dit conseil ECOFIN, procède ensuite à l’examen des textes. L’ensemble de la procédure se déroule entre les mois d’avril et de juin ou juillet. Ces textes reviennent ensuite au niveau des États et font l’objet d’un vote des Parlements nationaux dans le cadre du projet de loi de finances. Ce vote intervient donc après la consultation en amont et l’examen des textes par les instances communautaires et le Conseil.
La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la période 2011à 2014 prévoit ainsi que le projet de programme de stabilité sera adressé au Parlement au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne, afin que le Sénat et l’Assemblée nationale puissent porter un regard conjoint sur la coordination des politiques européennes. Le principe est également de permettre une meilleure prise en compte des préconisations européennes, dans le strict respect des compétences de nos parlements respectifs, dans les grands choix de politique économique et budgétaire des États membres, et une meilleure articulation de la surveillance budgétaire avec celle des politiques de croissance, dans le cadre de la stratégie Europe 2020.
Je voudrais également souligner le fait que le plan d’assistance à la Grèce – et je m’en souviens très bien, c’était il y a exactement un an –, de même que la création du Fonds européen de stabilité financière ont été discutés et votés ici même comme à l’Assemblée nationale. Permettez-moi de vous rappeler que c’est le 6 mai 2010, alors que nous célébrions en France le 60e anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, qu’a été voté, à la quasi-unanimité des deux chambres, le plan d’assistance à la Grèce.
Un mois après, messieurs Collin et Chevènement, vous vous absteniez cette fois de voter le Fonds européen de stabilité financière. Toutefois, monsieur Collin, je note que vous affirmez soutenir ce plan, dont vous avez évoqué la possibilité dès 2009, et que vous en souhaitez aujourd'hui la pérennisation.
Par ailleurs, et c’est bien normal, vous avez auditionné Mme Lagarde voilà quelques semaines sur le plan d’assistance à l’Irlande. Nous sommes donc très loin de la « “pensée unique” imposée par des conclaves fermés à toute critique », comme je l’ai lu dans l’exposé des motifs de votre proposition de résolution ! Une fois encore, je trouve que la réalité est quelque peu différente de ce que vous en faites.
Certes, on peut considérer que de tels mécanismes sont insuffisants, mais tout ce qui concernait la mise à disposition de financements sur la base de la solidarité financière en Europe a été décidé sur la base du vote souverain des parlements nationaux, en particulier du nôtre, ce qui, d’ailleurs, est tout à fait normal. Ces mécanismes seront maintenus.
Troisièmement, vous appelez à poursuivre les travaux en cours sur le mécanisme permanent de résolution de crise. Là encore, c’est précisément ce que nous faisons.
La crise nous a offert une leçon : la nécessité pressante de doter l’Union européenne d’un mécanisme permanent qui permette d’intervenir en cas de difficultés d’un État membre de la zone euro.
Rappelez-vous : en mai 2010, les rendements exigés par les marchés avaient quasiment fermé aux États périphériques l’accès au marché obligataire et les menaçaient littéralement d’étranglement. Or, à l’époque, le traité interdisait à un État membre de venir au secours d’un État menacé à l’intérieur de la zone euro. Qu’a-t-il été fait, sur l’initiative, là encore, du Président de la République et de la France, en liaison avec l’Allemagne ? Un mécanisme de soutien a été littéralement inventé, un mécanisme exigeant et qui met en avant le principe de la solidarité. Là aussi, il me semble que la critique est un peu sévère, car ces mécanismes ont été inventés en réaction à la crise la plus grave qui ait eu lieu depuis les années 1920, ainsi que le rappelait M. Bel.
C’est dans ces conditions que Christine Lagarde et ses homologues ministres des finances de la zone euro ont alors décidé de mettre en place, pour une durée de trois ans – le traité interdisait en effet à ce stade un système pérenne – un Fonds européen de stabilité financière destiné à refinancer des États membres de la zone euro en difficulté, en leur apportant jusqu’à 440 milliards d'euros de financements sous forme de prêts ou de lignes de crédits.
Même si je sais qu’elle est critiquée, je voudrais également souligner le rôle positif qu’a joué la Banque centrale européenne, la BCE, sous l’autorité de son président, M. Trichet, dans la résolution de la crise.
En toute indépendance, la BCE a fait preuve d’un pragmatisme et d’une réactivité exemplaire, notamment en élargissant les actifs financiers éligibles à son refinancement, en maintenant ses guichets de liquidité exceptionnels et en intervenant sur le marché secondaire des titres d’État, ce qui était radicalement nouveau par rapport à ses positions précédentes. Son action a été déterminante dans la résistance de la zone euro aux coups de boutoir des marchés financiers. Telle est la réalité.
Toutefois, une telle action de la BCE ne pouvait être pérenne ni menée de façon isolée : il était nécessaire que l’Union européenne mette en place un mécanisme permanent pour crédibiliser aux yeux des marchés la volonté des États membres de sauvegarder la monnaie unique européenne.
C’est pourquoi les chefs d’État et de gouvernement ont décidé d’instituer un mécanisme européen de stabilité pour les États membres de la zone euro, qui se substituera à compter de la mi-2013 au dispositif mis en place en mai 2010 ; je note d’ailleurs – avec plaisir – que le président du groupe socialiste soutient cette initiative.
Les ministres des finances de la zone euro ont donc reçu comme mandat très clair du Conseil européen du 4 février 2011 de préciser les caractéristiques de ce futur mécanisme d’ici au mois de mars 2011, c’est-à-dire avant le prochain Conseil évoqué voilà quelques instants par Jean-Pierre Chevènement.
Sachez cependant qu’il est d’ores et déjà acquis que l’assistance devra s’inscrire dans un programme d’ajustement rigoureux, établi et suivi par le FMI et la Commission européenne en lien avec la BCE, et que la participation du secteur privé se fera au cas par cas, sans automaticité, en cohérence avec les procédures d’implication du secteur privé définies par le FMI.
Quatrièmement, nous partageons bien entendu votre souci d’une meilleure régulation des institutions responsables de la crise. Le défi aujourd’hui consiste à rétablir la confiance des ménages et des entreprises dans notre système financier. Pour cela, nous devons créer un cadre de supervision et de régulation solide.
Notre première priorité est de faire en sorte que les nouvelles autorités européennes de supervision financière et le nouveau Comité européen du risque systémique, en place depuis le 1er janvier 2011, soient dotés des moyens d’accomplir leur mission. Je signale d’ailleurs que ces institutions ont bien souvent été remodelées à l’initiative de la France, en liaison avec l’Allemagne. Elles ont désormais commencé leur travail.
Je souligne que les candidats à la présidence des autorités européennes de supervision ont été auditionnés par le Parlement européen, qui n’a pas manqué de demander et d’obtenir des assurances sur la parité et l’indépendance des dirigeants.
Notre seconde priorité consiste à fortifier les banques en renforçant notamment la qualité et la quantité de leurs fonds propres, tout en veillant à ne pas les pénaliser sur le plan de la compétitivité.
En tant que ministre du commerce extérieur, permettez-moi de faire une petite parenthèse : nous devons prendre garde à ne pas être les seuls à imposer des règles extrêmement drastiques, car cela nous pénaliserait pour le financement de nos exportations par rapport à d’autres pôles de puissance ; à mon sens, c’est un point important.
M. Yvon Collin fait un signe d’assentiment.

Nous ne sommes pas les seuls ! L’Allemagne fait plus que nous sur ce plan !
Je souligne par ailleurs que les tests de résistance seront conduits avant l’été 2011 afin de vérifier la solidité de nos banques en cas de choc économique.
Notre dernière priorité sera la mise en œuvre d’un environnement financier plus stable, plus solide et plus transparent. Cela concerne notamment : l’encadrement des ventes à découvert ; la nécessité d’assurer la transparence et la sécurité des marchés dérivés ; la désaccoutumance progressive des acteurs des marchés financiers, des régulateurs et des banques centrales des notations externes ; le fait de favoriser une plus grande concurrence dans l’industrie et de réduire les effets pro-cycliques des notations souveraines.
Il me semble que ces mesures en cours de réalisation satisfont l’une des propositions de votre projet de résolution, monsieur Collin.
Cinquièmement, vous demandez l’instauration d’un cadre macroéconomique favorable à une croissance économique forte et durable. Un certain nombre d’intervenants ont abordé le sujet ce matin, d’ailleurs de façon fort intéressante. Cependant, il s’agit là non pas d’un débat institutionnel européen mais d’un débat politique, au demeurant noble et qui mérite d’être porté devant l’opinion.
Selon nous, un tel objectif est déjà en partie réalisé.
Permettez-moi de vous rappeler que c’est à l’initiative du Président de la République que le concept de gouvernement économique européen s’est imposé en Europe, et ce auprès non pas de l’ensemble des membres de l’Union européenne mais des seuls membres de la zone euro. Les États membres de l’Union européenne qui bénéficient de la clause de l’opting-out sur la monnaie unique ne sauraient en effet se trouver autour de la table du Conseil lorsqu’il est question de politique économique commune à l’intérieur de la zone monétaire.
Six textes sur le renforcement de la gouvernance économique européenne sont actuellement à l’étude, en étroite coopération avec le Parlement européen. Ils concernent le renforcement de la surveillance budgétaire, la mise en place de règles minimales communes en matière de cadres budgétaires nationaux ou encore la création d’une surveillance des déséquilibres macroéconomiques entre les États de l’Union européenne.
Ce dernier volet permettra de réduire les risques de déséquilibres néfastes pour la viabilité économique de l’Europe. Nous devons remettre nos économies sur la voie de la convergence, condition indispensable au développement d’une croissance harmonieuse, forte et créatrice d’emplois qualifiés.
Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de relever dans les propos de Mme Bricq, de M. Chevènement et de Mme Terrade des appréciations quelque peu erronées.
Ainsi que l’a souligné M. Humbert tout à fait justement, les crises ou les spéculations contre un certain nombre d’États à l’intérieur de la zone euro ont pu avoir pour origine, certes, le manque de cohérence de la zone et l’absence de gouvernement économique – nous nous employons à y remédier –, mais également les politiques nationales menées par certains, des politiques pour le moins contestables, notamment en matière de déficits, surtout lorsqu’il s’est agi de dissimuler des déficits réels.
De tels phénomènes bien évidemment accélèrent les crises. Ce que nous essayons de mettre en place, ce sont des mécanismes de discipline communs permettant d’éviter leur développement. Concernant les causes du problème, il ne faut donc pas se tromper de cible.

Le problème, c’est le rythme ! Il n’est pas adapté ! On ne peut pas faire cela en trois ans, ce n’est pas vrai !
Par ailleurs, dans la période de sortie de crise – et M. Chevènement a raison de le souligner –, la solution aux dettes et, plus largement, à la crise, c’est bien sûr la croissance. Mais c’est sur l’interrogation suivante que le débat politique intervient : comment s’organise la croissance ? Nous estimons pour notre part que la croissance doit être raisonnable et qu’elle doit passer par la maîtrise des déficits et une meilleure compétitivité. Je crains que pour certains des orateurs qui se sont exprimés ce matin la critique du « modèle allemand », la critique de l’ultralibéralisme – critique que je partage d’ailleurs sur certains points –, …
… ne mène à une politique de facilité, de planche à billets, de « dette perpétuelle » – je cite l’expression de M. Chevènement –, de culture permanente des déficits intérieurs et extérieurs, …
… qui n’est pas la solution au problème de compétitivité posé à l’Europe.
Je suis désolé de vous le dire, l’Europe – et singulièrement la France – n’a pas vocation à rester un territoire d’expansion des puissances émergentes pour devenir en bout de course, selon la vision développée par M. Houellebecq dans son dernier roman, un territoire de vacances pour cadres chinois fatigués qui viendraient visiter nos restaurants et nos musées !
Telle n’est pas notre vision de la France ! Oui à la croissance, mais celle-ci passe par la résorption de nos déficits, une meilleure gestion de nos déficits publics et une politique d’exportation plus dynamique.
Sur ce dernier point, madame Bricq, monsieur Chevènement, monsieur Bel, pardonnez-moi de vous le faire remarquer, la diabolisation du modèle allemand n’est pas la solution !
D’ailleurs – je le note au passage –, ce modèle tel qu’il existe aujourd’hui est le résultat de réformes nécessaires qui ont été menées par des chanceliers socialistes il y a dix ans.
Ce débat – au demeurant très intéressant – sur la politique économique me paraît tout de même assez éloigné de l’objectif de votre résolution : rien dans ce que nous mettons en place actuellement, dans le cadre de négociations franco-allemandes, ne condamne les peuples d’Europe à l’austérité ou à l’appauvrissement. Au contraire, il me semble que c’est la voix raisonnable qui nous permettra d’éviter de nouveaux chocs contre la monnaie commune.
Nous partageons la même monnaie, la même politique monétaire et nous réfléchissons ensemble à la réduction des écarts de compétitivité, à une meilleure coordination des politiques économiques au sein de la zone, afin justement de faire converger nos modèles économiques et sociaux.
Vous souhaitez également une meilleure coordination en matière fiscale, tout en interdisant à l’avance à la France d’inscrire un objectif de maîtrise des déficits dans la Constitution ; M. Chevènement indiquait voilà quelques instants que c’était une régression. Mais en quoi les déficits constituent-ils un progrès ?
Au contraire, le progrès consiste justement à contrôler nos dépenses, à faire en sorte de ne pas lester les générations futures des déficits de fonctionnement des générations actuelles !
Pour répondre à la demande formulée par le Président de la République le 21 juillet dernier, un rapport sur la convergence fiscale franco-allemande devrait donc être présenté dans les tout prochains jours par la Cour des comptes. Au-delà de l’Allemagne, la France se bat depuis des années pour améliorer la coordination des politiques fiscales nationales et encourage notamment la Commission européenne à présenter une proposition de directive visant à établir une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés.
Cela vaut notamment pour l’Irlande, que nous voulons voir converger vers une moyenne européenne. Le projet devrait d’ailleurs être présenté par le commissaire à la fiscalité au mois de mars.
Sur la question des changes, que vous avez eu raison de soulever, je vous répondrai qu’il est en effet dans l’intérêt des États membres de la zone euro d’avoir une devise stable car une volatilité des changes excessive aurait des implications négatives pour nos entreprises, nos agriculteurs, nos consommateurs, nos exportations. Les travaux sur la réforme du système monétaire international – une fois encore il s’agit d’une initiative de la France – débutent aujourd’hui même sous la présidence française du G20, qui en a fait une de ses priorités.
Une solution globale doit être recherchée à un problème qui concerne non seulement l’euro, mais également la plupart des monnaies des économies développées et en développement, dans un monde marqué par des déséquilibres mondiaux importants. Nous devons, en effet, absolument éviter d’entrer dans une logique de surenchère sur les changes qui serait finalement préjudiciable à tous. Nous devons aussi apporter plus de stabilité aux perspectives macroéconomiques, par une croissance plus forte, plus équilibrée et plus durable. La question de la volatilité des changes sera abordée à travers les grands axes de réflexion que nous proposons sur la réforme du système monétaire international, à savoir : accroître la protection face à la volatilité des flux de capitaux, répondre de façon ordonnée au besoin de diversification des réserves de change, améliorer la coordination des politiques macroéconomiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les observations que je voulais formuler sur la présente proposition de résolution. Le Gouvernement se réjouit de l’occasion qui nous a été donnée ce matin de débattre de l’évolution du travail accompli sur la crise, sur la consolidation de la zone euro. Le débat sur la politique économique et les déficits est un débat noble, mais nous ne l’épuiserons pas aujourd'hui.
Pour l’ensemble des raisons invoquées, le Gouvernement se prononce pour le rejet de cette proposition de résolution.

Personne ne demande plus la parole ?...
Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu les articles 1er à 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,
Vu le chapitre VIII bis du règlement du Sénat,
Considérant les engagements des États européens dans les traités convenus entre eux et les actes pris pour leur application dans les domaines économique, social, financier et monétaire,
Considérant que la situation économique et sociale de l’Europe ainsi que les mesures prises ou envisagées contreviennent manifestement à ces engagements,
Considérant que lesdites mesures insusceptibles d’efficacité sont de nature à aggraver les risques globaux subis par les peuples d’Europe et échappent pour certaines des plus décisives à tout contrôle démocratique,
Rappelle au respect des objectifs de l’Union européenne,
Invite le Gouvernement français à veiller à une stricte application des procédures démocratiques qui, dans la République française, permettent à la souveraineté nationale de se prononcer conformément à la Constitution sur les actes essentiels de la vie de la Nation,
Se félicitant de l’instauration d’un mécanisme européen de gestion de crise appelle à le compléter et à renforcer l’implication des institutions responsables des crises financières subies par les économies européennes,
Formule le vœu que les gouvernements européens adoptent des attitudes coopératives pour instaurer un cadre macroéconomique enfin favorable à une croissance économique forte et durable,
Souhaite particulièrement, à cet effet, qu’ils s’engagent sur des objectifs sociaux précis et contrôlés, notamment dans le domaine salarial, qu’ils exercent l’ensemble des compétences monétaires confiées à eux par les traités, en particulier s’agissant du taux de change de l’euro, qu’ils parviennent à éliminer la concurrence fiscale et qu’ils avancent de concert dans la mise en œuvre de la « Stratégie Europe 2020 ».

Mes chers collègues, la conférence des présidents ayant décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolution.
J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe du RDSE et, l'autre, du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 162 :
Nombre de votants339Nombre de suffrages exprimés315Majorité absolue des suffrages exprimés158Pour l’adoption132Contre 183Le Sénat n'a pas adopté.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à reconnaître une présomption d’intérêt à agir des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat en matière de recours pour excès de pouvoir (proposition n° 203, rapport n° 278).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous avons déposée s’inscrit dans la continuité du débat du 12 janvier dernier sur l’édiction des mesures réglementaires d’application des lois, débat dont le groupe du RDSE avait pris l’initiative.
Notre groupe a en effet pris au mot l’objectif de revalorisation du rôle du Parlement que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a mis en avant. C’est donc en vue de donner au Parlement et à ses membres les moyens d’exercer pleinement leur double mission de confection de la loi et de contrôle de l’action du Gouvernement que nous avons souhaité que le Sénat débatte aujourd’hui de cette proposition de loi.
Au-delà d’une question de technique juridique assez complexe, il faut bien le dire, les enjeux sont essentiels. L’article 24 de la Constitution prévoit depuis 2008 que le Parlement exerce, notamment, une mission de contrôle de l’action du Gouvernement, mission dont, avouons-le, les deux assemblées n’ont pas encore pris la pleine mesure.
Ce contrôle est informel et revêt donc une nature d’abord politique, qui s’étend, par exemple, au contrôle de l’application des lois, au contrôle budgétaire ou encore à l’analyse des dysfonctionnements des services de l’administration. Pour indispensable qu’il soit, il n’en est pas moins limité, tant dans sa nature que dans sa portée, et le débat que nous avons mené le 12 janvier dernier en a fourni une éclatante illustration.
Aux termes de la Constitution, chacun le sait, le Parlement ne peut enjoindre au Gouvernement de prendre une mesure réglementaire, non plus que lui fixer un délai pour ce faire. Dès lors, si le Parlement vote souverainement la loi et exprime ainsi la volonté générale, il advient beaucoup trop souvent que la mise en œuvre de la loi, qui dépend du pouvoir réglementaire, se retrouve paralysée, pour ne pas dire annihilée, par les retards d’édiction des actes réglementaires, que ces retards soient involontaires ou, ce qui est plus grave, délibérés.
Cette situation n’est naturellement pas acceptable dans notre démocratie. Je ne reviendrai pas sur les éléments dont nous avons longuement débattu le 12 janvier et qui démontrent l’insécurité juridique engendrée par cette situation. Je rappellerai simplement que tous les intervenants s’étaient alors accordés sur ce point essentiel, ce dont je me réjouis, même si les solutions envisagées n’allaient pas dans la même direction, mais cela n’a rien d’étonnant dans le cadre du débat démocratique.
La présente proposition de loi est la réponse des membres du groupe du RDSE au débat du 12 janvier et son champ va même au-delà de la seule carence du pouvoir réglementaire. Elle exprime, en toute hypothèse, notre volonté de ne pas laisser les membres du Parlement dans l’impuissance et, au contraire, de renforcer leur rôle.
C’est pour ces raisons impérieuses que nous souhaitons aujourd’hui que les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat puissent, ès qualité, se voir reconnaître un intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir dans les trois hypothèses suivantes : premièrement, lorsque le pourvoir réglementaire empiète sur une matière que la Constitution réserve au pouvoir législatif, violant ainsi une prérogative du Parlement ; deuxièmement, lorsqu’une mesure réglementaire viole une loi et méconnaît, de ce fait, la volonté du législateur ; troisièmement, lorsque le pouvoir réglementaire rend une loi inapplicable en ne prenant pas dans un délai raisonnable les mesures réglementaires qu’impose la loi.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’en ai parfaitement conscience, si nous souscrivons tous à l’idée de revaloriser le rôle du Parlement, le présent texte suscite des réactions contrastées, qui ont, du reste, été très largement exprimées en commission des lois.
Avant d’aller plus loin, je tiens d’ailleurs à saluer l’exceptionnelle qualité du travail accompli par le rapporteur de la commission des lois. Votre analyse, cher collègue Jean-René Lecerf, a réussi à embrasser l’ensemble des enjeux de cette proposition de loi, sans la caricaturer en y voyant un coup politique dirigé contre le Gouvernement ; de fait, ce n’était nullement notre objectif. Vous avez parfaitement cerné notre intention : défendre les prérogatives du Parlement, une préoccupation qui nous anime tous dans cet hémicycle, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons. Votre rapport traduit une recherche d’équilibre et un effort constructif que nous apprécions à leur juste valeur.
Le constat qui nous a conduits à déposer la présente proposition de loi est simple : dès lors que les actuels moyens de contrôle du Parlement sur le Gouvernement ne garantissent pas que la volonté souveraine exprimée au travers du vote de la loi est respectée, ou encore que le domaine propre du Parlement est violé, est-il illégitime de doter les parlementaires de nouveaux outils ? À notre sens, la réponse est non.
Après tout, ce type de dispositif existe déjà depuis 1974, lorsque fut introduite la saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés ou soixante sénateurs.
De même, la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité, depuis le 1er mars 2010, a permis d’étendre considérablement le champ des intérêts pouvant faire l’objet d’une protection juridictionnelle, en l’occurrence au bénéfice de personnes privées et même publiques, ce que nous avions tous salué comme une avancée de l’état de droit.
Alors, ne serait-il pas paradoxal de laisser aussi restreinte la capacité d’agir de ceux-là mêmes qui œuvrent dans l’intérêt général ? C’est pourquoi ne nous paraît pas fondé l’argument selon lequel ouvrir davantage les prétoires à la parole des membres du Parlement reviendrait à dénaturer la fonction parlementaire, argument que vous aviez avancé, monsieur le ministre, lors du débat du 12 janvier dernier. Au contraire, il est du rôle des tribunaux de sanctionner la violation de la loi, en l’espèce l’inaction fautive du pouvoir réglementaire, ou encore l’empiétement non consenti sur le domaine de la loi.
Dans ces conditions, il est tout à fait logique qu’un contrôle de nature politique et informelle puisse se prolonger sur le terrain du droit, au nom de l’intérêt général, mais surtout au nom de la défense des prérogatives du Parlement.
Je rappellerai qu’en l’état actuel du droit l’inaction du Premier ministre lorsqu’il s’agit d’édicter dans un délai raisonnable une mesure réglementaire d’application d’une loi peut être contestée devant le Conseil d’État, qui sanctionne ce refus depuis 1962 et le considère même, depuis 1964, comme engageant sa responsabilité. Il n’y a donc rien d’illégitime à ce que les parlementaires, collectivement auteurs de la loi, puissent dans tous les cas, et bien sûr sans préjuger du fond, demander à ce que soit réparée une faute de l’administration, en l’occurrence celle du Premier ministre.
Mes chers collègues, à la question de savoir si un parlementaire peut en tant que tel agir par la voie du recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État n’a, de façon très surprenante, jamais explicitement répondu. En la matière, la jurisprudence est aussi rare qu’incertaine, ce que le rapporteur public Rémi Keller résumait fort joliment en 2010, dans ses conclusions sur l’arrêt Fédération nationale de la libre pensée, par la formule suivante : « Le parlementaire frappe depuis plusieurs décennies à la porte de votre prétoire ; il ne sait toujours pas si elle lui est ouverte ou fermée. »
Plusieurs de nos collègues ici présents ont frappé à cette porte : Jean-Pierre Sueur l’a trouvé fermée, tandis que Nicole Borvo Cohen-Seat a réussi à la franchir, pour des raisons assez obscures, d’ailleurs, dans chaque cas.
Jusqu’à présent, le Conseil d’État n’a jamais ouvertement apporté de réponse à cette question pourtant essentielle à l’équilibre des pouvoirs.
S’il a accepté d’examiner la recevabilité de l’intérêt à agir, ce n’est qu’en attribuant au parlementaire requérant une autre qualité : président du comité des finances locales pour contester un décret relatif au Fonds de compensation pour la TVA, consommateur de produits pétroliers pour contester le refus de mise en œuvre de la « TIPP flottante », usager du service public de la télévision pour contester la suppression de la publicité sur France Télévisions, actionnaire d’une société d’autoroute pour contester la privatisation d’une concession.
À l’inverse, le Conseil d’État n’a pas hésité à examiner des requêtes directement au fond, sans statuer sur la recevabilité ; j’en ai moi-même fait la cruelle expérience avec certains de mes collègues du RDSE, l’année dernière, à l’occasion du recours que nous avions déposé contre un décret ratifiant un accord passé entre la France et le Saint-Siège concernant la reconnaissance des diplômes universitaires.
Au final, cette situation a fait dire à la doctrine, comme l’écrit le rapporteur, et à juste raison, que le Conseil d’État oscille entre contournement et évitement. De toute évidence, il n’est pas à l’aise.
Mes chers collègues, cette incertitude jurisprudentielle n’a que trop duré. Elle est source d’insécurité juridique, les raisons en étant trop opaques. Je ne me permettrai pas, bien entendu, de donner des leçons de droit aux membres du Conseil d’État, mais je tiens à rappeler que la clarté et la prévisibilité des règles nourrissent notre État de droit, y compris s’agissant de la jurisprudence. À partir du moment où la souplesse de la jurisprudence ne parvient pas à aboutir à une solution claire, et crée même de la confusion, le législateur est fondé à intervenir pour trancher une question aussi sensible dans le sens de la reconnaissance de l’intérêt à agir.
Notre proposition de loi se veut raisonnable et rationnelle. En aucune façon, il n’est question d’ouvrir une boîte de Pandore en déplaçant le débat parlementaire, donc politique, sur le terrain judiciaire.
Il n’est pas non plus question pour nous de créer la possibilité d’un contentieux de masse, qui verrait les parlementaires contester sans retenue les actes du Gouvernement. D’autres exemples permettent, du reste, d’écarter cette éventualité.
L’ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel en 1974 n’a jamais, à ma connaissance, abouti à engorger les juges de la rue de Montpensier, mais a au contraire permis au Conseil de consolider sa jurisprudence.
De la même façon, l’admission par le Conseil d’État de la recevabilité à agir d’un conseiller municipal qui conteste un acte du maire, en soutenant que cet acte entre dans le champ des compétences du conseil municipal, n’a pas produit de contentieux abondant.
En tout état de cause, les membres du Parlement sont suffisamment responsables pour ne pas agir en la matière de façon dilatoire et, de toute façon, je doute que puissent surgir chaque année des dizaines de cas susceptibles de justifier une requête.
Parallèlement, je ne crois pas non plus fondées les craintes d’une politisation du Conseil d’État, selon lesquelles celui-ci serait conduit à trancher par le droit des conflits de nature politique entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. D’abord, ce serait oublier la nature du contentieux administratif. Ensuite, par définition, le juge administratif est de toute façon amené tous les jours à connaître de recours à caractère politique puisque, selon l’adage, « juger l’administration, c’est encore administrer ». Nous pouvons donc faire toute confiance aux membres du Conseil d’État pour ne pas se laisser instrumentaliser à d’autres fins.
Et que ne dit-on du Conseil constitutionnel lorsqu’il censure ou ne censure pas telle ou telle disposition, ou du Conseil d’État lorsqu’il statue sur une question politiquement sensible ! Mes chers collègues, ce débat n’est pas prêt de se clore…
Enfin, je ne crois pas qu’il soit possible de soutenir les arguments invoquant le risque de favoriser une action qui se confondrait avec l’action populaire, étant entendu que le parlementaire est le représentant de la nation tout entière. Les parlementaires ne sauraient bénéficier d’un « privilège de recevabilité » en toutes circonstances. Néanmoins, les fonctions particulières qu’ils occupent justifient que, dans certaines hypothèses circonscrites à la défense des prérogatives du Parlement, ils puissent, me semble-t-il, agir ès qualité.
Revenons donc à la définition que donnait déjà Laferrière de l’intérêt à agir en 1888 : un requérant doit justifier d’un intérêt « parce qu’on n’a pas d’action si l’on ne peut retirer aucun effet utile du jugement qu’on sollicite ». L’effet utile que recherche le parlementaire, aux termes de notre proposition de loi, c’est la préservation de ses compétences, le respect de sa volonté, en clair la protection de l’intégrité de l’action du Parlement, au travers du recours objectif, je le souligne, que constitue classiquement le recours pour excès de pouvoir.
Monsieur le rapporteur, j’ai lu très attentivement votre rapport et les analyses qu’il contient. Vous l’avez compris, notre proposition de loi a d’abord, et volontairement, visé très large, de façon à susciter un débat de fond sur une problématique qui dépasse, me semble-t-il, la seule question des techniques contentieuses. Vous avez identifié trois options possibles : écarter par principe toute recevabilité à agir aux parlementaires ès qualité ; reconnaître, comme nous le proposons, un large intérêt à agir aux parlementaires ès qualité ; enfin, restreindre la reconnaissance de l’intérêt à agir à des hypothèses très précises, solution qui a votre préférence et qu’a retenue la commission des lois.
Mes collègues et moi-même avons été très sensibles aux arguments que vous avez développés et nous entendons cheminer avec vous pour aboutir à un texte qui permettra, demain, de doter les parlementaires d’un nouvel outil s’inscrivant dans la logique de revalorisation du Parlement, laquelle était aux fondements de la révision constitutionnelle de 2008 ; en tout cas, c’est ainsi que je l’ai comprise.
Signe de notre volonté d’avancer, nous avons choisi de déposer un amendement reprenant les remarques contenues dans votre excellent rapport. Vous avez déposé, au nom de la commission, un amendement identique. J’en conclus que la commission des lois et nous-mêmes, auteurs de la proposition de loi, nous rejoignons pour écrire ensemble un texte de compromis.
Nos deux amendements visent à restreindre la portée de la proposition de loi en la limitant à deux hypothèses spécifiques, certainement celles qui nous intéressent aujourd’hui le plus en tant que parlementaires : premièrement, la carence du Premier ministre lorsque ne sont pas prises dans un délai raisonnable les mesures d’application d’une loi, étant entendu que seule la décision de refus d’édicter ces mesures est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; deuxièmement, l’acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un accord international, dès lors que le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation relève du domaine de la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution. Cette dernière hypothèse englobe, par exemple, le cas de l’arrêt Fédération nationale de la libre pensée, précédemment évoqué.
Dans les autres cas, le juge administratif conserverait sa marge d’interprétation pour apprécier la recevabilité du recours d’un parlementaire au regard de son intérêt à agir, comme il le fait déjà à l’heure actuelle. Sur cette question, notre amendement ne contraint donc pas l’office du juge.
Mes chers collègues, la révision constitutionnelle de 2008 est encore récente. Nous n’avons sans doute pas d’ores et déjà pris toute la mesure des nouvelles opportunités qu’elle peut offrir au Parlement pour rééquilibrer notre architecture institutionnelle.
Toutefois, le renforcement de la position du Président de la République, qui résulte du quinquennat et de la coïncidence de son mandat avec celui des députés, implique nécessairement que le Parlement joue pleinement son rôle de pouvoir constitué à part entière. Et cela est encore plus vrai s’agissant du Sénat, dont le mode d’élection est déconnecté du mandat présidentiel.
Le groupe du RDSE entend prendre toute sa place dans l’indispensable réflexion sur l’évolution de nos moyens d’action, en gardant constamment à l’esprit que nous avons à cœur d’agir pour l’intérêt général.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite avec conviction à adopter les deux amendements identiques qui vont vous être proposés et à poursuivre ainsi sur le chemin du renforcement des droits du Parlement et, par là même, des droits des parlementaires.
MM. Jean-Pierre Sueur et François Zocchetto applaudissent.

Madame la présidente, monsieur le ministre des relations avec le Parlement, cher Patrick Ollier, mes chers collègues, mon premier sentiment, lorsque j’ai été désigné comme rapporteur de cette proposition de loi tendant à reconnaître une présomption d’intérêt à agir des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat en matière de recours pour excès de pouvoir, me portait à n’accorder à cette initiative qu’un caractère technique, susceptible d’intéresser avant tout les juristes de droit public.
À l’évidence, cette première impression n’était pas la bonne, car cette proposition de loi soulève des questions essentielles en ce qui concerne tant les moyens d’action des députés et des sénateurs pour la défense des prérogatives du Parlement que le rôle et la place du Conseil d’État.
Après avoir retracé l’actuel état du droit en cette matière, je tenterai d’écarter certaines hypothèses retenues par la proposition de loi, avant de vous inviter à donner des limites précises à la possibilité pour un député ou un sénateur de contester devant le juge de l’excès de pouvoir, en sa seule qualité de parlementaire, une mesure réglementaire qu’il considère comme portant atteinte aux prérogatives du Parlement.
La juridiction administrative n’a, paradoxalement, jamais tranché cette question. On connaît pourtant son approche très compréhensive de l’intérêt à agir, qui l’a amenée, dès le début du XXe siècle, à admettre la recevabilité du recours d’un contribuable communal, en cette seule qualité, pour attaquer l’ensemble des délibérations du conseil municipal ou, en 1971, à reconnaître l’intérêt à agir d’un hôtelier contre un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixant la durée des congés scolaires.
Pourtant, dans une affaire très récente, qui a donné lieu à l’arrêt Fédération nationale de la libre pensée du 9 juillet 2010, le rapporteur public – nouvelle appellation du commissaire du Gouvernement – Rémi Keller pouvait déclarer, ainsi que notre collègue Yvon Collin l’a rappelé : « Le parlementaire frappe depuis plusieurs décennies à la porte de votre prétoire ; il ne sait toujours pas si elle lui est ouverte ou fermée. »
Deux techniques, que la doctrine qualifie d’attitudes de contournement et d’évitement, ont jusqu’à présent permis au Conseil d’État de pérenniser ces incertitudes jurisprudentielles.
Le contournement consiste, pour le juge administratif, à reconnaître aux députés ou aux sénateurs requérants, une autre qualité que celle de parlementaire, fût-elle fort répandue, pour ne pas dire « abracadabrantesque ».
Les exemples sont légion et nous permettront de croiser nombre de collègues.
Ainsi, au député Patrice Brocas, qui demandait l’annulation des décrets organisant le référendum du 28 octobre 1962, la haute assemblée a admis un intérêt pour agir en sa qualité d’électeur.
Lorsque notre collègue Jean-Pierre Fourcade a contesté un décret relatif au Fonds de compensation pour la TVA, c’est sa qualité de président du Comité des finances locales qui fut prise en compte.
En 2002, c’est en tant que consommateur de produits pétroliers que le député Didier Migaud pouvait, selon le Conseil d’État, contester le refus du ministre du budget de mettre en œuvre le mécanisme de la « TIPP flottante ».
En 2006, ce fut comme actionnaire d’une société d’autoroute que François Bayrou vit reconnaître son intérêt à agir dans une affaire portant sur la privatisation d’une société autoroutière.
Craignant de vous lasser, mes chers collègues, je me contenterai de rappeler enfin que c’est en sa qualité d’usager du service public de la télévision que notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat était recevable à attaquer une lettre du ministre de la culture portant suppression anticipée de la publicité en soirée sur les chaînes télévisées du groupe France Télévisions, alors que la loi prévoyant cette suppression était encore en discussion au Parlement.
Quant à l’attitude de l’évitement, elle consiste, non sans que soit préalablement utilisée la formule expéditive « sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes des parlementaires », à examiner les requêtes avant de les rejeter au fond. Malgré des conclusions contraires du rapporteur public, ce fut le cas dans l’affaire Fédération nationale de la libre pensée.
En l’espèce, 57 sénateurs et 14 députés, se prévalant chacun de leur seule qualité de parlementaire, avaient mis en avant la méconnaissance, par le décret du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre la République française et le Saint-Siège, du droit des parlementaires d’exercer leurs compétences dans la mesure où la ratification de l’accord aurait dû, selon eux, être autorisée par une loi. En vain, Rémi Keller invita à l’évolution jurisprudentielle et à ne pas faire du parlementaire « la seule personne privée de tout droit de recours pour excès de pouvoir ».
Certes, on pourrait estimer qu’il reste urgent d’attendre et que, si la haute juridiction a jusqu’à présent constamment éludé cette question, elle ne pourra éternellement « récidiver », si je puis dire : elle aura nécessairement, un jour, à connaître d’un recours de parlementaires qu’elle estimera fondé et qui, sur la forme, ne lui permettra pas de s’appuyer sur une autre qualité que celle de parlementaire.
Nos collègues du RDSE n’ont pas eu cette patience, et on peut les comprendre. La présente proposition de loi consiste à doter les membres du Parlement d’une présomption d’intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir dès lors qu’est en jeu la défense des prérogatives du Parlement. Sont ainsi distinguées trois hypothèses de recevabilité des recours : celle où le pouvoir réglementaire empiéterait sur le domaine de la loi, celle où une mesure réglementaire méconnaîtrait la loi et celle, enfin, où le pouvoir exécutif, à défaut de prendre les mesures réglementaires nécessaires dans des délais raisonnables, rendrait de fait une loi inapplicable.
La commission n’est pas favorable à ce que soient retenues les deux premières hypothèses.
Permettre à un parlementaire d’attaquer toute mesure réglementaire qu’il estime contraire à une disposition législative reviendrait à admettre l’action populaire, ce qui n’apparaît guère souhaitable pour trois raisons essentielles.
Premièrement, la violation de la loi doit demeurer un moyen d’annulation d’un acte administratif et non devenir un critère de recevabilité du recours.
Deuxièmement, le parlementaire risquerait d’être soumis à de fortes pressions pour intenter des recours en lieu et place d’associations, de syndicats, d’administrés.
Troisièmement, l’hypothèse d’un intérêt à agir en cas de mesures réglementaires contraires à la loi semble tellement large qu’elle peut encourir le grief d’inconstitutionnalité.
Il n’en va pas tout à fait de même de la deuxième hypothèse, qui porte sur le cas de mesures réglementaires édictant une disposition relevant du domaine de la loi.
Sur le fond, votre rapporteur considère que l’atteinte alléguée à une compétence du législateur constitutionnellement garantie constitue un cas où la reconnaissance d’un intérêt à agir pourrait être pertinente. La reconnaissance de cet intérêt à agir serait cohérente avec le fait que le Conseil d’État admet, depuis plus d’un siècle, qu’un conseiller municipal est recevable à attaquer un acte du maire dont il soutient qu’il entre dans la compétence du conseil municipal ; notre collègue Yvon Collin y a fait allusion.
Elle établirait également une possibilité pour les membres du Parlement, avec l’aide du Conseil d’État, d’équilibrer la possibilité du Gouvernement de modifier par décret, avec l’aide du Conseil constitutionnel, les textes de forme législative, c’est-à-dire des dispositions adoptées par le Parlement dans le domaine du règlement.
À cet égard, rappelons, mes chers collègues, un souvenir aussi récent qu’amer.
Sur l’initiative du Sénat, la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne avait prévu la création auprès de Matignon d’un comité consultatif des jeux. Or, quelques mois à peine après le vote de la loi, le Gouvernement a demandé et obtenu du Conseil Constitutionnel de déclasser la disposition concernée afin de placer ce comité sous la responsabilité des ministres du budget et de l’intérieur. Quelques collègues, dont je me rappelle parfaitement les noms, éprouvèrent la désagréable impression d’avoir été floués.

Mais il nous faut bien constater que la procédure de déclassement ou de délégalisation est inscrite à l’article 37, deuxième alinéa, de la Constitution. La présence dans la Constitution d’un mécanisme de protection du pouvoir réglementaire peut légitimement laisser supposer que le mécanisme inverse, la protection du pouvoir législatif, ne peut être prévu que par la Constitution elle-même.
Reste la troisième et dernière hypothèse qui permettrait à un parlementaire d’agir en cette seule qualité dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’agit du cas de refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative. Je suggère d’ajouter le recours contre un acte réglementaire ayant autorisé la ratification ou l’approbation d’un traité alors que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution.
J’estime en effet que, dans ces deux hypothèses, il existe une atteinte réelle, directe et certaine à l’activité du Parlement et que, en conséquence, le parlementaire doit pouvoir, s’il le souhaite, intervenir de plein droit dans l’intérêt du Parlement.
Je considère que ce dispositif offre de sérieuses garanties de conformité à la Constitution, et ce pour trois raisons principales.
Tout d’abord, le champ de l’intérêt à agir des parlementaires serait très restreint, limité à deux hypothèses peu fréquentes.
Ensuite, il n’existe pas, pour ces deux cas de figure, de procédures comparables ou voisines dans la Constitution laissant penser que le dispositif devrait trouver sa place dans notre loi fondamentale.
Enfin, dans les deux cas visés, le parlementaire ne peut pas reprendre sa compétence violée par le pouvoir réglementaire. Ce point mérite que l’on s’y attarde.
Lorsqu’un acte réglementaire porte atteinte au domaine de la loi, le législateur peut généralement récupérer sa compétence par le vote d’une loi, surtout depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a prévu le partage de l’ordre du jour entre le Parlement et le Gouvernement. Tel n’est pas le cas dans les deux hypothèses que je viens d’évoquer.
En particulier, j’estime qu’un parlementaire justifie d’un intérêt à agir pour contester un décret autorisant la ratification d’un traité alors qu’il est convaincu qu’une loi était nécessaire pour une telle autorisation. En effet, dans un tel cas de figure, l’intérêt à agir des parlementaires est justifié par une double atteinte aux prérogatives du Parlement.
D’une part, si l’accord modifie des dispositions de nature législative, il aurait dû être soumis au Parlement en application de l’article 53 de la Constitution, qui dresse la liste des traités qui « ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ».
D’autre part, et surtout, un décret autorisant, en lieu et place d’une loi, la ratification d’un traité a pour effet d’introduire dans l’ordre juridique national une norme qui s’imposera au législateur en vertu de l’article 55 de la Constitution. Le Parlement se retrouve donc alors, en quelque sorte, pieds et poings liés.

Le législateur ne pourra donc pas reprendre sa compétence par le vote d’une loi, ce qu’ont reconnu toutes les personnes entendues par votre rapporteur.
De même, l’inaction du pouvoir réglementaire revient à faire échec à la volonté du Parlement, d’autant qu’elle peut être parfois volontaire, si le texte adopté par les assemblées vient à déplaire au Gouvernement, ce qui l’amène, pour reprendre l’expression qu’a utilisée le doyen Gélard lors du débat du 12 janvier dernier, à « traîner un peu les pieds avant de publier les règlements adéquats ».
Sans doute le Parlement dispose-t-il d’autres moyens sur le terrain politique pour défendre ses droits, depuis la motion de censure – en l’occurrence, ce serait le marteau-pilon pour écraser une mouche ! – à la question écrite, dont l’efficacité s’avère souvent aléatoire.

Mais contrôle politique et contrôle judiciaire ne peuvent-ils se révéler constituer deux modalités complémentaires, et non concurrentes, de la fonction parlementaire, dans l’esprit que soutient l’exposé des motifs de la proposition de loi ?
Nous aurons l’occasion de rouvrir ce débat lors de l’examen des amendements, mais notre commission a estimé que la proposition de loi soulevait trop de difficultés pour être, en l’état, acceptable. Elle a donc décidé de ne pas adopter de texte, afin que la discussion en séance publique porte sur le texte de la proposition de loi, en application de l’article 42 de la Constitution.
MM. André Reichardt, Yvon Collin et Jean-Pierre Sueur applaudissent.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi nous donne une nouvelle fois l’occasion d’évoquer la question de l’application des lois, dont le Sénat a débattu une première fois le 12 janvier dernier, déjà sur l’initiative de M. Collin.
La question soulevée est de savoir s’il serait judicieux d’ajouter aux outils de contrôle parlementaire de l’application des lois inscrits dans la Constitution un nouveau mécanisme de contrôle juridictionnel.
À la suite de l’exposé très argumenté du président Collin, M. le rapporteur a fait une brillante plaidoirie ; pour autant, depuis le précédent débat, ma position n’a pas varié.
Je me félicite de la qualité des discussions que nous avons eues en commission. J’observe d’ailleurs au passage que les membres de la commission ne se sont pas prononcés unanimement en faveur cette proposition de loi.
Vous soulevez, monsieur Collin, la question des pouvoirs du Parlement. Le Gouvernement défend les pouvoirs du Parlement, mais il défend aussi le respect de la Constitution. Or se pose ici, outre le problème de l’opportunité, celui de la constitutionnalité.
Que faut-il entendre par « contrôle de l’application des lois » ?
Les pouvoirs de contrôle du Parlement ont été renforcés, ne l’oublions pas, par la révision constitutionnelle de 2008 et sont dorénavant consacrés de manière claire par l’article 24 de la Constitution : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »
De plus, il ne faut pas non plus l’oublier, la moitié de l’ordre du jour du Parlement est consacrée à l’initiative et au contrôle parlementaires. Ainsi, non seulement la Constitution donne le pouvoir au Parlement de contrôler l’action du Gouvernement, mais elle prévoit que, dans chaque assemblée, une semaine de séance par mois est réservée par priorité à ce contrôle et à l’évaluation des politiques publiques.
Concrètement, comment ce contrôle peut-il s’exercer ? J’aimerais, cher Yvon Collin, que, au-delà de ce débat sur l’application des lois, nous puissions en discuter, car c’est bien là que se situe le problème.
Chaque assemblée organise ce contrôle librement, comme elle l’entend : vous en avez le pouvoir, mesdames, messieurs les sénateurs, et ce pouvoir, vous devez l’exercer !
Le contrôle de l’application des lois comprend, me semble-t-il, deux aspects : d’une part, la vérification de l’adoption des décrets d’application dans des délais raisonnables – il a été admis qu’un délai de six mois est raisonnable, mais nous aurons l’occasion d’y revenir – et, d’autre part, le contrôle de la bonne exécution des lois sur le terrain. Or, ce deuxième aspect, vous n’en avez soufflé mot !
Dès 2005, en tant président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale – pardon de reprendre un instant cette casquette ! –, j’ai eu à cœur de faire en sorte que les contrôleurs de l’exécution de la loi, constitués de binômes majorité-opposition – cela figure maintenant à l’article 145 du règlement de l’Assemblée nationale –, se rendent sur le terrain pour voir comment la loi est appliquée en différents points du territoire.
En effet, l’application de la loi, ce n’est pas qu’une question de parution des décrets ! Car la loi peut s’appliquer de manière différente d’un département à l’autre en fonction des personnes qui sont chargées de la mettre en œuvre.
Le contrôle de l’application des lois relève des prérogatives des commissions, selon des règles propres à chacune des deux assemblées.
Le Sénat et l’Assemblée nationale ont, ces dernières années, perfectionné leurs méthodes de contrôle. Ainsi, l’article 22 du règlement du Sénat dispose explicitement que les commissions permanentes assurent, entre autres missions, « le suivi de l'application des lois ». Alors, mesdames, messieurs les sénateurs, exercez donc les pouvoirs qui vous sont donnés !
Le rapporteur d’un texte me paraît être, à l’évidence, le mieux placé pour exercer le contrôle de son application, pour en vérifier la bonne exécution.
Quoi qu'il en soit, ensemble, nous avons accompli des progrès dans la façon de contrôler l’application des lois.
Je mentionnerai également l’obligation faite au Gouvernement par l’article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit – j’aurais aimé qu’on en parlât ! – de transmettre au Parlement, six mois après la publication de la loi, un rapport sur l’adoption de ses décrets d’application.
Monsieur le président Collin, c’est à cette obligation que je me suis référé lorsque j’ai pris devant vous l’engagement selon lequel, dorénavant, le Gouvernement prendrait chaque année l’initiative, au Sénat et à l’Assemblée nationale, d’organiser un débat sur l’exécution des lois votées au cours de la session précédente.
Il faut encore ajouter les questions écrites et orales adressées aux ministres sur le sort de tel ou tel texte ou les rapports annuels que le Sénat consacre depuis plus de trente ans à l’application des lois.
Je rends d’ailleurs hommage à votre assemblée, qui a beaucoup plus œuvré dans ce cadre-là que l’Assemblée nationale. Dans ce domaine, vous avez accompli un travail considérable, au service de l’ensemble de l’institution parlementaire.
Tous ces efforts ont contribué à une franche amélioration de la situation. Certes, il reste encore des marges de progrès, et je l’ai reconnu dernièrement devant vous. Personne ne saurait prétendre qu’il n’est pas possible de faire mieux à cet égard.
Nul ne peut contester non plus le fait que le Gouvernement a mis en place, en juillet 2008, suivant les instructions du Premier ministre, une nouvelle procédure dont les effets commencent à porter leurs fruits. Sans la détailler, je rappellerai simplement que, dans chaque ministère, un haut fonctionnaire est chargé de veiller à l’application des lois. Cela induit nécessairement, pour les parlementaires, une manière nouvelle d’organiser pratiquement le contrôle de cette application.
Ce sont quatre décrets sur cinq qui sont désormais pris dans un délai de six mois suivant la publication des lois, ce qui est certainement inédit dans l’histoire de la Ve République. Je crois d’ailleurs, monsieur Collin, que nous devrions nous mettre d’accord sur les méthodes de calcul…
Vous avez demandé que la volonté souveraine du Parlement soit respectée. Il est certain qu’elle doit l’être, mais, pardonnez-moi de le répéter, c’est au Parlement lui-même qu’il revient de vérifier si tel est bien le cas. Il en a le pouvoir et ne doit pas le transférer au juge pour que celui-ci décide à sa place ! Dans ce domaine, c’est donc à vous et à vous seuls d’agir. Telle est, du reste, la volonté que vous avez exprimée dans l’hémicycle, là où tout se décide !
Monsieur le président Collin, vous avez certainement eu raison de citer le propos que tenait Édouard Laferrière, vice-président du Conseil d’État, en 1888. Pour ma part, je me référerai au propos d’un autre membre éminent du Conseil d’État, Christian Vigouroux, qui expliquait en 1987 – c’est plus récent ! – que « le recours pour excès de pouvoir [...] n’a pas pour finalité la continuation, par d’autres moyens, du débat parlementaire ».
Vous avez fait un parallèle avec le droit de recours des parlementaires devant le Conseil constitutionnel. Si l’on adoptait cette manière de voir, ce serait au constituant d’agir, car il n’est pas possible de le faire par le biais d’une simple proposition de loi ordinaire.
Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué le cas de l’hôtelier qui peut avoir un intérêt à agir pour justifier de ses droits. Vous avez raison, mais a-t-il d’autres moyens d’intervenir que celui-là ? S’il était sénateur ou député, il pourrait, avec la commission à laquelle il appartient, convoquer le ministre à une audition à huis clos – donc hors la présence de la presse – pour lui demander des comptes et exiger que tel ou tel décret paraisse dans les délais voulus.
Face au recours introduit par M. Didier Migaud, avant qu’il ne devienne Premier président de la Cour des comptes, le Conseil d’État a vu non le député, mais le consommateur de produits pétroliers. Autrement dit, il a considéré que, sur la question ainsi soulevée, l’intérêt à agir était lié à la qualité de citoyen.
Le Parlement n’a nul besoin de pouvoirs supplémentaires pour interpeller le Gouvernement et vérifier la mise en œuvre des textes d’application des lois. Ceux dont il dispose déjà sont suffisants ; à lui de les exercer !
Monsieur le président Collin, avec cette proposition de loi, vous allez jusqu’à transférer des pouvoirs à la juridiction administrative. Je ne veux pas me montrer provocateur, mais, me rappelant que j’ai moi-même été parlementaire, je vous pose la question : n’est-ce pas un renoncement ? Le ministre que je suis ne devrait pas vous poser la question, mais j’aime trop le Parlement pour le voir renoncer à une partie de ses pouvoirs, fût-ce au bénéfice d’une juridiction aussi éminente que le Conseil d’État !
Finalement, qu’apporterait de plus la proposition de loi qui est aujourd’hui soumise à votre examen ? En quoi la saisine du juge serait-elle plus efficace que tous ces moyens dont disposent déjà les parlementaires pour interpeller directement les membres du Gouvernement ?
La responsabilité suprême qui vous est donnée par la Constitution vous place, vous parlementaires, au-dessus de toute juridiction ! Et vous disposez seuls des pouvoirs nécessaires pour agir. Par conséquent, personne ne pourra vous reprocher de le faire.
Le mécanisme proposé créerait un détour bien étrange par rapport à l’exercice de la prérogative politique qu’a aujourd’hui le Parlement d’interpeller le Gouvernement.
Je l’ai dit, je suis convaincu que nul n’est mieux placé que le rapporteur de la loi pour en contrôler la bonne application. Il consacre à la loi tant de travail et de temps que, pour veiller à son exécution, il est infiniment plus qualifié qu’une juridiction, qui doit se pénétrer d’un texte dont elle n’a pas, a priori, nécessairement connaissance.
De plus, au-delà du jugement proprement dit, quel pourrait être son rôle ? Prononcer une condamnation ? Se substituer au Gouvernement ? Quelle serait la porte de sortie ? Ces questions restent en suspens.
Selon moi, il serait préférable d’agir mieux, puisque, vous avez eu raison de le dire, il existe des marges de progrès. Pour ma part, je suis prêt à faire les efforts nécessaires de façon que soit encore amélioré ce qui peut l’être. Je vous le confirme, le Gouvernement est disposé à poursuivre sa coopération avec le Parlement et à intensifier cette interaction. Nous devons améliorer encore les résultats considérables qui ont été obtenus grâce aux instructions de François Fillon.
Dans un premier temps, mettons-nous d’accord sur la méthode de suivi. Comment apprécier la sortie des textes d’application des lois pour exercer un contrôle ?
J’en reviens à ce que je disais, monsieur Collin : nous devons être dans les mêmes conditions, disposer des mêmes critères et des mêmes curseurs. Or je n’ai pas le sentiment que tel était le cas lors du débat du 12 janvier !
Vous avez vos méthodes, qui sont tout à fait respectables. Le Gouvernement en a d’autres. Je suis à votre disposition pour imaginer une méthode de calcul commune permettant d’apprécier la publication des textes d’application des lois dans les six mois.
Je renouvelle donc ma proposition d’œuvrer à l’harmonisation de nos procédures de suivi et je suggère en outre aux assemblées d’organiser, lors de l’une de leurs semaines de contrôle, un débat annuel sur la façon dont les lois sont appliquées.
Monsieur le président Collin, l’honneur revient à votre groupe, puisque c’est lui qui est à l’origine du débat du 12 janvier. Le résultat est très positif. Cependant, bien qu’abondant dans votre sens, le Gouvernement ne peut accepter cette proposition de loi.
Mais je suis décidé à aller plus loin. Après avoir longuement réfléchi avec le secrétaire général du Gouvernement et le Premier ministre, je présenterai, au plus tard dans une quinzaine de jours, les initiatives nouvelles que je prendrai en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement pour améliorer encore l’application des lois. Je souhaite que vous y soyez étroitement associés.
À partir de cet engagement que je suis en mesure de prendre devant vous et d’une impulsion politique forte, nous pourrons sérieusement progresser dans ce domaine.
À la question de l’opportunité, à la volonté du Parlement d’accomplir ou non une partie du travail qui lui revient, il convient d’ajouter les sérieuses interrogations juridiques que soulève l’examen tant de la proposition de loi que des amendements identiques que vous avez déposés, monsieur Collin, monsieur le rapporteur.
Ainsi que vous l’avez démontré dans votre rapport, monsieur Lecerf, et comme votre commission l’a très largement admis, me semble-t-il, il existe de bonnes raisons de penser qu’en instituant une présomption d’intérêt à agir des parlementaires pour saisir le juge de la contrariété d’un décret à la loi ou d’un empiètement du décret sur le domaine de la loi, la proposition de loi se heurterait au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, défini par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Or nous avons une Constitution...
Malgré la solution subsidiaire présentée dans les amendements et qui consisterait à ne consacrer de présomption d’intérêt à agir des parlementaires qu’à raison de la carence à prendre un décret d’application, je ne peux manquer de dire que, comme cela a été relevé par plusieurs membres de la commission des lois, tant de la majorité que de l’opposition, le risque de contrariété à la Constitution ne peut être écarté. C’est pourquoi je le relève.
De plus, un texte organisant un mécanisme spécifique de recours juridictionnel pour permettre aux représentants du pouvoir législatif de faire pression sur le pouvoir exécutif ressortit nécessairement, je l’ai dit au début de mon intervention, à un niveau de norme supérieur à la loi ordinaire.
Au cas où il serait décidé d’opérer un vote par division sur les deux amendements identiques, vous devez bien avoir à l’esprit, mesdames, messieurs les sénateurs, que, dans le cas particulier des décrets de publication des accords internationaux, le même problème constitutionnel se pose.
Je souhaite également souligner, toujours à propos du 2° du texte proposé par ces amendements pour l’article 4 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958, le risque de remise en cause systématique des engagements internationaux souscrits par la France. Le fait qu’une disposition législative confère un très large intérêt à agir pour attaquer les décrets de publication des accords internationaux serait source d’une grande insécurité juridique, je suis sûr que vous en conviendrez.
Permettez-moi de relever aussi l’étrangeté de la solution qui consisterait à admettre une fragmentation de la représentation nationale devant le prétoire. En conférant aux parlementaires le droit de déférer la loi devant le Conseil constitutionnel, en vertu de l’article 61 de la Constitution, ou de saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour méconnaissance du principe de subsidiarité, aux termes de l’article 88-6 de la Constitution, le constituant a prévu que le recours doit réunir la signature d’au moins soixante députés ou soixante sénateurs. Ce n’est donc pas un hasard si le Conseil d’État a toujours été réticent à admettre l’intérêt à agir devant son prétoire d’un parlementaire isolé.
À ce sujet, l’incertitude invoquée par l’auteur de la proposition de loi et le rapporteur au sujet de la jurisprudence du Conseil d’État est tout à fait contestable. Alors qu’il en a eu maintes fois l’occasion, le Conseil d’État n’a jamais accepté de reconnaître l’intérêt à agir pour des parlementaires ès qualité.
Donc, il ne l’a jamais reconnu !
Par conséquent, le texte a bien pour objet, contrairement à ce qui est indiqué, d’infléchir la jurisprudence sur ce point.
Par ailleurs, si le texte parle de « présomption », il s’agit en fait d’une présomption irréfragable puisque le Conseil d’État ne pourra pas en écarter l’application. Je vous demande de bien y réfléchir.
Ce que le Conseil d’État admet de la part d’un conseiller municipal ne va pas de soi s’agissant d’un parlementaire, sauf à admettre que celui-ci, en s’emparant du cas singulier d’un décret d’application, se fasse le porte-parole d’une catégorie particulière d’intérêts.
Avant d’adopter une telle disposition, il convient d’envisager ses effets collatéraux. Comment ne pas craindre que les parlementaires ne soient harcelés par toutes sortes d’intérêts catégoriels ? Comment éviter les pressions auxquelles se livreront ceux qui défendent des intérêts catégoriels – les élus locaux savent de quoi je parle ! – pour qu’un parlementaire défère devant le Conseil d’État une supposée carence du Gouvernement dans l’adoption de mesures réglementaires ?
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous fais part de nouveau de ma conviction très profonde, qui est également celle du Gouvernement : s’il y a matière, du point de vue des parlementaires, à progresser encore en matière de contrôle de l’application des lois, cette amélioration passe certainement beaucoup plus par l’exercice de leurs prérogatives constitutionnelles que par leur recours au juge.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne peut pas accepter cette proposition de loi en l’état.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Anne-Marie Payet applaudit également.

J’invite chacun des orateurs inscrits à respecter le temps de parole qui lui a été accordé, faute de quoi nous ne pourrons pas achever la présente discussion dans les délais prévus, c'est-à-dire à treize heures au plus tard.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Monsieur le ministre, vous aurez beau dire et beau faire, il existe aujourd’hui un droit exorbitant de tout gouvernement à ne pas appliquer la loi. Vous le savez très bien, il suffit à un gouvernement de s’abstenir de publier les textes d’application pour que la loi ne s’applique pas.
Faites-la appliquer ! Exercez votre pouvoir, monsieur le sénateur !

Permettez-moi, monsieur le ministre, d’évoquer ce point en détail, en vous fournissant des exemples concrets.
Certes, nous pouvons poser des questions écrites ou orales, intervenir au cours des débats qui se déroulent ici. Pour autant, si le Gouvernement ne publie pas les décrets, nous n’avons aucune capacité de l’y contraindre. Telle est la vérité !

Si vous pensez le contraire, monsieur le ministre, expliquez-moi en quoi je me trompe !
Ce premier point, parfaitement clair, me permet d’ailleurs de répondre aux trois quarts de votre intervention, de plus de vingt minutes. Vous pouvez constater, madame la présidente, que je ne gaspille pas le temps qui m’est accordé !
Par ailleurs, je souhaite remercier M. Yvon Collin, ainsi que M. Jean-René Lecerf, de leur travail. Nous voterons en effet avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination les amendements identiques qu’ils ont déposés, lesquels, grâce à une rédaction parfaitement ajustée, prévoient que les parlementaires pourront intervenir non pas sur tout sujet, mais uniquement sur la question centrale de la mise en œuvre de la loi votée.
Monsieur le ministre, vous avez cité je ne sais plus qui, en prétendant qu’il disait, en 1987, je ne sais plus quoi.

Pour ma part, je vous citerai les propos tenus par M. Daniel Labetoulle, …

… ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État. C’est pourquoi, monsieur le ministre, votre question me paraît inappropriée.
Il a publié, dans le numéro de mai 2010 de la Revue juridique de l’économie publique, un article qui, j’en suis sûr, n’aura pas manqué de retenir votre attention et dont voici un extrait
« On connaît l’objection mise en avant par Jacques Massot et souvent reprise depuis : “… représentant la nation tout entière […], [le parlementaire] fait partie d’un cercle d’intérêt trop vaste pour que son action ne se confonde pas avec l’action populaire.”
« Mais y a-t-il là de quoi écarter autre chose qu’une vision d’une recevabilité “tous azimuts” d’un parlementaire qui tiendrait de son mandat le privilège de pouvoir attaquer tout acte susceptible de recours ? Ce qui ne paraît envisagé par personne et en tout cas ne l’est pas ici, où l’on se borne à suggérer que la réponse à la question de la recevabilité du parlementaire ne passe pas plus par le : “jamais” que par le : “toujours” mais seulement par le : “quand ?” »
C’est exactement ce à quoi M. Collin et M. Lecerf apportent une réponse pertinente.
M. Labetoulle expose ensuite ce que vous avez rappelé, et qui est bien connu, monsieur le ministre : jusqu’à ce jour, le Conseil d’État a pratiqué l’évitement ou le contournement. Nous connaissons tous la fameuse formule : « sans qu’il soit utile de statuer sur la recevabilité des parlementaires »…
Le Conseil d’État s’est appuyé soit sur le fait qu’il y avait d’autres requérants qui n’étaient pas parlementaires, soit sur le fait que le parlementaire requérant possédait une qualité autre. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’est ainsi vue reconnaître la qualité de téléspectatrice et M. François Bayrou, celle d’abonné au gaz ou plutôt, en l’espèce, d’« actionnaire d’une société d’autoroute ».
Bref, tout cela est proprement ridicule !
D’ailleurs, ce n’est pas moi qui le dis ! M. Daniel Labetoulle, dont nous connaissons l’autorité, rappelle également, en soulignant l’absurdité de la situation, qu’a été reconnue à M. Didier Migaud la qualité de « consommateur de produits pétroliers ». En tant que tel, sa requête avait été déclarée recevable ! Et M. Labetoulle de conclure par ces mots : « Non, décidément, la jurisprudence sur la recevabilité du parlementaire ne peut être aujourd’hui ce qu’on a trop cru qu’elle était. »
Voulez-vous que je vous cite la remarquable analyse conduite par Mme Véronique Bertile dans le numéro daté de 2006 de La Revue française de droit constitutionnel ? « La reconnaissance d’un intérêt pour agir aux membres du Parlement à l’encontre des actes administratifs portant atteinte à leurs prérogatives est indéniablement une étape – et, qui plus est, une étape nécessaire – de l’affermissement du recours pour excès de pouvoir comme véritable recours objectif, destiné à assurer le respect de la légalité par l’administration. »
Monsieur le ministre, je souhaite maintenant évoquer deux affaires concrètes.
Figurez-vous qu’il m’est arrivé de me trouver devant le Conseil d’État porteur d’un recours engagé par 70 sénateurs concernant une ordonnance. Nous avions adopté un texte qui autorisait le Gouvernement à légiférer par ce biais. L’ordonnance fut prise, mais plusieurs de ses dispositions étaient contraires à la loi.
Or l’ordonnance est un texte à caractère administratif tant qu’elle n’a pas été ratifiée. En tant que parlementaires, nous étions donc confrontés à ce texte censé répondre à l’autorisation donnée par la loi, mais contraire, pour plusieurs de ses dispositions, à celle-ci.
Je me suis donc rendu, une après-midi durant, devant le Conseil d’État, ce dont je garde un souvenir… mémorable. Vous savez en effet, monsieur le ministre, que, dans cette assemblée, on ne peut pas parler, ce qui est extrêmement frustrant !
Sourires

Nous avons appris, d’une part, que nous n’étions pas recevables en tant que parlementaires et, d’autre part, que l’ordonnance était ratifiée de fait, l’un de nos collègues l’ayant mentionnée dans un amendement. Aux yeux du Conseil d’État, elle était dès lors revêtue de l’aura législative, alors qu’aucun parlementaire, pas plus que le Gouvernement lui-même, n’avait considéré qu’il en était ainsi.
Nous étions donc dans une position absurde. Je vous renvoie à l’arrêt du 29 octobre 2004 du Conseil d’État, qui mérite d’être lu, car il montre clairement que notre recours était fondé et qu’il eût été préférable que la loi fût différente. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous sommes ici réunis à l’instigation d’Yvon Collin.
J’évoquerai un second cas très concret, en demandant à Mme la présidente de faire preuve d’un peu d’indulgence à mon égard en ce qui concerne mon temps de parole.
Monsieur le ministre, vous savez que, en 2004, le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité une disposition permettant aux femmes dont la mère s’était vu prescrire du Distilbène de bénéficier d’un congé de maternité aménagé.
Je tiens à votre disposition toutes les questions écrites et orales, toutes les lettres, l’inventaire de nos rendez-vous au ministère et de nos déclarations auprès de Mme Bachelot-Narquin, laquelle, indignée de la situation, s’était mise en colère ici même. Toujours est-il qu’il a fallu cinq ans, six mois et quatorze jours pour obtenir la parution des deux décrets nécessaires !
Monsieur le ministre, si vous trouvez cela normal, dites-le-moi ! Vous nous avez aujourd'hui invités, à d’innombrables reprises, à exercer notre pouvoir de contrôle. Eh bien, c’est ce que je me suis efforcé de faire de multiples fois et de toutes les manières possibles pour ces femmes. Pourtant, alors que certaines d’entre elles auraient pu bénéficier de cette mesure durant leur grossesse, cela n’a pas été le cas pendant cinq ans, six mois et quatorze jours. J’ai même demandé si l’on attendait, pour prendre le décret, qu’elles ne soient plus en âge de procréer !
Le Conseil d’État ayant le pouvoir de condamner le Gouvernement pour non-application de la loi, nous demandons qu’une présomption d’intérêt à agir soit reconnue aux parlementaires, parce qu’il n’existe pas d’autre moyen coercitif. Vous-même, dans votre discours, n’avez pas réussi à nous en citer un seul.

Je vous dis, monsieur le ministre, qu’il n’existe pas d’autre moyen.
On peut, certes, tenter de persuader et poser des questions. Mais, à la fin des fins, si le Gouvernement ne publie pas le décret, nous ne pouvons pas le publier à sa place !
Par conséquent, cette proposition de loi, le cas échéant modifiée par les amendements déposés par M. le rapporteur et par M. Collin, permettra, en tant que de besoin, une application effective des textes que nous votons, et c’est absolument nécessaire. Du reste, j’en suis convaincu, cette disposition aura un effet dissuasif.
C’est pourquoi, monsieur le ministre, nous ne partageons pas votre sentiment.
Ce n’est pas un sentiment, c’est une conviction !

Lundi, vous vous étiez montré rétif à une autre initiative parlementaire. Aussi pensais-je que vous auriez entre-temps réfléchi et fait évoluer votre position. Malheureusement, force est de constater que tel n’est pas le cas.
En ce qui nous concerne, nous soutenons avec enthousiasme cette initiative salutaire de nos collègues du RDSE.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi présentée par Yvon Collin et certains de ses collègues du groupe RDSE est intéressante et nous la voterons. Elle participe d’une amélioration des moyens de contrôle du Parlement sur l’exécutif, aujourd’hui bien limités, quoi que vous en pensiez, monsieur le ministre, fidèle en cela à une opinion que vous avez déjà eu l’occasion d’exprimer.
Certes, l’article 24 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision de juillet 2008, confère expressément au Parlement la mission de contrôle de l’action du Gouvernement. Néanmoins, le débat que nous avons eu ici même le 12 janvier dernier, sur l’initiative de nos collègues du RDSE, a bien montré les limites d’un tel mécanisme de contrôle, et le fait de répéter à l’envi le contraire n’y change rien !
Les rapports annuels successifs consacrés à cette question dressent, l’un après l’autre, le même bilan préoccupant.
Certains d’entre nous ont dénoncé la frénésie législative du Gouvernement depuis 2007, les nombreuses mesures d’affichage, de même que le recours fréquent à la procédure accélérée. Il en résulte une dégradation de la qualité du droit et, contrairement à ce qu’affirment certains au mépris de la réalité, du rôle du Parlement, ainsi qu’une remise en cause de l’égalité des citoyens devant la loi.
Certes, étant des opposants résolus à la politique menée actuellement, nous ne regrettons pas forcément que des mesures législatives votées par la majorité ne fassent pas l’objet de mesures d’application, surtout quand elles ne sont pas applicables. Mais c’est bien souvent dans d’autres hypothèses que le Gouvernement rechigne à appliquer la loi...
De fait, le rôle premier du Parlement, qui est de voter la loi, est remis en cause.
De quels droits et pouvoirs peuvent se prévaloir les parlementaires pour contraindre le Gouvernement à appliquer la loi ? D’aucun ! Ils ne peuvent que dresser un constat, dénoncer, poser des questions, rédiger des rapports, etc. Ils peuvent trépigner dans l’hémicycle, mais, en réalité, ils ne disposent que de l’information de nature politique que vous considérez comme bien suffisante, monsieur le ministre.

Le Parlement ne peut se prévaloir d’aucun pouvoir de coercition à l’égard du Gouvernement. Aujourd'hui, la motion de censure est tout de même très difficile à mettre en œuvre ! Ni par le vote d’une nouvelle loi ni par l’adoption d’une résolution, le Parlement ne peut contraindre le Gouvernement à prendre les mesures réglementaires requises par une disposition législative, de surcroît dans un délai qu’il pourrait lui-même fixer.

Le cas échéant, il serait sanctionné par le Conseil constitutionnel.
Quant aux parlementaires pris individuellement, ils n’ont pas le pouvoir de s’assurer que les mesures prises par le Gouvernement sont bien conformes à la loi et respectent les limites fixées par la Constitution. Ils ne disposent pas non plus du droit d’engager un recours juridictionnel pour demander que soit ordonnée l’édiction des mesures réglementaires exigées par la mise en œuvre d’un texte législatif.
Pour l’heure, la seule voie qui leur est ouverte est celle du droit commun : le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Mais encore ce pouvoir est-il limité à deux situations : décret du Président de la République ou acte réglementaire d’un ministre. Il ne s’applique pas aux mesures d’application d’une loi ou à leur non-édiction dans un délai raisonnable. Or c’est bien l’absence de publication d’une mesure réglementaire dans des délais normaux qui pose essentiellement problème.
Jusqu’à présent, la jurisprudence administrative a déduit l’intérêt à agir des parlementaires en matière de recours pour excès de pouvoir sans que ce droit de saisine leur ait été officiellement et légalement reconnu.
Certains objecteront, avec raison, que le Conseil d’État a trouvé des subterfuges. À cet égard, vous me permettrez de me référer à la requête que j’avais introduite auprès du Conseil d’État à la suite de la décision de supprimer la publicité sur les chaînes du groupe France Télévisions avant même le vote de la loi. Pour mémoire, je rappelle que le Président de la République avait, en décembre 2008, imposé au conseil d’administration de France Télévisions la suppression de la publicité de 20 heures à 6 heures dès le 5 janvier 2009, alors que le Sénat n’en avait pas encore délibéré.

Suivant les conclusions du rapporteur public, qui dénonçait « la piètre gestion d’un dossier sensible qui mettait en cause l’avenir du service public de l’audiovisuel », l’arrêt du Conseil d’État a sanctionné l’incompétence de l’exécutif, l’atteinte à notre droit d’amendement et le détournement de pouvoir dont ce dernier s’était rendu coupable.
Pour faire droit à ma requête, le Conseil d’État a usé d’un subterfuge en excipant de ma qualité d’usager du service public de la télévision. Cela étant, il est évident qu’il a voulu montrer combien la résistance institutionnelle, en particulier parlementaire, peut se révéler nécessaire et possible face aux dérives de l’exécutif. En l’espèce, il s’agissait de sanctionner non pas l’absence d’un décret d’application, mais un excès de pouvoir par lequel l’exécutif appliquait une loi avant qu’elle n’ait été votée.
Si la proposition de loi qui nous est soumise ce matin n’est pas susceptible de régler tous les problèmes que pose l’absence d’équilibre entre les pouvoirs de l’exécutif et ceux du Parlement, elle va néanmoins dans le bon sens et c’est pourquoi nous la voterons, le cas échéant amendée.
Aujourd’hui, la primauté de l’exécutif sur le Parlement est sans cesse confirmée, la légitimité des assemblées parlementaires est mise en cause, quoi que vous en disiez, monsieur le ministre, et les attributions de leurs membres sont rognées.

Redonner quelques pouvoirs institutionnels, y compris de nature juridictionnelle, aux parlementaires que nous sommes est de la plus grande utilité.
M. le rapporteur, avec l’accord de l’auteur de cette proposition de loi, a déposé un amendement visant à en réduire le champ d’application. S’agissant du vote sur l’ensemble, il s’en remet à la sagesse du Sénat. Pour notre part, nous considérons que l’adoption de cet amendement rendrait moins pertinent ce texte en en limitant par trop la portée. De fait, nous laissons au juge un pouvoir d’interprétation qui évoluera à mesure que la jurisprudence entendra, de façon plus large, la notion d’excès de pouvoir de l’exécutif.
Cela étant, je le répète, nous voterons cette proposition de loi, même si l’amendement de la commission est adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi présentée par Yvon Collin et certains de ses collègues du groupe RDSE soulève de vraies questions et suscite un réel débat, comme l’attestent les propos des différents orateurs qui se sont succédé à la tribune.
Même si, il faut bien le reconnaître, ce débat peut paraître très technique à la plupart de nos concitoyens, ses termes sont très concrets.
Le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé en faveur de l’intérêt à agir d’un parlementaire invoquant une atteinte aux prérogatives du Parlement. C’est pourquoi les auteurs de la proposition de loi proposent d’apporter une réponse législative aux incertitudes jurisprudentielles. Cela mérite débat, j’en conviens.
Si j’ai bien compris, nos collègues du RDSE nous proposent de doter les parlementaires d’une présomption d’intérêt à agir dans trois hypothèses : celle où le pouvoir réglementaire empiéterait sur une matière constitutionnellement réservée au pouvoir législatif ; celle où une mesure réglementaire méconnaîtrait la loi ; celle, enfin, où le pouvoir réglementaire ne prendrait pas dans un délai raisonnable les mesures d’application d’une loi.
J’ai beaucoup apprécié le travail mené par M. le rapporteur et les débats qui ont eu lieu au sein de la commission des lois. Trois options ont été mises en évidence : soit, comme le proposent les auteurs de la proposition de loi, les parlementaires se voient reconnaître un très large intérêt à agir ; soit, par principe, il leur est dénié tout intérêt à agir du seul fait de leur qualité ; soit cette qualité leur est reconnue dans un nombre limité de cas. C’est cette dernière voie qu’a choisie M. le rapporteur en retenant deux hypothèses où un intérêt à agir pourrait être reconnu aux parlementaires.
La première hypothèse est celle où le Premier ministre refuserait de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une loi.
Si cette disposition devait être adoptée, elle aurait des conséquences particulièrement importantes. À cet égard, les exemples qu’a cités notre collègue Jean-Pierre Sueur sont éloquents. Chacun d’entre nous a été au moins une fois rapporteur d’un texte et a pu faire l’expérience de la frustration qu’on peut éprouver quand, six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans après son adoption, les décrets d’application ne sont toujours pas pris, si tant est qu’ils le soient jamais. Me vient à l’esprit le cas d’une loi de procédure pénale, promulguée voilà maintenant sept ans, dont tous les décrets d’application n’ont pas encore été pris…
Certes, ces mesures réglementaires restant en souffrance sont peu nombreuses, mais le Parlement s’étant prononcé clairement et souverainement, cette situation est problématique.
C’est pourquoi l’approche de M. le rapporteur me paraît très intéressante.
La seconde hypothèse dans laquelle l’intérêt à agir pourrait être reconnu aux parlementaires, qui prête sans doute moins à discussion, est celle où un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité aurait été pris alors que cette autorisation devait être accordée par une loi.
L’approche retenue par la commission peut paraître séduisante. Néanmoins, comme j’ai eu l’occasion de le dire en commission, je ne suis pas totalement convaincu par la nécessité d’adopter ce dispositif.
À mon sens, trois interrogations subsistent, lesquelles, n’en doutons pas, ne seront pas tranchées par le débat d’aujourd’hui.
Premièrement, je m’interroge sur la constitutionnalité du dispositif proposé. En effet, la proposition de loi évoque une forme de nouvelle régulation juridictionnelle de la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Certes, je ne suis pas constitutionnaliste, mais, intuitivement, au regard du principe de séparation des pouvoirs, qu’on nous enseigne dès l’école primaire en cours d’instruction civique, j’ai tendance à penser que cette évolution peut difficilement se passer d’une base constitutionnelle.
Deuxièmement, je m’interroge sur les conséquences qu’aurait cette évolution sur le bon fonctionnement de nos institutions.
À mon sens, on ne peut être que réservé sur le sens et l’utilité d’une forme de juridictionnalisation du contrôle exercé par les assemblées sur l’action du Gouvernement. Les parlementaires, fussent-ils juristes, pourraient éprouver un certain dépit à devoir privilégier l’action devant les tribunaux, en lieu et place du débat parlementaire et politique. J’ai le sentiment que, si nous nous engagions dans cette voie, nous nous dessaisirions, nous, parlementaires, de nos prérogatives constitutionnelles en matière de contrôle de l’action gouvernementale.
Les actions que nous pourrions engager devant le Conseil d’État, en tant que parlementaires, concernant l’application des lois, ne pourraient que troubler nos concitoyens : pourquoi, se demanderaient-ils, des députés ou des sénateurs emprunteraient la même voie que nous en saisissant la juridiction administrative alors qu’ils ont théoriquement des prérogatives que nous n’avons pas ?
Cela provoquerait également des interrogations au regard du fonctionnement de la justice. En effet, le texte proposé reviendrait indirectement à créer une forme d’action populaire, et Jean-René Lecerf a évoqué ce risque dans son rapport. Or le Conseil d’État a toujours pris soin d’éviter toute forme d’action populaire.
Je rappelle que, en matière pénale, en France, on refuse qu’il y ait des procureurs privés : nous sommes attachés à ce que l’action publique soit exercée par des magistrats, les magistrats du parquet.
En outre, je ne suis pas convaincu que le recours aux juges serait plus efficace que le dialogue politique sur l’adoption des décrets.
Je remercie M. Yvon Collin et ses collègues de nous entraîner dans une réflexion qui, de prime abord, ne m’apparaissait pas essentielle. Mais, plus on y songe, plus on s’aperçoit qu’il y a quelque chose à faire. Toutefois, je me demande si le travail à accomplir n’est pas de plus grande envergure. Dans une République modernisée, où les pouvoirs seraient rééquilibrés en faveur du Parlement – même le Président de la République s’est exprimé en ce sens –, ne faut-il pas envisager des adaptations et des innovations institutionnelles ?
Monsieur Collin, vous ouvrez la voie à une réflexion bien plus approfondie, qui devrait se nourrir de propositions de juristes que nous ne sommes pas forcément, du moins que je ne suis pas.
Vous aurez compris, cher collègue, mes réticences importantes à l’égard de votre proposition de loi, quel que soit l’intérêt que j’y porte.
Mes collègues de l’Union centriste et moi-même sommes prêts à vous accompagner dans la réflexion d’innovation constitutionnelle qui pourrait être proposée dans les mois ou les années à venir. Cela apparaît, en effet, comme une nécessité, au moins en ce qui concerne les retards pris par le pouvoir exécutif dans la publication des textes d’application des lois.
Applaudissements sur le banc de la commission.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d’une règle de droit. Cela résulte de la jurisprudence du Conseil d’État. Ainsi est assuré, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité : si l’autorité administrative ne respecte pas les limites qui lui ont été assignées par la Constitution ou par la loi, elle commet un excès de pouvoir.
Vous nous proposez, cher collègue Yvon Collin, de trancher aujourd’hui une question importante à laquelle le Conseil d’État s’est toujours soustrait volontairement : un parlementaire peut-il jouir, ès qualité, d’un intérêt pour agir ou d’une possibilité d’agir en matière de recours pour excès de pouvoir lorsque la défense des prérogatives du Parlement est en jeu ?
Notre rapporteur, Jean-René Lecerf, qui a réalisé un travail dont je tiens à saluer la qualité, nous a rappelé que cette proposition soulevait des questions essentielles en ce qui concerne tant les moyens d’action des parlementaires pour la défense des prérogatives du Parlement que le rôle et la place de la haute juridiction.
D’abord, la proposition de loi s’inscrit-elle dans le droit fil de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dont l’ambition – et le résultat – est de rééquilibrer les institutions en faveur du Parlement ?
Ensuite, le parlementaire a-t-il vocation à agir sur le terrain judiciaire pour défendre les droits du Parlement ?
Enfin, le Conseil d’État peut-il ou doit-il devenir l’arbitre de conflits entre les assemblées et le Gouvernement ?
Le texte qui nous est soumis tend à apporter une réponse aux incertitudes jurisprudentielles et à trancher ainsi une question importante à laquelle, on l’a dit, le Conseil d’État s’est toujours soustrait, invoquant, à juste titre selon moi, une atteinte aux prérogatives du Parlement.
Lorsque cette proposition de loi a été déposée, j’ai regretté que le Conseil d’État n’ait pas lui-même tranché cette question, ce qui nous aurait épargné ce débat !
Toutefois, le Conseil d’État n’a fait que démontrer sa finesse d’analyse juridique en décidant de ne pas trancher ce débat parce que celui-ci est, en réalité, de niveau constitutionnel. Il porte, en effet, sur l’équilibre des pouvoirs puisqu’il s’agit de doter les parlementaires de prérogatives qui ne sont prévues nulle part.
Nous savons que le recours pour excès de pouvoir suppose, pour être recevable, un intérêt personnel à agir, défini dans la jurisprudence, comme le rappelait le président Hyest lors de nos débats en commission des lois.
Le parlementaire n’a pas un intérêt particulier à faire valoir en tant qu’individu pour introduire un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, si l’on va dans le sens de la proposition de loi, on crée un nouveau cas de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, distinct de celui qui existe actuellement et qui est fondé sur l’intérêt personnel à agir. Ce faisant, on donne un pouvoir nouveau aux parlementaires et on touche donc à l’équilibre des pouvoirs, qui est un principe purement constitutionnel.
Dès lors, il n’est pas concevable de toucher à cet équilibre par une voie ordinaire. C’est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas suivre la direction proposée.
Il s’agit d’autant plus d’un changement d’équilibre entre les pouvoirs au sein de la République que l’on confère finalement au juge un rôle nouveau : en cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement, il reviendra au juge de trancher. On crée ainsi un véritable gouvernement des juges, ce qui n’est pas imaginable dans le cadre d’une simple proposition de loi ordinaire. Il faut peut-être y regarder à deux fois avant de se lancer dans une telle entreprise !
Par conséquent, même si j’admire le travail effectué par notre rapporteur, je considère que nous ne pouvons pas aller dans ce sens ; je n’y vois pas de progrès pour la démocratie.
Il nous appartient, au titre des pouvoirs qui nous sont donnés par la Constitution, de nous engager dans un contrôle exigeant de l’application des lois. La disposition introduite par la révision constitutionnelle de 2008 concernant le contrôle exercé par le Parlement est récente et n’a pas encore produit tous ses effets. Il nous appartient de prendre des initiatives et d’appréhender la totalité des possibilités que nous offre la Constitution.
Le dispositif qui nous est proposé aujourd'hui allant bien au-delà des dispositifs constitutionnels actuels, le groupe UMP ne le votera pas.
M. René Garrec applaudit.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi présentée par M. Yvon Collin, et qui sera sans doute amendée par le rapporteur, me paraît essentielle. En effet, elle a pour but de rétablir l’équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Monsieur Collin, vous avez eu le mérite de poser le problème avec beaucoup de netteté : ce rééquilibrage des pouvoirs doit-il conduire à recourir au juge ?
J’aborderai ce débat sous deux angles, le premier étant celui de la légalité.
On a dit que ce texte posait un problème de légalité et de constitutionnalité. Ce n’est pas mon sentiment. Le droit est complexe, nous le savons tous, mais il l’est encore davantage en la matière. La jurisprudence du Conseil d’État est elle-même assez composite.
Un arrêt Schwartz de 1981, repris dans ses grandes lignes par un arrêt de 1987 concernant M. Michel Noir, précise qu’il n’existe pas d’intérêt à agir du parlementaire ; je le concède volontiers. Cependant, un arrêt de 1978 avait affirmé qu’un parlementaire peut agir contre un acte réglementaire qui limiterait les pouvoirs du Parlement. Autrement dit, dès lors que l’on porte atteinte aux pouvoirs du Parlement, le parlementaire se voit reconnaître un droit à agir.
En vérité, nous sommes, sinon dans l’hypocrisie, car il y a tout de même derrière la position du Conseil D’État un raisonnement juridique assez charpenté, mais au moins dans une situation paradoxale puisque, dès l’instant que le parlementaire se dépouille de ses attributs de parlementaire, il se trouve en droit d’agir.
Je reprends deux des exemples qui ont été cités. En tant que parlementaire, M. François Bayrou ne peut pas agir, mais en tant qu’actionnaire d’une société d’autoroute, il le peut ! En tant que parlementaire, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ne peut pas agir, mais en tant qu’usager du service public de la télévision, elle le peut !
Reconnaissons que, au-delà des solides soubassements juridiques du raisonnement, c’est tout de même à une forme de schizophrénie que nous conduit la jurisprudence du Conseil d’État !
Pour en revenir à la légalité, je reprendrai les excellents propos de Jean-Pierre Sueur. Quels sont les grands juristes à avoir considéré cette question ? M. Daniel Labetoulle, qui est indiscutablement un grand juriste, qui a une expérience considérable et qui a exercé de très hautes responsabilités au sein du Conseil d’État, affirme que cette question ne présente pas de difficulté constitutionnelle.
Il est quelque peu paradoxal de nous opposer l’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. En vérité, le problème se pose en sens inverse : c’est le pouvoir exécutif qui limite le pouvoir du Parlement s’il ne prend pas les mesures réglementaires ! Le principe de la séparation des pouvoirs exige que le pouvoir législatif exerce la totalité de ses prérogatives et, donc, qu’il dise au pouvoir exécutif que celui-ci n’a pas à le limiter dans son action.
J’en viens au second angle sous lequel j’aborde ce débat, et je me montrerai là un peu plus polémique.
Monsieur le ministre, j’ai bien entendu votre argumentation, reprise par Laurent Béteille, qui consiste à nous dire : « Vous ne vous rendez pas compte que vous allez renoncer à vos prérogatives parlementaires, et peut-être même dénaturer un peu la fonction de parlementaire si, demain, vous formez un recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux au lieu d’exercer ce que la loi vous reconnaît. » Honnêtement, je ne vois pas à quoi nous renonçons !
Aujourd'hui, nos droits consistent à publier tous les ans un excellent rapport sur l’application des lois, ce qui est une très bonne avancée, à poser des questions, sans doute remarquables. En quoi ce texte, si nous le votons, nous privera-t-il de ces droits ? En rien !
Non seulement nous ne renonçons à rien, mais nous souhaitons avoir une prérogative supplémentaire. Nous allons au bout de nos droits.
À cet égard, l’argument qui a été opposé est un peu paradoxal car, dans une démocratie, aller au bout de ses droits implique d’aller devant le juge. Je ne comprends pas le raisonnement qui est tenu. Le problème ne se poserait pas dans un autre pays démocratique. Exercer ses pouvoirs dans un État de droit, c’est, à un moment donné, s’adresser au juge pour qu’il arbitre un litige. Je ne vois là rien de scandaleux, d’anticonstitutionnel ou propre à limiter les libertés du Parlement.
Monsieur le ministre, pardonnez-moi, sauf erreur de ma part, j’ai cru vous entendre dire, dans votre volonté de démontrer, que, de toute façon, le Parlement se situait au-dessus de la justice et qu’il n’avait pas à se mettre en dessous en s’adressant à un juge.

Si vous ne l’avez pas dit, veuillez m’excuser. Mais si vous avez prononcé ces mots, j’estime que c’est assez maladroit de votre part, parce que nous sommes évidemment tous en dessous du pouvoir judiciaire, c’est-à-dire des décisions de justice. Nous vérifierons, mais il me semble bien avoir entendu cela.
Pour terminer, je partage totalement la philosophie qui sous-tend la proposition de loi et j’approuve les amendements présentés par Yvon Collin et Jean-René Lecerf. Ensemble, ils permettent de parvenir à un excellent équilibre et de réaliser une avancée, qui, si elle n’est pas majeure, favorisera tout de même le respect du travail parlementaire.
Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Madame la présidente, j’indique d’ores et déjà que le Gouvernement est contre la présente proposition de loi et les amendements qui ont été déposés.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de la qualité du débat. J’ai entendu les différents arguments invoqués en faveur de la proposition de loi. Ils sont tous parfaitement légitimes et il est normal que vous puissiez les développer, mais je ne les partage pas car je n’accepte pas leur logique.
Monsieur Sueur, vous dites qu’il n’existe aucun moyen de contraindre le Gouvernement à publier des décrets, c’est faux !
Monsieur le sénateur, il est très gênant pour moi de vous expliquer cela, parce que je donne l’impression que, dans un autre temps, j’ai pu recourir à des moyens qui ne sont pas utilisés aujourd’hui.
Je vais néanmoins répondre à votre question : le pouvoir de contrôle de l’exécution de la loi est donné aux commissions, qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs présidents, et non à n’importe quel parlementaire, qu’il soit député ou sénateur.
À partir du moment où un rapport sur l’exécution de la loi est rédigé conjointement par le rapporteur de la loi et un rapporteur de l’opposition – c’est ce qui se fait à l’Assemblée nationale –, il doit évidemment avoir une suite.
De plus, lorsqu’un ministre est convoqué devant une commission par le président de celle-ci, sans la presse – la présence de journalistes risquerait de dénaturer la réalité des échanges –, j’imagine mal que, face aux sénateurs ou aux députés qui décortiquent la mauvaise qualité de l’application de la loi en raison de l’absence de décrets, ce membre du Gouvernement se contente de répondre : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »
Chaque fois que nous l’avons fait à l’Assemblée nationale, les résultats ont été immédiats. Je vous citerai un seul exemple, celui de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. En quarante-huit heures, M. Chatel a rapporté une circulaire d’août 2008 – je le dis afin que cela figure au Journal officiel – qui remettait en cause ce que nous avions voté sur l’urbanisme commercial. Il l’a fait parce que nous l’avons convoqué et lui avons expliqué que la circulaire ne correspondait pas à l’esprit de la loi.
Il est donc possible d’établir des dialogues constructifs.
Monsieur Sueur, vous avez évoqué la loi de 2004 relative, notamment, au congé de maternité. Le ministre a-t-il été interpellé par la commission des affaires sociales du Sénat sur l’application de ce texte ? Je ne sais ce qu’il en est, je ne suis pas sénateur. Simplement, il est faux de dire qu’il n’y a aucun moyen de contraindre le Gouvernement à prendre des décrets.
Je croyais que c’était moi qui avais la parole, monsieur Sueur !

Je me permets de solliciter la possibilité de vous interrompre, monsieur le ministre !
Je ne vous ai pas interrompu lors de votre démonstration !
Je le répète, quand vous dites qu’il n’existe aucun moyen d’obliger l’exécutif à publier des décrets, je vous réponds que c’est faux ! Il suffit que les présidents de commission le fassent, et ils s’en acquittent aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.
M. Labetoulle que vous citez, dont je ne remets pas en cause les qualités, n’a jamais été président de commission, ni ici ni au Palais-Bourbon, n’a jamais exercé la fonction de parlementaire et n’a pu être investi à ce titre d’une mission de contrôle de l’exécution des lois.
Quant à M. Massot, il se prénomme Jean et non Jacques !
Je suis certes ignorant en ce qui concerne le Conseil d’État, mais au moins je connais M. Massot !
On pourrait poursuivre le débat, mais je ne souhaite pas le cantonner autour d’intentions politiques. J’essaie de l’orienter sur les questions de fond.
Même si j’appartiens au Gouvernement, j’aime trop le Parlement, …
…. je suis trop attaché à l’exercice de ses prérogatives pour accepter qu’il se « dépouille », comme l’a dit M. Anziani, ou se départisse de celles qui lui reviennent.
Nous parlons ici de l’équilibre des pouvoirs choisi par le constituant en 2008, voilà un peu plus de deux ans. L’article 24 de la Constitution a été modifié dans le sens d’un renforcement du rôle du Parlement, notamment pour le contrôle de l’exécution des lois.
Le Gouvernement est prêt à aider au maximum ceux qui souhaiteront s’investir dans cette mission, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
La séparation des pouvoirs, monsieur Sueur, est affirmée depuis bien plus longtemps que vous n’êtes sénateur et que je n’ai été député.
Si un parlementaire agit en son seul nom, pourquoi son action serait-elle forcément recevable, alors qu’il ne peut faire état d’aucun intérêt personnel ? Cela pose aussi un problème de fond : les rapporteurs des lois sont-ils dans la même situation que tous les autres parlementaires ? La réponse est non, et j’en reviens à la démonstration que j’ai faite tout à l’heure.
Enfin, monsieur Sueur, vous évoquez la volonté de coercition à l’égard du Gouvernement. Tel est bien le fond du problème. Un instrument de coercition entrant dans le cadre des relations entre les pouvoirs ne peut trouver sa place que dans la Constitution. Dès lors, proposez-nous une réforme constitutionnelle, ce serait légitime !
Monsieur le rapporteur, vous en conviendrez avec moi, ce n’est pas une simple loi qui peut modifier ce qui est de nature constitutionnelle et concerne notamment la séparation des pouvoirs.
Du travail reste à faire. Si vous le voulez, nous pouvons œuvrer ensemble, mais je suis obligé de vous dire que cette proposition de loi ne répond pas aux principes qui vous incitent tous à agir.
Madame Borvo Cohen-Seat, vous regrettez une dégradation de la qualité de la loi. L’initiative de la loi appartient au Gouvernement, mais c’est le Parlement qui vote la loi. Il revient donc à ce dernier d’en améliorer la qualité. Quand vous passez des heures et des heures dans cette enceinte, comme je l’ai fait à l’Assemblée nationale, c’est bien pour faire votre travail de parlementaire. Les amendements sont destinés à améliorer la qualité de la loi. Cela relève du fonctionnement normal du Parlement. Par conséquent, si la qualité du travail est dégradée, ce n’est pas le Gouvernement qui peut vous répondre, madame Borvo Cohen-Seat.
Vous avez dit tout à l’heure que les parlementaires trépignaient dans l’hémicycle. §La formule est amusante, et je veux bien rire avec vous ; mais permettez-moi d’en revenir à l’exemple que j’ai cité concernant la loi de modernisation de l’économie en 2008 : en deux heures, les modifications ont été introduites. Il s’agit donc non pas de trépigner, mais de travailler ; il s’agit non pas de lancer des invectives, mais d’organiser des actions de conviction, qui sont aussi des moyens de contrainte à l’égard du Gouvernement. On peut effectivement l’obliger à avancer et à prendre des décrets d’application. À cet égard, je prendrai des initiatives et j’espère, madame la sénatrice, que vous les soutiendrez.
Monsieur Zocchetto, je vous remercie de vos propos que j’ai appréciés car, malgré nos quelques divergences, nous sommes sur la même ligne.
Vous avez souhaité, comme M. Béteille, que nous continuions à travailler ensemble pour que le Gouvernement s’engage dans la voie d’un meilleur contrôle de l’application des lois. Je réponds par l’affirmative et, je l’ai dit, je prendrai des initiatives en ce sens. Je souhaite que vous soyez des gardiens vigilants de la manière dont le Gouvernement envisage les choses dans ce domaine. J’ai évoqué tout à l’heure les débats que nous organiserions dans cette enceinte. Ils seront la conclusion de tout ce que je souhaite que nous puissions faire d’ici là.
Vous avez insisté sur le fait qu’un recours des parlementaires devant le Conseil d’État risquait de troubler l’opinion et d’entretenir une certaine confusion. Je suis sensible à cet argument.
Le Gouvernement ne dit pas que la question posée par la proposition de loi n’a pas de réponse. Il considère que ce texte n’est pas la bonne réponse. Nous pourrons en rediscuter.
Monsieur Béteille, je partage votre analyse et vos arguments. Je le redis à vous et à celles et ceux qui veulent poursuivre la réflexion avec nous, le Gouvernement est à votre disposition pour mettre en commun des moyens, des actions, et améliorer encore l’application des lois par le pouvoir exécutif. J’y suis tout à fait favorable et je vous remercie de vos propositions.
Monsieur Anziani, d’un côté, vous vous demandez à quels droits vous renonceriez en votant cette proposition de loi et, de l’autre, vous ne comprenez pas que le Sénat veuille se dépouiller de ses prérogatives. Cela me paraît quelque peu contradictoire.
Par ailleurs, si des obstacles doivent être levés, c’est dans le cadre du contrôle exercé non par un parlementaire isolé, comme vous l’avez évoqué, mais par les commissions et leurs présidents. Un dialogue constructif doit avoir lieu en permanence entre le Parlement – la majorité et l’opposition – et le Gouvernement.
Je n’ai pas dit que le Parlement était au-dessus de l’autorité judiciaire. C’est une mauvaise interprétation de mes propos. J’ai affirmé que vous étiez souverains et que l’on ne peut pas vous retirer cette qualité. De ce fait, vous pouvez exercer la plénitude de tous vos pouvoirs, y compris celui qui consiste à contrôler l’application des lois.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique de la proposition de loi initiale.
Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. – Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat sont réputés justifier d’une qualité leur donnant intérêt à agir par la voie du recours pour excès de pouvoir contre une mesure réglementaire édictant une disposition relevant du domaine de la loi, une mesure réglementaire contraire à une disposition législative, ou contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative. »

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Collin.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :
« 1° Contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application d'une disposition législative ;
« 2° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l'article 53 de la Constitution. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi :
Proposition de loi tendant à reconnaître aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, cet amendement a pour objet de réécrire l’article unique de la proposition de loi en tenant compte des observations de M. le rapporteur, et donc de la commission des lois.
Le texte que nous vous avons initialement soumis visait un champ d’application particulièrement large, puisqu’un parlementaire aurait justifié d’un intérêt à agir dans des hypothèses si vastes que certains ont même posé la question de la constitutionnalité du dispositif visant, par exemple, le cas de la mesure réglementaire déférée devant le juge administratif comme contraire à une disposition législative.
Pour autant, sans entrer dans un débat juridique approfondi, je ne suis pas sûr que l’inconstitutionnalité ainsi avancée soit certaine, car la mesure que nous proposions était proportionnée au but recherché, à savoir garantir l’intégrité des prérogatives du Parlement et, en l’occurrence, s’assurer que la volonté du législateur est respectée.
Néanmoins, après avoir entendu les observations des uns et des autres, notre réflexion a évolué. C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, de restreindre le champ d’application de la proposition de loi à deux hypothèses plus précises.
En premier lieu, il vise, comme dans le texte initial, les cas dans lesquels le refus du Premier ministre d’édicter dans un délai raisonnable les mesures d’application d’une loi serait susceptible de constituer une faute.
Cette hypothèse se situe, pour nous, au cœur de l’objectif que nous nous étions fixé en déposant cette proposition de loi, à savoir permettre à des parlementaires, en tant que tels, de mettre, non pas l’administration, mais bien le pouvoir exécutif, au sens constitutionnel du terme, devant ses propres responsabilités, dans le cas où il n’aurait pas respecté ses obligations, en l’occurrence celle d’assurer l’applicabilité de la loi souverainement votée.
En aucun cas il ne s’agit, dans notre esprit, de prolonger devant le Conseil d’État le débat tenu dans une enceinte politique, au risque de dénaturer la fonction juridictionnelle de la haute juridiction administrative. Le contrôle politique et le contrôle judiciaire sont bien deux modalités complémentaires d’exercice de la fonction parlementaire, et non deux dispositifs concurrents.
Enfin, on aurait tort de croire que l’opposition, quelle qu’elle soit d’ailleurs, s’emparera d’un tel moyen pour inonder le Conseil d’État de recours en cascade. Nous souhaitons simplement que les parlementaires, auteurs de la loi, puissent s’assurer ès qualités de la pleine application de la norme qu’ils ont créée.
En second lieu, notre amendement vise le recours dirigé contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un accord international, dès lors que le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation relèverait du domaine de la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution.
Encore une fois, il est à notre sens légitime que les parlementaires puissent défendre les prérogatives du Parlement, en l’occurrence le domaine de la loi, à partir du moment où l’auteur d’un acte réglementaire viole son champ de compétence. Incontestablement, ce type d’acte réglementaire « fait grief » aux parlementaires, puisqu’il les prive de l’exercice d’une compétence que la Constitution leur a attribuée.
De plus, le Conseil d’État ne paraît pas avoir explicitement écarté l’intérêt à agir des parlementaires en tant que tels dans une telle hypothèse. C’est l’interprétation que l’on pourrait donner de l’arrêt Fédération nationale de la libre pensée et autres, même si la doctrine ne s’accorde pas sur ce point. Il n’en reste pas moins vrai que cette hypothèse est légitime du point de vue des droits du Parlement, et qu’il convient de mettre un terme au flou de la jurisprudence.
Je vous invite donc tous, mes chers collègues, à adopter cet amendement ou, si vous préférez, l’amendement identique de notre rapporteur.

Madame la présidente, je précise d’emblée que la commission ne peut qu’être favorable à l’amendement n° 1 rectifié, puisque l’amendement que j’ai déposé est identique.
D’abord, je dois dire que le juriste de droit public que je suis a pris beaucoup de plaisir à assister à ce débat.
Ensuite, permettez-moi d’apporter quelques précisions complémentaires. Ce texte pose, d’une part, un problème d’opportunité, d’autre part, un problème constitutionnel.
Sur le premier point, je laisse à chacun le soin d’apprécier l’opportunité de ce texte.
En ce qui concerne le second point, parmi les conseillers d’État et les professeurs de droit que j’ai auditionnés, aucun n’a jugé insurmontable le problème d’inconstitutionnalité. La majorité d’entre eux considéraient même que la proposition de loi d’origine était constitutionnelle.
Je ne peux donc pas laisser certains de nos collègues, comme Laurent Béteille, affirmer qu’il s’agit de demander au juge de trancher un différend entre le Gouvernement et le Parlement. Il ne saurait y avoir de différend en la matière, puisque le Gouvernement a l’obligation de prendre les décrets d’application des lois. Ce n’est pas pour l’exécutif une simple faculté, sans quoi la séparation des pouvoirs n’existerait plus.
Sur cet aspect strictement constitutionnel, je ne partage pas les opinions de M. le ministre. On peut certes considérer que ce texte a une incidence sur les rapports entre le Gouvernement et le Parlement, bien que ce soient plutôt les rapports entre le Parlement et le juge qu’il tendrait à modifier.
Quoi qu’il en soit, j’observe que de nombreuses structures ayant une incidence sur les rapports entre le Gouvernement et le Parlement ont été créées, alors même que leur existence n’était nullement prévue par le texte de la Constitution. Ce fut le cas des commissions d’enquête pendant très longtemps, avant que la révision de 2008 ne leur confère une existence constitutionnelle, mais aussi des différents offices et délégations qui ont été instaurés.
Sur la question de savoir si la reconnaissance d’un intérêt à agir des parlementaires pourrait être considérée comme une injonction du Parlement à l’égard du juge, je fais remarquer que de très nombreux textes contiennent des dispositions similaires, notamment le code de l’environnement ou le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l’article L. 211-2 de ce dernier code donne au ministre chargé de la culture intérêt à agir en matière de droits d’auteur.
Les arguments en faveur de l’inconstitutionnalité de ce texte méritent donc, à tout le moins, d’être relativisés.
Je précise enfin que, si le 1° de l’amendement n’a été adopté qu’à une seule voix de majorité par la commission des lois, le 2° l’a été à la quasi-unanimité de ses membres, aucune voix ne s’étant élevée contre cette disposition.

Le Gouvernement a exprimé son opposition à ces amendements.
La parole est à M. le vice-président de la commission des lois.

Pour les raisons que vient d’exposer à l’instant M. le rapporteur, je demande qu’il soit procédé à un vote par division sur cet amendement, en distinguant les deux cas pour lesquels l’intérêt à agir des parlementaires pourrait être reconnu.
Tout d’abord, ces cas soulèvent des questions sensiblement différentes, comme nous l’avons vu au cours du débat.
Ensuite, comme l’a précisé M. le rapporteur, il apparaît que, si le second cas n’a pas posé de problèmes en commission, le premier a soulevé davantage de difficultés.

Je suis saisie d’une demande de vote par division sur les amendements identiques n° 1 rectifié et 2.
Je vais donc mettre aux voix le 1° du I de ces amendements.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 163 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Quel est donc l’avis de la commission sur le 2° du I des amendements identiques n° °1 rectifié et 2 ?

Comme je l’ai indiqué tout à l'heure, la commission est à l’évidence totalement favorable à l’adoption de cette disposition qui a recueilli l’unanimité des suffrages exprimés au sein de la commission des lois.
J’ajoute que si vous votiez ce second point, mes chers collègues, vous permettriez à la proposition de loi de suivre son cours. Il me semble important que le débat passionnant qui s’est engagé dans cette assemblée puisse se poursuivre dans le cadre de la procédure législative.
Très clairement, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Je vous invite à faire preuve de cohérence dans vos votes, mesdames, messieurs les sénateurs. Je ne vois pas au nom de quoi le Sénat, après avoir rejeté le 1°, approuverait le 2°.
En outre, l’adoption de cette disposition risquerait, en rendant plus difficile l’application des accords internationaux, de gêner la conduite de la politique étrangère de la France.

Je mets aux voix le 2° du I des amendements identiques n° 1 rectifié et 2.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 164 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 1 rectifié et 2.

Madame la présidente, mon explication de vote vaudra à la fois pour ces deux amendements identiques et pour l’article unique de la proposition de loi.
Monsieur Collin, au nom du groupe socialiste, je veux vous remercier de nouveau, car vous avez posé une véritable question et proposé, avec M. le rapporteur, une très bonne solution. Nous pensons que, de toute façon, il faudra revenir sur le sujet, car nous ne pouvons accepter que le législateur soit ainsi constamment bafoué par des gouvernements qui omettent de publier les textes d’application des lois.
Je le répète, la seule façon de régler ce problème est que le Conseil d'État condamne le Gouvernement pour la non-application de la loi et le préjudice qui est ainsi porté aux citoyens de ce pays.
Je le redis également, la jurisprudence est en train de changer. Ce qu’a écrit à cet égard le président Labetoulle n’est absolument pas anodin. Celui-ci a pris position clairement pour indiquer que le Conseil d'État ne pourrait éternellement considérer qu’il n’est pas opportun de statuer sur la recevabilité des recours des parlementaires pour excès de pouvoir.
La présente initiative était donc nécessaire et salutaire, et j'espère qu’elle sera reprise. L’histoire est un long chemin, monsieur Collin !
Monsieur Dallier, je me permettrai, à votre attention particulière, une remarque complémentaire sur le mode de scrutin dans notre hémicycle.
Je sais que le vote est libre, et évidemment nous sommes tous très attachés à ce principe. Je sais également qu’entre le débat en commission et le vote en séance publique les esprits peuvent évoluer et qu’il peut se produire une maturation intellectuelle, voire idéologique.
Néanmoins je constate que, en commission, l’ensemble des membres du groupe UMP, pour parler franchement, avaient voté dans un sens…

M. Jean-Pierre Sueur. En effet ! Je vous en donne acte, monsieur Garrec, monsieur Béteille, puisque vous n’étiez pas présents, pour de très bonnes raisons d'ailleurs, au moment du vote en commission.
Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

L’ensemble des membres du groupe UMP présents en commission, disais-je, avaient approuvé la seconde partie de ces amendements identiques, qui d'ailleurs vient d’être votée par le Sénat, ce dont je me réjouis.
Or la réflexion ultérieure et les efforts d’argumentation déployés par M. Dallier pour convaincre ses collègues, sur le plan intellectuel et par la force des idées
Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Je me permets de le noter, à toutes fins utiles, car cela ne me paraît pas totalement anodin. En tout cas, monsieur Dallier, je vous félicite de votre force de conviction.

Monsieur Sueur, en cet instant deux représentants du groupe socialiste sont présents dans cet hémicycle, et je ne sais pas s’ils peuvent s’exprimer au nom de l’ensemble de leurs collègues. Dès lors, de grâce, ne me prenez pas à partie !
S’il faut changer un jour le mode de scrutin de cette assemblée pour faire en sorte que seuls les présents votent, nous le ferons. Nous serons dès lors certains de l’opinion des uns et des autres. En attendant, je le répète, ne me prenez pas à partie sur ce sujet, de grâce, car à bien d’autres occasions nous aurions pu vous retourner le compliment.
Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié et 2.
Je rappelle que le rejet de ces deux amendements identiques vaudrait rejet de la proposition de loi.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 165 :
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, l’article unique constituant la proposition de loi est rejeté.

Ce vote est contradictoire avec le précédent. C’est complètement illogique !

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Roland du Luart.