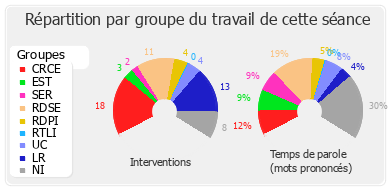Séance en hémicycle du 15 octobre 2012 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décisions du conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité
- Renvois pour avis
- Ressortissants de nationalités roumaine et bulgare (voir le dossier)
- Haute autorité de l'expertise scientifique (voir le dossier)
- Transfert des biens sectionaux aux communes (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 12 octobre 2012, les décisions du Conseil sur deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- le IV de l’article L. 430-8 du code de commerce, ainsi que du II de l’article L. 461-1, de l’article L. 461-3 et du III de l’article L. 462-5 du même code (n° 2012-280 QPC) ;
- les articles 1er-1, 29, 29-1 et 29-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom et des articles 2 et 8 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (n° 2012-281 QPC).
Acte est donné de ces communications.

J’informe le Sénat que le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (n° 43, 2012-2013), dont la commission des finances est saisie au fond est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des affaires sociales.

L’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de résolution relative aux ressortissants de nationalités roumaine et bulgare, présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par Mme Aline Archimbaud et les membres du groupe écologiste (proposition n° 590, 2011-2012).
Dans le débat, la parole est à Mme Aline Archimbaud, auteur de la proposition de résolution.

délégué, mes chers collègues, lors de mon arrivée au Sénat, l’année dernière, j’ai souhaité commencer un travail de fond portant sur la situation de certains de nos concitoyens européens, les ressortissants roumains et bulgares, et, parmi eux, ceux qui connaissent les situations les plus précaires économiquement, communément désignés comme « Roms », bien que tous n’appartiennent pas au peuple rom.
Mon expérience d’élue locale m’avait conduite à être témoin des conditions de vie misérables dans lesquelles beaucoup d’entre eux vivent, ou plutôt survivent, et des préjugés dont ils sont victimes dans la société française, qui débouchent sur bon nombre de discriminations et de mauvais traitements.
Cette situation m’a paru indigne de notre République. J’ai donc pris contact avec les acteurs de terrain engagés à leurs côtés : associations et organisations non gouvernementales, élus et simples citoyens, mais également ressortissants roumains et bulgares, car on ne peut agir pour le bien des personnes sans elles. Il s’agissait pour moi de mieux comprendre les difficultés et les obstacles rencontrés au quotidien et d’identifier les leviers à actionner afin de permettre une meilleure intégration de ces populations.
Tous ont répondu présent, et je souhaite les en remercier chaleureusement. Je veux aussi saluer amicalement ceux d’entre eux qui suivent aujourd’hui ce débat dans les tribunes de cet hémicycle. Sans eux, ce travail n’aurait pas été possible.
Nous avons donc organisé, à partir de novembre 2011, des réunions de travail au Sénat et des déplacements dans plusieurs régions, dans les campements illégaux, sur les terrains conventionnés, au sein des dispositifs d’insertion, afin de prendre la pleine mesure de la situation. La direction de l’initiative parlementaire et des délégations du Sénat a également organisé des auditions ; je la remercie pour le travail accompli.
Nous avons donc entendu les responsables nationaux, mais aussi locaux, de la plupart des grandes associations qui interviennent sur le terrain : associations de défense des droits de l’homme, associations de solidarité et de lutte contre la pauvreté, associations de médecins humanitaires. Nous avons également entendu de nombreux élus locaux de toutes couleurs politiques, des responsables administratifs, ainsi que des citoyens roumains et bulgares. Tous soulignent les situations d’errance permanente, qui posent de graves problèmes d’accès aux soins. Les médecins auditionnés ont ainsi martelé les termes d’« urgence sanitaire ». Je vous invite également à lire le rapport de l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France, intitulé « Situation sanitaire et sociale des Roms migrants en Île-de-France », qui est, hélas, très clair sur cette question. Bien d’autres difficultés, touchant notamment à la scolarisation, ont été évoquées.
Permettez-moi, mes chers collègues, d’ouvrir une parenthèse historique.
L’histoire des Tsiganes et des Roms est faite depuis de nombreux siècles de réduction en esclavage, de stigmatisation, de persécution allant jusqu’à leur extermination par le régime nazi.
Sur un million de personnes dites « tsiganes » vivant en Europe à la fin des années trente, et plus spécialement en Europe de l’Est, entre 25 % et 50 % furent tuées durant la Seconde Guerre mondiale, et de nombreuses autres déportées à Auschwitz, Jasenovac et Buchenwald.
Aujourd’hui encore, les Roms sont victimes de discrimination dans leur pays d’origine, mais également dans leurs pays de résidence. Les préjugés sont tenaces envers cette population soupçonnée de se livrer à des actes de délinquance, de se complaire dans l’inactivité et de vivre des aides sociales.
Or les Roms présents en France sont le plus souvent des migrants économiques que la très grande précarité a poussés à quitter leur pays d’origine. Les témoignages recueillis lors des auditions qui ont précédé l’élaboration de cette proposition ont fait ressortir de façon très convergente leur volonté de trouver un emploi pour subvenir à leurs besoins et de scolariser leurs enfants, à l’opposé de la vision culturaliste développée par certains, qui postulent que les Roms ne souhaitent ni travailler ni s’intégrer.
Par ailleurs, la méfiance envers ces populations est également confortée par l’idée d’une arrivée massive de Roms en France. Or leur nombre sur le territoire français reste stable. Depuis le début des années 2000, il est comparativement faible : environ 15 000 à 20 000 Roms, au maximum, vivent sur tout le territoire. Toutes les estimations convergent sur ce point.
Très majoritairement de nationalités roumaine et bulgare, les Roms vivant en France doivent surmonter un très grand nombre d’obstacles, au premier rang desquels figurent les mesures transitoires des traités d’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union européenne signés en 2007.
En effet, bien que citoyens d’un pays membre de l’Union européenne, ils ne disposent pas aujourd’hui des mêmes droits que les autres ressortissants européens en France en matière d’emploi.
Alors que tous les autres ressortissants européens peuvent avoir accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants français, les Roumains et les Bulgares restent assujettis, en matière d’accès à l’emploi, aux mêmes obligations que les étrangers non communautaires souhaitant travailler en France : être en possession d’un titre de séjour et obtenir une autorisation de travail. Les textes communautaires autorisent, pour les pays qui le souhaitent, le maintien de telles mesures jusqu’à la fin de 2013.
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a critiqué cette situation dans sa délibération n° 2009-372 du 26 octobre 2009, en soulignant que, « depuis l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, les ressortissants de ces États ne sont considérés ni comme les autres communautaires ni comme des migrants non communautaires ».
L’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union européenne a permis à partir du 1er janvier 2007 aux ressortissants de ces deux pays, comme à « tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union », de bénéficier du « droit de circuler ou de séjourner librement sur le territoire des États membres ».
La directive européenne 2004/38/CE restreint cette liberté : « Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois [...] s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ».
Or les délais constatés pour l’obtention d’une carte de séjour et d’une autorisation de travail – nous en avons eu confirmation au cours des auditions que nous avons organisées et dans les témoignages que nous avons pu rassembler – sont très longs et dépassent souvent cinq ou six mois, pouvant aller jusqu’à neuf mois, ce qui ne manque évidemment pas de décourager les employeurs.
Mes chers collègues, depuis quelques mois, le contexte national a beaucoup changé concernant cette question, et je m’en réjouis.
Le 22 août dernier, M. le Premier ministre a présidé une réunion de travail à laquelle neuf ministres ont participé. Il a clairement été rappelé qu’il s’agissait d’une question d’humanité et de respect des principes fondateurs de la République, lesquels appellent à traiter de façon égale et digne toute personne en situation de difficulté sociale.
Un certain nombre de mesures extrêmement positives ont été prises, telles que la suppression de la taxe due par l’employeur à l’OFII, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et la mise en place d’une mission de coordination des différents ministères concernés et d’interface avec le monde associatif auprès du Premier ministre.
En outre, il y a quatre jours – le 11 octobre –, les ministres de l’intérieur et du travail ont annoncé que la liste des métiers accessibles aux Roumains et aux Bulgares en France sans opposabilité allait être élargie, notamment à des secteurs où les employeurs peinent aujourd'hui à recruter. Le nombre de ces métiers passera ainsi de 150 à 291.
La diminution des restrictions va dans le bon sens et, bien sûr, nous nous en félicitions. Mais justement, à quoi bon surcharger des administrations et des services qui ont déjà, on le sait, fort à faire par ailleurs pour contrôler le respect d’une liste désormais très large ainsi que d’une norme qui, à mon avis, ne présente plus aucun avantage mais en revanche bloque l’accès à un revenu légal ?
Dans ces conditions, il vaudrait mieux, me semble-t-il, aller jusqu’au bout, simplifier la procédure, et sortir ce faisant d’une situation absurde.
Absurde, la situation l’est en effet sur le plan financier. L’aide au retour humanitaire coûte – ce sont les chiffres officiels – 3 millions d’euros par an à notre pays, sans compter les frais de fonctionnement dont je n’ai pas pu trouver le montant mais qui, à mon avis, sont importants. Or c’est une mesure objectivement inefficace : elle ne règle rien puisque les Roumains et les Bulgares, qui sont Européens, peuvent revenir librement sur notre territoire. De plus, si ceux-ci avaient accès sans restriction au marché du travail, ce seraient autant de cotisations sociales qui tomberaient dans les caisses de l’État.
Absurde, la situation l’est également, me semble-t-il, sur le plan économique. Certes, la France est confrontée à une crise grave et à un chômage massif préoccupant, mais nous parlons ici d’environ 5 000 adultes postulant à des emplois dans des corps de métier dont beaucoup manquent actuellement cruellement de main-d’œuvre et qui sont donc non concurrentiels.
On arguera aussi d’un risque d’« appel d’air ». Pour ma part, je n’ai constaté d’appel d’air, ni en Italie, pays qui a suspendu les mesures de restriction sur son territoire à la fin de 2011, voilà donc bientôt un an, ni en Irlande, pays qui les a suspendues il y a environ un mois, ni dans les autres pays – nous ne sommes plus que dix à les maintenir – qui les avaient déjà suspendues.
Je rappelle par ailleurs que la Commission européenne a rendu public, le 18 novembre 2008, un rapport sur les effets de la libre circulation des travailleurs élargie aux nouveaux membres de l’Union européenne, rapport qui ne concluait à aucun impact négatif significatif sur les salaires, sur les emplois locaux, sur les finances publiques non plus que sur les systèmes de protection sociale des pays d’accueil.
Par ailleurs, si nous voulons construire l’Europe, quelles que soient les difficultés, nous ne pouvons pas admettre que subsistent longtemps des citoyens européens de seconde catégorie qui auraient moins de droits que les autres. Ce n’est pas une bonne base pour construire l’Union européenne !
La Roumanie et la Bulgarie sont les deux seuls pays, sur les vingt-quatre autres, dont les ressortissants sont visés en France par des mesures de dérogation, demandées par notre pays, et cela sans qu’il n’y ait réciprocité : un citoyen français en Roumanie ou en Bulgarie n’a pas à demander une autorisation spéciale de travail.
Soyons clairs. Chacun doit assumer ses responsabilités, qui, en l’espèce, sont de trois ordres : celle des gouvernements roumain et bulgare, qui doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les discriminations et les persécutions à l’égard des Roms ; celle de l’Union européenne, qui doit veiller à ce que les fonds européens destinés à financer des projets d’intégration de ces populations dans toute l’Europe – fonds très importants et dont nous avons aussi besoin en France – soient bien utilisés à cette fin et distribués en toute transparence ; celle, aussi, de la France, qui ne peut pas se défausser et qui doit donner un accueil digne à tous nos concitoyens européens sur notre territoire.
Il n’y a aucune particularité ethnique, raciale, génétique qui empêcherait les Roms de s’intégrer. Les auditions et les témoignages de tous les acteurs de terrain que nous avons reçus le confirment tous : dans la majorité des cas, ces populations montrent des formes extraordinaires de solidarité, de courage, de fierté, une farouche volonté de s’intégrer et de réels talents. On compte parmi elles des musiciens célèbres, des artistes et bien d’autres qui ont réussi. Savez-vous, mes chers collègues, que la jeune fille qui a reçu ici-même, au Sénat, en mars 2012, la médaille d’or des meilleurs apprentis de France est une jeune fille rom qui avait été scolarisée un peu moins de cinq ans ?
Comme dans tous les bidonvilles, comme dans toutes les favelas du monde, on trouve aussi chez eux une fraction, très minoritaire, de comportements délinquants, voire criminels, et il n’y a, bien sûr, aucune complaisance à avoir à l’égard des réseaux, mais leur existence ne peut servir de prétexte pour ne pas avancer avec la grande majorité de cette population.
Si les mesures transitoires sont levées, ce sera l’aboutissement du processus engagé par le Gouvernement.
Ce sera la possibilité pour tous les Roumains et Bulgares présents en France de rechercher un travail légal, et donc d’avoir des ressources légales. Ce sera aussi un signal fort pour tous les réseaux, notamment associatifs, qui se battent à leur côté et qui sont prêts à engager une dynamique positive d’intégration.
Ouvrir l’accès à un travail légal, et donc à un revenu légal, sera la base objective pour mettre en œuvre un plan d’intégration qui permette aussi de traiter le problème de l’hébergement et donc de faire disparaître les bidonvilles, sources de tensions sociales et terreau des mafias et des réseaux d’exploitation.
Ce sera la fin en France d’une discrimination entre les pays européens, discrimination inefficace et sans aucun sens aujourd'hui, et l’établissement des mêmes droits pour tous nos concitoyens européens sur notre territoire.
Notre pays, avec 3 millions de chômeurs et 7 millions de précaires, est confronté à de grands défis et à la nécessité d’un immense effort pour relancer l’industrie et pour faire face à une grave crise internationale. Il ne peut se permettre d’être divisé par des tensions inutiles.
Mes chers collègues, en votant cette résolution, en souhaitant la levée immédiate des mesures transitoires, le Sénat peut influer dans le bon sens sur le débat public : sa voix pèse, vous le savez.
En présentant cette proposition de résolution, je ne suis pas dans l’angélisme. Comme vous, je suis attachée à la disparition des bidonvilles, je suis contre le travail illégal, contre la mendicité agressive et contre la surexploitation des enfants, je suis pour la poursuite et la répression des trafics en tout genre, mais je constate que le système des mesures transitoires empêche l’exercice d’un droit légitime, à savoir le droit à un travail et des revenus légaux.
Ce système bloque aussi réglementairement les postes d’insertion, les postes d’apprentissage, les postes en alternance, l’accès à la formation de droit commun. Il empêche donc la création d’une base objective pour dépasser la situation et, évidemment, pour aborder les autres questions importantes, qui sont notamment celles de l’hébergement, de la santé et de la scolarisation.
Je demande pour les Roumains et pour les Bulgares, les mêmes droits que pour les autres citoyens européens sur le territoire français. Donnons-leur les mêmes droits d’accès à un revenu légal, ni plus ni moins. Nous ne demandons en effet aucun privilège spécial pour eux, mais simplement l’égalité des droits. Le meilleur moyen de lutter contre toutes les pratiques illégales est d’assurer cette égalité.
Je veux évoquer un événement récent qui nous appelle, mes chers collègues, à faire preuve de responsabilité. Les habitants d’un quartier très pauvre de Marseille s’en sont pris à un campement de Rom dont ils ont brûlé les affaires. Ces tensions entre deux groupes d’habitants, qui auraient pu dégénérer encore plus gravement, sont inquiétantes.
On le sait, des tensions du même genre existent dans d’autres villes. Les élus locaux, les parlementaires, les pouvoirs publics ont un devoir absolu face à une telle situation : ne pas jeter de l’huile sur le feu, mais au contraire mettre en place des dispositifs d’apaisement et des décisions structurelles qui permettent d’avancer vers l’intégration, le maintien de la sécurité et la cohésion sociale.
Ces récents événements nous montrent qu’il y a urgence. Voilà pourquoi nous émettons le souhait dans la proposition de résolution que le Gouvernement demande la levée, non pas début 2014, mais dès maintenant des mesures transitoires. Il en a le pouvoir et la démarche est simple, car une nouvelle loi n’est pas nécessaire.
Je soulignerai en conclusion que cette proposition de résolution répond à une préoccupation de bon nombre de nos collègues élus dans des municipalités et des communautés d’agglomération de toutes couleurs politiques. Nous sommes allés à Bordeaux, dans la région nantaise, dans le Nord-Pas-de-Calais, à Strasbourg et en Alsace, dans tous les départements d’Île-de-France… Les démarches des élus qui ont engagé leurs collectivités dans la création de lieux d’accueil, de médiation, d’insertion et qui ont essayé d’avancer en matière de logement, de santé, d’accès à la scolarité sont aujourd'hui bloquées parce que les personnes concernées ont, même lorsqu’elles sont dans le cadre d’un dispositif, d’énormes difficultés à avoir accès au travail pour les raisons que j’ai indiquées.
Il y a là un risque de fragilisation et la mise en danger de dispositifs pourtant financés par de l’argent public, avec souvent, au départ, le soutien du Gouvernement, risque à propos duquel ces élus, interpellés comme nous par cette situation sans issue, nous ont alertés.
Mes chers collègues, cette proposition de résolution appelle donc à l’apaisement sur un sujet dont l’importance a été, avant mai 2012, artificiellement gonflée, par populisme ou par électoralisme – je rappelle que sont au maximum concernées 20 000 personnes, en comptant les enfants et les personnes âgées, sur tout le territoire français.
Elle appelle à en finir avec les préjugés et les discriminations, à rétablir l’égalité des droits entre les citoyens européens présents sur notre territoire, à la mise en place d’un accueil digne des traditions de notre République.
Je terminerai en citant Vaclav Havel : « La façon dont sont traités les Tsiganes représente le vrai test, non seulement pour une démocratie mais d’abord pour une société civile. »
Réussissons ce test ensemble, au nom de l’apaisement, au nom de l’égalité des droits : mes chers collègues, j’ai confiance en vous !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Mes chers collègues, la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote.
Dans la suite du débat, la parole est à M. Pierre Hérisson.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution relative aux ressortissants de nationalités roumaine et bulgare, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, me permet de m’exprimer à cette tribune à un double titre : tout d’abord, au nom, avec mon Pierre Charon, du groupe de l’UMP ; ensuite, comme représentant pour la France depuis 2011 au CAHROM, le comité ad hoc d’experts sur les questions roms au sein du Conseil de l’Europe.
Ce comité, dont on parle malheureusement trop peu à l’échelle nationale, se réunit plusieurs fois par an à Strasbourg et a siégé plus récemment à Istanbul et en Macédoine.
Si les problématiques relatives aux populations roms doivent être abordées sous le prisme de la dignité humaine, il importe avant tout pour nous de répondre à une question précise qui touche au véritable fond du problème : quel avenir pour ces personnes sur le territoire européen dans les conditions actuelles ?
Y répondre ne peut se faire qu’à une seule condition : être à la hauteur du mandat qui est le nôtre, ce qui implique de dépassionner le débat, de l’appréhender loin de la démagogie ambiante et de préciser avec la plus grande rigueur le cadre des problématiques qu’il recouvre.
Il convient dans un premier temps de préciser les termes.
Madame Archimbaud, les populations de nationalités bulgare et roumaine dont vous faites état dans votre proposition de résolution sont communément appelées « Roms ». Dans leurs pays respectifs, elles appartiennent à une minorité ethnique d’origine et y sont constitutionnellement reconnues comme telle. Ce n’est pas le cas en France : notre République, une et indivisible, ne reconnaît pas dans sa Constitution l’existence de minorités ethniques. Dans notre pays, ces populations sont bien souvent considérées comme des gens du voyage. C’est un amalgame qu’il faut absolument éviter, d’autant que les gens du voyage sont citoyens de la République française et bénéficient d’un véritable statut. J’ai d’ailleurs récemment déposé une proposition de loi relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie.
Cette précision indispensable établie, je tiens à attirer votre attention sur un constat simple : les Roms passent quotidiennement nos frontières et s’installent là où ils le peuvent, pas toujours là où ils le souhaitent. Ils vivent dans des campements de fortune, faute d’autres solutions. Il s’agit d’un péril humanitaire et social ; sur ce point, nous sommes tous d’accord. Alors, arrêtons de céder aux sirènes de la « bien-pensance » ambiante, selon laquelle il y aurait les vilains persécuteurs de Roms, d’un côté, et les bien-pensants, de l’autre !
Ce sujet complexe, qui mérite plus qu’une seule heure de débat, exige surtout que les élus appréhendent la réalité sans parti pris. Aucun des élus des collectivités que nous sommes et que nous représentons ne peut nier que l’un des premiers problèmes tient au fait que les Roms occupent des campements illégaux. Ce n’est pas le cas des gens du voyage, pour qui les collectivités s’organisent et aménagent des aires de stationnement, respectant en cela une législation contraignante, même s’il reste encore beaucoup à faire sur ce point.
Madame Archimbaud, si elle a le mérite de permettre à la Haute Assemblée de débattre de ce sujet, votre proposition de résolution laisse accroire que les discriminations en France envers les Roms seraient d’ordre ethnique. Je ne peux souscrire à cette allégation. De même, vous n’abordez ce problème que sous le prisme de l’expulsion et de la reconduite à la frontière. Or ce problème comporte deux aspects : la circulation des Roms et l’illégalité de leurs installations, et ce alors même que ces personnes peuvent circuler librement dans l’espace européen, vous l’avez rappelé tout à l’heure.
Sur ce point, chers collègues, à vous qui avez tant critiqué la politique de la majorité précédente, je tiens à faire observer que, depuis le 6 mai dernier, les expulsions des terrains et les reconduites à la frontière n’ont pas cessé. Voilà qui démontre bien – je le dis sans esprit polémique – la difficulté à régler ce problème.
Cet été, plus de 1 500 Roms ont été évacués à travers la France, dont 550 en moins de deux mois dans l’agglomération lyonnaise, même si, il faut le souligner, 95 personnes ont été régularisées sur l’initiative du préfet de région. Le 9 août décollaient deux charters de l’aéroport Saint-Exupéry en direction de Bucarest, avec à leur bord pas moins de 240 Roms.
Dans votre proposition de résolution, madame Archimbaud, vous demandez la levée anticipée des mesures transitoires, qui limitent l’accès au marché de l’emploi de ces ressortissants roumains et bulgares ; c’est bien de cela qu’il s’agit. Avec tout le respect que je vous dois, je vous pose la question : vraiment, est-ce bien réaliste ?
La libre circulation des biens et des personnes, mais aussi des travailleurs, s’inscrit comme l’un des principes fondamentaux de l’Union européenne. Pourtant, la France, tout comme neuf autres États membres, applique des restrictions à l’égard des travailleurs de Roumanie et de Bulgarie. Cette dérogation temporaire prendra fin le 1er janvier 2014, c'est-à-dire dans moins de quinze mois.
Cette période transitoire n’est pas un caprice : elle est nécessaire. Ne pas la considérer comme une période propice à la réflexion risquerait d’aggraver la situation au lieu de la résoudre. En en demandant la levée, vous revenez sur un mécanisme européen adopté et appliqué par nos partenaires.
Sur ce point, il ne s’agit pas de Roms de Bulgarie ou de Roumanie. Il s’agit d’un mécanisme applicable à de futurs ressortissants européens qui pourront d’ailleurs s’inscrire sur les listes électorales pour les élections locales dès 2014. C’est bien là un sujet à propos duquel votre majorité est très active, de la même manière qu’elle participe à la création d’amalgames au détriment des ressortissants étrangers en situation régulière !
Mme Éliane Assassi s’exclame.

Enfin, je souhaite attirer votre attention sur une autre réalité, celle de la mendicité organisée, des vols à la tire, de la délinquance. Ce n’est pas autre chose que l’exploitation de la misère par d’autres sur notre territoire national. Aujourd'hui, appréhender la réalité rom implique de s’attaquer aux réseaux qui les exploitent, réseaux qui vont parfois jusqu’à la prostitution.
Le paradoxe pour les services de l’État français, c’est que ces populations sont à la fois victimes et acteurs de ces réseaux. Ne faudrait-il donc pas mettre à profit cette période transitoire pour trouver des réponses à une situation schizophrénique ? Vous préconisez des solutions alternatives, qui, de toute évidence, ne sont pas prêtes ou ne le sont que dans une autre dimension.
Les milieux associatifs le constatent chaque jour : contrairement aux promesses d’un certain candidat à la présidence de la République, les vagues d’expulsions n’ont pas été suivies de relogement. Les familles, quand elles n’étaient pas reconduites à la frontière, ont continué d’errer dans les rues, de dormir dans les jardins publics ou dans les friches industrielles. Pourquoi ? Parce ce que n’est pas réalisable dans un tel délai : nous n’en avons pas les moyens, quelle que soit la majorité en place dans notre pays.
C'est la raison pour laquelle cette période transitoire est obligatoire et impérative. Au regard de la complexité de la situation à laquelle nous devons faire face, nous sommes même en droit de nous demander si elle est assez longue. Nous subissons les effets d’une très grave crise économique et n’avons pas les moyens d’une politique de générosité et d’intégration massive.
Beaucoup de gens souffrent en France. S’il n’y a pas de hiérarchie dans la misère, il n’est pas scandaleux de vouloir traiter des questions sociales et économiques nationales préexistantes à l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie au sein de l’Union européenne. Je pense à la situation des gens du voyage, qui sont des citoyens français ; je vous parle de 400 000 personnes. Sur un tel sujet, je pense que vous reconnaîtrez les dix ans de travail – et de travail important ! – qui nous furent nécessaires pour mettre en application la loi Besson de 2000, pierre fondatrice de notre action en faveur de ceux qui ont décidé de vivre en itinérance dans notre pays.

Je souhaite d’ailleurs que nous puissions prochainement voter un texte pour faire évoluer cette loi.
Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je vous renvoie à cet égard aux derniers travaux du CAHROM, qui participe à l’élaboration de la position européenne sur le sujet, à savoir la budgétisation d’une véritable politique de développement et d’inclusion de ces populations dans leur pays d’origine, chaque fois que cela est possible. Développer le programme européen destiné à favoriser l’inclusion de ces populations en Roumanie et en Bulgarie doit être notre priorité absolue.
La Roumaine et la Bulgarie doivent respecter leurs engagements et assumer leurs responsabilités. Ces pays doivent mettre en place ces programmes, dans l’application desquels on note pour le moins de grandes lacunes. Lorsque je me suis entretenu à Bucarest avec l’ancien ministre de l’intérieur roumain et le secrétaire d’État chargé de la réinsertion des Roms, j’ai enfin compris la situation : si ces deux membres du gouvernement roumain sont attachés au respect des décisions européennes conditionnant leur future intégration à l’Union européenne, ils ne m’ont jamais répondu quant à l’utilisation des crédits européens dédiés à l’amélioration des conditions de leurs minorités ; cela est proprement inadmissible !
Aussi, malgré les bonnes intentions qui sous-tendent cette proposition de résolution, l’adopter serait véritablement contre-productif. Le signal envoyé aux États bulgare et roumain ne serait autre que celui-ci : « En dépit des millions d’euros que vous percevez grâce aux contribuables européens, ne faites rien pour gérer vos minorités, car la France s’occupe de tout et endosse la responsabilité à votre place. »
Adopter votre proposition de résolution reviendrait à décrédibiliser l’Europe, puisque vous reniez les mécanismes qui ont été mis en place avec nos partenaires européens et qu’il nous faut respecter.
Adopter votre proposition de résolution, c’est avoir la prétention de croire qu’une initiative nationale française peut se substituer au travail mené avec nos partenaires en faveur de ces populations. Je rappelle que l’Espagne vient de réduire les possibilités d’accès au travail. La crise est une évidence, là-bas sans doute plus que chez nous.
Adopter votre proposition de résolution, c’est désacraliser le nécessaire respect des engagements auxquels doivent se conformer les États candidats ou en phase d’intégration. C’est tout simplement décrédibiliser le processus d’adhésion et d’intégration à l’Union européenne, dans ses principes et dans le respect des engagements. Enfin, c’est laisser croire aux associations et à ces populations que nous sommes en capacité de les accueillir dignement et de nous dispenser de solutions qui ne peuvent être qu’européennes et transitoires.
Aussi, madame Archimbaud, si louables que soient vos intentions, vous comprendrez que le groupe UMP vote contre cette proposition de résolution. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la semaine dernière, l’Union européenne s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix. Ainsi, l’une des plus formidables constructions politiques de l’après-guerre était récompensée pour avoir institué en Europe un espace de paix et de sécurité définissant une citoyenneté européenne garantissant des droits fondamentaux comme la liberté de circulation et d’installation.
Force est de constater que cette construction fragile, complexe ne va pas de soi, qu’elle provoque lors de chaque phase d’intégration des moments de crainte et de doute. Ces moments sont encore plus difficiles, voire risqués, lorsque la situation économique et sociale est douloureuse, engendrant d’inévitables tensions. Il était toutefois historiquement symbolique et politiquement nécessaire de ne pas laisser de côté une partie significative de « l’autre Europe », après le grand élargissement de 2004.
Cette conviction a dominé l’ensemble des négociations d’entrée dans l’Union européenne de la Roumanie et de la Bulgarie. Néanmoins, intégrer ces États, dont le PIB atteint 25 % de la moyenne des PIB des États membres de l’Union européenne, représentait un enjeu économique et administratif important.
Lorsque l’on regarde aujourd’hui les situations politiques en Hongrie et en Roumanie d’une part, en Ukraine de l’autre, on mesure combien ce volontarisme politique était indispensable pour éviter tout retour en arrière sur le plan démocratique.
Comme en 2004, avec les vagues migratoires de Pologne et des pays baltes vers l’Irlande et le Royaume-Uni surtout, la libre circulation a vite engendré une inquiétude : les Roumains et les Bulgares n’allaient-ils pas déferler sur des marchés de l’emploi déjà très tendus et engendrer un mouvement de baisse des salaires ? C’est pour face à cette crainte que des États membres ont souhaité mettre en place des mesures transitoires de protection de leur marché du travail.
C’est encore le cas aujourd’hui pour la France, comme pour l’Allemagne et l’Espagne. Pourtant, un rapport de la Commission européenne au Conseil européen sur le fonctionnement des dispositions transitoires sur la libre circulation des travailleurs en provenance de la Bulgarie et de la Roumanie, remis le 11 novembre 2011, a évalué l’impact de ces mesures transitoires tant pour la Bulgarie et la Roumanie que pour les pays de migration. C’est à cette date la seule étude d’impact de référence sur la question.
Quelles sont les conclusions de cette étude ?
Indépendamment de leur participation au marché du travail, on estime à environ 2, 9 millions de personnes le nombre de ressortissants bulgares et roumains installés dans l’un des 25 autres États membres de l’Union européenne, cette mobilité étant antérieure à la date d’adhésion de ces pays, en 2007. L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne hébergent plus de 75 % de l’ensemble des travailleurs bulgares et roumains.
Les flux de mobilité suivent bien évidemment les périodes de croissance économique. Ainsi, l’arrivée de travailleurs bulgares et roumains s’est fortement ralentie depuis 2009. Quand l’Espagne a réintroduit des restrictions, le 22 juillet 2011, plus de 50 % des travailleurs migrants provenant de Bulgarie et de Roumanie avaient déjà quitté ce pays, car ils étaient privés d’emploi°!
Les profils professionnels des travailleurs migrants sont rarement qualifiés et les métiers qu’ils occupent restent directement liés à la conjoncture économique : construction, services domestiques, hôtellerie, restauration... Pourtant, comme le montrent en France des études réalisées par Pôle emploi, plusieurs de ces métiers font aujourd'hui l’objet de nombreuses offres d’emploi non pourvues.
Au-delà de la simple étude statistique, ce rapport tire des conclusions importantes pour l’analyse de la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd’hui : « Toutefois, il est clair que les citoyens mobiles récemment arrivés en provenance [de Bulgarie et de Roumanie] ont joué un rôle très mineur dans la crise du marché du travail des différents pays. Par exemple, en 2010, ils représentaient seulement 1 % de l’ensemble des personnes au chômage (âgées de 15 à 64 ans) dans les pays de l’UE-15, contre 4, 1 % pour les ressortissants de pays tiers récemment arrivés.
« La vaste majorité des citoyens mobiles récemment arrivés de Bulgarie et de Roumanie participent au marché du travail dans la même mesure que la population moyenne, voire de manière plus importante. Dans l’ensemble, ils ont joué un rôle positif pour les économies des pays d’accueil... »
Ce sont ces conclusions qui ont incité le Parlement européen à adopter, le 15 décembre 2011, une résolution sur la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne. Cette résolution a été votée aussi bien par le PPE et le PSE que par les Libéraux et les Verts européens. Il en avait été de même de la résolution sur les mesures d’encouragement de la mobilité des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne adoptée le 25 octobre 2011.
Il faut souhaiter, mes chers collègues, que notre attachement à la construction européenne nous conduise à faire aujourd'hui un choix similaire. Notre collègue Aline Archimbaud nous demande de voter une proposition de résolution relative aux ressortissants de nationalités roumaine et bulgare. Beaucoup ont voulu y voir un texte essentiellement destiné à favoriser l’insertion en France des migrants roms ; c’est en partie vrai.
À ce stade, plusieurs remarques doivent être faites. La proportion de migrants d’origine rom est conforme à leur part – plus ou moins 10 % – dans la population de leurs États d’origine. Grâce à la liberté de prestation de service dans l’Union européenne, il est déjà possible de travailler en France en toute légalité quand on vient de Bulgarie ou de Roumanie. Dans ce cas, les cotisations sociales des employés détachés en France ne sont pas payées en France mais dans le pays d’origine de l’entreprise. La CGT ne faisait-elle pas remarquer l’année dernière que Bouygues Construction employait sur le chantier de l’EPR à Flamanville un tiers d’ouvriers roumains par le biais d’entreprises sous-traitantes roumaines ? Notons que cette main-d’œuvre a l’avantage d’être payée neuf euros de l’heure et de n’être pas syndiquée... En outre, les cotisations sociales sont payées en Roumanie.
On retrouve le même type de montage dans certaines de nos entreprises de transport, qui emploient des chauffeurs routiers bulgares sur des cycles de quatorze jours. Donner aux ressortissants roumains et bulgares d’autres possibilités de travailler légalement en France participera au relèvement des droits sociaux des migrants européens et de leurs salaires, comme cela a été le cas pour les États ayant intégré l’Union européenne en 2004.
Il existe en France des filières d’emploi qui fonctionnent de façon clandestine : outre les 15 000 à 20 000 Roms qui vivent dans des conditions indignes, ce sont plusieurs dizaines de milliers de Bulgares et de Roumains qui occupent des emplois dans le BTP, l’hôtellerie ou la restauration. Ce sont ces travailleurs qui font la fortune des marchands de sommeil.
En demandant la suppression des mesures transitoires, les auteurs de cette proposition de résolution formulent une solution alternative au détachement de personnels, système dans lequel aucune cotisation sociale n’est payée en France. Cela ôterait toute justification à ceux qui emploient de manière illégale de la main-d’œuvre bulgare ou roumaine en France, en exploitant leur précarité et leur illégalité.
Il convient aussi de rappeler que la Roumanie et la Bulgarie ont respecté, dans leur processus d’adhésion, l’esprit des traités européens sur la liberté de circulation et d’installation, en n’imposant aucune réciprocité aux mesures transitoires demandées par la France, contrairement à ce qu’avait fait la Pologne en 2004. En effet, ce pays avait estimé que ces mesures transitoires étaient discriminatoires et contraires à l’esprit des traités et avait donc instauré par réciprocité des barrières à l’embauche pour les ressortissants des États ayant mis en œuvre de telles mesures. Ces barrières ont été levées en même temps que les mesures transitoires visant les ressortissants polonais, sans aucun effet négatif pour l’emploi. Du reste, qu’aurait dit la France si Renault avait dû affronter ce type de situation avec l’administration roumaine dans la gestion de ses expatriés travaillant sur le site de l’usine Dacia à Pitesti ?
Quel est l’objet de la proposition de résolution qui nous est présentée ? Elle s’inscrit dans la volonté de la nouvelle majorité de marquer une rupture avec la politique de stigmatisation et de refus d’intégration des migrants dont le discours de Grenoble a constitué le néfaste point d’orgue. Ce discours fut à la fois une justification et une théorisation du refus des valeurs républicaines.
Toutefois, depuis son dépôt en juin dernier, cette proposition de résolution a perdu une partie de son actualité grâce à l’action du Gouvernement. La circulaire interministérielle du 26 août 2012 marque en effet la volonté du gouvernement de Jean-Marc Ayrault d’avoir une vision intégrée des enjeux liés à l’apparition et au démantèlement de lieux de vie indignes, ainsi qu’à l’insertion des populations y habitant. Cette circulaire souligne que l’intégration se fait par le travail et l’école. Conformément à la demande formulée dans la présente proposition de résolution, cette circulaire supprime la perception de la taxe OFII pour toute délivrance de titre de séjour, ouvre l’accès des ressortissants bulgares et roumains aux services de Pôle Emploi et leur permet d’intégrer des filières de formation professionnelle.
Ce texte fondateur a été complété par trois circulaires visant à garantir la scolarisation de tous les enfants de six à seize ans, quels que soient leur niveau et leurs origines. En outre, la semaine dernière, un arrêté a élargi de façon significative la liste des emplois accessibles aux Bulgares et aux Roumains. La publication de cet arsenal de textes s’est accompagnée de la nomination d’un délégué interministériel, le préfet Alain Régnier, en charge de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, la DIHAL, dont la fonction principale est l’appui méthodologique et la coordination des différentes administrations impliquées dans la nouvelle stratégie d’inclusion des Roms. L’objectif est bien l’entrée de toutes ces populations dans le droit commun.
Des difficultés demeurent. Tout d’abord, il est urgent que nous puissions compter sur la mobilisation pleine et entière de nos administrations, préfectures et collectivités territoriales, pour coordonner l’action sur le terrain des acteurs impliqués dans l’éradication des bidonvilles et l’insertion sociale de leurs habitants. Est-il normal que la procédure administrative conduisant à la délivrance d’un titre de séjour prenne de six à huit mois, pas seulement pour les ressortissants roumains ou bulgares, d’ailleurs ? Est-il normal que des mairies refusent d’inscrire des enfants à l’école ou d’accorder la domiciliation qui permet notamment l’accès aux soins ? Toutes les préfectures appliquent-elles la circulaire du 26 août dernier ? Ont-elles seulement les moyens de le faire ?
Est-il normal que, de plus en plus, les pouvoirs publics se dérobent dans leur mission d’intégration sociale et de lutte contre la grande pauvreté, en fermant des lieux de vie indignes sans s’occuper du sort de ceux qui les occupent ? Pourtant, les difficultés d’accès au logement demeurent une réalité qui touche des franges de plus en plus importantes de notre population. Les collectivités territoriales ne sauraient assumer une part toujours plus grande de l’effort demandé à notre communauté nationale envers ses habitants les plus fragilisés.
La plupart des pays de l’Union européenne étant confrontés aux enjeux des migrations et de l’intégration des migrants, il serait légitime de renégocier partiellement la stratégie nationale d’inclusion et de lancer, dans le cadre de la programmation des fonds structurels pour la période 2014-2020, une politique nouvelle à destination des collectivités, afin de soutenir leur politique d’aide à l’intégration. Plus rapidement, les fonds structurels à destination de la Roumanie, qui sont actuellement inutilisés, ne pourraient-ils être réaffectés aux collectivités qui développent des programmes d’intégration ? Avec un peu plus de moyens, il serait plus facile de travailler ensemble à un changement de regard de la population, pour que les stéréotypes et le racisme ambiant ne deviennent pas une barrière de plus en plus visible, freinant la nécessaire insertion des personnes qui le souhaitent.
Pour conclure, je dirai que le vote de cette résolution est nécessaire, même si nombre des propositions qu’elle contient sont déjà caduques. Il faut surtout ouvrir un autre débat : celui du contrôle des modalités de mise en œuvre des différents textes rédigés par le Gouvernement depuis la fin du mois d’août 2012. Cela pourrait être le rôle d’un groupe de travail sénatorial, dont la mission serait d’évaluer non seulement la mise en œuvre de ces textes mais aussi la stratégie nationale d’insertion, que le Gouvernement s’est engagé à réviser.
Rappelons la promesse qu’avait faite le candidat François Hollande à Romeurope : « Les Roumains et Bulgares, quelle que soit leur origine, sont citoyens européens. Les mesures transitoires qui limitent encore leurs droits feront l’objet d’un examen objectif en accord avec la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 et le rapport de la Commission européenne du 11 novembre 2011. »
Grâce à la circulaire du 26 août dernier, les demandes formulées dans la proposition de résolution sont en partie satisfaites. Le reste semble à portée de main. C’est la raison pour laquelle, constatant le chemin parcouru depuis le 6 mai sur cette question, le groupe socialiste votera cette proposition de résolution. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne prétends pas être un expert sur le sujet qui nous occupe, même si, dans un mois, je déposerai devant la commission des affaires européennes un rapport concernant les populations roms au sein de l’Union européenne, après six mois de travail.
Cette proposition de résolution relative aux ressortissants roumains et bulgares, présentée par nos collègues écologistes, ouvre un débat nécessaire au moment où l’État et les collectivités locales sont confrontés à des situations parfois délicates et souvent mal gérées. Même si cette proposition de résolution ne concerne pas uniquement les populations Roms, les dispositions visées les frappent principalement.
Une vingtaine de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, de nationalité roumaine – dans la majorité des cas –, bulgare ou provenant d’un pays balkanique, mais ayant la particularité d’être Roms selon la définition retenue par les institutions européennes, résident actuellement en France. Contrairement à une idée reçue, leur nombre est resté stable depuis plusieurs années.
Le nombre de Roms résidant en France est très faible au regard de la population de notre pays, mais la dimension polico-médiatique du sujet est considérable. Cela tient au fait que cette population a été fortement discriminée en Europe depuis de nombreux siècles et que son arrivée en France est très mal supportée. Les Roms sont confondus avec les gens du voyage français, ce qui est une erreur, ou perçus comme des étrangers migrants, ce qui est une autre erreur. Ils sont donc frappés par une double peine, et constituent un « problème », avec tous les guillemets nécessaires.
Le constat est connu : il s’agit d’une immigration économique. La situation des populations roms s’est en effet terriblement dégradée dans les pays d’Europe centrale et des Balkans depuis les années 1990, avec l’abandon ou la privatisation de pans entiers de l’industrie. Alors que le plein-emploi était pratiquement assuré aux hommes et en partie aux femmes, le taux de chômage des populations roms avoisine aujourd’hui les 90 %.
La situation dramatique des Roms installés en France provient de leur absence de revenus légaux, qui entraîne une extrême précarité et des conditions de vie indignes, généralement dans des campements de fortune insalubres. À cela s’ajoute une forte hostilité à leur égard. Leur situation d’extrême pauvreté en fait également des proies faciles pour les réseaux criminels. Je tiens à réaffirmer ici que les Roms sont plus souvent victimes qu’auteurs de délits.
Les auteurs de la proposition de résolution considèrent que les Roumains et les Bulgares, déjà stigmatisés en France et en Europe bien qu’ils soient des citoyens européens, sont victimes d’une discrimination supplémentaire de la part de l’État français du fait des dispositions qui freinent considérablement leur accès à un emploi légal. En effet, la France applique aux ressortissants de Bulgarie et de Roumanie le statut transitoire négocié avec ces deux pays lors de leur adhésion à l’Union européenne. La conséquence de ce statut fait que les Roumains et les Bulgares peuvent, comme tous les citoyens européens, se déplacer librement dans l’Union européenne, et donc venir en France, mais n’ont pas pleinement le droit d’y travailler. Citoyens européens de seconde zone, ils ne peuvent être embauchés que dans un nombre restreint de métiers mentionnés dans une liste, à condition que l’employeur paie une taxe supplémentaire et après un long délai – neuf mois, trop souvent – d’instruction de leur dossier administratif.
Reconnaissons que, si ces fameuses mesures transitoires s’appliquent en principe à tous les travailleurs roumains et bulgares, elles touchent plus fortement les populations déjà fragilisées que, par exemple, les médecins roumains, qui sont accueillis plus chaleureusement sur notre sol, ou les entreprises roumaines sous-traitantes, qui sont très prisées du patronat français.
Ce statut dérogatoire au droit commun européen est assez choquant, car il conduit mécaniquement à des situations inextricables. Cet été, l’évacuation et le démantèlement par les forces de police de campements de familles roms occupant illégalement des terrains ont légitimement choqué une grande partie de l’opinion publique et suscité la réprobation des associations qui œuvrent auprès de ces familles, associations que je tiens d'ailleurs à saluer. Il est vrai que la différence entre la méthode de l’actuel gouvernement et celle du précédent a pu ne pas apparaître très clairement.
L’évacuation de ces campements est toujours une réponse brutale à des situations humaines et sociales complexes. Il a souvent été reproché au Gouvernement de décider du démantèlement des camps avant d’avoir recherché des solutions préalables, et même parfois, comme à Évry, de procéder à l’évacuation avant qu’une décision de justice ait été rendue.
La réunion interministérielle du 22 août, qui a abouti à la définition d’une nouvelle politique à l’égard des populations roms, a malheureusement été perçue comme une tentative de faire oublier la vague de démantèlements de camps qui l’avait précédée. La décision du Gouvernement d’assouplir les conditions d’embauche, en élargissant la liste des métiers ouverts aux Roumains et aux Bulgares et en supprimant la taxe due par les employeurs, est un bon signe, mais elle risque de n’avoir que peu d’effet car les dispositifs qu’elle nécessite ne pourront vraisemblablement pas être mis en place avant la levée des mesures transitoires, prévue dans quinze mois. Cet élargissement de la liste de métiers ouverts a toutefois le mérite d’attirer l’attention sur près de trois cents métiers dans lesquels certains emplois, dont notre société a besoin, ne trouvent pas preneur.
J’estime donc que la demande, formulée dans cette proposition de résolution, d’une levée immédiate de l’intégralité des mesures transitoires limitant l’accès à l’emploi des ressortissants roumains et bulgares, est pleinement justifiée. Les mesures transitoires n’ont servi à rien. Aucune véritable étude d’impact n’a été réalisée pendant ces cinq ans et demi. Il est prévu que ces mesures soient levées dans quinze mois, mais cela n’apporterait rien d’attendre, bien au contraire.
La levée des mesures transitoires serait un élément important, qu’il conviendrait de compléter par d’autres actions afin de résoudre l’ensemble des difficultés rencontrées par les populations concernées. C’est l’intégration de ceux qui sont venus en France, et non leur exclusion ou leur expulsion, qui permettra de trouver une solution durable à ces difficultés. L’accès au travail devra donc être complété par des mesures d’accompagnement, en matière de formation – c’est une des demandes formulées dans la proposition de résolution – mais aussi de logement, d’accès aux soins et d’éducation des enfants. Cet ensemble de dispositifs devrait être piloté par l’État, lequel s’en remet trop souvent aux collectivités locales, qui sont ainsi réduites à gérer une situation d’accueil à laquelle elles ne sont pas préparées, alors même que leurs budgets sont déjà mis à mal par le contexte économique.
J’ajouterai que cette question ne doit pas faire l’objet dans notre pays d’un traitement que je qualifierai d’« ethnique ». Il s’agit simplement d’appliquer le droit commun et de venir en aide à des citoyens européens, des migrants économiques, qui sont victimes de conditions économiques et sociales déplorables.
Enfin, ce problème ne peut être du seul ressort de chaque État membre de l’Union européenne. Les situations visées existent dans de nombreux pays et requièrent un traitement d’ensemble plus cohérent.
Ce n’est qu’après la vague d’expulsions de Roms survenue en France pendant l’été 2010 et qui avait mis notre pays à l’index que l’Union européenne a décidé de coordonner des stratégies nationales. Aujourd’hui, elle se doit de rendre plus efficace son intervention auprès de l’ensemble des États concernés, qu’ils soient qualifiés d’« accueil » ou d’« origine ». Il faudrait notamment qu’elle rende plus opérationnelle l’utilisation des fonds structurels destinés à la lutte contre la pauvreté, à l’insertion par l’emploi, à la scolarisation et qu’elle impulse mieux la lutte contre l’anti-tsiganisme, véritable fonds de commerce des organisations politiques d’extrême droite, dans l’Europe tout entière comme en France.
Je conclus : si elle était adoptée, la proposition de résolution de nos collègues du groupe écologiste permettrait d’engager une dynamique positive contre les discriminations. C’est pourquoi les membres du groupe communiste, républicain et citoyen voteront en sa faveur. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour bien comprendre le sujet que nous examinons aujourd’hui, il est utile de rappeler le processus qui a conduit à l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union européenne le 1er janvier 2007.
Cette adhésion s’inscrit dans le prolongement du grand élargissement européen de 2004, qui a entériné celle de pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est.
L’ensemble de ce processus, qui s’est déroulé au cours des années 2000, participe d’une logique d’élargissement, lequel, à mon sens, n’a pas été suffisamment précédé de l’approfondissement nécessaire des relations entre les États fondateurs de l’Union européenne. Dans une certaine mesure, l’élargissement s’est donc fait au détriment de l’approfondissement, fragilisant ainsi la construction européenne. Cet élément important doit être pris en considération dans le débat qui nous réunit ce jour.
En effet, si nous examinons la question des citoyens roumains et bulgares aujourd’hui, c’est justement parce qu’ils sont devenus des ressortissants communautaires en 2007. Et je m’interroge encore sur la pertinence et l’urgence de l’adhésion de pays qui traitaient une partie de leur population de façon notoirement discriminatoire…
Le problème auquel nous devons faire face était donc largement prévisible. D’ailleurs, malheureusement, certains d’entre nous l’avaient anticipé.
S’ajoutant aux problèmes économiques, ces difficultés d’intégration de la communauté rom, en Roumanie notamment, ont favorisé le départ des Roms de leur pays d’origine vers la plupart des autres pays communautaires, dont la France. Bien sûr, ces départs ont été facilités par l’entrée dans un espace de libre circulation où les exigences de visa ont disparu.
Quelle est la situation aujourd’hui ?
La Roumanie et la Bulgarie sont membres de l’Union européenne et, conformément à la faculté offerte par leur acte d’adhésion, la France a décidé d’instaurer une période transitoire de sept ans en matière de libre circulation des travailleurs salariés à compter du 1er janvier 2007. Ce régime dérogatoire prévoit que, à l’issue d’un délai de trois mois passé sur le sol français, Roumains et Bulgares doivent avoir un emploi, suivre des études ou justifier de ressources suffisantes et bénéficier d’une assurance maladie pour pouvoir rester en France. Jusqu’à cet été, l’emploi qu’ils pouvaient occuper devait figurer dans une liste de cent cinquante métiers connaissant des difficultés de recrutement.
À ce sujet, les auteurs de la proposition de résolution suggèrent d’une part, « que le Gouvernement français mette fin aux mesures transitoires restreignant l'accès à l'emploi » et, d’autre part, « que les ressortissants roumains et bulgares de moins de vingt-six ans aient accès à la formation dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires ».
Sur ces deux points, nous serions prêts à vous suivre, madame Archimbaud, dans la mesure où il ne s’agirait que de réduire d’un an la durée de ces mesures transitoires. En revanche, il en va différemment pour ce qui concerne les autres préconisations de la proposition de résolution.
En effet, vous nous proposez de nous prononcer sur des thématiques complètement différentes au sein d’un texte non amendable.
Quel lien existe-t-il entre, d’une part, les conditions d’accès à l’emploi et, d’autre part, les conditions d’expulsion de camps occupés de façon illicite ? Notons d’ailleurs la subtilité sémantique des auteurs de la proposition de résolution qui parlent de « lieux de vie irréguliers »...
En fait, vous auriez rencontré un plus grand succès, me semble-t-il, si vous vous étiez limitée à des problématiques cohérentes entre elles, comme le sont effectivement celles qui concernent l’accès au travail et à la formation.
En voulant en faire trop, vous perdez cette cohérence et vous en arrivez à associer des problématiques qui, certes, concernent les mêmes personnes, mais n’ont aucun rapport entre elles sur le fond.
Votre dernier souhait relatif aux expulsions de camps occupés de façon illégale – c’est bien ainsi qu’il faut les appeler – sous-entend que « l’ensemble des dispositifs existants relatifs à l’accompagnement social individualisé, au droit au logement et à l’hébergement » ne sont pas mobilisés aujourd’hui.
J’en suis navré, je ne partage pas cette interprétation et je démens toute allégation en ce sens. En tant que maire de Massy, à plusieurs reprises, j’ai connu moi-même de telles situations et je démens que tous les moyens humains et matériels ne soient pas régulièrement mis en œuvre aujourd’hui, notamment par les travailleurs sociaux qui font un travail remarquable.

La présente proposition de résolution marquée au coin du bon sentiment, à vouloir élargir fortement les droits des Roms omet, dans un mal bien français, de rappeler certains devoirs, particulièrement le devoir des Roms eux-mêmes de ne pas investir de manière illicite des terrains communaux ou autres.
À ce sujet, je salue la fermeté du ministre de l’intérieur qui rappelle que tout n’est pas possible dans notre pays et que la loi s’impose à tous. À juste titre donc et à l’instar de son prédécesseur, Manuel Valls a procédé à l’expulsion de plusieurs camps illicites. Il est à noter un traitement médiatique de la question bien différent… Que n’a-t-on entendu voilà quelque temps, et quel silence aujourd’hui !
Sans doute Manuel Valls a-t-il acquis cette fermeté de l’expérience qu’il a engrangée en tant que maire d’Évry. Pour nourrir un débat qui sera bientôt le nôtre, mes chers collègues, j’en profite pour dire à ceux qui souhaitent absolument imposer le non-cumul d’un mandat de parlementaire et d’un mandat exécutif local que seule la réalité du terrain éprouvée, telle que je la connais et comme Manuel Valls l’a connue, peut nous permettre de prendre en compte dans nos raisonnements et décisions le sens des responsabilités et les motifs d’ordre public qui s’imposent à l’ensemble des exécutifs locaux, qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre.

Mais le sens du devoir doit aussi être rappelé aux pays d’origine des populations roms, pays auxquels l’Union européenne a versé des sommes considérables pour aider à l’intégration de ces communautés. Pour quels résultats ?
Je garde en tête les paroles prononcées en 2010 par Pierre Lellouche, alors secrétaire d’État aux affaires européennes : « Ce serait une bien curieuse interprétation de la lettre des traités [...] que de considérer que certains pays puissent offrir comme seule perspective à leurs citoyens roms celle d’émigrer vers les pays européens les plus riches, auxquels reviendrait ipso facto la charge de les intégrer. […]Nous comptons sur la Roumanie et la Bulgarie pour qu’elles prennent leurs responsabilités à l’égard de leurs propres citoyens, car, avant la liberté de circuler d’un pays à l’autre de l’Union européenne, il y a le devoir pour chaque État membre d’assurer la protection et l’intégration de ses propres ressortissants ».
Les discussions entamées en son temps par Pierre Lellouche avec la Roumanie et la Bulgarie doivent donc être poursuivies si nous voulons avancer sur cette question.
Pour toutes ces raisons, tant pour son manque de cohérence que pour l’accent qu’elle met sur les droits – ses auteurs les souhaitent toujours plus nombreux – sans jamais insister sur les devoirs à respecter, les membres du groupe UCR ne voteront pas en faveur de la proposition de résolution. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je connais l’implication personnelle de notre collègue Mme Archimbaud dans ce dossier, ainsi que la générosité personnelle et le souci de l’humain qui sont à la base de sa démarche. Non seulement les membres de mon groupe savent cela, mais encore ils le comprennent et le respectent.
Nous ne nous sommes jamais inscrits dans le fil du discours de Grenoble et l’avons combattu fermement. Mais de grâce, aujourd'hui, gardons-nous de toute simplification hâtive et d’anathème ! Heureusement, tous les Roms ne vivent pas dans des bidonvilles, et des milliers d’entre eux s’insèrent normalement dans la société française.
C’est pour deux raisons fondamentales que les membres du RDSE s’abstiendront sur la présente proposition de résolution.
La première, c’est qu’une grande partie des orientations de ce texte, déposé sur le bureau du Sénat le 13 juin dernier, sont satisfaites par la circulaire du Gouvernement en date du 26 aout 2012 et par l’arrêté du 1er octobre publié – est-ce un hasard ? – hier soir.
La seconde raison découle logiquement de la première : la politique mise en œuvre ces derniers mois par le Gouvernement, auquel nous apportons toute notre confiance, et en particulier par le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, nous semble conforme à ce que nous souhaitons, deux objectifs étant visés parallèlement : application de la loi de la République et des décisions de justice ; traitement égal et digne de toute personne en situation de détresse sociale.
Dans ces conditions, quel est aujourd’hui le véritable but de cette proposition de résolution ? Elle ne tend certes pas, à notre avis, à faciliter l’action du Gouvernement dans un dossier dont on connaît la difficulté, l’utilisation médiatique déplorable au profit le plus souvent, hélas, de l’extrême droite.

Comporte-t-elle des propositions concrètes en matière de constructions de logements sociaux, de classes adaptées pour la lutte contre l’illettrisme ?
Mes chers collègues, ce qui s’est passé à Marseille le 28 septembre devrait faire réfléchir ceux qui considèrent l’angélisme comme la solution et une politique d’immigration sans aucun filtre comme le meilleur chemin vers un monde en paix. La destruction d’un camp installé illicitement sur un terrain par des voisins est un fait grave, intolérable, qui doit être dénoncé, sanctionné.
Mais, hélas, cela se reproduira s’il n’est pas mis fin à ces occupations illicites de terrains, dans des conditions inacceptables pour les riverains et, la plupart du temps, pour les occupants eux-mêmes, marginalisés, au contact d’une délinquance contagieuse constituant la seule école de vie pour les enfants, sans parler des conditions de santé déplorables, de l’absence d’école, de formation, d’intégration dans la République quasi impossible…
Pour autant, l’argent circule dans ces zones de non-droit. Au demeurant, je ne ferai aucune comparaison, qui ne déplairait pas à notre collègue Pierre Hérisson, avec certains regroupements de gens du voyage qu’il connaît, où les véhicules de haut de gamme vont de pair avec l’absence de revenus fiscaux. Ce cas de figure est tout à fait différent.
On peut traiter de ce genre de problèmes avec beaucoup de certitudes, d’humanisme ; on peut en discourir dans les restaurants parisiens où se retrouvent politiques et journalistes donneurs de leçons. Mais quand il faut les gérer sur le terrain, c’est une autre affaire, c’est la nôtre, à nous élus locaux, responsables des collectivités locales !
Il n’est pas raisonnable d’augmenter le nombre d’arrivées de Roms sur les territoires nationaux ni de continuer à tolérer les occupations illégales de terrains. Résoudre les problèmes humains, oui ! Faciliter l’accès à l’emploi : oui ! Mais justement, pour ce qui est de ce dernier point, l’arrêté publié hier vise une liste fort complète de 291 métiers, soit tous les métiers qui peuvent faire l’objet de demandes de la part de ce groupe de population.
Les Roms viennent de Roumanie et de Bulgarie, deux pays membres de l'Union européenne depuis 2007 et dont la responsabilité est importante dans la situation actuelle. Cette responsabilité est d’autant plus forte que l'Union européenne a mis à disposition des crédits importants pour l’intégration des Roms dans leur propre pays et que la Roumanie n’a pas hésité à émettre une réserve interprétative sur la Déclaration de Strasbourg du Conseil de l’Europe du 20 octobre 2010 concernant la participation active des Roms à leur insertion sociale. La Roumanie a d’ailleurs osé déclarer que la responsabilité d’intégrer les Roms incombait aux pays d’accueil après trois mois de séjour. Comme c’est facile de se défausser sur les autres alors qu’on est à l’origine d’un problème !
Rappelons que, si Roumains et Bulgares ne sont pas encore membres de l’espace Schengen, c’est en raison de leur retard en matière de lutte contre la corruption et le crime organisé ainsi que de régulations de flux migratoires.
L’action menée par le Gouvernement depuis cet été, la circulaire du 26 août et l’arrêté du 1er octobre sont des mesures de bon sens alliant le respect de la loi et celui de la personne humaine.
La circulaire met au préalable l’accent sur la mise en œuvre de solutions d’accompagnement le plus en amont possible des décisions de justice, avec des diagnostics anticipés et individualisés dans les domaines de la scolarisation, de la santé, de l’emploi et de l’hébergement, mais aussi, dans le délai séparant l’installation et l’évacuation, avec une évaluation en coopération entre tous les acteurs.
Cette circulaire prévoit la garantie de la continuité de l’accès aux droits des personnes, en assurant l’application du principe d’obligation scolaire, un accès aux soins et la mobilisation de façon individualisée des solutions d’hébergement d’urgence, en favorisant les parcours d’insertion avec pédagogie, enfin, en supprimant la taxe due à l’OFII ; cette dernière mesure vient d’être mise en œuvre.
Le Gouvernement s’est en outre engagé à allonger la liste des métiers accessibles – cela vient d’être fait – et à étudier la levée des mesures transitoires de restriction d’accès à l’emploi.
Dans ce dossier, nous considérons, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le Gouvernement a fait du bon travail. Le ministre de l’intérieur a montré très clairement que la fermeté dans l’application de la loi de la République allait de pair avec le respect des personnes et des droits fondamentaux.
La résolution de nos collègues écologistes, notamment ses derniers paragraphes, qui bloquerait de fait toute possibilité d’expulsion d’installations illégales, procède, au-delà des soucis humanitaires, d’une vision de la République qui n’est pas exactement la nôtre. C’est pourquoi la majorité des membres de notre groupe s’abstiendra.
Applaudissements sur les travées du RDSE. – M. Vincent Delahaye applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pourquoi les Roms nous font-ils si peur ? Cette peur a une histoire. Permettez-moi de vous en rappeler l’essentiel en quelques phrases.
Au XVIIe siècle, le destin de la « nation bohémienne » bascule. La montée de l’intolérance s’accompagne de la promulgation de règlements et de l’instauration de sanctions d’une sévérité qui se généralise. Privés de l’accueil des châteaux, où les Égyptiennes et leurs spectacles de danse suscitaient un véritable engouement, exclus des compagnies de gens d’armes, chassés des villes, assimilés à des « errants et vagabonds » et pourchassés à ce titre dans toute l’Europe, interdits de contact, dans l’impossibilité d’exercer une activité itinérante, mais légale, les Tsiganes voient leur situation se dégrader.
Au XVIIIe siècle, l’opinion administrative englobe désormais les Bohémiens dans la catégorie des « vagabonds, mendiants et gens sans aveu ». Il y a un siècle presque exactement, le 4 mars 1907, un long article du Matin consacré aux « Bohémiens et Romanichels » énumérait encore sans honte les maux nombreux impliqués par le nomadisme des Tsiganes, ce « péril errant ». Pillards, propagateurs d’épidémies, meurtriers, empoisonneurs, insaisissables, hors-la-loi, ainsi sont-ils présentés. Redoutés comme des espions en période de guerre, comme des voleurs le reste du temps : voleurs de poules, ou d’enfants… Quant aux femmes tsiganes, on leur reproche leur lubricité éhontée. Vous n’aurez pas oublié, mes chers collègues, la Carmen de Bizet, inspirée de Mérimée.
Au cours de l’histoire, les États européens se sont efforcés de réprimer la mobilité tsigane perçue comme une déviance sociale, d’imposer la sédentarisation aux familles itinérantes, sans pour autant, au fond, les tolérer davantage. Ce qui fait peur, c’est leur nomadisme.
Aujourd’hui, les Roms venus des Balkans réveillent en nous ces peurs ancestrales. Sinon, comment comprendre que, devenus citoyens européens en janvier 2007, et devant donc jouir en théorie des mêmes droits que les autres citoyens européens, dont la liberté de circulation et d’installation sur le territoire de l’Union, ils soient acculés à envahir nos bouches de métros ou à survivre misérablement dans des campements qui déshonorent notre pays ?
Les Roms ne sont traités en France ni comme les autres citoyens communautaires ni comme des migrants non communautaires, ce qui les place en marge des dispositifs nationaux de politiques sociales. Or, tous les témoignages de terrain concordent, ainsi que l’atteste le rapport de l’ancienne HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, les Roms roumains et bulgares souhaitent résider chez nous de manière stable et scolariser leurs enfants. Lorsqu’ils sont régularisés, ils accèdent au logement et à l’emploi et sortent de l’extrême pauvreté.
Si, sous l’actuel gouvernement, leurs conditions d’accès au marché du travail ont effectivement été assouplies, nous sommes toujours très loin du compte.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, croyez-vous que les Roms émigrent chez nous parce qu’ils sont heureux chez eux ? Les peuples heureux n’émigrent pas.

J’ai vécu un moment – c’était voilà quelques années – en Europe centrale, et je n’oublierai jamais ces grappes humaines errant de nuit comme de jour, au bord des routes, en haillons. Je ne nierai pas que nous ayons chez nous à faire face à quelques abus avec les Roms, je ne nierai pas la réalité des désagréments causés aux riverains par des campements improvisés. Reste une vérité amère : ces Roms préfèrent la misère chez nous à la persécution chez eux.
Notre tradition humaniste nous oblige à mettre fin à toute politique d’expulsions de groupes ciblés, à toute exclusion spécifique de ces populations de nos dispositifs éducatifs, sanitaires ou sociaux. Elle nous impose, au contraire, l’élaboration d’une politique veillant à leur assurer, ici, un égal accès aux droits, en même temps que d’une politique en amont, là-bas, dans les pays d’origine, pour améliorer leur condition.
L’Europe est notre maison. Comme historienne, comme juive et comme citoyenne de ce pays, je croyais que la construction de l’Union effacerait à jamais de notre vocabulaire les mots de « camps » et de « pogroms ». Hélas, ces termes reviennent avec les Roms ! Ces derniers s’entassent dans des campements de fortune. Des riverains osent organiser contre eux des sortes de battues.
Des milliers de visiteurs se précipiteront à l’exposition la plus courue de ces derniers jours, Bohèmes, de Léonard de Vinci à Picasso, au Grand Palais, parce que la bohème et les Bohémiens font partie du fantasme de liberté sans attache des artistes, mais aussi du quidam. Toutefois, on n’hésitera pas à pourchasser sans pitié une pauvre famille de Roms parce que sa pauvreté, sa saleté, sa condition sont une insulte à notre confort mental. Quel décalage, n’est-ce pas !
Quelque 200 000 Tsiganes d’Europe ont été assassinés dans les camps de la mort. À nous d’accomplir notre juste travail de mémoire en tant qu’Européens dignes et de montrer notre courage et notre empathie. Avançons la levée des mesures transitoires ! Ouvrons sans faillir l’indispensable chantier de l’intégration ! Monsieur le ministre, mes chers collègues, répondez sans tarder à l’appel d’un devoir qui est celui du pays des droits humains, le nôtre, ancien et généreux creuset d’immigration.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaiterais commencer mon propos par des regrets : bien que chacune des interventions soit des plus intéressantes, la proposition de résolution que nous examinons cet après-midi ne nous laisse que très peu de marge pour traiter le fond du sujet.
Madame Archimbaud, dans votre texte vous pointez les nombreuses difficultés que rencontrent certains ressortissants bulgares et roumains lorsqu’ils viennent en France, que ce soit pour trouver du travail, pour se loger et même pour se soigner. De même, vous constatez la précarité dans laquelle ils vivent. Cette misère est insupportable pour chacun d’entre nous. Les questions de dignité humaine ne sont l’apanage d’aucun parti politique.
Ma chère collègue, vous mentionnez plus spécifiquement la précarité d’une communauté, celle des Roms. À la lecture du texte que vous nous proposez, en tant que parlementaire et républicain, permettez-moi de m’interroger.
Lorsque vous abordez les difficultés d’accès au marché du travail français, vous parlez de « ressortissants roumains et bulgares ». Mais ces difficultés tiennent au fait que, en tant que futurs citoyens européens, ceux-ci doivent respecter les conditions relatives aux mesures transitoires, inhérentes au processus d’adhésion des pays en phase d’intégration à l’Union européenne.
Ensuite, quand vous abordez les dispositifs de nos missions locales d’insertion, les services des collectivités pour le relogement de ces personnes, vous vous référez à une origine ethnique et les désignez en tant que « Roms ».
Bien entendu, vous nous direz que c’est tout à fait différent dans la mesure où, vous, vous prônez la fin de la stigmatisation, qui ne serait propre qu’à la droite, et que vous, vous exigez de l’État français et des pouvoirs publics qu’ils mettent tout en œuvre pour permettre à ces gens de s’intégrer et de vivre décemment sur notre sol national.
Nous ne pouvons qu’approuver vos propos, à la seule condition que nous abordions ce sujet sans hypocrisie et sans malhonnêteté intellectuelle.
En France, avec le mot « Rom » on parle de ressortissants de pays d’Europe de l’Est. Le Conseil de l’Europe, lui, regroupe dans une même définition « les Roms, les Cyntés, les Gens du voyage et les groupes de populations en Europe ».
Il y a quelques minutes, notre collègue Pierre Hérisson a souligné les dangers que présentent les amalgames et la confusion, notamment, avec les gens du voyage en France.
Pour ma part, en tant que républicain, je ne peux que vous renvoyer à l’article 1er de notre Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
C’est à croire que, en France, nous sommes schizophrènes.

En effet, nous voulons accueillir et intégrer tous ceux qui souhaitent venir s’installer en France, peu importe le coût pour nos finances déjà exsangues et pour nos concitoyens. Nous parlons d’égalité et nous nous battons tellement contre les discriminations que nous devenons des égalitaristes forcenés, mais nous avons cette manie de vouloir sans cesse préciser l’origine des gens.
Aussi, c’est en tant qu’élu de Paris que je poursuis mon propos, en élu respectueux du droit communautaire et de ses directives, en particulier celle du 29 avril 2004. Celle-ci dispose que, pour les séjours de moins de trois mois, le droit de libre circulation et de séjour est ouvert aux ressortissants des États membres sans autre condition que la possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, mais sous la réserve du respect du droit public.
Ce droit de libre circulation et de séjour n’est cependant maintenu que s’il ne constitue pas « une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil ».
Dès lors, quand ces conditions ne sont pas respectées, non, il n’est pas scandaleux de vouloir faire appliquer le droit !
En tant qu’élu d’une ville parmi les plus prestigieuses au monde, visitée chaque jour par des milliers de touristes, pour son histoire, son patrimoine et sa culture, je suis atterré de voir ce que Paris est en train de devenir. Il s'agit maintenant pour les touristes d’un véritable parcours du combattant
Exclamations sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.

… entre des groupes de pickpockets organisés et des matelas servant de couches à des familles auxquelles nous ne pouvons pas offrir d’avenir.

On ne peut se poser comme défenseur des droits de l’Homme et tolérer ces conditions de vie.
Pour autant, je vous mets au défi d’expliquer à des familles qui travaillent et qui paient des impôts, dont la hausse est exponentielle à Paris, que vous allez attribuer des logements sociaux prioritairement aux ressortissants en situation irrégulière.
Mêmes mouvements.

De même, alors que les services de Pôle emploi sont débordés et qu’ils ne parviennent pas à recevoir les demandeurs d’emploi déjà inscrits, …

… vous irez leur expliquer que vous souhaitez augmenter les flux des migrations européennes de travail.

Parce que c’est cela, aussi, la levée des mesures transitoires ! Même l’Espagne, pourtant exemplaire quant à l’intégration des populations d’Europe de l’Est, qui avait suspendu ces mesures, les a réintroduites le 22 juillet 2011.

Je m’insurge parce que l’on demeure impuissant face aux actes de délinquance, qu’ils soient commis par des ressortissants bulgares ou roumains.
Je suis effaré de la fin de l’arrêté anti-mendicité qui avait été mis en place le 14 septembre 2011. C’est la victoire du sectarisme sur le droit à la sécurité ! §

En tant que citoyen et élu parisien, je m’insurge de voir que l’on se déchaîne contre les retours aux frontières de personnes qui bafouent la déclaration des droits de l’enfant de 1959, en les contraignant à la mendicité dans la rue ou dans le métro parisien.

Çà et là, je constate qu’il est plus facile pour certains de crier à la discrimination lors d’expulsions plutôt que de voir la tragique réalité, qui n’est autre qu’une double instrumentalisation, …

… celle de la misère et celle d’enfants à qui l’on vole leur innocence. À ce titre, je vous renvoie aux travaux de mes collègues Joëlle Garriaud-Maylam et Isabelle Debré, qui ont rendu des rapports sur les mineurs roumains.
Ma chère collègue, je déplore votre manque de réalisme et de pragmatisme. Le propre du politique est de prévenir, d’anticiper et de sauvegarder un bien précieux : la cohésion nationale.

L’impuissance et le laxisme des autorités publiques quant aux campements illégaux représentent une menace pour la paix sociale.
L’errance de ces ressortissants insupporte nos concitoyens, parce qu’ils ne comprennent pas ce qui s’apparente à un mode de vie et n’acceptent pas de voir se développer en bas de chez eux des bidonvilles.
Cet immobilisme retranché derrière le misérabilisme est la source des pires exactions. Il nourrit les extrêmes et, surtout, conduit nos concitoyens à agir en dehors du droit. C’est la société tout entière qui est en danger.

La France ne veut plus de ce genre de discours ! Elle vous l’a signifié, puisque vous avez été battus aux dernières élections !

Ce geste n’a pas été condamné à l’unanimité par la classe politique, ce qui est ulcérant et antirépublicain, comme l’a rappelé Jacques Mézard.
Par ailleurs, que des habitants commettent un geste aussi extrême qu’intolérable pour pallier l’inertie des pouvoirs publics doit nous alerter, car force est de constater que nous sommes en présence d’une fracture républicaine, dont nous sommes tous responsables : le peuple a tenté de résoudre par lui-même un problème que nous nous refusons de voir.
Si nous continuons de détourner les yeux de la réalité, préférant le confort hypocrite et les déclarations de bonnes intentions, à l’image de votre proposition de résolution, nous détruirons ce qu’il reste de confiance en la République chez nos concitoyens.
Enfin et surtout, il importe que la France et ses partenaires européens engagent un dialogue ferme et responsable avec les gouvernements de la Bulgarie et de la Roumanie. Ces deux États bénéficient de fonds européens pour la réintégration des Roms. Nous ne pouvons endosser la responsabilité de cette mission à leur place.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’Europe, c’est l’union d’États qui partagent les mêmes valeurs, mais c’est aussi l’union d'États responsables, capables d’offrir un avenir à leurs peuples. Offrons à la Bulgarie et à la Roumanie cette occasion formidable et ne nous substituons pas à leurs devoirs nationaux ! §
Monsieur le président, madame Archimbaud, mesdames, messieurs les sénateurs, j’observe que le débat a été intéressant, posé, calme, évitant les extrêmes jusqu’à ces derniers instants…
Croyez bien que je le regrette, car, d’une certaine façon, on perçoit quelles réponses communes, consensuelles, au moins républicaines, étaient susceptibles de sortir de cette discussion. En effet, en dépit des prises de position ou des conclusions peu rationnelles de certains, le fait que le représentant du groupe UCR reconnaisse que ce qu’avait fait le Gouvernement en matière de travail et de formation professionnelle pouvait faire l’objet d’un consensus, prouve l’utilité de la démarche. Force est de constater que l’on peut – c’est peut-être la bonne nouvelle de l’après-midi ! – dépasser les affrontements habituels sur cette question, même si certains ont une autre lecture et essaient de recréer des frontières n’ayant pas lieu d’être.
Le Sénat étudie aujourd’hui la proposition de résolution relative aux ressortissants de nationalités roumaine et bulgare. Je tiens tout d’abord à vous prier d’excuser l’absence de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui est en déplacement à Marseille aujourd’hui.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution l’article 34-1, lequel autorise les assemblées à voter des résolutions. Cette procédure constitue une des voies d’affirmation du Parlement, lui permettant d’avoir une expression distincte de la réponse législative. À mon sens, cette possibilité est positive.
Le texte proposé par le groupe écologiste fait référence à la situation des Bulgares et des Roumains. Pour l’essentiel, ainsi que le débat l’a montré, il s’agit plus précisément de celle des Roms.
Quand l’Europe a souhaité s’acquitter de sa dette historique à l’égard des pays de l’Est et renouer les fils de son histoire défaits par la Seconde Guerre mondiale, puis la Guerre froide, elle l’a fait en posant des conditions, tant les écarts entre nos pays et les derniers entrants dans l’Union européenne, notamment la Roumanie et la Bulgarie, étaient importants.
En matière de travail et d’emploi, une restriction à la libre circulation des travailleurs roumains et bulgares a été décidée de manière transitoire. Les travailleurs de ces deux pays voulant exercer une activité salariée en France sont ainsi soumis à une autorisation de travail délivrée par les services de la main-d’œuvre étrangère, SMDE, dans les conditions de droit commun. L’obtention de cette autorisation est conditionnée, notamment, par la situation de l’emploi qui leur est opposable. Toutefois, à l’origine, une liste de 150 métiers, pour lesquels la situation de l’emploi n’était pas opposable, a été établie.
Aujourd’hui, nous portons cette liste à 291 métiers, par souci de justice et d’efficacité. L’arrêté vient d’être publié au Journal officiel du 14 octobre.
Pour éclairer le débat, à la fois sur cet arrêté et les commentaires qui l’ont accompagné, je rappelle que la seule réaction négative à sa publication a été le fait de Marine Le Pen, qui l’a considéré comme parfaitement scandaleux. Que chacun puisse se situer par rapport à cette réaction !
La liste élargie comprend désormais tous les métiers situés au-dessus d’un taux de tension de 0, 6, ce qui représente 72 % des offres d’emploi de Pôle emploi, contre 46 % auparavant. Le critère retenu est un critère objectif, correspondant à des secteurs en tension sur le marché de l’emploi. À nos yeux, il place le curseur au bon endroit, entre un chômage de masse, que l’on ne peut prendre la responsabilité d’alimenter, et des tensions sectorielles.
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a souhaité consulter les partenaires sociaux, dans le cadre du comité du dialogue social sur les questions européennes et internationales, au sujet de cette liste élargie. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les DIRECCTE, ont également été sollicitées pour que cet élargissement de la liste des métiers soit en prise avec la réalité du terrain.
En parallèle, dans un souci de justice, nous n’avons pas voulu ajouter l’entrave à la restriction : la taxe due par l’employeur lors de la délivrance du titre de séjour et de son renouvellement est d’ores et déjà supprimée.
Cette ouverture concerne 33 000 Roumains, dont 26 000 en âge de travailler, et 9 000 Bulgares, dont 7 000 en âge de travailler. Parmi les autres pays de l’Union, dix avaient choisi de n’appliquer aucune mesure de restriction dès 2007 et 5 ont levé leurs restrictions en 2009, rejoints par l’Italie cette année. Le dernier groupe de pays, auquel appartient la France, s’est engagé dans la voie de l’assouplissement des contraintes. La Belgique, notamment, a choisi d’accélérer la délivrance du permis de travail.
Par travailleurs roumains ou bulgares, il ne faudrait pas entendre uniquement les Roms, lesquels constituent une question spécifique sur laquelle je vais revenir. Gardons-nous de représentations trop simplistes ! L’image du migrant affamé et dépenaillé ne correspond pas toujours à la réalité de ce que sont aujourd’hui la majorité des migrations, qui vont du cadre supérieur à l’ouvrier désœuvré, de l’ingénieur qualifié au travailleur spécialisé.
L’un d’entre vous a rappelé, tout à l’heure, de manière pertinente, que nombre d’élus locaux ici présents se battent les fins de semaine dans leurs territoires ruraux pour faire venir des médecins roumains, alors qu’ils se battent les autres jours, dans cette enceinte, pour leur interdire de venir en France. Je résume un peu, mais c’est une réalité partagée. §
Dans deux rapports publiés le vendredi 5 octobre 2012 par l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, il est démontré que, globalement, 28 % des migrants sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur contre 24 % pour les « nationaux ». Les migrations sont donc un accélérateur de compétences. Il faut, certes, savoir les réguler, mais aussi avoir pleinement conscience de leurs apports. De plus, pour reprendre une formule qui a eu son succès en France, « la France qui se lève tôt » est aussi largement composée de travailleurs immigrés occupant des emplois peu prisés par les Français.
J’en viens à la question spécifique des Roms, incluse dans la question plus globale des travailleurs roumains et bulgares, car je sais que la représentation nationale attend du Gouvernement une réponse à cette question.
Nous appartenons à une gauche qui marche sur ses deux jambes, qui n’ignore rien des problèmes de sécurité. À ce titre, l’évacuation des campements roms illicites se poursuivra, car la République suppose des règles, à commencer par le respect des décisions de justice. Il y a derrière ce sujet un vrai enjeu de cohésion sociale. La République doit agir et préserver l’ordre public, ou reprendre pied quand elle s’est éclipsée.
Mais nous sommes aussi la gauche du travail, celle qui pense qu’il est le meilleur moyen de s’intégrer dans notre société, d’en partager les valeurs et les aspirations. C’est pourquoi nous en élargissons l’accès, sans pour autant peser sur le chômage.
Nous portons avec nous la République qui ne dévie pas et qui n’est pas hémiplégique, croyant au travail, à l’égalité et à l’insertion, mais qui sait aussi ce que sont l’autorité, l’ordre et la liberté. Si nous sommes les successeurs de Clemenceau, nous sommes aussi ceux de Jaurès et de la République sociale. Ces deux gauches ne vont pas l’une sans l’autre.
Le rapport à la loi, règle de caractère général, est un principe fondateur de la République, qui se veut également protecteur. À cet égard, je voudrais rappeler ici un événement survenu lorsque nous étions dans l’opposition, qui illustre l’application de ce principe dans l’autre sens. Cet épisode, au sujet de la situation des enfants roumains en France, n’a pas été commenté, mais il aurait dû être au cœur de nos débats, à tout le moins rappelé.
Je veux parler de l’accord intervenu entre les gouvernements français et roumain en vue de régler la question des mineurs roumains isolés et les conditions dans lesquelles nous devions les renvoyer dans leur pays d’origine. C’est un cas assez rare d’un accord ratifié, sous l’ancienne majorité, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, qui a tout simplement été annulé par le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 4 novembre 2010.
Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que la majorité et le Gouvernement en place à l’époque, au nom de l’efficacité, avaient décidé que ces mineurs n’avaient pas droit à la protection de la loi, l’accord ayant prévu que le juge des enfants serait dessaisi de sa compétence habituelle au profit du procureur de la République, qui, sans en référer à personne, pouvait les renvoyer dans leur pays. Tel était l’accord signé par le gouvernement français et ratifié par la majorité de droite de l’époque. Le Conseil constitutionnel a jugé que, s’il était juste de rappeler aux Roms, ou à d’autres, qu’ils devaient respecter la loi, ceux-ci devaient aussi pouvoir bénéficier de sa protection.
C’est le cadre dans lequel s’inscrit, aujourd’hui, le Gouvernement et qui est, tout simplement, le cadre républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE.
En matière d’hébergement et de logement pour les Roms, l’ensemble des outils existants est à mobiliser, depuis les dispositifs d’urgence, notamment pour les personnes les plus vulnérables, jusqu’à, éventuellement, la mise en place de structures d’accueil provisoires, en liaison avec les collectivités territoriales.
En ce qui concerne les dispositifs sociaux et sanitaires d’accompagnement et de droit commun, ainsi que les questions de scolarisation, une mission interministérielle a été confiée à plusieurs inspections pour procéder à l’état des lieux des dispositifs existants et au recensement des expérimentations en cours et des bonnes pratiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je salue la qualité du débat et la manière dont vous avez su ici, au Sénat, parler de ce sujet difficile, sur lequel chacun a pu exprimer ses arguments. Je remercie donc le groupe écologiste d’avoir pris l’initiative de cette proposition de résolution.
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement a tenu à vous donner une réponse républicaine, suivant en cela le fil rouge de son action. Sur le fond, il s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
Applaudissements

Personne ne demande plus la parole ?…
Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu les articles 1er à 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,
Constatant que les ressortissants roumains et bulgares, et les Roms en particulier, sont victimes de stigmatisation, de discriminations et d’entraves à l’intégration et contestant que la précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles résulte de l’existence d’une culture rom réticente au travail et à l’intégration ;
Sur l’emploi :
Considérant que l’accès à l’emploi est le facteur essentiel d’une sortie de la grande précaritéainsi que la condition d’une intégration dans la société française, et rappelant que la grande majorité des Roms vivant en France sont de nationalité roumaine ou bulgare, qu’ils sont de ce fait soumis aux mesures transitoires des traités d’adhésion à l’Union européenne restreignant leur accès au marché de l’emploi ;
Constatant que l’employeur d’un ressortissant bulgare ou roumain doit, jusqu’à la levée des mesures transitoires, s’acquitter d’une taxe auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dont le montant varie en fonction de la durée du contrat et du salaire, que de ce fait celle-ci peut avoir un effet dissuasif pour certains employeurs, que les ressortissants bulgares et roumains, à la différence des ressortissants des autres pays membres de l’Union européenne, doivent être en possession d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail pour exercer un emploi salarié en France et que le délai d’obtention de ces documents peut être de plusieurs mois dans certaines préfectures, et considérant que l’ensemble de ces procédures constituent autant de freins à l’emploi pour ces populations ;
Rappelant enfin que plusieurs États européens ont procédé à la levée de ces mesures sans connaître de dégradations de leur marché du travail ;
Sur l’accès à la formation :
Rappelant que l’accès aux stages de formation professionnelle est régi par les mêmes règles que celles relatives à l’inscription sur la liste de demandeurs d’emploi, et qu’un ressortissant bulgare ou roumain est soumis aux mêmes restrictions qu’un ressortissant d’un pays non membre de l’Union européenne du fait de l’existence des mesures transitoires, la grande majorité des ressortissants roumains et bulgares ne pouvant en conséquence accéder aux services de pôle emploi que s’ils ont travaillé au minimum un an en France ;
Rappelant qu’il en est de même pour les outils à la réinsertion professionnelle comme le contrat d’apprentissage ou le contrat d’insertion ;
Soulignant que de nombreuses missions locales hésitent à accueillir les jeunes Roms de moins de vingt-six ans de nationalité bulgare ou roumaine, du fait du peu d’outils dont elles disposent pour les accompagner, ces derniers n’ayant accès ni à la formation professionnelle, ni à l’alternance, ni aux contrats aidés ;
Sur les dispositifs d’insertion :
Constatant que les dispositifs d’accompagnement mis en place par les associations les collectivités territoriales, et cofinancés par les pouvoirs publics, ne peuvent atteindre pleinement leurs objectifs que s’ils permettent de conduire à l’obtention d’un emploi ;
Sur la santé publique
Considérant en outre que les expulsions de terrains occupés illégalement permettent difficilement de mener à leur terme les campagnes de traitement et de vaccination soutenues ou cofinancées par les pouvoirs publics alors même que l’on constate la présence au sein de ces populations de maladies infectieuses graves ;
Souhaite que le Gouvernement français mette fin aux mesures transitoires restreignant l’accès à l’emploi pour les ressortissants bulgares et roumains ;
Et donc :
- que les employeurs de ressortissants bulgares et roumains soient exemptés, comme les ressortissants des autres pays de l’Union européenne, de la taxe versée à l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- que les ressortissants roumains et bulgares de moins de vingt-six ans aient accès à la formation dans les mêmes conditions que les ressortissants communautaires et que tous les ressortissants roumains et bulgares aient accès à la formation lorsqu’ils sont en possession d’une promesse d’embauche ;
Estime, en outre, que les dispositifs d’insertion soutenus ou cofinancés par les pouvoirs publics, doivent comporter des mesures d’accompagnement en vue de l’obtention d’un emploi ;
Souhaite que, en cas d’expulsion des lieux de vie irréguliers, l’ensemble des dispositifs existants relatifs à l’accompagnement social individualisé, au droit au logement et à l’hébergement soient mobilisés, en particulier pour les familles avec enfants, en sorte d’éviter la simple délocalisation des problèmes résultant d’une absence de travail à des solutions alternatives.

Mes chers collègues, je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explications de vote.
Je mets aux voix la proposition de résolution.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 4 :
Nombre de votants344Nombre de suffrages exprimés330Majorité absolue des suffrages exprimés166Pour l’adoption157Contre 173Le Sénat n’a pas adopté.
Applaudissements sur certaines travées de l’UMP.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures trente.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à la création de la Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement (proposition n° 747, rapports n° 24 et 32).
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec beaucoup de plaisir que, après la discussion de la proposition de résolution d’Aline Archimbaud, je vous présente la première proposition de loi du groupe écologiste.
Ce texte est le fruit de plusieurs années de travail, en lien avec les acteurs associatifs, que je tiens à saluer pour la qualité de leurs propositions : fondation Sciences citoyennes, réseau Environnement Santé, Écologie sans frontière…
Je tiens également à remercier mes collègues rapporteurs de ce texte, Ronan Dantec et Aline Archimbaud, pour la qualité du travail qu’ils ont effectué en lien avec les services des commissions.
Présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, je n’oublie pas un sujet qui me tient à cœur, l’expertise et son indépendance, ainsi que la lutte contre les conflits d’intérêts. Mon but est aussi de donner un débouché aux nombreux rapports du Sénat sur ce thème.
Chaque scandale sanitaire et environnemental fait resurgir la question de l’indépendance de l’expertise scientifique et montre l’existence d’alertes non entendues. Les mécanismes sont si semblables qu’on retrouve les mêmes mots pour dire les dysfonctionnements. Ainsi peut-on lire, s’agissant de l’amiante, sous la plume des rapporteurs Dériot et Godefroy, que « l’État a été anesthésié par le lobby de l’amiante » ou encore, au sujet du Médiator, sous la plume d’Aquilino Morelle, que « les laboratoires Servier avaient anesthésié les acteurs publics ».
Eh bien, ces acteurs publics, le Parlement va les réveiller !
L’étude des scandales sanitaires montre qu’ils relèvent de la même typologie. Ils ne sont pas dus à des concours de circonstance ; ils sont la conséquence d’un système, système qu’il est urgent de réformer afin d’éviter de nouveaux drames.
En matière de santé, l’exemple du bisphénol A, dont l’interdiction a enfin été votée, est saisissant.
Après le polycarbonate et ses usages alimentaires, inaugurés en 1953, les résines polyépoxy sont utilisées comme revêtement à l’intérieur des boîtes de conserve dès 1970. Les bienfaits annoncés de cette innovation justifient, pour certains, l’urgence de son autorisation. Il s’ensuit une mauvaise évaluation des risques.
Dès le début des années 1990, les premières alertes sont lancées – cancérogénicité, perturbation endocrinienne – et les premières sanctions sont prises… contre les lanceurs de ces alertes. Ainsi, l’industrie chimique entreprend, en 1997, une campagne de calomnie contre le professeur Frederick Vom Saal, qui dénonçait la dangerosité du bisphénol A.
Face à ces expertises scientifiques faisant état d’un danger pour la santé, les industriels ont gagné du temps en finançant et en publiant un petit nombre d’études dont le seul message était que les chercheurs n’avaient rien trouvé !
Il aura fallu attendre près de dix ans pour que le législateur finisse par se saisir du problème. Pour commencer, un texte sur les biberons fut proposé en 2010 par le sénateur Yvon Collin et ses collègues du groupe RDSE. Vint ensuite, en 2011, le rapport Barbier, Perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution. Enfin, ce fut, tout récemment, en octobre 2012, grâce au combat de Gérard Bapt, l’interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires.
Ainsi, près de vingt ans se seront écoulés entre les premières alertes et le retrait de la substance. Vingt ans durant lesquels les manquements dans l’évaluation des risques sanitaires et l’absence de protection des scientifiques alertant sur les dangers pour la santé ont laissé l’industrie chimique jouer avec la santé de nos concitoyens, malgré 700 études concordantes sur la dangerosité du bisphénol A.
Avoir identifié et dénoncé des éthers de glycol dangereux au sein de l’institut national de la recherche scientifique, l’INRS, vaudra au professeur André Cicolella un licenciement en 1994. Il sera définitivement rétabli dans ses droits en 2000, grâce à un arrêt de la Cour de cassation.
Pour avoir alerté sur des approvisionnements d’intestins de porcs venant de Chine aux fins de fabriquer un anticoagulant, Jacques Poirier, immunobiologiste, fut licencié en 2003 par Sanofi.
Pour avoir alerté sur les dangers du sel dans l’alimentation, Pierre Méneton, chercheur de l’institut national de la santé et de la recherche scientifique, l’INSERM, a été traîné en justice. Sans avoir été aidé par l’organisme qui l’employait, il a néanmoins été acquitté.
Dernier exemple : la courageuse Denise Schneider, habitante de Bourg-Fidèle, qui a alerté sur la contamination de son village par le plomb de l’usine Métal Blanc. Le dossier ne sortit que grâce à France 3. Les victimes endurèrent ainsi dix ans de souffrances avant qu’un arrêt favorable soit rendu en cassation et que le versement de dommages et intérêts soit ordonné.
Nous ne devons pas nous résigner à ce que les défenseurs de la santé publique ou de la protection de l’environnement, quand il y a apparition d’un risque, ne trouvent d’écoute, au début, qu’auprès des medias et, à la fin de l’histoire, en justice !
Ce qui touche à l’environnement est tout aussi saisissant ; j’évoquerai ici le cas du Régent et du Gaucho.
Quand, dès 1994, les firmes enrobent les semences de pesticides systémiques afin, disent-elles, de réduire les quantités de produits utilisés, l’évaluation de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA, conclut de manière très étonnante à l’absence de changement sur le comportement des abeilles et à l’absence d’augmentation du taux de mortalité des abeilles.
Les premières alertes ne tardèrent pas. Ce furent, tout d’abord, celles provenant des apiculteurs, dont Maurice Coudouin. Ce fut, ensuite, le chercheur Jean-Marc Bonmatin qui démontra la nocivité du pesticide, puis vit ses crédits de recherche réduits…
Marc-Edouard Colin, chercheur de l’institut national de la recherche agronomique, l’INRA, montrera les effets sur la mortalité des abeilles en présence de taux plus de 1 500 fois inférieurs à ceux qui étaient annoncés par les laboratoires Bayer. On lui ordonnera d’abandonner ses travaux.
En 1999, le ministère de l’agriculture interdit l’utilisation du Gaucho sur le tournesol.
En 2003, le groupe d’experts mis en place par le ministère de l’agriculture conclut dans son rapport que « l’enrobage de semences de tournesol Gaucho conduit à un risque significatif pour les abeilles de différents âges ». Mais la direction générale de l’alimentation niera tout effet possible sur la santé humaine et contestera le rapport !
Le toxicologue Jean-François Narbonne rendra un rapport d’expertise sur le Régent dans lequel seront démontrés les effets neurotoxiques, hépatotoxiques et néphrotoxiques du fipronil. Il évoquera même un effet possible sur le développement cérébral du fœtus.
Le Régent sera à son tour interdit en 2004.
En 2005, un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques commentera tous ces dysfonctionnements en écrivant : « L’atmosphère particulièrement lourde dans laquelle ces affaires se sont développées mérite d’être relevée, notamment les comportements de l’administration en cause […]. Une proportion importante des chercheurs travaillant sur ces problèmes ont rencontré des difficultés ou ont été l’objet de pressions. »
Enfin, que dire du manque criant d’outil public quand on voit la situation créée par l’étude dite « secrète » de Gilles-Éric Séralini sur la toxicité du maïs modifié NK 603 et de l’herbicide Roundup ? Cent vingt-huit ONG signent un appel commun au Gouvernement, tandis que le consommateur découvre, médusé, que l’EFSA, c'est-à-dire l’autorité européenne de sécurité des aliments, émet des doutes, elle dont la présidente, Diana Banati, a dû démissionner en raison de sa proximité avec BASF, Syngenta et... Monsanto.
Tout le monde est conscient de ces dérives, et je crois que le rôle du législateur est désormais de renforcer le droit de la santé publique et le droit de l’environnement afin de limiter ou d’éviter des dommages en cours de réalisation.
Le Sénat, que ce soit par le biais de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ou dans le cadre de diverses missions d’information et de commissions d’enquête, a utilisé sa fonction de contrôle et rendu des rapports qui, bien souvent, dressent les mêmes constats, relèvent les mêmes failles, déplorent les mêmes dégâts et élaborent les mêmes propositions.
On constate que, dans telle ou telle agence, des arbitrages d’expertise publique sont influencés par un ou plusieurs membres ayant des liens d’intérêts avec une firme à l’origine du produit ou du médicament incriminé.
On constate par ailleurs que des citoyens, des ouvriers, des chercheurs ou des praticiens ont tiré la sonnette d’alarme bien avant que les pouvoirs publics n’agissent et que, parfois, ces « lanceurs d’alerte » se sont trouvés intimidés, calomniés, placardisés, voire licenciés.
Au final, pour quelques dysfonctionnements, il y a des malades, des décès, une perte de confiance entre société et science et des milliards d’euros de coûts de réparation.
En 2005, le rapport de l’Office parlementaire intitulé Risques chimiques au quotidien : quelle expertise pour notre santé ? et adopté à l’unanimité préconisait d’élaborer un projet de loi sur l’alerte et l’expertise afin de garantir l’écoute et la protection des lanceurs d’alerte le plus en amont possible, l’indépendance et la transparence des expertises, la qualité des relations entre le système de sécurité sanitaire et environnementale et les usagers.
En 2011, le rapport de Marie-Thérèse Hermange consacré au Mediator, fait au nom de la mission commune d’information présidée par François Autain, proposait la mise en place d’une procédure protégeant les lanceurs d’alerte « qui [les] garantisse contre les pressions éventuelles exercées par l’industrie, sans pour autant permettre que le lancement d’alerte soit instrumentalisé pour nuire à une entreprise ».
En outre, ce rapport proposait de « confier le contrôle de l’expertise de santé publique à l’Autorité de la déontologie de la vie publique », pour reprendre les termes du rapport Sauvé. La formule « Autorité de la déontologie » est intéressante, mais le champ d’une telle instance dépasse la santé et l’environnement.
Pendant la discussion du volet « gouvernance » du Grenelle 1, un vote unanime, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, encouragé par l’avis « très favorable » du Gouvernement, a permis d’inscrire dans la loi les phrases suivantes : « La création d’une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie, la déontologie des expertises sera mise à l’étude. Elle pourra constituer une “instance d’appel” en cas d’expertises contradictoires et pourra être garante de l’instruction des situations d’alerte. » Voilà donc ce qui fut voté. Mais il n’y eut pas de suite !
À la clôture de la Conférence environnementale dont vous avez pris l’initiative, madame la ministre, le Premier ministre s’est engagé à transformer ces vœux en actes, déclarant notamment : « L’indépendance des experts sera plus sûrement garantie. »
Eh bien, avec ce texte, nous proposons de mettre en application l’ensemble de ces préconisations sur les lanceurs d’alerte et en matière d’expertise !
Aujourd’hui, il est urgent de restaurer la confiance entre la société et les experts. Les conflits d’intérêts ne sont repérés que par les déclarations des chercheurs. Ainsi, pendant la pandémie grippale de 2009, les doutes croissants des citoyens se sont nourris des négligences médiatisées de nombreuses instances – dont le Haut Conseil de la santé publique – sur la vérification des liens d’intérêts, malgré les règles qui s’imposent à elles.
Le drame de l’amiante, avec ses milliers de morts, de malades en souffrance et de contaminés en sursis, repose sur une dangerosité vite identifiée par les acteurs de terrain : inspecteur du travail en 1906, ouvriers de Condé-sur-Noireau dès 1955, ouvrières d’Amisol dès 1970, enseignants de Jussieu dès 1974. Mais, là aussi, la présence de chercheurs non indépendants au sein du Comité permanent amiante, mélangeant autorités publiques et industriels soucieux de protéger leurs intérêts, a différé les bonnes décisions.
Je sais le contexte exceptionnel de crise. Je sais la parcimonie avec laquelle doit être engagé l’argent public. Mais c’est précisément pour économiser non seulement des vies, mais aussi les milliards que nous coûtent les drames sanitaires que je vous propose de créer cette autorité indépendante.
Ah, bien sûr, si, demain, le Gouvernement nous propose une solution témoignant d’une égale exigence, invente une cellule de déontologie scientifique auprès du Défenseur des droits ou remanie très profondément la Haute Autorité de santé, l’étendant au champ environnemental, et rendant la commission de transparence à l’Agence du médicament, pourquoi pas ?
Envisager un dispositif à faible coût regroupant diverses personnes détachées partiellement est aussi imaginable. Mais il ne faut rien céder sur l’indépendance !
L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit la création d’une Haute Autorité, ou du moins d’une entité crédible et indépendante. C’est le plus souvent à la suite d’une impasse de l’évaluation institutionnelle qu’une personne devient lanceur d’alerte : il faut donc prévoir qu’une instance puisse donner suite à cette alerte. Parce qu’elle ne mènera pas elle-même d’expertise et parce qu’elle ne sera pas spécialiste du sujet, une telle instance disposera du recul nécessaire pour s’attacher aux méthodes plutôt qu’aux positions déjà structurées.
Les membres de cette autorité seront compétents en matière de déontologie, de méthodologie et quant aux principes directeurs de l’expertise. Elle pourra s’autosaisir d’office, mais les saisines les plus fréquentes viendront de l’extérieur : associations, syndicats, personnes impliquées dans une alerte…
Cette future instance sera composée de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation, de parlementaires membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, ainsi que des responsables des missions d’expertise collective des grands organismes de recherche, qui contribuent à améliorer la technique des expertises collectives et la mise au point des principes directeurs.
La présence des représentants des agences est également importante : il convient en effet d’intégrer des personnes ayant travaillé sur la déontologie de l’expertise plutôt que des personnes qui sont en charge de dossiers spécifiques.
De surcroît, la présence des représentants d’associations ouvrira la procédure à la société civile, tout comme celle des syndicats assurera la représentation des premiers concernés.
Par ailleurs, le texte prévoit l’exercice d’un droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale.
Avant tout, précisons que le lanceur d’alerte n’est pas un professionnel identifié dans son entreprise ou dans son laboratoire, qui serait spécifiquement investi de cette mission ; c’est une personne – chercheur ou salarié – qui, au hasard de sa vie professionnelle, est soudain confrontée à un risque qu’elle identifie comme sérieux et dont elle ne parvient pas à faire valoir la prise en compte.
Le statut de lanceur d’alerte protège à la fois le message – pour que les institutions l’entendent – et celui qui l’a émis – pour que ce dernier ne soit pas inquiété. Loin d’ouvrir la boîte de Pandore des vocations d’alerteur, ce texte définit un protocole raisonné, sanctionne les communications malveillantes ou non fondées et éloigne l’alerte des aléas médiatiques. À l’émotion, nous préférons la raison.
Ce texte distingue les personnes salariées, qui encourent des mesures discriminatoires de la part de leur employeur, notamment un licenciement, comme dans le cas d’André Cicolella, et les personnes non salariées qui, elles, s’exposent à des actions en justice sur le terrain de la diffamation ; je songe notamment à Véronique Lapides, attaquée après avoir mis au jour un nombre élevé de cancers parmi les enfants fréquentant une école maternelle de Vincennes, construite pour partie sur le site d’une ancienne usine chimique.
Je ne dis pas que se valent le niveau de connaissances de nos chercheurs et le niveau moyen des savoirs et savoir-faire de la population en matière d’expertise. Mais j’affirme que les salariés qui lancent une alerte après avoir repéré une anomalie, une pathologie induite ou une toxicité ne peuvent qu’enrichir les hypothèses du chercheur par leur connaissance du terrain et, surtout, la permanence de leurs observations.
Du reste, les salariés sont demandeurs de ce droit. J’apprécie les propositions formulées en ce sens par les syndicats, qui conjuguent la légitimité du comité d’hygiène et de sécurité et la mission d’écoute et de transmission de l’alerte.
Avant de conclure, je répondrai, à cette tribune, à certaines questions persistant au sujet du présent texte.
Voulons-nous créer une agence de plus ? Non ! Cette Haute Autorité n’exercera aucune mission de recherche ou d’expertise. Elle ne se substituera pas aux laboratoires ou aux agences. Par sa veille, elle garantira le bon fonctionnement, l’indépendance et l’efficacité de l’expertise. À cet égard, elle pourrait être comparée à la CNIL, qui n’a pas pour mission de produire des fichiers, mais qui veille à ce que les fichiers existants ne contreviennent pas aux libertés individuelles.
N’aurions-nous pas confiance en nos chercheurs ? Je l’affirme solennellement, la quasi-totalité de ces derniers allie la compétence à l’éthique. Néanmoins, tous les rapports parlementaires relatifs aux scandales sanitaires l’attestent, certains arbitrages ont été modifiés par la présence de certains chercheurs liés par des intérêts financiers aux produits qu’ils expertisaient.
Sommes-nous inspirés par un manque de confiance dans nos agences ? Celles-ci représentent un réel progrès dans la mesure où elles ont permis de séparer l’évaluation du risque et la gestion du risque. Au surplus, elles ne cessent de s’améliorer, notamment en constituant en leur sein des comités d’éthique. Néanmoins, il est toujours préférable de ne pas être juge et partie. Cette proposition de loi fournira donc au Gouvernement l’occasion d’engager une réforme et une refonte de toutes nos agences, que je crois trop nombreuses : dans le seul domaine des produits chimiques, j’en ai moi-même recensé cinquante !
Enfin, cette Haute Autorité ne va-t-elle pas susciter de nouvelles dépenses ? Au contraire, elle engendrera surtout des économies ! Certes, il faudra dépenser un peu pour la faire fonctionner, mais on me permettra de rappeler ce qu’auront coûté aux comptes publics les drames qu’une telle instance aurait permis d’éviter : 2 milliards d’euros au titre des compensations versées par le FIVA, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ; 1, 8 milliard d’euros pour le désamiantage de Jussieu ; pour le désamiantage de nos lycées… la facture n’est pas connue ; 1, 2 milliard d’euros pour les victimes du Mediator, en plus des 800 millions de francs versés par la sécurité sociale pour les remboursements de ce médicament.
Je pourrais également évoquer la réparation des dégâts cardiaques causés par le Mediator, ou encore le coût à venir de l’ablation des prothèses PIP et de la chirurgie réparatrice qui sera ensuite nécessaire, le coût du traitement des victimes des hormones de croissance ou des irradiés d’Épinal, sans même parler des soins induits, demain, par des produits encore autorisés.
Allons-nous, chaque année, créer de la douleur, présenter un rapport au Parlement et dépenser, en réparation, des milliers de fois plus qu’en prévention ?
Madame la ministre, mes chers collègues, les sénatrices et les sénateurs du groupe écologiste ont choisi de présenter cette proposition de loi en raison de l’urgence à agir.
Il peut être amélioré, et je ne veux pas croire que la conclusion du travail en commission, qui a été difficile, trahit une volonté de faire échouer cette initiative pour des raisons purement politiques.

Nous agissons non seulement avec conviction, mais aussi dans le respect du travail parlementaire accumulé depuis des années sur ce sujet. Nous sommes des lanceurs d’alertes législatives, soucieux de garantir aux citoyens une sécurité sanitaire et environnementale hors de tout soupçon.
Je ne doute pas que vous saurez nous entendre. Si nous réussissons, nous dédierons cette avancée législative à Irène Frachon. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de Mme Blandin, déposée par le groupe écologiste dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, marque un moment important pour la Haute Assemblée. En effet, au terme d’un travail collectif, fondé sur un diagnostic partagé des lacunes actuelles de nos systèmes d’expertise et d’alerte, il s’agit de parvenir, en lien avec le Gouvernement, à une loi claire, efficace et à la hauteur des enjeux.
L’ambition du rapporteur de la commission du développement durable, saisie au fond sur le présent texte, est donc de contribuer à établir cette vision partagée.
En matière d’alerte, les enjeux actuels sont reflétés par les chiffres de l’INSEE. Depuis une demi-douzaine d’années, en France, l’espérance de vie en bonne santé diminue : alors qu’elle s’élevait à 64, 3 ans pour les femmes en 2005, dernière année au terme de laquelle cet indicateur a progressé, elle n’est plus aujourd’hui que de 63, 2 ans. Ainsi, nous sommes revenus dix ans en arrière, à l’espérance de vie en bonne santé telle qu’elle était à la fin des années quatre-vingt-dix.
Les causes de ce recul sont globalement connues, même s’il est évidemment difficile de les hiérarchiser, entre facteurs environnementaux – pollution de l’air, perturbateurs endocriniens, produits cancérigènes – et facteurs liés au mode de vie – sédentarité, mauvaise alimentation, tabagisme, ou encore, ne l’oublions pas, montée de l’exclusion sociale.
Ce n’est donc pas par peur irrationnelle de dangers imaginaires que la population française s’alarme et demande aux élus qui la représentent d’ériger l’enjeu de la santé et de l’environnement en nouvelle priorité de l’action publique nationale, mais bien par conscience lucide des problèmes qui pèsent sur son avenir.
De plus, cette diminution de l’espérance de vie en bonne santé constitue un paramètre essentiel de l’équilibre des comptes de la Nation. Car, ne l’oublions pas non plus, perdre un an de vie en bonne santé à l’échelle d’une population qui, grâce aux progrès de la médecine, vit de plus en plus longtemps, c’est perdre parallèlement des dizaines de milliards d’euros de dépenses de santé, …

… soit un gaspillage insensé au regard des économies que dégageraient des politiques de prévention plus résolues, à la définition desquelles la présente proposition de loi a vocation à contribuer.
Si une seule affaire devait illustrer nos dysfonctionnements en matière d’alerte et de prise de conscience, je citerais le traitement accordé à la prise de position publique de Pierre Meneton, chargé de recherche au sein du département santé publique de l’INSERM : après avoir alerté ses concitoyens sur la surconsommation de sel en France, tout en dénonçant le lobbying des producteurs de sel et du secteur agroalimentaire, il fit l’objet d’une plainte en diffamation déposée par les Salines de France, avant de gagner son procès.
L’ensemble des tracasseries – c’est un euphémisme ! – dont Pierre Meneton a été victime après le lancement de cette alerte donne l’image d’un pays où il ne fait pas si bon alerter sur les dangers ignorés ou cachés. Pourtant, en France, une centaine de décès peuvent être attribués chaque jour à l’excès de consommation de sel. C’est donc un enjeu majeur de santé publique, qui appelle expertise, débat contradictoire et décision finale du pouvoir politique.
Bref, notre chaîne d’alerte et d’expertise est notoirement insuffisante. Le présent texte ambitionne d’engager une forte modernisation de nos procédures pour garantir plus d’efficacité et de transparence.
Je vais rappeler à présent les principaux points du rapport, en détaillant les améliorations proposées à la suite des auditions et des débats de notre commission.
Tout d’abord, la proposition de loi prévoit la création d’une Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement.
Cette idée n’est pas nouvelle : de fait, à plusieurs reprises, le Sénat a examiné l’opportunité de créer une haute autorité chargée de garantir l’expertise et l’alerte. Dès 2005, une proposition de loi de Claude Saunier visait à la création d’une Haute Autorité de l’expertise publique, ayant pour mission d’harmoniser les procédures d’expertise dans le but de revaloriser cette dernière.
Cette réflexion a également été engagée lors de l’examen de la loi Grenelle 1, dont l’article 52 – soutenu avec force dans cet hémicycle par le ministre d’alors, Jean-Louis Borloo – prévoyait un rapport sur l’opportunité de créer une instance garantissant la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises, ainsi que l’instruction des situations d’alerte. Ce document n’a jamais été fourni par le gouvernement de l’époque.
L’idée est donc assez répandue selon laquelle il est nécessaire, premièrement, de se doter d’une instance indépendante pour s’assurer que les alertes ne se perdent pas et, deuxièmement, de mener les expertises dans les règles de l’art. Elle aurait même pu être considérée comme consensuelle : tel est notamment le sentiment qu’a exprimé, lors de la Conférence environnementale qui s’est tenue il y a quelques semaines, notre collègue Chantal Jouanno que je me permets de citer : « Je suis très déçue que la Haute Autorité sur l’expertise, pourtant consensuelle, n’ait pas été évoquée. » Voilà une omission qui est corrigée ! §

Au demeurant, les auditions que j’ai pu mener en vue de la rédaction de ce rapport n’ont pas effacé ce sentiment. Les agences de sécurité sanitaire elles-mêmes ne sont pas hostiles à ce principe : elles sont conscientes de l’intérêt d’un avis indépendant et respecté, extérieur à elles et garantissant, en définitive, la qualité de leur travail.
La discussion de cette proposition loi, qui ne se conclura que dans les prochaines semaines puisque nous ne pourrons pas la prolonger aujourd’hui, devrait nous donner l’occasion d’améliorer cette articulation entre les lanceurs d’alertes, les agences et la Haute Autorité de l’expertise, afin d’accroître l’efficacité et la lisibilité des dispositifs. En tant que rapporteur, j’ai d’ailleurs déposé en commission de nombreux amendements allant dans ce sens. J’ai notamment proposé, à l’article 1er, une modification rédactionnelle destinée à gommer une légère ambiguïté du texte initial, concernant la capacité de la Haute Autorité à mener elle-même des travaux d’expertise.
Comme vient de le rappeler clairement Marie-Christine Blandin – et ce point ne doit pas faire débat entre nous – cette Haute Autorité ne doit être ni une assemblée de super-experts ni une nouvelle agence chargée de mener ses propres travaux d’expertise : sa mission est de définir des règles déontologiques et d’émettre des avis quant au respect de ces règles ; ce n’est pas la même chose !
Si la commission du développement durable a adopté la totalité des amendements qu’elle a eu à examiner, le vote négatif de l’opposition sur l’ensemble de la proposition de loi n’a pas permis d’intégrer ces modifications, ce que je regrette profondément pour la lisibilité du débat. J’espère néanmoins que nous ne nous égarerons pas dans de faux débats.
Je ne crois pas trahir les échanges que nous avons eus en commission – je parle sous le contrôle de son président – en signalant que ce rejet s’est notamment appuyé sur l’argument : « une structure supplémentaire, donc des dépenses supplémentaires et des processus administratifs supplémentaires ». La création de la Haute Autorité irait donc à l’encontre de l’efficacité de l’action publique et de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques.
L’existence de nombreuses agences de sécurité sanitaire et leur coordination constituent, certes, un vrai sujet, qu’Yves Bur, ancien vice-président UMP de l’Assemblée nationale et auteur d’un rapport en 2010, avait déjà étudié. Je le cite : « La multiplication des organismes, le chevauchement de leurs compétences, et l’insuffisance de coordination, contribuent au manque de lisibilité du dispositif des agences. » Il étayait son propos d’une citation de Thierry Tuot, conseiller d’État : « Le paysage des agences n’a pas été pensé dans sa globalité selon un schéma d’ensemble structuré mais résulte d’un empilement d’institutions créées au gré des crises, d’où cette impression de dispositif manquant de lisibilité. »
Yves Bur soulignait la présence de « zones grises » : des domaines de santé publique où l’on ne savait pas très clairement quelle agence devait intervenir. Il constatait aussi la multiplication des missions d’inspection, pouvant être diligentées par plusieurs ministères à la fois, mobilisant du temps et de l’énergie au sein des agences.
On peut rejoindre Yves Bur dans son constat, examiner avec intérêt les propositions de fusion et de rapprochement d’agences qu’il a préconisées, mais ce n’est pas, en tout état de cause, le sujet qui nous intéresse aujourd’hui puisque nous créons non une nouvelle agence d’expertise mais une Haute Autorité unique, qui a sans doute vocation à s’adosser à la remise à plat de l’architecture globale des agences.
Néanmoins, notre proposition va dans le sens du rapport Bur sur au moins trois points.
En premier lieu, nous entendons éviter la multiplication des processus de contrôle interne, car on voit bien que les agences elles-mêmes sont en train de se doter de comités de déontologie sans aucune harmonisation des règles entre agences sur le rôle de ces comités, leur intervention dans le processus de décision ou encore la transparence de leurs débats.
La présence d’une Haute Autorité unique va être ici obligatoirement facteur de cohérence, et donc d’économie de moyens publics, ainsi que de moyens associatifs ou syndicaux, car on demande de plus en plus aux acteurs de la société dite « civile » de rejoindre ces comités, suscitant ainsi, là encore, la multiplication des réunions et des sollicitations.
La Haute Autorité de l’expertise est, par conséquent, un élément de rationalisation des procédés et donc une source d’économies substantielles pour l’État. Comme, par ailleurs, il subsiste, au sein de l’État, un certain nombre de petites structures de prévention et d’évaluation sans grand impact, nous pouvons, me semble-t-il, sans nul doute créer cette Haute Autorité, dont les effectifs administratifs seront modestes, à moyens constants pour l’État et avec la promesse de réelles économies d’échelle.
En deuxième lieu, il s’agit d’éviter le maintien de ces « zones grises » où l’alerte peut échapper à la vigilance de l’État. Ce point est essentiel. À partir du constat du rapport Bur sur l’existence de ces zones grises, dès lors qu’existe une Haute Autorité qui assure le suivi des alertes qu’elle reçoit, il devient quasi impossible que ces alertes ne soient pas traitées.
En troisième lieu, il faut absolument garantir l’indépendance des décisions de l’expertise par rapport à l’État, et donc au pouvoir politique en place, de manière que ses conclusions soient totalement admises par la société.
À cet égard, le rapport Bur est tout aussi explicite, parlant d’autonomie artificielle des agences : « L’autonomie dont bénéficient les agences est relative, tant la tutelle est présente dans les instances de gouvernance et conditionne leurs ressources financières. » Ou encore : « L’élaboration du budget de chaque agence avec le ministère du budget ne laisse que peu de marge de négociation aux responsables des agences. » Enfin : « Un autre inconvénient tient à la compétition entre administrations centrales dans la commande d’études ou d’avis, la principale contributrice budgétaire faisant valoir sa prééminence dans le traitement des demandes. »
La Haute Autorité de l’expertise renforcera donc l’autonomie des agences, gage de leur efficacité, d’obligation de réponse aux alertes essentielles et d’acceptabilité des conclusions de l’expertise.
J’insiste tout particulièrement sur ce dernier point : l’acceptation, dans la société, des résultats de l’expertise.
Il y a sans doute, dans les raisons de l’opposition à ce texte – je note au passage que l’opposition est peu présente aujourd'hui –, l’idée selon laquelle il va ajouter encore de l’« émotionnel » dans le traitement de l’alerte et du risque en France, qu’il s’agira d’un appel d’air pour les polémiques, peut-être l’irrationnel, dans le débat public sur les enjeux de santé publique.
Je tiens à dire que c’est exactement à l’inverse que nous entendons aboutir avec cette proposition de loi, et je vais à nouveau partir d’un exemple concret, celui des OGM.
Je ne me prononcerai pas au fond sur l’étude du professeur Gilles-Éric Séralini, ni sur ses choix méthodologiques, ni sur ses choix en termes de communication. Mais il ne fait aucun doute que le débat médiatique n’aurait pas été ce qu’il a été si nous avions eu à notre disposition une Haute Autorité de l’expertise.
Celle-ci aurait, par exemple, depuis longtemps, interpellé l’État pour qu’il demande à une de ses agences de mener elle-même les études nécessaires à la clarification du débat. La Haute Autorité se serait alors saisie de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, sur les maïs ou les colzas OGM ; de nombreux avis sont disponibles sur le site de l’ANSES. La Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte serait partie de ce simple avis de l’ANSES que je cite : « Pour 55 % des OGM étudiés, l’Agence estime que les données fournies par l’industriel ne sont pas suffisantes pour conclure sur la sécurité sanitaire liée à la consommation de l’OGM. » Elle aurait aussi pu reprendre des avis plus détaillés comme celui qui concerne le colza MON 88302. J’en citerai deux, portant sur les interactions avec les herbicides.
« Étant donné que ce colza MON 88302 a été développé pour résister à un traitement glyphosate tardif, il aurait été nécessaire de réaliser une analyse de composition sur du colza MON 88302 traité tardivement et de fournir les teneurs résiduelles en glyphosate et ses métabolites dans les graines et les huiles. » Je précise que le glyphosate est l’herbicide.
Voici maintenant ce que dit l’ANSES sur les durées des études de toxicité, thème très débattu aujourd'hui dans les médias : « L’objectif de l’étude de toxicité subchimique de 90 jours n’étant pas de démontrer uniquement l’absence de toxicité de la protéine CP4EPSPS, mais surtout d’écarter le risque d’effets inattendus liés à l’insertion du transgène dans la matrice végétale, la seule documentation de la sécurité de la protéine est considérée par le comité d’experts spécialisé comme insuffisante. »
Logiquement, avec ces conclusions, qui ont amené l’ANSES à émettre un avis négatif sur ces produits, y compris quant à la sécurité sanitaire liée à leur consommation, la Haute Autorité aurait pu se saisir de la question.
Aujourd'hui, les études du professeur Séralini répondent donc clairement à une absence d’action publique de recherche – je répète que je ne me prononce pas ici sur les méthodologies retenues, l’ANSES étant saisie par l’État pour émettre un avis avant la fin du mois –, et une Haute Autorité aurait certainement permis d’éviter cette situation, en demandant à l’État de diligenter lui-même, à partir des conclusions de l’ANSES, les études nécessaires. La création même d’une Haute Autorité indépendante irait donc dans le sens d’un débat apaisé et de décisions de l’État mieux acceptées par la société, car adossées à des expertises dont la validité serait garantie, précisément, par les représentants légitimes de la société – haute instance administrative, associations agréées, syndicats –, dans le cadre d’un processus délibératif transparent.
Bien sûr, cette Haute Autorité répond à des enjeux de santé publique, face à des risques non encore parfaitement identifiés ou insuffisamment pris en compte, mais elle répond aussi aux difficultés de l’État à développer ces actions, à autoriser des aménagements, à assumer ces décisions, car on conteste aujourd'hui et on contestera de plus en plus, dans le nécessaire débat public, la légitimité d’expertises considérées comme non indépendantes de lui-même.
La Haute Autorité de l’expertise peut ainsi permettre à l’État de mieux défendre certains de ses choix, y compris, parfois – j’espère que vous allez savourer la phrase ! –, contre des contestations dites « écologistes ». §
Dans la même logique, l’amendement adopté en commission à l’article 8, mais non intégré au texte pour les raisons déjà exposées, soulignait l’intérêt de la création d’une chaîne d’alerte complète associée à un principe de confidentialité. Il s’agit là – et ce dispositif est complété par l’article 21 de la proposition de Marie-Christine Blandin, relatif à la condamnation de la diffamation – de protéger aussi l’entreprise, pour éviter que le battage médiatique ne soit la seule possibilité de créer une alerte. Pour les entreprises également, la création d’une Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement serait donc, sans nul doute, un vrai progrès.
Je ne reviendrai pas ici sur le titre II, sur lequel nous avons entendu les remarques des syndicats : simplifications de procédure possibles ; disparition de la cellule d’alerte au profit du renforcement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la protection solide du salarié lanceur d’alerte, tout simplement par extension de la loi Bertrand relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, qui avait suivi le scandale du Mediator. Ces amendements vont être détaillés par ma collègue Aline Archimbaud, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, qui reviendra sur l’intérêt que les syndicats ont manifesté à l’égard de cette proposition de loi.
Cet exemple montre bien la place laissée, dans le processus engagé, à un dialogue constructif avec les parlementaires, le Gouvernement et les acteurs de la société. Nous voulons arriver à un texte partagé, compris par tous, que nous avons le temps de mettre au point.
Chers collègues, nous sommes confrontés à des enjeux majeurs de santé publique, que nous ne pouvons régler au coup par coup, comme c’est aujourd'hui le cas : initiatives parlementaires se traduisant par des amendements de séance trop peu discutés en amont, comme on l’a vu encore la semaine dernière à propos du texte sur le bisphénol A ; création d’agences ; vote de nouvelles lois censées répondre au dernier scandale en date. Eu égard aux enjeux, nous ne pouvons plus fonctionner ainsi !
Cette loi est une loi de modernisation démocratique, qui doit permettre à l’État et à la société d’avoir une approche rigoureuse des risques émergents, de se doter de nouvelles capacités de décision, autant pour mieux se protéger que pour mieux assumer l’ensemble de ses propres décisions.
J’espère, chers collègues, que nous aurons entre nous, à partir d’aujourd’hui – cette discussion générale n’est qu’un début –, un temps de débat et de travail commun, sans posture politicienne, pour aboutir à une loi qui soit à la hauteur de ces enjeux majeurs.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste. – M. Jean-Pierre Plancade applaudit également.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales, bien que compétente pour les questions d’expertise sanitaire, s’est saisie pour avis des seuls articles relatifs à l’alerte sanitaire et environnementale qui concernent l’entreprise.
L’entreprise est d’ores et déjà un acteur de la santé et de l’équilibre environnemental. Les institutions représentatives du personnel, les IRP, sont, aux côtés de la médecine du travail, les premiers acteurs de la protection de la santé au travail. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, créé par la quatrième loi Auroux en 1982, a élargi le champ de compétences de l’ancien comité d’hygiène et de sécurité pour prendre en compte l’impact des conditions de travail sur la santé des salariés.
Les pouvoirs de cette instance, notamment celui de mener des enquêtes sur les accidents du travail et de faire appel à un expert, en ont fait un outil de prévention des risques professionnels indispensable. Toutefois, à l’heure actuelle, ses compétences en matière de prévention des risques sanitaires et environnementaux que fait peser l’entreprise sont très limitées, voire inexistantes.
En effet, la réponse à une situation de risque sanitaire et environnemental relève avant tout de l’État et des autorités publiques locales, en vertu de pouvoirs de police administrative généraux ou spécifiques.
Le maire est chargé de la police municipale, qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Il peut donc, en cas de danger grave ou imminent, prescrire l’exécution de toute mesure exigée par les circonstances.
Le préfet est, quant à lui, compétent dès lors que le champ d’application des mesures à prendre excède le territoire d’une seule commune. Surtout, ses pouvoirs sont étendus en cas d’urgence.
Plusieurs agences et organismes publics, ainsi que les services déconcentrés de l’État, ont pour mission de réaliser une veille sanitaire et environnementale, de répondre aux situations de danger grave et imminent et d’examiner les signalements et alertes dont ils sont destinataires.
Les agences régionales de santé, les ARS, comptent, parmi leurs attributions, l’organisation de la veille sanitaire et le traitement des signalements d’événements sanitaires. Pour ce faire, elles concentrent les moyens de l’État dans les régions, notamment grâce à leur cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires, la CVAGS.
Il existe un véritable chaînage dans la réponse aux événements sanitaires, selon la gravité et le caractère imminent ou non de ceux-ci, qui implique tous les échelons de l’organisation administrative de l’État et les professions concernées.
La prévention et la réparation des dommages causés à l’environnement correspondent à une logique différente et reposent sur le principe général du pollueur-payeur.
Il appartient à l’exploitant d’une activité économique de prendre, en amont, toutes les mesures nécessaires pour limiter les effets potentiels d’une menace imminente de dommage sur l’environnement et de tenir l’autorité administrative informée de ses initiatives et de leurs conséquences. En cas d’atteinte avérée à l’environnement, les mesures de réparation doivent supprimer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine et, éventuellement, rétablir les espaces naturels dans leur état initial. Elles sont à la charge de l’exploitant.
En cas d’urgence ou de danger grave, le préfet dispose d’un pouvoir très large : il peut, à tout moment, prendre ou faire prendre, aux frais de l’exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.
Le régime des installations classées constitue le seul lien qui existe entre les deux logiques, l’une interne à l’entreprise, l’autre reposant sur l’intervention de la puissance publique, que je viens de vous exposer.
La loi Bachelot de 2003, votée à la suite du terrible accident industriel de l’usine AZF, a élargi le champ d’action du CHSCT dans les structures qui présentent de graves dangers pour la santé publique ou l’environnement. C’est une nécessité dans des territoires tels que la « vallée de la chimie » lyonnaise chère à notre collègue Guy Fischer ou bien d’autres encore, où sont concentrées, sur quelques kilomètres, des dizaines d’installations classées. Le CHSCT y dispose d’une information renforcée en matière de prévention des risques écologiques liés à l’activité de l’entreprise, au-delà de la simple protection de la santé et de la sécurité du travailleur, et il émet un avis, transmis au préfet, sur la demande d’autorisation faite par l’entreprise.
Toutefois, je viens de vous décrire un régime dérogatoire au droit commun. Alors que les dangers pesant sur l’environnement et la santé publique – pas seulement la santé au travail – du fait des activités économiques se font, malgré le cadre réglementaire existant, de plus en plus nombreux, les employés et leurs représentants n’ont, dans la grande majorité des entreprises, aucun moyen d’agir en la matière.
Le constat de l’insuffisance des dispositions existantes n’est pourtant pas nouveau.
Ainsi, l’article 53 de la loi Grenelle 1 de 2009 invitait déjà les partenaires sociaux à négocier sur « la possibilité d’ajouter aux attributions des institutions représentatives du personnel une mission en matière de développement durable, d’étendre la procédure d’alerte professionnelle interne à l’entreprise aux risques d’atteinte à l’environnement et à la santé publique ».
Auparavant, un document d’orientation, qui avait été transmis aux partenaires sociaux à la suite de la conférence tripartite sur l’amélioration des conditions de travail du 4 octobre 2007, prévoyait de soumettre à la négociation la définition des risques qui seraient concernés par la mise en place d’un dispositif d’alerte et les conditions dans lesquelles celui-ci serait déclenché, ainsi que la question de l’auteur de l’alerte et de la protection de ce dernier.
Malheureusement, vous vous en doutez, aucune suite n’a été donnée à ces initiatives encourageantes, que ce soit du fait de la mauvaise volonté des acteurs concernés ou de l’apparition d’autres priorités politiques.
Dans ce contexte, nos travaux ont été principalement orientés sur l’articulation entre la proposition de loi de Marie-Christine Blandin et les dispositions du code du travail existantes.
Dans le cadre du protocole organisant la concertation avec les partenaires sociaux, la présidente de la commission des affaires sociales et le président de la commission du développement durable ont saisi les partenaires sociaux sur le texte de la proposition de loi afin de recueillir leurs avis. Les réponses écrites des organisations ont été publiées en annexe du rapport de la commission des affaires sociales. J’ai souhaité compléter ces réponses par l’audition des partenaires sociaux, et j’ai ainsi pu entendre le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CGT, les autres syndicats n’ayant pas souhaité ou pas pu répondre à ma demande dans les délais d’examen fixés.
La question de l’expertise sanitaire relevant également du champ de compétence de la commission des affaires sociales, j’ai entendu, sur l’ensemble des dispositions de la proposition de loi, le point de vue d’un acteur indépendant particulièrement impliqué sur cette question, à savoir la revue Prescrire.
Concernant la création de la Haute Autorité de l’expertise scientifique, les partenaires sociaux m’ont fait part de deux objectifs principaux : l’efficacité et l’absence de redondance avec les compétences des agences existantes, en particulier l’ANSES, dont ils sont partie prenante.
S’ils considèrent que la mise en place de normes centralisées pour définir les conditions d’indépendance de l’expertise ainsi que le contrôle des déclarations d’intérêt leur paraissent nécessaires, ils sont opposés à l’idée que la nouvelle instance dispose de pouvoirs d’expertise propres, dont la constitution leur paraît difficile et la mise en œuvre, peu efficace. La revue Prescrire rejoint cette analyse, mais estime utile la possibilité accordée à la Haute Autorité de saisir directement le ministre d’une alerte, afin de surmonter l’éventuelle inertie d’une agence.
Concernant la mise en place d’une procédure de recueil des alertes dans l’entreprise et le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte, mesures qui, du fait de leur incidence sur le droit du travail, relèvent du champ de la négociation nationale interprofessionnelle, les organisations consultées m’ont informée qu’elles n’envisageaient pas d’ouvrir une négociation à ce sujet.
Elles ont toutefois formulé plusieurs remarques qui, malgré des points de vue parfois éloignés, laissent apparaître un consensus.
Les organisations patronales – le MEDEF, l’UPA et la CGPME – se sont montrées réticentes à l’idée de créer une cellule d’alerte dans chaque entreprise. Le MEDEF a, malgré tout, souligné la nécessité d’assurer une meilleure cohérence en matière de veille et d’alerte.
Pour les représentants des employeurs, la création d’une nouvelle institution représentative du personnel n’est pas opportune au moment où de nombreuses entreprises sont victimes d’une situation économique peu favorable. De plus, le MEDEF a, lors de son audition, fait valoir que la négociation sur la modernisation du dialogue social, qui a débuté en 2009, est toujours en cours et porte notamment sur la réforme des IRP.
Les organisations représentatives des salariés – la CFDT, la CFTC et la CGT – ont, quant à elles, estimé que la solution la plus pertinente serait de confier les missions qui sont données, dans la proposition de loi, à la cellule d’alerte au CHSCT ou, en son absence, aux délégués du personnel, car le lien entre les conditions de travail, la santé publique et l’environnement est désormais avéré. Pour expliquer leurs doutes sur la nécessité de créer une cellule d’alerte dans chaque entreprise, elles ont mis en avant le caractère concurrent de la structure envisagée par la proposition de loi par rapport aux IRP existantes et le besoin de renforcer celles-ci.
De fait, les questions que la proposition de loi laisse sans réponse sont relatives à la composition et aux modalités de désignation de la cellule ainsi qu’à son indépendance vis-à-vis de l’employeur. Les dispositions applicables au CHSCT et à ses membres garantissent d’ores et déjà l’indépendance et la protection de ces derniers contre un licenciement abusif. Cette IRP pourrait donc jouer le rôle de filtre des alertes dont les salariés la saisiraient, ce qui permettrait d’écarter les signalements infondés ou de mauvaise foi.
La CFDT a rappelé l’existence d’un certain nombre de dispositions en matière d’association des IRP aux questions environnementales, ainsi que les avancées contenues dans la loi Bachelot de 2003, qui n’ont, jusqu’à présent, jamais été mises en œuvre. Cela s’explique par le manque de formation des membres des CHSCT dans les domaines très techniques que sont les risques sanitaires et environnementaux. Le représentant de la CFDT, tout comme celui de la CGT, a beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer le droit à la formation des membres des CHSCT.
Toutes les organisations syndicales ont souligné l’autocensure dont font preuve les salariés, ainsi que les pressions plus ou moins explicites qu’ils subissent lorsqu’ils cherchent à révéler un risque lié à l’activité de leur entreprise. Dans la période actuelle de chômage élevé, le chantage à l’emploi dont ils peuvent être les victimes est souvent dissuasif.
C’est la raison pour laquelle elles prônent avant tout une extension du droit de retrait reconnu au salarié et du droit d’alerte du CHSCT aux conséquences sur la santé publique et sur l’environnement des méthodes de production de l’entreprise.
Enfin, la CFTC a considéré que la difficulté majeure, pour les salariés, consiste à accéder à la connaissance scientifique nécessaire pour démontrer les risques dont ils soupçonnent l’existence. Celle-ci est souvent fragmentée dans l’entreprise, ce qui ne permet pas forcément à une personne isolée et non experte de reconnaître une situation de danger et de lancer une alerte.
C’est pourquoi il a été suggéré de s’appuyer sur les réseaux de vigilance existants, en particulier les groupes d’alerte en santé travail, les GAST, qui sont en cours de déploiement auprès des agences régionales de santé, sous l’égide de l’Institut de veille sanitaire, l’InVS.
La commission des affaires sociales a adopté onze amendements tendant à supprimer les cellules d’alerte dans les entreprises telles qu’elles sont proposées dans le texte initial et à intégrer la mission de veille sanitaire aux compétences du CHSCT ou, à défaut, à celles des délégués du personnel.
Il s’agit : d’élargir les missions du CHSCT en y ajoutant l’examen des alertes de santé publique ou d’environnement transmises par les salariés ou identifiées par ses membres ; de renforcer le pouvoir d’enquête de cette instance, pour lui permettre d’enquêter sur les alertes qu’elle reçoit dans les domaines que je viens de citer ; de prévoir que le CHSCT est consulté avant tout changement des produits ou des procédés de fabrication utilisés dans l’établissement qui sont susceptibles de faire peser un risque sur la santé publique ou l’environnement ; de rendre obligatoire la réunion du CHSCT lorsqu’un événement lié à l’activité de l’établissement a porté atteinte ou a pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ; de permettre au CHSCT de faire appel à un expert pour ce qui concerne les risques sanitaires ou environnementaux qui peuvent être posés par l’activité de l’entreprise.
Il est également nécessaire d’élargir le droit d’alerte et de retrait reconnu à tout salarié par le code du travail et le droit d’alerte dont disposent les représentants du personnel au CHSCT, afin d’inclure les risques en matière de santé publique et d’environnement.
Pour garantir la meilleure protection possible des lanceurs d’alerte contre les représailles qu’ils pourraient subir dans le monde du travail, il est également apparu nécessaire de modifier l’article du code qui pose le principe général de non-discrimination, en incluant dans la liste des personnes ne pouvant être écartées d’un recrutement, sanctionnées ou licenciées celles qui, de bonne foi, ont été à l’origine d’une alerte.
Il faut également garantir à tout citoyen ou à tout salarié d’une entreprise de moins de onze salariés la possibilité de lancer une alerte. Pour cela, il est nécessaire de prévoir dans le code de la santé publique, d’une part, dans le code de l’environnement, d’autre part, que ce citoyen ou ce salarié pourra saisir, selon le cas, le directeur général de l’ARS ou le préfet de département s’il a connaissance d’un risque grave en matière de santé publique ou d’environnement.
En outre, afin de garantir l’information des IRP compétentes sur les questions environnementales, l’obligation de consultation du comité d’entreprise sur le rapport de développement durable des entreprises cotées doit être rétablie.
Cette obligation, créée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, avait été supprimée moins de six mois plus tard par un cavalier législatif introduit dans la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Au moment où nous examinons la possibilité d’élargir la compétence des CHSCT aux alertes environnementales, il nous apparaît tout à fait pertinent de restaurer un droit de regard des IRP en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises.
Mes chers collègues, les propositions de modification que je viens de vous présenter sont empreintes d’un souci de pragmatisme et d’efficacité. Elles sont destinées à garantir que le dispositif proposé, s’il est voté, s’intégrera à la vie des entreprises et contribuera à renforcer la sécurité sanitaire et environnementale de notre pays.
Si des dispositions similaires avaient existé il y a dix ou vingt ans, la collectivité publique n’aurait pas à dépenser des millions d’euros pour assurer la dépollution de sites industriels laissés à l’abandon par un propriétaire qui s’est soustrait à ses responsabilités.
Les désastres des plans sociaux cachent souvent, comme ce fut le cas pour celui de Metaleurop à Noyelles-Godault, des drames sanitaires et environnementaux : pollution des sols, des eaux, de l’atmosphère et, inévitablement, dégradation de la santé des populations alentour.
Faisons en sorte que ceux qui en sont les témoins et les victimes puissent agir efficacement pour y mettre un terme !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC. – M. Jean-Pierre Plancade applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, madame la rapporteur pour avis, mes chers collègues, je me réjouis que nous puissions consacrer du temps à l’examen de la question noble et sérieuse qui nous réunit aujourd’hui.
L’occasion nous en est offerte par la proposition de loi de notre collègue Marie-Christine Blandin, dont l’engagement sur ce sujet est ancien et constant.

Aux bonnes questions que pose Mme Blandin nous devons, ensemble, tenter de répondre avec une sincérité et une détermination égales à la sienne, mais aussi, comme elle l’a souligné, sans arrière-pensées politiques.
Qui, en effet, n’a pas été interpellé, touché, choqué, voire scandalisé, au cours des dernières années, par les affaires de l’amiante, du sang contaminé ou du Mediator ? Et, bien sûr, qui ne serait pas prêt à tout faire pour que de tels drames ne se reproduisent pas ?
Le cas de l’amiante est à mes yeux le plus désastreux, puisque les premières traces de l’alerte datent de 1906 !
Qui ne souhaiterait réduire autant que possible le délai entre l’apparition d’un problème sanitaire ou environnemental et son traitement par des mesures appropriées ?
Nous-mêmes, parlementaires, sommes parfois alertés ; mais nous nous trouvons bien souvent démunis devant les situations qui nous sont signalées car il nous est difficile d’en mesurer l’ampleur et d’apprécier la réalité de leur gravité.
C’est pourquoi toute mesure propre à réduire les risques et à améliorer le traitement des alertes en matière de santé et d’environnement est la bienvenue et mérite tout notre intérêt.
Loin de moi l’idée de nier la justesse des propos qui ont été tenus. Pour autant, il me semble qu’il ne convient pas d’adopter trop vite des décisions dont, sur le moment, nous ne mesurerions pas toutes les conséquences.
Je veux dire qu’on ne peut pas remettre en cause le sérieux et l’éthique des experts de grande qualité qui travaillent dans les très nombreuses structures que compte déjà notre pays. Dans leur immense majorité, ces chercheurs et ces experts font leur métier loyalement ; ils y consacrent, avec beaucoup de dévouement, un temps considérable. Ils travaillent en lien avec d’autres chercheurs dans le monde entier, avec toutes sortes d’instituts de recherche, avec des laboratoires universitaires. Leurs travaux sont publiés, critiqués, évalués, décortiqués par d’autres spécialistes.
En outre, il ne me semble pas qu’on ait pu les prendre en défaut, à de très rares exceptions près.
On ne peut donc pas leur reprocher un manque de sérieux ou de méthode dans leurs recherches.
J’ajoute que la mobilisation des réseaux sociaux est une autre forme de garantie dont ces experts doivent tenir compte.
J’en conclus qu’il nous faut réfléchir avant de remettre en cause leurs méthodes ou leurs choix. Il n’est donc sans doute pas opportun de mettre en place une expertise de l’expertise dans la précipitation.
Le rapporteur de notre commission a bien résumé la situation : ce dispositif sera partagé ou il ne sera pas. Nous ne pouvons pas imposer une Haute Autorité du jour au lendemain, sans qu’il y ait eu une concertation, un bilan de ce qui existe et une analyse des failles, s’il y en a.
Pourquoi les experts de la Haute Autorité qu’il est proposé de créer seraient-ils plus exemplaires que les autres ?
N’oublions pas, enfin, que les scandales sanitaires dont nous parlons ici n’ont pas seulement une dimension nationale. Je doute que nous puissions, à nous seuls, trouver le moyen d’en prévenir d’autres à l’avenir ; nous devons donc, là aussi, prendre en compte la dimension européenne.
Un sujet mérite aussi une vraie réflexion : celui du lanceur d’alerte et de son statut. Je souhaite d’ailleurs que la commission du développement durable profite des semaines à venir pour approfondir son analyse sur ce point, pour se mettre en état de reprendre à son compte et de compléter les dispositions de la proposition de loi touchant à cette question.
Oui, il faut créer un statut du lanceur d’alerte. Il faut soutenir et protéger les démarches d’alerte et même, s’il est nécessaire, dédommager ceux qui ont le courage de faire état de leurs doutes, de leurs interrogations ou de leurs constats.
Je pense en particulier aux docteurs Irène Frachon et Georges Chiche, pour le Mediator, ou à Suzanne de Bégon, qui a dénoncé l’utilisation de l’oxyde d’éthylène pour stériliser les biberons : tous ont subi des préjudices inacceptables.

Il faut aussi responsabiliser l’État, qui est coupable par ses silences !

Si un statut de lanceur d’alerte avait existé lorsque ces personnes ont entamé leurs démarches et envoyé leurs premiers signaux d’alarme, elles auraient probablement été mieux entendues et leurs alertes, mieux traitées.
Définir un statut pour le lanceur d’alerte doit donc, à mon sens, être la priorité.
Le dossier n’est pas clos puisque nous n’aurons pas le temps d’achever cette après-midi l’examen de la proposition de loi. Je souhaite que nous mettions à profit le temps qui nous sépare de la reprise de la discussion pour mieux garantir la protection des lanceurs d’alerte et pour faire de cette proposition un projet partagé !
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement accueille avec bienveillance cette proposition de loi, qui montre l’utilité de l’initiative parlementaire pour faire avancer les sujets les plus difficiles.
L’indépendance de l’expertise et la prise en compte des alertes faisant état des conséquences sur la santé publique de telle ou telle substance ont été au centre de plusieurs scandales sanitaires et environnementaux ces dernières années. Plusieurs avancées législatives notables en ont résulté.
Mais on observe des risques émergents et un doute subsiste encore : tout a-t-il été fait pour garantir la déontologie et l’indépendance de l’expertise ? Toute l’attention nécessaire a-t-elle été accordée aux alertes ? Peut-on affirmer avec certitude que la protection de la santé publique et de l’environnement passe avant tout, lorsqu’elle contrarie de puissants intérêts financiers ? Et lorsque les incidences sanitaires ont été connues, les pouvoirs publics en ont-ils tiré toutes les conséquences ?
La décision publique doit pouvoir s’appuyer sur la science. La confiance des citoyens dans les autorités et les procédures scientifiques d’évaluation des risques est indispensable.
Convaincue de l’importance majeure de ces enjeux, j’ai souhaité que, pour la première fois, la question de la prévention des risques sanitaires environnementaux soit appréhendée globalement et inscrite à l’ordre du jour du dialogue environnemental lancé par le Gouvernement, lors de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier ; je salue d’ailleurs les sénatrices et sénateurs qui y ont participé.
L’impact sur la santé des pollutions, des ondes et des produits chimiques est désormais la première préoccupation déclarée par les Français lorsqu’on les interroge sur l’environnement ; la qualité de l’air que nous respirons, de l’eau que nous buvons et des aliments que nous mangeons est devenue une préoccupation quotidienne.
En particulier, la santé des enfants, dont l’organisme est plus exposé aux polluants et les absorbe davantage, doit être la priorité absolue.
C’est le devoir du Gouvernement de répondre à ces préoccupations en veillant à la meilleure prévention, à l’information et à la protection.
En ouvrant la Conférence environnementale, le Président de la République a affirmé avec force la nécessité d’agir face aux « conséquences de la dégradation de notre environnement sur l’augmentation d’un certain nombre de pathologies chroniques ».
Dans cette perspective, le Gouvernement a d’ores et déjà pris plusieurs initiatives.
D’abord, j’ai annoncé récemment devant le Sénat la poursuite des expérimentations d’abaissement de fréquence pour les antennes relais de téléphonie mobile et la mise à jour des travaux de l’ANSES, dont le Gouvernement tirera les conclusions d’ici au mois de juin 2013.
Nous nous mobilisons également, en collaboration avec les grandes villes, pour traiter les points noirs de la qualité de l’air extérieur, en particulier les concentrations de particules fines qui, selon l’OMS, sont responsables de 40 000 décès prématurés chaque année en France.
En outre, à la suite de la position exprimée par le Premier ministre lors de la Conférence environnementale, le Sénat a voté la proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A.
À ce propos, je vous rappelle que le Gouvernement s’est engagé, à l’issue de la Conférence environnementale, à présenter d’ici à juin 2013 une stratégie nationale concernant les perturbateurs endocriniens.
Avant la fin de l’année, nous prendrons aussi un arrêté renforçant les interdictions d’utilisation du perchloréthylène dans les pressings, jusqu’à une interdiction totale de ce produit sur plusieurs années.
Enfin, la Conférence environnementale a entériné la fin des dérogations à l’interdiction de l’épandage aérien de produits phytosanitaires ; un bilan de ces dérogations, autorisées par le précédent gouvernement, sera dressé d’ici à la fin de l’année et nous allons organiser leur extinction.
Il est urgent de mobiliser et d’orienter l’action publique vers la santé environnementale. C’est une question de sécurité sanitaire, mais aussi de justice sociale car l’exposition aux pollutions n’est pas la même selon les catégories sociales.
Nous ne pouvons pas nous contenter de lutter contre les risques connus et expliqués. En effet, de nouvelles pollutions apparaissent, liées aux évolutions des modes de vie et des techniques.
Comme je l’ai dit mercredi dernier devant l’Assemblée nationale, des études épidémiologiques font apparaître, depuis le début des années 2000, des corrélations entre l’exposition aux champs magnétiques de très basses fréquences et certaines pathologies comme la leucémie chez l’enfant. Bien qu’aucune étude n’ait permis de mettre en évidence un mécanisme scientifique de causalité, le principe de précaution doit s’appliquer.
Un protocole conclu entre l’État et Réseau de transport d’électricité, RTE, prévoit déjà des actions pour les bâtiments installés dans une bande de 100 mètres autour des lignes à haute tension. Mais nous avons demandé à l’ANSES d’actualiser son expertise au sujet des conséquences de ces expositions sur la santé humaine et animale, afin de proposer de nouvelles règles.
De la même façon, les débats sur la proposition de loi relative au bisphénol A ont été l’occasion de rappeler, en s’appuyant notamment sur les résultats des travaux de l’ANSES et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, que plusieurs études remettent en cause la pertinence de l’approche toxicologique classique : on ne peut raisonner seulement par rapport à des doses quand on sait que les perturbateurs endocriniens, par exemple, peuvent avoir des effets à faibles, voire à très faibles doses.
Nous devons aussi être très attentifs au fait que des molécules différentes peuvent, lorsqu’elles sont associées, exercer sur l’organisme un « effet cocktail » ; des recherches ont d’ailleurs été lancées sur ce phénomène pour ce qui est des pesticides.
Les risques émergents ne se manifestent souvent que par des signaux diffus, isolés ou faibles, ce qui les rend difficiles à identifier.
Les controverses qu’ils soulèvent peuvent aussi être liées à des difficultés réelles et objectives rencontrées pour mesurer des effets sur la santé ou à l’insuffisance des dispositifs susceptibles de repérer d’éventuels risques.
L’étude du professeur Séralini publiée il y a quelques semaines sur les OGM illustre le poids de l’expertise dans les décisions publiques.
Les polémiques sur la durée des tests toxicologiques pratiqués sur les rats, le poids de l’évaluation des risques dans les décisions d’autorisation de mise sur le marché et, plus récemment, les suspicions de conflits d’intérêts au sein de l’Autorité européenne de sécurité des aliments – suspicions suffisamment sérieuses pour que le Médiateur européen juge une plainte recevable – démontrent l’importance de pouvoir disposer d’une capacité d’expertise fiable, indépendante, transparente et contradictoire. (
C’est pourquoi la France envisage de proposer à ses partenaires européens un changement radical de la politique d’expertise pour ce qui concerne les OGM.
Nous considérons qu’il faut rendre contraignantes des lignes directrices renforcées d’évaluation des risques et tenir compte des conséquences socio-économiques.
Selon nous, il faut aussi que les agences d’évaluation disposent de moyens suffisants pour réaliser leurs propres études, alors que ce sont actuellement les industriels qui fournissent les études et les données qui déterminent les autorisations de mise sur le marché.
À l’instar de ce qui a été prévu par le législateur pour garantir l’indépendance en matière de mesure des ondes électromagnétiques, nous devons réfléchir à la création d’un fonds qui aurait vocation à financer directement des études toxicologiques publiques d’évaluation des risques. Ces études pourraient notamment porter sur des périodes longues d’exposition et s’intéresser plus spécialement aux effets sur les personnes vulnérables, en particulier les femmes enceintes et les enfants.
La proposition de loi qui vous est soumise aujourd’hui est donc utile. Elle porte sur deux questions majeures : les conditions de l’indépendance de l’expertise et la prise en compte des alertes. Elle s’inscrit ainsi directement dans la perspective ouverte par les travaux de la table ronde santé-environnement de la Conférence environnementale, dont la feuille de route contient les engagements selon lesquels « le statut de l’expert fera l’objet d’une réflexion plus poussée » et « les conditions permettant de repérer et de confirmer une alerte seront également étudiées ».
Le Gouvernement soutient donc la démarche du Sénat. Les dispositions précises du texte font débat et ont été discutées, je le sais, de façon approfondie en commission du développement durable, en s’appuyant sur le travail de qualité mené par M. le rapporteur Ronan Dantec, ainsi qu’en commission des affaires sociales, grâce à l’implication de Mme Aline Archimbaud.
Concernant les conditions de l’indépendance et de la déontologie de l’expertise, les défis posés par les risques émergents demandent une structuration adaptée, fiable et transparente de la recherche et de l’expertise, afin de les traiter selon une procédure traçable et de leur apporter une réponse satisfaisante.
Des progrès incontestables ont été accomplis ces dernières années.
L’ANSES s’est ainsi dotée, en avril 2011, d’un comité de déontologie et de prévention des conflits, d’un code de déontologie de l’expertise et d’une cellule d’audit interne.
L’INERIS, l’institut national de l’environnement industriel et des risques, dispose depuis 2004 d’une charte de déontologie et d’un comité de déontologie.
Une charte nationale de l’expertise scientifique, élaborée en mars 2010 par le ministère de la recherche, assure un premier niveau de traitement de l’alerte au sein des organismes de recherche. En mai 2012, elle avait été adoptée par treize établissements d’enseignement supérieur et de recherche et quarante universités.
Par ailleurs, la loi du 29 décembre 2011 a renforcé les dispositions en matière de déontologie de l’expertise sanitaire pour l’ANSES, l’InVS, l’IRSN – institut de radioprotection et de sûreté nucléaire – et l’ASN – autorité de sûreté nucléaire –, et prévoit une protection des lanceurs d’alerte dans le domaine de la pharmacovigilance.
Ces avancées récentes, qui pourront être complétées par une nouvelle étape, doivent être soulignées. Pour autant, la création d’une nouvelle structure fait débat. En tant que ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, je suis favorable à ce qu’une instance soit spécifiquement chargée d’une mission transversale de suivi des garanties déontologiques que je viens de citer. Celle-ci aurait vocation, j’y insiste, non pas à se substituer aux instituts et agences existants, mais à s’assurer de la prise en compte des enjeux déontologiques et des bonnes pratiques de l’expertise.
Elle pourrait veiller à la mise en place des comités et chartes de déontologie ainsi que des cellules d’audit interne au sein de l’ensemble des agences et organismes qui produisent nos expertises, sans les décharger pour autant de leurs responsabilités. Sur ce dernier point, très important à nos yeux, il convient d’améliorer le texte.
Il ne peut s’agir d’instituer un échelon supplémentaire et unique d’instruction d’expertise technique, comme le débat a d’ailleurs permis de le préciser. L’expertise scientifique ne peut être concentrée en un lieu unique, ce qui serait contre-productif par rapport aux buts recherchés, à savoir le pluralisme, l’évaluation contradictoire par les pairs, la transparence et la fiabilité de l’expertise.
De plus, l’ouverture à la société civile, telle qu’elle est pratiquée notamment à l’ANSES, l’INERIS et l’IRSN, dont mon ministère partage les tutelles, me semble devoir être généralisée.
Il s’agit de procédures de consultation et d’audition ouvertes aux parties prenantes, notamment aux ONG, de mise en place de comités de dialogues thématiques et de comités d’orientation. Ouvrir l’expertise à la société est à la fois un facteur d’indépendance et de prise en compte des signaux faibles.
L’alerte environnementale et sanitaire et la bonne manière de l’entendre et d’y donner suite ont été beaucoup discutées ces dernières années. Toutefois, ces sujets demeurent en chantier, car nous devons encore travailler sur les difficultés liées à leur mise en œuvre opérationnelle et juridique.
Nul ne doit pouvoir être inquiété parce qu’il aurait révélé un danger sanitaire ou environnemental. Vous avez eu raison, madame Blandin, de rappeler le nom de ceux qui ont eu le courage de dénoncer de véritables scandales.
Concernant la protection du lanceur d’alerte, il me paraît cependant important de préciser que la structuration actuelle des institutions représentatives du personnel, au sein desquelles figure le CHSCT, fait l’objet d’une négociation au niveau national interprofessionnel entre les partenaires sociaux dans le cadre de la Conférence sociale. La question de la place du CHSCT et de ses missions, notamment environnementales, est au cœur de ces négociations. Nous devons respecter le dialogue social, qui doit apporter une solution négociée, conformément à ce qu’ont demandé les organisations de salariés et d’employeurs.
À cet égard, je rappelle que le droit d’alerte existant à l’heure actuelle ne vaut qu’en cas de danger grave et imminent et n’est donc pas applicable au sujet qui nous préoccupe, à savoir les risques pour la santé ou environnementaux.
Pour ce qui concerne la prise en compte des signaux faibles, la création d’un « registre national des alertes » doit être envisagée. Nous devons effectivement nous assurer qu’à chaque alerte plausible correspond bien une expertise scientifique indépendante menée par une ou plusieurs des agences compétentes. Des structures existantes pourraient tenir ce registre : elles s’assureraient que chaque question peut être traitée par un organisme d’expertise à même de l’analyser.
Je pense notamment au Comité de la prévention et de la précaution ou au Haut Conseil de la science et de la technologie. Ces instances pourraient également identifier, sans instruction technique directe, je le répète, d’éventuels « sujets orphelins » et s’en autosaisir. Ces sujets seraient ensuite répartis entre les agences compétentes. Une mission de réflexion sur la captation de l’alerte et des signaux faibles est actuellement menée par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD, et le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, le CGEIET, dont le Gouvernement attend le rapport d’ici à la fin de l’année.
Il est également souhaitable, parallèlement au suivi des conditions déontologiques d’exercice, de veiller à la méthodologie de prise en compte de ces signaux faibles à l’intérieur même des agences, là encore en généralisant les bonnes pratiques déjà mises en œuvre dans certaines d’entre elles.
Afin d’améliorer les dispositions de cette proposition de loi, je me tiens, mesdames, messieurs les sénateurs, à votre entière disposition. Conformément au cap fixé par le Président de la République et le Premier ministre lors de la Conférence environnementale, le Gouvernement entend améliorer la prise en compte des enjeux de santé environnementale dans l’ensemble des politiques publiques. Pour cela, il a besoin de la force d’initiative du Parlement.
Nous nous engageons donc à travailler sérieusement et rapidement, sur la base de vos propositions, en renforçant les cadres existants, pour faire progresser les garanties de l’indépendance de l’expertise. Les débats en témoignent, votre initiative est la bienvenue. Elle mérite d’être précisée et améliorée, pour pouvoir rassembler. Le Gouvernement reste à votre disposition pour qu’elle puisse aboutir.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Nous examinons aujourd’hui une proposition de loi déposée par notre collègue Marie-Christine Blandin, qui vise à inscrire dans la loi la protection des « lanceurs d’alerte », l’assurance d’un suivi de cette alerte et le traitement honnête du message.
Nous avions été un certain nombre, lors des débats de la loi Grenelle 1, à soulever la question spécifique des lanceurs d’alerte, convaincus que nous sommes de son importance. Le ministère de l’époque avait simplement consenti à prévoir, à l’article 52 du texte, la remise d’un rapport au Parlement sur ce sujet. Aujourd’hui, le scandale du Mediator nous éclaire assez sur la capacité de firmes sans scrupules à nuire à ceux qui tentent d’alerter l’opinion publique !
Nous partageons donc les objectifs de cette proposition de loi, qui offre un cadre légal sécurisé à une pratique citoyenne et organise parallèlement la procédure d’instruction des alertes.
Cependant, sa rédaction initiale suscitait un certain nombre d’interrogations, auxquelles M. le rapporteur a tenté d’apporter des réponses en commission. Il a proposé notamment de redéfinir l’architecture globale de la procédure d’alerte, en précisant les rôles de chacun des acteurs, pour la rendre plus efficace et plus respectueuse de l’existant.
C’est pourquoi nous regrettons vivement que cette proposition de loi, ainsi amendée, n’ait finalement pas été adoptée par la commission. Les amendements déposés ont pour objet de repenser le rôle de la Haute Autorité ici envisagée, en la considérant comme un trait d’union entre les agences existantes, le ministère, les entreprises et les lanceurs d’alerte, afin qu’elle soit garante, tout au long de la procédure de l’alerte, que celle-ci sera bien menée à son terme. Un tel dispositif nous semble bien plus pertinent et nous voterons les amendements allant dans ce sens.
Pourtant, nous avons encore des remarques à formuler.
Si le rapporteur a proposé à juste raison de donner un pouvoir de saisine aux organisations syndicales, nous estimons que cette saisine devrait être élargie aux CHSCT, au regard des nouvelles missions qui leur sont confiées.
Plus globalement, considérant ses faibles moyens d’investigation et une absence de pouvoirs de contrainte, nous craignons que cette Haute Autorité ne puisse remplir ses missions de manière efficace.
De plus, au regard des financements prévus, son action dépendra très concrètement de la volonté de l’État d’accorder, ou non, les subsides nécessaires à son fonctionnement.
Plus largement, sur le fond, nous pensons que le vrai problème réside dans une conjonction d’intérêts des acteurs politiques, industriels et de la recherche, intérêts qui ne correspondent pas toujours à l’intérêt général. Le législateur devra s’atteler à ce problème et fixer, à l’instar de ce qui a été fait pour le médicament, des règles strictes.
Parallèlement, l’ouverture de plus en plus importante de la recherche au financement privé et la force des lobbies conduisent à faire prévaloir, y compris au niveau de l’expertise, les considérations commerciales sur les conséquences en matière de santé ou d’environnement. Nous maintenons donc notre exigence d’un renforcement des moyens de la recherche publique et d’une redéfinition du champ et du périmètre du secret industriel, véritable frein à la réalisation d’expertises fiables et transparentes.

Sur la déclinaison à l’échelle de l’entreprise, nous estimons donc qu’il est plus pertinent de confier cette mission au CHSCT. D’une part, les CHSCT disposent de véritables moyens – en termes de connaissances sur la santé au travail – et, d’autre part, l’unité d’action résultant d’une seule et même structure permet d’éviter la distinction entre le champ social et le champ environnemental dans l’action des salariés.
Pour ce qui concerne la garantie d’un statut protecteur des lanceurs d’alerte, nous considérons que les propositions formulées vont dans le bon sens, même si nous gardons à l’esprit que les salariés dits « protégés » continuent d’être malmenés par leurs directions et sont encore souvent les premiers à être licenciés ou mis au placard, malgré les protections légales. Nous devrons donc être particulièrement vigilants sur ce point.
Pour finir, mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que, par la place que nous attribuerions ainsi au CHSCT, nous redonnerions très symboliquement une dimension collective à cet exercice. C’est le gage de véritables constructions partagées, qui, précisément parce qu’elles sont partagées, permettent d’enregistrer des avancées sociales dans notre pays.
Parce qu’il est urgent de permettre une meilleure prise en compte des risques sanitaires et environnementaux au sein des entreprises et qu’il est nécessaire de promouvoir un véritable statut pour les lanceurs d’alerte, nous apporterons notre soutien aux amendements déposés et, s’ils sont adoptés, à l’ensemble du texte. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi relative à la création de la Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement, déposée par notre collègue Marie-Christine Blandin. Ce texte a le mérite de rouvrir le débat sur ce sujet. En effet, depuis dix ans, et depuis cinq ans encore plus intensément, la même préoccupation est régulièrement évoquée.
Le RDSE, que je représente aujourd’hui, n’a pas été franchement convaincu par ce texte. Plus que sur le fond, notre groupe s’interroge sur sa forme. Cette remarque ayant été formulée par les orateurs qui m’ont précédé, je m’efforcerai d’être bref.
Pourquoi créer une Haute Autorité supplémentaire d’experts, alors qu’il en existe déjà un certain nombre ? Ne serait-il pas préférable de mieux gérer, dans la transparence et l’indépendance, ce qui existe déjà ?
D’ailleurs, comme l’a fait remarquer tout à l’heure mon collègue Raymond Vall, pourquoi certains experts seraient-ils « plus experts » que d’autres ? À les écouter, il apparaît qu’ils sont souvent sûrs de la qualité de leurs travaux ; mais force est d’admettre qu’ils ne sont pas indemnes de tout conformisme.
Notre groupe n’est pas favorable à la création de cette haute autorité supplémentaire telle qu’elle nous est présentée aujourd’hui. Pour autant, le statut du lanceur d’alerte a, bien sûr, retenu toute notre attention. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut poursuivre la réflexion et retravailler le texte qui nous est soumis.
Je ne reviendrai pas sur la trop longue histoire des silences meurtriers des industriels, des institutions et de l’État. Madame Blandin, vous avez rappelé que c’est en 1906 que fut identifiée la dangerosité de l’amiante. J’ajoute que, dès 1918, aux États-Unis, les assurances ne couvraient plus les travailleurs de l’amiante. Chez nous, il a fallu attendre 1997 pour qu’une décision soit prise !
Je ne reviendrai pas sur le cas du Mediator. S’agissant de l’oxyde d’éthylène, vingt ans auront passé avant que celui-ci soit interdit, et je pense en ce moment à Mme de Bégon, ancienne salariée de Blédina, qui est aujourd'hui ruinée.
Il faut aussi envisager plus précisément que ne le fait la loi de décembre 2011 la question de la responsabilité de l’État lorsque celui-ci reste sourd, ainsi que le problème des conflits d’intérêts. Sur ce dernier point, comme vous l’avez dit, madame Blandin, on ne peut se contenter d’une simple déclaration.
Il faut également rendre systématique le couplage des expertises et des contre-expertises, imposer aux industriels de communiquer l’intégralité de leurs données de recherches et d’études, obligation à laquelle ils ne sont pas soumis à ce jour. Comme cela a été dit, les secrets industriels tiennent trop souvent lieu d’excuse pour ne pas rendre plus transparent ce qui devrait l’être, surtout en matière de santé publique.
Chère collègue Marie-Christine Blandin, permettez-moi de vous dire que la cause que vous défendez avec cette proposition de loi est noble et mérite qu’on l’examine de près. Cependant, le dispositif que vous préconisez ne nous paraît pas satisfaisant. Nous pensons qu’il faut continuer à y travailler, élargir le champ de cette Haute Autorité. Lorsque ce sera chose faite, mon groupe étudiera de nouveau ce dossier afin d’arrêter une nouvelle position.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous devons reconnaître que ce texte pose une question fondamentale : celle de notre capacité à détecter et à traiter des signaux faibles d’alertes sanitaires ou environnementales.
Le sujet est redoutable, mais il est urgent de le traiter. Les exemples de nos propres doutes abondent. Nous avons récemment débattu de la question du bisphénol A, qui nous renvoie à notre incapacité d’identifier les effets à long terme de faibles doses de pollution.
Nous avons également débattu à maintes occasions des nanomatériaux, des champs électromagnétiques, des ondes radiofréquences et de la téléphonie mobile, des OGM ou encore de l’impact des pesticides, et je pense que nous serrons amenés à en débattre encore très souvent. Ce furent des points majeurs du Grenelle de l’environnement, et le doute l’emportait généralement sur les certitudes.
D’ailleurs, les exemples qui sont pris dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi ne sont peut-être pas les bons : pour l’amiante comme pour le Mediator, les pouvoirs publics ne pouvaient pas ignorer. Vous le rappelez en introduction, vingt et un ans se sont écoulés entre la reconnaissance de la cancérogénicité de l’amiante et son interdiction. Autrement dit, ce n’est pas l’expertise qui était défaillante, ce sont les pouvoirs publics qui l’ont été.
Lors du Grenelle de l’environnement, la proposition de créer une haute autorité visait justement à appréhender ces autres risques que sont les risques émergents caractérisés par les effets à long terme des faibles doses, les effets cocktails ou encore les « effets fenêtres », autant de phénomènes qui nous plongent très souvent dans l’incertitude car nous ne disposons que très rarement des expertises concluant clairement à l’innocuité ou la nocivité des produits en cause. Et nous devons décider avec cette marge d’incertitude !
L’enjeu de la Haute Autorité est bien de réduire autant que possible cette marge d’incertitude.
Quelles que soient nos convictions politiques, nous nous efforçons toujours, au sein de cet hémicycle, d’éviter deux écueils : d’une part, la renonciation frileuse au progrès – vous connaissez les arguments, souvent avancés de manière très véhémente, contre l’obscurantisme ou le principe de précaution – et, d’autre part, l’émergence de maladies ou de risques que je qualifierai de planétaires et sur lesquels nous fermerions les yeux ; ce dernier écueil est, à mon avis, particulièrement redoutable.
Je conserve un préjugé positif face aux progrès. Pour autant, celui-ci n’est pas linéaire. Des innovations ont pu engendrer le meilleur comme le pire. Au xxie siècle est apparue une réalité inédite : jamais l’humanité n’aura autant partagé les mêmes biens et les mêmes aspirations. Par exemple, le téléphone portable, notamment celui d’une marque bien connue, est devenu planétaire. Dès lors, ne pas identifier aujourd’hui des signaux faibles de pathologies naissantes reviendrait à prendre le risque d’une épidémie planétaire.
Nous avons donc l’obligation morale de détecter ces signaux faibles.
Notre deuxième défi, et il en a été amplement question cet après-midi, est de fiabiliser l’expertise.
Nous aimerions tous pouvoir nous abriter derrière les certitudes de l’expertise, mais elles n’existent pas. Au demeurant, cette dictature de l’expert serait contraire aux principes démocratiques.
La science est d’autant plus mise en doute aujourd’hui que ces risques émergents remettent en question tous les protocoles traditionnels de l’expertise.
Comme l’un des orateurs qui m’ont précédée, je prendrai l’exemple, risqué, du débat ultramédiatisé autour des travaux du professeur Séralini sur l’OGM NK 603.
Je ne me prononcerai pas sur le fond, mais ce débat pose clairement la question des protocoles d’expertise. Est-il pertinent d’évaluer l’impact d’un produit sur 90 jours et non sur une durée de vie ? À l’évidence, la réponse est négative.
Je me permets d’observer au passage, madame la ministre, qu’on s’inscrit toujours dans la continuité de ses prédécesseurs. Avec Jean-Louis Borloo, dès 2009, nous avions demandé à l’ensemble de nos partenaires européens la révision des conditions de l’expertise de l’EFSA. La Commission européenne devait d’ailleurs nous faire des propositions. Probablement attend-elle le bon moment pour formuler celles-ci… C’est regrettable !
Je ne comprends d’ailleurs pas, madame la ministre, que la France se soit abstenue lors du dernier Conseil européen sur le vote portant autorisation du maïs NK 603. Nous aurions beaucoup gagné à voter contre cette autorisation.
La deuxième question posée par l’étude du professeur Séralini est celle de l’indépendance des expertises.
Il n’existe pas d’expertise indépendante en soi. Certes, les lobbies exercent sans doute des pressions, mais certains experts ont aussi parfois des convictions très affirmées. La meilleure garantie d’indépendance, c’est le caractère pluraliste, contradictoire et transparent des expertises ; du reste, le professeur Séralini le souligne lui-même.
La troisième question posée par cette étude est la prise en compte des enjeux sociétaux. Elle est fondamentale. L’expertise ne peut pas être uniquement scientifique.
Ainsi, un OGM peut présenter un risque environnemental et, en même temps, répondre à une urgence humaine. Certes, nous attendons toujours cet OGM miracle, mais peut-être apparaîtra-t-il un jour…
Aussi, je veux affirmer – sans doute plus à titre personnel qu’au nom de mon groupe – que cette proposition de loi part d’un constat que je fais mien et pose des principes que je partage. Pour autant, elle n’est pas acceptable en l’état.
Je vous renvoie aux débats du Grenelle de l’environnement, qui n’ont pas abouti à un consensus sur ce sujet. Le groupe 5 du Grenelle a bien conclu à la nécessité de créer une haute autorité indépendante de médiation des conflits sur l’expertise et l’alerte, mais il n’y a eu consensus ni sur le rôle de cette autorité ni sur l’encadrement de l’alerte, deux points qui sont au cœur de notre débat d’aujourd'hui.
S’agissant du rôle de cette autorité, nous avons tous souligné la nécessité que cette instance ne soit pas une agence d’expertise supplémentaire qui se superposerait aux autres. Même si je sais que telle n’est pas l’intention des auteurs de la proposition de loi, une certaine confusion subsiste.
L’autre point d’interrogation porte sur l’alerte.
Fort heureusement, l’idée d’une structure nouvelle au sein des entreprises a été écartée, mais les débats en commission ont souligné la difficulté de prévenir les alertes abusives et la capacité même de cette future Haute Autorité à traiter toutes les alertes. Ce point reste obscur dans la mesure où, faute d’étude d’impact, on ignore le volume potentiel de dossiers à traiter, le nombre de personnes qui pourraient y être affectées et le montant précis de son budget.
Un autre point mérite d’être encore clarifié : la confidentialité de l’alerte. Nous en avons longuement débattu, mais le droit doit poser clairement le principe que l’alerte est donnée dans la plus stricte confidentialité et que rendre publique une alerte n’est pas le meilleur moyen d’en garantir la bonne fin.
Ces deux réserves ont interdit le consensus sur la haute autorité lors du Grenelle. Elles l’interdisent encore.
Vous comprenez donc que le choix du législateur fut à l’époque de demander un rapport au Gouvernement – le fameux article 52, déjà mentionné – afin de mieux tracer les contours de cette haute autorité. Il est effectivement regrettable que ce rapport n’ait jamais été produit parce que les questions demeurent.
Le Gouvernement a fait part de son intention de reprendre l’initiative d’un tel rapport. À cet égard, il me semblerait opportun que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques puisse, lui aussi, expertiser cette haute autorité, les conditions de la prise en compte de l’alerte. Son président, Bruno Sido, y est d’ailleurs très favorable.
Pour toutes ces raisons, et compte tenu des exigences budgétaires, mon groupe votera contre cette proposition de loi. Il a exprimé sa grande préoccupation face aux risques de dérives du droit d’alerte et du recours abusif au principe de précaution.
Pour ma part, monsieur Dantec, je ne renierai ni ce que j’ai dit, ni ce que j’ai fait voter, ni ce en quoi je crois. Néanmoins, je suis réservée sur la forme. Cette proposition de loi laisse trop de questions en suspens, même si je partage l’objectif de ses auteurs.
Nous avons besoin d’une instance qui définisse clairement les protocoles d’expertise face aux risques émergents. Les protocoles existants ne sont plus adaptés et nous ne disposons toujours pas de solutions de remplacement. Nous avons besoin d’une instance qui harmonise les exigences des comités déontologiques des différentes agences et il ne serait pas aberrant – je sais que les présidents de ces agences n’y sont pas opposés – de regrouper ces comités afin qu’ils se prononcent sur l’indépendance des expertises et, surtout, qu’ils finalisent la charte de l’expertise.
Nous avons besoin d’un encadrement du droit d’alerte. Un premier pas a été franchi avec la loi sur le médicament de décembre dernier. Nous devons encore clarifier la loi afin d’interdire les alertes médiatiques abusives. Je reprendrai la formule de Mme Blandin : « À l’émotion, nous devons préférer la raison. »
C’est un bon débat de fond qui est posé, un débat qui ne doit pas tomber sur une opposition inutile entre l’accusation de pression des lobbies, d’une part, et l’accusation d’obscurantisme, d’autre part. Nous devons approfondir cette initiative pour en clarifier les contours.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je veux d’abord remercier Marie Blandin du travail qu’elle a conduit, de son opiniâtreté à faire inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour et de sa détermination à susciter dans notre assemblée un débat sur l’expertise scientifique.
Débattre de l’expertise scientifique pourrait presque passer pour un oxymore tant les mots « expert » et « scientifique » sont souvent mis en avant justement pour clore le débat. Le rappel des nombreux cas, évoqués par les orateurs précédents, où l’expertise a été aussi défaillante qu’arrogante est fort instructif.
Par présomption, l’expertise est toujours scientifique, donc objective, et sa critique, toujours par présomption, serait idéologique, donc subjective.
Le débat en commission et les oppositions qui s’y sont manifestées se sont concentrés sur la question de la création d’une nouvelle autorité indépendante. Cet aspect formel a été l’abcès de fixation, et je regrette que le rapport ait été rejeté par la majorité UMP. Du reste, madame Jouanno, en vous écoutant à l’instant, je me disais combien il serait heureux que vous rejoigniez un jour la commission du développement durable : vous vous y trouveriez tout à fait à votre place, et nous pourrions échanger de manière fructueuse et améliorer ensemble les textes que nous examinons.
Le Conseil d’État a compté 103 autorités indépendantes. C’est effectivement beaucoup ! Il a aussi indiqué que, depuis 2007, soit durant le quinquennat précédent, leur budget avait augmenté de 15 % et leurs effectifs, de 6 %. Donc, le problème des agences ne date pas de la proposition de loi de Marie Blandin et provient plutôt d’une inflation de ces structures, particulièrement au cours des cinq dernières années.
Mais la vraie question n’est pas tant celle-là que celle de la place de l’expertise scientifique dans notre prise de décision.
Les attendus de la proposition de loi sont-ils fondés ? Le but visé est-il légitime ? À ces deux questions, nous considérons que la réponse est oui. Nous sommes, législateur comme Gouvernement, de plus en plus souvent sommés d’arbitrer des débats d’une grande technicité, débats d’ailleurs moins scientifiques que technologiques, autrement dit portant plutôt sur l’utilisation faite par l’homme et pour l’homme de la science.
Pour arbitrer conformément à l’intérêt général, nous nous tournons souvent vers des experts et nous nous demandons souvent, durant les processus de réflexion, si leur expertise est aussi indépendante qu’il est confortable de le croire.
Mme Blandin, M. le rapporteur et Mme la rapporteur pour avis ont évoqué plusieurs exemples et nous avons eu maintes fois l’occasion de découvrir que tel ou tel scientifique ou expert n’était pas sans liens tantôt avec l’industrie agroalimentaire, tantôt avec celle du pétrole, voire avec celle du tabac. La qualité d’expert scientifique n’est donc pas incompatible avec les conflits d’intérêts économiques.
Et puis les experts scientifiques ont, eux aussi, des convictions et des partis pris idéologiques ; après tout, c’est bien leur droit ! Nous connaissons ce courant de pensée selon lequel toute innovation est toujours bénéfique pour les populations et tout artifice éternellement supportable pour la planète.
Quant aux médias, qui popularisent ou dénigrent telle ou telle expertise, ils ne sont pas non plus exempts de connivences économiques et de présupposés idéologiques.
Nous voilà, législateur, Gouvernement, fort perplexes et sommés de choisir entre l’aveuglement et l’obscurantisme.
D’autres experts seraient-ils plus indépendants ? La question a été posée. Si l’on parle d’indépendance intellectuelle ou économique, nous ne pouvons en être certains. La seule façon de résoudre ce problème est d’organiser une expertise contradictoire et pluraliste, comme le prévoit la proposition de loi, et de veiller à la protection des lanceurs d’alerte.
Les lanceurs d’alerte ne sont pas des gêneurs ; ce sont des vigies que la complexité et la technicité de notre monde rendent indispensables. Ils peuvent se tromper, nous objectera-t-on ; sans doute, mais pas plus que des experts : parmi ces derniers, certains se sont trompés, rétractés et parfois disqualifiés.
Aucune procédure ou institution ne nous mettra totalement et durablement à l’abri des expertises erronées ou biaisées, mais nous pouvons organiser l’expertise pour éviter qu’une décision soit prise dans l’ignorance ou la dissimulation d’autres points de vue.
À l’issue de ce débat, nous souhaitons, à l’instar de Mme la ministre, qu’il soit pris acte de plusieurs points.
Premièrement, l’expertise scientifique souffre d’un déficit d’indépendance et de pluralisme qui peut être réduit grâce à davantage de transparence, de pluralité et de déontologie.
Deuxièmement, les lanceurs d’alerte sont utiles, et leur expertise, qui n’est pas toujours sanctionnée par des diplômes universitaires et provient de leur observation, doit pouvoir être recueillie.
Troisièmement, nous avons besoin d’un peu de temps pour ajuster et évaluer le meilleur dispositif pour atteindre les objectifs que je viens d’évoquer, et recueillir l’avis de quelques experts indépendants.
En concluant ainsi notre séance, nous n’aurons pas achevé notre travail, mais nous aurons posé les jalons d’une belle évolution au service de la démocratie et du progrès scientifique, en garantissant qu’il se forge aussi hors de la sphère des producteurs et des acteurs économiques du progrès.
J’espère que ceux de nos collègues qui n’ont trouvé dans ce texte aucun problème de fond et ont décelé seulement des inconvénients de forme seront satisfaits par les propositions qui naîtront de la concertation entre tous ceux qui y travailleront à partir de maintenant.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l’heure de la controverse qui a suivi la publication de l’étude de Gilles-Éric Séralini sur la toxicité d’un maïs OGM, la nécessité d’encadrer la déontologie de l’expertise et de protéger les lanceurs d’alerte devient indispensable.
Je me réjouis très vivement que cette proposition de loi du groupe écologiste soit la première à être discutée dans un Sénat où la gauche est majoritaire. C’est tout à la fois un symbole fort pour l’écologie politique et un élément important de la vitalité démocratique de notre institution.
En effet, cette proposition de loi écologiste constitue une belle opportunité pour valoriser le rôle du Parlement. Force est de le reconnaître, sous l’ancienne mandature, nous n’en avions pas l’habitude, mais je ne tiens pas à entamer une polémique sur ce point.

Ce texte présenté par Marie-Christine Blandin est le fruit d’un travail de réflexion et de dialogue de longue haleine. On y reconnaît la marque de fabrique des écologistes, d’abord par le souci constant d’impliquer les acteurs de la société civile concernés, mais aussi par la volonté d’associer l’ensemble des parlementaires à la coproduction de la loi afin d’aboutir au meilleur résultat possible. Cette phase de discussion au sein de nos deux commissions a été très importante et je rends hommage à M. le rapporteur, à Mme la rapporteur pour avis, ainsi qu’à M. le président de la commission pour le travail qu’ils ont effectué.
Cette confrontation, sans attaques idéologiques stériles, a permis d’engager une discussion très approfondie avec le Gouvernement, en particulier avec Delphine Batho, qui a longuement travaillé avec ses collaborateurs sur cette proposition de loi dans un grand esprit d’ouverture, tranchant avec la réticence devant les textes d’origine parlementaire qui prévalait jusque récemment sous la Ve République. Cela augure bien de la suite de notre travail.
Je tiens à remercier les parlementaires de toutes tendances politiques, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, notamment Chantal Jouanno, dont l’intervention fut, comme toujours, très argumentée, sérieuse et solide, en un mot : « écologiste » ! §Il est important, pour l’image des parlementaires, de nouer un échange réellement constructif et de trouver des points d’accords sur un tel thème.
Nous touchons là à un vrai sujet de fond. La proposition de loi que nous espérons avoir la possibilité de voter lors d’une future séance est, en fait, la transposition des préconisations contenues dans de nombreux rapports parlementaires, mais aussi la traduction de la volonté du Gouvernement pour que l’indépendance des experts soit plus sûrement garantie.
En effet, face aux pressions, menaces de licenciements et écoutes téléphoniques, les experts, hauts fonctionnaires ou salariés qui osent alerter quand tout le monde se tait sont trop souvent victimes de leur courage.
Les écologistes souhaitent créer la Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement afin qu’elle élabore des règles déontologiques propres à l’expertise scientifique, établisse des procédures d’évaluation des pratiques d’expertise, donne suite aux alertes qui lui sont soumises, assure le respect des dispositions protégeant les lanceurs d’alerte, tienne un registre des alertes consignant toutes les procédures en cours.
D’ailleurs, je le dis à celles et ceux qui, comme nous, sont attentifs à la maîtrise des finances publiques, une telle proposition, loin d’engendrer des coûts supplémentaires, permettra au contraire de faire des économies. En effet, lorsqu’il est question de santé environnementale, de sécurité de nos enfants, de respect des personnes qui nous alertent sur les risques sanitaires, il n’y a pas de coûts inutiles. C’est d’abord de la prévention : prévention des dangers, bien sûr, mais aussi prévention de dépenses futures. On oublie trop souvent que les alertes non entendues en leur temps nous coûtent aujourd’hui extrêmement cher en remboursements et indemnisations des dommages causés aux victimes.
C’est pourquoi la création d’une instance indépendante est, avant tout, une proposition de bon sens et extrêmement économe de nos deniers.
Cette proposition de loi illustre bien ce qu’est véritablement l’écologie : la responsabilité, la protection et l’écoute. Cette écologie se fait avec et pour les citoyens, dans un but commun : mieux vivre au sein d’une société durable.
Pour conclure, chers collègues de tous horizons politiques, je vous invite à prendre la mesure de l’importance de ce sujet : nous sommes face à un enjeu démocratique majeur. Samedi, j’étais à Laval avec des manifestants qui s’inquiètent des dangers possibles des lignes à très haute tension. Leurs effets supposés doivent-ils être mis à l’étude sérieusement, avec des protocoles débattus ? Tel est l’enjeu de ce débat : après des discussions, des expertises, des études partagées, on peut convaincre les populations ; avant, notre vision est parfois très technocratique et autoritaire.
Les opinions sont très partagées, mais nos concitoyens ne veulent plus entendre parler de scandales comme ceux du Mediator, du bisphénol A, des dangers des pesticides ou des risques induits par les OGM. Nous avons besoin, en France, d’une expertise indépendante, hors de tout soupçon de conflit d’intérêts.
Nous faisons confiance au Président de la République et au Gouvernement, particulièrement à vous, madame la ministre, chère Delphine Batho, pour promouvoir au sein de la majorité présidentielle les progrès nécessaires. Nous pensons apporter notre pierre à l’édifice avec cette proposition de loi, qui dépasse les clivages politiques pour servir l’intérêt commun auquel nous sommes tous très attachés. §

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.

Mes chers collègues, étant à la fois jeune parlementaire et nouveau président de groupe, j’ai cru comprendre que le temps imparti pour les espaces réservés aux groupes était de quatre heures. Nous ne voulons pas contrevenir au règlement du Sénat, mais, dans le même temps, vous l’aurez compris, nous souhaitons que, sur cette proposition de loi, le dialogue avec nos collègues et avec le Gouvernement puisse se poursuivre. Nous proposons donc de reprendre cette discussion, qui a d’ailleurs été aujourd'hui d’une grande qualité, lors d’un espace réservé à notre groupe et que cela soit précisé lors d’une prochaine conférence des présidents.

Mes chers collègues, ainsi que vient de vous l’indiquer M. Placé, la conférence des présidents avait prévu, conformément aux règles que nous nous sommes fixées, un espace réservé de quatre heures pour le groupe écologiste. En tenant compte des petites suspensions de séance qui ont eu lieu, je constate que nous sommes arrivés au terme de cet espace réservé.
À ce stade, et avec l’accord du groupe écologiste, je vous propose d’en prendre acte et de suspendre l’examen de ce texte, qui sera repris à une date ultérieure, étant entendu que, par la voix de son président, ce groupe nous a fait à l’instant savoir que tel était son souhait. La conférence des présidents pourra examiner cette question lors de sa prochaine réunion, c’est-à-dire après-demain, mercredi 17 octobre.
Assentiment.

Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe du RDSE, la discussion de la proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes (proposition n° 564 [2011-2012], texte de la commission n° 14, rapport n° 13).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, vue de Paris, notre si belle capitale, la question des biens sectionaux peut paraître aussi incongrue que celle du désenclavement de nos départements.
Et pourtant, il existe encore en France environ 27 000 sections dans plusieurs dizaines de départements, en particulier dans une dizaine où leur fonctionnement provoque de multiples litiges et de graves conflits dans beaucoup de communes. L’exaspération de nombre de maires s’explique facilement et à juste titre. Pour certains d’entre eux, c’est l’exercice même de leur mandat qui est constamment troublé.
Heureusement, il existe encore des parlementaires, des sénateurs, dont mon collègue et ami Pierre Jarlier, pour connaître et relayer les problèmes de ces nombreux collègues maires, ce qui démontre encore une fois l’utilité du cumul d’un mandat local exécutif avec un mandat parlementaire.
Cet objectif de facilitation du transfert des biens sectionaux aux communes, nous le poursuivons depuis plusieurs années. J’avais ainsi déposé et soutenu à deux reprises un amendement allant dans le même sens lors des débats sur la réforme des collectivités territoriales. J’avais retiré le premier lorsque le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix, s’était engagé à faire travailler dans les meilleurs délais une commission sur ce sujet pour proposer un texte, engagement repris par le président de la commission des lois de l’époque.
Je sais qu’un travail a été réalisé au sein de la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, et qu’il a été utile lors de la concertation ayant permis à la commission des lois d’œuvrer à son tour. Pour faire avancer le dossier, il convenait cependant de l’amener en séance publique au Sénat. C’est ce que le groupe RDSE fait aujourd’hui.
Je tiens à remercier le rapporteur, notre collègue Pierre-Yves Collombat, qui a beaucoup et bien travaillé sur un sujet qui ne concerne pas son département, ainsi que nos collègues de la commission des lois et son président, qui ont apporté leur pierre à l’édifice. Je remercie aussi de leur concours la DGCL, son directeur, et, bien sûr, notre ministre Anne-Marie Escoffier, que je salue.
Les sections de commune sont une survivance du droit d’Ancien régime, qui permettait l’utilisation des communaux par les habitants des villages. Ces biens se rattachaient alors directement à la notion féodale de « feu », que l’on retrouve encore aujourd’hui dans certaines décisions de nos tribunaux administratifs.
La notion de section de commune telle que nous la connaissons aujourd’hui a été fixée par le décret des 10 et 11 juin 1793 assignant aux sections la finalité d’un usage collectif des biens exploités. Le but était à l’époque d’assurer aux habitants modestes ou indigents des moyens de subsistance par l’exploitation directe de terres ou de forêts dont ils partageaient la jouissance.
Cette finalité historiquement datée s’est aujourd’hui totalement renversée. Les sections de commune, initialement destinées à un usage collectif, sont aujourd’hui l’enjeu de luttes entre intérêts particuliers, marquées par les égoïsmes locaux, souvent par un certain conservatisme, avec en toile de fond des querelles qui sont devenues personnelles.
La réalité est que ces différends empoisonnent la vie locale durant des années, et parfois, comme nous l’indiquent nombre d’élus municipaux, sur toute la longueur d’un mandat de maire, voire de plusieurs. J’en connais au moins un, élu depuis quatre mandats, qui a toujours affaire aux même difficultés, mettant en cause les mêmes personnes...
Le contentieux qui en résulte est aussi abondant que complexe dans la dizaine de départements particulièrement concernés par les sections. Certains tribunaux administratifs sont devenus, de fait, des spécialistes de la question, et l’un des meilleurs ouvrages sur les sections a été rédigé par un ancien président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
L’ancienneté de l’institution de la section et la complexité de son régime juridique expliquent en grande partie les difficultés rencontrées quotidiennement sur le terrain.
L’existence d’une section ne résulte pas d’une création ex nihilo, mais d’un constat de faits : elle est reconnue lorsque des habitants d’une partie déterminée de la commune possèdent des biens ou des droits à titre permanent et exclusif prouvés par un titre, souvent remontant à l’Ancien régime, par une décision de justice ou une sentence arbitrale, ou par un usage public paisible, continu et non équivoque. Le constat de cet usage est en lui-même déjà source de contentieux, étant donné leur ancienneté.
Par ailleurs, le nombre de sections et leur délimitation exacte ne sont pas connus avec précision. L’excellent rapport Lemoine de 2003 relevait qu’il existait quelque 27 000 sections, qui se concentraient principalement dans le Massif central.
L’absence courante de délimitation précise des périmètres entraîne des difficultés pour déterminer la commune de rattachement, lorsque la section n’est pas rattachée à plusieurs communes ou est à cheval sur plusieurs départements, ce qui est souvent le cas. Les cadastres sont de peu d’utilité puisqu’ils ne valent qu’en matière fiscale et ne constituent pas un titre de propriété. Il est en effet jugé de façon constante que le cadastre ne saurait faire preuve du droit de propriété.
Le nombre de sections est pourtant en diminution. De plus en plus de biens de sections ne sont plus exploités, en particulier dans les régions de chasse, et les revenus tirés des biens sont globalement en baisse.
À l’inverse, les difficultés ne disparaissent pas ; elles se sont au contraire maintenues, et se sont même multipliées dans certains cas.
Ces difficultés tiennent d’abord au mode de gestion des sections. Seules 200 commissions syndicales ont été constituées sur 27 000 sections. La répartition des compétences entre le conseil municipal et la commission est très complexe. Même en l’absence de commission syndicale, le conseil municipal n’est pas pleinement décisionnaire et doit s’en référer aux électeurs de la section. Voilà un bel exemple d’usine à gaz !
La jouissance des biens et la distribution des revenus qui en sont tirés ont été détournées de l’esprit initial de la loi, ce qui est grave. Nombre d’ayants droit considèrent les biens comme une propriété privée et n’hésitent pas à redistribuer en espèces les revenus tirés des biens, alors que la loi l’interdit ; tous ceux ici qui sont confrontés à ce type de situation le savent bien.
L’articulation entre les finances communales et les finances sectionales est inextricable. Il arrive souvent que des sections soient plus riches que leur commune de rattachement, mais qu’elles refusent d’engager leurs revenus à l’aménagement de leur territoire, préférant s’adresser à la commune pour qu’elle engage ses crédits.
Les sections sans commission syndicale sont encore plus complexes à gérer. Ainsi, l’absence de dispositions relatives à leur représentation en justice conduit à ce que la commune supporte les frais de justice lorsqu’elle engage une action contre une section, et ce y compris lorsque la commune gagne contre la section. C’est tout de même un paradoxe !
Les sections constituent, dans de nombreux cas, un frein au développement des territoires ruraux, notamment pour l’aménagement du territoire des communes. L’aspect de démocratie locale s’estompe derrière des considérations, le plus souvent, de défense d’intérêts particuliers. Le rapport Lemoine avait souligné certaines de ces contraintes.
Ainsi, pour préserver leurs revenus, les habitants des sections n’admettent que difficilement l’arrivée de nouveaux habitants, au risque dans certains cas d’empêcher, par exemple, l’installation de jeunes agriculteurs.
Les sections de communes cristallisent le morcellement des territoires et privilégient des arbitrages financiers de court terme.
Le poids d’une section peut être détourné et utilisé pour bloquer un projet municipal intéressant l’ensemble de la commune. Le cas s’est produit plusieurs fois dans des communes de montagne qui n’ont pu développer leur domaine skiable en raison de l’opposition des habitants d’une section qui se sont constitués en commission syndicale pour l’occasion.
L’expropriation d’une parcelle par des procédures de droit commun est toujours possible, mais à la condition qu’existe un projet d’intérêt général. De plus, elle doit être réalisée parcelle par parcelle.
L’exercice par le maire de ses pouvoirs de police administrative peut être limité à l’intérieur de la section.
Le législateur a tenté de simplifier et de rationaliser le régime, en 2004 et en 2005, mais ses tentatives n’ont pas eu les effets attendus. La procédure de transfert simplifié, introduite en 2004, n’est ainsi que peu utilisée.
Le débat engagé en 2010 sur notre amendement n’a pas non plus porté ses fruits.
En revanche, élément nouveau qui permet d’avancer aujourd'hui et qui est même fondamental, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 avril 2011, a clarifié la nature de la section de commune et tracé une nouvelle voie : il a jugé que les électeurs ne disposaient pas d’un véritable droit de propriété sur les biens ou droits concernés, mais d’un simple droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature.
Cette décision constitue un tournant positif dans le droit des biens sectionaux et nous met dans la bonne voie.
La réflexion sur la suppression pure et simple des sections peut être engagée, mais nous savons qu’elle ne peut déboucher, en l’état actuel, que sur un dispositif complexe, coûteux pour les communes et propice à un très abondant contentieux. Nous nous passerons donc d’un tel dispositif.
C’est dans ce cadre qu’a été rédigée la présente proposition de loi, en partant de l’idée tranchée qu’il fallait faciliter la suppression des sections au profit de la communalisation des biens et, surtout, remettre la question des biens de section au cœur du débat en vue de faciliter la vie des maires ruraux.
Il convenait de réfléchir à la création d’un nouveau dispositif de communalisation des biens permettant de s’affranchir, pour des objectifs d’intérêt général, de l’accord des commissions syndicales ou des électeurs. En l’occurrence, les motifs d’intérêt général que nous mettons en avant sont la fin des blocages et des dysfonctionnements administratifs et financiers.
Comme je l’ai indiqué, le Conseil constitutionnel a tracé le cadre dans sa décision de 2011 : aucune disposition constitutionnelle ne s’oppose au transfert gratuit de biens entre personnes publiques dès lors qu’est poursuivi un objectif d’intérêt général.
S’agissant de la garantie des droits légalement acquis, en l’espèce le droit de jouissance des ayants droit, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur ne pouvait y porter atteinte que si celle-ci était justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. C’est bien le cas ici.
À la suite du dépôt de la présente proposition de loi, nous avons bien volontiers assoupli notre position initiale en préférant, pour une fois, à une solution…radicale une solution de compromis.
Sourires.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Radicalisme et compromis ne sont pas incompatibles !
Nouveaux sourires.

J’étais sûr, monsieur le président de la commission des lois, que vous feriez cette réflexion, et vous n’avez pas tout à fait tort !
Comme l’a expliqué le rapporteur, toutes les sections ne sont pas problématiques. Dès lors, s’il est opportun de faciliter et de rationaliser le fonctionnement des sections, il faut corrélativement tout faire pour faciliter la suppression de celles qui ne fonctionnent que peu ou plus en assouplissant le régime de transfert des biens.
C’est sur la base de ce diptyque que la commission des lois a fort opportunément choisi de prolonger l’objet initial de la proposition de loi pour impulser une modernisation de l’ensemble du régime des biens de section.
L’intégration de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour définir la section et ses membres est pertinente. La section est une personne morale de droit public, qui s’acquitte à ce titre des impôts fonciers. Quant aux membres de la section, ce sont les personnes qui ont leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section, disposition qui simplifiera l’actuelle différenciation entre électeurs et ayants droit.
Cette clarification permettra, par exemple, de faciliter le transfert aux communes des biens des sections dans lesquelles les impôts sont payés depuis des années sur le budget communal ou même admis en non-valeur. En effet, dans la pratique, le juge administratif exige que la commune apporte la preuve qu’elle a bien émis pendant au moins cinq ans – six ans dans les faits – un rôle de répartition des impôts fonciers à destination des ayants droit, et non de la section. Or les biens ne sont pas la propriété des ayants droit.
Dans le même registre, nous considérons que plusieurs dispositions vont dans le bon sens : le règlement de la question récurrente de la représentation en justice des sections dépourvues de commission – il reviendra au maire d’agir, sauf en cas d’intérêts concurrents ; l’assouplissement de la procédure de transfert simplifié des biens à la commune, procédure qu’il est possible de mettre en œuvre quand une section n’a plus de membre ; l’affirmation expresse du principe de l’interdiction de la distribution de revenus en espèces entre membres de la section ; l’affirmation expresse du principe de l’interdiction du partage des biens entre membres ; la clarification de la règle selon laquelle les revenus issus de la vente des biens ne peuvent être utilisés que dans le seul intérêt de la section, avec un tempérament, à savoir la possibilité pour la commune de financer certaines dépenses communales sur le budget sectional, sous réserve que les besoins de la section aient été satisfaits, disposition judicieuse qui résulte d’un amendement de M. Jarlier et qui facilitera le règlement de ces questions.
Il est donc parfaitement logique que la commission ait choisi de définitivement interdire la constitution de nouvelles sections.
La diminution progressive du nombre des sections simplifiera la vie quotidienne de milliers de maires : ces élus de la République ont suffisamment à faire pour ne pas avoir à être confrontés à des litiges fondés sur des dispositions qui se rattachent à une histoire et à un passé certes intéressants, mais qui appellent aujourd'hui la véritable modernisation proposée dans le texte de la commission. Nous souhaitons donc que celui-ci soit adopté.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et de l'UMP.

Institution peu connue et pour beaucoup mystérieuse, la section de commune s’enracine, comme l’a rappelé Jacques Mézard, dans les droits ancestraux des villageois sur les « communaux ».
Nécessaires à la survie des plus pauvres, ces communaux ont fait l’objet non seulement d’âpres disputes entre seigneurs et villageois, mais aussi de critiques sévères de la part des « réformateurs » des Lumières, qui y voyaient une forme dépassée de mise en valeur de la terre. C’est par le partage des communaux que ces derniers entendaient régler le problème, et il est significatif que le décret des 10 et 11 juin 1793 de la Convention, qui signe l’entrée des « communaux » –institution aussi ancienne que contestée – dans la modernité, soit appelé « décret de partage ».
Âpres débats auxquels fait écho le célèbre passage du Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes de Rousseau : « Le premier qui, ayant enclos un terrain s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreur n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne. »

Patrimoine collectif, et non propriété privée indivise comme on l’interprète trop souvent, la section de commune confère à ses habitants uniquement un droit de jouissance sur les biens communs. On ne saurait donc la réduire au statut de survivance anachronique dont le destin serait de disparaître, oubliant ainsi son originalité.
Ce n’est pas, en tout cas, la position de la commission des lois, qui entend bien laisser vivre les sections de commune encore vivantes et qui fonctionnent selon leur logique originelle, ce qui ne va pas de soi.
Jusqu’à la loi municipale du 5 avril 1884, qui consacre définitivement les sections de commune en fixant les conditions d’élection des commissions syndicales, la distinction est d’ailleurs flottante entre « biens communaux » et « biens sectionaux ». Le code civil, par exemple, ne la fait pas dans sa version de 1804.
Surtout, par un de ces retournements dont l’histoire a le secret, nombre d’ayants droit vont donner aux biens sectionaux un sens inverse de leur sens originel : non plus un patrimoine collectif, mais une propriété privée, certes indivise, mais privée, dont ils peuvent se partager les revenus, y compris pécuniaires, ce qui est parfaitement illégal.
Il en est résulté de nombreux conflits, opposant les ayants droit sectionnaires et les municipalités auxquelles se rattachent les sections qu’elles gèrent, directement ou concurremment, avec une commission syndicale, opposant aussi intérêts particuliers et intérêt général. Bref, de la chicane picrocholine ou personnelle au cas des petites communes pauvres gestionnaires de sections riches dont les revenus sont redistribués illégalement entre les membres ou ne peuvent être intégralement réinvestis – les besoins des sections sont souvent relativement limités –, les situations auxquelles on assiste sont abracadabrantesques.
Les sections de commune se concentrant en plus grand nombre sur une poignée de départements, du Massif central en particulier, l’importance du contentieux varie, évidemment, selon les lieux. Constatons en tout cas que le seul tribunal administratif de Clermont-Ferrand traite annuellement de quarante à cinquante affaires de sections de commune, ce qui n’est tout de même pas rien.
Cette réalité a conduit le législateur – particulièrement le Sénat – à retoucher à plusieurs reprises le régime juridique des sections de commune, espérant le rationaliser mais, constatons-le, aboutissant plutôt à le complexifier. Comme en témoigne une surabondante jurisprudence, rien qui ne puisse être objet de chicane !
Comme le partage avant 1884, le transfert des biens sectionaux aux communes est longtemps apparu comme l’unique moyen de sortir réellement de l’imbroglio. C’est cependant une solution difficile à mettre en œuvre. Surtout, elle était souvent hors de portée financière des communes tant que ce transfert était assimilé plus ou moins clairement à une expropriation, ce qu’il n’est absolument pas.
Heureusement, par sa décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a « remis les pendules à l’heure ».
« Une section de commune est une personne morale de droit public », a-t-il ainsi statué, précisant par ailleurs que « les membres de la section ont [...] la jouissance de ceux des biens des sections dont les fruits sont perçus en nature ; […] ainsi, ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou droits » et que « le droit au respect des biens [...] ne s’oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un motif d’intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques ».
Autrement dit, le seul droit des membres de la section en cas de transfert des biens de la section peut porter sur l’indemnisation, non pas de la propriété, mais de la perte d’usufruit, ce qui est tout différent.
C’est cette voie qu’a empruntée Jacques Mézard pour élaborer sa proposition de loi et que la commission des lois a suivie à sa suite.
Prolongeant la proposition de loi, elle a voulu saisir cette occasion pour tirer toutes les conséquences de la décision rendue le 8 avril 2011 par le Conseil constitutionnel, pour rappeler ce que sont les sections de commune et pour clarifier le cadre juridique les régissant.
L’esprit du texte est de simplifier la gestion des sections de commune quand elles sont vivantes et authentiques, notamment en améliorant l’articulation entre communes et sections, mais de « faciliter le transfert des bien sectionaux aux communes » – pour reprendre le titre de la proposition de loi – lorsque les sections dépérissent, qu’il y a des conflits ou pour des motifs d’intérêt général.
Cet objet initial de la proposition de loi figure dans les articles 4 et 4 bis nouveau, de même que dans les articles 2, 3 et 5 du texte de la commission.
Pour le reste, ce dernier comprend trois types d’articles.
Certains, tout d’abord, sont essentiellement rédactionnels : ils suppriment des redondances, unifient la terminologie, etc. En un mot, ils clarifient des dispositions particulièrement obscures du code général des collectivités territoriales. Je ne les énumère pas…
Quatre articles rendent ensuite plus lisibles les conditions d’attribution des terres à vocation agricole ou forestière ou intègrent leurs nouvelles formes juridiques d’exploitation. Ils sont pour la plupart issus d’une proposition de loi dont Pierre Jarlier était le premier signataire.
Enfin, certains articles, que je qualifierais de « substantiels », procèdent, sans changer l’état du droit et de la jurisprudence, à un « décapage » qui mérite quelques explications.
Je précise au préalable que l’article 1er, qui prévoyait un inventaire préliminaire des sections de commune, a été supprimé, avec l’accord de l’auteur de la proposition de loi et de la Direction générale des collectivités locales, et ce pour deux raisons. D’une part, la commission doute que les services préfectoraux aient les moyens matériels et humains de mener à bien une opération aussi complexe. D’autre part – et c’est une raison de fond –, elle a préféré éviter de multiplier les difficultés en inscrivant d’emblée dans la loi la délimitation d’une section de commune, alors même qu’a déjà été introduite une détermination de ses membres. Lorsqu’un maire voudra mettre un peu d’ordre et clarifier la situation, si des conflits surgissent, le tribunal administratif tranchera.
Parmi les dispositions substantielles, les articles 1er bis nouveau et 1er quater nouveau sont essentiels. Suivant la décision du Conseil constitutionnel, ils précisent que la section de commune est une personne morale de droit public. Ils unifient quatre notions qui ne se recouvrent pas exactement, ce qui est source d’extraordinaires complications et parfois d’absurdités : les notions d’habitant, d’électeur à la commission syndicale, d’éligible à la commission syndicale et d’ayant droit. Exemple d’absurdité : les membres de la commission syndicale ne sont pas obligatoirement des ayants droit.
Nous sommes partis du principe que l’origine des biens sectionaux tenait au fait qu’ils étaient indispensables à la vie, voire à la survie, d’une collectivité paysanne, et que ce qui se rapprochait le plus aujourd'hui de la collectivité originelle, c’était l’ensemble des habitants de la section. Nous avons posé que les membres de la section de commune, les ayants droit à l’usage de ses biens et ceux qui pouvaient être habilités à les gérer quand le conseil municipal ne s’en chargeait pas, ceux qui avaient la capacité de les désigner et de donner leur avis en l’absence de commission syndicale étaient les « habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire », ainsi que le précise l’alinéa 3 de l'article 1er bis nouveau.
Ce faisant, la commission a souhaité revenir à l’esprit de la section de commune : non pas des propriétaires indivis, mais des biens nécessaires à la vie d’une collectivité. Or ce qui aujourd'hui se rapproche le plus de la collectivité ancienne, ce sont encore les habitants.
La commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’aller plus avant et de définir la notion d’« habitant ayant leur domicile réel et fixe ». Celle-ci existe déjà dans la législation actuelle et est connue de la jurisprudence. Si des problèmes se font jour, la jurisprudence les réglera, comme elle le fait déjà actuellement.
Lier la qualité de membre de la section à la résidence a le mérite de la clarté et permet de revenir aux fondamentaux : à l’origine, les biens sectionaux étaient nécessaires à la vie d’une collectivité et, Jacques Mézard l’a rappelé, leur usage était réservé aux « feux », c'est-à-dire à ceux dont la cheminée fumante attestait qu’ils vivaient là.
Notons aussi que le droit actuel ne définit pas l’ayant droit indépendamment de la qualité de membre de la section : il n’a pas pris ce risque !
Sourires.

Ce droit de jouissance, aux termes de la loi et comme l’atteste la pratique notariale, n’est ni cessible ni transmissible, à la différence d’un droit patrimonial classique. Il ne peut pas être cédé définitivement ou temporairement – on ne peut, par exemple, donner son droit de jouissance pendant que l’on part en vacances ! Par conséquent, en matière de biens sectionaux, on ne peut parler de droit patrimonial acquis : il s’agit d’un droit lié à l’appartenance à une collectivité. Le fait que la Cour européenne des droits de l’homme puisse qualifier ce droit de jouissance de « bien », ce qu’il est effectivement et que nous ne contestons pas, est sans influence sur la qualification qui lui est donnée en droit interne. Ce point me paraît essentiel.
Les articles 4 sexies nouveau et 4 septies nouveau sont tout aussi importants, mais je les décrirai plus rapidement.
L'article 4 sexies permet de sortir de l’impasse née du refus d’un conseil municipal de voter le budget proposé par une section. Dans le vide des textes et en l’état de la jurisprudence, il ne peut que l’accepter ou le refuser. Nous proposons qu’il puisse modifier ce projet de budget.
L'article 4 septies autorise, une fois les besoins de la section satisfaits, et non ceux de ses membres – c’est interdit –, l’affectation du surplus de revenus au financement d’opérations d’intérêt général, au bénéfice non exclusif de la section.
Jacques Mézard l’a souligné : cette disposition met un terme à un objet de scandale pour les élus et les habitants de communes pauvres sur le territoire desquelles prospèrent des sections riches, qui, faute de pouvoir répartir leurs excédents entre membres sous forme pécuniaire, doivent les laisser dormir dans les comptes, alors que la commune doit emprunter pour investir. Si, en plus, un conflit oppose le maire et la section de commune, la situation devient intenable.
Ce pouvoir du conseil municipal est cependant strictement encadré. Seul le surplus budgétaire de la section de commune peut être utilisé, les besoins de la section devant d’abord être satisfaits. Par ailleurs, seules des dépenses pour la réalisation de travaux d’investissement ou d’entretien pourront être ainsi financées : les dépenses de personnel sont donc exclues, pour ne prendre que cet exemple. Enfin, le conseil municipal devra motiver sa délibération.
Quelle que soit notre volonté de conserver les sections de commune bien vivantes, nous proposons qu’il ne puisse plus en être créé d’autres. Je ne m’y attarde pas. Lorsque des communes prennent la décision de fusionner, aux termes des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales, c’est qu’elles entendent constituer une seule commune. Or, maintenant que le développement de l’intercommunalité offre des modalités d’associations très fines, laisser se créer de nouvelles sections de commune, c’est aller au-devant de difficultés inutiles !
Mes chers collègues, telles sont les propositions que la commission des lois vous soumet. Elle a poursuivi un double objectif. D’une part, il s’agit de faciliter et de pacifier les relations trop souvent conflictuelles entre les communes, leurs conseils municipaux et les sections de commune. D’autre part, lorsque ces sections se contentent de survivre ou constituent, à l’évidence, un obstacle au développement communal, il convient de donner les moyens aux conseils municipaux qui le souhaitent – j’insiste sur ce point – d’en sortir, au terme d’une procédure strictement encadrée et respectueuse des droits de chacun.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur Mézard, mesdames, messieurs les sénateurs, « on n’hérite pas de ses parents, on emprunte à ses enfants ». Il est des moments où cette phrase de Saint-Exupéry, si juste dans notre société d’aujourd'hui confrontée à l’instantanéité et au tout urgent, a quelque chose de paradoxal au regard de ce dispositif particulier que sont les biens de section.
Je ne reviendrai pas sur l’histoire de cette survivance, héritée d’un temps où les seigneurs concédaient gratuitement à la communauté des habitants des biens, sous réserve de percevoir une partie du revenu qui en était tiré. Les orateurs qui m’ont précédée ont repris l’évolution de cet avatar, mieux que je ne pourrais le faire. Il n’est qu’à lire l’excellent rapport de Pierre-Yves Collombat, qui nous a transportés de l’époque médiévale jusqu’à nos jours, en nous faisant traverser les différents épisodes juridiques qui ont accompagné cette évolution.
Comment alors ne pas remercier les auteurs de cette proposition de loi et ceux qui, comme eux, s’étaient intéressés à cette situation, d’avoir voulu trouver des solutions de bon sens à des problèmes souvent inextricables ?
Mes remerciements s’adressent en particulier à Jacques Mézard, à qui je sais gré d’avoir cent fois sur le métier remis son ouvrage et de l’avoir déposé, dans une forme presque parfaite, sur le bureau de la commission des lois. L’expérience qui est la vôtre, monsieur le sénateur, dans ce domaine aussi, justifie à elle seule que vous vous soyez saisi de cet épineux problème. Le département du Cantal compte à lui seul 2 227 biens de section, sur un total de 26 792, selon le recensement de 1999, soit presque un dixième de tous les biens sectionaux concentrés majoritairement dans quelques départements : la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Aveyron, la Creuse, la Lozère et le Lot.
Rien d’étonnant non plus à ce que les parlementaires et les élus de ces départements soient particulièrement sensibles aux problèmes soulevés.
Les problèmes sont nombreux. Ils concernent prioritairement les élus locaux, les communes, les conseils municipaux et ceux que l’on nomme jusqu’à présent les ayants droit – lorsqu’il y en a encore – et qui viennent directement impacter l’aménagement et le développement de l’espace rural. Cadre juridique complexe, imbroglio sans fin en matière de transfert des biens au profit des communes : autant de raisons qui rendaient souhaitable une révision législative.
La décision récente du Conseil constitutionnel que vous avez relevée, messieurs Mézard et Collombat, a été l’élément déterminant pour provoquer la nouvelle réflexion devenue aujourd'hui proposition de loi. « Tournant décisif », avez-vous dit à juste titre à son propos. En effet, aujourd'hui, les membres de la section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens et droits de la section. Le droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789 ne s’oppose pas à ce que le législateur, se fixant un objectif d’intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques. Le transfert à titre gratuit des biens de section n’est autorisé que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants.
Aussi la proposition de loi entend-elle permettre le transfert de biens sectionaux aux communes, soit la communalisation de ces biens, avec une indemnisation des ayants droit pour la perte de jouissance sur les biens concernés.
Actuellement, des dispositions de communalisation existent et permettent d’ores et déjà d’organiser ce transfert, sur demande du conseil municipal et de la commission syndicale ou, si la commission syndicale n’existe pas, sur demande du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. Les ayants droit reçoivent une indemnité dès lors qu’ils en font la demande. On mesure la difficulté du dispositif, qui prévoit également la possibilité pour la commune d’obtenir le transfert des biens d’une section sans indemnisation des ayants droit lorsque les habitants de la section ne manifestent plus d’intérêt pour le fonctionnement de celle-ci. Or il existe aujourd'hui des ayants droit dont on ignore l’identité.
La présente proposition de loi permet de résoudre, ou du moins d’atténuer l’ensemble de ces problèmes.
Je ne manquerai pas de relever que, durant la précédente législature, M. Jarlier, sénateur du Cantal, avait également déposé une proposition de loi visant à assouplir la gestion des biens sectionaux. Cette proposition de loi visait essentiellement à renforcer les prérogatives des maires et de la commune en la matière. Elle prévoyait notamment d’accorder à la commune un droit d’initiative pour lancer une procédure de délimitation de la section, de renforcer les possibilités pour le conseil municipal de procéder à la vente des biens de section, et d’instaurer une procédure allégée pour communaliser les biens.
Je veux également souligner que plusieurs propositions d’évolution du régime juridique des biens de section ont été élaborées par un groupe de travail composé de représentants du ministère de l’intérieur, des préfectures de six départements – Aveyron, Cantal, Haute-Loire, Lozère, Puy-de-Dôme et Tarn –, du ministère de l’agriculture et de l’Office national des forêts, avec la collaboration d’un conseiller d’État. Le groupe de travail a émis plusieurs propositions, fondées notamment sur le rapport, déjà évoqué, qu’a remis M. Lemoine, inspecteur général de l’administration, en 2003, sur les travaux de l’association des maires du Cantal et sur l’expérience des préfectures concernées. Ces propositions visaient essentiellement à équilibrer les prérogatives entre les différentes autorités compétentes, en favorisant notamment la création d’une commission ad hoc pour gérer la section ou en confiant au préfet le soin de faciliter la communalisation dans un but d’intérêt général.
La proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui est la synthèse de ces différents travaux, auxquels votre commission des lois a souhaité ajouter des éléments de modernisation, de rationalisation et de simplification du fonctionnement des sections de commune. La nouvelle définition de la section de commune, entendue comme une personne morale de droit public jouissant du droit de propriété des biens, opère une clarification, comme M. le rapporteur l’a expliqué. Il en va de même de la suppression de la distinction, difficile à établir, entre électeurs et ayants droit, au profit de la seule notion de membres de la section, qui désigne « les habitants ayant leur domicile réel et fixe » sur le territoire de la section.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des autres dispositions, que nous évoquerons au cours du débat. Je n’ignore pas le travail fin accompli par la commission des lois sur ces sujets.
Je salue le résultat équilibré de toutes ces réflexions. Cette proposition de loi doit permettre, demain, le transfert de biens sectionaux aux communes par la communalisation de ces biens, dans un objectif d’intérêt général, avec une indemnisation des ayants droit pour la perte de jouissance des biens concernés, tout en renforçant les garanties encadrant ce transfert. S’y ajoute l’interdiction de la création de nouvelles sections de commune – comme cela a déjà été souligné, il s’agit d’un point important.
Je ne peux que formuler un vœu : que cette proposition de loi apporte les meilleures réponses à tous ceux, élus ou ayants droit, qui ont été confrontés à des procédures complexes ayant entravé le développement de leurs territoires. Je forme le vœu que, loin de cet abracadabra évoqué par M. le rapporteur, les biens de section deviennent un jour la section dorée, celle qui s’apparente au Beau, à l’harmonie, à la divine proportion.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, le législateur s’y est repris à plusieurs fois pour tenter de rationaliser le régime juridique des sections de commune, de faciliter la gestion de ces biens et de favoriser leur transfert vers le patrimoine communal. Il fallait ces quelques interventions pour dénouer ce régime complexe et ainsi répondre au souhait des élus locaux.
La proposition de loi de notre collègue Jacques Mézard, qui vise à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes, poursuit le même objectif de rationalisation et de simplification, dans un souci d’intérêt général. La commission des lois a poursuivi ce travail en intégrant diverses dispositions susceptibles de faciliter la gestion des biens sectionaux, tout en prenant soin de distinguer les cas où les sections de commune s’apparentent à des coquilles vides, inutiles, et ceux où elles sont un facteur de dynamisation de la gestion de ces biens.
Nous approuvons ce travail réfléchi, car il était important de distinguer ces situations et de recadrer un système qui – cela a été rappelé – a été progressivement dévoyé. Avec le temps, en effet, de nombreux ayants droit ont donné aux biens sectionaux un sens inverse de leur sens premier. À l’origine, les sections de commune représentaient des moyens de subsistance pour des personnes ne pouvant être propriétaires. Toutefois, petit à petit, la situation a évolué : comme l’a souligné M. le rapporteur, une part importante de ces biens ont cessé d’être des patrimoines collectifs pour devenir des patrimoines privés dont les ayants droit peuvent se partager les revenus.
Les biens sectionaux sont des propriétés publiques, même si la quasi-totalité d’entre eux relèvent du domaine privé de la section de commune. Cet état de fait nourrit de nombreux conflits opposant les ayants droit et les communes, soit des intérêts particuliers à l’intérêt général. La jurisprudence, abondante et ancienne, ne suffisait plus à dénouer ces situations, d’autant que cette jurisprudence – ce point est mentionné à juste titre dans le rapport – s’entremêle avec des dispositions législatives mal coordonnées. Ces conflits récurrents entraînent des blocages et des dysfonctionnements administratifs qui entravent la vie communale. Pire encore, ils créent des inégalités entre habitants d’une même commune.
Il fallait donc agir. C’est ce qu’a fait notre collègue en déposant cette proposition de loi, que nous voterons pour toutes les raisons que je viens d’exposer.
Néanmoins, nous regrettons la suppression de l’article 1er par la commission. Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier cette suppression, notamment la difficulté pour l’État d’honorer l’engagement que prévoyait cet article, compte tenu des conséquences de la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Nous faisons donc encore une fois les frais du désengagement de l’État. L’article 1er confiait aux préfets la responsabilité d’établir dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi, après enquête publique, l’inventaire des sections de commune et de leurs biens, droits et obligations.
Un tel inventaire serait utile aux élus, qui, pour pouvoir décider des transferts, ont besoin de savoir exactement ce qu’il en est sur leur territoire communal. De nombreux maires nous interpellent encore aujourd'hui à ce sujet, et nous disent que cet article 1er était important pour eux. C’est pourquoi nous vous proposerons tout à l’heure un amendement visant à le rétablir partiellement. C’est le rôle de l’État d’assurer l’égalité entre toutes les communes sur l’ensemble de notre territoire, et de les accompagner dans leurs démarches, quels que soient leur taille, leurs moyens et leurs services.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question des biens de section est enfin soumise au Sénat : un texte spécifique leur est dédié. C’est une excellente chose, car les élus locaux de plus de 2 500 communes de notre pays concernés par ce droit, qui a résisté à la Révolution française, attendent une modification de la législation avec une certaine impatience.
En effet, on ne compte plus les situations de blocage, les conflits liés au mode d’attribution comme au mode de gestion actuel de ces biens, ou encore les contentieux résultant de l’application d’un droit d’un autre temps et d’une complexité rare sur laquelle même les meilleurs juristes s’interrogent.
L’initiative de notre collègue Jacques Mézard, élu du Cantal, et des membres du groupe RDSE est donc la bienvenue, d’autant qu’elle rejoint la démarche que j’ai engagée avec quinze collègues, dont treize sénateurs appartenant à l’Union centriste et républicaine, qui nous avait conduits à déposer, l’an dernier sur le bureau du Sénat, la proposition de loi relative à la clarification et à l’assouplissement de la gestion des biens sectionaux.
Ce texte déposé l’an dernier est le fruit d’un travail collectif de deux ans mené en collaboration avec les maires d’un département particulièrement touché par le sujet – je veux parler du Cantal, dont 235 communes sur 260 sont concernées par les biens de section – qui nous ont fait part de leur expérience, des représentants des communes forestières, de la chambre d’agriculture et des services de l’État. Cette concertation nous a permis de rédiger un texte dont les quatorze articles visent aussi à faciliter la gestion quotidienne des sections.
Les auteurs de la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui se sont largement appuyés sur cet important travail, ce dont je tiens à les remercier.
À cet égard, la convergence de nos travaux est révélatrice des préoccupations fortes des élus : à l’heure où nous évoquons l’intercommunalité et les métropoles dans cet hémicycle, sur le terrain, les maires sont confrontés à des blocages importants nés d’un régime ancestral issu du droit féodal. Il est donc temps d’évoluer dans ce domaine.
Comme Jacques Mézard précédemment, je vais citer l’inspecteur général Lemoine, qui a parfaitement résumé la situation dans son rapport de 2003 : « Ces sections de commune, dont la vie démocratique est des plus réduites, obéissent à un régime juridique suranné. Elles sont à la fois une source de contraintes pour les maires, qui en réclament la suppression, et un frein à l’aménagement et au développement de l’espace rural. Tout en n’étant plus des outils de subsistance, elles constituent néanmoins un enjeu particulièrement sensible dès lors que les ayants droit en tirent […] quelques revenus ou avantages ».
Autrement dit, ces biens à usage collectif sont parfois considérés par certains ayants droit comme des propriétés privées sources de revenus personnels. Et il s’agit bien là de l’un des problèmes majeurs. Je peux vous assurer que la gestion des biens sectionaux s’avère autrement plus difficile dans le cas, par exemple, d’un terrain accueillant des éoliennes ou planté d’une forêt que dans celui d’un terrain nu, pentu et inculte.
Comme l’a très justement souligné M. le rapporteur, considérer comme privés des biens à usage collectif constitue un dévoiement complet de l’esprit et de la vocation originels de la section.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2011, a opportunément rappelé aux ayants droit qu’ils bénéficient non pas d’un droit de propriété, mais seulement d’un droit de jouissance.
Malgré cette récente clarification, la gestion des biens sectionaux constitue toujours un vrai « casse-tête » pour les maires et peut parfois remettre en cause le potentiel de développement de leur commune, voire parfois leur mandat même.
Aussi manque-t-il maintenant un dispositif législatif clair qui s’appuie sur la décision du Conseil constitutionnel et qui pourrait donner plus de marge de manœuvre aux communes et faciliter leur intervention, tout en respectant, bien entendu, les intérêts de la section et de ses ayants droit.
C’est le sens de la présente proposition de loi enrichie par plusieurs amendements que nous avons déposés et que la commission a bien voulu retenir.
Je relève d’ailleurs que sur les cinq articles de la proposition de loi initiale de notre collègue Jacques Mézard, trois correspondent à l’esprit des dispositions que j’ai proposées avec plusieurs de mes collègues. Nous sommes donc parfaitement en phase sur ce sujet, qui dépasse largement les clivages partisans.
Madame la ministre, mes chers collègues, vous comprendrez aisément que les membres du groupe de l’Union centriste et républicaine soutiennent la démarche de leurs amis radicaux.
Je souhaite maintenant revenir un instant sur le contenu du présent texte.
Pour ce qui concerne la clarification du régime juridique, le texte de la commission apporte des précisions qui permettront de limiter les contentieux. Il procède à d’utiles rappels, parmi lesquels l’exclusion de tout revenu en espèces au bénéfice des ayants droit. En effet, la distribution entre ayants droit des revenus tirés de la coupe de bois, par exemple, est une pratique courante, alors même qu’elle est prohibée implicitement par la loi et expressément par la jurisprudence. Ce point, qui était d’ailleurs rappelé dans notre proposition de loi, est essentiel à la transparence de la gestion des biens de section.
Quant à la rationalisation du régime des biens sectionaux, je souhaite attirer votre attention, mes chers collègues, sur deux articles introduits par la commission qui devraient permettre de lever des obstacles majeurs auxquels sont confrontés certains maires pour réaliser des investissements structurants.
Des dispositions semblables figuraient aussi dans notre proposition de loi. J’avais particulièrement insisté sur ces points lors de mon audition par M. le rapporteur, tant ils me paraissent extrêmement importants.
Il s’agit, d’abord, de la possibilité pour le maire de représenter les intérêts de la section devant le juge en l’absence de commission syndicale, puis de la faculté pour la commune de financer certaines dépenses communales sur le budget de la section si les besoins de celle-ci sont satisfaits. Cette disposition est fondamentale : aujourd’hui, l’argent de la section ne peut être utilisé que dans l’intérêt exclusif de celle-ci. Or ce régime conduit à des situations aberrantes.
À titre d’illustration, je prendrai l’exemple d’une petite commune, dont je tairai le nom, qui souhaite réaliser un lourd investissement. Mais faute de financements suffisants, la réalisation du projet est remise en cause. Tel est le quotidien de nombre de petites communes, me direz-vous. Toutefois, il faut savoir que, parallèlement, la section située sur le territoire communal et sur les terres de laquelle sont implantées des éoliennes dispose d’un budget excédentaire et n’utilise pas les sommes importantes qui lui sont reversées chaque année. L’argent « dort » donc sur un compte... Certes, le Trésor public est ravi ! Mais où est le bon sens ?
S’agissant du transfert des biens sectionaux « au libre choix de la commune », cette procédure, qui s’accompagne de garanties au bénéfice des membres de la section, répond pleinement aux attentes des élus. En effet, il arrive souvent que, faute d’être levés, les blocages avec les ayants droit empêchent la réalisation de projets structurants. À titre d’exemple, je citerai le cas d’une commune qui souffre d’un problème technique : un seul emplacement a été identifié pour l’implantation de sa future station d’épuration. Or le terrain est un bien sectionnaire et les ayants droit refusent tout transfert à la commune. De surcroît, la commune ne peut pas non plus utiliser les ressources de la section pour cet investissement alors que les ayants droit sont susceptibles de bénéficier du service. Vous le constatez, mes chers collègues, le régime actuel aboutit parfois à des situations ubuesques...
Enfin, pour ce qui concerne les modalités d’attribution des terres à vocation agricole et pastorale, sur ce point aussi le rapporteur a bien voulu reprendre un amendement que mes collègues et moi-même avons déposé. Cette disposition, élaborée en lien avec la chambre d’agriculture du Cantal, est extrêmement importante pour nos agriculteurs.
Le régime actuel d’attribution suscite de nombreuses situations conflictuelles, car, vous le savez, les biens sectionnaires sont souvent situés en zones de montagne, secteurs dans lesquels les primes à l’hectare sont très convoitées et, par voie de conséquence, les biens de section.
En conclusion, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes satisfaits du travail de coproduction efficace qui a été réalisé avec Jacques Mézard, l’un des auteurs de la présente proposition de loi, le rapporteur et les services de la commission, que j’ai eu plaisir à retrouver et dont j’apprécie toujours l’excellence. À cet égard, je tiens à vous remercier, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, ainsi que vos administrateurs, d’avoir prêté une oreille attentive à ce sujet délicat et à nos propositions. Je veux saluer ce travail de qualité.
Les biens de section donnent lieu à des rendez-vous législatifs fort rares. Celui de ce jour, très attendu, est une occasion précieuse pour faire évoluer le dispositif et améliorer le quotidien des maires ruraux, quelle que soit leur sensibilité. Ces derniers comptent sur la solidarité du Sénat.
Applaudissements sur les travées de l'UCR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente.
Applaudissements.

J'indique donc tout de suite que nous approuvons cette proposition de loi et essaierons d'aider nos collègues à la faire aboutir.
Je ne reviendrai pas sur les antécédents historiques de ce régime, malgré leur intérêt. Je souhaite commencer mon intervention en évoquant la divergence, pour ne pas dire le conflit d'intérêts intrinsèque qui existe entre la section et la commune.
Telle est l'origine de la situation à laquelle nous sommes confrontés : la section est structurée pour gérer des intérêts distincts de ceux de la commune, et généralement à l'intérieur du territoire de cette dernière. Il s'agit d'une réelle difficulté, comme l'ont souligné tout à fait justement plusieurs collègues quand ils ont évoqué les raisons pour lesquelles la section avait été, sinon instaurée, en tout cas consacrée.
Il y a un fait historique qui, me semble-t-il, n'a pas encore été rappelé ce soir et que je voudrais souligner : il s'agit de la loi de 1884, qui a organisé la commune républicaine et consacré l'existence de la section comme une particularité à l'intérieur de la commune.

L'évolution de ces dernières décennies est donc double : d'une part, on note une tendance, que le rapporteur a bien décrite, à une certaine privatisation, en tout cas à un esprit d'appropriation privative des biens de la section ; d'autre part, il existe une contradiction entre l'existence des sections, qui sont tout de même des unités géographiques toutes petites et qui n'ont pas nécessairement de stratégie de long terme, avec les nécessités de l'aménagement rural et de la gestion modernisée du territoire.
Au fond, si j'ai bien compris cette proposition de loi, je la résumerai en disant qu'elle introduit trois objectifs distincts dans notre droit : favoriser la gestion au nom de la section, mais par les organes de la commune, le maire et le conseil municipal ; faire obstacle à la captation de ressources par la section et ses ayants droit, au détriment de la commune ; encourager la reprise de la propriété des biens de section par la commune, auquel cas les biens entrent dans le domaine privé de la commune, sans changer l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent.
Sur le premier point, ce texte marque sans doute un progrès, mais, comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, il me semble que c'est un progrès partiel, dans la mesure où les différences d'intérêt subsistent. La gestion est donc conduite par la municipalité, mais pour le compte de la section, y compris si les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune. À cet égard, j'ai eu connaissance d'un arrêt récent du Conseil d'État faisant apparaître que si une erreur lésant des tiers est commise par le conseil municipal dans la gestion des biens de la section, c'est cette dernière qui encourt la responsabilité, ce qui peut d'ailleurs donner lieu à des actions récursoires intéressantes.
À mon sens, les mesures tendant à faciliter la reprise de la gestion par les autorités municipales, ce qui est déjà le cas pour la grande majorité des sections, représentent un progrès. La proposition de loi tend donc à prévoir, de façon judicieuse, les moyens adéquats pour atteindre cet objectif en réservant le recours à une commission syndicale aux cas où la section présente une réalité humaine et économique palpable, ce qui explique le nouveau seuil de vingt membres et le niveau d'activité économique supérieur à 2 000 euros. Dans les autres cas, c'est la commune qui gérera.
Je voudrais toutefois appeler l'attention du Sénat sur un autre point, la question clé de la qualité d'ayant droit sur les droits sectionaux.
La propriété n'est pas douteuse, c'est la personne publique de la section. Encore que celle-ci représente un territoire global et pas simplement un ensemble de biens, ce qui fait qu'il y a des biens privés sur le territoire de la section. C'est même la condition pour l'application de la nouvelle définition de la qualité de membre : en effet, s'il faut être résident à l'intérieur de la section, c'est donc qu'il peut y avoir des biens privés qui ne sont pas des biens sectionaux. Toujours est-il, donc, que la propriété ne fait pas de doute, c'est la personne publique de la section. Il s'agit d'ailleurs de son domaine privé et elle en a la pleine propriété, au sens du code civil.
En revanche, les droits de jouissance, eux, ont un caractère privatif et ils sont assez imprécisément définis. Leur définition varie même d'une section à l'autre, d'une commune à l'autre. Simplement, je le répète, ces droits ont un caractère privatif et ils constituent un élément patrimonial susceptible d'acquérir une valeur monétaire. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs reconnu dans une décision de 2002, Commune de Saint-Martin-d'Arrossa.
La reconnaissance de la notion nouvelle de membre de la section de commune, qui est unifiante, marque un grand progrès. S'agit-il pour autant d'une simplification et d'une clarification de la notion d'ayant droit ? À mon sens, c'est l'intention du rapporteur et de l'auteur de la proposition de loi, mais il me semble que nos travaux parlementaires préparatoires seront utiles pour l'établir. Pour ma part, je comprends que la nouvelle notion de membre de la section, telle qu'elle se dégage du texte proposé, remplace la notion d'ayant droit. Ne pourront être ayants droit que les membres de la section.
S'agissant de la gestion budgétaire, les mesures prévues me semblent tout à fait judicieuses. Le texte donne formellement aux municipalités la possibilité de modifier le budget de section préparé par une commission syndicale, alors que, jusqu'à présent, la loi le leur refusait. Il leur donne également le droit de financer des dépenses communales sur le budget de la section, à la condition, qui donnera parfois lieu à quelques disputes, que les besoins de la section aient été satisfaits, ce qui suscite, philosophiquement, des interrogations d'une grande profondeur : à partir de quand des besoins sont-ils totalement satisfaits ? Néanmoins, il est évident que cette mesure s'inspire du bon sens.
Par ailleurs, cette proposition de loi recèle une autre nouveauté tout à fait opportune et judicieuse, à savoir que c'est bien la section, en tant que propriétaire, qui est assujettie au paiement de l'impôt foncier. En effet, puisque la fin d'activité de la section peut se caractériser par le constat qu'elle ne paie plus le foncier, il est nécessaire de préciser que c'est bien elle qui en est débitrice.
En outre, le texte tend à faciliter le transfert d'une section à la commune, novation qui est de nature à permettre un règlement définitif de la situation de conflit d'intérêt, mais seulement, évidemment, si ce transfert est souhaité par la commune et si des garanties suffisantes ont été données aux membres de la section pour défendre leurs intérêts. À mon avis, les mesures réduisant les obstacles ou les conditions préalables à l'engagement de la procédure de transfert sont bienvenues. Il en est ainsi de l'exigence accrue de représentation des membres de la section et de la durée moindre de non-paiement de la taxe foncière.
Je souligne au passage la curiosité qui subsistera après l'adoption éventuelle de la proposition. Au fond, l'extinction des droits d'usage par le transfert reste entièrement implicite dans ce texte : il n'est dit nulle part que le transfert met fin au droit d'usage. Il entraîne le transfert des droits et obligations de la section à la commune. Or, dans les obligations de la section, figurait le respect des droits d'usage des ayants droit ou des membres, selon la nouvelle définition. Je comprends que la pratique, en réalité, est contraire et que, de façon coutumière, on considère que le transfert met fin au droit d'usage – c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un système d'indemnisation est instauré par la loi –, mais, assez curieusement, la loi ne le précise pas. C'est sans doute un signe de pudeur au regard du ressentiment et des mécontentements subjectifs que peut entraîner ce transfert.
Enfin, le texte prévoit la possibilité de vendre les biens. Si l'on veut rétablir une certaine fluidité, une certaine mobilité dans l'usage de ces biens, en général agricoles ou forestiers, il faut bien sûr que la vente soit possible. En principe, elle reste une compétence de la section, mais, dans la pratique, il s'agira de la commune, au nom de la section. Si le transfert a eu lieu, la commune, seule, décidera du transfert, une fois que les membres de la section auront pu faire valoir leurs droits.
Madame la ministre déléguée, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous n'avons aucune peine à reconnaître les avancées importantes de cette proposition de loi, qui vont, non seulement simplifier la vie quotidienne administrative des communes, mais également favoriser une mobilisation des territoires et des espaces fonciers dans des régions menacées par la déprise et l'affaiblissement du potentiel d'exploitation, en donnant aux communes une possibilité de mieux affecter les biens de leur territoire. Je remercie et félicite les auteurs de la proposition de loi, ainsi que leurs prédécesseurs ayant travaillé sur ce sujet, pour avoir fait avancer la réflexion. Au regard des modifications, sans doute trop ponctuelles, qui avaient été adoptées ces dernières années, nous aurons, cette fois-ci, fait un véritable pas en avant. Il faut, je crois, s'en réjouir.
Applaudissements.

M. Alain Bertrand. Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, oserai-je dire que jusqu'à l'initiative des sénateurs du groupe RDSE
Sourires.

En revanche, il est certain que cette question est au cœur des préoccupations de milliers de maires ruraux et hyper-ruraux, confrontés quotidiennement aux tensions et aux contentieux que génère la vie des sectionaux.
Comme cela a été rappelé, autrefois destinées à assurer aux plus démunis des moyens de subsistance par l'usage collectif d'un patrimoine mis en commun, de trop nombreuses sections de communes sont aujourd'hui devenues un instrument dévoyé, destiné à satisfaire les intérêts financiers des particuliers, sous couvert de protéger l'intérêt général. En d'autres termes, comme le regrettait M. le rapporteur, toute la philosophie qui sous-tendait le décret de la Convention de 1793 s'est perdue en route, par un malheureux retournement de l'Histoire, ou plutôt à cause de la cupidité de nos compatriotes.
Sur le terrain, la situation des quelque 27 000 sections de communes recensées en 1999 s'avère extrêmement complexe et différenciée. En Lozère, par exemple, 1 455 sections – elles sont encore plus nombreuses dans le Cantal, me semble-t-il – occupent 70 000 hectares. Pour vous donner un ordre d'idée, certaines communes en Lozère ont des sectionaux de 400, 500, 800 voire 1 000 hectares. Pensez que, en matière agricole, ces terres sont mises à disposition de preneurs qui sont fermiers. La question est donc d'importance.
À côté de cette espèce de mêlée ouverte des sections, il y a 200 commissions syndicales, nous dit-on, qui fonctionneraient correctement.
Le président Mézard l'a rappelé, ces biens sont l'objet de nombreux contentieux, à la source desquels on trouve des problèmes familiaux ou des litiges anciens, à propos d'un chien qui aurait divagué sur un territoire ou d'une nièce qui n'aurait pas épousé le bon mari. En réalité, le sectionnement encourage ces règlements de compte.
Si la situation semble à ce point inextricable, c'est aussi parce que le droit applicable est dépassé. En sortant de séance tout à l'heure, M. le rapporteur, avec brio, nous expliquait qu'il fallait encore, en 2012, se référer à la notion féodale de « feu » pour déterminer qui est ayant droit. Il a eu raison de se replier sur les habitants de la section, mais c'est quand même une notion passéiste. De même, la délimitation de la section demeure incertaine.
La lecture du chapitre du code général des collectivités territoriales consacré au sujet s'apparente davantage à un empilement désordonné de normes qui se sont stratifiées au fil du temps, faisant le bonheur des avocats, qu'à un bel ordonnancement juridique permettant à la loi d'être efficiente. Les difficultés d'application sont telles que, comme certains collègues l'ont souligné, les contentieux durent, s'aggravent et justifient tous les règlements de compte.
Si le constat des dysfonctionnements est unanimement partagé, les réformes votées en 2004 et 2005 n'ont pas permis d'atteindre l'objectif affiché. En déposant une proposition de loi, notre collègue Pierre Jarlier a fait, l'an dernier, un premier pas. Aujourd'hui, l'initiative du président Mézard est relayée par la commission des lois, dont je salue le président et le rapporteur. Confortés par la confiance que nous plaçons en Mme la ministre – de par ses origines aveyronnaises, elle connaît bien le problème des sections –, nous pensons que la présente proposition de loi va restructurer complètement la gestion et l'avenir de ces biens de section.
Il s'agit d'offrir aux maires un outil juridique simple et rapide. Peut-être, dans un premier temps, ne sera-t-il pas complètement simple, ni rapide, ni exhaustif… Néanmoins, il représentera une avancée importante. Les solutions s'imposent petit à petit, en marchant. Jaurès disait qu'il suffit d'améliorer micrométriquement les choses chaque jour pour bien faire son travail.
Nous nous réjouissons donc que la commission des lois ait approuvé cet objectif et l'ait même dépassé, puisqu'elle a considérablement modifié la proposition de loi. Je le répète, le travail de M. le rapporteur a été remarquable.
Dans l'hypothèse où, comme je le souhaite, cette proposition passe le filtre de l'Assemblée nationale, il faudra veiller, dans le cadre des textes d'application, à protéger les intérêts des communes tout en garantissant la bonne gestion, l'équité et la simplification administrative. L'objectif est de permettre d'éviter les blocages liés à l'existence même des biens sectionaux.
Je reprendrai l'exemple, cité précédemment, de cette station d'épuration qui n'a pu être construite car se trouvant sur le territoire d'un bien sectional. Ailleurs, ce sont des terrains à bâtir qui ne pourront pas l'être, et ce pour la même raison. Et n'oublions pas la situation des agriculteurs !
Dans mon département, nous voyons arriver des gens qui se disent agriculteurs mais ne le sont pas. Ils s'immatriculent à la MSA, alors même qu'ils ne respectent pas le cadre d'une installation classique, au regard, notamment, de la dotation jeune agriculteur ou des diplômes requis, dans le seul but de pouvoir accéder aux biens sectionaux.
Imaginez le tableau. J'arrive dans une commune qui me plaît. J'achète une ruche, je la pose au fond de mon jardin. J'ai la chance de pouvoir acheter 5 000 mètres carrés attenant à ma propriété. Je vais me déclarer à la MSA et me fais passer pour un agriculteur. Après enquête, je découvre que la commune compte 400 hectares de biens sectionaux et que nous sommes 8 habitants dans la section. Eh bien, j'en réclame 50 hectares ! Voilà un cas de figure que nous rencontrons régulièrement en Lozère.
Il faudra donc veiller à ce que l'attribution des biens sectionaux, laquelle relève aujourd'hui, le plus souvent, des sections et des syndicats ou, en cas de défaillance, des communes elles-mêmes, bénéficie, en priorité, aux véritables agriculteurs. À mon sens, la qualité d'agriculteur se définit par le fait non seulement que l'installation est accréditée par la commission départementale d'orientation agricole, notamment dans le cadre de la dotation jeune agriculteur, mais aussi que le professionnel tire l'essentiel de son revenu de l'agriculture. Il faudra donc être vigilants sur la rédaction des textes d'application, qui devront aller dans ce sens.
En tout état de cause, monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, il s'agit d'une bonne proposition de loi. Plus conforme au droit général, elle met fin à certains passe-droits, qui n'étaient pas compatibles avec notre bonne République ! §

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
(Supprimé)

L'amendement n° 6, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Afin de faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes, un ou plusieurs maires des communes intéressées peuvent demander au représentant de l'État dans le département, d'établir après enquête publique, un inventaire des sections de communes et de leurs biens, droits et obligations. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Cet amendement a pour objet de rétablir partiellement l'article 1er, dont la suppression a été actée en commission.
Il nous semble cependant important de permettre aux maires qui en feront la demande de bénéficier de l'aide de l'État pour établir, après enquête publique, un inventaire des sections de commune et de leurs biens, droits et obligations. Ceux-ci seraient alors à même de surmonter un certain nombre de problèmes, que plusieurs d'entre nous ont évoqués à l'occasion de la discussion générale et sur lesquels nous sommes d'ailleurs régulièrement interpellés. Il est effectivement des communes où la situation n'a malheureusement pas évolué depuis longtemps.
L'un des atouts de cette proposition de loi, qu'avaient en tout cas décelé les élus locaux, figurait justement dans la rédaction initiale de cet article 1er. C'est la raison pour laquelle nous proposons de le rétablir, mais seulement en partie, puisque l'inventaire ne pourrait être établi qu'à la demande des élus concernés.

C'est une question dont nous avons longuement débattu. Madame Cukierman, si vous avez la logique pour vous, permettez-moi de vous rappeler les termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. »
Dès lors, quelle est la partie de commune à considérer ? Que faut-il entendre par ces biens dont l'usage est exclusif ? Que recouvre l'expression « droits distincts » ? À l'évidence, quand on commence à gratter pour savoir exactement ce qu'il y a derrière ces notions générales, les difficultés apparaissent.
De notre point de vue, toute généralisation de la mesure, même si telle n'est plus votre intention, risquerait d'encombrer, sans plus de résultat, les différents services concernés. S'il ne s'agissait que de ceux des préfectures, à la limite, cela pourrait être amusant…

Les difficultés perdureraient et la question resterait entière. La seule façon d'en sortir, c'est d'aller au contentieux pour demander au tribunal de trancher les conflits.
Nous faisons un effort de clarification. En posant le principe que, finalement, tout se résume à savoir qui est habitant de la section, nous facilitons tout de même grandement la résolution du problème.
Par conséquent, madame Cukierman, si vous aviez l'amabilité de retirer votre amendement, cela m'éviterait d'émettre un avis défavorable.
Sur cet amendement, dont chacun a bien compris la logique, je reprendrai les arguments que vient de développer M. le rapporteur. Il est vrai que, aujourd'hui, le fait de prolonger une telle activité, dont on ne mesure pas tout à fait l'intérêt, ne ferait qu'alourdir le dispositif. À mon tour, je sollicite le retrait de cet amendement.

Mme Cécile Cukierman. La logique étant avec moi, je le maintiens, monsieur le président !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 7, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de permettre l'évolution des biens sectionaux, les communes concernées établissent une délimitation du territoire de la section de commune, de leur propre initiative ou à l'initiative de la seule section de commune.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Dans la mesure où nos arguments respectifs sur cet amendement seront les mêmes que ceux qui viennent d'être avancés, pour le bien-être de chacun, nous le retirons !
I. – Le second alinéa de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section de commune est une personne morale de droit public.
« Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. »
II. – L'article L. 2411-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section ».
III. – Au dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, les mots : « ces habitants » sont remplacés par les mots : « la section de commune ».

L'amendement n° 15, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, les mots : « la moitié des électeurs » sont remplacés par les mots : « la moitié des membres » ;
2° Au septième alinéa (5°) de l'article L. 2411-4, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
3° L'article L. 2411-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section ».
La parole est à M. le rapporteur.

Madame la ministre déléguée, mes chers collègues, dans notre souci d'unifier un certain nombre de notions telles que « habitants », « ayants droit » et « électeurs », qui étaient à peu près semblables, mais pas partout, nous avons été amenés à harmoniser la terminologie dans l'ensemble du code général des collectivités territoriales. Vous voici proposée, par cet amendement, la liste des différents changements de dénomination prévus dans ce cadre.
Le Gouvernement ne peut être que favorable à cette harmonisation.

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l'article 1er bis.

Alors que le Sénat s'apprête à adopter une nouvelle définition de « membres de la section de commune », il est une petite question de droit qui reste pendante, puisque, dans l'esprit de tous ceux qui, comme moi, l'ont adoptée en commission, cette définition établit, me semble-t-il, une nouvelle notion d'ayants droit.
Aux termes de l'article 1er bis, seuls les résidents de la section peuvent en être ayants droit, c'est-à-dire avoir accès au droit d'usage s'attachant à cette qualité. Voilà qui devrait beaucoup simplifier le règlement des disputes au sujet de la qualité d'ayant droit, étant donné que, dans nombre de situations, celle-ci devenait difficile à justifier.
Même si je fais toute confiance à l'auteur de la proposition de loi et au rapporteur pour trouver la bonne solution, je rappellerai que, dans les autres cas, lorsque des personnes perdent la qualité d'ayant droit à la suite d'un transfert, la loi prévoit une indemnisation. Cette dernière est logiquement à la charge de la commune, laquelle récupère les droits sur la section et se trouve ainsi libre d'en disposer.
Du fait de la nouvelle définition légale, un certain nombre d'ayants droit, du moins s'ils peuvent justifier de leur titre, perdent cette qualité. Si aucune précision n'est apportée, il conviendra de se référer à ce qu'a précisé le Conseil constitutionnel dans la décision qu'il a rendue l'année dernière : auraient droit à une indemnisation à la suite de la perte de ce bien immobilier particulier qu'est le droit d'usage ceux qui peuvent justifier de leur qualité antérieure d'ayants droit, mais seulement dans les conditions habituelles de la responsabilité du fait des lois, c'est-à-dire s'ils subissent un préjudice anormal et spécial. Or l'existence d'un tel préjudice ne peut être constatée que par une juridiction : autrement dit, on en arriverait à fabriquer du contentieux.
Selon moi, un autre système pourrait être envisagé, dans lequel la qualité d'ayant droit ne serait perdue qu'à terme. Ce ne serait qu'au moment des transferts auxquels procéderaient les communes que pourrait être mise en route une demande d'indemnisation.
En tout cas, il convient de trancher explicitement la question par la loi, ce que j'avais imaginé de faire au travers d'un amendement, qui a été, à bon droit, déclaré irrecevable. À défaut, on se retrouverait dans un cas de figure délicat, où la responsabilité de l'État serait engagée. J'espère donc qu'il sera possible, d'ici à la lecture du texte à l'Assemblée nationale, de trouver une solution à cette petite difficulté.

Monsieur Richard, je ne fais pas du tout la même lecture que vous du texte. Non, aucune nouvelle définition de la notion d'ayants droit n'est donnée au travers de l'article 1er bis. Relisez-le bien ! Je peux vous l'assurer car je me suis moi aussi posé la question, au point même d'en avoir quelques sueurs froides !
C'est l'appartenance à la section qui fait l'ayant droit, et non l'inverse. §Cela peut paraître bizarre, c'est ainsi, il suffit de lire ce qui est écrit.
Vous évoquez par ailleurs le cas où les ayants droit feraient état d'un titre. En réalité, le titre appartient à la collectivité, et non à ses membres pris individuellement. C'est donc le fait d'appartenir à la collectivité qui confère la qualité d'ayant droit.
Notre cheminement a été très simple, nous avons raisonné par défaut. En l'absence de définition, je le souligne une nouvelle fois, c'est l'appartenance à la collectivité qui fait l'ayant droit, et non l'inverse. À partir de là, cherchant ce qui se rapprochait le plus de la collectivité originelle, nous en sommes arrivés à la notion d'« habitants ayant leur domicile réel » sur le territoire concerné.
Ce raisonnement est peut-être un peu troublant si l'on continue à s'appuyer sur le concept, moderne, d'un droit personnel que l'on tiendrait d'un héritage, mais une telle interprétation n'a strictement rien à voir avec la notion d'ayants droit d'une section de commune.
En tout cas, après moult hésitations, voilà la solution à laquelle nous sommes parvenus. C'est non seulement la plus simple, la plus pragmatique et la moins susceptible d'engendrer des contentieux, mais aussi la plus proche à la fois de la logique originelle et de la logique profonde de ce que recouvrent les notions de sections et d'ayants droit.

J'apporterai à mon tour une précision à l'appui de la démonstration de M. le rapporteur. Le fait de prévoir une telle définition dans la loi ne ferait qu'aggraver le problème, perturber complètement le système et fausser la réalité, puisque serait remis en cause le fondement même de la notion d'ayants droit.
Selon les sections, on n'est pas ayant droit dans les mêmes conditions. Ce sont la tradition et les usages qui fondent les droits applicables à tel ou tel. Ainsi, dans une même section, on peut perdre la qualité d'ayant droit faute de remplir les conditions requises ou la gagner dès lors qu'on vient habiter sur le territoire considéré.
L'instauration d'une définition juridique de la qualité d'ayant droit aurait pour corollaire la création, par la loi, d'une nouvelle catégorie d'ayants droit forcément d'application générale. Cela aboutirait à dénaturer la qualité d'ayant droit liée à chaque section.
J'évoquais précédemment le cas d'une commune comptant deux sections. Les conditions d'accès à la qualité d'ayant droit n'y sont pas les mêmes. Dans l'une, les habitants vont disparaître, donc les ayants droit aussi. Dans l'autre, si quelqu'un achète une ruine ou y construit son habitation, il deviendra ayant droit, avec les mêmes droits que ceux qui le sont depuis des générations.
Sourires.
L'article 1er bis est adopté.
L'article L. 2411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-2. – La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.
« Dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, la gestion est assurée, si elle est constituée, par la commission syndicale et par son président. » –
Adopté.
L'article L. 2411-3 du même code est ainsi modifié :
I. – Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « les membres de la section ».
II. – Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. » –
Adopté.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 2411-5 du même code est ainsi rédigé :
« La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque :
« - le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;
« - la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'État dans le département faites à un intervalle de deux mois ;
« - les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à 2 000 euros de revenu cadastral annuel, à l'exclusion de tout revenu réel. »
II. – L'article L. 2411-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot « électeur », sont insérés les mots : « dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre » ;
2° Le neuvième alinéa est supprimé ;
3° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de commission syndicale, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale est instituée par le représentant de l'État dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de création de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant de l'État dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice. »

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce montant peut être révisé par décret.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Il s'agit simplement de préciser que la somme de 2 000 euros sera éventuellement amendée ou modifiée par décret en Conseil d'État. Notre objectif est de ne pas figer le système sur l'année 2012. Si, à l'avenir, le Gouvernement juge bon d'augmenter cette somme par décret, il pourra ainsi le faire.
Avis favorable, sous réserve qu'il s'agisse bien d'un décret simple et non pas d'un décret en Conseil d'État.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
L'article L. 2411-6 du même code est ainsi modifié :
1° dans la première phrase du onzième alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres ».
2° le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. » –
Adopté.
Dans l'article L. 2411-9 du même code, les mots : « à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par les représentants de l'État dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux » sont remplacés par les mots : « à l'exception des membres de la section, sont convoqués par le représentant de l'État dans le département à l'effet de tirer au sort, parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, ceux ». –
Adopté.
L'article L. 2411-10 du même code est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'exclusion de tout revenu en espèces ».
II. – Dans le cinquième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section ».
III. – A la fin du cinquième alinéa, les mots : « dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural » sont supprimés.
IV. – Le sixième alinéa est supprimé.
V. – Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des membres » sont supprimés.

L'amendement n° 16, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans le respect
par les mots :
notamment dans le respect
La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à réparer une erreur. À vouloir faire sauter un membre de phrase qui n'avait pas d'intérêt, nous avions, en mauvais chirurgiens, laissé une compresse. L'objet de cet amendement est de l'enlever !
Sourires.
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même si je n'ai pas d'affection particulière pour le mot « notamment », l'avis ne sera pas défavorable !
Sourires.
L'amendement est adopté.
L'article 2 quater est adopté.
Le dernier alinéa de l'article L. 2411-12 du même code est ainsi rédigé :
« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. »

L'amendement n° 2, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
section
insérer les mots :
qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Cet amendement est retiré. Je m'étais perdue dans les modifications de la loi !
L'article 2 quinquies est adopté.
L'article L. 2411-12-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le chiffre : « cinq » sont remplacés par les mots : « trois » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'un tiers » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune ». –
Adopté.
Après l'article L. 2411-12-1 du même code, il est inséré un article L. 2411-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L 2411-12-2. – I. – A la demande du conseil municipal, le représentant de l'État dans le département engage une procédure de transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une ou plusieurs sections de commune situées sur le territoire de la commune dans un objectif d'intérêt général.
« Dans un délai d'un mois suivant la délibération du conseil municipal, le maire consulte la commission syndicale sur le projet de transfert ainsi que sur ses modalités.
« La commission syndicale dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour présenter ses observations. En l'absence de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Par dérogation à l'article L. 2411-4, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.
« Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire, dans le délai d'un mois suivant la délibération du conseil municipal, informe les membres de la section dudit projet par voie d'affiche à la mairie durant deux mois. Ce projet est également publié dans un journal local diffusé dans le département concerné. Les membres de la section disposent d'un délai de deux mois à compter de l'affichage pour présenter leurs observations.
« II. – A l'issue des procédures visées au I, le représentant de l'État peut, par un arrêté motivé, prononcer ou non le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune.
« Dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'État dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.
« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. »

L'amendement n° 13, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
consultatif
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 11, présenté par MM. Domeizel, Richard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au projet de transfert ainsi qu'à ses modalités
La parole est à M. Alain Richard.

Dans la procédure qui est décrite par l'article, il est prévu de demander l'avis des membres de la section sur un projet de délibération. Je crois qu'il faut préciser sur quoi porte le projet de délibération, c'est-à-dire le projet de transfert.

Il me semble que, sur ce point, la rédaction du texte de la commission est suffisamment claire.
Dans tous les cas, qu'il y ait ou non réponse de la commission syndicale, il apparaît clairement qu'il s'agit d'un avis portant sur le projet de transfert et ses modalités.
Cela ressort en effet de la rédaction de l'alinéa 3, qui dispose : « Dans un délai d'un mois suivant la délibération du conseil municipal, le maire consulte la commission syndicale sur le projet de transfert ainsi que sur ses modalités. »
En conséquence, je demanderai à notre collègue de bien vouloir retirer cet amendement.

L'amendement n° 11 est retiré.
L'amendement n° 12, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
voie d'affiche à la mairie
par les mots :
affichage sur les panneaux d'informations habituels de la commune
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 10, présenté par MM. Domeizel, Richard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
un journal local diffusé
par les mots :
deux médias dont au moins un journal diffusé
La parole est à M. Alain Richard.

L'article 4 est adopté.
Après l'article L. 2411-12-2 du même code, il est inséré un article L. 2411-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-3. – A compter du transfert définitif de propriété, la commune est substituée de plein droit à la section de commune dans ses droits et obligations.
« La commune qui souhaite revendre tout ou partie des biens transférés, dans le délai de cinq ans à compter de l'arrêté de transfert, informe les anciens membres de la section, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité. » –
Adopté.
L'article L. 2411-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-14. – Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres. » –
Adopté.
I. – L'article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article L. 2411-6 » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L'article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'article L. 2411-6 et » ;
2° A la fin du premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » et les mots : « représentants de l'État dans le département » sont remplacés par le mot : « maire » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé. –
Adopté.
L'article L. 2411-17 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. » –
Adopté.
L'article L. 2412-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le budget de la section est proposé par la commission syndicale et voté par le conseil municipal qui peut le modifier. » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, » sont remplacés par le mot : « si » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé. –
Adopté.
I. – L'article L. 2411-17-1 du même code est supprimé.
II. – Après l'article L. 2412-1 du même code, il est inséré un article L. 2412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412-2. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10, lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d'investissement ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune, par une contribution du budget de la section. » –
Adopté.
I. – L'article L. 2411-19 du même code est supprimé.
II. – L'article L. 2573-58 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « L. 2411-19 » est remplacée par la référence : « L. 2411-18 » et les mots : « l'article L. 2412-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2412-1 à L. 2412-2 » ;
2° Les V et VI sont supprimés. –
Adopté.
A compter de la publication de la présente loi, aucune section de commune ne peut être constituée.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

L'amendement n° 14, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - À compter de la publication de la présente loi, aucune section de commune ne peut être constituée.
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2112-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-7. - Les biens meubles et immeubles situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.
« S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. » ;
2° Les articles L. 2112-8 et L. 2112-9 sont abrogés ;
3° L'article L. 2242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-2. - Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité dans les conditions prévues à l'article L. 2242-1.
« En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt des habitants bénéficiaires du don ou du legs. »
III. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie.
IV. - La présente loi est applicable en Polynésie française.
La parole est à M. le rapporteur.

J'ai déjà évoqué ce problème tout à l'heure. Nous ne souhaitons pas que puissent se constituer de nouvelles sections de communes. Il y avait deux cas, avec deux traitements différents, les fusions de communes et les legs faits à une partie d'une commune.
Dans l'hypothèse de fusions de communes, cet amendement vise à rendre impossible le départ dans l'autre commune de certains habitants, qui garderaient quand même quelques privilèges, quelques particularités. Si les deux communes veulent fusionner, elles fusionnent, et les biens collectifs deviennent des biens de la nouvelle commune, d'autant qu'avec le développement de l'intercommunalité, les modalités d'associations sont beaucoup plus souples et subtiles que par le passé.
Dans l'hypothèse d'un legs, notre objectif n'est pas de léser les bénéficiaires de cette libéralité, mais de confier la gestion du bien à la commune dans l'intérêt des bénéficiaires. Là encore, on ne créera pas de sections de commune, ce qui simplifie les choses.
J'émets, au nom du Gouvernement, un avis de sagesse. Même si le Gouvernement ne voit aucune opposition de principe à cette proposition, nous n'avons pas été à même d'en mesurer l'impact. C'est notre seule réserve.
L'amendement est adopté.
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :
« 1° au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, leurs bâtiments d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci et, si la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l'article L. 2411-5, le conseil municipal en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;
« 2° à défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;
« 3° à titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section. »
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués par la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l'article L. 2411-5, le conseil municipal, soit à chacun des associés exploitants dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. »
III. – A la fin du troisième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'autorité municipale » sont remplacés par les mots : « la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l'article L. 2411-5, le conseil municipal. »
IV. – Le quatrième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :
« Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation des contrats. Cette résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'autorité compétente et prend effet à l'expiration d'un délai de préavis d'au minimum six mois à compter de la notification de la résiliation. »
L'amendement n° 3, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
biens
insérer le mot :
agricoles
L'amendement n° 4, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
biens
insérer le mot :
agricoles
La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour présenter les amendements n° 3 et 4.

Il s'agit d'harmoniser la rédaction de cet article en mentionnant les termes « biens agricoles » dans tous les alinéas de celui-ci, et non dans les deux premiers seulement.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 4 decies est adopté.
Après le neuvième alinéa de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. » –
Adopté.
I. – Le septième alinéa de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
II. – L'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission syndicale ou à défaut les électeurs de la section rendent aussi un avis consultatif sur la constitution ou l'adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement de gestion forestière. En cas de désaccord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou à défaut les électeurs de la section, le maire sollicite une nouvelle délibération du conseil municipal. »

L'amendement n° 5, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première et seconde phrases
Remplacer le mot :
électeurs
par le mot :
membres
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Il s'agit de finir de peigner la girafe en remplaçant le mot « électeurs » par le mot « membres ».

La commission est favorable à cet amendement dans la mesure où cette nuance nous avait échappé !

M. Jean Desessard. Il ne faut pas laisser échapper les électeurs, monsieur le rapporteur !
Sourires.
Nouveaux sourires.
L'amendement est adopté.
L'article 4 duodecies est adopté.
(Non modifié)
Les conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les conséquences financières pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Nous demandons, par cet amendement, que le gage soit levé, ce à quoi nous sommes évidemment fort attachés.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. La commission n'a pas eu connaissance de cette bonne nouvelle mais, à titre personnel, je ne me vois pas bien la refuser !
Sourires.
L'amendement est adopté.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean Boyer, pour explication de vote.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, permettez d'abord que l'élu de Haute-Loire, l'un des départements du Massif central, considère que l'ancienne sénatrice de l'Aveyron est restée égale à elle-même. Elle a gardé sa classe, dans une compétence discrète et naturelle. §(M. Gilbert Barbier applaudit.) Madame le ministre, je voulais très simplement vous le dire.
Il n'est pas nécessaire d'enfoncer des portes lorsqu'elles sont ouvertes. Je tenais simplement à apporter, au nom de mon groupe, au nom de Pierre Jarlier et de tous ceux qui ne sont pas là, les mots qui alimentent une conclusion positive plutôt qu'une interrogation.
Permettez-moi, ensuite, de saluer les deux Cantalous, les deux Cantaliens. Je connaissais le premier, prénommé Pierre. Il n'habite pas très loin de la Haute-Loire, dont le Cantal est séparé par une chaîne, la Margeride. Je le connaissais pour l'avoir vu ici, il y a deux ans de cela, nous sensibiliser sur ce sujet lors de la discussion d'une proposition de loi analogue à celle que nous examinons aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons pu le constater, la plupart des amendements alors déposés ont été repris.
Pour aborder les biens de sections, il faut, à mon sens, avoir une conviction. Il faut, d'abord, vivre les problèmes dans son pays. Je le redis, madame la ministre, je suis du département de la Haute-Loire, qui compte 2 825 sections. §C'est un record ! Mais en Lozère, il y a 72 000 hectares. Si je cite ces chiffres, ce n'est pas pour faire une surenchère ! Je veux, surtout, féliciter Jacques Mézard d'avoir pris cette initiative et d'avoir trouvé en Pierre Jarlier un complice constructif.
Je m'écarte du texte que j'avais rédigé pour m'en tenir à l'essentiel. Pendant trente-six ans, j'ai été maire d'une commune qui a compté l'éventail des biens de sections, productifs et non productifs. Et je sais qu'il suffit d'en parler pour allumer la mèche ! Quand on ne parle pas des biens de sections, les ayants droit ne se réveillent pas. Mais si vous y touchez, vous verrez qu'ils portent dans le dos un panneau avec l'inscription « Touche pas à mon pote ! »
Pour faire avancer nos communes, pour qu'il y ait une cohérence dans les équipements, pour qu'il y ait une vision sur l'avenir, il faut aller dans le sens que vous avez indiqué, cher monsieur Mézard, avec cette proposition de loi.
Nous ne sommes pas cinq siècles en arrière. Nous sommes en 2012 et nous devons regarder de l'avant.
Dans nos zones de montagne, il y a des obstacles constitués par la topographie et par le climat. Mais il y a des obstacles administratifs contre lesquels les hommes de bonne volonté que nous sommes devons trouver des solutions dans le respect du passé et dans la perspective de l'avenir.
Vous l'avez deviné, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe auquel nous appartenons, Pierre et moi, votera, sans hésitation, cette proposition de loi.
Bravo ! et applaudissements.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, faciliter la gestion des communes et la mission de leurs maires en mettant fin aux dysfonctionnements qui frappent la majorité des sections des communes, tel est l'objet de cette proposition de loi que le groupe du RDSE soumet, ce soir, à l'examen du Sénat.
Cela a été dit tout au long de ces débats, les sections de communes sont une institution qui peut trouver toute sa place dans le paysage de nos territoires ruraux à partir du moment où leur fonctionnement et leur gestion ne viennent pas perturber la vie communale.
Malheureusement, trop souvent, des différends personnels ou la crispation sur des intérêts particuliers viennent grever les relations entre les sections ou leurs ayants droit et les communes.
Les blocages constatés n'ont d'autre source que le conservatisme d'une minorité qui, par exemple, ne veut pas partager ses revenus avec de nouveaux et jeunes agriculteurs ou qui préfère s'arc-bouter sur des droits particuliers au détriment de l'intérêt de l'ensemble de la commune et de ses habitants.
Il est clair que, lorsque la section met un frein au développement de nos territoires ruraux ou devient un facteur de morcellement des terres, tout doit être mis en œuvre pour favoriser l'intérêt général. C'est ce que nous avons souhaité faire en mettant à la disposition des maires un nouvel outil plus simple, plus rapide et plus sécurisé, de communalisation des biens sectionaux. C'est ce qu'a également fait notre rapporteur Pierre-Yves Collombat, en s'appuyant sur ce texte pour proposer une modernisation et une rationalisation du régime même des sections de commune.
Ce soir, il me semble que nous avons indéniablement fait œuvre utile pour l'ensemble de nos communes, en accomplissant un travail législatif de profondeur, appuyé sur la réalité du terrain et sur l'expérience de ses représentants.
Mes chers collègues, je ne peux donc que vous inviter à voter en faveur de la présente proposition de loi, déposée par plusieurs membres de mon groupe. Ce texte facilitera la gestion de nos communes et notamment d'un certain nombre d'entre elles que je connais parfaitement, étant donné qu'elles sont situées dans mon département, l'Aveyron.
Pour ces mêmes raisons, ainsi que pour d'autres, évoquées par plusieurs orateurs avant moi, nous avons la certitude de pouvoir compter sur le soutien actif de Mme le ministre déléguée, pour assurer une inscription rapide du présent texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. §

Avant tout, je tiens à remercier Jacques Mézard de m'avoir conduit à m'initier aux mystères des sections de communes, …

… je connaissais certes l'existence de ce statut juridique mais, sauf erreur de ma part, mon département ne compte pas de biens sectionaux.
Quoi qu'il en soit, les sections de commune constituent un sujet extrêmement intéressant sur le plan intellectuel, …

Ensuite, je tiens à remercier l'ensemble de nos collègues qui nous ont permis d'accomplir ce travail collectif : nous nous sommes efforcés, ensemble, d'améliorer la situation.
Enfin, pour éviter toute ambiguïté, je dresserai ce constat : certes, nous l'avons souligné, ce texte a pour but d'éradiquer un certain nombre de déviances, en évitant que certains intérêts particuliers n'entravent l'existence des communes. Toutefois, parallèlement, nous nous sommes efforcés de perpétuer cette longue tradition des sections de commune, qui se perd dans le fond de notre histoire, avec tout ce qu'elle peut avoir de vivant et d'un peu étonnant pour des juristes d'aujourd'hui : de fait, il n'y a aucune raison d'empêcher ces structures de vivre, dès lors qu'elles fonctionnent bien et qu'elles donnent satisfaction. Lorsque tel n'est pas le cas, ou lorsqu'elles n'ont même plus d'existence réelle, il faut évidemment passer à autre chose.
Tel est, mes chers collègues, l'esprit général dans lequel nous avons essayé de travailler

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité des présents.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous dire combien je me réjouis que cette proposition de loi ait été adoptée, qui plus est dans les conditions que vous avez relevées les uns et les autres, à savoir dans une belle harmonie.
Cette coproduction, ce travail collectif ne pourra que faciliter sur le terrain l'action de tous ceux qui, jusqu'à présent, restaient confrontés à l'ensemble des difficultés que chacun d'entre nous a successivement énumérées.
À mes yeux, ce texte ne présente qu'un seul défaut, que je tiens malgré tout à mentionner : demain, nos avocats vont être au chômage ! §

Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, il convient de suspendre la séance quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures quarante.