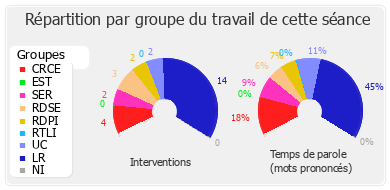Séance en hémicycle du 1er octobre 2013 à 9h30
Sommaire
- Ouverture de la session ordinaire de 2013-2014
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Commissions mixtes paritaires
- Dépôt d'un rapport
- Retrait de l'ordre du jour de questions orales
- Décisions du conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité
- Communication du conseil constitutionnel
- Questions orales (voir le dossier)
- Sinistre des orages de grêle du 2 août 2013 sur la vigne et autres cultures de l'entre-deux-mers (voir le dossier)
- Mise au point au sujet d'un vote (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

En application de l’article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2013-2014 est ouverte.

Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2013 a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution de commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur, et du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la structure des prix pratiqués par les compagnies desservant les outre-mer, établi en application de l’article 2 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des affaires économiques et est disponible au bureau de la distribution.

J’informe le Sénat que les questions n° 428 de M. Claude Bérit-Débat et n° 512 de M. Jean-Paul Amoudry sont retirées de l’ordre du jour de la séance de ce matin, à la demande de leurs auteurs.

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du vendredi 20 septembre 2013, deux décisions du Conseil sur deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- d’une part, le 1. de l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2000 (n °2013-340 QPC) ;
- et, d’autre part, l’article L.12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (n °2013-342 QPC).
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du vendredi 27 septembre 2013, quatre décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (n° 2013-341 QPC) ;
- le deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime (n° 2013-343 QPC) ;
- l’article L. 431-9 du code des assurances (n° 2013-344 QPC) ;
- l’article L. 2142-6 du code du travail (n° 2013-345 QPC).
Acte est donné de ces communications.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le lundi 30 septembre 2013, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 9 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (Cour d’assises des mineurs) (2013-356 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.

La parole est à M. Michel Boutant, auteur de la question n° 527, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des laboratoires publics départementaux.
L’article 52 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, en instaurant l’ouverture à la concurrence des analyses de contrôle de la qualité de l’eau, a bouleversé l’organisation et le fonctionnement des laboratoires publics départementaux, structures pourtant reconnues pour la qualité de leurs travaux.
Le gouvernement de l’époque avait alors éludé le débat parlementaire, présentant cette évolution comme indispensable au regard du droit européen. Or, on constate aujourd’hui que la France est le seul pays à avoir pris une telle décision.
Certains départements n’ont donc eu d’autre choix que de fermer leur laboratoire. Les autres se retrouvent considérablement fragilisés, alors même qu’apparaissent sur nos territoires de nouvelles maladies telles que la fièvre catarrhale ovine, la maladie de Schmallenberg ou encore la grippe aviaire. Parallèlement, on observe la résurgence de maladies anciennes, telle la brucellose ou la tuberculose. Enfin, la présence de résidus de médicaments ou d’hormones dans les eaux naturelles laisse craindre des crises sanitaires à venir.
Dans ce contexte, il serait à mon sens tout à fait regrettable de se priver des compétences d’un réseau de laboratoires à la fois performants et mobilisables à tout moment, qui sont sans aucun doute les mieux à même de préserver la sécurité sanitaire de nos concitoyens.
Il me semble donc urgent d’assurer aujourd’hui la pérennité des laboratoires publics départementaux, en revenant notamment sur les dispositions de la loi du 30 décembre 2006.
Il a été récemment fait état d’un travail mené conjointement sur cette problématique par le ministère en charge de l’agriculture et l’Assemblée des départements de France. Dans le cadre du prochain projet de loi de modernisation agricole, ce travail pourrait aboutir à une évolution sur la situation des laboratoires.
Je vous demande par conséquent, monsieur le ministre, de bien vouloir me préciser de quelle façon le Gouvernement entend assurer le bon fonctionnement des laboratoires publics départementaux, qui sont une composante essentielle du système sanitaire français.
Monsieur le sénateur, vous avez fait référence à une loi qui a remis en cause l’organisation et le fonctionnement des laboratoires publics départementaux. En arrivant au ministère de l’agriculture, j’ai pris un certain nombre de dispositions.
J’ai considéré nécessaire, s’agissant de la question sanitaire de l’eau ou des autres domaines sanitaires que vous avez évoqués – je pense notamment aux maladies telles que la brucellose, la tuberculose, la fièvre catarrhale ovine –, que notre pays se dote d’une double compétence : celle de l’État à travers la direction générale de l’alimentation, la DGAL, qui suit ces questions pour le ministère de l’agriculture, et celle des laboratoires départementaux.
Voilà déjà huit mois, après une discussion avec un certain nombre de présidents de conseil général et avec le président de l’Assemblée des départements de France, nous avons engagé un travail commun pour essayer de coordonner les services de l’État et les laboratoires départementaux. Le groupe de travail créé a pour objectif de maintenir sur notre territoire les laboratoires départementaux et d’assurer entre ces derniers et l’État un service pouvant être offert à l’ensemble des acteurs concernés par ces problèmes sanitaires.
Le travail est donc engagé. L’idée serait de reconnaître les laboratoires publics départementaux comme un service économique d’intérêt général.
Je ne suis pas en mesure de vous donner ce matin une conclusion sur les travaux menés par ce groupe de travail. Ce dont je peux vous faire part, en tout cas, c’est de ma détermination à assurer la pérennité de ces laboratoires, à favoriser une politique sanitaire parfaitement cohérente à l’échelle nationale et à nous appuyer sur toutes les compétences existantes, notamment celles des laboratoires départementaux.
Le groupe de travail s’est assigné pour objectif de réfléchir à cette idée d’un service d’intérêt économique général. Outre qu’elle correspond au droit européen, une telle évolution permettrait de valoriser les prestations que pourraient rendre ces laboratoires, donnant ainsi à ces derniers la capacité de se maintenir et, surtout, d’assurer une cohérence entre les services de l’État et les services départementaux.
Monsieur le sénateur, je partage votre avis : le changement législatif qui a eu lieu en 2006 a été lourd de conséquences. Un certain nombre de laboratoires ont déjà fermé. Ceux qui restent sont performants, et nous devons compter sur eux pour mieux organiser cette police sanitaire absolument nécessaire, que ce soit dans le domaine de l’agriculture, le domaine de l’eau et, surtout, dans le domaine plus général de la sécurité due à tous nos concitoyens.

La parole est à M. Gérard César, auteur de la question n° 547, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Monsieur le ministre, le 30 août dernier, lors de votre déplacement en Gironde qui faisait suite aux dégâts considérables provoqués par les violents orages de grêle sur la vigne et autres cultures de l’Entre-deux-Mers, vous avez annoncé la mise en place dans votre ministère de groupes de travail afin d’étudier le principe d’assurance et d’indemnisation.
Au cours de la réunion qui a eu lieu à Grézillac, je vous ai proposé de choisir le département de la Gironde pour expérimenter une assurance avec franchise, qui couvrirait les aléas climatiques. Celle-ci prendrait la forme d’une assurance récolte et pourrait être en partie subventionnée par l’Union européenne dans le cadre de la nouvelle PAC 2014-2020.
La présence à cette réunion du président du conseil général et du président de la région Aquitaine confirme l’intérêt que tous deux portent au traitement de ces sinistres. Les viticulteurs et les agriculteurs l’ont interprétée comme un soutien de leur part.
Il me semble nécessaire, pour le futur, de renforcer la prévention de ces sinistres en densifiant, en amont du vignoble, le maillage des postes à iodure d’argent gérés par l’association départementale d’étude et de lutte contre les fléaux atmosphériques de la Gironde, ou ADELFA, afin de diminuer les conséquences d’orages tels que ceux de cet été. Je rappelle que 12 000 hectares de vigne ont été touchés, dont plus de la moitié l’ont été dans une proportion variant de 80 % à 100 %.
Survenu après une dizaine d’années de crise viticole, cet événement climatique sans précédent a des conséquences économiques et sociales dramatiques pour les exploitations dont les trésoreries sont le plus souvent exsangues. Sans récolte en 2013 et avec une production faible en 2014, autant dire que l’existence de certaines exploitations est fortement compromise !
Je vous invite donc, monsieur le ministre, à poursuivre la réflexion engagée sur la mise en place dans le département de la Gironde en 2014, à titre expérimental, d’une assurance couvrant les aléas climatiques. Outre l’Union européenne, les collectivités locales, les organisations professionnelles, les compagnies d’assurance pourraient apporter tout leur concours.
Dans l’immédiat, et pour faire face à l’urgence de la situation, des mesures telles que l’exonération et le dégrèvement des charges fiscales et sociales, le recours à la procédure de chômage technique pour les salariés des exploitations, la prise en charge des intérêts d’emprunt, l’inclusion des pertes de fonds dans le régime des calamités agricoles, la possibilité pour les exploitants assurés de ne pas déclarer fiscalement les primes d’assurance sont à envisager afin de redonner espoir aux exploitants viticoles et agricoles.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de me faire part des décisions que vous avez prises depuis votre déplacement en Gironde, au demeurant fort apprécié, et de celles que vous envisagez de prendre.
Monsieur le sénateur, lors de ce déplacement, nous avons pu faire ensemble le constat d’une situation que vous connaissiez et dont je suis venu me rendre compte.
Cet événement de grêle appelle une attitude en deux temps : premier temps, régler dès aujourd’hui le problème de ceux qui ont été victimes de cet aléa climatique ; second temps, anticiper et prévoir ce qui sera mis en place pour l’avenir.
Pour ce qui est du premier temps, toutes les mesures ont été annoncées. Il s’agit de mobiliser des crédits FranceAgriMer, affectés en priorité aux viticulteurs touchés par la grêle, et de mettre en œuvre le système de volume complémentaire individuel, lequel constitue un élément très important. Il s’agit aussi d’engager des mesures d’exonération des cotisations sociales et d’utiliser le levier de la fiscalité, avec la possibilité pour les exploitations sinistrées de solliciter le dégrèvement de leur taxe sur le foncier non bâti. Il sera possible de mobiliser le fonds national de garantie des calamités agricoles pour indemniser les pertes de fonds sur vigne lorsque, comme on l’a constaté, les ceps eux-mêmes ont été touchés.
Nous avons là un dispositif aujourd’hui mobilisable à la condition qu’on s’organise au niveau du département. C’est ce qu’a fait la préfecture en mettant en place le groupe de travail et le guichet unique, lequel permet aux viticulteurs d’avoir un interlocuteur dédié au règlement des problèmes les plus immédiats.
S’agissant du chômage, s’il advenait que de grandes difficultés conduisent malheureusement certains à perdre leur travail, il sera possible de recourir au chômage partiel. Nous aurons l’occasion d’en rediscuter dès que ce sera nécessaire.
Pour ce qui est du second temps, de l’avenir, de la manière dont nous allons gérer ces crises et ces aléas climatiques, ce qui s’est passé en Gironde, comme ailleurs, prouve qu’on arrive au bout d’un système tel qu’il a été organisé, qui a fonctionné, qui fonctionne encore. Compte tenu de l’intensité des aléas que nous connaissons aujourd’hui et de leur fréquence, provoquée par le réchauffement climatique, il est absolument indispensable de réfléchir à des systèmes assurantiels.
Lors de mon déplacement en Gironde, il est apparu possible de réaliser une expérimentation du système assurantiel pour essayer de régler ce problème. En effet, les agriculteurs ou viticulteurs assurés représentent aujourd’hui à peine 20 % de l’ensemble des populations concernées.
Nous avons un besoin impérieux d’élargir la base sur laquelle doit s’appuyer l’assurance contre les risques climatiques. Si nous en restons là, nous connaîtrons en effet à chaque fois les mêmes difficultés.
Le groupe de travail que j’ai mis en place mène actuellement une réflexion sur les perspectives. Il me reviendra ensuite de rendre l’arbitrage final. Il faudra envisager, en particulier, la mobilisation des fonds prévus par la politique agricole commune. Je suis d’accord sur ce principe et tout à fait disposé à examiner l’expérimentation menée en Gironde pour voir comment l’étendre ensuite.
Enfin, j’envisage également le recours au dispositif existant de la déduction pour aléas, la DPA, qui pourrait être mobilisée aux fins de constituer une épargne de précaution, ce qui est d’ores et déjà quasiment possible. Il s’agit, comme vous le disiez, d’étendre la base sur laquelle sont calculées les cotisations, afin d’assurer une meilleure couverture des risques.
Telles sont les pistes sur lesquelles je travaille aujourd’hui, et l’expérimentation menée en Gironde sera l’un des éléments qui nourriront la réflexion.
Je suis convaincu tout comme vous, monsieur le sénateur, que nous avons besoin, au-delà des dispositifs actuellement existants, d’un système fondé sur une base plus large, afin de permettre d’aider plus efficacement les agriculteurs, et ce à un coût moins élevé. Il nous faut en effet arbitrer en vue de trouver un équilibre entre le coût de l’assurance et la prestation fournie.
Nous travaillerons sur cette question jusqu’à l’examen de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, afin de trouver des solutions qui garantissent aux agriculteurs une meilleure couverture des risques.

Je remercie M. le ministre de sa réponse, qui rejoint tout à fait les préoccupations des professionnels girondins concernés.
Il me semble que l’on pourrait augmenter la DPA lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2014, quitte à supprimer la déduction pour investissement, la DPI, qui ne s’applique qu’au matériel agricole. Mieux vaudrait, en termes de dotations, avoir une assurance qui concerne les aléas climatiques. Chaque agriculteur pourrait ainsi constituer une provision.
Se posera toujours le problème de la garantie de la réassurance, sur lequel nous avons buté lors du débat sur la loi de modernisation agricole, comme j’ai eu l’occasion de vous le dire, monsieur le ministre.
Nous devons trouver un système permettant de garantir la réassurance. Pour ce qui concerne la Gironde, le département et le conseil régional pourraient jouer ce rôle à titre expérimental ; ce serait une très bonne chose.

La parole est à M. Jean-Pierre Chauveau, auteur de la question n° 82, transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Monsieur le ministre, en juillet 2010, j’avais déjà interrogé le prédécesseur du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social au sujet des conséquences pour les groupements d’employeurs de la circulaire n° DSS/5B/2010/38 de la direction de la sécurité sociale en date du 1er février 2010, qui harmonise les règles de décompte des effectifs pour l’application de la réduction dite « Fillon », de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, de l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage, de l’assujettissement au versement transport, au fonds national d’aide au logement supplémentaire, et à la participation formation.
En effet, cette circulaire précisait que, pour les groupements d’employeurs, l’effectif à prendre en compte est celui des membres adhérents. Il s’agissait d’un mode de calcul contraire à l’intérêt des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, les GEIQ, puisqu’il leur faisait porter le poids de l’intégralité des effectifs de leurs adhérents.
Or, nous le savons tous, les GEIQ sont des groupements d’employeurs dont l’importance n’est pas à démontrer en matière d’insertion de personnes éloignées de l’emploi. Leurs résultats sont très probants. Ainsi, ils embauchent dans le cadre de contrats en alternance des salariés qui sont très souvent recrutés par des entreprises, ce qui représente près de 70 % de sorties vers l’emploi. Il convient, bien évidemment de conserver et de renforcer ce formidable outil d’insertion par l’économie.
Depuis l’année 2010, l’administration a fait preuve de pragmatisme, écartant ainsi une application trop stricte de la circulaire. En effet, pour les GEIQ, les dispositions applicables aux effectifs des membres adhérents sont réputées être rapportées. Un courrier du chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale, en date du 1er avril 2011, en atteste. Cependant, comme moi, vous connaissez la valeur juridique des circulaires, directives et autres instructions.
Aujourd’hui, pour la détermination de l’effectif du groupement d’employeurs en tant que tel, doivent être pris en compte les salariés propres du groupement, ainsi que les salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes, liées à ce groupement par un contrat d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile, qu’ils aient été ou non mis à disposition d’une de ces entreprises.
S’agissant des effectifs des entreprises adhérentes au groupement, doivent être pris en compte les salariés propres de l’entreprise, ainsi que les salariés mis à sa disposition par le groupement d’employeurs qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an.
C’est ce dispositif qu’il faut désormais consolider. Compte tenu de la fragilité de sa base juridique, cette position de l’administration demande à être confortée par un texte réglementaire qui lui donnerait un caractère officiel.
Monsieur le ministre, je vous demande donc de bien vouloir me préciser quelle décision vous entendez prendre pour soustraire définitivement les GEIQ à un mode de calcul injuste et défavorable.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de mon collègue Bernard Cazeneuve, au nom duquel je vous répondrai, en espérant vous apporter les clarifications que vous attendez.
Vous interrogez le Gouvernement sur la prise en compte des groupements d’employeurs dans les règles de décompte des effectifs, qui ont un impact sur les niveaux de cotisations dus par les employeurs. En effet, l’effectif détermine l’ampleur des allégements généraux de cotisations sociales, le bénéfice de la déduction forfaitaire des cotisations employeurs pour les heures supplémentaires, le régime d’exonération applicable aux contrats d’apprentissage, ainsi que l’assujettissement au versement transport, à la cotisation au fonds national d’aide au logement supplémentaire et à la participation formation.
La circulaire du 1er février 2010 sur les règles de décompte des effectifs retenait pour règle, s’agissant des groupements d’employeurs, que l’effectif à prendre en compte était constitué de la somme des effectifs des employeurs adhérents.
Toutefois, une lettre ministérielle du 1er avril 2011 a permis d’apporter une adaptation en faveur des groupements d’employeurs. Il a été admis que l’effectif du groupement soit déterminé en tenant compte seulement, d’une part, des salariés propres au groupement et, d’autre part, des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liés au groupement par un contrat d’au moins trois mois. Cette règle de décompte permet de tenir compte des spécificités des groupements d’employeurs, et notamment des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, dans un sens favorable à ces structures.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Nous souhaitons une officialisation de ces dispositions. Si celle-ci pouvait intervenir au niveau règlementaire, ce serait encore mieux.

La parole est à Mme Laurence Cohen, auteur de la question n° 499, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Monsieur le ministre, faisant suite au pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi et à la nécessité de trouver des recettes pour financer le crédit d’impôt accordé aux entreprises, l’Assemblée nationale a adopté le 5 décembre dernier un amendement visant à augmenter deux des trois taux de TVA.
Ainsi, le taux intermédiaire passerait de 7 % à 10 % dès le 1er janvier 2014. Plusieurs secteurs seraient concernés par cette augmentation.
Cette hausse annoncée crée beaucoup d’inquiétude chez les professionnels du transport. La Fédération nationale des associations d’usagers des transports, la FNAUT, la Fédération nationale des transports de voyageurs, la FNTV, le Groupement des autorités responsables de transport, le GART, et l’Union des transports publics et ferroviaires, l’UTP, viennent d’ailleurs d’adresser un courrier au Premier ministre pour demander un taux réduit à 5 % pour les transports publics.
Cette inquiétude est d’autant plus légitime que cette mesure constituerait quasiment un doublement de la TVA en deux ans, à la suite de la hausse de 2011.
En Île-de-France, par exemple, cela représente environ 100 millions d’euros, une somme qui aura des conséquences sur les finances du Syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF, qui devra répercuter cette hausse soit par une augmentation du prix des tickets, et donc sur les usagers, soit par une diminution des projets de renforts d’offre de bus.
Je précise d’ailleurs que le conseil du STIF, présidé par Jean-Paul Huchon, a adopté à une très large majorité, le 13 décembre dernier, un vœu pour dénoncer cette hausse annoncée et pour proposer, au contraire, une application du taux réduit à 5 %.
Quelques jours après la Journée du transport public, destinée à favoriser la mobilité et à réduire l’usage de la voiture, et après la conférence environnementale, je ne peux que m’associer à cette inquiétude et plaider pour l’application d’un taux réduit pour les transports, considérant qu’il s’agit de biens de première nécessité. Je me permets d’ailleurs de rappeler que les transports publics sont classés comme tels en Allemagne, au Royaume-Uni, au Portugal, en Suède ou encore en Norvège, des pays que l’on aime à citer comme modèles lorsque l’on y trouve intérêt.
Au-delà du positionnement de notre groupe sur le crédit d’impôt, je trouverais particulièrement regrettable que les usagers voient les prix de leurs tickets augmenter pour financer une mesure qui ne les concerne pas. Cette hausse de TVA ne profitera même pas au financement du système de transport public, qui en a pourtant vraiment besoin.
Monsieur le ministre, à l’heure des premiers arbitrages budgétaires pour 2014, pouvez-vous me dire si vous entendez revenir sur cette hausse, qui serait particulièrement impopulaire auprès des usagers et tout aussi inefficace en termes d’incitation à l’utilisation des transports publics dans une optique de développement durable ?
Je vous prie, madame la sénatrice, de bien vouloir excuser l’absence de Bernard Cazeneuve.
Vous avez appelé l’attention du Gouvernement sur les taux de TVA applicables aux transports et sur les conséquences de la hausse du taux de TVA de 7 % à 10 % qui interviendra à compter du 1er janvier 2014 concernant, notamment, les prestations de transport public de voyageurs.
Vous considérez qu’il s’agit de prestations de première nécessité devant bénéficier du taux de TVA réduit de 5 %.
La restructuration des taux de TVA votée l’an dernier contribue au financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Cette mesure fiscale, dont je crois savoir que vous ne la soutenez pas particulièrement, est l’une des pierres angulaires de la politique du Gouvernement en matière macroéconomique puisqu’elle vise à restaurer les marges des entreprises afin de permettre à ces dernières d’investir et de créer de l’emploi. Ce point fait débat entre nous. Le Gouvernement a choisi, pour sa part, de consacrer 20 milliards d’euros à cette mesure de soutien aux entreprises.
Le CICE sera très profitable au secteur du transport collectif et son montant sera supérieur au coût représenté par la hausse de la TVA. Le secteur bénéficiera donc d’un gain net, si bien que les prix pratiqués par les entreprises de transport ne devraient pas, en moyenne, connaître de hausse. En outre, les contrats liant ces entreprises aux collectivités territoriales prévoient souvent une indexation des tarifs sur l’indice du coût du travail.
Le CICE étant pris en compte dans cet indice, il se traduira, pour tous les contrats ainsi rédigés, par une baisse des tarifs pour la collectivité, sans même qu’il faille conclure un avenant au contrat. C’est l’un des impacts positifs attendus du CICE sur la politique tarifaire de ces entreprises.
Enfin, le passage au taux de 5 % du transport public de voyageurs impliquerait un manque à gagner pour la puissance publique et l’État de 1 milliard d’euros, par rapport au relèvement à 10 % voté en loi de finances rectificative pour 2012. Je vous rappelle que le droit communautaire n’autorise pas un traitement différencié pour le transport public et les autres modes de transport.
Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de réduire le taux de TVA sur le transport.

Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, qu’un tel raisonnement est une faute politique. D’un côté, vous prônez des mesures censées privilégier l’environnement, et, de l’autre, vous dites que la TVA n’aura pas d’incidence sur le prix des transports. C’est une mauvaise analyse !
La conseillère régionale d’Île-de-France que je suis considère qu’il y a un besoin très important de financements en Île-de-France.
Au conseil régional, en particulier au sein du STIF, nous avons émis un vœu unanime d’augmentation du versement transport, en vue, justement, de mettre en place une zone et un tarif uniques. Malheureusement, la représentation nationale n’est pas allée dans ce sens.
Vous me dites que la TVA n’aura aucune incidence sur le prix des trajets : vous me permettrez d’en douter fortement !
Il s’agit à mon avis d’un rendez-vous manqué, et je comprends d’autant moins ce positionnement que j’avais eu le sentiment – je suis optimiste, il est vrai ! – que les choses pouvaient bouger. Je le pense toujours, d’ailleurs. François Hollande a en effet annoncé, le 20 septembre dernier, que la TVA pour la rénovation thermique des logements allait passer de 10 % à 5 % en 2014. Pourquoi ne pas prendre des mesures équivalentes pour les transports ? Pour ma part, je les appelle de mes vœux.
J’espère que, en cas d’impact sur la tarification, ce qui serait particulièrement injuste pour les Franciliennes et les Franciliens, la mobilisation sera suffisamment forte.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 529, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Monsieur le ministre, ma question porte sur le délai de dépôt des déclarations de succession.
L’article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l’enregistrement des déclarations pour les héritiers est de six mois à compter du jour du décès. Passé ce délai, un paiement d’intérêts de retard est adressé aux héritiers dans l’attente de la confirmation successorale.
Jusqu’à présent, l’administration fiscale a toujours fait preuve de tolérance dans l’application de cet article, notamment quand seulement une partie des héritiers est connue et qu’il est donc nécessaire d’avoir recours à un généalogiste pour déterminer le reste des héritiers. Il semble que cela ne soit désormais plus le cas. Le comité de contentieux de la chambre des notaires de Paris a remarqué que, au cours des derniers mois, cette pratique de tolérance était remise en cause.
Cette nouvelle interprétation soulève une inégalité de traitement entre les héritiers. Sans avoir connaissance de leur situation, certains doivent s’acquitter de pénalités de retard pour non-paiement de frais de succession, alors qu’ils ne se savaient pas encore héritiers.
De plus, lorsqu’un généalogiste intervient, les notaires ne sont pas toujours informés des avancées de leurs recherches et n’en découvrent l’issue que le jour de la remise du tableau généalogique à date unique, alors que le délai de succession court pour chacun des héritiers.
Enfin, du fait de leur degré de taxation élevée, puisqu’ils ont pour la plupart un lien éloigné avec la personne décédée, et des intérêts de retard qui peuvent s’étaler sur plusieurs années, avec cette nouvelle application de l’article 641, les bénéficiaires pourront être conduits à abandonner la succession.
Monsieur le ministre, le ministre du budget entend-il continuer à demander aux services fiscaux d’adapter l’article 641 aux diverses situations que j’ai évoquées ? Envisage-t-il de prendre des mesures pour que l’interprétation de cet article soit uniforme sur le territoire et, si oui, dans quel sens ?
Madame la sénatrice, l’article 641 du code général des impôts prévoit que le délai de dépôt de la déclaration de succession court à compter du jour du décès. Cependant, lorsque aucun héritier n’est connu à cette date, il est admis que le délai de déclaration imparti aux bénéficiaires de la succession ne commence à courir que du jour où il leur est révélé l’ouverture de la succession. Ce cas ne se produit que lorsque aucun héritier n’est connu le jour du décès ; il ne s’applique donc pas lorsqu’un héritier est connu à cette date.
L’héritier concerné a l’obligation légale de déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès. Dès lors, toute demande d’abandon des pénalités afférentes à un dépôt hors délai relève d’une décision de remise gracieuse dont l’opportunité est appréciée par l’administration en fonction des circonstances propres à chaque succession.
Contrairement à ce que laisse entendre le comité de contentieux de la chambre des notaires de Paris, il n’y a pas eu ces derniers mois de modification des modalités de traitement des demandes de remise gracieuse. En effet, aucune directive générale n’a été donnée aux services concernant le traitement des demandes de remise relatives aux successions par la Direction générale des finances publiques.
Lors des demandes de remise ou de modération, il est effectué un examen au fond des requêtes tendant à obtenir, à titre gracieux, l’abandon total ou une atténuation des majorations ou amendes. D’une manière générale, les critères retenus lors de chaque demande sont de même nature pour toutes les majorations et amendes, quelle que soit la matière fiscale à laquelle elles se rapportent.
Ces critères sont tirés, d’une part, des circonstances particulières à l’infraction sanctionnée, du comportement habituel du contribuable et, le cas échéant, de ses antécédents contentieux et, d’autre part, de la situation personnelle et des possibilités de paiement de l’intéressé. Par ailleurs, il n’est pas prévu de prendre de mesure dérogatoire s’agissant du traitement des demandes de remise concernant les successions pour lesquelles il est fait appel à un généalogiste.

Monsieur le ministre, la chambre des notaires de Paris et l’ensemble des notaires de France étudieront avec intérêt votre réponse, en particulier le fait qu’aucune directive générale modifiant l’interprétation de l'article 641 du code général des impôts n’a été donnée.
Selon vous, un examen au fond des requêtes détermine l’application ou non de pénalités de retard. Je ne suis pas spécialiste de ces dossiers, mais le passé ou la situation personnelle de chacun des héritiers ne me paraissent pas des critères très équitables, surtout si les personnes concernées ont découvert leur statut d’héritier deux mois, voire un mois avant le terme fixé. On peut être héritier et ignorer par exemple que celui ou celle dont on recueille la succession a reconnu dans un autre pays des enfants, qui maintenant habitent en France.
Les notaires sauront à mon avis étudier ces éléments de réponse et les utiliser en cas de contentieux. Le fait de ne pas se savoir héritier justifie à mes yeux un allongement du délai légal.
En outre, l’appréciation de la situation devrait être la même partout en France. Or c’est à Paris que l’application de l'article 641 semble la plus restrictive.

La parole est à M. Dominique de Legge, auteur de la question n° 515, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

Monsieur le ministre, la loi de finances rectificative pour 2012 modifie les règles actuelles de calcul de la valeur locative applicable aux ports de plaisance à compter du 1er janvier 2014.
La valeur locative est fixée de la façon suivante : 110 euros pour les ports de plaisance de la Méditerranée, 80 euros pour les ports de plaisance maritime de la Manche et de l’Atlantique, 55 euros pour les ports non maritimes.
La loi dispose que, pour chaque port, après avis des commissions communales et intercommunales prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts, le tarif peut être minoré ou majoré de 20 % ou de 40 %, en fonction des services et des équipements offerts, les modalités d’évaluation desdits équipements ou services justifiant la majoration.
Ces nouvelles dispositions, sources de difficultés d’interprétation et de situations inéquitables, soulèvent plusieurs questions.
Tout d’abord, quelle est la définition exacte du poste d’amarrage, base des futurs calculs des services fiscaux ? La valeur locative est fixée par poste d’amarrage, mais le texte ne précise nullement ce qu’il faut entendre par poste d’amarrage d’un point de vue fiscal. Or il existe une grande variété de postes – à quai, sur ponton flottant, mouillage –, eux-mêmes adaptés à des types et à des tailles de bateaux très différents. Au regard de tant des cas, comment définir les niveaux de services et d’équipements qui seront la condition de la modulation de la valeur locative ?
Ensuite, est-il judicieux de fixer pour une très grande façade maritime un barème unique qui ne tienne pas compte des disparités pouvant exister à l’échelon local ? Les ports de la façade Atlantique sont ainsi mis sur le même plan que ceux de la Manche ou de la mer du Nord.
Enfin, est-il normal de fixer pour une même région une valeur locative identique pour un port disposant d’infrastructures majoritairement adaptées à des bateaux de six mètres et pour un port ayant un nombre similaire de postes d’amarrage adaptés à des bateaux de douze mètres ? Cette méthode forfaitaire me semble déroger totalement au principe inscrit dans le code général des impôts, qui évalue la valeur locative en fonction du loyer qui pourrait être perçu.
On le voit, l’uniformisation des tarifs risque de fragiliser la situation de certains ports de plaisance qui subiraient un alourdissement de leur taxe foncière conjugué peut-être à une désaffection dommageable de leur clientèle.
Monsieur le ministre, je souhaite connaître votre réponse à ces questions qui traduisent l’inquiétude des professionnels.
Monsieur le sénateur, l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoit que la valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance est fixée à compter de 2014 selon le tarif que vous avez rappelé, à savoir 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 euros pour les autres ports maritimes et 55 euros pour les ports non maritimes.
Après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs, ces tarifs pourront être minorés ou majorés de 20 % ou de 40 % en fonction des services et des équipements offerts, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État.
En proposant l’année dernière l’adoption de cette réforme au Parlement, le Gouvernement a cherché à clarifier et à encadrer les méthodes de valorisation qui étaient jusqu’alors pratiquées par l’administration fiscale. Le tarif forfaitaire fixé dans la loi était celui qui était utilisé jusque-là dans les évaluations de la valeur foncière. La loi permet désormais de borner la capacité de l’administration à moduler ce tarif en fonction des caractéristiques locales. Surtout, elle prévoit qu’un décret précisera les critères de modulation afin d’offrir aux contribuables une transparence maximale sur la méthode de l’administration.
Ce décret, en cours de rédaction, précisera quels critères, liés aux prestations et services offerts aux plaisanciers par les gestionnaires des ports, seront pris en compte pour la modulation à la hausse ou à la baisse prévue par la loi. Le projet de décret est actuellement soumis aux représentants des ports de plaisance, afin qu’il soit aussi proche que possible des réalités locales et des spécificités qui influent sur la valeur foncière des ports. Les échanges qui ont eu lieu avec les professionnels ont notamment permis de mesurer l’importance de la taille des emplacements comme déterminant de cette valeur foncière.
L’emploi de ces critères, qui font toujours l’objet d’une concertation, permettra d’adapter la valeur foncière aux particularités de chaque port. Par exemple, selon l’importance des prestations offertes, la valeur locative des ports de la façade Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord sera calculée sur la base d’un tarif qui pourra aller de 48 euros à 112 euros. Cet écart permet de traduire la diversité des infrastructures et des services mis à disposition des plaisanciers dans les différents ports.
Selon les simulations réalisées sur les effets de la réforme, certains ports seront gagnants, d’autres perdants. Les ports perdants sont, pour beaucoup, ceux dont la valeur foncière est aujourd’hui manifestement sous-estimée, mais, pour chaque plaisancier, le surcoût annuel demeurera très limité.
Au terme de la concertation avec les représentants de la plaisance, il sera temps de déterminer si un correctif législatif est nécessaire dans les projets de loi de finances de fin d’année.

Monsieur le ministre, j’espère que le décret en Conseil d’État auquel vous renvoyez sera publié avant le 1er janvier 2014, soit dans trois mois. À vous entendre, il est en cours de rédaction. En tout cas, vous n’avez pas répondu sur la définition exacte du poste d’amarrage.
Vous n’excluez pas un correctif législatif s’il apparaissait que le décret envisagé ne réglait pas tous les problèmes. J’en prends bonne note. Je pense que nous serons conduits à revenir sur ce sujet dans trois mois.

La parole est à Mme Jacqueline Alquier, auteur de la question n° 531, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

Monsieur le ministre, ma question est certes technique, mais touche aujourd’hui un certain nombre d’entrepreneurs dans notre pays. Elle porte sur les règles fiscales applicables aux plus-values de cession d’entreprise en cas de crédit-vendeur.
Comme vous le savez, lors de la vente d’une entreprise avec crédit-vendeur, la personne qui vend son entreprise est immédiatement imposée au titre de la plus-value, et ce dès la date de cession de l’entreprise. Pourtant, à cette même date, elle n’a perçu qu’une partie des revenus de la vente.
Cette règle pourrait aller de soi si chaque vendeur était assuré de voir l’acheteur honorer le crédit-vendeur qu’il a contracté. Or il peut tout à fait arriver que ce ne soit pas le cas et que le vendeur voie une partie des revenus issus de la vente de son entreprise disparaître. C’est le risque du crédit, et nous le comprenons tous. Cependant, le cédant demeure imposé sur la totalité du prix de cession et non sur la partie effectivement reçue, payée par l’acheteur.
Or, comme tout le monde le sait, pour être exigé, l’impôt doit avoir une assiette. En l’absence de versement d’une partie du prix de cession, il est difficile d’établir la base d’imposition sur cette somme non perçue.
Prenons maintenant une situation semblable de transmission d’entreprise.
Dans ce cas précis, il est possible, avec l’article 150-0 A du code général des impôts, de voir l’imposition liée à la transmission de l’entreprise assise sur un prix révisé.
Au regard du principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, comment expliquer que deux contribuables placés dans des situations semblables soient traités différemment ?
Monsieur le ministre, je vous poserai deux questions précises.
Dans la situation que je viens d’exposer, qu’est-ce qui justifie qu’un citoyen soit imposé sur une somme qu’il n’a pas perçue et qu’il ne percevra jamais ?
Comment le Gouvernement corrigera-t-il cette règle fiscale, et compte-t-il revenir sur les impositions injustifiées qu’elle a entraînées ?
Madame la sénatrice, vous évoquez la situation des cessions d’entreprise réalisées dans le cadre d’un crédit-vendeur.
La situation que vous exposez est plus précisément celle d’une défaillance de l’acquéreur postérieurement à la cession, auquel cas le vendeur n’aura effectivement encaissé qu’une partie du prix initialement convenu. Il est pourtant imposé, comme vous l’indiquez, sur la totalité du prix de cession, ce qui peut soulever des difficultés financières pour la personne concernée.
La question est de savoir si le cédant peut se prévaloir d’un impayé pour demander restitution de l’impôt acquitté sur la plus-value réalisée au titre de l’année de cession. En l’état du droit, selon les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts, le fait générateur d’imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des titres.
L’impôt étant établi au titre de l’année au cours de laquelle la cession est intervenue, les modalités de paiement du prix n’ont pas d’incidence sur l’exigibilité de l’impôt, et le cédant ne peut dès lors se soustraire à son paiement en se prévalant de la non-perception d’une partie du prix. Il en va autrement seulement dans les cas de contrats annulés, résolus ou rescindés.
Une évolution de la doctrine fiscale en la matière a été mise à l’étude, mais elle soulève des questions techniques et juridiques délicates, dont l’expertise n’est pas achevée.
Mme Linda Gourjade, député du Tarn, a soulevé le même problème que vous dans le cadre de sa question écrite n° 31907 publiée le 9 juillet dernier. Celle-ci fait l’objet actuellement d’une expertise approfondie par les services du ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, qui s’engage à vous apporter dans le cadre de cette question une réponse qui soit adaptée à vos préoccupations et la plus complète possible.
En clair, puisque l’expertise se poursuit depuis juillet, je me ferai l’interprète de votre demande auprès du ministre pour que celle-ci s’accélère et que nous puissions vous répondre ultérieurement de manière très précise sur les conditions dans lesquelles faire évoluer la doctrine fiscale dans ce domaine afin d’éviter la situation où une personne paie un impôt sur une somme qu’elle n’a jamais perçue.

Bien que les lourdeurs et les lenteurs de l’administration persistent, il me semble néanmoins avoir perçu une certaine évolution. Je ne manquerai pas de vous interpeller à nouveau si celle-ci tardait trop.
En tous les cas, que ce soit Mme Gourjade ou moi-même, nous veillerons à une évolution de la législation sur ce problème.

La parole est à M. Alain Dufaut, auteur de la question n° 528, transmise à M. le ministre de l'économie et des finances.

Monsieur le ministre, ma question porte sur les dépenses engagées par la Banque publique d’investissement, ou Bpifrance, depuis sa création.
La Banque publique d’investissement, qui succède à OSÉO, s’illustre par des dépenses somptuaires bien éloignées de sa vocation d’accompagnement des petites et moyennes entreprises pour leur financement au service de la compétitivité.
Actuellement, elle est propriétaire d’un immeuble de plus de 30 000 mètres carrés à Maisons-Alfort, où elle vient d’installer son siège social. Ce dernier se situe à quelque trois kilomètres de Bercy et à proximité immédiate du centre de Paris.
Or, nous avons appris que la Banque publique d’investissement a décidé de louer, au cœur de Paris, boulevard Haussmann, 10 800 mètres carrés supplémentaires en signant, pour cet immeuble, un bail de neuf ans pour un loyer de 6, 6 millions d’euros par an.
À ces dépenses immobilières, s’ajoute un budget de communication pour le lancement de la « marque » Bpifrance d’un montant considérable : 7 350 000 euros, dont 300 000 euros pour la seule création d’un logo.
Il serait donc souhaitable que le Gouvernement s’assure que la Banque publique d’investissement, sous tutelle de l’État, soit sobre, efficace et réellement au service de la compétitivité des PME.
Quelles actions le Gouvernement envisage-t-il donc de prendre auprès de la gouvernance de la Banque publique d’investissement et de son directeur général afin de faire cesser ces dépenses inconsidérées ?
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité interroger le ministre de l’économie et des finances sur les dépenses engagées par Bpifrance. Ma réponse sera très concrète et très précise, peut-être trop.
Concernant les implantations des équipes parisiennes de Bpifrance, le site du boulevard Haussmann est le site de l’antenne parisienne de l’entreprise. Le siège et la direction générale de l’entreprise sont bien situés à Maisons-Alfort, comme vous l’avez rappelé.
Le siège de Maisons-Alfort ne peut accueillir la totalité des effectifs concernés de Bpifrance. Quand l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, quittera les 4 000 mètres carrés qu’elle occupe dans ce bâtiment, les équipes des fonctions supports actuellement situées dans d’autres immeubles à proximité seront réintégrées au siège.
Le choix d’une implantation boulevard Haussmann est économiquement justifié par le regroupement d’équipes autrefois dispersées entre la rue de Lille, la rue de l’Université et la rue Joubert, pour un loyer de 560 euros le mètre carré en moyenne.
Les 6, 6 millions d’euros par an mentionnés pour les 10 800 mètres carrés boulevard Haussmann correspondent au tarif catalogue avant négociation – 612 euros le mètre carré –, alors que le loyer qui sera in fine versé, pour un bail de neuf ans, est de 462 euros le mètre carré par an, les avantages jouant à plein sur les cinq premières années avec un loyer économique de 369 euros le mètre carré pendant cette période. Cette nouvelle implantation permet donc d’économiser 9 millions d’euros sur neuf ans.
Lorsque la nécessité de trouver une surface de plus de 10 000 mètres carrés s’est fait jour, deux scénarios de déménagement complet de l’ensemble du site de Maisons-Alfort ont été examinés : l’un Porte de Pantin, l’autre à La Défense. Dans les deux cas, l’équation économique n’était pas convaincante sachant que le bâtiment de Maisons-Alfort appartient à Bpifrance en pleine propriété, et la justification opérationnelle insuffisante pour convaincre les 1 000 collaborateurs de Maisons-Alfort de basculer de l’est de Paris, où ils sont pour l’essentiel domiciliés, vers l’ouest.
L’option privilégiée a été la recherche d’une nouvelle surface de 10 000 mètres carrés. Trente-cinq sites ont été sélectionnés, soit la quasi-totalité des produits disponibles eu égard à la surface nécessaire dans le délai imparti. Sur ces trente-cinq sites, dix-neuf ont été visités. Sur ces dix-neuf sites, seize présentaient un loyer facial supérieur ou significativement supérieur au loyer économique obtenu sans perspectives de réelle négociation.
Quant aux deux autres sites, soit ils requéraient des travaux trop importants, soit ils étaient trop éloignés des relations d’affaires des équipes concernées. Les chargés d’investissement sont en effet au contact permanent d’entrepreneurs venus de toute la France et de partenaires tous installés dans le centre de Paris.
L’antenne parisienne boulevard Haussmann a vocation à accueillir de 350 à 500 personnes, salles de réunion, archives et locaux techniques compris. Sur cette surface de 10 800 mètres carrés, 300 mètres carrés seront consacrés à l’accueil de TPE et de PME des régions, qui disposeront, moyennant un abonnement modique, d’espaces de travail, d’accueil et de démonstration-exposition de leurs produits et services.
Au niveau social, ce dispositif a facilité l’accord de construction sociale conclu le 3 juin dernier avec l’ensemble des organisations syndicales de toutes les entités constitutives de Bpifrance. Sans cet accord, la mise en œuvre rapide de Bpifrance n’aurait pas été possible.
J’ajoute que Bpifrance est une entreprise publique et non un opérateur de l’État. À ce titre, elle n’est pas soumise aux règles mises en œuvre par France Domaines sur l’immobilier public.
Concernant les dépenses de communication, je précise tout d’abord que la création du logo de Bpifrance a coûté non pas 300 000 euros, mais 70 000 euros. De plus, le lancement de la nouvelle structure et de la nouvelle marque a entraîné la construction d’une plate-forme de communication indispensable à la concrétisation des missions que le législateur a confiées à Bpifrance.
Enfin, la communication de Bpifrance n’a qu’un objectif : l’information des entreprises dans leurs démarches de recherche de financement. Cette bonne information des entrepreneurs est d’autant plus nécessaire que le sujet du financement des entreprises est crucial dans le contexte actuel, et qu’elle est réclamée par les entrepreneurs eux-mêmes et par les nombreux élus qui se font l’écho de ces derniers.
Pour conclure, soyez assuré, monsieur le sénateur, que, au-delà de la phase de lancement, les actionnaires de Bpifrance, l’État et la Caisse des dépôts et consignations veilleront scrupuleusement à la sobriété des moyens dévolus à la communication de Bpifrance.

Je vous remercie, monsieur le ministre, pour ces éléments de réponse, quoiqu’ils ne m’aient pas particulièrement convaincu ni rassuré. Il me paraît urgent de mettre un terme à des dépenses indécentes de Bpifrance qui sont manifestement contraires à la vocation première de cette banque.

Avant d’aborder la prochaine question orale, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures vingt-cinq, est reprise à dix heures trente-cinq.

La parole est à M. François-Noël Buffet, auteur de la question n° 473, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Madame le ministre, à travers la loi de refondation de l’école, votre ambition, bien naturelle, est la réussite pour tous. Nous entendons que la lutte contre l’échec scolaire est une priorité nationale, et nous partageons avec vous cet objectif.
Comme vous le savez, la pratique musicale, et plus largement artistique, a des conséquences directes sur l’acquisition des fondamentaux de l’école, tout en favorisant l’équilibre des enfants dans leur développement. Depuis trente ans, les neuf centres de formation de musiciens intervenants, ou CFMI, forment des artistes – tous musiciens professionnels – pour que les enfants pratiquent la musique à l’école primaire dans une démarche de projet avec les professeurs des écoles. L’action des 5 000 musiciens intervenant à l’école ou « dumistes » est ainsi unanimement reconnue tant par les employeurs – les élus des collectivités locales que nous sommes – que par les responsables des ministères de l’éducation nationale et de la culture, les professeurs des écoles et les parents d’élèves.
Les « dumistes » sont incontestablement des acteurs professionnels importants pour relever ce défi de la réussite scolaire pour tous les enfants de France. Or, malgré le bilan positif de leur action, qui s’inscrit totalement dans les objectifs et les attendus de la loi, les CFMI sont aujourd’hui en difficulté. Ils sont de moins en moins en capacité de maintenir le cap des objectifs ambitieux de formation artistique, supérieure et professionnelle que les trois ministères de l’éducation nationale, de la culture et de l’enseignement supérieur leur ont fixés dans les années quatre-vingt. En effet, l’absence d’une concertation régulière entre les services centraux des trois ministères porte atteinte à la pérennité des moyens humains et financiers mis à disposition de ces établissements.
Je souhaite donc vous poser deux questions aujourd’hui.
Premièrement, comment le Gouvernement envisage-t-il de préserver et de renforcer les lieux de formation que sont les centres de formation de musiciens intervenant à l’école et de s’appuyer sur les artistes, musiciens professionnels, qui en sont issus, pour atteindre l’ambition de réussite scolaire pour tous inscrite dans cette nouvelle loi ?
Deuxièmement, comment le Gouvernement compte-t-il réactiver la coopération interministérielle, indispensable pour un vrai développement de l’éducation artistique et culturelle dans nos écoles et nos communes ?
Monsieur Buffet, j’ai bien entendu vos interrogations sur l’avenir des centres de formation de musiciens intervenant à l’école, et je vais donc tâcher de vous rassurer.
Comme vous le savez, le 29 avril 1983, les ministres chargés de l’éducation nationale et de la culture ont signé un protocole d’accord afin de développer une collaboration entre le service public de l’éducation et le secteur culturel. Dans le cadre de cet accord, des CFMI à l’école élémentaire et préélémentaire ont été créés. Au nombre de neuf, ils fonctionnent au sein de neuf universités françaises et sont habilités à délivrer le diplôme universitaire de musicien intervenant.
L’objectif de ces centres est de donner à des musiciens une formation spécifique, à la fois musicale, pédagogique et générale, leur permettant de travailler, dans le cadre de l’école élémentaire et préélémentaire, en collaboration avec les professeurs des écoles. Ces musiciens apportent donc leur collaboration aux enseignements et activités artistiques à l’école, leurs interventions ayant lieu durant le temps scolaire.
Leur formation comporte également une dimension de médiation culturelle qui accompagne, dans les grandes zones urbaines, les partenariats mis en place par diverses institutions. Au fil des années, il est apparu que les titulaires de ce diplôme exerçaient non seulement dans des écoles maternelles et élémentaires, mais également dans des écoles de musique ou des associations culturelles. Leurs compétences sont aussi reconnues par des établissements spécialisés tels que des crèches, des hôpitaux, des maisons de retraite, des centres pénitentiaires, etc.
L’article 10 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République définit le rôle de l’éducation artistique et culturelle, qui participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. Je tiens à cet égard à vous rassurer : l’éducation musicale et les CFMI s’inscrivent pleinement dans le parcours d’éducation artistique et culturelle instauré par la loi. Ils constituent une richesse qu’il convient de ne pas négliger.
Comme vous le soulignez, la pratique musicale, et plus largement artistique, a des conséquences directes sur l’acquisition des fondamentaux de l’école ; elle permet également de mieux lutter contre l’échec scolaire. Ainsi, afin de réduire efficacement les inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture, la loi du 8 juillet 2013 met en place un parcours d’éducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la scolarité des élèves, ce qui donnera à chaque enfant la possibilité de développer sa créativité, sa curiosité intellectuelle, sa sensibilité et son jugement esthétique.
Dans ces conditions, le rôle des CFMI doit être conforté, et nous avons d’ores et déjà défini le pilotage et le suivi du parcours d’éducation artistique et culturelle. De surcroît, les futurs enseignants, dans le cadre de leur formation dispensée au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, seront sensibilisés au travail avec d’autres acteurs que ceux de l’éducation nationale, notamment ceux qui sont issus des milieux culturels ou artistiques comme les musiciens du CFMI.
La refondation de l’école suppose une plus grande ouverture de l’établissement sur son environnement. La nouvelle organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ménage précisément des séquences consacrées à une activité culturelle, en lien avec l’environnement de l’école.
Les CFMI apparaissent donc comme des partenaires incontournables dans la mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle. Une réflexion commune des ministères chargés de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la culture va toutefois s’engager afin de conforter leur rôle dans la formation d’intervenants qui ont toute leur place dans la mise en œuvre des parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves.
Vous le voyez, la loi d’orientation et de programmation est une bonne loi. Dommage que vous ne l’ayez pas votée…

Dans la commune d’Oullins, que j’ai l’honneur de diriger, nous salarions quatre musiciens intervenants depuis près de dix-sept ans maintenant. Ils collaborent étroitement avec l’éducation nationale, pour un résultat tout à fait exceptionnel.
Nul besoin de voter des lois pour parvenir à ce résultat. Il suffit de travailler avec les gens du CFMI, de les rassurer, de les conforter dans leur travail et de leur permettre de l’exercer correctement.
Je vous remercie toutefois de vos propos, madame le ministre : ces centres de formation doivent en effet être préservés. Ils doivent aussi pouvoir être identifiés, car ils accomplissent un travail important.

La parole est à M. Marc Laménie, auteur de la question n° 542, adressée à M. le ministre de la défense.

Ma question porte sur le devenir du 3e régiment du génie, en garnison à Charleville-Mézières, sur lequel planent des menaces de fermeture depuis plusieurs années.
Ce régiment, qui a été créé dans les années 1810, est installé à Mézières depuis 1947. Il attestait la volonté de la nation de maintenir une présence militaire sur ses frontières – de par la position géographique du département des Ardennes –, car, si les Ardennes sont aujourd’hui au cœur de l’Europe, elles ont payé un lourd tribut aux guerres qui se sont succédé au cours des XIXe et XXe siècles.
La disparition de cette unité aurait des conséquences économiques et sociologiques désastreuses. Elle impliquerait une perte de 2 000 habitants dans la ville chef-lieu et marquerait la fin irrémédiable de la présence militaire dans les Ardennes, après le départ du 12e régiment de chasseurs de Sedan, dans les années 1980, et la fermeture du centre d’entraînement commando de Givet en 2008.
À l’heure où l’on s’apprête à commémorer le centenaire de la guerre de 1914, je souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement quant au maintien d’une présence militaire sur le sol ardennais.
Certes, le ministre de la défense a indiqué hier que le 3e régiment serait maintenu en 2014. Cependant, les perspectives pour 2015-2019 ne sont pas rassurantes. De nombreuses interrogations demeurent et interpellent les Ardennaises et les Ardennais, les forces vives et les élus. La présence de ce régiment est vitale pour le département des Ardennes !
Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser Jean-Yves Le Drian, retenu par d’autres obligations et qui m’a demandé de vous répondre.
Le projet de loi de programmation militaire présenté par le ministre de la défense en Conseil des ministres le 2 août dernier va déterminer la configuration de nos armées pour les années à venir, sur la base des orientations définies par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale remis au Président de la République le 29 avril 2013.
La loi de programmation militaire repose sur un effort financier important de la nation avec la reconduction décidée par le Président de la République du budget de la défense à hauteur de 31, 4 milliards d’euros, c’est-à-dire au niveau où il se situe cette année.
Cette loi respecte un équilibre entre les deux impératifs qui s’imposent à nous : celui de notre autonomie stratégique et celui de notre autonomie budgétaire, qui est un autre enjeu de souveraineté pour notre pays. Elle fixe également un cap ambitieux : la France se donne les moyens de mettre en œuvre un modèle d’armées adapté aux évolutions de notre environnement stratégique des quinze prochaines années.
Dans le même temps, la loi de programmation militaire intègre pleinement la nécessité d’un redressement des comptes publics et s’inscrit dans la trajectoire budgétaire globale de la nation, ce qui nécessite un nouvel effort de nos armées, comme de l’ensemble de nos administrations publiques. À cet égard, la diminution nette des effectifs pour la période 2014-2019 résulte des objectifs arrêtés cette année – 23 500 emplois – et des suppressions qui restent à opérer au titre de la précédente programmation militaire. Dans le détail, il faut souligner que les nouvelles suppressions .de postes concerneront pour les deux tiers l'administration, les soutiens, les structures organiques des états-majors et pour un tiers seulement les forces opérationnelles.
C'est dans ce contexte de réforme globale que viennent d'être prises les décisions de restructurations des armées pour l'année 2014.
Le ministre de la défense a souhaité prendre le temps de l'écoute avant de rendre ses arbitrages. Le choix des régiments, bases aériennes ou structures administratives devant être conservés résulte donc d'une analyse fonctionnelle et multicritères.
Au-delà de cette analyse, le ministre de la défense a conduit sa réflexion dans une logique de préservation des forces et des missions, avec le souci constant de l’aménagement du territoire. Il a donc été tenu le plus grand compte de l'implantation ancienne des unités militaires et de la situation économique et sociale des territoires concernés ainsi que des éventuelles restructurations prévues par d'autres administrations de l'État.
S'agissant du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières, et ce dès avant l'été, Jean-Yves Le Drian a pu prendre toute la mesure de l'attachement que Charleville-Mézières porte à son régiment, en garnison dans la ville depuis 1947, notamment par la voix de la maire, Mme Claudine Ledoux, du député de la circonscription, M. Christophe Léonard, ainsi que du président du conseil régional de Champagne-Ardenne, M Jean-Paul Bachy. Vous-même, monsieur le sénateur, serez également reçu au ministère dans les tout prochains jours.
Lors des échanges entre les élus et le ministère, il a été souligné que la Champagne-Ardenne n'a pas été épargnée par les restructurations antérieures et que, d'une manière générale, la région fait face à des problématiques d'aménagement du territoire qui doivent être prises en compte à un niveau interministériel.
Il résulte de tous ces éléments que le 3e régiment du génie de Charleville-Mézières ne sera pas impacté par les rationalisations d'effectifs en 2014 et que sa présence sera maintenue sur le sol ardennais. Pour les territoires qui seront quant à eux impactés par des restructurations, un accompagnement spécifique est prévu tant vis-à-vis des élus, du corps préfectoral que du personnel civil et militaire.
Voilà la réponse positive que je suis en mesure de vous apporter de la part de M. Le Drian.

Je remercie M. le ministre de la défense, ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi que vous, madame la ministre, de cette réponse. Cependant, je demeure réservé quant aux éléments qui me sont apportés. Certes, pour l’année 2014, la présence du régiment à Charleville-Mézières est assurée, mais après ?
Nous comprenons les contraintes financières pesant sur le budget de l’État. Nous partageons tous, dans cet hémicycle, cette préoccupation. Reste que l’impact économique, humain, social d’une fermeture du 3e régiment du génie serait important pour le département des Ardennes, qui a un vrai passé militaire – comme d’autres départements, je m’empresse de le dire.
Malgré le sursis accordé pour l’année 2014, la période 2015-2019 reste exposée à de nombreuses incertitudes, et nous ne sommes pas rassurés. Nous resterons donc vigilants.

La parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 487, adressée à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Ma question concerne le dispositif d’affichage environnemental expérimenté entre juillet 2011 et juillet 2012 dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », et qui devait faire l’objet d’un rapport d’évaluation, le Parlement pouvant être saisi en vue d’une éventuelle généralisation du dispositif.
Il apparaît que la méthodologie utilisée dans le cadre de cet affichage – l’analyse du cycle de vie – provient du monde industriel. Elle nous semble par conséquent totalement inadaptée au secteur agricole, d’autant qu’elle aboutit à des résultats qui relèvent du non-sens écologique : les produits les plus pénalisés sont ceux qui sont issus des systèmes d’élevage les plus extensifs, voire biologiques.
En se focalisant sur les émissions de méthane « tout au long de la vie » des ruminants et en ne tenant absolument pas compte des externalités positives, comme l’entretien des prairies, les viandes rouges issues de ces filières d’élevages herbagers se retrouvent « dernières de la classe » en matière d’impact environnemental. De même, l’affichage environnemental défavorise le « local », les impacts du transport étant négligeables par rapport à ceux de l’amont et de la production.
Le constat négatif est donc double.
En premier lieu, parce qu’il repose sur des méthodes non consolidées et des bases de données non fiables, l’affichage environnemental sera à l’origine d’une véritable désinformation du consommateur. Comment celui-ci percevra-t-il le fait qu’une viande étiquetée bio soit si mal « notée » sur le plan environnemental ?
En second lieu, l’affichage environnemental n’aboutira pas à une amélioration des pratiques en matière de préservation de l’environnement, puisque les méthodes sont encore trop peu fiables et simplistes pour servir d’outils d’amélioration dans les exploitations. Actuellement, elles conduiraient à abandonner l’herbe dans l’alimentation des ruminants pour qu’ils émettent moins de méthane, ce qui serait une aberration.
Ce sont donc les objectifs mêmes de la mise en place d’un affichage environnemental qui se trouvent « annulés » par ces limites méthodologiques.
Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais connaître vos intentions face à ce paradoxe écologique – ce n’est pas le seul, nous en connaissons beaucoup. N’est-il pas nécessaire de laisser le temps de la réflexion et de l’étude, pour aboutir à une information juste et utile pour le consommateur, plutôt que de se précipiter dans une mesure qui ne relèverait que du marketing et de « l’éco-blanchiment » ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question qui porte sur un sujet que la commission du développement durable de la Haute assemblée, présidée par mon ami Raymond Vall, a traité à l’occasion d’une table ronde qui s’est tenue au mois de juin dernier.
L’affichage environnemental doit permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause les produits qu’ils achètent, en intégrant entre autres critères l’impact des produits sur l’environnement. Il s’agit d’un outil précieux pour la transition écologique, car il vise à donner davantage de poids et de pouvoir aux citoyens pour orienter les modes de production, sans alourdir les normes qui pèsent sur les producteurs.
Ainsi, dans la continuité des travaux engagés par votre assemblée, je souhaite que nous poursuivions avec détermination dans cette direction.
Bien sûr, la mise en œuvre d’un tel instrument mérite de la concertation. Nous devons prendre en compte les spécificités de chaque secteur, et particulièrement du secteur agricole. Venant moi-même d’un territoire – le Gers – particulièrement rural qui compte un important cheptel de Blondes d’Aquitaine, je suis sensible au fait que l’on ne méconnaisse pas la réalité du travail de nos éleveurs.
Je n’ignore pas les critiques adressées à la méthode actuelle de calcul des impacts environnementaux ou les inquiétudes qu’elle suscite dans le secteur agricole. Soyez assuré que nous prenons en considération ces inquiétudes et qu’un important travail d’analyse est mené pour tenir compte des spécificités du secteur agroalimentaire et des labels existants.
Mes services mènent actuellement plusieurs actions pour dissiper ces inquiétudes.
Ainsi, un rapport du commissariat général du développement durable tirera prochainement les enseignements d’une première expérimentation nationale, laquelle a rassemblé cent soixante-huit entreprises volontaires des secteurs de l’agroalimentaire, du textile, de l’ameublement, de la beauté, de l’hygiène et de l’hôtellerie. Cette expérimentation portait sur un affichage multicritères intégrant les émissions de CO2.
Je peux d’ores et déjà vous annoncer que cette phase d’essai a confirmé l’intérêt et la faisabilité de l’affichage environnemental. L’expérimentation a également mis en évidence l’ampleur du travail restant à accomplir avec tous les acteurs et notamment – vous avez raison d’y insister – les producteurs du secteur agricole. C'est pourquoi une nouvelle méthode de calcul des empreintes carbone des produits agroalimentaires est en cours d’élaboration. Cette nouvelle méthode sera plus favorable à l’élevage extensif et prendra mieux en compte le stockage de carbone dans les prairies et la qualité herbagère. On ne parle pas assez du rôle des prairies dans le stockage du carbone.
Les instituts techniques agricoles et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, travaillent sur cette nouvelle méthode avec des chercheurs.
Une étude a également été pilotée pendant un an par mon ministère afin de construire un indicateur « biodiversité » pour les produits agricoles et d’élevage. Cet indicateur est fondé sur les infrastructures agro-écologiques ; il est donc favorable à l’élevage biologique.
En conclusion, je tiens à souligner que la Commission européenne, inspirée par les initiatives françaises, qui sont pour le moment uniques en Europe, vient de décider de lancer sa propre expérimentation, qui aura lieu de 2014 à 2016. Avec 11 % des projets déposés, la France est le premier État membre pour le nombre de candidats à l’expérimentation européenne.
Avec tous les acteurs, ainsi qu’avec vous-même, monsieur le sénateur, je veillerai à la bonne avancée du dossier dans sa globalité et à la mise en place de modalités pertinentes pour chaque secteur, et notamment pour le secteur agricole.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je ne doutais pas que la Blonde d’Aquitaine du Gers…

M. Jacques Mézard. … pouvait sauver la production bovine de nos départements.
Sourires.

Je me félicite qu’une nouvelle méthode de calcul des empreintes carbone soit en cours d’élaboration. Vous savez comme moi, et comme nous tous, que, si nous ne prenons pas de dispositions spécifiques pour l’élevage, l’affichage environnemental aura des effets contraires à ce que nous souhaitons tous : nous pénaliserons durement la production agricole et en particulier l’élevage. Il est donc indispensable que la nouvelle méthode de calcul tienne vraiment compte des spécificités de l’élevage et des qualités de nos prairies.

La parole est à Mme Mireille Schurch, auteur de la question n° 534, adressée à M. le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Je commencerai par citer les propos qu’a tenus le ministre du redressement productif lors de la présentation des trente-quatre plans de reconquête industrielle : « Redonner le goût de l’industrie et de l’innovation, engager la bataille du Made in France, c’est d’abord croire en nous-mêmes. C’est poser un regard résolument optimiste sur les capacités de notre pays à se redresser. Une nation sans industrie est une nation qui se condamne au déclin. »
Parmi les plans de reconquête industrielle, le plan « Réseaux électriques intelligents » a vocation à consolider les filières électriques et informatiques françaises sur de nouveaux marchés à forte croissance et créateurs d’emplois. Le plan doit également permettre d’accompagner le déploiement des compteurs communicants Linky. Le compteur Linky est un fleuron de la technologie française. Il a été mis au point en France, sur le site montluçonnais de l’entreprise Landis+Gyr, dont je suis fière. Ses équipes de recherche et développement ont travaillé avec ERDF pour en faire un produit disposant de composants et de logiciels évolutifs.
Le Premier ministre a récemment annoncé le lancement d’un appel d’offres en vue d’installer les compteurs de nouvelle génération d’ici à 2018. L’entreprise montluçonnaise est bien placée pour répondre à un tel appel d’offres, car elle dispose de l’historique du produit et de l’expertise nécessaire. C’est un atout sérieux tant pour la qualité de la production que pour la réactivité en cas de problème ou de réajustement. La fabrication de ce compteur en France permettra de créer de nouveaux emplois, directs et indirects, et répondra à l’exigence de privilégier les circuits courts, qui nous préoccupe dorénavant. L’enjeu est donc à la fois social, environnemental et industriel.
Alors que nous entrons maintenant dans la phase opérationnelle de consultation, monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur trois points.
Le premier est le volume de l’appel d’offres. La consultation fait état de trois millions de compteurs installés au cours de la première étape, de 2015 à la mi-2017. Cela pose la question de l’importance de l’investissement nécessaire à la production. Le PDG, que j’ai rencontré, estime à 700 000 euros la ligne de fabrication d’un million de compteurs. Un volume trop restreint ne permettrait pas de procéder dès maintenant à une automatisation suffisante, et il pourrait donc être difficile de se lancer dans une production en plus grand nombre.
Le deuxième point concerne les conditions générales contractuelles d’achat. ERDF cherche, et c’est bien naturel, à sécuriser sa commande. Elle ne doit pas pour autant, dans un contexte économique fragile, imposer des contraintes excessives. Elle doit notamment veiller à ce que les garanties demandées aux entreprises restent au plus près des réalités.
Enfin, et je relaie ici, vous le comprenez bien, la parole des habitants, des industriels et des élus du bassin de Montluçon, il est plus que jamais indispensable de doper l’outil industriel en utilisant le dynamisme et les savoir-faire existants en accord avec les exigences de développement durable.
La mise en fabrication imminente des compteurs communicants représente une grande opportunité pour notre industrie, comme vous allez sans doute nous le confirmer, monsieur le ministre. Ma question est donc double : comment le Gouvernement entend-il valoriser les industriels qui font le choix de produire en France ? Comment accompagner ERDF dans ses choix afin que les critères imposés dans le cadre contractuel restent raisonnables, c’est-à-dire qu’ils permettent à nos entreprises de prendre des risques sans pour autant remettre en cause leur pérennité ?
La transition énergique illustre la volonté du Gouvernement de structurer des filières industrielles ancrées dans nos territoires, créatrices d’emplois durables et non délocalisables.
Le déploiement du compteur intelligent dit « Linky » permettra une connaissance fine du profil de consommation des usagers et rendra possible la transmission d’ordres et d’informations relatives aux consommations. Mais le compteur Linky représente également – vous l’avez souligné, madame la sénatrice – un projet industriel pour nos entreprises et nos territoires ; votre question le met parfaitement en exergue.
Comme vous le savez, le Premier ministre a annoncé en juillet dernier un premier déploiement par ERDF de trois millions de compteurs d’ici à 2016. Tous les logements seront équipés d’ici à 2020 ; environ trente-cinq millions de compteurs seront ainsi installés. Un appel d’offres sera lancé très prochainement par ERDF. Le déploiement devrait avoir lieu sur tout le territoire.
Les investissements nécessaires à ce projet, estimés par ERDF à 4, 5 milliards d’euros, seront financés par les gestionnaires de réseaux de distribution. Grâce aux gains de productivité réalisés, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE, n’augmentera pas. Il n’y aura donc aucun impact pour l’usager, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement.
La concertation avec l’ensemble des parties prenantes, menée par le Gouvernement de novembre 2012 à février 2013, a notamment permis de souligner les forts enjeux industriels attachés à ce projet pour de nombreuses entreprises implantées en France, ainsi que ses conséquences bénéfiques pour l’emploi. ERDF estime en effet que le projet Linky serait en mesure de créer environ 10 000 emplois directs et indirects en France. L’enjeu est donc très important.
Les appels d’offres qui seront réalisés par ERDF respecteront les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, incompatibles avec des critères de sélection des offres fondés sur l’origine de l’entreprise candidate ou la localisation de sa production. Pour autant, cette procédure ouverte, transparente et non discriminatoire laisse toutes leurs chances aux entreprises françaises ou produisant en France, qui sont d’ores et déjà très bien positionnées sur ce marché d’avenir.
Parmi les trois entreprises retenues au titre de l’appel d’offres de cette expérimentation, deux disposaient de sites de production en France : l’entreprise Landis+Gyr installée à Montluçon, à laquelle vous avez fait référence, madame la sénatrice, et l’usine d’Itron, installée à Chasseneuil-du-Poitou, beau village bien connu du Sénat grâce à la personnalité qui y est attachée.
Le déploiement de Linky est un exemple parfait de la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique dans notre pays. Cette transition doit porter ses fruits en matière tant de protection de l’environnement que – vous l’avez souligné – de développement économique et industriel de nos territoires.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je n’en attendais pas moins de votre part. Vos propos constituent un encouragement pour nos entreprises. Nous devons promouvoir nos savoir-faire et développer la production française de qualité. Nous espérons que nos entreprises seront retenues dans le cadre de l’appel d’offres.
L’entreprise Landis+Gyr m’a informé de son succès en Grande-Bretagne : elle vient de signer un contrat de 710, 5 millions d'euros avec British Gas. Cela fait trois ans que, sur le site de Peterborough, les deux entreprises travaillent de conserve au développement de compteurs intelligents. Suite à l’annonce de la signature du contrat, Landis+Gyr prévoit de doubler ses effectifs en Grande-Bretagne, où elle emploie déjà six cents personnes. Elle compte accroître ses capacités de production non seulement pour permettre le déploiement prévu par British Gas mais également pour répondre aux demandes de ses autres clients britanniques. Pour sa part, British Gas a annoncé la création de plus de mille nouveaux postes d’experts en énergie intelligente dès 2014.
Monsieur le ministre, serons-nous capables de faire mieux ou du moins aussi bien ? Je compte sur vous, et j’attends une réponse favorable pour nos industriels.

La parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la question n° 484, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique.

Madame la ministre, je me dois, hélas ! d’appeler une nouvelle fois votre attention sur la couverture du territoire par la téléphonie mobile. Dans le département de l’Eure, il reste de nombreux secteurs qui ne sont pas couverts. Cette situation est due au fait que, depuis de nombreuses années, l’État se désintéresse de ce sujet, tandis que les opérateurs n’interviennent qu’en zone rentable. En outre, le conseil général de l’Eure a refusé de signer la convention de couverture des zones blanches.
Vous comprendrez que nos concitoyens n’admettent plus d’être encore privés, en 2013, de toute couverture par la téléphonie mobile 2G et 3G. Ils le supportent d’autant moins que les opérateurs vantent à grand renfort de publicité les mérites d’une 4G totalement inaccessible pour eux et répètent inlassablement qu’il n’existe aucun problème de couverture, l’ensemble du territoire, ou presque, étant couvert.
Lors de son audition par la commission des affaires économiques du Sénat, le 24 avril dernier, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, a d'ailleurs reconnu que des zones devaient encore être traitées et indiqué que, « s’agissant des zones encore non couvertes par la 2G et la 3G, la solution relève du Gouvernement, qui pourrait réunir les opérateurs, les élus et l’ARCEP pour définir un nouveau programme de couverture des zones blanches ». Pourtant, rien n’a été fait. Ni l’État, ni le conseil général, ni les opérateurs ne semblent se soucier de cette question !
Plusieurs maires et présidents de communauté de communes de l’Eure ont reçu en novembre dernier, à leur grande surprise, une lettre du préfet de région leur proposant d’installer à leurs frais un pylône pour un montant de 100 000 euros, en précisant toutefois que des subventions pourraient leur être versées. De très nombreux élus ont été scandalisés par cette demande, le coût étant particulièrement élevé au regard de la taille des collectivités concernées : la plus grande commune compte 519 habitants. Certains élus étaient cependant prêts à s’engager dans ce projet, avant d’apprendre, de la bouche des opérateurs, que, de toute manière, ils ne travailleraient pas sur les infrastructures quand bien même elles seraient construites. Vous comprendrez donc aisément leur déception et leur colère.
Madame la ministre, je vous avais saisie de cette question lors de votre audition le 11 décembre dernier, et vous m’aviez indiqué votre surprise. Malheureusement, la situation n’a pas évolué depuis, et je n’ai eu aucun retour de votre part.
Par ailleurs, et ce n’est un secret pour personne, les critères retenus pour mesurer la couverture du territoire ne rendent pas compte de la réalité. La couverture est en effet mesurée en zone habitée, à l’extérieur des bâtiments et en situation statique, ce qui est pour le moins paradoxal. Le Sénat a demandé à plusieurs reprises que ces critères soient revus, mais, pour le moment, vous n’avez pas jugé bon de vous atteler à cette tâche.
Ma première question est très simple et appelle une réponse très claire : que compte faire le Gouvernement pour mettre un terme à cette situation insupportable et s’assurer que toutes les communes de France puissent enfin bénéficier d’une couverture par la téléphonie mobile, sans avoir à attendre le déploiement de la 4G, prévu à un horizon de quinze ans ?
Ma seconde question est tout aussi simple : quelles initiatives le Gouvernement entend-il prendre pour réviser les critères de mesure de la couverture par la téléphonie mobile afin que ces critères rendent fidèlement compte de la réalité ?
Monsieur Maurey, vous m’interrogez sur la question de la couverture en téléphonie mobile des territoires.
Comme vous, je constate que le groupe de travail auquel vous participiez, mis en place par le précédent gouvernement, n’a pas permis de trouver de solutions satisfaisantes en la matière.
Sur le fond, vous avez raison et je partage une bonne partie du constat que vous dressez. Toutefois, à mon sens, le problème de l’accès aux réseaux mobiles ne saurait se limiter à la seule question de la téléphonie, car cela reviendrait à avoir une vision trop étroite de ce qu’apportent les réseaux de communications à nos territoires, à nos concitoyens et à notre économie. La stratégie du Gouvernement en matière d’infrastructures se place dans un cadre plus large au travers du plan « France très haut débit » : il s’agit d’étendre progressivement les réseaux à très haut débit à chaque bourg, tout d’abord, en construisant les réseaux de collecte nécessaires, puis à chaque foyer.
Cette infrastructure à très haut débit en fibre optique, que nous construisons avec les opérateurs, les départements et les régions, servira également de support au renforcement des infrastructures mobiles sur l’ensemble de nos territoires. L’objectif du plan « France très haut débit » est de pouvoir apporter à tous, partout, de meilleurs services. À cet égard, nous devons avoir particulièrement à l’esprit les zones mal desservies aujourd’hui, que ce soit en haut débit fixe ou en téléphonie mobile.
Monsieur le sénateur, tout cela ne doit pas nous faire oublier que les réseaux de communication électronique sont non pas une fin en soi, mais un moyen de diffuser le numérique au bénéfice de nos concitoyens, de nos territoires et de nos entreprises.
Je suis d’accord avec vous : à quoi bon, au fond, afficher l’objectif du raccordement de tous nos concitoyens, la couverture de tous nos territoires, si nous ne faisons rien pour que chacun puisse en bénéficier, pour organiser la solidarité et l’inclusion de tous, en somme pour lutter contre la fracture numérique. C’est pourquoi j’ai demandé au Conseil national du numérique dans sa nouvelle formation élargie, c’est-à-dire comprenant le comité des assemblées et des territoires, lequel est composé de quatre parlementaires et de cinq élus locaux, de travailler sur la question centrale de l’inclusion numérique.
J’attends du Conseil national du numérique qu’il traite la problématique de l’inclusion numérique de façon étendue, au-delà de la fracture numérique et des problèmes d’accès, pour permettre la plus large diffusion des usages, et qu’il envisage la manière dont cet objectif peut être partagé avec les collectivités territoriales, qui sont les acteurs de proximité et les garants de l’inclusion, qu’elle soit sociale, générationnelle ou technologique.
Dans le cadre de ses travaux, le Conseil national du numérique a largement consulté, notamment les acteurs locaux. Son rapport devrait nous orienter prioritairement vers les besoins les plus forts et les plus immédiats pour que personne ne soit exclu des formidables avancées technologiques que nous connaissons. Aujourd’hui, la question principale à laquelle nous devons apporter une réponse est la suivante : comment permettre à chaque citoyen, sinon de participer, au moins de tirer avantage au quotidien des évolutions numériques de notre société ?
Pour relever ce défi, nous allons nous appuyer sur la montée en puissance des espaces publics numériques, qui vont bénéficier de 2 000 emplois d’avenir. Nous allons permettre à ces espaces de se renouveler en faisant évoluer leurs missions et en les soutenant fortement. Nous montrerons ainsi que le numérique n’est pas que l’affaire d’ingénieurs bac+5 ou bac+8. J’ai la conviction que, dans ce secteur plus que dans tout autre, les acquis personnels peuvent être un véritable tremplin pour des jeunes sans diplôme.
Ainsi se pose selon moi, au-delà de la seule question de la couverture en téléphonie, la question plus large et plus décisive de l’inclusion numérique de nos concitoyens.

Madame la ministre, au moins vous me dites partager le constat que j’ai dressé, à savoir que nous sommes dans un pays et, en ce qui me concerne, dans un département où il y a encore de graves lacunes dans la couverture numérique du territoire. Pour le reste, je suis vraiment navré de constater que vous n’avez pas répondu à mes questions, qui étaient pourtant très claires : que fait-on pour assurer une couverture du territoire en téléphonie mobile ? Que fait-on pour avoir une mesure de cette couverture correspondant à la réalité, ce qui n’est pas le cas actuellement ?
À ces deux questions, je le répète, vous n’avez pas répondu, sauf pour me dire qu’il s’agissait d’une vision un peu étriquée de ma part que de m’intéresser uniquement à la couverture mobile du territoire. Allez donc dire ça aux élus et aux habitants qui cherchent désespérément un signal pour utiliser leur téléphone mobile !
C’est très bien d’avoir des ambitions plus grandes, de vouloir aller bien au-delà de mes questions qui sont très terre à terre, mais, quand on n’a pas cette couverture de base, je vous assure que les priorités sont tout autres.
Je suis donc vraiment déçu que, une fois de plus, vous ne répondiez pas à mes questions, faisant ainsi la démonstration que le Gouvernement se désintéresse totalement de ces territoires qui n’ont pas de couverture en téléphonie mobile. Vous vous contentez de noyer le poisson en nous renvoyant à des problématiques qui sont certes bien plus intéressantes, larges et ambitieuses, mais qui, malheureusement, ne permettent pas de régler le cas des populations habitant ces zones. Vous refusez même que l’on travaille à affiner les instruments de mesure, ce qui avait pourtant été commencé par votre prédécesseur.

La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 366, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Avec le Président de la République, le Gouvernement a fait de la sécurité une priorité d’action, mettant notamment fin aux suppressions d’emplois dans la police. C’est pourquoi je souhaite appeler l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’avenir de la CRS 39, implantée depuis 1943 à Jarville-la-Malgrange, dans la banlieue de Nancy, en Meurthe-et-Moselle.
Le précédent gouvernement avait souhaité, en 2010-2011, regrouper sur un seul site, à Châtel-Saint-Germain, près de Metz – vraisemblablement pour compenser des pertes d’effectifs militaires –, soit à 60 kilomètres du site actuel de stationnement de la CRS 39, les trois compagnies républicaines de sécurité de Lorraine, à savoir la CRS 30 de Metz, la CRS 36 de Thionville et donc la CRS 39 de Jarville-la-Malgrange, et ce, paraît-il, pour des raisons économiques.
Selon les syndicats, ce projet, laissé plus ou moins en l’état, semble être de nouveau à l’étude par les services du ministère de l’intérieur. Je voudrais donc présenter ici plusieurs arguments qui plaident pour un maintien de cette compagnie en Meurthe-et-Moselle, le seul souci de rentabiliser le site de Châtel-Saint-Germain ne pouvant suffire.
Tout d’abord, à l’instar de plusieurs élus qui se sont déjà exprimés sur le sujet, je pense que l’économie imaginée est peu probable. Le ministère est propriétaire des locaux de Jarville-la-Malgrange ; ceux-ci ont fait l’objet de près de 2, 5 millions d’euros d’investissement ces dernières années et se révèlent être peu coûteux du point de vue du fonctionnement. Or rien que le déménagement à Châtel-Saint-Germain est déjà estimé à plus de 1 million d’euros, et il faudra y entreprendre des investissements lourds.
Ensuite, certaines missions assurées par cette compagnie sont menacées. En effet, celle-ci intervient, en plus de ses missions hors de la région, sur tout le sud de la Lorraine, en complémentarité des autres compagnies, qui, elles, interviennent plutôt sur le nord de la région. L’éloigner de cette zone géographique entraînerait des surcoûts liés aux déplacements et des temps de réaction plus longs en cas d’urgence. De surcroît est attaché à la CRS 39 le très important PC autoroutier de Champigneulles sur l’A31, qui a besoin d’une compagnie support à proximité. En effet, il s’agit de la route de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.
Par ailleurs, le ministère vient de classer en zone de sécurité prioritaire, ou ZSP, les territoires de Nancy-centre, Plateau de Haye et Vandoeuvre-Nations, marquant ainsi une volonté forte de renforcer le service public de sécurité dans l’agglomération.
Enfin, pour les rencontrer régulièrement, je puis vous assurer que la vie des 150 familles concernées sera bouleversée par cette éventuelle décision, puisqu’elles seraient alors contraintes de déménager, sans parler de l’impact négatif pour les territoires où celles-ci vivent, consomment et fréquentent les écoles aujourd’hui.
Aussi, je souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement à propos de ce projet de déménagement de la CRS 39, en insistant sur le fait qu’il est particulièrement difficile pour les agents et leurs familles de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes depuis près de quatre ans.
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité appeler l’attention du ministre de l’intérieur sur l’avenir de la CRS 39, implantée depuis 1943 à Jarville-la-Malgrange. Manuel Valls vous prie de bien vouloir excuser son absence aujourd’hui et m’a chargée de vous faire part de sa réponse.
La révision générale des politiques publiques a été abandonnée, car elle prévoyait des suppressions d’effectifs indiscriminées dans les services publics au risque de leur affaiblissement. Ce sont ainsi 13 700 emplois qui ont été supprimés dans la police et la gendarmerie par le précédent gouvernement.
Nous avons rompu avec cette politique et stoppé l’hémorragie d’effectifs. Les engagements du Président de la République sont tenus : 480 emplois nets ont été recréés dans la police et la gendarmerie en 2013 et 405 le seront en 2014. Par ailleurs, 64 zones de sécurité prioritaires ont été créées et elles seront progressivement renforcées en effectifs.
Pour autant, le contexte budgétaire de la France et l’impératif de justifier auprès du contribuable chaque euro dépensé n’exonèrent pas l’État d’accomplir sans cesse de nouveaux efforts en matière d’organisation et de gestion de ses services, y compris au sein des forces de l’ordre. Une politique de sécurité efficace ne peut reposer sur la seule hausse des effectifs et doit explorer toutes les voies permettant de faire mieux fonctionner les effectifs existants. À ce titre, la rationalisation de certaines implantations immobilières mérite d’être poursuivie, particulièrement pour les compagnies républicaines de sécurité, qui interviennent, la très grande majorité du temps, à l’extérieur de leur département d’implantation. Une telle politique permet en effet des mutualisations et des économies d’échelle dans les fonctions dites supports et, par conséquent, le redéploiement de ressources humaines dans les unités opérationnelles qui interviennent directement pour protéger les citoyens sur la voie publique.
C’est dans cet objectif que plusieurs services de CRS – la CRS 30 de Metz, la CRS 36 de Thionville et la CRS autoroutière Lorraine-Alsace – ont déjà été regroupés en 2012 à la caserne de Metz-Séré, libérée par le ministère de la défense en 2011 et acquise par le ministère de l’intérieur. Si ce type de regroupement présente certes un coût initial substantiel, les économies cumulées dégagées au fil des ans sont bien supérieures. L’opération de Metz-Séré, dont il convient de souligner qu’elle ne s’est accompagnée d’aucune diminution ou dégradation de l’offre de sécurité garantie par l’État, a en effet permis d’importantes économies structurelles, les mutualisations – cantine, garage, armement et équipement, frais d’entretien – ayant permis une réduction des charges auparavant assumées par les différents services dans leurs cantonnements respectifs.
La caserne Séré disposant de réserves immobilières inoccupées, c’est pour poursuivre cet effort d’optimisation et de mutualisation que le regroupement d’autres services de police, dont la CRS 39 et la délégation interrégionale au recrutement et à la formation de la police nationale, est actuellement à l’étude. Cette réforme n’affecterait en rien le potentiel opérationnel pour la ville de Nancy et ses environs. La majorité des aménagements nécessaires ont déjà été effectués pour la première phase de regroupement, à hauteur de 2 millions d’euros, et la CRS 39, force mobile, intervient déjà sur l’ensemble du territoire national. Elle pourrait donc continuer à œuvrer au sein de la ZSP de Nancy au cours d’une partie de ses vacations.
Dans ce domaine comme dans d’autres, l’action menée par le ministre de l’intérieur vise un seul objectif : gagner en efficacité pour mieux répondre aux attentes de la population. Elle est conduite dans le souci permanent du dialogue et de la pédagogie. Ainsi, une concertation avec les élus comme avec les personnels, qui est un axe central de sa politique, interviendra après finalisation des études sur ce dossier.

Mes chers collègues, avant d’aborder la question orale suivante, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à onze heures trente-cinq.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, auteur de la question n° 490, adressée à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

Madame la ministre, j’appelle votre attention sur la situation de l’hébergement d’urgence dans le département d’Indre-et-Loire.
À l’automne 2012, le numéro d’urgence 115 a été amené à refuser, chaque soir, faute de places, l’hébergement d’une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles, il faut le regretter, beaucoup de femmes et d’enfants. Face à cette situation, un collectif d’associations s’est mobilisé, les élus ont été alertés et une nuit de la solidarité a été organisée.
La mise en place d’un dispositif hivernal a permis d’ouvrir, dans des conditions très précaires, une cinquantaine de places dispersées apportant certes une amélioration sensible, mais provisoire. La Direction départementale de la cohésion sociale a lancé un appel à projet pour ouvrir dans une ville de l’agglomération tourangelle un foyer d’hébergement qui comporterait justement les 50 places a priori nécessaires. Les locaux et le cahier des charges étaient bien adaptés aux besoins et permettaient des conditions d’accueil satisfaisantes.
Deux associations ont répondu conjointement à cet appel à projet, mais elles ont depuis appris que cet appel avait été déclaré infructueux. Elles m’ont donc alerté. Faute de financement, ce foyer risque de ne pas ouvrir ou, si ce financement n’est pas suffisant, l’hébergement ne pourra pas être assuré dans des conditions humainement acceptables.
Cette situation est la conséquence d’une répartition particulièrement inéquitable des crédits aux niveaux national et régional. En effet, sur l’enveloppe de 40 millions d’euros ouverte par l’État pour consolider les places du dispositif hivernal, 260 000 euros seulement ont été affectés à la région Centre. Par ailleurs, le nombre de places d’hébergement financées a été inférieur en Indre-et-Loire par rapport à d’autres départements de la région. Une telle disparité me paraîtrait compréhensible si la condition des personnes en situation précaire était plus favorable dans notre département, mais tel n’est pas le cas.
En conséquence, je vous demande quelles mesures vous comptez prendre avant l’hiver afin que l’ouverture de ce foyer permette l’accueil des personnes en situation précaire dans les meilleures conditions possibles. Le développement du nombre de places en hébergement d’urgence ne doit d’ailleurs pas nous faire perdre de vue la nécessité de rechercher des solutions durables de logement pour ces personnes.
Nous savons que, grâce à la politique que vous avez engagée, un effort important a été consenti dans ce domaine, mais l’hiver qui arrive suscite de nombreuses inquiétudes dans notre département, en particulier dans les communes situées au cœur de l’agglomération tourangelle.
Monsieur Filleul, vous le savez, l’hébergement d’urgence est une priorité pour le Gouvernement. Ce sujet est encore plus sensible du fait de l’aggravation des difficultés sur l’ensemble du territoire français, en particulier dans des régions auparavant moins concernées par cette détresse sociale. C’est pourquoi, dès 2012, des crédits complémentaires ont été débloqués pour un montant total de 50 millions d’euros, dont 41, 7 millions d’euros pour le budget opérationnel de programme 177, ou BOP 177.
La quote-part de la région Centre a représenté 523 577 euros, dont 45 %, soit 235 000 euros, ont été affectés au département d’Indre-et-Loire. Ces crédits ont permis de renforcer le dispositif de veille sociale à l’approche de l’hiver et d’augmenter la capacité du dispositif d’hébergement d’urgence en la portant de 133 places à 204 places, soit une augmentation de 53 % du nombre de places ouvertes dans le dispositif hivernal.
Pour répondre le mieux possible aux besoins, dans la limite de ses crédits, la Direction départementale de la cohésion sociale a mis sur pied, par l’intermédiaire des associations, des solutions pour mettre à l’abri le maximum de personnes grâce à des dispositifs rapidement mobilisables qui n’avaient pas vocation à être pérennisés.
Dès le mois de novembre, une solution immobilière de pérennisation de cinquante de ces places a été identifiée par la mise à disposition d’un foyer logement appartenant à ICF Habitat Atlantique, situé à Saint-Pierre-des-Corps. L’annonce de crédits supplémentaires de la circulaire du 4 janvier 2013 a permis de lancer, dès le 14 janvier 2013, un appel à projet que vous avez mentionné. Toutefois, les trois propositions reçues présentaient des budgets dont le coût à la place était supérieur à 10 000 euros par an. Cet appel à projet a donc été déclaré infructueux, et des négociations ont été engagées le 15 février 2013, à l’issue desquelles la société Adoma a été retenue pour gérer cette nouvelle structure d’hébergement mise en service en mars 2013 en remplacement de dispositifs ouverts pour la période hivernale.
Cette solution respecte l’esprit des mesures annoncées par le Premier ministre à l’issue de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : la fin « de la gestion au thermomètre » et la volonté de ne plus recourir aux solutions hôtelières.
Par ailleurs, le montant de la dotation du département d’Indre-et-Loire pour 2013 dans le BOP 177 s’élève à 7 369 447 euros, soit 24 % de la dotation régionale. Les crédits du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale alloués au département d’Indre-et-Loire représentent 34 % des crédits du « Plan pauvreté » reçus par la région Centre. Cet effort particulier a permis de créer 94 places d’hébergement d’urgence supplémentaires, dont 50 places pour le foyer ICF.
Ainsi, en Indre-et-Loire, le nombre de places d’hébergement d’urgence pérennes financées par le BOP 177 est passé de 133 en 2012, année où un effort avait déjà été réalisé, à 227 en 2013, soit une augmentation de 71 % en un an. Je me permets donc d’insister sur l’importance de cet effort, monsieur le sénateur.
En dépit de ces moyens supplémentaires, la situation reste fragile. C’est pourquoi le Gouvernement a pris un décret d’avance d’un montant de 107 millions d’euros, signé le 27 septembre et publié au Journal officiel du 28 septembre. Des crédits seront donc disponibles aux niveaux régional et départemental dès la mi-octobre pour faire face à l’aggravation de ces difficultés.

J’ai pris bonne note des précisions très importantes que vous venez de m’apporter, madame la ministre. J’espère que nous pourrons ainsi offrir des solutions pérennes l’hiver prochain aux personnes en attente de logement. En effet, dès maintenant, nous devons répondre à un nombre croissant de demandes. Nous allons donc suivre avec intérêt l’utilisation des sommes supplémentaires que vous nous avez annoncées.
L’augmentation de 71 % que vous avez mentionnée est évidemment considérable. J’espère que les solutions se traduiront directement dans la réalité. En effet, comme je l’ai dit, des personnes en grave difficulté s’adressent déjà à nous : dans ma petite ville située près de Tours, les services municipaux ont dû trouver une solution pour héberger une femme en déshérence complète, à laquelle on avait conseillé, en l’absence d’hébergement disponible, d’aller dormir dans la gare de Tours !
Je suis conscient du fait que le Gouvernement consent un effort très important en débloquant 107 millions d’euros, et je l’en remercie.

La parole est à M. Christian Cambon, auteur de la question n° 517, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Ma question s’adressait à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, mais Mme Duflot connaissant bien notre département, elle sera bien évidemment à même d’y répondre.
Soumis au devoir de réserve, interdits de faire grève, les agents pénitentiaires ont pourtant, à de nombreuses reprises, manifesté cette année pour exprimer leur « ras-le-bol » face à ce qu’ils appellent la « déroute » de la politique carcérale.
Au début du mois de juin 2013, ils se sont rassemblés devant l’établissement pénitentiaire de Fresnes pour dénoncer la violence grandissante des détenus à leur égard : un surveillant venait encore d’être pris à partie par un détenu, provoquant son malaise, tandis que l’un de ses collègues était également agressé avec une fourchette, agression qui lui a valu une incapacité temporaire de travail de quinze jours. C’est dire si la fourchette devait être affûtée !
La multiplication de ces agressions est l’illustration de la détérioration des conditions de travail de ces agents en milieu pénitentiaire, alors qu’ils sont eux-mêmes très exposés. Les surveillants dénoncent la surpopulation carcérale chronique et leurs sous-effectifs, situation qui devient compliquée à gérer. Déjà, en avril 2012, ils soulignaient ce manque de moyens. De fait, nous en assumons tous, les uns et les autres, la responsabilité, quel que soit le gouvernement que nous ayons soutenu.
Le centre pénitentiaire de Fresnes compte 2 275 détenus pour une capacité de 1 440 places et quelque 750 surveillants. Or, derrière la surpopulation, les trafics s’organisent, rendant ces personnels de plus en plus exposés et leur travail de plus en plus difficile.
Le 22 mai dernier, une centaine d’agents ont manifesté contre la remise en cause de leurs pratiques professionnelles. En effet, le tribunal administratif de Melun venait de suspendre la fouille corporelle intégrale pour les détenus s’étant rendus au parloir pour rencontrer des visiteurs. Instituée par le directeur de la prison de Fresnes en décembre 2012, cette pratique, il est vrai ingrate y compris pour les surveillants, était pourtant nécessaire pour des raisons de sécurité. Le juge a considéré que cette application systématique constituait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de ces détenus. Néanmoins, le problème reste posé.
Certes, le recrutement de conseillers d’insertion et de probation que Mme la garde des sceaux a annoncé dans le cadre de la réforme pénale va dans le bon sens. Mais, des promesses à leur mise en œuvre, nous sommes très loin du compte. Si le ministère de la justice veut atteindre la moyenne de 40 dossiers par conseiller d’insertion et de probation, les 450 recrutements promis d’ici à 2015 sur tout le territoire ne suffiront évidemment pas. Si l’on fait un rapide calcul, il apparaît que ce sont 1 500 agents qu’il conviendrait de recruter.
Les syndicats demandent donc un plan pluriannuel de quatre à cinq ans avec des objectifs garantis.
Vous le savez, madame la ministre, deux conceptions s’affrontent au sujet des prisons, même si là n’est pas l’objet de ma question : l’une demande une plus grande sévérité et la construction de places nouvelles dans les prisons – conception partagée plutôt par mes collègues siégeant sur les travées qui m’entourent –, l’autre, qui est plutôt celle de Mme la garde des sceaux, vise au contraire à diminuer les effectifs en réservant la prison pour les formes les plus graves de la délinquance. Il s’agit là d’une question d’importance nationale dont la Haute Assemblée sera sans doute prochainement saisie.
Il n’empêche, quelle que soit l’orientation à court terme, le problème de la sécurité du personnel sera toujours présent. Aussi, je vous demande, madame la ministre, de quelle manière votre collègue entend répondre à ces préoccupations et quelles vont être ses priorités en matière de politique pénitentiaire et de sécurité des agents de l’administration pénitentiaire.
Monsieur le sénateur, Mme la garde des sceaux étant retenue, elle vous prie de bien vouloir l’excuser de son absence et souhaite vous apporter les éléments suivants en réponse à votre question précise. Un débat sur la politique pénale nécessiterait que nous disposions d’un peu plus de temps que celui qui nous est autorisé dans le cadre de la séance des questions orales sans débat…
À la fin du mois de mai et au début du mois de juin, deux agressions graves sur du personnel ont effectivement eu lieu au centre pénitentiaire de Fresnes. Elles sont évidemment intolérables. Le Gouvernement se tient aux côtés de l’ensemble des personnels, qui sont engagés dans un métier difficile et nécessaire à la cohésion de notre société. On peut toutefois heureusement constater que, sur un plan général, l’administration pénitentiaire a relevé soixante-dix agressions contre le personnel en 2012 et que, à ce jour, trente-cinq ont été recensées en 2013, ce qui laisse présager une diminution du nombre de faits pour cette année.
Ces tensions – vous avez évoqué le cas de la prison de Fresnes – sont amplifiées par le contexte de surpopulation carcérale, lié en grande partie aux politiques pénales menées depuis dix ans. Rappelons que, entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2012, le nombre de personnes incarcérées a augmenté de 20 000. Vous l’avez dit, il existe un désaccord entre nous, car nous considérons que la surpopulation carcérale n’est pas gage d’un plus grand bienfait et d’une plus grande sécurité pour la population. Le quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes n’échappe pas à cette problématique, avec un taux d’occupation de 156 %, comme vous l’avez souligné.
Depuis sa nomination, la garde des sceaux a fait de la lutte contre la surpopulation carcérale, qui rend les conditions de détention indignes et les conditions de travail du personnel très difficiles et pénibles, tant humainement que professionnellement, une priorité de son action.
Des mesures ont d’ores et déjà été prises sur plusieurs plans.
Ainsi, le parc immobilier sera rénové et étendu : 6 500 nouvelles places de prison seront livrées, avec une fermeture corrélative d’établissements vétustes, des grands chantiers de rénovation seront menés aux Baumettes, à Fleury-Mérogis et à la maison d’arrêt de la Santé, et les autres établissements ont vu leurs crédits de rénovation augmenter de 20 % cette année pour améliorer les conditions de travail des personnels et les conditions de détention des personnes incarcérées.
En outre, la sécurité des personnels pénitentiaires sera renforcée grâce à la mise en œuvre d’un plan exceptionnel portant sur 33 millions d’euros et qui permettra de mieux équiper les établissements grâce à l’installation de dispositifs antiprojections dans trente-cinq établissements et au déploiement de portiques à ondes millimétriques dans vingt établissements accueillant les détenus au profil le plus sensible et de 282 nouveaux portiques à masse métallique dans toutes les zones sensibles des établissements.
Au-delà de l’aspect matériel, le ministère de la justice travaille aussi à une amélioration des pratiques, avec une circulaire à venir sur la prise en charge des détenus particulièrement signalés et des partenariats avec les autorités judiciaires et les forces de sécurité.
Tout cela se fait avec les personnels, que la ministre de la justice rencontre régulièrement.
La situation de Fresnes est examinée avec la plus grande attention en ce qui concerne les effectifs. Aujourd’hui, près de 97 % des postes de surveillant sont pourvus et une trentaine de surveillants stagiaires ont rejoint cet établissement dès le 30 septembre. Cinq postes de surveillant sont en outre offerts à la prochaine commission administrative paritaire de mobilité, qui aura lieu à la fin du mois de novembre.
Mme la garde des sceaux entend ainsi conduire une politique ambitieuse pour les agents du service public pénitentiaire, ce qui se traduira encore par de nouvelles créations d’emplois dans le projet de loi de finances pour 2014, tout en assurant le respect de la dignité et des droits des personnes privées de liberté, conformément à nos principes.

Madame la ministre, je vous remercie de la réponse précise que vous m’avez transmise. Je pense que les chiffres que vous avez cités contribueront à apaiser les personnels de l’administration pénitentiaire.
Certes, nous avons des désaccords sur la politique pénitentiaire – nous les assumons, car nous sommes en démocratie –, mais nous pourrons peut-être nous retrouver sur cet objectif, à savoir rassurer l’ensemble de ces agents, qui travaillent dans des conditions très difficiles et très tendues. De fait, les mesures que s’apprête à mettre en œuvre Mme la garde des sceaux vont dans le sens des préoccupations que j’ai évoquées.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 493, adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication.

La part croissante dans notre pays des chaînes à péage dans la diffusion des rencontres sportives est particulièrement préoccupante. En 2016, pour la première fois en France, la phase finale de football du Championnat d’Europe des nations ne sera pas, dans sa totalité, visible gratuitement. La retransmission de vingt-neuf matchs sera ainsi réservée aux abonnés de beIN SPORT, chaîne payante et détentrice des droits. C’est un précédent navrant !
Le problème concerne le football, mais pas uniquement. La Formule 1 est ainsi passée au « tout-payant » ; en rugby, le Top 14 est désormais retransmis par Canal+ ; les grands tournois de tennis – US Open, Wimbledon, Open d’Australie – sont également diffusés par des chaînes à péage, ainsi que tout le basket-ball de haut niveau et l’essentiel du handball.
Il s’agit malheureusement d’une particularité française. Alors que les chaînes en clair – du service public ou non – sont rebutées par l’inflation des droits sportifs, elles ne l’ont pas été dans d’autres pays européens. Pour la Formule 1, par exemple, en Grande-Bretagne et en Italie, les bouquets payants retransmettent les Grands Prix. Cependant, chacun a passé un accord, respectivement avec la BBC et la RAI, pour que ces deux chaînes publiques diffusent neuf courses en direct et les autres en différé.
Cette tendance française à la raréfaction du sport gratuit à la télévision exclut de fait les téléspectateurs aux moyens financiers réduits. Il n’est pas sûr, par ailleurs, que les sponsors des grandes manifestations sportives s’en arrangent très longtemps s’ils ne peuvent plus toucher un public aussi large que précédemment. Cette tendance contribue également à marginaliser des sports qui ne devraient pas l’être. Ainsi, à ce jour, seulement 7 % des retransmissions sportives concernent le sport féminin et 95 % de celui-ci est diffusé uniquement sur des chaînes payantes. Il est souhaitable que la télévision publique reprenne la main afin d’éviter une telle marginalisation, inacceptable.
Certes, il existe un décret de 2004 dressant la liste des vingt et un événements sportifs d’importance majeure qui doivent être diffusés en clair, mais il est aujourd’hui insuffisant et ses termes demeurent trop imprécis.
Je rappelle par ailleurs que l’avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne a, par exemple, estimé le 12 décembre 2012 que les États de l’Union ont le droit d’interdire la diffusion de la Coupe du monde et de l’Euro de football sur des chaînes payantes et d’exiger leur retransmission sur une télévision en accès libre.
Madame la ministre, il existe donc une forme de fracture sociale en matière de retransmissions sportives télévisuelles. Quelles mesures envisagez-vous pour garantir au public le plus large l’accès aux compétitions qui sont des événements d’importance majeure pour notre société ?
Tout comme vous, monsieur Vaugrenard, je suis soucieuse de la plus large diffusion possible du sport à la télévision sur les chaînes gratuites.
Comme vous l’avez souligné, le décret du 22 décembre 2004 prévoit une liste de vingt et un événements d’importance majeure pour la société française qui doivent être retransmis par les chaînes de télévision dans des conditions qui garantissent que le plus grand nombre y ait accès. Les jeux Olympiques, la finale de la Coupe du monde de football ainsi que le Tour de France sont sur cette liste. C’est ce dispositif qui a permis tout récemment à France Télévisions de retransmettre la finale du Championnat d’Europe de basket, alors même que Canal+ détenait les droits exclusifs de diffusion.
En l’état actuel des choses, le texte – vous avez raison là encore – ne prend pas suffisamment en compte l’exposition du sport féminin. Aussi, pour répondre à cette problématique, la ministre des sports, la ministre des droits des femmes et moi-même avons engagé la modification du décret du 22 décembre 2004. Il est ainsi proposé d’étendre la liste actuelle des événements sportifs d’importance majeure à des compétitions féminines comme, par exemple, les matchs de l’équipe de France féminine de football. Le projet de texte a été soumis pour avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, et il sera notifié à la Commission européenne, conformément à la procédure instituée par la directive Services de médias audiovisuels.
Votre question exprime en outre le souci de permettre au plus grand nombre de téléspectateurs d’accéder aux événements sportifs majeurs. En effet, l’accroissement de la concurrence sur le marché de la télévision payante conduit les chaînes à acquérir des droits exclusifs de diffusion afin de se démarquer de leurs concurrents, ce qui se fait, malheureusement, au détriment de la diffusion de certains très grands événements populaires sur les chaînes gratuites.
L’exposition du sport à la télévision en général a considérablement augmenté au cours des dix dernières années, mais, malheureusement, elle a diminué sur la télévision gratuite. Pour faire face à ce phénomène nouveau, la ministre des sports et moi-même avons décidé d’engager, en lien avec le CSA, une concertation avant la fin de l’année 2013 sur l’équilibre de la diffusion du sport entre les chaînes gratuites et payantes. Nous devons encore en déterminer la forme exacte, mais je peux d’ores et déjà vous dire que nous souhaitons que cette concertation associe tous les diffuseurs et les organisateurs d’événements sportifs. J’espère que les parlementaires, dont vous-même, monsieur le sénateur, prendront part à cette réflexion.
Pour le Gouvernement, il s’agit d’un sujet de préoccupation majeure. Nous travaillons par conséquent à l’évolution de la réglementation pour permettre l’accès du plus grand nombre de nos concitoyens à la diffusion d’événements sportifs.

Je vous remercie beaucoup, madame la ministre, de votre réponse très complète et argumentée.
Je suis satisfait que nous partagions la même préoccupation. Lorsque des événements d’importance majeure peuvent réunir la communauté nationale – ces événements sont rares, et les compétitions sportives en font partie –, il serait bon de ne pas créer ce que l’on pourrait appeler une fracture sociale télévisuelle en excluant, pour des raisons financières, certaines personnes de ce rassemblement.
J’ai bien noté que le sport féminin serait plus et mieux pris en compte. Le basket est d’ailleurs un bon exemple.
J’ai également noté qu’une concertation allait être mise en place avant la fin de cette année, en liaison avec le CSA, pour trouver un équilibre, qui m’apparaît aujourd’hui absolument indispensable. Il fut un temps où l’Eurovision négociait avec l’ensemble des partenaires au nom de toutes les chaînes européennes, dans un bel esprit mutualiste. À plusieurs, on est plus fort que seul ! Nous savons que les retransmissions de grands événements sportifs sont une préoccupation non seulement pour nous, mais aussi pour tous nos concitoyens européens. Par conséquent, peut-être serait-il intéressant d’ouvrir une réflexion à ce sujet.
J’ai noté enfin que vous estimez qu’il s’agit là d’une véritable mission de service public et qu’il est nécessaire de mieux l’assurer. Je le répète, les événements sportifs créent parfois une véritable communion nationale. Il est donc nécessaire que tout le monde y soit associé et que personne n’en soit exclu pour des raisons financières.
Je vous remercie à nouveau, madame la ministre, de votre réponse, et des engagements que vous avez pris.

Monsieur le président, s’agissant du scrutin n° 343 du 18 septembre 2013, qui portait sur les amendements identiques n° 46, 58 et 63 à l’article 1er du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il a été indiqué que, par délégation, j’avais voté pour, alors que je souhaitais voter contre.

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La sé ance, suspendue à douze heures, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.