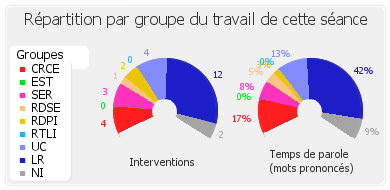Séance en hémicycle du 18 novembre 2014 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire
- Dépôt d'un document
- Renvoi pour avis unique
- Questions orales (voir le dossier)
- Situation de l'établissement public de santé mentale de saint-avé dans le morbihan (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu intégral de la séance du 14 novembre 2014 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 14 novembre prennent effet.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la convention entre l’État et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relative au programme d’investissements d’avenir, action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain ».
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires économiques.

J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 16 [2014-2015]), dont la commission des affaires économiques est saisie au fond, est envoyée pour avis, à sa demande, à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, auteur de la question n° 903, adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Un établissement public de santé mentale, ou EPSM, est un centre de soins où l’on soigne non pas des blessures physiques, mais des blessures de l’âme. Si la douleur est parfois moins discernable, elle n’en est pas moins puissante et requiert des moyens adaptés, qui soient à la hauteur des nombreux besoins des patients.
L’établissement public de santé mentale situé à Saint-Avé, près de Vannes, dans le Morbihan, a pour mission principale les soins en psychiatrie pour enfants, adultes et personnes âgées. Il regroupe un ensemble de structures sanitaires et médico-sociales de consultation, de soins et d’hébergement.
Il traverse actuellement des difficultés financières importantes, puisque le déficit prévisionnel s'élèverait à 940 000 euros pour l’exercice 2014. Afin de remédier à ce manque de moyens budgétaire, la direction a émis des propositions se résumant en quatre mots : « la baisse des dépenses » !
Dans ce pêle-mêle de diminutions, on peut noter au niveau du personnel la possible perte de cinquante-trois postes, la renégociation à la baisse de l’accord sur la réduction du temps de travail – passage de dix-sept à quinze jours – ou la révision des octrois de temps partiel. En ce qui concerne les patients, outre une facturation à la hausse avec l’augmentation du tarif journalier ou le paiement des chambres individuelles, il est proposé une accélération du projet médical avec, dès l’année prochaine, la fermeture d’une partie de l’unité des Rosiers Peupliers avant sa fermeture définitive en 2016. Une question s’impose alors : où iront les patients actuellement suivis dans cette unité ?
Ces mesures peuvent étonner, d’autant que des postes d’infirmiers de nuit auraient été remplacés par des aides médico-psychologiques, ou AMP, dont les missions et les compétences ne sont pas du tout les mêmes. Même si ce recrutement a été occasionnel, il ne doit pas devenir un choix permanent qui porterait gravement atteinte à l’encadrement de nuit des patients.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’établissement pour la période 2013-2017, l’EPSM Morbihan a mis en place une nouvelle organisation de son offre de soins qui s’appuie sur une nouvelle organisation territoriale.
Hélas ! force est de constater que cette nouveauté est à l’image de la réforme territoriale actuellement en cours. Elle porte en elle les germes de l’inégalité et de la précarisation de l’accès aux soins.
Tous les établissements de santé mentale en Bretagne sont concernés par cette situation ; il en est ainsi, par exemple, de celui de Caudan, également situé dans le Morbihan. La proximité annoncée tarde à se révéler puisque l’on déplore déjà la fermeture d’un CPEA, un centre psychothérapique pour enfant et adolescent. Où se situent la logique et la simplification dans ce cas ? Lorsque l’on ferme un établissement, on éloigne les plus démunis de l’accès aux soins.
Les membres du personnel sont toujours dans l’attente de connaître, par catégorie professionnelle, le nombre de postes qui seront supprimés. Et les patients, pour qui la régularité de l'encadrement est primordiale, ne devraient pas être défavorisés par une offre de soins de qualité moindre en raison d'un budget en baisse.
Il est regrettable qu'aucune concertation n'ait été menée afin d'exposer aux équipes les enjeux de la situation de l'établissement et les perspectives proposées.
Madame la secrétaire d'État, afin de répondre aux inquiétudes des personnels et des patients, quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il pour accorder à cette structure publique le budget nécessaire à son bon fonctionnement ? Quel espoir pouvez-vous apporter à ces agents qui exercent leurs missions difficiles et délicates avec des moyens déjà en deçà de ce qu'ils devraient être ?
Monsieur le sénateur, la situation bretonne concernant les soins psychiatriques présente de fortes spécificités. Ainsi, les taux d’équipements hospitaliers et de recours aux soins hospitaliers psychiatriques, en particulier pour la psychiatrie générale, sont parmi les plus élevés de France. Par ailleurs, le fort taux d’équipement en lits et places n’a pas pour corollaire une meilleure fluidité des parcours. On observe en effet une saturation importante de l’offre de soins psychiatriques hospitaliers, qui participe elle-même à un engorgement plus global de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale en santé mentale : taux d’occupation des lits élevé, patients retenus à l’hôpital par manque de places médico-sociales disponibles, listes d’attentes pour l’entrée en structures médico-sociales...
Sur la base de ce constat, l’Agence régionale de santé de Bretagne a engagé un plan ambitieux de réorganisation de l’offre en santé mentale privilégiant l’autonomie des personnes, le maintien de leur insertion sociale et professionnelle, ainsi que des parcours plus cohérents et plus fluides. Un appel à projets a notamment été lancé à ce propos.
En réponse à l’appel à candidatures de l’Agence régionale de santé de Bretagne portant sur cette évolution de l’offre de soins, l’établissement a effectivement sollicité des moyens nouveaux et non pérennes pour accompagner la recomposition en cours de son offre de soins.
La reconfiguration qui en découle répond aux exigences d’un rééquilibrage de l’offre au profit des activités ambulatoires et doit permettre à l’établissement public de santé mentale du Morbihan de s’inscrire dans une trajectoire financière équilibrée.
Le redéploiement – et non la réduction – de cinquante-trois postes programmé sur les trois prochains exercices vise à transférer une partie des activités et des moyens du secteur de l’hospitalisation complète vers les dispositifs extrahospitaliers ambulatoires afin d’apporter une meilleure réponse aux besoins des patients.
Le déficit prévisionnel de l’établissement devrait s’établir en 2014 à 500 000 euros, soit 0, 7 % des recettes d’exploitation. Le plan d’économies visant au retour à l’équilibre fin 2016 porte aussi sur les dépenses de fonctionnement dans le cadre d’une démarche d’amélioration générale de l’efficience, tout en garantissant le niveau et la qualité des prestations hôtelières. Dans un contexte financier contraint, l’EPSM a mis en œuvre des mesures d’ajustement sans aucune suppression de poste de personnel titulaire en 2014.

Madame la secrétaire d'État, j’ai bien entendu votre réponse, qui montre les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements de santé mentale en Bretagne, en général, et en particulier dans le Morbihan, s’agissant de l’établissement de Saint-Avé à propos duquel j’ai été interpellé.
Cet établissement est unanimement reconnu pour la qualité de son suivi des patients dans le cadre de l’exercice de ses missions avec, par exemple, une pratique formidable en matière d’addictologie. Dès lors, la baisse des moyens et le plan d’économies ne constituent pas une réponse extrêmement positive, propre à garantir l’avenir aux yeux des personnels, qui s'interrogent… Je ne suis pas sûr que l’ambulatoire et le redéploiement permettent de venir à bout de toutes les difficultés rencontrées ces dernières années. L’établissement rencontre déjà des problèmes financiers qui risquent plutôt, si l’on diminue les moyens, de se renforcer.
Il se pourrait donc bien que cette réponse ne soit pas à la hauteur de besoins qui, hélas ! vont en s'accroissant. Vous le savez, l’ouest de la France est confronté à un nombre de tentatives de suicide plus élevé qu’ailleurs. C'est extrêmement grave, et il serait dommage que cette donnée ne soit pas prise en considération.

La parole est à M. Claude Haut, auteur de la question n° 908, adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur l’éligibilité à la catégorie dite « active » des personnels des hôpitaux, selon qu’ils sont affectés dans des services en contact direct et permanent avec les malades ou dans des services qui ne le sont pas, telles les crèches du personnel hospitalier, par exemple.
Le sujet est important pour les fonctionnaires intéressés. Dans le premier cas, les agents pourront faire valoir leurs droits à la retraite entre cinquante-cinq et cinquante-sept ans selon l’année de naissance, tandis que, dans le second cas, ils devront attendre cinq années supplémentaires, soit entre soixante et soixante-deux ans selon l’année de naissance. Il faut noter que les affectations des personnels relèvent de décisions de l’employeur prises dans le respect du principe de la distinction du grade et de l’emploi. Les agents ne peuvent s’y opposer tant que l’affectation est conforme à leur statut.
Il semblerait en effet que cette question fasse l’objet de difficultés d’interprétation récurrentes pour les employeurs hospitaliers et donc pour les agents concernés. Ainsi, je souhaiterais savoir si, pour ces personnels hospitaliers, l’exigence d’un contact direct et permanent avec les malades pendant une durée qui, de quinze ans avant le 1er juillet 2011, est progressivement passée à dix-sept ans à compter du 1er janvier 2015, est une condition d’éligibilité à la catégorie active.
Monsieur le sénateur, les emplois de fonctionnaires sont classés en deux catégories : la catégorie active et la catégorie sédentaire. Les conditions d’éligibilité au régime de la catégorie active sont fixées par la loi à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ainsi, les fonctionnaires ayant accompli au moins dix-sept ans de services actifs, s’agissant de la génération née en 1955, dans un emploi « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite à partir de cinquante-sept ans, ainsi que d’une majoration de durée d’assurance. La limite d’âge est fixée, pour ces fonctionnaires, à soixante-deux ans.
Dans la fonction publique hospitalière, le classement des emplois en catégorie active relève de l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. Cet arrêté liste précisément les fonctions hospitalières ouvrant droit au bénéfice de la catégorie active. Il précise dans certains cas qu’elles impliquent d’être « en contact direct et permanent avec des malades ». La rédaction, ancienne, de cet arrêté est potentiellement source d’incompréhension, voire d’interprétations divergentes, d’autant que les décrets statutaires, postérieurs, ont parfois employé des dénominations différentes.
Mais quelle que soit la lecture des textes, il ne paraît pas envisageable d’accepter, en équité, que des mêmes personnels hospitaliers, affectés aux mêmes emplois dans les mêmes conditions, puissent ouvrir des droits à la retraite différents en raison de textes ambigus. Un travail d’expertise a donc été engagé sur cette question et, dès que le processus de clarification sera achevé, le droit applicable sera précisé.

Je serai bref, car j’ai bien compris qu’il faut encore travailler sur ce sujet avant d’obtenir une réponse définitive. Mais cette réponse, nous l’attendons maintenant avec un sentiment d’urgence : il faut en effet rapidement définir le statut de ces personnels pour savoir à quel âge ils peuvent prendre leur retraite.

La parole est à Mme Laurence Cohen, auteur de la question n° 909, adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Madame la secrétaire d'État, le 17 janvier 2015, nous célébrerons les quarante ans de l’adoption de la loi Veil, légalisant et encadrant l’avortement.
Il s’agit, sans aucun doute, de l’une des plus grandes conquêtes sociales de ce siècle, obtenue de haute lutte par la mobilisation des militantes et des associations féministes, de femmes et d’hommes politiques, ainsi que grâce au courage de Mme Simone Veil.
Ce droit est désormais inscrit à l’article L. 2212-1 du code de la santé publique. D’autres avancées ont également eu lieu au cours des dernières années, avec la suppression de la notion de détresse dans la loi et, sous l’impulsion de la ministre des affaires sociales, Mme Marisol Touraine, le remboursement à 100 % de l’IVG pour toutes les femmes.
Annuellement, en France, plus de 200 000 femmes ont recours à une IVG, chiffre stable depuis quelque temps. Pourtant, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile d’avorter en France.
Un rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a montré que 130 établissements pratiquant des IVG ont fermé dans notre pays au cours des dix dernières années. L’offre s’est progressivement concentrée sur un nombre réduit d’établissements de santé.
Aujourd’hui, 5 % des établissements effectuent près d’un quart des IVG. Aussi les délais prévus par la loi sont-ils souvent dépassés, ce qui met en difficulté de nombreuses femmes, contraintes parfois de se rendre à l’étranger pour mettre un terme à leur grossesse.
Par ailleurs, selon le Mouvement français pour le planning familial, certains départements ne proposent aucune prise en charge publique de l’IVG. En Ariège, par exemple, on compte cinq hôpitaux publics, mais aucun centre IVG. La situation est identique dans le Lot-et-Garonne. Certains départements d’Île-de-France, comme la Seine-et-Marne ou la Seine-Saint-Denis, sont sous-équipés.
Le planning familial de Seine-Saint-Denis a d’ailleurs rendu publique l’an dernier une enquête très fournie sur les difficultés d’accès à l’IVG dans ce département.
C’est l’un des enjeux actuels pour sauver la maternité des Lilas et son centre IVG, l’un des plus importants d’Île-de-France, avec plus de 1 000 IVG réalisées chaque année.
Madame la secrétaire d’État, vous le savez, les personnels sont épuisés par les menaces de fermeture qui pèsent sur cet établissement. Leur engagement pour sauvegarder les conditions d’accueil des nouveau-nés, des patientes, de leurs compagnons et de leurs familles n’est plus à démontrer. Soutenus par un collectif très large, ils mènent une bataille sans relâche.
Nous serons reçus, avec un certain nombre d’élus, par Mme Marisol Touraine le 9 décembre prochain pour aborder cette question.
Mon intervention concerne l’immédiat : finalement, quelles sont les propositions du Gouvernement pour ce qui concerne le pôle d’interruption volontaire de grossesse de cet établissement et, plus globalement, son avenir ?
La reconstruction aux Lilas est la garantie de ne pas voir disparaître non seulement un centre réalisant 1 000 IVG annuelles, mais également une maternité emblématique, atout précieux pour la qualité de la prise en charge des femmes de Seine-Saint-Denis, plus largement de la région d’Île-de-France et même de l’ensemble du territoire national.
Madame la sénatrice, je vous remercie pour cette question qui me permet de réaffirmer notre attachement au droit des femmes à disposer de leur corps, et en particulier au droit à l’avortement.
Vous le savez, le Gouvernement mène depuis 2012 une action résolue pour garantir le droit et l’accès à l’IVG.
L’IVG est désormais, vous l’avez dit, remboursée à 100 %. Le tarif de l’acte a été revalorisé de 50 % dans les hôpitaux. Il a été rappelé aux agences régionales de santé leur devoir d’assurer la continuité de l’offre de service sur le territoire, notamment pour éviter les ruptures estivales.
Le site ivg.gouv.fr a été lancé pour contrer les informations mensongères anti-IVG. Une convention pluriannuelle de financement du planning familial a été conclue en 2013.
Récemment, la loi du 4 août 2014 a étendu le champ du délit d’entrave à l’IVG et supprimé la notion de « détresse » des femmes souhaitant recourir à l’IVG. C’est une avancée importante réaffirmant le droit des femmes à disposer de leur corps, sans stigmatisation moralisante.
J’en viens à l’accès à l’IVG en Ariège. Sur ce territoire, il existe deux établissements de santé publics autorisés en gynécologie obstétrique et/ou chirurgie, susceptibles de réaliser des IVG : il s’agit du centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège et du centre hospitalier Ariège Couserans. Ces établissements ont une convention avec le conseil général pour exercer la mission de CPEF, ou centre de planification ou d’éducation familiale.
Dans tous les bassins de santé de l’Ariège, y compris au Pays d’Olmes, une offre existe en matière de consultations pour demande d’IVG.
Dans le Lot-et-Garonne, quatre établissements réalisent des IVG : trois établissements publics – Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot – et la clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Ces structures travaillent en partenariat avec les CPEF.
L’agence régionale de santé, ou ARS, a par ailleurs mandaté le réseau de santé en périnatalité pour effectuer un travail de réseau avec les acteurs libéraux et hospitaliers, ainsi que les différents services du conseil général, tels que le CPEF et la PMI. Le réseau vient également en appui aux acteurs pour améliorer les pratiques.
C’est en Île-de-France que près du quart des IVG sont réalisées. L’offre hospitalière est constituée de 105 établissements, dont 14 en Seine-Saint-Denis et 11 en Seine-et-Marne.
Cette offre est complétée par une offre en ville plus dense que dans les autres régions. En 2012, 418 professionnels libéraux exerçant en Île-de-France ont prescrit au moins un acte d’IVG médicamenteuse.
L’offre en CPEF et centres de santé est également plus développée en Île-de-France qu’ailleurs, et 38 % des IVG réalisées en CPEF ou centres de santé le sont dans cette région.
Enfin, il faut noter que l’Île-de-France a initié un programme ambitieux intitulé FRIDA, qui vise à garantir, tant en ville qu’à l’hôpital, une offre répondant aux besoins de la population, et ce de manière adaptée dans chaque département.
J’en viens à la maternité des Lilas, dont je suis très attentivement la situation. Vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, les équipes en place réalisent un travail formidable. Un délai a été accordé jusqu’au 30 juin 2015, afin que le projet architectural initial de reconstruction sur site soit revu et le plan de financement actualisé, conformément aux souhaits de la présidente et du conseil d’administration de la maternité.
Dans l’attente de la remise de ces travaux, prévue le 30 juin 2015, la maternité des Lilas continuera à être soutenue, comme c’est le cas depuis 2012, afin de garantir l’accès aux soins, notamment en matière d’IVG.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Vos propos marquent votre engagement, ainsi que celui de Mme la ministre Marisol Touraine, concernant le droit à l’avortement des femmes, partout.
Cela dit, je veux noter ici la contradiction entre, d’une part, votre volonté et, d’autre part, les restrictions budgétaires imposées à la santé, restrictions dont nous avons pu mesurer l’ampleur la semaine dernière en examinant le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit des coupes drastiques dans les établissements publics hospitaliers.
J’attire votre attention sur cet aspect, en soulignant qu’on ne peut pas mener une politique de santé de qualité avec des moyens qui se réduisent comme peau de chagrin.
Vous évoquez par ailleurs l’IVG médicamenteuse. Il y est recouru, il est vrai, de façon importante dans le cadre de l’avortement. Mais de nombreuses jeunes femmes m’ont dit regretter que cette méthode manque cruellement d’un suivi psychologique et médical : on se contente de donner le médicament en question, et les femmes sont laissées dans un certain désarroi. Il y a donc, selon moi, des choses à faire dans ce domaine.
Enfin, la réponse que vous m’apportez concernant la maternité des Lilas se veut rassurante. J’espère que les personnels, le collectif, les élus, recevront jusqu’au bout votre soutien attentif, pour que cette maternité emblématique en termes non seulement de naissances mais aussi d’IVG soit bien reconstruite sur le site des Lilas et que le dessein initial de l’ARS, qui n’intégrait pas cette exigence, soit définitivement abandonné au profit d’un projet correspondant aux besoins des femmes de Seine-Saint-Denis, d’Île-de-France et, plus globalement, de l’ensemble du territoire.

La parole est à M. Pierre Laurent, auteur de la question n° 911, adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Madame la secrétaire d’État, je me permets d’attirer votre attention sur le projet de création d’un nouvel hôpital, l’hôpital Nord du Grand Paris, évoqué par le Président de la République le 10 juillet 2013.
Comme vous le savez, les territoires du nord de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du nord-est des Hauts-de-Seine se caractérisent par une moindre densité de l’offre de service public, une forte proportion de population confrontée à des situations de précarité et des difficultés d’accès aux soins. Ces territoires font face à un risque croissant de désertification de l’offre médicale de ville, à l’instar de ce qui a été récemment souligné s’agissant de l’Est parisien.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de l’hôpital Nord du Grand Paris, évoqué par le Président de la République. Le risque est grand de voir fusionner en un seul site des hôpitaux existants, à savoir Bichat, Beaujon et Lariboisière. Une telle évolution serait préjudiciable au vu de la situation que je viens d’évoquer.
Madame la secrétaire d’État, pourriez-vous m’indiquer les intentions précises du Gouvernement en la matière et la manière dont il compte les mettre en œuvre ?
Force est de le constater, ce projet annoncé par le Président de la République intervient dans un contexte de mise en application par le Gouvernement d’un plan de rigueur comprenant une réduction des dépenses de santé de 10 milliards d’euros, ce qui aura des conséquences extrêmement préoccupantes à nos yeux.
Compte tenu de ces éléments, une grande inquiétude se fait jour chez les personnels des hôpitaux et la population de cette zone géographique. Un très grand nombre d’entre eux porte l’exigence d’une rénovation des hôpitaux existants, ainsi que la conservation, le développement et une meilleure articulation de l’offre de soins, alors que, s’agissant du projet de fusion envisagé, une réduction du nombre de lits de 1 400 à 1 000 lits est envisagée.
Face à l’ensemble de ces problématiques, un débat a vu le jour au sein de la Ville de Paris, qui souhaite notamment que, à chaque étape, le « fil conducteur » des réorganisations proposées pour le service public hospitalier soit l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que la concertation avec les habitants et les élus concernés.
En prolongation de cette logique exprimée par le Conseil de Paris, il a été décidé la tenue des Assises de la santé, qui se termineront début 2016. Ne serait-il pas souhaitable que l’État agisse auprès de la direction de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’AP-HP, pour que les projets de restructuration, dont celui de l’Hôpital Nord du Grand Paris, soient purement et simplement suspendus jusqu’à l’aboutissement de ces assises parisiennes ?
Monsieur le sénateur, dans le cadre de son plan stratégique, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a retenu, parmi ses toutes premières priorités pour la décennie à venir, l’objectif d’un renforcement et d’une modernisation de l’offre hospitalière et universitaire au nord de Paris.
Cet effort d’investissement sans précédent pour l’institution aura pour objectif de mieux coordonner l’offre hospitalière au nord de Paris au sein d’un projet médical coordonné, en continuant de distinguer les deux groupements hospitaliers en fonctionnement aujourd’hui.
Dans ce cadre, il est prévu de reconstruire l’hôpital Lariboisière sur son site actuel. La majeure partie des activités des hôpitaux Bichat et Beaujon seront pour leur part regroupées au sein d’un nouvel ensemble, l’Hôpital universitaire du Grand Paris Nord.
Le nord de la métropole parisienne se caractérise par des besoins importants et spécifiques. Ce territoire va également connaître d’importantes mutations dans les décennies à venir, en raison de la dynamique liée au Grand Paris. L’offre hospitalière publique occupe une place prépondérante au regard de cette évolution, mais les hôpitaux Lariboisière, Bichat et Beaujon, qui assurent la plus grande part de l’activité, doivent être modernisés pour adapter leurs bâtiments à l’évolution des besoins et pour préserver les conditions d’exercice et d’accueil, gage de l’attractivité des hôpitaux.
C’est la raison pour laquelle le Président de République a fait part de son soutien à un projet ambitieux de modernisation de l’offre hospitalière et universitaire au nord de Paris, s’inscrivant dans la dynamique du Grand Paris, prenant la mesure des enjeux de santé de ces territoires et contribuant à rééquilibrer les forces hospitalières, d’enseignement et de recherche au sein de la métropole.
L’État, dans le cadre de la procédure d’examen des projets majeurs d’investissements par le COPERMO, le comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers, sera appelé prochainement à se prononcer sur les modalités de mise en œuvre de ces projets et leur financement.
Le Gouvernement sera dans ce cadre particulièrement attentif aux propositions qui seront formulées par l’AP–HP, en termes à la fois de qualité de la réponse aux besoins de santé et de contribution à la modernisation de l’organisation hospitalière.
La concertation qui a été engagée, notamment avec la Ville de Paris, doit être naturellement poursuivie pour répondre aux interrogations que ces projets peuvent soulever.

Madame la secrétaire d’État, votre réponse confirme malheureusement nos inquiétudes : vous parlez de « concertation », de « projet coordonné », mais cela ne signifie pas forcément la fusion des deux hôpitaux Bichat et Beaujon, point qui est précisément en débat.
Puisqu’il est question, dans les discours, d’améliorer l’offre de santé, permettez-moi de répéter mon propos : notre crainte est de voir le nombre total de lits passer des 1 400 lits existants à 1 000 lits. Or, vous n’apportez aucun éclaircissement sur ce point.
Par ailleurs, vous avez parlé de financement. Le projet de la direction de l’AP-HP est, on le sait, de revenir à une situation d’équilibre budgétaire – c’est du moins ce qu’elle annonce – au moyen d’un plan de cession de 200 millions d’euros. Cela nous porte à craindre que, pour financer ce projet d’hôpital Nord du Grand Paris, l’AP-HP procède par redéploiement, en fermant des services et en cédant une partie de son patrimoine au plus offrant.
Le rapport sur l’hôpital rédigé en 2012 par l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, soulignait les surcoûts et les dysfonctionnements inhérents aux hôpitaux de trop grande taille. Les projets déjà existants montrent que ce problème se pose effectivement de façon extrêmement sérieuse. Le rapport mettait en évidence la diminution du nombre de lits engendrée par les fusions d’hôpitaux publics intervenues entre 2003 et 2008.
Vous comprendrez dans ces conditions que nous allons rester mobilisés et vigilants. La volonté que vous avez réaffirmée d’entendre les propositions présentées par la population et les élus de Paris et d’être attentive à cette concertation ne saurait être qu’une déclaration d’intention si, dans le même temps, un projet contraire à ce qu’expriment les personnels et les populations continue de prospérer.

La parole est à M. Vincent Dubois, auteur de la question n° 912, adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Ma question s’adresse à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Cette question, à laquelle se joint Mme la sénatrice Teura Iriti, est relative au retour attendu de l’État dans le financement du Régime de solidarité de la Polynésie française, le RSPF.
La loi du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française définissait, pour une durée de dix ans, les conditions dans lesquelles « la nation aidera le territoire de la Polynésie française à réaliser une mutation profonde de son économie, afin de parvenir à un développement mieux équilibré et à une moindre dépendance à l’égard des transferts publics, en favorisant le dynamisme des activités locales et le progrès social ».
Au chapitre de ce progrès social, la conjugaison des solidarités territoriale et nationale a permis de mettre en place un système de protection sociale original, qui a notamment introduit la création d’un régime de solidarité spécifique pour les plus démunis. Ainsi, entre 1994 et 2007, la participation de l’État au régime de solidarité a représenté une somme globale de 350 millions d’euros, soit une moyenne de 27 millions d’euros par an.
L’interruption brutale, en 2008, de ces crédits de solidarité a généré un défaut de financement de l’État de 190 millions d’euros alors que, concomitamment, la Polynésie subissait les conséquences de la crise économique mondiale. En effet, le taux de chômage en Polynésie a doublé en six ans, passant de 10 % à plus de 20 % et entraînant une augmentation des effectifs relevant du régime de solidarité territoriale, passés de 50 000 à 80 000 bénéficiaires.
Aujourd’hui, plus du quart de la population de la Polynésie française vit en dessous du seuil de pauvreté et ne survit que grâce aux faibles allocations versées via ce régime de solidarité. Par voie de conséquence, celui-ci connaît un déficit chronique qui s’aggrave chaque année, avec un risque imminent de non-paiement des allocations sociales, unique source de revenus pour les plus démunis.
Cette situation est évidemment très inquiétante et nécessite une intervention rapide de l’État au titre de la solidarité nationale, intervention qui commence par un retour de l’État au financement dudit régime de solidarité.
En réponse aux sollicitations de la nouvelle majorité issue des élections de mai 2013, et notamment de nos trois députés à l’Assemblée nationale, deux pistes de réflexion sont actuellement proposées par le Gouvernement, pistes qui ne constituent cependant que des régularisations : premièrement, l’obligation pour les fonctionnaires métropolitains en poste en Polynésie française de cotiser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; deuxièmement, l’application aux malades polynésiens, qui sont obligés d’être rapatriés en France pour y recevoir des soins très spécialisés, des tarifs hospitaliers métropolitains, et non pas des tarifs plus élevés de 30 %, comme c’est le cas actuellement. Ces deux mesures, si elles sont nécessaires, restent encore très insuffisantes pour combler le déficit colossal du régime de solidarité territoriale.
Je vous rappelle en outre que les recommandations du rapport de l’IGAS de janvier 2004 étaient extrêmement claires quant à la participation de l’État au régime de solidarité territoriale : « Un arrêt, ou même une réduction sensible aurait des effets déstabilisants pour l’équilibre financier du régime de solidarité, et au-delà, pour la protection sociale généralisée qui risquerait des remises en cause. Ceci est » – selon la mission IGAS – « d’autant moins souhaitable que les plus fragiles en seraient les premières victimes. Cette participation de l’État fait partie de la solidarité nationale. »
En septembre dernier, Mme la ministre des affaires sociales et de la santé et Mme la ministre des outre-mer ont réaffirmé par écrit « le principe d’une contribution de l’État au redressement du régime de solidarité de la Polynésie française ».

Constatant qu’aucune disposition n’est prévue dans le projet de loi de finances pour l’année 2015, je souhaite savoir si Mme la ministre des affaires sociales et de la santé compte oui ou non, et dans quel délai, remettre en place une véritable contribution financière de l’État au Régime de solidarité de la Polynésie française, comparable à celle qui existait jusqu’en 2007, et ce, au profit des familles polynésiennes les plus fragiles.
La protection sociale généralisée, la PSG, qui comprend le régime de solidarité destiné aux personnes ne pouvant pas être couvertes par les deux autres régimes composant la PSG, a été créée en Polynésie française en 1994.
Si ce régime a permis une amélioration significative de l’état de santé de la population de la Polynésie française, il fait aujourd’hui face à d’importantes difficultés financières, en grande partie liées à la dégradation du climat économique général depuis 2008. En effet, la croissance atone du pays s’est répercutée sur les finances de la collectivité.
À la demande du président de la Polynésie française, une mission d’appui sur le système de santé et de solidarité polynésien a été conduite conjointement par l’Inspection générale des affaires sociales, l’Inspection générale des finances, et l’Inspection générale de l’administration, s’agissant de l’aggravation de la situation financière du RSPF. Elle a donné lieu en juin dernier à un rapport qui formule soixante-six propositions permettant de poursuivre le rétablissement de l’équilibre des dépenses de santé et de restaurer celui du RSPF. Ces propositions portent à la fois sur la maîtrise des dépenses et sur les hausses de recettes envisageables sans remettre en cause l’accès aux soins pour les plus démunis.
À la suite des engagements pris cet été, un groupe de travail composé de représentants des autorités polynésiennes et de représentants des administrations centrales du ministère des affaires sociales et du ministère des outre-mer a été installé afin d’approfondir les pistes de réformes et les modalités d’accompagnement de l’État au redressement du RSPF.
Deux pistes sont d’ores et déjà à l’étude : d’une part, mettre fin à la majoration du tarif appliqué aux Polynésiens soignés en métropole ; d’autre part, réfléchir aux conditions dans lesquelles l’État pourrait, en tant qu’employeur, verser à la Polynésie française une partie des cotisations patronales. Des expertises devraient déboucher dans les toutes prochaines semaines. Il s’agira là encore d’un effort conséquent pour l’État.
Je puis vous assurer de la volonté du Gouvernement de rechercher avec les autorités de la Polynésie française les voies d’un redressement durable du RSPF, en réaffirmant le principe d’une contribution de l’État à ce régime, au regard et en accompagnement des réformes qui seront engagées pour en assurer la pérennité dans le sens des propositions de la mission inter-inspections.

J’entends la confirmation des deux mesures que vous proposez, mesures qui, comme je l’indiquais, sont certes nécessaires, mais ne constituent à notre sens que des régularisations attendues depuis déjà plusieurs années, notamment en ce qui concerne un tarif « homogène » pour les malades polynésiens, c’est-à-dire un tarif identique à celui des malades français. Cela me semble une évidence.
Néanmoins, ce régime a connu un déficit considérable en 2014, et rien n’est prévu à cet égard dans le projet de loi de finances pour 2015. Or les soixante-six mesures du rapport de l’IGAS ne seront pas mises en place avant plusieurs années et ne permettront donc pas de résoudre la difficulté à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés. Cette difficulté est liée à une situation d’urgence. L’État doit donc apporter rapidement son soutien au titre de la solidarité nationale à ce régime de solidarité, car ce sont les familles les plus démunies qui en ont le plus besoin. Je vous rappelle qu’un quart de la population polynésienne vit aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté, sans aucun revenu et sans travail. Nous ne pouvons attendre que ces soixante-six mesures soient mises en œuvre car, malheureusement, le déficit du Régime de solidarité de la Polynésie française s’aggravera encore au cours de l’année prochaine.

La parole est à M. Christian Favier, auteur de la question n° 890, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite appeler votre attention et dire mon inquiétude sur les conditions de mise en œuvre du plan crèches 2013-2017, qui se fixe pour objectif la création, en moyenne annuelle, de 20 000 nouvelles places d’accueil collectif.
Le Haut Conseil de la famille, le HCF, a fait part des mêmes inquiétudes. Dans sa note de conjoncture du mois d’octobre, il constate que, en 2013, seule la moitié des places prévues aura été créée. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, mais la plus importante tient aux difficultés rencontrées par de nombreuses collectivités territoriales, qui sont aujourd’hui dans l’impossibilité de mobiliser les financements nécessaires à la construction et à la gestion de nouvelles crèches, du fait des restrictions budgétaires drastiques qu’elles subissent et qui vont malheureusement s’accélérer.
Après le gel puis la forte diminution des dotations d’État, des études récentes font apparaître le risque que ces collectivités baissent leurs investissements de près de 25 %.
Il faut savoir également que, toujours d’après le Haut Conseil de la famille, le coût de construction des crèches a presque doublé en dix ans sans que le montant des aides ait suivi cette progression. Pis même, une étude récente sur le financement des structures d’accueil montre que le taux de participation de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, a reculé au cours de la même période, passant de 36, 8 % à 25, 6 %.
Ce désengagement des allocations familiales doublé des réductions de dotation imposées aux collectivités territoriales risque donc de compromettre gravement le développement des places en crèche, pourtant indispensables.
Alors que le Gouvernement réaffirme faire de la création de nouvelles places en crèche une priorité de la convention d’objectifs et de gestion signée avec la CNAF, je crains que cette volonté ne soit contredite par les faits et par un désengagement financier sur le terrain.
Aussi je vous demande, madame la secrétaire d’État, si cette diminution de près d’un tiers de l’intervention de la CNAF n’est pas de nature à décourager encore plus les collectivités territoriales, principales actrices en ce domaine, d’autant que ces dernières sont frappées par ailleurs d’une forte baisse de leurs ressources, pour aujourd’hui mais aussi, malheureusement, pour demain.
Dans ces conditions, madame la secrétaire d’État, de quels moyens allez-vous vous doter pour remédier à cette situation et pour faire face à ce risque de relative stagnation du nombre de places en crèche alors que les besoins n’ont jamais été aussi forts ? Quelles mesures nouvelles le Gouvernement compte-t-il prendre pour soutenir les collectivités qui investiront dans la création de nouvelles places en crèche, tant attendues par les parents de jeunes enfants ?
Monsieur le sénateur Favier, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme la secrétaire d’État, Laurence Rossignol.
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion pour la période 2013-2017, le Gouvernement a fixé à la Caisse nationale des allocations familiales un objectif sans précédent : la création de 100 000 solutions en accueil collectif et 100 000 solutions en accueil individuel.
Il s’agit d’une contribution déterminante à l’atteinte de l’objectif global de 275 000 places d’accueil supplémentaires pour les enfants de zéro à trois ans d’ici à 2017, objectif qui mobilise également l’éducation nationale à hauteur de 75 000 places de préscolarisation.
Cet objectif conduira à augmenter de 20 % le nombre de places d’accueil disponibles en seulement cinq ans. À titre de comparaison, à peine 100 000 solutions d’accueil pour les enfants de zéro à trois ans ont été créées sous le gouvernement de François Fillon : pour 158 000 nouvelles solutions d’accueil en crèche ou auprès d’assistants maternels, la précédente majorité avait supprimé 58 000 places en maternelle. Les ambitions ne sont donc en rien comparables.
Le 9 octobre 2014, le Haut Conseil de la famille a adopté un avis et une note faisant le point sur le développement de l’accueil des jeunes enfants. Le HCF souligne que la tendance constatée permettrait d’atteindre 51 % de l’objectif en 2013. Il précise que la conjoncture a pesé sur les réalisations.
En effet, l’année 2013 constitue la première année de la convention d’objectifs et de gestion, dont la signature a été tardive, en juillet. Or, la sous-exécution des crédits finançant l’investissement des projets de crèches est habituellement la première année d’une convention d’objectifs et de gestion. Parmi les autres facteurs conjoncturels cités par le HCF figurent le contexte économique dégradé, qui aurait induit une plus faible demande d’accueil par les parents, ainsi que les élections municipales du printemps 2014, qui auraient freiné les projets.
Malgré ce contexte très défavorable, ce sont près de 11 000 places de crèche nouvelles qui ont été proposées aux familles en 2013, auxquelles s’ajoutent les 14 000 places déjà ouvertes en 2012. En deux ans, les efforts du Gouvernement ont porté leurs fruits et ont permis d’offrir des solutions supplémentaires aux familles. Au total, ce sont 384 000 places dans 11 400 établissements d’accueil du jeune enfant, qui sont proposées aux enfants de moins de trois ans.
Mais ce n’est pas tout : 313 000 assistants maternels agréés accueillent en 2013 plus de 960 000 enfants, dont 620 000 sont âgés de moins de trois ans. Enfin, à la rentrée scolaire 2013, plus de 97 000 enfants de moins de trois ans ont été scolarisés en maternelle.
Néanmoins, le Haut Conseil met également en avant des difficultés d’ordre structurel pour expliquer les moindres créations de places d’accueil collectif depuis 2013. Pour autant, je ne peux pas vous laisser dire que ces difficultés sont liées à un désengagement de la Caisse nationale d’allocations familiales. C’est faux : la subvention d’investissement des caisses d’allocations familiales est passée de 6 600 euros en moyenne par place en 2000 à près de 9 000 euros en 2013 ; elle a donc augmenté de 32 %.
En revanche – et c’est le constat du HCF –, « les coûts de construction des établissements d’accueil du jeune enfant ont presque doublé » sur la même période, passant de 18 000 euros à 34 000 euros. Dès lors, le taux de cofinancement par les CAF a effectivement diminué.
Face à ce constat, le Gouvernement a immédiatement décidé d’agir pour conforter le plan crèches, pour rassurer les collectivités territoriales et les familles.
Cette accélération du plan crèches repose, d’une part, sur une aide exceptionnelle de 2 000 euros supplémentaires pour chaque nouvelle place de crèche dont la création sera décidée en 2015 et, d’autre part, sur un travail de simplification par l’allégement des normes qui encadrent la construction de places de crèches.
À cela s’ajoute un plan global de développement des places auprès des assistants maternels, fondé sur le renforcement de l’accompagnement des assistants maternels par les relais d’assistants maternels, l’augmentation de la prime à l’installation des assistants maternels, l’expérimentation du versement, en tiers payant, du complément de libre choix du mode de garde pour les familles modestes.
Vous le constatez, la détermination du Gouvernement à tenir ces objectifs ambitieux est intacte.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse, qui confirme mes propos sur le faible nombre de places créées en 2013. À cet égard, vous avez en effet confirmé que l’objectif n’avait été atteint qu’à 50 %. Pour notre part, nous ne pouvons nous contenter de déclarations d’affichage ou de bonnes intentions. Si un changement significatif n’est pas obtenu dans l’amélioration de l’offre d’accueil pour la petite enfance, et dans des conditions financièrement acceptables pour les familles et donc pour le plus grand nombre, c’est aussi l’accès à l’emploi de nombreux parents qui risque d’être remis en cause, et tout particulièrement – je sais que vous êtes sensible à cette question – des femmes, qui sont souvent les premières victimes de l’absence de mode d’accueil.
Personnellement, j’attends d’un gouvernement de gauche des décisions courageuses en la matière. Or, quand on a pu trouver 20 milliards d’euros dans le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sans aucune contrepartie en matière d’emploi, on devrait être capable, me semble-t-il, de dégager des moyens plus importants permettant la réussite de ce plan crèches !
Madame la secrétaire d’État, vous avez effectivement évoqué une aide supplémentaire de 2 000 euros par place. Je rappellerai simplement que le coût d’une place est de 35 000 euros à sa création et de 15 000 euros par an pour son fonctionnement.
Par conséquent, en dépit des efforts du Gouvernement, certes appréciables, les maires et les collectivités territoriales sont très loin de disposer des moyens nécessaires pour faire face à cette demande. En outre, il est faux de dire, comme vous l’avez affirmé, madame la secrétaire d’État, que les résultats en 2013 étaient liés au nombre de demandes des familles en diminution. C’est complètement faux ! Au contraire, les demandes de place en crèche, notamment dans un département comme le Val-de-Marne – j’en sais quelque chose ! – sont aujourd’hui de cinq à dix fois supérieures au nombre de places proposées, y compris dans les départements qui font beaucoup d’efforts en la matière.
Par conséquent, nous attendons que ce plan crèches soit réellement mené au bon niveau. Or ce n’est pas encore le cas pour le moment…

La parole est à M. Jean Desessard, auteur de la question n° 917, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Madame la présidente, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur, qui est absent ce matin. J’en profite pour dire que je lui ai envoyé quelques courriers qui sont restés sans réponse ; mais enfin, je ne m’attarderai pas sur ce point… Madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’être présente ce matin pour m’apporter une réponse, que j’espère positive.
Ma question sera brève, car elle est simple et son exposé clair et limpide.
Depuis plusieurs mois, dix-huit travailleuses et travailleurs sans papiers se battent contre l’exploitation dont ils sont victimes en plein cœur de Paris : je veux parler des salariés du salon de beauté situé au 57, boulevard de Strasbourg. Recrutés peu après leur arrivée en France par ce qu’il convient d’appeler « un réseau mafieux », ces dix-huit personnes, en majorité des femmes, ont subi l’inacceptable.
Je me suis rendu sur place voilà une dizaine de jours et j’ai été bouleversé par leur récit : effectuant des journées de travail de plus de douze heures, dans des locaux insalubres, mal aérés, en présence de produits chimiques, ces personnes sont payées entre 200 et 400 euros par mois et séparées selon leur nationalité pour éviter toute rébellion.
Ces salariés se sont mobilisés avec courage pour s’extraire de leur condition et ont pris contact avec la Confédération générale du travail qui leur a, depuis, apporté un soutien indéfectible. Mesdames, messieurs les sénateurs de l’UMP, qui critiquez souvent la CGT, je veux aujourd’hui rendre hommage à cette organisation pour ce combat : la CGT Paris a mené cette action de façon admirable et désintéressée, dans des conditions très difficiles.
Les salariés du 57, boulevard de Strasbourg ont porté plainte individuellement contre ce système fondé sur le recrutement et l’exploitation de personnes vulnérables par le travail dissimulé. La loi prévoit, dans le cadre de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, la délivrance d’un titre de séjour dès le dépôt d’une plainte contre la traite des êtres humains afin de protéger les victimes. Ce délit a été constaté par l’inspection du travail à quatre reprises depuis le mois de mai avec des procès-verbaux mentionnant des « conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ».
Or cette demande légitime n’a pas été entendue par la préfecture de police, qui refuse de délivrer les titres de séjour. Ces travailleurs qui ont choisi de résister et de faire valoir leurs droits pourraient être expulsés, alors que leur employeur, qui a entre-temps fui les lieux, n’est pas inquiété. Cette situation ne peut plus durer.
Madame la secrétaire d’État, la dignité humaine exige au moins le respect de la loi. Quelles mesures M. le ministre de l’intérieur compte-t-il prendre afin que ses services respectent l’article L. 316-1 du CESEDA et délivrent à ces travailleuses et travailleurs courageux un titre de séjour afin de mener leur combat à terme ?
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention du ministre de l’intérieur, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence, sur la situation au regard du droit au séjour des personnels d’un établissement situé sur le boulevard de Strasbourg, à Paris, qui ont porté plainte pour des faits de travail dissimulé et de traite des êtres humains.
Ce dossier fait l’objet d’un suivi très attentif de la part de la préfecture de police et du directeur général des étrangers en France.
Dès le printemps a été engagé un examen individualisé de la situation de chacune de ces personnes. Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs entrées dans un processus de régularisation qui pourrait aboutir favorablement dès lors qu’elles seront en mesure de produire des promesses d’embauche.
La préfecture de police poursuit l’instruction de l’ensemble de ces dossiers dans le cadre fixé par la circulaire du 28 novembre 2012 qui, comme vous le savez, a énoncé des critères précis de régularisation pour assurer à chaque ressortissant étranger en situation irrégulière un traitement équitable de sa demande, quel que soit le lieu où il se trouve sur le territoire.
Toutes les diligences sont prises pour favoriser, dans le respect des textes, la prise en compte des situations humaines que vous évoquez et pour que les personnes présentant une promesse d’embauche et des perspectives satisfaisantes d’intégration professionnelle et sociale puissent sortir de la clandestinité.
Par ailleurs, vous évoquez l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile…
… qui permet à l’autorité préfectorale de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un ressortissant étranger portant plainte contre un réseau de traite des êtres humains.
Les conditions de mise en œuvre de cette disposition ne pourront être réunies qu’à partir du moment où le procureur de la République aura engagé des poursuites sur ce fondement.
De manière plus générale, les services du ministère de l’intérieur sont convenus d’un plan d’action résolu pour mettre un terme aux situations de travail illégal et d’exploitation qui se font jour sur ce boulevard et qui ne peuvent pas être tolérées.
Des contrôles renforcés ont été diligentés pour identifier les cas de travail non déclaré. Au 30 septembre 2014, ce sont vingt et une opérations qui avaient été réalisées contre huit sur toute l’année précédente. Ces investigations vont se poursuivre dans les prochaines semaines.

J’ai des raisons de me réjouir de votre réponse, madame la secrétaire d’État : il est vrai que des actions sont engagées ; il est vrai également que, alors que ces travailleuses et travailleurs du 57, boulevard de Strasbourg ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion par le propriétaire des murs du salon et que le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’il n’était pas compétent sur le plan procédural pour accéder à cette demande, la police s’intéresse désormais à toute cette rue ! En effet, quelque cent-cinquante boutiques de ce type sont dans les mêmes conditions ! J’ai donc bien compris, madame la secrétaire d’État, que M. le ministre de l’intérieur voulait agir.
Néanmoins, je suis déçu ! Vous dites que l’article L. 316-1 du CESEDA n’a toujours pas été utilisé parce que le procureur n’a pas encore engagé des poursuites. Pourtant, c’est la loi ! Ces travailleurs ont porté plainte pour dénoncer des conditions inacceptables de travail, dont j’ai pu me rendre compte par moi-même, qu’il s’agisse du local de travail ou de l’exploitation de ces personnes sans papiers depuis des années ! D’ailleurs, si vous vous rendez dans les boutiques d’à côté, c’est quasiment la même chose !
Si le simple citoyen, le sénateur de base que je suis arrive à constater tout cela, les services de la police et le procureur devraient pouvoir faire quelque chose !
Madame la secrétaire d’État, c’est dès le dépôt de la plainte pour travail illégal dans des conditions inacceptables qu’il faut lutter contre le travail au noir, le travail dissimulé, l’exploitation ! Il ne faut pas attendre ! Vous avez l’air de dire que le procureur n’est pas prêt, qu’il n’a pas réuni les conditions… J’espère que, à la suite de cette question orale sans débat, la procédure va être accélérée en vue de mettre fin à des conditions de travail inacceptables !

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, auteur de la question n° 893, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Madame la secrétaire d’État, le 18 septembre 2014, l’Autorité de la concurrence, saisie par la commission des finances de l’Assemblée nationale, a rendu public son avis relatif aux sociétés concessionnaires d’autoroute : son principal constat est cinglant à leur égard. Elle pointe une rentabilité exceptionnelle, déconnectée des coûts et disproportionnée par rapport au risque de l’activité.
Il est vrai que les marges affichées – entre 20 % et 24 % – battent des records et sont à faire pâlir d’envie n’importe quel autre secteur d’activité. À front renversé, elles sont aussi à faire rougir de colère les utilisateurs, qui subissent les hausses répétées des tarifs.
L’Autorité, qui assimile cette situation à une rente, appelle à davantage de régulation en faveur de l’État et des usagers. Plus de régulation en faveur de l’État et des usagers, c’est aussi ce que défendent les membres de l’Association « A10 gratuite ». Ces derniers militent, et ce depuis 2001, pour la mise en gratuité des autoroutes A10 et A11 en Île-de-France.
L’autoroute A10 possède la particularité d’être payante à seulement vingt-trois kilomètres de Paris lorsque les autres autoroutes « historiques » franciliennes, à savoir les autoroutes A6, A13, A5, A4 et A1, le sont à environ cinquante kilomètres, voire aux portes de la région d’Île-de-France.
Les Essonniens sont de fait des usagers assidus de cette infrastructure. Dans le cadre de leurs déplacements pendulaires, nombre d’entre eux s’acquittent du prix du péage, si bien que, sur une année, le montant de la somme dépensée pour emprunter le tronçon s’échelonne entre 300 et 1 300 euros. Il s’agit donc d’un poste budgétaire important pour les familles.
Par ailleurs, le péage emporte des conséquences sur le réseau routier secondaire essonnien. La RN20 fait par exemple figure d’itinéraire bis pour les camions souhaitant s’exempter du prix du péage. En 2013, selon les relevés du syndicat RN20, le trafic moyen journalier annuel poids lourds s’élevait sur cet axe à plus de 25 000 véhicules. Or bon nombre d’entre eux n’y circulent pas pour raison de desserte locale. Ils optent tout simplement pour une stratégie d’évitement. En effet, pourquoi s’acquitter des droits du péage lorsqu’il est possible de rejoindre sa destination via Artenay, en remontant la RN20 jusqu’à Montlhéry pour enfin reprendre la RN104, soit plus de cent kilomètres sans bourse délier ? En conséquence, les nuisances se développent, l’axe sature, les riverains également.
En mai 2013, à l’idée de la gratuité de l’A10 pour tous, le ministre des transports interrogé répondait « coût du rachat du péage dans un contexte budgétaire contraint ». À l’idée d’une gratuité catégorielle, il opposait le principe d’égalité entre les usagers. Soit !
Des tarifs préférentiels sont bien proposés, mais ce n’est pas suffisant, et ce d’autant moins si l’on considère les marges de manœuvre dont disposent les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Aussi, à l’heure où les avis convergent pour reconnaître la nécessité de rééquilibrer les contrats de concession au profit des usagers, à l’heure où il existe une volonté politique de redonner du pouvoir d’achat aux ménages, pouvez-vous m’indiquer si le Gouvernement entend revoir les contrats de concession, ce à dessein de supprimer ou d’assouplir davantage encore les conditions tarifaires d’accès au tronçon francilien de l’autoroute A10 ?
Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur les suites à donner à l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence au sujet des contrats de concession.
Soyez assurée de la mobilisation du Gouvernement sur ce dossier, dans le respect, bien entendu, de ses engagements et des obligations juridiques qui s’imposent à lui.
M. le Premier ministre l’a indiqué il y a quelques jours, des réunions de travail associant le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, le ministère des finances et des comptes publics et les concessionnaires autoroutiers auront lieu dans les prochaines semaines. Leur but est d’élaborer des propositions, notamment à la suite de l’avis de l’Autorité de la concurrence.
En ce qui concerne les autoroutes desservant les territoires de l’ouest de l’Essonne, d’importants efforts ont été accomplis par l’État et la société concessionnaire Cofiroute, pour améliorer les conditions financières d’utilisation de l’autoroute A10.
Depuis plusieurs années, des formules d’abonnement préférentielles à destination des usagers réguliers transitant par le diffuseur de Dourdan ont été instaurées. Les réductions ont été accrues en 2011 et ont conduit à abaisser le péage jusqu’à 80 centimes d’euro par passage, au lieu de 1, 60 euro. Des tarifs préférentiels destinés à favoriser le covoiturage sur ce trajet sont également proposés. En outre, des aires de covoiturage ont été aménagées à Ablis, Allainville et Dourdan.
Les autoroutes d’Île-de-France sont des infrastructures déjà proches de la saturation pour les trajets « domicile-travail » en véhicule individuel. C’est pourquoi les stratégies publiques de déplacement dans cette région tendent à favoriser les transports collectifs, en particulier pour les territoires riverains de l’A10 et de l’A11.
Ainsi, la poursuite du projet de réalisation d’une voie réservée aux bus sur la section terminale de l’A10 entre Les Ulis et Massy, en complément de la section de 1, 5 kilomètre déjà en service, garantira des temps de trajet performants pour les lignes de bus mises en service entre Dourdan, Briis-sous-Forges et Massy.
Un accroissement de la capacité d’accueil du parking de comodalité de Dourdan est également envisagé, dans le cadre des travaux environnementaux du plan de relance autoroutier récemment approuvé par la Commission européenne.

Monsieur le secrétaire d’État, vous formulez certains rappels importants, notamment au sujet de la stratégie élaborée en matière de transports collectifs. Le développement de ces derniers est une nécessité, j’en conviens volontiers.
Malgré tout, je tiens à apporter une précision : les tronçons de l’A10 et de l’A11 en Île-de-France sont victimes de la pratique du foisonnement. Ce procédé, totalement inacceptable, consiste à faire payer plus cher la circulation sur les portions autoroutières les plus fréquentées.
Vous nous rappelez les perspectives de travail que le Premier ministre a rendues publiques il y a quelques semaines. J’ai bien entendu que des propositions seraient émises dans ce cadre, à la suite de l’avis de l’Autorité de la concurrence.
Je tiens à rappeler une nouvelle fois les attentes que ces négociations suscitent, et le souhait que l’État travaille avec ses partenaires pour proposer des solutions qui tiennent naturellement compte des intérêts des usagers. Sans doute sommes-nous aujourd’hui à un moment où la discussion est possible, en particulier dans le cadre du plan de relance autoroutier.
Je vous remercie d’ores et déjà, monsieur le secrétaire d’État, de l’attention que porte le Gouvernement à ce dossier.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, auteur de la question n° 895, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur la situation du service de santé des gens de mer, le SSGM, plus particulièrement au Guilvinec, dans le département du Finistère.
Depuis avril dernier, aucun médecin n’est affecté au suivi sanitaire des gens de mer dans ce quartier maritime, qui est l’un des plus grands de France, sinon le premier. Cette situation n’est, hélas ! pas nouvelle. Ce service autonome de médecine du travail relevant de l’administration de la mer, organisé pour les marins professionnels de la pêche, du commerce et de la plaisance professionnelle, exerce des missions capitales, imposées par la législation maritime : il procède à l’examen médical annuel de chaque marin embarqué.
Ainsi, l’absence d’un praticien au Guilvinec est source de vives inquiétudes pour les marins, car les besoins sont réels. Je le rappelle, en 2010, le médecin en fonction assurait près de 2 500 visites en douze mois, contre près de 1 500 pour celui de Concarneau. Pas de visite médicale, pas d’embarquement : le bateau reste à quai ! On mesure les conséquences financières d’une telle situation.
Les sites de Morlaix, Audierne, Douarnenez et Auray ont déjà fermé. Les solutions prévues à l’heure actuelle ne sont que temporaires. À titre transitoire, un médecin militaire réserviste assure une permanence à Concarneau, une fois par semaine. Les médecins de Paimpol et de Saint-Malo se déplaceront quant à eux ponctuellement pour effectuer des visites. Certains quartiers maritimes en viennent à proposer aux médecins généralistes, non formés à cette spécialité, d’assurer quelques visites, par ailleurs fort peu rémunérées.
En dépit des efforts accomplis par votre ministère, ainsi que par la direction interrégionale de la mer, force est de constater que la situation ne semble guère évoluer. Or une solution transitoire ne saurait par définition suffire ni perdurer.
Monsieur le secrétaire d’État, quelles solutions envisagez-vous pour faire face à ce problème urgent, mais aussi, à plus long terme, pour assurer la sécurité sanitaire des marins, en cohérence, bien entendu, avec les conventions internationales ?
Madame la sénatrice, l’accès à la profession de marin est réglementé. Les conventions internationales et la réglementation nationale imposent la délivrance périodique d’un certificat médical d’aptitude à la navigation.
Le service de santé des gens de mer assure, pour les marins professionnels, ces visites médicales. Tout marin bénéficie ainsi d’une visite médicale annuelle. Le SSGM a la charge de veiller au bon fonctionnement des services médicaux des gens de mer sur la façade littorale.
Pour ce qui concerne plus particulièrement le Guilvinec, le poste de médecin est vacant depuis plusieurs mois, par suite du décès de son titulaire, survenu en avril de cette année.
Depuis lors, la direction des affaires maritimes s’est attelée au remplacement de ce praticien. Ses recherches se sont dirigées vers les médecins de prévention et les médecins titulaires du diplôme de médecine maritime du département du Finistère, puis de la région Bretagne. À ce jour, nous n’avons pu encore conclure avec aucun des candidats potentiels.
Bien entendu, les recherches se poursuivent très activement.
Je suis très attaché au bon fonctionnement de ce service de santé, particulièrement auprès des marins du Finistère sud, pour qu’ils puissent exercer leur métier dans des conditions optimales. Des dispositions transitoires ont au demeurant été prises et, vous le savez, je me suis rendu sur place, au Guilvinec, il y a quelques semaines.
Vous m’interrogez par ailleurs sur la durée de validité de ces certificats médicaux, qui pour l’heure est d’un an. La convention du travail maritime en date de 2006 autorise, sous conditions, une validité d’une durée maximale de deux ans pour les certificats médicaux des gens de mer. J’ai demandé à mes services d’étudier la faisabilité de cette mesure et de soumettre cette question aux partenaires sociaux pour consultation.

Merci, monsieur le secrétaire d’État, de votre réponse. Ce bilan annuel est une grande contrainte, pour les médecins de mer comme pour les marins. Cela étant, vous l’avez souligné à juste titre, l’état sanitaire de nos marins est une préoccupation importante, car ces derniers exercent un métier fort difficile.
Au-delà de ce problème spécifique, il faut souligner plus généralement la pénurie de praticiens spécialisés dans la médecine du travail, dans la médecine scolaire, ou dans la protection maternelle et infantile. La France connaît de vraies difficultés de formation dans ces différentes disciplines, ce qui peut conduire à des situations assez compliquées, voire ubuesques : les marins sont parfois contraints de prévoir dans leur agenda un déplacement, à Saint-Malo, par exemple, simplement pour pouvoir embarquer, c'est-à-dire pour faire leur travail !
À mon sens, la piste que vous proposez, à savoir travailler avec les partenaires sociaux pour permettre, sous certaines conditions et selon l’état de santé de chaque marin, de porter à deux ans la validité de ce certificat, pourrait être une solution. Pour autant, il ne faut pas oublier la formation des médecins.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 873, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur les problèmes et les conflits induits par le développement des éoliennes.
Le Gouvernement a annoncé vouloir réduire à 50 % la part du nucléaire d’ici à 2025. Pour atteindre cet objectif, il mise notamment sur le développement de l’éolien terrestre et maritime.
En 2013, malgré 5 000 implantations d’éoliennes sur le territoire français, cette énergie ne représentait que 2, 9 % de la production d’électricité nationale.
Si, dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, l’éolien est bien présenté comme l’une des énergies alternatives au nucléaire, on ne peut observer sans inquiétudes que la filière éolienne commence à être critiquée, voire suspectée.
Tel est l’objet de ma question.
Le premier problème est celui des tarifs de rachat de l’éolien, qui ont été imposés à EDF à un prix supérieur à celui du marché. La Cour de justice de l’Union européenne a estimé que ce mécanisme français de compensation des surcoûts relevait de la notion d’intervention de l’État et que cette utilisation des ressources publiques était contraire aux règles communautaires. Le Conseil d’État a par ailleurs annulé en mai 2014 les arrêtés introduisant ce dispositif.
Le deuxième problème tient au développement acharné de cette filière, qui est principalement dominée par des industriels internationaux. Ces derniers usent d’arguments erronés pour favoriser l’implantation de parcs qui peuvent défigurer des paysages et porter atteinte, dans certains lieux, à notre patrimoine architectural. Ajoutons à cela la détérioration du cadre de vie des Français et l’impact sur leur santé, à cause du bruit que font ces éoliennes, lorsqu’elles fonctionnent.
Le troisième et dernier problème est tout aussi grave. L’implantation à marche forcée de ces éoliennes entraîne la multiplication des prises illégales d’intérêts de la part des élus locaux, comme l’a souligné, dans son rapport d’activité pour 2013, le service central de prévention de la corruption, le SCPC. Y est dénoncée la participation de certains élus aux délibérations de leur conseil municipal portant sur l’implantation d’éoliennes, alors qu’ils sont propriétaires de parcelles situées dans le périmètre qui va accueillir ces infrastructures.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite connaître les mesures qu’envisage le Gouvernement pour résoudre ces divers problèmes : le coût du rachat de l’électricité par EDF via un dispositif qui a été annulé, les menaces pesant sur nos paysages et notre patrimoine, les nuisances subies par les riverains de ces éoliennes et, enfin, les conflits d’intérêts d’élus locaux qui fragilisent de plus en plus, par leur multiplication, la prise de décision.
Madame la sénatrice, Mme Ségolène Royal, qui ne peut être présente ce matin, m’a demandé de vous transmettre les éléments de réponse qui suivent.
La transition énergétique appelle un fort développement des énergies renouvelables. Parmi ces dernières, l’énergie éolienne terrestre est la plus compétitive, après l’énergie hydraulique. Regroupant de nombreux acteurs industriels français de premier plan, cette filière contribue à la réindustrialisation de nos territoires. La maîtrise des impacts de ces projets sur le paysage, l’occupation des sols et la faune sauvage sont autant de priorités pour permettre un développement durable de l’éolien terrestre.
Pour planifier l’implantation des éoliennes, le schéma régional éolien, annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, identifie les zones favorables ; il tient compte du potentiel éolien, des règles de protection des espaces naturels et du patrimoine naturel, culturel et paysager.
Les projets d’éoliennes doivent, en outre, obtenir une autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou ICPE. La procédure impose aux porteurs de projet de démontrer, par le biais d’une étude d’impact détaillée, que tous les risques et les impacts sur l’environnement que vous mentionnez sont bien maîtrisés.
Avant décision du préfet, le dossier est soumis à enquête publique. Le préfet doit accompagner l’arrêté d’autorisation de prescriptions visant à réduire les impacts.
Afin d’accélérer la réalisation des projets éoliens sans diminuer le niveau des exigences applicables, Mme Ségolène Royal a fait inscrire dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte la généralisation de l’expérimentation de l’autorisation unique. Celle-ci regroupe l’autorisation ICPE, le permis de construire, l’autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie ainsi que l’autorisation de défrichement et la dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, lorsqu’elles sont nécessaires.
Enfin, le dispositif de soutien aux tarifs d'achat a été sécurisé en mars 2014, après sa notification approuvée par la Commission européenne.
M. Jean Desessard applaudit.

Monsieur le secrétaire d’État, vous évoquez les industriels français, dont quelques-uns sont, heureusement, associés à ces investissements. La plus grande part du marché reste cependant aux mains d’industriels étrangers.
En outre, votre réponse n’a pas abordé un aspect de la question sur lequel j’attire votre attention : les conflits d’intérêts qui touchent les élus.
Dans le Lot, par exemple, un procès s’est tenu il y a moins d’un mois, dans lequel six élus municipaux étaient poursuivis pour prise illégale d’intérêt au motif qu’ils étaient propriétaires de terrains : alors même que le projet d’implantation des éoliennes avait été retiré, la procédure à l’encontre de ces élus s’est donc poursuivie.
En Mayenne, une audience se tiendra dans deux jours, au tribunal correctionnel de Laval, dans une affaire impliquant un élu également soupçonné de prise illégale d’intérêt.
À Caen, une audience du même type est prévue en janvier.
Rien de ce que vous décrivez des dispositions prises par Mme la ministre - études d’impact, prescriptions du préfet, autorisation unique -, ne concerne les élus. Or, en milieu rural, il est tout à fait possible que des élus soient par ailleurs propriétaires des terres agricoles. Dès lors, ils ne peuvent délivrer cette autorisation sans se retrouver poursuivis.
On sait les problèmes sérieux d’ordre patrimonial qui peuvent se poser localement, certaines photos en témoignent, mais vous me dites qu’ils seront pris en compte dans la prochaine loi. En revanche, on ne voit rien venir, pour le moment, concernant les élus, qui se trouvent fragilisés. Ils peuvent en effet souhaiter en toute bonne foi l’implantation d’éoliennes, mais s’ils sont quatre à posséder des terrains agricoles, ils se retrouvent en situation de prise illégale d’intérêt !
Je souhaite que des éléments soient précisés sur cette fragilité juridique, et que le préfet, dans sa prescription, puisse également voir ce qu’il en est.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, auteur de la question n° 900, transmise à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Ma question s’adresse à Mme la ministre de la santé et concerne les suites, en particulier pour les industriels, de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012, qui vise à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A en France, au 1er janvier 2015.
À ce jour, la réglementation européenne n’a pas encore évolué dans le même sens. Dès lors, cette mesure paraît tout à fait anachronique vis-à-vis de nos partenaires européens. Conformément à la réglementation en vigueur, d’autres pays autorisent en effet encore la fabrication de ces composants. La production française va donc être pénalisée une fois de plus par une législation plus restrictive.
Il n’est pas question ici de nier le bien-fondé de cette loi, essentielle sur le plan sanitaire. Cependant, force est de constater que la France ne facilite pas la vie, voire la survie de ses industriels ; le présent dossier en est une nouvelle illustration.
Il en va ainsi de la société Crown Food France, implantée à Laon – la ville dont je suis le maire et qui est le chef-lieu du département de l’Aisne – et employant 247 salariés dans la fabrication de couvercles de boîtes de conserve.
La mise en application de la loi met directement en péril l’activité de ce site, centre européen, pour ce produit, de ce groupe d’emballage. L’exportation de ses couvercles représente annuellement un milliard d’unités, à destination d’autres sites de fabrication du groupe, et de ses clients européens.
À la date du 1er janvier 2015, cette fabrication devra cesser à Laon, et donc être délocalisée vers d’autres sites de production en Europe, mettant immédiatement en danger la pérennité de ce site.
Parallèlement, le rapport évaluant les substituts possibles au BPA dans ses applications industrielles, qui devait être rendu avant le 1er juillet 2014, vient seulement – enfin ! – d’être déposé, ce 30 octobre, donc avec plusieurs mois de retard, alors même que le délai est maintenu à deux mois pour les industriels.
Ce rapport est censé dresser un état des lieux des connaissances sur la substitution du BPA dans les matériaux au contact des denrées alimentaires. Il identifie ainsi soixante-treize alternatives, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES.
Au cours du premier semestre 2014, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a envoyé un questionnaire aux principaux syndicats représentatifs des industriels concernés par la présente loi. Elle a conclu des réponses que ces derniers étaient globalement prêts pour l’échéance du 1er janvier 2015. Or cette conclusion n’est nullement partagée par lesdits industriels que j’ai rencontrés, en particulier par les conserveurs, qui connaissent toujours des difficultés quant à la qualité des substituts.
Ce point est d’ailleurs précisément évoqué dans le rapport : « des difficultés sont mentionnées pour certains produits – corrosion, étanchéité, problèmes organoleptiques, industrialisation etc. – […] qui sont toujours en phase de test industriel. Ces problèmes techniques pourraient ne pas permettre la mise en œuvre de solutions de remplacement au 1er janvier 2015 ». Il apparaît donc plus que nécessaire de plaider pour un report de la date d’entrée en vigueur d’au moins six mois, voire davantage, et, à tout le moins, pour des assouplissements tant que l’Union européenne n’a pas statué dans le même sens que la France.
Ne peut-on envisager de continuer à produire des éléments avec BPA, dès lors qu’ils sont destinés à l’exportation vers les pays de l’Union européenne et les pays tiers dans lesquels ce composant est encore autorisé, tout en respectant les mesures dictées par la loi en ce qui concerne l’interdiction d’importation et de mise sur le marché sur le territoire français ?
Cela répondrait aux inquiétudes des professionnels et des salariés du secteur de l’emballage alimentaire et permettrait ainsi de protéger l’emploi industriel en France, en particulier à Laon, mais également dans d’autres sites sur le territoire national, tout en préservant l’apport sanitaire de la loi, pour nos concitoyens.
Merci, monsieur le secrétaire d’État, de nous éclairer sur les intentions du Gouvernement dans ce dossier.
Monsieur le sénateur, nos concitoyens, alertés par la communauté scientifique, sont de plus en plus préoccupés par les risques pour la santé liés à l’exposition aux substances chimiques dans la vie quotidienne, en particulier à celles qui ont des propriétés de perturbateurs endocriniens et qui sont présentes dans les produits de consommation.
La France, par l’adoption en avril 2014 de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, a été pionnière dans ce domaine. Nous sommes désormais une force de proposition au niveau européen pour accélérer la mise en œuvre de mesures permettant d’évaluer ces substances et de restreindre, voire d’interdire leur utilisation.
Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien avéré et chaque jour de nouvelles études scientifiques viennent nous alerter sur les effets qu’il peut emporter sur la santé.
La loi du 24 décembre 2012, proposée par le député Gérard Bapt, a permis de mettre fin à l’utilisation du BPA dans les contenants alimentaires d’ici au 1er janvier 2015.
Cette mesure d’interdiction a été notifiée à la Commission européenne dès son adoption, il y a bientôt deux ans. La loi adoptée par le Parlement a prévu la rédaction d’un rapport de synthèse des substituts envisageables pour les usages du BPA. Celui-ci a fait apparaitre l’existence de nombreuses possibilités, grâce à la forte mobilisation des industriels depuis deux ans, preuve que des solutions économiques acceptables existent.
Cet élan remarquable, qu’il faut saluer, est un facteur d’innovation pour les entreprises de notre secteur de l’agroalimentaire. Lors de l’adoption de la loi, le débat a porté sur l'interdiction à l’export des produits imprégnés. Les parlementaires ont écarté à juste titre cette éventualité, considérant qu’il n’était pas acceptable de commercialiser hors des frontières des produits jugés impropres sur le territoire national.
Au-delà du caractère moral de cette décision, je suis convaincu que l’avantage qualitatif des produits français pourra être ainsi valorisé à l’export, grâce à la communication sur leur caractère sain. C’est le sens du nouveau modèle de croissance verte promu par le Gouvernement.

Monsieur le secrétaire d’État, je suis un peu déçu par la réponse qui vient de m’être communiquée. Vous me rappelez la préoccupation sanitaire prégnante dans le dossier du bisphénol A, mais sachez que, dès mon arrivée au Sénat, je fus au nombre des rares parlementaires à se préoccuper du sujet. Je mesure donc bien les enjeux de santé publique.
Ma question portait sur la situation de nos industries. Compte tenu du délai très court laissé à nos entreprises pour la mise en œuvre des dispositions de la loi, j’attendais surtout une réponse sur le moratoire et sur les solutions intermédiaires qu’il faut rapidement trouver afin de ne pas, une fois de plus, gêner nos industriels.
Je regrette que l’on ne s’oriente pas dans cette direction.

La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, auteur de la question n° 896, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, depuis quelques dizaines d’années, l’oléiculture française est redevenue un secteur dynamique, avec une production moyenne annuelle de 2 000 tonnes d’olives de table et de 5 000 tonnes d’huile d’olive.
Cette production ne satisfait, certes, qu’environ 5 % de la consommation française d’huile d’olive, mais elle fait vivre près de 30 000 oléiculteurs et près de 200 mouliniers et confiseurs, sans compter les retombées économiques qu’elle emporte pour les territoires concernés.
La qualité du travail et les efforts consentis depuis 1994 par la filière oléicole se mesurent d’ailleurs par les reconnaissances en appellation d’origine contrôlée, ou AOC : cinq olives de table, huit huiles d’olive et une pâte d’olive sont concernées.
Or le secteur de l’olive devrait connaître cette année sa plus grave crise depuis 1956, quand le gel des oliviers avait entraîné la quasi-disparition de l’oliveraie française.
Les oléiculteurs s’attendent en effet, dans les semaines à venir, à des pertes de production pouvant aller jusqu’à 80 % de la récolte, notamment en raison d’un développement inhabituellement fort de la mouche de l’olive, bactrocera olea, qui a entraîné la chute au sol d’une importante proportion de fruits.
Tout au long de l’année 2014, le développement végétatif des olives a été contrarié par des conditions météorologiques très défavorables, qui ont facilité le développement des parasites.
De plus, le respect de la réglementation en matière d’application de pesticides s’est traduit par une impossibilité de lutter efficacement contre la présence permanente de la mouche de l’olive, y compris pour les exploitants en agriculture biologique.
En conséquence, la plupart des territoires français de la production d’olives vont connaître un volume de récolte très réduit et des rendements en huile extrêmement faibles. Tout cela va provoquer d’importantes difficultés économiques pour l’ensemble de la filière, en particulier dans les territoires dont les productions sont reconnues soit en appellation d’origine contrôlée soit en indication géographique protégée.
Permettez-moi, monsieur le ministre, d’insister plus particulièrement sur la situation des oléiculteurs du Nyonsais et des Baronnies, que je connais bien : ces exploitants risquent d’être vraiment sinistrés, en raison de la spécificité de leur production d’olives de bouche, reconnue depuis 1994 par l’AOP « olive noire de Nyons ». Cette production requiert en effet une récolte plus tardive et est plus exigeante quant à l’aspect des fruits que celle des olives à huile.
Aussi, monsieur le ministre, je souhaite que vous m’indiquiez les moyens que vous entendez mettre en œuvre pour apporter une aide économique aux oléiculteurs, ainsi qu’aux membres des structures de la filière organisée, notamment à ceux du Nyonsais et des Baronnies, afin de leur permettre d’affronter cette période : elle s’annonce délicate non seulement pour l’ensemble de la filière mais aussi, au-delà, pour l’activité économique des territoires concernés.
Madame la sénatrice, vous avez évoqué les circonstances assez exceptionnelles qui touchent cette année la production d’olives, notamment celles qui sont reconnues en AOP comme l’olive noire de Nyons, que vous connaissez bien.
Il apparaît assez clairement de ce que nous disent les services que cette situation est liée à un été particulièrement pluvieux et peu chaud. La mouche de l’olive a donc sévi avec une acuité beaucoup plus grande que d’ordinaire. Cet insecte n’étant malheureusement pas répertorié dans la catégorie des nuisibles, il n’est pas possible de mobiliser le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale.
Que peut-on faire ?
On peut réfléchir aux meilleurs moyens de s’organiser pour lutter et préparer l’avenir. Les services de mon ministère seront disponibles pour rencontrer les producteurs, afin de discuter de ce qui peut être fait.
Dans l’immédiat, pour répondre aux difficultés économiques, les directions départementales sont mobilisées, au titre du Fonds d’allégement des charges financières et des demandes d’exonération de taxe foncière sur le non bâti, afin de permettre aux producteurs de traverser cette période difficile et d’assurer, demain, la pérennité des exploitations.
Voilà ce que l’on va faire. Voilà ce que l’on peut faire. Voilà ce que l’on doit faire, face à ce phénomène qui touche, cette année, non seulement la France, mais aussi l’Italie et l’Espagne, des pays ayant connu à peu près la même situation climatique. Les pertes de production au niveau européen sont assez significatives, notamment en France. C’est pourquoi nous devons être mobilisés.
Je le répète, les services de mon ministère recevront les producteurs pour discuter de l’avenir et, dans le même temps, nous nous mobilisons dans l’immédiat pour apporter des solutions aux producteurs, afin d’éviter que cette situation conjoncturelle n’ait des conséquences économiques dramatiques pour la plupart d’entre eux.

Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir pris en compte les problèmes auxquels sont confrontés nos oléiculteurs et la filière oléicole dans son ensemble.
Permettez-moi de reprendre plusieurs des points que vous avez développés.
Vous avez parlé du report des charges et d’une exonération de la taxe sur le foncier non bâti. Je sais que cela répond à une attente des exploitants en monoculture : c’est en effet la demande que m’a récemment faite une oléicultrice qui ne récoltera cette année que 54 litres d’huile d’olive, au lieu de 800 à 1 000 litres habituellement.
Il est essentiel toutefois de prendre en compte les autres exploitations, celles qui ne sont pas en monoculture. Dans le Nyonsais, on trouve également de la vigne et d’autres productions encore.
J’ai également bien noté votre proposition de rencontrer les producteurs. Il est important de penser à soutenir la filière tout au long de l’année prochaine. En effet, cette situation est malheureusement une bombe à retardement pour les mouliniers et les confiseurs, qui souffriront d’un manque de stocks dans le courant de l’année prochaine et perdront de ce fait des parts de marché, qu’ils devront reconquérir.
Peut-être pourrons-nous évoquer ces difficultés jeudi prochain, en marge des assises de la ruralité à Nyons, auxquelles vous assisterez, monsieur le ministre…
M. le ministre opine.

Quoi qu’il en soit, je vous remercie, monsieur le ministre, de l’attention que vous portez à ce dossier.

La parole est à M. Jean-Yves Roux, auteur de la question n° 910, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Ma question porte sur les conséquences sanitaires et économiques de la progression de la besnoitiose bovine.
Encore inconnue il y a quelques années dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la besnoitiose bovine, qui a été identifiée dans la région en 2005, s’est répandue très rapidement dans les cheptels bovins des Alpes-de-Haute-Provence.
Cette maladie parasitaire vectorielle est inoffensive pour l’homme, mais fait des ravages dans les troupeaux de mon département. La maladie était jusqu’à présent identifiée dans le sud de l’Europe et, en France, au sud d’une ligne Nantes-Lyon. Quelques cas viennent aussi d’être détectés en Allemagne.
La contamination se fait le plus souvent par l’intermédiaire d’insectes comme les taons, qui transmettent directement les parasites d’un bovin à l’autre. Un animal infecté reste porteur à vie du parasite.
La besnoitiose peut circuler deux à trois ans dans un cheptel avant que les premiers cas cliniques n’apparaissent. Même en l’absence de cas cliniques, il peut y avoir des animaux infestés dans le troupeau. Il n’est pas rare de constater que 75 % des animaux du troupeau sont touchés. Or un animal contaminé perd toute valeur économique !
Cette maladie peut entraîner des pertes lourdes, car la majorité des animaux peuvent être concernés en quelques mois, avec un taux de mortalité qui se situe régulièrement entre 7 % et 10 %.
À l’heure actuelle, il n’existe en Europe ni traitement ni vaccination préventive. On ne peut donc empêcher la propagation de la maladie de manière véritablement efficace que par l’abattage des troupeaux infectés.
L’un des agriculteurs de mon département, en plein désarroi face aux pertes économiques qu’il subit – son troupeau a été ravagé –, m’a interpellé.
Les pertes sont sévères et les conséquences économiques majeures dans les exploitations touchées.
Des actions de terrain sont menées pour soutenir et informer les éleveurs.
Il est aujourd’hui indispensable d’apporter une réponse de grande ampleur à ce problème, car le monde de l’élevage est très inquiet.
Aussi, vous est-il possible, monsieur le ministre, de nous apporter quelques éclaircissements sur le soutien que vous pourriez apporter en matière de recherche sanitaire, afin, notamment, d’améliorer les outils de diagnostic, d’étudier la possibilité de développer un vaccin, d’améliorer l’identification des animaux porteurs de parasites et d’établir un plan de maîtrise de la maladie ?
De plus, cette maladie n’étant pas réglementée, quel soutien financier peut-on envisager pour ces agriculteurs qui se battent au quotidien pour faire vivre l’élevage dans nos territoires ?
Monsieur le sénateur, vous avez évoqué, vous aussi, une maladie qui n’est pas réglementée. Il n’est donc pas possible de mobiliser les fonds prévus au titre des maladies réglementées, qui ont des conséquences sur les humains.
La besnoitiose exige une forte implication de la recherche, car ses conséquences peuvent être extrêmement lourdes, comme l’illustre l’exemple que vous avez pris d’un agriculteur de votre département. Comme pour d’autres maladies, il s’agit donc de trouver des solutions pérennes.
Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, l’élevage, ce ne sont pas que des maladies ! N’oublions donc pas les actions générales en cours au travers de la réforme de la politique agricole commune, des compensations de handicaps naturels ou encore des aides dites « couplées ».
Vous m’interrogez sur un problème sanitaire, qui a des conséquences sanitaires. Une recherche est engagée sur cette maladie. Nous allons tout faire pour trouver des solutions, mais rien n’est évident. Vous posez une question au ministre de l’agriculture que je suis, mais, sur de tels sujets, je suis obligé de m’adresser aux chercheurs et aux vétérinaires.
Il nous faut donc nous organiser.
Aussi, je demanderai que des réflexions soient conduites, en vue de mettre en place des politiques préventives à différents titres, afin de limiter le développement de cette maladie.
Mais cette maladie peut avoir également des conséquences économiques extrêmement lourdes pour une exploitation lorsqu’un troupeau est décimé. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment pour l’olive, nous devons trouver des solutions économiques en matière d’allégements de charges pour favoriser la pérennisation de l’activité.
Surtout, il convient de ne pas remettre en cause les élevages, qui souffrent déjà. Ce n’est jamais facile, mais, si les exploitants sont en plus confrontés à ce type de maladie, ils doivent être aidés.
C’est pourquoi les services de l’État sont mobilisés sur ce sujet comme sur d’autres, pour mettre en place des mesures d’allégement de charges et de report, qui sont indispensables, je le répète, pour assurer la pérennité économique de l’élevage.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse et du soutien que vous apportez aux éleveurs.

La parole est à Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 901, adressée à M. le ministre de la défense.

Ma question porte sur la dissolution du 1er régiment d’artillerie de marine et sur le départ de l’état-major de la 1ère brigade mécanisée de Châlons-en-Champagne et leurs conséquences économiques et sociales.
Depuis de nombreuses années, notre région, et plus particulièrement la Marne, a payé un lourd tribut aux efforts de restructuration de l’armée, à l’occasion, d’une part, de sa professionnalisation et, d’autre part, de sa modernisation, avec la suppression du 13e régiment du génie d’Épernay, du 402e régiment d’artillerie de Châlons-en-Champagne – déjà -, et de la base aérienne 112 de Reims. Or, aujourd’hui, outre les deux unités militaires châlonnaises, est prévue la suppression du site de stockage de munitions de Connantray-Vaurefroy – environ 100 postes – et du centre de ravitaillement en essence de Bouy, soit 39 postes.
Soyons clairs, monsieur le ministre : je souscris à la logique de réduction de la dépense publique, et la baisse des effectifs en est l’un des moyens. Toutefois, l’objectif du Gouvernement est de supprimer 12 % des emplois militaires en France. Or, à Châlons-en-Champagne, ces emplois disparaissent dans leur intégralité !
Vous le savez, cette décision est un vrai choc économique et social pour une ville qui subit une telle mesure. Mais ce choc est double lorsque cette ville est située dans la seule région de France – la seule ! – à perdre des habitants.
Je ne peux pas comprendre que l’État accompagne cette déprise démographique ! Est-ce une action équilibrée et juste d’aménagement du territoire ?... Non !
Il n’est pas juste de supprimer 1 250 emplois, sans compter les 800 emplois indirects – 3 000 habitants sont concernés –, dans une ville de 45 000 habitants qui est en décroissance démographique. Il est des territoires ultra-urbains où l’État peut opérer des réductions d’effectifs sans compromettre la démographie et le dynamisme économique local.
Cette « double peine » pourrait devenir triple si Châlons-en-Champagne perdait en plus son statut de capitale administrative régionale, avec ses 1 000 autres emplois.
Monsieur le ministre, je demande que l’État joue son rôle d’aménagement du territoire !
Aussi, je souhaite revenir sur les engagements du Gouvernement à propos d’un plan de compensations exemplaire commandé par le Premier ministre. Des mesures de soutien et d’investissement doivent être prises dans la Marne.
En premier lieu, des dotations budgétaires fortes doivent être consenties. Pouvez-vous me confirmer le déblocage important des crédits d’un fonds de restructuration militaire ? À quelle hauteur sera-t-il ?
En second lieu, le territoire marnais attend des mesures en termes de relocalisation d’emplois. Quelles décisions l’État va-t-il prendre ou quelles orientations va-t-il donner pour ce qui concerne le transfert d’agences ou d’administrations d’État, ainsi que les investissements d’entreprises de défense dont l’État est actionnaire ou donneur d’ordre, à l’instar de ce qui s’est fait dans le département voisin de la Meuse ?
Le Gouvernement pourrait également inciter à des transferts d’activité pour l’aéroport de Paris-Vatry, situé précisément dans l’agglomération de Châlons-en-Champagne !
Vous pourriez également orienter les politiques que vous soutenez vers la Marne, tels le programme d’investissements d’avenir ou le plan de relocalisation visant à rapatrier des activités sur le territoire national.
Monsieur le ministre, les élus, les entreprises et les habitants de la Marne attendent des engagements précis de l’État sur ces questions d’aménagement du territoire, de compensations financières et d’investissements économiques.
Madame la sénatrice, je vous prie, tout d’abord, de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre de la défense, empêché.
En tant que porte-parole du Gouvernement, je veux vous dire que je mesure parfaitement l’intensité du choc que représente, pour un territoire, la fermeture d’un régiment, avec les conséquences que vous avez évoquées.
Le ministre de la défense a signé, le 15 octobre dernier, une décision ministérielle présentant toutes les restructurations pour 2015 et la suppression de 7 500 postes prévus dans la loi de programmation militaire.
Conformément à ses engagements, il a veillé à ce que cette réduction d’effectifs touche le moins possible d’unités opérationnelles. L’essentiel porte sur les structures organiques, l’environnement et l’administration du ministère. Il s’est notamment attaché à ce qu’il y ait le moins possible de dissolutions de garnison.
Les choix graves que le ministre de la défense a dû faire correspondent à un impératif capacitaire réfléchi, qui découle des besoins de l’armée de terre de demain.
En effet, les forces terrestres devront disposer d’unités adaptées à la diversité, à la durée et au durcissement des opérations. Offrant une capacité opérationnelle de 66 000 hommes projetables, l’armée de terre comprendra sept brigades interarmes.
Deux de ces brigades devront être aptes à l’entrée en premier sur un théâtre d’opération et au combat de coercition face à un adversaire équipé de moyens lourds.
Deux autres brigades, plus légères, devront être capables d’intervenir dans des milieux très spécifiques ou difficiles ou, très rapidement, en complément de l’action des forces spéciales.
Enfin, trois brigades multirôles seront prioritairement équipées et entraînées pour la gestion de crise.
Cette réarticulation des forces terrestres, guidée par le principe de différenciation des forces en fonction des missions qu’elles sont appelées à remplir, implique donc la dissolution du seul régiment d’artillerie non doté d’équipements lourds ou spécifiques, ou non implanté sur un camp.
C’est dans ce contexte global qu’il a fallu faire le choix douloureux de la dissolution du 1er régiment d’artillerie de marine et de l’état-major de la 1ère brigade mécanisée, à Châlons-en-Champagne.
Le ministre de la défense et le Gouvernement sont bien conscients de l’impact économique et social négatif que ces mesures auront pour la ville de Châlons-en-Champagne. Le Premier ministre, ainsi que le ministre de la défense, s’en est entretenu très récemment avec le député-maire de Châlons-en-Champagne.
Ils ont évoqué les lourdes et légitimes préoccupations des élus locaux, et le Premier ministre a souhaité que soit élaboré, au plus vite, pour la ville de Châlons-en-Champagne, un plan d’exception, afin de compenser autant que possible cette suppression d’emplois, avec toutes les conséquences qu’elle implique.
Ce plan d’accompagnement exceptionnel sera mis en œuvre par le préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne, mandaté par le Premier ministre.
Le vecteur principal de ce plan d’accompagnement sera un contrat de redynamisation du site « défense ». Le comité de site, qui associera l’ensemble des acteurs locaux concernés, sera réuni avant la fin du mois de novembre.
Dans cet accompagnement du territoire vers la reconversion, le ministère de la défense restera un partenaire responsable et déterminé.

En entendant votre réponse, monsieur le ministre, qui se veut tout aussi rassurante que le courrier que M. Le Drian m’a personnellement adressé et que l’engagement pris par le Premier ministre, je veux croire que le Gouvernement a pris la mesure de nos difficultés.
La compassion est importante, monsieur le ministre, mais nous avons surtout besoin d’être aidés, car une création de richesses est indispensable pour compenser autant qu’il est possible les conséquences de la fermeture décidée. Une dotation la plus élevée possible, c’est évidemment très bien, mais nous avons surtout besoin de moyens pour développer l’ensemble du secteur marnais.
Ma question avait aussi pour but de vous assurer, monsieur le ministre, de la détermination de tous les acteurs dans la défense de ce dossier : habitants, entreprises et forces économiques, acteurs politiques de toutes tendances, nous sommes tous solidaires et tous résolus face à ce qu’il faut bien appeler une catastrophe pour la ville, pour le département et au-delà, car elle aura des répercussions dans l’ensemble de la région.
Monsieur le ministre, je vous demande de transmettre ce message : nous ne nous résignerons pas !

La parole est à M. Jacques Genest, auteur de la question n° 913, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur, mais je sais que M. Le Foll, qui le représente ce matin dans notre hémicycle, est très au fait des problèmes du monde rural et du climat.
Je souhaite, pour commencer, m’associer à la douleur des habitants du Gard et de la Lozère, qui ont eu à déplorer cinq victimes lors des violentes inondations des 14 et 15 novembre ; j’ai une pensée spéciale pour la famille qui a été terriblement endeuillée.
Monsieur le ministre, l’Ardèche a été très durement éprouvée au cours de l’année 2014, particulièrement depuis cet été : les spécialistes du climat s’accordent à considérer que, avec quatre épisodes cévenols en deux mois, cette année est tristement exceptionnelle.
L’Ardèche a d’abord été frappée les 17 et 18 septembre 2014, puis entre les 9 et 13 octobre par une crue qualifiée de « vicennale ». Les services du département, au lendemain des événements du mois d’octobre, estimaient déjà à plus de 10 millions d’euros le montant des dégâts pour l’année 2014.
Or, deux semaines plus tard, les 3 et 4 novembre, l’Ardèche a connu de nouvelles et violentes intempéries. Dans certains endroits, il est tombé en quelques heures l’équivalent d’un mois de précipitations, ce qui a entraîné les crues de la Deûme et de la Cance. Routes départementales hors d’usage, glissements de terrain, bâtiments inondés, équipements dévastés, coupures d’électricité : tel est le lourd bilan pour soixante-dix-neuf de nos communes rurales.
Cette triste série vient de connaître encore un nouvel épisode, puisque notre département a été lui aussi très affecté par le tragique épisode des 14 et 15 novembre, que j’ai rappelé au début de mon intervention.
Par un arrêté publié le mardi 4 novembre, l’État a reconnu l’état de catastrophe naturelle au bénéfice de cent quatorze communes ardéchoises touchées en septembre et en octobre. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette décision, qui va permettre aux particuliers d’être indemnisés dans des délais raisonnables.
Toutefois, un problème demeure, qui suscite l’inquiétude des élus ardéchois : les collectivités territoriales doivent faire face, dans un contexte financier déjà fragilisé, à une série de sinistres qui ont durement affecté leurs infrastructures.
Ma question est donc simple et relaie l’inquiétude des élus ardéchois : monsieur le ministre, quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il prendre pour les aider à affronter cette situation ?
Avant de vous répondre, monsieur le sénateur, je tiens à m’associer, avec l’ensemble des membres de la Haute Assemblée, à la douleur des familles de nos cinq compatriotes disparus lors des récentes intempéries. À la suite du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, je les assure, en ma qualité de porte-parole du Gouvernement, de la sympathie de l’ensemble de mes collègues.
La zone cévenole, comme vous l’avez rappelé, a connu de manière consécutive quatre épisodes climatiques difficiles en quelques semaines seulement. Le drame qui s’est produit il y a quelques jours confirme que ces intempéries deviennent récurrentes : elles frappent non seulement par leur fréquence, mais aussi et surtout par leur intensité. Ce constat nous renvoie à la question globale du réchauffement climatique et de la lutte contre le dérèglement climatique.
Par un arrêté interministériel du 4 novembre, publié le 7 novembre, cent vingt-sept communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, l’intensité anormale de l’agent naturel ayant pu être démontrée sur le fondement des rapports météorologiques et hydrologiques fournis dans des délais extrêmement brefs. Trente autres dossiers ont été ajournés dans l’immédiat, dans l’attente de données météorologiques et hydrologiques complémentaires ; bien entendu, ils feront l’objet d’un réexamen lors de la prochaine séance de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle.
Les habitants des communes reconnues en état de catastrophe naturelle pourront bénéficier de l’extension de garantie ouverte par les décisions de reconnaissance ; elle permettra d’assurer une indemnisation rapide des personnes et des acteurs territoriaux, notamment les entreprises, qui ont été touchés.
S’agissant des intempéries de début novembre, la préfecture de l’Ardèche avait reçu hier environ quatre-vingts demandes adressées par les communes. Les démarches sont en cours pour obtenir dans les délais les plus courts les rapports techniques, notamment ceux de Météo France et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, afin de permettre, là aussi, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes qui relèvent de ce dispositif.
Au-delà de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le ministre de l’agriculture que je suis tient à vous préciser, monsieur le sénateur, que les dossiers de reconnaissance de l’état de calamité agricole pour les agriculteurs de votre département touchés par les intempéries seront étudiés rapidement et avec toute l’attention nécessaire. Soyez donc assuré que, en ce qui concerne les dégâts subis par les agriculteurs, qui sont un problème important, nous engageons l’ensemble des procédures nécessaires.
Le ministre de l’intérieur et moi-même saluons la mobilisation de l’ensemble des services de l’État, des collectivités territoriales et des élus : leur engagement a permis d’éviter que ces intempéries n’aient des conséquences encore plus graves.
S’agissant des dégâts subis par les communes, sur lesquels vous avez insisté, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et moi-même avons saisi nos inspections respectives pour qu’elles constituent une mission chargée d’évaluer les dégâts subis par les collectivités locales : en fonction des dégâts subis par chacune des communes, des investissements seront nécessaires.
Cette mission, qui a été formée, se rendra très prochainement en Ardèche et dans les autres départements frappés par les intempéries de septembre et d’octobre pour évaluer les dommages subis par les collectivités et envisager les modalités du soutien de l’État. Son rapport est attendu pour la fin de cette année ou le début de l’année 2015 ; nous avons voulu des délais courts pour pouvoir ensuite activer dans les meilleurs délais les dispositifs d’aide aux collectivités territoriales.
Sur le fondement de ce rapport, il conviendra de déterminer les dispositifs les mieux adaptés, en prenant en compte leurs délais de mobilisation.
Enfin, le préfet de l’Ardèche et l’ensemble des services de l’État sont évidemment à la disposition des collectivités pour examiner leur situation et trouver rapidement les solutions les plus adaptées.
Comme vous le constatez, monsieur le sénateur, avec les ministres de l’intérieur, de l’agriculture et des finances, c’est l’ensemble du Gouvernement qui est pleinement attentif et mobilisé pour apporter des réponses, notamment aux collectivités, après des intempéries dont vous avez rappelé à juste titre l’exceptionnelle intensité.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, au nom des Ardéchoises et des Ardéchois.
Le gros problème pour les communes tient au délai entre la constatation des dégâts et l’indemnisation par l’État. Dans cette période dont vous ne pouvez ignorer qu’elle est délicate pour les collectivités locales, confrontées à une réduction de leurs ressources et à un manque de trésorerie, certaines communes, qui ont été frappées deux ou trois fois dans la même année, vont se trouver dans de très graves difficultés.
C’est pourquoi je demande au Gouvernement d’accélérer les procédures et même, s’il était possible, de consentir une avance à ces communes, pour qu’elles puissent faire face aux conséquences des récents événements.

La parole est à M. Jean-François Longeot, auteur de la question n° 902, adressée à M. le ministre des finances et des comptes publics.

Ma question, adressée à M. le ministre des finances et des comptes publics, visait à attirer son attention sur la baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales, qui sera lourde de conséquences pour l’investissement local, l’emploi et le maintien des services de proximité dans nos territoires.
Le cumul des baisses annoncées s’élève à 28 milliards d’euros pour la période 2014-2017, sans compter que cette diminution est à mon avis sous-estimée, compte tenu des effets contre-productifs qu’elle aura sur le redressement des comptes publics. Ce prélèvement est insoutenable et insupportable pour nos communes.
Depuis trente ans, les collectivités ont joué leur rôle en investissant dans les infrastructures et dans les équipements et en apportant davantage de services aux habitants. Désormais confrontées à une diminution nette de leurs ressources, les communes n’auront pas d’autre choix que de diminuer leurs investissements pour ne pas augmenter la fiscalité locale en cette période de crise.
La Cour des comptes a établi que le bloc communal avait réalisé plus de 37, 4 milliards d’euros d’investissements en 2013, soit près de 64 % des investissements locaux, et qu’il était par conséquent le seul échelon à avoir réussi à maintenir la croissance des investissements tout en contribuant à limiter les effets de la crise économique.
Il est évident que la situation va changer et que les investissements publics locaux vont fortement diminuer en 2015, ce qui entraînera la perte de dizaines de milliers d’emplois, par exemple dans le BTP.
Particulièrement conscientes de l’effort qu’elles doivent accepter pour participer à la maîtrise des dépenses publiques, les collectivités locales demandent une diminution des baisses de dotations, ainsi qu’une modification du rythme de leur contribution. Dans ce contexte, je demande au Gouvernement de bien vouloir accorder une plus grande confiance aux élus locaux et à leur sens des responsabilités, notamment quand il s’agit de problèmes d’ordre national et d’intérêt général.
Monsieur le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale, est-il dans les intentions du Gouvernement de réexaminer le plan de réduction des dotations de l’État et d’arrêter immédiatement les transferts de charges et de mesures normatives sur les collectivités locales ?
Monsieur le sénateur, nous faisons confiance aux élus et nous faisons le plus grand cas de leur sens des responsabilités. Nous avons conscience de leur demander un effort financier considérable, mais nous savons qu’ils sauront surmonter cet obstacle, qui s’inscrit dans l’indispensable redressement de nos finances publiques.
Le pacte de responsabilité et de solidarité, qui prévoit 50 milliards d’euros d’économies sur trois ans, exige en effet un effort de toutes les composantes de la puissance publique : État, organismes de sécurité sociale et collectivités territoriales. L’effort de 11 milliards d’euros demandé aux collectivités est proportionnel au poids de la dépense publique locale dans le total de la dépense publique, qui est un peu supérieur à 20 %.
La baisse prévue pour 2015 est de 3, 67 milliards d’euros sur 229, 7 milliards d’euros de recettes totales des collectivités territoriales, ce qui représente 1, 6 % : certes, cet effort n’est pas neutre, il est même important, mais ce n’est pas non plus l’étranglement que certains décrivent.
Il faut par ailleurs tenir compte des autres ressources des collectivités qui, elles, vont continuer de croître ; je pense notamment aux recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devraient progresser de 700 millions d’euros en 2015, et aux droits de mutation à titre onéreux, la possibilité ouverte aux départements de relever le taux plafond étant pérennisée eu égard à l’augmentation considérable des dépenses sociales de ces collectivités territoriales.
Comme vous, monsieur le sénateur, le Gouvernement est bien conscient que plus de 70 % de l’investissement public dans notre pays est réalisé localement, le bloc communal assurant à lui seul autour de 65 % de cette proportion.
C’est pourquoi plusieurs mesures ont été prévues, dont deux concernent le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA : la suppression de la réfaction de 0, 9 point, qui porte le taux de remboursement des investissements à 16, 4 %, et la sortie de l’enveloppe normée de l’aide aux collectivités locales de l’augmentation spontanée du FCTVA en 2015.
En 2015, ces deux mesures représenteront 192 millions d’euros de recettes, financées sur le budget de l’État au profit des collectivités territoriales. À compter de 2016, le relèvement du taux de FCTVA apportera un soutien supplémentaire aux collectivités qui investissent de plus de 250 millions d’euros.
Par ailleurs, et toujours en faveur de l’investissement, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux, de la dotation de développement urbain et de la dotation globale d’équipement des départements sont maintenus. L’Assemblée nationale a même souhaité aller plus loin puisque, vous le savez, les députés ont augmenté ces trois dotations – DETR, DDU et DGE des départements - de 30 % en redéployant les crédits des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, les FDPTP. Je ne sais pas ce que les sénateurs décideront à propos de cette mesure, mais elle a été adoptée par les députés.
Je vous rappelle également que le Gouvernement favorise l’accès au crédit des collectivités territoriales : une nouvelle banque publique des collectivités locales, créée autour de La Banque postale ; une enveloppe de prêts bonifiés à long terme financée sur les fonds d’épargne et ouverte pour 20 milliards d’euros par la Caisse des dépôts et consignations pour la période 2013-2017 ; la mise en place d’une agence de financement des collectivités territoriales, l’Agence France Locale.
Enfin, monsieur le sénateur, je suis chargé par le Premier ministre de mener une action résolue contre l’inflation normative – vous avez évoqué ce sujet à la fin de votre question –, véritable carcan juridique et financier qui entrave et renchérit l’action des collectivités territoriales.
Nous avons en effet décidé de mener une action déterminée, avec le Conseil national d’évaluation des normes, le CNEN, et Alain Lambert notamment. D’ici à la fin de l’année, je serai en mesure de proposer au Gouvernement plusieurs suppressions ou allégements de normes.
Pour 2015, l’objectif est clair : arriver à un coût « zéro euro » des nouvelles normes. À chaque fois qu’une nouvelle norme, avec un impact financier sur les collectivités territoriales, sera créée, le ministre concerné devra proposer la suppression d’une norme d’un coût équivalent.

Vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, les élus locaux sont des gens très responsables. Leur difficulté, aujourd’hui, est d’assumer à la fois la baisse des dotations et l’apparition de charges supplémentaires. Cet effet de ciseaux devient totalement insupportable, notamment pour les communes.
J’ai pris note de votre propos sur la revalorisation des DMTO. Mais il s’agit là d’une augmentation supplémentaire de la fiscalité, dont les collectivités territoriales porteront la responsabilité. Je ne suis pas sûr que cela soit de bon augure, surtout en cette période !

La parole est à M. François Bonhomme, auteur de la question n° 906, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur la situation délicate dans laquelle se trouvent un certain nombre de départements, singulièrement le Tarn-et-Garonne, face à l’afflux important de dossiers de demandeurs d’asile.
Je le rappelle, la répartition des demandeurs d’asile entre les départements est effectuée par le préfet de région. À Montauban, une association particulièrement active, l’Association montalbanaise d’aide aux réfugiés, répond à un grand nombre d’appels d’offres, ce qui a pour effet de diriger vers Montauban la majorité des dossiers de la région.
Ainsi, en 2014, alors que Toulouse et la Haute-Garonne recevaient 300 demandeurs d’asile, pour une population de 1, 3 million d’habitants, la ville de Montauban et le Tarn-et-Garonne en recevaient 156, pour une population, bien moins importante, de 240 000 habitants.
Cette situation pose de véritables problèmes d’hébergement mais aussi et surtout de scolarisation des enfants. Les écoles se trouvent déjà en flux tendu, compte tenu de l’essor démographique de la ville, mais aussi de l’accueil d’enfants étrangers non francophones bénéficiaires d’un titre de séjour ou en provenance de l’espace Schengen. À titre d’exemple, 10 % des enfants scolarisés dans ses écoles ne maîtrisent pas la langue française.
En conséquence, la ville de Montauban, qui accueille pour cette année scolaire 175 enfants relevant du droit d’asile, n’a pu prendre en compte l’ensemble des demandes ; 29 dossiers sont toujours en attente de traitement.
Il apparaît donc nécessaire de corriger les dysfonctionnements liés à la complexité de notre dispositif, qui ne répond plus ni à ses obligations d’intégration ni au principe de solidarité entre collectivités territoriales.
Le rapport remis le 28 novembre 2013, dans le cadre du projet de loi relatif à la réforme de l’asile, en cours de préparation, préconise l’élaboration d’un schéma de répartition territoriale afin de rééquilibrer les flux entre demandeurs d’asile et de faire jouer la solidarité entre les régions.
Ce schéma serait élaboré en concertation avec les intervenants locaux et permettrait d’orienter les demandeurs d’asile en fonction du poids accordé à chaque région dans sa mission d’accueil, tout en prenant en compte la situation particulière des personnes.
Sur le fondement de ce rapport, alors que les services du ministère de l’intérieur ont déjà été alertés à plusieurs reprises, il me semble que le schéma de répartition pourrait être mis en place, à titre expérimental, dans la région Midi-Pyrénées, et que l’Association montalbanaise d’aide aux réfugiés, qui perçoit une aide substantielle de l’État, pourrait être dotée d’une vocation régionale afin de mettre ses compétences au service de l’ensemble des départements de la région Midi-Pyrénées. Cette expérimentation pourrait d’ailleurs servir de base aux discussions qui s’engageront lors de la préparation du projet de loi.
Dès lors, monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de bien vouloir m’indiquer si le Gouvernement entend satisfaire cette demande et s’il compte mener une large concertation avec tous les acteurs concernés. Le cas échéant, pouvez-vous me donner des précisions sur un éventuel calendrier prévisionnel ?
Monsieur le sénateur, le ministre de l’intérieur, qui vous prie de bien vouloir l’excuser pour son absence ce matin, partage vos préoccupations quant aux modalités de répartition des demandeurs d’asile sur le territoire.
S’agissant de la situation spécifique de la région Midi-Pyrénées, et plus particulièrement du département du Tarn-et-Garonne, il est observé une diminution des flux de première demande d’asile de plus de 15 % dans la région entre septembre 2013 et septembre 2014 et de 8, 9 % dans votre département.
Par ailleurs, des chiffres de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, il apparaît que le Tarn-et-Garonne a enregistré 113 premières demandes d’asile depuis le début de l’année, alors que la Haute-Garonne en a enregistré 529, ce qui correspond à un ratio proche de celui du nombre d’habitants par département.
En outre, la création, au plan national, de 4 000 places supplémentaires en centres d’accueil pour demandeurs d’asile, ou CADA, entre le 1er juillet 2013 et le deuxième semestre 2014 est en cours ; elle portera la capacité totale du parc national à 25 410 places.
Dans le Tarn-et-Garonne, douze nouvelles places ont été ouvertes en juillet 2013 et quinze en avril 2014. Le département dispose actuellement de 158 places de CADA, tandis que la région Midi-Pyrénées en compte 1 000 au total.
Les projets déposés par les opérateurs dans le cadre de la dernière vague d’ouverture de 1 000 places, prévue pour la fin de cette année, sont actuellement examinés. Huit projets ont été déposés dans la région Midi-Pyrénées, dont trois dans le Tarn-et-Garonne. Ces projets, je le signale, sont examinés dans le cadre de l’instruction menée actuellement par les services de l’État.
Le schéma de répartition territoriale prévu dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile pour le rééquilibrage des flux de demandes d’asile, après avoir été arrêté à l’échelle nationale, devra, si le Parlement en valide le principe, être décliné à l’échelon régional par le préfet de région. Ce dernier devra travailler, comme vous le souhaitez, monsieur le sénateur, en concertation avec les acteurs locaux, au premier rang desquels les parlementaires et les élus des collectivités territoriales.
Les schémas régionaux devront intégrer les responsabilités de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, qui serait chargé, selon les dispositions actuelles du projet de loi sur l’asile, de l’ensemble des orientations au sein du dispositif d’accueil dédié.
En tout état de cause, et en fonction de l’issue des débats parlementaires et du processus d’adoption du projet de loi, l’expérimentation proposée retient tout l’intérêt du Gouvernement et devra faire l’objet d’un échange avec le préfet dans le cadre de la mise en œuvre des schémas régionaux.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. J’ai bien noté que les capacités d’accueil devaient être un peu augmentées. Je pense néanmoins que, dans ce domaine plus que dans d’autres, où il est particulièrement difficile pour certaines collectivités territoriales d’absorber les flux, notamment quand il s’agit de scolarisation des enfants, il est important d’organiser plutôt que de subir. Or, en l’espèce, certaines collectivités, et la ville de Montauban au premier chef, ont dû faire face à des situations extrêmement difficiles, compte tenu, surtout, de l’obligation de scolarisation.

La parole est à M. Cyril Pellevat, auteur de la question n° 905, adressée à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ma question porte sur la pérennisation du fonds d’amorçage des rythmes scolaires pour la période 2015-2016.
La réforme des rythmes scolaires suscite beaucoup d’inquiétudes quant à son financement par les communes. En 2013 et en 2014, un fonds d’amorçage a été mis en place afin d’aider les communes dans la mise en place de ces nouveaux rythmes - 50 euros par élève et par an et une majoration pour les communes en difficulté.
Alors même que le coût de cette réforme est estimé entre 180 et 200 euros par élève selon l’Association des maires de France – à titre d’exemple, dans ma commune de 1 300 habitants, en Haute-Savoie, le coût par élève se monte à 240 euros par an –, la pérennité de ce fonds d’amorçage est aujourd’hui cruciale pour de nombreuses communes aux finances incertaines, surtout dans un contexte de baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales.
Dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2015, l’article 55, rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Enseignement scolaire », avait totalement supprimé l’aide de 50 euros apportée par le fonds d’amorçage aux 16 000 communes de base, ne reconduisant qu’une aide de 40 euros – au lieu de 90 euros – et encore uniquement pour les 7 500 communes en difficulté.
Le 28 octobre dernier, face aux contestations, le Premier ministre s’est engagé devant le Sénat à rétablir la dotation du fonds à son niveau initial. Le 30 octobre, l’Assemblée nationale a effectivement restauré l’aide de 50 euros, mais à la condition que la commune bénéficiaire ait signé un projet éducatif territorial, ou PEDT, afin de garantir des activités périscolaires de qualité.
Si cette condition constitue une avancée pour un plus grand nombre de communes, elle crée néanmoins de grandes inégalités sur notre territoire. En effet, cette restriction laisse de côté de nombreuses communes, essentiellement rurales, qui ne peuvent s’organiser pour élaborer un tel projet.
De plus, si le Gouvernement a rétabli le fonds d’amorçage à son niveau précédent, il ne faut pas oublier que le fonds reste insuffisant, puisqu’il ne représente que 50 à 90 euros par élève.
Enfin, ce fonds n’est toujours pas pérenne, ce qui conduira finalement les communes à solliciter soit les contribuables, à travers une hausse des impôts locaux, soit les parents, à travers une participation supplémentaire aux frais afférents.
Aussi, monsieur le secrétaire d’État, au nom de l’équité entre tous les élèves de France, quelle que soit leur domiciliation, et pour ne pas créer de charges supplémentaires aux communes, charges qui seraient supportées par les contribuables, je vous demande que le Gouvernement donne au fonds d’amorçage un caractère durable et général et alloue des crédits plus importants pour supporter le coût de cette réforme.
Monsieur le sénateur, Mme Vallaud-Belkacem, qui vous prie de bien vouloir excuser son absence, est bien consciente – et tout le Gouvernement avec elle – de l’effort financier consenti notamment par les communes pour mener à bien le nouvel aménagement des rythmes scolaires, qui doit contribuer à favoriser l’épanouissement des enfants et à lutter contre les inégalités sociales.
Cet effort, monsieur le sénateur, est partagé. Depuis 2013, l’État a accompagné financièrement toutes les communes qui mettent en place la réforme des rythmes scolaires afin de développer l’offre d’activités périscolaires : pour 2013, 90 millions d’euros ont été mobilisés pour soutenir les 4 000 communes volontaires, qui avaient anticipé la réforme ; pour 2014-2015, ce sont près de 400 millions d’euros qui sont prévus pour soutenir les communes et intercommunalités qui mettent en œuvre la réforme.
Pour l’année 2015-2016, les inquiétudes sur la baisse du niveau de l’aide du fonds d’amorçage sont nombreuses, c’est vrai.
Devant la Haute Assemblée, le 28 octobre dernier, le Premier ministre a dit son engagement de maintenir le niveau et le périmètre de l’aide du fonds d’amorçage ; il a aussi évoqué notre souhait de conditionner cette aide à l’engagement des communes dans l’établissement d’un projet éducatif territorial.
C’est pourquoi la ministre de l’éducation nationale a émis un avis favorable sur l’amendement déposé par la majorité à l’article 55 du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Cet amendement ayant été adopté, c’est donc une version modifiée de l’article 55 qui sera soumise prochainement à l’examen du Sénat.
Mettre une condition à ce financement, monsieur le sénateur, c’est un acte de bonne gestion et c’est surtout la garantie que l’aide de l’État est utile à la qualité des activités périscolaires.
Ce n’est pas, d’ailleurs, une condition insurmontable : le PEDT est un outil simple ; beaucoup de communes, d’ailleurs, et même parmi les plus petites, en ont déjà conclu. Celles qui ne l’auraient pas encore fait pourront compter sur le soutien des services de l’État – les académies – au plan local pour les y aider.
J’ajoute que Mme Vallaud-Belkacem a installé un groupe de travail avec toutes les associations d’élus locaux concernées afin d’élaborer les outils utiles aux maires – plus particulièrement aux maires des petites communes, qui devront s’engager dans cette démarche – pour la confection d’un PEDT.
Pour conclure, monsieur le sénateur, d’autres partenaires de l’État sont également engagés dans le financement des nouveaux rythmes scolaires, tels que la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, dont l’accompagnement prend notamment la forme d’un versement, par les caisses d’allocations familiales, d’une prestation au titre des nouvelles heures en accueil de loisirs sans hébergement déclarées induites par le nouvel aménagement du temps scolaire.
Sur la période 2013-2018, c’est une enveloppe spécifique de 850 millions d’euros qui est prévue par la Caisse nationale des allocations familiales.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement agit en étant à la fois bien conscient des contraintes qui pèsent sur les collectivités locales, mais également soucieux de la bonne gestion des deniers publics et du besoin des enfants, objectif qui, plus que jamais, guide son action.

Monsieur le secrétaire d’État, je suis déçue par votre réponse.
L’aménagement des rythmes scolaires est difficile à mettre en place dans les zones rurales. Nous vérifierons si les dispositifs mobilisés en faveur de nos collectivités sont suffisants. On nous incite à solliciter les associations, mais il n’est tout de même pas évident d’impliquer des bénévoles dans une petite commune de 1 300 habitants comme la mienne…
En outre, l’aide apportée par la caisse d'allocations familiales ne peut pas excéder 54 euros, ce qui est insuffisant. De surcroît, elle est accordée seulement aux communes ayant prévu des activités périscolaires, et pas à celles, comme la mienne, qui n’ont pu mettre en place que des solutions élaborées de garde d’enfants.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, auteur de la question n° 898, adressée à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Madame la ministre, depuis que l’État a transféré aux communes l’instruction des dossiers relevant du droit des sols, nos collectivités tentent de s’organiser pour procéder ou faire procéder à cette instruction.
Or l’instruction de tels dossiers est régie par les articles R. 410-5 et R. 423-15 du code de l’urbanisme : seuls les services de la commune, les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités, les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités, une agence départementale créée en application de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les services de l’État lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale remplissent les conditions fixées – mais c’est aujourd'hui quasi caduc – peuvent instruire les dossiers relevant du droit des sols.
La liste est ainsi exhaustive, donc restrictive, si bien que les prestataires privés sont exclus de ce cadre réglementaire. Or l’instruction des dossiers de droit des sols n’est pas une activité linéaire dans l’année.
Compte tenu du coût à l’échelle d’une année, dans la période budgétaire difficile actuelle, le recrutement d’agents publics peut, dans certaines situations, se révéler moins judicieux qu’un recours au secteur privé. Les communes concernées doivent être opérationnelles dès le 1er janvier 2015, afin d’assurer un service public de qualité aux administrés.
Le Gouvernement est le seul à pouvoir agir dans le domaine réglementaire, donc pour autoriser le recours aux prestataires privés.
Aussi, madame la ministre, je souhaiterais connaître vos intentions quant à une éventuelle modification du code de l’urbanisme pour permettre aux communes et intercommunalités, qui sont contraintes par cette nouvelle charge, de s’administrer avec le plus de liberté possible.
Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur l’instruction des dossiers relevant du droit des sols, notamment sur la possibilité d’avoir recours à des prestataires privés pour mener à bien une telle activité.
Je souhaite tout d’abord rappeler que l’instruction des actes d’urbanisme est une compétence des collectivités territoriales. Si certains services de l’État étaient jusqu’à présent mis à disposition de certaines collectivités pour les aider à instruire les actes, le maire, ou le représentant de l’intercommunalité, demeurait le signataire de l’acte.
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », en favorisant le regroupement intercommunal, incite à la mutualisation de l’ingénierie d’instruction, afin de mieux répondre aux impératifs de bonne gestion financière, de capitalisation de la doctrine et de montée en compétence des services.
Comme vous le rappelez, le code de l’urbanisme précise la liste des services habilités à instruire les actes d’urbanisme.
Par une instruction ministérielle du 3 septembre 2014 relative aux missions de la filière d’application du droit des sols dans les services de l’État et aux mesures d’accompagnement des collectivités locales, il est clairement précisé que, en l’état actuel des textes, une commune ne peut pas confier l’instruction des actes d’urbanisme à des prestataires privés.
Toutefois, cela n’interdit pas à une collectivité d’avoir recours à un prestataire de droit privé pour assurer des missions bien délimitées, dès lors que celles-ci ne sont pas constitutives de l’instruction et que le prestataire n’est pas intéressé aux projets qu’il sera amené à examiner dans ce cadre.
En revanche, il peut s’agir d’une aide à la décision apportée à l’autorité compétente.
Cette aide peut, par exemple, éclairer la réflexion de l’autorité compétente sur la compatibilité du projet avec des prescriptions particulières d’une zone ou encore sur sa conformité avec le règlement du document d’urbanisme. J’attire néanmoins votre attention sur le fait que l’aide ne peut pas comprendre la rédaction des actes d’instruction.
Je tiens enfin à préciser que l’autorité compétente en l’espèce, que cela soit le maire ou le président de l’EPCI lorsqu’il s’agit d’une compétence déléguée, conserve son pouvoir de police de délivrance des autorisations d’urbanisme.
Au regard du contexte budgétaire actuel, que vous avez évoqué, la mutualisation de l’ingénierie au niveau intercommunal est la solution qui me paraît la plus adaptée pour assurer une prise en compte des préoccupations locales – le maire reste signataire des actes –, et de l’impératif de capitaliser expérience et savoir-faire avec un service d’instruction dédié au niveau intercommunal. C’est d’ailleurs ce que je préconise dans l’instruction du 3 septembre.
Au regard du poids financier que cela représente et de la charge fluctuante d’actes dans l’année, à laquelle vous avez fait référence, la dissémination des moyens à l’échelle de chaque commune ne me paraît pas pérenne.
En outre, la sous-traitance de l’instruction d’actes, parce qu’elle a de lourdes conséquences pour le pétitionnaire, mais également dans l’intérêt général des collectivités locales, me semble devoir rester dans la sphère publique.

Madame la ministre, j’entends bien les précisions que vous apportez quant à l’instruction du 3 septembre dernier.
Néanmoins, je suis déçue, puisque vous m’indiquez très clairement que les collectivités ne peuvent pas avoir recours à un prestataire privé pour aider à l’instruction des dossiers d’urbanisme relevant du droit des sols. C’est extrêmement regrettable. Une telle facilité aurait pu leur être accordée.
Au demeurant, les communes font régulièrement appel à des prestataires privés, bureaux d’étude ou maîtres d’œuvre, pour la plupart des actes touchant à l’urbanisme.
Par ailleurs, madame la ministre, il serait bon de fournir les mêmes éléments d’information à vos directions départementales, qui n’en disposent visiblement pas toujours : il leur est arrivé de mal informer certaines collectivités sur ce point précis du droit…

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions orales.
L’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à quatorze heures trente.