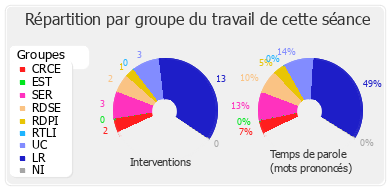Séance en hémicycle du 24 janvier 2013 à 10h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Mes chers collègues, la conférence des présidents qui s’est réunie ce matin a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE
Jeudi 24 janvier 2013
À 15 heures :
1°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
À 16 heures 15 :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
2°) Débat sur l’avenir du service public ferroviaire (demande du groupe CRC) ;
La conférence des présidents a :

SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE
Lundi 28 janvier 2013
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 15 heures et le soir :
- Proposition de loi portant création d’une Haute autorité chargée du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales, présentée par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur (texte de la commission, n° 283, 2012-2013)
La conférence des présidents a fixé :

Mardi 29 janvier 2013
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales ;
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 29 de M. Gilbert Roger à M. le ministre de l’intérieur ;
- n° 90 de M. Philippe Bas à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche ;
- n° 91 de M. Alain Néri à Mme la ministre chargée de la famille ;
- n° 96 de M. Philippe Dominati à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche ;
- n° 152 de M. Michel Boutant à M. le ministre de l’économie et des finances ;
- n° 172 de M. Philippe Madrelle à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- n° 200 de M. Jean-Claude Lenoir à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
- n° 213 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
État d’avancement de la création du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon

- n° 222 de M. Louis Duvernois à Mme la ministre de la culture et de la communication ;
- n° 245 de Mme Catherine Tasca à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
- n° 249 de Mme Laurence Rossignol à M. le ministre de l’économie et des finances ;
- n° 254 de M. Michel Le Scouarnec à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- n° 259 de Mme Mireille Schurch à M. le ministre du redressement productif ;
- n° 261 de M. Dominique Bailly à M. le ministre du redressement productif ;
- n° 264 de M. Marcel Rainaud réattribuée à M. le ministre chargé du budget ;
- n° 271 de M. André Vallini à M. le ministre de l’intérieur ;
- n° 278 de M. Bernard Fournier à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- n° 282 de Mme Leila Aïchi à M. le ministre des affaires étrangères ;
- n° 287 de M. Jacques Mézard réattribuée à Mme la ministre chargée de la décentralisation ;
- n° 289 de M. Jean-Léonce Dupont à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement ;
À 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
2°) Proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, présentée par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur (texte de la commission n° 281, 2012-2013).
La conférence des présidents a fixé :

Mercredi 30 janvier 2013
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe RDSE :
1°) Proposition de loi visant à créer des zones d’exclusion pour les loups, présentée par M. Alain Bertrand et les membres du groupe RDSE (texte de la commission n° 276 rectifié, 2012-2013) ;
La conférence des présidents a fixé :

2°) Débat sur les conclusions de la mission commune d’information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l’État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale ;
La conférence des présidents a :

À 18 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
3°) Suite éventuelle de la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Jeudi 31 janvier 2013
De 9 heures à 13 heures :
Ordre du jour réservé au groupe UMP :
1°) Suite de la proposition de loi visant à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels, présentée par Mme Isabelle Debré et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 182, 2012-2013) ;
2°) Proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable, présentée par M. Philippe Marini (n° 682 rectifié, 2011-2012) ;
La commission des finances se réunira pour le rapport le mercredi 23 janvier après midi [délai limite pour le dépôt des amendements en commission lundi 21 janvier, à douze heures].

À 15 heures :
3°) Questions cribles thématiques sur le commerce extérieur ;
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.

De 16 heures à 20 heures :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
4°) Proposition de loi portant réforme de la biologie médicale (Procédure accélérée), présentée par M. Jacky Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés (texte de la commission n° 278, 2012-2013).
La conférence des présidents a fixé :

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 5 février 2013
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales ;
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 94 de M. Hilarion Vendegou à M. le ministre de l’intérieur ;
- n° 123 de M. Antoine Lefèvre à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
- n° 130 de Mme Catherine Morin-Desailly à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche ;
- n° 157 de M. André Trillard à Mme la ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion ;
- n° 217 de Mme Maryvonne Blondin à M. le ministre de l’éducation nationale ;
- n° 227 de M. Vincent Delahaye à M. le ministre de l’intérieur ;
- n° 230 de M. Gérard Bailly à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
- n° 250 de M. Dominique Watrin à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- n° 260 de M. Christian Bourquin à M. le ministre du redressement productif ;
- n° 275 de M. Robert del Picchia à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- n° 277 de M. Joël Guerriau à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
- n° 279 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
- n° 281 de M. Yves Daudigny à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
- n° 283 de Mme Josette Durrieu à Mme la ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique ;
- n° 284 de M. Alain Richard à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement ;
- n° 285 de Mme Muguette Dini à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- n° 288 de Mme Marie-Christine Blandin à M. le ministre du redressement productif ;
- n° 290 de M. Jean-Pierre Sueur à M. le ministre de l’intérieur ;
- n° 292 de Mme Cécile Cukierman à M. le ministre de l’économie et des finances ;
- n° 295 de M. Jean Louis Masson réattribuée à M. le ministre de l’intérieur.
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 :
2°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) relatif à l’établissement d’un bureau de l’IPGRI en France et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 582, 2011-2012) ;
3°) Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (n° 375, 2011-2012) ;
4°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées (n° 451 rectifié, 2011-2012) ;
5°) Projet de loi autorisant l’approbation du protocole commun relatif à l’application de la convention de Vienne et de la convention de Paris (n° 485, 2011-2012) ;
6°) Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (n° 527, 2011-2012) ;
7°) Projet de loi autorisant l’approbation de la convention relative à la construction et à l’exploitation d’une infrastructure pour la recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (n° 606, 2011-2012) ;
8°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg concernant la mise en place et l’exploitation d’un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune (n° 665, 2011-2012) ;
9°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (n° 664, 2011-2012) ;
Pour ces huit projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le lundi 4 février, à dix-sept heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.

10°) Suite éventuelle de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale ;
11°) Projet de loi portant création du contrat de génération (n° 289, 2012-2013) ;
La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport mercredi 30 janvier matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 28 janvier, à douze heures].

De 18 heures 30 à 19 heures 30 :
12°) Débat, sous forme de questions-réponses, préalable à la réunion du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 ;
À 21 heures 30 :
13°) Suite du projet de loi portant création du contrat de génération.
Mercredi 6 février 2013
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Suite du projet de loi portant création du contrat de génération ;
2°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à sanctionner la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l’Union européenne (n° 118, 2010-2011).
La commission du développement durable se réunira pour le rapport mercredi 30 janvier matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 28 janvier, à douze heures].

Jeudi 7 février 2013
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Éventuellement, suite de l’ordre du jour de la veille ;
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ratifiant l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières (n° 503, 2011-2012) ;
La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport mercredi 30 janvier matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : vendredi 25 janvier, à douze heures].
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.

À 16 heures 15 et, éventuellement, le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
4°) Éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin ;
5°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (n° 122, 2011-2012) ;
La commission des lois se réunira pour le rapport mercredi 30 janvier matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 28 janvier, à douze heures].

6°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 136, 2012-2013) ;
7°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions (n° 135, 2012-2013).
Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le mercredi 6 février, à dix-sept heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.

Lundi 11 février 2013
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 16 heures et le soir :
- Projet de loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports (Procédure accélérée) (n° 260, 2012-2013).
La commission du développement durable se réunira pour le rapport mardi 5 février après-midi [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : vendredi 1er février, à douze heures].

Mardi 12 février 2013
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes par M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
2°) Suite de l’ordre du jour de la veille.
Mercredi 13 février 2013
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Éventuellement, suite de l’ordre du jour de la veille ;
2°) Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes (n° 270, 2012-2013).
La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport mercredi 6 février matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : vendredi 1er février, à douze heures].

Jeudi 14 février 2013
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite de la nouvelle lecture de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ;
2°) Proposition de loi relative à la prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers, présentée par M. Gérard Miquel (Procédure accélérée) (n° 272, 2012-2013) ;
La commission du développement durable se réunira pour le rapport mercredi 6 février au matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 4 février, à douze heures].

À 15 heures :
2°) Questions cribles thématiques sur la gynécologie médicale ;
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.

À 16 heures et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite de l’ordre du jour du matin.
Éventuellement, vendredi 15 février 2013
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite de l’ordre du jour de la veille.
SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE
Mardi 19 février 2013
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales ;
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 145 de M. Francis Grignon à Mme la ministre chargée de la décentralisation ;
- n° 149 de M. Michel Teston à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
- n° 178 de M. Daniel Laurent à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
- n° 209 de M. Jean Boyer à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement ;
- n° 215 de M. Henri Tandonnet à M. le ministre de l’intérieur ;
- n° 251 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le ministre de la défense ;
- n° 252 de Mme Michelle Demessine à M. le ministre chargé des affaires européennes ;
- n° 258 de Mme Valérie Létard à Mme la ministre chargée de la famille ;
- n° 268 de M. Jacques Legendre à M. le ministre de la défense ;
- n° 269 de M. Raymond Couderc à M. le ministre de l’économie et des finances ;
- n° 291 de M. Jean-Patrick Courtois à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche ;
- n° 296 de M. Roland Courteau à M. le ministre chargé du budget ;
- n° 297 de Mme Aline Archimbaud à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
- n° 298 de M. Jean-Pierre Leleux à M. le ministre de la défense ;
- n° 300 de Mme Nathalie Goulet à M. le ministre de l’intérieur ;
- n° 303 de Mme Françoise Laborde à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- n° 311 de M. Didier Guillaume à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- n° 314 de Mme Claire-Lise Campion à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche ;
- n° 316 de M. Michel Doublet à M. le ministre chargé du budget ;
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 14 heures 30 :
2°) Débat sur les nouveaux défis du monde rural (demande du groupe UMP) ;
À 17 heures :
3°) Débat sur la politique étrangère (demandes du groupe UDI-UC et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) ;
La conférence des présidents a :

Mercredi 20 février 2013
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 14 heures 30 :
1°) Débat sur l’avenir de l’industrie en France et en Europe (demande du groupe UDI-UC) ;
La conférence des présidents a :

À 17 heures :
2°) Débat sur la situation à Mayotte (demande de la commission des lois).
La conférence des présidents a :

Jeudi 21 février 2013
À 10 heures :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
1°) Débat d’étape sur les travaux du Conseil national du débat sur la transition énergétique (demande du groupe RDSE) ;
La conférence des Présidents a :
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.

À 16 heures 15 :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
3°) Débat sur le développement dans les relations Nord-Sud (demande du groupe écologiste).
La conférence des présidents a :

SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE
Mardi 26 février 2013
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
- Proposition de loi tendant à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues (n° 753, 2011-2012).
La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 13 février matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 11 février, à douze heures].

Mercredi 27 février 2013
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe CRC :
1°) Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et revendicatives, présentée par Mmes Annie David et Éliane Assassi et plusieurs de leurs collègues (n° 169 rectifié, 2012-2013) ;
La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 13 février matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 11 février, à douze heures].

2°) Proposition de loi permettant l’instauration effective d’un pass navigo unique au tarif des zones 1-2, présentée par Mme Laurence Cohen et plusieurs de ses collègues (n° 560, 2011-2012).
La commission du développement durable se réunira pour le rapport le mercredi 20 février au matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 18 février, à douze heures].

Jeudi 28 février 2013
De 9 heures à 13 heures :
Ordre du jour réservé au groupe UMP :
1°) Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, portant application de l’article 11 de la Constitution (n° 242, 2011-2012) et projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant application de l’article 11 de la Constitution (n° 243, 2011-2012) ;
La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

2°) Suite éventuelle de la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable, présentée par M. Philippe Marini ;
3°) Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues (n° 546, 2011-2012) ;
La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 13 février matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 11 février, à douze heures].

De 15 heures à 15 heures 45 :
4°) Questions cribles thématiques sur la compétitivité ;
L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.

De 16 heures à 20 heures :
Ordre du jour réservé au groupe UDI-UC :
5°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à reconnaître le vote blanc aux élections (n° 156, 2012-2013) ;
La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 13 février matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 11 février, à douze heures].

6°) Proposition de loi autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, présentée par Mme Muguette Dini (n° 548, 2010-2011).
La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 20 février matin [délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 18 février, à douze heures].

Y-a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...
Ces propositions sont adoptées.

L’ordre du jour appelle le débat sur la police municipale, organisé à la demande de la commission des lois (rapport d’information n° 782 [2011-2012]).
La parole est à M. François Pillet, au nom de la commission des lois.

Monsieur le président, monsieur le ministre de l’intérieur, mes chers collègues, l’État est le garant de la sécurité sur l’ensemble du territoire. Le maire, quant à lui, est chargé de la police municipale, qui a pour objet d’assurer, aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, premier alinéa, « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Cet article de code, bien écrit, fait également référence, en son alinéa 2°, à la « tranquillité publique ».
Certes, le cadre général des missions de toutes les polices municipales est posé par différents textes législatifs : la loi du 15 avril 1999, qui a étendu les missions et compétences des agents, les lois du 15 novembre 2001, du 5 mars 2007 et du 5 mars 2011. Ainsi, tout semble avoir été dit.
Pour autant, il existe, sur le terrain, une grande diversité des pratiques, la physionomie de chaque police municipale dépendant des décisions prises par le maire.
Quant aux compétences, elles paraissent beaucoup plus floues. Des dérives sont apparues, découlant sans doute d’un désengagement des forces régaliennes. Les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie, comme le nombre de leurs implantations, ont effectivement diminué ces dernières années.
Selon le rapport de la Cour des comptes, pour la période triennale d’application du principe de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, soit de 2008 à 2011, les effectifs de la gendarmerie ont été amputés de 3 717 personnes sur un total de 101 136, et ceux de la police ont perdu 1 322 agents sur un total de 148 563.
En conséquence, les maires doivent bien souvent, sous la pression de leurs concitoyens, pallier le manque en étoffant leurs services de police.
Il en résulte une situation confuse, brouillée. À force de voir leurs pouvoirs augmentés, les polices municipales connaissent actuellement une crise d’identité conjuguée à une crise de croissance.
Ainsi la France comptait-elle 5 600 agents municipaux en 1984. Elle en recense désormais plus de 18 000. Les gardes champêtres sont les grands perdants de l’explosion des effectifs : 20 000 en 1950, ils ne sont plus que 1 450 aujourd’hui.
Tous statuts confondus, les polices des maires constituent un effectif global de près de 27 260 agents, soit plus de 10 % des effectifs cumulés de la police et de la gendarmerie nationales.
De nombreuses questions se posent sur le statut des personnels, les modes opératoires, la coopération entre les différents intervenants et l’augmentation progressive des pouvoirs judiciaires des polices municipales.
L’ensemble de ces considérations a conduit le Sénat à s’interroger sur l’équilibre général des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
C’est pourquoi mon collègue René Vandierendonck et moi-même avons été missionnés par la commission des lois pour dresser un état des lieux des polices municipales et de leur cadre juridique, ce qui nous a conduits à émettre un certain nombre de propositions susceptibles de résoudre la crise que traversent nos policiers municipaux.
D’emblée, je tiens à souligner que René Vandierendonck et moi avons été en accord complet sur les méthodes, le constat et les objectifs. Si le rapport d’information que nous avons rédigé jouit d’une fiabilité certaine, c’est avant tout grâce à la méthode employée : nous nous sommes en effet attachés à donner la parole, en premier lieu, à tous les maires concernés.
Il existe non pas une police, mais des polices municipales, chaque maire ayant le pouvoir de décider du format de la police et des missions menées par les agents. En effet, qu’y a-t-il de commun entre une petite police municipale dotée de quelques agents et une police forte d’un personnel nombreux, d’un système de vidéosurveillance voire d’un centre de supervision urbain ? Pas grand-chose !
C’est pourquoi nous avons adressé un questionnaire aux 3 935 maires qui se sont dotés d’un tel outil, pouvant se réduire à un garde champêtre ou compter, comme c’est le cas de Nice, jusqu’à 578 policiers municipaux, dont 353 policiers municipaux, 126 ASVP, ou agents de surveillance de la voie publique, 22 techniciens et 75 agents administratifs.
Près de la moitié des maires, soit 1 849, nous ont répondu, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Je tiens d’ailleurs à saluer ici le travail effectué par les collaborateurs de la commission des lois, qui ont envoyé ce questionnaire puis effectué le fastidieux travail d’analyse des retours.
Les maires ont démontré, par leurs réponses de qualité, leurs observations et commentaires nombreux, l’importance du sujet à traiter. Ils ont forcément orienté les propositions que nous faisons et que développera mon collègue René Vandierendonck.
Le retrait des forces régaliennes du territoire, qu’il s’agisse de la gendarmerie ou de la police, a été, par exemple, majoritairement dénoncé. La judiciarisation a été mise en exergue par la majeure partie des maires, certains déclarant même que, « dans le domaine judiciaire, l’évolution a été exponentielle ces dernières années ».
Par ailleurs, tous les acteurs concernés ont été auditionnés. Je n’en dresserai pas ici la liste, qui serait trop longue, puisque cinquante-quatre personnes ont été auditionnées au Sénat. Il s’agit de représentants de l’Association des maires ou des communautés de France, du Centre national de la fonction publique territoriale, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des ministères de l’intérieur et de la justice, de l’Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires, de la Conférence nationale des procureurs de la République, ainsi que de membres d’associations de policiers municipaux ou d’organismes syndicaux de la profession, y compris des gardes champêtres.
En tant qu’élus de collectivités territoriales disposant d’une police municipale mais sociologiquement très différentes, René Vandierendonck et moi-même avons des connaissances complémentaires des terrains et des enjeux.
Enfin, nous avons effectué huit déplacements, qui ont enrichi notre travail.
Nous nous sommes rendus dans les villes de Nice et d’Évry, dont les maires, malgré des appartenances politiques différentes, ont voulu une police municipale réactive, disposant d’équipements modernes et menant des missions proches de celles de la police nationale, notamment en matière de répression.
Nous nous sommes également déplacés dans des villes moyennes devant faire face à une délinquance importante, dotées d’un nombre de policiers municipaux non négligeable mais ne disposant pas des moyens nécessaires pour augmenter les effectifs, les équipements ou étendre les missions de leur police à mesure que la police nationale diminue son engagement.
Ce sont des communes qui vivent ou qui ont vécu la judiciarisation de façon subie. Ainsi, la ville de Colombes, dans laquelle nous nous sommes rendus, a dû s’adapter à cette situation en créant une police municipale travaillant de jour et de nuit et en installant un système de vidéosurveillance. La ville a pu revenir sur une partie des évolutions citées lors d’un changement de majorité municipale, la nouvelle équipe ayant notamment supprimé l’armement de 4e catégorie au profit des tonfas et de lanceurs Flash-Ball.
Nous avons pu constater en revanche que la communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency dispose, elle, d’effectifs étatiques adaptés à ses besoins. La gendarmerie nationale et la police municipale y font bon ménage ! Leurs responsables respectifs se réunissent périodiquement pour échanger des informations relatives à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité sur le territoire, et ce en vue de l’organisation matérielle des missions qui leur ont été confiées, partageant même, ce qui est assez original, une cartographie de la délinquance.
À Roissy, on nous a expliqué la convention de coordination signée entre la police municipale de la communauté de communes et la gendarmerie nationale. Les missions dévolues aux agents municipaux sont clairement définies : ils peuvent intervenir en tout lieu et à tout moment sur appel téléphonique d’un tiers, à la demande des forces de l’État, sachant que des missions de maintien de l’ordre ne peuvent en aucun cas leur être confiées.
À Amiens, nous nous sommes rendu compte que la vidéosurveillance peut constituer un axe structurant de la coopération entre la police municipale et la police nationale. L’implantation d’un centre de supervision urbain a permis que le dialogue se noue. Les partenaires deviennent complémentaires, les relations verticales disparaissent du même fait, les interventions sont coordonnées.
Nous avons pu noter que Dijon, comme Amiens, a axé son dispositif sur la prévention. Les agents municipaux, qui sont au nombre de 92 tous statuts confondus, ne sont pas armés et la vidéosurveillance reste un outil parmi d’autres.
Maintenon, commune d’environ 4 500 habitants, illustre pour nous le cas où un agent unique doit déployer une large palette de compétences pour assurer la tranquillité publique.
Évoquons maintenant la montée en puissance de la judiciarisation des polices municipales.
Traditionnellement, la police municipale est par excellence la police de proximité, celle qui met en œuvre les pouvoirs de police administrative du maire, essentiellement tournée vers la prévention des troubles à l’ordre public, à seule fin d’assurer la préservation du « bien-vivre ensemble » dans la commune.
Il s’agit de régler des conflits sociaux par la médiation, la persuasion, la dissuasion, en s’appuyant sur le sens civique des citoyens. Cette pratique domine encore dans de nombreuses communes, en particulier les plus petites. Les gardes champêtres sont davantage voués à régler les problèmes ruraux.
Si l’activité traditionnelle de la police municipale est ainsi à dominante préventive, les règles du bien-vivre ensemble impliquent une part de répression sous forme de contraventions, prévues par la loi ou par des arrêtés municipaux.
Les agents des polices municipales verbalisent principalement les contraventions aux arrêtés de police du maire, au code de la route, ainsi que les infractions à un certain nombre d’arrêtés pris en vertu de pouvoirs de police spéciale.
La diversité des compétences de la police municipale pose la question de l’unité du corps chargé d’assumer la diversité des missions. Il lui est en effet possible de verbaliser des infractions au code de la santé publique, mais aussi au code rural, au code de la voirie routière, au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ou encore au code de l’urbanisme.
Force est de constater que, depuis une dizaine d’années, la notion de tranquillité publique s’est largement durcie. Face à un sentiment d’insécurité, les maires, quelle que soit leur tendance politique, choisissent de répondre aux sollicitations de leurs administrés, qui supportent de moins en moins les actes d’incivilité ou la délinquance, en progression.
Ainsi de nombreux arrêtés municipaux sont pris contre les rassemblements nocturnes, la consommation d’alcool sur la voie publique, et certains instituent des couvre-feux.
Parallèlement à cette évolution, les polices municipales les plus importantes, en nombre d’agents et pour l’étendue de leurs fonctions, tendent à mettre l’accent moins sur l’îlotage et la présence sur la voie publique que sur la rapidité d’intervention.
L’exemple emblématique est naturellement celui de la ville de Nice dont les agents, qui disposent par ailleurs d’équipements extrêmement modernes, ont des missions si larges, placées sous le signe de la réactivité et du professionnalisme, qu’elles se rapprochent de celles des forces nationales
Le maire d’Évry illustre bien cette évolution, considérant même que « la police municipale est le premier niveau de la sécurité, pas de la tranquillité ».
Au-delà du renforcement des actions de « tranquillité publique », nous avons pu noter que, de manière croissante, les agents de police municipale se sont vu confier des missions de police judiciaire se rapprochant de celles des forces nationales.
Cette transformation accompagne un infléchissement des missions vers davantage d’interventions, de répression et de travail judiciaire. Au sein de certaines polices municipales, l’accent est ainsi mis de manière croissante sur la verbalisation, les flagrants délits, les interpellations suivies de mises à disposition de la police ou de la gendarmerie nationales. Il s’agit avant tout de faire appliquer les lois et de combattre vigoureusement la délinquance de voie publique.
En matière d’infractions routières, les policiers municipaux ont progressivement acquis une palette très large de prérogatives.
Dans le cadre des conventions de coordination, certaines polices municipales interviennent fréquemment en soutien des forces de sécurité nationale. La vidéosurveillance, devenue un passage quasi obligé pour une politique de sécurité locale qui se veut dynamique, peut constituer un élément structurant de la coopération entre ces deux corps, surtout dans les zones urbaines connaissant un taux élevé de délinquance.
Cette évolution n’est pas toujours voulue. D’après de nombreux maires, elle semble plutôt résulter d’une volonté des forces nationales de se décharger de leur rôle immédiat.
De nombreux maires ont toutefois mis en garde contre une extension des pouvoirs des policiers municipaux, qu’ils jugent périlleuse. Le rapprochement entre les missions de ces agents et celles des agents des forces nationales comporte en effet plusieurs inconvénients.
En premier lieu, outre le rapprochement des missions, une certaine confusion dans l’esprit des citoyens peut être entretenue par la similarité des uniformes. Cette confusion peut être dommageable dans la mesure où les habitants n’admettent pas que les policiers municipaux verbalisent le stationnement irrégulier plutôt que de chasser les délinquants, d’enregistrer leurs plaintes ou de retenir une personne suspecte.
En second lieu, de nombreux maires ayant répondu au questionnaire craignent qu’un renforcement supplémentaire des missions répressives et des pouvoirs de police judiciaire des policiers municipaux ne les éloigne de la population.
L’augmentation du niveau de formation des policiers nationaux, alliée à l’accroissement du nombre d’officiers de police judiciaire, a eu ces dernières années pour effet d’éloigner la police nationale du terrain, créant un vide qui a été partiellement comblé par la progression des effectifs de policiers municipaux.
L’exemple des sorties d’école illustre bien ce phénomène de délégation en chaîne. Cette tâche, naguère dévolue aux forces de sécurité nationales, a progressivement été prise en charge par les policiers municipaux qui, dans de nombreuses communes, l’ont déléguée aux agents de surveillance de la voie publique. À l’heure actuelle, elle est assurée par ceux que l’on appelle les « papys et mamies trafic ».
Cette évolution a pour effet de diminuer la fréquence des contacts de la police municipale avec le terrain, donc la qualité de la relation avec les citoyens, gage d’efficacité de la prévention.
Enfin, la judiciarisation tend à rendre les policiers municipaux plus indépendants des maires en les rattachant davantage à la chaîne pénale. Si cette évolution est souhaitée par certains syndicats, elle ne recueille en revanche pas notre assentiment dans la mesure où nous considérons que la police municipale doit rester la police du maire.
L’intercommunalité est dans ce domaine une expérience intéressante. Cet aspect sera développé dans un instant par M. René Vandierendonck, et je me limiterai donc à indiquer que nous avons effectué des visites riches d’enseignements et observé des expériences encourageantes et très positives.
Je terminerai cette intervention par la question de l’armement des policiers municipaux qui a suscité de très nombreux commentaires de la part des maires et des organismes syndicaux.
Qu’en est-il vraiment ? Force est de constater que la situation est très hétérogène sur le terrain, l’armement dépendant des missions qui sont confiées aux polices municipales. En définitive, l’armement dépend plus de la doctrine d’emploi arrêtée par le maire qu’il n’est lié à la population ou aux réalités sociologiques de cette dernière.
À titre d’illustration, je citerai une nouvelle fois Nice et Évry, deux villes dans lesquelles la police municipale dispose d’armes de 4e catégorie alors que les agents dijonnais sont équipés de bâtons et de bombes lacrymogènes, que, à Amiens, les agents ont des armes de 6e catégorie pour certaines missions, et que, à Roissy, ils ont à leur disposition, en plus de l’armement, une brigade canine.
Le port d’armes de 4e catégorie est une revendication récurrente.
Comme je l’ai mentionné précédemment, police et gendarmerie se sont parfois délestées de certaines de leurs fonctions, et il est arrivé que des agents municipaux aient été réquisitionnés par le procureur de la République pour mener des opérations proches de celles qui relèvent des forces régaliennes.
Le renforcement des pouvoirs exercés et l’absence de moyens juridiques ont notamment pour conséquence que le port d’armes de 4e catégorie est revendiqué par les syndicats de policiers municipaux.
Si de nombreux maires y sont favorables, il en est également qui craignent certaines dérives.
La commission considère que l’armement ne doit pas être une question idéologique. L’armement n’est pas une prérogative attachée à l’exercice des missions de police municipale, il doit rester fonction de la réalité du terrain, des missions attribuées aux agents, de la volonté du maire, et faire l’objet de dispositions plus précises dans les conventions de coordination, comme le précisera mon collègue René Vandierendonck. En un mot la question de l’armement doit être posée non avant, mais seulement après celle des missions. §

La parole est à M. René Vandierendonck, au nom de la commission des lois.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, après cet état des lieux dressé par François Pillet, je regrouperai les vingt-cinq propositions du rapport sénatorial d’information autour de trois thèmes : la police territoriale, le renforcement de la coordination, sur le terrain, entre police nationale et police municipale, enfin, les voies de l’optimisation, notamment l’intercommunalité.
S’agissant tout d’abord du premier thème, c’est-à-dire la substitution de la police territoriale à la police municipale, vous reconnaîtrez sans doute avec moi, mes chers collègues, que l’émission Enquête exclusive consacrée aux polices municipales d’Amiens et Nice, diffusée par M6 le dimanche 20 janvier dernier, ne donne pas une image conforme à la réalité des missions des polices municipales et de la coopération avec la police nationale que nous avons pu constater dans de nombreuses communes, notamment dans ces deux villes.
Le seul mérite de la caricature est de faire apparaître, au-delà de l’hétérogénéité des polices municipales, la nécessité de privilégier la voie d’un réformisme pragmatique qui refuse de limiter la diversité des missions en les recentrant exclusivement sur la lutte contre la délinquance. Le risque serait alors grand de déconnecter le pouvoir de police du maire de la proximité avec la population et de l’adaptation aux circonstances locales, tandis que les besoins non satisfaits seraient relégués à je ne sais quelle sous-police municipale : agents de surveillance de la voie publique, ou ASVP, médiateurs et autres.
Mon collègue François Pillet et moi-même validons l’orientation esquissée en 2009 par le préfet Jean Ambroggiani de créer une police territoriale qui fusionnerait les cadres d’emploi des policiers municipaux et des gardes champêtres, non seulement sur le plan statutaire, mais aussi par leurs missions. La future filière serait alors constituée de trois cadres d’emploi de police : des agents de police territoriale relevant de la catégorie C, des chefs de service de police territoriale relevant de la catégorie B, des directeurs de police territoriale relevant de la catégorie A.
S’ajouterait à cette filière un vrai cadre d’emploi de catégorie C, celui des ASVP, accessible sans concours, et comprenant – c’est essentiel – une formation obligatoire.

D’ailleurs, nous entendons prévenir les dérives concernant l’utilisation illégale des ASVP à d’autres tâches que celles qui sont liées au constat des infractions au stationnement.
À nos yeux, la proposition tendant à la création d’une police territoriale doit permettre d’améliorer la qualification, les conditions de travail et l’avancement grâce à plusieurs critères : une durée homogène de formation initiale, une formation continue obligatoire pour tous permettant d’adapter les pratiques à l’évolution des missions, des conditions d’avancement uniformes, une meilleure mobilité entre les métiers dont la diversité reflète les très nombreux secteurs d’intervention, que ce soit au titre des pouvoirs de police générale ou au titre des pouvoirs de police spéciale.
Dans cette nouvelle dynamique statutaire, la considération légitime attendue par les policiers municipaux suppose de retenir les principales propositions de la commission consultative des polices municipales discutées lors de sa réunion du 27 mars 2012 : l’assouplissement du seuil de création du poste de directeur de police municipale par l’instauration d’un critère alternatif – soit l’effectif du service, qui doit être au moins de 20 agents, soit la population de la commune ou de l’intercommunalité, qui doit atteindre au minimum 20 000 habitants – ; la généralisation d’une indemnité spéciale de fonction de 20 %, avec un complément de 5 % maximum « en fonction de la valeur professionnelle » des agents ; la création d’un échelon supplémentaire pour les brigadiers-chefs principaux et chefs de police.
En allant pendant plusieurs mois à la rencontre des polices municipales, François Pillet et moi-même avons acquis la certitude que l’amélioration de la formation est au cœur de la nouvelle police territoriale. Sans aucune complaisance, et grâce aux remontées des communes dans le cadre de notre enquête – et je tiens à remercier les collaborateurs de la commission des lois qui nous ont remarquablement aidés, notamment à dépouiller les questionnaires –, nous avons longuement auditionné le Centre national de la fonction publique territoriale, qui a d’ores et déjà pris conscience des évolutions indispensables attendues de tous, notamment en travaillant à la fois sur son référentiel de formations et sa labellisation, au nécessaire regroupement à un niveau interrégional de ses formations spécialisées, enfin, à l’adaptation – à la demande, si je puis dire – de son catalogue des formations aux missions et tâches de plus en plus spécialisées exercées par les agents.
Nous demandons également, monsieur le ministre, que le préfet et le parquet délivrent leur agrément en visant explicitement l’avis préalable de fin de formation initiale délivré par le président du CNFPT. C’est loin d’être le cas aujourd’hui.
J’en viens au deuxième thème, la coordination opérationnelle sur le terrain.
Le 8 avril prochain, monsieur le ministre, sera organisée sur votre initiative un séminaire sur les méthodes de pilotage et d’évaluation des zones de sécurité prioritaires.
M. le ministre de l’intérieur acquiesce.

Pour renforcer le pouvoir de police du maire, il nous semble utile, tout d’abord, de proposer la mise à jour des dispositions du code général des collectivités territoriales, en notant bien que les réponses au questionnaire font apparaître l’importance de la préservation du cadre de vie, élément qu’il ne faut pas passer par pertes et profits.
Sans revendiquer l’originalité, nous souhaitons donc que la coordination entre police nationale et police municipale, pour être meilleure, soit enfin formalisée dans un cadre contractuel plus précis, avec des obligations réciproques.
Je rappelle que les conventions de coordination actuellement existantes sont très diversement utilisées.
À cet égard, le maire de Vernouillet, dans les Yvelines, a indiqué, dans ses réponses au questionnaire : « Certes, il existe déjà des conventions de coordination, mais celles-ci pourraient être rénovées afin d’être mieux adaptées en matière de coopération, de coordination et de commandement ».
Ces conventions de coordination obéissent trop souvent à un modèle-type : elles réaffirment avec force que la police municipale n’est pas en charge du maintien de l’ordre – et c’est heureux ! –, tout en restant généralement assez discrètes sur le contenu précis et actualisé des conditions, sur un même territoire, de la coopération entre la police nationale et la police municipale.
Le décret du 2 janvier 2012 a bien évidemment amélioré le contenu des conventions de coordination, mais des lacunes importantes subsistent tout de même aujourd’hui. C’est pourquoi nous formulons un certain nombre de propositions pour rénover ces conventions.
Tout d’abord, nous préconisons que ces conventions soient signées non seulement pas le préfet et le maire, mais aussi par le procureur de la République. Je rappelle à cet égard que, à l’instar de MM. Cayrel et Diederichs, inspecteurs généraux de l’administration, auteurs d’un rapport publié en 2010, nous avons constaté que la vidéosurveillance et la création des centres de supervision urbains structurent souvent la coopération entre la police municipale et la police nationale. Il y a par conséquent un travail de coopération à effectuer autour de la vidéoprotection.
Il est important que l’État s’engage dans ces conventions, d’une part, en décrivant la gestion de ses moyens propres en matière de sécurité publique, compétence régalienne, et, d’autre part, en étant très actif s’agissant de la simplification des procédures.
François Pillet l’a remarquablement mis en évidence, si nous voulons limiter l’extension des pouvoirs de police judiciaire des policiers municipaux, nous entendons néanmoins que, là où ces prérogatives existent, elles puissent s’exercer correctement.
Ceux qui ont regardé l’émission télévisée diffusée dimanche soir sur la chaîne M6 ont appris qu’un policier municipal, même à Nice, a moins de pouvoirs que le Norauto du coin pour accéder au fichier des permis de conduire et à celui des voitures volées. (Des progrès doivent incontestablement être enregistrés en la matière.
De la même manière, l’unification de la rédaction des procès-verbaux grâce à l’élaboration d’un guide des procédures, et surtout – je sais que ce thème vous est cher, monsieur le ministre – l’extension de la liste des contraventions susceptibles d’être verbalisées par timbre-amende sont des attentes concrètes qui représentent des heures de mise à disposition des fonctionnaires municipaux.

Cette question rejoint la problématique plus large de l’optimisation du temps passé sur la voie publique par la police nationale. Je le dis à l’adresse de ceux qui ont lu les derniers rapports de la Cour des comptes.
J’en viens à l’armement.
En premier lieu, l’armement de la police municipale relève du choix et de la responsabilité du maire, mais le fait de savoir « qui est armé ? quand ? comment ? » doit à notre avis être défini dans la convention de coopération.
En second lieu, il est important de sécuriser l’armement. L’évaluation du stagiaire par le Centre national de la fonction publique territoriale doit devenir un élément déterminant de la délivrance de l’agrément. En conséquence, l’avis rendu en fin de formation initiale par le président du CNFPT doit être transmis au préfet et au procureur préalablement à toute décision de ces derniers quant à une demande d’agrément.
J’en viens à une troisième voie qui nous paraît intéressante et nous renvoie d’ailleurs à l’actualité du débat sur la décentralisation, celle de l’optimisation par l’intercommunalité.
La situation est paradoxale : de nombreux maires de petites communes, quand on les questionne, estiment souhaitable la mutualisation à l’échelle intercommunale. Pourtant, il n’y a aujourd’hui que 50 conventions intercommunales signées en zone de gendarmerie sur les 1078 conventions existantes. Cet aspect ne doit pas être négligé, d’autant que ces accords sont encadrés par la loi, comme notre collègue Alain Richard l’a encore indiqué hier en commission des lois.
Quelles sont les modalités de la coopération intercommunale ? Il existe plusieurs formules de mutualisation.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent recruter directement des agents de police municipale pour les mettre à disposition de l’une des communes membres ; dans ce cas, ces agents sont sous l’autorité du maire concerné.
Par ailleurs, des dispositions prévoient aujourd’hui le transfert du maire au président de l’EPCI de certains pouvoirs de police spéciale, tel l’assainissement. Mais sur le terrain, dans leur grande majorité, les maires n’entendent pas se dessaisir des prérogatives de police municipale, si faibles soient-elles.

Peut-on, à l’instar de la communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency et de celle de Roissy-Porte-de-France en Île-de-France, concevoir, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires, de concilier, d’une part, une mutualisation de toutes les fonctions « support », une mutualisation des connaissances et du suivi en matière de délinquance, et, d’autre part, la préservation du pouvoir de police des maires ?
Après un avis donné en bonne et due forme par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la mutualisation s’est traduite, à la CAVAM, par une analyse de la délinquance effectuée par le biais d’un logiciel spécifique de cartographie partagé avec la police nationale : des données anonymisées du système de traitement des infractions constatées, le STIC, ont pu être partagées, cartographiées, visualisées, permettant une géolocalisation et, en vertu d’une convention de coopération, un suivi des rôles respectifs de la police nationale et de la police municipale.
Les maires des communes membres, cher monsieur Nègre, ont affirmé à l’unanimité, lors de leur réunion, que l’intervention réalisée sur leur territoire continuait à relever de leur pouvoir d’appréciation.
J’irai même plus loin – je sais que vous m’attendez sur ce point –, les maires ont déclaré utiliser les données pour être capables, lorsque les habitants d’un lotissement se plaignent pendant une réunion de quartier de ne plus voir passer la police nationale ou la police municipale, de leur transmettre des informations précises à ce sujet, par exemple le relevé des infractions constatées dans un secteur donné.
À mon avis, nous avons intérêt, dans un certain nombre de cas, à réfléchir à des expériences de mutualisation qui ne comportent pas nécessairement un transfert en bonne et due forme des pouvoirs de police du maire. Une telle réflexion pourrait intervenir à l’occasion de l’examen du projet de loi « Lebranchu », relatif à la décentralisation et à la réforme de l’action publique.
Ces exemples suffisent à mon sens à montrer qu’il y a matière à réfléchir, …

… d’autant que l’effet « plumeau » de la vidéosurveillance serait ainsi corrigé : nous pouvons adapter, avec la mobilité correspondante, des outils que nous sommes loin de condamner dans la mesure où, quand ils sont organisés dans une convention de coopération digne de ce nom, ils contribuent très fortement à produire des résultats.
L’autre avantage, en termes de gestion – je m’adresse plus particulièrement aux maires, à ceux qui l’ont été ou à ceux qui le seront –, est la diminution du turn-over, véritable fléau récurrent de la police municipale. Ainsi, à Montmorency, le turn-over est passé de30 % avant l’intercommunalité à 13 % maintenant.
Je conclurai cette intervention en adressant des remerciements : tout d’abord à M. le président de la commission des lois et aux collaborateurs de cette dernière, ainsi qu’à tous ceux qui, par leur disponibilité, ont rendu ce travail possible ; à M. le ministre, ensuite, puisque j’ai beaucoup apprécié, comme mon collègue François Pillet, la façon dont, très spontanément, il s’est ouvert à notre démarche : monsieur le ministre, vous avez créé les conditions pour que nous ayons accès à toutes les informations utiles et puissions organiser toutes les auditions nécessaires. Je ne doute pas que nous continuerons à travailler dans cet esprit.
Applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois encore, avec le rapport d’information de MM. François Pillet et René Vandierendonck, nous avons l’occasion de remarquer l’excellence de la démarche mise en œuvre depuis plusieurs années par la commission des lois du Sénat.
Que René Garrec et Jean-Jacques Hyest – nous avons, hier, rendu conjointement hommage à la fonctionnaire du Sénat qui a dirigé avec talent et sagacité les services de notre commission durant quinze ans – me permettent de les associer à ce propos : la pratique consistant à confier un rapport d’information à un sénateur de la majorité et à un sénateur de l’opposition, déjà appliquée à plus de dix reprises, s’est révélée féconde.
Bien sûr, chaque sujet abordé suscite des discussions, mais nous avons choisi, pour chaque mission d’information, de partir du réel – car, pour paraphraser une formule célèbre, le réel est têtu – et de regarder ce qui se passe sur le terrain : qu’il se soit agi du droit d’asile, de la réforme de la carte judiciaire, de la loi pénitentiaire ou de la police municipale, sujet qui nous occupe aujourd'hui, les faits s’imposent et, dès lors, nos rapporteurs s’accordent avant tout sur le diagnostic. Ensuite, des propositions sont formulées, généralement au terme d’un débat et d’un dialogue.
Nul n’est obligé d’acquiescer à tout, bien sûr. Les comptes rendus des débats de la commission figurent d’ailleurs en annexe du rapport, qui est publié.
Je le répète, cette démarche est féconde. Nous aimons tous le débat politique : la contradiction est saine, naturelle et utile. Au surplus, cette manière de faire de la politique permet de réaliser un certain nombre d’avancées. Nous en observons un nouvel exemple aujourd’hui.
Aussi, je tiens à saluer le travail considérable accompli par nos collègues René Vandierendonck et François Pillet, qui n’ont pas ménagé leur peine : ils ont fait nombre de déplacements et ont interrogé, par écrit, quelque 3 200 maires, qui leur ont répondu. Avec l’aide des services de la commission, ils ont dépouillé les questionnaires et mené, sur la base des réponses obtenues, un travail extrêmement sérieux.
Telle était la principale remarque que je tenais à formuler.
J’ajoute que ce rapport fait écho à une préoccupation que M. le ministre a exprimée à maintes reprises : vivre en sécurité est un des premiers droits de chacune et de chacun dans notre pays.
Les polices municipales regroupent un grand nombre d’agents. Les chiffres figurant dans le rapport sont frappants : ces services, qui comptaient 5 600 salariés en 1984, en comptent 18 000 aujourd’hui. C’est dire que l’accroissement a été considérable.
Messieurs les rapporteurs, votre travail est porteur d’un message important : il faut établir un rapport de confiance avec les personnels des services de police municipale. À cette fin, vous proposez d’améliorer le statut de ces derniers et de créer une police territoriale qui rassemblerait policiers municipaux, gardes champêtres et agents de surveillance de la voie publique.
En additionnant les personnels relevant de ces trois catégories, on obtient, pour l’ensemble de notre pays, un total de 27 260 agents. Vous insistez sur la nécessité de rendre à chacun d’eux confiance dans sa mission et dans l’utilité de cette dernière. C’est nécessaire : il ne faut pas que ces agents aient le sentiment de constituer une police subsidiaire, qui ne serait pas reconnue pour ce qu’elle est.
Bien entendu, vous souhaitez, comme nous, garantir la clarté de la répartition des compétences : la mission de cette police territoriale ne sera ni celle de la police nationale ni celle de la gendarmerie nationale. Sur ce point, votre rapport est très clair : « coordination, complémentarité, et non confusion ». À cet égard, ce nouveau concept de police territoriale sera, j’en suis certain, très utile.
De plus, vous formulez des propositions concrètes, sur lesquelles nous attendons naturellement les réponses du Gouvernement. Peut-être ne viendront-elles pas aujourd’hui, monsieur le ministre. Du moins pourrez-vous nous livrer vos réflexions concernant un certain nombre des avancées proposées. J’en mentionnerai trois.
Premièrement, les rapporteurs proposent de permettre une verbalisation immédiate des contraventions aux arrêtés du maire. Est-il utile que cette procédure prenne tant de temps ? Ne pourrait-elle pas devenir plus efficace ?
Nouveaux sourires.

Deuxièmement, ils suggèrent de donner aux agents de cette police territoriale l’accès à certains fichiers routiers dont ils peuvent avoir besoin, par exemple pour gérer des immobilisations de véhicules. C’est un problème qui se pose souvent dans nos communes : lorsque des policiers municipaux sont placés face à une situation qui nécessite l’immobilisation d’un véhicule, de nombreuses procédures doivent être suivies ; or ils n’ont pas directement accès à l’information qui leur permettrait de les accomplir rapidement.
Troisièmement, j’évoquerai une question au sujet de laquelle j’ai eu l’occasion de me battre à maintes reprises par le passé : celle des quotas dans l’attribution des postes de directeur de police municipale.
Vous le savez, le maire a longtemps eu toute latitude pour proposer à son conseil municipal de créer un ou deux gymnases, trois salles des fêtes, etc. Cependant, il lui était très difficile – et cette difficulté persiste pour partie aujourd’hui – de décider de la création de tel ou tel cadre, dans la mesure où il fallait respecter des quotas et des obligations de parité. Aussi justifiées que puissent être ces contraintes s’agissant de la fonction publique de l’État, elles sont, dans les communes, parfois paralysantes.
Aussi, messieurs les rapporteurs, vous suggérez de réviser les critères pour la création de postes de directeur de police municipale. Vous formulez une proposition très concrète : cette adaptation pourrait intervenir soit dans les communes de plus de 20 000 habitants, soit lorsque les effectifs de police municipale dépassent vingt agents.
Cette proposition a le mérite de la clarté. Elle est de nature à bien préciser les attributions et les responsabilités de chacun, et à donner confiance aux différents personnels en clarifiant leurs missions et leurs moyens, tout en accroissant l’efficacité de leur intervention.
Avant de conclure, permettez-moi de mentionner deux autres apports importants de votre travail.
D’une part, vous émettez une proposition concernant le cadre de la coopération intercommunale.
Mes chers collègues, voilà quelques mois, j’ai eu l’occasion d’assister à la mise en œuvre d’une mesure prise par trois maires de mon département, dont les communes, voisines, comptent entre 1 000 et 3 000 habitants. Chacune d’entre elles employait jusqu’alors un garde champêtre ou deux. Elles se sont organisées en les regroupant au sein d’une unité de cinq agents. Vous me direz que cette réalisation est modeste. Pas du tout ! En effet, il est plus efficace de créer une équipe coordonnée de cinq personnes couvrant un secteur de trois petites communes que de maintenir, dans chacune de ces communes, une personne qui ne peut, par définition, exercer qu’une surveillance aléatoire et qui travaille dans la solitude.
Je suis heureux de citer cet exemple, car il me donne l’occasion de montrer une fois de plus combien le Sénat est attaché aux petites communes !

Une telle mutualisation des moyens est gage de modernité et d’efficacité.
D’autre part, votre rapport témoigne d’une grande exigence en matière de formation, notamment lorsque le maire prend des décisions concernant l’armement des agents de la police municipale. Soyons très clairs : aucune décision de cette nature ne doit être prise sans, primo, la formation appropriée et, secundo, l’entraînement approprié. Sinon, c’est de l’irresponsabilité !

Les critères de recrutement, de formation et d’entraînement doivent garantir une totale fiabilité.

Tout à fait, mon cher collègue !
Disons-le, tout ce qui, dans ce domaine, irait dans le sens de la démagogie – nous avons vu cela, dans le passé – se retournerait contre les agents de cette « police territoriale », à qui nous voulons faire confiance eu égard à leur contribution éminente, complémentaire, spécifique et reconnue comme telle, à une meilleure sécurité, qui est un droit fondamental de chaque être humain. §

Nous allons maintenant entendre les orateurs des groupes.
La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos collègues François Pillet et René Vandierendonck, dont j’ai lu le remarquable rapport avec toute l’attention qu’il mérite, ont établi un inventaire exhaustif, réfléchi et cohérent, traduisant une pensée claire et traçant une perspective nette. Je souscris, pour l’essentiel, à leurs préconisations. Je serai toutefois amené à formuler quelques réserves en conclusion.
Le constat qu’ils dressent est sans ambiguïté : si les responsabilités en matière de sécurité publique semblent clairement réparties entre l’État et les communes, la réalité des faits sur le terrain est beaucoup plus floue. Il n’est pas rare de constater que les conditions dans lesquelles certaines polices municipales interviennent sont assez imprécises, ou que les moyens mobilisés ne permettent pas aux agents présents sur le terrain de remplir correctement toutes les missions qui leur sont assignées.
Certes, la diversité des missions assumées par les polices municipales est le reflet de la libre administration des communes, et je sais combien celles-ci sont attachées à ce principe. Mais peut-être faudrait-il engager une nouvelle réflexion et voir plus loin, compte tenu de l’évolution des problèmes de sécurité dans nos villes et nos villages.
Dans le temps qui m’est imparti, je ne pourrai pas aborder l’ensemble des problématiques relatives au thème de ce débat. Toutefois, j’espère que celui-ci offrira à M. le ministre l’occasion d’apporter un certain nombre d’éclaircissements.
L’approfondissement de la coopération intercommunale qui se dessine depuis quelques années et qui ne peut que s’amplifier, nécessitera un ajustement de la mutualisation de la gestion des polices municipales. Je dois d’ailleurs dire que la notion de « police territoriale » a de quoi me séduire. Seules cinquante polices municipales intercommunales existent à l’heure actuelle, mais de nombreux maires, en particulier dans les petites communes rurales, souhaitent que cette mutualisation se développe, évidemment pour compenser la réforme de la carte des gendarmeries.
Encourager la mutualisation intercommunale des polices municipales, y compris en rendant possible le transfert de certains pouvoirs de police générale des maires, nous apparaît comme une piste de réflexion fondamentale au regard de l’impératif de l’égalité devant le droit à la sécurité.
Je ne développerai la nécessité de conforter le volet social et statutaire des agents des polices municipales. Il s’agit également d’un aspect fondamental, sur lequel les rapporteurs ont justement insisté.
Monsieur le ministre, le champ des polices municipales est aujourd’hui brouillé par les signaux émis pendant plusieurs années par l’État en matière de sécurité. Les messages politiques martelés à différentes tribunes n’ont jamais été suivis sur le terrain par les actes appropriés. La police municipale n’est pas la police nationale, mais elle n’en demeure pas moins une police de la République. C’est pourquoi son action doit s’inscrire dans un cadre légal rénové, clair et opérationnel.
Je souhaite que ce débat permette de connaître votre plan d’action en la matière. Il ne nous semble pas acceptable que seules les communes les plus riches soient en mesure de combler les lacunes de l’État. En d’autres termes, il n’appartient pas aux communes d’exercer les missions de la police nationale.
Au regard de ce constat succinct, il importe de mettre l’accent sur la clarification des missions de la police municipale, en insistant sur l’approfondissement des spécificités de ses attributions, et en les distinguant plus clairement de celles de la police nationale et de la gendarmerie.
Dans le contexte juridique actuel, on comprend que le Conseil constitutionnel n’ait pas souhaité renforcer les pouvoirs de police judiciaire, lorsqu’il a rendu sa décision sur la LOPPSI – loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Il ne s’agit pas de renforcer davantage les pouvoirs judiciaires des agents de police municipale ; le Conseil constitutionnel a été très clair sur ce point.
Comme le préconisent nos collègues dans leur rapport, il semble plus opportun de renforcer l’assise territoriale des polices municipales, en regroupant les compétences des agents de police municipale et des gardes champêtres, en précisant, dans les conventions de coordination avec les forces nationales le rôle spécifique des polices municipales, ou encore en articulant le cadre d’intervention de ces dernières avec la politique partenariale de prévention de la délinquance.
Sur le terrain, nous voulons non pas des petits shérifs, mais des forces de police respectueuses de l’ordre républicain.
De même, nous ne voulons pas que soient placés en première ligne des agents dont la formation ne répond pas aux mêmes exigences que celle des fonctionnaires de l’État. Il est ainsi regrettable qu’il n’existe aucun régime institutionnalisé de formation pour certains métiers liés au maintien de la sécurité, comme les agents de surveillance de la voie publique, pourtant agréés et assermentés, les opérateurs de vidéosurveillance ou les assistants temporaires de police municipale. C’est un vrai problème.
Pour notre groupe, l’égalité devant la sécurité, quel que soit le lieu où l’on réside, est également un principe fondamental. Nous avions d’ailleurs défendu sur ce point de nombreux amendements lors de la discussion de la LOPPSI. Il n’est pas admissible que le désengagement de l’État au regard des services de police ou de gendarmerie – conséquence, en partie, de la révision générale des politiques publiques – se traduise par l’obligation pour les collectivités de pallier les insuffisances en la matière.
C’est précisément de cette situation que naissent des inégalités face au droit à la sécurité puisque la capacité d’action des communes dépend d’abord e leurs ressources.
Les différentes formes de polices municipales mises en évidence par nos collègues illustrent le fait que la proximité est un élément essentiel de la prévention de la délinquance. Médiation, dialogue, connaissance du territoire, présence visible sur le terrain sont autant de moyens d’assurer la tranquillité de l’espace public et des habitants. Les outils de répression que la loi met entre les mains des policiers municipaux ou des gardes champêtres n’ont eux-mêmes pour finalité que de renforcer la dissuasion.
Cependant, la montée en puissance, au cours des dernières années, des problématiques de sécurité, parfois instrumentalisées à des fins un peu moins nobles, a eu pour conséquence de brouiller ce schéma.
Soyons clairs : tandis que certaines politiques pénales tendaient à occulter l’indispensable volet préventif, à l’échelon local, les actions de prévention ont été quasiment laissées de côté.
Du reste, nous constatons que certaines communes ont tendance à rapprocher leur doctrine d’emploi de la police municipale de celle de la police nationale.
Depuis le début de ce débat, certains mots sont revenus à plusieurs reprises dans la bouche des orateurs : territorial, coopération, coordination, intercommunalité, mutualisation. Si ce rapport est bien fait, c’est parce que ses auteurs sont des élus locaux qui connaissent bien la problématique locale, qui la vivent au quotidien, avec ses bonheurs, mais aussi, hélas ! ses malheurs. Néanmoins, le logiciel demeure le même : on n’a pas remis le dossier complètement à plat, on ne s’est pas demandé quels étaient fondamentalement les problèmes de sécurité dans notre pays, ni même s’il appartenait vraiment à la police d’État et aux polices municipales de les régler.
Monsieur Pillet, monsieur Vandierendonck, ne vous méprenez pas sur mes propos : vous faites dans ce rapport des propositions remarquables, mais les solutions que vous préconisez sont le reflet de votre expérience, des outils auxquels vous recourez habituellement. Vous parlez de mutualisation, de regroupement, de rapprochement, de coordination, mais ne faut-il pas aller jusqu’à s’interroger, même si cela peut sembler choquant à certains, sur une éventuelle décentralisation de la police nationale ?
Mme Éliane Assassi s’exclame.

Pourquoi ne pas envisager cette perspective ? Certes, elle contrevient à tout ce qu’on enseigne dans les facultés de droit, mais, pour autant, je pense que, à un moment donné, il faudra envisager cette évolution, sous une forme qui reste à définir. Je comprends que cette proposition puisse heurter, mais un changement est nécessaire, parce que les méthodes auxquelles on a recouru jusqu’à présent n’ont pas vraiment été couronnées de succès. Changer d’état d’esprit requiert certes un effort violent sur soi-même, mais c’est parfois aussi un signe d’intelligence.
Cette suggestion a, je le reconnais, un caractère iconoclaste, mais je me permets de faire remarquer que, chaque fois qu’on s’est engagé dans un mouvement de décentralisation qui nous paraissait difficile, voire impensable, la réussite a toujours été au rendez-vous.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris, c’est un point de vue personnel dont j’ai fait part en conclusion de mon propos. Pour le reste de mon intervention, je m’exprimais au nom du RDSE.
M. le président de la commission des lois, M. René Vandierendonck, Mme Virginie Klès et M. René Garrec applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la sécurité est un sujet de société important en ce qu’elle garantit les libertés publiques et la protection de toutes et de tous. L’attente des Françaises et des Français sur ce sujet est, à juste titre, très forte.
À côté de l’État, les communes concourent de plus en plus à la sécurité. Les polices municipales sont devenues des acteurs incontournables du paysage local, de la sécurité et de la prévention.
Pour autant, la police municipale n’est pas un sujet qui fait consensus, en dépit des efforts des deux excellents auteurs de ce rapport pour rapprocher les points de vue.
Aussi, je me réjouis de la tenue de ce débat, qui prolonge la réflexion que j’ai pu mener moi-même dans le cadre de mon rapport spécial sur la sécurité, au nom de la commission des finances.
Même si elle demeure insuffisamment entendue, ma formation politique apporte des réponses à la fois novatrices et pertinentes en matière de sécurité. Nous pensons qu’il est temps d’évoluer dans nos modes de pensée et de revoir le fonctionnement de la police municipale.
En effet, on ne peut envisager la sécurité uniquement sous l’angle de la répression, comme cela a été le cas, pendant trop longtemps, notamment sous l’ancien gouvernement. La sécurité relève aussi du « vivre ensemble » et c’est dans cet esprit qu’une meilleure gouvernance au niveau de la police municipale doit être mise en place. Il convient aussi de s’interroger sur la future gouvernance locale afin de privilégier la prévention. N’oublions jamais qu’il n’est pas possible de lutter contre l’insécurité sans la participation des habitants.
C’est pourquoi nous avons tout intérêt à « investir » dans la médiation. Oui, je parle d’investissement, car on ne peut pas considérer comme du « temps perdu » le fait de créer un lien durable avec la population. Cela évite bien des conflits par la suite.
Dans ces conditions, la police municipale est incontestablement utile. Il est néanmoins primordial que ses missions soient bien définies. La police municipale ne doit pas être un supplétif de la police nationale ou de la gendarmerie, qui relèvent de registres bien différents.
Les forces de l’ordre nationales sont, en vertu de la tradition républicaine, garantes de la sécurité sur l’ensemble du territoire, ce qui implique un droit de coercition légitime. Pour éviter toute dérive, le droit à « la privation de liberté » par la force doit être le plus limité possible et rester du domaine étatique. Je veux dire par là, même si cela fait débat, qu’il me paraît assez naturel que seules la police nationale et la gendarmerie devraient pouvoir être armées.

C’est la condition sine qua non pour que l’usage de la force reste exceptionnel, dûment contrôlé et bien encadré, grâce, notamment, à la formation des agents de police et des gendarmes.
La police municipale, quant à elle, peut naturellement compléter l’action de la police nationale. Ses tâches sont multiples : accueil des administrés, sécurisation des entrées et des sorties d’école, police des marchés ou des cimetières, urbanisme, lutte contre le bruit, défense de l’environnement, stationnement payant, régulation de la circulation routière, etc. C’est une police du quotidien à laquelle on peut aussi assigner des objectifs de police de proximité.
Il faut profiter des compétences et de l’expertise de cette police, qui, au plus près des citoyens, a une excellente connaissance des quartiers et instaure une relation de confiance avec les habitants. À cet égard, il est important de laisser l’initiative aux policiers de terrain pour construire cette relation et réaliser cette osmose avec la population. La fonction de la police municipale est d’assurer la tranquillité et la salubrité de l’espace public dans le périmètre de la municipalité.
Dans le cadre des missions que j’ai évoquées, il ne me semble pas du tout nécessaire que la police municipale soit armée. Ses agents ne devraient pas être autorisés à porter d’arme à feu, de pistolet à impulsion électrique ou de Flash-Ball ; en revanche, ils doivent pouvoir être dotés de protections individuelles adaptées, car il ne s’agit bien évidemment pas de mettre en danger ces policiers.
Vous l’aurez compris, je plaide pour une police municipale de terrain qui ne soit ni un « sous-produit » ni un « concurrent » de la police nationale. Sur ce point, le flou ne doit pas être entretenu. Aussi, je me permets de vous interpeller, monsieur le ministre, afin de savoir si vous comptez définir clairement les missions prioritaires et l’identité de la police municipale.
Bien que j’estime que cette dernière n’a pas vocation à se renforcer à outrance au détriment de la police nationale, je crois toutefois qu’il faut lier ce débat, dans ses aspects non seulement juridiques, mais également budgétaires, à celui sur la vidéosurveillance.
Même si, en tant que rapporteur spécial de la mission « Sécurité », je ne suis pas parvenu, lors de l’examen de la loi de finances pour 2012, à rallier une majorité de mes collègues à ma cause sur cette question, je demeure très critique vis-à-vis de la vidéosurveillance et c’est pourquoi je salue la diminution des crédits qui y sont consacrés.
M. le ministre s’étonne.

Je précise, ministre le ministre, puisque je vois votre étonnement, que je parle du volume global des crédits en faveur de la vidéosurveillance, et non des crédits d’État, lesquels ont été maintenus.
La vidéosurveillance représente un gouffre financier pour les communes qui doivent assurer le coût des investissements, de maintenance et de visionnage des images par des agents, lesquels ne sont plus, de fait, sur le terrain. Et tout cela, au final, pour quelle efficacité ? Aucune étude ne la démontre, ce qui rend l’efficience de cette politique somme toute discutable et contestable.
Je vous avoue également ma crainte quant à une intrusion du privé dans le domaine de la sécurité. Dans mon rapport de 2011, j’alertais le gouvernement de l’époque sur les conséquences de la RGPP sur le niveau de sécurité garantie par les forces de l’ordre. Je soulignais le risque d’une « privatisation rampante » de la sécurité, faute d’un État ayant les moyens de répondre par lui-même aux attentes légitimes de nos concitoyens.
À cet égard, je me réjouis que le ministre ait mis fin à cette logique en renforçant les effectifs.
Ni la police municipale ni les activités privées de sécurité ne sont destinées à combler les manques de la police nationale ou de la gendarmerie. L’encadrement de la sécurité privée doit d’ailleurs être renforcé.
Je conclurai mon propos en évoquant quelques pistes d’évolution.
Pourquoi ne pas créer des écoles interrégionales de police municipale dirigées par les délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT ? Pourquoi ne pas mettre en place un corps d’inspection des polices municipales ? Enfin, il serait bon de mutualiser davantage les moyens des polices municipales au sein des intercommunalités et, à cette fin, de conduire une réflexion sur la cohésion territoriale, sur ce qu’on pourrait appeler l’« aménagement de la sécurité » par analogie avec l’aménagement du territoire. En la matière, même si le débat progresse, il n’est pas tranché.
En espérant avoir exposé de manière équilibrée les convictions des écologistes sur cette question, j’espère que nous pourrons avoir un échange constructif avec M. le ministre au cours de ce débat, dont je salue l’action dans ce domaine.
M. le président de la commission des lois, M. René Vandierendonck et M. Alain Fauconnier applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le code de la sécurité intérieure le proclame : « L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République […], au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens. »
Les dérives qui découlent du désengagement progressif de l’État en matière de sécurité dans nos communes touchent aux fondements mêmes de notre République, pour reprendre des termes contenus dans le rapport de nos deux collègues. J’ajoute que ces dérives et ce désengagement se sont particulièrement fait sentir quand la droite était au pouvoir, singulièrement durant le précédent quinquennat.
Nous adhérons donc totalement au constat que dressent les auteurs de ce rapport, d’autant que, à maintes reprises, notamment dans cet hémicycle, nous avons dénoncé ce désengagement et alerté sur ses conséquences.
Ce rapport a donc une résonance particulière puisqu’il est corédigé, et donc « coapprouvé », si je puis dire, par deux sénateurs de bords différents, nos collègues François Pillet et René Vandierendonck, dont je tiens saluer le rigoureux travail de fond.
Même si nous pourrions discuter en détail chacune des 25 propositions contenues dans ce rapport, le constat, établi par la gauche comme par une partie de la droite de cette assemblée, des méfaits du désengagement de l’État en matière de sécurité est de nature à nous satisfaire, dans un premier temps. Peut-être même laisse-t-il présager une évolution prochaine en la matière ! Nous l’espérons, car il serait dommage que ce travail reste « dans les tiroirs ».
Ainsi, le rapport dénonce à juste titre la diminution progressive des effectifs de police nationale au cours des dernières années et le retrait des forces régaliennes du territoire, que les maires de tous bords – je dis bien : de tous bords – soucieux de la sécurité des citoyens, sont contraints de compenser par le renforcement de leurs services de police municipale.
Nos élus constatent chaque jour les conséquences de cet abandon, qu’ils se voient contraints de pallier par diverses mesures, qui entraînent toutes, pour les budgets locaux des charges supplémentaires auxquelles ils ne peuvent souvent faire face qu’avec difficulté.
Il s’ensuit inéluctablement une aggravation des inégalités entre nos concitoyens devant la sécurité en fonction des moyens dont disposent les communes, puisque toutes ne peuvent se permettre de compenser l’absence de police nationale par l’emploi de policiers municipaux ou par le recours à la vidéosurveillance – quoi que j’en pense par ailleurs –, voire à des services de sécurité privés.
De plus, même si elles en avaient les moyens, ce ne serait pas leur rôle. La sécurité des citoyens est une mission régalienne et doit le demeurer. « L'État ne doit pas délaisser sa responsabilité éminente », dit le rapport. J’ajoute que l’argent des collectivités serait sans doute plus utile dans la construction de logements sociaux.
Le rapport souligne aussi qu’au-delà des contraintes budgétaires, le désengagement des forces régaliennes brouille les pistes et entraîne des confusions. Pour avoir reçu un très grand nombre de représentants de syndicats de policiers municipaux, je peux dire qu’ils partagent ce point de vue.
La confusion concerne d’abord les agents de police municipale, qui se trouvent, par la force des choses, contraints d’accomplir de nouvelles missions de répression dévolues en principe aux forces nationales, au détriment de leurs missions traditionnelles de prévention et de proximité, pourtant essentielles.
Mais elle s’installe aussi dans l’esprit des citoyens, entretenue par la similarité des uniformes et des équipements. Ses conséquences peuvent être très dommageables. Les habitants sont en effet conduits à penser – je m’y suis moi-même déjà trompée – que l’ensemble des policiers, qu’ils soient nationaux ou municipaux, ont pour tâche principale de combattre les crimes et délits, de rechercher leur auteur et de les livrer à la justice.
On devine la pression supplémentaire qui pèse sur les policiers municipaux face à des citoyens qui risquent de voir leurs espérances déçues du fait du décalage entre les nouvelles missions assignées aux policiers municipaux et les moyens juridiques dont ils disposent.
On devine le mal-être de ces policiers, qui, du fait des nouvelles charges qu’ils subissent, ont légitimement le sentiment de ne pas être reconnus à leur juste valeur.
S’agissant de l’armement des polices municipales, je n’y suis personnellement pas favorable, quelle que soit la nature des armes. Mais, au-delà de mon opinion, on devine que la polémique à ce sujet dissimule en réalité un débat plus large lié, là aussi, aux missions qui ne leur échoient qu’en raison du désengagement de l’État.
La seule issue à ces problèmes est une réappropriation par l’État de sa mission régalienne. En la matière, notre position est claire : la sécurité n’est pas l’affaire des municipalités, mais de l’État.
Pour éviter le développement d’une sécurité à double vitesse, je suis favorable, à l’inverse de Jean-Pierre Plancade, à la création, à terme, d’un grand service public où seraient regroupées les polices municipales, la police nationale et la gendarmerie nationale, et où le rôle des différentes forces serait clairement défini, de façon à mettre un terme à ces confusions, dans l’intérêt des citoyens comme des policiers.

Certes, mais ce n’est quand même pas tout à fait le même projet. J’espère que le débat de ce matin ouvrira la voie à un débat plus ample, qui nous permettra éventuellement de trancher la question.
Je pense que cette proposition aurait la vertu de clarifier le statut social des policiers municipaux. Elle est ambitieuse, c’est vrai, mais elle mériterait, comme d’autres propositions, dont la vôtre, d’être débattue.
Nous avons réclamé, il y a quelque temps déjà, une réflexion globale sur la police municipale. Ce travail étant maintenant impulsé par ce rapport, il reste à agir !
Nous savons, monsieur le ministre, que vous avez reçu les syndicats représentatifs des policiers municipaux. Peut-être nous apporterez-vous des éléments de réponse sur les intentions de l’État en la matière. §

Les polices municipales, avec plus de 25 000 agents répartis dans près de 4 000 collectivités, sont aujourd’hui une réalité.
Le débat idéologique sur la nécessité et l’utilité de créer une police municipale me semble derrière nous. Mais comment en vient-on à créer une police municipale ?
Dans le consensus que recueille le travail excellemment engagé par les rapporteurs, il faut rappeler une évidence qui n’est pas franchement « politiquement correcte ». On crée une police municipale quand on constate qu’à défaut, on ne disposera d’aucun autre moyen pour assurer une présence supplémentaire et répondre aux attentes de la population. L’essor des polices municipales tient au fait que l’espoir de voir les effectifs de police nationale ou gendarmerie augmenter a disparu. J’ai créé, il y a quatre ans, une police municipale dans ma ville du Bourget, et je n’imagine pas un instant revenir à la situation antérieure, car il s’agit d’une présence et d’un moyen supplémentaires que l’État ne peut fournir.
Pour la population, les policiers municipaux s’inscrivent dans la réalité locale, et font partie du paysage communal. Leur absence, ou plutôt leur non-visibilité, dans les rues de nos villes suscite l’interrogation et, parfois, le mécontentement. Cela prouve l’utilité de ces agents territoriaux au service de la tranquillité publique.
La police municipale est aussi nécessaire à la politique du maire, à l’exécution des arrêtés municipaux qu’il prend au titre de ses pouvoirs de police. Avec l’extension de leurs missions, les polices municipales sont devenues à la fois un outil de la politique de cadre de vie des maires et, surtout, de la politique de prévention de la délinquance. En quelques années, parce qu’elles se sont professionnalisées, elles se sont imposées comme des acteurs de premier plan dans les dispositifs locaux de sécurité publique.
Il est utile que le Sénat ouvre ce dossier avec pragmatisme, car il ne s’agit pas de révolutionner l’existant.
Comme le notent les rapporteurs, que nous remercions d’avoir lancé ce débat, il n’y a pas une police municipale mais des polices municipales, ce qui se traduit sur le terrain par une grande diversité de pratiques et de missions des agents municipaux. Qu’y a-t-il de commun, en effet, entre le policier municipal d’une commune rurale, qui s’occupe principalement du respect des règles de stationnement et dont les fonctions rappellent un peu celles du garde champêtre, et celui de la ville de Nice, qui travaille au sein d’un service de 578 agents armés, équipé d’un centre de supervision urbaine de vidéosurveillance et dont les missions viennent en appui de celles des forces nationales ?
En Île-de-France, les polices municipales, par leur forte présence au cœur de l’agglomération parisienne et par la diversité et l’étendue de leurs missions, sont devenues des acteurs essentiels de la sécurité. Plus d’un tiers des communes sont aujourd’hui équipées d’une police municipale.
Je pense qu’il est important que la police municipale conserve cette proximité avec la population, en étant présente sur le terrain et en contact avec les habitants, pour des actions de prévention, auxquelles il faut cependant se garder de cantonner les policiers municipaux.
Reconnaître le travail des polices municipales, c’est reconnaître que la médiation et la connaissance des intervenants de toutes sortes, y compris des fauteurs de troubles, sont très précieuses lorsqu’il est nécessaire de comprendre ce qui se passe, par exemple après des échauffourées. La police municipale connaît le terrain.
De par mon expérience locale, pas plus que nos rapporteurs, je ne suis favorable à ce que l’on change radicalement le cadre législatif existant. Il laisse en effet aux maires les marges de manœuvre nécessaires pour définir le rôle et les missions de la police municipale. Cette souplesse et cette liberté permettent à chaque maire de fixer la politique de sécurité qu’il entend mettre en œuvre dans sa commune, en fonction des problématiques locales de sécurité et ainsi d’apporter une réponse adaptée aux réalités locales.
Cela étant, les polices municipales ne sont pas « la » solution : elles ne constituent qu’un élément d’efficacité supplémentaire. Leur développement ne remplacera pas l’État dans son rôle nécessaire. Si les polices municipales sont utiles, ô combien, elles ne sauraient cependant servir de prétexte à un désengagement de l’État.
Bien entendu, le contrôle de l’État est nécessaire et le rôle du préfet est important puisqu’il lui revient d’agréer et assermenter les policiers municipaux, ainsi que d’autoriser le type d’armement souhaité par le maire.
S’agissant de l’armement il faut se garder d’une approche idéologique et privilégier, là encore, une vision pragmatique. Exposer des agents exige de se donner les moyens d’assurer leur sécurité. Il faut faire confiance aux maires et examiner cette question à l’aune des situations et des caractéristiques de chaque territoire.
L’armement relève principalement de la doctrine d’emploi des policiers municipaux. Dans ma commune de la banlieue parisienne, l’armement de 4e catégorie des policiers municipaux est nécessaire pour assurer leur propre sécurité. Le type de délinquants auxquels ils peuvent être confrontés et les missions qui leur sont confiées justifient qu’ils portent ce type d’armement. Mais je comprends que des maires, confrontés à d’autres réalités dans leur commune, choisissent de ne pas armer leur police municipale ou de l’équiper uniquement de tonfas et de bombes lacrymogènes.
C’est pourquoi, à mon sens, il est bon que ce soit le préfet qui accorde l’armement de la police municipale, sur demande motivée du maire, et par autorisation individuelle des agents, pour des missions définies. C’est là une garantie contre de possibles dérives.
Il faut aussi, de ce point de vue, renforcer la formation des policiers municipaux. Je souscris aux propositions inscrites dans le rapport relatives au renforcement de l’entraînement annuel au tir pour les agents équipés d’une arme de 4e catégorie et à la formation à l’utilisation du bâton de défense.
Plus globalement, et le rapport l’évoque longuement, il faut poursuivre la professionnalisation des policiers municipaux par une formation de qualité plus adaptée à la diversité des fonctions qu’ils sont amenés à exercer, comme le demandent leurs représentants professionnels. En tant que maires, nous avons tout à gagner à disposer d’agents mieux formés et mieux encadrés.
Quant à la vidéoprotection, elle me semble aujourd’hui essentielle dans la lutte contre la délinquance. Les polices municipale et nationale peuvent ainsi cibler leur présence sur le terrain et leurs interventions dans les zones les plus sensibles. La vidéosurveillance est un élément capital dans une politique de sécurité efficace, et c’est un moyen, un moyen seulement, mais un moyen important, de réintroduire de la proximité dans l’action globale de nos polices.
En outre, la vidéosurveillance constitue un bon instrument pour faire travailler ensemble police nationale et police municipale, l’une utilisant, pour mener à bien des enquêtes de police judiciaire, les images transmises et exploitées par l’autre. Elle autorise un diagnostic partagé de la délinquance et donc la mise en œuvre d’un travail commun quotidien appuyé sur la cartographie et la géolocalisation des délinquants. C’est en tout cas une des voies possibles.
Cela me permet d’aborder la question de la coordination des actions entre la police nationale et la police municipale. On le constate à la lecture du rapport, les relations entre forces régaliennes et agents de police municipale sont un sujet majeur et récurrent de préoccupation pour les élus et les représentants des policiers municipaux. Elles sont visiblement parfois sources d’insatisfaction. Je souhaite témoigner du contraire : dans ma ville du Bourget, la police municipale travaille en parfaite entente avec la police nationale, sous son contrôle et son autorité, celle du préfet et celle du parquet. Cette entente nous permet de faire face à la délinquance en échangeant, dans le cadre réglementaire, les informations nécessaires et en menant des opérations communes quand la situation l’exige.
C’est, chez nous, en Seine-Saint-Denis, une nécessité et un accélérateur d’efficacité. Si les forces de l’ordre nationales et municipales ont leurs missions respectives dans le maintien de l’ordre public, il faut trouver les voies et moyens pour favoriser leur complémentarité sur le terrain.
Je crois que ces bonnes pratiques, lorsqu’elles sont mises en œuvre, constituent un acquis qui demeure ensuite au-delà des changements d’hommes. Quand cela fonctionne bien, c’est très efficace. Ainsi, dans ma modeste commune de 15 000 habitants, nous avons réussi en trois ans à faire baisser la délinquance de 20 %. Cela correspond à la période de mise en place de la police municipale, et le préfet Lambert nous a lui-même indiqué qu’elle avait joué un rôle majeur dans ce succès, aux côtés des forces de police nationale.
Nous avons donc retrouvé le terrain et recréé de la proximité, peut-être même recréé la police de proximité ! Mais les mots comptent peu au regard de la réalité des chiffres. En Seine-Saint-Denis, l’enjeu majeur est de travailler ensemble pour faire face au défi de la délinquance ; je sais que le préfet veille à ce qu’il en soit ainsi.
Compte tenu de la diversité des polices municipales, il pourrait être utile de partager les expériences de terrain. D’aucuns ont évoqué la création, au ministère, d’un bureau qui serait un « lieu ressource » ou un « lieu référence », d’autres, une académie des polices municipales, qui pourrait être gérée par le monde territorial. Ces voies méritent d’être examinées, dès lors qu’est respectée l’autonomie des collectivités locales.
Comme le souligne le rapport d’information, la coopération n’est pas parfaite, du fait de l’existence de certains freins juridiques. Les améliorations pratiques proposées par nos collègues, qui reprennent d’ailleurs les demandes récurrentes des syndicats de policiers municipaux et des élus, vont dans le bon sens : un accès direct aux fichiers routiers et une amélioration des communications entre les différentes forces de sécurité, qui est une question majeure.

Il est nécessaire que le poste de police dispose au moins d’une radio afin que les policiers municipaux sachent ce qui se passe dans la circonscription.

Ils ont, par exemple, besoin de savoir qu’une opération dangereuse est menée, car des délinquants armés circulent dans la ville. À défaut, les policiers municipaux travaillent à l’aveugle et il peut en résulter, on l’a vu, des événements tragiques. Certes, ce n’est pas simple de mettre en œuvre cette logistique, mais il faut y travailler, car, en la matière, ce problème constitue une véritable inquiétude pour les maires, et la responsabilité de chacun est engagée.
L’extension de la liste des contraventions pouvant être verbalisées par timbre-amende ou encore l’autorisation d’effectuer des contrôles préalables en matière routière sont également évoquées dans le rapport d’information de nos collègues.
Monsieur le ministre, vous aurez compris la philosophie qui m’anime : ne modifions pas ce qui fonctionne bien ; n’imaginons pas une révolution qui n’aurait pas de sens et qui ne nous conduirait sans doute nulle part ; renforçons la police nationale et la gendarmerie nationale ; ayons conscience que le vieux modèle, dans lequel la police nationale et la gendarmerie œuvraient seules, laisse tranquillement place, sous le contrôle de l’État, à la complémentarité nouvelle qui se fait jour avec les polices municipales ; accompagnons ce mouvement de manière pragmatique ; enfin, regardons avec tout l’intérêt qu’il mérite le rapport d’information de la commission des lois et engageons-nous dans l’étude de la mise en œuvre des mesures suggérées. Tel est en tout cas le vœu que je forme, monsieur le ministre. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens avant tout à saluer l’excellente qualité du rapport d’information de nos deux collègues.
Mon intervention se placera dans le cadre des discussions faisant suite aux propositions de ce rapport, mais je m’attacherai aussi à faire remonter mon expérience de terrain forgée depuis plusieurs années dans l’exercice de mes mandats d’élue locale.
Ville de province de 75 000 habitants, Calais est doté d’une police municipale, dont je partage la vie quotidienne et dont, surtout, j’assume la responsabilité. C’est pourquoi je puis, à l’instar d’autres collègues, livrer une vision issue directement du terrain.
De 5 600 agents en 1984, les effectifs des polices municipales françaises sont passés à plus de 18 000 aujourd’hui. Aussi était-il inévitable que la police municipale connaisse une véritable « crise d’identité », qui est bien évidemment liée à une « crise de croissance », comme nos collègues l’ont souligné dans leur rapport d’information.
La publication de ce rapport parlementaire et la tenue de ce débat au Sénat sont les bienvenus, car ils vont permettre d’avoir une nouvelle vision de nos polices municipales et de leur proposer un nouvel avenir. Les clivages politiciens peuvent, en la matière, laisser la place à l’expérience locale des collectivités, que la Haute Assemblée a vocation à représenter.
Je veux vous faire part de mes convictions, dont plusieurs sont partagées par MM. Pillet et Vandierendonck dans leur rapport.
La crise d’identité et de croissance que vit la police municipale est liée à un véritable paradoxe qu’il appartient aux responsables politiques de résoudre. Le boom des effectifs depuis vingt-cinq ans montre bien l’engouement des élus et des populations pour ce service public. Qui imaginerait aujourd’hui s’en passer ? Le caractère indispensable des polices municipales est devenu évident. L’attachement des populations a sans doute été révélé aux yeux de tous, sur le plan national, lors du décès, il y a deux ans, de l’agent de police Aurélie Fouquet, qui avait suscité une très vive émotion dans le pays.
Le geste symbolique de Nicolas Sarkozy, alors Président de la République, d’assister aux obsèques de la jeune policière municipale, comme le chef de l’État peut le faire pour des soldats, était bien en phase avec le sentiment de grande considération que porte la société française à ses policiers municipaux.
Toutefois, demeure un flou permanent sur les missions des policiers municipaux, ce qui explique, en bonne partie, la regrettable mésestime dont ils font l’objet de la part de certains : des fauteurs de troubles, bien sûr, mais aussi, parfois, en tout cas trop souvent, de leurs homologues de la police nationale.
La clarification des missions doit répondre à cette crise d’identité, qui pourrait devenir une crise de confiance si nous n’y prenions garde. Pour apporter à nos policiers municipaux toute la confiance qu’ils méritent, il faut revaloriser leur rôle, ce qui va de pair avec une grande exigence à l’égard de ce corps de métier.
Cela passe, sans aucun doute, par la création d’une véritable « filière sécurité » au niveau local.
Appelé « police territoriale », ce corps pourrait avantageusement réunir les agents de police municipale avec les ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, et les gardes champêtres, sans pour autant mélanger leurs prérogatives.
Concernant les ASVP, il s’agirait ni plus ni moins que d’entériner ce qui se fait déjà dans bon nombre de communes. À Calais, par exemple, les agents de surveillance de la voie publique sont sous la responsabilité directe du chef de la police municipale.
Le bon sens commande en effet que les deux corps, amenés à coopérer en permanence sur le terrain, et qui sont d’ailleurs souvent basés dans les mêmes locaux, puissent être officiellement coordonnés sous la même houlette.
Pour les gardes champêtres, ce serait, en revanche, une innovation, mais elle serait en cohérence avec une réforme possible proposée dans le rapport, qui est, elle aussi, intéressante ; je veux parler de la création d’une police intercommunale. Cette possibilité ne doit en rien devenir une obligation : elle doit être laissée au libre choix des communes et des intercommunalités. Toutefois, elle peut s’avérer utile pour mutualiser les moyens entre les petites communes rurales périphériques et les centres urbains.
Les petites communes n’ont ni les moyens ni le besoin d’entretenir des effectifs importants de police municipale. Mais elles peuvent avoir occasionnellement besoin d’une mise à disposition d’agents, par exemple lors de l’organisation d’événements festifs ou culturels.
La création de cette « filière sécurité » au niveau communal doit s’accompagner d’une clarification des relations entre police municipale et police nationale.
Source de malentendus fâcheux, la situation actuelle n’est pas satisfaisante et ne permet pas de créer une entente optimale entre les deux polices. Les policiers municipaux se sentent encore parfois considérés, à tort, comme des policiers de seconde zone.
La police municipale doit devenir notre véritable police de proximité. Sans tomber dans une polémique facile, nous pouvons tous aujourd’hui reconnaître, me semble-t-il, que cette mission spécifique de proximité ne peut être dévolue à la police nationale.
La police nationale a ses missions, et c’est son honneur de les assumer. La police municipale doit avoir les siennes, et il se trouve qu’elle est particulièrement bien placée pour les remplir au plus près des habitants.
N’étant pas soumis aux règles des classements et des mutations, les policiers municipaux sont presque toujours recrutés localement, ce qui favorise leur intégration dans le tissu social. Souvent bien connus des habitants, ils sont un atout important pour le renseignement et sont un élément de cohésion sociale dans nos quartiers. Ce rôle doit donc être pleinement reconnu, ce qui suppose l’attribution des moyens nécessaires, en bonne entente avec la police nationale.
Certes, des conventions de coordination existent, mais les mentalités ont la vie dure, et certaines procédures ne sont pas de nature à créer les conditions d’une collaboration qui pourrait pourtant devenir excellente.
Je prendrai l’exemple de l’accès au fichier des cartes grises, qui, nous le savons tous, n’est pas ouvert directement aux policiers municipaux, alors qu’ils en ont besoin au quotidien. Cela crée une situation de dépendance des policiers municipaux vis-à-vis des policiers nationaux, les premiers étant contraints de solliciter les seconds pour obtenir les informations. Il est pourtant indispensable d’obtenir ces éléments le plus rapidement possible pour la mise en fourrière d’un véhicule ou pour contrôler un automobiliste, par exemple. Cette dépendance est évidemment néfaste à tous, car elle est aussi source d’une inutile perte de temps pour les policiers nationaux. C’est pourquoi l’accès aux fichiers routiers doit être ouvert rapidement aux polices municipales.
Nous devons aussi penser à simplifier les procédures qui alourdissent le travail des agents. En leur permettant de verbaliser sur-le-champ les contrevenants aux arrêtés du maire, sur le modèle des infractions au stationnement, nous ferions gagner un temps précieux aux policiers municipaux.

Concernant la question du port d’armes, il nous faut avoir une position mesurée, dénuée d’idéologie.
Le port d’armes peut se justifier dans certaines villes, tandis qu’il n’est pas nécessaire dans d’autres.

Bien entendu, dans des villes où la délinquance sévit fortement, le port d’armes peut être un élément d’intimidation et de protection pour les policiers municipaux. À Calais, ville où la délinquance est maîtrisée, mais qui subit la présence journalière des migrants, …

… je n’ai, pour ma part, pas jugé utile, pour l’instant, de mettre en place le port d’armes pour nos 21 agents.
Par ailleurs, la clarification du rôle des polices municipales doit aller avec la valorisation de celles-ci.
Les revendications sociales des agents sont naturellement légitimes quand il s’agit d’aligner sur le modèle des policiers nationaux l’intégration des primes dans le calcul des cotisations pour la retraite. Cette réforme de l’indemnité spéciale de fonction doit être un objectif. Elle pourrait cependant être, il faut en être conscient, un coût pour les communes. Y aura-t-il une contribution au niveau national ? Je profite de ce débat pour vous interroger, monsieur le ministre, sur cette question. La ville de Nice a les moyens d’assurer cette dépense, mais tel n’est pas le cas de la ville de Calais !

Or il s’agit bel et bien de la sécurité de tous ! Les communes les plus pauvres font des efforts en la matière et voudraient même faire plus, mais elles ne le peuvent, faute de disposer d’un budget le leur permettant.
Je suis favorable à l’idée de faciliter l’accès au statut du cadre A des chefs de police municipale, alors que le titre de directeur n’est aujourd'hui donné qu’à partir d’un effectif de 40 agents.
Par ailleurs, j’ouvrirai une parenthèse sur un éventuel changement de la couleur des uniformes, qui m’inspire les plus expresses réserves.
En effet, les uniformes des agents ont déjà été modifiés en 2003, …

… précisément pour les différencier des policiers nationaux et des gendarmes.
Sans parler du coût inutile que cela entraînerait, supprimer le bleu n’est pas, à mon avis, une bonne idée : dans l’esprit de nos concitoyens, c’est la couleur de la sécurité. De plus, certains y verraient une vexation.
En contrepartie des avancées que nous devons mettre en place pour garantir les missions des polices municipales, nous devons aussi avoir une grande exigence dans l’accomplissement de leurs missions. En termes de formation professionnelle, mais aussi dans le contrôle du travail réalisé, la plus grande rigueur est de mise.
En conclusion, je formerai simplement le souhait de voir émerger de ce débat un consensus entre la droite et la gauche. Le Sénat est l’assemblée des collectivités locales ; il nous revient donc de nous saisir de cette réforme indispensable de la police municipale en France. Le rapport d’information de nos collègues est une première étape. Il faut que notre débat soit la base d’un grand consensus national des élus locaux pour une police municipale française mieux identifiée et revalorisée, et ce dans l’intérêt de tous.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. René Vandierendonck applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, beaucoup a déjà été dit et ce débat a été jusqu’à présent relativement consensuel. Pour ma part, je m’attacherai à présenter des propositions qui le seront peut-être un peu moins, en espérant qu’en tout cas elles provoqueront l’étonnement.
Doit-on vraiment se poser la question de savoir s’il existe une police municipale ou des polices municipales quand le nombre de policiers par commune varie de un à plus de cinq cents, comme l’ont souligné nos excellents collègues MM. Pillet et Vandierendonck ? En tout cas, les services de police municipale sont composés de personnels très différents : des ASVP, des gardes champêtres, des policiers municipaux.
Faut-il mettre en place une seule filière de la sécurité territoriale, harmoniser les carrières et offrir des perspectives différentes aux uns et aux autres ? Sans doute. Ces objectifs semblent faire consensus et, à cet égard, je suis d’accord avec les orateurs qui m’ont précédée.
Pour ce qui concerne l’idée de distinguer les différentes forces de sécurité par leur uniforme, notamment par sa couleur, ma position est un peu plus nuancée que celle de Mme Bouchart. Je pense que des évolutions pourraient être imaginées en fonction des missions confiées aux policiers municipaux, pour s’en tenir à l’appellation actuelle.
Par exemple, quand un policier municipal est chargé de la gestion des conflits de voisinage, qu’il est présent sur le marché ou qu’il est un interlocuteur de concertation et de négociation tout en représentant l’autorité, il est sans doute important qu’il porte un uniforme. Faut-il pour autant que, par sa couleur et sa forme générale, cet uniforme se confonde dans l’esprit des citoyens avec celui des forces de sécurité chargées de missions plus répressives ? On peut se poser la question.
Je ne sais pas s’il faut un seul ou uniformes, mais je partage l’avis de Mme Bouchart sur le problème des coûts. Prenons garde à ne pas alourdir les coûts pour les collectivités territoriales !

Je vous rappelle que nous avons remplacé les uniformes, les voitures, etc., il y a peu de temps ; il n’est peut-être pas nécessaire de recommencer de façon arbitraire et précipitée.
Lorsqu’on examine les missions confiées aux policiers municipaux, quelle variété l’on découvre ! À la vérité, il existe à peu près autant de missions différentes que de collectivités territoriales disposant d’une police municipale.
Certaines missions sont confiées de façon assez générale aux policiers municipaux là où ils existent : la police funéraire, la surveillance des marchés, la tranquillité publique et le contrôle du stationnement, mais aussi la prévention dans les écoles et les collèges, par exemple en matière d’éclairages de vélos.
Il existe aussi des missions spécialisées, qui dépendent des situations locales et des habitudes de travail différentes selon les endroits. C’est ainsi que, dans certains cas, les missions sont fortement orientées vers l’environnement, les policiers municipaux et les gardes champêtres travaillant au sein de brigades vertes, de brigades à cheval, de brigades avec chiens ou d’équipes de plongée.
Les interlocuteurs de nos policiers municipaux sont aussi multiples que leurs fonctions et missions : citoyens contents ou, plus souvent, mécontents, commerçants, délinquants, bailleurs sociaux, acteurs du transport routier et des transports collectifs publics. N’oublions pas les interlocuteurs du monde de la sécurité car, comme plusieurs orateurs l’ont déjà signalé, les policiers municipaux sont un maillon parmi d’autres de la sécurité. Dans ce cadre, ils ont affaire aux gendarmes et aux policiers nationaux, ainsi qu’aux pompiers, car ils interviennent aussi dans le domaine de la sécurité civile, par exemple lors des accidents de la route.
À cette multiplicité des missions et des interlocuteurs doit correspondre une multiplicité d’équipements. La question de l’armement a déjà été soulevée, mais il faut considérer l’ensemble des équipements mis à la disposition des policiers municipaux, qui peuvent être très variés.
C’est précisément sur ce continuum de la sécurité que s’arrête le consensus : les avis diffèrent sur la question des limites entre les missions des uns et des autres, des zones de chevauchement, des zones de partage ou de « départage » des responsabilités.
René Vandierendonck nous a présenté des exemples de mutualisations opérationnelles réussies. Sans doute y en a-t-il. Reste que, si l’on veut en multiplier le nombre, il faut que les hommes et les femmes concernés partagent un minimum de culture professionnelle et que les mots aient la même signification pour les uns et pour les autres !

Monsieur Plancade, je ne peux pas être d’accord avec votre idée de décentraliser la police nationale.
Voilà quelques heures, M. le Premier ministre s’est adressé à des élus de terrain, parlementaires de gauche. Étant moi-même maire d’une petite commune, membre du bureau de l’association des petites villes de France et ayant toujours siégeant sur la gauche de cet hémicycle depuis que je suis élue au Sénat, j’ai cru pouvoir me reconnaître dans ceux devant qui s’exprimait le Premier ministre. Or je l’ai entendu dire très précisément que nous devions nous garder d’empiler des mesures comme cela avait pu se faire sous les gouvernements précédents. Puisque nous savons où nous voulons emmener le pays, nous ne devons pas avoir peur des grandes réformes de fond.
Alors, mes chers collègues, n’ayons pas peur des grandes réformes de fond en matière de sécurité !

Ce continuum de la sécurité, par quel côté faut-il l’aborder ? Monsieur le ministre, je vous suggère de l’aborder sous l’angle de la formation, en créant une véritable filière des métiers de la sécurité. Certes, des assises de la formation de la police nationale seront organisées le 7 février prochain, mais cela n’est pas suffisant.
Certains ont aussi lancé l’idée de créer une grande école de la police municipale ou des polices territoriales. Cela ne suffit pas non plus. En matière de sécurité, aucun acteur ne peut rester tout seul sur son îlot, comme dans une tour d’ivoire. Le partage des compétences, les zones de chevauchement et de « départage » des missions doivent faire l’objet d’un examen attentif.
Monsieur Vandierendonck, il est vrai que le CNFPT existe. Reste qu’il ne pourra jamais être l’unique interlocuteur de l’État en matière de formation aux métiers de la sécurité.
Prenons l’exemple de l’armement. Oui, le maire doit être responsable de la décision d’armer ou non sa police municipale, en fonction de la situation locale. Seulement, à partir du moment où l’on confie une arme, quelle que soit sa catégorie, à un homme ou à une femme, il faut avoir la garantie que cette personne a reçu la formation et acquis les compétences qui lui permettent de savoir utiliser et ne pas utiliser son arme.

Il faut mettre en place une grande filière des métiers de la sécurité avec différents niveaux : une formation généraliste au niveau du BEP ou du baccalauréat et des spécialisations préparant aux différents métiers.
Dans ma commune, j’ai récemment recruté un policier municipal. Plus de 80 % des candidats qui se sont présentés étaient d’anciens gendarmes ou d’anciens policiers nationaux qui n’avaient aucune idée de ce qu’est le métier de policier municipal !
Il faut donc une formation, qui comporte à la fois des enseignements communs et des modules spécialisés. L’État doit garantir l’égalité des compétences acquises par les personnes en charge de la sécurité, qu’il s’agisse de policiers municipaux ou de policiers nationaux.
Monsieur le ministre, ce projet est sans doute ambitieux, mais j’ai cru comprendre hier que M. le Premier ministre souhaitait aller dans le même sens. Le défi est passionnant et les enjeux sont majeurs. En outre, un marché existe, puisque l’État pourrait « vendre » la formation aux métiers de la sécurité aux acteurs privés du secteur. De cette façon, nous aurions la garantie qu’un agent de sécurité privé possède, lui aussi, un « prérequis », des compétences minimales en rapport avec ses missions et ses responsabilités.
L’organisation par l’État d’une grande filière des métiers de la sécurité me semble un projet extrêmement intéressant et ambitieux. J’espère qu’il ouvrira des perspectives à notre débat.
Pour terminer, je tiens à rendre hommage à tous les policiers municipaux de France, qui ont parfois bien du mal à se retrouver dans leur propre métier compte tenu des tâches différentes qui leur sont confiées d’une commune à l’autre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. René Vandierendonck applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, comme tous les orateurs qui se sont succédé à cette tribune, je suis satisfait du rapport d’information consensuel de MM. Pillet et Vandierendonck, qui est exhaustif, fouillé et construit. Leurs très nombreuses propositions rejoignent le vœu que j’ai moi-même formulé plusieurs fois depuis le début de cette mandature : celui de voir la police municipale évoluer et être beaucoup plus largement reconnue par la société.
La police municipale existe, nous l’avons rencontrée. Elle compte aujourd’hui 18 000 agents – 27 000, en comptant les gardes champêtres et les ASVP –, alors qu’ils étaient seulement 5 600 en 1984. On voit bien que cette « accélération de l’histoire » vient du besoin et de l’attente qui existent dans notre pays. Aussi bien parmi la population que parmi les élus, cette demande de sécurité est forte et consensuelle ; on ne peut pas l’ignorer. Nous, les maires, essayons de satisfaire les demandes de nos concitoyens.
Aujourd’hui, nous reprenons à notre compte la formule du précédent Président de la République, qui avait parlé, à propos de la police municipale, de la « troisième force de sécurité en France ».
La police municipale, dont je viens de dresser l’état des lieux, quelles missions exercent-elles ? Le rapport d’information fait le constat d’une extrême diversité entre les missions du garde champêtre de village, celles des policiers d’une petite ville, qui sont peu nombreux, ne travaillent que de jour et ne sont pas armés, et celles de la police d’une grande ville.
À Nice, j’ai 602 personnes : 380 policiers municipaux, 150 agents de surveillance de la voie publique et 72 agents administratifs. La ville compte 10 postes de police municipale et 750 caméras. Grâce à l’action de la police municipale, 2 678 interpellations ont été menées en 2012.
Notre collègue Jean-Vincent Placé pourra constater que ses doutes sur l’efficacité de la police municipale sont contredits ! D’ailleurs, l’efficacité de la police municipale à Nice est si grande que la police judiciaire procède quasiment à deux réquisitions par jour. Monsieur le ministre, que 621 réquisitions d’officier de police judiciaire aient eu lieu en une année dit assez combien le travail de la police municipal est remarquable. J’ajoute que son action bénéficie d’un soutien populaire tout à fait large.
Le constat de l’extrême diversité des missions assurées par la police municipale justifie que nous conservions sa capacité à s’adapter aux situations locales. Le maire doit demeurer libre de définir les missions de la police municipale, dont je répète qu’elle est la seule à maîtriser les spécificités de la commune, les services de l’État ayant généralement des périmètres d’action plus larges. Méfions-nous donc des normes et des autres dérives technocratiques qui pourraient nous arriver d’en haut.
L’action de la police municipale, qui est toujours une police de proximité, repose sur deux socles : une mission de prévention, de tranquillité publique et d’aide, mais aussi, en fonction de l’environnement local, une mission de répression plus ou moins développée, complémentaire de l’action de la police nationale.
Compte tenu de l’état des finances publiques et de la judiciarisation des forces de l’État, un risque de dérive existe, signalé par le rapport d’information et par de nombreux maires. Je rappelle, quant à moi, que la police municipale doit rester par excellence une police de proximité et qu’elle n’a pas vocation à remplacer la police nationale ou, pis, à lui faire concurrence : l’une et l’autre sont complémentaires.
Dans le cadre que je viens de tracer, nous considérons que la police municipale, pour être encore plus efficace au service de nos concitoyens, doit disposer de tous les moyens dans son domaine de compétence actuel, et seulement dans ce domaine.
Alors, quelles améliorations apporter ? Plus que le sénateur, c’est le maire d’une ville de 50 000 habitants comptant plus de 70 personnes travaillant pour la police municipale qui s’exprime ici.
J’ai un avis globalement positif sur les propositions qui ont été émises. Toutefois, concernant le transfert à l’intercommunalité – la proposition 14 –, je mettrai tout de suite un bémol. Je rappelle, en effet, que le pouvoir de police administrative constitue le noyau dur des compétences du maire ; M. le ministre de l’intérieur le sait parfaitement pour avoir été maire, lui aussi. Toucher à ce noyau dur peut donc, à long terme, déstabiliser l’avenir de la commune elle-même.
À Nice, avec le président Christian Estrosi, que je tiens à remercier publiquement, alors que notre intégration est la plus complète qui soit, puisque nous faisons désormais partie d’une métropole, après nous être posé la question, nous n’avons pas voulu entrer dans une démarche susceptible d’aboutir à la limitation des pouvoirs des maires. C’est dire que, nous aussi, nous avons trouvé un modus vivendi, mais, monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec beaucoup d’attention.
Dans le cadre du groupe de travail sur la police municipale qui doit être mis en place par M. le ministre, je souhaite que cette question soit effectivement abordée, là encore sans idéologie, avec un examen cas par cas. Nous nous ferons ensuite notre religion !
Nous n’avons donc pas fait de transfert chez nous, mais je reste ouvert, à condition que l’on ne s’aventure pas à toucher à ces pouvoirs de police administrative qui me paraissent encore fondamentaux, surtout si l’on va vers plus d’intégration, d’intercommunalité.
J’en reviens aux propositions du rapport.
Il est évident qu’il faut améliorer la coopération avec les forces nationales ; je parlais d’ailleurs de complémentarité. Dans ma commune, une nouvelle convention de coordination est en discussion. Cette proposition ne nous pose donc aucun problème, bien au contraire, car nous estimons que nous devons travailler de manière transversale. Je le dis au ministère : il faut, dans les conventions en cours d’élaboration, éviter qu’il y ait des transferts unilatéraux de charges au détriment des communes. À cet égard, il y a peut-être des choses à revoir...
Pour bien fixer cette complémentarité, nous allons acheter un logiciel afin d’établir une cartographie avec la police nationale, pour nous entraider mutuellement et défendre l’intérêt général.
Nous avons poussé cette démarche de sécurité et de prévention de la délinquance en définissant, puis en et signant avec le préfet des Alpes-Maritimes, le procureur de la République – le président du conseil général et le recteur étaient associés à cette opération –, une stratégie territoriale de sécurité. C’est une première dans les Alpes-Maritimes ! Nous sommes extrêmement sensibles à cette amélioration de la coopération avec la police nationale et les autres institutions.
Le chapitre III, qui vise à renforcer la spécificité de la police du maire, ne pose aucun problème. Mais encore faudrait-il renforcer la proposition 9. En effet, contrairement à d’autres intervenants, je suis favorable au port, en plus de l’arme de quatrième catégorie, d’armes non létales.

Le Flash-Ball et le pistolet à impulsion électrique nous paraissent être des armes mieux adaptées pour une police de proximité qui, heureusement pour nous tous, n’a pas besoin de sortir fréquemment un pistolet 9 mm ! En conséquence, une arme non létale…

… serait beaucoup plus appropriée dans la plupart des situations.
Le chapitre IV porte sur la valorisation des parcours professionnels. Celle-ci est bien entendu nécessaire, et je m’aligne sur les propositions du rapport, tout en formulant deux observations.
Il me semble indispensable de maintenir un seuil significatif de population pour ne pas dévaloriser le grade de directeur de la police municipale – c’est un compromis – et de renforcer la proposition 13, afin de créer – vous l’avez très bien dit, monsieur le rapporteur – un cadre d’emplois d’ASVP. Cela permettrait d’avoir une formation, …

… ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. On peut progresser sur ce point.
Concernant le chapitre V, il est indispensable d’améliorer le dispositif de formation. J’avais proposé ici même la création d’une école nationale.

M. Louis Nègre. Pourquoi pas ? C’est une excellente idée et je la reprends !
Nouveaux sourires.

Je ne suis pas totalement convaincu par votre argumentaire La proposition 14 d’un cadre d’intervention à un niveau interrégional pourrait être un compromis, sous réserve toutefois, monsieur le rapporteur, monsieur le président, que la formation du CNFPT soit réellement à la hauteur des exigences recherchées. Tout à l’heure, notre collègue a déjà fait des remarques en ce sens.
Enfin, les propositions 21 à 25 du chapitre VI sont concrètes, pragmatiques, et correspondent parfaitement à une police de proximité, certes aux pouvoirs limités, mais qui, dans ses secteurs actuels de compétence, doit, pour être efficace et ne pas encombrer inutilement l’État, disposer de tous les outils indispensables, comme l’accès aux fichiers.
Je rappelle que, contrairement aux garagistes, la police municipale n’a pas accès au système d’immatriculation des véhicules ! C’est incohérent, cela relève d’une logique ubuesque et dénote un profond mépris pour la police municipale !
Voilà les remarques que je souhaitais verser à ce débat. Je demande à l’État de ne surtout pas se désengager de la police nationale et à M. le ministre de bien vouloir faire en sorte que ce groupe de travail puisse commencer ses travaux dès que possible. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, cher Manuel, mes chers collègues, on ne le dira jamais assez, il est nécessaire de distinguer nettement les compétences et attributions de la police nationale et des polices municipales.
La police municipale dépend de l’autorité d’un maire, qui doit définir les contours et le périmètre d’intervention de ses agents sur le territoire communal. En aucun cas les agents de police municipaux ne doivent et ne peuvent se substituer à leurs homologues de la police nationale pour exercer des missions spécifiques à ces derniers.
Ainsi, la mairie qui envoie la police municipale pour des impayés de cantine se trompe sur les fonctions qui incombent à ses agents. Ces derniers doivent faire de la prévention et de la surveillance, et « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Ils ne sont pas, comme les policiers nationaux, des forces de maintien de l’ordre et ne doivent pas se substituer à la justice. Certains de nos élus et certains fonctionnaires municipaux ont tendance à l’oublier à en juger par l’évolution anarchique des missions confiées à des agents municipaux.
Il me semble donc important de rappeler qu’en France la sécurité doit rester l’affaire de l’État, car c’est une fonction régalienne, les polices municipales n’intervenant qu’en appoint de la police nationale. Elles ne reçoivent d’ailleurs pas la même formation : pour les gradés et les gardiens de la police nationale, la durée de la formation est fixée à douze mois au sein des écoles nationales de police, alors que, pour les policiers municipaux, elle est de 121 jours et est dispensée par le CNFPT. C’est la raison pour laquelle j’ai toujours été opposé à l’armement des policiers municipaux, qui accroît la confusion entre police municipale et police nationale dans l’esprit de nos concitoyens.
À ce propos, je me réjouis, monsieur le ministre, que vous ayez pris la décision de recruter davantage de policiers d’État – 6 000 au total en 2013 –, alors que le gouvernement précédent en a supprimé plus de 10 000 sur les cinq dernières années. §
Ce désengagement de l’État dans le domaine de la sécurité publique au cours du quinquennat de M. Nicolas Sarkozy a entraîné une explosion du nombre de policiers municipaux, que les maires, toutes tendances politiques confondues, ont recruté en masse pour tenter de pallier les déficiences de l’État.

Il n’y a même pas eu de concours de recrutement de gardiens de la paix en 2009 !
On estime que les policiers municipaux sont plus de 18 0000 aujourd’hui, répartis dans 3 500 communes en France. Ce phénomène pose par ailleurs un véritable problème d’égalité entre ceux de nos concitoyens qui vivent dans une commune dotée d’une police municipale et les autres.
Je pense que, au lieu de recruter davantage de policiers municipaux, comme cela s’est fait sous l’ancien gouvernement de droite, il faut plutôt donner à notre police nationale les moyens de travailler. Seuls les policiers d’État sont habilités à maintenir et à rétablir l’ordre.
À cet égard, on ne peut que se réjouir que la disposition de la LOPPSI 2 prévoyant d’attribuer la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale ait été judicieusement invalidée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011. Cette dernière limite, comme il était urgent de le faire, le champ d’évolution de ces forces.
En érigeant en principe constitutionnel le contrôle et la direction effective de la police judiciaire par l’autorité judiciaire, cette décision réduit à néant les espoirs de tous ceux qui, sous le gouvernement précédent, espéraient doter les policiers municipaux d’une compétence d’investigation, afin de réduire encore davantage les compétences de l’État dans les collectivités territoriales.
Aussi, armer la police municipale n’est pas la solution, même dans les quartiers où l’on constate une recrudescence de la violence sur les personnes. Si c’était une bonne solution, les chiffres de la délinquance seraient en baisse spectaculaire dans les communes où l’armement de la police municipale a été mis en place. Or aucune statistique ne va dans ce sens jusqu’à présent, pas même à Nice, où les atteintes à la personne ont augmenté de 4, 42 % entre juillet 2011 et juillet 2012, alors que les Alpes-Maritimes comptent 1 233 policiers municipaux armés ; ils sont plus nombreux que les gendarmes !
C’est la raison pour laquelle est nécessaire, selon moi, un recentrement des missions de la police municipale sur son cœur de métier, à savoir les tâches qui relèvent de la compétence du maire et que celui-ci lui confie, conformément à l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales : exécution des arrêtés de police du maire, constatation par procès-verbaux des infractions à ces arrêtés – par exemple en ce qui concerne la lutte contre les nuisances sonores – ou encore de délits tels que les voies de fait ou la commission de violences dans l’entrée, la cage d’escalier ou les parties communes d’un immeuble collectif. Les polices municipales sont amenées, comme je l’avais demandé à Bondy, à s’imposer comme opératrices de vidéosurveillance de l’espace public.
Aussi, les maires qui réclament les moyens nécessaires pour orienter leur appareil policier vers le flagrant délit et l’interpellation des délinquants sont, selon moi, dans l’erreur, car la cohérence des missions respectives de ces deux forces de police doit prévaloir. Il ne faut pas encourager la concurrence entre police municipale et police nationale. Il convient donc d’empêcher toute dérive et de clarifier la doctrine d’emploi des policiers municipaux, qui peinent aujourd’hui à trouver leur voie entre prévention et répression.
C’est pourquoi je soutiens le recentrement des fonctions de la police municipale sur ses missions traditionnelles liées à la tranquillité publique, celles qui contribuent à la qualité de vie en ville. Autrement dit, il me semble nécessaire de respecter de façon stricte le champ d’intervention fixé par le code général des collectivités territoriales.
Enfin, sur le plan matériel, j’ai toujours souhaité voir imposer un changement de couleur des uniformes des policiers municipaux, qui, aujourd’hui, sont trop facilement assimilés à ceux des policiers de l’État. J’y pensais encore tout à l’heure en voyant des ASVP habillés en treillis bleu et chaussés de rangers faire traverser la rue de Vaugirard aux enfants des écoles.
Par ailleurs, la similitude des sérigraphies entre les véhicules des deux polices est une mauvaise chose et contribue également à entretenir la confusion, comme ce fut le cas à Villiers-sur-Marne.
Pour conclure, je souhaite rappeler que le rôle des polices municipales n’est pas de se substituer à la police nationale ; il est de tisser des liens avec la population, selon une approche de prévention clairement assumée. §

Ce rapport d’information est construit autour de deux objectifs : améliorer le statut de la police municipale et rurale et rendre cette police plus efficace en renforçant la coopération avec les forces de police nationales. Je souhaiterais insister sur le premier objectif, et plus particulièrement sur la question de l’unification des statuts des polices locales par la création d’une police territoriale.
En effet, il existe aujourd’hui plusieurs types de polices locales. Ces polices sont façonnées par les décisions des maires, qui sont compétents pour organiser ce service public. Cette situation a conduit les rapporteurs à s’interroger sur la nécessité de fusionner police municipale et gardes champêtres au sein d’une police territoriale, afin de disposer d’agents polyvalents qui pourraient agir tant en milieu urbain qu’en milieu rural, selon la spécificité de leur périmètre d’action.
Je tiens à mentionner l’une des particularités du Haut-Rhin en la matière : le syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux, composant ce qu’on appelle communément la « brigade verte ». La loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation a repris à son article 44 un amendement qui avait été proposé par le sénateur Goetschy, auquel s’étaient associés les sénateurs Schiele et Haenel. Cet amendement visait à permettre à un groupement de collectivités réunies dans un syndicat mixte d’avoir en commun des gardes champêtres compétents sur l’ensemble du territoire des communes constituant le groupement. La possibilité de mise en commun de ces fonctionnaires dans un établissement public de coopération intercommunale est désormais prévue par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-3 du code de la sécurité intérieure.
Depuis l’entrée en application de ces dispositions, les gardes champêtres ont constitué un véritable corps dans le Haut-Rhin. Ils sont placés sous l’autorité juridique de leurs maires et leur cadre de gestion est un syndicat mixte regroupant des communes, le département du Haut-Rhin et, le cas échéant, des syndicats de communes.
La brigade verte compte 58 gardes champêtres, 6 personnels administratifs, 2 personnels techniques de catégorie B, 5 contrats uniques d’insertion et 1 contrat de travail après mise à la retraite, pour 308 communes. La soixantaine de gardes champêtres est répartie sur les dix postes du département. Des patrouilles sont effectuées sept jours sur sept, 365 jours par an. Cette structure est financée à 48 % par le conseil général, pour les missions environnementales dévolues aux gardes champêtres, et à 52 % par les communes adhérentes, pour les missions liées aux pouvoirs de police du maire. La brigade verte travaille en partenariat avec toutes les autres institutions du territoire, notamment la région, le conseil général, la gendarmerie et la police.
Cette brigade est l’un des piliers de la sécurité et de la tranquillité des habitants du Haut-Rhin. Cette organisation fonctionne très bien et répond parfaitement aux besoins des petites communes, en répartissant les coûts entre les communes, les intercommunalités et le département.
Monsieur le ministre, si une fusion de la police municipale et des gardes champêtres au sein d’une police territoriale était réalisée, quel serait l’avenir de la brigade verte ? La question mérite d’être posée. En effet, dans le Haut-Rhin, il pourrait y avoir un vrai problème de financement, car il serait difficilement envisageable que le conseil général continue à financer à 48 % un EPCI dont l’objet principal serait la « police intercommunale », dans la mesure où la sécurité des biens et des personnes ne fait pas partie des compétences qui lui sont dévolues.
La brigade verte étant unique sur le territoire national tant par le nombre des communes adhérentes – je rappelle qu’elles sont 308 – que par sa méthode de financement, il est certain qu’un projet national de police territoriale remettrait en cause son mode de fonctionnement et, donc, l’existence même de cette structure qui a su répondre aux attentes de nos concitoyens haut-rhinois et des élus des collectivités concernées.
Cette structure ayant fait ses preuves depuis plus de vingt ans, il serait intéressant de ne pas exclure ce genre de coopération intercommunale et même d’envisager de traiter avec soin cette question dans les futures lois de rénovation de la police municipale. En effet, si les mutualisations de personnels et de moyens sur le modèle de la brigade verte restent peu nombreuses en France, leurs résultats semblent prometteurs. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ces dernières années, le nombre de policiers municipaux a connu une nette augmentation. On compte aujourd’hui quelque 18 000 agents, dont 715 dans les départements d’outre-mer, soit environ trois fois plus qu’il y a vingt-cinq ans.
Alors que, à l’origine, la police municipale avait une dimension essentiellement préventive et intervenait surtout en complément de la police nationale, ses missions se sont développées au point de l’ériger parfois en « police nationale bis ». Ce phénomène s’explique en grande partie par la réduction des effectifs des forces de sécurité de l’État – police et gendarmerie nationales – dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et du fait de l’application de textes comme la LOPPSI.
Le reflux des forces nationales, combiné au développement et à l’intensification des phénomènes de délinquance, a contraint de nombreux maires à pallier, quand ils le pouvaient, les carences de l’État. On observe ainsi une grande diversité de pratiques sur le terrain, selon que les communes ont eu ou non les moyens de créer une police municipale et de l’équiper convenablement. Cette situation aboutit à un traitement différencié des administrés, à une police municipale à géométrie variable.
Je pense pouvoir affirmer que, au sein de cette assemblée, nous rejetons tous une telle dérive. Aucun recul des missions régaliennes exercées par l’État ni aucun système inégalitaire ne sauraient être tolérés.
Comment améliorer la situation ? Sur la base du rapport de nos collègues, qui établit un état des lieux et propose des pistes pour éclaircir les enjeux de la répartition des attributions et des moyens, la commission des lois a décidé d’engager un débat sur la police municipale, même s’il eût été plus approprié de parler de débat sur « les » polices municipales, comme cela a dit tout à l'heure.
Je tiens tout d’abord à féliciter nos collègues pour la qualité de leur rapport. Je n’ai qu’un seul regret à formuler : les territoires ultramarins semblent avoir été encore une fois oubliés…
À mon sens, les différences d’opinion entre nous se rapportent moins aux clivages politiques qu’aux réalités locales. Comment prendre en compte les inégalités locales ? Le rapport préconise d’encourager la mutualisation intercommunale. C’est une excellente idée, même si je m’interroge sur la possibilité de sa mise en œuvre dans les départements caractérisés par une grande fragilité budgétaire.
L’amélioration du dispositif de formation va également dans le bon sens. Cependant, le financement de la formation initiale peut être un frein et s’avérer discriminant. La situation financière d’une grande partie des communes ne leur permet pas d’assurer une formation correcte, ni même de doter leurs policiers d’un équipement plus approprié. Dans mon département, où 11 communes sur 17 sont aujourd’hui sous le contrôle de la chambre régionale des comptes, l’instauration d’un mécanisme de péréquation n’y changera rien.
À Mayotte, 140 policiers municipaux sont en exercice. D’après le dernier recensement, l’île compte 212 600 habitants, auxquels il faut ajouter les personnes en situation irrégulière, qui sont, vous le savez, très nombreuses sur ce territoire. Les effectifs sont donc loin de répondre aux besoins de cette île frappée par une forte délinquance et qui souffre de l’absence de structures d’accueil et d’encadrement d’une jeunesse parfois à la dérive. Par ailleurs, une partie de l’activité des policiers municipaux consiste à prêter main-forte aux forces de police et de gendarmerie – qui sont, faut-il le rappeler, en situation de sous-effectif – pour les reconduites à la frontière.
Quant à la formation des policiers municipaux mahorais, elle est très récente puisqu’il a fallu attendre la création de la délégation régionale du CNFPT, à Mayotte, en 2005, pour légaliser une activité qui existait depuis 1977.
Il paraît également indispensable de recentrer les polices municipales sur ce qui fait leur véritable singularité, à savoir leur connaissance du terrain, et de développer leur savoir-faire en matière d’îlotage, de prévention et de médiation. Les propositions formulées par les rapporteurs qui visent à améliorer les nouvelles conventions de coordination devraient permettre de clarifier le rôle de chacun et de rappeler la spécificité des différentes missions.
Monsieur le ministre, vous avez récemment confié à Jean-Louis Blanchou, préfet délégué à la sécurité privée, le pilotage d’un groupe de travail sur les polices municipales. Je souhaiterais que ce groupe de travail puisse tenir compte des situations spécifiques des territoires ultramarins. §
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à me féliciter des échanges que nous avons aujourd’hui.
Assurer la sécurité de nos concitoyens est ma priorité, celle qu’a définie le Président de la République. Cette priorité mobilise chaque jour les gendarmes et les policiers. Leur mission est de garantir l’ordre républicain sur l’ensemble du territoire : dans nos villes, dans nos zones périurbaines, dans nos campagnes. L’ordre républicain, c’est la même exigence de sécurité pour tous les Français. La sécurité est un droit, car c’est le préalable à la liberté et au progrès.
Assurer la sécurité de nos concitoyens est une mission essentiellement régalienne – vous avez été nombreux à le souligner –, une mission dans l’accomplissement de laquelle l’État doit assumer pleinement ses responsabilités. L’exercice de cette mission réclame des moyens et des effectifs adaptés.
C’est pour répondre à cet impératif prioritaire qu’un terme a été mis à la politique du gouvernement précédent, qui, je le rappelle, s’était traduite par la suppression de 10 700 postes de policiers et de gendarmes en cinq ans. Si rien n’avait été fait, 3 200 postes supplémentaires auraient disparu en 2013. Cette hémorragie devait cesser : tous les départs en retraite seront donc remplacés, poste par poste. Mais le Gouvernement fait plus encore : 480 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés en 2013. Les créations d’emplois se poursuivront au même rythme au cours des prochaines années.
Ce renforcement des effectifs était nécessaire, mais les augmentations d’effectifs ne sont pas tout. Des réformes sont également menées afin de renforcer la présence des forces de l’ordre sur le terrain – c’est leur vocation – et de restaurer le lien essentiel qui doit les unir à la population.
Si je veux rappeler, comme l’ont fait beaucoup d’entre vous, notamment Gilbert Roger, que j’ai été très heureux d’entendre, et Thani Mohamed Soilihi, qui nous a apporté il y a quelques instants son regard d’élu d’outre-mer, cette évidence du caractère régalien des missions de sécurité publique, c’est afin de préciser le cadre de nos échanges et de souligner que chacun doit être traité de manière égale sur notre territoire.
En effet, il me paraît important que les choses soient dites de la manière la plus claire, même si, selon moi, il n’y a pas de véritables désaccords entre nous sur cette question.
Les polices municipales ne sont pas et ne doivent pas être des palliatifs à un État défaillant. Elles ne sont pas les renforts nécessaires pour des forces de l’ordre ne pouvant, à elles seules, accomplir leurs missions. Les polices municipales – vous avez eu raison, messieurs les rapporteurs, d’en parler au pluriel – ont pour rôle de mener une action complémentaire aux côtés des forces de la police et de la gendarmerie nationales.
Ministre de l’intérieur, je suis également élu d’une ville de la banlieue parisienne, Évry, dont j’ai été le maire pendant plus de dix ans. Je connais donc bien le rôle et l’importance des polices municipales.
J’ai moi-même agi avec constance pour mettre en place, dans ma ville, une police municipale dotée des moyens nécessaires pour accomplir ses missions au plus près des habitants, qui, je le crois, même si Mme Assassi nous a fait part d’une expérience personnelle différente, ne la confondent pas avec la police nationale, confusion qui – j’en suis d’accord avec vous, madame le sénateur – ne doit pas se produire.
Monsieur Roger, je suis aussi d’accord avec vous pour dire que les polices municipales ne doivent pas être constituées seulement pour faire face à la baisse des effectifs de la police nationale.
Comme maire, à l’instar de beaucoup d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai considéré qu’il fallait créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement, dans le cadre de la loi, de cette nouvelle force.
Je sais combien les policiers municipaux de France, les gardes champêtres et les agents de surveillance de la voie publique, à qui je veux rendre hommage, permettent aux maires, conformément au code général des collectivités territoriales, que beaucoup d’entre vous ont cité, « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Je sais également que les prérogatives des polices municipales se sont renforcées, au travers de plusieurs textes de loi, portés d’ailleurs par différentes majorités, et qu’une certaine amplitude existe dans les missions qu’elles assument et dans les moyens dont elles disposent. Cette diversité, qui tient aux choix faits par les municipalités, doit être préservée.
Toutes les polices municipales ont en commun d’assurer des missions de police administrative et de police du code de la route. Par leurs actions de prévention, de présence dissuasive, de médiation et également, ne l’oublions pas, de répression, elles sont des acteurs déterminants pour assurer non seulement la tranquillité, mais également la sécurité de nos concitoyens. Il en va ainsi pour la sécurité routière, mais également pour la lutte contre les trafics de drogue.
Il y a eu des changements au cours des dernières années – pas uniquement depuis dix ans… –, changements auxquels les élus, avec le pragmatisme qu’on leur connaît, se sont adaptés. Nous sommes loin, même si parfois il en subsiste quelques traces, des polices municipales façon « cow-boy ». Tout est aujourd’hui encadré, ce qui est une bonne chose, grâce aux pratiques des élus et aux évolutions impulsées par le législateur.
Des partenariats efficaces se nouent, localement, entre les polices municipales et les forces de police et de gendarmerie. Les conventions de coordination permettent la mise en place d’une coopération solide, sur le long terme, assurant une meilleure efficacité opérationnelle. L’organisation d’actions communes, la répartition des interventions en fonction de leur nature et du lieu, ou encore le partage de moyens techniques, notamment la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, sont autant de voies qui contribuent à une coproduction de sécurité au bénéfice des habitants.
À cet égard, monsieur Placé, vous avez encore une marge d’évolution, mais je ne doute pas que votre position changera
M. Jean-Vincent Placé sourit.
La vidéoprotection, si elle est respectueuse des droits fondamentaux de nos concitoyens, bien installée et adaptée à la carte de la délinquance dans nos villes, peut en effet être efficace. C’est grâce à elle aussi que l’enquête ouverte à la suite du terrible meurtre de trois militantes kurdes, voilà quelques semaines, avance à grands pas.
Nombre d’entre vous l’ont souligné, cette coproduction de sécurité ne se fait cependant pas sans certaines difficultés, dont il convient d’être conscient afin d’y remédier.
À ce titre, les travaux de la mission d’information conduits par René Vandierendonck et François Pillet, qu’à mon tour je veux féliciter, méritent d’être salués, tant pour leur ampleur que pour leur pragmatisme.
Le dossier des polices municipales appelait une étude approfondie, étude que fournit le rapport qu’ils ont remis le 26 septembre dernier. En tant qu’ancien parlementaire, je sais ce que représente, en temps et en implication, la rédaction d’un tel document. Le Gouvernement a besoin de cet autre regard, de cette expertise et de ce recul. À cet égard, monsieur Sueur, la commission des lois du Sénat vient une fois encore de faire la démonstration de l’aide précieuse qu’elle est susceptible de nous apporter. Je lui en suis très reconnaissant.
La complexité du sujet tient, en premier lieu, à la multiplicité des acteurs et à leur articulation. Pour l’État, en particulier pour le ministre de l’intérieur que je suis, les polices municipales apportent une contribution indispensable à la politique de sécurité, avec une approche de proximité et une connaissance de la réalité du terrain irremplaçables.
Cette articulation entre la volonté de l’État, ses besoins, ses objectifs et ceux des élus doit être abordée de façon fine, ce qu’ont très bien fait les rapporteurs.
Monsieur Nègre, en aucun cas je ne souhaite apporter une réponse uniforme aux problématiques que vous avez soulevées. En effet, ce sujet ne peut être appréhendé sans une bonne compréhension de la diversité des situations locales.
À cet égard, l’éclairage apporté par le rapport de la mission d’information est essentiel. Messieurs les rapporteurs, cette qualité tient à la méthode employée : en fondant votre travail sur les réponses à un questionnaire que vous aviez adressé à près de 4 000 maires, vous êtes parvenus à retranscrire au plus près les attentes du terrain.
De même, les multiples déplacements que vous avez effectués, à Nice, à Dijon, ou encore à Évry, …
… entre autres villes, montrent à la fois votre capacité d’aller au contact de la réalité du terrain et votre intelligence politique. Ils sont le gage d’une approche réaliste et pluraliste. L’un des apports de votre travail tient justement au fait que vous avez su appréhender la diversité des situations.
Ce pragmatisme et cette attention portée au terrain sont aussi les axes que je souhaite donner au travail qu’accomplit actuellement le ministère de l’intérieur.
Tout d’abord, la méthode que j’ai choisie est simple et transparente : elle est basée sur la concertation et la collégialité.
Cela a été rappelé, j’ai décidé de créer un groupe de contact. Constitué de M. Jean-Louis Blanchou, préfet, délégué interministériel à la sécurité privée, de MM. Yves Monard et Bertrand Michelin, inspecteurs généraux de la police nationale, et de M. Jérôme Millet, chef d’escadron à la direction générale de la gendarmerie nationale, il bénéficiera du soutien de deux directions du ministère de l’intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ainsi que la direction générale des collectivités locales. Je remercie de leur implication toutes les personnes concernées, dont plusieurs assistent d’ailleurs, ici-même, au débat.
Cette collégialité permet la confrontation des points de vue et des expériences. À cet effet, le groupe de contact s’est vu confier pour tâche de recevoir au ministère toutes les organisations syndicales de policiers municipaux. Le dialogue va évidemment se poursuivre, mais il en est d’ores et déjà ressorti un besoin partagé de reconnaissance – Mme Bouchart, qui connaît bien ces questions, y a fait allusion – des missions et du rôle des polices municipales.
Parmi les attentes qu’elles expriment, les organisations syndicales considèrent le volet social comme étant prioritaire. Néanmoins, même si les policiers municipaux demandent une reconnaissance, qui leur est d’ailleurs due, ils ne recherchent pas forcément une uniformisation. En effet, comme les élus, les personnels sont attachés à la diversité, car ils sont conscients de la nécessité d’adapter les polices municipales aux spécificités et aux besoins de chaque territoire.
Dans le cadre de ces consultations, le rapport sénatorial joue un rôle essentiel. En effet, vos recommandations ont constitué le fil rouge des entretiens menés par le groupe de contact. Un des objectifs essentiels de ces rencontres est de dégager des priorités au regard des attentes des organisations syndicales représentant les policiers municipaux, mais le réalisme est, là aussi, de mise : l’État ne promettra rien qu’il serait dans l’impossibilité de tenir.
Outre le volet social, j’ai engagé une réflexion globale au sein du ministère de l’intérieur sur le cadre et les moyens d’intervention des polices municipales. Cette mission, qui doit déboucher sur des propositions concrètes, a également été confiée au préfet Jean-Louis Blanchou. Ce dernier a la charge de piloter ces travaux, qui associent l’ensemble des entités du ministère ayant des compétences en matière de police municipale : la police et la gendarmerie, bien sûr, mais aussi la direction générale des collectivités locales et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. L’implication de ces deux dernières est, de ce point de vue, capitale. Il s’agit en effet de mieux définir les cadres d’intervention, ainsi que l’articulation de la politique de l’État avec les collectivités.
Monsieur Thani Mohamed Soilihi, vous avez eu raison de pointer la nécessité d’intégrer dans ces réflexions la spécificité des territoires d’outre-mer, à laquelle Victorin Lurel et moi-même sommes évidemment attentifs.
Messieurs les rapporteurs, vous avez dressé un état des lieux précis des problématiques auxquelles sont confrontées les polices municipales, état des lieux que les intervenants ont complété, en esquissant chacun des solutions, des voies de progrès. À mon tour, je tiens à vous faire part des objectifs que je me suis fixés ainsi que des mesures déjà prises au sein du ministère.
La politique que je veux mener repose sur trois axes principaux, qui visent à une plus grande efficacité du dispositif : une meilleure coordination entre l’État et les collectivités ; un impératif de proximité, garanti par l’adaptation au contexte local ; enfin, un renforcement des moyens d’action, pour une police municipale reconnue et efficace.
Pour traiter correctement du sujet des polices municipales, il convient d’abord de définir les responsabilités de chacun, en premier lieu celles de l’État, qui est, je le répète, responsable de la sécurité de nos concitoyens.
En aucun cas, les polices municipales ne doivent empiéter sur les prérogatives régaliennes de la police ou de la gendarmerie. Je le redis, elles ne sont pas non plus destinées à pallier une quelconque carence de l’État.
Je rappellerai, comme Mme Assassi, les termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, auxquels je me tiendrai : « L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, […] au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des biens et des personnes ».
La coproduction sécuritaire ne peut être efficace que si elle repose sur un partage des responsabilités clair, et donc sur une coordination entre forces nationales et forces municipales. Tel est l’objectif des conventions de coordination mises en œuvre depuis 2000.
Les premières conventions types, issues d’un décret du 24 mars 2000, ont constitué un progrès certain, mais elles n’allaient pas assez loin. Surtout, elles ne reposaient presque jamais sur un diagnostic sécuritaire partagé. On pourrait citer plusieurs exemples illustrant cette réalité.
Services de l’État et collectivités travaillant de plus en plus ensemble en matière de sécurité, notamment dans le cadre des contrats locaux de sécurité ou des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, cette réalité devait se traduire dans les conventions de coordination. C’est l’une des recommandations qui ressortent du rapport d’information, mais c’était déjà l’un des axes du rapport commun produit en 2010 par l’inspection générale de l’administration, l’inspection générale de la police nationale et l’inspection générale de la gendarmerie nationale.
Cette recommandation a donc conduit à une nouvelle génération de conventions types, prévues par le décret du 2 janvier 2012. Ces conventions prévoient, par exemple, des coopérations opérationnelles renforcées entre polices municipales et forces de l’ordre.
Ces conventions constituent déjà un cadre intéressant, mais qu’il faut encore approfondir, notamment en ce qui concerne la définition des opérations conjointes ou l’armement.
Une meilleure coordination sur le plan national passe aussi par une harmonisation des pratiques lorsqu’elle est possible. Ainsi, en matière de procès-verbaux, il serait souhaitable qu’un modèle type soit généralisé afin de faciliter le travail de tous. Je sais que le CNFPT diffuse déjà un document de cette nature, pratique qui doit être étendue.
Marques d’approbation au banc de la commission .
L’adaptation au contexte local est le deuxième axe de la réflexion que je souhaite développer. C’est un impératif qui concerne l’ensemble des politiques de sécurité. Je ne crois pas aux solutions uniformes, appliquées partout de façon indistincte. Le principe d’adaptation fine aux réalités de chaque territoire a présidé, par exemple, à la création des zones de sécurité prioritaires, dans lesquelles les polices municipales sont aussi impliquées. Les effectifs, les dispositifs opérationnels, les partenariats locaux, tous ces éléments doivent être adaptés au terrain et aux types de délinquance.
Cette adaptation est aussi rendue nécessaire par la diversité des polices municipales présentes sur le territoire. Dans sa coopération, l’État doit prendre en compte la volonté des communes et des intercommunalités, qui restent maîtresses des polices municipales. En aucun cas, il n’est question de remettre en cause le pouvoir de police générale du maire, car celui-ci est inhérent au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. J’adhère d’ailleurs à l’approche pragmatique du rapport, que vous avez été nombreux à saluer – je pense notamment aux interventions de Mme Klès et de M. Capo-Canellas –, mais je n’oublie pas les observations de MM. Plancade et Placé, ou de Mme Assassi, sur la nécessité de pousser davantage la réflexion.
L’idée d’une plus grande déconcentration ou d’une décentralisation accrue n’est pas, en elle-même, absurde, car de telles solutions sont appliquées dans d’autres pays et l’ont aussi été chez nous. Cependant, nous disposons aujourd’hui d’un cadre régalien qu’il me paraît important de respecter, tout en tenant compte des évolutions évoquées dans le rapport.
C’est donc par un dialogue approfondi, que j’espère fructueux, entre l’État et les élus que nous parviendrons à définir une « offre de sécurité » plus efficace pour nos concitoyens. La situation a d’ailleurs déjà évolué : le dialogue qui existe entre l’État, les collectivités territoriales et l’éducation nationale en matière de sécurité n’était pas même pensable voilà seulement quelques années.
Le dialogue doit aussi être pratiqué avec les partenaires sociaux comme avec les agents de l’État ou des conseils généraux, dans le respect, bien sûr, du secret professionnel. La coproduction doit en effet passer par un dialogue fondé sur la confiance à l’échelon local pour gagner en efficacité.
À cette même fin, une voie mérite, comme vous le soulignez dans votre rapport, messieurs les rapporteurs, d’être approfondie, celle de la mutualisation intercommunale. Vous citez notamment l’exemple de la communauté de communes de Roissy Porte de France – c’est donc faisable, monsieur Nègre ! Dans le respect, là encore, des pouvoirs de police générale du maire, il est possible par ce biais de réaliser des économies réelles d’échelle et de structures.
Surtout, la mutualisation intercommunale permettrait de mieux adapter l’action de la police municipale aux variations dans l’espace et dans le temps des besoins en termes de présence et de régulation de proximité.
Dans le cadre des conventions de coordination avec l’État, il peut également s’avérer souhaitable de rapprocher les périmètres d’action : des polices intercommunales seraient sans doute plus proches du zonage des circonscriptions de sécurité publique de la police ou des communautés de brigades de la gendarmerie.
M arques d’approbation au banc de la commission .
Les rapporteurs l’ont constaté lors de leurs déplacements, les premières expériences en la matière sont une réussite. Il faut aller plus loin, mais sans attenter au pouvoir de police générale du maire, ce qui nous vaudrait d’ailleurs d’être rappelés à l’ordre par le Conseil constitutionnel.
Dans cette perspective, le projet de loi de décentralisation prévoira la possibilité, pour les EPCI à fiscalité propre le souhaitant, de transférer un pouvoir de police spéciale à leur président en matière de circulation et de stationnement ; ce transfert de plein droit découlera de la communautarisation de la compétence en matière de voirie.
Un double pouvoir de veto sera toutefois garanti : celui du maire, conformément au principe de libre administration ; celui du président de l’EPCI, pour lui éviter d’avoir à exercer une compétence sur un territoire en « taches de léopard » en cas de consensus insuffisant entre les différents maires concernés. Explorons cette voie, qui devrait également s’avérer intéressante pour nos agglomérations, compte tenu des compétences qu’elles exercent dans le domaine des transports.
L’adaptation au contexte local n’est pas seulement affaire de structures ; elle doit aussi guider la définition des moyens et modes d’action accordés aux polices municipales.
Il en va ainsi en matière d’armement. Comme l’a déjà dit M. François Pillet, il n’y a pas lieu de légiférer sur ce sujet. Il n’y a pas, en effet, de réponse univoque : dans certaines communes, il serait absurde que les policiers municipaux soient armés, mais cela peut se révéler nécessaire dans d’autres. Les policiers municipaux d’Évry sont armés, choix que n’ont pas fait d’autres villes et qui n’est d’ailleurs pas seulement fonction de la taille : le maire de Bordeaux ne souhaite pas armer sa police municipale, alors que celui de Lyon l’a fait. La solution retenue est ainsi plus affaire de pragmatisme, de prise en compte des réalités du terrain, que de positions politiques, même si des différences existent évidemment, et loin de moi l’idée de les gommer !
En revanche, il faut garantir à tous les policiers municipaux les moyens de se défendre si nécessaire. Je n’ai évidemment pas oublié cette policière municipale, Aurélie Fouquet, qui a payé de sa vie son engagement courageux. Je pense aussi aux policiers municipaux de Nice, que j’ai rencontrés il n’y a pas si longtemps, ou à ceux d’Évry, qui travaillent jusqu’à deux heures ou trois heures du matin et subissent les mêmes caillassages que d’autres fonctionnaires dans certains quartiers.
Ma volonté d’assurer une meilleure protection des policiers et des gendarmes vaut aussi, bien évidemment, pour les policiers municipaux. Tel est l’objectif du projet de décret, actuellement examiné par le Gouvernement, qui leur permettrait de disposer d’un certain type de tonfas, dont l’usage ne leur est pas autorisé pour l’instant, ou de matraques télescopiques.
Sur ces questions d’armement, soyons également pragmatiques et reconnaissons, en dépit des éventuels incidents ou accidents qui ont pu se produire, que nos forces de l’ordre, nationales et municipales, agissent avec beaucoup de responsabilité, même dans les situations extrêmement difficiles. Nous pouvons donc souligner l’exemplarité – en comparaison avec d’autres pays notamment – de nos forces de l’ordre.
Le troisième axe de ma politique concerne les moyens donnés à la police municipale pour qu’elle soit davantage reconnue et encore plus efficace.
Les polices municipales s’appuient sur les compétences de leurs agents. Ces compétences, il convient de les entretenir, mais également de les développer par des actions de formation adéquates.
En ce qui concerne la formation initiale, les parcours pédagogiques doivent être adaptés aux acquis professionnels des élèves. Pour autant, il faut veiller à ce que tous passent par le même creuset, y compris les anciens policiers et gendarmes, car, comme Mme Klès l’a dit à juste titre, même pour eux, devenir policier municipal revient à apprendre un nouveau métier.
Il est primordial, également d’être en mesure d’évaluer en fin de formation si les nouvelles recrues présentent bien les qualités requises pour exercer leurs fonctions.
La police nationale a instauré dans ses écoles, en 2005, un jury de fin de scolarité pour les élèves gardiens de la paix. De même, les commandants d’école de sous-officiers de gendarmerie se prononcent systématiquement, à la fin de la formation, sur l’aptitude des élèves-gendarmes. Cette évaluation sera d’ailleurs d’autant plus nécessaire à l’avenir que plusieurs milliers de policiers et de gendarmes vont être de nouveau recrutés.
Actuellement, pour les polices municipales, le président du CNFPT porte à la connaissance de l’autorité territoriale, à l’issue des six mois de formation initiale, son appréciation écrite sur les stagiaires. Cet avis n’a toutefois aucun caractère contraignant. Il me paraît souhaitable que le préfet et le procureur en aient également connaissance, préalablement à leur décision sur les demandes d’agrément.
Le CNFPT propose également une offre complète en matière de formation continue, permettant d’accompagner les policiers municipaux au cours de leur carrière et de les aider à assumer de nouvelles responsabilités, mais il faut aller plus loin. Il serait ainsi utile que les directeurs de police municipale soient également tenus de suivre ces actions de formation continue, ne serait-ce que pour maintenir leurs connaissances à niveau.
Le CNFPT joue ce rôle, à titre principal, mais il n’est pas le seul. Déjà les moniteurs de tir de la police et de la gendarmerie forment ceux du CNFPT en mettant à disposition leurs stands de tir, mais il doit être possible d’aller au-delà, dans l’esprit de cette véritable filière de la sécurité que vous êtes plusieurs à appeler de vos vœux.
C’est pourquoi je demanderai au groupe de contact animé par le préfet Jean-Louis Blanchou de réunir l’ensemble des acteurs de ces secteurs pour réfléchir à la possibilité d’une mutualisation dans ce domaine. Sont concernés le CNAPS, ou Conseil national des activités privées de sécurité, le CNFPT, et évidemment la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale. Là aussi, nous devons avancer et j’ai entendu vos propositions, mesdames, messieurs les sénateurs.
Bien formés, les policiers municipaux doivent également bénéficier de rémunérations prenant en compte la nature des missions qu’ils remplissent. Je sais que la question du régime indemnitaire et catégoriel représente une attente forte. Un cycle de discussions s’est engagé en 2012 ; je propose de le conduire à son terme au premier trimestre de cette année.
S’agissant des policiers municipaux de catégorie C, je suis favorable à la valorisation des fins de carrière pour les personnels exerçant des responsabilités d’encadrement. Les négociations avec mes collègues chargés de la fonction publique et du budget relatives à la création d’un échelon spécial à l’indice 529 pour les personnels de catégorie C devraient aboutir dans les prochaines semaines : il ne reste plus qu’à préciser le mécanisme de contingentement de l’accès à cet échelon spécial.
Je suis ces négociations de très près, et j’ajoute qu’il est parfois utile qu’un ministre de l’intérieur ait exercé les responsabilités de maire et présidé, à ce titre, quelques commissions administratives paritaires où étaient représentés les policiers municipaux de sa ville. Ne voyez pas dans cette remarque une ode au cumul des mandats !
Sourires.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Bien entendu ! Il n’était pas utile de le préciser !
Nouveaux sourires.
Nous nous sommes également mis d’accord sur le principe de la création d’un indice brut terminal 801 pour les directeurs de police municipale.
En ce qui concerne l’élargissement des possibilités légales pour les collectivités de recruter au grade de directeur, une étude d’impact a été menée : elle montre que les propositions émises augmenteraient de 50 à 500 le nombre de communes concernées, ce qui n’est pas très progressif. Les discussions conduites avec les services de la fonction publique et du budget nous amènent donc à rechercher des critères fonctionnels et qualitatifs plus précis que ceux qui sont proposés afin d’encadrer l’évolution du nombre de bénéficiaires.
Enfin, j’ai retenu la proposition de vos rapporteurs concernant la fusion des cadres d’emploi des gardes champêtres et des policiers municipaux, tout en étant très sensible au statut et à l’avenir de la brigade verte évoquée par Mme la sénatrice du Haut-Rhin, que décidément je ne quitte plus, que ce soit au cours de nos débats ou sur le terrain !
Mme Catherine Troendle sourit.
J’ai demandé à mes services d’étudier les modalités pratiques de cette fusion. Cette réforme devra être préparée dans le courant de l’année 2013 pour une mise en œuvre en 2014, si vous en êtes d’accord, avant les élections professionnelles au sein de la fonction publique territoriale prévues à l’automne.
Enfin, je vous propose d’être prudents sur la question de l’uniforme et de garder ce bleu qui me semble correspondre à une demande forte de nos policiers municipaux.
Des moyens d’action renforcés, cela signifie enfin une meilleure mutualisation et, lorsque cela est possible, une harmonisation avec la police et la gendarmerie nationales.
Les services du ministère de l’intérieur étudient la question de la consultation de certains fichiers d’État par les policiers municipaux, notamment en matière routière. Il s’agit, je le sais, d’une revendication récurrente de ces agents, qui rencontrent, j’en suis conscient, des complications dans leur travail quotidien, mais je ne vous cache pas que nous abordons ce problème avec une certaine vigilance compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle.
Le législateur a exclu de confier aux polices municipales des pouvoirs d’investigation qui relèvent de la police et de la gendarmerie nationale. Or, le recours à ces fichiers, dont certains comportent des données sur des personnes surveillées, permet de procéder à des identifications de personnes. J’ai donc demandé à mes services d’approfondir la réflexion, sous un angle pragmatique et à partir de cas concrets, en vue de déterminer les modalités d’accès limité, fichier par fichier, qui faciliteraient le fonctionnement quotidien des polices municipales.
Un autre axe de mutualisation semble plus prometteur : il s’agit de l’interconnexion de certaines fréquences radios entre les forces de l’ordre et les polices municipales. Outre que celle-ci permettrait d’améliorer la fluidité des communications lors des opérations conjointes, elle serait également un gage de sécurité pour les policiers municipaux mis en danger dans leurs missions. Je pense évidemment, cette fois encore, à cette policière municipale qui a perdu la vie dans une opération de ce type.
Bien entendu, l’interconnexion ne pourrait intervenir que dans le cadre de conventions renforcées. J’ai donc annoncé une expérimentation dans ce sens sur quatre villes qui seront prochainement désignées par les directions générales de la police et de la gendarmerie.
Afin de simplifier encore le travail des policiers municipaux, nous devons veiller à renforcer l’efficacité de la répression, qu’ils exercent dans le strict cadre de leurs prérogatives. Si les policiers municipaux sont aujourd’hui habilités à sanctionner les infractions aux arrêtés du maire, leurs procès-verbaux doivent être transmis à la police ou à la gendarmerie en vue de la comparution du contrevenant devant le tribunal de police.
Ce système est lourd et peu efficace, reconnaissons-le. La procédure du timbre-amende ou de l’amende forfaitaire serait une simplification appréciable. Une réflexion est en cours sur ce sujet, en lien, cela va sans dire, avec la Chancellerie.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont nos réflexions, nos réponses à vos attentes et à vos questions. Tel est notre regard sur les pistes élaborées par un rapport dont je veux, une fois encore, souligner la qualité.
Je propose, monsieur le président de la commission des lois, que les deux rapporteurs soient régulièrement associés aux travaux du ministère de l’intérieur.
D’importants rendez-vous, notamment sur la formation des policiers et le bilan d’étape des zones de sécurité prioritaires, sont prévus. MM. Vandierendonck et Pillet y seront bien évidemment invités. Leurs réflexions constitueront un apport précieux, et je ne doute pas qu’ils tireront aussi un certain nombre d’enseignements des débats.
Je l’ai dit, la sécurité dans notre pays dépend, d’abord, de l’État régalien, c'est-à-dire de la police et de la gendarmerie nationales, mais d’autres acteurs se sont invités. Je pense à la sécurité privée, à laquelle plus de 200 000 personnes contribuent – grâce aux travaux du CNAPS et à l’action du préfet Blanchou, le renforcement de leur encadrement évolue dans le bon sens – et, bien sûr, à la police municipale, forte de près de 19 000 agents. Ces acteurs de la sécurité et de la tranquillité de nos concitoyens doivent être soutenus et voir leurs conditions de travail améliorées.
Grâce au rapport de la mission d’information, qui a nourri un débat que je crois avoir été de très grande qualité, nous parviendrons à atteindre ces objectifs. §

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.