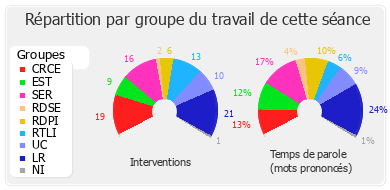Séance en hémicycle du 16 mai 2018 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Rappel au règlement (voir le dossier)
- Indemnisation des interdictions d'habitation résultant d'un risque de recul du trait de côte (voir le dossier)
- Infractions financières et suppression du « verrou de bercy » (voir le dossier)
- Revalorisation des pensions de retraite agricoles (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, chacun a en mémoire la séance publique du 7 mars dernier, au cours de laquelle le Sénat, à une quasi-unanimité, s’est élevé contre la décision – véritable coup de force du Gouvernement – d’imposer un vote bloqué sur la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, dont notre groupe avait demandé l’inscription à l’ordre du jour qui lui est réservé dans le cadre de l’initiative parlementaire.
Notre proposition de loi, attendue par des dizaines de milliers d’anciennes agricultrices et d’anciens agriculteurs, avait été adoptée à l’unanimité par la commission des affaires sociales du Sénat.
Une telle unanimité – fait rare pour l’une de nos propositions de loi – n’est pas le fruit du hasard. Au travers de ce texte, nous portons une proposition humaine, que je qualifierais de bon sens social pour des femmes et des hommes qui, durant toute leur vie, ont travaillé dur et ont permis par leur labeur de maintenir des espaces de ruralité. La Nation leur doit une forme de reconnaissance, de prise en compte de ce grand effort.
Le 7 mars dernier, le Gouvernement a agi avec violence en utilisant une procédure rarissime à l’égard d’une initiative parlementaire. Le vote bloqué obligeait le Sénat à se prononcer par un seul vote sur un amendement déposé par le Gouvernement visant à reporter à 2020 la seule éventualité d’une augmentation des retraites agricoles et, dans le même temps, sur le texte dans son ensemble.
En clair, soit nous acceptions le renvoi aux calendes grecques de la revalorisation des retraites agricoles, soit nous votions contre notre propre texte ainsi défiguré. Comment ne pas faire le lien entre cet acte autoritaire et les projets de remise en cause des droits des parlementaires dans le projet de loi constitutionnelle à venir ?
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la ministre des solidarités et de la santé a annoncé officiellement, à l’issue de la séance du 7 mars dernier, qu’elle recourrait de nouveau à la procédure du vote bloqué si le texte était de nouveau présenté au débat sénatorial.
À quelques heures de ce débat, pourrions-nous savoir si le Gouvernement entend revenir sur son coup de force, sans le conditionner à tel ou tel compromis que l’on sent de toute façon « piégeux » ? Le Sénat, selon nous, ne peut délibérer ainsi, sous la contrainte.
Applaudissements.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi visant à instaurer un régime transitoire d’indemnisation pour les interdictions d’habitation résultant d’un risque de recul du trait de côte, présentée par Mmes Françoise Cartron et Laurence Harribey et par M. Philippe Madrelle (proposition n° 307, texte de la commission n° 440, rapport n° 439).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Françoise Cartron, auteur de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, déposée il y a quelques semaines, cette proposition de loi dont nous avons à débattre aujourd’hui vise à prévoir un régime d’indemnisation pour les interdictions d’habitation résultant d’un recul du trait de côte.
Ce texte répond en fait spécifiquement au problème de l’immeuble Le Signal, construit à Soulac-sur-Mer, dans le département de la Gironde, dont je suis élue. Cette affaire, que nous connaissons désormais trop bien dans les assemblées parlementaires, est inédite, exceptionnelle et injuste. Elle est aussi devenue inextricable, car, hélas, à ce jour, aucune solution n’a pu être trouvée.
L’article unique de la présente proposition de loi, exclusif de toute autre disposition, se veut une réponse d’initiative parlementaire efficace et rapide à la détresse des copropriétaires qui n’ont plus accès à leur logement depuis plus de quatre ans, et ce – faut-il le rappeler ? –, sans aucun dédommagement.
Le problème est désormais connu bien au-delà du sud du Médoc. Tout le monde a en tête l’image de cet immeuble à l’abandon, face à la mer. Elle est devenue un terrible symbole environnemental. Madame la secrétaire d’État, n’en faisons pas également un symbole d’indifférence ou d’abandon.
Ce bâtiment, construit en 1967 sur une emprise située alors à plus de 200 mètres du front de mer, se trouve aujourd’hui à moins de 10 mètres de ce dernier. Il est interdit d’accès par un arrêté pris le 7 janvier 2014 du fait de l’imminence du danger.
Depuis plus de quatre ans, cette situation ubuesque perdure, car l’interdiction effective d’habiter le bâtiment ne vaut pas expropriation, ce qui aurait donné lieu à une indemnisation à hauteur du prix de chaque bien. En effet, conformément au code de l’environnement, l’expropriation donne lieu à une indemnisation si, et seulement si, il existe une menace grave pour la vie humaine, ce qui n’est pas le cas des risques d’érosion côtière.
En conséquence, en l’absence d’expropriation in jure, le fonds dit « Barnier », qui permettrait d’indemniser les copropriétaires, n’a pu être mobilisé. Répondant à la question qui lui était posée, le Conseil constitutionnel a de plus confirmé dans sa décision n° 2018-698 du 6 avril 2018 qu’il n’y avait pas inégalité de traitement au regard de la législation actuelle – ce point est important – entre les copropriétaires de l’immeuble et d’autres bénéficiaires du fonds Barnier.
Après quatre années de contentieux avec l’État, dont je rappelle que la responsabilité est totalement engagée, il est urgent de répondre légalement à cette problématique, qui devient pour les personnes concernées proprement insoutenable.
Depuis quatre ans, onze des copropriétaires sont décédés. Par ailleurs, les copropriétaires dont l’immeuble est la résidence principale doivent s’acquitter d’un certain nombre de charges, alors même qu’ils n’ont plus et n’auront plus jamais accès à leur logement.
Pourquoi cette situation perdure-t-elle ? Disons-le très clairement : si cet enfer est encore aujourd’hui devant nous, c’est par manque d’efficacité, par manque de volonté et du fait de tergiversations politiques. Ce texte entend y mettre fin. Il comporte des dispositions prises à titre exceptionnel et dérogatoire, car le cas du Signal est unique.
Permettez-moi de souligner que cette initiative qui est aujourd’hui la mienne et celle des membres du groupe socialiste et républicain, qui ont demandé l’inscription de la présente proposition de loi dans le cadre de l’ordre du jour réservé à notre groupe, est en fait beaucoup plus large : il s’agit de proposer une réponse législative adéquate à ce problème.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité d’autres actions parlementaires, engagées par notre collègue députée de la Gironde Pascale Got et poursuivies au Sénat par mes collègues MM. Vaspart, Retailleau et Bas.
M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable l’a parfaitement rappelé en commission le 16 avril dernier : « Ce texte reprend à l’identique un article de la proposition de loi de notre collègue Michel Vaspart que le Sénat a adoptée en janvier dernier et que nous avons peu d’espoir de voir inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. […] L’initiative de nos collègues du groupe socialiste et républicain repose sur la volonté de faire avancer rapidement la législation sur le cas particulier de l’immeuble du Signal […], dans l’espoir que cette proposition de loi soit plus rapidement inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. »
Tout est dit ! Mes chers collègues, la proposition de loi que je vous propose d’adopter, soutenue à l’unanimité par les membres de la commission, reprend un article du texte initial de notre collègue Michel Vaspart. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de notre rapporteur, Nelly Tocqueville.
Ce texte, inspiré par une démarche pragmatique, répond à un impératif d’efficacité, dont je crois qu’il s’inscrit dans l’esprit de la révision constitutionnelle voulue par le Président de la République. En effet, le dispositif d’indemnisation prévu par la présente proposition de loi a déjà été intégré dans deux véhicules législatifs distincts ces derniers mois, sans succès. Il ne fait pourtant l’objet d’aucune contestation, puisqu’il bénéficie d’un soutien unanime.
Aussi, en proposant un article unique, je souhaite donner une chance à ce dispositif d’entrer en vigueur rapidement, parce qu’il n’est plus possible d’attendre.
Mes chers collègues, cette proposition de loi n’est ni de gauche, ni de droite, ni de La République En Marche. Ce n’est ni un coup d’État médiatique ni la manifestation d’une histoire personnelle – surtout pas !
C’est pourquoi je ne puis que regretter, madame la secrétaire d’État, d’avoir appris par voie de presse ces dernières semaines que des solutions auraient été envisagées, voire arrêtées, soit par votre ministre de tutelle, M. Hulot, soit par le ministre de la cohésion des territoires, soit par le biais d’amendements, soit dans le cadre d’un texte plus large.
Un texte plus large, nous en avons fait l’expérience, ne nous permettrait pas d’aboutir à une solution applicable avant un an, dans le meilleur des cas ! Si une solution existe, et je souhaite que ce soit le cas, je vous demande, madame la secrétaire d’État, d’utiliser ce véhicule législatif pour la déposer par voie d’amendement et la faire entériner par votre majorité à l’Assemblée nationale.
Nous ne demandons que cela, et tout le monde retiendra qu’il s’agit d’une réponse collective. Il eût d’ailleurs été intéressant que tous les groupes politiques qui se sont penchés sur cette question soient associés à la réflexion, afin d’envisager une sortie de crise. La concertation n’a pas été au rendez-vous, mais une sortie par le haut est toujours possible.
En effet, il ne faudrait pas que s’installe l’impression que des solutions sont trouvées facilement pour les plus riches dans d’autres lieux et dans d’autres textes, alors que, pour certains, il faut toujours attendre. C’est pourquoi nous faisons de cette situation un symbole non seulement environnemental, mais aussi, et avant tout, social et humain. Car cela commence à faire beaucoup – beaucoup de textes, beaucoup d’unanimités – pour bien peu d’avancées.
Les propriétaires en ont assez du manque d’informations, assez d’entendre parler de rapidité et d’équité, assez de savoir que, chaque jour qui passe, leur responsabilité est engagée en cas d’accident consécutif à la chute de l’immeuble, assez d’être assimilés à des privilégiés alors qu’ils sont le plus souvent des retraités modestes épuisés moralement et physiquement, qu’ils ont pour beaucoup investi toutes leurs économies et qu’ils se sont parfois engagés jusqu’en 2030 pour le remboursement de leur prêt. Lorsqu’ils arriveront au bout de l’échéance, l’immeuble, lui, sera tombé depuis bien longtemps ! Cette situation est inacceptable.
Il est également inacceptable que des copropriétaires continuent à payer une location extérieure, en plus des frais de syndic de propriété, des assurances et des frais d’avocat pour une procédure qui, nous l’avons vu, se révèle interminable.
Mes chers collègues, permettez-moi de conclure ce propos liminaire en vous lisant un extrait du courrier que l’un des copropriétaires m’a adressé :
« Début 2014, nous avons été expulsés de cet appartement par un arrêté de péril. […] Depuis, c’est un calvaire, un cauchemar que nous vivons. Outre l’enfer d’avoir été expulsés de chez nous sans aucune aide proposée, sans aucun accompagnement. […]
« Aujourd’hui, je travaille, mais je dois faire face aux frais d’un logement de 656 euros de loyer hors charges, je dois rembourser un crédit de 550 euros pour l’appartement de Soulac-sur-Mer hors charges que je ne peux pas habiter, le tout avec un salaire de 1 800 euros. Si je rajoute les frais d’énergie, les impôts, les frais pour aller travailler, il me reste entre 100 et 200 euros pour vivre et faire vivre ma famille. […]
« Drôle de traitement pour des citoyens pourtant exemplaires, majoritairement des gens simples. […] Nous avons été obligés de faire une action en justice dans ce dossier, bien à contrecœur, rien ne se passant. Nous sommes à bout nerveusement, physiquement, intellectuellement. À tout cela s’ajoute l’humiliation subie par le fait que dans la même ville de Soulac-sur-Mer, à deux kilomètres de chez nous, a été protégée à grands frais une zone pavillonnaire. […] Nous ne demandons pas grand-chose, juste de quoi effacer notre crédit. » Et cette lettre est signée : « Une famille au bord du gouffre ».
Mes chers collègues, je vous remercie d’avoir écouté et, je l’espère, entendu la détresse de ces citoyens et citoyennes, victimes ignorées jusqu’à ce jour et qui, je l’espère, ne le resteront pas indéfiniment.

Mme Françoise Cartron. Aussi, je vous demande de voter massivement cette proposition de loi.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous prie d’excuser l’absence du président de notre commission, qui préside une audition relative au projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Il nous rejoindra dans quelques instants.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui porte sur un sujet bien connu de certains d’entre vous, puisque son article unique figurait déjà dans la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, qui n’avait pas pu aboutir lors de la précédente législature, compte tenu de la suspension des travaux parlementaires.
Ces mêmes dispositions ont ensuite été reprises dans la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, déposée en septembre 2017 au Sénat par notre collègue Michel Vaspart et adoptée par notre assemblée en janvier dernier. Vous le voyez, madame la secrétaire d’État, le Parlement est constant sur ce sujet, et il est plus que temps que le Gouvernement reconnaisse enfin l’urgence qu’il y a à le traiter.
Je souhaite insister sur trois points.
Tout d’abord, la commission a été frappée par le caractèreubuesque et kafkaïen de ce dossier – je l’ai ainsi qualifié dans mon rapport –, dans lequel la responsabilité de l’État est évidente et son inaction préjudiciable aux copropriétaires de l’immeuble du Signal.
Dans le cadre de l’ancienne mission interministérielle pour l’aménagement de la côte Aquitaine, active des années 1960 à la fin des années 1980, un grand programme de constructions était prévu à Soulac-sur-Mer en Gironde, sur 19 hectares de terrain.
Environ 1 200 logements devaient être construits le long du front de mer, ainsi qu’un boulevard de deux fois trois voies, un établissement de thalassothérapie et un hôtel de luxe. Ce projet n’a jamais vu le jour, l’aménageur retenu par les pouvoirs publics ayant déposé le bilan. Seul un immeuble de 78 logements, le Signal, a été construit in fine, pour le malheur aujourd’hui de ses propriétaires.
Mme Françoise Cartron acquiesce.

En 1967, il se situait à plus de 200 mètres du rivage. Les habitants présents depuis l’origine rapportent même que l’on peinait à voir l’océan depuis les logements ! Aujourd’hui, Le Signalest à moins de 10 mètres du rivage et menace de tomber. Les propriétaires, expulsés en trois jours, mais non expropriés, depuis 2014, par arrêté du maire de Soulac-sur-Mer, demandent tout simplement à être indemnisés pour leur bien.
La situation des propriétaires du Signal est ubuesque, parce que c’est l’État qui a décidé de lancer une opération d’aménagement à Soulac-sur-Mer. C’est l’État qui a accordé le permis de construire, et c’est l’État qui, à cette époque, ne pouvait ignorer que plusieurs immeubles du front de mer étaient déjà tombés de la falaise dunaire dans les années 1930. La situation actuelle relève donc de la responsabilité de l’État.
Ce dossier est également kafkaïen, parce que la situation juridique des propriétaires est absurde. Ils ont engagé une procédure contentieuse dès 2013, d’abord pour demander au maire et aux représentants de l’État dans le département de mettre en place un enrochement autour de l’immeuble. Cela leur a été refusé au motif que le coût de protection s’élevait à 17 millions d’euros, ce qui dépassait largement la valeur de l’immeuble, estimée à 10 millions d’euros, le tout sans prendre en compte le risque du recul du trait de côte. L’action contentieuse des propriétaires visait ensuite à contester le refus d’indemnisation par le fonds Barnier.
En 2014, le ministre de l’écologie, Philippe Martin, s’était rendu sur place avec le préfet et avait promis « un règlement rapide et équitable ». Les deux objectifs de rapidité et d’équité ne sont toujours pas atteints quatre ans plus tard.
À l’heure actuelle, la situation est inextricable. En effet, un arrêté portant ordre d’évacuation et interdiction d’occupation de l’immeuble a été publié le 24 janvier 2014 par le maire de Soulac-sur-Mer, au titre de ses compétences de police administrative. Les habitants sont donc privés de la jouissance de leur bien et des fruits de leur propriété, tout en restant propriétaires ; ils pourront par ailleurs voir leur responsabilité engagée en cas d’accident consécutif à la chute de l’immeuble.
L’affaire du règlement de cette procédure est pendante devant le Conseil d’État et devrait intervenir au mois de juin prochain, le Conseil constitutionnel ayant rendu sa décision sur la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par les propriétaires, relative aux dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement le 6 avril dernier, en écartant les griefs tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du droit de propriété.
Une fois la décision du Conseil d’État rendue, les propriétaires pourront ultimement saisir la Cour européenne des droits de l’homme.
À ce stade, l’administration refuse toujours d’accéder à la requête des propriétaires visant à obtenir une indemnisation via le fonds Barnier, pour deux motifs : d’abord, parce que l’érosion dunaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, qui définit le champ d’intervention du fonds Barnier ; ensuite, parce que l’une des conditions d’éligibilité au fonds – la menace grave à la vie humaine – ne serait pas remplie en l’espèce. Mes chers collègues, je vous laisse apprécier ces deux arguments.
Ensuite, au-delà du contenu de ce dossier, la dimension humaine du sujet est essentielle et me paraît très insuffisamment mentionnée dans le débat public.
Mme Françoise Cartron approuve.

On a entendu bien des choses sur les propriétaires du Signal, qui seraient des nantis, des privilégiés, et qui devraient assumer sans se plaindre les conséquences de leur désir de vivre au bord de l’eau. Je souhaite couper court à ces représentations, car la majorité d’entre eux sont en réalité des personnes séduites par le projet initial, mais de condition modeste, et aujourd’hui très éprouvées moralement et physiquement par la longueur des procédures et un manque d’informations sur la réalité des initiatives conduites pour leur apporter une solution.
Certains ont investi toutes leurs économies et doivent en plus, cela a été rappelé, continuer à rembourser leur dette jusqu’en 2020, 2025, voire 2030 ; d’autres ont dû se reloger et acquittent un loyer ; tous continuent d’assumer les frais de syndic de copropriété, les assurances et le coût d’une procédure longue et coûteuse pour se défendre. Les frais d’avocats s’élèvent à 100 000 euros depuis 2012, d’après leurs représentants.
Par ailleurs, depuis quatre ans, date de l’évacuation, onze propriétaires sont décédés. La question des successions est alors apparue comme un nouveau problème pour leurs descendants, qui sont en contact avec l’administration fiscale pour estimer la valeur de la transmission, ajoutant du découragement à la détresse.
Quant à l’immeuble, il a été vandalisé et occupé de façon irrégulière en dépit de nombreuses plaintes des propriétaires. Il est en très piteux état, et sa protection par la commune n’est pas suffisamment assurée à ce jour, alors même que cette dernière pourrait voir sa responsabilité engagée en cas d’accident.
Permettez-moi enfin de vous faire part d’une conviction : le cas du Signal est tout à fait exceptionnel, et appelle de ce fait un traitement lui-même exceptionnel. Si le recul du trait de côte s’impose comme un phénomène commun à de nombreux territoires et s’il nécessite une approche intégrée et globale, sans doute davantage dans une logique d’acquisition que d’indemnisation, le cas du Signal est inédit et la situation des copropriétaires est injuste. Cette situation a trop duré, je le dis fermement.
Selon l’Observatoire de la côte Aquitaine, le trait de côte recule de 2, 5 mètres en Gironde chaque année et de 1, 7 mètre dans les Landes. Dans le cas du Signal, le recul du trait de côte est de 5 à 7 mètres par an en moyenne, recul accentué notamment par la présence d’une digue à proximité, qui protège le quartier de l’Amélie à Soulac-sur-Mer et qui a tendance, de plus, à accélérer les courants et à empêcher le sable de se stabiliser.
Si nous sommes d’accord sur la nécessité de régler le problème de l’indemnisation et de la propriété de l’immeuble, le Gouvernement doit maintenant prendre ses responsabilités.
Le dispositif prévu par l’article unique de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à rendre éligibles les propriétaires de l’immeuble du Signal à une indemnisation rétroactive par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », créé en 1995.
Nous devons également éviter qu’une telle situation ne se reproduise. C’est pourquoi il est fondamental d’inscrire rapidement dans les textes une obligation d’information préalable à l’acquisition d’un bien proche du rivage, pour que les futurs propriétaires de ce type de biens aient pleinement conscience du risque de recul du trait de côte.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’un amendement du Gouvernement serait nécessaire pour établir clairement un transfert de propriété. En l’état, le dispositif permettra uniquement d’indemniser les propriétaires.

Les charges de démolition et de désamiantage leur incomberont également. Il conviendrait donc que l’État dépose un amendement visant à établir un transfert de propriété, car nous ne pouvons pas, en raison de l’article 40 de la Constitution, le déposer nous-mêmes.
J’espère sincèrement que nous pourrons trouver collectivement une réponse rapide. C’est indispensable. Sous le bénéfice de ses observations, la commission vous invite, mes chers collègues, à adopter le présent texte sans modification.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste. – M. Michel Vaspart applaudit également.
Monsieur le président, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les conséquences de l’érosion sur les territoires littoraux sont un sujet stratégique et complexe – nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre à plusieurs reprises dans cette enceinte.
Il est plus que jamais impératif de repenser l’élaboration de nos politiques publiques et d’anticiper les effets du changement climatique, pour imaginer et travailler ensemble au littoral de demain.
En janvier dernier, lors de l’examen de la proposition de loi déposée par M. Vaspart, nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce sujet crucial. La présente proposition de loi pose de nouveau et à juste titre la question des modalités d’indemnisation des propriétaires de biens menacés par ces phénomènes d’érosion côtière.
Le trait de côte est mobile et cette évolution ne va que s’accentuer. Elle doit être prise en compte pour deux raisons principales : parce qu’il faut aménager nos territoires littoraux de façon durable et parce qu’il faut préserver à la fois leur attractivité économique et leurs richesses naturelles.
Nous devons atteindre ces deux objectifs, en tenant compte des conséquences du changement climatique. Au contraire des crues ou des séismes, qui surviennent de façon aléatoire et renouvelée, le recul du trait de côte, même s’il est inéluctable, ne peut être largement anticipé. Il impose donc une gestion spécifique.
Cette distinction n’est pas une simple vue de l’esprit. Elle a été confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 6 avril dernier sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les copropriétaires de l’immeuble du Signal en Gironde.
Confirmant la position de l’État sur les conditions d’éligibilité à l’expropriation pour les risques naturels majeurs, le Conseil constitutionnel considère que l’érosion côtière ne permet pas de déclencher une expropriation au titre d’un risque naturel majeur. Cette spécificité du phénomène d’érosion appelle donc de nouvelles solutions d’ensemble et structurantes.
Elle suppose, en premier lieu, l’adaptation de nos territoires littoraux menacés.
Comme je le détaillais déjà en janvier dernier, deux mesures me semblent aller en ce sens. D’abord, je suis convaincue qu’il est nécessaire d’offrir aux collectivités compétentes des outils adaptés en matière d’aménagement du territoire. Ensuite, il est également nécessaire de faire évoluer le cadre juridique existant pour mieux prendre en compte la temporalité de ce phénomène dans les documents d’urbanisme.
C’est pour ces raisons que le Gouvernement appelle de ses vœux un texte global, complet et équilibré. Vous avez parlé de « spécificités », madame la sénatrice, mais nous voulons un texte global parce que lui seul permettra de traiter à la fois de la question de l’anticipation des phénomènes d’érosion côtière, par le biais, notamment, d’une description et d’une intégration dans les documents d’urbanisme par les acteurs compétents, de la question de l’indemnisation des biens existants qui ont été ou seront atteints à court terme par l’érosion et, enfin, de la question de relocalisation, de la conception et du déploiement de projets dans les territoires préservés à plus long terme.
Dire cela ne signifie pas pour autant que le Gouvernement oublie les situations les plus urgentes.
La situation de l’immeuble Le Signal en Gironde est, au-delà de son caractère symbolique, au cœur de nos préoccupations : je partage avec vous le souci et l’exigence de trouver au plus vite une réponse équilibrée afin de mettre un terme à cette situation, qui est, il est vrai, comme vous l’avez souligné, très difficile pour certains des copropriétaires.
Le ministre d’État a également eu l’occasion d’exprimer sa préoccupation sur cette question et sa volonté d’identifier rapidement des solutions pratiques pour cette situation spécifique et particulière. Aussi, je veux vous assurer que l’État va rapidement – quand je dis rapidement, je veux dire d’ici à la fin de l’année – …
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. … prendre sa part dans la résolution de cette situation.
Exclamations sur des travées du groupe socialiste et républicain.
Nous avons d’ores et déjà demandé au préfet de région d’organiser des opérations de désamiantage de l’immeuble pour prévenir, sans attendre, les risques pour la santé publique et l’environnement. Vous pouvez aisément l’imaginer, si l’immeuble venait à s’effondrer, l’amiante contaminerait tout l’environnement. Il est en effet impératif d’agir vite sur cette question, et je sais par ailleurs que vous partagez ici la nécessité d’avoir une approche globale en faveur d’une gestion intégrée du trait de côte.
D’aucuns pensent peut-être qu’elle pourra intervenir dans un second temps, après avoir réglé la situation des copropriétaires du Signal. Pour ma part, je considère que la question de l’indemnisation ne peut pas être traitée indépendamment.
Elle doit faire partie d’un tout : il faut régler la question de l’acquisition de l’immeuble pour pouvoir le détruire et apporter aux autres territoires l’ensemble des outils nécessaires à la transformation de nos littoraux. Cela suppose que les collectivités intéressées soient parties prenantes des décisions prises à court et long termes.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur la proposition de loi qui nous est aujourd’hui présentée.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Marc s ’ exclame également.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. Nous ne reculons pas ! Bien au contraire, madame la sénatrice.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, je vous en prie, seule Mme la secrétaire d’État a la parole !
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. Nous entendons travailler avec l’ensemble des parlementaires sur un texte de loi plus complet et plus ambitieux.
Exclamations sur les mêmes travées.
Je vois l’intérêt que ce texte suscite ici et je me réjouis de pouvoir travailler avec vous parce que nous ne pouvons pas avoir en France plusieurs Signal ; ce n’est pas possible.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. Il y en a déjà eu un de trop ! Nous voulons éviter de telles situations, et c’est pour cette raison qu’il faut avoir le courage d’une approche large et intégrée.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Daniel Laurent proteste également.
Celui-ci devrait nous permettre d’atteindre dans les meilleurs délais l’objectif ciblé et légitime que nous défendons tous, à l’instar de Mmes les sénatrices Cartron et Tocqueville.
Je vous remercie de votre attention et me réjouis de discuter et d’avancer prochainement avec l’ensemble d’entre vous sur ces questions-là.
M. François Patriat applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, en début d’année, nous avions discuté en ce lieu d’une proposition de loi tendant en partie à réviser la loi Littoral, dans une perspective globale d’aménagement des territoires littoraux.
Beaucoup d’entre nous dans l’hémicycle avaient peur d’ouvrir la boîte de Pandore : les avantages d’un tel assouplissement auraient pu avoir des effets pervers.
Nous étions tous d’accord pour reconnaître le bienfait de la loi Littoral, mais nous ne placions pas le curseur au même endroit. Il est nécessaire de lever les blocages, mais pas à n’importe quel prix ni dans n’importe quel cadre.
Néanmoins, si l’article 9 nous opposait, l’article 3 faisait plutôt consensus : il s’agissait de résoudre la situation des propriétaires de l’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer.
La question du recul du trait de côte ne fera peut-être pas la une des journaux, pourtant cette problématique, au-delà de Soulac-sur-Mer, concerne aujourd’hui beaucoup de monde, et elle en concernera encore beaucoup plus demain.
Rappelons qu’un Français sur dix vit sur le littoral et que les départements d’outre-mer comptent près de cent dix communes littorales.
Pour bien comprendre les enjeux de la question du recul du trait de côte, il faut avoir en tête deux choses que l’on ne connaissait pas il y a trente ans au moment de la loi Littoral. Premièrement, l’érosion connaît des phases d’accélération dues au réchauffement climatique dont nous sommes responsables. Deuxièmement, l’érosion est moins prévisible qu’on ne le pensait : sa survenue s’apparente parfois à une catastrophe naturelle.
Vous le savez, mes chers collègues, nous ne pouvons pas faire des lois pour régler chaque cas particulier. Mais nous ne pouvons pas non plus, au motif de chercher des dispositifs élaborés et globaux mais qui mettent plusieurs années à être opérationnels, refuser de regarder en face les situations dramatiques que vivent nos concitoyens. L’équilibre entre la hauteur de vues et la réalité concrète, avec ses souffrances réelles, est parfois précaire.
Aussi, mes chers collègues, mon groupe soutient avant tout une réflexion globale et collective sur les enjeux liés au littoral. Nous devons en priorité développer une culture de la prévention qui anticipe les risques liés au dérèglement climatique. Mais, considérant que la problématique du trait de côte se présente sous un jour que ne pouvait pas encore connaître le législateur au moment du vote de la loi Littoral, considérant que la dimension de catastrophe naturelle liée à l’accélération de l’érosion justifie la mobilisation du fonds Barnier et, enfin, considérant que la situation de l’immeuble Le Signal n’a que trop durer, le groupe La République En Marche – je vais vous étonner, mes chers collègues ! – votera en faveur de ce texte.
Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, je remercie tout d’abord le groupe socialiste et républicain de cette initiative, qui vise à mettre en place un régime transitoire d’indemnisation pour les interdictions d’habitation résultant d’un risque de recul du trait de côte.
Il s’agit de la troisième tentative avec, notamment, l’adoption en première lecture par notre assemblée, le 30 janvier dernier, de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, qui restera a priori sans suite.
Il y a urgence, madame la secrétaire d’État, et c’est la responsabilité de l’État de trouver une solution concrète à cette situation. Réglons d’abord ce problème et – chiche ! – comme vous l’avez dit, travaillons sur un texte plus vaste.
Il est essentiel de gommer aujourd’hui cet angle mort du dispositif de prévention des risques naturels majeurs. Rappelons que l’État a autorisé et supervisé la construction d’un immeuble sur une zone où le risque n’était pas inenvisageable. Pire, le droit censé protéger les citoyens est ici lacunaire, l’érosion dunaire n’étant pas prise en compte au titre des risques naturels indemnisés par le fonds Barnier.
Ainsi délogés sans indemnisation et après plusieurs années de procédures judiciaires au cours desquelles ils ont épuisé tous les recours, ces hommes et ces femmes se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Il est de notre rôle de législateur de régler ce problème et de débloquer une indemnisation légitime et de bon sens. Nous sommes ainsi favorables à cette proposition de loi.
Par ailleurs, ce cas d’espèce nous rappelle l’importance de la loi Littoral quant à l’aménagement de nos côtes. Nous ne pouvons plus nier le recul du trait de côte et déléguer la gestion de son impact aux générations futures. Une réflexion aurait été nécessaire sur les possibilités d’urbanisation dans des zones aussi proches du littoral et leur relocalisation sans pour autant défigurer les terres par une urbanisation discontinue et consommatrice de terrains agricoles ou naturels.
Cela doit également nous interpeller sur l’ensemble des situations similaires présentes tout le long de notre façade maritime. Il nous faut envisager un mécanisme d’indemnisation plus large, par équité envers les autres citoyens lésés par le recul du trait de côte.
Progressivement, les missions du fonds Barnier sont élargies, mais les moyens de ce dernier sont réduits chaque année. La loi de finances pour 2018 a également prévu le plafonnement de la taxe dévolue au fonds Barnier à hauteur de 137 millions d’euros, réaffectant ainsi près de 90 millions au budget général. Ce montant est très inférieur aux dépenses constatées ces dernières années, équivalant à 178 millions d’euros. De manière plus générale, le budget consacré aux risques hydrauliques et naturels est en constante régression.
À ce titre, la discussion de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux avait donné lieu à une discussion intéressante qu’il faudra reprendre rapidement, car la situation est urgente : en cinquante ans, le territoire français a rétréci de 2 600 hectares, l’équivalent de 3 600 terrains de football, témoin concret de l’ampleur et de la gravité du réchauffement climatique, qui est bien un défi d’aujourd’hui et non de demain.
Au-delà de ces aspects plus généraux, nous proposons de voter en faveur de ce texte et espérons vivement que ce travail parlementaire puisse aller à son terme.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, c’est aujourd’hui la troisième fois que nous examinons dans cette assemblée un texte permettant de réparer l’injustice que connaissent les habitants de l’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer.
Je tiens à remercier ma collègue Françoise Cartron, à l’origine de cette proposition de loi, et la rapporteur Nelly Tocqueville pour leur persévérance en faveur de la résolution de cette situation qui n’a que trop duré.
Ce texte entend en effet répondre à une urgence, alors même que la situation de l’immeuble Le Signal et de ses copropriétaires nous est désormais familière.
Lors de sa construction, en 1967, cet immeuble était éloigné de l’océan de plus de 200 mètres. Aujourd’hui, de tempête en tempête, le trait de côte n’est plus qu’à quelques mètres.
Depuis 2014, les habitants ne peuvent plus occuper les lieux, mais aucun dispositif d’expropriation permettant leur indemnisation n’a pu être mis en œuvre. Nous regrettons tous cet état de fait et les difficultés dans lesquelles se trouvent les copropriétaires.
Le Sénat a déjà voté deux propositions de loi intégrant une disposition en réponse à cette situation. Cela a permis de mettre en évidence un consensus sur la mise en place d’un régime transitoire d’indemnisation pour les interdictions d’habitation résultant d’un risque du recul du trait de côte. De plus, la commission des lois avait apporté des modifications au texte initial afin d’éviter que l’équilibre financier du fonds Barnier ne soit remis en cause, et je le salue de nouveau.
Or, malgré ce consensus et l’importance des enjeux, la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux reste inexplicablement bloquée par la majorité de l’Assemblée nationale. La mer monte, la plage disparaît, mais le texte, lui, pendant ce temps, s’ensable.
C’est donc pour cesser de perdre un temps précieux que l’article 3 de cette proposition de loi, initiée par notre collègue Michel Vaspart, est ici intégralement repris.
Par ailleurs, les études du Cerema, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, montrent que de plus en plus d’habitations seront touchées par ce phénomène, et l’indemnisation des propriétaires sera au cœur du problème. N’en déplaise aux sceptiques, le changement climatique est une réalité d’ores et déjà visible.
La montée du niveau des océans ainsi que l’aggravation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes qui en résultent auront un impact important sur nos côtes. Il est donc temps de se saisir de ces problèmes et d’y apporter au plus tôt une réponse appropriée.
Mes chers collègues, le groupe UC votera cette proposition de loi, car celle-ci répond à un problème urgent, tout en étant symptomatique des effets de politiques d’aménagement du littoral que nous ne pouvons plus tolérer. Souhaitons que nos collègues du Palais-Bourbon, enfin sensibles à la détresse matérielle et humaine des habitants de l’immeuble Le Signal comme à la prégnance des enjeux auxquels font face les espaces littoraux, adoptent au plus vite cette proposition de loi, mais aussi celle dont elle est issue. Nos concitoyens, nos paysages et notre économie le méritent. Alain Cazabonne, sénateur du groupe Union Centriste, compte d’ailleurs évidemment sur une large adoption de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain. – Mme Marie-Thérèse Bruguière applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, je ne surprendrai probablement personne en disant que le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera évidemment ce texte, car il vient en soutien de la proposition de notre collègue et des explications de Mme la rapporteur qui a très bien rappelé la situation. La plupart des groupes qui se sont prononcés depuis le début de la discussion générale vont dans ce sens ; nous sommes donc tout à fait solidaires de cette position.
Je suis moi-même issu d’un département littoral qui souffre de l’érosion, dans des conditions dont l’État ne se soucie pas toujours à la juste mesure. La mer a envahi il y a vingt-cinq ans notre littoral dans la partie que l’on appelle « le hâble de Ault » : la mer attaque les falaises de Ault et plusieurs rues de Ault-Onival, qui est une station balnéaire, ont dû être interdites à l’habitation. Ce sont donc des sujets que nous connaissons bien.
Par ailleurs, j’avais suivi avec beaucoup d’intérêt – le président avait bien voulu m’y déléguer au nom de l’ANEL, l’Association nationale des élus du littoral – les travaux menés par le groupe de travail mis en place par le Gouvernement à la suite des propositions de Pascale Got et Chantal Berthelot. Ce groupe de travail avait choisi un certain nombre de sites pilotes, dont la station balnéaire de Ault, une autre située sur le littoral méditerranéen et celle de Soulac-sur-Mer. Nous avons travaillé sur ce sujet depuis cinq ans au moins.
Madame la secrétaire d’État, quand vous dites que le Gouvernement va prendre ce sujet à bras-le-corps pour le résoudre d’ici à la fin de l’année, je suis tenté de vous croire – j’espère que c’est exact –, mais j’ai entendu tant d’autres ministres tenir de tels propos dans d’autres circonstances et depuis tant d’années… Comme on disait autrefois dans nos campagnes, chat échaudé craint l’eau…

En effet!
Aussi, j’aimerais voir l’engagement du Gouvernement tenu.
Honnêtement, ce problème est beaucoup plus vaste que celui que rencontrent les habitants de Soulac-sur-Mer. Mais ce qu’ils vivent est humainement intolérable. On ne peut pas laisser ces habitants seuls ; il ne s’agit pas de riches citoyens habitant dans d’énormes propriétés au bord de la mer qui perdraient quelques mètres carrés. Ces gens ont économisé, investi, construit une partie de leur vie patrimoniale et de leur retraite. Certains font des dépressions, d’autres sont malades, meurent. Cette situation est quasiment inhumaine. On sait bien que la mer monte, on ne le sait pas depuis quarante-huit heures ! La France a été à l’initiative de la COP21 : l’un des arguments majeurs avancés par les climatologues, c’est l’augmentation du niveau de la mer. Mais on fait comme si elle ne montait pas. Ils nous disent : « Résolvez les problèmes », …

… mais on ne les résout pas !
Aujourd’hui, nous voterons évidemment cette proposition et nous attendons résolument et avec attention, peut-être même avec une certaine exigence, madame la secrétaire d’État, que les engagements que vous avez pris devant nous cet après-midi soient tenus dans les meilleurs délais, dans l’intérêt des populations et de tous ceux qui, sur le littoral, sont dans la même situation.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, en deux ans, c’est la troisième proposition de loi que nous examinons ayant pour objet d’utiliser le fonds Barnier afin de résoudre le problème de l’immeuble Le Signal.
Alors que des textes plus généraux sont encore dans les tuyaux de la machinerie législative, mais risquent fort de ne pas aboutir pour cause d’ouverture de la boîte de Pandore de la loi Littoral, le texte présenté ce jour a le mérite de se limiter au Signal : cette fois-ci, c’est clair. Le sujet est délimité, mais il ouvre évidemment le dossier plus général du risque de recul du trait de côte, avec ses conséquences sur les biens bâtis au bord d’une dune sableuse. Permettez-moi de rappeler que la dune peut bouger même si le niveau de la mer n’augmente pas ; les dunes ont aussi leur propre mécanique.
Répondant à l’urgence aujourd’hui médiatisée de la perte des économies de ces propriétaires d’appartements avec vue imprenable sur la mer, ce texte prévoit de créer un usage dérogatoire du fonds Barnier pour que les copropriétaires concernés puissent bénéficier d’une indemnisation de leurs biens à hauteur de 75 % de leur valeur.
Cela a été beaucoup dit, ces propriétaires qui se trouvent dans une situation inextricable connaissent une vraie détresse.
On a ici un débat assez théorique, mais il faut peut-être tout simplement reconnaître la responsabilité de l’État dans la délivrance du permis de construire.
Mme Françoise Cartron opine.

Plutôt que d’avoir un débat très général, on devrait peut-être simplement se dire que l’État n’aurait pas dû délivrer ces permis de construire ; on aurait pu régler le problème ainsi. Tel n’a pas été le choix opéré. On en revient à un dispositif législatif, alors que l’affaire est encore actuellement pendante devant le Conseil d’État, qui se prononcera en juin.
Ce texte risque donc d’être adopté ici avant la décision de justice et celle-ci pourra sans doute recréer aussi de l’inconstitutionnalité. Il faut en être conscient, le dispositif proposé aujourd’hui reste tout à fait fragile et, ainsi que l’a relevé Mme la secrétaire d’État, ne serait pas juste.
Quoi qu’il en soit, cet exemple nous montre très clairement à quel point il faudra être prudent à l’avenir dans la gestion de l’urbanisme littoral. Il conviendra de se méfier des dispositifs temporaires, comme la création de zones constructibles potentiellement concernées par la montée des eaux et le risque de recul du trait de côte, ce que nous avions appelé les ZART, les zones d’activité résiliente et temporaire, que nous avions examinées au mois de janvier dernier – le législateur avait fait preuve là d’une très grande imagination.
Mal gérées, les ZART – elles ne font plus du tout partie, me semble-t-il, des projets du Gouvernement – pourraient conduire à ce que nous nous retrouvions avec sur les bras nombre d’immeubles similaires à celui du Signal.
Considérant que cette proposition de loi offre les garanties nécessaires à une application très circonscrite du fonds Barnier au cas de l’immeuble Le Signal, une majorité du groupe du RDSE votera ce texte, alors que l’autre partie du groupe – c’est aussi légitime – considérant qu’il pose trop de problèmes juridiques, ce cas particulier risquant de constituer une rupture d’égalité devant la loi, préférera s’abstenir.
M. Claude Bérit-Débat sourit.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit cet après-midi appelle – enfin ! – une réponse du Gouvernement, alors qu’il est sollicité pour la troisième fois sur l’éligibilité de l’indemnisation du recul du trait de côte au titre du fonds Barnier.
Mes collègues Françoise Cartron, auteur de la présente proposition de loi, et Nelly Tocqueville, rapporteur, ont parfaitement restitué le contexte avant moi : il s’agit de traiter le cas particulier des propriétaires de l’immeuble Le Signal construit à Soulac-sur-Mer, en Gironde, dans les années soixante-dix, impactés par une interdiction définitive d’habiter ou d’occuper les lieux prise en raison de l’érosion du trait de côte, tant et si bien que l’immeuble est devenu inhabitable depuis de nombreuses années déjà, sans qu’ils aient été expropriés ni indemnisés, comme cela a été répété.
Je ne voudrais pas redire ce que mes collègues ont déjà exprimé aujourd’hui, et ce qui avait été déjà dit lors de l’examen de deux précédentes propositions de loi : la proposition de loi sur le recul du trait de côte présentée par Pascale Got et la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, que j’ai déposée avec mes collègues Retailleau et Bas et qui fut largement adoptée par le Sénat en séance publique en janvier dernier.
Merci, madame la secrétaire d’État, d’avoir enfin reconnu qu’il s’agit d’un sujet stratégique : cela fait déjà plusieurs années que nous le disons au Sénat !
La proposition de loi de Françoise Cartron reprend à l’identique l’article consacré au Signal.
Les mois passent, et les propriétaires, pour la plupart de modestes retraités, attendent désormais seulement, si j’ose dire, une indemnisation.
Face à cette situation, vous nous avez opposé un refus en janvier, en nous disant que l’érosion dunaire n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 561–1 du code de l’environnement.
Il est par ailleurs pris acte du sort de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le Conseil d’État, et rejetée par le Conseil constitutionnel le 6 avril dernier. Comme cela vient d’être rappelé, le Conseil d’État doit se prononcer sur le fond en juin.
Le Gouvernement dira qu’il faut attendre juin, voire la fin d’année, comme vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État, ou bien encore d’attendre le lancement des travaux d’un groupe de travail sur l’érosion du trait de côte, que vous avez vous-même annoncé en janvier dernier, groupe de travail au sujet duquel on attend encore d’être sollicité…
Certes, la création de ce groupe de travail sera peut-être un progrès puisque le recul du trait de côte est général : il appelle une réflexion globale et des solutions de principe et pérennes de façon à anticiper ces difficultés pour les propriétaires, les élus et les professionnels de la mer.
Mais s’agissant du cas particulier de l’immeuble Le Signal, vous comprendrez, madame la secrétaire d’État, qu’il ne soit pas possible d’attendre. C’est d’ailleurs à l’unanimité que la commission a adopté ce texte le 18 avril dernier, afin de prévoir ce cas éligible au fonds Barnier.
J’y suis personnellement plus que favorable et je soutiens fortement cette proposition de loi discutée dans la niche réservée au groupe socialiste et républicain.
Il est des sujets, madame la secrétaire d’État, qui transcendent et qui devraient transcender les clivages politiques, et c’en est un. Plus généralement, la plupart des sujets qui touchent au littoral échappent aux clivages politiques, alors que certains veulent souvent, de mauvaise foi, opposer les protecteurs du littoral et les autres, ce qui finit par être insupportable.
Cependant, le Gouvernement le sait bien, ainsi que les sénateurs, qui représentent les élus locaux, ces élus locaux placés dans des situations inextricables du fait de l’interprétation jurisprudentielle fluctuante de la loi Littoral de 1986 appartiennent à tous les bords politiques. C’est un message que je m’efforce de faire passer depuis mon élection au Sénat en 2014.
Les élus locaux du littoral comme les associations de propriétaires dans ce domaine ne font pas de politique, ils sont pragmatiques : il n’est pas question de porter atteinte à l’environnement, il est seulement question, si j’ose dire, de trouver des solutions pragmatiques utiles à nos concitoyens et aux élus qui les représentent, sans dogmatisme. Et j’aimerais bien que le ministre, les secrétaires d’État et les hauts fonctionnaires du ministère soient dans le même état d’esprit.
Vendredi dernier encore, je me suis rendu à Plestin-les-Grèves, dans mon département des Côtes-d’Armor, sollicité par une famille sommée de détruire sa maison, alors qu’elle détient pourtant un permis de construire en bonne et due forme, une maison écologique à énergie positive construite dans une dent creuse. J’ajoute que la mairie s’est vu refuser l’extension de sa zone d’activité, alors qu’elle est en continuité de celle qui existe déjà. Nous allons là au-delà de la loi de 1986.
Excès de zèle ou parapluie inutile ? Madame la secrétaire d’État, cela n’est plus supportable et les élus locaux ne le supportent plus. Aujourd’hui, si le Gouvernement continue de faire la sourde oreille, ce sera non pas une erreur, mais une faute impardonnable.
Sur tous ces points, la position du Gouvernement doit être clarifiée, pour que chacun soit au clair et prenne ses responsabilités. Comment comprendre la remise à plus tard et la création de groupes de travail, alors que le travail a été fait par les représentants du peuple, notamment par le Sénat ?
Pour en revenir au Signal, je voterai cette proposition de loi sans aucune réserve, et c’est aussi la position de mes collègues du groupe Les Républicains.
Les propriétaires du Signal ne peuvent plus attendre. J’aimerais vous convaincre aussi de l’urgence à ouvrir clairement le sujet de la clarification de la jurisprudence sur la loi Littoral, en lien avec notre droit de l’urbanisme. La discussion à venir du projet de loi ÉLAN, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, peut être l’occasion de clarifications. Je le propose, je le souhaite, je l’espère et je vous en conjure.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain. – MM. Michel Dennemont et Jean-Noël Guérini applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, mon intervention vient clore un concert unanime ou presque appelant à résoudre une énigme, celle de ce qu’on pourrait appeler le mauvais génie français : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Comme l’a souligné Mme la rapporteur, forte de l’unanimité de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, la situation est ubuesque, kafkaïenne.
Ce serait risible, si soixante-quinze familles n’étaient pas en cause : non pas des investisseurs à haut niveau de revenus, ni des marchands de nuitées touristiques, mais, tout simplement, des familles, pour l’essentiel modestes, qui se sont endettées sur vingt-cinq, voire trente ans, comme l’a expliqué Françoise Cartron, en faisant confiance à un plan d’aménagement du littoral aquitain supervisé par l’État dans les années 1960.
Les planificateurs ne sont pas allés au bout de l’aménagement, car, comme par hasard, ils n’avaient pas prévu le recul du trait de côte. Le droit est rarement en amont des faits.
Depuis quatre ans, les propriétaires se voient interdire l’accès à leur bien, sans pour autant avoir été expropriés en droit, au motif que l’article L. 561–1 du code de l’environnement n’établit pas de lien formel entre l’érosion côtière et la menace grave pour la vie humaine. Par voie de conséquence, impossible pour eux d’être indemnisés par le fonds Barnier.
Cette absence de droit pose problème au regard de la responsabilité de l’État, comme l’a signalé notre rapporteur, puisque c’est lui qui a délivré le permis de construire, et de celle des collectivités territoriales – l’arrêté de péril sans expropriation, quelle hypocrisie ! –, mais aussi de l’égalité entre citoyens : quelques kilomètres plus loin, comme l’a rappelé Mme Cartron, d’autres zones ont bénéficié d’un enrochement. Au regard, aussi, des enjeux environnementaux, puisque si l’érosion rocheuse peut être prise en compte, tel n’est pas le cas de l’érosion sableuse.
Nous sommes bien en présence d’un vide juridique. Or un vide juridique est fait pour être comblé.
Tel est l’objectif de cette proposition de loi, d’une clarté à toute épreuve et d’une grande simplicité. Préciser l’article L. 561–3 du code de l’environnement, d’une manière limitée dans le temps, pour éviter toute dérive, on ne saurait faire ni plus simple ni plus efficace.
Avec ce texte, le cas qui nous préoccupe n’est pas noyé – sans jeu de mots – dans un dispositif global. Vous avez dit, madame la secrétaire d’État, qu’il faut du courage pour prendre de la hauteur : pour moi, le courage consiste parfois à admettre qu’on ne détient pas la vérité. Une certaine humilité, c’est aussi une forme de courage !

Mme Laurence Harribey. Ce matin, en commission des lois, nous avons entendu le Défenseur des droits présenter son rapport annuel d’activité pour 2017. Dans l’éditorial qui ouvre ce rapport, Jacques Toubon écrit : « Le droit est le ciment d’une commune humanité sans cesse à construire. » Madame la secrétaire d’État, je vous invite à un peu d’humanité et à moins de calculs politiciens dans cette affaire : l’ensemble de nos institutions en sortiront grandies !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains. – MM. Ronan Dantec et Yvon Collin s ’ exclament.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Le fonds mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement finance les indemnités allouées aux propriétaires d’un bien immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou d’occuper les lieux prise en raison du risque de recul du trait de côte pour des faits intervenus avant le 1er janvier 2017, à l’exception des immeubles dont le permis de construire a été délivré par le maire au nom de la commune, en application d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme.
Ces indemnités sont évaluées sans prendre en compte ce risque et leur montant maximum est fixé à 75 % de la valeur estimée de chaque bien.

Madame la secrétaire d’État, vous avez fait connaître, il y a quelques instants, votre avis négatif sur la proposition de loi.
C’est la cinquième fois en peu de temps qu’une proposition de loi reçoit un avis négatif du Gouvernement. Celle sur l’eau et l’assainissement, celle sur la loi Littoral, celle de Patrick Chaize sur le numérique et la mienne, sur le ferroviaire : autant de textes, portant sur des sujets variés et déposés par des groupes divers, auxquels le Gouvernement s’est opposé. Nous devrions donc être habitués !
Et pourtant… Comme vous l’avez compris aux réactions suscitées par votre intervention, tous, à quelque groupe que nous appartenions, nous sommes choqués par cette position du Gouvernement.
Tout simplement parce que, comme l’ensemble des orateurs l’ont expliqué, à commencer par l’auteur de la proposition de loi et la rapporteur, nous sommes face à des drames humains absolument épouvantables. Quand des familles ne peuvent plus habiter leur logement, mais continuent de payer des remboursements d’emprunt et doivent en même temps payer un loyer, ce qui les accule parfois dans des situations dramatiques, le « on verra plus tard » est juste tout à fait insupportable !
Mme Françoise Cartron opine.

Il est d’autant plus intolérable que l’État est totalement responsable de cette situation : c’est lui qui a aménagé, lui qui a délivré le permis de construire, lui encore qui n’a pas su prendre les mesures nécessaires pour éviter l’érosion côtière qui entraîne les difficultés actuelles.
Tous, madame la secrétaire d’État, quels que soient notre groupe et la région que nous représentons, nous ne pouvons pas comprendre la position que vous défendez.
Voilà quatre ans déjà, un de vos lointains prédécesseurs, M. Martin, éphémère ministre de l’écologie, avait affirmé que le gouvernement prendrait dans des délais très proches les mesures qui s’imposaient. Quatre ans plus tard, nous en sommes au même point, et le Gouvernement nous dit toujours la même chose. Ce n’est pas acceptable !
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain. – M. Emmanuel Capus applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de loi s’inscrit pleinement dans la démarche et les compétences de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui a pris une position unanime. Bien entendu, comme tous les membres de la commission, je la voterai.
Madame la secrétaire d’État, l’enjeu est extrêmement important : alors que la situation est catastrophique pour de nombreuses familles, on ne peut pas comprendre que l’on remette les décisions à plus tard.
Il se trouve que je siégeais dans cet hémicycle lorsque la loi Barnier a été votée. J’ai le souvenir précis que, si elle a été adoptée, c’est justement pour répondre à des situations correspondant à ces circonstances. La Seine-Maritime était directement concernée, à la suite d’événements que nous avions connus, mais d’autres territoires l’étaient aussi.
Madame la secrétaire d’État, alors que c’est l’État qui a pris les décisions et procédé aux aménagements, pourquoi s’opposer à une proposition de loi qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi Barnier ?
J’ai bien compris que, en s’appuyant sur le code de l’environnement, le Gouvernement considère qu’on ne peut pas recourir aux financements de la loi Barnier pour répondre à ces situations. Vous proposez donc de reporter les décisions, en y associant l’ensemble des partenaires concernés.
Je m’appuierai, moi, sur la démarche lancée par M. le Premier ministre, qui vient d’emmener le Gouvernement dans le Cher pendant trois jours pour voir comment les choses fonctionnent sur le terrain et se montrer proche de celui-ci, pour suggérer à M. le président de la commission que celle-ci se rende sur place, afin de souligner l’importance de l’enjeu et la nécessité de prendre en compte réellement et rapidement ces situations inacceptables !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la secrétaire d’État, vous ne serez pas surprise que mon intervention s’inscrive dans le droit-fil de celles des orateurs précédents.
Voilà quelques mois, j’ai été le rapporteur d’une proposition de loi de Michel Vaspart portant sur le même sujet, puisque son article 3 traitait le cas de l’immeuble Le Signal. Force est de reconnaître que la question n’a pas beaucoup avancé…
Ce qui me désole et m’exaspère, comme un certain nombre de mes collègues sur les différentes travées de notre assemblée, c’est que le texte précédent a été jeté aux orties et que celui-ci prendra le même chemin – vous nous l’avez d’ores et déjà annoncé – sans que la question posée soit résolue.
Je souhaite que, dans les semaines et les mois qui viennent, vous trouviez des solutions rapides. J’ose espérer que le fonds Barnier ne sera pas sollicité : cela voudrait dire que nous aurions perdu beaucoup de temps, que la difficulté aurait pu être résolue bien plus tôt.
En ce qui concerne le fonds Barnier, je rappelle que le gouvernement précédent avait procédé à une ponction de 55 millions d’euros. L’actuel, le vôtre, a ponctionné 71 millions d’euros, non pas directement, mais en plafonnant à 137 millions d’euros…

… le budget global de ce fonds, dont vous savez bien qu’il pourrait être utilisé – c’est un constat relativement partagé.
Le président de la commission a énuméré les différentes propositions de loi qui ont été jetées, non pas en pâture à l’Assemblée nationale, mais dans des puits sans fond. Je regrette que celle-ci, déposée par Mme Cartron et bien rapportée par Mme Tocqueville, subisse le même sort.
Madame la secrétaire d’État, vous avez encore la possibilité de résoudre la question du Signal. À une situation exceptionnelle, vous devez pouvoir trouver une solution exceptionnelle. Le fonds Barnier pourrait être utilisé : il vous suffit d’accepter le dispositif que nous proposons !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi, qui certes a un caractère exceptionnel, permet d’envoyer un message fort sur le registre du symbolique.
L’évolution du trait de côte est une préoccupation constante des riverains, qui se perçoivent comme des victimes potentielles. Je puis vous assurer que les porter à connaissance des zones rouges définies dans les plans de prévention des risques de submersion marine par les DREAL suscitent une grande anxiété, notamment dans le département de la Manche, qui a plus de 330 kilomètres de côte.
Il est donc indispensable que la représentation nationale s’approprie le sujet, s’agissant du droit des sols comme des processus de déplacement des activités et des populations – souvenons-nous de nos débats de janvier dernier sur la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux.
Nous devons également prévoir les modalités de mobilisation de nouveaux moyens pour faire face aux indemnisations.
Certes, il faut une approche globale ; mais le mieux est souvent l’ennemi du bien. Cette proposition de loi, bien que de portée limitée, constitue une avancée. Elle est l’expression du courage de traiter rapidement une situation exceptionnelle et d’une volonté immédiate, à l’inverse de ce qui pourrait être considéré comme une forme de mépris, consistant à toujours remettre les décisions à plus tard. C’est pourquoi je la voterai !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous n’en sommes pas encore aux explications de vote.
La parole est à Mme Françoise Cartron, sur l’article unique.

J’ai bien entendu l’exposé de Mme la secrétaire d’État. Sans répéter tout ce qui a été dit à propos du Signal, je voudrais souligner que cette proposition de loi illustre ce que peut être le travail parlementaire et le rôle d’initiative que peut jouer le Sénat, composé d’élus des territoires porteurs de la voix et des réalités de ceux-ci.
Il y a aujourd’hui dans notre pays une grande défiance envers les élus, les décideurs quels qu’ils soient et tous les gouvernements.

On a l’impression qu’ils sont impuissants à résoudre les problèmes les plus simples !
J’entends que, d’un point de vue technique, technocratique, il est très compliqué de trouver une solution en s’appuyant sur tel texte, amendement, contre-texte ou autre. Mais le résultat, c’est que, depuis cinq ans – ce n’est donc pas un procès fait à ce gouvernement –, nous sommes dans l’immobilité, alors que des gens sont expulsés de chez eux sans indemnité.
Peut-on imaginer cette violence ? D’une certaine manière, notre rôle de parlementaires n’est-il pas d’être la voix des plus faibles, de ceux qui subissent, face à une machine administrative parfois complètement inhumaine ?
Cette proposition de loi est une perche tendue au Gouvernement pour qu’il s’en saisisse. Il faut ou bien qu’elle soit adoptée, ou bien qu’une mesure dérogatoire soit prise ; mais, surtout, ne repartons pas dans des lois globales, ou des espèces de tables rondes où personne ne sera d’accord ! Car, au bout du compte, les habitants du Signal assisteraient, impuissants, à l’impuissance des politiques.
Rendons service à notre pays en nous montrant efficaces et pragmatiques, comme le dit souvent le Président de la République !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, madame la rapporteur, mes chers collègues, quelle grande déception, vraiment, de devoir à nouveau discuter de cette question, que le Sénat a déjà tranchée à plusieurs reprises !
Pourquoi sommes-nous dans cette situation ? Tout simplement parce que, comme l’ont souligné plusieurs de nos collègues, parmi lesquels Michel Vaspart, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, le Gouvernement et celui qui l’a précédé n’ont pas voulu prendre leurs responsabilités pour traiter ce problème.
Il y a, bien sûr, le problème de l’immeuble Le Signal, symptomatique des difficultés que nous rencontrons du fait du recul du trait de côte ; mais il n’épuise pas le sujet.
Nous avons récemment adopté une proposition de loi, cosignée par Michel Vaspart, Bruno Retailleau et moi-même, mais aussi beaucoup d’autres parmi vous. À cette occasion, une quasi-unanimité s’est exprimée au Sénat pour une approche globale de toutes les conséquences à tirer pour l’action publique du recul du trait de côte, s’agissant y compris du redéploiement des installations et de la construction dans les dents creuses, sans oublier l’évolution du fonds Barnier et de ses financements.
Il n’est pas admissible que, chaque année, le gouvernement détourne pour le budget de l’État une partie du produit de ce fonds
M. Jean-Paul Émorine opine.

… qui vient tout de même des assurances ! Alors que nous avons les moyens d’agir avec le fonds Barnier, on le dégonfle artificiellement pour utiliser cet argent à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été institué !
Je préférerais de beaucoup qu’on élargisse les possibilités de financement du fonds Barnier et que l’on traite l’ensemble des questions, y compris celles qui sont relatives à la construction, quand il n’y a pas de vue sur le littoral, sur les terrains compris entre deux terrains construits, sans altérer en rien nos paysages.
Que le Gouvernement prenne ses responsabilités en inscrivant à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale les textes que nous avons votés ! Je lui dis : n’ayez pas d’amour-propre d’auteur, car le problème est de régler les difficultés qui assaillent de très nombreux Français devant le recul du trait de côte !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain, ainsi qu ’ au banc des commissions. – M. Olivier Cigolotti applaudit également.

Madame la secrétaire d’État, vous avez invoqué la volonté de traiter ce sujet dans un texte global. La proposition de loi de notre collègue Michel Vaspart sur le développement durable des territoires littoraux est un texte global… Puisqu’il semble qu’on nous oppose aujourd’hui une fin de non-recevoir, il est urgent d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, en écho à la remarque de notre collègue Françoise Cartron sur l’immobilisme, je tiens à souligner, à l’heure où l’on parle beaucoup de révision constitutionnelle, que, sur cette question, le Sénat démontre son efficacité et sa persévérance, en jouant tout son rôle pour défendre les territoires et les gens en situation d’extrême difficulté !
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. Efficace et pragmatique, a dit Mme Cartron. C’est bien ainsi que le gouvernement auquel j’appartiens entend travailler, contrairement au gouvernement précédent.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Mes chers collègues, veuillez laisser Mme la secrétaire d’État poursuivre.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. J’entends bien poursuivre… Contrairement à la méthode du gouvernement précédent, nous voulons, sur cette question-là, adopter une approche à la fois globale et spécifique : c’est le fameux « en même temps ».
Exclamations et rires sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Une approche globale, parce que l’érosion du trait de côte est une réalité dans notre pays, et que vous, élus des territoires, serez peut-être confrontés à d’autres questions comme celle-là.
La France a un domaine littoral et des côtes partout !
Cela n’empêche pas, madame Cartron, que nous entendions les personnes modestes dont vous avez parlé, qui souffrent de cette situation.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. C’est pourquoi nous allons nous attaquer à la question de façon spécifique. Nous pourrions vous faire croire, comme on l’a fait par le passé
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

M. Philippe Bas. Vous nous avez dit la même chose il y a trois mois, et vous n’avez rien fait !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe socialiste et républicain.
Nous n’allons pas entrer à cet instant dans ce débat particulier.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. Discutez-en aussi avec vos collègues de l’Assemblée nationale, dont certains travaillent sur une proposition de loi globale. En janvier, nous avons essentiellement parlé de la loi Littoral.
M. Philippe Bas fait un signe de dénégation.

Inscrivez donc la proposition de loi Vaspart à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale !
Pour ce qui est de l’immeuble Le Signal, nous allons travailler en liaison étroite avec vous, madame Cartron, pour trouver une solution pragmatique.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. Il est vrai qu’il y a des personnes qui souffrent, là-bas : nous ne voulons pas les abandonner !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Reste que, sur les territoires, d’autres immeubles pourraient se trouver dans la situation du Signal dans les années et les décennies à venir, parce que la réalité du changement climatique, elle est maintenant. C’est pourquoi nous voulons aussi agir à cette échelle : c’est le fameux « en même temps », auquel nous tenons !
Rires et exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le vote sur l’article unique vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi.
Avant donc de mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Madame la secrétaire d’État, j’ai été très touché par la dernière intervention de Françoise Cartron, qui m’a semblé très juste.
Dans cette situation inextricable, où la responsabilité de l’État est engagée, il faut une réponse rapide. Il ne faut surtout pas mélanger la situation du Signal et les réponses à l’évolution du trait de côte liée au réchauffement climatique.

Si vous faites les deux à la fois, vous n’arriverez à rien !
Il faut que vous agissiez de manière extrêmement rapide, probablement – parlons clair – en faisant un chèque aux habitants de cet immeuble, parce que la responsabilité de l’État est engagée.
Ainsi nous sortirons de cette situation qui nous empêche d’avoir un vrai débat sur la loi Littoral, à propos de laquelle, monsieur Bas, il n’y a pas de consensus : la zone d’activité résiliente et temporaire instaurée par la proposition de loi Vaspart est un dispositif extrêmement mauvais, qui créerait de nombreux Signal !
Une partie des dispositions de cette proposition de loi ne doivent pas être suivies, même si, dans de nombreuses situations – M. Vaspart et moi-même en discutons souvent –, il faut trouver des solutions, y compris en construisant des consensus dérogatoires, comme je le propose depuis longtemps.
En tout cas, ne mélangeons pas les deux questions. Que l’État trouve d’abord les quelques millions d’euros qui régleront le problème du Signal, problème qui envoie un message extrêmement négatif sur sa capacité à répondre aux injustices – il est important de le faire tout de suite. Ensuite, madame la secrétaire d’État, il faudra que vous mettiez rapidement les acteurs autour de la table pour trouver des consensus sur la loi Littoral.
En ce qui concerne la proposition de loi sénatoriale, je tenais à rappeler qu’il n’y avait pas eu de consensus, …

Mme la secrétaire d’État plaide pour une approche globale : très bien, mais alors, comme l’a fait observer Mme Billon, pourquoi ne pas avoir inscrit la proposition de loi de Michel Vaspart à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ?
Si, madame la secrétaire d’État, ses dispositions ne vous conviennent pas, il est tout loisible à l’Assemblée nationale de les modifier. Je suis désolé de faire un petit cours de droit constitutionnel, mais ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord avec un texte voté par le Sénat qu’on ne doit pas l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale… §Les députés peuvent modifier un texte qui ne correspond pas aux souhaits de la majorité de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.
De même, pourquoi ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour du Sénat la proposition de loi de notre collègue députée Pascale Got, examinée deux fois par l’Assemblée nationale sous la précédente législature et que la fin des travaux parlementaires l’année dernière nous a empêchés d’examiner en deuxième lecture ?
D’un côté, on n’inscrit pas à l’ordre du jour les textes qui ont une approche globale, sans que nous sachions pourquoi ; de l’autre, quand il y a un texte spécifique, on dit qu’il faut une approche globale !
Monsieur Revet, je suis tout prêt à aller avec la commission à Soulac-sur-Mer, …

… mais je crois qu’il faudrait surtout convaincre Mme la secrétaire d’État d’y aller.

Si elle voyait la situation sur le terrain et rencontrait les familles plongées dans des drames, peut-être le Gouvernement aborderait-il la question de manière différente.
Quoi qu’il en soit, j’observe que, pour la troisième fois, nous allons voter un dispositif qui remédie à cette situation dramatique, et que, pour la troisième fois, notre vote ne servira à rien. Pour la troisième fois, on nous dit : on verra plus tard…
Dans ces conditions, je ne puis malheureusement que rejoindre Mme Cartron : une fois de plus, on va donner l’image d’un Parlement impuissant et qui ne sert à rien, et j’en suis navré !
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Michelle Gréaume applaudit également.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi visant à instaurer un régime transitoire d’indemnisation pour les interdictions d’habitation résultant d’un risque de recul du trait de côte.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 99 :
Nombre de votants341Nombre de suffrages exprimés335Pour l’adoption334Contre1Le Sénat a adopté.
Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Les Républicains.
Sourires.

Madame la secrétaire d’État, constatez ce vote : il est unanime ! Il est aussi l’expression de ce que Mme Cartron décrivait précédemment, l’expression de la capacité et de la volonté des parlementaires de se faire l’écho des préoccupations de nos concitoyens et de nos territoires.
Ce vote, je pense, mérite plus que d’être pris en compte par le gouvernement auquel vous appartenez. Il vous faut reprendre ce texte à l’Assemblée nationale, parce que le Sénat a manifesté cette volonté d’être présent aux côtés de nos concitoyens qui vivent ce drame, mais aussi parce que nous nous devons d’être honnêtes à leur égard.
Les propositions que vous avez avancées aujourd’hui ne peuvent pas nous convenir, tout comme l’approche globale n’est en rien satisfaisante.
Vous avez parlé d’un désamiantage… Dans quelle situation se trouvent les propriétaires d’un immeuble désamianté ? Nous demeurons dans cette situation tout à fait kafkaïenne, pour reprendre la qualification que j’ai précédemment utilisée !
Madame la secrétaire d’État, cette unanimité doit vous inciter à apporter votre soutien à notre texte !
À la fin de cette séance, lorsque nous serons sortis de l’hémicycle, nous poursuivrons ensemble le travail. Nous continuerons à travailler pour que les copropriétaires du Signal finissent par avoir gain de cause. Nous le leur devons ! C’est une simple question d’honnêteté, mais aussi une question d’assistance à personne en danger !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains. – Mme Michelle Gréaume applaudit également.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi renforçant l’efficacité des poursuites contre les auteurs d’infractions financières et supprimant le « verrou de Bercy », présentée par Mme Marie-Pierre de la Gontrie et plusieurs de ses collègues (proposition n° 376, résultat des travaux de la commission n° 447, rapport n° 446).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le vice-président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 2 avril 2013, celui-là même qui était parfois assis, dans cet hémicycle, au banc du Gouvernement, chargé quelques mois plus tôt par le Premier ministre de redresser les comptes publics et de lutter contre l’évasion fiscale, celui-là même qui, devant la représentation nationale, avait menti en niant catégoriquement avoir jamais détenu de compte bancaire à l’étranger, ce jour-là, le 2 avril 2013, Jérôme Cahuzac reconnaissait détenir des fonds non déclarés sur un compte bancaire, en Suisse, puis à Singapour.
Nous le savons, l’histoire de la lutte contre la fraude et la corruption progresse souvent par crises. Crises de confiance, d’abord.
Ce coup porté à la démocratie, ébranlant l’opinion, a agi comme un électrochoc et ouvert la voie à des avancées majeures dans cette lutte et dans la transparence de la vie publique.
À ce moment-là ont été créés la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – la HATVP –, le Parquet national financier, l’Office central de lutte contre la fraude et les infractions financières et fiscales. Des législations spécifiques, dont nous nous souvenons, ont en outre été adoptées.
Si le bilan du quinquennat de François Hollande en matière de lutte contre la fraude fiscale est jugé positivement par des ONG – organisations non gouvernementales – comme Transparency International, c’est en partie grâce à l’instauration de ces nouvelles institutions, désormais incontournables.
Mais nous devons aujourd’hui aller plus loin.
Nous l’avons vu lors de la campagne présidentielle de 2017, elle aussi marquée par une profonde crise. Les scandales qui l’ont rythmée sont à l’origine des lois sur la transparence de la vie politique de septembre 2017. Ils nous rappellent à tous qu’on ne parvient jamais au bout du chemin et que celui-ci est semé d’obstacles, qu’il nous revient de dépasser.
C’est bien d’obstacle dont il est question aujourd’hui. Cet obstacle a un nom – et un surnom, « verrou de Bercy » – : il s’agit de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, en vertu duquel l’auteur d’une infraction fiscale ne peut être poursuivi que sur plainte de l’administration et, au surplus, sous réserve d’un avis conforme de la commission des infractions fiscales, la CIF.
Nous le connaissons dans cet hémicycle, puisque, à plusieurs reprises au cours des dernières années, le Sénat a voté en totalité la suppression ou l’assouplissement de ce verrou de Bercy. Ce fut notamment le cas en mars 2016, avec l’adoption d’un amendement déposé par notre collègue Éric Bocquet, ou encore plus récemment, en 2017, avec l’adoption d’un amendement proposé par notre collègue Éliane Assassi.
Par deux fois, l’Assemblée nationale s’est engagée dans la même démarche. Pourtant, en 2017, décision a été prise de se donner un temps de réflexion supplémentaire. Nos collègues députés ont créé une mission d’information commune sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, commission qui rendra son rapport dans les jours à venir.
Suppression prématurée, nécessité d’une réflexion plus approfondie, c’est généralement le dernier argument utilisé quand il n’en reste pas, quand tous les autres ont été épuisés. Gageons donc que le moment est opportun !
Ce verrou, en effet, est une anomalie dans notre droit. Comment continuer à accepter qu’un tel système, sans équivalent en Europe, perdure, dans lequel la justice ne peut se saisir d’office des infractions fiscales, y compris lorsqu’il s’agit de fraudes majeures ? Comment accepter ce nihil obstat sur la répression de la fraude fiscale ?
Cette situation heurte le principe de transparence, réclamé chaque jour davantage par nos concitoyens, et l’indépendance de la justice à laquelle nous sommes tant attachés.
Cette anomalie est largement dénoncée, au-delà des travées du Sénat.
Ainsi Éliane Houlette, procureur de la République financier, devant l’Assemblée nationale voilà quelques jours, a dénoncé la situation en ces termes : « le verrou bloque toute la chaîne pénale. Il empêche la variété des poursuites et constitue un obstacle théorique, juridique, constitutionnel et républicain, en plus d’être un handicap sur le plan pratique. »
François Molins, procureur de la République de Paris, considère que « la situation telle qu’elle résulte de l’actuelle rédaction de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales n’est plus tenable », rappelant que ce monopole est « contraire à certains principes, freine dans leur action les procureurs de la République sans aucune raison objective ».
Déjà, en août 2013, la Cour des comptes s’exprimait en des termes sans équivoque dans un référé. Selon elle, le « verrou de Bercy » est « préjudiciable à l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale ».
De nombreuses ONG – j’ai cité Transparency International, mais on peut ajouter Oxfam, Sherpa ou Anticor – rappellent depuis plusieurs années la désuétude de ce dispositif.
Il est donc plus que temps d’y mettre fin, car il est indispensable que la justice puisse se saisir en toute transparence des infractions fiscales, en particulier des plus graves.
Nous regrettons que le Gouvernement ait fait le choix de l’immobilisme, en n’intégrant pas cette disposition dans le projet de loi présenté le 28 mars dernier et dont nous aurons à débattre dans quelques semaines.
Effectivement, le Gouvernement continue aujourd’hui – avec des déclarations assez évolutives, mais c’est le cas depuis plusieurs années – de soutenir le dispositif. Il l’a encore fait devant la mission de l’Assemblée nationale que je mentionnais il y a quelques instants.
Il invoque des motifs d’efficacité et de compétence fiscale d’une haute technicité. Ce point de vue, pourtant, ne tient compte ni du gain d’efficacité indéniable rendu possible par la Cour de cassation, qui a étendu les moyens de l’autorité judiciaire et a permis l’ouverture d’une enquête à l’encontre de Jérôme Cahuzac au titre de blanchiment de fraude fiscale, ni de la procédure d’enquête judiciaire créée par la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative.
Pour peu qu’on lui en donne les moyens, la justice française ne fait pas défaut !
La situation doit aujourd’hui être assumée face à l’opinion, qui a évolué et qui est devenue plus favorable à la suppression de ce verrou après les révélations des affaires WikiLeaks, « Panama papers » et « Paradise papers ».
Ces arguments ne peuvent plus tenir devant les citoyens français, soucieux du respect des principes démocratiques. Ils ne tiennent plus devant les contribuables, qui voient le principe du consentement à l’impôt bafoué sous leurs yeux. Ils ne peuvent tenir davantage devant les justiciables français, qui ignorent sur quels critères se fonde l’administration fiscale pour désigner les 1 000 dossiers qu’elle transmet chaque année au Parquet national financier, sur les 4 000 dossiers considérés comme représentant des fraudes graves.
Selon le président de la commission des infractions fiscales, mes chers collègues, il conviendrait de ne pas divulguer les critères présidant à ces choix, qui font pourtant l’objet de poursuites, afin de ne pas permettre aux contribuables, paraît-il, de monter des stratégies d’évitement et pour laisser la justice extérieure à ces dossiers.
Face aux citoyens, contribuables et justiciables, pouvons-nous prétendre à l’efficacité d’un dispositif permettant à l’administration fiscale de traiter certains dossiers, sans contradictoire, sans motivation des décisions prises et, comme l’avait déjà souligné Éliane Houlette, précédemment citée, sans information du Parquet national financier ?
Ce dispositif, manquant de transparence, n’engendre qu’une faible coordination entre la justice et l’administration fiscale, ce à quoi nous ne pouvons nous résoudre.
À ce propos, nous pensions que M. Gérald Darmanin serait présent parmi nous aujourd’hui, mais je suis heureuse de compter sur la présence de M. Olivier Dussopt. J’ai effectivement bien noté que ce dernier avait exprimé voilà quelques mois une position allant dans notre sens, en tout cas critique à l’encontre de l’instauration du « verrou de Bercy ». J’imagine donc qu’il fera preuve d’ouverture d’esprit par rapport à notre démarche de ce jour.
On parle aujourd’hui d’une question d’efficacité. Alors que le coût actuel de la fraude fiscale pour la Nation s’établit entre 60 et 80 milliards d’euros, nous devrions donc maintenir un dispositif si efficace, prétend-on, qu’il permet de recouvrer seulement 11 milliards d’euros pour l’année 2016. Ainsi, 75 % des dossiers échappent à la justice, dans des conditions que nous ignorons, pour des motifs qui nous sont inconnus et selon des règles obscures pour tous.
S’agissant de rentabilité financière, rappelons que nul ne peut prétendre que l’intervention de l’administration permettrait de récupérer plus de fonds qu’un passage par la justice. L’exemple de Jérôme Cahuzac le montre : taxé pour comportements délictueux au regard de l’impôt, celui-ci a aussi été sanctionné, nous l’avons vu hier, la règle non bis in idem ayant été écartée.
Le risque d’engorgement est aussi évoqué par certains, notamment par la garde des sceaux, dont je regrette l’absence dans cet hémicycle – la question concerne tout de même le code pénal et le code de procédure pénale.
Cet argument est réfuté par François Molins, que j’ai déjà cité. Selon lui, l’autorité judiciaire a vocation non pas, évidemment, à se saisir des 16 000 dossiers d’irrégularité fiscale, mais à exercer le principe bien connu de l’opportunité des poursuites.
Sur la nécessaire technicité, là aussi, c’est assez étrange… En effet, la Direction générale des finances publiques ou DGFiP – le monument de compétences sur ces questions – a elle-même indiqué, dans une circulaire du 22 mai 2014, que l’instauration du parquet financier, sujet du moment, rendait possible « une spécialisation du ministère public permettant d’accroître son action contre la très grande délinquance économique et financière, dont relève la fraude fiscale complexe ».
De même, dans son rapport, notre collègue de la commission des finances, que je salue, soulignait l’apport des techniques spéciales d’enquête dont bénéficient les services judiciaires dans les cas des fraudes les plus complexes.
C’est bien dans ce cadre de collaborations que nous devons nous situer.
Mes chers collègues, il est temps ! La mission de l’Assemblée nationale va rendre son rapport. Les affaires et les révélations se succèdent. La démocratie est mise à mal. Nous devons prendre nos responsabilités !
Portant devant vous cette proposition de loi, avec l’ensemble de mes collègues du groupe socialiste et républicain, je m’exprime ici alors que des semaines d’auditions ont eu lieu à l’Assemblée nationale.
En ce moment même, les affaires dévoilées par la presse et les lanceurs d’alerte se succèdent ou sont en cours d’investigation. Chacune d’entre elles constitue un acte de résistance de la démocratie, …

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. … mais en ébranlant l’opinion, elles agissent comme autant de crises de confiance, et c’est là le paradoxe. Allons-nous justifier le statu quo jusqu’à ce que la démocratie s’en trouve suffisamment affaiblie, ou bien allons-nous saisir l’occasion qui nous est donnée aujourd’hui de faire face aux responsabilités propres à notre fonction, en supprimant cette anomalie française qu’est le « verrou de Bercy » ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi nous permet de porter un regard plus approfondi sur un mécanisme qui revient régulièrement dans nos débats depuis 2013, après, faut-il le rappeler, qu’un ministre chargé du budget a été reconnu – reconnaissance pleine et entière depuis hier – comme fraudeur fiscal, une première dans cette République, ou qu’un secrétaire d’État s’est trouvé pris de phobie administrative.
Cette conjonction malheureuse pour deux anciens ministres socialistes, à l’époque a permis de faire connaître ce sujet original dans notre droit que l’on nomme « verrou de Bercy ». Elle explique aussi cette proposition de loi de Marie-Pierre de la Gontrie et du groupe socialiste et républicain, ouvrant le débat qui devra nous rassembler, monsieur le secrétaire d’État, sur le sujet de la fraude fiscale.
Le Sénat, dans la volonté de recherche de consensus qui le caractérise et qui fait la force du bicamérisme, présentera des propositions ambitieuses allant vers plus de transparence, sans supprimer le verrou.
Nous allons en égrener quelques-unes, bien avant le rapport de nos collègues de l’Assemblée nationale.
Le sujet, rappelons-le, n’est pas médiocre. Il touche à la conciliation de plusieurs principes qui se trouvent au cœur du pacte républicain : l’efficacité, l’égalité, mais aussi le principe de réalité.
Je voudrais d’abord revenir sur le mécanisme de ce fameux verrou.
Chaque année, l’administration conduit 1 million de contrôles sur pièces, mais surtout 50 000 contrôles fiscaux sur place.
L’objectif du contrôle fiscal est triple : recouvrer, sanctionner, dissuader. L’administration cherche donc à récupérer les droits et peut appliquer des pénalités allant de 40 % à 100 % selon les cas. L’application de ces pénalités de 40 % et plus concerne 15 000 dossiers, pour 4 à 5 milliards d’euros par an, soit 0, 2 point de PIB.
Tous ces dossiers n’ont pas vocation à être déférés devant l’autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel a limité aux cas les plus graves la possibilité de cumuler sanction administrative et sanction pénale.
Sur les 50 000 contrôles fiscaux externes, 4 000 sont qualifiés de « répressifs ». À ce stade, nous n’en sommes pas encore au « verrou de Bercy », à proprement parler. Nous nous situons non pas au 139 rue de Bercy, mais dans les directions départementales des finances publiques, les DDFiP.
L’administration centrale n’a pas à avoir connaissance de ces dossiers – encore moins le cabinet du ministre, dont la cellule fiscale a été supprimée en 2010. En fait, elle ne reçoit que 1 100 dossiers par an et les transmet presque tous à la commission des infractions fiscales.
Nous en arrivons alors à un élément central du verrou, lequel est en fait double, avec, du coup, possibilité d’une double critique.
D’une part, une plainte pénale pour fraude fiscale est irrecevable si elle n’est pas déposée par l’administration fiscale. D’autre part, cette administration ne peut déposer plainte que si elle y est autorisée par la CIF, ce qu’elle fait dans 90 % à 95 % des cas tant l’administration a intériorisé l’exigence de cette commission.
Je préfère le dire avec solennité : les membres de la CIF tout comme les équipes de l’administration fiscale sont indépendants et me semblent irréprochables. Les soupçons exprimés à l’encontre du verrou sont relativement insultants pour eux et pour le travail qu’ils réalisent. Ne cédons pas aux modes, car ce climat de défiance généralisé n’est pas sain !
Pour autant, j’invite les fonctionnaires, dès lors qu’ils n’ont rien à se reprocher, à ne pas avoir peur de plus de transparence et j’en viens aux pistes qui permettraient de rendre le dispositif « translucide » – la lumière passe, mais on ne peut pas identifier les personnes.
Aujourd’hui, la transparence est assurée par un certain nombre de rapports – rapport d’activité de la CIF, rapport au Parlement sur les remises et transactions, rapport du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes –, et ce sans compter les enquêtes menées régulièrement par la Cour des comptes.
Ce n’est plus suffisant, vous l’avez dit, madame Marie-Pierre de la Gontrie, et cela n’éclaire pas entièrement la question des critères utilisés pour la transmission des dossiers à la CIF.
Ces critères, réglés par circulaire, ont été en partie repris par le Conseil constitutionnel. Ce sont le montant des droits fraudés ; les manœuvres du contribuable, qui constituent une circonstance aggravante ; les circonstances relatives à la personne même du fraudeur, en espérant que le cas d’un ministre chargé du budget soit une exception.
Première proposition, monsieur le secrétaire d’État, la transparence pourrait être améliorée par l’inscription de certains de ces critères dans la loi.
L’importance de la question justifie effectivement l’intervention du Parlement. Mais il faut veiller à ne pas trop rigidifier le système : imaginons par exemple que l’on souhaite inscrire un seuil de 100 000 euros, seuil le plus communément admis, il faudrait trouver une rédaction qui supprime tout risque d’annulation de la procédure au motif qu’une fois devant le juge, on s’est rendu compte que le montant de l’impôt dû s’élevait à 99 500 euros seulement !
Je suis donc opposé à l’inscription d’un montant dans la loi.
Deuxième proposition, la transparence pourrait aussi être améliorée par un contrôle plus diversifié.
Je plaide pour un contrôle plus systématique, mais sous sa forme habituelle, par l’Inspection générale des finances dans les différentes DDFiP, ainsi que par la Cour des comptes du point de vue consolidé.
Gérald Darmanin a suggéré de faire entrer des parlementaires à la commission des infractions fiscales. Je ne pense pas que ce soit notre place ou notre mission, d’autant que le volume de travail de cette commission serait difficilement compatible avec notre agenda.
En revanche, troisième proposition, nous pourrions envisager que des parlementaires, habilités à cet effet, contrôlent les 50 dossiers rejetés chaque année par la CIF, afin de comprendre les raisons pour lesquelles il a été décidé de ne pas les transmettre à la justice. Ces parlementaires pourraient également, par voie de sondage, examiner une partie des 3 000 dossiers non transmis par l’administration à la CIF.
Bien entendu, ils devraient appartenir à tous les bords politiques, condition indispensable au rétablissement de la confiance.
Un tel examen, qui permettrait de comprendre concrètement le fonctionnement du système, me paraîtrait plus efficace que l’audition annuelle de la CIF prévue par la loi de 2013.
Quatrième proposition, les membres de la CIF désignés par les présidents des deux assemblées pourraient, plus logiquement, être proposés par le président et le rapporteur général des commissions des finances, afin d’assurer la pluralité.
S’agissant de la critique portant sur le principe d’égalité de traitement, elle s’appuie notamment sur l’intervention – fantasmée, je l’ai dit – du ministre dans certaines situations individuelles. Je rappelle, une fois de plus, que la cellule fiscale au cabinet du ministre a été supprimée en 2010.
Dans ce cadre, se pose aussi la question des transactions régies par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, car ces dernières supposent une négociation et laissent à l’administration une marge d’appréciation, d’ailleurs assez proche de celle du juge, qui, parfois, condamne un fraudeur exemplaire à 300 000 euros d’amende, alors qu’il aurait pu fixer le montant à 375 000 euros.
Dans les cas les plus importants, les transactions donnent lieu à une transmission au Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Elles font l’objet d’un rapport annuel au Parlement et je voudrais montrer que leur ampleur n’est pas celle que l’on croit.
Les transactions n’ont concerné que 294 des 4 000 dossiers les plus importants, pour un montant total de 12, 5 millions d’euros. Pour l’essentiel, elles ont été passées avec des entreprises, les particuliers ne représentant qu’une petite part de 28 transactions, correspondant à un montant remis de 1, 8 million euros.
Ces transactions se justifient par leur efficacité, tout simplement, et l’efficacité doit rester un principe important en matière d’impôts.
L’action judiciaire, en revanche, doit être privilégiée dans un objectif d’exemplarité et de dissuasion, notamment lorsque la fraude est répétée année après année, ce qui – cinquième proposition, monsieur le secrétaire d’État – peut être considéré comme un critère supplémentaire.
Toutefois, lorsque les conclusions d’un dossier ne sont pas suffisamment certaines, est-il pertinent de mettre sur la place publique la situation d’une personne ou d’une entreprise de bonne foi ? Je vois là une question de protection des personnes, mais aussi des intérêts économiques.
Pour finir, j’en viens au monopole du dépôt des plaintes par l’administration. Cela répond à une logique très simple : l’État porte plainte parce que c’est lui la victime.
Sixième proposition, comme le Sénat l’a déjà voté, peut-être faudra-t-il permettre à l’autorité judiciaire d’étendre une enquête existante à des faits de fraude fiscale connexes.
Septième proposition, peut-être faudra-t-il aussi que la CIF puisse être saisie cette fois-ci par la justice pour que l’administration fiscale, qui ne peut pas tout détecter, s’empare utilement d’un dossier de fraude.
Enfin, autre amélioration et dernière proposition, il faudrait clarifier l’articulation entre l’article 40 du code de procédure pénale et le dispositif du « verrou de Bercy ».
Voilà un certain nombre de propositions qui seront à discuter en juillet et à enrichir, de manière consensuelle, dans le cadre de nos travaux au Sénat.
Je propose donc à notre assemblée de ne pas adopter ce texte, qui a pourtant le mérite d’engager, avant l’heure utile, le débat sur ce sujet essentiel.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux d’intervenir devant vous aujourd’hui sur un sujet qui fait l’objet, cela vient d’être rappelé, de réflexions et de travaux approfondis, aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. En témoigne la mission d’information commune aux commissions des finances et des lois, qui a été mise en place par les députés et dont les conclusions seront rendues la semaine prochaine.
Toutefois, en dépit de ces nombreux travaux, le sujet continue, et c’est logique, de susciter des commentaires et des critiques, apparaissant parfois infondés.
L’examen de cette proposition de loi issue du groupe socialiste et républicain m’offrira donc l’occasion, je l’espère, de dissiper un certain nombre de malentendus, qui semblent avoir été repris dès l’exposé des motifs du texte. Je rappellerai ainsi, contrairement à ce qui y est indiqué par la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie, que le ministre chargé du budget ne dispose pas, à titre personnel, du monopole de l’ouverture des poursuites pénales en matière de fraude fiscale ; celui-ci revient bien à l’administration elle-même !
Comme vient de le faire votre rapporteur, dont je salue l’objectivité, je m’attacherai donc à décrire les faits avec précision, tout en dessinant des pistes de réflexion pour pallier le manque de transparence dont – nous en convenons tous – le dispositif souffre.
Effectivement, comme vous l’aurez constaté, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude que le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat ne comporte pas de disposition sur le sujet. Cela signifie, non pas que le Gouvernement ne compte pas s’emparer de cette question, mais simplement que nous souhaitons laisser les parlementaires formuler leurs propres propositions en la matière – M. le rapporteur vient de le faire avec ses huit propositions. Elles les concernent en effet au premier chef.
Le rapporteur de votre commission des finances, M. Jérôme Bascher, a d’ailleurs rappelé, à juste titre, que le calendrier dans lequel nous examinons cette proposition de loi ne permet pas de prendre en compte les travaux de la mission d’information de l’Assemblée nationale, dont les conclusions seront rendues mercredi prochain.
De fait, le rejet du texte par votre commission des finances suffit, me semble-t-il, à démontrer que la démarche d’ouverture du Gouvernement a été entendue.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie rit.
Je ne surprendrai donc personne en annonçant que le Gouvernement n’est pas favorable à une suppression pure et simple du « verrou de Bercy ». En revanche, et ce sera l’objet de mon intervention, je souhaite que nous puissions remettre aux parlementaires les clefs de ce verrou, en sanctuarisant dans la loi les critères déclenchant des poursuites pénales en matière de fraude fiscale, tout en renforçant leurs pouvoirs de contrôle.
Nous rejoignons ainsi la position de votre rapporteur, qui propose lui aussi l’inscription de ces critères dans la loi et l’amélioration du contrôle sur la sélection de ces dossiers.
J’ajoute, pour être complet, que le Gouvernement partage aussi pleinement les préoccupations du rapporteur en matière de préservation du secret fiscal. Ce dernier ne saurait être levé qu’en toute fin de procédure.
Le sujet – et c’est encore un point souligné par M. Bascher – doit être démythifié.
Premier mythe, le « verrou de Bercy » n’est précisément pas un verrou !
La disposition communément dénommée « verrou de Bercy » prévoit en effet que l’action pénale peut être engagée pour fraude fiscale uniquement sur le fondement d’une plainte préalable de l’administration fiscale. Est-ce si choquant ?
Dans beaucoup d’autres domaines de l’action pénale, personne n’imaginerait que l’on puisse engager des poursuites sans une plainte de la victime. Or, en cas de fraude, c’est le Trésor qui est lésé ! C’est donc en tant que victime que l’administration fiscale porte plainte pour engager l’action pénale.
En réalité, il y a derrière le sentiment que ce système est par trop verrouillé l’idée selon laquelle la fraude est non pas l’affaire d’experts, mais l’affaire de tous. C’est naturellement vrai. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude généralise la publication des sanctions en matière pénale et permettra la publication des sanctions administratives.
Pour autant, on voit mal comment les choses pourraient aller véritablement plus loin en la matière. Sans exigence de plainte préalable de l’administration, le juge judiciaire se retournera toujours vers l’administration fiscale pour caractériser la fraude et le dossier finira toujours par revenir chez l’expert…
Les finances publiques ne seront pas gagnantes à un changement de système, et la levée du « verrou » irait au-delà de notre objectif commun, qui est de sanctionner les fraudeurs et d’additionner aux sanctions administratives les sanctions pénales dans les cas les plus graves.
Je veux démonter un second mythe : la commission des infractions fiscales, la CIF, n’est pas un OVNI administratif.
Que fait cette commission ? D’abord, joue-t-elle le rôle d’un parquet comme on l’entend parfois ? En réalité, non. Elle s’emploie surtout à vérifier que le dossier est suffisamment solide et étayé juridiquement pour que l’on mobilise l’autorité judiciaire, dont elle sait qu’elle a de nombreuses autres préoccupations et qu’il est peut-être inutile de l’engorger inutilement.
Ce travail de filtre pose-t-il une difficulté ? Je ne le crois pas non plus, puisque la commission des infractions fiscales valide 85 à 95 % des propositions de plaintes selon les années.
Par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, si certains parmi vous émettent des doutes à ce sujet, le Gouvernement ne saurait que conseiller à votre assemblée de s’emparer du pouvoir de contrôle que vous a donné la loi Sapin de 2013, qui oblige la commission à publier un rapport annuel et dispose qu’un débat sur son action doit avoir lieu chaque année devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport prévu est élaboré chaque année et comporte des informations utiles. Le débat devant les commissions n’a jamais été organisé !
Faut-il pour autant laisser le système actuel en l’état, sans rien y changer ? Je ne le crois pas, et ce n’est pas la position du Gouvernement.
S’il existe tant de fantasmes autour du « verrou de Bercy », cela signifie que des évolutions sont nécessaires. Je rejoins ici M. le rapporteur quant à la nécessité de réformer le dispositif afin d’y introduire plus de transparence sur les critères de transmission des dossiers à la CIF. Cela permettra de dissiper les fantasmes, parmi lesquels l’idée selon laquelle le ministre en charge du budget déciderait lui-même de la transmission des dossiers.
Toutes les décisions de ne pas transmettre les dossiers à la CIF sont tracées et peuvent être auditées. Il y a donc sans doute de bonnes raisons de ne pas transmettre, soit que le dossier soit au contentieux devant le juge administratif, soit que la fraude ne soit, par exemple, pas suffisamment caractérisée. Aucune main invisible n’intervient pour protéger certains et en exposer d’autres. Votre rapporteur a souhaité, à ce titre, que des parlementaires habilités puissent mieux contrôler le travail de transmission de l’administration fiscale. Le Gouvernement est favorable à cette proposition.
En réalité, comme Gérald Darmanin a eu l’occasion de le dire et de le proposer devant la mission d’information de l’Assemblée nationale, nous considérons que la loi devrait être plus claire sur les critères de définition des dossiers fiscaux donnant lieu à proposition de poursuite pénale, qu’il s’agisse du montant des droits fraudés, des agissements du contribuable ou encore du contexte du dossier.
Je pense également que, en matière de présomption de fraude, c’est-à-dire lorsque la fraude n’est pas encore caractérisée, les instruments à disposition de l’administration n’étant pas suffisants, ou lorsque la démonstration de la fraude nécessite la mise en œuvre de méthodes d’enquête beaucoup plus intrusives, le sas de la CIF n’est pas nécessaire. En effet, il s’agit non pas ici de rajouter une couche pénale aux sanctions déjà appliquées au niveau fiscal, mais de passer le témoin du contrôle fiscal à la police fiscale afin de poursuivre l’enquête.
Le Gouvernement considère, en revanche, qu’une ligne rouge ne doit pas être dépassée : celle qui consisterait à remettre en cause le principe de plainte préalable de l’administration, en cas de connexité par exemple. C’est avant tout un sujet de coordination des procédures. Il faut veiller à ce que les choses soient faites dans l’ordre et à ne transmettre à la CIF que les dossiers les plus graves et pour lesquels l’application de sanctions pénales complémentaires aux sanctions administratives paraît justifiée.
De fait, comme M. le rapporteur l’a rappelé voilà un instant, en cas de suppression de l’exigence de plainte préalable, nous nous exposerions à deux problèmes très pratiques.
Premièrement, les procédures parallèles devant le juge judiciaire et le juge administratif se multiplieraient. Des contentieux formés sur un même dossier risqueraient ainsi d’aboutir à la situation ubuesque dans laquelle, par exemple, un contribuable serait condamné pénalement pour fraude, mais verrait ses rappels et pénalités annulés devant le juge administratif.
Deuxièmement, les procédures se multipliant, le nombre de dossiers dans lesquels sanctions pénales et sanctions administratives se cumuleront augmenterait nécessairement. Ce cumul de peines est, certes, admis par le Conseil constitutionnel, mais seulement dans les cas les plus graves. La nécessité d’un processus sélectif pour amener les dossiers au pénal est donc consubstantielle à ce principe. Elle s’imposera, quoi que l’on veuille, à toute évolution de notre procédure actuelle.
Je note, d’ailleurs, que la procureur du Parquet national financier, le PNF, ne disait pas autre chose lorsqu’elle déclarait, en mai 2016, que « le rôle de filtre assuré par la CIF est une bonne chose, dans la mesure où il faut être pragmatique : la justice serait dans l’incapacité de traiter l’ensemble des plaintes ».
En conclusion, vous l’aurez compris, le Gouvernement ne souhaite pas l’adoption de cette proposition de loi, tant la suppression complète et immédiate à la fois du monopole du dépôt des plaintes par l’administration fiscale et de la validation de la CIF aurait des conséquences sur l’engorgement de la justice ou l’efficacité dans le recouvrement des sommes dues et des pénalités. À vouloir tout judiciariser, nous risquons d’affaiblir l’efficacité de notre système répressif, ce qui serait contraire à l’objectif.
La voie que nous vous proposons constitue une véritable amélioration de notre système. Elle consiste, comme je l’ai indiqué il y a un instant et comme l’a proposé votre rapporteur, à maintenir le « verrou », mais à vous en remettre les clefs, à vous, parlementaires, en définissant dans la loi les critères de transmission des dossiers et en renforçant vos moyens de contrôle, conformément au principe de la séparation des pouvoirs.
Pour terminer, je veux vous répondre, madame la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie. Vous avez eu l’amabilité de dire que vous étiez heureuse de me retrouver au banc du Gouvernement, ce qui m’a doublement surpris.
Vous avez rappelé que j’étais favorable à un aménagement du « verrou ». Je pense qu’il faut être encore plus précis.
De fait, vous avez été encore plus précise, il y a un instant, dans un tweet que vous avez commis et dont j’ai pris connaissance. Vous y avez indiqué que, le 25 juillet 2017, je m’étais félicité de l’adoption, par le Sénat, d’un aménagement au « verrou de Bercy ». Je l’ai fait et, si c’était à refaire, je le referais.
Ce que vous proposez aujourd’hui, c’est une suppression totale du « verrou ». À aucun moment, les groupes socialistes de l’Assemblée nationale – j’en étais membre – comme du Sénat ne se sont prononcés en faveur de cette suppression.
Le 5 juillet…
… 2016. Vous parlez du 25 juillet 2017, et moi du 5 juillet 2016 ! Le 5 juillet 2016, donc, dans cet hémicycle, la totalité des membres du groupe socialiste du Sénat ont voté contre un amendement présenté par le sénateur Éric Bocquet visant à supprimer le « verrou de Bercy ». Au demeurant, sous la législature précédente, chaque fois qu’une mesure en ce sens a été adoptée par le Sénat, le groupe socialiste a suivi l’avis du Gouvernement, refusé cette suppression et affirmé sa volonté d’aménager le « verrou », et non de le supprimer totalement.
C’est la ligne que je suis aujourd’hui.
M. Julien Bargeton applaudit.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, cher collègue Philippe Dominati, compagnon de lutte de la commission d’enquête
M. Antoine Lefèvre sourit.

Chacun conviendra que, au lendemain du jugement rendu par la cour d’appel sur l’affaire Cahuzac – je suis désolé, mes chers collègues, de rappeler cet épisode terrible pour la République, mais l’actualité m’y amène –, ce débat sur le « verrou de Bercy » prend un tour particulier. Du fait de ses fonctions de ministre délégué au budget, Jérôme Cahuzac avait le privilège, par le mécanisme du « verrou de Bercy », de décider ou pas d’ester en justice contre lui-même. Convenez, mes chers collègues, que cette situation oscille quelque peu entre l’hallucinant et l’ubuesque !
Cette situation nourrit un sentiment de justice à deux vitesses chez nos concitoyens : les plus puissants semblent bénéficier d’une impunité inacceptable, il n’y a plus d’égalité devant l’impôt.
Observons un instant les statistiques : sur les 50 000 contrôles fiscaux réalisés chaque année, de 12 000 à 15 000, selon les années, mettent en évidence des fraudes caractérisées. Sur ce total, quelque 4 000 dossiers concernent un montant de fraude supérieur à 100 000 euros.
Combien de gros fraudeurs finissent devant la justice ? C’est là que s’enclenche le « verrou de Bercy ».
L’administration fiscale, qui fait un travail remarquable – rappelons-le sans cesse –, fait un premier tri entre ces 4 000 dossiers et détermine ceux qu’elle transmet à la commission des infractions fiscales, composée de magistrats du Conseil d’État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation. Puis, parmi les dossiers reçus, la CIF choisit à son tour ceux qu’elle transmet à la justice.
En général, sur les 4 000 dossiers de gros fraudeurs, le fisc en transmet entre 900 et 1 000 à la CIF, qui en retransmet elle-même 95 % à la justice. En conclusion, moins du quart des gros fraudeurs finissent devant le juge.
Comment s’étonner que nos concitoyens s’indignent de cette situation quand, dans ce pays, on peut être condamné à deux mois de prison ferme pour avoir volé un paquet de pâtes alimentaires ?
Non seulement le monopole de l’administration fiscale pour déclencher les poursuites en matière de fraude fiscale commise en bande organisée ou complexe est contre-productif, mais il heurte de front l’idéal de justice.
On nous dit que l’actuel dispositif serait plus efficace lorsque, au cours des contrôles classiques, les agents identifient des indices de fraude fiscale qui pourraient laisser penser qu’ils sont en présence d’une fraude fiscale grave ou transnationale dans certains cas. Ils ne peuvent pas se satisfaire de simples indices. Ils doivent établir l’existence d’une présomption caractérisée qu’une infraction fiscale pour laquelle il existe un risque de dépérissement des preuves résulte des procédés figurant au livre des procédures fiscales. Or il n’est pas possible d’y parvenir sans mettre en œuvre des moyens coercitifs dans le cadre d’investigations judiciaires qui, dans un État de droit, ne peuvent être autorisées que par une autorité judiciaire. C’est ainsi qu’il arrive que des indices ne soient ni traités ni transmis à la justice.
Pour contrer l’action de l’administration, qui s’est révélée jusqu’à présent très efficace, les fraudeurs émiettent les intervenants en recourant à des prête-noms, des sociétés-écrans ou des entreprises fictives. Dans ces cas de fraudes très complexes, là encore, seules des enquêtes judiciaires permettraient de démonter les schémas de fraude.
L’existence du « verrou de Bercy » n’est-elle pas aussi de nature à engendrer une confusion entre l’exécutif et le judiciaire ? Cette situation est-elle acceptable en démocratie ? Pourquoi les dossiers fiscaux très médiatisés de grands groupes transnationaux et de certains particuliers fortunés ne sont-ils pas parvenus à un juge d’instruction ? Personne ne nie ici que les agents du fisc aient une expertise incomparable. Mais les magistrats disposent de techniques spéciales d’enquête indispensables dans les affaires impliquant la criminalité organisée ou faisant intervenir sociétés-écrans et logiciels comptables frauduleux. Croit-on vraiment que les grands groupes cesseront de tricher tant qu’aucune condamnation pénale ne les dissuadera, par exemple, de manipuler les prix de transfert ? Les intermédiaires arrêteront-ils de conseiller et de protéger les fraudeurs tant que l’impunité leur sera garantie ?
Mes chers collègues, ce « verrou de Bercy » n’a plus aucune légitimité depuis la création, en 2013, du Parquet national financier, le PNF, qui a justement compétence sur les infractions fiscales graves.
Je veux, en cet instant, à l’instar de Marie-Pierre de la Gontrie, citer Mme Éliane Houlette, procureur de ce parquet – je citerai les mêmes propos, mais il faut dire que nous puisons à bonne source. Lors de son audition par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, celle-ci a déclaré que « le verrou de Bercy bloque toute la chaîne pénale », qu’il « empêche la variété des poursuites et constitue un obstacle juridique » et « un handicap sur le plan pratique ». Les procureurs, censés diriger l’action publique, en sont réduits à attendre de voir arriver une petite partie du spectre de la fraude fiscale que Bercy souhaite leur transmettre.
La liberté d’action du PNF est mise à mal par le « verrou de Bercy ». La phase administrative, la sélection et le choix des affaires qui doivent faire l’objet de poursuites échappent totalement au Parquet national financier, qui a transmis, l’an dernier, 77 signalements de suspicion de fraude fiscale à Bercy, mais n’a aucun moyen de savoir à l’heure actuelle comment ces cas graves ont été ou seront traités.
Un parlementaire compromis ne pourrait pas être jugé pour fraude fiscale sans une plainte de Bercy.
Cela pose évidemment et de manière très concrète la question des moyens financiers, techniques et humains de la justice.

La réduction de la dépense publique a aussi des conséquences pour les magistrats.
Lutter contre l’évasion fiscale passe par la suppression du « verrou de Bercy », l’attribution des moyens nécessaires à la justice et la volonté d’une politique infaillible, au nom de l’intérêt général.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mmes Victoire Jasmin et Nathalie Goulet applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le vice-président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, une impression de déjà-vu plane sur ce débat relatif au « verrou de Bercy », qui vient comme mars en carême. De fait, cela fait déjà trois fois que le Sénat a voté la suppression de ce dispositif.
Il est dommage que la proposition de loi de notre collègue du groupe socialiste et républicain n’ait pas été examinée sous la législature précédente : nous aurions alors peut-être pu venir à bout du « verrou ».
En attendant les conclusions de nos collègues de l’Assemblée nationale, la niche parlementaire de ce jour nous permet d’évoquer de nouveau le sujet et de plaider une nouvelle fois la suppression du « verrou ».
Monsieur le rapporteur, nous n’avons pas attendu l’affaire Cahuzac pour discuter du « verrou de Bercy » : en 2010–2011, dans le cadre des travaux d’une commission d’enquête sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, nous avions déjà diagnostiqué cette anomalie, dont plusieurs personnes auditionnées avaient soutenu la suppression.
Le sujet de la fraude et de l’évasion fiscale est un sujet républicain. Un scandale, une annonce : les choses fonctionnent toujours ainsi. La suppression du « verrou » n’est pas une marotte de quelques parlementaires. Je ne reviendrai pas sur les déclarations de Mme Éliane Houlette et du procureur de la République de Paris, M. François Molins, qui ont déjà été longuement citées.
Monsieur le secrétaire d’État, nous devons partir du principe qu’il faut vous croire sur parole, c’est-à-dire que le « verrou » est plus rapide, plus efficace, qu’il rapporte plus d’argent et que sa levée engorgerait les tribunaux. Partant de ce postulat, partant du principe qu’il faut vous croire sur parole, il convient de maintenir le dispositif tel qu’il est.
Je note avec intérêt qu’aujourd’hui, occupant le poste qui est le vôtre, vous acceptez des aménagements. Je me souviens très bien que, en 2013, notre collègue Alain Anziani, tombé au champ d’honneur du non-cumul des mandats, avait multiplié des propositions, qui n’ont malheureusement pas été adoptées, mais qui auraient d’ores et déjà pu améliorer les dispositifs de transparence.
En effet, ce que l’on reproche à ce « verrou », c’est surtout son manque de transparence. Aujourd’hui, tout le monde veut de la transparence ; il suffit de penser au traitement des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Or voilà qu’au milieu du dispositif répressif en matière de fraude et d’évasion fiscale, on trouve une institution non pas translucide, mais totalement opaque.
Il est désormais question d’impliquer les parlementaires et de faire intervenir les commissions dans les nominations. Mais est-ce bien le rôle des parlementaires ? Ce qu’il faut, c’est une institution transparente.
(L ’ orat rice montre un exemplaire du rapport.) Honnêtement, je le trouve totalement abscons. Il comporte un nombre de camemberts supérieur à la production du village éponyme de mon bon département de l’Orne…
Sourires. – Mme Laurence Harribey applaudit.

Nous disposons effectivement d’un rapport : le rapport annuel à l’intention du Gouvernement de la commission des infractions fiscales. Je me suis procuré ce rapport. §Je peux vous assurer que ce rapport est absolument incompréhensible. On n’y trouve aucun montant. Certes, les évaluations, les informations relatives à la géographie ou à la répartition socioprofessionnelle de la fraude ne sont pas inintéressantes, mais l’ensemble n’est toujours pas transparent.
Monsieur le secrétaire d’État, je veux bien vous croire sur parole et penser comme vous que la transaction d’un certain nombre de dossiers vaut mieux que la procédure judiciaire, mais quelle doit être la marge de manœuvre ? Doit-on transiger à hauteur de 30 % ou de 70 % du montant de la créance ? Quelle est votre estimation du niveau d’une bonne transaction ?
Si nous disposions de ces éléments, je pense que la question du maintien du « verrou » serait probablement moins d’actualité et moins prégnante qu’aujourd’hui. C’est surtout le manque d’informations qui choque les parlementaires et, au-delà, Transparency Internationalet les magistrats.
On me dit qu’il est normal que les magistrats veuillent plus de pouvoirs et que les fonctionnaires de Bercy sont dans leur rôle en voulant garder les leurs. Ce ne serait qu’une question de corporatisme.
Il se trouve que l’ordre du jour de nos travaux d’aujourd’hui ressemble beaucoup à celui du 7 mars dernier : de nouveau, nous sommes amenés, au cours d’une même journée, à évoquer les 80 milliards d’euros de fraude fiscale et à envisager une augmentation de 26 euros des retraites agricoles. Comme je l’avais dit alors, l’argent que nous ne récupérons pas sur la fraude fiscale ne peut pas nous servir à améliorer la situation des agriculteurs qui touchent 700 euros par mois.
Le sujet est extrêmement important. Il ne s’agit pas seulement de la question technique d’une instance au sein de Bercy, défendue par les membres, vénérables, de cette institution tout aussi vénérable qu’est le ministère de l’économie et des finances.
C’est très bien de prévoir des aménagements. Je vais d’ailleurs, au nom du groupe Union Centriste, vous en proposer tout à l’heure.
Cependant, monsieur le secrétaire d’État, puisque l’époque est aux réformes, je veux surtout vous proposer, dans le cadre de la révision constitutionnelle à venir, que nous modifiions l’article 34 de la Constitution, afin d’intégrer l’ensemble de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales dans le domaine de la loi.
Pour le moment, cette lutte échappe tout à fait au Parlement, raison pour laquelle celui-ci ne peut notamment pas disposer d’une liste des paradis fiscaux ou des territoires non coopératifs : lorsque nous voulons nous mêler de ces questions, le Conseil constitutionnel nous explique qu’elles relèvent du domaine réglementaire. Si l’amendement que je compte déposer à cette occasion est adopté, nous aurons alors tout loisir de proposer des dispositifs.
Le groupe Union Centriste n’est pas favorable, dans sa majorité, à la suppression pure et simple du « verrou », qu’à titre personnel, je voterai.
Toutefois, nous avons proposé un amendement d’assouplissement. Puisque vous semblez ouvert aux assouplissements, ce serait un bon signal, monsieur le secrétaire d’État, si vous acceptiez cet amendement.
MM. Yves Détraigne et Éric Bocquet, ainsi que Mmes Marie-Pierre de la Gontrie, Viviane Artigalas et Laurence Harribey applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, chaque année, la fraude fiscale représente une perte de 60 à 80 milliards d’euros pour le budget de la France. Ces sommes donnent le vertige, parce qu’elles représentent environ 15 % du budget de l’État.
Au plan international comme au plan national, grâce aux lanceurs d’alerte, aux médias, aux ONG, qui ont alerté les citoyens et poussé les gouvernements à légiférer, des avancées incontestables ont été opérées ces dernières années.
À notre échelle, nous devons maintenant poursuivre l’action entamée ces cinq dernières années, que Marie-Pierre de la Gontrie a largement rappelée.
La présente proposition de loi se situe dans ce fil, et je remercie d’ailleurs notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie d’en avoir pris l’initiative.
Ce texte est une fin en soi, parce qu’il abroge un système inacceptable sur les principes, mais il n’est pas un aboutissement, car d’autres mesures sont indispensables pour mettre sur pied un système alternatif pleinement efficace.
Qu’appelle-t-on « le verrou de Bercy » ? Aujourd’hui, même si c’est toute la société qui est spoliée par les fraudeurs, la seule entité en droit de porter plainte pour fraude fiscale est le ministère des comptes publics. Nous sommes les seuls dans le monde à appliquer une telle règle, au mépris du principe le plus fondamental de la démocratie : la séparation des pouvoirs.
On nous dit que c’est plus efficace ainsi. L’argument est à la mode chez ceux qui aspirent à réduire les contre-pouvoirs…
Un dispositif de ce type est grave sur le plan des principes. Il est de surcroît totalement injuste, si l’on considère ce délit parmi l’ensemble des autres délits. Supprimer le « verrou de Bercy » est la seule manière de lutter contre cette impression de collusion des élites qui s’assemblent pour reporter la charge fiscale sur les citoyens. En effet, aller devant le juge, écoper d’une sanction pénale a une connotation morale essentielle et dissuasive.
Face aux divers scandales, qui se répètent, les citoyens, qui, eux, ne peuvent pas « s’évader », nous interpellent et nous regardent. Le doute devant le manque de justice fiscale est présent chez tous les contribuables qui s’acquittent de leurs impôts et qui ne comprennent pas que certains puissent réaliser des « montages exotiques » pour optimiser leur fiscalité ou cacher une partie de leurs revenus ou patrimoines.
C’est aussi au nom de la concurrence déloyale que cette fraude doit être pénalement punie. Actuellement, la droiture est une faiblesse qui dessert la compétitivité des entreprises vertueuses, face à celles qui ne jouent pas le jeu.
D’ailleurs, c’est sous cet angle de la concurrence déloyale que la commissaire européenne à la concurrence, Mme Vestager, a jugé que le régime fiscal dont bénéficie, par exemple, Apple en Irlande est assimilable à des aides publiques indues qui faussent la concurrence.
Outre ces raisons de principe, de multiples raisons pratiques appellent à supprimer le « verrou de Bercy », sorte de pierre angulaire d’un système qui ne fonctionne pas.
On nous parle souvent de mutualisation, de rationalisation. Pour le coup, dans le système actuel, on a empilé les dispositifs sans les articuler : la commission des infractions fiscales, qui, comme cela a été dit, sert de filtre totalement opaque entre le ministère des finances et le parquet, analyse un quart des dossiers dits « répressifs », autrement dit les plus graves ; 10 % des mêmes dossiers sont suivis par la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la BNRDF. Il est question d’ajouter une nouvelle police fiscale, dont l’articulation avec la BNRDF est floue. Si l’on ajoute à cela que la police des douanes traite principalement de fraudes à la TVA, on réalise que le système est particulièrement complexe…
Si ce système ne fonctionne pas, c’est aussi parce qu’il n’a aucun effet dissuasif. J’en veux pour preuve que le nombre de fraudes graves est constant. Ce sont les mêmes chiffres, à quelques unités près, qui sortent chaque année : 50 000 contrôles, 16 000 manquements délibérés, 4 000 fraudes d’une gravité particulière… Il est quand même paradoxal de qualifier d’efficace un système qui ne fait pas baisser le nombre de fraudes.
Il est tout aussi paradoxal, et même intolérable, de considérer comme efficace un système qui ne permet de recouvrer que 5 à 10 % du montant total estimé de la fraude.
Pour ma part, je n’appelle pas cela un système efficace, d’autant que ce système est porteur d’effets pervers, l’administration intégrant en amont les règles de filtrage.
Le dimensionnement de la CIF ne lui permet de traiter que 1 000 dossiers par an, ce qui, de surcroît, rallonge les procédures de six mois.
Les services de Bercy s’adaptent, en transmettant 1 000 dossiers. D’où vient l’écart entre les 4 000 dossiers les plus graves et les 1 000 dossiers transmis ? C’est là un bien grand mystère.
Au-delà du problème du nombre de dossiers transmis – 1 000, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige –, on constate que les dossiers transmis sont toujours de même nature, concernant un, deux, voire trois types de fraudes. Tous les autres échappent totalement à la justice.
Dans le même temps, les différentes enquêtes – « Papers » ou « Leaks » – montrent que les dossiers où apparaissent les noms de grandes personnalités ou de grandes entreprises ne font pas l’objet de procédures aboutissant à des peines pénales. Il faut lever le doute sur une possible sélection qui tiendrait compte du CV du contribuable plus que de l’infraction.
On nous oppose aussi souvent que les juges n’ont pas le temps, ne sont pas formés, ne s’intéressent pas à ces affaires. Il est exact que les enquêtes sont souvent limitées et ne vont pas plus loin que les dossiers transmis par les contrôleurs des impôts. Il est exact que de nombreux juges, dans les petits tribunaux notamment, sont peu formés à cette matière, voire ne le sont pas du tout, et que les audiences sont souvent rapides.
En réalité, on nous oppose comme argument ce qui est précisément une conséquence d’un système qui déresponsabilise la sphère judiciaire, qui amène à un sentiment de mise à l’écart des juges, lesquels ont l’impression que, de toute façon, les affaires les plus sensibles leur échappent…
L’ouverture au juge de la possibilité de se saisir pour blanchiment de fraude fiscale, en 2008, et la création du Parquet national financier, en 2013, ont marqué un tournant. Nous sommes aujourd’hui au bout de ces avancées. Il faut donc reprendre le chemin, franchir une nouvelle étape, d’autant que le Parquet national financier est doté de moyens insuffisants et que, dans le même temps, les effectifs des pôles économiques et financiers des parquets des tribunaux de grande instance diminuent.
Le système qui s’est construit autour du « verrou de Bercy » est à bout de souffle. Les lois précédentes ont permis de tracer les contours d’un système alternatif, fondé sur une coopération renforcée entre juges et administration fiscale, dont les pivots sont le PNF et la BNRDF. Il faut les renforcer et les placer au cœur du dispositif.
En effet, si la suppression du « verrou de Bercy » est une fin en soi, elle ouvre une nouvelle voie, dans laquelle il faut nous engager.
Cette suppression devra s’accompagner de nouvelles mesures, d’une augmentation significative des moyens mis à la disposition de la DGFiP et de la justice et d’une meilleure communication entre ces deux institutions.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’une double sanction pouvait s’appliquer pour les cas présentant un caractère exemplaire ou grave de par l’importance des montants en cause ou la complexité du dispositif de fraude mis en œuvre.
Ces définitions devront nous permettre d’automatiser la transmission de ces cas graves ou complexes à la justice pénale.
Il faut également renforcer les moyens, en premier lieu ceux de la DGFiP. La base de l’information, c’est le contrôle. Si l’on peut comprendre que le nombre de contrôles effectués soit calibré en fonction du nombre d’agents, il nous semble impossible de déclarer vouloir lutter véritablement contre la fraude fiscale et faire de ce combat un fer de lance de sa politique et diminuer les moyens alloués à cette lutte au lieu de les augmenter.
Comment être crédible quand on prétend se montrer moins indulgent et qu’on laisse perdurer une situation dans laquelle une société n’est contrôlée qu’une fois tous les 120 ans en moyenne ?
Le rapport d’information sur l’évaluation de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, présenté par Mme Mazetier et M. Warsmann, insiste sur les moyens humains nécessaires aux enquêtes judiciaires menées par la BNRDF.
Il est question, dans le projet de loi de M. Darmanin, de la création d’un autre service, dont on comprend mal le lien avec la BNRDF, et d’une quarantaine d’agents en redéploiement… Ce n’est pas la bonne échelle si l’on souhaite vraiment parvenir à l’étiage nécessaire.
Certains experts parlent de 400 postes. J’ignore s’ils ont raison, mais il est certain que les 40 agents évoqués seront largement insuffisants pour mener des enquêtes approfondies sur 4 000 dossiers graves et s’assurer que ceux-ci tiennent la route devant un juge.
Par ailleurs, il faut certainement s’interroger sur la nature des peines appliquées. On affiche des sanctions de plus en plus sévères – selon le projet de loi Darmanin, il serait question d’aller plus loin encore –, mais ces peines sont rarement appliquées : beaucoup de communication, peu d’efficacité !
Au Royaume-Uni, en Italie, des peines de prison ferme sont bien plus souvent prononcées. En outre, le juge peut avoir recours aux travaux d’intérêt général, peine qui présente un caractère d’exemplarité très fort. Il s’agit d’une première piste de réflexion : il serait intéressant d’envoyer tel ou tel fraudeur aider au nettoyage dans un hôpital ou effectuer d’autres tâches…
Actuellement, le juge peut prononcer une interdiction de gérer une entreprise. Toutefois, en l’absence de fichier national, cette peine est totalement inopérante. Rendons-la opérante et dissuasive.
L’inscription au casier judiciaire est rarement retenue. Ne pourrait-elle l’être beaucoup plus systématiquement ? À l’égard de la petite délinquance, on n’a pas ce genre de pudeur…
Enfin, il faut clarifier la distance entre fraude et optimisation fiscale, car c’est dans cette zone grise que tout se passe. Peut-être faut-il englober dans une même infraction le fait de frauder et de conseiller quelqu’un pour la commission d’une fraude ? Dès lors qu’un montage douteux est constaté, la charge de la preuve ne pourrait-elle être inversée ?

Mes chers collègues, nous avons aujourd’hui la possibilité de montrer de nouveau que le Sénat est mobilisé pour franchir une nouvelle étape.
Adopter cette proposition de loi, c’est dire qu’il faut être à la fois dans la justice et dans l’efficacité. Nous aurons ensuite l’occasion de débattre d’un certain nombre de propositions lors de la discussion du projet de loi à venir pour finaliser un dispositif complet, juste et efficace.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la question délicate qui nous est soumise mérite d’être examinée à la fois avec sérieux et avec recul.
La présente proposition de loi, vous l’avez compris, vise à supprimer purement et simplement le dispositif dénommé « verrou de Bercy ».
Je vais le dire assez clairement pour qu’il n’y ait pas de suspense : une suppression sèche de ce dispositif, c’est-à-dire sans réfléchir à un mécanisme de substitution ou à d’éventuelles améliorations, me semble, pour plusieurs raisons, à la fois précipitée et contre-productive.
Premièrement, je pense qu’on ne légifère pas pour répondre à des cas particuliers.

J’ai beaucoup entendu parler de M. Cahuzac. On ne légifère pas non plus sous la pression médiatique ou sous la pression des effets de mode, encore moins au Sénat.
Mes chers collègues, la vocation de la Haute Assemblée est justement de se prémunir contre ce qui se passe malheureusement trop souvent à l’Assemblée nationale. À force de subir la pression médiatique, les effets de mode, on finit par regretter d’avoir élaboré des lois totalement inutiles ou contre- productives.
M. Sébastien Meurant applaudit.

Cette première raison me paraît primordiale.
Deuxièmement, on a beau le critiquer, je pense très sincèrement que ce dispositif permet un tri efficace des affaires. Il ne faut pas oublier que le souci de recouvrer les sommes dues est l’objectif prioritaire. Certains ont exprimé un souhait de sanction morale, mais tel n’est pas l’objectif du législateur. Le Parlement, non plus que le tribunal correctionnel, n’est pas le lieu des sanctions morales.

Certains orateurs ont évoqué de telles sanctions. Or ce n’est pas le sujet qui nous occupe : il s’agit de lutter contre la fraude et d’obtenir une restitution la plus rapide possible des sommes non recouvrées. L’administration fiscale me semble donc dans son rôle lorsqu’elle recourt à la transaction pour récupérer efficacement les sommes soustraites à la collectivité. Là est l’intérêt général.
J’ajoute que ceux qui dénoncent l’engorgement des tribunaux sont ceux-là mêmes qui poussent à une surpénalisation.
Mes chers collègues – je m’adresse principalement à ceux qui veulent vraiment lutter contre la fraude fiscale –, si vous voulez enterrer un dossier, envoyez-le au tribunal correctionnel.

Les dossiers vont traîner des années et des années. En tant qu’avocat, certains de mes dossiers concernant des accidents mortels sont pendants devant le tribunal correctionnel depuis 2010. Encore une fois, si vous voulez enterrer un dossier fiscal, envoyez-le directement à ce tribunal : ce sera la meilleure façon de le laisser pourrir.
Par ailleurs, les procédures de règlement amiable des différends en matière fiscale me semblent aller dans le sens de l’avenir et de la modernité. C’est d’ailleurs la voie choisie par toutes les juridictions judiciaires qui proposent d’emblée une médiation, y compris en matière de transaction pénale.
C’est un non-sens absolu de vouloir renoncer à la transaction administrative devant des fonctionnaires spécialisés pour renvoyer les affaires à des juges qui ne sont absolument pas formés – nous sommes d’accord sur ce point – pour les traiter, qui plus est au cours d’audiences surchargées où des cas de conduite en état d’ivresse succèdent à des cas de violences conjugales qui engorgent malheureusement encore nos tribunaux. Le juge, qui devra statuer au cours de ces mêmes audiences sur ces dossiers ultrasophistiqués, ultra-précis et ultra-techniques, - n’aura qu’une seule échappatoire : s’en rapporter aux sachants, c’est-à-dire aux fonctionnaires compétents de l’administration fiscale.
Mes chers collègues, je pense que vouloir surpénaliser les dossiers fiscaux relève du fantasme.
Troisièmement, ce dispositif s’appuie sur la compétence et sur le jugement de l’acteur le mieux à même de sélectionner les affaires. Je veux bien évidemment parler de l’administration fiscale, dont l’expertise serait de toute façon nécessaire au juge judiciaire pour sélectionner les dossiers.
Quatrièmement, enfin, il me semble que le « verrou de Bercy » s’est bonifié depuis 1977, au fil de nombreuses améliorations. Les travaux en cours à l’Assemblée nationale et les réflexions évoquées par M. le secrétaire d’État permettront d’améliorer encore ce dispositif sans le supprimer.
Nous partageons la volonté de changement des auteurs de ce texte, mais nous estimons que cette proposition de loi est à la fois trop brutale et prématurée, raison pour laquelle le groupe Les Indépendants – République et Territoires ne la votera pas.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après les excellentes interventions des orateurs précédents, je m’exprimerai à mon tour sur le sujet qui nous intéresse aujourd’hui.
Au fond, la question que pose le « verrou de Bercy » est celle de la séparation des pouvoirs et de la transparence dans les relations entre administration fiscale et autorité judiciaire.
Le « verrou de Bercy » constitue une exception à la procédure judiciaire. Alors que, en temps normal, seul le procureur de la République décide d’engager des poursuites pénales, l’auteur présumé d’une infraction fiscale ne peut être poursuivi que sur plainte de l’administration, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, la CIF – autorité administrative indépendante, créée en 1977 et composée de vingt-quatre magistrats.
En effet, en vertu de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, « les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales », et ce sous peine d’irrecevabilité.
Toujours selon le même article, « la commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires. » L’administration fiscale possède donc le monopole du déclenchement de poursuites pénales en matière de fraude fiscale.
Ce privilège légal remonte aux années 1920, à une époque où l’État souhaitait recouvrer plus efficacement les impôts. Il faut le reconnaître, l’État, le « plus froid de tous les monstres froids », comme l’a appelé Nietzsche, se préoccupe plus souvent d’efficacité que d’éthique. Mais cette particularité a-t-elle encore une raison d’être aujourd’hui ?
Le « verrou de Bercy » est un sujet bien connu au Sénat. Nous en avons débattu à maintes reprises, ces dernières années. Il est déjà arrivé à notre assemblée de voter sa suppression ou, à tout le moins, son assouplissement.
Ce fut le cas l’an dernier, lors des débats sur la loi pour la confiance dans la vie politique. Ce le fut également lors de l’examen de la loi Sapin II, en 2016, au cours duquel un amendement de notre excellent collègue Éric Bocquet prévoyant la levée du « verrou de Bercy » pour fraude fiscale associée à d’autres activités criminelles ou délictuelles avait été adopté.
Je rappellerai également que le groupe du RDSE, sur l’initiative de notre tout aussi excellent collègue Pierre-Yves Collombat, avait proposé de confier l’initiative de poursuites au procureur de la République financier sur avis simple de la commission des infractions fiscales.
S’il avait reconnu la légitimité du débat, Michel Sapin avait néanmoins émis un avis défavorable, considérant que l’efficacité du dispositif devait primer sur les considérations éthiques.
Il est vrai que les arguments contre une suppression sèche du « verrou de Bercy » ne manquent pas : expertise reconnue de l’administration fiscale, efficacité pour récupérer des sommes dues, réponse pénale existant déjà dans les cas les plus graves, possibilité d’engager des poursuites pour le blanchiment de fraude fiscale, et, surtout, risques liés à un transfert brutal à l’autorité judiciaire sans dispositif transitoire – engorgement, perte d’expertise, de confidentialité…
Toutefois, les arguments en faveur d’une plus grande transparence, notamment s’agissant des critères de sélection des dossiers transmis par la CIF au juge pénal – montant concerné par la fraude, agissements du contribuable, circonstances personnelles – gardent toute leur pertinence.
Le manque de données sur le nombre de dossiers traités, l’ampleur des affaires et celle des transactions contribuent à la crispation des positions sur ce débat, ce qui n’est ni sain ni acceptable.
Il faut néanmoins souligner les progrès accomplis ces dernières années. Même s’il reste du chemin à parcourir pour en finir avec la fraude, un changement de culture, comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition de loi, s’est opéré et la lutte contre l’évasion fiscale a gagné en efficacité.
De nouveaux outils ont été créés. Je pense à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et au Parquet national financier.
Après l’affaire Cahuzac, la Haute Autorité a rendu publics des manquements ayant entraîné la démission de deux anciens ministres. Chargé des affaires les plus complexes, le Parquet national financier a obtenu quelques condamnations fortes et symboliques.
La loi Sapin II de 2016 a notamment accordé un statut aux lanceurs d’alerte, créé l’Agence française anticorruption et introduit l’infraction pour corruption d’agent public étranger.
Enfin, le guichet pour les fraudeurs repentis, ouvert entre 2013 et 2017, a permis de régulariser quelque 32 milliards d’euros d’avoirs et de recouvrer près de 8 milliards d’euros.
La présente proposition de loi permettrait, si elle était adoptée, d’approfondir logiquement ce changement culturel. C’est la raison pour laquelle les membres du groupe du RDSE sont, dans leur très grande majorité – à une exception près –, favorables à son adoption.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il faudrait commencer par écarter deux idées reçues sur le « verrou de Bercy ».
Premièrement, ce « verrou » serait une anomalie juridique. Or, lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC, de juillet 2016, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré son existence. Bien au contraire, dans une seconde QPC de décembre 2016, le Conseil s’est prononcé contre un trop gros transfert de compétence en matière de fraude fiscale.
Deuxièmement, le « verrou de Bercy » entraînerait un laxisme en matière de fraude fiscale. Il faut écarter cette idée, comme le démontrent certains chiffres qui ont déjà été rappelés – 68 peines de prison ferme et 131 amendes d’un montant moyen de 10 000 euros. Les sanctions sont bel et bien réelles et un certain nombre d’affaires sont parvenues jusqu’aux tribunaux en dépit de l’existence du « verrou ». L’efficacité est là.
Je rappelle que le délai moyen d’un contrôle fiscal est de huit mois, alors que, au pénal, il faut compter en moyenne trois ans entre le dépôt de plainte et le jugement…
Mais je ne voudrais pas trop rentrer dans ce débat. En effet, à opposer l’engorgement des tribunaux et l’incapacité de la justice à gérer ce genre d’affaires, on peut se voir répondre qu’il faut armer la justice en matière de fraude fiscale…
Au-delà du fait que certains avocats chevronnés et très spécialisés seraient en mesure de retarder très sensiblement les délais en matière de jugement, c’est une question de principe qui est posée : la judiciarisation est-elle la meilleure garante de la souveraineté de l’État ? Faut-il tout judiciariser dans la société ?
Ceux qui critiquent le « verrou de Bercy » ne démontrent pas que sa suppression, au profit d’une judiciarisation généralisée, serait plus efficace. Je le dis même très clairement : la suppression de ce dispositif ne permettrait pas de recouvrer les 60 à 80 milliards d’euros de fraude fiscale par an dont il est souvent question. C’est une évidence.
Le débat va avoir lieu : nous allons examiner le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude et Mme Cariou, grande spécialiste des sujets fiscaux à l’Assemblée nationale, va bientôt rendre son rapport, au nom de la mission d’information commune sur les procédures de poursuite des infractions fiscales.
Bien évidemment, comme lors du débat précédent, on pourra nous reprocher de toujours vouloir reporter la discussion à un texte ultérieur, alors que la situation est urgente. Or, si j’étais taquin, je relèverais que certains signataires de la proposition de loi semblent découvrir cette urgence, puisque pas moins de sept étaient à des postes de responsabilité sous le quinquennat précédent et n’ont rien fait pour régler cette question…

Le mieux est l’ennemi du bien en cette affaire. Si la plus grande efficacité de la judiciarisation n’est pas démontrée, l’efficacité du « verrou de Bercy » ne l’est pas non plus entièrement.
Je partage les propos de Mme Goulet : il faut améliorer l’évaluation de ce mécanisme. Le rapport présenté n’est pas satisfaisant pour les parlementaires que nous sommes.
D’autres évolutions sont possibles. Je pense à l’amendement – encore une fois – de Mme Goulet qui vise à inscrire les critères de la circulaire dans la loi, sans rigidifier. On peut aussi renforcer le contrôle, notamment en ciblant les dossiers qui ne sont pas transmis, ou bien améliorer l’encadrement des transactions. Nous pouvons nous inspirer de certains autres pays pour avancer.
La suppression du « verrou de Bercy » n’est pas l’alpha et l’oméga. Ce dispositif ne remet pas en cause la séparation des pouvoirs ; il instaure un filtre. La judiciarisation totale n’irait pas forcément dans le bon sens.
Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas continuer d’avancer. M. Stanislas Guerini, par exemple, a proposé, à l’Assemblée nationale, de déchoir de leurs droits civiques les personnes condamnées pour fraude fiscale caractérisée, et il a obtenu satisfaction.
Des avancées récentes, rappelées par plusieurs orateurs, ont eu lieu depuis 2013. La fraude fiscale est une atteinte à l’esprit civique, au principe d’égalité devant l’impôt et même à l’ordre public. Mieux qu’un débat précipité, cette question mérite une réflexion approfondie en partant des propositions évoquées au cours de notre discussion.
C’est la raison pour laquelle, tout en étant tourné vers la lutte contre la fraude fiscale, le groupe La République En Marche votera contre cette proposition de loi.
MM. Emmanuel Capus et Gérard Longuet applaudissent.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le dispositif du « verrou de Bercy » confie à l’administration fiscale française le monopole des décisions de poursuite judiciaire en matière de fraude fiscale. Il s’agit du seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome. Ce « verrou » est donc un dispositif dérogatoire au droit commun.
L’administration opérant un filtre, ce manque de transparence est critiqué. D’aucuns pensent que des affaires de fraude fiscale sont ainsi étouffées. En réalité, ce dispositif est très encadré. Il a la vertu de l’efficacité, ce qui permet à Bercy de récupérer plus vite les sommes dues.
Certes dérogatoire, le « verrou de Bercy » est parfaitement conforme à la Constitution : il est donc encadré juridiquement. Dans sa décision du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel estime que ce mécanisme ne porte pas « une atteinte disproportionnée au principe selon lequel le procureur de la République exerce librement […] l’action publique ». Une fois la plainte déposée, le parquet a « la faculté de décider librement de l’opportunité d’engager des poursuites. »
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel juge que l’administration fiscale est la mieux placée pour estimer le préjudice qui lui est causé par la fraude fiscale et qu’ainsi « l’absence de mise en mouvement de l’action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l’ordre public. »
Enfin, le « verrou de Bercy » s’inscrit, selon le Conseil constitutionnel, « dans le respect d’une politique pénale déterminée par le Gouvernement ».
Par ailleurs, ce dispositif est encadré par une autorité administrative indépendante – la commission des infractions fiscales –, composée de membres du Conseil d’État, de conseillers de la Cour des comptes, de magistrats de la Cour de cassation et de personnalités qualifiées nommées par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale. C’est elle qui décide du dépôt de plainte ou non. Dans les faits, 90 % des dossiers qui lui sont transmis font l’objet d’une plainte.
En amont de cette commission, l’administration fiscale effectue un travail de contrôle : chaque année, elle opère 1 million de contrôles sur les pièces transmises pour la déclaration d’impôt et 50 000 contrôles fiscaux. Elle réalise un travail d’investigation très pointu qu’un magistrat pénal ne pourrait effectuer aussi rapidement et facilement, ne disposant pas de l’expertise technique de Bercy. Il aurait, de toute façon, besoin des services de l’administration pour être éclairé.
En outre, le secret fiscal est parfaitement préservé par Bercy, ce qui n’est, hélas !, pas toujours le cas du secret de l’instruction. Nous avons pu constater à plusieurs reprises que, de manière très sibylline, des pièces de dossiers en cours d’instruction sont publiées dans la presse…

De surcroît se pose le problème des moyens de la justice. En tant que rapporteur spécial du budget de la justice, j’ai pu constater, comme l’ont souligné d’autres orateurs avant moi, un allongement des délais de traitement des contentieux. Cette question ne peut être éludée.
Les tribunaux pénaux étant engorgés, la suppression du « verrou de Bercy » ajouterait une charge de travail considérable. Les recouvrements seraient donc très longs à obtenir, ce qui serait d’autant plus préjudiciable qu’ils représentent chaque année 4 à 5 milliards d’euros de recettes pour l’État, à moins d’embaucher des centaines de magistrats pour examiner les 16 000 manquements délibérés et les 4 000 dossiers répressifs constatés en matière de fraude fiscale.
Ce dispositif apparaît par conséquent comme un garde-fou qu’il faut maintenir, même s’il doit évoluer. En effet, davantage de transparence et de contrôle sont nécessaires, nous n’en disconvenons pas.
Ainsi, les critères de sélection des dossiers par Bercy et par la commission des infractions fiscales, aujourd’hui définis par une circulaire, devraient être redéfinis par la loi.
Le Parlement pourrait également être mieux associé au contrôle. J’ai bien entendu, monsieur le secrétaire d’État, votre souhait de lui redonner les clés du « verrou ».
Des amendements allant dans ce sens seront d’ailleurs déposés dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude qui sera examiné prochainement par le Sénat, première chambre saisie de ce texte.
Dans l’attente de l’examen de ce projet de loi, et pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, le groupe Les Républicains n’adoptera pas cette proposition de loi, conformément à la position de la commission des finances et de son rapporteur, Jérôme Bascher, que je tiens à féliciter très chaleureusement pour la qualité de son rapport.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

M. Gérard Longuet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances par intérim
Sourires.

À cet égard, je veux remercier Mme Marie-Pierre de la Gontrie d’avoir déposé cette proposition de loi, qui permet d’ouvrir le débat.
Je me réjouis également que de nombreux membres du groupe socialiste et républicain qui auraient pu, en qualité de ministre, initier ce débat lorsqu’ils exerçaient des responsabilités – mais à tout pécheur, miséricorde… – se posent aujourd’hui la question du « verrou » fiscal.
Ce dispositif est d’ailleurs non pas un verrou, mais un point de passage obligé. Comme Jérôme Bascher l’a souligné avec pertinence, il s’agit non pas d’empêcher – ce qui est la fonction d’un verrou –, mais de contrôler.
Nous avons le choix entre deux extrémités également condamnables : faire de Bercy et de l’administration le « cercle des dossiers disparus », ce qui donnerait le sentiment d’une obscurité coupable, ou accepter le pilori en place de Grève, avant qu’il y ait eu instruction et, a fortiori, condamnation, ce qui est malheureusement souvent le cas lorsque la procédure emprunte la voie strictement judiciaire.
Les interventions précédentes, notamment celles de nos collègues avocats, ont justement rappelé un certain nombre de vérités. Si l’affaire était facile, cela se saurait. Depuis que ce principe a été posé en 1920, on peut relever certaines interventions prudentes. Je songe, par exemple, à la création de la commission des infractions fiscales en 1977.
Souvenons-nous, le président élu à cette époque avait bénéficié indirectement et involontairement de la transmission par la presse d’une information fiscale concernant l’un de ses compétiteurs. Ce fut une première. Sans doute avait-il eu la volonté de faire en sorte que ce secret soit maintenu, pour préserver l’égalité des citoyens et ne pas les exposer à la pression de Bercy, tout en veillant à ce que ce ministère ne devienne pas le cercle des dossiers disparus. En effet, la commission des infractions fiscales, élargie aux magistrats honoraires de la Cour de cassation, permet aujourd’hui un contrôle.
Interventions donc en 1920, 1977 et 2013. Et aujourd’hui ? La société du numérique, que nous l’aimions ou pas, que nous le voulions ou pas, est une société de la transparence. C’est aussi celle des data massives, des innombrables banques de données et de l’intelligence artificielle. On l’imagine assez bien, les contrôles fiscaux changeront progressivement de nature et gagneront en exhaustivité par rapport au système du prélèvement aléatoire, qui ne permet pas d’établir une véritable égalité.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous ne pourrons pas aller au bout de ce débat. La position adoptée par le rapporteur et défendue par le groupe auquel j’appartiens est pertinente. Le débat est ouvert, et ne sera pas tranché, ce d’autant moins que l’Assemblée nationale s’exprimera la semaine prochaine sur ce sujet, vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État, à l’occasion du dépôt du rapport de la mission d’information présidée par M. Éric Diard et dont la rapporteur est Mme Émilie Cariou – nous connaissons tous sa compétence. Ce rapport enrichira le débat et dégonflera sans doute un certain nombre d’illusions, notamment celle de l’existence d’une caverne magique, un antre d’Ali Baba, permettant de récupérer rapidement 80 milliards d’euros de fraudes fiscales.
À cet égard, la définition de la fraude fiscale mériterait d’être contrôlée et vérifiée, et ce sera sans doute l’un des sujets traités lors de l’examen en juillet prochain du texte de Gérald Darmanin. Il serait utile de s’entendre sur ces termes, entre optimisation et délinquance pure et simple.
Il ne me paraît donc pas possible, en cet instant, de céder à la tentation qui anime implicitement les auteurs de cette proposition de loi, à savoir l’idée selon laquelle la voie judiciaire constituerait le moyen de rendre les choses les plus publiques possible, rejoignant ainsi l’idée de pilori que j’évoquais tout à l’heure. Ainsi, ceux qui seraient soupçonnés de fraude ne seraient libérés de ce soupçon qu’au terme de plusieurs années de procédure judiciaire, tant la justice est confrontée, on le sait, à de nombreuses difficultés.
Je compte donc sur le texte de Gérald Darmanin pour approfondir une question bien présentée par notre rapporteur, lequel ne peut pourtant prétendre en cet instant, il le reconnaît lui-même, à une solution définitive. Il serait malheureux d’abandonner une procédure qui rend implicitement hommage au sérieux, à la responsabilité, au professionnalisme, mais aussi – et ce n’est pas sans importance – à la discrétion de l’administration des impôts, laquelle est assurément un facteur de cohésion et de respect de l’État pour l’ensemble des citoyens, contribuables pour les impôts indirects et largement représentés pour les impôts directs.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Emmanuel Capus applaudit également.
Je souhaite apporter quelques éléments de réponse à certaines interventions.
Je donnerai tout d’abord des précisions sur la quantité de contrôles fiscaux et de dossiers ayant donné lieu à une action pénale, notamment ceux qui sont dits répressifs.
En 2017, sur les quelque 50 000 contrôles fiscaux externes qui ont été effectués – c’est le nombre habituel constaté chaque année –, 14 200 dossiers sont dits « répressifs », c’est-à-dire qu’une pénalité exclusive de bonne foi est appliquée. Ces derniers représentent plus de 6, 4 milliards d’euros de droits et pénalités notifiés, soit une moyenne de plus de 453 000 euros par dossier. Parmi eux, 4 200 concernent des droits et pénalités notifiés supérieurs à 100 000 euros, soit un total de plus de 4 milliards d’euros.
Quant à l’action pénale, elle a donné lieu, en 2016 – pardonnez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de comparer deux années différentes, mais nous savons que, d’une année sur l’autre, les chiffres restent stables –, à 770 décisions de justice et aux sanctions suivantes : 939 condamnations, dont 430 définitives ; 360 peines de prison, dont seulement 68 fermes, mais, pour l’essentiel d’entre elles, faisant l’objet d’aménagements ; et 131 peines d’amende, dont 121 fermes, pour un montant moyen de 14 000 euros, ce qui est évidemment bien éloigné de la moyenne de 453 000 euros que j’évoquais voilà un instant.
Des questions ont été posées à propos de la police fiscale prévue dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, qui sera bientôt présenté devant votre assemblée. Je veux le rappeler, la procédure d’enquête fiscale a été créée pour permettre d’asseoir l’impôt. À cette fin, les officiers fiscaux judiciaires ont été dotés de prérogatives de police judiciaire permettant auditions, gardes à vue, perquisitions, saisies judiciaires et écoutes. Ainsi, 83 % des plaintes déposées par la DGFiP concernent la fraude fiscale sophistiquée, qui a recours à des montages opaques et au blanchiment, et non pas le crime organisé. Ces fraudes doivent mobiliser une expertise avant tout fiscale.
Les résultats obtenus par la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, évoquée précédemment, sont contrastés, puisque 496 plaintes ont été déposées par la DGFiP depuis 2010 ; 124 dossiers fiscalisés par la DGFiP ont permis 209 millions d’euros d’impôts et de pénalités mis en recouvrement ; 62 décisions de justice sont intervenues, dont 12 classements sans suite ; 260 plaintes restent en cours, auxquelles il faut ajouter les 69 affaires de blanchiment de fraude fiscale, dans le cadre de l’affaire dite des « Panama Papers ».
Au vu des capacités de traitement de la Brigade, soit environ 50 affaires par an, il faudrait six ans pour que le stock d’affaires en cours soit purgé.
La création d’une police fiscale à Bercy est donc prévue à l’article 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude. Elle permettra de s’appuyer sur le socle du SNDJ, le Service national de douane judiciaire, qui a fait ses preuves, de désigner des agents de la DGFiP chefs d’enquête, ce qui n’est pas possible aujourd’hui dans le cadre de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, de privilégier une approche fiscale pour accélérer les rentrées budgétaires et, surtout, de densifier la coopération entre Bercy et la justice, en plaçant ce nouveau service sous l’autorité directe d’un magistrat de l’ordre judiciaire et, ainsi, d’avoir plus d’efficacité.
Par ailleurs, la question des moyens a été posée. Je peux vous l’assurer, les moyens mis au service de la DGFiP ont pour objet de lui permettre de s’équiper des outils nécessaires, notamment en termes de collecte et d’analyse de données, et de mettre ainsi à profit la dématérialisation croissante, pour ne pas dire presque totale, des déclarations et des informations faisant l’objet de traitements et d’enquêtes, afin d’être plus efficace dans la recherche de la fraude.
Enfin, je veux évoquer le contrôle parlementaire de l’activité de la commission des infractions fiscales. Mme Goulet a dit tout à l’heure qu’il y avait plus de camemberts dans le document en question que dans un village de son département.
Ce rapport, effectivement assez dense, présente des données quantitatives statistiques importantes, dont la lecture peut paraître, au premier abord, sinon rébarbative, en tout cas parfois compliquée. Je l’ai dit, les deux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ont la possibilité, depuis 2013, d’organiser un débat sur ce rapport, ce qui n’a jamais été fait. Elles peuvent également auditionner le président de la CIF. Par ailleurs, leurs présidents, comme leurs rapporteurs généraux, sont habilités à mener un contrôle sur pièces et sur place, à leur discrétion, pour obtenir les informations nécessaires, notamment celles qui permettent d’auditer et de tracer les décisions de la CIF ne donnant pas lieu à une transmission devant la justice.
À cet égard, la députée Émilie Cariou, qui est rapporteur de la mission d’information sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, a mis en œuvre ce droit de contrôle sur pièces et sur place et s’est rendue au sein de la CIF pour rencontrer les agents y exerçant et avoir ainsi les informations complémentaires dont elle avait besoin.
Nous sommes un certain nombre à défendre, depuis longtemps, dans différentes responsabilités, le principe d’un aménagement du « verrou de Bercy », pour aller vers plus de transparence et d’objectivité et pour donner les clés du « verrou de Bercy » au Parlement. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude qui vous sera présenté bientôt permettra d’inscrire dans la loi les critères et les conditions de la transparence, sans en venir, comme le prévoit le texte examiné aujourd’hui, à la suppression pure et simple du « verrou ». Il s’agira d’un aménagement de bon aloi permettant l’efficacité que nous recherchons tous en matière de lutte contre la fraude fiscale.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Nous avons essayé d’avoir le débat le plus serein possible, afin que la diversité des opinions puisse s’exprimer sur ce sujet. Nous l’avons fait dans la plus grande transparence et avec le maximum de pédagogie. Toutefois, j’ai parfois été choqué par l’imprécision de certaines interventions, celle-ci étant à l’origine d’un certain malaise. Les imprécisions, les fantasmes et les mythes minent notre démocratie et la question fondamentale du consentement à l’impôt.
J’ai entendu le chiffre de 80 milliards d’euros qui concerne la fraude fiscale et sociale. Or l’essentiel de la fraude fiscale et sociale est social. §Cela ne relève donc pas de Bercy, je suis désolé de vous le dire. Il faut continuer à être précis. À cet égard, je tiens à me faire le porte-parole du rapporteur général, que j’ai eu au téléphone tout à l’heure et qui vous prie, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, de l’excuser de ne pas être parmi nous, en raison d’une mission aux États-Unis.
La commission des finances, sans doute avec l’aide de la commission des lois, travaillera pour trouver le point d’équilibre auquel nous aspirons tous, fondé sur le principe de réalité. Nous le savons, la suppression pure et simple du « verrou » ne fonctionnera pas. Il est donc nécessaire que nous cherchions tous ensemble le vrai point d’équilibre. Ce serait un beau travail sénatorial, alimenté par le rapport de nos collègues sur le sujet, mais nos travaux ont par ailleurs déjà largement défriché le sujet.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Emmanuel Capus et Pierre Louault applaudissent également.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
Chapitre unique
Dispositions renforçant l’efficacité des poursuites contre les auteurs d’infractions financières et supprimant le « verrou de Bercy »
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – Lorsque des faits sont susceptibles de donner lieu à des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre, le procureur de la République territorialement compétent apprécie les suites à leur donner dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale. » ;
2° Le II de la section I du chapitre II du titre III de la première partie est complété par un article L. 225 B ainsi rédigé :
« Art. L. 225 B. – Sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale, tout procès-verbal établi en application de la présente section est transmis au procureur de la République » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 229, après les mots : « Les plaintes », sont insérés les mots : « formées par l’administration » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 230 est supprimé ;
5° À l’article L. 232, les mots : « sur la plainte » sont remplacés par les mots : « sur une plainte » ;
6° À l’article L. 233, les mots : « dans les poursuites engagées par les administrations fiscales » sont supprimés ;
7° Les articles L. 137, L. 228 A, L. 228 B et L. 248 sont abrogés.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote sur l’article.

Je souhaite réagir aux propos qui viennent d’être tenus, pour vous inciter, mes chers collègues, à voter l’article 1er de cette proposition de loi et les suivants.
De mémoire, la fraude sociale représente 500 millions d’euros. Le chiffre de 60 à 80 milliards d’euros correspond à la fourchette donnée par les syndicats de Bercy, sur la base d’une extrapolation des résultats des 50 000 dossiers qui sont contrôlés chaque année. Bien entendu, personne ne dit qu’on va récupérer du jour au lendemain 80 milliards d’euros. Toutefois, dans la mesure où l’on recouvre aujourd’hui 5 % de la fraude estimée, il n’existe donc, je le répète, aucun travail de dissuasion.
Monsieur le secrétaire d’État, vous dites que les amendes sont faibles. Néanmoins, pour les 4 200 dossiers les plus graves, le Conseil constitutionnel a précisé que l’on pouvait cumuler sanctions administratives et sanctions pénales. On ne peut par conséquent pas opposer le montant des sanctions prononcées par les tribunaux au montant des sanctions administratives.
Je termine enfin sur la suspicion qui mine la démocratie. Je suis tout à fait d’accord avec M. Longuet, il convient de louer les services de Bercy pour leur sérieux, leur responsabilité et leur professionnalisme. Mais notre collègue évoque également leur discrétion, alors que j’estime pour ma part que c’est exactement cela qui mine la démocratie !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.

La commission est bien évidemment défavorable à cet article, comme elle le sera aux articles suivants.
Pour ma part, je préfère le secret fiscal, beaucoup moins bafoué, au secret de l’instruction.

Je mets aux voix l’article 1er.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 100 :
Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est complété par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les poursuites sont engagées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale :
« – lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour d’autres faits ;
« – lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
« L’administration est informée sans délai des poursuites engagées dans ces conditions. ».
II. – Après l’article L. 227 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 227-… ainsi rédigé :
« Art. L. 227 - … – Pour le délit de fraude fiscale prévu à l’article 1741 du code général des impôts, l’administration fiscale a le droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République ou du procureur de la République financier, dans les conditions définies aux articles L. 247 à L. 251 A du présent livre, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228.
« L’acte par lequel le procureur de la République ou le procureur de la République financier donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Un amendement similaire a déjà été adopté par le Sénat. Vous parliez tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État, d’aménagement. Je sais bien que ce n’est ni le bon moment, ni le bon texte, ni le bon jour, ni la bonne heure, mais l’adoption du présent amendement enverrait un bon signal.
Cet amendement tend à lever partiellement le « verrou de Bercy », en visant la possibilité pour l’autorité judiciaire d’engager des poursuites sans autorisation préalable de l’administration, d’une part, lorsque les faits sont apparus à l’occasion d’une enquête ou d’une instruction portant sur d’autres faits, d’autre part, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou par le recours à diverses manœuvres.
Il vise en outre à ouvrir, sous le contrôle du parquet, une possibilité de transaction pénale pour les faits de fraude fiscale complexe commis dans les circonstances susvisées.
Il s’agit donc d’un aménagement préfigurant tous ceux que vous suggérerez ou validerez dans le cadre du projet de loi qui nous sera soumis dans quelques semaines.

Cet amendement reprend un dispositif proposé en juillet 2013 par la commission des lois et adopté effectivement par cette commission, mais pas par le Sénat, ma chère collègue. Je tiens à repréciser les choses sur ce sujet important.
Le mécanisme prévu par l’amendement soulève plusieurs difficultés de fond. En effet, quel sera l’impact sur les services de justice et sur l’administration ? Par exemple, l’interdiction de lancer des transactions sans passer par le parquet suscite des interrogations sur la réactivité du dialogue entre l’administration et le contribuable, comme sur la préservation du secret fiscal.
S’agissant de l’égalité entre les citoyens, au nom de quoi introduirait-on une procédure spéciale pour certains cas de fraude fiscale ? Toutes les affaires graves doivent aller devant le juge pénal, qu’elles relèvent ou non des conditions fixées par cet amendement. C’est justement l’avantage de la procédure actuelle, qui permet l’application de critères homogènes grâce au contrôle de la CIF.
Il convient également de réfléchir au périmètre du mécanisme prévu par l’amendement. Les cas de fraude fiscale aggravée sont ceux qui justifient le plus le renvoi devant l’autorité judiciaire, mais ce sont aussi ceux pour lesquels la compétence technique de l’administration est essentielle. Cela ne s’oppose en rien au dépôt de plainte. Certes, il manque à l’administration des moyens spéciaux pour mener l’enquête, nous en avons parlé, mais elle peut d’ores et déjà les obtenir par la procédure d’enquête judiciaire fiscale instaurée en 2009, sous le double contrôle de la commission des infractions fiscales et du parquet.
Avec l’adoption de cet amendement, il faudrait craindre une désorganisation du fonctionnement actuel, ce qui aurait finalement une incidence catastrophique sur la qualité du recouvrement des impôts et des pénalités.
S’agissant de la première partie de l’amendement, c’est précisément lors des débats portant sur ce point que l’Assemblée nationale a décidé de constituer une mission d’information. À un moment donné, il serait souhaitable d’avoir un minimum de cohérence !
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous demande, madame Goulet, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Il est identique à celui de la commission. En présentant votre amendement, vous avez vous-même relevé, madame la sénatrice, que le moment était sans doute inopportun.
Quoi qu’il en soit, votre proposition mérite d’être examinée. Je l’ai déjà dit, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la fraude fiscale, nous aurons la possibilité de procéder à des aménagements du « verrou de Bercy », pour le rendre à la fois plus transparent et plus objectif, afin de dissiper les doutes et les interrogations.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il sera au regret d’émettre un avis défavorable.

Cet amendement va dans le bon sens et fait tomber un certain nombre d’arguments avancés par ceux qui s’opposent à ce texte, jugé jusqu’au-boutiste. Toutefois, pour le rapporteur comme pour le Gouvernement, c’est encore trop ! En fait, le blocage, que nous ne pouvons plus comprendre, vient d’ailleurs.
En effet, quand on parle du « verrou de Bercy » en dehors de l’hémicycle, même des sénateurs de droite estiment qu’il faut arrêter cet archaïsme, qui ne correspond ni à ce qui se passe à l’étranger – on nous montre souvent en exemple un certain nombre de pays – ni au principe de séparation des pouvoirs qui guide notre République. Quand on fait des entorses à des principes fondamentaux, on peut toujours avoir recours à des arguties, mais on décrédibilise les fondements mêmes de notre République.
Par ailleurs, si ce gouvernement s’assoit parfois sur les grands principes, il ne cesse en revanche de se réclamer de l’efficacité économique. Or comment peut-il justifier le fait de renoncer à une somme évaluée entre 60 et 80 milliards d’euros, même si l’on sait qu’on ne pourra jamais la recouvrer totalement ? Avez-vous une idée de ce qu’on peut financer en récupérant ne serait-ce que 10 milliards d’euros supplémentaires ? Au moment où il n’y a plus d’argent dans les caisses, où les services publics ne sont plus assurés sur l’ensemble du territoire, où les hôpitaux publics sombrent dans le marasme, ce qui menace la santé de nos concitoyens, comment peut-on se priver de la recherche de mécanismes permettant de faire entrer plus d’argent dans les caisses de l’État, tout en envoyant un signe de respect du principe d’égalité à l’ensemble de la société ? Même si l’on dispose des meilleurs conseils juridiques, on ne doit pas être mieux loti que les simples citoyens assujettis à l’impôt.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

L’examen de cet amendement est caractéristique du double discours et d’un traitement peu agréable du Parlement.
M. le secrétaire d’État l’affirme, reprenant ainsi une expression de M. Gérald Darmanin que l’on ne comprend d’ailleurs pas très bien, le Gouvernement a décidé « de donner les clés du verrou de Bercy au Parlement ». Cela tombe bien, car nous, parlementaires, sommes chargés de faire la loi !
On peut être en accord ou en désaccord avec ce que nous proposons ici, mais comment peut-on dire une phrase pareille ? Ou alors, le Sénat n’est pas le Parlement, comme je le comprends malgré tout.
J’entends également M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur, ce qui me surprend davantage, évoquer la nécessité d’aménager, de trouver des critères, de ne pas engorger la justice, etc. Or notre collègue Nathalie Goulet, que personne ne peut soupçonner de s’intéresser à ces questions sous le coup de l’émotion, puisqu’elle y travaille depuis plusieurs années, comme nombre d’entre vous, mes chers collègues, propose un mécanisme constituant un début d’aménagement. Cela correspond d’ailleurs à la décision prise, voilà plusieurs années, par la Cour de cassation, qui voulait exclure du « verrou » le blanchiment de fraude fiscale. Il s’agit donc d’un dispositif identifié d’un point de vue juridique.
Pourtant, une telle proposition ne convient toujours pas ! Monsieur le rapporteur, nous allons, dans quelques semaines, voire quelques jours, travailler sur ce sujet. Que direz-vous, alors que vous refusez aujourd’hui, dans un bel élan et de concert avec le Gouvernement et, sans doute, la majorité du Sénat – j’ai cru comprendre que c’est ainsi que se dessinaient les accords internes –, ce modeste aménagement, que le groupe socialiste et républicain, considérant qu’il est important d’avancer, souhaite voter ?
Ce double discours est absolument regrettable et peu positif pour le Parlement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
J’ai entendu deux fois, et même trois, en comptant la dernière intervention, évoquer l’idée d’un double discours sur cette disposition. Mais s’il fallait supprimer le « verrou » fiscal, pourquoi le groupe socialiste n’a-t-il pas voté en faveur de l’amendement de M. Bocquet, le 5 juin 2016 ? Pour quelle raison ?
Avec toute l’estime que j’ai pour beaucoup d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je me demande ce qui empêchait votre groupe de le faire.
De la même manière, le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, dont je faisais partie, a toujours voté le rétablissement du « verrou » fiscal lorsqu’il était question de le supprimer purement et simplement.
Nous l’avons dit et répété pendant cinq ans ! Souvenez-vous-en !
Pendant cinq ans, nous avons dit que nous étions opposés à la suppression pure et simple du « verrou de Bercy ». Parce que vous êtes dans l’opposition, vous militeriez aujourd’hui, en vertu de je ne sais quelle amnésie, pour cette suppression pure et simple ?

Il y a six mois, vous étiez contre le budget de l’État ! C’est l’hôpital qui se moque de la charité ! C’est vous qui êtes amnésique !
C’est donc vous qui tenez un double discours !
Je le répète : nous sommes - et j’ai toujours été, à titre personnel - favorables à l’aménagement du « verrou ».
Le Gouvernement travaillera, avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, de manière à aménager le « verrou » dans le sens d’une efficacité renforcée.

Je regrette que nous ayons ce type de discussion. Je crois en effet que la lutte contre la fraude fiscale peut nous rassembler et nous faire avancer.
Mais, en l’occurrence, objectivement, nous sommes devant un refus. Ce ne serait pas le moment ! Je ne sais ce qui aura changé dans un mois et demi ; peut-être un nouveau scandale aura-t-il éclaté. Sinon, rien n’aura changé !
On aurait donc tout à fait pu avancer, par exemple en adoptant un amendement émanant d’autres groupes que le nôtre – je salue, à ce titre, le travail de Nathalie Goulet ; sa proposition constitue en quelque sorte une solution de repli, et nous la soutiendrons, notre état d’esprit étant, comme je l’ai dit, d’avancer.
Un certain nombre de choses ont été faites au cours du précédent quinquennat, notamment la création du Parquet national financier – cela a été rappelé. Des dispositifs ont été mis en place – ils sont désormais opérationnels –, conditions nécessaires à la suppression du « verrou de Bercy ». Nous disposons désormais d’outils qu’il convient de déployer pour permettre cette suppression et faire cesser cette logique qui n’est pas du tout dissuasive. Or il faut que nous entrions dans une logique dissuasive !
Oui, nous serons présents lors de la discussion du projet de loi Darmanin. Vous nous trouverez ici même, avec des propositions. Mais il eût été possible, et souhaitable, que le Parlement prenne ses responsabilités aujourd’hui, ici, au Sénat, pour faire des propositions, afin que l’on avance sur le chemin de la lutte contre la fraude fiscale.

J’interviens d’autant plus volontiers que j’ai été pris à partie directement.
Je suis tout à fait d’accord avec ma collègue Sophie Taillé-Polian sur le fait que nous sommes tous profondément attachés à la lutte contre la fraude fiscale.

Nous divergeons un tantinet sur la définition des moyens efficaces, et sur l’opportunité de judiciariser exclusivement ou pas le mode de règlement de ce type de litiges. La divergence porte simplement sur le type de moyens.
Vous l’avez compris : il me semble, à titre personnel, que supprimer totalement la voie administrative, au profit exclusif de la poursuite pénale, n’est pas le moyen le plus efficace.

S’agissant de l’amendement de Mme Goulet, l’idée d’une levée partielle, dans certains cas, du « verrou de Bercy » mérite d’être étudiée très sérieusement – je partage cette analyse avec le rapporteur du texte.
Il me semble que la proposition de Mme Goulet, qui consiste à développer le recours à la transaction pénale en cas de refus de la solution transactionnelle durant la phase administrative, constitue un compromis intéressant, et nous pourrons en débattre.

Je dis juste que ce n’est ni le lieu ni le moment. Nous allons avoir un débat. Le texte qui va être proposé et les discussions qui ont lieu à l’heure actuelle à l’Assemblée nationale, et qui seront rendues publiques le 22 mai prochain, nous permettront d’avancer. C’est juste une question de timing. Mais je salue le travail effectué par Mme Goulet.
Vous aurez compris, mes chers collègues, que, à ce stade de la discussion, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera contre le présent amendement.

Oui, monsieur le président.
Cette disposition ne fait que découler de ce qui a été auparavant voté dans cette maison. Elle a déjà été adoptée, notamment dans le cadre d’un texte relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, via un amendement déposé par Éric Bocquet.
Il ne s’agit pas d’engorger les tribunaux ; il s’agit simplement de pouvoir délester, le cas échéant, le « verrou », dans l’hypothèse d’instructions connexes. Ce n’est quand même pas la mer à boire, d’autant plus que l’article 1er de cette proposition de loi a déjà été rejeté par le Sénat et que le texte n’a aucune espèce de chance d’arriver jusqu’à l’Assemblée nationale, puisque nos collègues du groupe Les Républicains ont demandé un deuxième scrutin public !
Je trouve donc que l’image donnée n’est pas du tout satisfaisante. Il s’agit d’une simple procédure ; on peut parfaitement imaginer adopter cette disposition à titre de signal en faveur de l’assouplissement promis ; de toute façon, dans quelques semaines, au mois de juillet, lorsque le projet de loi qui a été évoqué arrivera devant nous, cet amendement sera de nouveau déposé. Et je doute que, d’ici à juillet, il fasse l’objet d’une expertise plus poussée, et qu’on ait le temps d’expertiser les autres mesures.
Je ne parle pas de double discours, monsieur le secrétaire d’État – je ne pense pas que vous teniez un double discours. Je dis simplement que les échéances que vous évoquez, qui sont à quelques mois, ne sont absolument pas une garantie. Compte tenu de la capacité générale des gouvernements successifs à accompagner leurs textes d’études d’impact, je doute que l’ensemble des mesures d’assouplissement que vous allez nous proposer soient plus expertisées que les dispositions du présent amendement du groupe Union Centriste, que je maintiens.
Mme Élisabeth Doineau et M. Jean-Marie Janssens applaudissent.

Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 101 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Exclamations sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Le 3 de l’article 1746 du code général des impôts est abrogé.

Il s’agit d’un article de cohérence ; l’article 1er n’ayant pas été adopté, il n’y aurait aucun sens à adopter l’article 2.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Laissez le vote se dérouler, monsieur le rapporteur !
Brouhaha.
L ’ article 2 est adopté.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-21 est ainsi modifié :
a) À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le VI de l’article L. 725-3, le 5° du III de l’article L. 745-13 et le 5° du III de l’article L. 755-13 sont ainsi modifiés :
a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée. –
Adopté.
Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales » sont supprimés. –
Adopté.
L’article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière est abrogé. –
Adopté.
Le III de l’article 21 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « L. 228, L. 229, les premier et dernier alinéas » sont remplacés par les références : « L. 229, le premier alinéa » ;
2° La seconde phrase est supprimée. –
Adopté.
Le II de l’article 58 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé. –
Adopté.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. le rapporteur.

L’article 1er n’ayant pas été adopté, adopter les articles suivants, qui sont des articles de cohérence avec l’article 1er, me semble un peu original. Cela n’a pas de sens, et il serait dommage qu’un texte dépourvu de sens sorte du Sénat. Je suis donc évidemment défavorable à l’adoption de ce texte.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de la proposition de loi renforçant l’efficacité des poursuites contre les auteurs d’infractions financières et supprimant le « verrou de Bercy ».
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 102 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures trente-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (proposition n° 368 [2016-2017], texte de la commission n° 316, rapport n° 315).

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l’article 36 du règlement.
Le 7 mars dernier se tenait ici même une discussion houleuse sur la proposition de loi que nous allons de nouveau étudier ce soir.
Alors que tous les groupes parlementaires du Sénat, à l’exception du groupe La République En Marche, étaient prêts à voter ce texte en l’état, vous aviez décidé, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, d’utiliser l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, prévoyant la procédure du vote bloqué.
Face à ce coup de force sans précédent et antidémocratique, nous avions suspendu l’examen de notre proposition de loi. Depuis, les retraités agricoles et des élus de toute la France se sont mobilisés et nous ont fait parvenir plus de 8 000 pétitions demandant expressément à votre gouvernement de revenir sur sa position et d’accepter de revaloriser les pensions agricoles sans attendre.
Ces plus de 8 000 pétitions, je vais vous les remettre, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État. Elles seront entre vos mains, tout comme le devenir des retraités agricoles, dont certains, ce soir, sont de nouveau en tribune, aux côtés d’André Chassaigne, initiateur de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale.
Par ce rappel au règlement, je vous demande, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, d’une part, si le gouvernement que vous représentez est prêt à faire un pas vers la démocratie en acceptant le débat sans avoir recours au vote bloqué, et surtout, d’autre part, s’il est enclin à revoir son jugement sur le sort des pensions agricoles.
À l’heure où le Sénat rassemblé souhaite voter en l’état cette proposition de loi en vue d’une application immédiate, sans report dans le temps, vous avez entre les mains, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, le devenir des pensions agricoles les plus faibles, qu’il vous appartient de revaloriser. §

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour un rappel au règlement.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, mon intervention, comme celle de ma collègue Cécile Cukierman, se fonde sur l’article 36 du règlement.
Ce matin, nous avons eu un débat, en commission des affaires sociales, sur cette proposition de loi ; chacun, président, rapporteur, commissaire, a pu y exprimer son point de vue. Ce dialogue contrasté, parfois contradictoire, est nécessaire, utile, sain, et fait partie de l’exercice parlementaire. Je pense sincèrement qu’en politique, la confrontation est salutaire, et je ne suis pas seule à le penser : cette position est partagée, sur toutes les travées de la Haute Assemblée.

La stratégie du Gouvernement, qui consiste à passer en force coûte que coûte, bafouant le vote de plusieurs groupes parlementaires, à l’Assemblée nationale et ici même, à la Haute Assemblée, n’en apparaît qu’encore plus antidémocratique.
Après avoir, le 7 mars dernier, utilisé l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, vous avez en effet fait le choix, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, de détourner une nouvelle fois le débat en déposant des amendements portant articles additionnels avant l’article 1er, dont les dispositions n’ont que peu à voir avec le fond de notre texte.

Effectivement, alors que notre texte, s’il était adopté, entraînerait immédiatement une revalorisation sensible du revenu des agriculteurs, vous proposez, quant à vous, une revalorisation de 27 euros par mois pour les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les conjoints participant aux travaux et les aides familiaux, et ce seulement, mes chers collègues, en 2020 !

Il faut encore attendre ! Quelle générosité, mais surtout quel mépris pour le monde agricole ! Il en va de même avec votre amendement sur les travailleurs inaptes.
Quel mépris, aussi, pour l’initiative parlementaire et pour l’esprit de consensus dont ont fait preuve les membres de la Haute Assemblée !
À l’aube de la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l’État afin d’améliorer l’efficacité du travail parlementaire, vous avouerez que c’est la marque d’une cruelle ironie. En quoi maltraiter l’initiative parlementaire peut-il être gage d’efficacité, d’autant que, vous le savez bien, l’adoption de ces amendements entraînerait de facto la fin de cette proposition de loi, une navette ne pouvant aboutir ?
Éloigner, par des amendements dilatoires, le débat parlementaire du fond de notre proposition ne peut que renforcer nos inquiétudes et notre opposition à la réforme à venir.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour un rappel au règlement.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l’article 36 du règlement.
Je tiens, par ce rappel au règlement, à vous faire part, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, du soutien que notre proposition de loi a recueilli auprès de nombreux élus locaux. Car, au-delà des premiers concernés, les retraités eux-mêmes, la discussion et l’adoption de ce texte répondraient à plusieurs enjeux essentiels pour nos territoires.
Il est urgent de faire bénéficier chaque agriculteur d’une pension décente au moment où il cesse son activité, pour plus de justice sociale d’abord, mais aussi parce que le niveau des retraites agricoles a un impact sur notre modèle agricole.
Si nous voulons une agriculture avec des agriculteurs, si nous voulons résister aux phénomènes de financiarisation de l’activité agricole et d’accaparement des terres, il est impératif de permettre des départs anticipés et des rachats d’exploitations à un coût acceptable, rendant possible l’installation de jeunes agriculteurs et la préservation d’un modèle d’agriculture à taille humaine.
Répondre à la détresse des retraités agricoles, c’est faire le choix de maintenir une diversité des agricultures, des produits, des terroirs. C’est refuser une agriculture standardisée aux mains des firmes financières, avec des acteurs économiques capitalistiques en lieu et place des agriculteurs et de leur statut.
Les élus locaux, qui, à travers de nombreuses motions – vous les avez en main, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État –, ont exprimé leur souhait de voir cette proposition de loi adoptée dans les plus brefs délais, ne s’y sont pas trompés.
Comment pouvez-vous justifier la suppression de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune, et dans le même temps prétendre que la revalorisation des retraites agricoles coûterait trop cher ?

M. Éric Bocquet. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez dit, en mars, qu’on ne trouvait pas, comme ça, un soir, au Sénat, 400 millions d’euros ; nous sommes en mai, et M. le Président de la République vient d’annoncer la suppression de l’exit tax. Or cette taxe représente deux fois les 400 millions d’euros nécessaires pour financer la revalorisation des retraites agricoles !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, je vous rappelle que la discussion de la présente proposition de loi a commencé le 7 mars dernier et que la discussion générale a été close.
Le Gouvernement avait demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote, conformément à l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, sur l’ensemble de la proposition de loi, modifiée par l’amendement n° 3, qu’il avait déposé.
Pour la clarté de nos débats et afin de répondre d’ores et déjà aux différentes interrogations et d’éviter tout risque d’incompréhension, je me permets de vous apporter quelques précisions sur le déroulement de nos travaux.
Dans le cadre de la procédure du vote unique, les sénateurs conservent la possibilité de prendre la parole sur tous les articles du texte, et les auteurs des amendements conservent naturellement leur droit de présentation.
En conséquence, à chaque article, les sénateurs inscrits pour une prise de parole sur l’article disposent, en vertu de notre règlement, de deux minutes trente.
À l’issue de ces prises de parole et de la présentation des amendements, nous passerons aux explications de vote et au vote unique sur les articles, sur les amendements retenus et sur l’ensemble de la proposition de loi.
Cette procédure n’étant pas si commune, ce rappel me semblait utile pour que nos débats se déroulent dans une sérénité parfaite.
Applaudissements.
TITRE Ier
GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant minimum mentionné au même article au titre des périodes d’assurance accomplies comme collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, comme conjoint participant aux travaux et comme aide familial est revalorisé de 5 % au 1er janvier 2020, dans des conditions fixées par décret.
La parole est à Mme la ministre.
Au sein du régime des exploitants agricoles, les conjoints collaborateurs sont ceux qui perçoivent les pensions les plus faibles, de l’ordre de 597 euros par mois.
La pension majorée de référence est un minimum de pension de retraite de base spécifique au régime des non-salariés agricoles qui permet précisément de relever les pensions les plus faibles à un minimum variable selon la durée de cotisation. Le montant perçu par les conjoints qui travaillent sur l’exploitation est inférieur à celui qui est perçu par le chef d’exploitation. De fait, il reste à un niveau particulièrement bas : 546, 17 euros par mois pour une carrière complète en tant que collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole ou aide familial.
Cet amendement vise donc à augmenter le minimum de pension des conjoints de 5 %. L’augmentation interviendra dès le 1er janvier 2020. Cette mesure de justice permettra d’améliorer la retraite de près de 160 000 personnes.

Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 5, également déposé par le Gouvernement.
L’amendement n° 4a pour objet de revaloriser de 5 % la pension minimale de référence qui est le minimum contributif du régime des non-salariés agricoles pour les seuls conjoints collaborateurs et aidants familiaux au 1er janvier 2020.
L’adoption de cet amendement représenterait, pour les intéressés, une augmentation de 27 euros par mois maximum, pour les assurés collaborateurs ayant effectué l’intégralité de leur carrière au sein du régime des non-salariés agricoles.
Ces données sont à comparer avec l’écart actuel entre la moyenne des pensions des anciens exploitants agricoles – il s’agit, dans la plupart des cas, d’hommes – qui se situe à 855 euros, et celle des conjoints collaborateurs, qui est de 597 euros, c’est-à-dire un écart de 30 %.
D’après les estimations fournies par le Gouvernement, le coût d’une telle mesure s’élèverait à 30 millions d’euros par an en moyenne, contre – je le signale – 400 millions d’euros pour l’ensemble de la proposition de loi en débat aujourd’hui.
L’amendement n° 5, quant à lui, vise à assouplir les conditions d’éligibilité aux points gratuits du régime complémentaire obligatoire des chefs d’exploitation pour les pensionnés actuels reconnus travailleurs inaptes ou handicapés ayant liquidé leur pension depuis 1997 en levant la condition du taux plein pour bénéficier de points gratuits et en alignant les règles.
La commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur ces deux amendements. Le pas fait par le Gouvernement reste très limité, d’autant que la hausse de la pension minimale de référence est renvoyée à 2020, ainsi que Mme la ministre vient de le souligner.
Par ailleurs, vous le savez, l’adoption de ces amendements irait à l’encontre de la position de la commission des affaires sociales, qui souhaite à la quasi-unanimité un vote conforme sur ce texte. C’est d’ailleurs une nécessité pour une application rapide de l’ensemble de la proposition de loi, face à une urgence sociale reconnue de tous.
La commission des affaires sociales ne peut donc, je le répète, qu’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Le vote est réservé.
L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au présent 2° n’est pas applicable aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions mentionnées à l’article L. 732-23 et aux personnes justifiant d’une pension de retraite liquidée en application des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-3 et du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. »
La parole est à Mme la ministre.
Je considère que cet amendement est défendu, monsieur le président.

Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le vote est réservé.
(Non modifié)
À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : «, à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à la lecture de cette proposition de loi, je ne peux qu’approuver le principe d’une revalorisation des petites retraites agricoles, tout en émettant quelles remarques.
En effet, la revalorisation des petites retraites en agriculture est un problème récurrent, que nous ne sommes jamais parvenus à endiguer, même si le passage de 75 % à 85 % du SMIC est une avancée.
Qui aujourd’hui peut trouver normal d’avoir une si faible pension après une vie de travail ?
À ce sujet, n’oublions pas que la faiblesse du montant de ces pensions résulte de la faiblesse des cotisations, elle-même due à la faiblesse des revenus.
Aussi, cette revalorisation est une attente forte des anciens agriculteurs, qui voient tous les jours leur pouvoir d’achat diminuer. Et les décisions du Gouvernement, comme la hausse de la CSG et des carburants, n’ont fait qu’aggraver cette situation.
Je formulerai deux remarques.
La première concerne le mode de financement de cette revalorisation, qui représente environ 400 millions d’euros. Dans la présente proposition de loi, il est prévu qu’elle soit compensée par l’augmentation de la taxe sur les transactions financières, portée de 0, 3 % à 0, 4 %.
Il ne faudrait pas que cette compensation devienne très vite un leurre et que cela se termine par une énième augmentation de la cotisation des actifs à la retraite complémentaire obligatoire, ou RCO.
En effet, la RCO, qui est de l’ordre de 760 millions d’euros, est aujourd’hui financée par la contribution des actifs, à hauteur de 470 millions d’euros, le reste étant compensé par des taxes diverses.
Depuis 2014, la RCO des actifs n’a cessé d’augmenter, en passant de 3 % à 3, 5 %, puis 4 %, pour atteindre l’objectif d’une retraite à 75 % du SMIC. Si ma crainte se révèle fondée, cela se traduira par un quasi-doublement de la cotisation à la RCO des agriculteurs actifs. Ce n’est absolument pas acceptable.
Ma seconde remarque s’inscrit dans une réflexion plus globale sur la situation de nos agriculteurs. Comme les petites retraites résultent de petits revenus, leurs faibles montants résident dans la difficulté pour les agriculteurs de bénéficier de prix de vente de leurs produits suffisamment élevés. Une des raisons, largement connue, est la pression qu’exercent les enseignes des grandes surfaces pour faire baisser les prix depuis des décennies.
Alors, au lieu d’augmenter la taxe sur les transactions financières pour compenser le coût de la revalorisation, ne faudrait-il pas augmenter la fiscalité des grandes et moyennes surfaces, via la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, et affecter ce produit à la revalorisation des retraites ? C’est le sens de la proposition de loi que j’ai aussi déposée sur la revalorisation des retraites agricoles.

Cela permettrait enfin un juste retour du fruit du travail du laboureur et de ses enfants !
Certes, la terre n’est pas obligatoirement un trésor. Mais les grandes enseignes, comme Leclerc, Auchan et d’autres encore, s’en sont fait un sur le dos des paysans !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Fils et petit-fils de paysans – je pense que nous sommes nombreux dans ce cas au sein de la Haute Assemblée –, nous avons tous été marqués par la retraite de misère de nos parents et grands-parents. Cela nous ramène aujourd’hui au sort de nombreux retraités agricoles.
Aussi, cette proposition de loi constitue un appel à la dignité pour nos agriculteurs. Elle est un appel à la justice pour nos territoires ruraux. Elle est un appel à l’équité et à la solidarité des parlementaires pour des hommes et des femmes qui ont travaillé durement toute leur vie et se retrouvent, pour certains d’entre eux, sous le seuil de pauvreté.
Cette proposition de loi a déjà fait l’objet d’un vote à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Et pour cause ! Elle répond à des situations de détresse de nos anciens chefs d’exploitation agricole, désormais à la retraite, dont un sur trois touche une pension de moins de 350 euros par mois, et dont le niveau moyen est le plus faible des régimes.
La proposition de loi demande ainsi d’offrir un minimum que tout un chacun est en droit d’attendre après une vie de travail sans avoir jamais sollicité d’aides sociales diverses, sans avoir jamais sollicité la solidarité nationale, alors que les enfants accompagnent bien souvent leurs parents et leurs grands-parents en fin de vie à domicile.
Le désarroi dans lequel vivent certains de nos retraités mérite une action. Il ne peut pas attendre d’être traité dans le cadre d’un projet de réforme globale des régimes de retraite qui en est toujours au stade de l’annonce.
Cette préoccupation a été celle de gouvernements successifs depuis 2002, notamment en 2011, où le régime de retraite a été élargi. Mais 75 % du SMIC, c’est assurément insuffisant ; 85 %, c’est un minimum vital !
Georges Pompidou, Président de la République, qui connaissait bien la ruralité du Cantal et la rudesse de la vie des agriculteurs, témoignait ainsi : « Mon père et ma mère appartenaient profondément à la race française, dure au travail, économe, croyant au mérite, aux vertus de l’esprit, aux qualités du cœur. Je n’ai pas eu une enfance gâtée. Mais, si loin que je remonte, je n’ai reçu que des leçons de droiture, d’honnêteté et de travail. Il en reste toujours quelque chose. »
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Madame la ministre, vous persistez ! Vous persistez à considérer que cette proposition de loi est prématurée. Nous, nous persistons à dire qu’il y a urgence sociale. Les amendements que vous proposez, pour une application en 2020 ou plus tard, ne dupent personne. Vous voulez éviter le vote conforme. Nous, nous voulons ce vote conforme, parce qu’il y a urgence.
Nous ne nous parlons pas le même langage. Vous nous parlez d’équilibre des comptes ; nous parlons de justice sociale et de nécessaire solidarité. On nous dit que cette proposition de loi est prématurée. Nous, nous disons qu’il y a une urgence sociale et que, par exemple, la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune n’était aucunement une urgence sociale ou une nécessité !
Certes, vous nous dites que les retraités agricoles méritent toute l’attention du Gouvernement. Très bien ! Mais c’est comme en amour : seules comptent les preuves !
Sourires.

Vous refusez les propositions de financement de ce texte du groupe CRCE, mais vous n’en formulez aucune autre. Or, dans cette proposition de loi, il est envisagé de mettre à contribution le monde de la finance. En quoi cela peut-il gêner de prélever un centime d’euro pour l’achat d’une action de dix euros ?
Vous nous parlez de chiffres et d’équilibre des comptes. Des chiffres, en voici, madame la ministre : retraite de monsieur, non-salarié agricole dans le département de l’Aude, 646 euros ; retraite de madame, non-salariée agricole dans le département de l’Aude, 321 euros ; au total, pour ce couple, 967 euros de retraite par mois ! Ne pensez-vous pas qu’un effort supplémentaire puisse être fait et qu’il y a urgence en la matière ?
Voilà la situation difficile, pour ne pas dire précaire, dans laquelle se trouvent les anciens travailleurs de la terre après des décennies de dur labeur. Ils ne demandent donc que reconnaissance et justice sociale.
Au demeurant, cette demande urgente concerne en priorité non pas les grands propriétaires terriens, mais les petits paysans de métropole et d’outre-mer, ceux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont fait passer l’agriculture autarcique à une agriculture de production. Ils ont droit à notre reconnaissance !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Je suis gêné par cette discussion, et plus encore, en cette période difficile que traversent le monde agricole et le monde de l’économie rurale, lorsque je songe à ceux qui ont construit la richesse de notre pays pendant des décennies, j’ai honte.
J’ai honte de voir que l’on ne reconnaît pas la qualité de leur travail, la qualité de la production, la sécurité qu’ils apportent à nos besoins alimentaires au quotidien. J’ai honte qu’un agriculteur, quel qu’il soit, n’ait pas aujourd’hui une retraite juste.
Madame la ministre, je vous invite à réfléchir. Je vous suggère d’imaginer que vous repreniez une exploitation agricole, que vous en trouviez les moyens, que vous travailliez pendant quarante ans ou cinquante ans, que vous éleviez votre famille et que, à la fin de votre vie, vous touchiez seulement 687 euros pour vivre. Je pense que c’est insupportable !
Je vous appelle sincèrement à mieux prendre en compte les dispositions qui nous sont proposées.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les pensions de retraite sont un enjeu vital pour nos agriculteurs. C’est d’autant plus vrai dans nos territoires ultramarins, à plus d’un titre.
En Martinique, notre agriculture est soumise à des contraintes insulaires – je pense à l’exiguïté ou à la dépendance économique vis-à-vis de certains produits d’importation –, climatiques, sanitaires, par exemple, la pression parasitaire, et à des possibilités réduites d’économies d’échelle, du fait de la prédominance des petites exploitations, du coût de la main-d’œuvre et du prix élevé du foncier qui augmentent les coûts de production. Les coûts post-récoltes sont également élevés, en raison de la faible taille et de l’isolement des opérateurs concernés, rendant certains produits issus de l’agriculture locale peu compétitifs face aux importations.
Entre 2001 et 2011, la Martinique a vu le nombre de ses exploitations agricoles passer de 8 000 à 3 300. Cette diminution a été particulièrement marquée pour les petites structures. Aujourd’hui, 66 % des 2 994 exploitations agricoles présentent une surface agricole utile, ou SAU, de moins de 5 hectares. L’agriculture couvre désormais 21 % du territoire, soit une diminution de 23 % de la SAU en dix ans.
En outre, entre 2013 et 2014, nous avons assisté à une régression de 14 % des cultures légumières, de 6 % des cultures fruitières semi-permanentes et de 30 % des cultures fruitières permanentes !
Dans un contexte de fort vieillissement de la population et de déclin démographique, le renouvellement des exploitants agricoles – seulement 9 % des chefs d’exploitation ont moins de quarante ans – exige une forte vitalité de l’enseignement agricole et une intensification de la politique d’encouragement à l’installation. Mais comment y parvenir quand l’on promet aux potentiels jeunes agriculteurs travaux pénibles et horaires à rallonge, faibles revenus durant leur vie active et retraite aux antipodes de tous les efforts fournis pendant tant d’années ?
Selon le rapport de 2016 du Conseil d’orientation des retraites, les prestations de retraite pour une carrière complète s’élèvent à 1 690 euros pour les salariés agricoles et à 710 euros pour les non-salariés agricoles, soit un niveau inférieur à la fois au seuil de pauvreté et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sachant qu’un non-salarié agricole monopensionné sur deux en outre-mer perçoit une retraite mensuelle inférieure à 333 euros !
Nos agriculteurs sont en grande souffrance. Ils se tuent à la tâche sans parvenir à vivre décemment du produit de leur labeur, et, à la retraite, ils se retrouvent dans une extrême misère. Nous ne pouvons pas tolérer cette situation ni être complices de cette infamie. En attendant, peut-être, de meilleures propositions du Gouvernement dans le cadre du prochain projet de loi agricole, sur lequel nous serons extrêmement vigilants, j’ose espérer que cette proposition de loi ira au terme de son cheminement législatif pour une réelle application, rendue plus que nécessaire !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les agriculteurs sont des passionnés. Ils aiment leur travail. Ils travaillent pour faire progresser leur ferme, leur productivité et la richesse de notre pays.
Les agriculteurs, notamment les éleveurs, ont eu des journées, des mois, des années pleines de difficultés : responsabilité sanitaire, responsabilité de vendre leurs produits en essayant de dégager un excédent pour faire vivre leur famille et payer les emprunts. En 2016, ils ont même vendu au-dessous du prix de revient.
Je connais bien ces agriculteurs à la retraite, qui ont travaillé sept jours sur sept toute leur vie sur des petites propriétés, qu’ils ont agrandies à force de labeur.
Ce serait donc pour moi justice de porter leur retraite à 85 % du SMIC en métropole et à 75 % du SMIC dans les territoires d’outre-mer en 2020.
En commission, j’avais émis un vote positif sur l’amendement du Gouvernement, l’échéance de 2020 me paraissant acceptable.
Je comprends bien qu’il faut respecter certaines exigences budgétaires lorsque l’on gère un pays. Les retraites que verse la Mutualité sociale agricole, la MSA, sont déjà subventionnées par l’État, puisque les agriculteurs en activité ne sont pas assez nombreux.
Le Gouvernement a formulé une proposition, qui est certainement appréciée, mais qui n’est pas assez importante. Je pense qu’il faut porter le montant de la pension à 987 euros par mois le plus vite possible. Certes, les gouvernements précédents auraient pu le faire, et ils ne l’ont pas fait… Les conjoints – ce sont essentiellement des femmes –, qui ont beaucoup travaillé, souvent sept jours sur sept, doivent avoir une retraite décente, proche de celle des chefs d’exploitation. Ce n’est pas le cas avec les 5 % prévus.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants – République et Territoires s’abstiendra.

Le 7 mars dernier, beaucoup d’entre nous, qui étaient déjà présents dans l’hémicycle, ont été stupéfaits de la demande de vote bloqué formulée par le Gouvernement. Je n’ai pas eu alors l’occasion d’exprimer mon profond désaccord.
Sur la forme, le Gouvernement a préféré le bras de fer pour gagner du temps, restreignant à son minimum l’expression des parlementaires, ce qui n’est arrivé que six fois depuis 1959 – je crois que cela a été souligné – pour une proposition de loi, dans un contexte où il n’y avait pas d’obstruction.
Si le Gouvernement ne veut pas de ce texte, il a toutefois la responsabilité de respecter le débat démocratique et son expression. Cette proposition de loi, votée à l’unanimité par les députés, certes avant l’élection du nouveau Président de la République, aurait pu entrer en application au 1er janvier 2018 si elle avait été adoptée par le Sénat.
Je félicite ses auteurs, ainsi que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, d’avoir rendu possible son examen. En outre, le texte est parfaitement cohérent avec les engagements de campagne du candidat Emmanuel Macron en faveur de la revalorisation des retraites agricoles.
Sur le fond, c’est insultant pour une profession en détresse depuis des années. Pour eux, la situation est intenable.
Si je peux entendre que le Gouvernement souhaite par cohérence retarder la revalorisation des retraites agricoles pour la faire coïncider avec la réforme globale annoncée des retraites, il n’en demeure pas moins que la situation des agriculteurs de nos territoires en matière de retraite est dramatique. Et c’est encore plus vrai pour les agricultrices, qui, pour une grande part, n’ont pas de statut professionnel ou relèvent du statut de conjointe collaboratrice, lequel ne les couvre pas en l’espèce.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons autour de la proposition de loi « revalorisation acte II ».
J’ai pris connaissance, comme nombre d’entre nous dans cette enceinte, des deux amendements déposés par le Gouvernement, portant sur des mesures qui pourraient être mises en application en 2020. Je regrette de constater qu’il s’agit d’une aumône ; d’un côté, certains diront que c’est mieux ; de l’autre, certains se demanderont où est le respect…
Puisque ce texte fait l’objet d’un vote bloqué, ma question est claire : en l’absence de vote conforme, sera-t-il inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement ?
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Quelle déception, madame la ministre ! Quelle déception de constater que le Gouvernement veut une nouvelle fois jouer de tous les artifices de la procédure parlementaire pour entraver l’adoption définitive de ce texte !
En déposant deux nouveaux amendements, en apparence favorables aux agriculteurs, vous tentez d’atténuer votre stratégie d’obstruction à ce texte présenté par nos collègues communistes.
Mais nous ne sommes pas dupes ! Votre unique objectif est d’empêcher à tout prix un vote conforme du texte adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale. La procédure du vote bloqué soumet la Haute Assemblée à votre souhait d’enterrer au plus vite ce texte. Est-ce cela la démocratie responsable et efficace que vous prônez ? Une démocratie dans laquelle le Parlement serait hors-jeu ?
Vous pourriez tout à fait déposer ces amendements dans le cadre d’autres véhicules législatifs et permettre ainsi l’adoption de la revalorisation des petites retraites agricoles à 85 % du SMIC dès cette année. C’est le principal sujet de la proposition de loi ; c’est celui qui nous rassemble ce soir, au-delà des clivages politiques. Il y a une urgence sociale, vous le savez. Repousser l’entrée en vigueur de ce texte reviendrait à nier la précarité de ces hommes et de ces femmes de la terre.
Plutôt que de laisser les sénateurs voter la loi en l’état, vous fomentez une nouvelle diversion et vous exercez un marchandage tactique sur le dos des agriculteurs. Ce n’est pas acceptable !

C’est pourquoi, en toute logique, nous sommes opposés à ces amendements-postiches, qui, aussi pertinents soient-ils, sont des leurres destinés à fracturer la quasi-unanimité de la Chambre haute, démontrée le 7 mars dernier. Les deux sujets que vous mettez au dernier moment sur la table sont loin d’être sans intérêt pour les agriculteurs. Vous pouvez compter sur nous pour vous rappeler ces bonnes intentions le temps venu.
Dans le cas présent, il fallait adopter rapidement ce texte. Vous nous l’empêchez par la procédure du vote bloqué et décevez du même coup l’ensemble du monde agricole et rural, qui nous regarde et soutenait unanimement l’adoption de ce texte sans modification.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, vous avez maintenu le recours au vote bloqué, comme vous l’aviez d’ailleurs annoncé à l’issue de nos débats le 7 mars dernier. Vous n’avez pas bougé d’un iota.

Nous constatons donc une fermeture totale de votre part sur un sujet qui fait pourtant l’objet d’une quasi-unanimité.
Ce nouveau coup de force est inacceptable ! Il illustre votre manque de respect à l’égard des retraités agricoles, mais aussi du Parlement, un manque de respect qui transparaît également d’ailleurs dans vos projets de loi organique et ordinaire, lesquels visent ni plus ni moins à réduire la place du Parlement dans l’architecture institutionnelle de notre pays !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.

Je veux maintenant profiter de l’examen de l’article 1er du présent texte pour évoquer la situation catastrophique des retraités agricoles outre-mer.
Les principales raisons de cette situation sont connues : des superficies agricoles nettement plus faibles, mais aussi la mise en place tardive du régime de retraite de base, ou encore, pour la retraite complémentaire obligatoire, une assiette de cotisations basée non pas sur le revenu professionnel, mais sur la surface des exploitations pondérée par l’activité. Les outre-mer sont donc doublement défavorisées.
Mmes Catherine Conconne et Victoire Jasmin applaudissent.

Ainsi, à La Réunion, où vivent plus de la moitié des 30 000 agriculteurs retraités d’outre-mer, le montant moyen de la pension était – écoutez bien ! – de 375 euros par mois en 2016.

Les trois quarts d’entre eux perçoivent un revenu inférieur au seuil de pauvreté, et 25 % perçoivent moins de 100 euros mensuels.
C’est la raison pour laquelle il est indispensable, dans un premier temps, de supprimer la condition d’une durée minimale d’assurance en tant que chef d’exploitation. À défaut, toute mesure de revalorisation – aujourd’hui 75 %, demain 85 % du SMIC – risque de rester virtuelle.
Bien évidemment, d’autres mesures seraient nécessaires pour revaloriser les pensions de tous les retraités agricoles, et particulièrement de ceux de l’outre-mer. Mais nous aurons, je pense, l’occasion d’y revenir au cours de la discussion.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain. – Mme Viviane Malet applaudit également.

Traditionnellement le monde agricole a longtemps été considéré, à tort, comme un milieu d’hommes, en oubliant le rôle central des femmes, assumant souvent dans l’ombre une bonne partie des tâches de la ferme.
De nos jours, alors que le métier d’agriculteur et d’agricultrice a beaucoup évolué et impose des contraintes très lourdes, les inégalités, notamment lors du départ à la retraite, subsistent, en particulier pour les femmes.
Si les femmes ont depuis toujours joué un rôle crucial dans la vie des exploitations agricoles, celui-ci n’a pas toujours été reconnu comme tel. Du fait de leur statut de conjointe ou d’aide occasionnelle, elles restent minoritaires en tant qu’agricultrices à part entière. Les agricultrices qui réussissent à avoir des terres obtiennent bien souvent les plus petits lots lors des ventes.
Il est important de dénoncer ici la situation extrêmement précaire des femmes retraitées de l’agriculture. Les agriculteurs, pour beaucoup d’entre eux, ont des revenus faibles, je vous laisse donc imaginer, comme Éliane Assassi et d’autres collègues l’ont souligné, le montant de leurs pensions de retraite ! Savoir que des femmes et des hommes perçoivent 100, 200 ou 300 euros de retraite par mois m’inspire un sentiment de révolte difficilement contrôlable ! Comment pouvons-nous, en tant que parlementaires, accepter cela ?
La moyenne des pensions versées par la MSA était, ces dernières années, autour de 400 euros. Dans mon département des Côtes-d’Armor, en Bretagne, je rencontre beaucoup d’agriculteurs, de paysans, de représentants syndicaux : les femmes ne perçoivent pas obligatoirement 400 euros, elles touchent plutôt environ 150 euros !
Cet article, comme l’ensemble de cette proposition de loi, est indispensable pour reconnaître une évolution urgente du montant des pensions de retraite : nous ne devrions même pas en discuter !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – MM. Roland Courteau et Jean-Marc Boyer applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, c’est la troisième fois depuis décembre 2017 que nous avons la possibilité d’accéder à la demande plus que légitime des agriculteurs de porter le minimum de leur retraite à 85 % du SMIC.
Lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, aucune majorité ne s’était dégagée dans ce sens. En mars dernier, le Gouvernement a sorti « l’artillerie lourde » pour empêcher ce vote. Aujourd’hui, nous sommes de nouveau placés devant ce choix. Et, de nouveau, alors que les sénateurs sont quasiment unanimes, vous ne voulez pas de l’adoption de ce texte.
Au travers des amendements que vous déposez, vous feignez de vouloir faire évoluer la situation des retraités agricoles, mais toutes vos propositions n’ont pour seul but que de repousser l’échéance !

Mme Monique Lubin. Comme cela a été dit au cours du débat sur le recul du trait de côte, allons-nous enfin sortir de nos circonvolutions habituelles qui, sous des prétextes toujours renouvelés, nous empêchent de régler des situations humaines urgentes ? Allons-nous cesser de remettre à plus tard, sous prétexte d’un mieux, ce que nous pouvons faire de bien ici et maintenant ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, cela ne vous a pas échappé, les membres de cette assemblée ont du mal à comprendre votre sens de la justice sociale tel qu’il transparaît au travers des amendements que vous avez déposés.
Cela étant, n’ayant pas une pensée suffisamment complexe, je vous propose de nous en tenir à la réalité des faits, lesquels ont une fâcheuse tendance à être têtus !
La réalité, c’est celle des 13 483 agriculteurs retraités landais, mais c’est aussi le cas sur d’autres territoires, qui perçoivent moins de 85 % du SMIC. La réalité, c’est celle d’un agriculteur de Saint-Vincent-de-Tyrosse, dans les Landes, qui a exercé sa profession de quatorze ans à soixante ans, avec les servitudes inhérentes au métier d’agriculteur, et qui, pour cette carrière, touchera une pension de 815 euros par mois quand le seuil de pauvreté est de 1 015 euros !
La réalité, c’est celle aussi d’associations, de syndicats, qui se mobilisent pour dire qu’il n’est pas possible que les retraités agricoles vivent sous le seuil de pauvreté : ils se sont sentis trahis par l’attitude du Gouvernement le 7 mars dernier.

La réalité, c’est que cette proposition de loi fait l’objet d’un consensus parlementaire, ce que vous n’acceptez pas et ne prenez pas au sérieux. Cela laisse augurer de la place que vous voulez laisser au Parlement, avant même votre proposition de réforme constitutionnelle…
La réalité, c’est que votre gouvernement a choisi de privilégier les 330 000 contribuables assujettis à l’ISF, au détriment des retraités agricoles, pour un rapport d’un à dix puisqu’il est question de 350 millions d’euros d’un côté et de 3, 2 milliards d’euros de l’autre !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

La réalité, et c’est la seule qui doit compter ici, c’est que les agriculteurs ne sont pas des sous-citoyens qui ne mériteraient qu’une retraite de misère. Les 116 euros de revalorisation dont il est aujourd’hui question sont une nécessité et, croyez-moi, ils ne seront pas placés, eux, dans un paradis fiscal !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avons dans cet hémicycle, le 20 février dernier, débattu d’un rapport d’information de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes intitulé Femmes et agriculture : pour l ’ égalité des territoires.
Chacune des oratrices et chacun des orateurs a fait un constat partagé, un constat unanime, d’un métier rimant avec « passion », « courage », « engagement », aussitôt suivis par les mots « pénibilité », « préjugés » et « invisibilité », surtout quand il s’agit des femmes agricultrices.
Nous avons abordé à cette occasion, outre le statut économique critique des agricultrices, la question de la parité dans les instances dirigeantes du monde agricole, la question du statut juridique de la femme conjointe ou collaboratrice d’agriculteur.
Marlène Schiappa, qui représentait le Gouvernement lors de ce débat, s’est dite consciente de la situation et particulièrement concernée. Quoi de plus normal, me direz-vous, pour la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes ?
Mais permettez-moi, mes chers collègues, de dénoncer le scénario ubuesque que nous vivons une fois de plus aujourd’hui. Au-delà de tous les aspects antidémocratiques qui ont été déjà dénoncés sur le recours au vote bloqué, voilà un gouvernement qui, selon les dires de Marlène Schiappa, est attentif et sensible à une situation, mais refuse de prendre en compte notre proposition, laquelle permettrait justement de revaloriser la pension des femmes agricultrices particulièrement malmenées.
J’avoue que ce double langage est insupportable… Notre proposition de loi a justement pour but de répondre à la question des faibles revenus, aux retraites insignifiantes, à la reconnaissance du travail de ces femmes. La refuser aujourd’hui, c’est concrètement refuser de prendre en compte la situation des femmes agricultrices.
Une fois de plus, dans une situation où le président Macron a affirmé vouloir faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale, les mesures concrètes ne suivent pas. On pourrait s’amuser à plagier une célèbre chanson et fredonner « Paroles, paroles, paroles », si le contexte n’était pas aussi dramatique !
Madame la ministre, j’aimerais vraiment savoir comment le Gouvernement entend répondre précisément aux problématiques des femmes agricultrices sans permettre la revalorisation des pensions agricoles !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’adoption de ce texte est une nécessité pour répondre à une urgence sociale.
Non, les retraites des agriculteurs ne sont pas comparables avec les autres retraites ni dans leur niveau ni dans leurs modalités de calcul. Il n’y a donc aucun argument technique pour attendre qu’elles soient abordées dans le cadre de la réforme générale des retraites prévue en 2020.
La retraite moyenne d’un non-salarié agricole, tous bénéficiaires confondus, s’élève aujourd’hui à 766 euros par mois, contre 1 800 euros pour l’ensemble des Français, soit un niveau inférieur à la fois au seuil de pauvreté et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Je souligne, par ailleurs, que les agricultrices retraitées perçoivent une retraite moyenne de 570 euros par mois !
Dans les modalités de calcul des pensions, il existe, là aussi, des différences importantes avec le régime général : pour le monde agricole, l’ensemble de la carrière est pris en compte, alors que, pour les salariés, seules les vingt-cinq meilleures années entrent dans le calcul.
Dans la Drôme, en 2016, le montant moyen de la pension de retraite d’un non-salarié agricole pour une carrière complète était de 758 euros par mois. Mais les carrières sont, vous le savez, souvent courtes et hétérogènes : moins de 30 % des anciens exploitants justifient d’une carrière complète et moins de la moitié bénéficient de la retraite complémentaire. Les pensions réellement versées sont donc trop souvent beaucoup plus faibles.
Face à cela, le précédent gouvernement avait mené une politique volontariste en faveur des anciens exploitants en relevant le minimum garanti à 75 % du SMIC net, avec l’objectif d’aller plus loin en le portant à 85 % dès 2018, comme nous le proposons aujourd’hui.
Hommes ou femmes, cultivateurs ou éleveurs, tous les agriculteurs retraités témoignent des mêmes difficultés : une vie de dur labeur pour une retraite de misère ! Cette situation est vécue comme une injustice.
Madame la ministre, il y a urgence à soutenir le monde agricole. Ce monde contribue à nourrir la France, à développer nos terroirs, à entretenir nos paysages et à maintenir la vie dans nos territoires. Oui, l’urgence sociale et la précarité vécue par des milliers d’anciens paysans ne sont pas acceptables et ne peuvent attendre 2020.
L’amélioration des recettes fiscales doit permettre au Gouvernement de trouver, au titre de la solidarité nationale, les 350 millions d’euros nécessaires qui pourraient changer le quotidien de milliers de retraités agricoles et corriger un peu les injustices qui caractérisent ce régime de retraite.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 1er de notre proposition de loi a pour dessein d’assurer aux non-salariés agricoles une pension de retraite équivalente à 85 % du SMIC. Aujourd’hui, comme il y a quelques semaines, le Gouvernement se refuse à cette revalorisation.
La revalorisation de ces pensions a trait à de multiples enjeux.
Des enjeux sociaux tout d’abord, puisque la pension d’un retraité agricole est de 766 euros en moyenne, soit en dessous du seuil de pauvreté. Un retraité agricole sur trois a même une pension de retraite inférieure à 350 euros.
Mais cette revalorisation est aussi un enjeu de genre puisque, aujourd’hui, les femmes bénéficiant de ce régime touchent des retraites deux fois et demie moins élevées que celles de leurs collègues masculins, soit environ 500 euros à 550 euros mensuels.
Enfin, il s’agit d’un enjeu territorial dès lors qu’en outre-mer les retraites descendent parfois jusqu’à 100 euros par mois !
Vous en conviendrez, ces rémunérations sont iniques et indignes, en particulier pour des travailleurs qui ont connu un labeur harassant tout au long de leur vie professionnelle.
Par ce refus doctrinal de revaloriser les pensions des plus modestes, le Gouvernement fait preuve d’un mépris sans nom envers nos concitoyens les plus démunis du monde rural. Pire encore, il accroît la fracture sociale et territoriale entre villes et campagnes.
Gouverner, pourtant, ce n’est pas diviser. Ce n’est pas non plus maintenir dans la précarité. Nous avons certes compris que ce gouvernement avait plus à cœur les intérêts des patrons du CAC 40. Nous espérons cependant un geste pour ces retraités agricoles qui le méritent tout autant, si ce n’est plus !
Madame la ministre, peut-être pourriez-vous nous écouter au lieu de bavarder ? Nous ne sommes pas là pour faire du théâtre !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes de nouveau devant un abus de droit du Gouvernement qui cherche par tous les artifices réglementaires à nous imposer le vote bloqué. La démocratie est en danger !
Ce passage en force est d’autant plus regrettable qu’il constitue la seule réponse du Gouvernement à l’égard d’une profession en grande difficulté dans l’Hexagone, mais aussi dans les outre-mer.
Reporter ainsi l’application des dispositions de cette proposition de loi à 2020 est, à l’évidence, une forme de mépris vis-à-vis des travailleurs de la terre qui, après toute une vie de dur labeur, ont des retraites inférieures au seuil de pauvreté. Ils vivent dans la misère, madame la ministre !
Ce gouvernement est manifestement sourd. Il ne comprend pas que les agriculteurs et les agricultrices ont besoin de vivre de manière décente. Il est sourd à la souffrance des agriculteurs, qui vivent de plus en plus dans la précarité et le désarroi, cédant parfois au suicide. Au mois de mars dernier, le journal La Croix a consacré un article à la situation des agriculteurs, particulièrement au taux de suicide dans la profession. La situation est triste.
Vous comprendrez que les mesures de justice et d’équité concernent également les outre-mer, de même que la disposition visant à étendre la couverture de retraite complémentaire à l’ensemble des salariés agricoles ultramarins.
Il y va de la survie d’une profession qui, à force de sacrifices, participe à notre alimentation en privilégiant les circuits courts et en préservant nos réserves foncières. Il est important que l’on puisse sauver des agriculteurs du suicide, de la misère. Il faudrait que vous soyez vigilants et à l’écoute de ces personnes qui souffrent. Certains d’entre eux ont fait le déplacement pour entendre, pour voir, pour écouter, pour comprendre d’où vient le mal !
Aussi, en toute conscience, je porte mon soutien indéfectible à l’ensemble des agriculteurs.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.