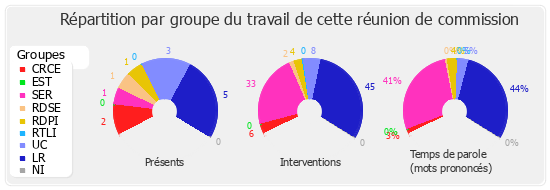Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 2 février 2011 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission examine les amendements au texte n° 240 (2010-2011) qu'elle a établi pour le projet de loi n° 27 (2010-2011) relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
ADOPTION DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR

A la réflexion, je vous propose quelques amendements de précision sur le texte que nous avons établi.
EXAMEN DES AMENDEMENTS EXTÉRIEURS
Article additionnel après l'article 1er A

L'amendement n° 272 rectifié, qui reprend une proposition formulée par le groupe de travail créé par Médiateur de la République sur la reconnaissance juridique de la kafala, vise à supprimer la condition de résidence de cinq ans imposée aux enfants recueillis et élevés par une personne de nationalité française pour pouvoir demander la nationalité française.
L'amendement vise le cas de l'enfant recueilli dans le cadre d'une kafala de droit coranique, où la prise en charge de l'enfant orphelin par le kafil produit des effets équivalents à une tutelle ou une délégation d'autorité parentale sans aboutir à une adoption, interdite par le droit coranique.
Cependant, si la kafala produit en France des effets équivalents à ceux d'un recueil de l'enfant par l'intéressé, elle n'emporte aucun effet sur la filiation de l'enfant et du kafil. Il n'y a donc pas lieu de la traiter comme une adoption simple, dispensée de la condition de résidence ; en l'absence de tout lien de filiation, la condition de résidence de cinq ans manifeste le lien que l'enfant a forgé avec le pays dans lequel il a été recueilli. Avis défavorable à cet amendement et aux suivants n°s 273 et 144.
La commission émet un avis défavorable aux amendements n°s 272 rectifié, 273 et 144.

Les amendements n°s 20 rectifié, 22 et 274 remplacent le terme d'assimilation par celui d'intégration. Nous avons déjà eu ce débat la semaine dernière. Avis défavorable.

Pourquoi refusez-vous le terme d'intégration ? Le concept d'assimilation a été utilisé par le passé, et, s'il l'est également en droit anglo-saxon par exemple, il comporte une connotation communautaire qui sied mal à notre tradition républicaine, laquelle s'accorde davantage avec le concept d'intégration, qui préfère l'idée du creuset républicain à la juxtaposition de communautés.

La notion d'assimilation va plus loin que celle d'intégration, car elle comporte l'idée d'une adhésion active aux valeurs communes de la nation, dans le respect des différences culturelles. Elle s'appréciera notamment par la maîtrise de la langue française et par l'adhésion à nos valeurs.

En cas de réciprocité, nos compatriotes établis en Chine, par exemple, devront donc parler le chinois et adhérer aux valeurs de la société chinoise...
La commission émet un avis défavorable aux amendements n°s 20 rectifié, 22 et 274.

La Charte des droits et devoirs du citoyen français n'ayant pas de caractère normatif, elle relève du pouvoir réglementaire : avis défavorable à l'amendement n°275.

Nous en reparlerons : le Parlement serait tout à fait dans son rôle en rédigeant cette charte.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 275.
Article 2 ter

Cet article, que l'amendement n° 27 rectifié supprime, oblige à déclarer les autres nationalités possédées, conservées ou abandonnées en vue de l'acquisition de la nationalité française : l'objectif est de fournir à l'administration des données statistiques globales sur les étrangers ayant acquis la nationalité française. Cette obligation n'est cependant assortie d'aucune sanction. La commission demandera l'avis du Gouvernement sur l'amendement.

De fait, si le Gouvernement tenait à cette obligation, il l'assortirait d'une sanction...
La commission demandera l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 27 rectifié.
Article 3 bis

L'amendement n° 30 s'oppose à la possibilité de déchéance de la nationalité en cas de meurtre d'un magistrat, d'un gendarme, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, ou d'un agent de police municipale. Avis défavorable.

Pourquoi cet article, dont on sait qu'il s'appliquera très exceptionnellement ? Le Sénat s'honorerait à écarter cette extension toute médiatique de la déchéance de nationalité...
Articles additionnels après l'article 4

Le code civil écarte de l'acquisition ou de la réintégration dans la nationalité française l'étranger qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis. Les personnes qui se rendent coupables de délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier encourent une peine de cinq ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende : l'administration est donc tenue de refuser ou de s'opposer à l'acquisition, par les intéressés condamnés à plus de six mois fermes, de la nationalité française.
L'amendement n° 281, en écartant le motif du délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, remettrait en cause la règle générale liée non à la nature de l'infraction, mais à sa gravité, dont rend compte la peine prononcée. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 281.

L'amendement n° 282 étend le délai d'enregistrement des déclarations de naissance en Guyane : il ne présente pas de lien avec l'objet du présent texte, avis défavorable.

Nos collègues ultramarins y tiennent pourtant et votre réponse confirme les incohérences de la commission, s'agissant des cavaliers législatifs : vous acceptez hier un article sur la CNIL dans un texte relatif au Défenseur des droits, mais vous refusez aujourd'hui cet amendement qui a pourtant trait au code civil et à la nationalité.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 282.
Article 5 bis

Les auteurs de l'amendement n° 290 souhaitent préciser que la lutte contre les discriminations vise les discriminations « directes » et « indirectes ». Viser des discriminations dans leurs généralités est suffisant : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 290.
Articles additionnels après l'article 5 bis

L'amendement n° 291 rectifié crée une interdiction de discrimination à l'emploi en fonction du lieu de résidence. Avis défavorable.

Pourquoi ? Il y a là un vrai sujet. L'adresse d'un candidat peut entraîner ipso facto la mise à l'écart de sa candidature, le phénomène est si fort que certains maires en sont venus à changer le nom des rues de certains quartiers, pour leur éviter la stigmatisation. Il est tout à fait légitime que la loi cherche à protéger contre cette discrimination.

Convenez que nous sommes ici très loin des questions d'immigration et de nationalité.

On sait ce qu'il en est des cavaliers législatifs... Quant au fond, les sujets sont bien liés, car les quartiers stigmatisés sont souvent ceux où les étrangers sont relégués.

Le droit en vigueur vous donne satisfaction, puisque la discrimination fondée sur l'adresse d'habitation entre dans le champ de l'article 225-1 du code pénal, qui réprime toute discrimination fondée sur l'origine de la personne.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 291 rectifié.

En disposant que, sauf le cas de fraude manifeste, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie, l'amendement n° 293 remplace une présomption simple par une présomption irréfragable contraire à l'esprit de l'article 30 du code civil. Avis défavorable.

C'est bien dommage, car cette disposition accélèrerait et simplifierait les procédures !

Et cette disposition pourra être étudiée à l'occasion de la proposition de loi relative à la protection de l'identité.
Article 9

L'amendement n° 305 propose que le juge se prononce « dans un délai raisonnable » sur la prolongation du maintien en zone d'attente, plutôt que dans un délai de 24 heures. Avis défavorable.

Nous sommes plus réalistes que vous et nous nous soucions de ce qui se passera quand le juge, débordé, ne pourra matériellement pas se prononcer dans les 24 heures...

La rédaction actuelle donne 24 heures supplémentaires, c'est raisonnable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 305.
Article additionnel après l'article 10

L'amendement n° 309 rectifié interdit le renvoi dans son pays d'un mineur isolé qui n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire.
Le droit en vigueur prévoit déjà que les mineurs isolés qui n'ont pas été admis sur le territoire se voient désigner un administrateur ad hoc, qui les assiste durant leur maintien en zone d'attente et assure leur représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Cet administrateur est désigné sans délai.
Ensuite, en cas de danger pour le mineur, le juge pour enfants peut prendre toute mesure de protection qu'il estime utile.
Notre droit apporte donc de nombreuses garanties aux mineurs isolés qui se présentent à la frontière. Avis défavorable.

Le mineur qui se présente à la frontière ne saurait être admis automatiquement, il ne faut pas confondre sa situation avec celle du mineur déjà présent sur notre territoire. Nous devons assister le mineur qui se présente à notre frontière, c'est ce que notre droit permet déjà. Mais l'automaticité n'est pas une solution, surtout qu'elle ferait le jeu des filières de passeurs, qui utilisent déjà les mineurs pour parvenir à leurs fins.

Notre République s'honorerait pourtant à affirmer qu'elle ne renvoie pas les mineurs dans leur pays d'origine. Je souhaite un vote.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 309 rectifié.
Article 12 (supprimé)

L'amendement n° 270 rétablit l'article 12, que nous avons supprimé. Nous souhaitons maintenir le principe dévolutif de l'appel : avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 270.

Cet article instaure un droit au séjour autonome pour les conjoint et enfants du titulaire d'une carte bleue européenne à partir de cinq années de résidence. Pour le calcul de ces cinq années de résidence, les auteurs de l'amendement n° 314 proposent de tenir compte des années passées dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Je suggère d'interroger le Gouvernement sur cette possibilité. Cet amendement, cependant, devrait être placé après l'alinéa 10, pour viser également les enfants du titulaire de la carte bleue.
La commission demandera l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 314.
Article additionnel après l'article 17 AA

L'amendement n° 319 propose d'étendre aux pacsés et concubins les dispositions prévoyant que le titre de séjour est obligatoirement délivré, ne peut être retiré et peut être renouvelé à la victime de violences conjugales entrée en France au titre du regroupement familial.
L'article L. 431-2 du code des étrangers, visé par l'amendement, concerne les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial et qui seraient victimes de violences conjugales.
Or, en l'état du droit, le regroupement familial ne concerne que le conjoint et les enfants mineurs d'un étranger en situation régulière, et non son partenaire par un PACS ou son concubin.
En revanche, l'ordonnance de protection créée par la loi du 9 juillet 2010 a vocation à bénéficier tant aux conjoints qu'aux pacsés et aux concubins. De ce fait, lorsque ces derniers se verront délivrer une ordonnance de protection en raison de violences conjugales, ils pourront se voir accorder ou renouveler un titre de séjour, quelle que soit la régularité de leur entrée sur le territoire et y compris s'ils sont conjoint, pacsé ou concubin de l'auteur des violences. L'amendement est donc satisfait.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 319.
Article 17 A

Cet article vise cependant les Roms et il serait très symbolique que le Sénat le supprime, tant le Gouvernement a terni l'image de la France par les expulsions de Roms.

Cet article ne fait pourtant qu'appliquer la directive du 29 avril 2004 sur le droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 320.
Article additionnel après l'article 17

L'amendement n° 324 permet aux conjoint et enfants d'un salarié en mission de bénéficier d'un titre de séjour sans attendre le délai de six mois exigé par le code des étrangers.
Avis favorable, sous réserve de le rectifier ainsi : à la première phrase du cinquième alinéa du 5° de l'article L. 313-10, les mots : « qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France » sont supprimés et cette phrase est ainsi complétée : « dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois ».
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 324 ainsi rectifié.
Article 17 bis

L'amendement n° 326 propose de délivrer de plein droit un titre de séjour à l'ensemble des mineurs isolés confiés à l'aide sociale à l'enfance, quel qu'ait été leur âge d'entrée sur le territoire et quel que soit le sérieux de leurs efforts d'intégration. Ces dispositions profiteraient également aux mineurs victimes de la traite.
A l'heure actuelle, un titre de séjour est délivré de plein droit aux jeunes majeurs entrés en France avant l'âge de 16 ans, sous réserve notamment du caractère sérieux de la formation suivie.
La situation des mineurs isolés entrés en France après 16 ans est prise en compte par l'article 19 du projet de loi, qui autorise le préfet à leur délivrer à leur majorité un titre de séjour dès lors qu'ils sont engagés dans une démarche sérieuse de formation.
S'agissant des mineurs étrangers victimes de la traite ou d'autres infractions, le juge des enfants est compétent pour ordonner l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la protection du mineur.
Enfin, les jeunes majeurs qui ne pourraient pas se prévaloir d'une des dispositions du code des étrangers, l'autorité administrative peut toujours délivrer une carte « vie privée et familiale » au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
L'amendement paraît donc satisfait.

Nous voulons attirer l'attention sur les relations familiales, qui souvent n'ont pas été maintenues.

Quand le mineur n'a plus de lien avec sa famille, le préfet accorde systématiquement le titre de séjour.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 326.
Article additionnel après l'article 17

Le titre de séjour d'un conjoint étranger entré en France au titre du regroupement familial peut être retiré ou faire l'objet d'un refus de renouvellement en cas de rupture de la vie commune, sauf si celle-ci résulte du décès de l'un des conjoints.
Une telle exception n'est pas prévue pour les étrangers mariés à un ressortissant français. Les auteurs de l'amendement n°132 rectifié proposent d'y remédier. La commission y est favorable, à condition d'insérer ces dispositions à l'article L. 312-12, qui traite du renouvellement de la carte « vie privée et familiale », plutôt que dans l'article L. 313-11, qui traite des cas de délivrance de plein droit de ce titre. L'amendement deviendrait alors identique à l'amendement n° 346.
Article 25

L'amendement n° 165 supprime les nouvelles dispositions relatives à l'abus du droit au court séjour. Il est vrai qu'il sera difficile de prouver l'abus, les personnes concernées n'étant soumises à aucune formalité particulière ou enregistrement pour pouvoir séjourner moins de trois mois. L'abus du système d'assistance sociale sera également difficile à prouver.
La commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° 165.
Article 29

Favorable à l'amendement n° 375, sous réserve de remplacer le terme de décision par celui d'obligation.
Article 30

Retrait de l'amendement n° 377 : le fait que le placement en rétention ne puisse avoir lieu qu'en cas de perspective raisonnable d'éloignement résulte déjà des dispositions de l'article 33.
Article 33

Défavorable à l'amendement n° 64 : il n'est pas logique de prévoir que l'étranger assigné à résidence puisse bénéficier d'une autorisation de travail alors même que son éloignement du territoire est imminent.

Retrait du n° 391, satisfait : la scolarisation des mineurs est obligatoire dans le primaire.
Retrait du n° 61 : l'assignation à résidence ne saurait se prolonger plus d'une année.
Les amendements identiques n°s 63, 178 et 392 visent à ramener de 45 jours à 20 jours renouvelables une fois la mesure alternative d'assignation à résidence alternative à la rétention. Cette durée de 45 jours a été fixée pour correspondre à la durée maximale de la rétention administrative. Toutefois, tandis que le juge des libertés et de la détention intervient, dans le cas de la rétention, au bout de 48 heures puis de 20 jours, il n'interviendrait pas du tout dans le cas de l'assignation à résidence alternative à la rétention. Il peut donc sembler raisonnable de limiter la durée de cette assignation, qui reste une forte restriction de liberté. Je vous propose de demander, sur ces amendements, l'avis du gouvernement.

Je souhaite soulever un problème de fond. Que le port du bracelet électronique puisse résulter d'une décision de l'autorité administrative est une nouveauté qui contrevient aux droits fondamentaux.

C'est ici une alternative à la rétention, qui fait l'objet d'une simple proposition et doit être acceptée par l'intéressé. Nous nous sommes déjà prononcés la semaine dernière.

Reste que le bracelet électronique n'est pas une mesure de sûreté, mais une peine.

Il y a là un problème de principe qu'il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher.

Il n'en reste pas moins que l'on crée ici la confusion entre ce qui n'est pas même une mesure de sûreté et une peine. Cela pose problème au plan des principes.

C'est pourquoi nous sommes favorables à l'amendement Mézard, qui exige l'accord de l'intéressé.

Le bracelet électronique n'est ici qu'une possibilité. On ne recule en rien sur les principes.

L'accord de l'intéressé est indispensable, mais ne suffit pas. Il arrive aussi que l'intéressé se déclare d'accord pour être aller en prison... C'est pourquoi je tiens qu'il faut une décision de l'autorité judiciaire.

S'il ne consent pas au bracelet, il ira en centre de rétention. Où est le problème ?

Je rejoins M. Mézard : c'est une question de principe. Le bracelet électronique relève du régime juridique de la peine. Le législateur reste libre de le modifier, mais il faut être conscient que c'est ouvrir une brèche. C'est une question de politique publique. La question à nous poser est bien la suivante : peut-on confier la décision à une autorité autre que judiciaire ?

N'oubliez pas que le juge des libertés et de la détention intervient à bref délai.

Nous nous sommes beaucoup interrogés sur le caractère alternatif du bracelet. Il ne faudrait pas que cela ouvre à une banalisation. Le fond du problème réside bien dans l'autorité qui prend la décision.

Il est de fait difficile de faire exception aux principes. La rétention est certes plus privative de liberté que le bracelet, mais le bracelet reste attentatoire à la liberté. On peut souhaiter que le juge se prononce, il n'en reste pas moins que cet usage du bracelet en change la vocation.

Dès lors que l'on admet que la décision de privation de liberté peut être prise par l'administration, il devient difficile de lui contester la faculté de décider d'une mesure moins privative de liberté, comme l'est le bracelet électronique. Mais la question que je me pose est la suivante : qui en assurera le suivi ?

Lorsqu'il s'agit d'une peine, c'est l'administration pénitentiaire qui est chargée des mesures d'exécution. Mais ici ? Rechercher une alternative part d'une bonne intention - M. Michel vient de dire lui-même que cela peut éviter des gardes à vue - mais suppose une mise au point de l'ensemble du dispositif.

Que l'on reconnaisse au juge administratif un rôle de défenseur des libertés va dans le sens des mécanismes votés ces dernières années. Mais se pose dès lors, ainsi qu'on l'a vu avec la loi pénitentiaire, la question de la frontière. On s'en sort en donnant aux deux juges les mêmes pouvoirs. Ici, on va au bout de cette logique, en instituant deux procédures parallèles : il faut en être conscient.

Le bracelet électronique est ici un aménagement de peine, soit, mais il remplace la simple assignation à résidence : ce dont il faut être conscient, c'est que l'on va vers une criminalisation des étrangers.

De deux choses l'une, soit on laisse le dispositif que nous avons retenu en l'état, sachant que c'est un progrès au regard du droit actuel, qui ne prévoit que la rétention, soit, si cela peut aider à lever les inquiétudes, on donne faculté au préfet la faculté de saisir le JLD. Je rappelle cependant que si la personne accepte, le juge des libertés et de la détention interviendra en tout état de cause sous cinq jours.

En l'état du droit, c'est le juge administratif qui place en rétention, puis le JLD qui peut décider d'une remise en liberté. La commission a fait la semaine dernière le choix d'améliorer le dispositif. N'est-il pas insultant pour le juge administratif de considérer qu'il n'est pas protecteur des libertés publiques ? Alors qu'il est quelquefois même en avance sur le juge judiciaire...
Je vous appelle à présent à vous prononcer sur ces amendements, auxquels notre rapporteur se déclare défavorable.

L'amendement n° 60 tend à prévoir que la mesure de placement sous surveillance électronique prévue par l'article 33 comme alternative à la rétention soit décidée non par le préfet mais par l'autorité judiciaire. Or, l'intervention de l'autorité judiciaire n'est pas prévue dès le début de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, mais seulement au bout d'un délai de cinq jours. Par conséquent, le juge ne peut avoir l'occasion de prononcer cette mesure. En revanche, le juge des libertés et de la détention doit bien valider la prolongation du placement sous surveillance électronique au terme du délai de 5 jours. Avis défavorable, donc. Favorable, en revanche, à l'amendement n° 89, qui exige l'accord de l'intéressé, conformément à la position qui fut la nôtre lors de la discussion de la Loppsi.
Article 34

L'amendement n° 13 tend à réécrire les modalités selon lesquelles l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est informé dans une langue qu'il comprend des décisions qui ont été prises à son encontre ; il est satisfait par la rédaction de la commission qui prévoit bien, comme les auteurs de l'amendement le souhaitent, que l'étranger est informé qu'il peut obtenir ces éléments, dont font partie les voies et délais de recours contre les décisions dont il fait l'objet. Retrait ou rejet.
Favorable à l'amendement n°67, qui précise utilement que l'exclusion du droit au retour ne concerne pas toutes les personnes placées un jour en rétention.
Les amendements n° 187 et n° 406 confèrent caractère suspensif aux recours administratifs contre les décisions de réadmission dans un autre État européen prononcées en vertu des articles L 531-1 et suivants du CESEDA, les requêtes en annulation à l'encontre de ces décisions de réadmission dans d'autres pays de l'Union européenne visant des ressortissants de pays tiers, demandeurs d'asile ou non, n'étant de fait pas suspensives de plein droit.
Si le règlement Dublin II n'impose pas de recours suspensif, le Conseil d'État a rappelé, dans un arrêt du 6 mars 2008, que ces décisions peuvent faire l'objet d'un référé-suspension selon l'article L 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme, en date du 21 janvier, semble clairement impliquer que ce type de procédure n'est pas suffisant pour assurer un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment parce qu'il ne permet pas réellement d'évaluer, dans le cas d'un demandeur d'asile, s'il n'y a pas un risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays ou il est réadmis.
Il faudra donc pousser la réflexion. C'est pourquoi je vous propose d'émettre un avis de sagesse sur ces amendements, et d'interroger le gouvernement en séance.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 67.
Article 37 (supprimé)

Nous voici parvenus à l'amendement n° 1 rectifié, porté par M. Longuet, visant à revenir au dispositif du projet de loi initial, inspiré des propositions du rapport Mazeaud, qui, relevant que l'enchevêtrement des procédures administrative et judiciaire rend de nombreuses mesures d'éloignement quasi inexécutables, préconisait le report de l'intervention du JLD, à cinq jours maximum au lieu de 48 heures, afin de laisser la procédure administrative aller à son terme. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, le JLD, saisi par le préfet, statue sous 48 heures sur le maintien ou non en rétention.
Se pose le problème du caractère constitutionnel du délai, la seule certitude dont nous disposions tenant à une décision du Conseil qui sanctionne clairement, au regard de l'article 66 de la Constitution, une intervention du juge des libertés à sept jours. En deçà, nous n'avons pas de certitude. L'autre question qui a été soulevée porte sur la capacité du juge administratif à apprécier en juge des libertés publiques.
Au regard de ces interrogations, je précise que le délai de cinq jours constitue le délai maximum sous lequel le juge doit rendre sa décision. A supposer qu'il soit saisi tardivement par le préfet, au cinquième jour, et ne rende sa décision qu'au sixième, le retenu aura dû, entre temps, être remis en liberté. Cette considération est sans doute de nature à rassurer nos collègues.
A titre personnel, je suis favorable à ce dispositif, mais je dois rappeler que la commission a rendu un avis défavorable il y a quinze jours.

Nous en avions alors longuement débattu. Pour nous, rétablir l'ordre des interventions de l'un et l'autre juge ne constitue pas une mesure de défiance à l'égard du juge administratif, mais vise à souligner le rôle prépondérant du juge des libertés et de la détention, chargé de se prononcer sur le principe de l'incarcération. En retardant son intervention, on conduit le juge administratif à se prononcer, nolens volens, sur une question qui n'est pas de sa compétence. Ce n'est pas là clarifier mais bien complexifier les choses.
Revenir au texte initial du projet de loi, c'est admettre que l'étranger puisse être privé jusqu'à quatre jours et demi de tout contact avec le juge des libertés. Et pourquoi avoir retenu ce délai de cinq jours ? C'est tout simplement, sachant que le juge des libertés a 24 heures pour se prononcer, que l'on arrive à un total de six jours, tangent avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Voilà un de ces réglages au millimètre comme nous ne les apprécions guère...

C'est bien la réaction du Conseil constitutionnel qui seule me préoccupe. L'imbroglio actuel doit être clarifié. La contradiction entre décision du juge administratif et décision du juge judiciaire doit être levée.
Nous savons que six jours pourraient être trop, nous subodorons que quatre pourraient être acceptés, mais cinq ? Ne serait-il pas plus sage, à ce compte, de s'en tenir à quatre, ce qui laisse au juge administratif un temps raisonnable pour rendre sa décision ?

Les juges administratifs que nous avons entendus considèrent que quatre jours serait une cote mal taillée : trop court. Retenir un délai de cinq jours permet de mettre en cohérence les deux procédures, sans mettre en cause les libertés fondamentales. C'est en effet, monsieur Yung, pesé au trébuchet. Et je le répète, la décision devra intervenir au plus tard le cinquième jour : c'est réellement une date butoir.

Ce qui préoccupe ici, c'est l'idée que le juge administratif n'est pas un vrai juge : il n'est pas indépendant, il n'est pas protecteur des libertés, mais une simple autorité administrative. Grave question...

Le juge administratif se prononce sur toute la procédure administrative ; le juge des libertés, sur la privation de liberté : là réside la difficulté de toujours. J'ai demandé aux juges des libertés sur quoi ils fondaient leur décision. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient rien sur quoi la fonder, moyennant quoi s'applique parfois par défaut le principe qui veut que la liberté soit la règle et la détention l'exception.

Dans le cas de la garde à vue, c'est le parquet qui se prononce. Ici, comme c'est un juge administratif, on considère qu'il n'est pas un vrai juge. Le dispositif à deux juges est sécurisant, mais la logique voudrait que l'ensemble de la procédure relèvât d'un seul juge.

Tout est fait à l'heure actuelle pour qu'une fois sur le sol français, la personne étrangère ne reparte pas. Ce n'est pas tenable. Le pire, c'est que, du coup, certaines personnes qui mériteraient de rester ne restent pas. Car tel est bien l'enjeu majeur : que soit préservé l'exercice du droit d'asile. C'est pourquoi j'ai voté le texte du gouvernement, même si je me pose des questions sur sa cohérence.

Nous avons déjà voté des mesures alternatives à la rétention comme le bracelet, mais que deviennent les principes généraux du droit ? Il n'est pas sain de multiplier ainsi les îlots juridiques. Le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles.

Je suis favorable, à titre personnel, à l'amendement, mais me dois encore une fois de rappeler que la commission a émis un avis défavorable il y a quinze jours.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1 rectifié.
Article 38

Favorable à l'amendement n° 91 qui précise utilement que les conditions du maintien à la disposition de la justice sont fixées par le procureur de la République.
Article 49

L'inquiétude des auteurs de l'amendement n°76 n'est pas fondée : l'article 533-1 du CESEDA, relatif à la reconduite à la frontière pour menace à l'ordre public n'est plus, en vertu des dispositions que nous avons adoptées à l'article 25, qui transpose la directive « libre circulation », applicable aux ressortissants communautaires.
Sagesse sur l'amendement n° 419, qui vise à supprimer l'énumération des faits pouvant justifier une reconduite à la frontière pour les étrangers en court séjour : les énumérations présentent toujours le risque d'être incomplètes. Défavorable à l'amendement n° 99, qui ajoute à la liste visée, pour les mêmes raisons.
Article additionnel après l'article 51

Défavorable à l'amendement n° 421, qui vise à prohiber le port d'armes dans les lieux de rétention administrative : ces dispositions sont de nature réglementaire.
Examen des amendements extérieurs
Sur l'ensemble des amendements, la commission adopte les avis suivants :
La commission examine ensuite le rapport de M. Jean-Pierre Sueur et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 61 (2010-2011), présentée par M. Hugues Portelli, sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral.

Nous allons examiner le rapport de M. Sueur sur la proposition de loi de M. Portelli sur les sondages qui fait d'ailleurs beaucoup de bruit.

Faisant suite au rapport d'information sur les sondages qui a été présenté devant la commission, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de M. Portelli sur le même sujet : elle reprend exactement l'ensemble des points soulevés dans le rapport. L'objectif est de réviser la loi de 1977 sur les sondages car, malgré ses avancées, elle est aujourd'hui dépassée et pose désormais certains problèmes d'application.
L'article 1er propose une définition des sondages, ce que ne faisait pas la loi de 1977. Nous avons procédé à quelques auditions supplémentaires et je vous proposerai d'en préciser encore la définition afin que la loi s'applique à tous les sondages politiques, car ils ont pris une place très importante dans le débat politique. Pas un débat sans que l'un des participants ne sorte de sa manche un sondage ! Comme ils sont devenus omniprésents, il faut que leur fabrication et leur publication soient totalement transparentes. Nos concitoyens doivent savoir qui a commandé et qui a financé le sondage, au moment même où il est publié.
L'article 2 demande que les questions posées, le nombre de personnes interrogées, les noms du commanditaire et du financeur soient publiés en même temps que le sondage. Nous avions pensé qu'un résumé des questions suffirait. A la réflexion, nous préférons que l'intégralité des questions figure sur le site Internet de l'organe d'information qui a publié ou diffusé le sondage.
L'article 3 traite des éléments remis à la commission des sondages 24 heures avant la publication du sondage. Cette nouveauté a suscité quelques réactions : nous proposons que ces éléments soient mis en ligne par la commission des sondages afin que chacun puisse y avoir accès. La totalité des questions doit être publiée dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. On s'est en effet aperçu que l'ordre des questions avait une influence sur les réponses. Le taux de non-réponses aux questions, mais aussi au sondage, devra également figurer. Nous demandons aussi que le taux de marge d'erreur soit publié en même temps que le sondage. Certains journaux, comme le Figaro, le font déjà, ce qui prend exactement deux-tiers de ligne. Quand un candidat arrive à 51% d'intentions de vote et l'autre à 49%, on est tenté de penser que le premier va l'emporter sur le second. Et pourtant, si 900 personnes ont été interrogées, la marge d'erreur est de plus ou moins 3 points. Avec 500 personnes, on passe à une marge de plus ou moins 4 points !
Nous avons souhaité aussi que les critères précis de redressement soient publiés, ce qui a donné lieu à quelques débats. Il y va de la transparence et de la vérité. Lorsqu'une enquête donne 5 ou 6 % d'intentions de vote à tel ou tel candidat et que vous estimez qu'il fera 14 ou 15% des voix, la correction est inévitable et, même si elle est justifiée, il serait très intéressant de savoir comment les instituts de sondages procèdent. Si, par exemple, il y a eu quatre séries de sondages et qu'un tiers seulement des personnes votant effectivement pour le FN l'ont déclaré, il est légitime de rectifier le cinquième sondage. Il sera d'ailleurs intéressant de voir comment la déclaration des votants Front national va évoluer avec la nouvelle présidente de ce mouvement ... Quoi qu'il en soit, il est important que nous sachions comment sont effectués les redressements.
Avec M. Portelli, nous avons procédé à une audition très intéressante qui a regroupé tous les sondeurs, à l'exception d'un seul. Les réactions à nos propositions ont été diverses. Alors que, dans un premier temps, nombre d'entre eux protestaient lorsqu'on demandait la publication des marges d'erreur, arguant qu'avec la méthode des quotas, il n'était pas possible de présenter une marge d'erreur, plus personne n'en a parlé lors de cette audition. D'ailleurs, les mathématiciens que nous avons rencontrés nous ont dit que l'on pouvait toujours définir une marge d'erreur, que ce soit dans le cadre de la méthode aléatoire ou dans celui des quotas.
Nous avons eu des réactions sur les méthodes de redressement mais nous avons décidé, avec M. Portelli, de maintenir notre position. Certains sondeurs ont estimé qu'il s'agissait d'un secret de fabrication, comparable aux recettes des grands cuisiniers, qui ne les divulguent pas. Certes, mais les chefs ne prétendent pas faire de la science, alors que c'est bien ce que font les sondeurs : de la science sociale, humaine ! Et ils ont d'ailleurs raison de dire cela, car, si les sondages ne s'appuyaient pas sur des données scientifiques, il ne servirait à rien d'en publier. Les sondeurs ont donc tout intérêt à expliciter leurs méthodes et les résultats auxquels ils parviennent.
Enfin, nous proposons que les personnes interrogées ne touchent pas de gratification, ce qui a troublé certains instituts. Mais répondre à un sondage politique doit être une démarche républicaine. En outre, le fait que les personnes de l'échantillon soient rémunérées peut influer sur leurs réponses.
J'en arrive à la commission des sondages pour laquelle nous proposons une nouvelle composition : deux magistrats nommés par la Cour des comptes, deux par le Conseil d'État et deux par la Cour de cassation.

M. Michel est hostile à ce que les magistrats de la Cour des comptes siègent dans diverses instances, car il estime qu'ils ne sont pas de véritables magistrats.

C'est sa position ... Nous proposons en outre que cinq personnalités qualifiées siègent dans cette commission afin de représenter respectivement les domaines des sciences politiques, du droit public, des sciences sociales, des mathématiques et des statistiques. Nous avons aussi prévu une totale indépendance des membres de cette commission qui ne doivent pas travailler pour des instituts de sondages ou pour les médias qui publient des sondages avant, ou après leurs fonctions au sein de cette instance.
Nous souhaitons maintenir le dispositif en vigueur interdisant la publication de sondages la veille et le jour des élections. On nous dira qu'il suffit de consulter par Internet les sondages réalisés en Belgique ou en Suisse. Certes, mais entre deux inconvénients, nous avons préféré maintenir la législation en vigueur, même si elle n'est pas parfaite, pour éviter, le jour du vote, les sondages commentés aux nouvelles de 9 heures, de 13 heures, puis de 15 heures ! Nous pensions modifier le code électoral, mais comme l'élection présidentielle relève d'un texte particulier, il nous a semblé préférable de modifier la loi de 1977.
Enfin, nous avons voulu qu'aucun bureau de vote ne ferme après la fermeture du dernier bureau de vote en métropole, quitte à commencer le vote la veille dans un certain nombre de territoires ultra-marins.

Ces dispositions techniques sont très importantes, mais un problème continue à m'interpeller. S'il convient de ne pas publier des sondages avant une élection, ne faudrait-il pas faire de même pour les sondages qui interviennent trop en amont d'une élection ? Certains sondages servent à mettre en orbite un candidat, ou une candidate, en annonçant très longtemps à l'avance sa probable victoire, alors que tel ne sera pas le cas. Ne faut-il pas réfléchir à cette question ?

Nous avons été très attentifs à ne limiter en rien la liberté d'expression. Si quelqu'un décide de faire un sondage sur la popularité de tel ou tel, je ne vois pas au nom de quoi nous pourrions l'en empêcher. En revanche, nous avons prévu d'encadrer ces sondages, grâce, entre autres, à la commission des sondages qui peut publier une mise au point si elle considère que la loi n'a pas été respectée. Pendant le mois qui précède l'élection, elle peut exiger que sa mise au point soit publiée en même temps que le sondage, ce qui a un indéniable effet dissuasif. Nous préférons ces mesures à une restriction de la liberté d'expression.
L'article 5 prévoit que lorsqu'un sondage publié porte sur le deuxième tour, il doit tenir compte des résultats du premier tour, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous pouvons lire des sondages de deuxième tour qui oublient le premier tour. Quand un candidat est crédité de 19 % et un autre de 17 %, compte tenu de la marge d'erreur, il est possible que ce soit ce dernier qui arrive avant l'autre : nous avons déjà connu la situation...

Nous sommes le pays au monde où l'on publie le plus de sondages. En outre, nous sommes le seul pays à pratiquer la méthode des quotas, sans doute grâce à l'excellence de l'Insee.
EXAMEN DES AMENDEMENTS.
Article 1er

L'amendement n °1 propose trois modifications à la définition des sondages. La première remplace, à la demande de mathématiciens, le terme « opération » par celui « d'enquête statistique ».
La deuxième modification est due à notre collègue Gélard qui souhaite viser aussi bien les sondages réalisés par la méthode des quotas que ceux effectués selon la méthode aléatoire. En nommant les deux méthodes, nous couvrons ainsi l'ensemble du champ.
La dernière modification a été suggérée par M. Pierre Zémor, membre de la commission des sondages, afin que les sondages portent non seulement sur les opinions, mais également sur les souhaits, car les opinions portent sur des évènements récents alors que les souhaits renvoient à des choix à venir. M. Zémor estime en effet que des intentions de vote exprimés aujourd'hui pour la présidentielle de 2012 ne signifient rien.

On a en effet vu des candidats qui étaient sûrs d'être élus... et qui ne l'ont pas été.

Vous vous focalisez sur deux méthodes utilisées par les sondeurs mais il peut y en avoir d'autres. Votre rédaction n'est pas trop limitatrice ? Pourquoi ne pas écrire « ou toute autre méthode » ?

Pourquoi ne pas supprimer la fin de phrase à partir du mot « représentatif » ? Toutes les situations seraient couvertes et la rédaction serait plus simple.

Les statisticiens que nous avons rencontrés tiennent vraiment au terme « représentatif » et voulaient même y adjoindre celui de « extrapolable ».

Que l'échantillon soit représentatif, c'est leur affaire ! Il a d'ailleurs intérêt à l'être, sinon la marge d'erreur pourrait être considérable.

Il s'agissait aussi de viser tous ceux qui demandent à leurs lecteurs ou à leurs auditeurs de réagir sur tel ou tel sujet : le résultat obtenu n'est pas représentatif et il ne peut s'agir d'un sondage.

Le mot « représentatif » doit être maintenu afin de viser les sondages stricto sensu, mais je suis sensible à l'idée qu'il ne faut pas exclure d'autres méthodes éventuelles.

La notion de représentativité n'exclue-t-elle pas la méthode des quotas ?

Nous avons ajouté la méthode des quotas et la méthode aléatoire à la demande de M. Gélard qui craignait qu'en l'absence de cette précision, la loi ne s'applique qu'aux sondages par quotas. Mais nous pourrions effectivement ajouter « ou toute autre méthode ».

Dans une vie antérieure, j'ai fait des études de statistiques et je puis vous assurer que le terme « représentatif » n'a rien à voir avec les marges d'erreur qui sont calculées en fonction du résultat attendu selon le nombre de personnes interrogées. « Représentatif » est un terme statistique qui confirme simplement que les différents échantillons sont comparables avec les critères pris en compte ou avec la population sur laquelle on veut tester l'hypothèse. Cela ne caractérise pas non plus une méthode particulière. Si l'on veut tirer un enseignement valable du sondage, il faut que l'échantillonnage soit représentatif.

Si l'échantillon n'est pas représentatif de la population, pourquoi faire des sondages ? La technique doit permettre de régler ce type de problèmes. Lorsqu'on prend des échantillons assez petits, il faut se référer à la méthode des quotas pour garantir une forme de représentativité et, quand ils sont larges, on peut recourir à un échantillonnage aléatoire.

J'ai cru que l'objectif était de moraliser les sondages. Il ne faudrait pas que, lorsque nous avons affaire à une étude sérieuse, nous l'encerclions dans une réglementation très stricte pour mieux laisser toutes les enquêtes farfelues prospérer ! La proposition de M. Béteille me semble préférable : tout ce qui a prétention à apparaître comme un sondage doit être encadré. Si nous arrêtions la rédaction au mot « échantillon », nous viserions toutes les possibilités.

Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Gautier, mais pour des raisons inverses. Nous devons prévoir l'apparition d'autres méthodologies. Mais la proposition de loi ne comporte pas qu'un seul article et les pseudo-sondages sont traités plus loin. Il s'agit ici de définir le sondage authentique.

Pour les sondages, il existe soit la méthode des quotas, soit la méthode aléatoire : il n'y en a pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres à l'avenir. Reportez-vous à tous les travaux de sciences politiques ! Pour tout le reste, il ne s'agit pas de sondages.

La commission des sondages va vérifier, avant toute autre chose, la qualité de l'échantillon. Ou bien il est suffisamment grand, et il y aura sélection aléatoire, ou bien il est petit et il faut savoir comment il est déterminé. Si l'image ainsi obtenue n'est pas représentative de l'ensemble, il ne s'agit pas d'un sondage.

La commission devra décider quel est l'échantillon qui est représentatif et quel est celui qui ne l'est pas. Je lui souhaite bien du plaisir !

La méthode aléatoire est retenue dans la plupart des pays du monde et elle n'a pas d'échantillon, puisqu'on procède à un tirage au sort. En utilisant la méthode des quotas, la France fait exception.

Un échantillon de 10 000 personnes est quand même plus représentatif que 200 personnes !

On ne peut pas dire qu'il n'y a que deux méthodes : il existe des barèmes mathématiques et informatiques qui combinent les deux méthodes.

Il faut donc soit suivre M. Béteille, soit écrire « ou toute autre méthode ».

A l'heure actuelle, il n'existe que deux méthodes, mais qui peuvent être combinées. Mais les modèles mathématiques découlent des deux modèles précédents.

Cette proposition de loi n'a pas la prétention de régler la question pour la nuit des temps. Le législateur fera évoluer le texte s'il le juge nécessaire.

Je tiens vraiment à maintenir l'adjectif « représentatif ». Tous les instituts de sondages sont attachés à la notion « d'échantillonnage représentatif ». La communauté mathématique et statistique tient également à cette notion, tout comme la commission des sondages.
Si l'on renonce à ce terme, on en arrive à un mélange des genres. On risque notamment de prendre les questions posées par les journaux ou par les radios à leurs lecteurs et auditeurs pour de véritables sondages, alors que nous savons bien qu'il n'en est rien. Les gens qui répondent ainsi n'ont rien de représentatif. Celui qui est passé à l'antenne a intérêt à demander à ses amis ou à son parti politique de téléphoner pour dire qu'il a été excellent... Si on supprime « représentatif », on prend à rebrousse-poil toute la communauté scientifique et tous les sondeurs.

Lors de mon premier cours de statistiques, on nous a donné l'exemple du taux de décès des nourrissons lors des accouchements : le taux était plus élevé à l'hôpital que pour ceux réalisés à domicile, 3 pour 1000 contre 1 pour 1000. On pouvait donc en déduire qu'il était plus dangereux d'accoucher à l'hôpital. En fait, il n'en était rien, car les deux échantillons n'étaient pas représentatifs : les femmes qui accouchaient chez elles étaient suivies et pouvaient accoucher chez elles car elles présentaient des grossesses à très faible risques tandis que les femmes accouchant à l'hôpital étaient dans de plus fortes proportions des grossesses à risques. Il est donc indispensable que l'échantillon soit représentatif.

Tout ce que nous venons de dire signifie-t-il que cette loi ne s'appliquera pas aux escrocs ?

Nous prévoyons des sanctions avec des amendes pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. C'est dissuasif.

Si vous appelez sondage quelque chose qui n'en est pas un, vous risquerez de lourdes amendes. C'est comme pour la contrefaçon.
L'amendement n° 1 est adopté.
L'amendement de précision n° 2 est adopté.

L'amendement n° 3 permet de prévenir un possible contournement de la loi. Si quelqu'un fait un sondage mais ne veut pas appliquer la loi, il peut appeler son sondage « étude » ou « enquête ». Nous interdisons de telles pratiques.
L'amendement n° 3 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 4 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'amendement n° 5 a trois objets : il inscrit dans la loi la jurisprudence de la commission des sondages qui estime que les mentions légales ne doivent figurer que lors de la première publication du sondage.
En second lieu, plutôt qu'un résumé des questions, il est demandé que l'intégralité des questions figure sur le site Internet du média, à condition que la référence soit clairement indiquée.
Enfin, la marge d'erreur doit être publiée en même temps que le sondage.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3
L'amendement rédactionnel n° 6 est adopté.
L'amendement de coordination n° 7 est adopté.

L'amendement n° 8 traite du taux de non-réponse à la totalité du sondage et à chacune des questions.
L'amendement n° 8 est adopté.
L'amendement de coordination n° 9 est adopté.
L'amendement n° 10 traite des critères de redressement : au lieu de mettre les critères généraux, nous proposons d'écrire les critères précis.
L'amendement n° 10 est adopté.
L'amendement n° 11 fait suite à une demande justifiée des instituts de sondage qui sont d'accord pour diffuser leurs notices 24 heures avant la publication de leur sondage, pour que la commission des sondages puisse faire son travail, mais les éléments inclus dans la notice ne doivent pas être rendus publics par la commission avant que le sondage ne soit publié.
L'amendement n° 11 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 5

Il n'est pas logique de publier des intentions de vote sur le second tour sans intégrer les intentions de vote sur le premier tour. Nous avions mis dans la proposition de loi « correspondre » et nous estimons préférable d'écrire « tenir compte » afin de prendre en compte la marge d'erreur, d'où l'amendement n°12
L'amendement n° 12 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 7

Cet article traite de la composition de la commission des sondages. Nous avons beaucoup travaillé sur ce point, d'où notre amendement n° 13. Nous proposons que les six magistrats soient désignés par leurs instances. Pour les cinq autres membres, plutôt que de citer des institutions, nous avons préféré faire référence à des compétences.

La conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur ne doit comprendre en tout et pour tout que trois ou quatre professeurs de droit sur environ 80 membres. En réalité, le choix ne sera pas représentatif. On pourrait tourner la difficulté en prévoyant que le représentant est nommé par la Conférence des doyens des facultés de droit.

Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à l'Académie des sciences morales et politiques de nommer un représentant ?

Il s'agit de personnes très distinguées, parfois un peu conservatrices.

L'Académie désignera une personne qui ne sera pas automatiquement en son sein !

Les juristes sont surreprésentés par rapport aux statisticiens. Or, la commission doit dire si les sondages sont techniquement bien fabriqués.

Vous oubliez les six magistrats ! Il faudra que cette commission juge de la validité des échantillonnages, tant d'un point de vue technique que sociologique. Peut-être qu'un seul statisticien suffira, d'autant qu'il sera peut être aidé par un mathématicien, mais quel sera son poids !

Pour ce qui est des magistrats, je tiens à faire remarquer que nous réduisons leur nombre à deux pour chaque instance. En outre, nous prévoyons cinq personnalités qualifiées, contre deux actuellement. Parmi elles, nous avons tenté de trouver un équilibre, car nous avons reçu des demandes fortes pour les Instituts d'études politiques, notamment l'IEP de Paris. Finalement, la Fondation nationale des sciences politiques convient très bien à tout le monde. Nous avons deux personnes compétentes en matière technique : le statisticien et le mathématicien. Nous avons une personnalité qualifiée en matière de sciences sociales qui aura nécessairement des connaissances en matière statistique puisqu'elle sera nommée par l'EHESS. Une personne qualifiée en matière de sciences politiques s'impose puisqu'il s'agit de sondages politiques. Nous sommes donc parvenus à un équilibre. Nous rectifions cet amendement pour remplacer la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur par l'Académie des sciences morales et politiques.
L'amendement n° 13 est adopté.
Avec l'amendement n°14, nous proposons que les membres de la commission soient nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
L'amendement n° 14 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 15 est adopté.
L'amendement n° 16 étend aux médias le régime d'incompatibilité des membres de la commission qui vaut pour les instituts de sondage.
L'amendement n° 16 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 10
L'amendement rédactionnel n° 17 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 12

L'amendement n° 18 rectifie une erreur de la proposition de loi : un ordonnateur ne peut être qu'une personne. C'est pourquoi nous précisons qu'il s'agit du président de la commission.
L'amendement n° 18 est adopté.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Il convient de maintenir l'interdiction de diffusion des sondages sur le territoire national la veille et le jour des élections, tout en sachant les limites d'une telle interdiction. L'amendement n° 19 maintient dans la loi de 1977 les dispositions de son article 11.
L'amendement n° 19 est adopté.
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 14

L'amendement n° 20 répare une omission : l'ensemble des violations de la loi doit être puni de la même amende.
L'amendement n° 20 est adopté.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 18
L'amendement rédactionnel n° 21 est adopté.
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 19

Tous les bureaux de vote doivent être fermés au moment où ferme le dernier bureau de vote de la métropole. D'où l'amendement n° 22.
L'amendement n° 22 est adopté.
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 21

L'amendement n° 23 traite des dispositions transitoires. Les actuels membres de la commission des sondages resteront en fonction trois mois après la publication de la loi: en trois mois, les différentes instances citées devraient avoir le temps de désigner leurs représentants.

J'ai toujours un doute sur les termes « publication » et « promulgation ». L'un est-il préférable à l'autre ?

Pour ce qui est des trois mois, nous avons pensé que le Conseil d'État, la Cour des comptes et la Cour de cassation auraient le temps de désigner leurs représentants, car elles se réunissent régulièrement. Pour les autres, nous espérons qu'elles pourront y procéder dans les délais impartis.

Cette proposition de loi raccourcit le mandat de ceux qui sont en fonction.

La loi peut le prévoir. Les actuels membres pourraient être désignés une nouvelle fois. Si nous votons une loi, autant qu'elle s'applique le plus tôt possible.
Le texte de la proposition de loi de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Puis la commission examine le rapport de M. Jean-René Lecerf sur la proposition de loi n° 203 (2010-2011), présentée par M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues, tendant à reconnaître une présomption d'intérêt à agir des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat en matière de recours pour excès de pouvoir.

Le Sénat est saisi de la proposition de loi présentée par M. Yvon Collin et plusieurs de ses collègues tendant à reconnaitre une présomption d'intérêt à agir des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat en matière de recours pour excès de pouvoir.
Cette proposition invite à trancher la question suivante : un député ou un sénateur peut-il se prévaloir de sa seule qualité de parlementaire pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir une mesure règlementaire qu'il considère comme portant atteinte aux prérogatives du Parlement ? Paradoxalement, la juridiction administrative n'a jamais tranché la question et s'est jusqu'à présent réfugiée dans une stratégie de contournement ou d'évitement.
L'attitude de contournement du juge administratif consiste à reconnaître au parlementaire requérant une autre qualité, fût-elle fort répandue. Ainsi, à un député qui demandait l'annulation des décrets organisant le référendum du 28 octobre 1962, la Haute juridiction a admis dans l'arrêt Brocas un intérêt pour agir en sa seule qualité d'électeur. De même, lorsque notre collègue M. Jean-Pierre Fourcade a contesté un décret relatif au Fonds de compensation pour la TVA, le Conseil d'État a retenu sa seule qualité de président du Comité des finances locales. En outre, en 2002, il a reconnu au député Didier Migaud la qualité de « consommateur de produits pétroliers » afin de lui permettre de contester le refus du ministre du Budget de mettre en oeuvre le mécanisme dit de la « TIPP flottante ». Notre collègue député François Bayrou a été reconnu en 2006 comme « actionnaire d'une société d'autoroute» dans une affaire portant sur la privatisation d'une société autoroutière. Enfin, très récemment, dans un arrêt du 11 février 2010, le Conseil d'État s'est explicitement penché sur la question de la recevabilité du recours présenté par divers parlementaires, dont notre collègue sénatrice Mme Nicole Borvo-Cohen-Seat, arguant de leur seule qualité de parlementaire, contre une lettre du ministre de la Culture et de la Communication adressée au président-directeur général de France Télévisions, lettre qui avait eu pour effet la suppression anticipée de la publicité en soirée sur les chaînes télévisées du groupe, alors que la loi prévoyant cette suppression était encore en discussion au Parlement. C'est en relevant leur qualité d'usagers du service public de la télévision que le Conseil d'État a reconnu l'intérêt à agir des requérants. Autrement dit, le juge administratif préfère masquer le parlementaire derrière l'administré, en l'espèce l'usager du service public, pour ne pas traiter la question de la recevabilité de la requête.
Quant à l'attitude de 1'évitement, elle consiste à statuer directement sur le fond après avoir précisé qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Cette technique contentieuse peut paraître étonnante puisqu'elle conduit à l'inversion de l'ordre normal d'examen des recours. Elle est toutefois assez fréquente car elle évite de laisser le requérant croire qu'il aurait pu obtenir l'annulation recherchée si sa requête avait été, sur la forme, jugée recevable.
Très récemment, une affaire dite « Fédération nationale de la libre pensée », a offert l'occasion au Conseil d'État de trancher la question de l'intérêt à agir d'un parlementaire invoquant une atteinte aux prérogatives du Parlement. Dans cette espèce, le Conseil d'État était en effet saisi par 57 sénateurs et 14 députés se prévalant de leur seule qualité de parlementaires. Ils mettaient en avant la méconnaissance, par le décret du 16 avril 2009 publiant un accord entre la France et le Saint-Siège, du droit des parlementaires d'exercer leur compétence dans la mesure où la ratification de l'accord aurait dû être autorisée par une loi. Dans ses conclusions, le rapporteur public Rémi Keller consacre de longs développements à la question de la recevabilité des requêtes des parlementaires. Par une formule imagée, il rappelle le refus constant du Conseil d'État de se prononcer sur cette question sensible : « Le parlementaire frappe depuis plusieurs décennies à la porte de votre prétoire; il ne sait toujours pas si elle lui est ouverte ou fermée. » Il ajoute solennellement: « Pour notre part, nous croyons que la considération que l'on doit à la fonction parlementaire doit vous conduire à renoncer aux subterfuges et à dire clairement ce qu'il en est. ». Il invite ainsi le Conseil d'État à trancher enfin la question de savoir si les députés et sénateurs peuvent se prévaloir de leur seule qualité de parlementaire pour contester devant la Haute juridiction un acte réglementaire qu'ils considèrent comme portant atteinte aux prérogatives du Parlement. Le Conseil d'État n'a pas suivi son rapporteur et s'est contenté de poursuivre sa stratégie d'évitement.
Ces jurisprudences sont étonnantes au vu de la largesse avec laquelle le juge administratif ouvre son prétoire, qu'il s'agisse de la reconnaissance de décisions faisant grief ou d'une appréhension très compréhensive de l'intérêt à agir. On cite par exemple une jurisprudence Casanova de 1901 qui reconnaît l'intérêt à agir d'un contribuable communal en cette seule qualité pour attaquer l'ensemble des délibérations du conseil municipal, ou bien un arrêt de 1971 reconnaissant l'intérêt à agir d'un hôtelier contre le ministre de l'Éducation nationale qui avait fixé la durée des congés scolaires. Il est donc paradoxal que nous soyons devant ce type d'incertitude jurisprudentielle.
Le texte proposé vise donc à doter les membres du Parlement d'une présomption d'intérêt à agir par la voie du recours contentieux, dès lors qu'est en jeu la défense des prérogatives du Parlement. Sont ainsi distinguées trois hypothèses de recevabilité du recours : celle où le pouvoir réglementaire empièterait sur une matière constitutionnellement réservée au pouvoir législatif ; celle où une mesure réglementaire méconnaîtrait la loi ; celle, enfin, où le pouvoir réglementaire, faute de prendre les mesures réglementaires nécessaires dans un délai raisonnable, rendrait de fait une loi inapplicable.
Sous des dehors techniques, cette proposition soulève des questions essentielles, tant en ce qui concerne les moyens d'action des députés et sénateurs pour la défense des prérogatives du Parlement que sur le rôle et la place de la Haute juridiction. La proposition de loi s'inscrit-elle dans le droit fil de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 dont l'ambition affichée était de rééquilibrer les institutions en faveur du Parlement, notamment en renforçant ses pouvoirs de contrôle de l'action du Gouvernement ? Le parlementaire a-t-il vocation à agir sur le terrain judiciaire pour défendre les droits du Parlement ? En outre, le dispositif proposé est-il conforme à l'office du juge administratif ?
Une question préalable : l'intervention du législateur en la matière est-elle justifiée ? On pouvait attendre - encore longtemps - que le Conseil d'État se prononce sur la question. Le juge administratif aura forcément un jour à connaître d'un recours de parlementaires qui sera accepté sur le fond et qui ne lui permettra pas de s'appuyer sur une autre qualité que celle de parlementaire. Il lui faudra alors déterminer sa position et tracer les limites de l'intérêt à agir des parlementaires en cette seule qualité. Comme l'écrit le président Daniel Labetoulle, « la question de la recevabilité des parlementaires ne passe pas plus par le « jamais » que par le « toujours » mais seulement par le « quand » », « quand » signifiant « à quelle date ? » mais aussi « dans quelles hypothèses ?».
Votre rapporteur estime que la question de l'intérêt à agir des parlementaires est une question trop sensible pour la confier au Conseil d'État et qu'il est même possible de considérer que le refus de la Haute juridiction de trancher cette question jusqu'à présent est un appel à une intervention normative. A cet égard, le dispositif envisagé par la proposition de loi, bien que touchant à la procédure contentieuse administrative, ne relève pas de la compétence du pouvoir réglementaire. En effet, le texte fixe des règles concernant les droits des parlementaires à l'égard de l'exécutif et relève, en conséquence, au minimum de la loi ordinaire.
Dès lors qu'est admise la nécessité d'une intervention du législateur, trois options sont possibles : dénier, par principe, tout intérêt à agir aux parlementaires en cette seule qualité ; reconnaître un très large intérêt à agir aux parlementaires en cette seule qualité - c'est l'option retenue par la proposition de loi d'Yvon Collin ; reconnaître un intérêt à agir aux parlementaires dans des hypothèses restreintes - c'est la position de votre rapporteur.
La première option dénie par principe tout intérêt à agir aux parlementaires en cette seule qualité, afin d'éviter une dénaturation tant de la fonction parlementaire que de la fonction juridictionnelle du Conseil d'État. C'est la position de M. Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement. Ce dernier, lors du débat sur l'édiction des mesures règlementaires d'application des lois, organisé au Sénat le 12 janvier 2011, a craint qu'une telle initiative n'« instaure une confusion des rôles ». Il a ajouté que cela correspondrait « à un renoncement au pouvoir du Parlement en la matière. La Constitution donne en effet aux parlementaires, notamment aux sénateurs, la possibilité de s'engager dans le contrôle de l'application des lois. Le ministre chargé des relations avec le Parlement vous le dit : « Vous ne devez pas renoncer à ce pouvoir au bénéfice des tribunaux. Ils ne sont pas là pour cela. C'est votre rôle! ».
En paraphrasant Clausewitz, on pourrait résumer ainsi cette position : « Le recours pour excès de pouvoir n'a pas pour finalité d'être la continuation, par d'autres moyens, du débat parlementaire ».
En second lieu, cette proposition de loi provoquerait un afflux de litiges et entraînerait une dénaturation de la fonction juridictionnelle du Conseil d'État. Pourrait-il conduire le Conseil d'État à arbitrer entre des parlementaires et le Gouvernement? Le Conseil d'État n'exercerait-il pas alors une fonction politique plus que juridique? N'y a-t-il pas là un risque d'instrumentalisation de la Haute juridiction, de dérive vers un « gouvernement des juges» ? Comme le soulignent très justement les professeurs de droit public, M. Thierry Rambaud et Mme Agnès Roblot-Troizier : « Si le requérant se prévaut de sa qualité de parlementaire et invoque l'atteinte aux prérogatives du Parlement, ce n'est plus l'administré qui est protégé mais le Parlement, ce n'est plus l'autorité administrative qui est sanctionnée mais le pouvoir exécutif. Bien sûr, la réalité juridique est parfaitement identique et cette différence n'est que symbolique mais, admettre l'intérêt à agir des parlementaires en cette qualité, c'est prendre le risque d'apparaître comme une juridiction exerçant une fonction politique ». Par ailleurs, comme l'a relevé, lors de son audition, M. Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d'État, le dispositif envisagé par la proposition de loi revient à créer pour les parlementaires un recours sui generis dont la recevabilité est appréciée au regard, non de la nature de l'acte, mais de la nature des moyens soulevés, ce qui constituerait une innovation forte en matière de procédure administrative contentieuse. Autrement dit, le recours du parlementaire ne serait recevable que si le Conseil d'État estime que le moyen invoqué est bien tiré d'une atteinte aux prérogatives du Parlement.
La deuxième option consiste à écarter les arguments évoqués plus haut afin de reconnaître un très large intérêt à agir aux parlementaires en cette seule qualité. C'est l'option retenue par la présente proposition de loi. Les tenants de cette thèse mettent en avant les arguments suivants : en premier lieu, le contrôle politique et le contrôle judiciaire sont deux modalités d'exercice complémentaires, et non concurrentes, de la fonction parlementaire ; en deuxième lieu, l'introduction, à côté des outils de contrôle politique existants, d'un nouvel outil de contrôle, judiciaire cette fois, s'inscrit dans le droit fil de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui avait pour ambition affichée de rééquilibrer les institutions en faveur du Parlement, notamment en renforçant ses pouvoirs de contrôle de l'action du Gouvernement ; en troisième lieu, les parlementaires disposent déjà de moyens de contrôle à caractère judiciaire, à travers la saisine du Conseil constitutionnel ; enfin - et surtout - les tenants de la reconnaissance de l'intérêt à agir des parlementaires mettent en avant l'efficacité de l'action juridique qui peut aboutir à l'annulation d'un acte de l'exécutif. C'est en particulier ce que notre collègue Jean-Pierre Sueur a souligné lors du débat sur les mesures règlementaires d'application des lois, de janvier 2011 : « On peut émettre tous les voeux possibles concernant le Gouvernement et le Parlement, lequel fait d'ailleurs son travail - et nous veillons à ce qu'il en soit ainsi -, à travers les diverses procédures de questions et la publication de nombreux rapports. Cependant, monsieur le ministre, on ne s'en sortira pas s'il n'existe pas de mesure plus coercitive ! .À cet égard, il convient de travailler dans deux directions. La première solution consiste à emprunter la voie qu'offre le Conseil d'État. En effet, celui-ci peut condamner le Gouvernement pour non-application de la loi. Je souhaite que de telles procédures se multiplient parce que c'est un moyen d'obtenir satisfaction.».
Selon les tenants de cette argumentation, une telle évolution ne constituerait pas un dévoiement de la fonction juridictionnelle du Conseil d'État. Rémi Keller, rapporteur public dans l'affaire « Libre pensée », ne craint pas que cela provoque un afflux de recours, ne serait-ce qu'en raison du temps nécessaire pour préparer et étayer un recours. Et il croit peu au risque de politisation. Il est rejoint sur ce point par deux maîtres des requêtes qui écrivent : « l'argument politique est exagéré: le juge, surtout administratif, est par sa nature même appelé à régler des problèmes d'ordre politique ; vivre avec son instrumentalisation fait partie de son office ». On pourrait aussi citer l'arrêt Rubin de Servens, décision directement d'ordre politique ; lorsque, la veille de l'exécution, le Conseil d'État annule la décision du Président de la République de créer un tribunal militaire spécial, le garde des sceaux, Jean Foyer, déclare qu'il faut une réforme radicale de la Haute juridiction.

La troisième option, qui a ma préférence, consiste à reconnaître un intérêt à agir aux parlementaires en cette seule qualité mais dans des hypothèses restreintes. Pour tenter de tracer les frontières acceptables pour l'intérêt à agir des parlementaires, il convient de reprendre les trois hypothèses de la proposition de loi.
En premier lieu, la proposition de loi entend permettre à un député ou un sénateur d'attaquer une mesure réglementaire qu'il estime contraire à une disposition législative. Ce cas d'ouverture très large a été très critiqué par l'ensemble des personnes entendues. Admettre la recevabilité d'un parlementaire à contester un acte administratif en ne se prévalant que de sa seule qualité de parlementaire reviendrait à admettre l'action populaire par la voie du représentant de la Nation, ce qui n'est pas souhaitable pour trois raisons principales. Tout d'abord, l'action populaire constituerait une innovation - pour ne pas dire une révolution - procédurale que rien ne justifie : la violation de la loi doit demeurer un moyen d'annulation d'un acte et non un critère de recevabilité du recours. Par ailleurs, le parlementaire serait soumis à de fortes pressions exercées par des élus, des associations, des syndicats, des habitants, pour qu'il porte une action devant le Conseil d'État, puisqu'à la différence des autres personnes physiques et morales, il bénéficierait ès qualité d'un droit de saisine. Enfin, sur le plan constitutionnel, l'hypothèse d'un intérêt à agir en cas de mesures réglementaires contraires à la loi est tellement large qu'elle est probablement inconstitutionnelle car contraire au titre V de la Constitution, au principe de la séparation des pouvoirs et à l'objectif de valeur constitutionnelle de « bonne administration de la justice ». Pour toutes ces raisons, votre rapporteur y est défavorable.
La proposition de loi prévoit une deuxième hypothèse qui permettrait à un parlementaire d'agir dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir : il s'agit du cas de «mesures réglementaires édictant une disposition relevant du domaine de la loi ». Sur le fond, je considère que l'atteinte alléguée à une compétence du législateur constitutionnellement garantie constitue un cas où la reconnaissance d'un intérêt à agir est pertinente. A titre d'exemple, l'intérêt à agir d'un parlementaire en cette seule qualité ne fait guère de doute lorsqu'un acte administratif intervient dans le domaine de la loi, alors même qu'une loi portant sur le même sujet est en cours de discussion, comme dans l'arrêt dit « Mme Borvo Cohen-Seat » précité. De même, on peut citer le cas du droit pénitentiaire, que le Gouvernement a longtemps considéré comme devant être régi par des circulaires alors même qu'il touchait aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et qu'à ce titre il relevait du domaine de la loi, conformément à l'article 34 de la Constitution. Le législateur a repris cette compétence en votant la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Si un Gouvernement venait, demain, à modifier cette loi par une circulaire, un parlementaire serait fondé à contester l'atteinte ainsi portée au domaine de la loi. Notons enfin que la reconnaissance de cet intérêt à agir serait cohérente avec le fait que le Conseil d'État admet depuis plus d'un siècle le fait qu'un conseiller municipal est recevable à attaquer un acte du maire dont il soutient qu'il entre dans les compétences du conseil municipal.
Pourtant je n'y suis pas favorable : une telle consécration serait probablement inconstitutionnelle car contraire à la séparation des pouvoirs, à l'objectif de valeur constitutionnelle de « bonne administration de la justice», et également, en creux, à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution. Ce dernier permet au Gouvernement de demander au Conseil constitutionnel de déclasser des dispositions législatives postérieures à 1958 lorsqu'elles présentent un caractère réglementaire. Institué en 1958, il s'inscrivait dans la logique du « parlementarisme rationalisé ». Le Gouvernement fait d'ailleurs un usage régulier - et parfois étonnant - de cette faculté. Il me plaît de rappeler que, à l'initiative du Sénat, la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne avait prévu la création, auprès de Matignon, d'un comité consultatif des jeux. Or, quelques mois à peine après le vote de la loi, le Gouvernement a demandé au Conseil constitutionnel, qui l'a accepté, de déclasser la disposition concernée afin de placer ce comité des jeux sous la responsabilité des ministères du budget et de l'intérieur.
L'existence, dans la Constitution, d'un mécanisme de protection du pouvoir réglementaire peut légitimement laisser supposer que le mécanisme inverse - la protection du pouvoir législatif - ne peut être prévu que par la Constitution elle-même. Je ne suis pas hostile à ce que, à l'occasion d'une prochaine révision constitutionnelle, soit inséré un troisième alinéa à l'article 37 ouvrant la saisine du Conseil d'État à 60 députés ou 60 sénateurs pour demander l'annulation d'un texte de forme réglementaire qui présenterait un caractère législatif.
La proposition de loi prévoit une troisième et dernière hypothèse qui permettrait à un parlementaire d'agir en cette seule qualité dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; il s'agit du cas du refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application d'une disposition législative. A la différence des deux autres hypothèses, je considère que cette hypothèse est constitutionnelle - et je ne suis pas le seul puisque Bernard Stirn, président de la section du contentieux, est du même avis - et, sur le fond, je la juge opportune. Je considère que l'inaction du pouvoir réglementaire, parce qu'elle revient à faire échec à la volonté du Parlement, donne qualité à agir aux parlementaires, d'autant que cette inaction peut tout à fait être volontaire comme l'a indiqué, lors du débat organisé au Sénat en janvier 2011 sur l'application des lois, notre collègue Patrice Gélard : « N'oublions pas non plus qu'un certain nombre de textes adoptés par nos assemblées ne plaisent pas au Gouvernement et que, par conséquent, celui-ci traîne un peu les pieds avant de publier les règlements adéquats. »
Au total, la proposition de loi soulève trop de difficultés pour être, en l'état, acceptable. Deux des trois hypothèses proposées sont probablement entachées d'inconstitutionnalité. En revanche, votre rapporteur croit possible de trouver un dispositif de compromis qui offre de fortes garanties de constitutionnalité. Il s'agirait de consacrer un intérêt à agir de plein droit des parlementaires dans deux cas très circonscrits : en cas de refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application d'une disposition législative ; lorsqu'un acte réglementaire a autorisé la ratification ou l'approbation d'un traité alors que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l'article 53 de la Constitution. J'estime que, dans ces deux hypothèses, il existe une atteinte - réelle, directe, légitime et certaine - à l'activité du Parlement et qu'en conséquence le parlementaire doit pouvoir, s'il le souhaite, intervenir de plein droit dans l'intérêt du Parlement. Ce dispositif offre de sérieuses garanties de conformité à la Constitution pour trois raisons principales : le champ d'intérêt à agir des parlementaires serait très restreint, limité à deux hypothèses peu fréquentes ; il n'existe pas pour ces deux cas de figure de procédures comparables ou voisines dans la Constitution laissant penser que le dispositif devrait trouver sa place dans notre loi fondamentale ; dans les deux cas visés plus haut, le parlementaire ne peut pas reprendre sa compétence violée par le pouvoir réglementaire.
Ce point mérite que l'on s'y arrête. Lorsqu'un acte réglementaire porte atteinte au domaine de la loi, le législateur peut généralement récupérer sa compétence par le vote d'une loi, surtout depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a prévu le partage de l'ordre du jour entre le Parlement et le Gouvernement. Ce n'est pas le cas dans les deux hypothèses visées plus haut. En particulier, un parlementaire justifie selon moi d'un intérêt à agir pour contester un décret autorisant la ratification d'un traité quand il estime qu'une loi était nécessaire pour une telle autorisation. En effet, dans cette hypothèse, l'intérêt à agir des parlementaires est justifié par une double atteinte aux prérogatives du Parlement : d'une part, parce que, si l'accord modifie des dispositions de nature législative, il aurait dû être soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution qui dresse la liste des traités qui «ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi» ; d'autre part, parce que le décret a pour effet d'introduire dans l'ordre juridique national une norme qui s'imposera au législateur en vertu de l'article 55 de la Constitution. En conséquence, le législateur ne pourra pas récupérer sa compétence par le vote d'une loi, ce qu'ont reconnu toutes les personnes entendues par votre rapporteur. Il y a sur ce point un vide juridique.
Par ailleurs, j'estime qu'il conviendrait de laisser au Conseil d'État le soin d'apprécier si les parlementaires ont intérêt à agir en cette seule qualité dans d'autres hypothèses que les deux présentées plus haut. En effet, ces dernières n'épuisent pas toutes les hypothèses dans lesquelles un parlementaire pourrait avoir ès qualité intérêt à agir. Ils ne constituent que des cas où l'atteinte aux prérogatives du Parlement est incontestable et justifie un intérêt à agir de plein de droit, mais il ne faut pas totalement fermer l'hypothèse d'un intérêt à agir dans d'autres cas.
Voilà la proposition que j'avance avec prudence et humilité.

Je remercie le rapporteur pour cet intéressant exposé. Son amendement reconnaît un intérêt à agir contre un refus du Premier ministre de prendre les mesures règlementaires d'application d'une loi. Or, le recours pour excès de pouvoir aboutit obligatoirement à l'annulation d'un acte. Comment, ici, le recours peut-il être opérant s'agissant d'une absence d'acte ?

Il faut demander au Premier ministre de prendre les mesures d'application. S'il ne répond pas dans les deux mois, il s'agit d'une décision implicite de rejet et c'est cette décision qui fait l'objet du recours pour excès de pouvoir. S'il répond qu'il ne veut pas, on attaque devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant le refus. Il y a là un problème de liaison du contentieux, classique dans les décisions négatives.

La proposition de loi n'y change rien : elle traite de l'intérêt spécifique à agir des parlementaires. Le reste relève du droit commun du contentieux administratif.

On se trouve un peu dans la même situation que le citoyen avant la réforme constitutionnelle et l'institution de la question prioritaire de constitutionalité. Ici, on peut violer les droits du Parlement sans qu'il puisse réagir. Je suis d'accord avec le rapporteur pour son choix du troisième cas de la proposition de loi mais, pour les deux premiers, je reste sur ma faim. On ne peut laisser un gouvernement, quel qu'il soit, violer les droits du Parlement sans rien faire ! Certes, pour qu'il n'empiète plus sur le domaine de la loi, on pourrait ajouter un troisième alinéa à l'article 37 de la Constitution. Mais lorsqu'il y a violation de la loi, pourquoi ne pourrions-nous pas réagir en tant que parlementaires ? Que faire, dans ce texte ou dans un autre, pour ne pas laisser violer la loi votée ?

Je ne vois pas pourquoi, d'un côté, on n'aurait pas d'intérêt à agir lorsqu'une mesure règlementaire édicte une mesure de nature législative, mais, de l'autre, on aurait cet intérêt lorsqu'il s'agit de la ratification ou de l'approbation d'un traité. Il est anormal que nous ne puissions pas agir - la question prioritaire de constitutionalité n'étant pas ici utilisable - lorsqu'une mesure règlementaire empiète sur le domaine législatif.

Le 1° de l'amendement du rapporteur peut avoir un effet considérable, compte tenu du nombre de lois qui restent sans décrets d'application ou dont les décrets paraissent avec retard. Cette absence de décret revient à permettre à tout gouvernement, quel qu'il soit, de s'arroger le droit de ne pas appliquer la loi. Dès lors que, dans un tel cas, les parlementaires seraient fondés à agir auprès du Conseil d'État, est-ce le Premier ministre ès qualité qui serait responsable de la publication de tous les décrets, de tous les ministères ? Si ce texte était voté, nous aurions une forte capacité à agir ; mais resterait le problème du qualificatif « raisonnable ».

C'est la jurisprudence du Conseil d'État : le délai raisonnable dépend de la complexité de la matière. On peut imaginer de un à trois ans.

Donc, après quatre ans, on ne serait plus dans un délai raisonnable. Le rapporteur nous dit avoir opté pour un champ restreint ; ce n'est pas du tout restreint ; cela nous donnerait une considérable capacité d'agir. D'autant, que, lorsque le Premier ministre recevra notre lettre, cela l'incitera peut-être à sortir le décret. Ce n'est pas du tout restreint.

Je trouve positif que les parlementaires aient ce droit à agir sans être obligés de prouver qu'ils sont abonnés au gaz. Cela dit, on pourrait agir sur le délai de parution du décret et on ne le pourrait pas si le décret est contraire à la loi ? Avec cette proposition de loi, le Parlement s'octroie des droits nouveaux qui modifient l'équilibre des pouvoirs. Je ne suis pas certain que ce soit possible par une loi ordinaire.

Le 1° de l'amendement du rapporteur a une portée très large et il règle notre problème d'application de la loi. Je signale qu'en Allemagne les décrets sont publiés en même temps que la loi, ce qui éclaire les parlementaires et peut même modifier leur point de vue. J'ai une question sur le 2° de l'amendement : quelle est la différence entre ratification législative et ratification par acte règlementaire ?

D'après l'article 53 de la Constitution, « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ». S'ils sont ratifiés par un décret, le Parlement perd toute possibilité de les modifier par une proposition de loi, il perd toute possibilité de récupérer sa compétence et l'article 55 l'oblige à respecter les traités en question.

Le législateur peut-il ès qualité se doter d'un nouveau pouvoir par une loi ordinaire ? Le 1° de l'amendement crée un intérêt à agir légal, il ne présente pas de risque particulier pour le gouvernement. En revanche, l'argument de M. Béteille m'inquiète davantage, quand il s'étonne de voir le Parlement s'octroyer de nouveaux pouvoirs par une simple loi.

La Constitution prévoit des modalités de protection du domaine règlementaire. N'oublions pas que son premier objectif, en 1958, était la « rationalisation du parlementarisme », ce qui, en termes polis, désigne l'abaissement des pouvoirs du Parlement. La dernière réforme constitutionnelle a procédé à un rééquilibrage des pouvoirs. Mais je suis gêné par l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution. Les dispositions qui permettent au gouvernement d'intervenir sont constitutionnelles et je ne vois pas comment le législateur, seul, pourrait y porter remède. La Constitution ne prévoit pas de procédure symétrique. Nous ne faisons là que reconnaître un intérêt à agir spécifique pour faire respecter la séparation des pouvoirs et l'obligation, pour le gouvernement, de prendre les mesures d'application de la loi.

L'intérêt à agir suppose qu'un intérêt matériel ou moral d'une personne ou d'un groupement soit lésé. Je ne vois pas quel est, en tant que parlementaire, mon intérêt spécifique à agir. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la dérive possible vers le « gouvernement des juges ». Le Conseil d'État finira par être juge de nos divergences avec le Gouvernement. J'admire le travail du rapporteur, travail d'orfèvre, mais, même s'il est plus restrictif par rapport à la proposition de loi, je ne voterai pas le texte qu'il nous présente. Je n'y vois pas un progrès pour la démocratie, contrairement à ce qu'il en était pour la question prioritaire de constitutionalité. Je vous mets en garde...

Il est arrivé que soient mis en place des dispositifs renforçant les pouvoirs du Parlement et qui n'étaient pas prévus dans la Constitution : les commissions d'enquête par exemple, ou les offices et délégations. Et le juge administratif est quand même un juge particulier ; on apprend encore aux étudiants en droit public que juger l'administration, c'est encore administrer. S'il n'y avait pas dans la balance le poids de l'intérêt général et de l'intérêt particulier il n'y aurait plus besoin de juge administratif et on unifierait les juridictions.

Le juge va donner une injonction au Premier ministre. Est-ce au parlementaire de s'occuper de cela ?

Les contentieux entre pouvoirs exécutif et législatif ne peuvent être résolus par le juge administratif. Le Parlement a d'autres moyens de traiter avec l'Exécutif. Mieux vaut renforcer ces moyens. La discussion est passionnante mais je suis d'accord avec le président.

Je propose de ne pas établir de conclusions dans l'immédiat. Ainsi, le texte viendra en séance dans la rédaction d'origine. Il appartiendra au rapporteur, ou aux auteurs de la proposition, de proposer ultérieurement des amendements en vue de la séance et la commission donnera un avis.

Je serais d'avis d'adopter tout de suite l'amendement du rapporteur pour faire de son texte le texte de la commission, parce que l'avancée sur les traités et sur la possibilité d'intervenir en cas de refus de faire paraître les décrets est très positive.

Je n'ai pas cosigné cette proposition de loi mais son auteur serait désormais d'accord avec la position du rapporteur.

C'est typiquement le texte sur lequel une exception d'irrecevabilité ne serait pas aberrante Dans un tel cas, mieux vaudrait qu'elle porte sur l'ensemble du texte. Donc je me rallie à la position du président.

Donc nous ne concluons pas aujourd'hui. Le texte viendra en discussion dans sa rédaction d'origine et nous verrons si des amendements seront déposés.