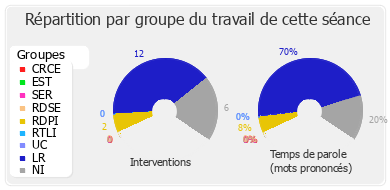Séance en hémicycle du 12 mai 2005 à 21h45
Sommaire
- Vote des français établis hors de france pour l'élection du président de la république assemblée des français de l'étranger
- Protocoles d'application de la convention alpine dans le domaine de la protection de la nature (voir le dossier)
- Accord sur la conservation des petits cétacés (voir le dossier)
- Accords internationaux sur la meuse et l'escaut (voir le dossier)
- Accord avec bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (voir le dossier)
- Protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées (voir le dossier)
- Protocoles relatifs à europol (voir le dossier)
- Convention sur la cybercriminalité (voir le dossier)
- Communication de l'adoption définitive de textes soumis au sénat en application de l'article 88-4 de la constitution
- Caducité de textes soumis au sénat en application de l'article 88-4 de la constitution
- Transmission de projets de loi
- Dépôt de propositions de loi
- Dépôt d'une proposition de résolution
- Retrait d'une proposition de résolution
- Textes soumis au sénat en application de l'article 88-4 de la constitution
- Dépôt de rapports d'information
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion :
- du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
- et du projet de loi modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique n° 305.
L'intitulé de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ».
L'article 1 er est adopté.
Les articles 1er à 9 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1 er . - Tout Français établi hors de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa demande, participer à l'étranger à l'élection du Président de la République conformément aux dispositions de la présente loi organique.
« Section 1
« Listes électorales consulaires
« Art. 2. - Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.
« Les articles L. 1, L. 2, L. 5 à L. 7 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales consulaires.
« Art. 3. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires.
« Art. 4. - Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur :
« 1° Tout Français résidant dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est établie et qui en fait la demande ;
« 2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part.
« Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. Le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique fixe le délai au terme duquel ce Français, lorsqu'il est déjà inscrit au registre des Français établis hors de France, et après la notification qui lui aura été faite de son inscription sur la liste électorale consulaire, est réputé ne pas s'opposer à cette inscription.
« Art. 5. - Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés lorsque les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent.
« Une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir la liste électorale consulaire établie au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.
« Art. 6. - Chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire, composée comme suit :
« 1° l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou leur représentant, président ;
« 2° deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ou par son bureau s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions plénières. Leur mandat prend effet au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement partiel. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement définitif ou de décès. Le mandat des membres titulaires ou des membres suppléants devenus titulaires n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.
« La commission administrative prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est également chargé de tenir en application du deuxième alinéa de l'article 5.
« Art. 7. - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères sous la présidence d'un magistrat de l'ordre administratif ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Sa composition est fixée par le décret prévu à l'article 19.
« La liste électorale consulaire arrêtée par la commission électorale mentionnée à l'alinéa précédent est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication. Le décret prévu à l'article 19 fixe les conditions dans lesquelles est préparée et arrêtée la liste électorale consulaire, ainsi que les modalités de son dépôt et de sa publication.
« Un double de la liste est conservé par la commission mentionnée au premier alinéa.
« Art. 8. - La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote. Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste.
« Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette dernière de leur choix de participer à l'étranger à l'élection du Président de la République.
« Art. 9. - Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles qui seront prises par le décret prévu à l'article 19 pour adapter les dispositions législatives applicables en France aux conditions de vote dans les ambassades et dans les postes consulaires, les dispositions des articles L. 16, L. 17, L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29 et L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.
« Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19. Ce décret pourra notamment allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
participer à l'étranger à
par les mots :
exercer son droit de vote à l'étranger pour
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement tend à préciser que l'objet de l'article 1er de la loi organique est bien de permettre aux Français établis hors de France d'« exercer » leur droit de vote à l'étranger, et non pas simplement de « participer » à une élection, terme insuffisamment précis.
Avis favorable, monsieur le président.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 2, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« 1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ;
La parole est à M. le rapporteur.

Il s'agit encore d'un amendement de précision.
En effet, le texte du projet de loi organique comporte les termes : « tout Français résidant » à l'étranger, alors que l'expression consacrée est : « tout Français établi » à l'étranger, comme cela vient d'ailleurs d'être confirmé dans l'ordonnance adoptée aujourd'hui en conseil des ministres. Il nous paraît donc nécessaire de modifier la rédaction de cet alinéa.
Je souscris parfaitement aux propos de M. le rapporteur : cette précision est nécessaire, et le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 3, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
S'il est inscrit au registre des Français établis hors de France, il est informé qu'il a la faculté de s'opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement a pour objet de clarifier le texte du projet de loi organique, car la présomption de non-opposition de l'électeur, après un certain délai fixé par décret, qui découle de sa rédaction actuelle pourrait soulever des risques d'inconstitutionnalité.
Or le projet de loi que nous sommes en train de discuter est un projet de loi organique et sera, dès lors, obligatoirement soumis à la censure du Conseil constitutionnel. C'est donc la prudence qui nous a dicté cet amendement.
Je me range à cette prudence et je suis favorable à l'amendement.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 4, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
lorsque les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent
par les mots :
en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement a pour objet d'introduire une certaine souplesse dans la loi organique de 1976.
En effet, aux termes du texte qui nous est soumis, il est possible d'organiser des sections de liste électorale dans différents bureaux de vote « lorsque les circonstances locales ou le nombre des électeurs l'exigent ».
Le verbe « exiger » semble bien fort ! Il nous a donc semblé nécessaire, pour conserver une souplesse qui nous paraît indispensable, de remplacer ce membre de phrase par les mots : « en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs ».
L'intervention de M. le secrétaire d'Etat au cours de la discussion générale m'a d'ailleurs donné à penser qu'il partageait l'analyse de la commission.
Je suis bien sûr favorable à cet amendement, car l'un des objets de la loi est de créer des bureaux de vote en plus grand nombre pour rapprocher l'urne de l'électeur et favoriser ainsi la participation aux scrutins.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 5, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise également à modifier non pas le fond du texte, mais simplement sa forme.
En effet, dans la loi du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, dont l'objet était de transformer le CSFE en Assemblée des Français de l'étranger, on trouve une phrase semblable, mais qui, pour bien montrer que le recours à cette possibilité ne saurait être systématique et doit être réservé aux cas où il est nécessaire, commence par les mots : « Toutefois, en cas de nécessité, ... » Sans cette précision, l'interprétation de la loi organique pourrait être faussée.
Le Gouvernement ayant accepté l'amendement dont est issue la rédaction du texte de la loi d'août 2004, il devrait conserver la même position pour cet amendement-ci.
Je n'ai aucune objection à soulever ! Il ne faudrait pas, en effet, que la nécessité s'applique uniquement aux cas de crise, de guerre ou d'événement grave : il existe aussi des nécessités administratives.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 6, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant ;
« 2° deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ; leur mandat prend effet au 1er janvier de l'année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le bureau de l'Assemblée procède, s'il y a lieu, à ces désignations dans l'intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.
« La commission administrative est présidée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant.
« Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du deuxième alinéa de l'article 5.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement porte sur la composition des commissions administratives. Sans viser à modifier au fond le texte proposé par le Gouvernement, il a pour objet de le clarifier autant que possible afin d'éviter toute confusion.
Il tend également, pour échapper aux difficultés que nous rencontrons parfois pour trouver des candidats à ces commissions - ils ne sont pas toujours légion ! -, à indiquer explicitement que seuls les membres titulaires ne pourront pas voir leur mandat immédiatement renouvelé : il va de soi que ces dispositions ne concernent les suppléants qu'à partir du moment où ils deviennent titulaires.
Je n'ai pas d'objection, monsieur le président.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 7, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 7. - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères.
« Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président. Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.
« La liste électorale consulaire est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication.
« Un double de la liste est conservé par la commission électorale.
La parole est à M. le rapporteur.

Toujours dans le souci d'une plus grande précision, mais aussi par cohérence avec l'article 6 de la loi organique de 1976, cet amendement vise à réécrire l'article 7 de cette même loi organique.
En effet, à l'heure actuelle, la composition de la commission électorale chargée d'arrêter les listes relève du décret en Conseil d'Etat du 14 octobre 1976, alors que, dans le droit commun, c'est l'article L. 17 du code électoral qui fixe la composition des commissions communales dont le rôle est identique.
Il nous paraît donc nécessaire, pour des raisons de cohérence, que des dispositions similaires s'appliquent dans les deux cas, et ce d'autant plus que c'est la loi organique qui, dans son article 6 que nous venons d'adopter, fixera la composition des commissions administratives responsables de la préparation des listes : dans un souci de parallélisme et d'harmonisation, il paraît normal de fixer également dans la loi organique la composition de la commission électorale, qui se situe hiérarchiquement au-dessus des commissions administratives puisque c'est elle qui en arrête les listes.
Tout à fait favorable, monsieur le président.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 8, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par une phrase ainsi rédigée :
Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d'exercer leur droit de vote en France pour l'élection du Président de la République.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement porte sur un sujet que nous avons évoqué tout à l'heure : la faculté offerte aux Français établis hors de France et inscrits à la fois sur une liste en France et sur une liste à l'étranger de voter, pour les scrutins présidentiels et pour les référendums, soit en France, soit à l'étranger, mais en optant préalablement pour l'une ou pour l'autre possibilité.
Les communes sont tenues, lorsqu'un Français de l'étranger inscrit sur leurs listes a fait le choix de voter dans un poste consulaire, d'indiquer à l'encre rouge que son droit de vote est suspendu. Il est donc tout à fait naturel qu'il soit tout aussi clairement précisé sur les listes consulaires qu'un électeur a opté pour l'exercice de son droit de vote en France, et ce afin d'éviter la moindre confusion et la moindre fraude.
Avis favorable, monsieur le président.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 20, présenté par M. Del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par une phrase ainsi rédigée :
Conformément aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les électeurs qui possèdent une messagerie électronique ont la faculté d'en communiquer l'adresse aux autorités consulaires.
La parole est à M. Robert Del Picchia.

Cet amendement vise à établir un lien entre les Français de l'étranger et leur pays d'origine, entre les électeurs et leurs élus. Ce lien, qui est fragile, est fondamental.
Pour pallier la distance et l'isolement, information et échanges sont nécessaires. Les moyens de communication classiques - la poste, le téléphone, la télécopie - sont inopérants et insuffisants pour l'information de la communauté française ; ils sont d'ailleurs peu utilisés, puisque, on le sait, les budgets étant limités, il n'est pas possible, comme l'a fort justement observé M. Yung, d'envoyer régulièrement des lettres.
En outre, dans certains pays, les services postaux fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas du tout. Ainsi, à Dakar, les facteurs ne remettent plus les lettres : il faut aller les chercher au bureau de poste.

Or beaucoup de Français vivent à Dakar. Et ce n'est qu'un exemple !
Les moyens de communication classiques sont donc limités.
Parmi les moyens de communication modernes, le courrier électronique semble être aujourd'hui idéal, pour les Français de l'étranger, afin de couvrir de telles circonscriptions. En effet, Internet permet de contacter en temps réel et sans frais un grand nombre de nos compatriotes. On notera aussi qu'une grande partie des Français établis hors de France utilise depuis longtemps le réseau Internet comme moyen d'information ou de communication avec la France.
Malheureusement, la plupart des postes consulaires ne disposent pas de l'adresse électronique des ressortissants Français établis dans leur zone de compétence. Si obligation leur en était faite dans la loi, ils s'impliqueraient davantage !
Telle est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement. Son objet est simple et modeste, puisqu'il vise seulement à apporter une précision permettant aux électeurs français établis où que ce soit dans le monde de savoir qu'ils ont cette faculté de communiquer leur adresse électronique à leur consulat.
J'entends déjà les objections qui vont m'être opposées : nous allons le faire, nous allons écrire... Non ! Je suis désolé, j'ai une expérience de l'étranger vieille de trente-cinq ans, je connais les consulats, je connais leur fonctionnement, et je sais que, malgré la bonne volonté d'un grand nombre d'entre eux, que je reconnais, certains n'ont toujours rien fait en ce sens.

La commission des lois a étudié attentivement cet amendement, dont elle partage l'esprit.
Nous avons eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises dans ce débat, il est évident qu'Internet et les messageries électroniques sont des moyens essentiels pour joindre les Français établis hors de France. Mais nous n'avons pas besoin d'une loi pour préciser que « les électeurs qui possèdent une messagerie électronique ont la faculté d'en communiquer l'adresse aux autorités consulaires » ! Les électeurs ont déjà le droit de le faire s'ils en ont envie !
Nous comprenons très bien le but réel, et fort honnête, de notre collègue, et nous y souscrivons : il s'agit d'inciter les postes diplomatiques et consulaires à recourir chaque fois que possible au courrier électronique pour joindre nos compatriotes expatriés. Mais cela ne relève pas du domaine de la loi : une circulaire, voire un arrêté ou un décret, si on l'estime utile, peuvent y suffire sans qu'il soit besoin de passer par la loi.
Mes chers collègues, n'oublions pas que nous sommes en train de débattre d'un projet de loi organique qui, en tant que tel, sera soumis à la censure du Conseil constitutionnel !

Or le Conseil constitutionnel nous a répété à plusieurs reprises, et son président y a insisté encore récemment, qu'il veillerait très strictement à ce que les lois ne sortent pas du champ que leur assigne l'article 34 de la Constitution : les matières réglementaires n'ont pas leur place dans la loi.
Nous devons en outre considérer que sont ici en jeu moins la faculté donnée aux électeurs de communiquer leur adresse électronique aux services consulaires - faculté qu'ils ont déjà, car le contraire serait une atteinte à leurs droits - qu'une injonction, aimable et courtoise, faite aux fonctionnaires du Quai d'Orsay d'utiliser davantage le courrier électronique. Or il me semble que les meilleures personnes placées pour ce faire sont le ministre, le secrétaire d'Etat ou les ministres délégués.
Voilà pourquoi la commission des lois, tout en partageant vos sentiments, mon cher collègue, estime que votre amendement relève du domaine réglementaire et vous invite à le retirer. Peut-être M. le secrétaire d'Etat va-t-il vous apporter tous les apaisements nécessaires et vous donner les gages que votre demande sera satisfaite, progressivement, bien sûr, et dans la mesure des moyens de chacun !
Le Gouvernement partage l'analyse de la commission. Nous ferons en sorte que la réglementation soit appliquée.

Je veux bien le retirer, mais je souhaite que le Gouvernement s'engage à faire en sorte que tous les consulats demandent systématiquement leur adresse électronique à tous les Français qui s'inscrivent sur les listes électorales.
Monsieur le secrétaire d'Etat, actuellement, ce n'est pas le cas partout ! J'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir l'affirmer et de très nombreux Français de l'étranger confirmeront mes propos.
Il existe une circulaire d'octobre 2004 relative à l'inscription des Français de l'étranger sur les listes électorales qui stipule que l'adresse est composée des éléments suivants : adresse personnelle postale, adresse électronique, numéro de téléphone fixe et, le cas échéant, mobile et de télécopie.
Cette circulaire n'est peut-être pas suffisamment appliquée, mais elle existe et nous ferons en sorte qu'elle ne soit pas oubliée.

L'amendement n° 9, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, remplacer les mots :
de participer à l'étranger à
par les mots :
d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 10, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 9.- Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du premier alinéa de l'article L. 17, des articles L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29, ainsi que des articles L. 31 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.
« L'article L. 30 du code électoral est également applicable ; le 3° dudit article s'applique à tout Français qui atteint la condition d'âge après la date à laquelle la liste électorale consulaire a été arrêtée.
« Le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations des commissions administratives et de la commission électorale s'il estime qu'elles sont irrégulières.
« L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti et peut présenter ses observations. Il peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
« Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l'inscription ou la radiation d'électeurs omis ou indûment inscrits.
« La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi.
« Le juge du tribunal précité a compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur les listes électorales consulaires après la clôture des délais d'inscription.
« Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19.
« Ce décret peut fixer des délais de procédure spécifiques pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux. »
La parole est à M. le rapporteur.

Il s'agit d'un amendement important.
L'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 tend à préciser les dispositions législatives du code électoral relatives à l'établissement et au contrôle des listes qui seraient applicables aux listes électorales consulaires. Il s'aligne autant que faire se peut sur le droit commun électoral applicable aux listes électorales dans les communes.
Ces dispositions s'appliqueraient sous réserve de celles de la loi organique du 31 janvier 1976, mais également du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19 pour « adapter » les dispositions législatives en vigueur aux conditions de vote spécifiques dans les ambassades et consulats. Or, le mot « adapter » peut porter en lui des dangers non négligeables en matière de constitutionnalité.
Le décret envisagé serait susceptible d'allonger les délais de procédure et de modifier les règles de compétence au sein de chaque ordre de juridiction pour faciliter le contrôle des listes. Je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel serait enthousiaste à cette idée, puisque cela relève de la compétence du législateur.
D'ailleurs, cette délégation importante au pouvoir réglementaire, qui avait été approuvée par le Conseil constitutionnel en 1976, se trouve maintenant confrontée à une nouvelle évolution de la jurisprudence. En effet, dans sa décision n° 94353/356 du 11 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a estimé que le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des conditions dans lesquelles les dispositions de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée pourraient être adaptées méconnaissait la compétence exclusive que le législateur organique tient de l'article 6 de la Constitution pour procéder à une telle détermination.
Ainsi, au regard de l'évolution de la jurisprudence du Conseil, le dispositif proposé est susceptible d'être considéré comme non conforme à la Constitution ; nous ne voulons pas prendre ce risque.
C'est pourquoi le présent amendement tend à supprimer la référence au décret en Conseil d'Etat pour « adapter » les dispositions du code électoral ; à étendre le nombre d'articles du code électoral applicables à l'établissement et au contrôle des listes électorales consulaires, afin de conforter l'harmonisation de ces procédures avec le droit commun ; à fixer la répartition des compétences spécifiques entre les juridictions relative au contentieux des opérations de révision des listes ; à permettre au décret précité de préciser les délais de procédure afin de prendre en considération les contraintes spécifiques pesant sur l'établissement et le contrôle des listes à l'étranger.
En d'autres termes, au lieu de faire référence à un décret, nous reprenons les dispositions du décret existant en les calquant sur le droit commun de façon qu'il puisse y avoir un parfait équilibre entre ce qui se passe en France et ce qui se passera dans les consulats, compte tenu, bien sûr, des spécificités figurant dans la loi elle-même et des contraintes inhérentes à l'éloignement du territoire national.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
Les articles 10 à 19 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° A l'article 10, les mots : « des consulats » sont remplacés par les mots : « des postes consulaires » ;
2° A l'article 12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vote dans les centres de vote » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;
3° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.
« Le décret prévu à l'article 19 fixe les modalités d'adaptation de ces mesures au vote dans les ambassades et les postes consulaires. » ;
4° A l'article 14, les mots : « article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 » ;
5° Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
« Tout candidat peut également, dans un délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales. » ;
6° A l'article 16 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables.
« Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de vote » sont remplacés par les mots : « l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire selon le cas, ou par leur représentant » ;
7° A l'article 17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les centres de vote » sont remplacés par les mots : « dans les ambassades et les postes consulaires » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux procédures relatives au vote dans les centres de vote » sont supprimés ;
8° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions du code électoral auxquelles renvoient les articles précédents sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2005- du » ;
9° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Un décret en Conseil d'État complétant et adaptant le décret pris en application de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République fixe les modalités d'application de la présente loi organique. »

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 18, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et M. André, M. Badinter, Mme Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10 - Sauf dans les Etats membres de l'Union européenne et les Etats qui ont déclaré l'accepter, toute propagande est interdite à l'étranger, à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et des postes consulaires. »
La parole est à M. Richard Yung.

L'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 stipule que « toute propagande est interdite à l'étranger, à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et des consulats ».
Cette mesure législative, qui a été complétée par les dispositions du décret n°76-950 du 14 octobre 1976, repose sur des « convenances internationales ». En d'autres termes, il est de coutume de ne pas diffuser ni d'organiser de « propagande » liée aux scrutins nationaux dans un Etat étranger.
On comprend bien les raisons qui militent en ce sens. Toutefois, les deux exceptions contenues dans la loi de 1976 - l'envoi des circulaires, d'une part, l'affichage dans les ambassades et les consulats, d'autre part - ne permettent pas de sensibiliser de manière satisfaisante nos concitoyens établis à l'étranger lors de l'élection du Président de la République ou pendant la campagne précédant un référendum.
Selon mon expérience personnelle, ayant vécu trente-cinq ans à l'étranger dont quatorze en Allemagne, la question du bien-fondé de ces dispositions peut se poser.
J'ai, par exemple, assisté à un meeting de Pierre Mauroy sur la Place du marché à Munich, annoncé de différentes manières. En d'autres temps, M. Sarkozy a tenu des réunions publiques à Bruxelles et personne n'a soulevé de critiques. Or, l'un et l'autre, qui figurent parmi les plus hauts représentants de notre République, étaient en contradiction avec la règle en vigueur.
Afin de mettre un terme à cette incohérence entre la loi et la pratique, il faut faciliter l'organisation de véritables campagnes politiques à l'étranger, notamment au sein de l'Union européenne.
Certes, la Constitution européenne n'a pas encore été adoptée - ...

... je ne doute pas que cela viendra ; on l'adaptera peut-être après - mais rappelons tout de même que, dans le projet de constitution, figurent plusieurs articles, notamment l'article II-71 relatif à la liberté d'expression et d'information et l'article II-72 relatif à la liberté de réunion et d'association des citoyens européens, qui reprennent des dispositions contenues dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 - les articles 10 et 11 - et qui visent précisément à favoriser l'expression de la citoyenneté européenne.
Par conséquent, nous devons nous aligner sur ces deux textes fondamentaux, l'un existant et l'autre, je l'espère, à venir.

L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Guerry, Mmes Brisepierre et Kammermann, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
« 1° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10 - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés ;
« 2° de l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et, en accord avec l'Etat concerné, dans les bureaux ouverts dans d'autres locaux. »
La parole est à M. Michel Guerry.

Le droit européen résultant des traités sur la Communauté européenne et sur l'Union européenne consacre la liberté d'expression politique dans les Etats de l'Union.
Cette liberté a été consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui n'a certes pas, en l'état, de valeur normative, mais la jurisprudence communautaire y voit l'expression des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » qui font partie du droit de l'Union en tant que « principes généraux » du droit communautaire, conformément à l'article 6, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et l'article 3 du protocole n°1 à la Convention garantissent également ce droit à la libre expression électorale.
Dans un arrêt « Piermont contre France » du 20 mars 1995, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'appartenance d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne ne permettait pas de lui opposer l'article 16 de la Convention de 1950 autorisant les Etats à restreindre la liberté politique des étrangers, notamment leur liberté d'expression au cours d'une campagne électorale.
La Cour a rappelé que la liberté d'expression constitue « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès. »
Elle a précisé, certes, que « la liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu et qu'un Etat contractant peut l'assujettir à certaines restrictions ou sanctions », mais la Cour a jugé qu'il lui appartenait de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 de la Convention.
En l'espèce, la Cour a protégé le droit de libre expression des citoyens européens contre les restrictions que voulait imposer le gouvernement français. Cet arrêt consacre, par conséquent, la liberté d'expression électorale des ressortissants de l'Union dans tout Etat membre.
L'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 ne respecte donc pas les dispositions actuelles du droit européen, ni les traités qui garantissent les libertés fondamentales.
En effet, tant la Charte du Conseil de l'Europe - article 10 - que les traités communautaires - article 6 du traité sur l'Union européenne - reconnaissent l'existence d'une citoyenneté européenne aux ressortissants des Etats membres.
Notre amendement a donc pour objet de rappeler les exigences de la liberté d'expression électorale sur le territoire de l'Union et des Etats membres. Seront ainsi autorisés les réunions, l'affichage, l'usage des moyens de communication, la liberté des correspondances, dans le respect de la législation du pays hôte, restant sauve l'interdiction de toute injure ou diffamation.
Notre amendement respecte les conclusions de la commission de la réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui avait opté pour une distinction entre le régime applicable dans l'Union européenne et le régime applicable dans les autres Etats.
A la suite des délibérations de la commission des lois, j'ai préféré remanier la rédaction de cet amendement pour le rendre plus clair et j'ai saisi cette occasion pour y ajouter, au 2° de l'article 10, un membre de phrase qui est en fait une coordination avec l'amendement n° 5 rectifié bis que j'ai déposé sur le projet de loi relatif à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Le sous-amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 22 rectifié bis pour l'article 10 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
« 2° de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Cet amendement se justifie par son texte même.

Le sous-amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 22 rectifié bis pour l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle sont tenus de mener une campagne d'information civique à destination des Français établis hors de France afin de leur rappeler notamment les dates et modalités de participation aux élections. ».
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

L'objet de ce sous-amendement est extrêmement simple. Comme je l'ai précédemment évoqué, il s'agit de rectifier une anomalie du droit commun qui constitue une discrimination envers les Français de l'étranger.
En effet, le manque d'information des Français de l'étranger en matière électorale est une discrimination au regard du droit commun. Est-il normal que les prud'hommes, par exemple, bénéficient de plusieurs centaines de spots télévisés alors que les élus français de l'étranger au suffrage universel ne peuvent y prétendre ?
Notre devoir, en tant que sénateurs représentant les Français de l'étranger, est de lutter contre toute forme de discrimination envers ces derniers.
L'objectif est, bien sûr, d'encourager la participation électorale. D'autres orateurs ont évoqué la nécessité d'une propagande électorale, de campagnes politiques, mais la première étape reste, bien évidemment, une information civique, d'autant que les difficultés d'information sont considérables à l'étranger.
A ce propos, vous me permettrez d'ouvrir une parenthèse : je regrette presque que notre collègue Robert Del Picchia ait retiré l'amendement n° 20 parce que le courrier électronique est fondamental. Le consulat de Londres, par exemple, qui compte près de 100 000 immatriculés, n'a jamais eu la possibilité matérielle d'envoyer une simple circulaire aux Français établis dans la circonscription, ne serait-ce que pour les informer qu'un ancien élu du Conseil supérieur était devenu sénateur et leur présenter son successeur !
Il est évident que l'utilisation d'une adresse électronique aurait été très utile. Certes, un tel voeu avait déjà été présenté par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, des demandes en ce sens ont été formulées auprès des consulats, mais elles n'ont malheureusement pas été suivies d'effet ; je ferme la parenthèse...
Vous remarquerez que TV 5 va diffuser, à partir de lundi prochain, une série de spots télévisés destinés aux Français de l'étranger. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois puisque, en tant que première vice-présidente du Conseil supérieur des Français de l'étranger, j'avais obtenu, au printemps 2003, que TV 5 organise une campagne d'information. Je dois souligner que la chaîne avait accepté de réaliser puis de diffuser gracieusement ces spots d'information sur l'élection au Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Néanmoins, il me paraît vraiment important d'inscrire cette possibilité dans la loi. Sinon, que se passera-t-il ? Nous serons toujours tributaires de la bonne volonté des rédacteurs, des présidents de chaînes de télévision ou de radio. J'avais d'ailleurs interrogé le Conseil supérieur de l'audiovisuel à ce sujet. Il m'avait répondu que la seule solution était l'inscription dans la loi, et que rien ne s'y opposait.
En définitive, je demande le simple rétablissement d'un principe fondamental du droit commun : l'égalité des citoyens devant la loi, en particulier en matière électorale, qui est, je le rappelle, l'un des fondements essentiels de notre République et de notre citoyenneté.

L'amendement n° 21, présenté par M. Del Picchia, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles technologies, telles que le réseau Internet et les messageries électroniques, sont utilisées comme outil de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve des recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La parole est à M. Robert Del Picchia.

Il s'agit, là encore, d'utiliser les nouvelles technologies telles que le réseau Internet et les messageries électroniques comme outils de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve, bien sûr, des recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL.
Je ne reviendrai pas sur la question du rôle politique dans les pays d'accueil, que j'ai déjà eu l'occasion de développer. L'envoi ou la remise aux électeurs par les services diplomatiques consulaires de tous les documents nécessaires à l'information reste la seule manière diplomatique acceptable. Les nouvelles technologies devraient le permettre.
On va me rétorquer que cela relève du domaine réglementaire, mais je pense que c'est faux - bien sûr, je ne suis qu'un simple sénateur ; la commission des lois m'est supérieure et je peux me tromper. Si une loi organique autorise une liste de moyens techniques, le décret d'application ne peut autoriser un moyen de communication qui ne figurerait pas dans cette liste. En vertu de la hiérarchie des normes, cet amendement est donc bien de nature législative ; de surcroît, si un décret autorisait la propagande par Internet et encourageait l'utilisation de nouvelles technologies, il serait contraire à la loi et pourrait faire l'objet d'un recours en Conseil d'Etat.
Il n'est volontairement pas précisé, dans cet amendement, qui utilise les fameuses nouvelles technologies. Il est bien évident que les partis politiques et les candidats, en particulier les candidats à l'élection présidentielle, seraient alors autorisés à le faire et ne seraient donc plus obligés de passer par l'intermédiaire des consulats, comme c'est le cas actuellement. D'ailleurs, le fait que les candidats à l'élection présidentielle puissent s'adresser directement aux électeurs de l'étranger leur ferait certainement prendre un peu plus conscience de leur existence...
L'article 4 de la Constitution reconnaît aux partis politiques un véritable rôle dans l'épanouissement de la démocratie. J'en rappelle les termes : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. »
Voilà pourquoi je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cet amendement visant à utiliser les nouvelles technologies comme outils de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire.

La commission des partage pleinement le point de vue de M. Yung. Il serait regrettable d'adopter une loi qui ne tienne pas compte de l'évolution tant du monde qui nous entoure que des textes qui nous régissent depuis 1976. C'est clair !
Quand je représentais les Français du Luxembourg, l'un de mes adversaires à l'élection au Conseil supérieur des Français de l'étranger se présentait aux élections européennes qui avaient lieu le même jour, sur une liste luxembourgeoise, et bénéficiait à ce titre de panneaux d'affichage, ce qui m'était à l'époque théoriquement interdit. Cela ne m'a pas empêché d'être élu confortablement !

Même si l'importance de ces questions est souvent théorique, je partage pleinement votre sentiment, monsieur Yung : il convient d'en tenir compte.
Toutefois, il y a deux façons d'appréhender la situation : l'autoriser, mais prévoir des restrictions, ou bien l'interdire, mais envisager des ouvertures. Nous avons intérêt, me semble t-il, à privilégier la seconde approche, qui est plus sûre. En effet, si nous autorisons la propagande électorale à l'étranger, nous devrons engager des négociations avec chaque pays, y compris au sein de l'Union européenne, afin d'en encadrer la pratique.
En revanche, nous sommes dans une situation juridiquement plus confortable si le principe général reste l'interdiction - principe d'égalité dans l'ensemble du monde - sauf dans les pays où la propagande électorale est autorisée et encadrée par des textes de niveau juridique supérieur.
M. Guerry a fort bien fait de rappeler l'arrêt Piermont, par lequel la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg - et non pas, curieusement, la Cour de justice des Communautés européennes de Luxembourg - a jugé que l'on ne pouvait entraver la liberté d'expression politique, pour autant qu'elle ne trouble pas l'ordre public, d'un ressortissant de l'Union européenne. Nous sommes donc obligés d'en tenir compte.
C'est la raison pour laquelle la commission des lois, après en avoir débattu, s'est ralliée à l'amendement de M. Guerry, qui paraît plus fédérateur. Elle vous invite donc, monsieur Yung, à retirer l'amendement n° 18 au bénéfice de l'amendement n° 22 rectifié bis, lequel nous apporte toutes les garanties dans nos relations avec les Etats membres de l'Union européenne et, au-delà, avec les quarante-cinq Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La portée de ce texte est donc supérieure, et sous une forme qui ne peut être contestée puisqu'elle a été ratifiée par ces Etats.
Il serait, en effet, paradoxal que nous refusions un droit que nous invitons par ailleurs les Français à reconnaître en approuvant par référendum le traité établissant une constitution pour l'Europe, d'autant que ce droit figure déjà dans la Charte des droits fondamentaux. Cela étant, les traités de Maastricht et d'Amsterdam reconnaissent la citoyenneté européenne et les droits qui y sont liés. Cette citoyenneté n'est ni un vain mot ni un symbole ; elle est une réalité.
Le sous-amendement n° 24 du Gouvernement, qui vise à rédiger deux alinéas de l'amendement n° 22 rectifié bis, n'a pas été examiné par la commission des lois. Les modifications apportées au second alinéa sont d'ordre rédactionnel. La commission des lois ne m'en voudra pas d'indiquer que je préfère, à titre personnel, un texte plus élégamment rédigé.
En revanche, la rédaction du premier alinéa intéresse directement M. Del Picchia. Il convient de remarquer, en effet, que les mots « sous pli fermé » ne figurent plus, témoignant de la volonté de recourir à d'autres moyens. Or quels sont les autres moyens si ce n'est la voie électronique et Internet ? Finalement, par ce sous-amendement, nous avons un premier témoignage tangible, concret, de l'engagement pris par M. le secrétaire d'Etat tout à l'heure.
Par conséquent, à titre personnel, compte tenu de la position de la commission des lois qui était favorable au principe soutenu par M. Del Picchia dans son amendement, je ne peux qu'approuver le sous-amendement n° 24.
Mme Garriaud-Maylam a posé un problème extrêmement important en matière d'équité. Les Français établis hors de France, puisqu'on leur donne la possibilité de voter, notamment dans les consulats et les postes consulaires, doivent bénéficier des mêmes conditions d'information que les Français de France, ou tout au moins du minimum vital, si je puis m'exprimer ainsi ! Sinon, à quoi bon les inviter à voter ? Nous pouvons donc féliciter Mme Garriaud-Maylam d'avoir déposé ce sous-amendement.
Ce sous-amendement peut-il, en l'état, être suivi d'effet ? C'est une autre question ! La commission des lois en a reconnu le bien-fondé, l'intérêt et la très forte valeur tant symbolique que pratique. C'est la raison pour laquelle elle a donné un avis favorable, sous réserve de l'avis du Gouvernement, dans la mesure où nous ne maîtrisons pas forcément toutes les implications.
Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, nous serions très heureux de connaître votre sentiment, afin de déterminer les suites qu'il convient de réserver à ce sous-amendement au demeurant fort intéressant.
S'agissant de l'amendement n° 21, monsieur Del Picchia, nous approuvons votre démarche, nous estimons que le concours des nouvelles technologies est nécessaire et que le Gouvernement doit donner des instructions très claires à ses services en ce sens. L'obstacle que constituait la mention « sous pli fermé » est levé - si nous adoptons, bien entendu, le sous-amendement n° 24 du Gouvernement.
La commission des lois, qui reconnaît l'intérêt de cet amendement, a cependant remarqué que l'organisation de l'envoi relevait du domaine réglementaire. Voilà pourquoi, monsieur Del Picchia, je vous invite à le retirer, étant entendu que M. le secrétaire d'Etat pourra peut-être vous apporter quelques compléments d'information.
En ce qui concerne l'amendement n° 18, je m'inscris dans la même logique que la commission : il paraît de bon aloi de le retirer, puisque l'amendement n° 22 rectifié bis participe d'une démarche similaire.
Je suis, bien entendu, favorable à cet amendement n° 22 rectifié bis, modifié par le sous-amendement du Gouvernement.
Madame Garriaud-Maylam, le sous-amendement n° 23 rectifié aborde un sujet particulièrement sensible. J'ai bien entendu vos propositions : il est vrai, je l'ai dit lors de la discussion générale, que la discrimination, quelle qu'elle soit, n'est pas acceptable.
M. le rapporteur a émis, sur le principe de ce sous- amendement, un avis favorable ; il est en effet nécessaire d'aller dans ce sens. Néanmoins, mon avis sera plutôt défavorable et je m'explique.
Inciter les Français établis à l'étranger à exercer leur droit de vote est, bien sûr, une ambition que le Gouvernement partage, madame la sénatrice. Toutefois, je ne pense pas que la méthode retenue ici soit la bonne.
D'abord, une telle disposition relève non pas de la loi organique, mais plus normalement des cahiers des charges des sociétés de l'audiovisuel public, par exemple ; elle figure, d'ailleurs, déjà spécifiquement dans le cahier des charges de la société RFI.
Ensuite, ce sous- amendement est trop imprécis. En effet, tel qu'il est rédigé, il s'appliquerait à des sociétés comme l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, dont la mission de service public est d'archiver des programmes et non de les diffuser.
Enfin, toutes les sociétés de l'audiovisuel public ne sont pas diffusées hors de France. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication assigne à chacune de ces sociétés des missions particulières, mais seules certaines d'entre elles sont diffusées à l'étranger. Tels messages sont donc particulièrement pertinents pour RFI ou pour TV5, mais ne le sont pas, par exemple, pour France 3 ou pour France 5.
Les sociétés concernées sont d'ailleurs sensibilisées. Ainsi, dans le cadre du prochain référendum, TV5 a produit et diffusera une campagne d'information civique spécifiquement adressée aux Français de l'étranger - vous l'avez souligné -, financée par le service d'information du Gouvernement. Ce message, qui sera diffusé à compter du 16 mai prochain, rappelle les dates du scrutin et ses modalités. Cela répond donc à votre préoccupation, madame la sénatrice.
Je ne suis donc pas favorable à ce sous-amendement, car, selon moi, il n'a pas sa place dans le projet de loi organique. Je vous demande donc, madame Garriaud-Maylam, de bien vouloir le retirer.
Néanmoins, madame la sénatrice, puisque le Gouvernement et la commission partagent votre préoccupation, je m'engage à rencontrer le ministre chargé de l'audiovisuel afin que nous puissions retravailler avec lui dans le sens que vous proposez.
Quant à l'amendement n° 21, la circulaire du 4 mai 2005, qui a reçu l'avis favorable du Conseil constitutionnel, permet aux ambassades et aux postes consulaires, qui sont responsables des votes, d'adresser aux électeurs, par courrier électronique, des informations relatives, par exemple, aux horaires, aux bureaux de vote, ou de la documentation électorale si le chef de poste estime que la voie postale ne permet pas d'acheminer cette documentation avant la date du scrutin.
En conséquence, cet amendement est déjà satisfait par la voie réglementaire et j'émets donc un avis défavorable.

Non, je le retire, monsieur le président. Je me rends aux arguments de la commission.
Le sous-amendement est adopté.

Madame Garriaud-Maylam, le sous-amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?

Je remercie la commission d'avoir soutenu ce sous-amendement.
Je ne partage pas vraiment la lecture qu'en fait M. le secrétaire d'Etat ; il me le pardonnera, je l'espère.
J'y insiste, il me semble que l'information des Français de l'étranger est très importante. Nous ne devons pas avoir une vision limitative des sociétés d'information. Bien évidement, celles qui ne sont pas destinées à diffuser de l'information ne sont pas concernées. En revanche, de nombreux Français de l'étranger regardent les émissions de France 2 et de France 3. Pour ma part, je les vois très régulièrement en Grande-Bretagne. Une réflexion doit donc être menée.
Quoi qu'il en soit, je prends acte de la volonté manifestée par le Gouvernement de travailler sur ce sujet. Seul le résultat compte, bien évidemment. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me tiens à votre entière disposition pour vous apporter mon concours sur un sujet que je connais bien, et pour revoir éventuellement la formulation de ce sous-amendement qu'en l'instant je retire.
Je compte sur vous, car les Français de l'étranger attendent cette disposition depuis de très nombreuses années. Ils vous seraient extrêmement reconnaissants si elle était mise en oeuvre et je ne manquerai pas de vous rappeler votre engagement.

Le sous-amendement n° 23 rectifié est retiré.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 22 rectifié bis.
L'amendement est adopté.

Monsieur le secrétaire d'Etat, au travers de cet amendement, je demande que les nouvelles technologies soient utilisées comme un outil de communication et d'information. En le présentant, j'ai bien précisé que les candidats passent, pour l'instant, par les consulats, qui transmettent les informations, conformément à la circulaire du 4 mai 2005 que vous avez évoquée.
Telle est la procédure, même si le consulat utilise la voie électronique.
Je veux bien retirer mon amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, mais je suis prêt à prendre les paris pour les prochaines élections présidentielles : pensez-vous réellement que les candidats s'adresseront à chaque consulat et qu'ils ne feront pas eux-mêmes leur campagne sur Internet en envoyant à tous les Français de l'étranger les informations qui les concernent ? Cela s'est déjà vu. Internet est utilisé régulièrement par les partis politiques pour des envois d'informations vers l'étranger.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vois pas quel mal il y aurait à adopter des procédures simplifiées qui, quoi qu'il en soit, sont déjà utilisées !
Je retire mon amendement, mais à regret pour les futurs candidats à la présidence de la République.

L'amendement n° 21 est retiré.
L'amendement n° 11, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du texte proposé par le b) du 2° de cet article pour le second alinéa de l'article 12 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ...
La parole est à M. le rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 5, précédemment adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 12, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 13.- Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration.
Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires. »
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement donne une base juridique véritable au vote par procuration des Français établis hors de France.
En effet, les dispositions de l'article L.71 du code électoral sont peu adaptées aux Français établis hors de France. Il existe d'autres articles, me direz-vous, mais il a semblé préférable à la commission de bien codifier ce point une fois pour toutes.
Par ailleurs, la commission est favorable au sous-amendement n° 19 du Gouvernement, qui vise à aligner ces dispositions sur le droit commun, de sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans l'égalité de traitement. En effet, si nous ne voulons pas de discrimination, l'égalité de traitement, quelles que soient les circonstances, est nécessaire.

Le sous-amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 12 pour l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 12 janvier 1976 par les mots :
lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur a tout dit !
Sourires.
La commission a très bien travaillé, de concert avec le Gouvernement. Nous sommes parfaitement en phase et nous avançons ensemble.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 13, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article 15 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »
La parole est à M. le rapporteur.

Les dispositions prévues par l'article 3 pour le troisième alinéa de l'article 15 de la loi organique de 1976 précisent les modalités des recours ouverts à l'encontre des opérations des commissions chargées de la révision des listes.
Cet amendement tend à supprimer la mention explicite de ces dispositifs, qui ont une valeur réglementaire pour l'élection du Président de la République - article 30 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 - et sont directement issus de la loi référendaire du 6 novembre 1962. Aussi, effectue-t-il un renvoi explicite à cette loi pour harmoniser les recours ouverts aux électeurs et aux candidats de l'élection présidentielle.
Il paraissait, en effet, peu convenable qu'il existe deux dispositifs de recours différents selon que l'on vote en France où à l'étranger, alors qu'il s'agit d'une seule et même élection.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 14, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par le 8° de cet article pour l'article 18 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, supprimer les mots :
Sous réserve des dispositions de la présente loi,
La parole est à M. le rapporteur.

L'article 18 de la loi organique de 1976 prévoit que les dispositions du code électoral auxquelles renvoient les articles précédents de la loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent texte.
Cette précision, qui cristallise le droit applicable afin d'éviter qu'une modification des articles du code électoral visés n'entraîne celle de la loi organique, reprend une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.
Le principe de l'application des dispositions du code électoral sous réserve des dispositions de la loi organique a déjà été posé à l'article 9. Cette mention est donc inutile dans cet article.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 15, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 9° de cet article pour l'article 19 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Art. 19 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi organique. »
La parole est à M. le rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, corollaire des différents amendements qui viennent d'être adoptés.
Il faut un décret, et il n'est nul besoin de développer à ce stade le contenu de ce décret, puisque cela a été fait précédemment.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits de droit sur les listes électorales consulaires :
1° Les électeurs inscrits sur les listes de centre de vote établies en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Ces électeurs sont réputés avoir demandé à participer à l'étranger à l'élection du Président de la République ;
2° Les électeurs inscrits sur les listes établies en application de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

L'amendement n° 16, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
présente loi
insérer le mot :
organique
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
Les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans leur rédaction issue de la présente loi organique s'appliqueront après le premier renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Jusqu'à la date du premier renouvellement partiel, les commissions administratives composées en application de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger sont maintenues pour exercer les compétences de la commission administrative prévue à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans sa rédaction issue de la présente loi organique.

L'amendement n° 17, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans leur rédaction issue de la présente loi organique s'appliqueront après le prochain renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Jusqu'à cette date, les commissions administratives composées en application de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger exercent les compétences des commissions prévues à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans sa rédaction issue de la présente loi organique.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
La présente loi organique entrera en vigueur le 1er janvier 2006. -
Adopté.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 180 :
Nombre de votants307Nombre de suffrages exprimés307Majorité absolue des suffrages exprimés154Pour l'adoption307 Le Sénat a adopté.
Applaudissements

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 306, relatif à l'Assemblée des Français de l'étranger.
L'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur les listes électorales consulaires et le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, remplacer les mots :
sur les listes électorales consulaires et le
par les mots :
relative aux listes électorales consulaires et au
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement rédactionnel vise à faire coïncider la référence de la loi ordinaire et celle de la loi organique, en utilisant le même titre.
Pas d'objection !
L'amendement est adopté.
L'article 1 er est adopté.
Dans l'article 4 de la même loi, après les mots : « listes électorales » est ajouté le mot : « consulaires ». -
Adopté.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Guerry, Mmes Brisepierre et Kammermann, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5 - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés ;
« 2° de l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et, en accord avec l'Etat concerné, dans les bureaux ouverts dans d'autres locaux.
« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »
La parole est à M. Michel Guerry.

Il s'agit d'un amendement de coordination.
L'article 5 de la loi du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ne respecte ni les dispositions actuelles du droit européen ni les traités garantissant les libertés fondamentales.
Par ailleurs, dans un souci d'harmonisation entre la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et la loi du 7 juin 1982, nous proposons que soient transposés dans cette dernière les termes de l'article 11 de la loi organique qui rendent applicables à l'étranger trois articles du code électoral - les articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 - qui réglementent certaines formes de propagande : interdiction de certaines distributions de documents électoraux ou de certaines diffusions, interdiction de recourir à des procédés de publicité commerciale.

Le sous-amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 5 rectifié bis pour l'article 5 de la loi n° 82?471 du 7 juin 1982, rédiger ainsi les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas :
« 1° de l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
« 2° de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'est déjà exprimé lors du débat sur la loi organique.

Le sous-amendement n° 6, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 5 rectifié pour insérer un article additionnel après l'article 3 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle sont tenus de mener une campagne d'information civique à destination des Français établis hors de France afin de leur rappeler les dates et modalités de leur participation aux élections ».
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Le sous-amendement n° 6 est retiré.
L'amendement n° 2, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 5 de la même loi, le mot : « consulats » est remplacé par les mots : « postes consulaires »
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement de coordination deviendra sans objet si, comme je le pense, la Haute assemblée, après avoir adopté l'amendement n° 22 rectifié bis à la loi organique, adopte l'amendement n° 5 rectifié bis de M. Guerry.

L'amendement n° 3, présenté par M. Del Picchia, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles technologies telles que le réseau Internet et les messageries électroniques, sont utilisées comme outil de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve des recommandations de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »
La parole est à M. Robert Del Picchia.

Cet amendement est identique à mon amendement n° 21 au projet de loi organique.
Le parallélisme des formes doit être respecté. La reconnaissance de ce mode de communication passe nécessairement par la voie législative ; il ne saurait être ajouté par la voie réglementaire.
Monsieur le ministre, votre sous-amendement l'a certes précisé. Cependant, il est dommage qu'on en revienne au même point.
Pour autant, mais à regret, je retire mon amendement, ce qui contentera tout le monde !

L'amendement n°3 est retiré.
L'amendement n° 4, présenté par M. Del Picchia, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 5 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des lois des pays d'accueil, la propagande électorale des candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger est autorisée dans les circonscriptions électorales des Etats membres de l'Union européenne. »
La parole est à M. Robert Del Picchia.

Tout à l'heure, lors de la discussion sur mon amendement n° 20 au projet de loi organique, le rapporteur a tenu à rappeler que le président du Conseil constitutionnel nous incitait à simplifier la loi.
L'amendement que nous avons adopté sur ledit texte- amendement que j'ai voté, par esprit de collégialité -, me paraît relativement compliqué. Il y est fait référence à ce qui passe ailleurs. La signification n'en est pas très claire. Une explication assez longue a d'ailleurs été nécessaire pour comprendre ce qui avait été décidé.
Le texte de mon amendement est un peu différent. Il vise à résoudre le problème que j'évoquais tout à l'heure : dans une même circonscription, un candidat au Parlement européen peut recourir à toute forme de propagande, alors même que le candidat à l'Assemblée des Français de l'étranger n'y a pas droit.
Sans doute le rapporteur m'objectera-t-il que le dispositif doit être identique dans les deux lois. Certes, il doit l'être, mais à la condition que, pour les mêmes élections, les deux lois mettent en place un mécanisme parallèle. Or, ce n'est pas le cas. Ainsi, pour les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, les électeurs peuvent voter par Internet, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour l'élection présidentielle. Il n'y a donc pas d'unité dans les opérations de vote.
Dès lors, acceptez, monsieur le secrétaire d'Etat, le vote par Internet pour la présidentielle ! On ne peut pas vouloir que la loi organique et la loi ordinaire prévoient des dispositions communes en matière de propagande, mais s'en abstiennent s'agissant des opérations de vote ! N'oublions pas qu'une élection présidentielle est régie par des lois organiques et que les élections locales ne se déroulent pas de la même manière qu'une élection présidentielle.
Pour respecter le parallélisme, j'ai déposé cet amendement très simple, qui me paraît être de bon sens. Je le retire toutefois, en espérant que chacun aura bien compris quelles étaient mes intentions.

Je me suis déjà exprimé sur un amendement identique à l'amendement n° 5 rectifié bis lors de l'examen du projet de loi organique. Je n'y reviendrai donc pas.
Je veux dire à M. Del Picchia que l'amendement de M. Guerry a une portée beaucoup plus large que le sien. En effet, il couvre l'ensemble des pays adhérant à la Convention européenne des droits de l'homme, tandis que le vôtre, mon cher collègue, limite son objet aux pays de l'Union européenne.
De surcroît, il faut aussi avoir présent à l'esprit que la France ne peut pas légiférer pour les autres Etats.

Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes. Seuls les textes signés par les Etats, à savoir les traités et les conventions, engagent tous les signataires, qui ne peuvent pas revenir sur leur signature.
Certes, il me plairait de dire que tout est autorisé ! Pour autant, cela ne me paraîtrait pas constituer la meilleure solution politique et juridique pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé.
Je remercie en tout cas M. Del Picchia d'avoir retiré son amendement. Il a parfaitement compris que nous partageons les mêmes objectifs et la même analyse ; nous divergeons seulement sur les moyens.
Concernant le sous-amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, je ne peux pas donner un avis favorable au nom de la commission, celle-ci ne s'étant pas prononcée. Cependant, si tel avait été le cas, tout laisse à penser qu'elle l'aurait approuvé.
Il est favorable, bien entendu, à l'amendement n° 5 rectifié bis.
Quant à l'amendement n° 2, il n'aura plus d'objet si, comme je l'espère, l'amendement de M. Guerry, sous-amendé par le Gouvernement, est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3, et l'amendement n° 2 n'a plus d'objet.
Les articles 2 bis, 2 ter, 2 ter-1, 2 ter-2, 2 quater et 2 quinquies de la même loi sont abrogés. -
Adopté.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2006. -
Adopté.

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.

Je tiens à apporter une petite précision à destination de M. le rapporteur. Je ne peux laisser passer l'argument selon lequel il faudrait renégocier avec tous les pays au motif qu'on ne pourrait imposer notre législation. En effet, je précisais bien dans l'amendement que j'ai retiré : « dans le respect des lois des pays d'accueil ». Cette réserve était donc très claire.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation des protocoles d'application de la convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports (nos 245, 318).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, dans les années cinquante, une volonté de protéger les Alpes a commencé à se faire jour. Elle a abouti, en 1988, à une résolution du Parlement européen invitant la Commission à présenter un projet de convention visant à assurer la protection de l'un des écosystèmes les plus importants d'Europe.
En 1989, la première conférence alpine des ministres chargés de l'environnement des Etats alpins, qui a eu lieu à Berchtesgaden, adopta une résolution de principe. Le 7 novembre 1991, une convention-cadre fut signée à Salzbourg par six Etats alpins : l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, le Liechtenstein et la Suisse, ainsi que par la Communauté européenne, constituant l'expression juridique de cette volonté.
Monaco et la Slovénie ont entre-temps également adhéré à la convention.
Après avoir été ratifiée par trois parties - Allemagne, Autriche, Liechtenstein - et ultérieurement par les autres, la convention alpine est entrée en vigueur le 6 mars 1995. Pour sa part, la France l'a ratifiée le 26 février 1996.
Avec l'entrée en vigueur de cette convention, une délimitation précisant l'espace alpin à l'échelle des communes est reconnue pour la première fois par les parties contractantes, y compris par la Communauté européenne. Au total, le champ d'application de la convention couvre une surface de 190 912 kilomètres carrés et englobe 5 971 communes comptant environ 13 millions d'habitants.
La convention alpine est une « convention-cadre » portant sur la protection des Alpes et ayant pour objet l'harmonisation des politiques des parties de manière à concilier les intérêts économiques en jeu dans le massif alpin avec les exigences de protection d'un patrimoine naturel menacé.
Afin de la mettre en oeuvre, la France, sept Etats alpins et la Communauté européenne ont négocié, entre 1994 et 2000, neuf protocoles d'application portant respectivement sur la protection de la nature et l'entretien des paysages, l'aménagement du territoire et le développement durable, le tourisme, les forêts de montagne, l'énergie, la protection des sols, les transports, l'agriculture de montagne et le règlement des différends.
Ces protocoles d'application ne constituent en fait que des instruments d'encadrement de l'action des parties à la convention alpine afin d'éviter qu'un Etat du massif alpin ne fonde son développement économique sur une politique de « moins-disant » écologique.
Toutefois, s'agissant du protocole « transports », la France a souhaité y adjoindre une déclaration visant à préciser les notions de « trafic transalpin, trafic intra-alpin et routes à grand débit », afin de pouvoir aisément déterminer si des projets routiers futurs seront ou non soumis au respect des règles du protocole, en particulier de son article 11.1.
A ce jour, la France n'a ratifié que les protocoles relatifs à l'agriculture de montagne et au règlement des différends par voie administrative.
La France a un intérêt particulier à l'affermissement de cette convention, qui constitue un cadre à la fois souple et renforcé, tout en préservant la souveraineté des Etats. De fait, par ses protocoles, cette convention, qui intègre les nouvelles exigences environnementales, amplifie les résultats de notre propre politique volontaire mise en oeuvre sur la région alpine et protège, sur le long terme, le cadre de vie des populations de l'arc alpin.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les protocoles qui font l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cette convention alpine offre un exemple d'une volonté commune d'assurer le développement durable. Elle constitue un cadre remarquable et original de coopération internationale, au service du développement durable du massif alpin.
Elle définit les principes que tous les Etats alpins - il faut bien le souligner - ont accepté de mettre en oeuvre en vue de préserver et de mettre en valeur l'espace alpin. Elle a créé les structures capables de favoriser l'échange d'informations, la concertation, l'harmonisation des politiques nationales et la conduite d'actions transfrontalières.
Cette convention couvre une vaste zone de près de treize millions d'habitants, répartie sur sept pays. Si le coeur du massif est tourné vers l'Europe continentale, il ne saurait pour nous être question de négliger son importante dimension méditerranéenne, monsieur le secrétaire d'Etat, avec les versants français et italiens des Alpes du Sud et les Alpes slovènes.

J'ajouterai même que cela peut être un élément d'une vraie politique euro-méditerranéenne, associant la Méditerranée au coeur continental.
Les sept protocoles qui sont soumis à notre approbation ont été adoptés entre 1994 et 2000, pour développer de manière plus précise les objectifs généraux de la convention alpine et les mettre en oeuvre dans chacun de ses domaines d'application. Je ne reviendrai pas sur leur contenu, car vous en avez parlé, monsieur le secrétaire d'Etat.
Je me limiterai à souligner que ces protocoles s'inscrivent pleinement dans la philosophie générale de la convention, qui vise à harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques, en considérant le massif alpin dans toutes ses dimensions : espace naturel, cadre de vie, espace économique pour la population qui y habite, voie de communication essentielle pour les régions extra-alpines. Nous sommes au coeur du développement durable.
Certaines dispositions sont communes à tous les protocoles.
Ainsi, chacun d'eux souligne que la population locale - et Dieu sait si c'est important - doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel, économique et de participer à sa mise en oeuvre. Il ne s'agit pas de plaquer des modèles extérieurs émanant de pseudo-intellectuels ; il s'agit de prendre en compte le projet de la population locale.
Un autre élément est commun à tous les protocoles : la coopération transfrontalière et la participation des collectivités territoriales constituent deux obligations fondamentales pour les parties.
Enfin, dans chaque protocole, une disposition-type stipule que les collectivités locales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en oeuvre des politiques qui en découlent, dans le respect de leurs compétences. Il s'agit là, bien entendu, d'un aspect particulièrement important, car il ne peut y avoir de politique de développement durable sans association étroite des acteurs locaux. Le développement durable n'est pas l'affaire d'une petite élite intellectuelle ; cela doit concerner l'ensemble des populations et des collectivités locales, n'est-ce pas, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. le secrétaire d'Etat acquiesce.

Les protocoles relatifs à la protection de la nature et l'entretien des paysages et à la protection des sols sont plus particulièrement axés sur la protection de l'environnement. Ils prévoient le recensement exhaustif des zones ou espèces sensibles et encouragent leur protection, en particulier dans le cadre des espaces protégés, comme les parcs nationaux ou régionaux, les parcs nationaux devant eux-mêmes - et le projet de loi doit le leur permettre - associer bien davantage les populations, surtout dans le cas des parcs nationaux habités.
Le protocole sur l'aménagement du territoire et le développement durable fixe les grandes lignes des politiques à suivre en la matière. Le renforcement de l'action des collectivités territoriales, j'y insiste, conformément au principe de subsidiarité, est mis en exergue. Le protocole reconnaît la légitimité de mesures d'aide spécifiques aux zones de montagne, visant à compenser les handicaps naturels ou les restrictions liées à la protection de l'environnement et à maintenir les activités économiques et les services publics.
Au passage, il convient de rappeler que c'est l'Europe qui a pris la première mesure de protection des sols, à travers l'indemnité spéciale montagne, qui a permis de maintenir des élevages en montagne évitant ainsi la dégradation des sols. A l'heure où l'on discute beaucoup de l'Europe, il est intéressant de le rappeler. Hommage soit rendu à l'Europe !
Les protocoles sur l'exploitation forestière, l'énergie et le tourisme reconnaissent pleinement la contribution de ces activités à l'économie alpine et au maintien de la population locale.
Enfin, le protocole sur les transports a donné lieu à de longues négociations et n'a été adopté qu'en octobre 2000. Les Etats alpins ont reconnu la nécessité d'agir face aux nuisances et à la dégradation de l'environnement engendrées par l'accroissement considérable du trafic transalpin durant les vingt dernières années. Il s'agissait surtout de concilier cet impératif avec le souhait des populations locales de pouvoir bénéficier d'infrastructures de qualité, propices au désenclavement et au maintien de l'activité économique. Par ailleurs, il n'était pas concevable de remettre en cause l'existence même d'un transit international vital pour certains pays, notamment l'Italie.
Le protocole « transports » affirme la priorité à accorder au transport ferroviaire dans les Alpes, ce qui légitime - ô combien ! - le projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin établi par les gouvernements français et italien et qui faisait partie des grands projets retenus par le groupe de travail dirigé par M. Christophersen. Ce projet s'articule d'ailleurs avec la ligne TGV allant jusqu'à Barcelone, qui sera d'actualité le 23 mai prochain.
Parallèlement à la priorité donnée aux transports ferroviaires, le protocole retient également - et vous voyez que l'on retrouve la réalité méditerranéenne - le développement du transport maritime et du cabotage comme alternative au transport terrestre, le renoncement à tout nouveau projet de route à grand débit pour le trafic de transit international, l'encadrement strict des nouveaux projets de routes à grand débit pour le trafic intra-alpin. Enfin, le protocole prévoit l'introduction progressive d'une tarification spécifique permettant de facturer à l'usager l'ensemble des coûts des infrastructures alpines, y compris les coûts externes liés à l'impact environnemental.
La France effectuera une déclaration interprétative visant à tenir compte des projets routiers dont le principe était acquis au moment de la signature du protocole, en octobre 2000, et qu'il reste à réaliser. Protéger l'environnement ne signifie pas pour autant que l'on doit empêcher les circulations ; on doit les maîtriser. C'est vraiment le résultat d'une approche équilibrée entre la protection et le développement.
En conclusion, on peut rappeler que la France dispose déjà, dans sa législation, de tous les instruments lui permettant de mettre en oeuvre la convention alpine et ses protocoles, en particulier la loi « montagne » et les différents textes en matière de protection de l'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
L'adoption de la convention et des protocoles s'est échelonnée sur plus de dix ans. Il importe désormais de donner corps à cette ambition, pour accentuer la protection des Alpes mais également pour répondre aux attentes de la population du massif.
Il faudra pour cela mieux intégrer dans nos politiques les différents objectifs énoncés par les protocoles. Je constate que, dans une large mesure, ces objectifs s'accordent parfaitement avec les propositions formulées voilà trois ans, au Sénat, par la mission d'information sur l'avenir de la montagne que j'ai eu l'honneur de présider et dont le rapporteur était notre ami Jean-Paul Amoudry. Notre rapport s'intitulait : « Un développement équilibré dans un environnement préservé » ; c'est bien ce qui est recherché à travers la mise en place d'une coopération internationale à l'échelle de tout le massif alpin.
Soulignons également que l'Union européenne est partie à la convention alpine. Il est donc nécessaire de prendre en compte, dans les politiques européennes, la spécificité de l'espace alpin comme celle de l'ensemble des zones de montagne.
Je suis de ceux qui espèrent que l'élan qui sera donné à la construction européenne permettra de mettre en oeuvre une politique européenne nouvelle de compensation des handicaps au sein des régions, comme l'Europe avait déjà su le faire dans le cadre de l'objectif 5b, afin de promouvoir une vraie politique d'aménagement du territoire.
Sous réserve de ces observations, la commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, d'approuver le projet de loi autorisant la ratification par la France des sept protocoles d'application de la convention alpine. Nous montrerons par là même qu'il n'y a pas d'opposition entre protection de l'environnement et développement, mais qu'il est au contraire possible de mettre en oeuvre un développement équilibré et respectueux du capital naturel que constitue ce merveilleux massif alpin dans sa dimension méditerranéenne.

Monsieur le président, mes chers collègues, M. le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur ont expliqué l'intérêt écologique de la convention alpine. Or il y a un « hic » : le projet de déclaration que le Gouvernement a pour ambition d'annexer au protocole « transports » de la convention alpine.
Selon ce projet de déclaration, neuf projets d'infrastructures routières seraient exclus de l'article 11 du protocole « transports », parmi lesquels l'axe Grenoble-Sisteron.
Cet article 11 dispose en effet que « les parties contractantes s'abstiennent de construire de nouvelles routes à grand débit pour le trafic transalpin », et encadre strictement la réalisation de projets routiers à grand débit interalpin.
Autrement dit, l'article 11 conditionne strictement la réalisation de nouvelles infrastructures routières dans les vallées alpines pour des raisons écologiques et environnementales qui sous-tendent la convention alpine.
Cependant, soustrait à l'article 11 du protocole « transports », et donc à la convention alpine, l'axe Grenoble-Sisteron échappe aux exigences de protection et de préservation de l'espace alpin. Ce faisant, il semblerait, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous condamniez définitivement toute alternative au « tout autoroutier » pour la réalisation de cette liaison.
En effet, à l'origine, trois possibilités avaient été proposées pour réaliser la liaison Grenoble-Sisteron : un aménagement des deux nationales - option qui avait notre préférence -, un aménagement autoroutier de l'A51 passant à l'est de Gap, et un autre par le col de Lus-la-Croix-Haute.
Lors du comité interministériel d'aménagement et du développement du territoire du 18 décembre 2003, le Gouvernement a retenu la seconde hypothèse. Mais, avec la convention alpine, cette option est fortement compromise, car elle contrevient aux dispositions environnementales qui sont inscrites. Cette déclaration est donc fort avantageuse pour les défenseurs d'un axe autoroutier entre Grenoble et Sisteron.
L'argument avancé consiste à minimiser les impacts du projet autoroutier en soutenant que celui-ci aurait pour seule vocation de relier deux villes entre elles. Certes, c'est le but de n'importe quelle route ! Mais ses auteurs ont omis de préciser qu'il s'agit là d'un axe fort structurant, avec d'importantes incidences écologiques dans un environnement fragile et à préserver.
Enfin, la liaison Grenoble-Sisteron, dans ses versions autoroutières, a bel et bien une fonction transalpine : celle-ci est établie dans le rapport Brossier de 1998. Elle est aussi renforcée par les mesures prises pour améliorer la sécurité et la maîtrise du trafic des poids lourds sous les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus.
L'A51 Grenoble-Sisteron-Aix-en-Provence constituera, avec le projet d'A48 Ambérieu-Bourgoin, un axe nord-sud parallèle à l'axe rhodanien A6-A7. Cet axe desservira, dans sa partie centrale, la haute vallée de la Durance et le col du Montgenèvre. Ainsi, un nouvel accès rapide à Turin s'offrira aux poids lourds provenant soit de la Méditerranée soit du nord de la France et de l'Europe.
L'importance nouvelle ainsi donnée au col du Montgenèvre pour capter les flux de marchandises risque donc de porter atteinte à l'économie globale du projet ferroviaire Lyon-Turin, pourtant reconnu comme prioritaire par la France et par l'Union européenne.
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous éclairiez le Sénat sur vos intentions à l'égard de ce projet de déclaration qui, s'il est adjoint au protocole « transports », entraînera une rotation non écologique et non conforme à la convention, à cause de cette liaison Grenoble-Sisteron.
A cette question d'un élu parisien, le modeste élu de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur va essayer de répondre avec le plus de précision possible. !

Même parisien, un sénateur a le téléphone et le courrier électronique !
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Nous avons l'habitude de ce débat : ce n'est plus une liaison routière ou autoroutière, c'est un serpent de mer !
Sourires
Les gouvernements se sont succédé au fil du temps, ainsi que les ministres chargés des transports de différentes sensibilités, du parti communiste à l'UMP, et la démarche consistant à désenclaver cette partie du territoire tout en respectant l'environnement a été systématiquement bloquée.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères, le gouvernement français envisage effectivement de déposer, parallèlement à l'instrument de ratification du protocole « transports », une déclaration visant à préciser la portée de certaines dispositions de ce texte.
Cette déclaration ne fait que confirmer les projets décidés par le Gouvernement dès 1992 dans le cadre du schéma directeur routier national, excluant de ce fait du champ du protocole six projets routiers, dont celui qui est destiné à relier Grenoble à Sisteron.
S'agissant des routes nouvelles non expressément visées par la déclaration, celles-ci relèveront des dispositions du protocole « transports », dès lors que leur tracé se situe de façon substantielle dans la zone alpine, à moins que le projet routier en cause vise à permettre le contournement d'une agglomération ou d'une conurbation, tel que celui qui est prévu pour la région de Nice. En ce cas, la déclaration française précisera que la réalisation de tels projets est possible compte tenu des impératifs prévus par le protocole, notamment celui qui tend à assurer une meilleure sécurité des transports.
S'agissant de l'A51, la Commission nationale du débat public a été saisie le 4 mai 2004 du projet de liaison entre Grenoble et Sisteron.
Le 2 juin 2004, cette commission a décidé d'organiser un débat public et d'en confier l'animation à une présidée par Daniel Ruez. Le dossier du débat a été transmis le 10 mars 2005 à la commission nationale du débat public par le ministre de l'équipement. Le débat se déroulera du 7 juin au 26 juillet et du 23 août au 20 octobre 2005, et portera sur l'ensemble des parties de l'aménagement envisageable, l'aménagement des routes existantes, ainsi que sur les solutions autoroutières passant par Lus-la-Croix-Haute et par l'est de Gap.
A l'issue du débat, le ministre de l'équipement décidera des suites à donner à ce projet.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, fait à Chambéry le 20 décembre 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi.
L'article 1er est adopté.
Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement durable, fait à Chambéry le 20 décembre 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi. -
Adopté.
Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine des forêts de montagne, fait à Brdo le 27 février 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. -
Adopté.
Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l'énergie, fait à Bled le 16 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. -
Adopté.
Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine du tourisme, fait à Bled le 16 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. -
Adopté.
Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols, fait à Bled le 16 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. -
Adopté.
Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine des transports, fait à Lucerne le 31 octobre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. -
Adopté.

Monsieur le président, je vous prie de bien vouloir m'excuser d'être intervenu un peu vivement tout à l'heure.
Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, il n'est pas sérieux de dire qu'un sénateur parisien ne peut pas intervenir à propos de l'ensemble de l'infrastructure routière française.

C'est ce que j'avais cru comprendre. Il est tout de même normal qu'un membre de cette assemblée puisse intervenir sur un sujet concernant un point quelconque du territoire.
Cela étant dit, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne m'avez pas répondu. Vous avez déclaré qu'il fallait désenclaver tout en respectant l'environnement. Quant à M. le rapporteur, il a souligné tout à l'heure qu'il fallait développer l'économie tout en préservant l'environnement.
On peut prévoir toutes sortes de mesures, mais tout est affaire de proportions : la répartition sera-t-elle de 10 % pour la préservation de l'environnement et de 90 % pour l'économie, ou le contraire, ou optera-t-on pour un partage à égalité ?
Dans le cas présent, la convention était bonne. Or l'axe Sisteron-Grenoble risque de mettre à mal la liaison ferroviaire, ce qui signifie qu'il y aura toujours un trafic de poids lourds pour transporter des marchandises, ce qui est grave pour l'environnement.
Il faut donc trouver une autre solution pour cet axe et développer absolument le chemin de fer, car c'est le moyen de transport le plus écologique et le plus respectueux de l'environnement ; il importe d'ailleurs de développer le chemin de fer tant en France qu'en Europe.
Monsieur le secrétaire d'Etat, j'aimerais que vous me répondiez sur ce point.
Je ne voulais pas vous blesser, monsieur Desessard. Ce n'est pas parce que vous êtes parisien que vous ne connaissez pas les Alpes !
Le hasard de la vie fait que je défends devant vous cette convention internationale. Mais je suis aussi premier adjoint au maire de Marseille et tête de liste régionale en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ayant participé à ce débat tout au long de ma dernière campagne électorale, je connais donc parfaitement ce dossier, même si, en l'occurrence, je change de casquette.
Cette région est bénie des dieux. Pour autant, le département des Hautes-Alpes est le plus petit département de France en nombre d'habitants.
D'autre part, savez-vous que, pour faire le parcours entre Marseille et Briançon, il faut cinq heures en voiture ?
Quant au développement ferroviaire, rien n'a été fait en ce domaine. Ainsi, les lignes TER, qui devaient être démultipliées, ne l'ont jamais été. Mais c'est un autre débat.
En réalité, le passage sur cet axe pose un vrai problème au niveau des ponts : soit on décharge l'axe rhodanien par la route et le rail, soit on trouve des moyens complémentaires pour désengorger l'ensemble des Alpes et créer un passage vers Grenoble et l'Italie. Le passage routier ou autoroutier présente quand même des avantages énormes pour cette partie des Alpes, sans pour autant dénaturer l'environnement.
J'ajoute que, sur la route, en cas d'afflux de voitures et de camions, la pollution et les embouteillages sont bien réels ! Telle est la réalité sur le terrain.
La création de cet axe n'est d'ailleurs pas incompatible avec le développement des axes ferroviaires déjà existants, même si des études doivent être menées.
Il ne s'agit donc pas de choisir entre le « tout environnement », le « tout voiture » ou le « tout rail ». Il existe, d'une part, une mécanique de développement d'un espace public, d'un espace urbain et, d'autre part, un massif montagneux qu'il nous faut préserver et auquel nous sommes tous attachés, vous comme moi, quelles que soient nos origines. Nous voulons, comme vous, protéger cet environnement, qui est essentiel, mais il faut aussi faire en sorte d'éviter la thrombose permanente.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe) (n° 46).
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est principalement assurée par la convention de Bonn du 23 juin 1979, instrument-cadre offrant aux Etats signataires la possibilité de conclure des accords plus spécifiques concernant une aire géographique ou des espèces dont le statut de conservation paraît défavorable ou menacé.
C'est à ce titre qu'ont été négociés des accords consacrés aux petits cétacés de la Méditerranée et de ses mers adjacentes, d'une part, et de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord, de l'autre.
Un premier accord est entré en vigueur à l'égard de la France le 1er juin dernier, alors que le deuxième, objet de la présente convention, ne pouvait recueillir notre adhésion que depuis 2003, année où il a été décidé par la conférence des parties d'étendre son champ d'application géographique de la mer Baltique et du Nord à l'Atlantique du Nord-Est jusqu'à Gibraltar, incluant ainsi l'ensemble de la côte atlantique française, qui abrite un riche habitat de cétacés de toutes tailles.
Le préambule de l'accord fait référence à l'appendice II de la convention de Bonn de 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui inclut les petits cétacés de la Baltique et de la mer du Nord parmi les espèces strictement protégées.
Les parties s'engagent en conséquence à coopérer en vue de préserver et de restaurer l'état de conservation favorable pour ces petits mammifères marins, en établissant un plan de gestion opérationnel qui, bien que figurant en annexe, constitue l'élément central de ce texte.
Les dispositions les plus importantes de ce plan portent sur les points suivants : la réalisation de travaux visant à la prévention des rejets de substances constituant une menace pour les animaux, la mise au point de modification d'engins et de méthodes de pêche afin de réduire les prises accessoires et de prévenir l'abandon en mer d'engins de pêche, la prévention d'autres perturbations significatives, de nature acoustique, par exemple, la réalisation d'une évaluation de l'état et des mouvements saisonniers des populations de petits cétacés, la localisation des zones importantes pour la survie de ces espèces, le recensement des captures accessoires et des échouages et la constitution d'une base de données internationale, l'incitation à interdire la capture et la mise à mort intentionnelle ainsi qu'à rendre obligatoire le relâcher des animaux capturés vivants et en bonne santé, l'information et la sensibilisation du public, notamment des pêcheurs.
Il appartient à chaque partie de désigner une autorité nationale de coordination faisant fonction de point de contact pour les travaux du secrétariat et du comité consultatif. Pour la France, l'autorité de coordination sera le ministère de l'écologie et du développement durable.
A ce jour, huit Etats sont parties à l'accord : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède. La Communauté européenne a signé l'accord, mais ne l'a pas ratifié.
Les amendements de 2003, en élargissant le champ géographique de l'accord de 1992, devraient inciter, outre la France, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal à adhérer.
L'approche de coopération régionale en matière de conservation des petits cétacés est intéressante, et la France, qui contribue, dans toutes les instances traitant des cétacés, à promouvoir une politique de conservation de ces espèces, ne peut donc qu'approuver un tel accord.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le président, mes chers collègues, l'accord du 23 août 2003 étend le régime de protection des petits cétacés, c'est-à-dire des dauphins et des marsouins, à la zone de l'Atlantique du nord-est, alors que cette protection était antérieurement limitée aux mers Baltique et du Nord, par un accord adopté à New York, en 1992.
La France, qui n'était que marginalement intéressée à la protection de ces espèces tant qu'elle était limitée aux mers Baltique et du Nord, est désormais impliquée pour l'ensemble de sa façade atlantique, et a donc décidé d'adhérer, à titre de membre à part entière, à la convention de 1992 ainsi modifiée.
Il faut relever que la ratification de ce texte par notre pays ne conduira pas à renforcer, pour les zones côtières françaises, le régime de protection des mammifères marins, déjà assuré par les dispositions adéquates du code de l'environnement.
Si cet accord ne comporte pas de dispositions contraignantes supplémentaires, il met en oeuvre un programme d'observation des décisions déjà prises pour réduire les captures accidentelles.
Un premier programme SCANS, Small cetaceans of the north sea, engagé en 1994, a permis l'observation des populations de petits cétacés dans la mer du Nord.
Le programme SCANS II, qui se déroulera de début 2005 à fin 2006, élargit ses actions avec une campagne de recensement prévue pour l'été 2005.
Notre pays va donc s'impliquer plus fortement dans les actions de recensement et de protection des petits cétacés, dont la mortalité croissante réside, non seulement dans les pollutions qui affectent les eaux de mer, mais également dans les prises accidentelles au cours d'actions de pêche.
Ces recensements sont indispensables à une meilleure connaissance des raisons du taux croissant de mortalité affectant les petits cétacés dans toutes les zones maritimes européennes.
Il faut souligner que la France n'a pas une politique scientifique, de suivi et de conservation relative aux mammifères marins, et particulièrement aux cétacés, à la hauteur de celle des autres pays européens, notamment ceux d'Europe du Nord, ni en proportion de son linéaire de côtes.
Il reste donc de nombreux efforts à effectuer pour évaluer les populations de petits cétacés, puis adopter les dispositions de nature à mieux les protéger.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose donc, mes chers collègues, d'adopter le présent texte, car il contribue de façon significative à cet effort.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Est autorisée l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le 17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. Jean Desessard. Je voterai cette convention. Je ne suis pas intervenu jusqu'à présent de crainte de m'entendre dire par M. le secrétaire d'Etat qu'un Marseillais connaît mieux la question des cétacés qu'un Parisien...
Sourires.

Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, pour remonter jusqu'à la mer Baltique, il vous faudrait une certaine santé... Pour faire de même, en partant de Paris, nous n'avons que la Seine, où nous n'avons même pas le droit de nous baigner.

M. le président. Mais certains cétacés remontent parfois la Seine ! Vous avez donc tout à fait la possibilité d'intervenir, et ce de façon encore plus raisonnable que tout à l'heure.
Nouveaux sourires
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la discussion :
-du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord international sur la Meuse (nos 85, 298) ;
-et du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut (nos 86, 298).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'adoption de la directive européenne établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, adoptée le 23 octobre 2000, a conduit à renégocier les deux accords internationaux sur l'Escaut et la Meuse, signés le 26 avril 1994 à Charleville-Mézières.
Cette directive constitue, en effet, le fondement de la politique de gestion de l'eau de tous les Etats membres de l'Union européenne. Se référant aux principes de précaution, de prévention, de lutte pour la sauvegarde de l'environnement, ainsi qu'au principe pollueur-payeur, désormais classique dans le droit international à l'environnement depuis le Sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992, elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux de surface et souterraines.
II convenait donc d'en intégrer les dispositions pertinentes dans ces deux nouveaux accords signés à Gand, le 3 décembre 2002.
Parmi celles-ci, on retiendra particulièrement le principe général de bon état de toutes les eaux en 2015, qu'elles soient de surface, souterraines ou côtières, l'établissement entre pays riverains d'un plan de gestion unique, ainsi que l'obligation de consultation du public sur l'élaboration de ce plan, l'amélioration de la prévention et de la lutte contre les inondations, et, enfin, la coordination des mesures de prévention et la lutte contre les pollutions accidentelles.
L'objectif de ces deux accords est donc de renforcer la coopération, déjà bien établie, entre les pays riverains, à partir de normes plus contraignantes, pour parvenir à une gestion durable et intégrée des districts hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse.
L'accord international de l'Escaut a été signé par les six gouvernements des Etats et régions suivants : France, Belgique, région de Bruxelles-capitale, région flamande, région wallonne et Pays-Bas.
L'accord international de la Meuse a été signé par les huit gouvernements des Etats et régions de Belgique suivants : Allemagne, France, Belgique, région de Bruxelles-capitale, région flamande, région wallonne, Luxembourg et Pays-Bas.
Leur mise en oeuvre ne nécessitera pas de modifier le droit français, du fait de la transposition déjà effectuée de la directive européenne sur l'eau et de la convention d'Aarhus.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les accords qui font l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Meuse et l'Escaut sont des fleuves internationaux dont la protection en matière de pollution a fait l'objet de deux accords signés à Charleville-Mézières en 1994.
Ces textes instauraient, pour chacun des fleuves, une commission internationale chargée de délimiter leur bassin versant et d'en développer la gestion coordonnée entre les Etats où sont situés ces bassins transfrontaliers. Cette coopération s'est d'ailleurs très rapidement et largement développée.
Cependant, l'adoption par l'Union européenne, en octobre 2000, d'une directive établissant un cadre général à la politique de l'eau a conduit à en intégrer le contenu en matière de gestion de ces fleuves.
Les deux accords, signés à Gand le 3 décembre 2002, tirent donc les conséquences de ces nouvelles normes pour la gestion des eaux de la Meuse et de l'Escaut.
L'accord sur la Meuse réunit la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et les trois régions belges de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles-capitale.
La Meuse est un fleuve international long de 950 kilomètres, qui prend sa source en France, sur le plateau de Langres, et se jette dans la mer du Nord. Son bassin versant comporte de nombreuses industries, principalement dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'industrie lourde et de la chimie.
Au total, la Meuse constitue une source importante d'approvisionnement, non seulement en eau potable, mais aussi en eau à usage industriel, pour plus de 6 millions de personnes.
La qualité de ses eaux est évaluée à « globalement moyenne ». Pour l'améliorer, plusieurs sources de pollutions doivent être réduites, d'origine tant agricole qu'industrielle.
La pollution des nappes souterraines par les nitrates, les sulfates et les chlorures, qui découlent des industries potassiques en Alsace, doit notamment être réduite. La politique de réduction des phosphates dans les lessives, dont le ministre de l'environnement, M. Serge Lepeltier, a fixé l'échéance en France à 2007, contribuera à l'action de cette dernière en ce domaine.
Quant à l'Escaut, qui coule de Cambrai à Anvers sur une longueur de 430 kilomètres, elle concerne une population de plus de 10 millions d'habitants, située dans l'une des zones les plus denses de l'Union européenne, avec 500 habitants au kilomètre carré.
Les principales pollutions sont les mêmes que celles qui touchent la Meuse.
Les accords de Gand instaurent deux commissions internationales chargées chacune d'élaborer un programme d'actions pour ces fleuves.
L'accord sur l'Escaut réunit six participants : la France, la Belgique, et les trois régions belges déjà citées.
Les objectifs de ces accords sont communs : ils visent à établir une gestion durable des deux bassins hydrographiques. Les signataires doivent coopérer dans ce but, et améliorer la prévention et la lutte contre les inondations et contre les pollutions accidentelles. Ces actions se fonderont sur le principe du pollueur-payeur.
Les accords prennent également en compte les dispositions de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus, au Danemark, par trente-neuf Etats, qui vise à une très large diffusion en direction des opinions publiques des informations en matière d'environnement.
Ces textes prennent en compte l'ensemble des aspects nécessaires à une gestion responsable de ces deux fleuves. C'est pourquoi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous en propose l'adoption, mes chers collègues.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 85 autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut :
Est autorisée l'approbation de l'accord international sur la Meuse (ensemble une annexe), fait à Gand le 3 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

A en croire M. le rapporteur, le principe pollueur-payeur s'appliquerait. Mais, dans la loi sur l'eau, dont nous avons longuement discuté, il est une catégorie qui échappe à ce principe : je veux parler de la pollution par les nitrates.
Faut-il comprendre qu'une disposition supplémentaire par rapport à la loi sur l'eau permettrait de pénaliser les personnes qui polluent en utilisant des produits agricoles ? Y-a-t-il des dispositions complémentaires ou la loi sur l'eau s'applique-t-elle tout simplement ?
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. C'est un long fleuve tranquille !
Sourires

Je suis persuadé, monsieur Desessard, que vous serez rasséréné par ces explications. (Nouveaux sourires.)
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité

Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 86 autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut.
Est autorisée l'approbation de l'accord international sur l'Escaut (ensemble une annexe), fait à Gand le 3 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (nos 124, 232).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, la mondialisation ne se fera au bénéfice de tous que si elle est régulée.
Soucieuse d'encadrer les flux économiques dont elle est destinataire, la France cherche dans ce contexte à fournir un cadre simple, clair et protecteur à ses investissements à l'étranger.
Hors des pays de l'OCDE, nous souscrivons, pour ce faire, comme vous le savez, des accords d'encouragement et de protection des investissements. C'est un tel accord, conclu le 24 février 2004 avec le royaume de Bahreïn, qui est aujourd'hui soumis à votre examen.
Quatre-vingt-six autres accords de ce type sont en vigueur. Vous en avez autorisé l'approbation ; vous en connaissez bien les principales dispositions.
Rappelons-les rapidement : tout d'abord, l'accord garantit nos entreprises contre le risque politique. Il interdit toute expropriation arbitraire et assure une indemnisation prompte et adéquate de toute dépossession. Les investisseurs français auront également, à compter de l'entrée en vigueur du texte, la faculté d'être assurés par la COFACE, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Ensuite, l'accord comporte la clause de traitement de la nation la plus favorisée et la clause de traitement national, gages d'une compétition économique équitable.
Le texte comprend, en outre, la clause de libre transfert, essentielle pour que les entreprises françaises actives à Bahreïn tirent les bénéfices de leur implantation.
Enfin, cet accord avec Bahreïn ouvre des voies de recours juridique, y compris devant l'arbitrage international, aux investisseurs français dans l'hypothèse d'un éventuel différend avec le pays d'accueil de leur investissement.
J'évoquerai brièvement notre partenaire dans cet accord, le royaume de Bahreïn, avec lequel la France entretient, comme vous le savez, des relations cordiales et confiantes.
Nous soutenons la politique menée par le Roi pour promouvoir les réformes politiques dans le pays, qui ont valeur d'exemple pour la région, qu'il s'agisse de l'organisation des élections, ou de l'octroi du droit de vote aux femmes.
L'économie bahreïnienne s'est considérablement modernisée et diversifiée au cours des trente dernières années. Les hydrocarbures ne représentent plus que le quart du PIB : l'aluminium, les activités touristiques et les services financiers ont une importance majeure dans l'économie nationale. Manama, la capitale, est aujourd'hui la première place financière du Golfe, devant Dubaï.
Par l'approbation de cet accord entre nos deux pays, c'est avec confiance que nous engageons les entreprises françaises à poursuivre leur implantation et à tirer profit du développement économique du pays et de la région.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les observations qu'appelle de ma part l'accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements avec le Royaume de Bahreïn, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « Al Bahrayn » signifie en arabe « les deux mers », ce qui s'explique par l'insularité du pays et par sa nappe d'eau souterraine.
Il convient essentiellement de définir le délicat contexte géopolitique dans lequel se situe Bahreïn. Petit royaume du Golfe dépourvu de richesses pétrolières importantes et dépendant financièrement de l'Arabie saoudite, Bahreïn a dû conclure une alliance stratégique avec les Etats-Unis afin d'assurer sa sécurité.
La sécurité de Bahreïn repose entre les mains des Etats-Unis, avec lesquels un accord de coopération en matière de défense a été conclu en octobre 1991.
L'archipel accueille le quartier général de la cinquième flotte et la composante navale du commandement central américain qui couvre l'est de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'océan Indien, ainsi que le siège de la coalition navale Enduring Freedom, instituée après le 11 septembre 2001 pour assurer la lutte contre le terrorisme, à laquelle participe la France.
Toutefois les liens de Bahreïn avec son voisin géographique l'Arabie saoudite sont très forts. La production locale de pétrole de Bahreïn ne s'élève plus qu'à 34 000 barils par jour. La compensation économique est fournie par l'Arabie saoudite qui cède au prix de l'extraction la production du champ pétrolier d'Abou Safaa, soit 140 000 barils par jour, à Bahreïn qui la revend au prix du marché, le bénéfice étant directement versé au budget de ce dernier Etat.
Cependant, depuis l'été 2004, l'Arabie saoudite a réduit ses cessions de pétrole brut à Bahreïn, indiquant que la forte hausse des prix compensait la diminution en volume.
Cette attitude, qui souligne la dépendance financière de Bahreïn par rapport à l'Arabie saoudite, s'explique peut-être aussi par la volonté de Riyad de faire pression sur Bahreïn afin que cet état contrôle plus fermement l'opposition chiite qui s'y développe.
Il convient d'ajouter que les autorités bahreïniennes sont très inquiètes du contexte d'insécurité en Arabie saoudite, situation qui va se détériorant, de l'éventuelle menace que cela constitue pour la stabilité de l'archipel et des conséquences néfastes que cela pourrait avoir pour la confiance des investisseurs à l'égard du pôle bancaire régional que Bahreïn souhaite être.
Sa situation au sein du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe est également complexe : Bahreïn n'est pas pourvu, comme les autres Etats arabes du Golfe, de ressources pétrolières ou gazières et espère donc qu'un renforcement de l'intégration au sein du Conseil de coopération des Etats du Golfe, le CCEAG, permettra à son économie, fondée sur les services, d'en tirer profit.
Là encore pourtant, Bahreïn est en position délicate car, si ses relations avec le Qatar se sont améliorées, si les liens avec le Koweït et les Emirats arabes unis sont très étroits, sa dépendance financière à l'égard de l'Arabie saoudite le contraint néanmoins souvent à s'aligner sur les positions saoudiennes au sein du CCEAG, ce qui limite singulièrement sa liberté d'action.
La situation économique de Bahreïn est relativement satisfaisante. Les acquis de l'année 2003 et les estimations disponibles pour l'année 2004 permettent d'affirmer que, malgré la fragilité du contexte sécuritaire en Arabie saoudite évoquée plus haut, l'économie de Bahreïn se porte relativement bien.
La bonne tenue et l'engagement du royaume à poursuivre les réformes économiques et institutionnelles attendues par les Bahreïniens n'ont pas échappé aux grandes agences de notations, qui ont revu à la hausse leur notation sur Bahreïn.
Les échanges commerciaux franco-bahreïniens pourraient être intensifiés.
L'accord relatif à la protection des investissements contient des clauses classiques.
Les autorités de Bahreïn ont souhaité que les entreprises françaises puissent s'impliquer davantage dans leur économie, en particulier par le biais de coentreprises, ou joint ventures, dans les domaines d'expertise.
Or, en l'absence d'un cadre multilatéral de protection des investissements internationaux, la protection juridique des investisseurs français à l'étranger, en dehors des pays de l'OCDE, repose généralement sur des accords bilatéraux de ce type.
Le marché bahreïnien présente de réelles opportunités pour l'offre française : on peut citer la réalisation de la centrale électrique HIDD, du Bahreïn financial Harbourg, du projet de pont reliant Bahreïn au Qatar, de la construction d'un monorail et de l'acquisition de dix-huit Airbus A318.
Il est essentiel que les entreprises françaises aient l'opportunité d'investir dans ces divers projets en toute sécurité, afin de ne pas être outre mesure concurrencées par les initiatives des pays arabes du Golfe, dont une partie des capitaux, habituellement investis sur les marchés occidentaux, est maintenant attirée par Bahreïn.
En conclusion, l'accord entre la France et le royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé le 24 février 2004 offre incontestablement un cadre juridique stable et satisfaisant pour les contrats que pourraient conclure les entreprises françaises.
C'est pourquoi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 24 février 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Le protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées complète la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 en définissant les règles applicables au transfert des personnes condamnées à une peine privative de liberté dans deux cas : soit lorsque ces personnes se sont enfuies de l'Etat de condamnation afin de se soustraire à l'exécution de leur peine, en se réfugiant dans l'Etat dont elles sont ressortissantes, soit lorsqu'elles font l'objet d'une mesure d'expulsion ou de toute mesure d'interdiction du territoire impliquant leur reconduite à la frontière en raison de leur condamnation.
En effet, la convention de 1983 n'est pas applicable lorsque la personne condamnée ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat de condamnation.
En outre, elle ne permet pas le transfèrement d'un condamné sans son consentement, même lorsque celui-ci doit, à l'issue de sa peine, être expulsé ou reconduit à la frontière.
Le protocole additionnel permet de pallier ces carences en instaurant un régime spécifique reposant principalement sur la suppression de l'exigence du consentement de la personne condamnée.
Dans le premier cas, il complète la convention en permettant la reprise de l'exécution de la peine, alors même que la personne condamnée ne se trouve plus sur le territoire de l'Etat de condamnation.
Dans le second cas, il permet le transfèrement du condamné, même en l'absence de consentement de l'intéressé. Cette dispense du consentement se justifie par le fait que la personne condamnée ne pourra pas, en tout état de cause, se maintenir sur le territoire de l'Etat de condamnation au terme de l'exécution de sa peine.
Cependant, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de la personne condamnée, le protocole prévoit deux garanties : d'une part, son avis devra être recueilli et communiqué à l'Etat d'exécution ; d'autre part, sauf dans quelques cas exceptionnels, l'intéressé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement.
Sous réserve de ces spécificités, le protocole additionnel ne modifie pas fondamentalement le régime juridique applicable au transfèrement des personnes condamnées.
Les autres conditions de fond et de forme énoncées par la convention du 21 mars 1983 demeurent applicables.
Le protocole n'impose pas l'obligation, pour l'Etat d'exécution, de faire droit à la demande de l'Etat de condamnation : il autorise une appréciation au cas par cas des demandes présentées, permettant ainsi une prise en considération de la qualité des systèmes pénitentiaires vers lesquels seront susceptibles d'être transférés des détenus étrangers.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées est le principal instrument international en la matière.
Avec la signature de la Russie le mois dernier, elle regroupe désormais quarante-cinq des quarante-six pays membres du Conseil de l'Europe, le seul Etat non signataire étant Monaco, tout récent membre de l'organisation.
Cette convention pose les principes régissant le transfèrement des personnes condamnées, notamment celui du consentement des deux Etats concernés - l'Etat où la condamnation a été prononcée et l'Etat où la peine sera exécutée - mais aussi du consentement du condamné.
Le protocole que nous examinons aujourd'hui a été adopté le 18 décembre 1997. Il a été élaboré pour résoudre certaines difficultés d'application de la convention du Conseil de l'Europe.
Il s'agit de permettre le transfèrement dans deux cas particuliers : le premier cas est celui des personnes évadées qui regagnent leur pays d'origine, le second est celui des condamnés frappés d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière.
En ce qui concerne le cas des personnes évadées qui ont rejoint leur pays d'origine, l'article 2 du protocole permet à l'Etat de condamnation de demander à l'autre Etat de prendre des mesures conservatoires, telles que leur arrestation ou toute autre mesure propre à garantir qu'elles demeurent sur son territoire, dans l'attente d'une décision.
L'article 3 du protocole concerne les personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière. Il vise à éviter leur maintien dans l'Etat de condamnation alors qu'elles ne pourront y rester une fois la peine purgée.
Par dérogation au principe habituel en matière de transfèrement, le consentement du condamné n'est pas nécessaire, mais la procédure n'est possible que sous certaines conditions. Elle ne peut être lancée qu'après l'épuisement de toutes les voies de recours contre la mesure d'expulsion. L'avis de l'intéressé est formellement requis et les deux Etats doivent s'accorder sur le transfèrement lui-même.
En conclusion, il apparaît que le protocole présente un intérêt pratique évident car les cas visés ne sont pas exceptionnels et ne peuvent pas véritablement être traités de manière simple avec les instruments habituels de la coopération judiciaire.
Pour cette raison, la commission vous demande d'adopter le projet de loi autorisant l'approbation d'un texte déjà signé, je le rappelle, par trente-trois Etats membres du Conseil de l'Europe, dont vingt-cinq ont achevé les procédures de ratification.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 24 février 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Le projet de loi est adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention portant la création d'un office européen de police - convention Europol - et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (nos 247, 320).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est le traité de Maastricht qui, le premier, a prévu la création d'un office européen de police.
Cet office a vu le jour en janvier 1994. Ses activités étaient alors limitées à la lutte contre la drogue.
Aujourd'hui le champ d'action d'Europol couvre plus d'une vingtaine d'infractions, tels le terrorisme, les homicides volontaires, le trafic d'armes ou encore la criminalité informatique et la criminalité contre l'environnement.
L'objectif d'Europol est d'améliorer l'efficacité des services répressifs des Etats membres et leur coopération aux fins de prévention et de lutte contre les formes graves de criminalité, dans la mesure où deux Etats membres au moins sont concernés et qu'une organisation criminelle est impliquée.
Le traité d'Amsterdam, dans son titre VI, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, a identifié un certain nombre de mesures visant à encourager la coopération par l'intermédiaire d'Europol.
Parmi ces mesures figure un rôle de facilitation et de participation à titre d'appui à des actions opérationnelles d'équipes conjointes. Le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 a par la suite confirmé cette orientation.
De même, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000 a également prévu des dispositions relatives aux équipes communes d'enquête, créées pour traiter d'affaires pénales concernant au moins deux Etats membres, le cas échéant avec la participation d'agents d'Europol.
Enfin, des dispositions relatives aux équipes communes d'enquête ont été reprises dans une décision-cadre, dans le but d'accélérer leur mise en oeuvre, d'application pour notre pays depuis le mois de mars 2004.
La France est le premier Etat membre à l'avoir mis en oeuvre, conjointement avec l'Espagne, à travers la constitution d'une équipe commune franco-espagnole sur le terrorisme basque.
Malgré ces dispositifs, une révision de la convention portant création de l'office était nécessaire pour fonder sa capacité au regard des équipes communes d'enquête.
Fruit d'une initiative française, un protocole modifiant la convention Europol dans ce sens a donc été signé le 28 novembre 2002 à Bruxelles. Il permet notamment à Europol, d'une part, de participer à titre d'appui aux équipes communes d'enquête et, d'autre part, de demander aux autorités des Etats membres concernés de mener ou de coordonner de telles enquêtes.
Ce protocole précise les modalités de participation des agents d'Europol à ces équipes. Soumis au droit interne de l'Etat membre d'intervention, ces agents ne peuvent participer à l'exécution de mesures coercitives.
Les modalités de cette participation sont précisées dans des arrangements conclus de façon ad hoc entre le directeur d'Europol et les autorités des Etats membres concernés, sur la base de règles générales arrêtées par le conseil d'administration de l'office.
Le protocole précise également les conditions de transmission et d'utilisation des informations dans le cadre de ces équipes communes d'enquête, les règles de procédure, ainsi que le régime de responsabilité applicable en cas de dommage causé par un agent d'Europol participant à une équipe commune d'enquête.
En résumé, ce protocole devrait contribuer à renforcer le rôle opérationnel d'Europol au service de la coopération policière en Europe.
C'est pourquoi le Conseil européen, dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée au lendemain des attentats de Madrid, a souligné l'urgence de l'entrée en vigueur de ce protocole.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole du 28 novembre 2002 modifiant la convention portant création d'un office européen de police et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents.
Comprenant des dispositions de nature législative, ce protocole est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, prévu dès le traité de Maastricht, l'office européen de police a pris un caractère réellement opérationnel avec l'entrée en vigueur de la convention Europol, le 1er octobre 1998.
Europol s'est en effet vu attribuer des compétences spécifiques, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, les homicides volontaires, le trafic d'armes et la criminalité informatique.
Le présent texte, signé le 28 novembre 2002 à Bruxelles, vise à lui conférer des possibilités nouvelles de soutien aux actions menées par les Etats membres dans ces domaines et à modifier en conséquence le statut des agents membres d'Europol.
Rappelons que, lors du Conseil européen de Tampere, en 1999, les Etats membres ont décidé de renforcer leur lutte contre les trois infractions majeures que sont le terrorisme, le trafic d'êtres humains et celui de stupéfiants. Pour accroître leurs capacités de répression, les Etats membres ont instauré la possibilité de créer, sur la base du volontariat, des ECE, des équipes communes d'enquête, permettant le traitement conjoint d'affaires pénales entre deux ou plusieurs Etats.
C'est ainsi que la France et l'Espagne ont constitué, en mars 2003, une équipe commune d'enquête en matière de lutte contre le terrorisme basque. Plus récemment, en février 2005, une ECE a été créée avec la Lituanie pour renforcer la répression de l'utilisation en France de fausses cartes bancaires par des ressortissants de ce pays. Deux autres ECE sont en projet : l'une, avec l'Allemagne, pour lutter contre le terrorisme islamiste ; l'autre, avec les Pays-Bas, pour une meilleure répression du trafic de drogues. L'extension de cette pratique de la mise en place d'équipes communes aux personnels de l'Office européen de police a semblé opportune et a nécessité la mise au point du présent protocole.
Ce texte tend donc à organiser la participation de ces personnels aux équipes communes d'enquête, en leur assurant les garanties juridiques nécessaires. Il vise également à établir la façon dont le conseil d'administration d'Europol statue sur un éventuel litige entre un Etat et Europol survenu à l'occasion de la participation d'un membre d'Europol à une équipe commune d'enquête. L'immunité de juridiction dont bénéficient les personnels d'Europol ne s'appliquera pas aux actes accomplis dans le cadre de l'appui à une ECE.
Cet accord aura pour effet principal de faciliter l'appui d'Europol aux services policiers des nouveaux Etats membres de l'Union européenne qui sont dépourvus des effectifs et des moyens nécessaires pour lutter contre la criminalité qui les affecte.
Cet appui passe notamment par le prêt de matériels légers, comme les appareils d'écoutes, l'envoi de spécialistes facilitant leur emploi, la fourniture de renseignements ou de facilités en matière d'interprétariat spécialisé dans les affaires policières.
Je rappelle que notre pays a apporté, en 2004, 8 millions d'euros au budget global d'Europol, qui s'élevait à 59 millions d'euros.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande, mes chers collègues, d'adopter ce protocole, qui ne résoudra certes pas les problèmes de fond soulevés par la coopération judiciaire et policière européenne, mais permettra de l'améliorer sur des points techniques.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Est autorisée l'approbation du protocole modifiant la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 28 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention sur la cybercriminalité et du protocole additionnel à cette convention, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (nos 248, 321).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, au cours de ces dernières années, le développement rapide de l'utilisation privée de l'Internet a été source d'abus et a pu faciliter la commission d'infractions pénales de toutes sortes, sans considération de frontières.
La répression de telles infractions se heurtant au principe de territorialité de la loi pénale, une approche internationale concertée s'imposait. Dès 1997, le Conseil de l'Europe a exprimé l'ambition de mettre au point un instrument international contraignant pour lutter contre cette nouvelle forme de délinquance.
C'est ainsi qu'il a créé un comité d'experts chargé d'élaborer un projet de convention destinée à lutter contre les auteurs des infractions pénales commises dans l'univers des réseaux et qui serait proposée à la signature de tous les Etats, et non pas des seuls Etats européens.
Ce comité, qui regroupait des experts représentant les Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi que des Etats observateurs, à savoir les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Afrique du Sud, a rédigé un projet de convention qui a été proposé à la signature des Etats lors d'une conférence organisée à Budapest le 23 novembre 2001.
Plus de quarante pays, dont la France, ont signé ce texte qui constitue la première convention pénale à vocation universelle destinée à lutter contre le cybercrime. Grâce à cet instrument, l'univers virtuel, dans sa dimension internationale, n'est pas un monde sans règles, sans police et sans juge ; les cyber-délinquants ne bénéficient pas d'une impunité.
La convention sur la cybercriminalité s'articule autour de trois axes.
Elle vise tout d'abord à harmoniser les législations nationales en matière d'incriminations dans le domaine du cyberespace. Dans cette perspective, elle fournit une liste des comportements pour la répression desquels chaque Etat partie s'oblige à instaurer des sanctions pénales dans son droit interne.
En outre, la convention tend à compléter l'arsenal juridique des Etats en matière procédurale, afin d'améliorer la capacité des services de police à mener en temps réel leurs investigations et à rassembler des preuves sur le territoire national avant qu'elles ne disparaissent.
Enfin, la convention s'efforce d'adapter les règles classiques des conventions du Conseil de l'Europe en matière d'extradition et d'entraide répressive de 1957 et de 1959.
Au total, la convention sur la cybercriminalité, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, prend acte des développements technologiques ayant une incidence sur la matière pénale. Les autorités judiciaires pourront ainsi faire face aux nouveaux enjeux liés aux réseaux.
Un second instrument vous est également présenté aujourd'hui : le protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.
En effet, lors du processus d'élaboration de la convention sur la cybercriminalité, le groupe de négociateurs n'avait pu parvenir à un consensus concernant l'incrimination des comportements racistes et xénophobes sur l'Internet, en raison de l'opposition de diverses délégations, qui invoquaient le principe de la liberté d'expression.
Aussi, pour pallier l'absence de prise en compte du discours de haine dans la convention sur la cybercriminalité, le Conseil de l'Europe suggéra, dès l'année 2001, l'élaboration d'un protocole additionnel consacré spécifiquement à l'incrimination des contenus racistes ou xénophobes sur les réseaux.
La France a eu un rôle déterminant dans l'élaboration de ce protocole, que sous-tendent trois grands axes.
D'abord, il pose une définition de l'expression « matériel raciste et xénophobe », qui conditionne largement l'application de la convention.
Ensuite, il énumère un certain nombre de comportements susceptibles d'être incriminés, notamment les insultes racistes proférées par le biais d'un système informatique ou les discours négationnistes. C'est une première dans un traité international.
Enfin, est prévue l'articulation du protocole avec la convention sur la cybercriminalité.
Au total, ce protocole, ayant actuellement été signé par vingt-trois Etats, reprend des formules très souples, susceptibles de préserver les spécificités de chaque ordre juridique national tout en élargissant la portée de la convention mère sur la cybercriminalité à des comportements contre lesquels la France se fait un point d'honneur de lutter.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent la convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 et le protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité du 28 janvier 2003, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, qui font l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la révolution numérique n'a pas seulement bouleversé l'économie mondiale, elle a aussi accru la délinquance dont les auteurs savent tirer profit des réseaux informatiques. De nouveaux délits ont surgi, qui menacent tant les individus que les entreprises ou les Etats.
Avec la première convention internationale relative à la lutte contre la cybercriminalité, les pays membres du Conseil de l'Europe et leurs partenaires se sont engagés sur la voie d'une régulation juridique et éthique d'un domaine jusqu'alors abandonné, pour le meilleur comme pour le pire, aux seules règles du marché.
La cybercriminalité se décline selon trois modes différents : les infractions relatives au contenu, qui se définissent comme la diffusion intentionnelle par l'Internet de textes ou d'images illégaux ; l'atteinte à la propriété intellectuelle, illustrée par la mise en ligne illégale de fichiers musicaux gratuits ; les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication.
L'Internet a été source d'abus : ainsi, en France, la cybercriminalité menace quelque 25 millions d'internautes, privés ou publics.
Par ailleurs, cette criminalité est transnationale et se développe, par définition, en dehors de toute considération de frontières. Sa répression se heurte au principe de territorialité de la loi pénale.
En France, des mesures ont déjà été prises : l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, créé en 2000 et rattaché à la direction de la police judiciaire, travaille en collaboration avec la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information, la DST, la Direction de la surveillance du territoire, les douanes et la gendarmerie et a pour fonction de participer à des enquêtes judiciaires et de coordonner l'action des services répressifs compétents dans le domaine des infractions informatiques.
Le G 8 s'étant saisi de cette question, les Etats-Unis, le Japon, le Canada et l'Afrique du Sud ont également signé la convention le 23 novembre 2001, aux côtés de trente-quatre des quarante-six membres du Conseil de l'Europe, ce qui porte à trente-huit le nombre d'Etats signataires.
Toutefois, sur les trente-huit Etats signataires, trente n'ont à ce jour pas déposé leurs instruments de ratification. Il importe donc que la France soit en mesure de le faire rapidement.
Cependant, lors des rencontres préalables, le comité d'experts n'avait pas adopté les propositions des délégations allemande et française concernant l'incrimination des comportements racistes et xénophobes sur l'Internet, en raison de l'opposition de diverses délégations, notamment celles du Canada, des Etats-Unis et du Japon, qui invoquaient le principe de la liberté d'expression.
Aussi le Conseil de l'Europe suggéra-t-il dès 2001 l'élaboration du protocole additionnel que vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d'Etat. Pour entrer en vigueur, il doit avoir été ratifié par cinq Etats. Une approbation rapide de ce protocole par la France s'impose d'autant plus que notre pays est à l'origine du texte ; elle constituerait en outre un signal en vue d'obtenir un plus grand nombre de signatures.
Il est essentiel de ratifier rapidement cette convention et ce protocole, car le récent rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme est très alarmant : en 2004, le nombre d'actes racistes et antisémites, passé de 833 à 1 565, soit une progression de 87, 8 % par rapport à l'année précédente, a atteint un niveau « exceptionnel et inquiétant ».
L'adoption de la convention de Budapest sur la cybercriminalité et du protocole additionnel sur la diffusion de propos et de matériels raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques est donc d'une importance capitale. La France peut jouer un rôle exemplaire en ratifiant ces textes, ce qu'ont fait, pour l'heure, deux pays seulement, l'Albanie et la Slovénie.
C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous invite à adopter ce projet de loi dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Est autorisée l'approbation de la convention sur la cybercriminalité, signée à Budapest le 23 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
L'article 1 er est adopté.
Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003. -
Adopté.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 12 mai 2005, l'informant de l'adoption définitive des textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
E2843 - COM (2005) 66 final : proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Adoptée le 13 avril 2005.
E2831 - COM (2005) 36 final : proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers des pays touchés par le tsunami en 2004.
Adoptée le 16 mars 2005.
E2823-1 - COM (2005) 25 final : avant-projet de budget rectificatif n° 1 au budget 2005 - état général des recettes - état des recettes et des dépenses par section : section III - Commission : note de transmission du secrétariat général de la Commission européenne au secrétaire général/haut représentant.
Adopté le 10 mars 2005.
E2819 - COM (2005) 5 final : proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles.
Adoptée le 14 mars 2005.
E2817 - COM (2004) 827 final : proposition de règlement du Conseil modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Adoptée le 12 avril 2005.
E2812 - COM (2005) 2 final : proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Adoptée le 16 mars 2005.
E2786 - COM (2004) 842 final : proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire.
Adoptée le 12 avril 2005.
E2714 - COM (2004) 643 final : proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la déclaration commune d'intention qui l'accompagne ; proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
1ère proposition adoptée le 29 novembre 2004.
2ème proposition adoptée le 22 décembre 2004.
E2692 - COM (2004) 569 final : proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du protocole d'accord qui l'accompagne ; proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
1ère proposition adoptée le 29 novembre 2004.
2ème proposition adoptée le 22 décembre 2004.
E2688 - COM (2004) 564 final : proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la déclaration commune d'intention qui l'accompagne ; proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
1ère proposition adoptée le 2 novembre 2004.
2ème proposition adoptée le 22 décembre 2004.
E2563 - COM (2004) 218 final : proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
Adoptée le 17 février 2005.
E2511-11 - SEC (2004) 1234 final : avant-projet de budget rectificatif n° 11 au budget 2004 : état général des recettes - état des recettes et des dépenses par section - section III - Commission.
Adopté le 2 décembre 2004.
E2363 - COM (2003) 468 final : proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Adoptée le 13 avril 2005.
E2116 - COM (2002) 536 final : proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part ; proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part.
1ère proposition adoptée le 18 novembre 2002.
2ème proposition adoptée le 28 février 2005.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 12 mai 2005, l'informant de la caducité du texte suivant soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution :
E2779 - SG (2004) D/10017 : lettre de la Commission européenne du 24 novembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République de Chypre en date du 11 novembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 343, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 344, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 31 décembre 1957.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 345, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 346, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 347, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 348, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 349, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant sous forme d'échange de lettres modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 350, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole).
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 351, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole).
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 352, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de M. Roger Madec une proposition de loi tendant à permettre aux conseils d'arrondissement d'acquérir des biens amortissables.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 342, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu de MM. Roger Madec, Jean-Noël Guérini, Jean-Pierre Bel, Jean Marc Pastor, Mme Nicole Bricq, MM. David Assouline, Jean-Pierre Caffet, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Bernard Frimat, Yves Dauge, Jean-Marc Todeschini, Bertrand Auban, Mmes Dominique Voynet, Sandrine Hurel, M. Jean-Marie Bockel, Mme Josette Durrieu, M. Didier Boulaud, Mme Patricia Schillinger, MM. Bernard Dussaut, François Marc, Serge Lagauche, Roland Ries, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Gisèle Printz, Michèle André, MM. Marcel Vidal, Claude Domeizel, Jean Desessard, Claude Saunier, Yannick Bodin, René-Pierre Signé, Yves Krattinger, Simon Sutour, Jacques Mahéas, Jean-Pierre Plancade, Mme Michèle San Vicente et M. Robert Badinter une proposition de loi renforçant les protections des locataires victimes de ventes à la découpe.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 353, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de M. Hubert Haenel une proposition de résolution, présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement, sur le projet de loi de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés aux suspects dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne (n° E-2589).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 341, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu une lettre par laquelle M. Pierre Fauchon déclare retirer la proposition de résolution sur le Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne (E 2821) (n° 241, 2004-2005) qu'il avait déposée, au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du règlement, au cours de la séance du 10 mars 2005.
Acte est donné de ce retrait.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant pour 2007-2013 un programme-cadre « Droits fondamentaux et justice ». Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique « Combattre la violence (Daphné), prévenir la consommation de drogue et informer le public » dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice ». Proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique « Droits fondamentaux et citoyenneté » dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice ». Proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique « Justice pénale » dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice ». Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour la période 2007-2013 le programme spécifique « Justice civile » dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice ».
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2875 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Lettre de la Commission européenne du 16 mars 2005 relative à une demande de dérogation présentée par la Lettonie en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2876 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Serge Vinçon, Josselin de Rohan, Didier Boulaud, Mmes Gisèle Gautier et Hélène Luc un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à la suite d'une mission effectuée du 16 au 24 avril 2005 par une délégation en Afghanistan.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 339 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Serge Vinçon un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur les apports du traité constitutionnel en matière de politique étrangère et de défense.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 340 et distribué

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 31 mai 2005 :
A dix heures :
1. Dix-huit questions orales.
A seize heures et le soir :
2. Discussion du projet de loi (n° 235, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises.
Rapport (n° 335, 2004-2005) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 337, 2004-2005) de M. Christian Gaudin, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 30 mai 2005, avant dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 30 mai 2005, à seize heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 13 mai 2005, à zéro heure dix.