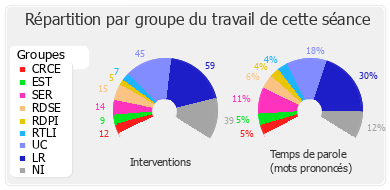Séance en hémicycle du 3 avril 2019 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidature à une commission
- Communication d'un avis sur un projet de nomination
- Produits agricoles ou alimentaires (voir le dossier)
- Souhaits de bienvenue à de jeunes citoyens en tribune
- Produits agricoles ou alimentaires
- Rappel au règlement (voir le dossier)
- Enjeux d'une politique industrielle européenne (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires européennes a été publiée.
Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable – 21 voix pour, 3 voix contre et 7 bulletins blancs – à la nomination de M. Julien Boucher aux fonctions de directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l’origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires, présentée par Mme Marie-Pierre Monier et plusieurs de ses collègues (proposition n° 322, texte de la commission n° 391, rapport n° 390), et de la proposition de loi tendant à abroger la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée, présentée par M. Gilbert Bouchet et plusieurs de ses collègues (proposition n° 231, rapport n° 390).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Marie-Pierre Monier, auteure de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, issue des États généraux de l’alimentation, la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Égalim, a connu des débats riches, qui s’étaient traduits par un foisonnement de dispositions nouvelles concernant des problématiques alimentaires.
Certaines de ces dispositions étaient sans doute trop éloignées du cœur du texte initial : c’est en tout cas ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel, estimant que vingt-trois articles introduits en cours d’examen par les parlementaires n’avaient pas de lien, même indirect, avec le texte.
Pour autant, nombre de ces dispositions retoquées étaient particulièrement utiles et représentaient de véritables enjeux pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs et, à travers eux, pour l’ensemble du monde agricole et rural. Que fallait-il faire alors ?
L’ensemble de ces dispositions ne pouvant être rassemblé dans une thématique suffisamment réduite pour constituer une proposition de loi homogène, j’ai souhaité constituer, parmi les articles retoqués de la loi Égalim, un ensemble d’articles cohérents et efficaces, visant à la fois à protéger le consommateur, à soutenir les producteurs et à valoriser les territoires.
Il m’est alors rapidement apparu que se focaliser sur les dispositions en lien avec les signes et mentions valorisantes permettait de répondre à l’ensemble de ces objectifs. Sur cette base, j’ai proposé une ébauche de texte à plusieurs de mes collègues, que j’ai souhaité associer à l’écriture de cette proposition de loi, à savoir Henri Cabanel, Franck Montaugé et Jean-Claude Tissot. C’est donc le résultat de ce travail collectif que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui.
Afin de ne pas dénaturer ce texte et, surtout, de permettre sa transmission à l’Assemblée nationale, nous avons fait le choix de le limiter à quatre dispositions qui concernent plusieurs filières agricoles – miel, fromage, vin – et touchent tous les territoires.
Seul l’article 2 peut être considéré comme plus spécifique, puisqu’il concerne la Clairette de Die, production emblématique du département de la Drôme dont je suis élue. Il répond aussi à une demande des producteurs en faveur d’une adaptation des signes valorisant cette production aux nouveaux enjeux du XXIe siècle.
J’ai accepté que mon collègue sénateur de la Drôme Gilbert Bouchet puisse joindre l’examen de sa proposition de loi sur la Clairette de Die à celui de la nôtre, car son texte est identique à l’article 2, et il aurait été dommage que nous ne nous retrouvions pas sur ces enjeux qui dépassent les clivages politiques.

D’ailleurs, je ne doute pas que notre autre collègue sénateur de la Drôme, Bernard Buis, élu dans le Diois, apportera aussi son soutien.
Au-delà de cet article, mes chers collègues, l’ensemble des dispositions que nous proposons vous sera présenté dans le détail par les rapporteurs Anne-Catherine Loisier et Henri Cabanel, dont je salue le précieux travail réalisé dans un esprit constructif, qui a permis d’affiner la rédaction du texte.
Le monde change, tout comme les préoccupations de nos concitoyens. Ainsi, les modes de consommation évoluent. Nous assistons depuis plusieurs années non seulement à la montée en puissance d’une exigence de traçabilité, de transparence et de qualité des produits, mais aussi à une attente forte des consommateurs d’une information juste et claire sur les produits alimentaires qui sont consommés au quotidien et sur les conditions de leur production.
Ce sont au moins huit consommateurs sur dix qui souhaitent plus de transparence pour les produits alimentaires et près de 80 % des personnes qui se déclarent prêtes à payer plus cher pour un produit régional ou pour un produit 100 % français. Cette exigence accrue d’éthique dans l’alimentation est tout particulièrement ressortie au cours des États généraux de l’alimentation et, bien entendu, des débats de la loi Égalim.
Les mentions et signes de la qualité et de l’origine valorisant les produits sont parmi les moyens les plus efficaces pour répondre à la fois aux demandes de transparence et de traçabilité et à la recherche de saveur et d’authenticité des productions.
Toutes les dispositions que nous avons reprises dans cette proposition de loi, que ce soit les informations figurant sur les étiquettes – miel, vin – ou l’adaptation de certaines mentions valorisantes – fromage fermier, appellation Clairette de Die – contribueront à restaurer durablement une relation de confiance entre les producteurs et les consommateurs.
L’agriculture française est confrontée à une concurrence internationale, parfois déloyale, face à laquelle il est nécessaire de promouvoir les signes et mentions valorisantes.
Les producteurs français sont désireux de faire reconnaître, protéger et valoriser la qualité de leur production, leur savoir-faire et leurs territoires. Ainsi, il convient de mieux mettre en valeur les garanties de leurs produits en termes d’origine et de qualité, grâce aux signes et mentions valorisantes, qui contribuent, en outre, à permettre une meilleure rémunération et une meilleure reconnaissance de leur travail.
Certaines dispositions de notre texte soutiennent donc les productions sous signe et indication de la qualité et de l’origine, ou SIQO, qui garantissent l’origine géographique ou les modes de production. Les SIQO ont l’avantage d’être facilement reconnus par les consommateurs, qui, s’ils ignorent parfois leurs caractéristiques et leurs garanties exactes, savent que ces mentions constituent une certaine assurance-qualité des produits sur lesquels elles sont apposées.
L’étiquetage des produits alimentaires, plus généralement l’information sur les produits, permet de faire évoluer les pratiques. Le pari est que, avec davantage d’informations en leur possession, les consommateurs feront des choix plus éclairés et privilégieront l’agriculture française, notamment l’agriculture paysanne.
En définitive en effet, à travers cette proposition de loi, il s’agit toujours de soutenir le modèle agricole français qui, à côté des grandes cultures, développe une agriculture de terroirs, basée sur le savoir-faire de nos producteurs et la valeur ajoutée de nos produits. Ce modèle offre des garanties de qualité incontestables.
Les filières agricoles et alimentaires concernées par ce texte sont parmi celles qui contribuent au dynamisme de nos territoires ruraux et à leur attractivité économique et touristique. Les consommateurs français mais aussi étrangers plébiscitent les produits made in France clairement identifiés.
À travers les mentions et signes de la qualité et de l’origine, ce ne sont pas seulement les produits agricoles ou alimentaires français qui sont valorisés, mais aussi les territoires où ils sont produits et toute l’économie rurale qu’ils contribuent à entretenir. Mettre en valeur les productions locales, les circuits courts, la territorialisation de l’alimentation constitue un puissant levier permettant de soutenir l’économie locale, mais aussi de préserver notre environnement et de tendre vers la nécessaire transition agroécologique.
C’est là une demande de nos concitoyens et des consommateurs en général, mais c’est aussi une orientation générale plus que souhaitable de notre agriculture et de notre société. Au fond, c’est un trio gagnant que doivent former les consommateurs, les professionnels et les territoires.
J’espère que le Sénat saura parvenir à un consensus et que ces mesures de bon sens trouveront une issue favorable, pour une mise en application la plus rapide possible.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, voilà quelques mois, alors que nous étions rapporteurs de la loi Égalim, Michel Raison et moi-même avions déploré que le texte initial ait été détourné par l’adoption de nombreux articles additionnels à l’Assemblée nationale, au mépris de l’esprit originel du texte, dans la mesure où cela revenait à délaisser la question du revenu des agriculteurs au profit de questions alimentaires, ajoutant encore des charges à nos producteurs.
Le Conseil constitutionnel a confirmé, d’un point de vue juridique, que la plupart des articles ajoutés à la loi Égalim n’avaient pas de lien, même indirect, avec le format initial du projet de loi. Il a censuré près d’un quart du texte. Certains articles censurés avaient toutefois fait l’objet d’un travail approfondi et consensuel entre nos deux assemblées et répondaient à des attentes tout à fait légitimes et justifiées de nos territoires.
Les deux propositions de loi que nous examinons, celle de Marie-Pierre Monier et celle de Gilbert Bouchet, dont je salue le travail, ont justement pour objet de reprendre ces principales dispositions sur l’étiquetage et les mentions valorisantes.
La proposition de loi de Marie-Pierre Monier entend permettre l’étiquetage de certains fromages fermiers affinés en dehors de la ferme et renforce l’information du consommateur sur l’origine des produits qu’il achète, notamment les pots de miel et les bouteilles de vin. Enfin, tout comme la proposition de loi de Gilbert Bouchet qui a, en conséquence, été intégrée à ce texte, elle permet aux producteurs du Diois de diversifier leur production. Henri Cabanel, avec qui j’ai travaillé sur ces deux propositions de loi, précisera la position de la commission des affaires économiques sur ces deux points viticoles.
Sur la problématique des fromages fermiers, depuis un arrêt du Conseil d’État de 2015, il n’est plus possible pour les producteurs de fromages fermiers ne disposant pas de cave d’affinage au sein de leur exploitation de mentionner que leurs fromages sont fermiers. Cet arrêt met en péril de nombreuses petites structures de nos territoires en empêchant les producteurs de valoriser au mieux leurs produits.
Certes, il faut protéger la mention valorisante « fromage fermier » – c’est d’ailleurs l’objet de cette proposition de loi –, afin qu’elle ne soit pas dévoyée, mais ce n’est pas en écartant certains producteurs plutôt que d’autres, notamment les producteurs qui répondent aux critères de production des fromages fermiers, que nous y parviendrons. La commission proposera de revenir à la rédaction issue de la loi Égalim en ajoutant une sécurité supplémentaire, suggérée par notre collègue Pierre Louault, la mention du nom du producteur sur l’étiquette, afin de s’assurer que la production demeure bien sous la responsabilité directe du fermier.
Enfin, les miels donneront probablement lieu à un débat important. Il est anormal que le consommateur ne puisse pas connaître l’origine des miels qu’il achète. La directive européenne offre déjà la possibilité d’afficher tous les pays d’origine, mais elle n’est malheureusement pas ou peu appliquée en France.
C’est pourquoi nous proposons de l’inscrire explicitement dans la loi. Juridiquement, il est difficile d’aller plus loin, sauf à négocier à l’échelon européen un renforcement de la fiabilité des étiquetages des miels. Nous savons que ce point est très attendu des consommateurs.
Aussi, monsieur le ministre, afin de vous aider dans cette négociation qui, nous le savons, vous tient à cœur, la commission proposera une solution opérationnelle d’équilibre, à savoir l’affichage des pays en toutes lettres par ordre décroissant d’origine, sans aller pour autant jusqu’à la mention des pourcentages, pour des raisons pratiques et techniques.
Nous considérons que le consommateur disposera ainsi clairement des informations nécessaires et pourra identifier les origines d’un miel issu de mélanges et pourra faire son choix d’achat en toute connaissance de cause.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de remercier Marie-Pierre Monier et Gilbert Bouchet de leur travail en faveur des signes de qualité, en portant une attention particulière à la Clairette de Die.
Monsieur le ministre, cet ordre du jour en partie drômois vous rappellera quelques souvenirs sur ces bancs.
Sourires.

Anne-Catherine Loisier a rappelé les principaux éléments relatifs à l’étiquetage du miel et des fromages fermiers. Passons aux problématiques viticoles auxquelles les deux propositions de loi entendent répondre.
L’article 2 entend abroger une vieille loi de 1957, qui interdit aux producteurs de l’AOC Clairette de Die de produire d’autres vins mousseux. Il est en tout point identique à l’article que nous avions adopté lors de la loi Égalim.
Depuis une douzaine d’années, force est de constater que la couleur rose a le vent en poupe… Je veux bien sûr parler des vins
Exclamations amusées

Pourquoi les producteurs de l’Est pourraient-ils faire du vin mousseux blanc ou rosé selon leur choix et non les producteurs de la zone de Die ? L’article 2 permettra aux producteurs du Diois pourront le faire. En revanche, ils ne pourront produire que du vin mousseux rosé sans appellation. S’ils le souhaitent, ils pourront entamer ensuite un long travail avec l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, pour que, un jour peut-être, leurs vins rosés soient reconnus AOC Clairette de Die.
Venons-en à l’article 4 et à la problématique générale de l’étiquetage des vins, avec l’exemple des vins du Pays d’oc.
Une vaste tromperie a été décelée en grande surface, surtout pour les bag in box de vin d’une contenance de deux à dix litres. Le consommateur est leurré avec des imageries régionales, un nom francisé, un cépage, mettant en avant le conditionnement français, alors que ces vins sont étrangers, notamment espagnols.
Cette problématique concerne essentiellement les IGP Pays d’oc. La DGCCRF – la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – estime que cette arnaque a porté sur plus de 10 millions de litres.

Les producteurs sont d’autant plus frustrés et en colère qu’ils ont eux-mêmes alerté les services des fraudes pour leur demander des contrôles accrus.
Le procédé est une astuce de contournement du droit européen : l’obligation d’informer sur le pays d’origine est bien respectée. Elle figure bien avec toutes les autres mentions obligatoires, dans la police exigée par la réglementation européenne. Reste que cette information se retrouve le plus souvent dissimulée sur la face cachée du bag in box, donc non visible par le consommateur.

Dans un autre registre, que vaut la mention France avec une taille de caractère de 1, 2 millimètre, la grande image d’un paysage provençal sur toutes les faces ? Il est urgent d’agir. La réglementation en vigueur prévoit déjà tous les instruments pour lutter contre ces méthodes.
L’enjeu est donc non le droit, mais la pratique : la pratique commerciale trompeuse est déjà contrôlée par la DGCCRF et peut donner lieu à des sanctions pénales, mais ces contrôles ne sont pas assez nombreux pour endiguer ce phénomène.
M. le ministre fait un geste d ’ impuissance.

Lors de leurs auditions par la commission, plusieurs responsables professionnels m’ont indiqué le manque de moyens de ces services : moins d’une dizaine d’agents, m’ont-ils dit, pour le territoire de l’ancienne région Languedoc-Roussillon.
Monsieur le ministre, la filière est unanime pour travailler dans le sens d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et engagée dans des signes de qualité pour répondre aux attentes des consommateurs. Cependant, comment soutenir cette volonté s’il n’y a pas suffisamment d’agents pour contrôler et dissuader les distributeurs peu scrupuleux ?
Dans un pays qui se targue d’une sécurité alimentaire élevée, les missions des services de l’État – la DGCCRF, mais aussi les directions départementales de la protection des populations – sont essentielles sur nos territoires. Le fait de clarifier l’article 4 rassurerait les producteurs et irait in fine dans le sens que nous souhaitons tous, à savoir une meilleure transparence pour le consommateur.
À l’échelon international, la France conserve encore l’image du Pays des Vins de qualité, car nous avons créé l’appellation d’origine contrôlée et l’indication géographique protégée. Dans les deux cas, les mots « contrôlée » et « protégée » sont les garants d’une qualité et d’une sécurité fortes.
Monsieur le ministre, quels moyens allez-vous développer et déployer pour garantir cette excellente image de la France ?

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis que cette proposition de loi ait été inscrite à l’ordre du jour du Sénat cet après-midi, ce qui nous permet d’aborder un certain nombre de sujets figurant au titre II de la loi Égalim.
Je commencerai par un point rapide sur la situation dans laquelle nous nous trouvons, notamment sur le point crucial de l’agriculture française et le titre Ier de la loi Égalim relatif aux prix payés aux paysans.
On peut parler de qualité de l’alimentation, de tout ce que l’on veut, mais, si les paysans ne gagnent pas leur vie, nous pourrons débattre tant et plus dans cet hémicycle : ce sera vain !
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe socialiste et républicain, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Républicains.

Si la loi Égalim a été un pas en avant, elle n’a pas encore atteint son but. Ainsi, dans certains secteurs, l’inversion de la construction des prix – les organisations de producteurs ont fixé le coût d’objectif du prix de production – a permis aux industriels, aux coopératives, aux GMS – les grandes et moyennes surfaces – de relever les prix, et pas seulement dans le secteur du lait.
Reste que le compte n’y est pas. Il faudra donc attendre la saison prochaine, et vraisemblablement même celle d’après, pour que les agriculteurs puissent enfin vendre leurs produits au prix où cela leur revient et non au prix où on leur impose de le vendre, ce qui est absolument scandaleux.

Toutes les forces du Gouvernement et du ministère de l’agriculture et mes modestes forces sont tournées dans cette direction. Nous allons maintenant entamer la lourde discussion sur les marques de distributeur, ou MDD, qui représentent tout de même plus de 40 % des produits et qui ne sont pas soumises aux négociations commerciales, qui ont lieu durant trois mois chaque année, du 1er décembre au 28 février.
Il suffit de regarder l’évolution de la grande distribution. Récemment, nombre de patrons de grandes surfaces ont évoqué les transformations à venir : les grandes surfaces avec 25 000 ou 30 000 références sont appelées à disparaître ; il s’agit de s’approcher au plus près de la qualité et de privilégier les circuits courts. C’est dans ce cadre-là que nous devrons travailler, non pas pour réajuster la loi Égalim, mais pour la renforcer, afin que les agriculteurs puissent réellement vivre de leur travail.
Une partie du chemin est faite, mais ce n’est pas suffisant. Espérons que, dans les mois et les années qui viennent, la situation s’améliore. Les ordonnances qui ont été prises sur le seuil de revente à perte, sur les prix anormalement bas, sur les promotions – avec l’assentiment des organisations professionnelles agricoles – permettront des avancées, pour que, enfin, les paysans puissent vivre de leur travail plus dignement que ce n’est le cas aujourd’hui.
Les quatre articles de cette proposition de loi concernent notamment le titre II de la loi Égalim et l’alimentation. Permettez-moi de revenir tout d’abord sur un point mentionné par Mme Monier : les Français seraient prêts à payer plus cher pour des produits de qualité.

Je n’en suis pas totalement sûr, et la démonstration doit en être faite.
Je pense au contraire que nombre de nos concitoyens n’ont absolument pas les moyens de payer plus cher leur alimentation. Je tiens à souligner ce point, car il ne faudrait pas penser que les riches mangeraient des produits de bonne qualité, pendant que les pauvres mangeraient des produits de qualité moindre.

M. Didier Guillaume, ministre. Je réaffirme ici que notre alimentation française est saine, sûre et durable. Qu’elle soit industrielle, artisanale ou fermière, les contrôles font qu’elle est de bonne qualité.
MM. Daniel Dubois et Yvon Collin applaudissent.

Ce qui importe, c’est de faire monter en gamme notre agriculture et d’augmenter ses revenus. Je tiens à le souligner, car c’est tout l’enjeu de mon action au sein de ce ministère : la montée en gamme et la montée en revenus.
Certes, on peut travailler sur la segmentation, qui est indispensable, sur telle ou telle filière d’excellence, sur telle ou telle niche – le bio, les circuits courts, que sais-je encore –, mais il n’empêche que les points centraux sont, premièrement, le revenu de l’agriculteur, deuxièmement, la traçabilité, la qualité et la durabilité de notre alimentation et, troisièmement, un prix accessible à nos concitoyens.

M. Didier Guillaume, ministre. J’ai coutume de rappeler que ce que nous trouvons sur les rayons des grandes surfaces ou dans nos marchés, ce n’est pas ce que cela coûte, mais c’est ce que cela vaut. Cette politique de toujours vouloir ramener aux petits prix et au moins cher – « moins c’est cher, mieux c’est »
M. Michel Canevet acquiesce.

M. Didier Guillaume, ministre. Je sais que nous partageons tous cette position dans cet hémicycle : nous voulons une agriculture de qualité qui soit rémunérée, mais qui soit accessible. Ce n’est pas évident, mais il faut tenir ces trois objectifs ensemble.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe de l ’ Union Centriste.

Ce texte a pour objet de reprendre un certain nombre d’articles de la loi Égalim qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, à la suite d’un recours déposé pour divers motifs. C’est le cas de ses quatre premiers articles, le cinquième adaptant le délai d’entrée en vigueur de ces dispositions. Le Gouvernement est globalement d’accord, et j’y suis évidemment favorable.
Nous serons amenés à discuter de nouveau de ces questions, car l’Assemblée nationale est en train de préparer une proposition de loi sur l’ensemble du titre II de la loi Égalim, et il faudra bien mettre toutes ces dispositions en cohérence, afin d’aller plus loin que les quatre premiers articles de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. En effet, ils sont importants, mais ne sont pas les seuls, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a censuré un certain nombre d’articles du titre II.
Cette proposition de loi concerne l’alimentation. Or l’alimentation, c’est la vie. Nous en avons parlé. De plus en plus, il faut réaffirmer – les jeunes notamment nous le montrent – l’importance de manger régulièrement des légumes frais, des légumes de saison, des fruits, des œufs, la viande lorsque l’on sait d’où elle vient et qu’elle est tracée et clairement identifiée. Oui, c’est ce chemin que notre société doit prendre.
Et que dire de la gastronomie, qui est l’une des références de notre pays ? Je rappelle que le menu gastronomique est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco.

Nous nous battons tous pour que la baguette le soit aussi – je suppose que vous avez tous signé le manifeste à cette fin. Un repas gastronomique sans une baguette de pain serait incomplet ; il manquerait quelque chose.
Laissez-moi ajouter – je sais qu’ici de tels propos n’attirent pas les foudres – qu’un repas gastronomique est composé de produits de qualité et d’une bonne baguette de pain. Et, s’il est arrosé d’un bon vin, nous atteignons l’extase !
Exclamations amusées et applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

C’est cela la France ! Or, mesdames, messieurs les sénateurs, vous représentez la France – j’ai tellement aimé siéger dans cet hémicycle ! –, j’allais dire, vous êtes la France.
Cette proposition de loi est placée sous le signe de la qualité, de l’origine, de la transparence et de l’information en direction des consommateurs.
Permettez-moi d’émettre un autre avis personnel et de reprendre une formule très connue : trop d’information tue l’information. Il ne faut pas que les étiquettes deviennent longues comme des parchemins pour que l’on sache ce que l’on va manger. Il faut faire preuve de cohérence sur ce que nous mettons sur les étiquettes des bouteilles de vin et des produits alimentaires, sinon nous ne saurons plus ce que nous mangeons.
C’est donc d’une alimentation saine, sûre et durable que nous débattons cet après-midi. C’est la raison pour laquelle nous devons veiller sans cesse à ce que nos concitoyens sachent ce qu’ils achètent, ce qu’ils mangent, d’où cela vient, comment c’est produit et qui commercialise. Si nous arrivons à faire la transparence sur ces sujets, nous aurons, je pense, fait œuvre utile.
Nous devons toutefois veiller – j’en ai discuté en aparté avec Mme la présidente de la commission, monsieur le président, je sais que ce n’est pas bien – à ne pas faire de sur-transpositions et à ne pas ajouter trop de normes. Je suis favorable à cette proposition de loi, mais, franchement, elle ne me paraît pas, dans son ensemble, conforme à l’esprit dans lequel travaille le Sénat, la règle ici étant de ne pas sur-transposer et de ne pas ajouter de normes. Or, cet après-midi, certes avec mon accord, nous allons en ajouter.
Existe-t-il de bonnes ou de mauvaises sur-transpositions, de bonnes ou de mauvaises normes ? Je n’en sais rien. Soyons toutefois vigilants sur ces points, le risque étant, à force, de mettre à mal la cohérence de notre raisonnement.
Enfin, je tiens à le redire : nous devons soutenir notre agriculture et nos producteurs. Il existe diverses agricultures, que je n’ai jamais opposées entre elles : l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique, les circuits lents et les circuits courts, l’agriculture productive et l’agriculture des marchés paysans. Nous avons besoin de toutes ces agricultures. C’est ainsi que nous y arriverons.
Toutefois, j’y insiste : veillons, alors que le Sénat aborde un débat agricole, à ne pas opposer les différentes agricultures entre elles – ce n’est pas le cas dans cette proposition de loi –, car, sous le soleil, il y a de la place pour tout le monde !
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

M. le président. Mes chers collègues, je salue la présence dans notre tribune des membres du conseil municipal des jeunes des communes de Saint-André-de-Sangonis et de Saussines, dans l’Hérault, qui sont accompagnés de notre collègue Jean-Pierre Grand. Qu’ils soient les bienvenus !
Applaudissements.

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l’origine valorisant les produits agricoles ou alimentaires.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Daniel Gremillet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à féliciter pour leur travail Anne-Catherine Loisier et Henri Cabanel. Je remercie également notre collègue Michel Raison, une partie de la présente proposition de loi provenant du travail qu’il avait réalisé, avec Anne-Catherine Loisier, dans le cadre du projet de loi Égalim, dont 23 articles viennent d’être censurés par le Conseil constitutionnel.
Mes collègues Gilbert Bouchet et Patrick Chaize évoqueront des sujets particuliers. Pour ma part, je me concentrerai sur trois points.
Monsieur le ministre, vous venez de confirmer ce que nous avions déjà appris, à savoir que l’Assemblée nationale prépare elle aussi un texte reprenant une partie des articles de la loi Égalim censurés par le Conseil constitutionnel.
Il n’est pas possible, dans notre pays, de ne pas reconnaître à ce point le travail du Sénat ! Quelles que soient nos sensibilités, nous nous partageons les mêmes positions sur les enjeux stratégiques pour notre agriculture, nos consommateurs, nos territoires. J’espère donc, monsieur le ministre, que l’Assemblée nationale ne refera pas le monde, si j’ose dire, après le vote du texte tout à l’heure, et qu’elle ne reviendra pas sur les décisions clairvoyantes que nous aurons prises sur l’étiquetage des produits fermiers et sur les autres points abordés dans la proposition de loi.

Si je les évoque en cet instant, c’est parce qu’il nous faut retrouver une certaine forme d’honnêteté, mais surtout d’efficacité.
Monsieur le ministre, j’aime rêver. Une vie sans rêve, c’est ennuyeux.

Nous sommes au début du mois d’avril 2019, les négociations commerciales commencent, et les craintes que nous avons évoquées dans cet hémicycle lors des débats sur la loi Égalim sont, hélas, en train de se réaliser : la montée en gamme des produits se fait au détriment des agriculteurs, car elle implique plus de charges et plus de contraintes pour eux, mais nulle augmentation de revenus.
Pis encore, certaines enseignes ont des pratiques contraires à l’esprit de la loi, esprit auquel nous adhérons totalement, monsieur le ministre – il s’agit d’établir un prix final à partir des coûts de production des agriculteurs. Pourtant, les montées en gamme, y compris des produits d’appel, bénéficient aujourd’hui surtout aux distributeurs, qui inventent des systèmes dans lesquels les agriculteurs doivent se caler.
Permettez-moi d’évoquer un exemple très concret. Aujourd’hui, la France demande aux producteurs de nourrir leurs animaux avec des aliments sans OGM. Il s’agit d’une belle montée en gamme, mais qui se traduit finalement par une hausse du coût de l’alimentation pour l’éleveur, ainsi que par des prix plus élevés des produits d’appel pour le consommateur.
Faisons donc attention à ces montées en gamme. Imaginez que l’on en vienne un jour à demander aux paysans de traire les vaches à la main, assis sur un tabouret à une patte, parce que cela serait une manière de se différencier ! Il faut revenir à l’essentiel.
J’évoquerai maintenant les fromages fermiers. Sur ce sujet, je tiens à remercier notre rapporteur. Il faut connaître le terrain, l’histoire, ce qui se passe dans nos territoires. Depuis des dizaines d’années, des paysans transforment chez eux leurs produits, l’affinage étant parfois réalisé dans des ateliers collectifs. Et vous savez très bien, monsieur le ministre – vous l’avez très bien dit – que l’on est capable, pour des raisons de sécurité sanitaire, de dire à tout instant d’où vient un fromage fermier transformé ou affiné collectivement. On sera également capable de le faire au niveau du consommateur.
Pour terminer, j’évoquerai le miel. Une fois encore, je remercie notre rapporteur d’avoir repris les dispositions de la loi Égalim. Monsieur le ministre, vous vous êtes à juste titre félicité dans un communiqué, à la fin du mois de décembre dernier, que l’Europe vous ait autorisé à prolonger l’expérimentation française sur les produits carnés et les produits laitiers.
Aujourd’hui, nous souhaitons tout simplement, pour des raisons de transparence et d’honnêteté à l’égard du consommateur, mais aussi des apiculteurs, obtenir la possibilité de procéder à une telle expérimentation pour le miel. Il s’agit là non pas de faire de la sur-transposition, mais de bâtir une Europe plus forte et plus clairvoyante, qui respecte les engagements pris par les parlements nationaux.
Le Sénat a pris une décision simple : l’ensemble des produits qui seront vendus en Europe et en France doivent correspondre aux exigences que nous leur imposons.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui d’un texte reprenant quatre articles de la loi Égalim, lesquels avaient fait, à l’époque, l’objet d’un certain consensus, et je m’en réjouis.
Fruit d’un travail parlementaire fourni et de longs mois de débats, ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Elles contribuent pourtant largement à l’amélioration de la transparence sur les produits alimentaires et de la traçabilité. On le sait, ce sujet est cher aux Français, qui sont de plus en plus attentifs à ce qu’ils consomment ; les chiffres et études le montrent.
Mes chers collègues, je remercie le groupe socialiste et républicain de s’être emparé de ce sujet et de nous proposer ce texte, qui reprend quatre articles ayant été considérés comme des cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel. Il s’agit des dispositions concernant la dénomination « fromage fermier » ; l’appellation « Clairette de Die », la transparence sur les pays d’origine du miel, la mention sur les étiquettes du vin de leur origine.
À mon sens, il aurait fallu étendre davantage le champ de cette proposition de loi et y inclure d’autres mesures qualifiées de « cavaliers » par le Conseil constitutionnel. C’est pourquoi, et je tiens à le souligner ici, un groupe de travail parlementaire de La République En Marche, auquel j’appartiens, a également travaillé sur un texte portant la même ambition. Il a été déposé à l’Assemblée nationale le 20 mars dernier.
M. Roland Courteau s ’ exclame.

Mes chers collègues, les États généraux de l’alimentation et les trois mois de concertation et d’échanges ont permis d’aboutir à un constat : il est nécessaire de répondre aux demandes de plus en plus exigeantes des consommateurs en termes de qualité des produits ou de respect de l’environnement.
Les mesures visant à améliorer la transparence sur les conditions et les lieux de production de nos produits agricoles ont ainsi une double ambition : protéger le consommateur en lui offrant une meilleure information sur ce qu’il mange, mais aussi – dois-je le rappeler ? – protéger nos agriculteurs. Tous les signes et mentions de la qualité et de l’origine jouent en faveur de notre production nationale. Les produits de nos terroirs sont une garantie d’excellence pour le consommateur. Une meilleure information valorise nos produits et fait ainsi gagner des parts de marché à nos agriculteurs.
Venons-en au fond du sujet. L’article 1er de la proposition de loi porte sur la labellisation des fromages dits « fermiers », la situation actuelle n’étant pas acceptable.
Les fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation ne sont plus encadrés par un étiquetage. Or, nous le savons, les affineurs ont historiquement été à l’origine de la création de nombreuses appellations d’origine contrôlée.
Dès lors que le lien direct du producteur avec le produit final et la mise en œuvre de pratiques traditionnelles d’affinage sont garantis par un cahier des charges, cette labellisation doit être ouverte aux fromages fermiers affinés à l’extérieur de l’exploitation. Cette labellisation ne doit pas être limitée aux fromages affinés portant des signes officiels de la qualité et de l’origine. En effet, cela reviendrait à exclure les petits producteurs, qui peinent à valoriser leurs produits. Le dispositif proposé permettrait de mettre fin à l’insécurité juridique.
L’article 3, qui porte sur l’étiquetage de la mention du pays d’origine des mélanges de miels issus de plus d’un pays, était attendu de longue date par nos producteurs, qui subissent la concurrence européenne et internationale.
En 2017, quelque 20 000 tonnes de miel ont été produites en France et 35 000 tonnes ont été importées, mais aucune indication du pays d’origine n’apparaît sur les étiquettes. En dix ans, les importations de miel, en provenance de la Chine, d’Ukraine, d’Allemagne, d’Espagne ou d’Argentine, ont augmenté de près de 60 %. Ces mélanges et les pays d’origine n’apparaissant pas, les consommateurs ne sont pas informés.
Or des tests effectués par des associations ont pourtant permis de constater du miel frelaté, artificiel, des ajouts de sucre et de sirops de sucre dans les miels importés.
Toujours dans un souci de transparence et de bonne information des consommateurs, mais aussi afin de mettre en valeur nos productions françaises, nous nous devons d’être plus ambitieux ! C’est pourquoi nous sommes favorables à l’inscription par ordre décroissant des pays d’origine.
Cette négociation doit également être portée à l’échelon européen afin de soutenir une filière en grande difficulté, confrontée au déclin du nombre d’abeilles dans l’Hexagone. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous.
Enfin, j’en viens à l’article 4, qui a suscité de nombreux débats en commission et lors de l’examen du projet de loi Égalim. Nous avons tous ici été interpellés à ce sujet, surtout ceux d’entre nous qui sont issus de régions viticoles.
Si l’on considère que le droit en vigueur est suffisant, les contrôles sont, quant à eux, largement déficients. Les étiquettes de certains vins issus de pays étrangers donnent à penser qu’ils ont été produits en France à partir de récoltes du vignoble français. C’est de la fraude, oui, et le consommateur est trop fréquemment induit en erreur !
Ces pratiques sont préjudiciables à toute une filière, laquelle est importante, puisqu’elle représente 15 % de la production agricole française. La clarification des règles d’étiquetage et l’indication visible de la provenance de ces vins sont donc primordiales pour assurer l’information claire et loyale du consommateur.
Nous vous interpellons aujourd’hui, monsieur le ministre, sur le manque de moyens alloués aux contrôles de la DGCCRF, la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes.
Enfin, mes chers collègues, je regrette que les amendements sur le maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte viticole, très largement soutenus, aient été déclarés irrecevables par la commission des affaires économiques. Cependant, je suis heureuse que le sujet ait été repris par nos collègues députés à l’article 8 de leur proposition de loi.
( M. Bruno Sido s ’ exclame.) Je vous demande de faire avancer ce dossier, indispensable pour nos producteurs, afin de valoriser notre agriculture et la France.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour vos propos. En effet, les agriculteurs, notamment les éleveurs, doivent décider du prix de vente de leurs produits, et non pas le subir. Nous sommes tous ici d’accord, je pense, sur ce principe. §

Mes chers collègues, je vous demande de bien respecter votre temps de parole : nous devons examiner deux propositions de loi cet après-midi, dans un temps contraint.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui prévoit de réintroduire des dispositions votées dans la loi Égalim, mais ayant été censurées par le Conseil constitutionnel.
Cette proposition de loi a donc plusieurs objectifs : il s’agit de permettre une certaine diversification des productions, une valorisation de certains signes de qualité et une information plus éclairée des consommateurs. Dans les faits, il s’agit de continuer à protéger certaines appellations d’origine, tout en permettant aux agriculteurs de valoriser des productions qui ne correspondent pas forcément aux cahiers des charges.
L’article 1er permet l’usage de la mention « fermier » sur les fromages bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine et dont l’affinage a lieu en dehors de l’exploitation, dès lors que le consommateur en est informé.
L’article 2 abroge la loi de 1957, qui interdisait aux viticulteurs de produire d’autres vins mousseux que de la Clairette de Die au sein de l’AOC du même nom. Si cet article est adopté, il permettra aux producteurs de ce territoire de diversifier leur production et de proposer des vins plus en vogue aujourd’hui chez certains consommateurs, notamment des vins mousseux rosés, afin d’améliorer leurs revenus. Ils ne pourront toutefois pas, et c’est logique, nommer ce vin « Clairette de Die », dans la mesure où le cahier des charges de l’AOC ne le prévoit pas.
Ce texte prévoit également la mention sur les étiquettes de l’origine des miels issus de mélanges de productions, mais aussi l’indication obligatoire du pays d’origine des vins, afin de permettre une information éclairée du consommateur et de lutter contre les contrefaçons ou les indications abusives d’origines.
Si nous partageons l’objectif central de ce texte, nous devons cependant veiller à ce qu’il ne dénature pas la protection accordée à certains produits ; je pense au label fermier pour les fromages.
Lors des auditions auxquels nous avions procédé en vue de la préparation de la loi Égalim, nous avions été alertés sur les risques d’une extension du label « fromage fermier » aux fromages ne bénéficiant pas d’un signe de qualité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre groupe n’avait pas voté l’article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, laquelle renvoyait à « la notion d’usages traditionnels » pour délivrer le label « fromage fermier ». Cette formulation ne permettait pas de se prémunir contre des risques d’industrialisation.
À l’heure où les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine sont dangereusement attaqués du fait de la prolifération des traités de libre-échange, il est impératif de ne pas les fragiliser.
Il faut au contraire les valoriser. En effet, ils permettent de créer de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne alimentaire. Ils favorisent la variété et la diversification de la production. Ils protègent bien évidemment les bassins de production traditionnels, valorisent le savoir-faire des agriculteurs, et permettent aux producteurs de commercialiser des produits différenciés ayant des caractéristiques clairement identifiables.
Ces produits ont d’ailleurs un poids économique réel. Le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, rappelait ainsi en 2016 que les quelque 1 100 produits sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine représentaient un chiffre d’affaires total de 30 milliards d’euros, soit plus d’un tiers de la valeur de la production agricole française.
Pourtant, de nombreux traités menacent ces signes officiels, qu’il s’agisse du TAFTA, le traité de libre-échange transatlantique, de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, ou encore du CETA, l’accord économique et commercial global, dont nous attendons toujours de connaître la date de ratification par le Parlement.
Ainsi, le Canada n’a reconnu que des indications protégées européennes. Sur près de 1 400 IGP, seuls 173 produits ont été reconnus. En outre, la protection qui leur sera accordée est loin d’être absolue, puisque le Canada a négocié le maintien provisoire ou définitif de certaines appellations similaires existantes.
C’est pourquoi nous insistons, monsieur le ministre, sur la nécessité d’exclure l’agriculture du champ des négociations des accords de libre-échange.
Sinon, nous pourrons toujours produire des rapports ou mettre en avant l’unanimité qui prévaut ici lorsqu’il s’agit de défendre notre agriculture, la qualité de nos produits, les consommateurs, l’augmentation des revenus des agriculteurs afin que ceux-ci puissent vivre dignement, nous verrons, du fait de la mondialisation accrue et des lois commerciales de plus en plus rudes pour les plus petits, indépendamment de la loi Égalim, disparaître, à force d’être fragilisés, celles et ceux qui s’efforcent aujourd’hui de produire une agriculture saine, de qualité et accessible au plus grand nombre.
Finalement, notre belle agriculture, la belle gastronomie française que vous évoquiez, monsieur le ministre, ne sera plus dans quelques années qu’un lointain souvenir. Ce serait bien dommage !
En l’état, nous voterons ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le sujet abordé dans cette proposition de loi est essentiel.
La bonne information du consommateur est nécessaire, à la fois pour répondre à une demande légitime de transparence sur l’origine et la fabrication des produits, mais aussi parce qu’il s’agit d’un réel levier pour changer les modes de production et évoluer vers des pratiques plus vertueuses. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter, par leur acte d’achat, valoriser les producteurs qui s’engagent pour la qualité et pour le respect de l’environnement et de la biodiversité, les deux étant très liés.
La nécessité d’informer le consommateur avait d’ailleurs été clairement établie lors des États généraux de l’alimentation. C’est pourquoi les parlementaires ont enrichi par voie d’amendements la loi Égalim, laquelle faisait suite à des mois de consultation, et y ont introduit plusieurs articles sur ce sujet.
Toutefois, comme cela a déjà été indiqué, le Conseil constitutionnel a estimé que ces articles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte. J’ai été, pour ma part, sidéré – il n’y a pas d’autre mot – par cette décision. Comme je l’ai dit, la bonne information du consommateur et les mentions valorisantes sont des leviers indispensables de la transition de notre agriculture.
Je remercie donc Marie-Pierre Monier et le groupe socialiste et républicain de leur initiative, qui vise à réintroduire une partie des articles censurés par le Conseil constitutionnel, ceux qui portent sur les mentions et signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine valorisant les produits agricoles.
C’est d’autant plus nécessaire que certaines mesures me paraissent urgentes, notamment l’étiquetage de l’origine des miels. En effet, nous connaissons tous les difficultés de nos apiculteurs, affectés par les fortes mortalités de leurs colonies, mais aussi par une concurrence qui paraît à bien des égards extrêmement déloyale. En effet, la France importerait près des trois quarts des miels qu’elle consomme. Et, nous le savons, certains pays pratiquant des prix extrêmement bas sont trop souvent épinglés pour des fraudes, comme l’ajout de sirop de sucre.
Dans ce contexte, le consommateur ne dispose même pas de l’information minimale, la pratique des mélanges de miels permettant jusqu’à présent d’échapper à l’obligation de mentionner l’origine du produit. Pour ma part, je trouve que le mélange de miels d’importation devrait être remis en cause en lui-même, car cette pratique est propice à la fraude.
L’étiquetage des pays d’origine est donc un minimum. Pour aller plus loin, je défendrai des amendements visant à prévoir l’affichage des pourcentages pour chaque origine.
En commission, on nous a opposé le droit européen, qui nous empêcherait d’adopter l’affichage du pourcentage. Or il est déjà pratiqué par la Grèce depuis 2011 et les Espagnols se préparent à l’adopter !
Par ailleurs, je suis convaincu que voter cette mesure aujourd’hui ne pourra que contribuer à accélérer un changement à l’échelon européen. La France doit être leader pour faire bouger l’Europe, parce que l’Europe doit bouger. Nous verrons plus tard la question des sur-transpositions, mais, au final, c’est nous qui aurons raison. Nous allons tirer l’Europe vers le haut.
Une autre question me paraît urgente – elle aussi a été victime de la censure du Conseil constitutionnel. Je pense, et cela ne vous surprendra pas de ma part, à l’étiquetage des huîtres, selon qu’elles soient nées en mer ou en écloserie.
Ce sujet n’a pas été repris dans la proposition de loi, et je le regrette. Je défendrai donc encore une fois, avec force, un amendement en faveur de cet étiquetage. Je sais qu’il ne sera pas adopté, mais sachez qu’il finira par l’être dans quelque temps – je pourrais prendre les paris –, tant la demande et les enjeux sont forts.
Je proposerai également un amendement visant à aller plus loin s’agissant de la protection de la mention « fromage fermier. » En effet, cette mention doit pour moi rester attachée, comme c’est le cas aujourd’hui, aux fromages affinés à la ferme. Il s’agit d’éviter une banalisation de cette mention valorisante.
En nous appuyant sur la position des producteurs de fromages fermiers, nous proposerons qu’elle soit autorisée pour l’affinage à l’extérieur de la ferme seulement pour les mentions liées à l’origine, qui garantissent un véritable lien au terroir, et à condition que le nom du producteur soit indiqué sur l’étiquette.
La rédaction actuelle pourrait entraîner des dérives. On sait déjà que l’industrie, dont Lactalis, a racheté des structures d’affinage, afin de récupérer cette mention valorisante.
Pour finir, cette proposition de loi, qui vise à renforcer l’information du consommateur, va dans le bon sens : promouvoir, via l’information du consommateur, la qualité et le lien au terroir est vertueux. Toutefois, un risque d’appropriation par l’industrie pèse sur ces mentions valorisantes. Comme pour l’agriculture biologique, il faut défendre une forte exigence des mentions valorisantes, sous peine de pénaliser l’ensemble des filières.
Comme les autres membres de mon groupe, je voterai cette proposition de loi, qui, je le répète, va dans le bon sens.
Il est urgent de répondre à toutes les questions liées à l’origine de notre consommation alimentaire. Or, à écouter les uns et les autres, on n’a pas l’impression que la situation est urgente ! Il y a pourtant urgence climatique, en raison du dérèglement climatique, et urgence « biodiversitaire », parce qu’il y a une perte considérable de la biodiversité.
Il est donc vital d’accélérer la transition vers un nouveau modèle agricole, respectueux de la biodiversité, et de relocaliser l’alimentation, afin d’assurer la souveraineté alimentaire à l’échelle de la planète.
La mondialisation de l’alimentation est un non-sens dans le contexte d’un nécessaire processus de résilience collective !
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe La République En Marche et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, l’agriculture française est riche de ses nombreux producteurs. Dans toutes les régions, ceux-ci sont passionnés par leur métier, produisant des produits de qualité reconnus dans le monde entier.
L’excellence alimentaire française est renforcée par les signes et les labels de qualité. Ces emblèmes de notre modèle connaissent un succès croissant, en réponse à une demande accrue de qualité de la part des consommateurs.
D’après un recensement agricole récent, 49 000 exploitations agricoles réalisent au moins une production sous AOP, IGP ou label rouge, hors produits viticoles. S’y ajoutent 76 500 exploitations viticoles et plus de 25 000 exploitations engagées en agriculture biologique. Au total, près de 30 % des exploitations françaises sont concernées par les signes d’identification de la qualité et de l’origine, ou SIQO. C’est considérable, et ce doit être un motif de fierté nationale. Nous devons les encourager, les soutenir, les promouvoir !
Ces labels français et européens présentent en effet de nombreux avantages : d’une part, la garantie de la qualité, de la provenance et des méthodes de fabrication pour le consommateur ; d’autre part, une meilleure visibilité, une reconnaissance d’un travail de qualité, ainsi qu’une meilleure rémunération pour le producteur.
Il faut, en contrepartie, veiller à la pertinence de ces labels et signes de qualité, adaptés pour ne pas induire en erreur le consommateur. C’est le sujet de l’article 1er, visant à préciser l’emploi du label fermier. Je soutiens cette démarche : elle s’inscrit dans le cadre d’un dialogue ouvert et transparent avec toutes les parties intéressées et ne dénature pas le sens de ce label, assurant ainsi une bonne information du consommateur.
Il faut, en effet, l’adapter à la réalité du terrain tout en préservant les intérêts de ces producteurs fermiers. Présents dans tous les territoires, ils participent à la richesse de la gastronomie française. Il doit ainsi être indiqué clairement sur l’avant de l’emballage des produits à la fois le nom du producteur et celui de l’affineur.
L’article 3 concernant le miel va également dans le bon sens. Réclamé par le secteur apicole, le groupe Les Indépendants – République et Territoires l’avait déjà défendu lors de la discussion du projet de loi Égalim, par la voix de ma collègue Colette Mélot.
Nous défendrons les producteurs français, alors que le miel est une denrée de plus en plus convoitée par les Occidentaux. Entre 2008 et 2015, sa production mondiale a augmenté de 8 %, et les exportations de 61 %. Depuis 2015, de nombreux pays européens ont accru leurs exportations de miel, mais aussi leurs importations en provenance de Chine.
En France, plus de la moitié du miel consommé sur le territoire est issu de l’importation. Cette situation peut impliquer des méthodes trompeuses. Ainsi, quelque 45 % des miels seraient d’une origine différente de celle mentionnée sur le pot, sans parler des mélanges au glucose, des miels dilués à l’eau et autres mélanges de miels divers et variés.
Pour contrer ces méthodes trompeuses et mieux protéger le miel, il est important de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine des miels issus de mélanges de productions, et ce en ordre décroissant. L’ensemble des pays d’origine du miel produit et mélangé sera ainsi connu des consommateurs. Nous protégeons donc les producteurs français, tout en valorisant un miel de qualité.
Le sujet de l’étiquetage des miels est similaire à celui des vins. Lorsque nous touchons au patrimoine national, nous nous devons de réagir, tout d’abord en condamnant les actes frauduleux trompant l’État français et les consommateurs.
La pratique de la naturalisation du vin espagnol, devenue courante, est ainsi inadmissible : on parle de 10 millions de bouteilles de rosé ! Les outils pour combattre ces actes délictueux existent. Les agents de la répression des fraudes contrôlent régulièrement les importateurs français de vins étrangers, mais le constat est là. Le dispositif en place est-il assez dissuasif ?
Nous devons adopter de nouveaux outils législatifs. Nous devons aussi, et avant tout, renforcer l’application du dispositif existant pour combattre ces tromperies des consommateurs. Bien entendu, la priorité doit rester la bonne information du consommateur. Ce dernier doit être en mesure de faire des choix, en ayant toutes les informations nécessaires quant à la qualité et la provenance.
Un contrôle plus strict de l’étiquetage serait souhaitable, notamment en mentionnant l’origine de chaque côté du contenant. L’offre gagnerait d’ailleurs en clarté si les revendeurs évitaient toute confusion dans leurs rayons en séparant clairement les vins français des vins étrangers.
Ces mesures permettent donc de compléter la loi Égalim et d’envoyer un message sur l’importance de la défense des productions agricoles françaises. C’est une force de notre pays qu’il nous revient de promouvoir. C’est aussi une façon de renforcer la bonne information du consommateur, lui permettant ainsi de faire des choix alimentaires éclairés.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires est favorable à cette proposition de loi avec les amendements proposés.
Applaudissements au banc des commissions.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, chers collègues, nous sommes nombreux, dans cet hémicycle, à avoir regretté que la loi qui devait décliner les états généraux de l’alimentation ne soit pas allée plus loin.
Finalement, la loi Égalim n’aura permis ni de garantir un revenu réellement rémunérateur pour les agriculteurs ni d’améliorer réellement l’accès à une alimentation saine, durable et de qualité. Il était donc d’autant plus regrettable que les quelques avancées obtenues au cours de nos travaux aient été retoquées par le Conseil constitutionnel, pour une raison de forme.
Il n’était bien évidemment pas possible pour nous de nous pencher de nouveau sur l’ensemble des dispositions rejetées. Avec cette proposition de loi, notre collègue Marie-Pierre Monier nous invite donc à nous concentrer sur l’amélioration du dispositif relatif aux signes de qualité et d’origine.
Cette démarche me semble tout à fait pertinente, les SIQO étant fortement emblématiques de ce que nous voulons pour l’agriculture et l’alimentation de demain. Ils permettent en effet de valoriser la qualité des produits, le savoir-faire de nos producteurs, y compris à travers le prix de vente.
Avec les SIQO des produits fermiers, seul le producteur reçoit le bénéfice de la plus-value dont il est à l’origine. Ils constituent aussi l’une des réponses à la demande croissante des consommateurs d’une plus grande transparence en matière de qualité et de sécurité alimentaire.
Plusieurs des dispositions de ce texte sont ainsi très attendues par les agriculteurs. La plupart de ces mesures avaient été adoptées à une large majorité, tant dans cette chambre qu’à l’Assemblée nationale. Elles ne devraient donc pas a priori susciter de clivage politique profond entre nous. D’ailleurs, j’imagine que nos collègues du groupe Les Républicains, en saisissant le Conseil constitutionnel, n’avaient pas particulièrement l’intention de faire tomber ces dispositions, qu’ils avaient eux-mêmes soutenues.
Le choix, inhabituel pour un texte qui ne comporte que cinq articles, de deux corapporteurs, issus l’un de notre groupe et l’autre de la majorité sénatoriale, marque cette volonté de parvenir à un consensus large sur cette proposition de loi. Henri Cabanel et Anne-Catherine Loisier, qui étaient rapporteurs de ces mêmes articles pour la loi Égalim, pourront ainsi enrichir nos débats de leur expertise.
Nous aurons peut-être des divergences sur la rédaction « technique » de ces articles, notamment à l’article 4, mais nous souhaitons réellement parvenir à un accord, afin que les SIQO puissent bénéficier de la juste reconnaissance que cette proposition de loi peut leur apporter.
C’est aussi pour cela que nous avons fait le choix, à l’article 1er et, initialement, à l’article 3, de nous en tenir à la rédaction de l’Assemblée nationale lors de la dernière lecture de la loi Égalim. Nous souhaitions ainsi permettre à ce texte d’être le mieux armé pour affronter les écueils de la navette parlementaire.
L’article 2 ne devrait pas poser de difficulté puisqu’il est rédigé dans les mêmes termes que la proposition de loi concernant la Clairette de Die de notre collègue Gilbert Bouchet, laquelle est d’ailleurs annexée au présent texte.
Avec cette proposition de loi, nous avons la possibilité de mieux reconnaître et protéger des produits français qui sont constitutifs de notre patrimoine commun. Je pense, en particulier, aux vins et aux fromages fermiers.
Nous avons l’occasion de redonner de la sérénité aux consommateurs qui veulent pouvoir acheter en confiance des produits de qualité, sains et au moindre impact environnemental. La question de l’étiquetage des miels en est particulièrement symbolique.
Enfin, nous avons une occasion de nous appuyer sur de bonnes pratiques existantes, en les confortant, afin de faire un pas supplémentaire vers le modèle agricole que nous avons le devoir de mettre en place pour notre planète et les générations qui vont nous succéder.
Pour ces raisons, mon groupe votera ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. Joël Labbé applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat avait amendé la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, afin d’améliorer le revenu des agriculteurs et de réduire leurs contraintes réglementaires, d’une part, et de protéger l’information et la santé des consommateurs, d’autre part.
L’Assemblée nationale n’a pas retenu toutes nos remarques, c’est le moins que l’on puisse dire. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a censuré quelques articles, notamment ceux qui étaient exposés dans la proposition de loi de nos collègues Marie-Pierre Monier et Gilbert Bouchet telles que l’affichage de la provenance des vins et du miel ou la notion qualificative de fromages fermiers.
Les raisons invoquées pour exclure ces articles du texte voté par les députés sont qu’ils n’auraient pas de lien avec le texte visant à une alimentation saine et durable. En revanche, le Conseil constitutionnel a validé que la fin des pics à steak ou des plateaux-repas en plastique avaient, quant à eux, bel et bien un rapport avec le texte… Soit !

Le Sénat a pris acte de cette décision et propose de reprendre certaines des dispositions censurées. Il le fait avec un esprit d’ouverture et de consensus, puisque cette initiative législative émane des groupes socialiste et républicain et Les Républicains, et reprend quelques-unes des dispositions introduites par des membres du groupe Union Centriste. Nous travaillons donc à l’intérêt général.
Si ce texte est voté, monsieur le ministre, soyez convaincant auprès de nos collègues du Palais Bourbon afin qu’eux aussi répondent à l’intérêt général.

Si les sénateurs réintroduisent si rapidement ces mesures, c’est que leur portée est partagée et dense.
D’une part, nous souhaitons protéger nos appellations dans un monde qui tend à s’uniformiser. Les fromages sont l’une des identités de notre patrimoine culinaire français. Ils font partie des ingrédients élémentaires du repas gastronomique français reconnu par l’Unesco, vous l’avez signalé, monsieur le ministre.
D’autre part, il s’agit également d’assurer la compétitivité de la Ferme France, ce qui aurait dû être l’un des objectifs de la loi Égalim.
La concurrence libre et non faussée est un pilier de la construction européenne et des règles qui organisent le marché commun et le commerce international. Par les dispositions présentes et par certains amendements qui seront débattus aujourd’hui, la transparence due aux consommateurs s’améliore : les producteurs français et européens pourront mettre en valeur leurs produits et se servir de cette visibilité retrouvée pour développer leur secteur et, pourquoi pas, augmenter et rendre de la valeur ajoutée à leurs productions.
Si je prends l’exemple du miel, traité à l’article 3, la France en consomme près de 40 000 tonnes par an, ce qui la place parmi les plus forts consommateurs d’Europe. Or seulement 20 000 tonnes au mieux, soit la moitié environ, sont fournies par des apiculteurs français. La valorisation de leur gamme leur donnera un souffle nouveau.
Donner des précisions sur la provenance de l’origine des miels est une idée simple et bienvenue. En effet, on pouvait lire, conformément à la réglementation : « Mélange de miels originaires et non originaires de l’Union européenne »… Autant inscrire « Miel de la planète Terre », on donnerait autant d’informations à l’amateur de produits sucrés ! §Citer les pays, et cela conformément au droit européen, renverse cette tendance. Voilà une sorte de « sur-transposition » des normes européennes en France que personne ne devrait contester !
Les auteurs de la proposition de loi souhaitent également que l’étiquette d’une bouteille de vin ou de tout autre contenant comporte en évidence la mention du pays d’origine afin de ne pas induire en erreur le consommateur, même si des attributs français, comme le nom, un dessin de château, perturbent la compréhension du produit. Les rapporteurs ont estimé que l’article 4 ne changerait pas la donne.
En revanche dans le rapport, une phrase m’interpelle : « La provenance doit donc être précisée selon des formules précisées à l’article 45 de ce règlement : “vin de” ou “produit de”, suivi du nom de l’État membre où les raisins sont “récoltés et transformés en vin” ».
Comme il n’est fait référence qu’aux États membres de l’Union européenne, la rédaction proposée par cette proposition de loi constituera-t-elle une avancée pour la transparence à l’égard des vins des pays tiers ? En tout état de cause, permettez-moi un aparté, à un mois et demi des élections européennes : si l’Europe est souveraine pour l’inscription de la décroissance des ingrédients d’un bien de consommation sur une étiquette, on peut comprendre que nos concitoyens s’interrogent sur son efficacité.
C’est pourquoi je maintiens que définir clairement l’origine de nos produits, notamment pour le miel, épouse parfaitement les attentes des consommateurs français et européens et ne trahit pas l’esprit de l’Union européenne de la défense du droit des consommateurs.

Faire apparaître tous les pays et, de surcroît, par ordre d’importance ne choquera pas, je pense, les commissaires de Bruxelles. De plus, monsieur le ministre, je veux croire que vous serez un ambassadeur fidèle de la volonté du Parlement français de défendre les droits des consommateurs et n’aurez donc pas de mal à convaincre vos collègues européens.
J’ajouterai par ailleurs que ces normes auront d’autant plus d’efficacité que les contrôles seront nombreux et coercitifs, ce qui ne manque pas d’inquiéter au regard des moyens alloués à la DGCCRF.

Ce sont des mots, monsieur le ministre, que j’ai déjà prononcés lors de l’examen budgétaire, que ce soit pour le Brexit ou pour tous les autres contrôles : il faut suffisamment de vétérinaires et d’agents de répression des fraudes pour respecter les règles.
Le respect des normes, c’est ce qui fait la qualité des productions et la confiance des consommateurs. Le respect des normes, c’est aussi l’expression d’un terroir et de ses produits qui peuvent être mentionnés dans le cahier des charges d’une appellation.
La Clairette de Die répond à ces exigences. Un accord local semble unanime pour abroger la loi du 20 décembre 1957. S’il n’est Clairette de Die qu’en vallée de la Drôme, l’interprofession y veillera. Je n’ai que très peu de mots à dire à ce sujet puisque tout le monde semble unanime et j’imagine, monsieur le ministre, que vous avez un avis très personnel sur ce sujet.
Ce menu législatif nous amène bien évidemment au fromage…
Sourires.

Comme l’a détaillé le rapport d’Anne-Catherine Loisier, l’article 9-1 du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages encadre déjà très strictement ces pratiques en réservant l’usage de la mention aux fromages fabriqués « selon des techniques traditionnelles ».
Une loi est cependant nécessaire pour permettre de nouveau l’affichage de la mention « fromage fermier » en cas d’affinage à l’extérieur de la ferme, et les modalités techniques encadrant cet affichage sont à définir au niveau réglementaire. Monsieur le ministre, il vous appartiendra donc de prendre les dispositions administratives accomplissant la volonté du législateur.
Mes chers collègues, le groupe Union Centriste se prononcera favorablement sur cette proposition de loi si celle-ci reste dans l’esprit des mesures introduites par le Sénat lors de l’examen de la loi Égalim et si les productions agricoles hexagonales sont préservées et défendues. Quelques amendements ont été déposés, dont l’adoption devrait permettre de parfaire ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, monsieur le ministre, j’adresse mes remerciements au président Larcher, aux deux présidents de groupe MM. Retailleau et Kanner, à ma collègue Marie-Pierre Monier, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la commission des affaires économiques, qui me permettent d’intervenir ce jour, afin de vous présenter ma proposition de loi tendant à abroger la loi de 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la Clairette de Die à l’intérieur de l’aire géographique de production des appellations « Clairette de Die ».
La Clairette de Die constitue la production principale des viticulteurs du Diois. Elle est élaborée d’après la méthode dioise ancestrale, issue de l’assemblage de muscat blanc et de la clairette blanche.
En 1908, la Clairette produite était blanche ou rosée. L’appellation d’origine datant de 1910, il faut préciser que, dans le premier cahier des charges AOC de 1942, la production de rosé n’avait pas été mentionnée. En décembre 1957, date à laquelle a été votée la loi visant à interdire la production de tout vin effervescent hors AOC dans l’aire d’appellation, il est apparu nécessaire de protéger l’appellation naissante « Clairette de Die » contre la concurrence déloyale des vins étiquetés « clairette muscat ».
Cette proposition de loi se compose de la manière suivante : le premier article dispose que toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die et « Crémant de Die » est interdite dans l’aire géographique de production concernée. L’article 3 prévoit des sanctions en cas de méconnaissance de cette interdiction.
Force est de constater que, depuis cette époque, les goûts des consommateurs ont changé. Il est donc apparu normal, aujourd’hui, de permettre aux producteurs du Diois d’adapter leur gamme à la demande de la clientèle, afin de sauver leurs entreprises et de répondre aux nouveaux enjeux du XXIe siècle.
Ils ont souhaité produire des vins mousseux « rosés » sous appellation « AOC Clairette de Die », conscients de la nécessité d’une modification du cahier des charges de l’AOC. En 2016, cette dernière a été homologuée par un arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et la production de ces vins effervescents rosés a donc démarré. Depuis lors, deux décisions juridiques sont venues stopper ce processus.
La première est celle du Conseil d’État, qui a annulé l’arrêté homologuant le cahier des charges de la Clairette de Die, mettant en graves difficultés trois cents vignerons drômois. Il leur a été demandé de cesser toute production et de rappeler toutes les bouteilles mises sur le marché, soit l’équivalent de 1, 5 million de bouteilles.
La seconde est intervenue à la fin de l’année 2018, à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi Égalim. Elle a entraîné la censure de l’amendement d’abrogation de la loi de décembre 1957, pourtant voté en termes identiques par les deux assemblées, au motif qu’il s’agissait d’un cavalier budgétaire.
Face à la concurrence de pays voisins, producteurs en grande quantité de vins rosés, l’évolution législative est fondamentale pour maintenir la vitalité de cette partie de la Drôme.
Conscient de cette situation délicate, je vous ai alerté dès le mois de janvier, monsieur le ministre, par le biais d’une question orale sur ce dossier que, en tant que Drômois, vous connaissez bien, et j’ai décidé de reprendre les modifications portées par l’amendement adopté dans la loi Égalim sous la forme d’une proposition de loi, afin d’attirer votre attention et celle de l’ensemble de mes collègues sur les conséquences économiques désastreuses pour la Drôme.
Sur ce dossier, nous avons été entendus, je le crois, pour essayer de résoudre le problème.
Nous avons été entendus par la Haute Assemblée, qui a bien voulu inscrire à l’ordre du jour, de façon conjointe avec Marie-Pierre Monier, et je l’en remercie, nos deux propositions de loi, prouvant qu’au Sénat nous travaillons dans un esprit constructif.
Nous avons été entendus également sur le terrain puisque, en collaboration avec mon collègue Chaize, sénateur de l’Ain, nous travaillons, avec les représentants des fédérations de vins de nos régions respectives, à la rédaction d’un protocole d’accord permettant, d’un côté, d’écouler ce stock, et, de l’autre, de s’engager à ce qu’aucun vin effervescent de couleur rosé présenté comme de la « Clairette de Die » ou effervescent de son ressort ne soit élaboré à l’avenir en l’absence de bases réglementaires.
Fort de tout cela, je vous demanderai de bien vouloir voter pour l’abrogation de cette loi du 20 décembre 1957 relative à la Clairette Die. Ainsi, pour reprendre une phrase employée précédemment : le soleil brille pour tout le monde !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, chers collègues, pour le citoyen qui en fait un enjeu de confiance, pour le consommateur qui s’y réfère dans son choix et pour le producteur qui y trouve le moyen de la différenciation et de la performance économique, la transparence, la traçabilité et les conditions de production sont aujourd’hui et plus que jamais au centre de l’acte commercial alimentaire.
Ces principes figuraient en bonne place dans la loi Égalim adoptée, et nous avons trouvé pour le moins surprenantes les très nombreuses décisions de rejet par le Conseil constitutionnel des articles les traduisant.
Montesquieu disait qu’il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante. Certainement faut-il aussi saisir le Conseil constitutionnel d’une main tout aussi tremblante. Nous avons perdu du temps, le travail est à reprendre… Soit ! Je tiens à remercier Marie-Pierre Monier, les rapporteurs Anne-Catherine Loisier et Henri Cabanel, ainsi que tous nos collègues qui se sont saisis de l’opportunité de cette proposition de loi pour remettre sur le métier l’ouvrage de la valorisation des produits agricoles et alimentaires.
L’article 1er, en complément de l’arrêt du Conseil d’État relatif à l’usage du mot « fermier », permet l’affinage extérieur à la ferme de produits sous SIQO si les liens entre les producteurs, le produit final et les pratiques traditionnelles d’affinage sont avérés. Le dispositif est offensif, tout en respectant le client final. Ce sera un progrès.
L’article 2 prend en compte des productions de vins en AOC, en permettant leur adaptation au changement climatique et à l’attente des consommateurs. Du pragmatisme qui ne lèse personne et qui conforte les économies territoriales concernées, drômoises en l’occurrence.
L’abrogation de la loi de 1957 ne provoquera pas la disparition de l’AOC « Clairette de Die » ou le changement de son cahier des charges. Elle permettra aux producteurs concernés de se diversifier dans une autre production, les vins mousseux rosés notamment, afin d’améliorer leurs revenus.
Toutefois, et c’est essentiel, ce vin ne pourra pas être appelé « Clairette de Die », dans la mesure où le cahier des charges de l’AOC ne le prévoit pas. Ce sera un vin mousseux rosé, produit dans la Drôme, qui pourrait bénéficier d’une IGP ou d’une appellation spécifique dans cinq ans, dix ans ou plus.
Pour protéger nos apiculteurs et informer le consommateur, il faut aller au-delà des strictes obligations européennes de 2001 concernant la provenance de l’UE ou hors de l’UE. Dans un contexte où la production de miel en France a été divisée par deux en quinze ans, la situation actuelle ne peut plus durer. Il y va de la survie de la filière française apicole, pour reprendre les mots du rapporteur Henri Cabanel ce matin en commission. Pour aller dans ce sens, l’article 3 précise l’étiquetage des miels par l’indication des pays d’origine et de la proportion des composants.
Dans le même esprit de respect du consommateur, la provenance des pays d’origine sera indiquée sur les étiquettes des vins vendus sans indication géographique. La renommée des vins français, le travail de nos vignerons n’en seront que mieux reconnus.
Aujourd’hui, en grandes surfaces, cela a été dit surtout pour les bag in box, les consommateurs sont dupés du fait que certains vins sont vendus comme français, en jouant sur l’étiquetage, le nom francisé, en mettant en valeur un cépage, alors qu’ils sont étrangers. Les cas de tromperie sont extrêmement nombreux, on le sait.
Pour aller toujours dans le même sens, celui de la transparence et du respect in fine du client, nous regrettons que, au titre de l’article 45, les amendements identiques portés par de nombreux groupes de notre assemblée et visant au maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte ne puissent être débattus et votés aujourd’hui par la Haute Assemblée.
Pour terminer, je veux saluer le travail très constructif réalisé au sein de la commission des affaires économiques sur ce texte. Les échanges ont été nourris, sans qu’à aucun moment soit perdu l’enjeu d’aboutir positivement. Pour l’essentiel, ce texte permettra de progresser vers plus de transparence et de respect des consommateurs. Les acteurs des filières concernées s’en trouveront, à n’en pas douter, renforcés.
Pour ces raisons, le groupe socialiste et républicain le votera.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. Joël Labbé applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le texte que nous avons à étudier aujourd’hui concerne diverses dispositions, issues de quatre articles du projet de loi Égalim censurés par le Conseil constitutionnel, au motif qu’ils n’avaient pas de lien direct avec le texte.
Pour ma part, je concentrerai mon intervention sur l’article 2 portant sur l’abrogation de la loi de 1957 protégeant l’appellation « Clairette de Die ». En effet, cet article avait été adopté conforme par les deux assemblées. Selon les auteurs de l’amendement à l’Assemblée nationale, cette loi était certes nécessaire à l’époque pour protéger l’appellation naissante Clairette de Die contre la concurrence déloyale des vins étiquetés « Clairette muscat », mais elle n’avait plus lieu d’être dès lors que cette protection est assurée par d’autres textes, nationaux et européens.
Vous n’êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, que ce sujet m’intéresse particulièrement, par rapport à la Clairette de Die, vin pétillant produit par les viticulteurs du Diois dans la Drôme, mais aussi et surtout par rapport à la situation conflictuelle avec les vins du Bugey §notamment le Bugey Cerdon, vin mousseux rosé produit dans l’Ain, ces vins bénéficiant tous deux d’une appellation d’origine contrôlée. Nous avons eu en effet à nous opposer, sur ses bancs, pour défendre nos territoires respectifs, et pour cause !
Je ne reviendrai pas sur les décisions juridiques qui ont définitivement tranché les procédures engagées. Je souhaite en revanche exprimer la bonne volonté des viticulteurs, qu’ils soient de la Drôme ou de l’Ain, pour trouver des solutions communes et intelligentes à la sortie du conflit les opposant. C’est en ce sens que nous avons œuvré, avec mon collègue Gilbert Bouchet, que je tiens ici à saluer au regard des actions que nous avons menées.
Mes chers collègues, je dois néanmoins vous avouer que l’inscription de ce texte dans cette période de négociations n’a pas facilité nos discussions.
Aussi, je tiens à annoncer aujourd’hui qu’un protocole d’accord a été conclu entre le Syndicat de la Clairette de Die et des vins du Diois et le Syndicat des vins du Bugey. Il doit faire l’objet d’une signature dans les prochains jours, pour venir clore définitivement cette situation, en redonnant à chacun une stabilité et une sérénité utiles.
Vous le voyez, monsieur le ministre, parole est tenue ! Je m’étais engagé à apporter une réponse pragmatique et rationnelle à ce sujet, tout en ayant à cœur d’y intégrer la valeur humaine.
Je veux ici remercier les rapporteurs, Anne-Catherine Loisier et Henri Cabanel, ainsi que l’ensemble de nos collègues. L’examen d’amendements à l’article 2 de la présente proposition de loi aurait eu pour seul effet de durcir les positions des uns et des autres, et ils ont eu la sagesse de ne pas en déposer.
Je suis heureux de constater que le bon sens et le pragmatisme ont primé pour venir à bout de ce dossier important pour nos territoires. Ils mettent en valeur notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, je vous le dis avec une pointe d’affection, vous avez beaucoup de talent ! Pour parvenir à se faire applaudir dans cet hémicycle sur la loi Égalim, que le Sénat n’a pas votée, il faut assurément être très fort !
Sourires.

En ce qui concerne la première partie de ce texte, comme vous le savez, nous avons mis en place un groupe de travail pour suivre les effets de la loi Égalim sur le revenu des agriculteurs. Nous auditionnerons demain Agnès Pannier-Runacher, qui dressera un premier bilan des négociations commerciales.
Ce matin, l’Association nationale des industries alimentaires, l’ANIA, a annoncé une diminution des prix alimentaires de 0, 1 % à 1 % – parfois plus –, et a confirmé que le « ruissellement » n’était pas au rendez-vous, puisque quelque 88 % des entreprises considèrent que la situation s’était plutôt dégradée.
Nous allons continuer à enquêter sur les effets de cette loi et y apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires. Nous attendons de vous, monsieur le ministre, que des contrôles soient réalisés partout sur le territoire français.
Également avec affection, je veux dire à notre collègue Noëlle Rauscent que je félicite La République En Marche d’avoir déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale. Nous ne revendiquons pas la paternité des bonnes initiatives, même si nous ne devons pas nous lancer dans une course entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ou entre les différents groupes politiques.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Il s’agit en l’occurrence d’un sujet d’intérêt partagé, et je remercie sincèrement Marie-Pierre Monier d’avoir accepté de lier sa proposition de loi à celle de notre collègue Gilbert Bouchet, tout comme je remercie Patrick Kanner d’avoir accepté ce regroupement en conférence des présidents.
Mme Françoise Férat et M. Gilbert Bouchet applaudissent.

Je précise également, notamment pour répondre aux interrogations de certains collègues, que nous avons intentionnellement resserré le texte sur quelques sujets très pointus que nous partageons tous. Ce faisant, il nous semble que nous avons d’autant plus de chance d’obtenir un vote conforme à l’Assemblée nationale et d’avancer vite sur ces points importants pour certains de nos agriculteurs. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas repris l’ensemble des articles annulés par le Conseil constitutionnel.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – M. le rapporteur applaudit également.

Je voudrais répondre aux orateurs sur quatre points.
Premièrement, le texte de l’Assemblée nationale, parce qu’il est beaucoup plus large, ne fait nullement concurrence à la présente proposition de loi, laquelle laisse de côté un certain nombre de sujets, qu’il faudra reprendre. Il n’y a donc pas de « course » entre les deux assemblées ; nous voulons simplement avancer.
Deuxièmement, en ce qui concerne le revenu des agriculteurs, je regrette, mais ce sont les filières qui ne sont pas allées assez loin ! L’article 1er de la loi Égalim confie en effet à celles-ci le soin de mettre en place un indicateur de coût. Or la filière laitière l’a fait, mais pas les autres. Il faut changer les habitudes.
Pour ma part, je n’ai jamais cru au ruissellement, madame la présidente. Je n’ai jamais pensé un instant, même en rêve, que l’augmentation des prix du Coca-Cola allait faire retomber de l’argent dans les cours de ferme ! En revanche, si l’on passe la marche avant et que l’on s’accorde sur un prix de base en deçà duquel on ne peut pas vendre ces produits, on y arrivera. Mais il faudra sans doute un ou deux ans pour cela.
Troisièmement, aucun accord international, quel qu’il soit, madame Cukierman, ne remet en cause les standards européens, notamment dans l’agriculture. Il n’y aura pas de poulet aux hormones, d’antibiotiques ou quoi que ce soit d’autre. C’est absolument faux !

Vous avez évoqué certains risques et certaines craintes, madame Cukierman. Vous n’en êtes certes pas responsable, mais, comme l’on dit en patois drômois, des fake news circulent sur ces sujets. Je le répète : aucun standard européen ne sera remis en cause par des produits venant de l’extérieur !
Quatrièmement, et enfin, quelque 6 000 contrôles ont été lancés par la DGCCRF, ce qui n’est pas rien, avec des vérifications pour chaque point de vente. Des amendes, parfois importantes, ont déjà été infligées, et le processus de contrôle suit son cours. Je tiens donc à vous rassurer sur ce point, mesdames, messieurs les sénateurs.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
TITRE Ier
ADAPTER LES MENTIONS VALORISANTES
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine au sens de l’article L. 640-2 du présent code, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa du présent article selon des modalités prévues par décret. »

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 1er vise à sécuriser le cadre juridique de l’affinage des fromages fermiers en dehors de la ferme, en comblant un vide juridique datant du 1er septembre 2015.
Nous savons qu’il va susciter des débats, comme il l’avait fait lors de la loi Égalim, et que des positions différentes vont s’affronter.
La rédaction actuelle de l’article permet un affinage extérieur à la ferme pour les seuls fromages répondant à un SIQO – un signe d’identification de la qualité et de l’origine –, dès lors qu’une information complémentaire est délivrée aux consommateurs.
Certains ne comprennent pas cette restriction et estiment qu’il faudrait l’ouvrir à tous les fromages. D’autres, à l’inverse, trouvent cette rédaction trop laxiste et considèrent qu’elle revient à dénaturer l’appellation « fromage fermier ». Cette différence de perception se retrouve également au sein de la profession, qui apparaît relativement divisée sur le sujet.
Ainsi, l’Association nationale des producteurs laitiers fermiers est opposée au fait d’ouvrir à tous les fromages fermiers la possibilité d’être affinés en dehors de la ferme. Elle nous a notamment fait part d’un phénomène actuel de rachat de petites structures d’affinage par de grands opérateurs industriels et des risques que cela représente pour la préservation de l’appellation. C’est pourquoi elle milite pour une rédaction plus restreinte de l’article 1er, qui limiterait aux seuls fromages AOP ou IGP, et non plus à tous les fromages sous SIQO, la possibilité d’être fermiers, avec de plus la précision du nom du producteur.
De son côté, le Conseil national des appellations d’origine laitières nous a transmis son souhait de ne réserver cette possibilité qu’aux fromages sous SIQO, dans une rédaction très proche de notre article actuel.
À l’opposé, des voix s’inquiètent du fait que notre rédaction enlèverait à certains producteurs n’étant pas sous SIQO la possibilité pour leurs produits d’être qualifiés de « fromages fermiers » – le nombre potentiel de producteurs concernés resterait toutefois faible, entre 500 et 700 d’après les chiffres qui nous ont été transmis.
Concernant le fait d’apposer sur chaque fromage le nom du producteur, nous y étions initialement favorables. Mais après des échanges avec des producteurs et des représentants de certaines appellations protégées, comme le Picodon, nous avons convenu que cette contrainte serait difficilement surmontable pour de petits affineurs. Nous pouvons donc constater que les positions sont très partagées sur le sujet et qu’aucune solution ne satisfera tout le monde.
C’est pourquoi le groupe socialiste a fait le choix de préserver cet article dans sa rédaction actuelle, dans une version que nous pourrions finalement qualifier de compromis.
Il s’agit de préserver l’appellation « fromages fermiers » dans toute sa spécificité, avec un gage de qualité lié aux SIQO, tout en garantissant aux consommateurs une véritable transparence sur les produits qu’ils consomment. En effet, soyons très vigilants à ne pas dévoyer le sens de l’appellation « fromage fermier ». Si un consommateur venait à se rendre compte que le fromage qu’il achète fermier est affiné, d’une part en dehors de la ferme, et, d’autre part, par de grands groupes industriels, c’est toute l’appellation qui pourrait en souffrir.
Les mots ont un sens, et nous ne pouvons pas faire comme si les consommateurs étaient hermétiques à cette question.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le ministre, si l’on peut se féliciter des propos que vous tenez dans la presse pour vanter tous les avantages de l’agriculture, il me semble que votre discours est parfois quelque peu paradoxal.
Premièrement, à force de dire que notre agriculture doit continuer de monter en gamme, on finit d’amplifier ce phénomène anxiogène qui fait que, dans notre pays, tout le monde doute de son alimentation. En effet, c’est finalement sous-entendre que notre agriculture n’est pas suffisamment montée en gamme auparavant.
Or, excusez-moi, mais les standards de l’agriculture française dépassent déjà tous les standards de tous les pays du monde producteurs de denrées agricoles ! Nous ne pouvons pas continuer de gravir l’échelle, alors que nous sommes déjà parvenus à sa cime et qu’il n’y a plus de barreaux.
Finissons-en avec cette fausse bonne idée. Les chiffres sont tenaces, monsieur le ministre : entre 2017 et 2018, le revenu des agriculteurs a baissé, en particulier pour les éleveurs, qui ont, de manière générale, subi une baisse de leurs revenus en raison d’une trop forte augmentation des charges et de la sécheresse.
Pour les éleveurs de bovins, c’est de 1 800 euros à 3 500 euros de moins par unité de main-d’œuvre, ou UMO, en moyenne. Mais le plus lourd tribut a été payé par la filière bio, avec une baisse de revenus pouvant aller jusqu’à 8 900 euros par UMO. Quant aux éleveurs de montagne, ils ont connu une baisse de 6 000 euros par UMO ! Ces chiffres montrent que nous ne pouvons pas éternellement monter en gamme si les marchés ne suivent pas. Le consommateur, notamment parce que votre gouvernement et le système français l’accablent de prélèvements, n’est pas prêt à mettre encore plus d’argent dans son alimentation.
Nous sommes aujourd’hui pris dans un système où toutes les lois vont dans le même sens. En dépit de la loi Égalim, nous continuons à donner à la grande distribution la possibilité de martyriser les producteurs et les transformateurs.
Monsieur le ministre, comment pouvez-vous continuer d’expliquer dans cette assemblée que le revenu des agriculteurs va augmenter, alors que je vous apporte les preuves du contraire ? Comment pouvez-vous expliquer que la loi Égalim va apporter des éléments positifs, alors que 77 % des entreprises agroalimentaires ont été obligées de concéder des marges et de baisser le prix de leurs produits ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, je vous remercie de respecter le temps de parole qui vous est imparti ! J’y veillerai désormais très strictement.
La parole est à M. Michel Raison, sur l’article.

Monsieur le ministre, je vous remercie de la loyauté avec laquelle vous défendez les agriculteurs français dans les médias.
Vous essayez de défendre avec la même loyauté votre gouvernement et votre prédécesseur. Pourtant, la loi Égalim est un texte d’illusionniste. En effet, que le prix soit construit dans un sens ou dans l’autre, les cours et les méthodes de la grande distribution restent les mêmes. Croire que l’on va sauver le revenu des agriculteurs uniquement par le biais du prix des achats de la grande distribution, c’est méconnaître l’ensemble du marché. En effet, le seul levier sur lequel le politique ne peut agir, c’est le prix du produit.
Veillons également à ne pas faire de la non-sur-transposition une religion ! Nous devons absolument lutter contre les sur-transpositions, qui mettent à mal les entreprises de notre pays, en raison des distorsions de concurrence qu’elles engendrent avec les autres pays européens. En revanche, lorsqu’on sur-transpose pour aider les consommateurs de produits alimentaires ou non alimentaires – je pense en particulier aux produits bancaires –, on peut se permettre de sur-transposer.
Par exemple, lorsque l’on impose une information supplémentaire sur les pots de miel, c’est une sur-transposition, mais je ne vois pas en quoi celle-ci pourrait créer une distorsion de concurrence pouvant nuire à nos apiculteurs. Au contraire, elle va les aider ! De même, si l’on décide d’indiquer sur les cartes des restaurants la région de provenance de tel ou tel pinot, par souci de transparence, c’est une noble sur-transposition, qui va aider nos producteurs et nos consommateurs.
Ne faisons donc pas une religion de la lutte contre les sur-transpositions, comme certains font une religion de la suppression des niches fiscales. Certaines sont utiles !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Joël Labbé applaudit également.

Monsieur le ministre, vous parliez des coûts de production et vous disiez que les indicateurs ne vous avaient pas été fournis par les filières. Or il y a un indicateur qui n’a pas été retenu par la loi Égalim, c’est celui de FranceAgriMer. Aujourd’hui, grâce à cette structure, nous connaissons les résultats comptables des exploitations agricoles pour l’an passé.
Laurent Duplomb a parlé de la baisse du revenu des agriculteurs, mais c’est sans compter les effets de la décapitalisation des cheptels.
Si les filières sont dans l’incapacité de fournir des indicateurs, je vous suggère, monsieur le ministre, de consulter les données de FranceAgriMer. Vous disposerez ainsi du véritable coût de production de l’ensemble des exploitations françaises, filière par filière. Si le Président de la République veut un revenu décent pour les agriculteurs, c’est à partir de ces chiffres que vous pourrez préparer l’agriculture de demain.

Je souhaite répondre à M. le ministre de l’agriculture sur les questions de libre-échange.
Loin de moi l’idée de vouloir répandre des fake news !

Le mot est à la mode chez les ministres… Il est désormais prononcé dès que nous voulons leur opposer des contre-arguments.
La question se pose à propos du CETA, par exemple. Ce n’est pas L ’ Humanité qui le dit, ni le CRCE, mais le groupe d’experts qui a remis un rapport au Premier ministre le 21 septembre dernier. J’en profite pour poser une nouvelle fois la question : quand allons-nous ratifier cet accord ?
Sourires.

Je rappelle qu’il est mis en œuvre de façon provisoire depuis septembre 2017, et que le Parlement devait se prononcer un an après, c’est-à-dire en septembre 2018. Si cet accord ne pose vraiment aucun problème, comme vous le dites, monsieur le ministre, il serait bon de fixer une date…
Le rapport évoque plusieurs problèmes, notamment un manque de transparence sur les questions des farines animales, des produits OGM et du niveau de pesticides utilisés dans le domaine agricole. Je vous propose donc d’alerter sur-le-champ le Premier ministre : le rapport qu’il a lui-même commandé est rempli de fake news !
Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Nous débattons de la manière de protéger notre agriculture et de mieux informer les consommatrices et les consommateurs. Nous sommes tous d’accord sur ces questions, mais nous disons aussi que le débat devrait porter sur les questions de libre-échange au niveau européen et mondial.
Je vous remercie par avance de vos réponses, monsieur le ministre.

Je voudrais tout d’abord remercier nos collègues d’avoir porté cette proposition de loi devant notre assemblée.
Respect des consommateurs, au travers de leur pleine information, santé publique, à travers la création de filières de qualité, emploi dans le milieu rural : les enjeux sont importants et rien ne justifie que l’on transige avec eux.
S’agissant de l’article 1er, il me semble en effet extrêmement important de sécuriser aujourd’hui l’appellation « fromage fermier », qui ne l’est plus depuis l’arrêt du Conseil d’État précité.
En revanche, nous ne devons pas non plus l’ouvrir trop largement. Il est notamment nécessaire d’autoriser l’appellation « fromage fermier » quand une affiche est apposée à l’extérieur de la ferme, car les cahiers des charges, en particulier des AOP, ont été le plus souvent élaborés avec les affineurs afin de garantir à la fois le respect du lien direct avec le producteur et l’usage de pratiques traditionnelles d’affinage.
Je viens d’une région où la quasi-totalité des producteurs de Saint-Nectaire affinent à l’extérieur, mais dans le cadre d’un cahier des charges contraignant. Une ouverture plus large pourrait donc aboutir à une mauvaise information donnée au consommateur. Notre ligne de conduite, dans toutes nos décisions, doit être la pleine information du consommateur !

Mes chers collègues, sans surprise, je vais vous demander de vous concentrer exclusivement sur le sujet de cette proposition de loi.
Notre collègue Jean-Pierre Sueur vient de m’annoncer qu’il avait besoin d’environ une heure et quart pour faire examiner la proposition de loi sur les biens mal acquis, qui est très attendue par les ONG.
M. Jean-Pierre Sueur acquiesce.

Si nous pouvions achever l’examen du présent texte à dix-sept heures dix, ce serait parfait !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pellevat, Mmes L. Darcos, Deromedi et Dumas, MM. Bonhomme, Morisset, Meurant, Paccaud et Cardoux, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Savary, Mme Micouleau, M. Chatillon, Mme Troendlé, MM. Mouiller et Vaspart, Mme Noël, MM. Vogel et Longuet, Mme Morhet-Richaud, M. Milon, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Bazin et Cambon, Mmes Bruguière, M. Mercier, A.M. Bertrand, Berthet et Bories, MM. Raison, Cuypers, Pointereau, Bonne et Mayet, Mme Deseyne, MM. Pierre, Husson, Sido et Revet, Mme Lassarade et M. B. Fournier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa, par la mention “fabriqué à la ferme” suivie du nom du producteur, puis “affiné par l’établissement” suivie du nom de l’affineur. Cette mention suit immédiatement la dénomination “fromage fermier”. La taille des caractères de ces mentions est identique. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.

L’amendement n° 17 rectifié vise à sécuriser notre système en matière de production fermière et à considérer, une fois pour toutes, la réalité de ce qui se passe dans nos territoires depuis des décennies.
Dès lors que la production fermière existe individuellement dans les exploitations, nous voulons que l’affinage puisse être réalisé dans un cadre collectif. Toutefois, pour assurer une grande transparence pour le consommateur, nous souhaitons que l’étiquetage mentionne à la fois le nom du producteur et de l’affineur.
Ce sujet ne me semble pas poser de problème, même s’il peut paraître complexe. Aujourd’hui, en termes de sécurité sanitaire – M. le ministre ne me contredira pas –, l’ensemble des produits présents dans un lieu collectif est connu. Les fromages constituent une production sensible à la listeria, et les analyses permettent de remonter en permanence au producteur. Dès lors que l’on peut le faire à l’échelon sanitaire, il n’y a aucune difficulté à le faire en termes de transparence sur l’étiquetage.
L’amendement n° 17 rectifié a donc pour objet d’intégrer directement le dispositif dans la loi, afin que nous ne soyons pas obligés d’y revenir par la suite.
Quant à l’amendement de repli n° 21 rectifié, il prévoit de renvoyer les modalités d’application de la mesure à un décret.
N’oublions pas d’où l’on vient ! Dans la montagne des Vosges, des paysans transforment depuis plus de trente ans leur fromage dans leur ferme avant de l’emmener dans une cave collective pour l’affinage. Il s’agit pourtant bel et bien d’une production fermière qui fait vivre des territoires.

Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Gremillet et Pellevat, Mmes L. Darcos, Deromedi et Dumas, M. Savary, Mme Troendlé, M. Vaspart, Mme Noël, MM. Vogel et Longuet, Mmes Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mmes Gruny et Bories, MM. Raison, Cuypers, Bonne, Pierre, Husson, Sido et Revet, Mmes Lassarade et Bruguière et MM. Laménie, Cambon et Bazin.
L’amendement n° 22 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, Decool et Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Buffet, Cardoux, Chasseing et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Danesi, de Legge, de Nicolaÿ et Dufaut, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Genest, Grand, Guerriau, Houpert et Kennel, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent et Leleux, Mmes Lopez et Malet et MM. Poniatowski, Priou et Savin.
L’amendement n° 37 est présenté par Mme Loisier, au nom de la commission.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination “fromage fermier” ou l’utilisation de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l’affinage a lieu en dehors de l’exploitation, le consommateur en est informé au moyen d’un étiquetage qui précise, dans le respect des conditions prévues au premier alinéa, le nom de l’affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret. »
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

Cet amendement de repli vise à renvoyer les modalités d’application de la mesure à un décret.
N’oublions pas d’où l’on vient ! Dans la montagne des Vosges, que je connais bien, des paysans transforment depuis plus de trente ans leur fromage dans leur ferme avant de l’emmener dans une cave collective pour l’affinage. Il s’agit pourtant bel et bien d’une production fermière qui fait vivre des territoires.

La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié bis.

Il s’agit d’une disposition de bon sens qui répond à la réalité du terrain.
Pour gagner un peu de temps, je renvoie aux arguments développés par Daniel Gremillet.

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 37 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 17 rectifié.

L’article 1er de la présente proposition de loi entend combler un vide juridique, en permettant à des fromages affinés hors de l’exploitation de bénéficier néanmoins de la mention « fromage fermier » s’ils respectent certaines conditions.
Contrairement à la rédaction adoptée dans la loi Égalim, l’article 1er réserve cette possibilité aux seuls fromages sous SIQO, ce qui pose plusieurs problèmes pratiques.
Tout d’abord, cela revient à privilégier certains producteurs au détriment d’autres. Pourquoi privilégier ainsi les producteurs bio, dont le cahier des charges est bien moins précis que celui des AOP, et non les petits producteurs affiliés à de petites coopératives de nos territoires, qui produisent du fromage non AOP ?
Pourquoi exclure les petits producteurs, qui n’ont pas de cave d’affinage chez eux, de la seule possibilité de valoriser leurs produits dont ils disposent ?
La rédaction retenue peut même se retourner contre les producteurs sous AOP et aboutir à des cas difficilement justifiables. Imaginons par exemple un producteur sous AOP qui, une année, dépasserait légèrement les quotas. Les mêmes fromages, absolument identiques, seraient étiquetés différemment, les uns sous AOP « fermier », les autres non.
L’amendement de la commission a donc pour objet d’élargir la possibilité de valorisation à tous les fromages, sous SIQO ou non, comme cela avait été prévu dans nos débats sur le projet de loi Égalim. Nous apportons en outre deux garanties supplémentaires.
D’une part, l’article adopté lors des débats sur le projet de loi Égalim n’était pas suffisamment précis et pouvait laisser planer une ambiguïté sur la dénomination de « fromage fermier ». L’amendement de la commission vise donc à préciser que les techniques traditionnelles devront impérativement s’appliquer à tous les fromages fermiers.
D’autre part, l’amendement de la commission tend à ajouter une condition pour s’assurer que le fromage fermier reste sous la responsabilité du producteur lorsqu’il est affiné à l’extérieur de la ferme. L’étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de la ferme devra préciser à la fois le nom de l’affineur, comme c’était le cas avant l’arrêté de 2015, mais également le nom du producteur. Je précise que l’affineur doit déjà lier, au nom de la traçabilité, les fromages à leurs producteurs. Le coût supplémentaire sera donc limité.
Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 17 rectifié, je sollicite son retrait au profit des amendements identiques n° 21 rectifié, 22 rectifié bis et 37, en raison d’une ambiguïté sur la définition des techniques traditionnelles.

Nous parlons de ce sujet depuis si longtemps et l’insécurité est telle qu’une traduction directe dans la loi permettait de régler une fois pour toutes le dossier du fromage fermier. Or nous en avons vraiment besoin !
Je souhaiterais entendre l’avis du ministre, mais il m’apparaît essentiel d’avoir des certitudes sur ce dossier. Nous ne devons pas casser ce qui existe dans nos territoires. Un fromage fermier produit dans des fermes doit pouvoir être affiné collectivement, dès lors que l’on mentionne le nom du producteur et de l’affineur.

Nous sommes globalement d’accord sur le fond, sauf sur la mention du nom du producteur.
Un fromage fermier est produit à la ferme, mais les petits producteurs doivent pouvoir faire l’affinage à l’extérieur. Sur ce point, nous nous accordons, et nous voulons le dire haut et fort, car certains estiment au contraire qu’un fromage affiné hors de la ferme n’est plus un fromage fermier.
En réalité, l’affineur prend les fromages en « blanc » et effectue lui-même l’affinage. Ce qui est important, c’est que le travail soit fait avec une méthode d’affinage traditionnelle, vérifiée et garantie par le cahier des charges de l’INAO.
En revanche, selon les différents contacts que les services de mon ministère ont eus à ce sujet, si nous obligeons les affineurs à inscrire le nom du producteur, ce sont les plus petits producteurs qui y perdront : en effet, les affineurs, qui devront modifier les étiquettes et rehausser les prix, ne voudront plus prendre leur production.
C’est uniquement pour cette raison que je ne suis pas favorable à ces amendements. Je comprends et je suis d’accord avec leur principe, ainsi qu’avec l’idée générale développée par M. Gremillet et Mme la rapporteure, mais il nous faudrait trouver, le cas échéant, une rédaction différente.
Je le répète, mettre le nom du producteur constituerait un véritable handicap pour les plus petits d’entre eux, qui auraient de grandes difficultés à faire réaliser l’affinage à l’extérieur.
Je ne puis donc qu’être défavorable à ces amendements, en tout cas tels qu’ils sont rédigés à ce stade.

Monsieur le ministre, je ne partage pas votre point de vue et je soutiendrai l’amendement de la commission. Si nous voulons une véritable traçabilité, la seule solution, pour le petit producteur, est de passer par une cave d’affinage. C’est ce qui se passe d’ailleurs dans la viticulture.
Pour obtenir une traçabilité complète, l’affineur est obligé de traiter le lait du producteur en question. Il n’y a donc pas d’incompatibilité à mettre le nom du producteur. C’est d’ailleurs ce que nos concitoyens réclament. Les petits producteurs ne vont certainement pas disparaître, si leur nom apparaît sur le produit affiné, parce qu’ils sont membres d’une coopérative ou d’une société.
Voilà pourquoi je soutiens tout à fait l’amendement de la commission.

Monsieur Gremillet, qu’en est-il finalement de l’amendement n° 17 rectifié ?

Monsieur le ministre, il ne faut pas se raconter d’histoires ! L’ensemble des agriculteurs, ainsi que vos services, qui font très bien leur travail, sont capables de « remonter » la filière d’un produit en cas de problème : si un cas de listeria apparaît dans une cave d’affinage, nous sommes capables d’identifier le producteur.

Dès lors, il doit bien être possible d’ajouter le nom du producteur sur l’étiquette… En tout cas, c’est très important en termes de transparence. C’est pourquoi je rejoins l’avis de la commission.
Quoi qu’il en soit, je retire cet amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 17 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre Louault, pour explication de vote.

La pression des affineurs n’est pas admissible, et nous ne devons pas la subir ! Mettre les deux noms sur l’étiquette n’est absolument pas un problème, cela se fait d’ailleurs déjà pour certaines appellations. Les producteurs doivent avoir toute leur place !

Je mets aux voix les amendements identiques n° 21 rectifié, 22 rectifié bis et 37.
Les amendements sont adoptés.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé, et l’amendement n° 30 rectifié ter n’a plus d’objet.
La loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.

Comme cela a été dit, cet article abroge la loi de 1957, pour permettre aux producteurs de l’aire d’appellation de fabriquer d’autres vins.
Toutefois, il reste un problème en ce qui concerne la production des années 2016 et 2017, soit environ 5 000 hectolitres encore en stock à ce jour. En 2016, le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie et des finances ont pris un arrêté qui a modifié le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée Clairette de Die.
Je me félicite bien évidemment de l’accord trouvé entre les élus locaux et les vignerons du secteur, comme l’a précisé notre collègue Patrick Chaize, mais il est de mon devoir de dire que, même avec cet accord, la vente de ce stock reste illégale. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un recours qui serait intenté au moment de la mise en vente d’une bouteille, par exemple sur l’initiative d’un producteur de Cerdon, qui aurait certainement raison sur le fond.
La question de ce stock est à l’heure actuelle dans l’impasse, et il est de mon devoir, je le répète, de le souligner.
Monsieur le ministre, que comptez-vous faire à ce sujet ? Les producteurs ne doivent pas payer pour l’erreur qui a été commise et ils doivent pouvoir écouler leurs stocks. S’ils ne les écoulent pas, ils devront détruire la production, et ce malgré l’accord, dont je me félicite, qui a été trouvé.

Conseiller départemental du Diois – je suis né à Die –, je représente ses habitants, en l’espèce ses viticulteurs. Je suis attaché à mon territoire et je souhaite son développement.
La Clairette de Die, produit phare de notre territoire, est reconnue, mais elle aujourd’hui concurrencée par d’autres vins effervescents, souvent rosés. De tels vins rosés sont appréciés des consommateurs et sont à la mode. Ainsi, au-delà de l’anecdote, un vin italien – je ne le citerai pas… – a pu mener à terme, en moins de deux ans, la commercialisation de son rosé effervescent.
Pour la Clairette de Die, c’est un véritable parcours du combattant : espoir en 2016, finalement déçu ; nouvel espoir en 2018, lui aussi déçu en fin d’année à la suite de la décision du Conseil constitutionnel… Tout a été dit par les orateurs précédents, hélas. Or la vente de Clairette de tradition a baissé de 5 % depuis 2012, cette baisse ayant été enrayée par la mise sur le marché, en 2018, de la Clairette rosée, qui est aujourd’hui interdite.
Le salut des viticulteurs du Diois passe par la possibilité de produire et de commercialiser ce vin effervescent rosé au plus vite. Le dispositif actuel de protection juridique des appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die », au travers de la loi de 1957 est obsolète, puisque cette protection est assurée par d’autres textes, nationaux et européens.
Surtout, la protection prévue par la loi de 1957 joue désormais comme un frein à la nécessaire adaptation de la production aux attentes des consommateurs. Il faut rapidement abroger cette loi et donner la possibilité aux viticulteurs du Diois de produire un vin effervescent rosé qui, même s’il ne s’appelle pas Clairette rosée, permettra sans doute d’offrir une nouvelle lisibilité et un espoir pour ce territoire et ses habitants.

Je veux replacer les choses dans leur contexte : les viticulteurs de Die ont planté des vignes à raisin rouge à jus blanc, alors qu’ils ne pouvaient pas vendre légalement cette production. De fait, l’abrogation de la loi de 1957 va leur permettre d’écouler ces vins rosés mousseux.
La présente proposition de loi légalise donc une concurrence, alors que le marché est déjà très fragile – je pense bien sûr aux vins du Bugey, en particulier à ceux de Cerdon. Autrement dit, on produit quelque chose dans l’illégalité la plus totale, et, quelques années après, on fait changer la loi, entre le miel et le fromage… Il est dommage, monsieur le ministre, que vous ne soyez pas originaire de l’Ain ! Je pense que vous m’auriez mieux comprise.
En d’autres temps, ces vignes plantées illégalement auraient été arrachées. Dans ce cas précis, on va au contraire les encourager à en planter davantage… Mieux ! On va sauver les stocks produits illégalement il y a quelques années. Je me doute bien, en effet, que ce point passera aussi comme une lettre à la poste. Vous allez me dire, monsieur le ministre, que l’accord qui a été trouvé ne donne pas l’appellation d’AOC à ces vins rosés mousseux, mais pour combien de temps ?
Vous allez donc bouleverser un marché qui est fragile, alors qu’il s’agit de productions d’excellence basées sur la tradition. La renommée de certains de nos terroirs est ainsi mise en danger. C’est fort dommage !
J’ai longtemps été maire de Cerdon, je connais donc parfaitement les difficultés de cette petite production des vins du Bugey et de Cerdon. Je puis vous garantir que, malgré toutes les promesses qu’on a pu leur faire, les viticulteurs sont extrêmement inquiets pour leur avenir !

M. Joël Labbé . Monsieur le président, j’ai un peu l’impression que nous sommes passés au vin sans avoir fini le fromage…
Sourires.

Je n’ai pas bien compris pourquoi l’amendement n° 30 rectifié ter que j’avais déposé sur l’article 1er n’était pas en discussion commune avec les autres amendements déposés sur cet article. C’était pourtant exactement le même sujet.
Je me sens très frustré de ne pas avoir pu le défendre, en particulier lorsque je pense aux gens que je représente ici. Pouvez-vous m’expliquer ce point de procédure ?

Mon cher collègue, les amendements identiques n° 17 rectifié, 21 rectifié, 22 rectifié bis et 37 proposaient une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article 1er. À partir du moment où ils ont été adoptés, les autres amendements visant cet article devenaient nécessairement sans objet.
La parole est à M. le ministre.

J’entends ce que dit Mme Goy-Chavent, ancien maire de Cerdon, et je constate qu’il n’y a pas d’unanimité dans l’hémicycle sur cet article.
En ce qui concerne les stocks, les productions de 2016 et de 2017 peuvent être écoulées du fait de l’arrêté qui a été évoqué, mais pas celles de 2018.
Je veux aussi dire que, du point de vue du ministère de l’économie et des finances, notamment pour la DGCCRF, l’accord dont a parlé M. Chaize ne repose juridiquement sur rien. Une loi est nécessaire, car s’il n’y a qu’un accord, il suffira – c’est ce qu’a dit Mme Goy-Chavent – qu’un citoyen dépose un recours, et l’affaire sera pliée !

Je ne dis pas qu’il ne faut pas les comprendre. Il ne m’appartient pas de juger. Il me semble simplement, en tant que ministre de l’agriculture, que nous avons encore besoin de travailler sur ces questions.
Il y a de la place pour tout le monde dans la viticulture – là n’est pas la question –, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, et ce que nous faisons aujourd’hui ne règle pas l’ensemble des problèmes. Nous allons sûrement devoir y travailler encore durant de nombreuses années.
Par ailleurs, la question posée par M. Cabanel sur les stocks est tout à fait judicieuse. Je note simplement que les viticulteurs du Diois veulent produire du vin effervescent rosé et que ce produit peut trouver sa place sur le marché. Il revient alors au législateur de faire son travail, mais nous ne devons pas pour autant partir sur de fausses pistes, au risque d’échouer.
Il est évidemment toujours possible de se faire plaisir et de discuter sans fin au Sénat et à l’Assemblée nationale, mais ce qui compte, c’est de savoir si nous voulons, oui ou non, abroger la loi de 1957 et permettre aux viticulteurs du Diois de produire des vins effervescents rosés.

J’attire simplement votre attention sur le fait que, lorsque l’on commence à dérouler la pelote, on ne sait pas jusqu’où les choses vont.
Or nous devons faire en sorte que ce débat se déroule de la façon la plus apaisée possible, pour que l’ensemble de nos territoires viticoles puisse vivre et se développer.

Vous l’avez dit, monsieur le ministre, il y a deux sujets : la loi de 1957, dont l’abrogation permet d’envisager l’avenir, et les stocks. Ce second sujet fait l’objet d’un accord. Effectivement, un accord de ce type est toujours fragile et peut être attaqué, comme a pu l’être l’arrêté signé en 2016 par le ministre de l’époque, sur une base illégale.
Cela dit, je crois que l’accord qui a été conclu repose sur notre intelligence collective – certes, elle nous échappe quelquefois… –, qui a permis de rassembler deux syndicats viticoles, celui du Bugey et celui de la Clairette de Die. Cet accord laisse entrevoir une issue à même d’apaiser les tensions existantes.
Au vu de cet accord, il me semblerait dommageable de modifier ce qui était prévu dans la proposition de loi. C’est pourquoi j’ai indiqué que je remerciais les rapporteurs de ne pas avoir proposé d’amendement sur cet article.
M. Gilbert Bouchet applaudit.
L ’ article 2 est adopté.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Grand, Daubresse, Milon, Buffet et Laménie, Mmes A.M. Bertrand et Lassarade, MM. Revet et Sido et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du II de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Les quatre articles de cette proposition de loi reprennent des articles de la loi Égalim censurés par le Conseil constitutionnel. Je vous propose d’en faire de même pour l’article 42 de cette loi, qui visait à mettre fin à l’utilisation abusive du terme « équitable », en la réservant aux seuls produits qui répondent à la définition légale du commerce équitable.
Aujourd’hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » – le lait, les fruits… – et recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements parfois non conformes aux principes énoncés par la loi. En jouant délibérément de la confusion avec les produits issus du commerce équitable, une telle pratique peut se révéler trompeuse pour le consommateur.
Sur le modèle de l’interdiction de l’utilisation des mentions « bio » ou « biologique » pour des produits non issus de l’agriculture biologique, je vous propose d’adopter cet amendement, qui participe de la bonne information du consommateur sur le caractère réellement équitable du produit.

La rédaction actuelle de la loi pose en effet une difficulté : elle permet d’utiliser la mention « équitable », même si tous les critères relatifs au commerce équitable prévus par la loi d’août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ne sont pas respectés.
Je le répète, il est possible de ne pas respecter tous les critères du commerce équitable et d’utiliser quand même la mention « équitable ». Comment légitimer le recours à une telle mention s’il n’y a pas de gouvernance démocratique ou d’informations relatives à la traçabilité du produit ?
Le Sénat a toujours proposé d’inclure l’ensemble des critères du commerce équitable pour pouvoir utiliser la mention « équitable ». Nous en avons d’ailleurs discuté lors de l’examen du projet de loi Pacte et nous avons adopté un tel dispositif en première lecture, avec l’avis favorable de la commission spéciale. Ce dispositif a été adopté conforme par l’Assemblée nationale, et il est devenu l’article 61 quinquies A du texte. Je note en outre que la rédaction que nous avions alors retenue était plus précise que le présent amendement, qui me semble donc pleinement satisfait.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Même avis, monsieur le président : cette mesure est déjà inscrite dans le projet de loi Pacte.

L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
L’amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pellevat, Mmes L. Darcos, Deromedi et Dumas, MM. Bonne et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Meurant, Paccaud et Cardoux, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Savary, Mme Micouleau, M. Chatillon, Mme Troendlé, MM. D. Laurent, Mouiller et Vaspart, Mme Noël, MM. Vogel et Longuet, Mme Berthet, M. Raison, Mme Bories, MM. Cuypers, Pointereau, Mayet, B. Fournier, Pierre, Husson, Sido et Revet, Mmes Lassarade et M. Mercier, M. Charon, Mme Bruguière, MM. Cambon et Bazin, Mmes de Cidrac, Gruny et Garriaud-Maylam, MM. Milon, Chevrollier et Morisset et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 48 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est abrogé.
La parole est à M. Daniel Gremillet.

Cet amendement est simple. Chacun le sait, les produits sous signes officiels de la qualité et de l’origine dits « SIQO » ne nous ont pas attendus pour intégrer la dimension environnementale. Je rappelle qu’ils ont été créés il y a plus d’un siècle. Ne leur ajoutons pas des contraintes supplémentaires et laissons chaque appellation vivre leur vie au niveau du territoire ! Il faut laisser faire les commissions syndicales.
La dimension environnementale qui est prévue à l’article 48 de la loi Égalim n’apporte rien ; elle ne fait que complexifier les choses. Aujourd’hui, des appellations renommées ont déjà mis en place des pratiques environnementales – ma collègue du Jura, Marie-Christine Chauvin, ne me démentira pas.

Dans le cadre de la loi Égalim, l’Assemblée nationale a pris une position différente de celle qui est proposée au travers de cet amendement, si bien que la commission, au regard du risque de désaccord entre les deux assemblées, a émis un avis défavorable.
Néanmoins, à titre personnel, et en lien avec la position que nous avions prise lors de l’examen de la loi Égalim, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

L’esprit de cette proposition de loi est de réintroduire des dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, et non d’ouvrir à nouveau les débats sur l’ensemble des dispositions de la loi Égalim ou de supprimer des mesures qui ont été finalement actées, mais qui n’iraient pas, selon certains, dans le bon sens.
Qui plus est, l’article 48 de la loi Égalim fixe une échéance pour 2030, soit dans douze ans ! D’ici là, l’INAO doit définir le contenu de la certification environnementale. Je ne crois pas que retirer cette mesure aujourd’hui serait un bon signal, car il s’agit tout simplement d’une demande de notre société. D’ailleurs, il me semble que les organisations professionnelles agricoles sont plutôt favorables à ce dispositif et à ce calendrier.
C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.

L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Pellevat, Mmes L. Darcos, Deromedi et Dumas, M. Savary, Mme Troendlé, M. Vaspart, Mme Noël, MM. Vogel et Longuet, Mmes Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Piednoir, Bazin, Cambon et Laménie, Mmes Bruguière, A.M. Bertrand et Lassarade, MM. Revet, Sido, Husson, Pierre, B. Fournier et Bonne, Mme Bories et MM. Raison et Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la perspective de la mise en œuvre de la révision de la réglementation européenne relative à la production biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2020, un rapport au Parlement faisant un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, et les mesures qu’il entend appliquer à partir du 1er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un principe de conformité avec les règles applicables à l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles.
La parole est à M. Daniel Gremillet.

Lors de l’examen du projet de loi Égalim, le Sénat a voté une disposition pour que l’ensemble des produits mis sur le marché dans l’Union européenne et proposés aux consommateurs réponde aux cahiers des charges prévus par la réglementation et aux différentes contraintes, tant européennes que françaises.
Or une question se pose en ce qui concerne les productions issues de l’agriculture biologique qui proviennent de l’extérieur de l’Union européenne.
Cet amendement a pour objet que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, afin que nous connaissions l’origine des produits issus de l’agriculture biologique provenant de pays tiers et importés au sein de l’Union européenne. Nous pourrions alors contrôler le respect des cahiers des charges qui s’appliquent en Europe et en France.
Je sais que le Sénat n’aime pas particulièrement les demandes de rapport, mais le sujet est véritablement important.

Nous sommes dans le même cas de figure que précédemment. Nous avions effectivement voté cette demande de rapport lors de l’examen du projet de loi Égalim. Toutefois, la commission est défavorable à cet amendement pour deux raisons : nous recherchons un accord avec l’Assemblée nationale et le Sénat est traditionnellement défavorable aux demandes de rapport.
La commission a donc émis un avis défavorable.

Il y a deux aspects. D’une part, nous sommes traditionnellement défavorables au principe des rapports. D’autre part, l’amendement de M. Gremillet sera satisfait : il est prévu que les États membres de l’Union européenne seront informés sur les volumes et la provenance et les autorités françaises ont demandé que ces informations soient rendues publiques.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Oui, je le maintiens, monsieur le président. En effet, le fait que les informations existent me confirme dans l’idée qu’il est opportun de demander ce rapport, pour bien s’assurer de la conformité des produits !

J’ajoute qu’il existe un groupe de suivi des effets de la loi Égalim, et que nous pouvons tout à fait travailler sur cette question dans ce cadre. Je souhaite donc apporter mon soutien à notre rapporteure.

Moi non plus, je n’aime pas les demandes de rapport, mais celle-ci est très importante. En effet, pour le moment, la grande distribution fait toute sa publicité sur le bio.
Or chacun sait comment ce secteur fonctionne ! Il y a donc un danger à ce que les produits bio soient finalement dévalorisés, alors même que les producteurs français sont encouragés à en faire. Il faut absolument que nous en sachions plus ! C’est pourquoi ce rapport est important.

Je n’arrive pas bien à comprendre l’attitude des ministres : même quand ils disposent des éléments pour répondre à une question d’un parlementaire, ils préfèrent rejeter nos amendements et nous dire de ne pas nous faire de souci ! Nous avons connu la même chose la semaine dernière avec Mme Borne sur le projet de loi d’orientation des mobilités. Or il serait tout de même plus respectueux, et plus simple d’ailleurs, d’accepter de tels amendements et de nous apporter les éléments demandés.
Est-ce que déposer des amendements fait partie des choses du vieux monde que le nouveau veut supprimer ? Je me pose la question…

Monsieur le sénateur, il ne me semble pas que j’incarne particulièrement le nouveau monde ! Tout le monde sera d’accord sur ce point dans cet hémicycle.
Je crois simplement que nous nous sommes mal compris. Je suis défavorable à cet amendement, parce que je considère que faire ce rapport n’a aucun sens. Je rejoins d’ailleurs la présidente de la commission à propos du groupe de suivi qui va lui-même pouvoir travailler sur cette question.
Les autorités françaises ont demandé à l’Union européenne la publication des informations demandées. Je le répète, cette information sera publique ; il n’est donc nul besoin de demander un rapport du Gouvernement au Parlement.
C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement. Je ne tiens pas du tout à polémiquer avec mon ami Daniel Gremillet – ce n’est pas le sujet !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Après le premier alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »

Je profite de l’examen de l’article 3 de cette proposition de loi pour aborder le sujet de la transparence sur l’origine du miel.
Alors que le marché du miel est maintenant mondialisé, la transparence sur l’origine des produits est devenue une nécessité, d’une part, pour le consommateur, qui ne se satisfait pas de l’étiquetage indiquant simplement une origine Union européenne ou non-Union européenne – je pense que nous sommes presque tous d’accord sur ce point –, et, d’autre part, pour l’agriculture française, qui ne parvient plus à écouler certains volumes de miel à des prix corrects du fait, notamment, de la concurrence déloyale.
L’Italie, la Grèce, Chypre et l’Espagne sont sur le point d’entériner un tel étiquetage. La réglementation espagnole irait même plus loin, en imposant que soient clairement indiqués sur l’étiquette le pourcentage de chaque miel et sa provenance – d’ailleurs, j’ai beaucoup apprécié l’intervention de Joël Labbé sur ce sujet. Des amendements ont été déposés en ce sens et nous les soutiendrons, tout comme la nouvelle réglementation sur l’étiquetage des miels.

Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Pellevat, Mmes L. Darcos, Deromedi et Dumas, MM. Bonhomme, Morisset, Meurant, Paccaud et Cardoux, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. Savary, Mme Micouleau, M. Chatillon, Mme Troendlé, MM. D. Laurent, Mouiller et Vaspart, Mme Noël, MM. Vogel et Longuet, Mme Morhet-Richaud, M. Milon, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny et de Cidrac, MM. Bazin et Cambon, Mme Bruguière, M. Charon, Mmes M. Mercier et Lassarade, MM. Revet, Sido, Husson, Pierre et Mayet, Mme Malet, MM. Cuypers et Raison et Mmes Bories, Lamure et Berthet.
L’amendement n° 38 est présenté par Mme Loisier, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
1° Après le mot :
indiqués
insérer les mots :
en toutes lettres
2° Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.

Cet amendement vise à améliorer la transparence sur l’étiquetage du miel, en prévoyant que les pays d’origine de la récolte soient indiqués par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition. C’est une nécessité, sur laquelle nous avons déjà insisté lors de l’examen de différents textes qui nous ont été soumis – j’y ai fait référence dans mon intervention.
Monsieur le ministre, j’espère d’ailleurs pouvoir compter sur vous et sur la détermination de la France pour obtenir la même expérimentation que celle que nous avons décrochée sur les produits carnés et laitiers.
Cette transparence est une demande de la société et une exigence des apiculteurs. Elle est essentielle en termes d’honnêteté et de traçabilité. Peut-être aurai-je plus de chance avec cet amendement qu’avec les précédents !

L’amendement de la commission a pour objet de réaliser une synthèse, en reprenant en grande partie le contenu des autres amendements déposés sur l’article 3.
L’objectif est d’atteindre l’unanimité sur cette position, qui représente, certes, un compromis, mais un compromis tellement attendu par les consommateurs et les apiculteurs de nos territoires.
Cet amendement a pour objet d’imposer un affichage de tous les pays par ordre d’importance décroissante et en toutes lettres. Aujourd’hui, l’affichage simplifié « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE » n’est plus tolérable. Le consommateur a le droit de savoir d’où viennent les miels qu’il consomme.
Il est d’ores et déjà permis par la directive de rendre obligatoire l’affichage de tous les pays. Il est d’ailleurs étonnant que cette mesure ne soit pas déjà mise en œuvre. Cependant, le cadre juridique européen nous interdit la sur-transposition, donc d’aller au-delà. De manière sans doute inédite, la directive prévoit en effet explicitement qu’il est impossible d’aller plus loin que cet affichage de tous les pays d’origine.
Toutefois, comme cela a été évoqué, un certain nombre de pays, notamment l’Espagne, se sont engagés dans une modification de leur réglementation, qui n’est pas aujourd’hui validée au niveau européen, les négociations étant en cours. Il est donc temps que la France s’engage à son tour sur ce sujet, pour répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens et des consommateurs.
Monsieur le ministre, il semble que vous vous soyez engagé devant l’Assemblée nationale à aller plus loin, en vous déclarant favorable à un affichage plus précis et plus strict des mélanges de miels. Dès lors, la commission saisit la balle au bond et propose de graver dans la loi, avec cet amendement, l’engagement d’un affichage par ordre décroissant. Il s’agit d’un mandat minimal, nous en sommes bien conscients, que vous donnent les territoires et nos concitoyens pour améliorer l’étiquetage de nos miels.

Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 5 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Buffet, Daubresse, Milon et Laménie, Mme Lassarade, MM. Revet, Segouin et Sido, Mme Lanfranchi Dorgal, M. B. Fournier et Mme Berthet.
L’amendement n° 16 rectifié est présenté par MM. Delcros, Kern, Henno, Moga, Longeot et Détraigne, Mmes Vermeillet, Sollogoub, de la Provôté, Vérien, Billon, Joissains, Goy-Chavent et Létard, M. Mizzon, Mme Férat, MM. Janssens et L. Hervé, Mme Doineau et MM. Vanlerenberghe et Maurey.
L’amendement n° 31 rectifié ter est présenté par MM. Labbé et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux, Vall et Gontard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel et avec indication de cette part en pourcentage
La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.

Mme la rapporteure a dit exactement ce que je pensais. À croire que nous avons écrit ces amendements à quatre mains, ou à deux mains… La seule différence, c’est que je défends également l’amendement n° 6 rectifié bis, qui est un amendement de repli visant à renvoyer toutes les précisions à un arrêté interministériel.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié

Comme les précédents, cet amendement vise aussi à mieux informer le consommateur, et à l’informer complètement. En plus d’indiquer tous les pays par ordre décroissant, je propose de mentionner les pourcentages. Sans cela, on peut avoir un miel composé à 99 % de miel venant de Chine – frauduleux à 30 %, nous le savons –, mais cette origine sera noyée au milieu de sept autres provenances.
Il faut vraiment informer le consommateur pour sauver notre filière apicole, ce qui est un enjeu important. Aujourd’hui, du miel de Chine arrive sur le marché français à 1, 30 euro par kilogramme, alors que le coût de production en France est de 4, 50 euros par kilogramme.
Il ne faut pas transiger. Prenons nos responsabilités en ce qui concerne la transparence que nous devons aux consommateurs. Or si le pourcentage n’est pas indiqué, nous n’allons pas au bout de la logique. C’est aussi un enjeu de santé publique et d’avenir pour notre filière apicole, qui représente des emplois dans les territoires ruraux.
C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié ter.

Je suis d’accord, nous devons être très exigeants. À terme, d’ailleurs, il faudrait interdire les mélanges de miels. Pour quelles raisons mélange-t-on les miels, si ce n’est pour des raisons bassement mercantiles ? Comme vient de le rappeler notre collègue, les différences de prix entre le miel français et le miel asiatique, qui, bien souvent, n’en est pas, fournissent l’explication.
La question de la transparence est absolument essentielle. Je l’ai dit, la Grèce respecte déjà ces pratiques d’étiquetage ; l’Espagne se prépare à le faire. Montrons l’exemple et tirons l’Europe vers le haut. Je vais même plus loin : bousculons l’Europe, parce que c’est nécessaire.
Enfin, nous devons préserver notre biodiversité en protégeant notre cheptel d’abeilles, sauvages comme domestiques, car cela revient à préserver la vie.
Applaudissements.

L’amendement n° 24, présenté par M. Tissot, Mme Monier, MM. Cabanel et Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance avec l’indication de la part prise en pourcentage de chaque pays dans la composition du produit final
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

Il est défendu, avec le même argumentaire que mes collègues Bernard Delcros et Joël Labbé.

Les amendements n° 15 rectifié, 25 et 36 rectifié ter sont identiques.
L’amendement n° 15 rectifié est présenté par MM. Delcros, Kern, Henno, Moga, Longeot et Détraigne, Mmes Vermeillet, Sollogoub, Vérien, Billon, Joissains, Goy-Chavent, Létard et Férat, MM. Mizzon, Janssens et L. Hervé, Mme Doineau et MM. Vanlerenberghe et Maurey.
L’amendement n° 25 est présenté par M. Tissot, Mme Monier, MM. Cabanel et Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 36 rectifié ter est présenté par MM. Labbé et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux, Vall et Gontard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d’importance de la part prise dans la composition du miel
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.

Je ne comprends pas bien le classement du dérouleur, car cet amendement est identique à celui de la commission. Il est défendu.

S’il est classé ainsi, c’est qu’il ne doit pas être exactement identique.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° 25.

La parole est à M. Joël Labbé, pour défendre l’amendement n° 36 rectifié ter.

L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Buffet, Daubresse, Milon et Laménie, Mme Lassarade, MM. Revet, Segouin et Sido, Mme Lanfranchi Dorgal et M. B. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’agriculture
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Vullien, M. Bonnecarrère, Mme Joissains, M. Luche, Mme Guidez, MM. Morisset, Louault, Henno et Delcros, Mme de la Provôté, MM. Lafon, Laugier et Vanlerenberghe, Mme A.M. Bertrand, M. Revet, Mme Vermeillet, MM. Lefèvre et Meurant, Mmes Gruny, Troendlé, Goy-Chavent et Dumas, M. Bazin, Mmes Perrot et Doineau, MM. Vogel et Kern, Mme Billon, MM. Panunzi, Moga, Chatillon, L. Hervé, Pointereau et Dufaut, Mme Létard et M. Janssens, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les pays doivent être nommés précisément selon leur nom complet en français ou leur dénomination usuelle.
La parole est à Mme Françoise Férat.

Je ne vais pas allonger les débats, tous les points ayant été abordés par mes différents collègues.
Je veux simplement insister sur le fait que les pays doivent être nommés précisément, selon leur nom complet en français. Je ne prendrai qu’un exemple : il est facile de comprendre qu’un miel vient des USA ; en revanche, le sigle RPC peut faire penser à un pays d’Afrique, avec ses plaines ou ses forêts équatoriales – je ne sais d’ailleurs pas s’il y a des abeilles dans les forêts équatoriales ! Les tests réalisés auprès des consommateurs par les représentants des apiculteurs montrent que les citoyens ne reconnaissent pas nécessairement la Chine sous ce sigle. Il me paraît donc important de développer le nom de République populaire de Chine, et cela vaut pour tous les pays.

Ce débat a tout lieu d’être. Nous aspirons tous à la plus grande transparence pour les consommateurs et à la valorisation des producteurs français.
Néanmoins, l’adoption de ces amendements nous mettrait en situation de sur-transposition. Je vous fais grâce du discours habituel sur ce phénomène.
Je me permettrai aussi de souligner que, parfois, le mieux est l’ennemi du bien. La commission a donc essayé de dégager un compromis, qui sera peut-être transitoire, monsieur le ministre, selon ce que vous arriverez à décrocher à Bruxelles
Sourires.

Honnêtement, nous sommes tous consommateurs – j’ai un pot de miel dans mon sac, que je ne vais pas sortir.
Si ! sur différentes travées.

–, et, avec la liste d’origine par ordre décroissant, ne pensez-vous pas que nous avons tous les éléments pour choisir ? Faut-il forcément demander au producteur d’ajouter le pourcentage ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure, exhibe un pot de miel que Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, lui a transmis, sous les rires de l ’ hémicycle.

Lors de nos auditions, nous avons rencontré beaucoup de producteurs, qui sont aujourd’hui dans des démarches de transparence totale avec des QR codes. Avec ce dispositif généralisé, dans un futur proche, vous aurez tout, même l’adresse du producteur. J’y insiste, il y a une véritable volonté tant de l’ensemble de nos producteurs, que de votre part, monsieur le ministre, j’en suis persuadée, pour aller dans ce sens avec l’Europe, dans le cadre d’une validation européenne.
Mes chers collègues, je vous propose que le premier étage de la fusée soit l’inscription en toutes lettres par ordre décroissant, sachant que nous aspirons tous à un maximum de transparence.
J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 19 rectifié bis, identique à l’amendement n° 38 de la commission, et défavorable sur les amendements n° 5 rectifié bis, 16 rectifié, 31 rectifié ter, 24, 15 rectifié, 25, 36 rectifié ter, 6 rectifié bis et 12 rectifié.

J’en reviens à ce que nous disions : le mieux est l’ennemi du bien !
Aujourd’hui, sur les pots de miel, on peut lire soit UE soit non-UE.

Madame Férat a raison, autant dire qu’il n’y a aucune précision. Jusqu’à maintenant, ce sujet a toujours bloqué. Je veux prendre une position forte au nom du Gouvernement en soutenant l’amendement de la commission, qui est un amendement de synthèse. À mon sens, on peut difficilement aller plus loin, parce que c’est avec ce mandat, en quelque sorte, que je dois aller me bagarrer auprès de la Commission européenne pour obtenir un résultat. Sans cela, on peut faire toutes les lois que l’on veut, on n’arrivera à rien.
Honnêtement, le fait de préciser l’origine de chaque miel par ordre décroissant d’importance dans la composition, c’est une avancée comme jamais nous n’en avons connu, ainsi que je l’ai dit à la commission du développement durable de l’Assemblée nationale voilà quelques jours.
Après, j’entends et je peux partager ce que disent Bernard Delcros et Joël Labbé. On peut toujours aller plus loin, mais rendez-vous compte de l’importance de l’avancée que vous présente la commission. Il faut que le Sénat vote cette disposition, sinon, sans être devin, je peux vous prédire qu’il n’y aura aucun accord avec l’Assemblée nationale. §La seule solution pour l’obtenir, tout comme pour espérer avoir une validation de l’Union européenne, c’est de voter l’amendement de la commission.
Par ailleurs, chers Joël Labbé et Bernard Delcros, il ne s’agit pas d’un enjeu de santé publique. Comme Daniel Gremillet l’a dit, arrêtons de penser que tout ce que nous produisons et mangeons dans ce pays est dangereux et dépourvu de traçabilité. Soyons sérieux, il n’y a pas d’enjeu de santé publique.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Enfin, où est le problème avec le mélange de miels ? Soit on achète son miel chez un petit apiculteur à côté de chez soi et, dans ce cas, on est sûr du miel contenu dans le bocal ; soit on va en grande surface, et ce n’est pas la même fabrication. C’est ainsi !
Pour conclure, je le répète, l’amendement présenté par Mme Loisier au nom de la commission constitue une belle avancée, et je le soutiens. S’il ne passe pas, cela signifie que le texte ne passera pas.

J’entends bien ce que vous nous dites, monsieur le ministre, mais qui peut le plus peut le moins. C’est à vous d’aller vous battre à Bruxelles avec un bon amendement qui permet d’aller plus loin !
Je prends un exemple concret : un pot de miel indique une origine RPC-France ; s’il y a 90 % de miel chinois et 10 % de miel français, vous ne le saurez pas. Certes, cet amendement représente une avancée, mais elle est vraiment minime.
Joël Labbé a raison : pourquoi se sent-on obligé de mélanger des miels ? C’est bien pour essayer de nous « empapaouter », comme on dit, en mettant du miel de je ne sais où avec du miel de je ne sais quoi, le tout mélangé avec un petit peu de miel français et tout le monde est content.
Pour prolonger ce que disait M. Gremillet, il faudrait que vous vous posiez un jour la question, monsieur le ministre, des pourcentages d’origine dans tous les produits que nous mangeons. Pour les produits carnés, c’est une évidence, les consommateurs s’interrogent vraiment. En précisant ainsi les origines, vous valoriserez les productions françaises, qui sont des productions d’excellence.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Je propose que l’on vote d’abord la possibilité de préciser les pourcentages avant le texte de compromis de la commission. Les autres amendements, y compris celui de la commission, sont des amendements de repli.

Politiquement, il me semble important pour les citoyens français que le Sénat leur permette de savoir précisément quelle est la composition, en fonction de l’origine géographique, du miel qu’ils consomment. S’il n’y a que 31 % de miel français pour 30 % de miel chinois, la France est placée en premier, ce qui ne veut absolument pas dire que l’on a du miel français.
Par ailleurs, le pipeau sur les directives européennes est à géométrie variable. Quand il s’est agi d’appliquer la directive Nitrates, on a eu moins de scrupules à prendre nos distances avec ce texte. Ce genre d’affaires est porté devant les tribunaux, mais il faut en général dix ans avant d’être éventuellement condamné. Si nous n’arrivons pas à convaincre nos partenaires européens sur cette mesure, j’attends qu’ils nous attaquent devant la CJUE.
De toute façon, nous savons que nous avons des alliés sur ce dossier. Si l’Assemblée nationale ne veut pas nous suivre, nous expliquerons, lors de la campagne pour les élections européennes, qui veut vraiment une Europe au service des citoyens, de la transparence et de l’écologie et qui se résigne à accepter l’Europe telle qu’elle est !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’avais pourtant cru comprendre que le Président de la République ne voulait pas se résigner devant l’Europe telle qu’elle est. Voici de quoi le montrer : prenons l’initiative sur un sujet qui fait consensus dans notre pays. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation, sans aucune transparence, avec une production française sans cesse défavorisée. Enfin, je ne veux plus que l’Europe serve de bouc émissaire en cas de reculs concernant l’environnement.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Je souscris tout à fait à ce qui vient d’être dit. Monsieur le ministre, je ne comprends pas votre blocage sur la transparence. Vous parlez de synthèse ; nous parlons de transparence.
Vous êtes de la Drôme, pas très loin de chez moi, et vous connaissez les difficultés des apiculteurs. Nous demandons juste d’indiquer un pourcentage pour que les consommateurs sachent précisément l’origine du miel qu’ils achètent. C’est très simple, facile, basique.
On nous rétorque qu’il faudrait suivre la directive européenne. Après Mme Lienemann, je peux vous donner un autre exemple où la France ne respecte pas une directive européenne : la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, vient de porter plainte pour non-respect des espèces protégées, puisque la France autorise la chasse de 63 espèces, dont 20 qui sont en déclin. C’est contraire à la directive européenne et cela montre que nous sommes tout à fait capables de nous affirmer parfois. En l’occurrence, nous devons nous affirmer, savoir où nous voulons aller et montrer le chemin à l’Europe pour assurer, tout simplement, la transparence sur les pots de miel.

Je tiens à rappeler que nous sommes en première lecture d’une proposition de loi. Pour le coup, il n’y a pas d’urgence ; donc, si le Sénat peut imprimer une qualité supplémentaire au texte, l’Assemblée nationale aura l’occasion d’en débattre. J’aurais pu m’exprimer comme tous mes collègues qui viennent de le faire, probablement pas avec autant de passion que Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le ministre, convenez-en, nous pouvons quand même avoir des exigences dans cet hémicycle. L’Assemblée nationale prendra ses responsabilités en votant un autre texte, puis il reviendra vers nous. Nous ne sommes pas à vingt-quatre heures près.
En plus, ce sujet n’est peut-être pas de santé publique, mais il est suffisamment important, notamment pour les apiculteurs de nos régions, pour que nous ne soyons pas soumis à ce type de chantage. M. le ministre ne se rendra pas à Bruxelles avec un demi-texte qui n’aurait pas été voté par l’Assemblée nationale. Pour une fois qu’il n’y a pas d’urgence, profitons-en pour avoir de l’exigence.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – M. Sébastien Meurant applaudit également.

Je veux juste apporter quelques éléments d’information et de réponse à M. le ministre, avec lequel je partage la même vision du modèle agricole de la France de demain. Néanmoins, en l’occurrence, je ne peux pas être tout à fait d’accord avec lui.
Aujourd’hui, on importe ce que l’on appelle du miel de Chine. Les contrôles faits tant par UFC-Que choisir que par l’administration montrent que, dans près de 30 % des cas, ces miels sont frauduleux en raison d’un ajout de sucre exogène. C’est cela la vérité ! On importe des miels à 1, 30 euro le kilogramme, quand, je le redis, le coût de production est à 4, 50 euros le kilogramme en France. Comment accepter de ne pas aller jusqu’au bout de l’information du consommateur sur ces sujets ?
Avec le taux, c’est simple, s’il y a 95 % de miel venant de Chine, dont on sait, en plus, qu’il est frauduleux à 30 %, le consommateur ne sera pas tenté de croire qu’il y a un septième de miel chinois quand il y a sept origines géographiques différentes. C’est très important.
Monsieur le ministre, vous avez raison, votre position constitue un progrès considérable, mais je vous rappelle qu’il y a des pays qui procèdent déjà à cette inscription du taux. L’Espagne, le 4 mars dernier, via un communiqué de votre homologue ministre de l’agriculture, s’est engagée à faire figurer sur les pots le taux correspondant à la part de chaque pays. Ne prenons pas de retard sur ce sujet ! Associons-nous à l’Espagne pour faire évoluer l’Europe. Je sais que c’est en accord avec vos convictions et vos valeurs. Pour ma part, je défendrai cette logique jusqu’au bout.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains. – M. Jean-Claude Tissot applaudit également.

D’autres chiffres parlent : ces dernières années, l’exportation de miel d’Asie a augmenté de 196 %, quand le nombre de ruches n’a grimpé que de 13 % dans cette zone.
Notre population, notamment les jeunes, nous regarde, nous écoute, nous attend. J’ai eu la chance et le plaisir de rencontrer plusieurs groupes de jeunes, lycéens et étudiants, ces derniers temps. Sur ces sujets, ils ne comprennent pas que l’Europe ne puisse pas bouger et que nous soyons obligés de nous mettre au garde-à-vous devant les directives européennes. À un moment donné, il faut faire bouger les choses et nous ne serons pas les premiers, car d’autres pays européens ont déjà montré l’exemple. À nous de les rejoindre pour tirer l’Europe vers le haut.
Mme Hélène Conway-Mouret applaudit.

Dans son rapport, la commission nous dit qu’il ne faut pas aller trop loin et respecter l’Europe, mais elle dit aussi qu’il ne sera pas nécessaire de notifier cette nouvelle règle d’étiquetage à la Commission européenne. Monsieur le ministre, le travail est déjà fait d’avance.
Si l’on indique les origines par ordre décroissant, on fait déjà une répartition, donc pourquoi ne pas indiquer en même temps la composition exacte ?
Sourires.

Cela me paraît simple. Sinon, comment fera-t-on le contrôle des étiquettes pour déterminer si les origines sont bien classées par ordre décroissant ?

Je mets aux voix les amendements identiques n° 19 rectifié bis et 38.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 74 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements n° 5 rectifié bis, 16 rectifié, 31 rectifié ter, 24, 15 rectifié, 25, 36 rectifié ter, 6 rectifié bis et 12 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Vullien, M. Bonnecarrère, Mme Joissains, M. Luche, Mme Guidez, MM. Morisset, Louault et Henno, Mme de la Provôté, MM. Lafon, Laugier et Vanlerenberghe, Mme A.M. Bertrand, M. Revet, Mme Vermeillet, MM. Lefèvre et Meurant, Mmes Gruny, Troendlé, Goy-Chavent et Dumas, M. Bazin, Mmes Perrot et Doineau, MM. Vogel et Kern, Mme Billon, MM. Panunzi, Moga et Chatillon, Mme Bories, MM. L. Hervé, Pointereau, Leleux et Dufaut, Mme Létard et MM. Janssens et Gremillet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs ou de miellat, qu’elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. »
La parole est à Mme Françoise Férat.

Avec cet amendement, je souhaite que nous puissions nous prémunir contre les fraudeurs et les produits falsifiés. Certains introduisent des sucres venant d’autres types de productions et il convient de repréciser comment se détermine un miel et quelle est sa composition. Cet amendement correspond au souhait des apiculteurs, avec lesquels j’ai échangé, sur la nécessité de protéger le miel en donnant dans la loi une définition claire, incontestable et conforme au droit européen.
Je suis bien consciente que les textes que nous votons doivent être conformes au droit européen. Les auteurs des amendements que nous étudions aujourd’hui ont cherché à respecter cet équilibre entre les règles communautaires et les possibilités d’adaptation du droit en fonction du principe de subsidiarité.
La définition que je vous propose d’adopter est bien évidemment conforme, car elle n’est que l’expression directe de l’annexe I, point 1, de la directive 2014/63/UE. Excusez ces précisions… Je peux la mettre à la disposition de celles et ceux qui voudraient la comparer à la définition de mon amendement. Elles sont semblables !
Il s’agit donc de donner force de loi à cette définition. En effet, un simple décret de 2003 reprend la définition de la directive qui correspond à celle que je vous propose.
Comme nous l’a indiqué ce matin en commission Mme la rapporteure dont nous avons tous partagé l’analyse, il nous faut appuyer notre détermination à défendre le miel, substance sucrée produite par les abeilles.
L’amendement que je vous demande d’adopter veut donner force de loi à cette définition et redonnera, grâce à cette visibilité législative, confiance aux consommateurs pour trouver des achats conformes à ces attentes.
Quand on achète du miel, on doit y retrouver du miel ! Rien de moins et rien de plus !

Cet amendement revient sur un sujet fondamental déjà évoqué, la définition de la composition du miel, qu’il s’agit de transposer dans la loi telle qu’elle est inscrite dans le décret.
Si je souscris entièrement à l’objectif, je pense, comme je l’ai dit ce matin, que la méthode retenue ne permettra pas de l’atteindre. En effet, ce qui nous est proposé, c’est de transposer une définition aujourd’hui désuète et qui ne garantira pas l’absence d’ajouts externes.
Je m’explique : la rédaction de ce décret repose sur des pratiques antérieures qui mesuraient le taux de saccharose, la cible étant alors les ajouts de sucre obtenu à partir de la canne à sucre ou de la betterave. On mesurait donc le taux de saccharose, lequel avait été limité à 5 %, et on parvenait de fait à identifier les ajouts de sucre extérieur. La donne a changé et les pratiques aujourd’hui condamnées sont notamment celles de la Chine, qui ajoutent non plus du saccharose, mais de l’amidon, ce que l’application des principes énoncés par ce décret ne permet pas de détecter. La démarche proposée par Mme Férat est louable, mais elle se révélera inopérante pour éviter les ajouts extérieurs.
De plus, si M. le ministre, qui recherche à promouvoir la transparence et la montée en gamme, réussit à modifier ce décret et à l’adapter aux pratiques actuelles, c’est-à-dire à l’ajout d’amidon, eh bien, si nous adoptons cet amendement en l’état, cela nous obligera à modifier de nouveau la loi, ce qui créera un niveau supplémentaire de contraintes.
Sur le fond, je suis à 100 % d’accord avec l’amendement pour lequel la commission a d’ailleurs donné un avis favorable. Je tiens toutefois à souligner que le problème ne sera pas résolu tant que le décret ne sera pas réactualisé.

Je partage l’avis de la commission. Je soutiens Mme Férat et tous les parlementaires qui, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, demandent plus de transparence et une meilleure protection des consommateurs contre les fraudes. Et là, on parle de fraude ! Le cadre réglementaire européen, que vous avez évoqué, prévoit déjà une définition du miel. L’annexe I de la directive européenne 2001/110/CE, transcrite en droit interne par le fameux décret n° 2003-587 du 30 juin 2003, définit le miel, ainsi que ses caractéristiques de composition, dont la teneur en sucre. Cette définition est plus précise que celle qui est proposée par votre amendement.
Telles sont les raisons pour lesquelles je partage l’avis de la rapporteure. Nous verrons s’il est possible d’aller plus loin en modifiant ce décret. Mais avec cet amendement, nous sortons du cadre des caractéristiques générales pour nous situer sur une problématique de fraude, laquelle est du ressort de la DGCCRF. Selon les services du ministère, le décret est conforme à la directive européenne.

Le décret de 2003 est désuet, dites-vous, et je l’entends. Depuis cette date, on aurait pu s’adapter pour une saine évolution répondant à la nécessité d’avoir un miel convenable et contrôlé. Je regrette que tel n’ait pas été le cas. J’entends votre argumentation, monsieur le ministre, comme j’entends celle de Mme la rapporteure. Ce que nous proposons est, à mon sens, une étape. Peut-être parviendrez-vous, monsieur le ministre, à avoir demain une démarche concertée avec vos collègues européens. En attendant que vos efforts portent leurs fruits, je maintiens mon amendement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux bien tout comprendre, mais je voudrais que l’on m’explique ! Selon Mme le rapporteur, il y a un décret qui aurait besoin d’être modifié. Sauf à n’avoir pas tout suivi, j’ai quand même l’impression que cela relève de la compétence du ministre, lequel pourrait éventuellement s’engager à en améliorer les dispositions, ce qui lui permettrait de sortir par le haut !

Madame la sénatrice, je veux bien que l’on s’amuse et que l’on dise n’importe quoi, mais il n’y a pas de décret à modifier !

Non, il faut simplement faire en sorte que les fraudeurs soient pris la main dans le sac et condamnés ! Pour l’instant, en l’état actuel des choses, il n’y a pas de décret à modifier !
Après, si on veut aller plus loin pour faire bouger les lignes, on peut envisager toutes sortes d’éventualités. Dès le jour où il sort, un décret est fait, par essence, pour être modifié. En l’état actuel des choses, les services du ministère considèrent que le décret suffit pour identifier les fraudes.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s ’ exclame.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues, je vais voter cet amendement. J’ai entendu Mme la rapporteure dire que le décret pris en 2003 est désuet.
Monsieur le ministre, si on fait le lien entre le décret, qui comporte une parfaite définition du miel, et l’amendement adopté précédemment par scrutin public, on peut contribuer à éviter la vente de produits non conformes à ladite définition – tout le monde s’accorde à dire que tel est le cas pour 30 % de produits venant de la Chine.
Monsieur le ministre, à ma connaissance, le décret relève de votre compétence.

Peut-être, mais c’est le ministre qui peut intervenir pour modifier un décret devenu désuet. Donc, quelque part, je pense que, en votant cet amendement, nous vous apportons, monsieur le ministre, un soutien pour faire modifier la réglementation européenne.

Je vais essayer d’expliquer les choses graduellement.
Il existe un texte européen qui définit le miel. Élaboré avec des experts, il a été transposé et s’applique dans notre pays.
Ce qui est difficile, c’est que nous sommes confrontés à une modification des normes dont il faudrait modifier la définition. Cela doit se faire au niveau européen. Je crois savoir que des négociations sont en cours pour y procéder, ce qui permettrait ainsi au ministre de modifier le décret français.

Laissez-moi terminer, s’il vous plaît ! Si nous inscrivons cette définition dans la loi, cela veut dire que lorsque le décret et les normes seront définis au niveau européen, le ministre devra revenir devant le Parlement pour rectifier la loi. Une modification par décret serait beaucoup plus rapide et plus simple.
Là aussi, je pense que le mieux est l’ennemi du bien ! Mieux vaut laisser les négociations se dérouler à l’échelon européen. Aujourd’hui, les normes ne permettent plus de détecter les nouvelles méthodes utilisées pour contourner la définition du miel. Monsieur le ministre, je suis certaine que, une fois les négociations abouties, vous modifierez le décret, veillant à ce qu’il soit applicable tout de suite.
Si cet amendement est adopté, il faudra voter une disposition législative pour modifier une définition du miel que nous aurons inscrite dans la loi, ce qui est contraire à la politique que nous avons adoptée pendant la discussion du projet de loi Égalim !

J’entends bien qu’on nous fait un cours de droit parlementaire et européen. Pour ma part, je m’en tiendrai à un propos très basique et très simple. Nous sommes sénateurs et les Français attendent de savoir ce qui va sortir de nos discussions. Les consommateurs attendent que nous faisions en sorte d’améliorer la transparence de l’étiquetage. Ils nous demandent d’être vigilants en matière de consommation.
On entend partout des tas de choses sur les abeilles, sur la planète… Les élections européennes sont pour bientôt. Monsieur le ministre, nous nous employons à faire sortir du Sénat un texte qui vous donnera des billes pour négocier et répondre un peu plus aux attentes des consommateurs.
Alors, pardon si cela ne va pas dans le sens de Mme la présidente – ou de je ne sais qui ! –, mais tant pis, moi, je voterai cet amendement !

Je voterai l’amendement de Mme Férat, parce que je ne comprends pas l’argument de la commission. Elle nous dit que le décret est désuet. On connaît les lenteurs européennes, nettement supérieures, on le sait, au temps nécessaire pour modifier une loi sur un point que presque tout le monde s’accorde à vouloir rectifier.
On ne sait absolument pas quand les experts européens vont se mettre d’accord sur de nouvelles normes qui seront, je l’espère, rigoureuses. Car il a quand même fallu un certain temps pour savoir que les Chinois ajoutent de l’amidon et non du saccharose ! Le subterfuge ne date pas d’hier et rien – rien du tout ! – n’a bougé en Europe ! Si on connaissait le pourcentage de miel chinois, cela améliorerait déjà l’information des consommateurs. Vous n’avez pas voulu adopter l’amendement qui allait en ce sens ! Erreur fatale !
Maintenant, vous nous expliquez qu’il faut attendre que les experts européens se mettent d’accord pour actualiser les normes sur le miel. Et, en attendant, la fraude va continuer puisque vous nous dites qu’il y a fraude !
Comme vous voulez faire baisser les emplois dans le secteur public, vous n’allez pas lancer un recrutement massif de contrôleurs du miel à la DGCCRF ! Nous allons donc devoir subir des fraudes sur le miel et vous allez nous expliquer que tout cela, c’est au nom de l’Europe, de la belle Europe que vous voulez ! Eh bien, je vous garantis que cet argument ne va pas convaincre nos concitoyens au moment de voter pour les élections européennes. Moi, je plaide pour une autre Europe ! Or là, nous avons l’occasion de montrer que la France est capable de faire entendre une autre voix sur les réglementations sanitaires alimentaires et de soutenir notre filière du miel.

Sur le fond, nous sommes d’accord. Simplement, inscrire dans la loi les dispositions d’un décret désuet ne le rendra pas plus efficace. Le vrai sujet est d’adapter le décret et de le rendre applicable au plus vite sur le territoire. Telle est la mission que nous confions à M. le ministre.

Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié bis.
L’amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Cambon, Husson et Daubresse, Mmes Deromedi, Micouleau et Thomas, M. Vaspart, Mmes Ramond, Noël, Bruguière, Di Folco et Chauvin, M. Lefèvre, Mmes Lanfranchi Dorgal et Morhet-Richaud, M. Segouin, Mme Lassarade, M. Genest, Mmes M. Mercier et Chain-Larché, MM. Huré et D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, J.M. Boyer, Kennel, Morisset et Chaize, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Meurant, Revet, Milon et Bouchet, Mmes Gruny, Troendlé, Duranton et Dumas, MM. Schmitz et B. Fournier, Mme Deseyne, MM. Bazin et Poniatowski, Mme Raimond-Pavero, MM. Bizet, Guené, Pierre, Forissier, Mandelli, Rapin et Gilles, Mme Lamure, MM. Calvet, Danesi, Chatillon, Laménie et Buffet, Mmes Deroche et Lherbier, MM. Cuypers, Pointereau, Leleux et Sido, Mme L. Darcos et MM. Ginesta, Babary et Dufaut, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’ensemble des productions de miel, la dénomination de vente peut préciser une indication ayant trait à l’origine florale ou végétale ainsi qu’à une origine régionale, territoriale ou topographique qui doit pouvoir être prouvée par le producteur. Cette mention est facultative et ne doit pas être de nature à induire l’acheteur en erreur sur les qualités du produit.
« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les critères spécifiques de qualité, d’identification et d’origine de miel qui peuvent être mentionnés dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime afin que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues aux certifications mentionnées à l’article L. 611-6 du même code. »
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Le miel, encore et toujours !
Cet amendement vise à appuyer une recommandation de la DGCCRF relative à la dénomination de vente du miel qui peut préciser une indication ayant trait à l’origine florale ou végétale, ainsi qu’à une origine régionale, territoriale ou topographique qui doit pouvoir être prouvée par le producteur.
De plus, cette mention serait facultative pour ne pas alourdir les obligations des producteurs, mais sans être de nature à induire l’acheteur en erreur sur les qualités du produit.
Un décret du ministère de l’agriculture fixerait ainsi les critères spécifiques de qualité, d’identification et d’origine de miel qui peuvent donner droit au label.
Cet amendement vise donc bien à protéger les producteurs français et à mieux lutter contre les miels d’assemblage ou ceux dont la traçabilité est impossible.
Il n’est pas question de bloquer la vente de miel étranger sur le marché français, mais bien de donner plus de garanties aux producteurs français et de possibilités pour mettre en avant leur travail et assurer une transparence optimale sur des produits proposés à la vente.

Il s’agit de préciser des mentions facultatives sur l’étiquetage du miel, sachant que les deux points soulignés sont déjà satisfaits par le droit existant. Néanmoins, la commission a émis un avis favorable.

Comme vient de le dire Mme Loisier, qui a toutefois émis un avis favorable, l’amendement est totalement satisfait par le droit existant. Je suppose qu’il sera voté. En attendant la suite du processus, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 18, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au deuxième alinéa, la mention “certifié agriculture biologique” et le logo AB ne peuvent être apposés sur l’étiquette. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

J’ai suivi ce débat avec attention et je pense que mon amendement, tout à fait banal, n’a guère de chances d’être adopté. Je vais néanmoins le soutenir. D’abord, parce que la discussion du texte suivant me semble nettement compromise, ensuite, parce que l’on a beaucoup parlé de mélanges de miels. Il existe un procédé qui me semble extrêmement douteux : vendre un miel de fleurs étiqueté avec le logo bio avec, au dos, une autre étiquette précisant « mélange de miels originaires de l’Union européenne ».
Comment est-il possible de garantir au consommateur de miel la filière bio avec un mélange de miels ?
Ce que je propose dans cet amendement, c’est de supprimer le label « agriculture biologique » en cas de mélange de miels.
Je ne vois pas très bien, en termes de traçabilité, comment il est possible de garantir la certification bio pour ce mélange de miels. Quand j’ai vu ce produit, je m’en suis étonnée. Comme le sujet du miel venait en discussion lors de cette séance, j’ai pensé que le moment était bien choisi pour défendre cet amendement !

Dans la mesure où il s’agit d’un mélange de deux miels bio, l’avis est défavorable. En effet, je ne vois pas comment on peut interdire l’appellation bio à un mélange qui est certes un mélange, mais qui comporte plusieurs miels bio.
En revanche, pour répondre à la précision qui vient d’être apportée par Mme Goulet, je pense que si les deux miels ne sont pas bio, la réglementation actuelle ne permet pas la certification.
S’il s’agit d’un mélange de deux miels d’origine bio, on ne peut pas s’opposer à ce qu’il porte la mention bio.

Je n’ai pas compris l’amendement de Mme Goulet ! L’agriculture biologique est encadrée par des règles et des normes : il y a le label AB.
Si tous les miels inclus dans le mélange ont obtenu cette certification, alors, il n’y a aucune raison de ne pas lui donner la mention « bio ». Si le mélange comporte des miels « bio » et d’autres qui ne le sont pas, alors, forcément, ce mélange n’est pas « bio ». Je ne vois pas de quoi il retourne. L’avis est défavorable.

Peut-être l’amendement est-il mal rédigé. Si tel était le cas, je le retirerais.
Le sujet est extrêmement simple. J’ai ici l’exemple d’un miel qui est « bio ». Et l’étiquette apposée au dos porte la simple mention « mélange de miels originaires de l’UE ».
Si je retirais cet amendement, je le déposerais de nouveau à une occasion ou à une autre. Je peux vous assurer qu’on trouve sur le marché une série de miels comportant la mention « bio » et qui, pour moi, sont douteux.
Mme Nathalie Goulet se déplace pour montrer à M. le ministre la photographie de l ’ étiquette d ’ un pot de miel sur son téléphone.
Sourires.

Cet amendement peut paraître curieux, mais de fait, il nous arrive souvent de voir de tels mélanges qui, d’un côté, sont bio, sans qu’on sache trop ce qu’il en est de l’autre. J’en reviens toujours à la même chose : tant qu’on n’aura pas le courage d’aller au bout de la démarche en inscrivant un pourcentage précis, une origine lisible, avec des pays nettement identifiés, cela restera confus.
Monsieur le ministre, je vous entends bien quand vous dites que tout est clair pour le 100 % bio, mais vous savez, comme moi, que selon les mesures et les pays, ce n’est pas tout à fait la même chose. Je pense qu’il faut aller plus loin dans l’étiquetage des miels. Cet amendement va dans ce sens.

Tel que l’amendement est rédigé, ce cas de figure n’apparaît pas. Quel que soit le mélange de miels, même s’ils sont tous « bio », il interdit la mention « bio ». Il faudrait être plus précis et spécifier des mélanges de miels « bio » et non certifiés « bio ». En l’état, la rédaction prête à confusion.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 est adopté.

L’amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Luche, Mme Berthet, M. Bignon, Mme Billon, MM. Bockel, Bonhomme, Bonne et Bonnecarrère, Mme Bories, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chasseing, Cuypers et Daubresse, Mme de la Provôté, M. Delcros, Mme Deseyne, M. Détraigne, Mme Doineau, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Goy-Chavent, MM. Guerriau et Henno, Mme Joissains, MM. Joyandet, Kern, Laurey, Le Nay, Longuet, Louault et A. Marc, Mme Micouleau, M. Moga, Mme Noël, MM. Paccaud, Revet et Saury, Mmes Tetuanui, Thomas, Vermeillet et Vullien et M. Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 412-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer à l’état transformé, le pays d’origine de la matière première principale utilisée est indiqué sur l’étiquette. »
La parole est à M. Jean-Claude Luche.

Par cet amendement, nous proposons d’indiquer sur l’étiquette le pays d’origine de la matière première principale du produit agricole et alimentaire transformé. Actuellement, le pays d’origine indiqué sur l’étiquette correspond au pays de transformation du produit – on vient d’en parler pendant une bonne partie de l’après-midi – ; mais le consommateur ignore totalement d’où proviennent les matières premières qui composent le produit transformé !
Ainsi, nous avons le souvenir de plusieurs scandales récents. Je pense à celui qui a concerné des coulis de tomate transformés en Italie, mais dont les tomates venaient en réalité de Chine. Certains coulis étaient même étiquetés « bio ».
Pour pallier ce manque de transparence, des initiatives ont été mises en place ici ou là. Tel est le cas dans mon département de l’Aveyron où nous avons créé l’estampille « fabriqué en Aveyron ». Pour l’obtenir, il faut que 50 % au moins des matières premières viennent de l’Aveyron. Je vous assure que cette démarche, très importante, est vraiment de nature à rassurer le consommateur. Elle a des effets très positifs sur la commercialisation de ces produits.
Aujourd’hui, je souhaite, avec cet amendement, pouvoir offrir une information très claire au consommateur qui en a véritablement besoin. Il connaîtrait ainsi le nombre de kilomètres parcourus par son alimentation entre le lieu de production de la matière première et le lieu de transformation, jusqu’à son lieu de consommation.
Enfin, pour des raisons sanitaires et afin de garantir la bonne traçabilité de ces produits, il me paraît nécessaire d’indiquer le pays d’origine de la matière première de ces produits transformés et leur lieu de production.

Il s’agit là d’un sujet majeur qui a fait l’objet d’expérimentations. Depuis mai 2018, est rendue obligatoire par un règlement d’exécution européen l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire. Ce règlement d’exécution sera applicable à compter du 1er avril 2020. Je considère que cet amendement est satisfait et j’en demande donc le retrait.

Je suis désolé, mais je maintiens mon amendement. Mme la rapporteure a parlé d’avril 2020. Or il est urgent, vraiment urgent, que nous mettions en place cette démarche. Le consommateur a été perturbé. On lui a adressé un certain nombre de messages mensongers depuis des années et des années. N’attendons pas avril 2020 ! D’ici là, il peut se passer quantité d’événements, de tromperies ou autres.
Il est urgent de délibérer sur cette question. J’en appelle à chacune et à chacun d’entre vous pour qu’on ait une meilleure traçabilité. Il est nécessaire de donner au consommateur tous les moyens pour lui permettre de faire le meilleur choix possible.

Cet amendement n’est pas du tout dénué de sens ! Rappelons-nous ces fameuses lasagnes étiquetées « viande bovine française » qui contenaient du cheval et qui ont fait scandale ! Cela pose aussi des problèmes sanitaires.
On parle de l’ingrédient primaire. J’ai parlé des lasagnes censées être cuisinées avec de la viande bovine. On peut avoir, adjoints à la recette, des produits, y compris d’origine animale, qui viennent de je ne sais où !
Nous devons la transparence aux Français ! Je rejoins complètement mon collègue Luche ! Il faut d’urgence davantage de transparence. On est en train de nuire à nos filières qui sont d’excellence – vous le savez bien, monsieur le ministre, puisque vous les défendez partout où vous allez. C’est le moment de les défendre et nous le ferons d’autant plus qu’il sera permis de mentionner la provenance exacte des produits. Ainsi, quand un produit est estampillé « produit français », on sait ce qu’on achète à 99 % !

Je veux tout d’abord préciser que je parle en mon nom propre. Je m’exprime peut-être au nom d’une partie du groupe, mais pas forcément au nom de l’ensemble du groupe. Il est important de le préciser.
Quoi qu’il en soit, ce type d’amendement est extrêmement attendu par nos concitoyens. Lorsque l’on parle d’urgence, oui, c’est vrai, il y a urgence, urgence à donner des signes forts. Il est fini le temps où l’on pouvait imaginer continuer à fonctionner ainsi !
N’oubliez pas les chiffres de l’année dernière concernant la consommation de viande de volaille. Nous sommes un pays exportateur de volailles et 45 % de notre viande de volaille consommée est importée ! On retrouve ces viandes-là dans les préparations élaborées. Ces obligations serviront la transparence et vont calmer les industriels sur les importations !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Union Centriste. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.

Je comprends votre volonté, dans cette proposition de loi, de marquer les esprits avec différents amendements. Nous aurons, je le crains, des difficultés à obtenir un vote conforme de l’Assemblée nationale.
Je le redis, l’esprit de la proposition de loi était d’être efficace, en particulier sur les problématiques de la Clairette de Die qui avaient été exprimées par différents collègues à l’origine de cette proposition de loi.
Je comprends bien votre volonté de marquer de nouveau les esprits, sauf que la proposition de loi ne sera pas votée conforme – j’en donne ma main à couper ! Elle ira donc à l’Assemblée nationale où elle sera examinée dans le cadre d’une niche. Elle reviendra ici, puis elle repartira au Palais-Bourbon, toujours dans le cadre d’une niche. Je pense que, avant le vote de la proposition de loi, ce qui était prévu sera déjà en place.
Tout en comprenant votre volonté de marquer les esprits, il me semble qu’il serait quelquefois bon de jouer l’efficacité…

Nous verrons bien si la décision déjà prise depuis 2018 sera mise en application avant avril 2020. Je pense que nous ne prenons absolument aucun risque à voter ma proposition !
Je reviens à ce qui a été dit : nous nous devons d’imposer une véritable transparence pour le consommateur qui, aujourd’hui, est totalement perturbé.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412 -7. – La mention de la provenance du vin est indiquée en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.
« Le non-respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant. »

Cette prise de parole sur l’article vaut présentation de l’amendement n° 27 rectifié. Nous souhaitons en effet proposer un compromis à nos collègues qui demandent la suppression de cet article. Je vous le précise d’emblée, l’amendement que nous avons déposé sur cet article a reçu l’accord de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d’origine contrôlées, la CNAOC.
La rédaction que nous vous proposerons traduit toujours l’objectif de la proposition de loi, à savoir la lutte contre les pratiques trompeuses visant à induire le consommateur en erreur quant à l’origine du vin.
L’article L. 413–8 du code de la consommation, que nous proposons de modifier, dispose en effet qu’il est interdit de laisser penser qu’un produit a une origine française alors que tel n’est pas le cas. Une dérogation est toutefois prévue si le pays d’origine figure sur l’étiquette de manière apparente.
Or c’est bien là que réside notre problème : dans les cas de fraude que nous observons pour le vin, la mention du pays d’origine figure bien sur la bouteille, mais de telle manière qu’elle n’est pas visible pour le consommateur. Nous pouvons ainsi relever, sur certaines bouteilles, la présence en très gros caractères de marques à consonance française, tandis qu’il n’est fait mention de la véritable origine du vin qu’en petits caractères, de façon peu lisible. Si toutes les mentions obligatoires au titre de la réglementation européenne sont donc bien présentes sur la bouteille, il n’en reste pas moins que nous nous trouvons là face à une tentative de tromperie du consommateur. Cette situation est encore plus critique lorsqu’il s’agit de bag in box.
Nous avons parfaitement conscience, monsieur le ministre, que la meilleure des réponses serait un renforcement des moyens dont dispose la DGCCRF pour lutter contre les fraudes. Les personnels de cette direction se plaignent de ne pouvoir, faute d’effectifs suffisants, atteindre leurs objectifs de contrôle ; ils ont le sentiment de trop souvent servir de variable d’ajustement.
Cela dit, compte tenu des divergences que nous avons eues, au Sénat, sur le sujet de la répression des fraudes lors de l’examen de la loi Égalim, nous avons déposé l’amendement n° 27 rectifié, qui devrait nous permettre d’obtenir un consensus au sein de notre assemblée.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et Lassarade, MM. Bouchet, Louault et Panunzi, Mme Bruguière, M. Savary, Mmes Berthet et Deromedi, MM. Grand, Huré et Lefèvre, Mme A.M. Bertrand, M. Détraigne, Mme Troendlé, MM. Mayet et Chaize, Mme Chain-Larché, MM. Mouiller, Cuypers, Babary, Bonhomme, Morisset et Pointereau, Mmes Renaud-Garabedian et Puissat, MM. Duplomb, Genest et de Legge, Mmes Morhet-Richaud et Lamure, MM. Calvet, Laménie et Sido, Mmes M. Mercier et Noël, MM. B. Fournier, Kennel et Milon, Mme Chauvin, M. Ginesta et Mmes Garriaud-Maylam et Thomas, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Laurent.

L’article 4 de la présente proposition de loi prévoit de mettre en évidence la mention de la provenance d’un vin sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d’origine du produit.
Si chacun s’accorde sur la nécessité de fournir au consommateur une information loyale sur les produits qui lui sont proposés, les dispositions de cet article peuvent apparaître superfétatoires.
Je considère que notre arsenal législatif et réglementaire offre les outils nécessaires pour lutter efficacement contre des pratiques trompeuses en matière d’étiquetage de l’origine.
Monsieur le ministre, comme Roland Courteau vient de le rappeler, il convient surtout de veiller à ce que les services de l’État en charge des contrôles disposent des moyens nécessaires pour assurer leurs missions, particulièrement lorsque celles-ci ont été élargies du fait de l’adoption de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Si l’intention de défendre notre filière vitivinicole et le droit d’information des consommateurs est fort louable, nous devons veiller à ne pas surcharger notre droit de diverses dispositions, en contradiction, par ailleurs, avec notre objectif permanent de simplification. Tel est l’objet du présent amendement.

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 4, au motif que l’arsenal juridique nécessaire existe déjà. Je partage tout à fait ce point de vue, et j’estime, moi aussi, qu’il faut donner davantage de moyens à la DGCCRF ; cela a été rappelé tout au long de l’après-midi.
En revanche, le cadre juridique peut laisser planer des doutes. Il en va ainsi de l’article L. 413–8 du code de la consommation, que je tiens à citer : « Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d’apposer ou d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. » Cette interdiction de tromper le consommateur est donc déjà prévue noir sur blanc.
Toutefois, l’alinéa suivant précise que « ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine ». Or cette mention est obligatoire, et donc toujours présente, sur les produits viticoles.
Dès lors, cet article du code de la consommation semble laisser entendre qu’il est possible d’utiliser, en toute légalité, une imagerie trompeuse quant à l’origine des vins. C’est ce dont sont victimes les vins de pays d’oc et, notamment, une marque très connue et très appréciée au sein de cette IGP, Ormes de Cambras : on peut trouver dans certains rayonnages un bag in box où figurent le nom « Cambras » et un beau paysage provençal ; en très petits caractères figure la mention « vin espagnol ».
Comme l’affirmait M. le ministre, il est important que nous défendions nos agriculteurs et, en l’occurrence, ces viticulteurs.
C’est pourquoi nous considérons que l’amendement n° 27 rectifié tend à réparer cette anomalie juridique. Il vise en effet à préciser que la dérogation dont peuvent bénéficier certains produits ne s’appliquera pas aux produits viticoles. Cela mettrait simplement en œuvre le droit européen au sein du droit français, sans en rajouter une couche !
Nous sommes donc favorables à cet amendement ; par conséquent, monsieur Laurent, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 7 rectifié, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

Le Gouvernement est pour sa part favorable à l’adoption de l’amendement n° 7 rectifié, car nous estimons qu’il correspond à nos besoins. L’amendement n° 27 rectifié recevra quant à lui un avis de sagesse.

Nous avons largement discuté de ce problème ce matin lors de la réunion de la commission des affaires économiques. Je comprends que l’amendement n° 27 rectifié a été rédigé dans un souci de recherche de l’unanimité et, surtout, de facilitation de la tâche des contrôleurs, notamment en Occitanie, qui pâtit, de ce point de vue, de la proximité de l’Espagne.
Je tiens à insister, monsieur le ministre, sur l’importance du rôle des services de l’État chargés de ces contrôles. On a lieu d’être inquiet à leur sujet, en dépit de vos déclarations précédentes : nombre de postes extrêmement importants risquent d’être supprimés, et il serait bon que vous preniez conscience du caractère indispensable de ces contrôles pour cette filière.
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
L’amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Monier, MM. Montaugé et Courteau, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au deuxième alinéa de l’article L. 413-8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : «, à l’exception des vins ».
La parole est à M. Roland Courteau.

Je l’ai défendu quand je me suis exprimé sur l’article, mais je veux préciser une chose : plus nous aurons d’outils, mieux cela vaudra – tel est notre rôle de législateur –, mais plus les effectifs de la DGCCRF seront renforcés, jusqu’à devenir suffisants, plus vite nous stopperons ces fraudes, ces tromperies et ces duperies !

Sur cet amendement, comme je l’ai annoncé, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Concernant les contrôles, il faut tout de même de la cohérence. On ne peut pas me demander, tous les trois jours, par courrier ou par téléphone, de diminuer les contrôles imposés aux exploitations agricoles et à la fois, quand c’est arrangeant, exiger de les renforcer ! Il n’y a pas de bons et de mauvais contrôles.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

C’est ce que je répète depuis le début de l’après-midi : les fraudes sont inacceptables. La DGCCRF, qui ne dépend pas du ministère de l’agriculture, mais de Bercy, fait son travail. Regardez le nombre de contrôles qu’elle accomplit : je ne sais pas si ses effectifs sont ou non suffisants, mais les contrôles sont très nombreux, et il y a des amendes à la clé ! Je veux donc quand même saluer les efforts entrepris par Bercy et la DGCCRF.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 33 rectifié ter, présenté par MM. Labbé et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall et Gontard, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115- … . – À partir du 1er janvier 2023, pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu’il provient d’écloseries ou d’huîtres nées en mer.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Joël Labbé.

Un amendement similaire avait obtenu un avis de sagesse de la commission lors de notre examen de la loi Égalim. Cette disposition avait été ensuite adoptée par l’Assemblée nationale, mais elle a été du nombre de celles qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Évidemment, il s’agit de produits alimentaires : nous ne sommes pas à côté du sujet !
Environ 50 % des huîtres en vente sur les étals sont des huîtres triploïdes, issues d’un croisement entre des huîtres tétraploïdes et des huîtres diploïdes. Elles sont censées être stériles, atteignent leur maturité en deux ans, au lieu de trois, et ne sont pas laiteuses l’été, ce qui permet leur consommation en cette saison. Je n’évoquerai pas les qualités gustatives de ces huîtres, mais il est indéniable que ce n’est pas le même produit que celui que fournissent les ostréiculteurs traditionnels.
C’est pourquoi ceux-ci demandent que leurs produits soient étiquetés. Il ne s’agit pas de mentionner la diploïdie ou la triploïdie de l’huître – cela ne serait pas très vendeur –, mais de distinguer sur l’étiquette entre huîtres nées en mer et huîtres nées en écloserie ; les huîtres triploïdes ne peuvent naître qu’en écloserie.
Je suis convaincu, même aujourd’hui, que l’on va avancer, parce qu’un tel étiquetage va dans le sens des attentes de nos concitoyens. Il ne dérange personne, mais il arrange tout le monde !

Nous connaissons la ténacité avec laquelle notre collègue Joël Labbé défend les huîtres !
L’étiquetage de ces produits comporte déjà de nombreuses mentions obligatoires. L’objet de cet amendement est de permettre au consommateur de différencier les huîtres triploïdes des huîtres diploïdes. Cela reprend un débat scientifique.
Le comité national de la conchyliculture a une nouvelle gouvernance ; c’est également le cas de certains comités régionaux de cette profession ; dans ma région d’origine, ce comité a élu un nouveau président. Je me suis longuement entretenu, au téléphone, avec les représentants de cette profession ; ils m’ont assuré que ce débat devait avoir lieu en leur sein, mais qu’il fallait les laisser travailler pour qu’ils nous présentent des propositions qui iraient dans votre sens, mon cher collègue. Comme de nouvelles personnes viennent de prendre leurs responsabilités, j’estime qu’il faut laisser le temps au temps !
Je veux néanmoins vous rassurer, mon cher collègue. L’information que vous proposez de rendre obligatoire peut déjà être apposée sur l’étiquetage par les producteurs qui souhaitent valoriser les productions traditionnelles en mer. Il n’est donc pas utile de l’inscrire dans la loi.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

On nous dit que la profession demande du temps, mais cela fait dix ans qu’elle présente de telles demandes ! La profession, ou du moins ses représentants majoritaires, réclame toujours plus de temps, mais on sait que derrière ces demandes, il y a le lobbying des écloseries !
Il faut envoyer un signe, puisque nous travaillons sur la qualité, la traçabilité et la transparence des produits alimentaires. On peut d’autant plus aisément adopter cet amendement que, volontairement, nous avons choisi de ne rendre cette disposition applicable qu’à partir de 2023. Ainsi, l’ensemble des professionnels auront le temps de s’y préparer. Nous avons tout creusé, nous avons véritablement discuté avec la profession, mais jusqu’à présent nous n’avons pas pu avancer. Envoyer ce signe fort permettrait au Sénat, avant même l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale, de prendre une position claire sur un sujet de transparence de l’alimentation.

Notre groupe s’abstiendra sur cet amendement, mais aussi sur les amendements n° 1 rectifié, 20 rectifié, 2 rectifié, 14 rectifié et 4 rectifié. Sur le fond, nous pourrions être d’accord avec ces amendements, mais ils n’ont pas de rapport direct avec le texte initial.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Grand, Daubresse, Milon, Buffet et Laménie, Mme Lassarade, MM. Revet et Sido, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412 -…. – I. – Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.
« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Cet amendement vise à interdire l’utilisation de certaines dénominations commerciales associées aux produits d’origine animale pour des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.
Il est question, notamment, de l’emploi des termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » pour qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande, ou de la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d’origine végétale.
En effet, de telles dénominations entretiennent la confusion dans l’esprit du consommateur, voire introduisent un principe d’équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.
Je vous propose donc d’intégrer à ce texte un article qui participe de la bonne information du consommateur sur l’origine, animale ou végétale, des produits qu’il consomme.

Tout a été dit par notre collègue Jean-Pierre Grand. L’adoption de cet amendement permettrait de nous mettre en conformité avec le droit européen tout en maintenant la position que nous avions adoptée lors de nos débats sur la loi Égalim ; un article similaire avait alors été adopté. Cela clarifierait également l’étiquetage pour les consommateurs, ce qui correspond à l’objectif de cette proposition de loi.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Sur le principe, je suis favorable à l’amendement de M. Grand, mais si une telle disposition s’appliquait seulement à la France, cela créerait une distorsion de concurrence avec les autres pays, ce qui poserait un réel problème.
La France, avec d’autres pays, défend cet encadrement au niveau européen ; nous souhaitons l’inscrire au sein de la Politique agricole commune 2020-2027.
J’estime par ailleurs que cet amendement pourrait être rectifié afin de viser, non pas l’ensemble des matières premières d’origine végétale, mais les seules protéines végétales utilisées en substitution de protéines animales.
Cela dit, au vu de la situation et de l’heure qu’il est, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

J’ai tout de même le droit de m’exprimer !
C’est un sujet suffisamment important ; je remercie M. le ministre, dont les propos ont utilement complété l’avis de la commission, du courage dont il fait montre à cet instant. Mesurez les conséquences de notre vote ! Je remercie également M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin, Mandelli et Mouiller, Mmes L. Darcos et Gatel, M. Maurey, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Gruny et M. Mercier, M. Bizet, Mme de Cidrac, MM. Piednoir, Kennel et Kern, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Pellevat, Grosperrin et Vaspart, Mme Ramond, MM. Meurant, Longeot et Bonhomme, Mmes Chauvin, Lamure et Morhet-Richaud, MM. Henno, de Nicolaÿ et Louault, Mme Troendlé, M. Cuypers, Mmes Guidez et Dumas, M. Paccaud, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Bascher et Vogel, Mmes Férat, Vullien, Malet et Bories, MM. Chaize et Huré, Mmes Deromedi et Goy-Chavent et MM. Pierre, Babary, Laménie, Revet, L. Hervé, Saury, Émorine, Dufaut, Daubresse et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412 -…. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins ou des spiritueux mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
La parole est à M. Michel Raison.

Cet amendement vise à offrir une transparence accrue aux consommateurs de vins, d’alcools et de produits spiritueux. Je pense en particulier au rhum que produisent différents départements d’outre-mer. Je sais que cet amendement sera adopté ; ainsi, nous ne serons pas venus en vain à cette séance !

L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Grand, Grosdidier, Daubresse, Milon, Buffet et Laménie, Mmes A.M. Bertrand et Lassarade, MM. Revet et Sido, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412 -…. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

Le dispositif de l’amendement n° 20 rectifié reprend les dispositions qu’avait adoptées le Sénat lors de l’examen de la loi Égalim, qui vont dans le sens que nous voulons donner à cette proposition de loi, à savoir la transparence offerte au consommateur. Ces dispositions ont trait aux établissements de débit de boissons.
Une seule différence distingue l’amendement n° 2 rectifié de l’amendement n° 20 rectifié : ce dernier vise également les spiritueux, et non pas seulement les vins. C’est pourquoi nous sommes favorables à son adoption plutôt qu’à celle de l’amendement n° 2 rectifié, qui serait alors pleinement satisfait et n’aurait plus d’objet.

Je suis désolé, mesdames, messieurs les sénateurs, mais il est l’inverse de celui de votre commission.
Autant je suis totalement favorable à l’adoption de l’amendement n° 2 rectifié – ces dispositions excellentes vont dans le bon sens et répondent aux demandes de nos concitoyens –, autant les dispositions relatives aux spiritueux qui figurent à l’amendement n° 20 rectifié sont impossibles à mettre en œuvre, puisque les bouteilles ne comportent pas d’indication de l’origine de la boisson. Le restaurateur ne pourra donc pas mettre en œuvre une telle mesure.
L’amendement n° 2 rectifié, pour sa part, tend à répondre à la demande de tous nos concitoyens ; cela fait écho à la traçabilité que M. Courteau réclamait à raison pour les vins qui nous viennent d’Espagne. Il est inacceptable que des bouteilles prétendent contenir du champagne alors que le vin qui s’y trouve n’a rien à voir ! Cette disposition serait donc très positive.
En revanche, on ne voit pas comment cela se ferait pour les spiritueux, puisque l’origine de ces boissons ne figure pas sur les bouteilles. C’est donc juridiquement impossible à mettre en œuvre.
C’est pourquoi le Gouvernement est plutôt favorable à l’adoption de l’amendement n° 2 rectifié et défavorable à celle de l’amendement n° 20 rectifié.

Au vu des précisions que vient de nous apporter M. le ministre, M. Raison voudrait-il bien retirer son amendement au profit de celui de M. Grand ? Si nous voulons que ce texte soit adopté conforme par l’Assemblée nationale, peut-être faudrait-il faire un effort supplémentaire.

Je vais le retirer, puisque l’amendement n° 2 rectifié est identique hormis la mention des spiritueux. Nous pourrons, je l’espère, travailler avec l’Assemblée nationale afin de déterminer comment répondre au problème spécifique du rhum ; je ne pouvais tout de même pas viser uniquement cette boisson dans mon amendement ! Cela dit, je le retire, monsieur le président.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel et Mme Jasmin, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412 -…. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine des matières premières est indiquée obligatoirement sur l’étiquetage des produits vendus sous l’appellation “Rhum”.
« La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article.
« Le non-respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant. »
La parole est à M. Victorin Lurel.

Cet amendement vise à imposer les mêmes exigences que celles qui étaient demandées au travers de l’amendement n° 20 rectifié dont nous venons de débattre.
Il y a une définition française du rhum. Elle est précise, mais elle est allégrement violée. Une meilleure protection serait offerte si l’on devait faire figurer sur les étiquettes l’origine des matières premières et des ingrédients présents dans les bouteilles. Ni plus ni moins !

Mon cher collègue, nous partageons vos craintes, mais ce problème d’étiquetage relève de la réglementation européenne. Nous ne pouvons pas nous y immiscer. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

Cet amendement est quelque peu similaire à celui que vient de retirer M. Raison ; certes, ce dernier avait pour objet les spiritueux en général, alors que celui de M. Lurel porte sur le rhum en particulier.
Aujourd’hui, comme M. le rapporteur vient de le rappeler, nous ne sommes pas en état de répondre directement à votre question, monsieur le sénateur, alors même qu’il s’agit d’un vrai problème que nous avons évoqué ensemble il y a quelque temps. On ne peut pas faire figurer sur les bouteilles « Rhum de Martinique », ou encore « Rhum de Guadeloupe ».
Tout comme la commission, le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’estime cependant qu’il serait bon que le Sénat et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation examinent comment apporter une réponse à la question que posent tant M. Raison que M. Lurel. On va toujours plus loin dans la recherche d’une traçabilité et d’une transparence totales : il sera normal que les gens sachent à quoi ils ont affaire, ce qu’ils mangent et ce qu’ils boivent. Il faudra avancer sur ce sujet. La grande différence qui existe entre le rhum et les autres spiritueux est la situation spécifique de l’outre-mer, qu’on ne peut pas traiter par-dessus la jambe.
Dès lors, je vous serais reconnaissant, monsieur Lurel, de bien vouloir retirer cet amendement ; je pense que, pour leur part, la commission et le Gouvernement prennent tous deux l’engagement d’essayer de trouver une solution aux questions posées.

Je pense très sincèrement qu’une erreur est commise : il ne s’agit pas d’une législation européenne, mais bien d’une définition française. Il y a dans le monde toutes sortes de définitions du rhum, de Cuba au Venezuela, et même à l’Allemagne, qui produit le Rum-Verschnitt, un rhum à base de pomme de terre ! Mais la définition française doit être respectée sur le territoire français, où les producteurs français subissent une concurrence déloyale !
On peut et, à mon sens, on doit faire respecter cette définition. L’Europe permet un rhum d’assemblage ; c’est son problème, ce n’est pas ce dont il est ici question. Nous voulons simplement, à l’instar de ce qu’a demandé notre collègue Michel Raison pour l’ensemble des spiritueux, mais avant tout pour le rhum, que soit rappelée l’interdiction française de l’assemblage d’ingrédients et de matières premières étrangères sans que cela figure sur l’étiquette. Je demande que soit corrigée cette anomalie, qui crée une concurrence déloyale qui nuit aux rhums français.
Je maintiens donc mon amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Grand, Grosdidier, Daubresse, Milon, Buffet, Laménie, Revet et Sido et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 641-19-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 641-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 641 -19 -…. – Ne peuvent bénéficier de la mention “sans glyphosate” que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d’exploitations n’utilisant pas des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

L’utilisation du glyphosate dans l’agriculture française est source de controverses depuis plusieurs années. La stratégie de la France pour sortir de cet herbicide ne doit pas se faire au détriment des agriculteurs, qui n’auraient pas de produits de substitution et subiraient des distorsions de concurrence avec les autres pays européens.
Le 7 mars 2019, lors d’une audition de la mission d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate à l’Assemblée nationale, M. Mathieu Beaudoin, vice-président des Jeunes Agriculteurs, a suggéré de mentionner l’absence de glyphosate dans les produits concernés, afin de les valoriser.
Ainsi, selon lui, dès lors que des pays étrangers peuvent continuer de produire en utilisant cette substance, il faudrait que le consommateur sache si tel produit, bio ou non, qu’il achète contient ou non du glyphosate et il conviendrait de mettre cette caractéristique en avant dans son intérêt.
M. Beaudoin a également souligné qu’on entend bien, dans le débat public, que tout le monde veut que le glyphosate disparaisse. Il ne faut pas pour autant que seul l’agriculteur paie : tout le monde doit prendre sa part. « Ce n’est pas à nous, a-t-il affirmé, de prendre en charge l’arrêt du glyphosate. »
Je vous propose donc, mes chers collègues, de reprendre cette proposition en créant une nouvelle mention valorisante « sans glyphosate » pour les produits agricoles, transformés ou non, issus d’exploitations n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate.
Je suis conscient qu’on ouvre là un champ compliqué à gérer. Je retirerai donc cet amendement après avoir entendu l’avis de la commission.

Effectivement, comme l’a souligné M. Grand, nous avons déjà largement débattu de ce sujet.
Lors de l’examen de la loi Égalim, j’avais interpellé M. Travert, alors ministre de l’agriculture, sur la traçabilité. Il était inconcevable d’interdire aux producteurs français d’employer cet herbicide tout en continuant à laisser entrer sur le territoire des produits ainsi traités sans qu’un étiquetage précis vienne les distinguer.
En revanche, il est pratiquement impossible de contrôler tous les produits qui entreraient en France sans un tel étiquetage : ce serait une tâche énorme.
Dès lors, le dispositif proposé risque d’imposer une obligation supplémentaire à nos agriculteurs. C’est de la sur-transposition. Nous risquons, une fois encore, la stigmatisation des producteurs et de cet herbicide qu’ils emploient. On ne va pas refaire le débat !
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, même si j’en comprends le sens.
Sourires et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Le titre II de la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2020. Les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant l’entrée en vigueur du même titre II, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, pour les produits mentionnés à l’article 3 de la présente loi, cette possibilité peut s’appliquer jusqu’au 1er septembre 2021.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

Cet amendement vise à limiter dans le temps, jusqu’au 1er septembre 2021, les dérogations aux nouvelles obligations d’étiquetage des miels.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, considérant qu’une telle limitation était de nature à complexifier la procédure et ferait encourir un risque : les produits qui n’auraient pas été vendus entre 2020 et 2021 pourraient être définitivement perdus, sachant qu’il ne s’agit somme toute que de quantités minimales.

Cet amendement tend à autoriser la vente de produits non conformes aux dispositions d’étiquetage prévues par la loi, notamment le miel, après son entrée en vigueur au 1er septembre 2020 et jusqu’à épuisement des stocks. Sur le principe, je suis favorable à cette mesure : un délai de transition permettra aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles dispositions.

À nos yeux, mieux vaut ne pas fixer de date limite : laissons le temps nécessaire pour écouler les stocks.

Je comprends celles et ceux qui veulent éviter les effets d’aubaine en amont. Mais, si l’on fixe une date limite, cela signifie qu’après le 1er septembre 2021 les produits en question ne pourront plus être commercialisés.

Quoi qu’il en soit, il faut bien fixer une limite : ces produits ne vont pas rester en vente ad vitam aeternam !

Si aucune date n’est arrêtée, certains produits seront écoulés en dehors de la réglementation pendant des lustres !

Ne pas préciser de date, c’est prendre le risque que ces dispositions ne s’appliquent jamais.

Quelle que soit l’échéance retenue, il faut une date butoir, à partir de laquelle on dira : « Ce n’est plus possible ! »

Mes chers collègues, je vous précise qu’il ne nous reste que quelques minutes pour achever l’examen de ce texte.
La parole est à Mme la rapporteure.

Mes chers collègues, je vous relis simplement l’article 5, pour que nous soyons bien d’accord : « Le titre II de la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2020. Les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant l’entrée en vigueur du même titre II, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ces dispositions, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks. »
Ce qui est proposé, c’est que ces produits puissent être vendus et distribués jusqu’au 1er septembre 2021 : il y a donc bien une date butoir pour la vente des produits sous ancien étiquetage.

Nous sommes bien d’accord : il faut une date butoir ! Un produit comme le miel n’a pas de limite de péremption. La distribution du stock pourrait donc prendre des années… Au point où nous en sommes, peu importe !
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 5 est adopté.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement porte sur la gestion du temps réservé à chaque groupe.
Ce système, nous le connaissons tous : nous essayons d’examiner deux textes par créneau de quatre heures, qu’ils soient d’ailleurs adoptés ou non.
Cet après-midi, nous avons assisté à un débat très intéressant et utile sur beaucoup de sujets. Mais il y a un problème : nous devions aussi examiner une proposition de loi relative à la corruption internationale, aux biens mal acquis et à la restitution de ces derniers, lorsqu’ils sont confisqués, aux populations spoliées.
Ce texte est d’une grande importance. Le sujet dont il traite sera examiné lors du prochain G7. De très nombreuses ONG se sont mobilisées face à ces enjeux, notamment Transparency International. Nous-mêmes, nous avons beaucoup travaillé la question : il y a dix jours, au Sénat, nous y avons consacré un colloque, auquel ont pris part des personnalités de différents pays. Or notre proposition de loi n’a pas pu être examinée, et je le regrette.
On le voit bien, il est très facile de détourner le système. Bien sûr, le droit d’amendement est imprescriptible. Mais si, au cours des quatre heures réservées à un groupe, l’on impose systématiquement l’examen d’un grand nombre d’amendements, on peut en définitive empêcher l’adoption du premier texte inscrit et le simple examen du second !
À mon sens, il s’agit là d’un vrai problème pour nous tous. Peut-être aurons-nous l’occasion d’en parler à la conférence des présidents ou dans une autre circonstance. Quoi qu’il en soit, il faut examiner cette question. Il s’agit de travailler ensemble dans de bonnes conditions en séance publique : je sais que nous y sommes tous attachés !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Monsieur Sueur, je comprends tout à fait vos remarques ; acte vous est donné de votre rappel au règlement.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures quarante.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Les Républicains, sur le thème : « Les enjeux d’une politique industrielle européenne. »
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je rappelle que l’auteur de la demande du débat dispose d’un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.
Dans le débat, la parole est à M. Pierre Cuypers, pour le groupe auteur de la demande.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis son essor il y a deux siècles, l’industrie a joué un rôle capital dans le développement et la puissance économique de l’Europe. Pourtant, les États membres de l’Union européenne n’ont jamais réussi à s’entendre pour mettre en place une politique industrielle active.
Les conséquences de cette carence sont connues : sans soutien stratégique pour affronter la libéralisation des échanges et l’ouverture des frontières, des secteurs industriels entiers ont été démantelés. Dans les territoires les plus durement touchés, les populations fragilisées expriment aujourd’hui leur ressentiment face à une Europe qui n’a pas tenu sa promesse de prospérité et n’a pas su, ou pas voulu, enrayer le cycle de la désindustrialisation.
Dans notre pays, l’hémorragie se poursuit. On ne compte plus les dossiers stratégiques sur lesquels l’absence de politique industrielle européenne se conjugue à l’incapacité du Gouvernement à écouter les acteurs de notre industrie. Alcatel-Lucent, ou l’abandon du marché des télécoms : 400 emplois sacrifiés ; Ford, qui a vu son projet de reprise de l’usine de Blanquefort rejeté : 850 emplois ; Ascoval, ou l’abandon des matières premières : 300 emplois ; chez moi, en Seine-et-Marne, Arjowiggins, ou l’abandon de notre souveraineté pour les documents sécurisés : 240 emplois ; Alstom, ou l’abandon des secteurs du nucléaire et du transport ferroviaire, Safran, qui, face aux contraintes administratives, a renoncé à ouvrir deux usines en France : 600 emplois.
Le Président de la République, qui n’hésite pas à brader les intérêts stratégiques de la France, …

… notamment en matière agricole, a renoncé à toute ambition industrielle pour notre pays, mais s’est découvert une ambition pour l’industrie européenne. Espérons qu’elle ne connaisse pas le même sort que ses autres priorités européennes, lesquelles ont toutes, jusqu’à présent, été mises en échec : l’Union européenne ne peut pas se permettre de poursuivre sur la voie de l’indifférence industrielle. Face aux grandes mutations de l’économie mondiale, cette évolution ne peut mener qu’au déclassement industriel et, à terme, au déclin économique de la France.
En effet, les pays émergents exercent une concurrence de plus en plus vive, y compris dans des secteurs où l’Europe pensait qu’elle aurait toujours une technologie d’avance.
Par ailleurs, la révolution numérique et la marche vers la transition écologique se sont accélérées. Dans la course de vitesse qui s’est engagée pour dominer les nouvelles technologies et les nouveaux marchés qui en découlent, les entreprises américaines et chinoises ont clairement pris une, voire plusieurs longueurs d’avance.
Enfin, l’ordre économique international est devenu dysfonctionnel. Les guerres commerciales amorcées par les États-Unis contribuent à le déstabiliser ; pis, les règles multilatérales sont de moins en moins respectées, à part peut-être par les Européens.
La Commission et les États membres doivent prendre la mesure du bouleversement en cours et dépasser leurs réticences respectives pour élaborer enfin une stratégie industrielle européenne digne de ce nom.
Les financements publics en faveur de la recherche devront non seulement être massifs, mais porter bien davantage sur les stades ultérieurs de l’innovation, jusqu’au déploiement industriel. Ils devront également s’accompagner d’une mobilisation plus importante qu’aujourd’hui des capitaux privés, notamment le capital-risque.
Surtout, les actions de la Commission et des États devront être mieux coordonnées, soit par de grands programmes mobilisateurs favorisant les coopérations industrielles, soit par l’animation de pôles d’excellence technologique et industrielle.
Une fois ce cadre établi, les autres politiques de l’Union européenne devront être mises en cohérence avec la priorité industrielle. L’affaire Alstom-Siemens l’a une nouvelle fois prouvé : le droit de la concurrence est concerné au premier chef, et il est indispensable de faire évoluer son application pour qu’elle soit plus en phase avec les réalités de l’économie contemporaine.
Les autorités de la concurrence doivent notamment prendre conscience du fait que, pour les entreprises industrielles, le marché pertinent est désormais, presque toujours, le marché mondial. Elles doivent également comprendre que la consolidation et le rattrapage technologique des entreprises étrangères sont aujourd’hui beaucoup plus rapides qu’hier ; dès lors, elles peuvent conquérir des marchés sur lesquels les industries européennes détenaient peu de temps avant un avantage concurrentiel certain.
La logique des régimes d’exemption par catégorie et des projets industriels d’intérêt européen commun pourrait également être élargie pour favoriser la formation d’une politique industrielle. Les secteurs définis comme stratégiques devraient ainsi bénéficier de règles dérogatoires assouplies, tant dans le domaine des aides d’État que dans celui des concentrations.
Ces évolutions sont fondamentales pour que l’Europe ne devienne pas une simple terre de consommation et de services ; pour qu’elle reste aussi une terre de production et d’industrie.

Toutefois, on ne saurait atteindre ce but sans faire preuve d’un plus grand pragmatisme en matière commerciale. L’Europe a fait le choix d’être, sans contrepartie, la région la plus ouverte au monde. Reconnaissons-le : cette logique atteint aujourd’hui ses limites. Il faut désormais donner au projet européen une orientation plus offensive et plus protectrice, face à des concurrents qui ne jouent pas selon les mêmes règles.
C’est particulièrement vrai à l’égard de la Chine : les immenses appétits de ce pays, illustrés par sa conquête des marchés africains, sa stratégie du Made in China 2025 ou encore son initiative de « nouvelles routes de la soie », se nourrissent de pratiques qu’il n’est plus possible de tolérer. Mais c’est également vrai de nos autres partenaires commerciaux, qui pour la plupart protègent leurs marchés et leurs entreprises tout en appliquant des normes bien moins strictes que les nôtres.
L’Europe doit donc d’urgence imposer une plus grande réciprocité des échanges et renforcer ses outils de défense commerciale. D’ailleurs, elle a récemment amélioré ses instruments antidumping, et elle a élaboré de nouvelles règles pour le contrôle des investissements étrangers. C’est un pas dans la bonne direction, mais il faut aller plus loin.
Ainsi, n’hésitons pas à mettre en place une taxation du carbone aux frontières de l’Europe ; renforçons massivement le contrôle des produits importés pour vérifier leur conformité aux règles d’accès au marché unique, qui est loin d’être toujours satisfaisante.

L’adoption d’un instrument international sur les marchés publics doit également être une priorité. Un tel outil permettrait de restreindre l’accès des entreprises étrangères à nos marchés publics si leurs États usent, dans leurs propres marchés publics, de pratiques discriminatoires envers les entreprises européennes.
Cette logique devrait même être amplifiée, pour s’étendre à tous les marchés, publics ou non, voire être complétée si nécessaire par un Buy European Act renouant avec le principe de préférence communautaire et réservant une part de la commande publique aux entreprises européennes, en particulier dans les activités dites « de souveraineté », comme la défense, l’aéronautique, l’énergie et les télécommunications.
Il s’agirait d’un pas décisif vers une véritable protection de nos technologies et de nos infrastructures critiques, qui sont par ailleurs de plus en plus liées aux infrastructures numériques et donc de plus en plus vulnérables face au pillage, à l’espionnage et au sabotage.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, vous le savez : l’Europe reste une terre d’exception sur le plan industriel. Elle n’est pas condamnée à rendre les armes. Nous le savons aussi, elle dispose des atouts nécessaires pour concevoir une stratégie industrielle conquérante, à condition que nous sachions la protéger.
Pour que nous soyons au rendez-vous, il faudra que tous les Européens aient une conscience aiguë des enjeux de puissance, ainsi qu’une volonté sans faille d’agir collectivement. C’est peut-être là leur défi le plus considérable !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Cuypers, avant tout, permettez-moi de vous dire avec quel plaisir je prends part à ce débat. S’il y a bien une conviction qui ne m’a jamais quittée, comme ancienne cadre exécutive d’entreprise industrielle et comme secrétaire d’État, c’est bien que le succès industriel français passe par une vraie politique industrielle européenne ; et ce débat est une excellente occasion d’aborder cette question avec vous.
Je ne reviendrai pas sur les enjeux de la renaissance industrielle française : les emplois directs et indirects, la vitalité que ces derniers offrent à nos territoires, le rétablissement de la balance commerciale, ou encore la souveraineté technologique.
Je ne reviendrai pas non plus sur la stratégie que le Gouvernement déploie au niveau national pour engager la reconquête industrielle de la France. Elle est très claire et tient en quelques mots clés : plus de compétitivité, plus de formation, plus d’innovation, des approches par filières – ces dernières sont, au total, au nombre de dix-huit –, plus de travail dans les territoires, plus d’attractivité – vous connaissez déjà ces grands piliers.
Cela étant, monsieur Cuypers, je vais devoir préciser certains points. Non, Safran n’a pas renoncé à installer deux usines en France. Cette entreprise a même annoncé le contraire il y a quelques jours. Non, Ascoval n’est pas perdu, puisque, aujourd’hui, trois repreneurs sérieux travaillent sur le dossier. Non, nous n’abandonnons pas notre souveraineté à propos des titres sécurisés : pour ce qui concerne ces documents, et notamment les cartes d’identité, nous sommes en train de passer à des formats différents du papier. Non, nous ne détruisons pas de l’emploi dans l’industrie…
Nous avons effectivement perdu un million d’emplois dans l’industrie entre 2000 et 2017. Mais force est de constater que, depuis 2017 – ce sont les chiffres de l’Insee –, l’emploi progresse à nouveau dans l’industrie : 9 500 emplois ont été créés l’année dernière, et l’Insee prévoit 6 000 emplois supplémentaires au premier semestre 2019.
Oui, le nombre de sites industriels augmente ; oui, le nombre d’expansions de sites industriels augmente ; oui, les investissements directs à l’étranger ont fait un véritable bond, en 2017, dans le domaine de l’industrie.
Cette mise au point étant faite, j’approuve beaucoup des idées que vous avez exprimées, au sujet de la politique industrielle : nous défendons d’ailleurs à peu près les mêmes ambitions que vous, auprès de la Commission européenne comme du Conseil européen.
Nous devons parler de l’Europe. Comme vous l’avez très bien dit, tout ce que nous faisons au niveau national ne peut avoir de sens que dans le cadre d’une politique industrielle européenne, pour une simple et bonne raison : face à la concurrence américaine ou chinoise, les bonnes réponses doivent être apportées au niveau continental.
Cela n’aura échappé à personne : depuis quelques années, le paysage économique mondial a changé. Le multilatéralisme est menacé par les aides d’État et, plus largement, par le protectionnisme que mettent en œuvre certains de nos partenaires commerciaux. L’industrie européenne doit par ailleurs faire face à une concurrence technologique féroce de la part de l’Asie – et pas seulement de la Chine – ou encore des États-Unis.
Face à ces menaces, l’Europe n’est pas restée les bras ballants. Nous avons su répondre de façon efficace, car unie, à la crise de l’acier, déclenchée par les importations massives d’acier en Europe. Nous avons modernisé nos instruments de défense commerciale pour mieux protéger nos entreprises face à une concurrence déloyale. Nous avons désormais un mécanisme européen de screening, ou de revue, pour contrôler les investissements étrangers en Europe dans les domaines stratégiques. Ce sont là autant d’avancées utiles ; mais il faut aller bien plus loin.
L’Europe manque toujours d’une vision de long terme pour son industrie, à l’image des grands plans adoptés par les puissances émergentes, comme Made in China 2025 ou Make in India. Les stratégies de ces pays sont assumées, globales, et bénéficient d’un soutien public ambitieux. À mon sens, l’Europe doit, elle aussi, être en mesure de proposer une stratégie ambitieuse, visible, centrée sur ses industries stratégiques.
C’est le message qu’ont signé les représentants de vingt-trois pays, dont onze ministres, à l’issue de la sixième conférence des Amis de l’industrie organisée avec Bruno Le Maire le 18 décembre 2018 à Bercy. Depuis, le Conseil européen des 21 et 22 mars a appelé la future Commission européenne à mettre en place une stratégie industrielle dès la fin de l’année 2019.
L’Allemagne et la France sont les moteurs de cette nouvelle politique. En Allemagne, Peter Altmaier a présenté une stratégie de politique industrielle qui marque une rupture forte par rapport à l’ordo-libéralisme traditionnel allemand.
En outre, le 19 février dernier, nos deux pays ont signé un manifeste franco-allemand pour une politique industrielle européenne adaptée au XXIe siècle. Ce texte traduit une ambition commune pour faire de l’Europe un continent doté d’une industrie forte, à la pointe de l’innovation, capable de favoriser l’émergence d’acteurs d’envergure internationale.
Avec les élections européennes et la constitution de la future Commission, la période qui s’ouvre est décisive.
Produire en Europe, avec de l’innovation européenne, des usines en Europe et des travailleurs européens, c’est possible ; c’est même encore plus possible avec la transformation technologique, qui nous permet de relocaliser de manière compétitive certaines productions en Europe. Mais, pour cela, il nous faut une impulsion politique nouvelle, autour de trois axes.
Le premier axe consiste à armer nos entreprises face à la concurrence mondiale.
Face à un protectionnisme américain assumé, face aux stratégies commerciales agressives de la Chine, l’Europe ne doit pas seulement être le bon élève du commerce international. Il nous faut renforcer drastiquement l’arsenal de l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, pour le contrôle des subventions industrielles et le respect des règles de protection de la propriété intellectuelle.
En outre, nous devons nous donner les moyens d’agir, en adoptant un instrument européen de réciprocité dans les marchés publics internationaux et en instaurant une préférence européenne dans nos industries stratégiques, comme l’espace ou le numérique – vous l’avez d’ailleurs dit vous-même.
Enfin, pour armer nos entreprises face à la concurrence mondiale, il est parfois nécessaire de constituer de grands groupes industriels. Pour que le refus de la fusion Alstom-Siemens ne se reproduise pas, les règles européennes de concurrence doivent évoluer. Sur certains marchés, peu nombreux et bien identifiés, il n’y a probablement pas de place pour plusieurs acteurs européens capables de concurrencer les acteurs américains, chinois ou indiens présents à l’échelle mondiale, qui sont souvent largement subventionnés ou qui bénéficient de marchés protégés.
Le deuxième axe consiste à soutenir massivement l’innovation et son déploiement industriel sur le sol européen.
Il faut tout d’abord coordonner nos efforts sur les chaînes de valeur stratégiques pour l’Union européenne – déterminées par la Commission européenne, ces dernières sont au nombre de six, parmi lesquelles la cybersécurité et la santé intelligente – en permettant le financement par les États membres des projets transnationaux de recherche et développement jusqu’au premier déploiement industriel.
Un premier projet de type PIIEC – projet important d’intérêt européen commun – a vu le jour à la fin de 2018 sur la nanoélectronique. La France va y investir 1 milliard d’euros.
Nous travaillons maintenant à un projet industriel avec l’Allemagne et d’autres partenaires pour produire en Europe des cellules de batteries électriques, composant indispensable à l’autonomie européenne sur les véhicules électriques. Demain, les batteries constitueront, de manière durable, 30 % à 40 % de la valeur de nos automobiles ; il est vital pour nos emplois et pour notre souveraineté technologique, et donc politique, qu’elles soient européennes et non asiatiques.
Enfin, l’Union européenne doit davantage financer l’innovation de rupture, pour que l’Europe soit la première sur les sauts technologiques. Il est également primordial de créer une véritable union des marchés de capitaux, pour rattraper notre retard sur le capital-risque.
Le troisième axe, enfin, s’attache à accélérer la transformation numérique et la transition écologique et énergétique de tous les secteurs industriels. Il n’y aura pas d’industrie forte en Europe sans une réponse complète et coordonnée à ces deux défis. Notre autonomie technologique et stratégique est en jeu.
L’Union européenne doit garder la maîtrise de ces technologies clés en favorisant l’émergence d’acteurs de référence au niveau mondial en matière d’intelligence artificielle, de calcul quantique, d’internet des objets ou de blockchain. Nous n’avons pas à rougir des grands groupes européens en la matière, mais il nous faut combler notre retard technologique en soutenant le développement industriel de notre propre offre numérique souveraine.
La lutte contre le changement climatique représente un coût pour nos sociétés et pour notre industrie, mais c’est aussi une chance, si on s’en donne les moyens, de positionner cette dernière à l’avant-garde mondiale et de gagner de nouveaux marchés. L’Europe doit focaliser ses financements sur le développement des technologies bas carbone et orienter les financements privés pour que l’industrie réalise les investissements nécessaires à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Les entreprises n’investiront toutefois pas si elles font face, sur leurs marchés, à des concurrents issus de pays à la législation environnementale plus laxiste, vous l’avez mentionné. Il nous faut donc préserver la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale en adoptant des mesures de lutte contre les risques de fuite de carbone et en mettant en place un mécanisme d’inclusion carbone aux frontières de l’Union pour des secteurs pilotes.
Hier encore, j’étais à la foire de Hanovre, qui est, comme vous le savez, le premier salon industriel au monde. J’y ai rencontré mes homologues portugais, suédois, allemand et néerlandais ainsi que de grands industriels européens. Je peux vous le dire : tous partagent ce besoin d’une nouvelle politique industrielle européenne. Pour la première fois, chacun a fait son deuil de l’idée que seul le libre-échange pouvait régler les problèmes de notre industrie.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, suivie d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
Dans le cas où l’auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n’ait pas été dépassé.
Dans le débat interactif, la parole est à Mme Michelle Gréaume.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, je vous livre deux citations : « Nous voulons enfin prendre l’opportunité de développer la productivité, l’expansion de notre économie. » « Il faut une nouvelle approche de la politique industrielle en Europe. »
Ces deux déclarations volontaristes pourraient être d’actualité, elles datent pourtant de la présidence de Walter Hallstein en 1960, pour l’une, d’une communication de la Commission européenne de 1990, pour l’autre.
En somme, cela fait soixante ans que c’est enfin le moment de l’industrie en Europe, mais cela fait soixante ans que l’Union européenne suit une stratégie de mise en concurrence et de compétitivité des prix, une stratégie de refus de tout soutien public, d’affaiblissement des protections sociales, tournée vers la profitabilité des grands groupes au détriment du maillage territorial, une stratégie qui a échoué.
Les chiffres ne mentent pas : en plus de vingt ans, l’emploi industriel a reculé de près de 26 %, alors cessons les grandes déclarations !
Au-delà des chiffres, ce sont les emplois induits, les réseaux de PME, l’aménagement du territoire, les conditions de vie qui se dégradent. Ce sont des métiers, des fiertés ouvrières, qui disparaissent.
Face aux défis de la révolution numérique, à la montée en puissance de la Chine, les propositions de la Commission et du Gouvernement ne remettent pas en cause une stratégie qui a pourtant échoué.
Madame la secrétaire d’État, je ne suis pas garagiste, mais je sais que, lorsqu’un moteur est défectueux, refaire la carrosserie ne sert à rien !
M. Bruno Sido rit.

Madame la secrétaire d’État, êtes-vous prête à soutenir l’idée d’un fonds d’investissement important à l’échelle européenne ? Êtes-vous prête à défendre nos marchés en imposant des visas écologiques et sociaux aux importations aux frontières de l’Union européenne ? Accepteriez-vous, enfin, de revoir les règles des marchés publics afin de favoriser les PME, qui sont le cœur du tissu industriel européen ?
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Madame la sénatrice Gréaume, vous indiquez que l’Europe avait pris en 1960 des positions très fortes sur l’industrie. Je crois me souvenir que, dans les années 1960 et 1970, elle avait effectivement une industrie particulièrement puissante au plan mondial. On ne peut donc pas dire que le marché européen a été un échec, bien au contraire.
Nous, nous parlons des vingt dernières années. Je vous rejoins sur le diagnostic, il correspond d’ailleurs, au terme près, à celui que je viens de faire à la tribune.
S’agissant des propositions que vous avancez, j’ai évoqué les règles des marchés publics. Il faut effectivement les adapter et, en particulier, faire en sorte que nos marchés publics ne soient pas ouverts à des produits et à des entreprises qui ne respectent pas notre haut niveau social et environnemental. Il est possible d’établir cette clause de préférence européenne, laquelle est d’ailleurs discutée en ce moment au niveau de la Commission européenne et soutenue par la France. Je mentionne en outre qu’il nous est possible, par dérogation, grâce à une autorisation spécifique, de la mettre en œuvre et que nous étudions cette piste de très près, de façon à préempter le sujet au niveau national.
Vous m’interrogez sur un fonds d’investissement important. Aujourd’hui, le fonds que constitue Bpifrance investit dans l’industrie. Comme vous le savez, Bpifrance s’est rapproché des autres acteurs d’investissement européens pour porter des projets industriels communs, j’en veux pour preuve le travail réalisé avec le Mittelstand allemand, qui a été un des sujets que nous avons abordés à Hanovre.
Je vais également citer le cas de la Banque européenne d’investissement, la BEI, qui coinvestit avec Bpifrance dans des projets industriels nouveaux, selon le principe du fonds SPI – pour sociétés de projets industriels.
Il me semble que ces éléments sont de nature à vous apporter des réponses.

Madame la secrétaire d’État, l’Europe se désindustrialise, la France a perdu la moitié de ses emplois industriels, la liste des entreprises qui licencient ou qui ferment ne cesse de s’allonger, certaines passent sous contrôle étranger, Saint-Gobain Pont-à-Mousson en est le dernier exemple.
Face à la Chine et à l’Amérique, madame la secrétaire d’État, face à leur agressivité commerciale, il est urgent de refonder une politique industrielle européenne et de mettre en place une politique industrielle française, qui nous fait cruellement défaut. Il faut en finir avec la naïveté face aux grandes puissances, nous ne sommes pas seulement un continent de consommateurs, mais aussi un continent de producteurs.
L’Europe ne doit être ni fermée ni offerte, les règles du jeu doivent être équitables, elles ne le sont pas : il n’y a pas réciprocité dans les échanges. Lorsqu’ils sont confrontés à un problème de concurrence déloyale, les États-Unis frappent fort et immédiatement ; l’Europe frappe faiblement et lentement.
L’industrie sans usine n’existe pas ; l’Europe sans industrie sera un continent faible, uniquement un marché.
Refonder une politique européenne, c’est revoir les règles de la concurrence, mettre en place des champions européens, non pas comme cela a été fait avec Alstom-Siemens, mais comme cela a été fait avec Airbus : en contrôlant les investissements et en mettant en œuvre une véritable politique commerciale et des investissements européens.
Quelle est votre politique dans ce domaine et quelles sont vos orientations ?
Monsieur le sénateur Bourquin, je vais vous rassurer. Certes, l’Europe a perdu des emplois, si l’on prend beaucoup de recul, mais elle s’est réindustrialisée ces dernières années, puisque la production industrielle a gagné deux points de PIB, passant de 17, 6 % à 19, 6 % entre 2016 et 2019.
Ce chiffre inclut les emplois induits dans les services et ne saurait donc être comparé aux 12 % d’emplois industriels français. En effet, la France ayant fait passer beaucoup d’emplois liés à l’industrie dans les services, pour obtenir une vision complète de l’emploi industriel ou induit, il faudrait donc ajouter 500 000 emplois.
Vous évoquez les problèmes de réciprocité, je suis parfaitement d’accord avec vous. C’est pour cela que nous avons réagi sur l’acier et que nous mettons en place des accords de libre-échange contenant les notions de réciprocité et d’ouverture sur les marchés publics. J’en veux pour preuve l’accord avec le Japon, qui vient d’entrer en vigueur.
C’est pour cela, aussi, que nous entendons réviser les règles de la concurrence, vous connaissez notre point de vue sur le sujet. Il s’agit, d’abord, de définir le marché pertinent pour apprécier la concurrence qui s’exerce lors d’une consolidation : ce n’est plus le marché européen, mais le marché mondial…
C’est une réalité que nous vivons tous.
Il faut également apprécier le marché avec une vision dynamique. Si l’on prend les parts de marché du passé, alors que les marchés peuvent se recomposer en cinq ans, et si l’on ne tient pas compte des appels d’offres à venir et de la réalité de la concurrence que ceux-ci suscitent, alors on est à côté de la plaque. C’est très exactement notre propos aujourd’hui devant la Commission européenne.
Je signale également qu’il faut avoir une appréciation particulière des plateformes, dans la mesure où celles-ci révolutionnent également l’approche de la concurrence.
Enfin, contrôler les investissements, cela correspond précisément aux décisions qui viennent d’être prises et que je mentionnais à la tribune, relatives au mécanisme de screening des investissements étrangers en Europe.

Madame la secrétaire d’État, quelques mots simplement pour vous rappeler que l’entreprise indienne Mahindra a racheté Peugeot Scooters. Elle avait promis un plan industriel, il n’y en a toujours pas, mais il y a eu 110 licenciements !
Nous avons besoin d’un État stratège, qui nous fait cruellement défaut.
Concernant Alstom, mettrez-vous en place une stratégie française à la suite de l’échec de l’absorption par Siemens ? Ces questions concernent des milliers d’emplois et beaucoup de sites industriels. Nous avons besoin d’une politique industrielle beaucoup plus incisive de la part du Gouvernement.

Notre tissu industriel souffre, c’est un fait.
Si je me félicite, en tant que parlementaire des Hauts-de-France, qu’une solution semble avoir été trouvée pour l’usine Ascoval, je ne peux que déplorer le sort réservé aux salariés d’Arjowiggins et je reste inquiet pour Arc International.
Plus que jamais, nous devons soutenir nos entreprises en difficultés et, surtout, trouver de nouveaux axes de développement industriel. Les énergies nouvelles en font incontestablement partie.
Pour résister à la mondialisation et à la concurrence des grandes puissantes émergentes, nous devons unir nos forces avec nos voisins européens, comme l’indique la récente déclaration commune de la France et de l’Allemagne publiée le 19 février 2019 et appelant à une véritable politique industrielle européenne. Nos deux pays ont d’ailleurs validé, à la fin de 2018, une feuille de route pour la création d’une filière européenne de la batterie de stockage d’énergie, ainsi que vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, après Bruno Le Maire.
Cette filière ambitionne d’accompagner la transformation de nos parcs automobiles avec un recours croissant aux véhicules électriques et hybrides. Ces batteries contribueront, par ailleurs, à l’alimentation en énergie de nos habitations.
Pour y parvenir, il est vital que les constructeurs automobiles européens jouent le jeu et que l’Europe réponde présent en renforçant ses investissements dans le secteur privé, ce que rendra possible la reconnaissance de cette filière comme projet commun prioritaire d’investissements.
Nos gouvernements espèrent obtenir ce label dès le premier semestre 2019, mais peut-être est-il déjà trop tard. Je fais référence à la construction en cours, en Allemagne, de la plus grande usine de batteries pour véhicules électriques. Un projet porté par la Chine !
Alors que l’Europe commence à réfléchir aux initiatives à reconnaître d’intérêt commun, la Chine monte les murs d’une unité de production de 55 hectares, investit 240 millions d’euros et crée 600 emplois avec l’objectif d’équiper 300 000 véhicules de marques allemandes et européennes.
En résumé, nous sommes à nouveau très en retard, voire à la traîne. Alors que se profilent les élections européennes, n’est-il pas temps d’inventer une Europe réactive et efficace, capable de prendre des décisions aussi importantes que le soutien à une filière d’avenir ?
Aujourd’hui, les processus décisionnels et l’absence d’harmonisation de nos cadres nationaux condamnent toute initiative de ce type et le résultat est devant nous : nos concurrents avancent bien plus vite et continuent de grignoter des parts de marchés là où nous devrions être en pointe.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Monsieur le sénateur Corbisez ce n’est pas parce que l’on répète en boucle que l’on perd de l’emploi industriel que l’on perd effectivement de l’emploi industriel en France !
Je le dis encore une fois : en 2017, en 2018 et au début de 2019, nous créons de l’emploi industriel. Certes, cela fait suite à beaucoup de pertes, mais il me paraît utile de rappeler sur quelle base nous nous fondons et de constater que la politique économique du Gouvernement semble fonctionner.
Par ailleurs, j’aimerais que l’on célèbre également les succès : Toyota investit 300 millions d’euros dans l’industrie automobile, AstraZeneca investit plus de 100 millions d’euros dans l’industrie pharmaceutique dans les Hauts-de-France, pour ne prendre que ces deux exemples.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s ’ exclame.
S’agissant d’Arc International, je veux vous rassurer, puisque, grâce au refinancement de 120 millions d’euros qui a été négocié – et grâce à l’État –, il va être possible d’améliorer la compétitivité de l’usine. Nous sommes donc plutôt confiants sur la situation de cette entreprise.
Enfin, s’agissant du projet relatif aux batteries électriques, vous mentionnez effectivement la construction d’une usine par CATL, en lien avec un contrat de BMW. Il ne s’agit pas du tout du projet que nous portons au niveau de la Commission européenne : il est question ici de batteries de la génération actuelle, pas des batteries de demain, de troisième génération « plus », voire de quatrième génération, qui sont en projet.
Aujourd’hui, aucune usine dans le monde ne maîtrise la technologie solid state sur laquelle nous voulons travailler. Il ne me semble donc pas que nous soyons en retard pour le moment. Vous avez raison, cependant, obtenir ce projet européen avec l’Allemagne, la Pologne et d’autres pays, c’est un véritable enjeu.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’Europe se prive du bénéfice d’un marché plus large que ceux des États-Unis et de la Chine à cause de l’hétérogénéité de ses réglementations et de ses politiques, notamment en matière industrielle.
Ainsi, dès avant le Brexit, et plus encore maintenant, le Royaume-Uni, traditionnellement peu interventionniste, affirmait néanmoins vouloir soutenir son industrie. L’Allemagne a été ébranlée par le rachat d’entreprises par de grands groupes chinois, sans que sa législation lui permette de s’y opposer.
Une politique commune ou une convergence des règles est nécessaire, à l’instar de ce qui a été fait, avec succès, pour la plupart des réglementations sur les produits.
Il est cependant un domaine dans lequel l’Europe a mis en place une politique commune : la concurrence. Je ne reviendrai pas sur la triste affaire Alstom-Siemens, déjà largement évoquée, mais, alors que les consommateurs européens peuvent acheter des produits fabriqués dans le monde entier, cette politique empêche l’émergence d’acteurs européens puissants, sans grand bénéfice pour le consommateur et avec des dommages importants pour le tissu industriel du continent.
Comme votre prédécesseur l’avait justement dit ici même, nous ne pouvons pas faire reproche à Mme Vestager d’appliquer les textes, mais cela signifie donc que ce sont les textes eux-mêmes qu’il convient d’adapter.
Madame la secrétaire d’État, que compte faire la France dans le cadre de la nouvelle Commission pour que les politiques industrielles des États membres soient mieux harmonisées entre elles et que l’on ne leur oppose plus une incompatibilité avec la politique de concurrence ?
Monsieur le sénateur, vous avez raison de mentionner l’hétérogénéité réglementaire. Notre marché unique n’est, de ce fait, pas complètement intégré et, alors que les Chinois et les Américains profitent d’un marché domestique très fort qui sert de base arrière à leur développement, l’Europe a encore un marché atomisé et éclaté et ne bénéficie pas aussi facilement d’un tel avantage.
Vous avez également mentionné les achats qui ont probablement fait bouger les positions allemandes sur l’ordo-libéralisme, notamment Kuka, une société de robotique extrêmement technologique qui a été rachetée par une entreprise chinoise. Des événements de ce genre se sont aussi produits en Finlande ou en Suède et font probablement bouger les lignes dans les pays européens.
C’est pour cela que je mentionnais mon déplacement à Hanovre, où j’ai été surprise de l’évolution du discours des autres pays européens. Nous sommes vus comme un pays plutôt interventionniste dans l’économie, alors que les autres pays se vivent plutôt comme libéraux, même si ce n’est pas aussi simple en pratique. En tout état de cause, il y a une vraie demande des autres pays européens pour mettre en place une forme de protection de notre industrie – et non de protectionnisme, c’est le vocabulaire qui est employé – en particulier à l’égard des pays qui ne jouent pas le jeu.
De ce point de vue, le fait que le Président de la République ait demandé à Mme Merkel d’être présente pour parler de politique commerciale avec la Chine a été extrêmement apprécié par l’ensemble des dirigeants.
S’agissant de la concurrence, effectivement, il faut adapter les textes, mais il n’est pas interdit de commencer par les interpréter correctement ! La notion de marché pertinent, par exemple, est fondée sur une jurisprudence et sur des habitudes et non sur les seuls textes réglementaires, il est donc possible également de bouger sur la base des textes existants.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous débattons ce soir de la politique industrielle européenne. Je salue l’initiative du groupe Les Républicains qui a placé ce sujet essentiel au cœur de nos réflexions, quelques semaines avant les échéances que nous savons.
Ce débat intervient aussi, et surtout, quelques semaines après un événement majeur pour l’industrie de notre continent : la Commission européenne a bloqué, début février, le projet de fusion entre Alstom et Siemens, tuant dans l’œuf l’émergence d’un nouveau champion européen.
Selon Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, cette décision se justifie, car « cette concentration aurait entraîné une hausse des prix pour les systèmes de signalisation qui assurent la sécurité des passagers et pour les futures générations de trains à très grande vitesse. »
Ces arguments ne sont pas à la hauteur des enjeux, ils révèlent l’absence criante, à Bruxelles, de vision politique claire en matière de stratégie industrielle. Il ne s’agit pas de remettre en question le principe de libre concurrence au sein du marché unique, mais simplement d’accepter la réalité d’un monde nouveau dans lequel les positions dominantes des entreprises européennes ne s’apprécient plus au niveau du marché unique, mais de la concurrence internationale.
Pour que l’industrie continue d’exister sur notre continent, nous aurons besoin de champions européens qui puissent tenir tête à leurs concurrents américains et chinois.
Dans quel périmètre le droit européen de la concurrence devra-t-il s’appliquer demain ? Quelles règles permettront de donner corps au principe de réciprocité ? Quelles actions le Gouvernement entend-il mener pour concilier, au niveau européen, respect de la concurrence et défense de nos intérêts continentaux ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Monsieur le sénateur, je vais pratiquer l’art de la répétition. Vous soulignez très justement que le rejet de la fusion Alstom-Siemens nous a privés d’un acteur qui était capable, en chiffre d’affaires, de faire jeu égal avec ses grands compétiteurs internationaux. Il nous aurait probablement permis, également, de concentrer l’innovation et de nourrir de nouvelles avancées technologiques susceptibles de donner ce quart d’heure d’avance stratégique qui fait la compétitivité d’une entreprise.
S’agissant de la concentration, la question de l’absence de vision de Bruxelles est importante, puisque c’est un des points qui a été évoqué durant le conseil de la concurrence du 30 novembre, auquel j’ai participé. Il a été également abordé dans la déclaration des Amis de l’industrie ainsi que dans celle de Peter Altmaier et de Bruno Lemaire.
L’idée avancée est qu’il faut avoir une vision industrielle transverse qui nourrisse l’ensemble des politiques de l’Union européenne. Pour utiliser le terme employé dans l’Union européenne, il s’agit de mainstreaming. Cela signifie que, dans la politique commerciale, dans la politique de la concurrence, dans la politique de l’innovation, dans la politique numérique, il faut que, à chaque avancée, une petite lumière s’allume afin que l’on se demande ce que cela signifie pour notre industrie, de manière à adapter l’action et à la coordonner en conséquence.
Cette idée fait partie des propositions que nous avons fait remonter au Conseil européen des 21 et 22 mars. Elle peut s’illustrer de différente façon : les Allemands poussent la Commission européenne à nommer un vice-président spécifiquement chargé de la politique industrielle ; nous n’avons pas la même vision institutionnelle, mais nous sommes persuadés qu’il faut préciser les chaînes de valeurs stratégiques pour lesquelles on met en place des aides spécifiques et revoir, effectivement, les règles de politique en matière de commerce et de concurrence.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Il me semble que nous devrions nous en tenir à un principe clair de réciprocité avec nos partenaires commerciaux. Il y va de notre capacité à rester maîtres de notre destin industriel, en faisant le choix d’une économie qui reflète les valeurs fondatrices de l’Union européenne face aux géants étrangers d’aujourd’hui et de demain.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de focaliser mon intervention sur la 5G. Son déploiement est un enjeu crucial pour nos opérateurs économiques comme pour nos concitoyens.
Il ne s’agit pas, en effet, d’une simple amélioration technologique, mais d’une véritable révolution au cœur du monde ultra-connecté de demain. En offrant un débit vingt fois plus rapide que la 4G, un temps de latence dix fois inférieur et la possibilité de connecter en même temps cinq fois plus d’objets, la 5G va, par exemple, permettre une robotisation accrue dans l’industrie, le déploiement massif de flottes de voitures autonomes, ou encore le développement de « villes intelligentes » qui optimiseront leurs réseaux d’énergie ou de transport. On le voit, cette technologie est au cœur de l’industrie et de l’économie du XXIe siècle.
Le réseau 5G est déjà actif en Corée du Sud, il est en cours de déploiement aux États-Unis et devrait l’être en Europe en 2020. Pourtant, les Européens sont en train de prendre du retard en la matière, principalement en raison des enjeux de sécurité attachés à cette technologie, alors que deux de ses principaux acteurs sont chinois.
En raison des transferts massifs de données inhérents à la 5G, la question de sa sécurité est en effet posée. Dans plusieurs pays européens, dont la France, des tests sont en cours. Cette question est cruciale, qu’il s’agisse de la sécurité des données à caractère personnel, de la protection des secrets de fabrication ou des secrets d’affaires, ou encore de la sécurité en matière de défense.
L’Union européenne s’est dotée d’un règlement général de protection des données à caractère personnel, ou RGPD, qui encadre les conditions de recueil, d’utilisation et de transmission de ces données. Pouvez-vous nous dire quelles démarches ont été engagées ou sont envisagées pour sécuriser le stockage des données ?
Quant à la sécurité des données commerciales, industrielles ou miliaires, quelles sont les garanties exigées des fournisseurs d’infrastructures, du point de vue technique comme juridique ?
Comment la France et, au-delà, l’Union européenne entendent-elles préparer cette étape aussi cruciale qu’urgente ?
Pouvez-vous, enfin, nous confirmer qu’un déploiement en 2020 est toujours d’actualité ?
Monsieur le sénateur Bizet, vous évoquez le sujet de la 5G. Je partage vos propos quant à son importance cruciale dans l’industrie. Il s’agit d’ailleurs d’une technologie qui s’adresse plus à des usages industriels nécessitant une très forte densité de connexions qu’à des clients finaux classiques comme vous et moi.
S’agissant de la sécurité des réseaux 5G eux-mêmes, comme vous le savez, nous sommes en train d’en débattre en ce moment même à l’Assemblée nationale et vous aurez donc l’opportunité de discuter ce texte, qui vise à prévoir un dispositif permettant au Premier ministre d’autoriser spécifiquement chaque équipement, cœur de réseau, base ou antenne, de façon à garantir que ceux-ci ne soient pas exposés au sabotage ou que les données qu’ils traitent ne soient pas trop facilement accessibles. Je précise que cette loi s’appliquera à tous les équipementiers.
En effet, l’un des enjeux consiste à s’assurer que les sous-traitants, ceux qui ajoutent de petites lignes de code, par exemple, ne constituent pas une fragilité pour les systèmes.
Par rapport aux autres pays de l’Union européenne, nous sommes plutôt en avance, mais, comme vous le savez, une démarche de convergence en matière de sécurité a été engagée à l’échelon européen : chaque État doit recenser les risques qu’il prend et les partager avec l’Union européenne. Des recommandations résulteront de ce processus, qui aboutira à un alignement sur les États dont les propositions apparaîtront les plus efficaces.
Vous avez évoqué le stockage de données : en la matière, l’enjeu porte notamment sur l’activité de nos serveurs. Il s’agit de favoriser la croissance d’acteurs comme la société OVH, par exemple, mais aussi de développer le stockage des données en Europe, même si leur protection peut ne pas être forcément assurée par des acteurs européens. Il faut a minima les protéger de l’extraterritorialité de certaines législations.
Enfin, il apparaît que le règlement général sur la protection des données, le RGPD, représente aujourd’hui davantage une chance qu’un inconvénient. Là encore, son déploiement est en cours en Europe.

Il y a un mois environ, la France a signé avec l’Allemagne un manifeste pour une politique industrielle européenne. Nous nous en réjouissons tous.
Simplement, j’ai cru comprendre que parmi les autres pays membres de l’Union européenne, certains avaient accueilli avec une certaine fraîcheur cet accord. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, madame la secrétaire d’État ? Quels sont ces pays et, surtout, quels sont les points de friction ?
Dans ce manifeste, Paris et Berlin proposent que le Conseil européen bénéficie d’un droit de recours en vue de revenir sur les décisions de la Commission en matière de concurrence. Quelle forme cette procédure d’appel politique pourrait-elle prendre ?
Il est désormais temps de faire des propositions pour réformer la politique de concurrence et les règlements en la matière. J’ai compris que Mme Vestager était plutôt ouverte sur le sujet. Je proposerai pour ma part que la Commission prenne en compte dans son appréciation l’ensemble du marché européen et réalise ses études et projections à moyen et long terme.
Nous devrions également revenir sur l’interdiction des aides publiques aux entreprises, règle qui n’existe nulle part ailleurs. Comme vous le savez, nos amis américains, parmi d’autres, ne se privent pas d’aider leurs entreprises.
Je propose par ailleurs de limiter l’intervention de la Commission aux cas les plus importants et les plus affectés par les échanges entre les pays membres.
Enfin, on l’a rappelé à plusieurs reprises, je souhaiterais restaurer ou imposer le principe de réciprocité. Il est anormal que nous ne puissions pas accéder aux marchés publics de la plupart des pays situés en dehors de l’Union européenne.
Monsieur le sénateur Yung, pour répondre à votre interrogation à propos des pays qui accueilleraient fraîchement les propositions de la France et de l’Allemagne, je crois utile tout d’abord de rappeler tout le travail que mène actuellement Peter Altmaier pour embarquer l’Allemagne elle-même dans cette démarche. Il s’agit en effet d’une vraie révolution copernicienne que de s’engager dans un tel projet.
Je discutais récemment avec l’un des dirigeants du BDI, l’équivalent allemand du Medef pour l’industrie : celui-ci accueille plutôt favorablement ces propositions. Le seul point de tension, le seul sujet d’inquiétude, mais qui me paraît en fait davantage relever d’une question de vocabulaire, concerne la notion de « champion européen ».
Il est vrai que les Français y tiennent, au regard notamment de la structuration de leur industrie et compte tenu de l’existence de très grands groupes qui sont les leaders mondiaux de leur secteur. L’Allemagne et le Portugal font valoir que leur industrie repose sur des groupes de taille plus modeste, le Mittelstand allemand et les PME portugaises en particulier. Ces États sont sensibles aux enjeux en termes de consolidation. Je crois que l’on peut les rassurer sur nos intentions dans le cadre des travaux que nous menons ensemble. Il ne s’agit pas d’imposer les grands groupes français partout en Europe.
L’autre point de tension concerne évidemment le budget.
Le deuxième sujet qui fait à peu près consensus a trait à l’innovation, en particulier en matière d’intelligence artificielle et de numérique : l’ensemble des pays s’accordent sur l’idée selon laquelle il faut élever le niveau de jeu et investir ensemble.
Vous m’interrogez sur l’interdiction des aides publiques aux entreprises. Je précise que ce type d’aides n’est pas interdit, mais encadré. Ces aides le sont d’ailleurs dans tous les pays membres de l’OMC. Au sein de l’Union européenne, elles doivent respecter les règles européennes.
Les aides aux PME sont autorisées : c’est ce qui nous a permis de créer un dispositif de suramortissement, par exemple. De même, les PIIEC représentent des aides massives à destination de secteurs entiers : ainsi, la France investit 1 milliard d’euros dans les nanotechnologies et 700 millions d’euros dans le secteur automobile, au travers des batteries électriques. Ces aides existent d’ores et déjà.

Madame la secrétaire d’État, je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction : l’industrie, de par les apprentissages et les progrès qu’elle favorise chez les acteurs, les entreprises et les personnels du secteur, est un vecteur essentiel de cohésion de nos sociétés.
Après avoir dit cela, je vous poserai trois questions.
Tout d’abord, l’évolution de l’économie mondiale et de ses zones de croissance nous force à constater que les bases de la politique de concurrence en Europe sont caduques aujourd’hui. Seront-elles revues avec le concours, le cas échéant, des règles et des sanctions extraterritoriales, qui me semblent être la seule solution aujourd’hui ?
Ma deuxième question porte sur l’avenir de l’industrie, qui ne correspond pas exclusivement à celui de la gestion des données, madame la secrétaire d’État. Je pense en particulier à la supraconductivité et aux ruptures qu’elle présage. Pourtant, je ne peux que constater que les acteurs de l’énergie en France sont totalement absents des recherches dans ce domaine. Pourquoi donc ?
Enfin, nous avons appris ces jours derniers que Saint-Gobain envisageait de céder 60 % de sa filiale Pont-à-Mousson à XinXing, une entreprise chinoise. Saint-Gobain Pont-à-Mousson, leader européen des canalisations en fonte ductile, est une entreprise stratégique pour la France. Je pense notamment à son apport en ce qui concerne la qualité des infrastructures d’assainissement et d’accès à l’eau dans nos villes, la sécurité alimentaire et son leadership en Europe sur les normes. Le Gouvernement considère-t-il que cette éventuelle opération devrait être soumise à une autorisation préalable au titre des investissements étrangers en France ?
Je vais tenter d’y répondre.
D’abord, on va effectivement proposer de revoir les bases de la politique de concurrence. La question des sanctions extraterritoriales relève en revanche d’un autre sujet, me semble-t-il. En tout cas, comme vous le savez, il est possible de porter des litiges au niveau de l’OMC. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous voulons relancer cette organisation et faire en sorte que sa structure d’arbitrage se dote d’un juge, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et ce qui constitue un point de blocage important.
Pour vous répondre au sujet de Saint-Gobain Pont-à-Mousson, notre objectif est évidemment de garantir la pérennité industrielle du site. À ce stade, Saint-Gobain a effectivement annoncé un projet d’ouverture de son capital ou de cession de la majorité de ses actifs qui, pour le moment, n’est ni précis ni totalement ficelé.
Ce projet pourrait effectivement donner lieu à une autorisation préalable de l’État. En tout état de cause, nous suivons de très près ce dossier : le ministre de l’économie et des finances recevra dans deux semaines les représentants de Saint-Gobain pour évoquer la pérennité de ce site, les assurer de notre attachement à ce qu’il soit maintenu en France, à ce que l’actionnariat de l’entreprise et le projet de cession d’actifs soient stables, crédibles et de long terme.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie pour votre réponse, même si elle n’est pas totalement satisfaisante.
Saint-Gobain est non seulement une entreprise industrielle qui crée des emplois, mais aussi une entreprise stratégique pour la France et pour l’Europe. Il ne s’agit donc pas simplement de dire qu’il faut obtenir des garanties sur l’avenir du site : il faut obtenir des garanties sur le maintien du contrôle de l’entreprise par un actionnaire européen. C’est absolument indispensable pour ce type d’entreprise. Il ne suffit pas de céder aux sirènes d’une bourse qui, malheureusement, fait gonfler le cours de Saint-Gobain, parce que la rumeur enfle. Ce n’est pas sur cette base que l’on construit une politique industrielle !

Madame la secrétaire d’État, parmi les trois dimensions de la politique industrielle européenne, le contrôle des concentrations, l’interdiction des aides publiques, et la répression des ententes et abus de domination, ce sont les deux premières qui recueillent sans aucun doute les critiques les plus virulentes.
Si l’existence d’une politique européenne de concurrence a puissamment contribué à l’intégration économique européenne, celle-ci se voit désormais adresser bon nombre de reproches, qui devraient conduire l’Union européenne à s’interroger sur les évolutions à y apporter.
Une fois de plus, l’histoire se répète avec Alstom. Après l’échec du rapprochement entre Aérospatiale, Alenia et De Havilland, le refus de l’accord entre Pechiney, Alcan et Algroup ou encore celui de la fusion Schneider-Legrand, sommes-nous condamnés à ne pas voir émerger de géants industriels européens dans les années à venir ?
Au-delà des projets remis en cause, si des industries européennes passent facilement sous contrôle chinois, comme Pirelli ou PSA, ou sous contrôle américain, comme Alstom Énergie, c’est, d’une part, parce que les acteurs européens potentiellement intéressés – je veux parler de Michelin, de Renault ou de Siemens – redoutent d’engager plusieurs mois de négociation avec la Commission européenne et, d’autre part, en raison de politiques industrielles nationales cloisonnées.
Il est pourtant essentiel de défendre l’application du principe de réciprocité dans la compétition mondiale. Alors que nos concurrents chinois ou américains réservent la plupart de leurs marchés publics à leurs entreprises, nous n’arrivons pas à dépasser nos intérêts nationaux ni à définir une véritable politique industrielle européenne.
Plusieurs pistes de réforme méritent d’être étudiées comme, par exemple, le fait d’instituer une instance d’appel politique aux décisions de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, la DG COMP, ou encore de créer une présomption de légalité pour les mesures de soutien aux entreprises qui sont mises en œuvre de façon coordonnée entre un nombre minimum d’États membres.
Pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, nous présenter les mesures que vous comptez défendre dans ce domaine ? Après la politique agricole commune, comment mettre en place une politique industrielle européenne, que Nathalie Loiseau appelait d’ailleurs de ses vœux la semaine dernière ?
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.
Monsieur le sénateur Longeot, je rappellerai d’abord que PSA n’est pas encore sous le contrôle des Chinois, puisque ces derniers ne détiennent que 10 % du capital du groupe, tout comme l’État français.
Concernant les règles de concurrence et notamment l’instance d’appel politique, l’une de nos propositions est de suggérer que le Conseil européen puisse revenir sur une décision de la DG COMP. C’est d’ailleurs le système qui est en vigueur, non seulement en France, mais aussi en Allemagne, où les ministres peuvent faire appel d’une décision de l’autorité de la concurrence, ou au Royaume-Uni. C’est dire si cette pratique n’est finalement pas si rare dans des pays de culture économique un peu différente.
S’agissant de l’interdiction des aides publiques, je veux rappeler qu’il existe des exceptions. Vous savez que les PME, en particulier, bénéficient d’un régime spécifique, ce qui leur permet de disposer de mesures spécifiques en matière fiscale. Je parlais tout à l’heure du dispositif de suramortissement.
C’est également le cas des PIIEC, ces projets particulièrement importants et stratégiques, qui sont choisis collectivement, qui peuvent profiter à plusieurs pays de l’Union européenne puis à l’ensemble des entreprises. Ils permettent aux États membres d’investir, comme c’est le cas dans les nanotechnologies – 1 milliard d’euros – ou dans les batteries électriques – 700 millions d’euros –, si nous obtenons gain de cause.
Nous voulons que ces projets soient plus simples à mener et plus rapides à boucler. C’est l’un de vos souhaits : offrir davantage de rapidité et d’agilité. Nous souhaitons qu’ils soient menés sur les six chaînes de valeur stratégiques arrêtées par la Commission européenne : les batteries électriques et la nanoélectronique, j’en ai parlé, mais aussi l’intelligence artificielle, le stockage du carbone, l’hydrogène, pour ne citer que ces sujets.

En tant que sénateur du Doubs, je sais que Peugeot n’est pas complètement sous la coupe des Chinois, mais leur participation est tout de même de 10 %. Vous savez, ils progressent tout doucement, mais sûrement !
Au travers de ma question, je voulais vous demander si l’Europe allait alléger sa réglementation pour que l’on puisse enfin faire comme les Américains et les Chinois, et accompagner un certain nombre d’entreprises dans leur développement. Ce point est essentiel si l’on veut développer une vraie politique industrielle européenne.

Madame la secrétaire d’État, l’Europe ne pourra pas bâtir de politique industrielle si elle n’est pas en mesure de protéger ses intérêts stratégiques, ses marchés et ses entreprises. Si le débat sur les outils de défense commerciale reste animé, voire houleux, il n’est heureusement plus tabou.
Il reste cependant un point sur lequel aucune riposte efficace n’a encore pu être élaborée, c’est l’extraterritorialité du droit américain, pratique qui s’apparente davantage à un racket organisé qu’a une simple distorsion de concurrence, puisqu’elle instrumentalise le droit pour déstabiliser, fragiliser ou placer sous surveillance les concurrents des entreprises américaines.

En décembre dernier, on apprenait qu’Airbus risquait d’en être la prochaine victime. En plus d’une colossale amende, le groupe pourrait ainsi se voir couper l’accès aux marchés internationaux libellés en dollars. Il s’agirait d’une catastrophe qui laisserait le champ totalement libre à Boeing. Ces dix dernières années, près de 40 milliards d’euros sont passés des caisses des entreprises européennes à celles du fisc américain. Et sur les dix-sept pénalités les plus lourdes qui ont été infligées, douze l’ont été à des entreprises européennes, la plupart industrielles.
Même si cela risque de changer avec Huawei, aucune entreprise chinoise n’a encore été visée, car l’administration américaine sait que Pékin n’hésitera pas à répliquer en s’en prenant aux sociétés américaines. Cette dissuasion, l’Europe n’est jamais parvenue à l’instaurer. L’activation du règlement dit « de blocage » de 1996 et le lancement du dispositif Instex – Instrument in support of trade exchanges – en début d’année ont le mérite d’exister. Toutefois, ils restent largement inopérants, car ils ne sont pas sous-tendus par une volonté politique de ne rien céder face à la prédation américaine.
Madame la secrétaire d’État, ma question est simple : quelle stratégie crédible et efficace la France pourrait-elle proposer pour que l’Europe ne soit plus soumise aux injonctions américaines et qu’elle protège mieux son industrie des appétits de Washington ?
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Madame la sénatrice Gruny, vous m’interrogez sur l’extraterritorialité.
D’abord, je précise que le cas d’Airbus est un peu plus complexe que ce que vous mentionnez, puisqu’il existe des soupçons sur les modalités de passation de certains marchés qui ne sont pas étayés que par les États-Unis : de mémoire, une instruction est également ouverte au Royaume-Uni et en France. Je me permets simplement de délimiter précisément le sujet.
En revanche, vous avez raison, ces pratiques d’extraterritorialité sont insupportables : elles conduisent à déstabiliser nos entreprises. Je prendrai l’exemple du marché iranien duquel certaines entreprises ont été obligées de sortir à très grande vitesse, en enregistrant évidemment des pertes et en perdant des parts de marché.
C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place un premier dispositif, Instex, qui sera opérationnel dans les prochaines semaines et permettra aux entreprises de travailler avec l’Iran, grâce à une institution neutre qui empêchera l’intervention des États-Unis.
Je précise que les Chinois font aussi l’objet de mesures de rétorsion de la part des Américains. C’est particulièrement vrai en matière de propriété intellectuelle. Ce sujet nous préoccupe moins en Europe, parce que nous respectons un peu mieux la propriété intellectuelle.
En matière d’extraterritorialité, nous travaillons actuellement sur le Cloud Act pour y apporterune réponse politique, l’application du principe de réciprocité, et technologique. Nous avons également le rapport Gauvain, qui permettra très prochainement de faire des propositions précises, à la fois à l’échelon national – je crois qu’il est important d’agir à ce niveau – et à l’échelon européen. Nous aurons tout loisir de revenir sur le sujet.

Ce sujet est vraiment important. Nous sommes à la veille des élections européennes et la question de la protection des entreprises en France, mais aussi au sein de l’Union européenne, revient tout le temps. Parfois, la DG COMP n’est d’aucune aide face à la puissance des entreprises étrangères.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je veux revenir sur le mécanisme européen de filtrage des investissements étrangers, entré en vigueur le lundi 1er avril. Ce mécanisme vise à surveiller l’impact des acquisitions d’entreprises ou de technologies stratégiques en Europe par des groupes étrangers. Il s’agit d’un premier pas en matière de défense commerciale de notre patrimoine industriel et technologique, bien nécessaire dans le nouveau contexte international.
Un rapport récent de la Commission européenne sur les investissements directs étrangers montre que le poids prépondérant des investisseurs étrangers historiques en Europe, au premier rang desquels les États-Unis, tend à diminuer en faveur notamment de la Chine.
Or la problématique essentielle pour les États-Unis était et reste celle des barrières douanières commerciales. En revanche, la Chine est bien plus intéressée par les technologies que nous développons en Europe, notamment en matière d’industrie aéronautique et de machines spécialisées, mais pas seulement.
Ces deux dernières années, l’Union européenne s’est certes dotée d’outils visant à améliorer sa capacité à résister aux offensives commerciales chinoises, mais l’action coordonnée des Européens doit être renforcée. Je pense en particulier au projet des nouvelles routes de la soie ou à la fragilité de certains États membres comme la Grèce, face aux investissements chinois, en raison de la perte de leur propre capacité industrielle.
Aussi, le mécanisme de filtrage des investissements reste insuffisant face à ces enjeux. Il met en place un dispositif utile de coopération entre États, qui permettra un échange d’informations sur les filtrages en cours. En revanche, le texte adopté n’oblige pas les États à opérer ce filtrage et précise clairement que la décision d’approuver un investissement reste exclusivement du ressort national. La Commission européenne aura simplement la possibilité d’émettre une opinion.
Il demeure donc indispensable de s’organiser, à la fois pour la protection des industries européennes et pour un meilleur encadrement des investissements étrangers dans les États membres tentés par des investissements chinois massifs.
Ma question est double : comment notre pays se saisira-t-il de ce nouveau dispositif de filtrage des investissements ? De quelle manière va-t-il s’engager pour améliorer les mécanismes de protection commerciale à l’échelle européenne ?
Je veux d’abord signaler que les États-Unis s’intéressent aussi à nos technologies. Ils n’entoureraient pas certaines de nos start-up de tant de sollicitude si tel n’était pas le cas.
J’évoquerai deux points au sujet du mécanisme de filtrage des investissements étrangers.
À l’échelon national, nous avons notre propre dispositif, que nous venons d’ailleurs de renforcer dans la loi Pacte. Celui-ci s’articule parfaitement avec le dispositif européen. Nous sommes un peu avant-gardistes sur le sujet. Nous avons également renforcé les sanctions applicables et pris un nouveau décret pour renforcer le rôle de l’État dans la détection et le suivi des investissements étrangers, notamment sur tout ce qui touche à la communication des informations de la part des investisseurs.
Par ailleurs, comme je l’ai déjà expliqué ici, notre mécanisme de suivi des investissements étrangers est particulièrement efficace, c’est-à-dire qu’un flux important de dossiers nous parvient et est examiné.
À l’échelon européen, la première étape consiste à ce que l’Europe se saisisse du mécanisme. Comme vous le savez, celui-ci rayonne sur chacune des législations nationales. L’Allemagne, par exemple, est en train de réfléchir à renforcer son propre dispositif en raison du départ de certains fleurons technologiques nationaux, qui a été légitimement assez mal vécu dans le pays. Un certain nombre de pays européens s’emparent donc de ce sujet, et ce de manière assez volontaire.
L’enjeu consiste également à mettre en place des échanges d’informations entre pays européens, justement pour améliorer le caractère fonctionnel de ce mécanisme de screening des investissements étrangers au plan national, mais également au niveau européen. Aujourd’hui, je ne crois pas que les gouvernements européens versent dans la naïveté par rapport aux investisseurs étrangers. La situation a beaucoup évolué.

J’ai bien compris votre réponse, madame la secrétaire d’État : notre pays est capable de dresser un constat. Toutefois, ma question portait plutôt sur notre capacité à mettre en œuvre des moyens coercitifs – le mot est peut-être un peu fort – une fois un tel constat dressé.
On peut déjà interdire certains investissements étrangers en France, monsieur le sénateur ! C’est déjà possible !

Nous avons bâti l’Europe avec l’idée que l’union était indispensable pour faire face aux puissants que sont les États-Unis ou la Chine. C’était plutôt bien parti avec le marché commun et la monnaie unique, qui ont facilité la vie des entreprises. Mais, nous sommes loin d’en avoir fini.
Chaque jour, en effet, nous constatons des différences réglementaires et politiques entre les États membres de l’Union européenne. Ces différences créent des concurrences toxiques et rendent difficile la production dans des domaines complexes et innovants. Nous sommes loin des produits made in Europe.
Je suis convaincu que nous pourrions conduire une politique commune avec, d’un côté, la convergence de certaines règles sur des chantiers majeurs et, de l’autre, des règles spécifiques pour que chaque État conserve ses caractéristiques.
Il suffit de bien définir les sujets. Je pense par exemple à la lutte contre le réchauffement climatique. Imposer une taxe carbone sur les produits importés pour rendre compétitifs les produits fabriqués en Europe, c’est un chantier qui doit être suivi au sein de l’Europe et qui sera une juste réplique aux taxations appliquées par nos concurrents, comme la Chine ou les États-Unis. De telles taxes seraient, de plus, parfaitement compatibles avec les règles de l’OMC.
Il faut aussi agir dans le domaine de la fiscalité et de la taxation du travail. Les différences actuelles entre États membres de l’Union européenne entraînent la fermeture de certaines de nos entreprises employant de la main-d’œuvre et de certaines de nos PME : en France, l’imposition est trop forte, le coût du travail est trop cher et nos réglementations sont trop strictes. Bilan : les entreprises françaises n’ont plus assez de marges et deviennent vulnérables à chaque transmission. On a encore pu le constater le week-end dernier.
Cette concurrence entre États bloque les rapprochements industriels et empêche l’émergence d’acteurs européens puissants, sans grand bénéfice pour les consommateurs. Posons-nous les bonnes questions : pourquoi ne fabriquons-nous pas de smartphone européen ? Pourquoi n’avons-nous pas de concurrent européen face à Amazon, Facebook ou Huawei, alors que nous sommes capables de construire des Airbus quand nous choisissons de nous rapprocher ? L’Europe devrait poursuivre les recherches nécessaires dans ces domaines et mobiliser les fonds pour le développement de telles sociétés.
Madame la secrétaire d’État, j’ai deux questions. Quelle orientation allons-nous prendre : allons-nous diminuer les impôts, les règles et les taxes pour redevenir compétitifs au sein de l’Europe ? Allons-nous enfin supprimer ces concurrences toxiques pour œuvrer ensemble à la réalisation de produits européens ?
Baisser les impôts pour redevenir compétitif ne peut pas faire de mal, mais je pense qu’il faut commencer par balayer devant sa porte et le faire en France. Il s’agit d’un commentaire à part.
Néanmoins, et je partage votre point de vue, on n’arrivera pas à développer le même modèle low cost que dans un certain nombre de pays. Le vrai sujet, c’est le travail que nous menons au plan européen au travers de la directive-cadre sur les exigences en matière d’écoconception, à savoir une conception des produits qui intègre dès l’amont une approche écologique, ce qui est aussi une façon de gagner de la compétitivité. Cette démarche n’est pas seulement contraignante, bien au contraire.
Il s’agit également d’engager une discussion, par exemple, pour mettre en place une taxe carbone aux bornes de l’Europe. On peut en effet justifier une telle mesure dans le cadre du marché unique, d’autant qu’elle respecte les règles de l’OMC. Des discussions existent sur ce dossier à l’échelon européen.
Quant à la mise en commun des moyens au service de l’innovation, vous savez sûrement que la France a créé un fonds pour l’innovation dans l’industrie, qui a été très discuté dans cette enceinte au moment du débat sur la privatisation d’Aéroports de Paris. Je rappelle que cette privatisation sert à abonder ce fonds pour l’innovation de rupture.
Dans un premier temps, nous travaillons avec l’Allemagne, mais nous nous inscrivons également dans une perspective européenne pour créer une approche commune au plan européen. Si dix pays différents versent 10 milliards d’euros chacun, le dispositif va commencer à ressembler à quelque chose.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la Cour des comptes a estimé récemment que la fusée Ariane 6 était trop conventionnelle pour faire de l’ombre à son grand rival américain SpaceX.
Comme vous le savez, l’année 2019 est une année de transition entre Ariane 5 et le nouveau lanceur Ariane 6, dont le premier vol devrait intervenir dans le courant du second semestre de 2020. Il est donc impératif de poursuivre, voire d’amplifier les programmes de recherche, car Ariane 6 va arriver sur le marché mondial dans un environnement très concurrentiel. L’option de lanceurs récupérables doit faire l’objet d’études complémentaires en vue d’améliorer ses performances et de mesurer sa viabilité.
Si on peut légitimement s’interroger sur les choix technologiques effectués par la filière européenne, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, qui nécessite une vision stratégique claire. Cette dernière nous a fait défaut ces dernières années, puisque Arianespace a perdu sa place de leader mondial de l’accès à l’espace commercial depuis 2016.
Dans ce contexte, j’aurais souhaité attirer votre attention sur l’absence d’une préférence européenne imposant aux États membres d’utiliser exclusivement le lanceur européen, contrairement à nos voisins américains, qui « lancent américain », aux Chinois, qui « lancent chinois », ou aux Russes, qui « lancent russe ».
Pourriez-vous m’indiquer, madame la secrétaire d’État, si la préférence européenne pour les lancements de satellites institutionnels européens – gouvernementaux, militaires ou scientifiques – sera une réalité pour la fusée Ariane 6 ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Vous avez raison, madame la sénatrice Morhet-Richaud, de souligner la percée spectaculaire de SpaceX dans l’univers des lanceurs. Je précise d’ailleurs que cette percée spectaculaire n’est pas le fait d’une entreprise inventée dans un garage ; nous avons face à nous une entreprise qui a été, dès l’origine, massivement soutenue par le Department of Defence – donc par le gouvernement des États-Unis –, lequel a financé un certain nombre de lancements.
S’agissant de la France, l’objectif est évidemment de poursuivre et amplifier les programmes de recherche, car le prochain lanceur est deux fois moins cher que celui que nous utilisons actuellement et permettra, par conséquent, un véritable gain de compétitivité.
Nous, Français, appliquons la préférence européenne, mais effectivement chaque pays est libre de le faire.
Nous la promouvons également, comme j’ai eu l’occasion de le dire à la tribune. En effet, il nous apparaît essentiel de mettre en œuvre cette préférence européenne si nous voulons construire une véritable industrie de la défense et aérospatiale, et nous donner un accès à l’espace – c’est tout de même un point important, sachant que, dans ce domaine, il y a également le projet italien de lanceur Vega, pour des lancements d’objets de plus petite taille.
Très clairement, c’est un des enjeux des discussions que nous avons, aujourd’hui, avec l’Agence spatiale européenne et l’ensemble des pays européens.
À cet égard, il faut garder en tête un autre sujet : celui des satellites. Dans ce secteur, où nous disposons de grands constructeurs, mais également de grands opérateurs, nous avons aussi à forger cette vision européenne.
Je partage donc entièrement votre constat, madame la sénatrice.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la politique industrielle a une singularité, comparée à de nombreuses autres politiques publiques – politique fiscale, politique commerciale, politique de l’emploi… – : on est tenté, soit de tout y mettre, soit de se concentrer sur un volet seulement, sur un concurrent en particulier ou sur un secteur.
Ces différentes tentations illustrent le flou de ce qui constituerait une politique ou une stratégie industrielle, de surcroît européenne.
Et derrière ce flou, se révèle un problème plus fondamental : nous ne serions pas capables, aujourd’hui, en 2019, en France et en Europe au moins, de déterminer la juste place et le rôle de la puissance publique, de l’État dans l’économie et dans la société.
Voilà quelques jours, à Hanovre, madame la secrétaire d’État, vous tweetiez qu’« une politique européenne, c’est mettre nos politiques de la concurrence, du commerce et de l’énergie au service de l’industrie ». Toutefois, vous ne précisez pas l’échelle la plus pertinente pour chaque volet et action de la politique industrielle.
Vous évoquez, avec le ministre de l’économie et des finances, la constitution de « champions européens » ou de « géants européens » capables de concurrencer les entreprises chinoises et américaines. Vous allez jusqu’à exprimer votre volonté de revoir les règles de la concurrence européenne, en particulier depuis le rejet, par la Commission, du projet de fusion entre Siemens et Alstom.
« Unir nos forces ou laisser notre base et notre capacité industrielles disparaître progressivement » : ce sont les mots du manifeste franco-allemand récemment publié.
Concrètement, comment concilier la constitution de géants avec la rigueur de notre administration européenne ? Dès lors, quelle place accordez-vous dans une politique industrielle européenne aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire ?
Je crois, monsieur le sénateur Bouloux, avoir mentionné que la vision que nous avons de la constitution de champions nationaux est assez teintée par notre propre tissu industriel. Notre objectif est d’aller au-delà, bien au-delà, de ce simple exemple.
Mais, si je crois profondément que le rapprochement entre Alstom et Siemens aurait pu faire naître un groupe ferroviaire suffisamment puissant pour affronter son homologue chinois, capable de continuer à investir dans l’innovation et de garder son avance technologique, notamment en matière de signalisation, je pense que la politique industrielle dépasse de loin les grands groupes. C’est d’ailleurs tout le sens du travail que nous réalisons avec le Mittelstand allemand, démontrant que des entreprises de taille intermédiaire peuvent réussir au plan international et devenir leaders sur des niches.
Vous l’avez dit, la politique industrielle a pour vocation d’irriguer l’ensemble des politiques européennes, avec un objectif : celui de produire et d’avoir de l’emploi en Europe, grâce à des entreprises compétitives, et non en soutenant de manière infondée des entreprises qui ne le seraient pas.
Pour atteindre une telle compétitivité, plusieurs conditions doivent être remplies.
Il faut une politique commerciale adaptée. Le libre-échange est souhaitable s’il y a réciprocité – il a permis à nos pays de connaître une forte croissance économique au cours des soixante dernières années –, mais nous devons être capables de réagir lorsque cette réciprocité n’existe plus.
Il faut une politique de la concurrence adaptée. Nous avons déjà largement évoqué cet aspect.
Il faut également une politique environnementale adaptée. Dès lors que nous nous imposons des contraintes pour protéger nos consommateurs, il n’est pas illégitime de les protéger également de produits qui ne répondraient pas aux standards que nous avons fixés. Nous disposons d’une certaine avance en matière de productions environnementales ; autant qu’elle soit un atout pour notre compétitivité ! Il en va de même pour l’énergie.
À cela s’ajoute un dernier point : il faut un marché intérieur mieux intégré, au niveau tant des services et des produits que des capitaux.

Si j’ai souhaité intervenir dans ce débat relatif à la politique industrielle européenne, c’est pour aborder le sujet de l’industrie pharmaceutique ou, plus précisément, comme le montre le récent rapport sénatorial auquel j’ai pu participer, celui de la dépendance en principes actifs de l’Europe pour la fabrication des médicaments.
De cette dépendance découle une pénurie pour notre continent, qui se fait de plus en plus prégnante, représente un danger pour les malades et met en jeu notre sécurité sanitaire.
Cette pénurie est en constante progression en France et en Europe depuis plusieurs années. Ainsi, nous sommes passés de 44 signalements de rupture de stock en 2008 à plus de 530 au 1er janvier 2019, pour une durée moyenne de quatorze semaines.
Les chaînes de production pharmaceutique font face, de façon générale, à d’importantes problématiques, telles que les difficultés d’approvisionnement en matières premières par concentration des sites de production en principes actifs en Inde, Chine et Asie du Sud-Est.
Par ailleurs, les professionnels sont confrontés, en Europe, à une augmentation des coûts de production, parallèlement à des prix de vente de plus en plus contraints, les incitant à externaliser leurs outils de production européens vers des pays à main-d’œuvre disponible, de bas coût et aux normes moindres. En 2018, l’Inde et la Chine concentraient 61 % des sites et 80 % des fabricants de substances actives des médicaments disponibles en Europe étaient situés en dehors de l’Union européenne, contre 20 % voilà trente ans.
Il y a donc là une inquiétante perte d’indépendance sanitaire et l’urgence de mettre en place une véritable stratégie industrielle de relocalisation européenne de fabrication des principes actifs. L’Europe doit recréer les conditions d’une production de proximité et d’une filière « chimie » forte, afin de redémarrer la fabrication des médicaments d’intérêt vital actuellement importés et dont la livraison est irrégulière. C’est d’autant plus important que certains sites français, par exemple celui de Saint-Genis-Laval, dans le Rhône, sont menacés.
Les sites de production chimique et pharmaceutique constituent un secteur particulier, auquel il est nécessaire d’appliquer des dérogations, en contrepartie, bien sûr, d’engagements.
Je voudrais donc savoir, madame la secrétaire d’État, quelle est l’ambition du Gouvernement pour une véritable stratégie pharmaceutique industrielle européenne.
La question que vous posez, madame la sénatrice, m’est particulièrement chère. En effet, pendant les trois années où j’ai travaillé à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, j’ai connu l’arrivée sur le marché de toute une génération de médicaments innovants et la dureté extrême des négociations conduites par les autorités de tutelle sur ces principes actifs, avec, effectivement, des impacts budgétaires non négligeables, mais aussi des réponses essentielles apportées aux patients.
Premier élément de réponse, l’industrie pharmaceutique fait l’objet, aujourd’hui, d’un contrat stratégique de filière, prévoyant un travail spécifique sur les bio-productions. Ce travail doit nous amener à être plus compétitifs en matière de production, mais aussi à assurer le financement des innovations afin d’en conserver la maîtrise.
Deuxième élément de réponse, le Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, déploie également un programme de travail en vue d’améliorer l’attractivité de la France en tant que pays de destination pour l’industrie pharmaceutique.
Nous devons notamment être capables d’avoir une vision industrielle s’agissant de nos dépenses de santé. Ainsi, la France est traditionnellement un très bon négociateur sur le prix des nouvelles thérapies, ce qui a pour contrepartie des difficultés en termes de financement et de juste paiement de la recherche sur ces nouvelles thérapies.
Comme l’a reflété la loi de financement de la sécurité sociale, le CSIS a donc prévu un traitement différencié entre les molécules dites « matures » – elles le sont en cinq ans, et non en quinze ans – et les molécules nouvelles, afin de garantir une rémunération plus appropriée de l’effort de recherche.
Ces axes de travail sont retenus pour l’ensemble des médicaments clés.
Je vois que mon temps de parole est écoulé et que j’ai beaucoup parlé de la France, et trop peu de l’Europe. À cette échelle, il nous faut penser chaîne de valeur et chaîne logistique. C’est un point que nous avons en tête.

En conclusion de ce débat, la parole est à M. Serge Babary, pour le groupe auteur de la demande.

Madame la secrétaire d’État, vous avez pu mesurer l’intérêt, parfois l’inquiétude, suscités par ce sujet de la stratégie industrielle sur toutes les travées de notre hémicycle et je voudrais, en conclusion de ce débat, remercier tous nos collègues qui sont intervenus.
L’industrie est un pilier fondamental de l’économie européenne, un moteur indispensable à sa productivité, sa croissance et son innovation. Elle fournit un emploi à 35 millions de personnes et représente 20 % du PIB de notre continent.
Depuis trente ans, son poids dans l’économie européenne n’a pourtant cessé de chuter.
La concurrence des pays émergents, qui a fait tant de mal à nos industries traditionnelles, s’exerce maintenant de manière aussi pressante sur des secteurs à très haute valeur ajoutée, que l’on croyait pour longtemps à l’abri.
Dans le même temps, des bouleversements technologiques majeurs rebattent avec une incroyable vitesse les cartes de la puissance industrielle, transformant des secteurs entiers aussi rapidement qu’ils créent de nouveaux marchés.
L’organisation collective du commerce international est, quant à elle, en train de changer radicalement de nature.
Ses règles multilatérales s’étiolent peu à peu dans la foulée du néoprotectionnisme américain et, surtout, de l’inexorable montée en puissance de la Chine, qui, rappelons-le, continue de profiter d’un traitement préférentiel lié à son statut d’économie en développement – ce qu’elle n’est plus – tout en réclamant les avantages liés au statut d’économie de marché – ce qu’elle n’est pas. La conquête du monde dans laquelle ce pays s’est lancé n’est donc pas alimentée uniquement par ses mérites propres, qui sont certes réels.
Dans ce contexte, la nécessité de bâtir une politique industrielle à l’échelon européen apparaît, non plus comme une option, mais comme une obligation.
La réalité économique ne laisse en effet plus guère le choix.
Le premier axe est humain. L’industrie est et sera confrontée à un immense besoin de compétences, lié à l’évolution de ses métiers. Il est donc nécessaire que l’Union européenne soutienne les efforts d’investissements des États membres dans l’éducation, l’apprentissage et la formation professionnelle.
Ensuite, un cadre stratégique de soutien au développement industriel doit être élaboré autour de l’identification des secteurs pouvant être qualifiés d’intérêt stratégique pour l’économie européenne. Dans ces domaines, la recherche et l’innovation devront être massivement soutenues, à la fois par des fonds publics en hausse et par une mobilisation accrue des financements privés, et les coopérations industrielles devront être facilitées et encouragées, notamment via le lancement de grands projets structurants.
Mais, pour que des leaders industriels européens, puis mondiaux, soient en capacité d’apparaître dans les secteurs prioritaires, la politique de concurrence devra opérer une importante évolution. Si l’on souhaite véritablement soutenir la réindustrialisation du continent, le droit de la concurrence devra également prendre en compte d’autres éléments que le seul intérêt du consommateur, notamment des impératifs tels que la préservation de l’indépendance technologique, de l’emploi ou des savoir-faire industriels.
Enfin, si l’Europe s’est fondée sur les principes d’ouverture des marchés et de concurrence libre et non faussée, force est de constater que ces préceptes ne sont pas nécessairement ceux qui guident la politique économique du reste du monde. La définition d’une politique industrielle européenne n’ira donc pas sans une politique commerciale révisée sur le fondement d’une exigence de réciprocité des échanges.
Instruments de défense antidumping et antisubventions, réciprocité des conditions d’accès aux marchés ou aux programmes de financements publics, contrôle renforcé des investissements étrangers dans les actifs stratégiques, meilleure vérification de la conformité des produits importés avec les règles européennes, tous ces thèmes sont aujourd’hui au cœur des discussions. Ils doivent trouver une concrétisation ambitieuse, et surtout efficace, pour que l’Europe s’affirme davantage dans la mondialisation.
Sans stratégie volontariste, l’Europe industrielle risque de passer à côté des nombreux nouveaux marchés qui ne cessent d’éclore. Mais, ce faisant, elle risque surtout d’être balayée par des concurrents internationaux particulièrement déterminés et conquérants. Il est donc urgent de la réindustrialiser.
Dans un rapport d’information intitulé La politique industrielle et commerciale de l ’ Union européenne face à la mondialisation de l ’ économie, présenté au Sénat le 28 mai 1998, le sénateur Jacques Oudin affirmait déjà : « L’Europe n’aura sa place dans le monde qu’en s’appuyant sur un socle industriel performant et compétitif. » Nous ne disons rien d’autre ! Il ajoutait : « Elle y trouvera également le moyen de créer de véritables emplois, les emplois industriels étant un élément déterminant pour la création d’emplois de service nombreux. »
Selon notre ancien collègue, le contexte était alors favorable à ce que soit, enfin, forgée une politique industrielle et commerciale porteuse d’espoirs pour l’avenir. Nous étions en 1998 !
En ce domaine, on le voit, les rapports, communications, résolutions se sont succédé avec les mêmes constats, mais aucun n’a véritablement été suivi. Pourquoi en irait-il aujourd’hui différemment ?
L’expression « politique industrielle » n’est plus un tabou. Une certaine prise de conscience semble enfin voir le jour, tant au niveau des institutions communautaires que des États membres, traditionnellement rétifs à une stratégie industrielle commune. Le manifeste franco-allemand pour une politique industrielle européenne adaptée au XXIe siècle, publié le 19 février dernier, est un premier pas vers une vision stratégique de l’industrie européenne.
C’est donc maintenant qu’il faut agir, pour permettre à l’industrie européenne de faire valoir pleinement ses nombreux atouts dans la compétition internationale.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Nous en avons terminé avec le débat sur le thème : « Les enjeux d’une politique industrielle européenne ».
Mes chers collègues, l’ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures vingt, est reprise à vingt-et-une heures cinquante, sous la présidence de M. Philippe Dallier.