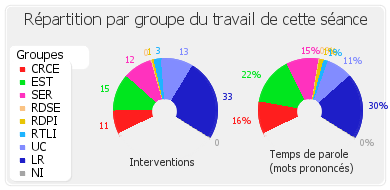Séance en hémicycle du 5 mars 2020 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (projet n° 307, texte de la commission spéciale n° 359, rapport n° 358).
Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous poursuivons l’examen de l’article 33, appelé en priorité.
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :
a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ;
b) De modifier la composition du conseil d’administration en prévoyant la représentation de l’ensemble des collectivités territoriales, afin d’enrichir la prise de décision de l’Office face aux nouveaux enjeux de la Forêt ;
2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter-départementaux, régionaux, inter-régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles.
I bis
I ter
I quater
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I.
III

L’amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l’organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter-départementaux, régionaux, inter-régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles
par les mots :
ainsi qu’aux organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 du même code, afin de rapprocher les règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 33 relatives aux chambres d’agriculture dans la rédaction qui était celle du projet initial du Gouvernement, en précisant que ces dispositions portent également sur les différents organismes inter-établissements du réseau des chambres d’agriculture.

Cet amendement contrevient aux travaux de la commission spéciale, qui avait souhaité encadrer cette habilitation. Nous y sommes par conséquent défavorables.

Je me réjouis de la position de Mme la rapporteure. Madame la secrétaire d’État, je ne comprends pas très bien pourquoi il faudrait supprimer ces lignes, qui présentent l’avantage de souligner la nécessité du dialogue avec les personnels des chambres d’agriculture.
Je veux vous rassurer, monsieur le sénateur. Comme vous pouvez l’imaginer, les négociations qui sont conduites actuellement par le ministre de l’agriculture – vous avez eu le loisir d’en parler mardi dernier – le sont évidemment dans la plus grande concertation. Comme, a priori, le projet de loi sera adopté après la fin de cette concertation, le retour à une écriture légistique conforme à la réalité de l’objet dont nous discutons me paraît raisonnable.
Voici donc ma réponse : les négociations vont bon train.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement vise précisément à adapter le texte à l’état des discussions que nous avons aujourd’hui avec l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA). Il s’agit d’élargir le champ de l’habilitation accordée au Gouvernement pour lui permettre, en fonction de l’issue de la négociation autour du contrat d’objectifs et de performance, de modifier la dénomination de l’APCA, de compléter ses missions et compétences relatives à l’animation des établissements du réseau, et de modifier en conséquence les missions des autres établissements.

Je voudrais rappeler dans quelles conditions particulièrement difficiles nous examinons ce projet de loi : le texte a été adopté en conseil des ministres le 5 février dernier et inscrit à l’ordre du jour de la séance publique à peine un mois plus tard. Quant au présent amendement, il nous a été transmis très tardivement ; nous n’avons pas eu le temps de l’examiner réellement avant le début de nos travaux en séance publique. La commission spéciale avait donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
À titre personnel, néanmoins, je considère qu’il ne serait pas raisonnable de ne pas le voter.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement vise à élargir le champ de l’habilitation relative au volet du texte portant sur les chambres d’agriculture en accordant au Gouvernement la possibilité de définir des règles particulières pour la chambre d’agriculture de Mayotte, laquelle n’était pas couverte par le texte tel qu’il était rédigé – nous réparons cet oubli.

Même commentaire que pour l’amendement précédent : la commission spéciale avait émis un avis défavorable ; à titre personnel, néanmoins, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Compte tenu des conditions dans lesquelles elle a dû travailler, je comprends la position initiale de la commission spéciale ; je remercie cependant Mme la rapporteure d’avoir revu cette position.
Cet amendement est très important pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, qui existe depuis 2001 – j’ai rappelé son histoire la dernière fois que nous avons abordé ce sujet. Celle-ci connaît des dysfonctionnements ou, en tout cas, fonctionne de façon bancale, parce qu’elle a été conçue sur un modèle très particulier sans être dotée des moyens correspondants.
Aujourd’hui, le Gouvernement demande une habilitation pour pouvoir régler la situation. L’enjeu est d’apporter de la sécurité juridique à cette chambre et de lui permettre de fonctionner comme toutes les chambres de France et de Navarre.
Le sujet revêt une importance particulière s’agissant d’un territoire d’outre-mer qui doit composer avec des impératifs d’autosuffisance alimentaire – en la matière, nous sommes loin du compte. Il s’agit aussi, tout simplement, d’alimenter les cantines scolaires ou de lutter contre la cherté de la vie – songez, mes chers collègues, que nous importons des produits qui viennent de très loin, du Brésil par exemple.
Sortir de cette situation très compliquée pour les outre-mer suppose aussi de restructurer et de soutenir les institutions telles que la chambre d’agriculture de Mayotte, afin qu’elles puissent jouer leur rôle, à savoir, en l’occurrence, aider les exploitants et les agriculteurs à nourrir la population.
Je vous saurais donc gré, mes chers collègues, de bien vouloir voter cet amendement. Une fois cela fait, le gros du travail restera à accomplir : les échanges avec le Gouvernement devront débuter pour déterminer ce qui doit être fait exactement sur le terrain.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 33 est adopté.

L’amendement n° 146 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset, Cardoux, Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-2 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 est supprimé ;
3° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;
- à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas », sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la phrase précédente » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à M. Daniel Gremillet.

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de certains articles du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs notamment aux droits de plantation de vignes et au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) sur des bâtiments ayant connu dans le passé un usage agricole.
Je rappelle que ce droit de préemption s’applique aujourd’hui uniquement aux bâtiments situés en zone de montagne. Il s’agit de donner une certaine cohérence au droit qui régit ces diverses compétences en matière d’agriculture.

L’objectif des auteurs de cet amendement est louable : il s’agit d’abroger certaines dispositions jugées superfétatoires ou obsolètes relatives aux droits de plantation de vignes, aux conventions de mise à disposition des Safer, ainsi qu’au droit de préemption dont disposent ces dernières.
Pour autant, un toilettage du code rural et de la pêche maritime ne peut être envisagé qu’à droit constant. Aussi convient-il de s’assurer de l’absence d’« effets de bord » résultant d’une éventuelle abrogation des dispositions précitées.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de suivre sur ce point l’avis du Gouvernement.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 33.
L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset, Cardoux, Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-2-2 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 312-4, qui devient l’article L. 312-3, est supprimé ;
3° Après l’article L. 313-7, il est ajouté un article L. 313-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-…. – En Corse, l’office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l’Agence de services et de paiement. » ;
4° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé.
La parole est à M. Daniel Gremillet.

Merci au Gouvernement d’avoir suivi, à l’amendement précédent, ma proposition de simplification et de mise en cohérence.
Le présent amendement va dans le même sens. Il a pour objet, là aussi, de remettre en cohérence diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime avec les textes réglementaires.
Il s’agit notamment, cette fois, d’abroger l’article du code rural et de la pêche maritime relatif à la création de l’inventaire des vergers, celui-ci étant désormais créé et relevant du cadre réglementaire et non législatif. Il s’agit également de supprimer la nécessité d’un décret, irréalisable et non sans dangers, fixant les modalités de publication du barème annuel de la valeur des terres agricoles et, en conséquence, de procéder à la sécurisation juridique de la pratique actuelle, qui a toujours eu cours de la même manière, avant ou après 2017.
Nous proposons en outre que, pour certains territoires, en l’occurrence la Corse, les textes réglementaires seuls prévoient désormais une composition spécifique de la commission territoriale d’orientation de l’agriculture, comme c’est déjà le cas en Île-de-France.

Avant d’envisager de supprimer les bases législatives listées par le présent amendement, il convient de s’assurer que ces abrogations n’ont pas d’incidence juridique. Or rien ne garantit que, en l’absence de fondement législatif, les dispositions réglementaires qui déclinent ces dispositions seront maintenues.
Dès lors, la sécurité juridique commande de conserver ces dispositions législatives, qui constituent autant de bornes légitimes à l’exercice du pouvoir réglementaire. Les professionnels eux-mêmes sont très sensibles à cet enjeu, plusieurs d’entre eux s’étant émus auprès de la commission spéciale des abrogations proposées.
Par ailleurs, si ces évolutions doivent intervenir, c’est davantage dans le cadre de la réforme globale que j’ai déjà évoquée, et qui devrait être mise en œuvre par le projet de loi foncière.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la rapporteure a très bien souligné la difficulté d’application juridique que pose cet amendement, dont l’adoption reviendrait à abroger le fondement législatif d’un certain nombre d’articles réglementaires. Il nous semble que cela ne fonctionne pas ; je demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettrai un avis défavorable.

Non, je vais le retirer, madame la présidente.
Si je l’ai déposé – la même remarque vaudra pour les amendements suivants –, c’est pour montrer qu’il est nécessaire de redonner à un certain nombre de textes, qui remontent parfois aux années 1960 – nous y reviendrons tout à l’heure –, une cohérence arrimée à une politique et à une stratégie agricoles. J’admets qu’un certain nombre de ces amendements sont un peu provocateurs ; mais si l’on ne provoque pas le débat, les semaines et les mois passent sans jamais accoucher des textes que la profession appelle de ses vœux et que la stratégie de notre pays en matière agricole exige.
Je retire cet amendement, donc, mais la réflexion qui s’y exprime a tout son sens et toute sa place dans une nouvelle définition de la politique agricole de notre pays.

L’amendement n° 144 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer et Berthet, MM. Morisset et Cardoux, Mme Bruguière, MM. Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-71 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf accord écrit et préalable des parties, » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
- la première phrase est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les travaux imposés par l’autorité administrative, les plantations, les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, y compris la valeur de la main d’œuvre, évalué à la date de l’expiration du bail et réduit d’un seizième par année écoulée depuis leur exécution. » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) À la première phrase du 3°, les mots : « déduction faite de l’amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « réduite d’un seizième par année écoulée depuis leur exécution » ;
e) Le 5° est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 1 de l’article L. 411-73, les mots : « figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et » sont supprimés ;
3° L’article L. 411-78 est abrogé ;
4° À la première phrase de l’article L. 416-5, les mots : « porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d’une superficie supérieure au seuil mentionné à l’article L. 312-1, qu’il » sont supprimés.
II. – L’article 78 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Daniel Gremillet.

Toujours dans le même sens, il s’agit de montrer que notre pays a beaucoup évolué.
Nous avons eu de nombreux débats, ici même, sur l’accaparement des terres, qui nous a tous choqués, ou sur la loi Égalim, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.
Des questions plus fondamentales encore ne sont pas posées : qu’est-ce aujourd’hui qu’un agriculteur – j’y reviendrai, là aussi, tout à l’heure ? Comment assurer que la transmission du modèle d’agriculture à la française reste viable ? Quelles sont les dynamiques possibles en matière de relations entre le propriétaire et le fermier ? Comment peut-on donner aux agriculteurs des capacités d’investissement et d’amortissement ?

La commission spéciale comprend tout à fait l’objet de cet amendement ; néanmoins, comme pour le précédent, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement relatif au statut du fermage. En effet, une mission d’information sur les baux ruraux est en cours à l’Assemblée nationale, conduite par MM. Antoine Savignat et Jean Terlier, qui ont commencé leurs travaux les 11 et 12 février dernier. Les conclusions de cette mission viendront enrichir la réflexion globale du ministère de l’agriculture sur le foncier.
La mesure que vous proposez est donc à ce stade, monsieur le sénateur, prématurée. Mais la bonne nouvelle est que le point que vous soulevez sera a priori étudié – tel était d’ailleurs, si je vous ai compris, le sens de cet amendement d’appel. Les suites qui seront données à cette mission offriront un angle d’attaque à la réflexion que vous souhaitez mener.
Demande de retrait, donc ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Non, je vais le retirer également, madame la présidente. Je remercie notre rapporteure ainsi que Mme la secrétaire d’État, qui a très bien compris le sens de cet amendement.
Je le répète : les mois passent, et nous n’avons toujours pas trouvé l’arsenal qui nous permettra de créer de nouvelles relations dans le monde agricole, donc une nouvelle sécurisation du foncier, et de faire en sorte que la terre, qui a différentes fonctions, puisse continuer d’être transmise à celles et ceux de nos enfants qui garantiront la sécurité alimentaire de notre pays. Il y a là, vraiment, un enjeu stratégique.
Je retire cet amendement dont les dispositions, là encore, auront toute leur place dans la discussion de la future loi relative notamment, mais pas uniquement, au foncier agricole.

L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 142 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer, Chauvin et Berthet, MM. Morisset et Cardoux, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Thomas, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont abrogés :
1° La loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
2° Les articles 4 et 6 à 33 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
3° La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ;
4° La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
5° La loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage ;
6° La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.
II. – Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions du chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime.
III. – L’article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article s’applique aux groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, lorsqu’ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles. »
III. – Après l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Le droit de reprise aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 ne peut être exercé au profit d’une personne bénéficiant d’un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.

Cet amendement est très symbolique ; il vise notamment à abroger les lois d’orientation qui ont fait l’agriculture française d’aujourd’hui. N’oublions pas d’où nous venons : nous ne venons pas de nulle part, et notre histoire a été scandée par des décisions fondamentales.
Première décision, au sortir de la guerre, à l’époque où la France et l’Europe avaient faim : le traité de Rome. Il grave dans le marbre le principe suivant : « Paysans, produisez ; l’Europe vous garantit un revenu ! ».
Ensuite furent votées les lois d’orientation que j’ai évoquées, très importantes pour le développement de l’agriculture. Si l’agriculture française est aujourd’hui à ce niveau de performance, si elle garantit aux Français et aux Européens tant la sécurité alimentaire que la qualité des produits, cela vient de ces textes.
Reste que, aujourd’hui, la taille moyenne des fermes n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était dans les années 1960 – on parlait, à l’époque, d’une surface minimale d’installation fixée à 16 hectares ou à 18 hectares… Si j’ai souhaité déposer cet amendement, c’est parce qu’il faut que nous ayons ce débat, et que nous ayons le courage d’aller plus loin.
Le sol est aujourd’hui convoité par tous ; or il est nécessaire à la sécurité alimentaire. Lorsque l’on implante une éolienne, on doit créer un chemin d’accès, et on ne pense jamais aux surfaces ainsi perdues, qui font partie, pourtant, de l’écobilan qu’il faut avoir l’honnêteté de faire. Il y a bien, donc, une certaine forme de concurrence entre les usages – c’est la même chose pour les panneaux solaires.
Surtout, serons-nous capables un jour de hiérarchiser les fonctions ? Lorsque la Safer préempte, doit-on donner la priorité, au moment de l’installation, à l’activité agricole à vocation alimentaire ? Quid des productions énergétiques, par exemple ? Je pense à la méthanisation qui, dans certains secteurs, peut entrer en concurrence avec la production alimentaire.
Il y a là des sujets qu’on ne doit pas ignorer. Il nous appartient – nous en avons besoin – de définir une nouvelle forme d’agriculture, qui doit nous apporter à la fois l’alimentation et de l’énergie.

L’abrogation des lois agricoles listées par l’amendement n’est pas souhaitable.
En effet, après un examen attentif, il s’avère que les lois de 1960, 1962, 1980, 1984 et 1988 comprennent encore des dispositions en vigueur, dont certaines ne sont pas codifiées dans le code rural et de la pêche maritime.
Dès lors, il n’est pas possible d’entreprendre un toilettage de ces lois sans risquer d’abroger des dispositions encore applicables.
Compte tenu du risque posé en termes de sécurité juridique, le chantier proposé par les auteurs de cet amendement, par ailleurs tout à fait utile, nécessite, pour aboutir, une analyse plus approfondie.
Ce chantier pourrait tout à fait être conduit dans le cadre de la mission, dite « Balai » – pour bureau d’abrogation des lois anciennes inutiles –, instituée par le bureau du Sénat.
Laissons-nous le temps de l’expertise sur ces sujets majeurs pour notre politique agricole.
La mesure proposée nécessite une étude d’impact, notamment juridique, des conséquences de l’abrogation des dispositions en cause.
À la suite de la publication de la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l’abrogation de lois obsolètes, qui traitait des lois antérieures à 1940, le Sénat a entrepris un travail sur l’abrogation des lois obsolètes de la période 1941-1981. Ce travail et le véhicule législatif qui en découlera permettront, si cela est jugé opportun, d’abroger les dispositions que vous visez.
Pour cette raison, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

J’entends les réponses de Mme la secrétaire d’État et de notre rapporteure.
Le point que je soulève, néanmoins, ne pourra pas être abordé dans un texte du type de celui qui est issu de la mission Balai. Cet amendement est en effet un amendement d’appel ; si j’ai fait référence aux lois d’orientation, c’est que la France a besoin de nouvelles définitions : qu’est-ce qu’un agriculteur ? Qu’est-ce qu’une entreprise agricole ? C’est cette base de départ qu’il faut avoir le courage de retravailler.
Je vous rappelle que, à l’époque où ces lois ont été adoptées, on donnait des aides aux paysans pour qu’ils quittent le métier d’agriculteur – c’est ce qu’on appelait les indemnités viagères de départ (IVD) –, parce que la France avait besoin de bras dans l’industrie.
Or, aujourd’hui, les agriculteurs ont peut-être besoin, plus que d’hectares supplémentaires, de voisins – c’est une vraie question, et un vrai débat de société.
Je vais retirer cet amendement, madame la présidente, mais il s’agit d’un amendement qui vient du cœur. Aurons-nous le courage de définir à nouveaux frais ce qu’est un paysan et de dire ce que l’on attend de l’agriculture sur nos territoires ? C’est à ce prix que nous pourrons créer une dynamique et, surtout, garantir la sécurité alimentaire de notre pays dans le cadre d’une stratégie européenne.
Un autre sujet, d’actualité brûlante, en lien direct avec cet amendement, fait d’ailleurs débat : l’Europe, précisément. Le seul sujet communautaire partagé est en effet celui de l’agriculture et de la pêche.
Là encore, si la France fait preuve de faiblesse, compte tenu de la faiblesse qui prévaut aujourd’hui au niveau européen, je suis inquiet pour le futur.

L’amendement n° 142 rectifié bis est retiré.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous revenons au cours normal de la discussion des articles.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Chapitre Ier
Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-5 est ainsi modifié :
aa)
a) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;
« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.
« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;
2° Le III de l’article L. 512-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;
« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté. » ;
3° L’article L. 512-10 est ainsi modifié :
aa)
a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.
« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »

Nous sommes assez préoccupés par cet article et, plus globalement, par ce chapitre du texte, qui ne tient absolument aucun compte et ne tire absolument aucun enseignement de l’accident qui a eu lieu, il y a quelques mois maintenant, à l’usine Lubrizol à Rouen, affectant très fortement des populations nombreuses, dans mon département, la Seine-Maritime, et au-delà, le panache de fumée ayant traversé les Hauts-de-France.
Cet accident a suscité un important travail parlementaire : une mission d’information à l’Assemblée nationale, une commission d’enquête unanimement demandée et mise en œuvre ici même, au Sénat. La remise des conclusions de ce travail est imminente, puisque notre commission d’enquête rendra son rapport d’ici à quelques semaines tout au plus.
Or, nous le regrettons, il n’est tenu absolument aucun compte, là encore, de ce travail important. Au contraire, le présent texte poursuit une logique à l’œuvre depuis plusieurs mois et plusieurs années, qui, sous couvert de simplification et d’accélération, fait reculer le droit de l’environnement et les instances de contrôle – je pense par exemple aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui étaient, sur les questions de sécurité, des outils pour les salariés et les dirigeants d’entreprises. Je pourrais parler également du secret des affaires et de tant d’autres évolutions qui vont dans le même sens.
On nous dit que ce texte est la traduction législative du rapport Kasbarian ; c’est vrai. Je voudrais simplement souligner que le rapport Kasbarian a été remis quelques jours avant l’incendie de Lubrizol ; son auteur ne pouvait donc évidemment pas en tenir compte. J’ajouterai que certaines recommandations du rapport, sur lequel je pourrais émettre de nombreuses critiques, contrebalançaient un peu, insuffisamment certes, les mesures qui nous sont aujourd’hui proposées.
Or nous ne retrouvons absolument aucune de ces recommandations dans le texte. Il nous semblerait donc judicieux que l’ensemble de ce chapitre soit retiré du projet de loi, que l’on attende les conclusions du travail en cours, et notamment de celui que nous sommes en train de mener ici même au Sénat, afin que de véritables enseignements, pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), puissent être tirés de cet accident industriel de Lubrizol.

Ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique est un texte important, intéressant, nécessaire. Nous en avons tous l’illustration dans nos départements : la suradministration, c’est-à-dire la lourdeur des procédures administratives, empêche la concrétisation d’un grand nombre de projets.
Je prendrai l’exemple de la transition énergétique. Nous affichons, en la matière, des ambitions extrêmement fortes. Or il s’avère que des barrages se dressent constamment devant la concrétisation des projets. On sait bien, pourtant, que cette transition énergétique est absolument nécessaire et urgente – dans quelques jours, les électeurs sauront le rappeler à l’ensemble des candidats à la prochaine élection.
Il est donc utile et important d’assouplir un certain nombre de procédures. Nous avons décidé par exemple, en 2012 et en 2014, de valider des projets éoliens offshore ; nous sommes en 2020, et aucun de ces projets n’est concrétisé ! Quand on voit comment, dans les pays voisins, les choses ont évolué, on se dit qu’il y a beaucoup à faire pour alléger les procédures et permettre la réalisation de nos ambitions.
Autre exemple : le photovoltaïque. Il faut bien sûr équiper autant de toitures que possible, mais cela ne sera pas suffisant : le développement de parcs est une nécessité. Des terrains s’y prêtent parfaitement – je pense à d’anciennes décharges ou à des périmètres de protection des captages. Il y a là des espaces qui ne peuvent être consacrés à l’agriculture traditionnelle ; il importe donc que l’on puisse se saisir de ces espaces pour les destiner à d’autres usages. Or, dans les communes littorales en particulier, de nombreux freins sont mis à cette évolution, par la conjonction de réglementations qui se contredisent.
Il est nécessaire, madame la secrétaire d’État, que ces problèmes soient traités ; je regrette, de ce point de vue, que l’amendement que j’ai déposé sur ce sujet ait été déclaré irrecevable.
Je pense utile de répondre à Mme Brulin et je remercie M. Canevet d’avoir apporté sa vision d’élu de terrain confronté aux difficultés rencontrées par certains projets.
Le rapport Kasbarian n’a rien à voir avec la réglementation relative au contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement. Aussi, cet amalgame est assez malvenu. Je précise que le Gouvernement a annoncé un plan d’action post-Lubrizol, qui se déroulera en deux temps : la première étape, ainsi que l’a annoncé Élisabeth Borne le 11 février, consistera à renforcer les prescriptions de fond ; la seconde étape portera sur la gestion des crises, de manière à nous aider à effectuer plus de contrôles sur le terrain.
L’allégement des procédures administratives n’emporte aucune modification du droit environnemental en vigueur. Au contraire, il permettra de libérer du temps pour le contrôle et la conduite des procédures en question.
Il me paraît important d’apporter cette précision parce qu’il ne faut pas mélanger les choses. En Suède, l’instruction administrative des dossiers d’installation ou d’extension de nouveaux sites prend deux fois moins de temps que chez nous, alors que le droit de l’environnement de ce pays est l’un des plus exigeants d’Europe.
Je le répète, nous ne modifions pas le droit de l’environnement, nous souhaitons juste faire en sorte que les délais d’instruction administrative des dossiers s’inscrivent dans la moyenne européenne et utiliser au mieux nos ressources en perdant moins de temps avec les procédures administratives et en envoyant plus d’inspecteurs sur le terrain pour contrôler les installations classées.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 62 rectifié est présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.
L’amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. Labbé et Dantec.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.

Nous proposons effectivement la suppression de cet article, qui modifie et infléchit de manière importante notre corpus juridique. En effet, alors que, jusqu’à présent, le principe de non-rétroactivité s’entendait évidemment pour les installations autorisées, il est prévu que ce principe s’applique également aux instructions en cours.
Nous considérons que la norme n’est pas un obstacle en soi, qu’elle est au contraire un élément de protection des populations, d’accompagnement des entreprises dans leur mise en conformité. En tout cas, on ne peut pas considérer que la réglementation doive sans cesse être assouplie.
L’adoption de cet article pourrait créer une insécurité plus grande pour les entreprises, ce qui n’est absolument pas souhaitable.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié.

Madame la présidente, avec votre autorisation, je dépasserai légèrement mon temps de parole pour présenter cet amendement, sachant que je prendrai très peu de temps pour présenter le suivant, qui est un amendement de repli.
Cet amendement de suppression est aussi un amendement d’agacement.
Nous en venons donc au débat sur la protection de l’environnement. La quasi-totalité des mesures figurant dans le texte constitue une poursuite du détricotage des mesures relatives à la protection de l’environnement et à la démocratie environnementale, à l’opposé des ambitions affichées par le Gouvernement.

L’affaire Lubrizol l’a montré et on l’a dit : le droit des installations classées a toute son importance, et c’est pourquoi les reculs dans ce domaine, couplés au manque de moyens pour contrôler le respect de la réglementation, font courir des risques à la population, à l’environnement, mais aussi à des activités économiques – je pense notamment à l’agriculture.
Il est donc difficile de comprendre, alors que nous sommes encore en attente des résultats des investigations sur l’accident de Lubrizol, que l’on nous propose davantage de recul sur les ICPE, qui plus est dans des délais parlementaires extrêmement courts.
La simplification pour les entreprises est un objectif légitime, et l’on peut parfaitement comprendre leurs besoins de clarté et de sécurité juridiques. Mais cette simplification ne passe pas nécessairement par un recul des exigences de sécurité et de participation concernant les projets.
Le texte renforce le risque de contentieux, ce qui va à l’opposé des objectifs affichés. C’est dans cet esprit que nous proposons, par cet amendement, la suppression de cet article. En effet, la mesure proposée ici vise à faire bénéficier les projets en cours d’autorisation, qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation complète, des délais impartis aux installations existantes pour se conformer aux nouvelles prescriptions en cas de modification de la réglementation.
Cette disposition conduit donc à autoriser des installations qui s’avéreront non conformes dès le jour de leur mise en fonctionnement. On peut s’interroger sur le gain de temps espéré, alors que les installations devront in fine se conformer ultérieurement aux prescriptions.
De plus, comme le souligne l’Association des maires de France, les normes ICPE font souvent, avant leur publication, l’objet de consultations avec les professionnels concernés. Ils sont donc largement informés de leur contenu, avant même la publication des textes, et ainsi en mesure d’anticiper les changements à apporter à leur projet.
On peut aussi légitimement s’interroger sur les risques pour la santé et l’environnement, alors que le contrôle des ICPE existantes est actuellement très insuffisant : il a été réduit de 40 % ces dernières années.
Cet article inscrit également dans la loi le principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre, « sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France […] ».
Cette rédaction semble imprécise et ne paraît donc pas favoriser la sécurité juridique des projets. De plus, elle ne tient pas compte de l’ensemble des intérêts devant être protégés, par exemple ceux de l’agriculture ou de l’environnement, les deux étant aujourd’hui intimement liés.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de refuser ces modifications.
Merci de votre tolérance, madame la présidente !

Je considère, monsieur Labbé, que votre prochain amendement a été défendu.
Sourires.

La commission considère que l’article 21 prévoit une simplification équilibrée qui ne remet pas en cause in fine le niveau de sécurité des installations concernées, puisqu’il ne s’agit que d’une application différée selon des délais définis par arrêté.
Je rappelle en outre que, en cas d’enjeux importants pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, il restera possible d’appliquer immédiatement les nouvelles règles à une installation en cours.
L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je me suis déjà exprimée à ce sujet, et l’avis est donc défavorable.
D’abord, il est faux de dire que, au moment de sa mise en service, l’installation ne respectera pas les normes puisqu’elle devra s’y conformer dans un délai donné. Il faut donc être précis.
Ensuite, le principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, est issu des recommandations du Conseil d’État. Je fais confiance à celui-ci pour sécuriser les textes sur le plan juridique.
Enfin, vous mentionnez le nombre d’inspections des ICPE. L’objet du plan d’action post-Lubrizol qu’a annoncé Élisabeth Borne est bien d’accroître de 50 % le nombre d’inspections. Je pense donc que vous êtes satisfaits sur ce point.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 62 rectifié et 167 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Collin, Gold, Jeansannetas et Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Joël Labbé.

Comme promis, je serai bref !
Cet amendement de repli vise à préserver le droit en vigueur applicable aux ICPE soumises au régime de l’autorisation, à savoir celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

L’amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, Gold et Jeansannetas, est ainsi libellé :
Alinéas 5, 10 et 16
Après les mots :
salubrité publiques
insérer les mots :
, de la protection de l’environnement,
La parole est à M. Joël Labbé.

C’est mon collègue Ronan Dantec – qui vous prie par ailleurs d’excuser son absence – qui est le premier signataire de cet amendement.
Par définition, les installations dont on continue d’alléger les contraintes sont classées pour la protection de l’environnement. Il est curieux de constater que ce motif ne figure pas parmi ceux qui permettent d’écarter la possibilité d’obtenir des délais d’adaptation ou le bénéfice de la non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre.
Or le régime des ICPE existe pour une raison majeure : la complexité de la réparation des atteintes à l’environnement, voire l’irréversibilité de ces dernières.
Tel est l’objet, positif et fort, du présent amendement.

L’amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mmes C. Fournier et Guidez, MM. Kern, Canevet, Delcros, Le Nay et Louault et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 12
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement.
La parole est à Mme Catherine Fournier.

Mon cher collègue Labbé, je vous rassure : ce n’est pas un détricotage du code de l’environnement que je demande à travers cet amendement ; c’est au contraire un engagement de clarté et un engagement de précision que je demande à l’administration.
Pour rendre plus opérantes les dispositions de l’article 21, il convient d’éviter toute ambiguïté sur les conditions d’appréciation de la complétude des demandes d’autorisation ou d’enregistrement.
Cette complétude doit s’apprécier d’un point de vue formel par référence aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement. L’aspect qualitatif des demandes est traité, après la complétude, dans le cadre de l’examen préalable du dossier par les services instructeurs.
Il convient donc de préciser que toute demande est présumée complète dès lors qu’elle répond aux conditions de forme prévues au code de l’environnement.

Avis défavorable sur l’amendement n° 150 rectifié ; sagesse sur l’amendement n° 149 rectifié bis ; avis favorable sur l’amendement n° 28 rectifié bis.
L’avis est défavorable sur l’amendement n° 150 rectifié. La problématique des prescriptions applicables aux projets en cours est identique, qu’il s’agisse d’installations soumises à autorisation ou d’installations soumises à enregistrement. La différenciation entre les régimes d’autorisation et d’enregistrement s’apprécie non pas selon la gravité des dangers encourus, mais dans le fait que les installations en question puissent être en principe gérées selon des prescriptions standard – pour le régime de l’enregistrement – ou non – pour le régime de l’autorisation. Il ne faut pas faire cette confusion.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 149 rectifié, qui induirait une plus grande fragilité juridique. C’est un point dont nous avons discuté avec le Conseil d’État, qui a recommandé d’introduire le motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
Enfin, l’avis est favorable sur l’amendement n° 28 rectifié bis : il convient en effet, ainsi qu’il est ressorti des discussions que nous avons eues, que les demandes d’autorisation ou d’enregistrement ne se résument pas à un dossier sommaire.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 21 est adopté.

L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 513-1 du code de l’environnement est abrogé.
La parole est à Mme Céline Brulin.

Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, qui confère des droits acquis aux entreprises en disposant que « les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration […] ».
Nous nous fondons en cela précisément sur ce qui s’est passé lors de l’incendie de Lubrizol, dont je disais qu’il n’avait été tenu absolument aucun compte.
Par exemple, les entrepôts de Normandie Logistique, où ont brûlé 4 200 tonnes de produits, c’est-à-dire à peu près la moitié des 9 500 tonnes de produits qui sont partis en fumée lors de ce dramatique incendie, n’étaient pas classés ICPE, à la différence de l’usine Lubrizol, alors même qu’ils sont imbriqués dans son périmètre. Pourquoi ? Parce qu’ils bénéficiaient précisément de l’antériorité au regard de la réglementation des ICPE, ces entrepôts préexistant à la loi. C’est d’ailleurs ce que nous ont rappelé les dirigeants de l’entreprise lorsque nous les avons auditionnés dans le cadre de la commission d’enquête. D’ailleurs, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie avait reconnu que Normandie Logistique aurait dû relever du régime de l’enregistrement.
Cet amendement tend à prendre acte de cette situation, et j’espère que vous le soutiendrez.

J’attire votre attention, ma chère collègue, sur la portée de cet amendement, qui irait bien au-delà des seuls établissements Seveso, puisqu’il impacterait l’ensemble des installations classées qui bénéficient de ce mécanisme parmi les quelque 500 000 installations existantes.
Il s’agit d’un dispositif ancien du régime des ICPE qui permet de lisser l’impact dans le temps des changements de nomenclature pour les installations existantes.
Nous comprenons le signal envoyé dans le cadre de l’après-Lubrizol, mais plutôt qu’une suppression brutale de ce mécanisme, il nous semble préférable de réfléchir à des mécanismes de contrôle ou de passage en revue des installations concernées en vue de vérifier l’adéquation entre leurs activités et les prescriptions auxquelles elles sont soumises.
L’avis est défavorable.
L’avis est défavorable, pour les raisons qu’a très bien invoquées Mme la rapporteure.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous avez indiqué, Normandie Logistique était un établissement classé ICPE.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L ’ article L. 522 -2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions de l ’ État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l ’ autorité administrative compétente en matière d ’ archéologie. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 est complétée par les mots : «, dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;
2° Au dernier alinéa du même III de l’article L. 122-1-1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;
3° Le II de l’article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1. »

Avant d’examiner cet article aux finalités contestables, je souhaiterais revenir quelques instants sur les évolutions, depuis plusieurs années, de l’évaluation environnementale, particulièrement malmenée. La réduction de sa portée de son usage est – je le maintiens – le signe d’une régression environnementale sans précédent.
C’est ainsi, d’abord, que les ordonnances de 2016 ont permis la mise en œuvre d’une évaluation au cas par cas au lieu d’une évaluation systématique pour la plupart des projets.
En juin 2018, un décret a réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale. Le Gouvernement a notamment décidé de soustraire les modifications des établissements Seveso à une évaluation environnementale systématique pour les soumettre à une procédure d’examen au cas par cas.
Parallèlement, la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi Essoc, puis la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ont transféré la responsabilité de la réalisation de l’évaluation environnementale au préfet lorsque le projet consiste en une modification des installations et non en une création.
J’ouvre une parenthèse : l’une des leçons que l’on peut tirer de l’incendie de Lubrizol, c’est que de lourdes responsabilités pèsent sur les épaules des préfets. Sans qu’il existe le moindre doute sur leur engagement en faveur de notre sécurité, peut-être faudrait-il mieux répartir ces responsabilités ?
L’établissement Lubrizol a, par exemple, bénéficié de ces assouplissements et, là encore, il nous semble qu’il faut en tenir compte. Non seulement les populations ont été impactées dans leur environnement direct, mais encore cet incendie aura des conséquences s’agissant de leur acceptation des activités industrielles.
Pour ma part, je tiens beaucoup au développement de l’industrie et je suis favorable à ce que l’on favorise des implantations industrielles dans notre pays. Mais pour que cela soit possible, pour que nos populations l’acceptent, encore faut-il montrer très clairement que nous apportons toutes les garanties en matière de protection de l’environnement, de prévention des risques sanitaires et de sécurité.

L’amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mmes C. Fournier et Guidez, MM. Kern, Canevet, Delcros, Louault et Le Nay et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171-8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;
La parole est à Mme Catherine Fournier.

La directive européenne n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement renvoie à une décision au cas par cas l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour certains projets limitativement énumérés.
Le code de l’environnement prévoit que, en l’absence de réponse par l’autorité chargée de cette décision dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation environnementale.
Le délai de réalisation du projet passe alors, en pratique, de quelques mois à plusieurs années. Or une décision implicite, d’une part, ne permet pas au maître d’ouvrage de connaître les enjeux environnementaux identifiés par l’autorité pour émettre sa décision, et, d’autre part, rend très difficile sa capacité à en contester le bien-fondé devant la juridiction administrative.
Sans remettre en cause le mécanisme de décision implicite, le pétitionnaire doit être en mesure d’obtenir rapidement les motifs ayant conduit à cette décision.

Cet amendement va dans le sens d’une plus grande lisibilité pour le maître d’ouvrage. L’avis est donc favorable.
L’avis est défavorable.
D’abord, le code de l’environnement prévoit déjà la possibilité d’un recours contre la décision de soumission à évaluation environnementale. Plus précisément, le VI de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dispose que tout recours contentieux doit d’abord faire l’objet d’un recours administratif préalable.
Ce recours administratif permet un dialogue entre le porteur de projet et l’autorité ayant pris la décision de soumission à évaluation environnementale, explicite ou tacite. En particulier, l’administration devra expliquer à cette occasion les motifs ayant conduit à soumettre à une évaluation environnementale.
L’objet de cet amendement est donc, à ce titre, déjà satisfait.
Ensuite, s’agissant du délai de quinze jours, il nous semble que cette disposition ne relève pas, théoriquement, du domaine législatif. En outre, ce délai est très contraint et, au regard de notre objectif de préservation du droit de l’environnement, nous ne pouvons le valider.

Ce texte ambitionne d’accélérer et de simplifier les procédures. Le délai d’instruction existe déjà, mais, en l’espèce, nous demandons que l’administration s’engage et assume ses propres responsabilités vis-à-vis du pétitionnaire. Faute d’imposer un délai, nous ne parviendrons pas à obtenir un résultat. Si l’on veut effectivement que les porteurs de projet disposent d’une meilleure visibilité, il faut absolument que l’administration s’engage et que chacun prenne ses responsabilités.
Bien sûr, je maintiens cet amendement, d’autant qu’il a reçu un avis favorable de la commission.

À titre personnel, je voterai cet amendement, qui ne vise qu’à accélérer et simplifier les procédures administratives.
Madame la secrétaire d’État, vous nous avez répondu que le pétitionnaire peut toujours aller devant le tribunal administratif.

Il s’écoulera alors plus d’une année avant que son recours ne soit examiné, sans compter les conséquences du mouvement de grève actuel de certains avocats.
L’administration doit répondre aux citoyens ou aux entreprises qui la sollicitent. Fixons un délai pour leur épargner tout recours devant le tribunal administratif. Cette proposition va dans le bon sens.
J’ai très précisément dit le contraire : par recours administratif, j’entends recours devant l’administration pour connaître les raisons de la décision défavorable. Et c’est bien ce que prévoit la réglementation.
Avant tout recours contentieux devant le tribunal administratif, un recours doit être exercé devant l’administration, qui doit donc apporter une réponse qui l’engage. Le présent amendement vise à lui fixer un délai de quinze jours pour indiquer les motifs qui ont fondé sa décision, délai auquel le Gouvernement n’est pas favorable.
Effectivement, et cela a été dit, les préfets assument de nombreuses responsabilités, avec charisme et engagement. Mais il n’est pas dans notre intention de revenir en arrière en matière de droit de l’environnement en leur imposant ce délai de quinze jours.
Vous l’avez compris, tout le sens de ce projet de loi consiste trouver les voies et moyens d’accélérer le traitement des dossiers sans revenir sur la législation en vigueur en matière d’environnement et, surtout, sans créer de risque contentieux.

Il faudrait aussi que l’administration se donne les moyens de répondre en temps voulu.
Je voterai cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 63 rectifié est présenté par Mmes Brulin, Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.
L’amendement n° 101 est présenté par Mme Préville, MM. Houllegatte et Sueur, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mme S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 168 rectifié est présenté par MM. Labbé et Dantec.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié.

On comprend évidemment l’intérêt de regrouper les projets industriels sur un même périmètre ; cela a du sens et les préconisations en la matière du rapport Kasbarian sont pertinentes. En revanche, nous regrettons qu’on ne prenne pas du tout en compte ce que l’on appelle les effets « dominos » ou les effets « cocktail ». Or l’on sait bien que la présence, les unes à côté des autres, de différentes installations non seulement a pour conséquence d’augmenter les risques potentiels, mais encore peut conduire à leur conjugaison. Il faut absolument prendre ce facteur en compte.

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 101.

Cet amendement vise donc à supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 23, qui affirment le principe selon lequel l’évaluation environnementale doit se faire opération par opération. Il nous semble que cela va à l’encontre de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, qui visait justement à mettre en conformité notre droit avec la directive Projets de l’Union européenne, qui interdit ce qu’on appelle le « saucissonnage ».
France Nature Environnement, également opposée à ces alinéas, donne un exemple qui nous semble très parlant : avec la réforme envisagée, la gare, les rails et les voies routières seraient donc considérés comme trois opérations distinctes, dont l’effet cumulatif des impacts ne sera donc pas évalué.
Nous ne sommes donc pas favorables à cette évolution législative, et nous considérons qu’il est indispensable de prendre en compte, comme cela a été indiqué, le cumul des différents projets pour en mesurer le réel impact sur l’environnement. Qu’en sera-t-il lorsque, sur une même zone industrielle – et cet argument sera sans doute encore développé –, on comptera un troisième, un quatrième, voire un cinquième projet supplémentaire ? Comment considérer que ces agrandissements successifs ne doivent pas être appréhendés dans leur ensemble, dans une approche systémique, pour mieux en mesurer le potentiel impact sur l’environnement ?
Une fois de plus, ce qui motive le Gouvernement à agir ainsi nous semble très clair – et l’étude d’impact ne le cache pas – : il s’agit avant tout – et uniquement – de rassurer les industriels et les porteurs de projet. Là encore, l’environnement passe au second plan et nous ne pouvons malheureusement pas nous en satisfaire.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 168 rectifié.

Permettez-moi d’insister, au risque d’être agaçant, mais nous ne devons pas oublier que nous vivons une situation d’urgence climatique et environnementale.
Il s’agit, une nouvelle fois, d’un amendement de suppression de deux alinéas de l’article 23, qui modifient le mécanisme d’actualisation des études d’impact de projets inscrits dans un processus d’autorisation.
Aux termes de cet article, l’autorité environnementale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés, les prescriptions nouvelles formulées ne portent que sur l’objet de la demande concernée et, en cas de procédure d’autorisation environnementale, la consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d’autorisation et pour l’actualisation de l’étude d’impact.
Cela revient donc à affirmer le principe selon lequel l’évaluation environnementale se fait opération par opération. Or le droit européen, dans la directive Projets, interdit le « saucissonnage », c’est-à-dire le découpage par opération ou par législation de l’évaluation de l’impact d’un projet, et ce afin de prendre en compte le cumul des différents projets et de mesurer leur réel impact sur l’environnement.
Il est en effet nécessaire de revoir les prescriptions visant à protéger l’environnement de l’ensemble des activités en cas de nouveau projet, car les impacts de celui-ci se cumuleront avec ceux des installations existantes.
Comme le souligne l’Association des maires de France, cet article ne semble pas prendre en compte le possible « effet domino », c’est-à-dire la propagation des effets d’un accident au-delà du strict périmètre d’une installation, qui est pourtant d’une importance capitale, comme l’a montré l’affaire Lubrizol.
De même, comme l’indique France Nature Environnement, si l’on évalue séparément une gare, les rails et les voies routières attenantes, sans analyser le cumul de ces installations, comment peut-on estimer que l’on prend en compte l’impact réel d’un projet ?
Enfin, les incohérences entre cet article et le droit européen peuvent également fragiliser les projets, qui pourraient être remis en cause pour non-conformité. Cela va, encore une fois, à l’inverse de la recherche de simplification et de sécurité juridique.
Cet article constitue un recul important, et c’est pourquoi nous aussi souhaitons sa suppression.

L’article 23 vient apporter de la lisibilité au droit existant en le clarifiant.
Je suis pour ma part favorable à ce que l’on rende le droit plus lisible pour les porteurs de projet. Il est nécessaire de préciser que l’actualisation d’une étude d’impact et le nouvel examen par l’autorité environnementale ne font pas peser de risque sur les autorisations déjà données. Il s’agit bien de rassurer les industriels et de privilégier plutôt l’implantation de nouveaux projets sur des zones industrielles déjà existantes.
L’avis est donc défavorable.
Je rejoins les explications de Mme la rapporteure.
Il n’est pas question ici de fractionner un projet ou une opération en distinguant, pour reprendre l’exemple donné, les rails, les voies et la gare ; le Conseil d’État l’a d’ailleurs confirmé. On reste dans une logique d’appréciation d’un projet global, inscrit dans un environnement. L’article 23 vise à apporter une précision juridique en disposant que chaque site est responsable de sa procédure, ce qui est important.
J’ajoute que France Nature Environnement faisait partie du groupe de travail qui intervenait en support dans le cadre du pacte productif de la mission Kasbarian, et que nous avions discuté d’un certain nombre de ces sujets. Sur l’article 23, cette fédération n’avait pas mentionné de difficultés dans un premier temps, avant d’y revenir. Nos échanges étant encore en cours, je ne pense pas que sa position soit définitive. Il faut donc se garder de dire qu’elle a tranché définitivement.
L’avis est défavorable.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 63 rectifié, 101 et 168 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 23 est adopté.

L’amendement n° 65, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
La parole est à Mme Céline Brulin.

Avec cet amendement, nous souhaitons revenir sur une disposition également contestable, selon nous, des ordonnances de 2016, qui ont conduit à multiplier le recours aux études d’impact au cas par cas, en lieu et place des évaluations environnementales automatiques.
Dès 2017, dans le cadre de la ratification des ordonnances, nous avions proposé de revenir sur la frontière trop stricte entre « cas par cas » et évaluation automatique.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact, dès lors qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, et, en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère de cumul d’effets avec ceux d’autres projets, ce cumul pouvant s’analyser seulement in concreto.
Ces considérations avaient conduit d’ailleurs le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement, dirigé par Jacques Vernier, à proposer l’introduction d’une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un projet que l’on pourrait qualifier de « petit », non visé par le régime de l’examen au cas par cas, mais situé dans un milieu sensible ou fragile ; tel est manifestement le cas de la prévention des risques industriels, notamment ceux liés aux effets « domino » ou « cocktail ».
L’objet de cet amendement, que nous présentons chaque fois que nous le pouvons parce qu’il nous semble extrêmement pertinent, est donc de mettre la législation en conformité avec le droit de l’Union européenne, pour lequel les seuils ne sont qu’indicatifs, et d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre en œuvre rapidement cette fameuse clause-filet.

Cet amendement, de même que le suivant que présentera M. Dantec, revient à créer une « clause de rattrapage » pour les petits projets qui sont en deçà des seuils fixés par décret, afin de pouvoir, si c’est justifié, les soumettre à évaluation environnementale.
Il prévoit ainsi que sont soumis à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement en fonction de critères « ou » de seuils définis par décret, et non pas en fonction de critères « et » de seuils. De cette manière, l’autorité compétente pourrait saisir l’autorité environnementale afin d’examiner s’il est nécessaire de soumettre un petit projet à évaluation environnementale. L’idée est de dire que ce n’est pas parce qu’un projet est « petit » en taille qu’il n’a pas d’impact sur l’environnement.
La France a fait le choix de fixer des seuils pour déterminer les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, systématique ou au cas par cas. La directive européenne nous le permettait. Nous avons usé de cette possibilité.
La mesure proposée serait potentiellement très lourde pour certains petits projets, agricoles notamment. N’importe quel permis de construire pourrait potentiellement être concerné. Je pense que l’on créerait ainsi davantage d’insécurité juridique.
L’avis est défavorable. Néanmoins, j’aimerais que le Gouvernement réponde sur la manière dont il va s’y prendre pour tenir compte de la mise en demeure adressée par la Commission européenne en mars 2019.
La nomenclature actuelle de l’évaluation environnementale permet déjà de distinguer les seuils et critères selon les types de projets et les milieux dans lesquels ils s’insèrent. C’est par exemple le cas des éoliennes, qui sont systématiquement soumises à évaluation environnementale lorsqu’elles sont situées en milieu marin, quels que soient leurs critères techniques, alors que des critères peuvent être pris en compte dans le cas des éoliennes terrestres.
La modification du code de l’environnement proposée n’apparaissant pas nécessaire, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et Collin, Mme N. Delattre et MM. Jeansannetas et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.
« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.
« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Joël Labbé.

Je présente cet amendement au nom de mon collègue Ronan Dantec, qui en est le premier signataire.
Il a pour objectif de garantir que tout projet ayant des incidences notables sur l’environnement fasse l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux dispositions de la directive Projets, et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui estime qu’un projet, de dimension même réduite, peut avoir de telles incidences et doit donc être soumis à évaluation environnementale.
Il s’agit aussi de répondre à la mise en demeure, en date du 7 mars 2019, de la France par la Commission européenne, laquelle considère que la législation française n’est pas conforme à la directive européenne en ce qu’elle exclut des projets ayant des incidences sur l’environnement de toute évaluation et fixe des seuils d’exemption inadaptés.
Le présent amendement vise donc à se conformer au droit européen et reprend la proposition du rapport du groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé Moderniser l ’ évaluation environnementale, qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage ».
Il permet de soumettre à évaluation environnementale tout projet qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation.
Il permet également à l’autorité compétente, ou au maître d’ouvrage, de saisir l’autorité environnementale afin de procéder à un examen au cas par cas, et donc de sécuriser juridiquement les projets.
Je précise que la mise en demeure de la Commission ne concerne pas l’absence de clause-filet, puisque cela est autorisé dans le cadre du droit européen.
L’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme N. Delattre et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « l’autorité en charge de l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « l’autorité environnementale » ;
3° Le V bis est ainsi rédigé :
« V bis. – L’autorité environnementale ne doit pas se trouver dans une position donnant lieu à conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Joël Labbé.

Le présent amendement vise à garantir l’indépendance de l’autorité environnementale, à l’instar de ce que prévoient les dispositions en matière de plans et de programmes, en la dissociant de l’autorité compétente en matière d’autorisation. Il vise à prévenir les contentieux en la matière et donc à sécuriser les projets.
Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne, laquelle considère que la législation nationale exclut des procédures d’évaluation certains types de projets ayant des incidences sur l’environnement et fixe des seuils d’exemption inadaptés, et que les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes.
L’absence de clause de rattrapage constitue une régression dans l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un recul en matière d’acceptabilité des projets. Elle représente donc un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projet. Or le Conseil d’État, dans sa décision du 8 décembre 2017, a confirmé qu’« une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».
Il s’agit là d’éviter les contentieux, qui risquent de se multiplier si l’on continue d’agir ainsi, car la population accepte de moins en moins ces pratiques. Puisqu’il faut bien réaliser les projets, sécurisons-les au maximum !

L’amendement n° 66, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du II, les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « autorité environnementale » ;
b) Le V bis est abrogé ;
2° Après le 3° du II de l’article L. 122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Il attribue la compétence d’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 soit au ministre chargé de l’environnement, soit à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, soit à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet concerné doit être réalisé. »
La parole est à Mme Céline Brulin.

Je disais précédemment que ce texte donnait une interprétation quelque peu unilatérale du rapport Kasbarian. Nous proposons de rééquilibrer les choses, en prenant en compte des éléments contenus dans ce rapport. Je pense notamment à la nécessité d’acculturer les industriels aux enjeux environnementaux et à la réglementation, ainsi qu’à l’importance de donner véritablement davantage de poids à la consultation du public, ce que certains qualifient de « redevabilité », c’est-à-dire la justification de la prise en compte des avis des citoyens et de l’autorité environnementale.
Je n’y reviendrai pas longuement, mais ce qu’a aussi montré l’accident industriel de Lubrizol, c’est la nécessité de tenir compte des inquiétudes légitimes et des avis des populations, voire de construire avec elles un certain nombre de réponses. Le rapport contient plusieurs propositions allant en ce sens, comme la création d’un portail numérique de suivi des dossiers. Il faut aussi citer la présentation de l’action 9 sur l’accélération des procédures, et ce regret, formulé sur la question plus large de la consultation du public : « La mission constate et regrette une prise en compte trop limitée de l’avis des citoyens lors du processus d’enquête publique. Pour y remédier et sans aller vers des solutions contraignantes, il conviendrait de concevoir et d’envisager des mécanismes plus innovants pour associer davantage les citoyens. »
Nous voulons pour notre part, aller en ce sens, et respecter l’esprit de la convention d’Aarhus en passant d’une simple consultation à une réelle prise en compte de l’avis des citoyens et de l’autorité environnementale.
Nous proposons de prendre en compte la position de cette autorité de deux manières : premièrement, en lui permettant de réagir à la réponse écrite du maître d’ouvrage à son avis en formulant un avis complémentaire à la demande du commissaire enquêteur ; deuxièmement, en obligeant l’autorité chargée de l’autorisation du projet à justifier la non-prise de mesures en cas d’incidences résiduelles négatives significatives.

Ces amendements visent à revenir sur la loi relative à l’énergie et au climat. Ils prévoient en effet que c’est l’autorité environnementale qui doit être compétente en matière de décision de soumission d’un projet à évaluation environnementale. L’objectif est que l’autorité chargée de décider de cette soumission ne soit pas la même que celle chargée de donner l’autorisation.
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait déjà souligné, à l’occasion de l’examen de la loi relative à l’énergie et au climat, que cette solution continuait de poser problème, dans la mesure où elle permettait à un préfet d’être à la fois celui qui décide si un projet doit faire ou non l’objet d’une évaluation environnementale et celui qui est compétent pour autoriser ce projet. Elle avait d’ailleurs proposé que l’autorité désignée pour assurer l’examen au cas par cas des projets dispose également d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet, mais cette modification n’avait malheureusement pas été retenue.
Néanmoins, il ne semble pas utile de revenir sur cette législation récente.
L’avis est donc défavorable.
Le Sénat a effectivement voté, dans le cadre de la loi relative à l’énergie et au climat, une disposition qui permet de trouver un juste équilibre entre autorité environnementale et autorité chargée de l’examen du projet au cas par cas.
Je précise, pour rassurer Mme la rapporteure, qu’un décret précisera les conditions de déport, ce qui permettra de répondre aux questionnements exprimés lors de l’examen de ce texte.
Par ailleurs, concernant la question posée sur la mise en demeure, j’ajoute que c’est bien la loi relative à l’énergie et au climat qui, opérant cette distinction entre autorité environnementale et autorité chargée de l’examen au cas par cas, répond à l’essentiel de la mise en demeure.
D’autres sujets ont été abordés par les auteurs des amendements, notamment à propos des seuils. Il nous a aussi été reproché de ne pas avoir transposé la directive, mais comme il n’y a aucun cas en France, nous devons nous mettre d’accord avec la Commission européenne. Quoi qu’il en soit, le point essentiel est réglé.
L’avis est donc défavorable sur les deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;
2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : «, dans un délai de deux mois, ».
La parole est à M. Dany Wattebled.

Cet amendement vise à obliger l’administration à apporter une réponse lorsqu’elle est saisie de demandes, notamment en matière d’environnement. En effet, nous constatons souvent sur le terrain que l’administration laisse fréquemment les entrepreneurs sans réponse, alors qu’ils ont déjà engagé des frais et mobilisé des ressources pour lancer de nouveaux projets.
Ainsi, dans le Nord, un entrepreneur a demandé à l’autorité compétente s’il devait engager une étude d’impact. Sans réponse de l’État pendant un an, il a décidé d’engager les travaux, et c’est seulement à ce moment-là que l’administration s’est réveillée pour le sanctionner ! Une telle situation est inacceptable, car l’administration doit être au service du citoyen, et non l’inverse.
Il faut obliger l’administration à apporter des réponses dans des délais raisonnables. C’est pourquoi je propose de fixer un délai de réponse, en l’occurrence de deux mois, au-delà duquel le silence gardé par l’administration vaut acceptation en matière environnementale.

Ma première remarque concerne la lisibilité du dispositif proposé par l’amendement : je ne suis pas sûre de comprendre ce que voudrait dire une « acceptation » dans le cas d’une procédure de cas par cas. En effet, l’autorité compétente doit décider si, oui ou non, un projet doit être soumis à évaluation environnementale. Que voudrait donc dire un silence valant acceptation ? Le projet serait-il soumis à évaluation environnementale en cas de silence ?
Deuxième remarque, je rappelle que ce qui justifie la règle du refus implicite en cas d’absence de réponse correspond à des enjeux de sécurité publique et de protection de l’environnement.
Enfin, l’autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le porteur de projet de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
La préoccupation exposée dans l’amendement étant en partie satisfaite, l’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 64, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur peut demander à l’autorité environnementale un avis complémentaire sur cette réponse écrite. Elle le lui communique avant le démarrage de l’enquête publique. » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 122-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise les motivations qui ont conduit à ne pas prescrire de mesures, en cas d’incidences résiduelles négatives significatives. »
La parole est à Mme Céline Brulin.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par Mme Noël, M. Bascher, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Chauvin, MM. Lefèvre, J.M. Boyer, Vial, Chatillon, Perrin et Raison, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 122-…. – Pour les projets ou aux parties de projet ayant pour objet le strict remplacement de remontées mécaniques ou de téléphériques transportant plus de 1 500 personnes par heure, une dérogation par décision de l’autorité compétente peut dispenser le maître d’ouvrage de l’étude d’impact telle que prévue par la présente section. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.

Aujourd’hui, le remplacement d’une remontée mécanique sur un même tracé est considéré comme une création de remontée mécanique, selon la législation en vigueur. Il fait donc l’objet d’une étude d’impact systématique dès que le débit de l’appareil projeté dépasse les 1 500 personnes à l’heure, ce qui est le cas de tous les téléportés créés actuellement.
Néanmoins, le remplacement d’une remontée mécanique s’accompagne bien souvent d’une diminution du nombre de pylônes, compte tenu des progrès de la technique, et n’entraîne pas d’impact significatif supplémentaire sur une zone déjà aménagée.
Lors des consultations et échanges avec l’administration sur le décret de 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN), Domaines skiables de France a proposé de dispenser ce type de projet d’étude d’impact. Cette proposition avait semblé recueillir l’assentiment de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et de France Nature Environnement.
Pourtant, la modification n’a pas été prise en compte dans les textes. Aussi, cet amendement a pour objet de permettre une dispense d’étude d’impact systématique lors du remplacement d’une remontée mécanique.

Les projets de remontées mécaniques transportant plus de 1 500 personnes sont aujourd’hui soumis à évaluation environnementale systématique. Cet amendement vise à déroger à cette systématicité en prévoyant la possibilité de dispenser le maître d’ouvrage d’une étude d’impact pour les projets de remplacement de remontées mécaniques ou téléphériques.
Tout d’abord, le champ des projets soumis à étude d’impact est de nature réglementaire : il est défini dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, à la rubrique 43 pour les projets de remontées mécaniques et de téléphériques.
En outre, il est prévu que les travaux de remplacement à l’identique des remontées mécaniques, qui sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosses réparations, sont exemptés de l’obligation de soumission à évaluation environnementale.
En revanche, les travaux de remplacement qui ont pour effet d’augmenter la capacité de transport de la remontée mécanique peuvent être considérés comme des extensions et, dès lors, soumis à examen au cas par cas dans la grande majorité des cas et, pour les augmentations les plus importantes, à évaluation environnementale systématique.
L’amendement proposé étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Compte tenu du métier que j’exerçais précédemment, je me contenterai de lire la fiche de banc préparée par les ministres compétents.
En premier lieu, je souhaite rappeler que le champ de l’évaluation environnementale relevant du domaine réglementaire, il ne revient pas à la loi de préciser les exemptions en la matière.
En second lieu, sur le fond, les travaux de remplacement à l’identique des remontées mécaniques sont déjà exemptés d’évaluation environnementale, en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans la mesure où ils sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosses réparations. Permettez-moi de citer cet article : « Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. »
Le droit actuel permet donc déjà de répondre pleinement au souhait des auteurs de cet amendement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Oui, madame la présidente. En effet, contrairement à ce qui vient d’être dit, cet amendement n’est pas satisfait, puisque l’évaluation environnementale s’applique pour les téléportés qui ont une capacité supérieure à 1 500 personnes à l’heure, ce qui est le cas aujourd’hui de tous les nouveaux tracés téléportés. La question n’est donc pas réglée du tout.
Selon son intitulé, le présent projet de loi vise à la simplification de l’action publique. On est là en plein dedans, si vous me permettez cette expression ! Imposer une étude d’impact pour une installation ayant moins d’impact que celle que l’on supprime, cela ne me semble pas aller dans le bon sens.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Le Nay et Louault et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la référence : « L. 122-1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 181-8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « lorsqu’elle est requise. »
La parole est à Mme Catherine Fournier.

Cet amendement concerne les études d’impact environnemental.
Sans justification par rapport au droit européen, cette exigence générale d’une étude d’incidence pour tout projet qui ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale constitue une surtransposition. Si l’obligation d’une étude d’incidence peut se justifier, sa généralisation à tous les cas pour lesquels il n’y a pas obligation d’évaluation environnementale semble excessive et injustifiée.
En effet, ce n’est qu’au terme d’un examen au cas par cas que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, qu’il doit faire une étude d’incidence environnementale. Cela conduit le pétitionnaire à supporter deux fois une procédure sans aucune justification légale, tant au niveau européen que national.

Supprimer ici l’obligation d’une étude d’incidence, dans une autorisation qualifiée d’environnementale, ne permettrait pas à l’autorité décisionnaire – le préfet – de prendre la décision d’autorisation ou de refus en toute connaissance de cause. En effet, l’absence d’étude d’impact ne signifie pas que le projet n’a absolument aucune incidence sur l’environnement, et ce d’autant que les seuils relatifs à l’étude d’impact ont été relevés ces dernières années.
Un projet qui n’est pas soumis à évaluation environnementale n’est pas pour autant dénué de tout impact sur l’environnement.
L’avis est donc défavorable.
Je tiens à préciser que le porteur de projet commencera par renseigner un formulaire « cas par cas » comportant les informations nécessaires à l’autorité compétente pour décider si l’étude d’impact est requise. Ce n’est que lorsqu’il est dispensé d’étude d’impact que le porteur de projet devra fournir une étude d’incidence environnementale.
Il n’est donc pas avéré, comme cela est affirmé dans l’exposé des motifs de l’amendement, que le pétitionnaire doit supporter deux fois une procédure. Le formulaire « cas par cas » permettra d’orienter le demandeur vers la procédure qui est la plus adaptée à sa situation, et donc vers une seule procédure.
L’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;
2° À l’article L. 512-7-5, les mots : «, après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : «, et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;
5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’associerai à ce propos ma collègue Nicole Bonnefoy.
Je souhaitais prendre la parole sur l’article 24 pour m’exprimer plus largement sur les dispositions du présent projet de loi relatives au régime des installations classées pour la protection de l’environnement.
Comme vous le savez, madame la secrétaire d’État, le Sénat a créé, à la demande de l’ensemble des présidents de groupes et de commissions, une commission d’enquête pour analyser la gestion des conséquences de l’incendie de l’usine Lubrizol du 26 septembre 2019, et en tirer des enseignements pour l’avenir. J’ai l’honneur d’en être l’un des vice-présidents.
Mon objectif est, à cet instant, non pas de m’exprimer au nom de la commission d’enquête, qui présentera ses conclusions d’ici au début du mois d’avril, mais de vous faire part, à titre personnel, de certaines réserves par rapport à ce projet de loi.
Je regrette vivement le signal qu’envoie le Gouvernement en proposant des mesures guidées par le seul souci de simplifier la vie des industriels. Ces propositions proviennent d’un rapport remis au Gouvernement par notre collègue député Guillaume Kasbarian le 23 septembre 2019, c’est-à-dire trois jours avant l’accident de l’usine Lubrizol.
Ce rapport était guidé par le souci d’alléger les contraintes administratives des entreprises. À mon sens, le contexte et les attentes de la population ont profondément changé depuis : c’est peu dire que la population de Rouen a été très mécontente du manque d’information sur les risques industriels liés, notamment, à la présence d’une industrie chimique puissante au sein même de l’agglomération.
L’article 24 du projet de loi prévoit de limiter le rôle consultatif du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). Aussi, je m’interroge sincèrement sur l’importance qu’accorde le Gouvernement à l’information du public par rapport aux considérations d’ordre économique. D’autres dispositions du projet de loi, aux articles 22, 23 et 25, malmènent également notre démocratie environnementale.
Traiter les procédures de consultation du public comme un fardeau ne contribuera pas à améliorer l’acceptabilité des activités industrielles. Au contraire, les réactions à l’accident de l’usine Lubrizol témoignent d’une véritable crise de confiance dans nos territoires à l’égard de la maîtrise des risques industriels.
Les mesures proposées ne vont pas dans le bon sens. J’observe d’ailleurs qu’elles entrent en contradiction avec les propos tenus devant notre commission d’enquête par plusieurs ministres, qui ont déploré le manque de culture du risque dans notre pays.
En outre, sur la forme, je m’étonne que le Gouvernement propose dès à présent des dispositions sur ce sujet, alors que plusieurs prises de parole avaient laissé entendre que l’exécutif attendrait les conclusions des travaux des deux assemblées avant de proposer des évolutions. Force est de constater que cette méthode n’a pas été respectée.
Permettez-moi donc d’espérer qu’à l’avenir le Gouvernement prêtera plus d’attention aux travaux de contrôle du Parlement et saura mieux mettre en cohérence ses actes avec ses paroles. Nous serons ravis de lui offrir une nouvelle occasion de le faire, lors de la présentation de nos conclusions dans quelques semaines.

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 67 est présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 105 est présenté par Mme Préville, MM. Houllegatte et Sueur, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mme S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 169 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec, Gold et Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 67.

Sans surprise, nous proposons la suppression de cet article qui généralise pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement la faculté accordée actuellement au préfet, en matière d’ICPE autorisées, de décider de ne pas consulter le Coderst ou, pour les parcs éoliens, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Sans faire de longs développements, nous estimons que cet article s’oppose à la démocratie environnementale. Nous devons, au contraire, donner collectivement le signe que nous souhaitons améliorer la transparence, associer et écouter les populations, développer une culture du risque. Que ce soit dans les ex-CHSCT ou dans les Coderst, il existe une véritable culture du risque qui se travaille, qui s’exprime, qui se partage. Amoindrir ces outils revient à se démunir, alors que nous aurions, au contraire, besoin de les renforcer.
Je souhaite, en conclusion, rappeler les réticences du Conseil d’État sur cet article. Celui-ci avait d’ailleurs invité le Gouvernement à préciser dans l’étude d’impact les cas où il envisageait de conserver une information systématique des commissions dans le cadre de dispositions réglementaires.
Faute d’une prise en compte des précisions réclamées par le Conseil d’État, l’adoption de cet article reviendrait à donner un chèque en blanc, ce qui n’est absolument pas souhaitable.

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 105.

M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement de suppression a déjà été excellemment défendu, mais, la pédagogie étant l’art de la répétition, j’ajouterai quelques arguments supplémentaires.
Sourires.

Tout d’abord, l’objectif du Gouvernement est très clair. Comme le précise l’étude d’impact, « dans les cas où le préfet choisira […] de ne pas consulter le Coderst, cela contribuera à raccourcir de plusieurs semaines le délai total d’autorisation d’une implantation industrielle, avec des gains indirects non négligeables sur l’économie du projet ».
Cela signifie que, une fois de plus, on oppose l’économie et l’environnement, alors qu’au contraire, dans notre monde moderne, face aux enjeux et aux risques qui pèsent sur nous, il faudrait apprendre à concilier le développement économique et le respect de l’environnement, et même faire de l’environnement un atout au service de l’économie.
De plus, et notre collègue l’a rappelé précédemment, nous sommes confrontés – on le sait très bien – à trois crises : une urgence sociale, une urgence environnementale et une urgence démocratique. Là encore, on amoindrit les procédures de consultation et de concertation, alors que nos concitoyens demandent de plus en plus à y participer.
Cet amendement de suppression tend donc à maintenir et à renforcer le dispositif existant, qu’il nous paraît important de défendre.
Mme Michelle Meunier et M. Hervé Gillé applaudissent.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié.

Cet amendement est identique aux deux précédents qui ont déjà été excellemment défendus. Mais je vais en « rajouter une couche » avec quelques autres arguments.
Avec cet article, nous allons à l’encontre d’une plus grande association des citoyens aux décisions environnementales. Nous sommes à l’opposé d’une réponse au désir de participation exprimé par la population lors du grand débat.
Cette concertation via les Coderst est très utile, car elle permet à différents acteurs locaux de souligner des enjeux dont l’administration n’a pas nécessairement connaissance et ainsi d’éclairer les décisions du préfet. Le Coderst est la seule instance départementale dans laquelle des représentants d’associations de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement notamment, ou encore des médecins, se réunissent pour évaluer les risques d’un projet pour la santé et l’environnement.
Il est d’autant plus dommageable de se priver de cette concertation que le gain de temps attendu de cette réforme pour les porteurs de projet est très modéré, de l’ordre de deux semaines, de l’aveu même de la commission spéciale dans son rapport.
La seule ambition du texte semble donc bien être l’accélération des projets. Rien ne semble aller dans le sens de la recherche d’un juste équilibre entre le développement industriel, qui est – je le rappelle – nécessaire, et la protection de l’environnement et des riverains.
De plus, cet article semble remettre en cause le rôle du Coderst, auquel de moins en moins de dossiers sont présentés, du fait du basculement de nombreux ICPE vers le régime de l’enregistrement. Il s’agit donc d’un recul majeur pour la démocratie environnementale qui pourrait, par ailleurs, donner lieu à des contentieux – certains sont d’ailleurs déjà en cours et la situation risque de s’aggraver.
Encore une fois, ces mesures peuvent in fine aboutir à un résultat inverse de la logique de simplification recherchée avec ce texte.

Ces amendements identiques visent à supprimer l’article rendant facultative la consultation du Coderst ou, le cas échéant, de la CDNPS. La commission spéciale a considéré qu’il s’agissait d’une évolution permettant une simplification proportionnée, offrant un gain en termes de délai pour la procédure d’enregistrement, de l’ordre de trois à quatre semaines. Le préfet gardera bien sûr la possibilité de consulter la commission compétente, en fonction des enjeux du projet et de la situation locale.
Le représentant de l’État sait apprécier la sensibilité du projet, car, à la suite de la réforme, 70 % des projets soumis à autorisation continuent de faire l’objet d’une consultation de la commission départementale.
L’avis est défavorable.
L’avis est également défavorable.
Je veux d’abord préciser un point : cette modalité d’assouplissement relative à la consultation du Coderst est précisément prévue pour les installations soumises à autorisation. Il est donc faux de dire que c’est parce que l’on a basculé un certain nombre d’installations soumises à enregistrement qu’il y aurait moins de dossiers devant les Coderst. Ce serait plutôt le contraire ! La réalité, c’est qu’il y a moins de dossiers d’extension et d’installation de nouveaux sites, tout simplement. Cet élément explique peut-être la suppression d’un million d’emplois dans l’industrie entre 2000 et 2016.
Exclamations sur les travées du groupe SOCR.
Ensuite, je veux également dire que ces dispositions s’appliquent à des installations qui permettent justement de relever le défi climatique : les éoliennes, les usines de méthanisation et autres installations du même type. Il faut donc éviter d’opposer de manière caricaturale économie et écologie, car cela n’a rien à voir.
Par ailleurs, contrairement à ce vous avez indiqué, l’information du Coderst sera systématique. Cela a été précisé sur la base de la recommandation du Conseil d’État. Je tenais à le redire ici.
Enfin, vous parlez de culture du risque, madame la sénatrice, mais c’est justement de cela qu’il s’agit ! Les dossiers à enjeux, ceux sur lesquels le préfet – les cas d’application ont également été précisés – sera amené à assouplir les prescriptions standard, seront obligatoirement soumis au Coderst. En revanche, si le préfet durcit les prescriptions ou s’il applique les prescriptions standard parce qu’il est face à un dossier qui n’appelle pas de consultation, il ne fera pas appel au Coderst, lequel sera tout de même évidemment informé.
Je crois que, là encore, il faut éviter de sortir de la rigueur juridique : nous modifions non pas le droit de l’environnement, mais les procédures administratives, afin que l’administration se concentre sur les dossiers à enjeux pour l’environnement et perde moins de temps sur des dossiers dont les enjeux sont moindres.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 67, 105 et 169 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Delcros et Le Nay, Mmes Férat et Billon, M. Louault et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 181-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;
La parole est à Mme Catherine Fournier.

Cet amendement – j’ai la prétention de le dire – atténuera peut-être l’insatisfaction exprimée précédemment.
L’article 24 supprime la consultation systématique du Coderst ou de la CDNPS pour des projets relevant notamment des régimes d’enregistrement.
Sans revenir sur le caractère facultatif d’une consultation de ces commissions et conseils pour les demandes d’autorisation environnementale soumises à évaluation environnementale, il est proposé d’ouvrir un droit d’option pour le porteur de projet. Il semble vertueux que celui-ci, qui connaît la sensibilité environnementale de son projet, puisse demander lui-même la consultation du Coderst ou de la CDNPS.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
D’abord, en l’absence de consultation, la commission est en tout état de cause informée.
Surtout, le porteur de projet a déjà la possibilité de solliciter l’administration en vue de la consultation de la commission. Il n’y a aucune raison que le préfet ne donne pas suite à sa demande.
Je ne vois donc pas de raison d’inscrire dans la loi une telle disposition, qui, au surplus, ne relève pas du champ législatif.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 24 est adopté.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 181-9 est ainsi rédigé :
« 2° Une phase de consultation du public ; »
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181-10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :
« – lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2 ;
« – lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.
« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19.
« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas du I et au II de l’article L. 181-31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».
II. – Au 2° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

Madame la secrétaire d’État, comment vous convaincre que nous ne sommes absolument pas dans l’optique d’opposer économie à écologie, précisément parce que nous avons besoin de l’industrie ? Je pourrais même dire que je soutiens Bruno Le Maire lorsqu’il fait remarquer que la crise sanitaire actuelle invite à réfléchir à des relocalisations de productions. Mais comment faire cela sans entendre la crise démocratique qui a été évoquée par mon collègue ? Pour que la relocalisation des implantations industrielles soit acceptée et soutenue par nos concitoyens, il faut les associer ! C’est ce que nous ne cessons de vous dire depuis le début de cette séance…
S’agissant de cet article, nous vous demandons d’entendre la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, qui en demande la suppression. En effet, la participation du public est un élément incontournable de l’élaboration de la décision ; elle est nécessaire à l’amélioration de la qualité des projets et donc à leur acceptabilité par nos concitoyens. Vouloir réduire cette mesure à une simple consultation du public par voie électronique non seulement porte atteinte à la bonne information et à l’expression de celui-ci, mais s’avère surtout incompatible avec l’objectif de simplification.
Je ne développerai pas plus les arguments extrêmement pertinents – vous les connaissez – que nous ont transmis les commissaires enquêteurs. La mesure proposée ne simplifiera et n’accélérera en rien les différents projets. Elle n’apporte d’ailleurs pas davantage de garanties, puisqu’elle n’exclura absolument pas les recours contentieux lourds de conséquences, notamment financières, pour les porteurs de projet.
Cette procédure de consultation fait douter de son efficacité en termes de restitution des observations. Lorsque des observations sont déposées, il est constaté qu’au final l’arrêté préfectoral ne fait état ni de leur synthèse ni de leur exploitation, alors qu’elles sont préparées par le commissaire enquêteur avec toute l’objectivité et l’indépendance requises.
Enfin, chacun sait ici qu’il existe dans notre pays une fracture numérique. La consultation électronique ne permettrait pas à l’ensemble de la population de donner son avis.

M. Joël Labbé. Je n’avais pas prévu d’intervenir à l’origine, mais j’ai été personnellement interpellé sur cette question. Il se trouve que, dans une autre vie, j’ai porté le projet de parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Dans le cadre de l’enquête publique, j’ai collaboré avec une enquêtrice qui a effectué un travail d’une qualité exceptionnelle. Elle avait très bien mené cette enquête qui a abouti d’ailleurs à la création de ce parc naturel. Quand nous en aurons fini avec ce foutu virus, je vous invite d’ailleurs à le visiter cet été !
Sourires.

Voici ce qu’elle m’a écrit : « Je m’adresse à vous aujourd’hui en votre qualité de sénateur au sujet du projet de loi ASAP. Le texte proposé vise en son article 25 à “permettre au préfet de choisir entre une consultation électronique du public ou une enquête publique pour certains projets soumis à autorisation ne nécessitant pas d’étude d’impact environnemental”.
« Outre le fait que le respect de la convention d’Aarhus, ratifiée par la France, est mis à mal par le renforcement des pouvoirs régaliens et discrétionnaires du préfet, la disparition de l’enquête publique aurait de nombreux effets négatifs, notamment : écarter toute possibilité d’expression orale des citoyens et des associations telle qu’elle se pratique lors des permanences des commissaires enquêteurs et durant toute la consultation ; ôter tout moyen de dialogue, d’approfondissement et de saisie d’observations pertinentes en résultant, car impossible par la seule approche dématérialisée ; pour le maître d’ouvrage, faire disparaître la possibilité, prévue par la procédure d’enquête, de répondre aux observations du public ; supprimer l’opportunité de disposer d’un avis indépendant et éclairé, permettant d’améliorer la qualité de la décision administrative et renforçant sa légitimité.
« Par ailleurs, cette recherche de réduction des délais par la suppression pure et simple de l’enquête publique, pourtant facteur de consensus et de contribution à l’acceptabilité par le public des projets, ne fera qu’augmenter le nombre de recours contentieux. »
Elle termine en s’adressant à moi – et à nous ! – : « Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir déposer un amendement pour demander le retrait de cet article qui contrevient au principe de la Charte de la participation du public […] qui dans son préambule précise que “la participation du public est un élément incontournable de l’élaboration de la décision, nécessaire à l’amélioration de sa qualité et de sa légitimité”. »

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 68 est présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 106 est présenté par Mme Préville, MM. Houllegatte et Sueur, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mme S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 170 rectifié est présenté par MM. Labbé, Dantec et Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 68.

Je l’ai déjà dit, nous proposons la suppression de cet article qui vise à remplacer les procédures actuelles par une simple consultation du public par voie électronique.
Pour ne pas allonger inutilement les débats, je voudrais simplement souligner que le Conseil d’État est lui-même extrêmement réservé sur cet article, ce qui donne un argument supplémentaire, me semble-t-il, pour en plaider la suppression.

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 106.

Nous sommes toujours confrontés, lorsqu’il y a des projets d’implantation d’ICPE, à la question de l’acceptabilité par les populations et des conditions de cette acceptabilité, qui reposent justement, selon moi, sur l’enquête publique.
La consultation électronique, c’est en quelque sorte un sondage. On demande aux gens de s’exprimer, etc. Sur des sujets qui sont parfois complexes, la présence du commissaire enquêteur me semble particulièrement pertinente, dans la mesure où celui-ci joue un rôle pédagogique : il est capable d’expliquer la complexité, et parfois ce qui est sous-tendu derrière un projet. Un projet d’ICPE a forcément une part de complexité.
Le dialogue qu’il peut avoir avec les personnes qu’il accueille lui permet à la fois d’être neutre, pédagogue et – c’est un point extrêmement important – indépendant. Supprimer, en quelque sorte, le rôle du commissaire enquêteur et l’enquête publique me semble préjudiciable du point de vue de l’acceptabilité nécessaire des projets d’ICPE par les populations.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 170 rectifié.

J’ai déjà développé une argumentation dans mon intervention sur l’article.
Les projets concernés par cette réduction du champ de l’enquête publique ont souvent de forts enjeux locaux. Pour ces projets, le maintien d’une enquête publique semble nécessaire. Cette procédure est en effet bien plus complète qu’une simple participation par voie électronique. D’ailleurs, cette modalité écarte du projet la partie du public qui n’est pas familière avec l’informatique.
Conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial, à la fois garant de la qualité de la participation et chargé de formuler un avis, l’enquête publique permet une véritable information du public et des échanges avec les citoyens.
De plus, je le redis, on constate que les procédures électroniques, dans un contexte de fracture numérique, rendent difficile la participation de certains citoyens.
Réduire ainsi le champ des enquêtes publiques constituerait donc une régression importante en matière de démocratie environnementale, dont on a plus que jamais besoin.

Ces trois amendements tendent à supprimer l’article 25 du projet de loi, qui est un article de simplification à mon sens bienvenu. Il reprend en effet une recommandation émise par la mission conduite par le député Guillaume Kasbarian, à savoir l’adaptation aux réalités locales.
En effet, il paraît de bon sens de laisser la possibilité au préfet d’adapter la procédure de consultation du public pour les projets dénués d’impact environnemental important. Aujourd’hui, tous les projets soumis à autorisation environnementale doivent faire l’objet d’une enquête publique, même ceux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, c’est-à-dire qui n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement.
Or, comme nous l’ont expliqué les services que nous avons entendus, les retours sur les enquêtes publiques de projets non soumis à évaluation environnementale sont d’ampleur très variable : concrètement, sur certains dossiers, personne ne se déplace. On parle d’autorisations de projets tels que de grandes stations-service ou de gros pressings. Cet article permet au préfet d’apprécier si une participation par voie électronique n’est pas suffisante.
Cette mesure, qui va dans le sens d’une simplification pour les porteurs de projet, me paraît proportionnée au regard de la nécessaire garantie de la protection de l’environnement.
C’est la raison pour laquelle l’avis est défavorable sur ces amendements.
L’avis est également défavorable. Je reprendrai certains points développés par Mme la rapporteure.
D’abord, nous parlons ici de projets qui sont hors du champ de l’évaluation environnementale. Les projets à forts enjeux environnementaux feront de toute façon l’objet d’enquêtes publiques.
Pour ceux qui ne sont pas soumis à l’évaluation environnementale, on distingue ceux qui présentent de forts enjeux locaux, pour lesquels le préfet conservera l’enquête publique, de ceux qui n’induisent pas de tels enjeux, pour lesquels le préfet opérera une procédure de participation par voie électronique.
Je veux également préciser que cette procédure utilise exactement les mêmes documents que l’enquête publique, elle présente donc la même « granularité » et la même rigueur. Ce n’est pas un sondage. La seule différence – et je peux comprendre la réaction des commissaires enquêteurs –, c’est justement l’absence de ces commissaires enquêteurs. La discussion est bien ciblée sur ce sujet, et – je le redis – cette procédure ne porte que sur les dossiers à plus faible enjeu.
Dernier point, il est faux de dire que le Conseil d’État s’oppose à cette procédure ou qu’il émet des réserves. Dans son avis, celui-ci a très clairement estimé que « la possibilité de remplacer au cas par cas l’enquête publique par la participation […] ne soulève pas d’objection d’ordre constitutionnel ou conventionnel, eu égard à l’adéquation entre les enjeux environnementaux des projets et les modes de participation du public ».
Enfin, la procédure n’est absolument pas contraire à la convention d’Aarhus, aux termes de laquelle il faut faire participer d’une manière ou d’une autre le public. C’est très exactement ce que prévoit cet amendement.

Bien sûr, nous sommes les uns et les autres attentifs à simplifier les procédures. En réalité, si tel est notre objectif, nous ne devons pas non plus ignorer certaines professions. Les commissaires enquêteurs nous ont sollicités, et je les ai, pour ma part, reçus. Je comprends leurs interrogations quant à ce projet de suppression de l’enquête publique pour des installations qui sont hors du champ environnemental et de moindre enjeu, comme vous l’avez précisé, madame la secrétaire d’État.
Si nous sommes d’accord avec l’objectif de simplification, il ne faut pas escamoter les relations entre la population et des personnes expertes dans ce domaine. J’ai moi aussi envisagé de déposer un amendement de suppression, comme vous, mes chers collègues. Je ne l’ai finalement pas fait.
Les procédures doivent être comprises dans le temps : c’est ce que nos concitoyens nous disent, et parfois le temps long fait oublier l’intérêt des projets. Je suis pour la simplification, mais en même temps j’entends ces professionnels. Quand on est élu de territoire, on sait combien ceux-ci sont importants pour cette relation presque « intime » entre un projet et une population.
Je ne soutiendrai donc pas ces amendements de suppression, mais je m’abstiendrai. En effet, madame la secrétaire d’État, je pense qu’il y a certainement eu un manque de relations avec cette profession qui apporte beaucoup en termes d’expertise. Pour que les commissaires enquêteurs comprennent mieux votre projet, vous auriez dû avoir des réunions avec la profession afin d’éviter qu’elle ne s’y oppose.
J’insiste : selon moi, il y a un défaut de compréhension. C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai. Je ne suis pas totalement d’accord avec l’idée selon laquelle cette absence de consultation est bienvenue.

Je veux vous faire part d’une interrogation. Dans cet hémicycle, nous sommes tous des élus à avoir été confrontés à ces procédures d’enquête publique – pour ne pas dire que nous les avons subies –, avec les lourdeurs et les contraintes qu’elles peuvent souvent présenter. Cela dit, outre la vertu démocratique du débat, il faut reconnaître que ces enquêtes ont également un côté positif.
La question que je me pose est la suivante : en voulant simplifier, ne risque-t-on pas de compliquer ? Je m’explique : dématérialiser les procédures donne une impression de simplification. Mais il ne faudrait pas qu’en cherchant à simplifier, et donc en évitant le débat, nous nous retrouvions avec une augmentation systématique des recours, justement parce que nous n’aurions pas permis ce débat.
Avant d’exprimer mon vote dans un sens ou dans l’autre, madame la secrétaire d’État ou madame la rapporteure, puisque vous avez dit que la procédure concernée concernait des projets très élémentaires qui méritaient un traitement simplifié, pourriez-vous nous communiquer leur nombre ? S’agit-il de projets qui ne font jamais l’objet de recours, qui ne sont jamais discutés ? Cela permettrait de nous rassurer. Faute de quoi, je le dis très sincèrement, je serai plutôt porté à l’abstention.

Entendre ces deux dernières prises de parole nous donne de l’espoir ! Nous disons de manière consensuelle que ces enquêtes numériques ne répondent pas à la nouvelle démocratie dont nous avons besoin.
Madame la secrétaire d’État, je vous trouve plutôt mesurée dans vos propos, mais, lorsque vous évoquez le million d’emplois perdu dans l’industrie, je vous en prie, ne mettez pas dans la balance la défense de l’environnement ! Vous aviez droit à une erreur dans la matinée, vous l’avez faite !
On entend trop cela. N’oublions pas que l’environnement et la biodiversité sont en péril ! Il ne faut pas tout mélanger. Il est nécessaire – cela a été dit et je suis d’accord – de réindustrialiser notre pays, de se réapproprier des outils de développement économique.
En revanche, de grâce, on doit maintenant, plus que jamais, être extrêmement précautionneux s’agissant des équilibres environnementaux, mais aussi de la démocratie. Consultez nos concitoyens parce qu’ils le demandent ! Comme cela a été souligné, en avançant comme vous le faites, vous allez augmenter les risques de contentieux et, au lieu de simplifier, énormément complexifier la situation, tout en vous opposant frontalement aux populations.

Un élément n’a pas été évoqué : la fracture numérique. Une consultation par voie électronique, ce n’est pas simple. Dans une enquête publique, les documents sont assez volumineux, et en général il y a des plans qui sont importants. Or lire un plan sur un écran, ce n’est pas évident ! Je peux vous dire que je suis le premier à avoir du mal à le faire, peut-être parce que je suis has been, tout comme j’ai parfois des difficultésà m’approprier un dossier complexe de 200 pages sur un PDF qui défile…
De plus, il faut une certaine agilité pour répondre à une consultation numérique, et ce n’est pas donné à tout le monde ! Les anciens maires comme moi ont non pas subi, mais connu les enquêtes publiques qui se tenaient dans des lieux publics. Des personnes qui n’avaient peut-être pas prévu de se déplacer se disaient finalement que, puisqu’il y avait une concertation sur tel ou tel projet et qu’elles étaient devant ce lieu public qu’est la mairie, elles allaient s’y rendre pour rencontrer le commissaire enquêteur qui était à leur disposition.
Alors il est vrai qu’il n’y a peut-être pas beaucoup de monde à ces réunions, mais le commissaire enquêteur est à la disposition du public, qui peut avoir toutes les informations nécessaires et consigner éventuellement des observations sur un cahier.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – M. Joël Labbé applaudit également.

Je suis, comme certains de mes collègues, assez gêné par la position de Mme la secrétaire d’État. Je lis le début de l’exposé des motifs du projet de loi : « Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français […] Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics, plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité […] »
Je ne vois pas en quoi le fait de passer par une consultation numérique au lieu d’aller en mairie et de rencontrer les gens répond à cet exposé des motifs et à ce besoin de proximité.
Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.

Le Sénat vient de créer une mission d’information sur l’illectronisme. Ce problème touche, on le sait, à peu près 27 % des Français. Ainsi, si le numérique peut parfois être une option, il ne saurait constituer une option définitive. En l’espèce, le fait de se déplacer, de pouvoir avoir matériellement accès au dossier ne doit pas devenir optionnel, cela doit rester une possibilité ouverte à tous, et je ne vois pas en quoi cela représenterait un recul.
Parfois, le mieux est l’ennemi du bien ; cet exemple l’illustre parfaitement.

Les projets dont il est, en l’occurrence, question ne sont pas de grands projets.
Ayant été, pendant vingt-deux ans, élue d’une commune, j’ai pu l’expérimenter personnellement : quand on ouvre la procédure, pour certains projets, personne ne se présente en mairie ; il faut raison garder.
Pour ma part, je suis donc favorable à la position de la commission.
Je souhaite tout d’abord apporter une précision : le dossier de consultation restera, sous format papier, disponible à la préfecture ou à la sous-préfecture ; il sera donc bien possible d’y avoir accès. Simplement, par facilité, pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer, il y aura aussi la possibilité d’utiliser des moyens électroniques. Cela répond donc, me semble-t-il, à votre inquiétude sur l’illectronisme.
Ce n’est pas une situation très différente de celle du commissaire enquêteur : soit on se déplace, soit on a accès aux documents par voie numérique ; c’est cumulatif.
En second lieu, on parle effectivement ici de projets sans portée pratique majeure. Certains d’entre vous me suggéraient de ne pas opposer écologie et économie, mais c’est très exactement ce que j’ai dit dans mon propos ! Seulement, je le répète, je parle de procédures administratives, de complexité administrative, non de droit de l’environnement. On ne touche pas, je le redis, à un seul article de ce droit.
C’est d’efficacité administrative que l’on parle. Ce n’est pas par hasard que la France figure au-delà de la centième place, en matière de complexité administrative, dans le classement du World Economic Forum
M. Jean-Claude Tissot s ’ exclame.
C’est donc bien cela que l’on vise, en s’appuyant sur des faits précis et sur des dossiers instruits réellement.
En effet, de quoi parle-t-on ici ? De pressings ou d’imprimeries – non pas de grosses imprimeries, mais d’imprimeries offset ! Il s’agit donc, de manière très factuelle, très basique, non de dossiers à fort enjeu environnemental, mais de cas pour lesquels – peut-être parce que nous avons trop élargi le propos – on additionne les délais. Il est bien question ici de dossiers à l’examen desquels les Français ne participent pas, parce qu’ils n’y voient pas d’intérêt.
Je rejoins votre avis sur la nécessité d’avoir un commissaire enquêteur de qualité, en particulier lorsque le projet est complexe, qu’il emporte des conséquences environnementales que l’on peine à évaluer ou qu’il porte sur des zones fragiles ; c’est évidemment essentiel et ces professionnels font un travail remarquable. Toutefois, accordez-le-moi, un pressing ou une imprimerie offset ne méritent probablement pas d’utiliser le temps précieux de ces professionnels.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 68, 106 et 170 rectifié.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas les amendements.

L’amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, Collin, Gabouty, Jeansannetas et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après les mots :
sur l’environnement
insérer les mots :
, sur la santé humaine
La parole est à M. Joël Labbé.

Avec beaucoup de regret – ainsi va la démocratie… –, je propose, au nom de mon collègue et complice écolo, Ronan Dantec, un amendement de repli par rapport au précédent. Je lui souhaite un sort meilleur…
Cet amendement vise à permettre au préfet de recourir à l’enquête publique lorsqu’un projet faisant l’objet d’une procédure d’autorisation, mais n’étant pas soumis à évaluation environnementale, est susceptible d’avoir un impact sur la santé humaine.
Les enjeux socioéconomiques peuvent être pris en considération dans ce cadre, mais l’impact sur la santé humaine nous semble constituer un intérêt au moins aussi fondamental à protéger.
Compte tenu de la technicité de certains dossiers, l’intervention d’un commissaire enquêteur indépendant permettra de mener une consultation du public qui soit plus objective et éclairante que la simple participation par voie électronique.

La commission spéciale souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Cet amendement n’est pas nécessaire, parce que le code de l’environnement prend déjà en compte la santé humaine dans la définition des impacts environnementaux.
Votre amendement est donc satisfait, monsieur le sénateur. Pour cette raison, le Gouvernement en demande le retrait et, à défaut, émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2124-3 est supprimé.
…. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;
2° À la première phrase de l’article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Le présent amendement vise à simplifier la participation du public aux procédures relatives au domaine public maritime.
Le domaine public maritime naturel est l’un des plus vastes domaines de l’État. Les préfets de département ont la charge d’administrer ce domaine en veillant à concilier ses différents usages et en intégrant au mieux les enjeux environnementaux. Les préfets ont été nombreux à mettre en évidence le besoin de simplifier certaines procédures, notamment celles qui sont liées à la délimitation ou aux concessions d’utilisation. Cet amendement vise à répondre à ces attentes, également relayées, pour ce qui concerne les concessions, par les collectivités locales qui administrent les ouvrages de protection de la population face aux risques littoraux.
En outre, les auteurs d’un rapport récent sur la mise en œuvre des plans d’action et de prévention des inondations appellent de leurs vœux une mise en œuvre rapide de la mesure de simplification relative aux concessions.
Cet amendement tend également à sécuriser les procédures de création de servitudes de passage de piétons sur le littoral ; l’objectif est de renvoyer ces créations à la procédure d’enquête publique prévue par le code des relations entre le public et l’administration, moins lourde que la procédure actuelle, rattachée au code de l’expropriation. Environ 5 800 kilomètres linéaires de sentiers du littoral sont ouverts en 2019 sur l’ensemble des côtes françaises, dont 1 530 kilomètres au titre de la servitude de passage des piétons. Avec cette mesure, le Gouvernement entend consolider la procédure de création de plus de 1 000 kilomètres linéaires de sentiers, qui sont encore à l’étude, afin de garantir l’accès des Français au rivage de la mer.
Cet amendement a donc pour objet d’introduire plusieurs simplifications, qui correspondent aux attentes des parties prenantes et qui seront bénéfiques à la gestion du domaine public maritime.

La commission spéciale, n’ayant reçu cet amendement gouvernemental que lundi dernier, c’est-à-dire assez tardivement, s’en remet à la sagesse du Sénat.
Néanmoins, je précise que, à titre personnel, j’y suis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 25 est adopté.
Après la sous-section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous -section 4
« Installations de production d ’ électricité à partir de l ’ énergie mécanique du vent
« Art. L. 181 -28 -2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1. »

Je veux remercier Mme la rapporteure et les membres de la commission spéciale d’avoir bien voulu accepter, à l’unanimité, je crois, l’intégration de cet article nouveau dans le texte. Je remercie également Mme la secrétaire d’État de ne s’être pas opposée à cet ajout.
Cette disposition est très attendue de nombreux maires. En effet, il arrive fréquemment que des entreprises souhaitant implanter des éoliennes contactent directement des propriétaires de terrain et passent, le cas échéant, avec ces derniers des accords ou des préaccords, sans que l’autorité municipale soit mise au courant. Par conséquent, certains maires découvrent par hasard ou dans la presse l’existence de projets d’installation d’éoliennes sur leur commune.
Je le précise d’emblée, cet article n’aura pas d’effet sur la capacité à s’opposer à un projet, dans les procédures existantes. Il permettra simplement au maire d’être informé, puisque, quinze jours avant une demande d’autorisation, le maire sera nécessairement prévenu. Cette information favorisera la réflexion sur de tels projets et la mise en œuvre des procédures existantes.
Je remercie donc tous ceux qui ont bien voulu souscrire à cette mesure, qui satisfera, je crois, les maires. Je remercie en particulier M. le président de la commission spéciale de ne pas avoir invoqué l’article 45 de la Constitution, que je crains toujours un peu, car on ne comprend pas toujours bien pourquoi il nous tombe sur la tête dans certains cas et pas dans d’autres…
Sourires.
L ’ article 25 bis est adopté.
I. – L’article L. 181-30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3.
« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;
2° L’article L. 425-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 425-14, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Le 1° est complété par les mots : «, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ».

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 69 est présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 107 est présenté par Mme Préville, MM. Houllegatte et Sueur, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mme S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 171 rectifié est présenté par MM. Labbé et Dantec.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 69.

J’avoue ne pas bien comprendre cet article, même si je vois bien qu’il concerne des cas assez particuliers.
Le fait de permettre, en gros, à des industriels de commencer des travaux à leurs risques et frais ne me semble pas être une idée particulièrement lumineuse ni relever de la simplification que vous prônez.
En outre, cela peut occasionner un impact environnemental, puisque des travaux commencés, puis refusés, peuvent nuire à l’environnement. Cela ne nous semble absolument pas judicieux.

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 107.

À nous non plus, cet article ne semble pas judicieux.
On pourrait d’abord, en préambule, se demander si cette disposition n’aurait pas plutôt vocation à figurer dans le futur projet de loi décentralisation, différenciation, déconcentration, dit « 3D », au titre de la déconcentration.
Surtout, je crains que cette mesure ne fasse peser, sur nos préfets, un poids énorme. En effet, quand le projet sera engagé et que des financements auront été mobilisés, ils risquent de subir un chantage à l’emploi, l’investissement risquant de ne pas être fructueux, tout cela, bien évidemment, au détriment de l’environnement.
Je ne m’étendrai pas davantage sur l’argumentation, mais nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer cet article.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 171 rectifié.

Il a été très bien défendu.
Toutefois, j’ajoute que cette mesure ne va pas dans le sens de la sécurisation des projets industriels, logique pourtant suivie par le texte. Le rapport de la commission spéciale le souligne, « il s’agit […] d’une complexification, [puisque cette mesure] se traduit par une troisième décision administrative du préfet ».
En outre, cela nuira à la lisibilité des procédures pour nos concitoyens, qui pourront voir des travaux se lancer avant même que la décision sur le projet ne soit rendue.
Ainsi, eu égard au risque que cette disposition fait peser sur l’environnement et à la complexité nouvelle qu’elle engendre alors que l’on cherche à simplifier, nous souhaitons supprimer cet article.

La possibilité offerte au préfet d’autoriser un démarrage anticipé des travaux est strictement encadrée : l’autorisation ne sera accordée qu’aux frais et risques du pétitionnaire, qui demandera donc cette dérogation en connaissance de cause ; cela concernera des endroits où il n’y a pas de problème d’espèce protégée ni de défrichement ; en outre, cela ne sera possible qu’à condition que les deux consultations du public aient été dissociées et que le permis de construire ait donné lieu à une consultation du public mentionnant le démarrage anticipé.
Cette recommandation est, à mon sens, de nature à conforter les projets industriels, via l’adaptation des procédures par les autorités locales, tout en garantissant une protection importante de l’environnement, dans le respect du droit à l’information du public.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d ’ État. Je veux rappeler les conditions d’application de cette mesure, qui sont très strictes
M. Jean-Claude Tissot s ’ exclame.
À quels cas cette disposition correspond-elle ? À des projets sur lesquels, disons-le très simplement, nous avons été mis en concurrence avec, sans citer le nom de l’entreprise, l’Allemagne, qui offre, contrairement à la France, cette possibilité.
En effet, dans des zones totalement artificialisées – il ne s’agit en aucun cas de zones naturelles –, certains industriels souhaitent commencer à construire, pour des raisons de délai de livraison de leurs produits. Ils mettent alors en concurrence différents sites – en l’occurrence, si c’est la France contre l’Allemagne, c’est une question non pas de coût du travail, mais d’accès au marché ou à des infrastructures ou à de la main-d’œuvre de qualité ; il ne s’agit pas du tout de rechercher le moins-disant social ou environnemental. Les industriels acceptent donc de prendre ce risque, parce qu’ils font face à des enjeux de concurrence sur leur marché, mais ils trouvent que cela va trop lentement en France et nous demandent à pouvoir aller un peu plus vite, en étant prêts à payer pour cela.
Je le répète, l’Allemagne le permet, la France, non. Par conséquent, pour le dire très concrètement, nous perdons ces projets. Je voulais donc partager cette considération avec vous.
Il est évident que des garanties sont prévues pour permettre la mise en œuvre de projets industriels impliquant une très grande rapidité d’exécution sans pour autant créer de préjudice pour l’environnement.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements.

Nous connaissons, madame la secrétaire d’État, votre profond attachement à l’État, au service public et aux procédures publiques et nous l’apprécions.
Nous sommes donc quelque peu étonnés par l’explication que vous venez de donner. En effet, il est quand même très difficile d’expliquer que l’on va inscrire dans la loi que des travaux peuvent être réalisés avant d’avoir été autorisés. C’est étrange ! C’est contraire à toutes les règles en vigueur !
J’ajoute que cela constituera un précédent pouvant avoir de lourdes conséquences. En effet, d’un point de vue pratique, lorsque la construction aura été entamée, voire quand l’édifice sera achevé, que fera-t-on si le projet n’est pas autorisé ? On se retrouvera devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel, lesquels jugeront qu’il faut démolir ; mais on ne démolit jamais !
Vous connaissez le cas fameux de ce président de conseil départemental qui s’est trouvé, pour la construction d’une déviation, dans cette situation : il avait fait la moitié de la déviation, mais n’avait pas l’autorisation de la continuer. Que doit-on alors faire ? Je ne crois pas que cela conforte le caractère cartésien de nos procédures, auquel nous sommes tous attachés.
J’ajoute, pour terminer, madame la secrétaire d’État, que votre argument se fondant sur ce qui se passe dans des pays étrangers, d’ailleurs amis, comme l’Allemagne, ne me rassure pas. S’il y a des endroits, sur la planète, où l’on peut construire en faisant fi de toute autorisation, devrons-nous nous aligner ? Nous entretenons aussi des relations positives, même en cette période de grande crise, avec la Chine. Or vous connaissez, je pense, les procédures de permis de construire en Chine : cela dure un jour et il n’y a rien à attendre avant de commencer à construire !

Mme Catherine Fournier. Pour la construction d’un hôpital, par exemple ?
Sourires.

Dans ce cas, c’est justifié, ma chère collègue, par l’urgence.
Je ne suis donc pas sûr qu’il faille s’aligner sur les pays les moins-disants en la matière.

Je veux venir en soutien à l’explication de Mme la secrétaire d’État, pour avoir connu un cas similaire en tant que président d’une communauté de communes.
Nous avions reçu une demande d’implantation d’une entreprise américaine, devant déboucher sur la création de 600 emplois. Or, vu la lourdeur et la longueur des procédures administratives, l’entreprise s’est installée à quinze kilomètres, juste de l’autre côté du Rhin, …

… et elle a créé ses 600 emplois là-bas. Nous avions, nous aussi, un site prêt à accueillir cette entreprise, donc nous avons perdu 600 emplois.
Par conséquent, je soutiens la position de Mme la secrétaire d’État.
Je me suis mal fait comprendre : il n’est pas question de permettre de commencer les travaux sans autorisation.
Je redis les conditions d’application de cet article : information préalable du public, démarches effectuées aux frais et risques du demandeur, permis de construire délivré – il y a donc évidemment une autorisation accordée – et absence d’atteinte irréversible à l’environnement, ce qui implique d’examiner tous les aspects : s’il y a une espèce protégée, s’il s’agit d’une zone humide ou s’il y a un défrichement, c’est non.
En outre, l’Allemagne sera sans doute ravie d’être comparée à la Chine, mais je ne pense pas, permettez-moi de le souligner, que nous parlions exactement des mêmes exigences, environnementales ou d’autre nature – d’ailleurs, l’obtention d’un permis de construire en Chine ne se fait quand même pas en une journée, je peux vous le certifier pour connaître également un peu le sujet –, puisqu’elle est soumise au même droit de l’environnement que la France. En effet, je le rappelle, ce droit est largement élaboré à l’échelon européen ; il s’applique donc de la même manière et les exigences sont de même nature.
Une fois de plus, il s’agit ici d’enjeux de procédures administratives, d’organisation de l’administration. D’ailleurs, cela s’inscrit exactement dans le cadre des titres Ier et II : simplifier, déconcentrer, diminuer le nombre de commissions quand celles-ci n’ont plus lieu d’être – elles ne se réunissent plus, ne correspondent plus à un besoin ou peuvent être fusionnées avec d’autres –, bref simplifier les processus administratifs.
Je le répète, il ne s’agit pas de toucher au droit de l’environnement, lequel est, j’y insiste, très déterminé par le droit européen, donc, même si nous souhaitions y toucher, nous ne le pourrions même pas.
Voilà ce que je voulais préciser sur cet article.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 69, 107 et 171 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 26 est adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Canevet et Kern, Mme Vérien, MM. Mizzon, P. Martin, Moga et Le Nay, Mme Doineau, M. Delcros, Mme Saint-Pé et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques. »
La parole est à M. Claude Kern.

Je présente l’argumentaire que m’a transmis Michel Canevet à l’appui de cet amendement, qui vise à remédier à des suradministrations ou à des lourdeurs administratives relatives à des situations concrètes.
En 2017, la communauté de communes du pays de Landivisiau a remporté un appel à projets pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un nouveau bâtiment destiné à accueillir des activités équestres.
Pour des raisons topographiques et d’accès au bâtiment, la communauté a dû déplacer de 120 mètres, sur le même site, l’emprise du bâtiment. En conséquence, l’administration a considéré qu’il fallait remonter un dossier, dans le cadre d’un nouvel appel à projets lancé en 2019, puisque les règles changent en permanence, ce qui a conduit à une nouvelle instruction par les services de l’État ; c’est une forme de suradministration…
Résultat : le bâtiment a été inauguré le 1er février dernier sans toiture photovoltaïque, alors que le point de raccordement et les caractéristiques techniques du projet n’ont guère été modifiés.
Des projets sont ainsi remis en cause, ce qui conduit à mobiliser d’importantes ressources humaines pour refaire constamment ce qui a déjà été examiné.
Si nous souhaitons concrétiser nos ambitions en matière de production d’énergies renouvelables, le bon sens doit revenir dans nos pratiques administratives, comme l’indique l’intitulé de ce texte, « accélération et simplification de l’action publique ».
J’ai cosigné cet amendement parce que, comme nombre de mes collègues ici présents, je suis, malheureusement, confronté régulièrement à de telles situations.

L’amendement n° 164 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 48 rectifié ?

Si l’objectif de cet amendement est louable, puisqu’il vise à mieux articuler différentes autorisations issues du code de l’urbanisme et du code de l’énergie, il pose plusieurs difficultés.
D’abord, il tend à priver de leurs attributions non seulement les maires, puisqu’une autorisation modifiant la construction au titre du code de l’urbanisme n’aurait plus nécessairement d’incidence sur l’autorisation permettant l’exploitation au titre du code de l’énergie, mais encore les préfets, qui ne disposeraient plus d’un pouvoir d’appréciation dans la délivrance de l’autorisation d’exploitation prévue par ce second code.
Ensuite, l’amendement n° 48 rectifié n’est pas borné, de sorte que l’autorisation demeurerait acquise sans contrainte de temps.
Enfin, le dispositif aurait sans doute peu d’applications concrètes puisqu’il pose comme condition que les caractéristiques techniques de l’installation soient identiques. Or la modification de la construction a très souvent un effet sur les caractéristiques de l’installation.
Ainsi, le dispositif pourrait bien s’avérer moins simplificateur qu’il n’y paraît et donner lieu à des incompréhensions, voire à des contentieux.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La localisation d’une installation produisant des énergies renouvelables est un élément fondamental dans la décision d’autoriser ou non un projet, notamment pour déterminer les impacts sur l’environnement ou sur le voisinage.
L’article L. 311-6 du code de l’énergie prévoit déjà que les installations dont la puissance est inférieure à un seuil défini par décret sont réputées autorisées. Par conséquent, pour celles-ci, aucune démarche n’est à accomplir. En pratique, la plupart des installations sont réputées autorisées ; seules les plus grosses installations, dont la puissance dépasse 50 mégawatts, ne le sont pas, compte tenu de l’enjeu qu’elles représentent.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Cela dit, comme je suis troublée par le dossier que vous mentionnez, monsieur le sénateur, je vous propose que l’on en fasse l’autopsie, car cela me paraît effectivement très perturbant et je comprends votre frustration.

Je remercie Mme la secrétaire d’État de ses explications, car cela a en effet occasionné une frustration pour mon collègue Michel Canevet.
Je ne souscris pas tout à fait à l’explication de Mme la rapporteure, car il s’agit d’une modification non du bâtiment, mais de son implantation.
Cela dit, comprenant que Mme la secrétaire d’État va s’occuper de ce dossier, je retire, au nom de mon collègue Michel Canevet, malheureusement absent pour cause d’audition, cet amendement.
Les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ne sont pas applicables aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.

L’amendement n° 70, présenté par Mme Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Céline Brulin.

Notre collègue Jérôme Bignon, qui est écologiste dans l’âme, m’a demandé de soutenir cet amendement. Il faut dire que, sur ce sujet, nous sommes sur la même ligne.
L’article 26 bis revient sur des avancées importantes pour les zones humides adoptées dans la loi portant création de l’Office français de la biodiversité (OFB), modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
La qualification en zone humide entraîne la soumission au régime de l’autorisation environnementale et permet donc une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.
L’article 23 de la loi OFB, issu justement d’un amendement de Jérôme Bignon, a permis d’améliorer considérablement la protection des zones humides, en prévoyant que les deux critères retenus pour définir celles-ci devront être pris en compte alternativement, et non plus cumulativement, ce qui permettra de revenir sur une décision du Conseil d’État qui réduisait de manière considérable le nombre de surfaces considérées comme zones humides.
Or l’article 26 bis du présent projet de loi prévoit que les projets en cours, dont la demande a été déposée avant la publication de la loi, ne soient pas concernés par cette nouvelle définition des zones humides. On peut comprendre que l’on recherche la sécurité juridique de ces projets. Mais, si cet objectif est louable, on sait que les zones humides constituent un enjeu majeur en termes de biodiversité et fournissent des services environnementaux essentiels en termes de protection des ressources en eau et de captation du carbone.
Il est important, au regard de ces enjeux, que la nouvelle définition des zones humides s’applique également aux projets en cours. Il convient donc de soutenir cet amendement de suppression pour éviter la destruction d’un nombre pour l’instant inconnu, mais non négligeable, de milieux humides.
À cet égard, je salue la position du Gouvernement sur l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.