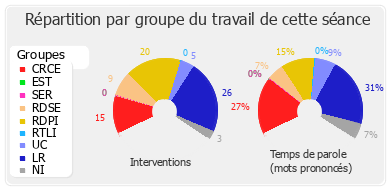Séance en hémicycle du 8 juin 2011 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Dépôt de documents
- Contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre (voir le dossier)
- Discussion en deuxième lecture et adoption définitive d'un projet de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Conventions internationales (voir le dossier)
- Bioéthique (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le Premier ministre a communiqué au Sénat, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, trois avenants aux conventions conclues entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds consacrés à la mise en œuvre des actions arrêtées au titre du programme des investissements d’avenir, et, en application de l’article L. 612-12 du code monétaire et financier, le rapport annuel de l’Autorité de contrôle prudentiel.
Les premiers ont été transmis à la commission des finances ainsi que, respectivement, à la commission des affaires sociales, à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, et à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Le dernier a été transmis à la commission des finances.
Acte est donné du dépôt de ces documents. Ils sont disponibles au bureau de la distribution.

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (projet n° 441, texte de la commission n° 537, rapport n° 536).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à vous présenter les excuses de mon éminent collègue ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet. Comme vous le savez, celui-ci devait personnellement défendre ce projet de loi hier soir, mais il est aujourd’hui retenu à Bruxelles par la réunion des ministres de la défense de l’OTAN.
Cela me vaut le privilège insigne de défendre, au nom du Gouvernement, ce texte devant la Haute Assemblée.
Aujourd’hui, confrontée à un monde de plus en plus imprévisible et à des contraintes budgétaires croissantes, l’Europe doit, plus que jamais, être en mesure de développer ses capacités militaires dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.
En transposant les directives sur, d'une part, les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et, d'autre part, sur la coordination des procédures de passation de marchés des travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, le texte qui vous est soumis aujourd’hui permet de nombreuses avancées.
Actuellement, le marché européen des produits liés à la défense est fragmenté en vingt-sept régimes nationaux, dont les procédures, les champs d’application et les délais d’obtention des licences d’exportation sont très hétérogènes. Chaque pays fait ce qu’il veut en matière de contrôle des exportations d’armement comme en termes de passation de marché.
Ces vingt-sept régimes représentent autant de procédures, de délais, et donc de coûts pour les entreprises comme pour les administrations. Ce sont aussi autant d’obstacles à la construction d’un marché européen pour les équipements de défense.
Demain, après votre vote, que j’espère positif, nous pourrons mettre un terme à cette mosaïque en transposant deux directives communautaires et en réformant le régime de contrôle des importations et exportations entre la France et les pays tiers.
L’Assemblée nationale a apporté quelques modifications complémentaires au texte issu des travaux de la Haute Assemblée.
Monsieur le président de la commission, vos préoccupations ont été suivies, puisque l’Assemblée nationale a repris et validé toutes les préconisations du Sénat, en particulier le système instaurant une quasi-préférence communautaire. Le Gouvernement observe, à cet égard, une totale convergence de vue entre les deux assemblées sur le projet de loi.
S’agissant du volet « transferts intracommunautaires », d’abord, les précisions apportées ont été essentiellement rédactionnelles.
Les changements les plus notables ont été introduits par le Gouvernement, qui a souhaité perfectionner le dispositif qu’il avait introduit au Sénat à l’article 2 pour ce qui concerne les poursuites en cas d’infraction au régime des autorisations.
S’agissant du volet « marchés de défense et de sécurité », ensuite, l’Assemblée nationale a apporté deux compléments utiles au texte issu du Sénat, qui vont dans le sens d’un renforcement du principe de fermeture de ces marchés de défense et de sécurité aux opérateurs de pays tiers à l’Union européenne, renforcement que vous appeliez de vos vœux.
En effet, un premier complément est introduit au niveau du recours à la procédure d’ouverture des marchés à des opérateurs économiques de pays tiers. Selon le texte issu du Sénat, les États membres conserveront la possibilité de décider si, oui ou non, leurs pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser des agents économiques de pays tiers à participer aux procédures de marché. Toutefois, les États membres devront fonder leur décision sur des considérations limitativement définies. « L’obtention d’avantages mutuels », qui n’avait pas été mentionnée par le Sénat, a été ajoutée.
Un second complément a été inséré au niveau de l’examen des offres. Selon le texte issu du Sénat, lors dudit examen, les pouvoirs adjudicateurs pourront prendre en compte le fait que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie du marché sont localisés sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. L’Assemblée nationale a également prévu la prise en compte de « considérations environnementales ou sociales ».
Mesdames, messieurs les sénateurs, votre commission des affaires étrangères, lors de ses travaux, a accueilli favorablement l’ensemble des ajouts apportés par l’Assemblée nationale. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement plaide pour une adoption conforme du texte.
Nous sommes en effet tenus par le calendrier, tout particulièrement par les délais de transposition. Si nous nous permettons de demander au Parlement une accélération de ses travaux, nous nous sommes également mis en situation de pouvoir publier, sans tarder, les décrets d’application. Je peux dire que leur préparation est déjà bien avancée.
Ainsi, aucune complexité supplémentaire n’a été introduite dans le décret relatif aux transferts intracommunautaires. Pendant la période transitoire, du 30 juin 2012 à la fin de 2014 au plus tard, le maintien de la procédure en deux temps, c'est-à-dire agrément préalable et demande d’autorisation, sera atténué par la mise en œuvre de la procédure dite « regroupée » pour traiter simultanément chaque agrément et demande.
Près de la moitié des demandes de licence individuelle, les moins sensibles, devrait ainsi pouvoir bénéficier de cette procédure.
Par ailleurs, même pendant la période transitoire, les autorisations d’importation et de transit intracommunautaires seront supprimées et les licences générales instaurées, conformément à la loi de transposition de la directive.
En outre, le décret « marchés de défense et de sécurité » a été élaboré conjointement par les services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministère de la défense et des anciens combattants et du ministère de l’intérieur, réunis au sein d’un groupe de travail, et a été amélioré à la suite des consultations des industriels de la défense. Il vise à transposer fidèlement la directive 2009/81/CE et en exploite toutes les marges de manœuvre. Le délai de transposition, dont l’échéance est fixée au 21 août 2011, devrait ainsi pouvoir être respecté.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, en transposant ces deux directives, adoptées par le Conseil et le Parlement européens lorsque la France assumait la présidence de l’Union européenne, nous avons eu à cœur de préserver à la fois les intérêts de l’État et de nos armées et ceux des entreprises de défense et de sécurité de l’Union européenne.
Je sais que vous êtes à l’écoute de tous ces acteurs pour établir un texte équilibré, ce à quoi, nous sommes, me semble-t-il, parvenus. Je vous invite par conséquent à l’adopter conforme afin de contribuer à bâtir l’industrie française et européenne de défense de demain et de répondre aux besoins de nos forces armées.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Aymeri de Montesquiou applaudit également.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture le projet de loi « paquet défense », que nous avons adopté en première lecture en mars dernier. Les deux directives concernées doivent être transposées avant, respectivement, les mois de juin et août 2011.
La première directive, dite « TIC », pour « transferts intracommunautaires », simplifie les conditions des transferts de produits liés à la défense au sein de l’espace économique européen. La seconde directive, dite « MPDS », pour « marchés publics de défense et de sécurité », harmonise les règles des marchés publics pour permettre une meilleure transparence et plus de concurrence dans le processus d’achat des équipements de défense.
La transposition de la directive TIC a donné lieu à un important travail de modernisation de notre régime d’autorisation, qui remontait au décret-loi de 1939 et n’avait pas beaucoup évolué depuis 1955. Cette remise à plat va nous permettre de disposer d’une réglementation beaucoup plus efficace. L’actuel système de double autorisation – agrément préalable pour négocier et signer un contrat, d’une part, autorisation d’exportation, d’autre part – sera remplacé par une licence unique. Il y aura trois types de licence de transfert suivant la sensibilité des matériels et des destinataires. Les autorisations d’importation et de transit dans le cadre intracommunautaire seront supprimées.
Bien qu’harmonisé en Europe sur le plan des procédures, le nouveau régime d’autorisation restera de la seule compétence des États membres : en France, il s’agit d’une compétence du Premier ministre, assisté d’une commission, la CIEEMG, la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre.
Naturellement, nous souscrivons à l’objectif de réduction des coûts et des incertitudes juridiques pour les entreprises, confrontées jusqu’alors à vingt-sept régimes nationaux d’autorisation différents dans l’Union européenne.
Pour autant, l’actualité récente a rappelé l’importance de deux exigences vitales.
Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir un régime d’autorisation réactif, qui s’adapte au plus vite aux évolutions du contexte international. À cet égard, je voudrais souligner l’application immédiate par la France des décisions d’embargo de l’ONU et de l’Union européenne sur les exportations d’armement à destination de la Libye et de la Syrie, et la suspension, immédiatement, et en fonction des pays et de la nature des équipements, des opérations de délivrance d’agrément préalable, d’autorisation d’exportation et de passage en douane dans les autres cas.
Ensuite, il est impératif de maintenir un très haut degré de rigueur dans le contrôle des exportations. En la matière, le nouveau cadre juridique comporte plusieurs garde-fous : un mécanisme de certification pour garantir la fiabilité des opérateurs qui recevront des matériels dans l’Union européenne ; de nouvelles obligations d’organisation et d’information pesant sur les entreprises, sous peine de sanctions pénales ; surtout, la mise en place, et c’est nouveau, d’un contrôle a posteriori, en plus du contrôle a priori, sous forme d’inspections menées directement sur place, dans les entreprises concernées ; enfin, toute autorisation pourra être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, notamment dans le cas d’un brusque changement du contexte international.
L’Assemblée nationale, saisie en première lecture, s’est ralliée à l’analyse qui avait été la nôtre.
On peut résumer ainsi la position prise par sa commission de la défense, sous l’égide de son rapporteur, notre collègue député M. Yves Fromion, par ailleurs excellent connaisseur du dossier : premièrement, accord sans réserve avec la démarche de modernisation du cadre juridique ; deuxièmement, présentation des deux interrogations pratiques suivantes : ne faudrait-il pas déléguer l’instruction de certaines demandes d’autorisations, les moins sensibles, pour désengorger la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre, la CIEEMG ? Comment la réforme va-t-elle pouvoir entrer en vigueur rapidement avec un système d’information aussi peu performant que le système SIEX actuel, qui fait aujourd’hui l’unanimité contre lui ?
Le Gouvernement lui a apporté les mêmes réponses que celles qu’il nous avait faites : des procédures accélérées et partiellement déléguées seront mises en place, et SIEX sera remplacé dès 2013, et non en 2014, qui est le délai maximal prévu par le texte de loi.
Pour ce qui est de la rédaction, l’Assemblée nationale a repris notre texte en n’y apportant, sur la partie « TIC », que des modifications d’ordre rédactionnel. Aussi, la commission n’a pas apporté d’amendements au texte qui nous a été transmis.
À propos de la partie « MPDS », vous vous souvenez sans doute que l’essentiel de la transposition se fera par décret. Le projet de loi ne concerne que le régime juridique spécifique de certaines personnes publiques tel qu’il est régi par l’ordonnance de 2005. Néanmoins, cette partie est essentielle, car les dispositions les plus importantes serviront de modèle pour la partie réglementaire du code des marchés publics.
Vous vous souvenez également que l’essentiel des modifications que nous avons apportées à cette partie du texte concernait l’affirmation d’une clause de préférence communautaire souple. En effet, le projet de loi initial ne donnait qu’une interprétation modérée et ambiguë du désormais célèbre considérant 18.
Nous nous sommes efforcés, en étroite concertation avec le Gouvernement, d’améliorer cette rédaction. Il ne s’agit pas de fermer le marché, ce que les règles européennes n’autorisent du reste pas, mais, sauf exception, le principe est désormais que les appels français sont ouverts aux seuls opérateurs économiques européens, et que ce n’est que par exception que les pouvoirs adjudicateurs peuvent ouvrir leurs offres à l’ensemble de la concurrence. Encore doivent-ils le faire en prenant en compte plusieurs éléments, tels que les impératifs de sécurité d’information et d’approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, ou encore l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne.
L’Assemblée nationale a réservé un accueil tout à fait favorable à cette modification. Toutefois, elle a souhaité ajouter aux conditions que je viens d’énumérer la prise en compte de « l’obtention d’avantages mutuels ». Dans la mesure où il s’agit de s’approcher le plus possible du texte de la directive, je n’ai aucune objection à opposer à cet ajout et vous propose d’accepter cette modification.
En première lecture, nous avions également souhaité définir, conformément à la directive, les conditions que les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en compte dans l’exécution des offres. Nous avions ainsi posé la condition de localisation de l’offre sur le territoire européen.
Là encore, l’Assemblée nationale a réservé un accueil favorable à notre texte. Toutefois, elle a souhaité le compléter en ajoutant la prise en compte des considérations environnementales ou sociales dans la décision d’accepter ou de rejeter une offre. Dans la mesure où, là encore, il s’agit de respecter très strictement le texte de la directive, je ne vois pas d’inconvénients à accepter ce complément voulu par nos collègues députés.
En conclusion, et compte tenu du très bon travail fait à l’Assemblée nationale, la commission a adopté conforme le texte qui nous est soumis.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, ce texte ne doit pas être cantonné à un simple débat technique. Il faut souligner son objectif : donner à l’Union européenne les capacités de construire une défense, pendant de sa politique étrangère. Les convulsions sur les rives de la Méditerranée et les événements de Libye, en particulier, ont démontré la nécessité de la coordination des politiques étrangères des États membres et de la mise en place d’une défense européenne.
Comment, pour cela, organiser le marché européen de l’armement ?
Le credo libéral de la Commission, « ouvrir d’abord, contrôler ensuite », va à l’encontre de la souveraineté nationale dans un domaine par essence régalien, mais renforce-t-il, pour autant, une hypothétique défense européenne ?
La deuxième lecture de ce projet de loi porte sur la transposition de deux directives, l’une relative aux transferts intracommunautaires, sur laquelle le consensus est total, et l’autre sur les marchés publics de défense et de sécurité, qui est plus discutée. Ce texte a des implications allant au-delà de la technicité de l’exercice.
Le précédent ministre de la défense, Alain Juppé, déclarait en commission : « Sans volonté politique, l’ouverture des marchés ne suffira pas à renforcer la base industrielle et technologique de la défense européenne ; il faut relancer l’Europe de la défense en prenant appui sur des coopérations bilatérales, par exemple franco-britannique ».
La volonté politique indispensable commence-t-elle à exister ? La France, en tout cas, fait preuve de diligence dans la transposition de ces deux directives, peut-être parce qu’elle a soutenu leur élaboration lors de sa présidence de l’Union en 2008. Elle devrait, une fois n’est pas coutume, les transposer dans les temps, y compris le volet réglementaire de quatorze décrets et six arrêtés, d’ici au 21 août prochain...
Le marché de défense et de sécurité européen n’a pas un principe corollaire de préférence communautaire comparable au Buy American Act, très protectionniste. Nous pouvons le regretter. Le marché américain, premier mondial, soutenu par une forte volonté politique, a besoin d’une émulation interne pour faire progresser la technologie de ses industries. Le marché européen, soutenu par une volonté politique en devenir, doit, sous peine de voir disparaître une industrie de l’armement toujours très éclatée, se donner le temps de se structurer, et donc, aujourd’hui encore, de se protéger.
Notre commission des affaires étrangères et de la défense a adopté un amendement, renforcé par l’Assemblée nationale, affirmant une clause souple de préférence communautaire, bien que ce principe n’ait qu’une valeur indicative dans le considérant 18 de la directive « MPDS ». L’article 37-2 permet aux acheteurs publics de fermer aux opérateurs économiques tiers à l’Union l’accès à certains de leurs marchés de défense ou de sécurité.
On peut estimer que la Cour de justice de l’Union européenne, compétente pour appliquer le droit communautaire, s’en tiendra au texte de la directive. Néanmoins, de nombreux partenaires européens seront moins vertueux que nous dans la transposition, et davantage tournés vers les importations en provenance des États-Unis.
Monsieur le ministre, vous devez rappeler à nos partenaires que la nécessité d’une application identique de la directive par tous les États membres est indispensable.
Le recours extensif des États membres à l’article 346 du traité de Lisbonne leur permet de se prévaloir de la défense de leurs « intérêts essentiels » pour soustraire un marché à la concurrence. Il a conduit à l’élaboration de ces deux directives simplifiant les procédures d’exportations et créant un nouveau régime des marchés publics.
Je me réjouis de la simplification des procédures de transferts intracommunautaires, car la double autorisation exigeait des délais d’instruction de plusieurs mois. Ce facteur temps, bien que réduit par la directive et la réforme engagée dans sa lignée par le Gouvernement, constitue toujours un handicap lorsque nos partenaires nous demandent d’être très réactifs. Pourquoi ne pas proposer que, passé un certain délai, le silence de l’administration vaudrait approbation ?
Les industriels français sont organisés selon des axes de spécialisation, par segment de marché, par métier ou par type de prestations. Leurs compétences sont étendues et complémentaires, mais ils doivent absolument se coordonner et « chasser en meute » pour être plus conquérants sur le futur marché unique européen. Le délégué général pour l’armement, Laurent Collet-Billon, a employé une expression très appropriée : « L’esprit rugby est à développer parmi les industriels français ».
L’industrie de défense européenne est présente dans tous les secteurs de l’armement, sur presque tous les types de produits, et son potentiel est donc très important.
L’Union européenne représente 30 % des parts du marché mondial, derrière les États-Unis, qui réalisent 52 %. Le Royaume-Uni et la France, deuxième et quatrième exportateurs mondiaux, sont à la pointe des initiatives européennes en matière de défense. La déclaration de Saint-Malo, la lettre d’intention signée par six pays de l’Union, aujourd’hui le « paquet défense », et bientôt le « paquet défense II » vont dans le sens d’une Europe de la défense plus effective.
Quel pourrait être le rôle de l’Agence européenne de défense, présidée par Mme Ashton ? La double responsabilité de celle-ci souligne bien que politique extérieure et défense sont indissociables.
Si nous voulons que l’Union européenne démontre qu’elle développe une politique étrangère, alors nous devons nous donner les moyens politiques, administratifs et techniques d’une défense européenne.
Monsieur le ministre, refusons que l’Union européenne ne devienne une immense Suisse mélancolique et résignée devant les événements du monde ; osons la défense européenne !
Applaudissements sur certaines travées de l’Union centriste et de l’UMP.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, ce projet de loi, que nous avons déjà examiné en première lecture, nous revient très peu modifié par l’Assemblée nationale.
Sur le volet qui libéralise encore un peu plus, en Europe, les marchés de défense, les députés ont légèrement renforcé la clause de préférence communautaire proposée par notre assemblée pour tenter de limiter l’ouverture des marchés nationaux de l’armement. En revanche, concernant les « transferts communautaires », autrement dit le contrôle des exportations, nos deux assemblées partagent le même point de vue et se satisfont du dispositif proposé. Je ne vois donc malheureusement rien qui puisse modifier l’appréciation négative que nous avions de ce projet de loi.
Nous continuons de penser que la transposition dans notre droit national de la directive visant à harmoniser les règles de procédure de passation des marchés publics des États membres est dangereuse pour la pérennité de nos industries de défense.
Les entreprises européennes de l’armement, d’ailleurs composées de différents partenaires nationaux, sont tout autant menacées par cette volonté dogmatique de privilégier à tout prix la concurrence. Sous prétexte de réduire le coût d’achat de nos armements et d’accroître la compétitivité de nos industries, nous devrions ainsi accepter une ouverture totale de nos marchés de défense, y compris hors de l’espace européen, et cela sans aucune garantie véritable de réciprocité.
Nous craignons tous ici que cette ouverture à une concurrence débridée profite essentiellement aux industriels américains de défense, qui poursuivront leur politique protectionniste.
Je n’insisterai donc pas à nouveau sur les graves dangers que comporte la transcription de cette directive pour la construction de l’Europe de la défense, dont la perspective s’éloignera encore plus et que ne protégera certainement pas une clause de préférence communautaire juridiquement incertaine.
Comme en première lecture, mes critiques portent principalement sur le volet qui modifie profondément notre législation de contrôle des exportations d’armements, sous couvert de transposer la directive simplifiant les ventes d’armes dans les pays de l’Union européenne.
Ces changements législatifs seraient relativement peu risqués s’ils ne s’appliquaient qu’à un marché européen encadré et pratiquant une certaine déontologie. Mais le Gouvernement, en supprimant le double niveau d’autorisation que constituaient l’agrément préalable et l’autorisation d’exportation pour le remplacer par une licence unique, en profite pour étendre les modifications de ce dispositif de contrôle aux pays extracommunautaires.
Jusqu’à présent, les deux demandes que devait déposer un industriel auprès de l’administration, l’une avant de pouvoir négocier avec un client, l’autre avant livraison du matériel, même si elles étaient lentes et lourdes, permettaient de s’entourer de garanties. Pouvant désormais négocier avec leur client sans autorisation préalable, les industriels de l’armement auront la facilité d’exercer un certain chantage à l’emploi auprès du Gouvernement lorsqu’il s’agira d’obtenir après-coup la seule autorisation nécessaire.
Le président de Rohan, dans son rapport de deuxième lecture, a raison…
Sourires

Le président de Rohan, disais-je, a raison de souligner que le système de contrôle en vigueur a jusqu’ici bien fonctionné pour éviter une utilisation détournée des armes fournies Le rapport donne des exemples précis, comme l’application des décisions d’embargos de l’ONU et de l’Union européenne sur les exportations d’armement à destination de la Libye et de la Syrie. Au demeurant, se conformer aux décisions d’instances internationales me paraît être la moindre des choses…
Ce dispositif a également permis de suspendre in extremis les exportations de certains matériels sécuritaires à destination de Bahreïn et de la Libye.
C’est pourquoi je doute que le nouveau système de contrôle, inspiré de ce qui se pratique dans l’Union européenne, soit aussi rigoureux et permette vraiment de maintenir la même réactivité en cas d’évolution de la situation dans tel ou tel pays.
La multiplication des conflits intérieurs armés dans la dernière période, que ce soit en Côte d’Ivoire, en Libye ou au Moyen-Orient, devrait au contraire nous inciter à la prudence.
Actuellement les matériels de guerre exportés peuvent être trop facilement détournés d’un usage habituel et utilisés de façon incontrôlée. Ils peuvent aussi être réexportés vers des zones de conflits. Cela est essentiellement dû au manque d’efficacité, en l’absence de moyens de vérification fiable, des contrôles post-exportation.
Au lieu de l’alléger, il aurait donc fallu renforcer le système de contrôle pour favoriser une plus grande vigilance et ne pas se contenter de la simple délivrance de certificats de non-réexportation de la part des pays importateurs. Tenons compte de l’expérience pour qu’à l’avenir notre pays se donne les moyens de mieux évaluer les éventuelles conséquences de ses exportations d’armements !
Il faudrait ainsi une législation contraignante, des procédures efficaces de certification et de surveillance de l’utilisation finale des matériels pour éviter que des armes françaises ne soient vendues lorsqu’il existe un risque qu’elles participent à des violations des droits humains et du droit international humanitaire ou qu’elles entravent le développement économique et social des populations.
C’est enfin sur le terrain de la transparence que cette nouvelle législation sera très nettement insuffisante. L’opinion publique devrait avoir le droit d’être régulièrement informée de ce qui a été exporté et de ce que l’on a interdit d’exporter. C’est ce qui se pratique chez nos voisins britanniques, premiers exportateurs européens dans ce secteur, qui eux publient la liste des licences accordées ou refusées.
Je regrette donc à nouveau que nos amendements de première lecture visant à favoriser une plus grande transparence du rapport sur les ventes d’armes remis par le Gouvernement au Parlement aient été repoussés.
Comme en première lecture, du fait de ses insuffisances et des conséquences négatives qu’il risque d’avoir pour le contrôle des ventes d’armements, le projet de loi ne pourra faire l’objet d’un vote favorable de la part du groupe CRC-SPG.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi, qui, pour l’essentiel, vise à transposer deux directives du « paquet défense » a fait et continue de faire l’objet d’un débat parlementaire constructif et plutôt de qualité, …

… tant entre l’Assemblée nationale et le Sénat, lequel a apporté à l’édifice une contribution assez consistante, qu’entre l’opposition et la majorité, qui y ont l’une et l’autre beaucoup travaillé.
Il est vrai que l’enjeu de ce texte est important ou, du moins, pourrait l’être. En tout état de cause, il ne justifiait pas de désaccord entre nous.
Nous avons fait part de nos observations en première lecture, tant en commission que dans l’hémicycle, en particulier s’agissant du maintien d’un contrôle nécessaire sur un marché, celui des armes, qui n’a rien d’ordinaire. Je n’y reviens donc pas, et notre groupe confirmera le vote qu’il a déjà émis sur ce texte.
Les directives du « paquet défense » vont plutôt dans la bonne direction et marquent une amélioration par rapport à la situation présente.
Elles vont simplifier la vie de nos industriels et leur ouvrir, peut-être, – l’avenir le dira – des opportunités de nouveaux marchés : rendez-vous dans quelque temps…
Le problème tient à ce que le « paquet défense » ne comporte pas de clause de préférence communautaire. Or l’émergence d’une authentique base industrielle européenne implique bel et bien l’existence d’une telle clause vis-à-vis des opérateurs économiques de pays tiers au grand marché.
Sans clause de préférence communautaire, il n’y aurait jamais eu de politique agricole commune et, sans politique agricole commune, nous ne serions pas parvenus à faire le marché commun, et donc l’euro. Évidemment, le problème ne se pose pas en ces termes, car agriculture et défense ne peuvent être comparées, mais le fait que nous ayons pu – il est vrai que nous étions alors moins nombreux et plus allants… – nous imposer une telle clause en matière agricole mais que nos contemporains ne réussissent pas à le faire en matière de défense en dit long sur l’essoufflement de la construction européenne !
À cause de cela, nous nous retrouvons dans une situation bien curieuse, avec, d’un côté, une base de défense industrielle américaine solidement protégée et qui s’ouvre uniquement lorsque les autorités américaines l’estiment profitable – je pense au récent épisode des avions ravitailleurs MRTT – et, de l’autre, une base de défense européenne ouverte à tous les vents !
Nous avons bien lu l’exposé des motifs de la directive MPDS : c’est une profession de foi dans les vertus du libre-échange, assortie de l’espoir – mais ce n’est qu’un espoir – de récompense en contrepartie. Permettez-moi cependant d’être sceptique : le libre-échange peut-être, la naïveté, non ! En matière de commerce international, nous croyons plus aux rapports de force et à la réciprocité.
C’est pourquoi, devant cette cécité de nature idéologique, nous en venons à nous demander si, au-delà d’une croyance dans les vertus du libre-échange, la volonté de la Commission, du Conseil et du Parlement européens n’a pas été tout simplement de laisser se construire une base industrielle en direction de l’OTAN plutôt qu’une base industrielle véritablement européenne.
Pour autant, et pour être honnête, il faut reconnaître que les choses sont plus compliquées qu’il n’y paraît. Nous savons tous qu’une clause de préférence communautaire en matière de défense aurait des avantages, car elle permettrait de consolider et de conforter l’industrie nationale en lui apportant la quasi-certitude de bénéficier de programmes d’équipement, mais elle aurait aussi un grand inconvénient, puisqu’elle pourrait conduire à acquérir des armes peut-être moins performantes et sûrement à des prix plus élevés, voire beaucoup plus élevés, que celles qui pourraient être acquises auprès de pays tiers.
La clause de préférence communautaire peut même conduire les autorités d’un État à subventionner de fait ses propres entreprises, surtout si celles-ci sont en situation de monopole. Dans le marché des avions MRTT que je viens d’évoquer, c’est bien parce que les autorités américaines ont refusé de payer à Boeing la rente qui découlait de son monopole qu’elles ont voulu mettre cette entreprise en concurrence avec l’européen EADS. Rien ne les y obligeait, mais, au final, c’est quand même l’entreprise américaine qui a remporté le marché. Le contribuable américain a réalisé grâce à cette « vraie-fausse » mise en concurrence une économie de sept milliards de dollars. Peut-être saura-t-il renvoyer la politesse au contribuable Européen ?...
Le refus d’une clause de préférence communautaire s’explique par le fait que les États européens ne disposent pas, en général, d’une industrie de défense et qu’ils n’étaient pas prêts à payer plus cher l’acquisition d’armes éventuellement moins performantes. Ils l’étaient d’autant moins que, pour eux, conforter la base industrielle européenne se serait résumé à acheter aux industriels français, britanniques, allemands, italiens, espagnols ou suédois, au nom d’un « intérêt général européen » dont ils ont du mal à percevoir les contours au-delà de leurs propres frontières.
Tel n’est pas le cas des autorités américaines, qui n’ont aucun scrupule à acheter plus cher à leurs propres industriels des armes moins performantes que celles qu’elles pourraient acheter aux industriels européens. Je pense encore, bien sûr, au contrat MRTT.
Par ailleurs, bon nombre d’entreprises européennes, comme le britannique BAE ou l’italien Finmeccanica, se sont beaucoup implantées aux Etats-Unis, à tel point que, par certains aspects de leur chiffre d’affaires, ces entreprises sont presque plus américaines qu’européennes ! Réserver le marché aux entreprises authentiquement européennes eût été, pour certains gouvernements, mettre en péril des stratégies d’implantation outre-Atlantique mises en œuvre depuis de longues années.
C’est afin de limiter les dégâts sur notre propre industrie de défense que le Sénat français a introduit – que nous avons introduit – une clause de préférence communautaire sous la forme d’un principe raisonnablement souple : lorsque nos autorités lanceront un appel d’offres en matière d’armement, cet appel d’offres sera réservé aux industriels européens et ce ne sera que par dérogation à ce principe que nous pourrons ouvrir nos appel d’offres à la concurrence internationale.
Nous avons ainsi choisi de jouer la carte européenne plutôt que la carte atlantiste. Qui en Europe pourrait nous le reprocher ? C’est une manière pour nous de tracer une ligne rouge. La souveraineté, c’est la faculté pour un État de pouvoir ouvrir ses offres quand il le veut, comme il le veut et à qui il veut.
Je vais donner un exemple. Aujourd’hui, parce que l’industrie aéronautique européenne de défense a complètement « raté » – et je pèse le mot ! – la révolution technologique des drones MALE
M. Jacques Gautier applaudit.

, nous, Français, pouvons nous placer dans la perspective d’acheter – parce qu’ils seraient moins chers, parce qu’ils sont plus efficaces et dans la mesure où les forces armées de notre pays en ont vraiment besoin – des drones américains, mais nous voulons pouvoir le faire à nos conditions et pour des quantités limitées. De la sorte, le moment venu, les industriels européens, qu’il s’agisse d’EADS, de Dassault ou de BAE, de Safran, de Rolls-Royce, de Thales, pourront produire des systèmes d’armes équivalents, sur lesquels nous garderons la souveraineté.
M. Jacques Gautier applaudit de nouveau.

Tout cela pour dire que le « paquet défense » constitue une avancée, mais qu’il ne permettra pas, à lui seul, de réaliser l’Europe de la défense.
La logique qui le sous-tend devrait permettre de disposer de bases équitables de concurrence entre industriels européens. Considérons cette avancée de façon positive et, autant que possible, tentons d’engranger des gains.
Mais il ne faut pas pour autant nourrir trop d’illusions. Nous sommes loin des objectifs affichés dans l’exposé des motifs des directives de 2009 et de la communication sur une stratégie industrielle commune en matière de défense de 2007.
Pour construire une base industrielle de défense européenne forte et autonome, il faudrait non seulement la régulation des conditions de marché ainsi qu’une clause de préférence communautaire, c’est-à-dire une politique de l’offre, mais aussi une politique de la demande, qui suppose l’harmonisation des besoins et des programmations par les états-majors des pays de l’Union et une harmonisation de l’effort de défense – point important – dans chacun des pays qui la compose. Hélas, nous n’en voyons pas le début du commencement !
L’industrie de la défense américaine dispose d’un marché intérieur non seulement protégé, mais également vaste et profond, ce qui explique sa force. Or la dimension du marché américain des armements est liée tant à l’importance des sommes qui y sont consacrées, qu’à l’uniformisation des besoins au sein d’une même armée.
Les industriels américains ne sont pas obligés de fabriquer un blindé pour la Pennsylvanie, un autre pour l’Arizona, voire un troisième pour le Vermont, ou encore de concevoir une frégate pour la Floride et une autre pour la Californie. Par ailleurs, l’Oregon et le Texas ne disposent pas d’avions de combat différents. L’Europe, elle, a trois avions de combat différents, sept programmes de frégates et dix-sept programmes de blindés ! La concentration ne se fera pas sous le seul effet des règles du marché.
Or la puissance de l’industrie de défense américaine permet aux États-Unis de s’assurer d’avantages compétitifs à l’exportation et de concurrencer durement et durablement les industriels européens sur les marchés mondiaux.
Comme l’a indiqué Aymeri de Montesquiou, tant que l’Europe ne sera pas capable d’harmoniser, de mettre fin à la segmentation de ses industries de l’armement ou d’organiser une coopération efficace entre ses entreprises de défense, la lutte demeurera inégale.
Le préalable à la réalisation de l’Europe de la défense est donc une volonté politique forte des États membres. Il n’y aura pas d’Europe de la défense sans cette volonté partagée. Le reste est littérature.
De ce point de vue, la coopération franco-britannique dans l’esprit de la déclaration de Saint-Malo, poursuivie par les traités signés à Londres au mois de novembre dernier, doit apparaître comme une étape dans la construction d’une Europe de la défense.
Certes, elle constitue une approche très différente des précédentes. Elle marque même une rupture en ce qu’elle affirme substituer une démarche pragmatique et concrète à une architecture globale et mal assurée, des programmes d’équipement précis et financés à des velléités ou à de bien minces réalisations.
Elle peut être – je le souhaite de tout cœur – le prélude à des coopérations renforcées prévues par le traité de Lisbonne qui, seules, peuvent faire progresser la politique européenne de sécurité et de défense commune, la PESDC, et lui donner un peu de consistance.
En conclusion, je dirai que le « paquet défense » peut représenter une étape nouvelle dans la réalisation d’une véritable base industrielle et technologique de défense européenne. Il ouvre des perspectives, autorise des espoirs. Il peut permettre de déboucher rapidement sur quelques projets mobilisateurs et crédibles. Il y va simplement de la volonté des acteurs.
Nous devons donc continuer à nous battre pour l’Europe de la défense, recoller les morceaux avec nos amis allemands, si vous me permettez cette expression, mes chers collègues, car on ne peut pas tourner le dos à quarante années de traité de l’Élysée comme cela. Il nous faut veiller, comme sur un trésor, à notre coopération avec l’Italie – ce n’est pas si simple –, dont nous oublions toujours qu’elle est notre premier partenaire industriel en matière de défense. Il nous faut panser les plaies de la coopération navale avec les Espagnols et consolider notre partenariat au sein d’EADS. Il nous faut coopérer avec les Néerlandais, qui ont des frégates Aegis dotées du même radar que nos frégates Horizon et qui ont, avec beaucoup de détermination et de résolution, décidé, en y mettant quelques moyens, d’en faire un instrument au service de la défense anti-missile européenne. Nous pouvons agir de même !
Bref, au lieu de donner sans cesse des leçons et de faire la démonstration de l’arrogance française, il nous faut convaincre, persuader, faire des compromis, si nous voulons favoriser la construction d’une authentique Europe de la défense. Une Europe de la défense qui ne se paiera pas de mots, mais qui continuera d’assurer la paix et la prospérité de nos citoyens, de faire respecter nos valeurs dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, ou ailleurs.
Tout cela est long, difficile, ingrat, compliqué, parfois coûteux, mais nécessaire.
Divisés, nous serons vassaux ; ensemble, nous demeurerons souverains. Cette noble et belle ambition justifie tous nos efforts.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UMP.

Le présent débat pourrait se résumer ainsi : « oui » à la libéralisation et à l’assouplissement des règles relatives aux transferts et aux marchés publics à l’intérieur de l’espace européen ; « non » au laxisme et à l’ouverture inconditionnelle aux tiers.
Monsieur Fischer, les conséquences pour nos industries d’armement des assouplissements auxquels nous allons consentir en transposant les deux directives vous inquiètent. Mais le statu quo n’a absolument pas empêché, comme l’a très bien démontré Daniel Reiner, la segmentation des marchés et la multiplication des programmes d’armement, leur duplication irrationnelle dans les domaines naval et aéronautique, comme dans celui des véhicules blindés. En l’espèce, si des harmonisations internes avaient été effectuées, bon nombre d’économies auraient pu être réalisées dans nos budgets de défense.

C’est la raison pour laquelle tout ce qui favorisera l’harmonisation des règles d’acquisition au sein de marchés publics de défense harmonisés est important. Dans le cadre des transferts intracommunautaires, qui ont lieu par conséquent à l’intérieur du marché unique européen, nous devons pouvoir importer des pièces détachées sans aucune contrainte administrative exagérée.
Daniel Reiner a également fait remarquer que nous devons favoriser les coopérations renforcées au sein de l’Union européenne ; je partage son sentiment. Les dispositions prévues par le traité franco-britannique ne doivent pas y faire obstacle. Au contraire, ce que nous accomplirons ensemble, France et Grande-Bretagne, doit être un exemple pour les autres États membres. Nos deux pays sont d’ailleurs tout à fait prêts à voir s’agréger à eux d’autres États qui voudraient partager une expérience dans le domaine de la défense.
Dans leur lettre adressée au Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les ministres des affaires étrangères français, polonais et allemand ont demandé que la Commission mette sur pied un programme de coopération dans le domaine de la défense.
C’est clair : nous sommes partisans d’édifier une base industrielle et technologique de défense européenne qui soit compétitive par rapport au principal de nos concurrents que sont les États-Unis.
En revanche, nous sommes opposés à la libéralisation inconditionnelle, vers laquelle certains membres de la Commission européenne voudraient nous pousser, au nom de la sainte concurrence, parce que la réciprocité n’existe pas dans d’autres pays, particulièrement de l’autre côté de l’Atlantique, où le buy american act interdit toute importation de matériel militaire. De surcroît, d’autres dispositions prohibent toute exportation américaine ou toute joint venture sans autorisation du Congrès, ce qui signifie que le marché américain est totalement protégé.
Nous sommes opposés à une ouverture inconditionnelle de notre marché à des importations en provenance d’un pays qui pratique lui-même la fermeture. Nous avons introduit une disposition – garantie minimale – qui, si elle est appliquée loyalement, nous permettra de nous garantir contre les faux-nez extérieurs, c’est-à-dire contre des entreprises apparemment européennes qui, en réalité, sont administrées intégralement par un conseil d’administration américain et qui importeraient des produits américains. L’administration française est bien déterminée à appliquer cette clause, monsieur le ministre.
Nous pouvons donc voter sans état d’âme le projet de loi équilibré que nous examinons ce jour.
Si nous voulons une réelle politique de défense européenne, elle devra s’appuyer essentiellement sur une base industrielle d’armement et de défense européenne, faute de quoi elle sera très difficile à mettre en œuvre. Mais cela relève d’une décision politique. Il faut que les vingt-sept pays membres de l’Union européenne soient enfin capables de comprendre que personne ne peut les défendre à leur place.

Nous ne pouvons pas éternellement nous reposer sur un tiers, fût-il extrêmement puissant, pour assurer notre sécurité.
Je suis convaincu qu’un jour nous serons contraints d’assurer nous-mêmes notre défense, tout simplement parce que les États-Unis n’accepteront plus de financer éternellement les dépenses de pays qui se refusent à consacrer un centime à leur défense, d’un continent qui ne veut pas comprendre qu’il doit enfin assumer ses charges.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Chapitre Ier
Dispositions relatives au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés et à la transposition de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Importations et exportations - Transferts au sein de l’Union européenne
« SECTION 1
« Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l’Union européenne
« SOUS -SECTION 1
« Autorisations d’importation et dérogations
« Art. L. 2335 -1. – I. – L’importation sans autorisation préalabledes matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories mentionnés à l’article L. 2331-1 provenant des États non membres de l’Union européenne est prohibée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d’importation peut être délivrée.
« II. – Aucun des matériels des 1re ou 4e catégories mentionnés au même article L. 2331-1 dont l’importation en France est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d’avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
« III. – Aucun importateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d’importation s’il n’est pas déjà titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1.
« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d’une autorisation d’importation des matériels des quatre premières catégories dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – L’autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d’importation qu’elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.
« SOUS -SECTION 2
« Autorisations d’exportation et dérogations
« Art. L. 2335 -2. – L’exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des États non membres de l’Union européenne est prohibée.
« L’autorité administrative définit la liste de ces matériels de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable, ainsi que les dérogations à cette autorisation.
« Art. L. 2335 -3. – I. – L’autorisation préalable d’exportation, dénommée licence d’exportation, est accordée par l’autorité administrative, sous l’une des formes suivantes :
« 1° Des arrêtés dénommés “licences générales d’exportation”, comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l’autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un État non membre de l’Union européenne ;
« 2° Des licences globales d’exportation, faisant l’objet d’une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un État non membre de l’Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ;
« 3° Des licences individuelles d’exportation, faisant l’objet d’une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un État non membre de l’Union européenne.
« Les licences d’exportation peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l’utilisation finale de ces matériels.
« II. – Les licences générales d’exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
« III. – Les licences globales et les licences individuelles d’exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
« IV. – Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d’informations dans le cadre de la négociation d’un contrat, l’acceptation d’une commande ou la signature d’un contrat.
« À la demande de l’exportateur ou lorsque l’autorité administrative l’estime nécessaire, compte tenu de l’opération d’exportation, l’autorisation peut être limitée à la communication d’informations dans le cadre de la négociation d’un contrat, à l’acceptation d’une commande ou à la signature d’un contrat.
« V. – Aucun exportateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l’article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d’exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d’exportation s’il n’est pas déjà titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1.
« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d’une licence générale, globale ou individuelle d’exportation des matériels des quatre premières catégories.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2335 -4. – L’autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d’exportation qu’elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
« SOUS -SECTION 3
« Obligations des exportateurs et des importateurs
« Art. L. 2335 -5. – Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d’utiliser une licence générale d’exportation pour la première fois.
« Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence d’exportation ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l’objet concernant l’utilisation finale de ces matériels ou leur réexportation. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
« Art. L. 2335 -6. – Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tiennent, dans des conditions déterminées par l’autorité administrative, un registre des exportations qu’ils ont effectuées.
« Le registre des exportations, ainsi que l’ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation, sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu.
« Les exportateurs sont également tenus de transmettre à l’administration un compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées. Les importateurs sont tenus de transmettre à l’administration un compte rendu des importations effectuées. L’autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de matériels concernées par cette obligation.
« L’autorité administrative définit en outre les obligations spécifiques qui s’appliquent aux exportateurs sollicitant une licence globale d’exportation.
« Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2335 -7. – Lors du dépôt d’une demande de licence d’exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu’ils ont reçus au titre d’une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre État membre de l’Union européenne et faisant l’objet de restrictions à l’exportation déclarent à l’autorité administrative qu’ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu’ils ont obtenu l’accord de cet État membre. Les modalités de cette déclaration sont fixées par l’autorité administrative.
« SECTION 2
« Transferts de produits liés à la défense au sein de l’Union européenne
« SOUS -SECTION 1
« Définitions
« Art. L. 2335 -8. – On entend par “transfert” toute transmission ou tout mouvement de produits liés à la défense d’un fournisseur situé en France vers un destinataire situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un fournisseur situé dans un autre État membre vers un destinataire situé en France.
« On entend par “fournisseur” la personne physique ou morale établie en France responsable d’un transfert.
« On entend par “destinataire” la personne physique ou morale établie en France ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et qui est responsable de la réception d’un transfert.
« On entend par “licence de transfert” une autorisation publiée ou notifiée par l’autorité administrative et permettant à un fournisseur établi en France de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un État membre de l’Union européenne.
« SOUS -SECTION 2
« Autorisations de transfert et dérogations
« Art. L. 2335 -9. – Le transfert de produits liés à la défense effectué depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne est soumis à autorisation préalable mentionnée à l’article L. 2335-10.
« L’autorité administrative définit la liste des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable conformément à l’annexe à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
« Art. L. 2335 -10. – I. – L’autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l’autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l’opération ou de la catégorie d’opérations, sous l’une des formes suivantes :
« 1° Des arrêtés dénommés “licences générales de transfert”, comportant des listes de produits autorisant directement tout fournisseur établi en France à effectuer le transfert de ces produits vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° Des licences globales de transfert, faisant l’objet d’une notification, autorisant, à sa demande, un fournisseur établi en France à effectuer des transferts de produits liés à la défense spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un autre État membre de l’Union européenne, pour une durée déterminée sans limite de quantité ni de montant ;
« 3° Des licences individuelles de transfert, faisant l’objet d’une notification, autorisant, à la demande d’un fournisseur établi en France, à transférer, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre État membre de l’Union européenne.
« Les licences de transfert peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l’utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l’Union européenne.
« II. – Les licences générales de transfert autorisent tout fournisseur à effectuer des transferts de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
« III. – Les licences globales et les licences individuelles de transfert autorisent un fournisseur à procéder au transfert de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
« IV. – Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d’informations dans le cadre de la négociation d’un contrat, l’acceptation d’une commande ou la signature d’un contrat.
« À la demande du fournisseur, ou lorsque l’autorité administrative l’estime nécessaire compte tenu de la nature des informations en cause, l’autorisation peut être limitée à la communication de certaines informations dans le cadre de la négociation d’un contrat, à l’acceptation d’une commande ou à la signature d’un contrat.
« V. – Les licences de transfert publiées ou notifiées par un État membre de l’Union européenne autorisent l’entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l’application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l’ordre public ou de la sécurité des transports.
« VI. – Aucun fournisseur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l’article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s’il n’est pas déjà titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1.
« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d’une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels des quatre premières catégories.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2335 -11. – L’autorité administrative peut accorder des dérogations à l’obligation d’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 2335-10 lorsque :
« 1° Le fournisseur ou le destinataire est une institution publique au sens de l’article 4 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, précitée ou fait partie des forces armées ;
« 2° Les livraisons sont effectuées par l’Union européenne, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, l’Agence internationale de l’énergie atomique ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins d’exécution de leurs missions ;
« 3° Le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’armements entre États membres de l’Union européenne ;
« 4° Le transfert est lié à l’aide humanitaire en cas de catastrophe ou réalisé en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence ;
« 5° Le transfert est nécessaire dans le cadre d’opérations de réparation, d’entretien, d’exposition ou de démonstration.
« Art. L. 2335 -12. – L’autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences de transfert qu’elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
« SOUS -SECTION 3
« Obligations des fournisseurs et des destinataires
« Art. L. 2335 -13. – Les fournisseurs de produits liés à la défense informent le ministrede la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d’utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. L’autorité administrative peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé.
« Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l’objet concernant l’utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l’Union européenne. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
« Art. L. 2335 -14. – Les fournisseurs de produits liés à la défense tiennent, dans des conditions déterminées par l’autorité administrative, un registre des transferts qu’ils ont effectués.
« Le registre des transferts, ainsi que l’ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation, sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.
« Les fournisseurs et les destinataires sont également tenus de transmettre à l’administration un compte rendu des prises de commande et des transferts effectués et reçus. L’autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de produits concernées par cette obligation.
« Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Celui-ci fixe, en particulier, les informations qui doivent figurer dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 2335 -15. – Lorsque le transfert d’un produit en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne est conditionné par cet État à la production d’une déclaration d’utilisation, le destinataire atteste que le produit lié à la défense qu’il acquiert doit être intégré dans ses propres produits et qu’il ne peut être ni transféré, ni exporté en l’état à partir du territoire français, sauf dans un but d’entretien ou de réparation.
« SOUS -SECTION 4
« Certification
« Art. L. 2335 -16. – Les entreprises souhaitant être destinataires de produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres États membres de l’Union européenne sollicitent, auprès de l’autorité administrative, une certification attestant de leur fiabilité, notamment de leur capacité à appliquer les restrictions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 2335-10.
« Les critères de certification sont définis par décret en Conseil d’État.
« SOUS -SECTION 5
« Transferts soumis à une procédure spécifique
« Art. L. 2335 -17. – I. – Pour le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste, est soumis à une autorisation préalable spécifique.
« Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l’autorité administrative.
« II. – L’autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu’elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation préalable.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2335 -18. – I. – Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres États membres de l’Union européenne des matériels suivants :
« 1° Les satellites de détection ou d’observation, leurs équipements d’observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d’exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;
« 2° Les véhicules spatiaux, les autres satellites, leurs stations au sol d’exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;
« 3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ;
« 4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens spécialisés de production, d’essai et de lancement ;
« 5° Les parties, composants, accessoires et matériels spécifiques d’environnement, y compris les équipements de maintenance, des matériels mentionnés aux 1° à 3° ;
« 6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4°.
« L’autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.
« II. – Les articles L. 2335-12 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation, ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d’autorisation.
« SOUS -SECTION 6
« Dispositions communes
« Art. L. 2335 -19. – Les contestations en douane portant sur la prohibition d’importation, d’exportation ou de transfert prévue au présent chapitre peuvent être soumises à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui. L’organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret. »
III. – Le second alinéa de l’article L. 2332-10 du même code est ainsi rédigé :
« Les prescriptions relatives à l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou au transfert au sein de l’Union européenne, y compris celles qui concernent l’acceptation des commandes en vue de l’exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre. ».
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 2331-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les matériels appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne, ou le transfert au sein de l’Union européenne, sont définis au chapitre V du présent titre. »
II. –
Non modifié
III. – Le second alinéa de l’article L. 2339-1 du même code est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l’État.
« Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
« Ils sont également tenus de n’apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l’exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l’examen des lieux, des matériels et du système d’information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
« Les agents habilités de l’État qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
« En cas d’infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
« Sans préjudice de l’application de l’article 36 du code de procédure pénale, l’action publique en matière d’infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l’article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l’article L. 2332-1, ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés, est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.
« Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l’autorité habilitée par lui.
« À défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l’autorité habilitée par lui.
« Hormis le cas d’urgence, le ministre de la défense, ou l’autorité habilitée par lui, donne son avis dans le délai d’un mois, par tout moyen.
« L’autorité visée au huitième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense. »
IV. – (Non modifié)
V. – Le premier alinéa de l’article L. 2352-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La production, l’importation et l’exportation hors du territoire de l’Union européenne, le transfert entre États membres de l’Union européenne, le commerce, l’emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
« L’autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l’agrément technique et les autorisations d’importation et d’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou de transfert entre États membres de l’Union européenne prévus à l’alinéa précédent qu’elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l’agrément technique ou spécifiées dans l’autorisation.
« Les conditions dans lesquelles l’agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
VI. – Le 1° de l’article L. 2353-5 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Toute violation de l’article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – §(Non modifié)
II. – La section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions pénales des importations, exportations et transferts » ;
2° L’article L. 2339-11 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « dans l’article L. 2335-4 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2332-8-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou du poinçon d’exportation » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des articles L. 2339-11-1 à L. 2339-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339 -11 -1. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € :
« 1° Sans préjudice de l’application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l’article L. 2335-18 ;
« 2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l’article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l’article L. 2335-14 ;
« 3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre de transferts aux agents visés à l’article L. 2339-1, à leur première demande ;
« 4° Le fait d’omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.
« Art. L. 2339 -11 -2. – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;
« 2° Le fait pour le destinataire de transférer ou d’exporter des matériels non intégrés dans ses produits en violation de l’engagement prévu à l’article L. 2335-15 ;
« 3° Le fait d’obtenir la licence d’exportation mentionnée à l’article L. 2335-7 à la suite d’une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l’exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d’une licence de transfert d’un État membre de l’Union européenne, ont été respectées ou levées par l’État membre d’origine ;
« 4° Le fait pour un destinataire d’omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l’article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l’utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l’entreprise au titre d’une licence de transfert d’un autre État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 2339 -11 -3. – Est puni d’une amende de 15 000 € :
« 1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d’utiliser une licence générale d’exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;
« 2° Le fait de ne pas transmettre à l’autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l’article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l’article L. 2335-14.
« Art. L. 2339–11 -4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – À la première phrase du 4 de l’article 38 du code des douanes, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la Convention de Paris et mentionnés à l’article L. 2342-8 du code de la défense, aux matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 du même code ainsi qu’aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l’article L. 2352-1 dudit code, ».
III à V. –
Non modifiés
VI. – (Supprimé) –
Adopté.
Chapitre II
Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité sont les marchés et accords-cadres ayant pour objet :
« 1° La fourniture d’équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu’ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu’ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
« 2° La fourniture d’équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous- assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
« 3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux 1° ou 2°, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement ; le cycle de vie de l’équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination ;
« 4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
« 5° Des travaux, fournitures ou services mentionnés aux 1° à 4° et des travaux, fournitures ou services qui n’y sont pas mentionnés, lorsque la passation d’un marché unique est justifiée pour des raisons objectives. » ;
2° Au II de l’article 3, après les mots : « les règles », sont insérés les mots : « de passation ou d’exécution » ;
3° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La présente ordonnance ne fait pas obstacle à la possibilité pour les entités adjudicatrices d’appliquer volontairement les règles de passation ou d’exécution prévues par le code des marchés publics. » ;
4° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés, quel que soit leur objet, qui présentent les caractéristiques suivantes :
« 1° Marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance, lorsque ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice bénéficie, sur le fondement d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 2° Marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;
« 3° Marchés passés au bénéfice d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité adjudicatrice en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ;
« 4° Marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers ;
« 5° Marchés de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation ;
« 6° Marchés de services concernant les contrats de travail.
« II. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés, autres que les marchés de défense ou de sécurité, qui présentent les caractéristiques suivantes :
« 1° Marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec un contrat d’acquisition ou de location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance ;
« 2° Marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
« 3° Marchés qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige ;
« 4° Marchés qui ont pour objet l’achat d’œuvres d’art, d’objets d’antiquité et de collection et marchés ayant pour objet l’achat d’objets d’art.
« III. – La présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés de défense ou de sécurité qui présentent les caractéristiques suivantes :
« 1° Marchés de services financiers, à l’exception des services d’assurance ;
« 2° Marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation.
« La recherche et développement est définie comme l’ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques, et à l’exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de pré-production, de l’outillage et de l’ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication ; les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d’un nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;
« 3° Marchés portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État l’exige ;
« 4° Marchés pour lesquels l’application de la présente ordonnance ou du code des marchés publics obligerait à une divulgation d’informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l’État ;
« 5° Marchés spécifiquement destinés aux activités de renseignement ;
« 6° Marchés passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l’État et un autre État membre de l’Union européenne en vue du développement d’un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° du II de l’article 2 ; lorsque seules participent au programme des personnes relevant d’États membres, l’État notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l’accord ou de l’arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l’accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d’achat pour chaque État membre telle que définie dans l’accord ou l’arrangement ;
« 7° Marchés passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations ;
« 8° Marchés ayant pour objet des travaux, fournitures ou services mentionnés au II de l’article 2, et des travaux, fournitures ou services n’entrant pas dans le champ de la présente ordonnance, lorsque la passation d’un marché global est justifiée pour des raisons objectives. » ;
5° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l’article 421-5, à l’article 433-1, au second alinéa de l’article 433-2, au huitième alinéa de l’article 434-9, au second alinéa de l’article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l’article 1741 du code général des impôts et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-9, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ; »
b) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Pour les marchés de défense ou de sécurité, les personnes qui ont été sanctionnées par la résiliation de leur marché ou qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information, à moins qu’elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu’elles établissent, par tout moyen, que leur professionnalisme ne peut plus être remis en doute ;
« 6° Pour les marchés de défense ou de sécurité, les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen, et le cas échéant par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État. » ;
6° Le chapitre IV est complété par des articles 37-2 à 37-5 ainsi rédigés :
« Art. 37 -2. – I. – Pour les marchés de défense ou de sécurité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat ou le titulaire comme sous-contractant, pour l’un des motifs prévus à l’article 8 ou au motif qu’il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l’information ou de sécurité des approvisionnements.
« Le sous-contractant est l’opérateur économique avec lequel le titulaire du marché conclut, aux fins de la réalisation de celui-ci, un contrat de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d’entreprise.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 37 -3. – I. – Les marchés de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l’Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen.
« II. – Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen à participer à une procédure de passation de marchés de défense ou de sécurité.
« III. – La possibilité mentionnée au II prend notamment en compte les impératifs de sécurité d’information et d’approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’État, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 37 -4. – I. – Dans le cadre des marchés de défense ou de sécurité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques au regard, notamment, de l’implantation géographique de l’outillage, du matériel, de l’équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d’approvisionnement dont il dispose pour exécuter le marché, faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché, lorsque cette implantation se trouve hors du territoire de l’Union européenne.
« II. – Afin de prendre en compte les objectifs de développement durable, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent ne pas accepter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques ou professionnelles suffisantes au regard, notamment, des exigences environnementales préalablement définies.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. 37 -5. – Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut imposer, notamment dans un marché de défense ou de sécurité, au titre des conditions d’exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie du marché, maintenir ou moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’Espace économique européen afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. » ;
7° L’article 38 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les articles 37-2 à 37-5 sont applicables aux personnes soumises au code des marchés publics. » –
Adopté.
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires
(Non modifié)
I. – À titre transitoire, jusqu’à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 décembre 2014 :
1° Les opérations commerciales préalables mentionnées au III de l’article L. 2335-3 du code de la défense sont soumises au régime de l’agrément préalable dans les conditions fixées par l’article L. 2335-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Les opérations commerciales préalables mentionnées au III de l’article L. 2335-10 du même code sont soumises au régime de l’agrément préalable dans les conditions fixées par l’article L. 2335-2 dudit code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Les agréments préalables délivrés dans la période définie au I conservent leur validité jusqu’à leur terme.
(Non modifié) –
Adopté.
III. – §

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

Je tiens d’abord à remercier Josselin de Rohan et à saluer l’excellent travail qu’il a accompli : la transposition dans le droit français des deux directives européennes relatives au contrôle des importations et des exportations des matériels de guerre et marchés de défense n’était pas chose aisée, dans un contexte économique et financier très difficile, dans lequel les budgets consacrés à l’armement sont souvent victimes de réductions importantes.
Par ailleurs, mes chers collègues, nous savons tous que l’industrie de la défense représente 165 000 emplois directs et autant d’emplois indirects.
Le secteur de la défense, les industries et les PME qui le composent sont des leviers fondamentaux de notre économie, à un moment où elle connaît des difficultés.
Parallèlement, avec ces transpositions de ce que nous appelons le « paquet défense », nous nous retrouvons face à une vraie dualité : d’un côté, être de fervents bâtisseurs de l’Europe de la défense, comme l’illustre la signature, au mois de novembre dernier, des accords de Londres, et participer à la construction d’une base industrielle et technologique de défense européenne compétitive, seul rempart face au risque de décrochage technologique et capacitaire, et, d’un autre côté, préserver nos champions nationaux face à la concurrence et au protectionnisme d’autres puissances, je pense à la Chine et aux États Unis. Nous ne disposons pas d’équivalent du buy american act, lequel permet aux acheteurs publics américains d’écarter toute offre d’équipements émanant d’opérateurs économiques non américains.
Si nous pouvons nous féliciter de la convergence de point de vue avec nos collègues de l’Assemblée nationale, je me réjouis des avancées opérées, notamment, sur les articles 37-3 à 37-5 de l’ordonnance du 6 juin 2006, qui favorisent la mise en place d’une préférence communautaire « raisonnable ».
Ce texte harmonise la législation communautaire, afin de favoriser le développement d’une concurrence loyale.
Le présent projet de loi introduit également une plus grande transparence quant à la passation de marchés de défense. Le commerce des armes n’est pas un commerce comme les autres ; les États qui s’y livrent ont une responsabilité et doivent demeurer vigilants. Les bouleversements que connaissent les pays du bassin méditerranéen n’ont pas manqué de nous le rappeler.
Enfin, concernant les transferts intracommunautaires, ce projet de loi offre un régime rénové, qui s’accompagne d’une grande rigueur en matière de contrôle.
Au final, ce texte jette les bases d’une BITD européenne compétitive. Il s'agit là, mes chers collègues, d’une condition indispensable à la construction d’une PESDC effective. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est définitivement adopté.
(Textes de la commission)

L’ordre du jour appelle l’examen de six projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ces six projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l’échange d’informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation (projet n° 199, texte de la commission n° 462, rapport n° 461).
Le projet de loi est définitivement adopté.
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité, signée à Monaco le 25 juin 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l’approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité (projet n° 37, texte de la commission n° 502, rapport n° 501).
Le projet de loi est adopté.
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces armées dans le cadre de la coopération militaire, signé à Paris le 2 octobre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces armées dans le cadre de la coopération militaire (projet n° 350, texte de la commission n° 504, rapport n° 503).
Le projet de loi est définitivement adopté.
Est autorisée l'approbation de l'accord de coopération en matière militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Astana le 6 octobre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de coopération en matière militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan (projet n° 351, texte de la commission n° 506, rapport n° 505).
Le projet de loi est définitivement adopté.
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés, signé à Marrakech le 22 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés (projet n° 445 [2009-2010], texte de la commission n° 527, rapport n° 526).
Le projet de loi est adopté.
Est autorisée l’approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine (projet n° 413, texte de la commission n° 574, rapport n° 573).
Le projet de loi est définitivement adopté.

Mes chers collègues, avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures trente-cinq, est reprise à quinze heures quarante.

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis répond à l’obligation de révision prévue par la loi de bioéthique de 2004.
Il a déjà fait l’objet de deux lectures par l’Assemblée nationale. La Haute Assemblée va à présent l’examiner en deuxième lecture.
D’ores et déjà, les travaux en commission et les débats en séance publique ont permis d’aboutir à certains votes conformes et de trouver plusieurs points d’accords, que je vais évoquer.
En particulier, la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes a été écartée au terme de discussions approfondies et de qualité qui ont conduit le Gouvernement à se rallier à cette position.
Le transfert post mortem d’un embryon a été rejeté, conformément au souhait du Gouvernement. En effet, quelle que soit la compassion qu’inspire ces situations douloureuses, rien ne peut justifier de priver délibérément un enfant de son père.
Je tiens à saluer la qualité, à la mesure des enjeux en présence, des débats conduits sur ces questions difficiles. Ils ont mis en évidence, au-delà de nos divergences d’opinion sur certains points, notre profonde adhésion commune aux valeurs fondamentales affirmées par les lois de bioéthique successives. Je pense, en particulier, à la dignité de la personne humaine et au refus de la marchandisation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il vous revient de nouveau de vous prononcer sur plusieurs questions sensibles et complexes. La recherche de justes points d’équilibre se poursuit, dans ces domaines où il nous faut concilier, d’une part, la liberté individuelle et l’autonomie de la personne, et, d’autre part, la préservation de valeurs essentielles – dignité humaine et respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, principe du don anonyme et solidaire. Il s’agit de conjuguer harmonieusement l’intime et le « vouloir vivre ensemble ».
Avant d’en venir aux sujets les plus sensibles, je tiens à exprimer ma satisfaction quant aux avancées réalisées sur le don d’organe. Un accord a été trouvé sur l’essentiel, ce qui est tout à fait important. En effet, le développement des possibilités de transplantations dans le cadre du don entre vifs permettra de réduire le nombre des personnes en attente de greffe et, surtout, celui des décès.
Rappelons que le nombre des greffes n’a que faiblement augmenté depuis 2004 – il est passé de 3 900 à 4 600 –, alors que celui, très réduit, des donneurs vivants est resté stable.
La pratique du don croisé d’organes a fait l’objet d’un accord de principe de vos assemblées. Elle est rigoureusement encadrée, dans la mesure où elle rompt le lien direct familial entre le donneur et le receveur.
Il est impératif d’empêcher toute possibilité d’une quelconque pression sur le donneur. En outre, le texte du projet de loi prévoit d’autoriser au-delà de la parentèle le don entre personnes unies par un lien étroit, stable et avéré. Le Gouvernement s’est rallié à cette ouverture supplémentaire du dispositif, qui appelle une vigilance renforcée. Ainsi, une condition de durée préalable de la relation paraît souhaitable. Rappelons, par ailleurs, que les donneurs vivants ne représentaient en 2009 que moins de 8 % des donneurs.
Toutefois, les avancées réalisées concernant les donneurs vivants ne doivent pas conduire à délaisser les dons post mortem, pour lesquels une information renforcée est nécessaire.
Enfin, trois questions cruciales seront au cœur de nos discussions : le diagnostic prénatal, la clause de révision et les recherches sur l’embryon.
Je serai particulièrement attentive à vos propos. Je souhaite néanmoins d’ores et déjà souligner certains points qui me paraissent importants.
Pour ce qui concerne le diagnostic prénatal, le texte qui vous est soumis correspond aux attentes du Gouvernement.
Il met en œuvre, en particulier, une approche cohérente et équilibrée du dépistage prénatal. Le droit à l’information de la femme enceinte et son autonomie de décision sont respectés et le cadre réglementaire est renforcé pour prévenir tout risque de dérive eugénique.
Je crois important à cet égard que l’accès aux examens de dépistage fasse l’objet d’une demande de la femme enceinte : l’information sur le dépistage est délivrée à toute femme, mais une manifestation de volonté de la femme enceinte est requise pour en bénéficier.
Par ailleurs, en cas de risque avéré d’anomalie génétique, une liste d’associations de patients concernés sera proposée à la femme enceinte pour compléter, si elle le souhaite, son information.
Le projet qui vous est présenté restaure la clause de révision de la loi, contrairement au souhait du Gouvernement et de l’Assemblée nationale.
Il faut, bien sûr, exercer toute la vigilance nécessaire à l’égard des avancées biomédicales et apporter des réponses aux nouvelles attentes de la société. Mais une clause de révision périodique n’est pas le seul moyen d’y parvenir. Réviser les lois de bioéthique tous les cinq ans présente de sérieux inconvénients. Cela expose, en particulier, le législateur au manque de réactivité face à de nouvelles menaces. Cela bloque tous les ajustements, utiles et nécessaires, qui se trouvent différés à l’échéance de la révision. Cela nécessite une procédure lourde, qui aboutit dans les faits à allonger sensiblement les délais prévus. Cela tend à radicaliser les positions des uns et des autres, alors que la bioéthique nécessite, au contraire, de cheminer sereinement vers de justes compromis.
De plus, les lois de bioéthique constituent aujourd’hui un socle juridique abouti et équilibré, qui ne nécessite plus de remise en chantier récurrente.
Enfin, les dispositions intégrées au projet qui vous est présenté permettent au Parlement d’exercer toute la vigilance nécessaire pour proposer, au moment opportun, des ajustements et des novations avec toute la fluidité requise.
À l’inverse, une clause de révision figerait toute adaptation et toute évolution des textes. Sa suppression est pleinement justifiée. Le Gouvernement déposera donc un amendement de suppression de cette clause de révision.
J’en viens, enfin, à la question la plus délicate, les recherches sur l’embryon.
Le projet qui vous est soumis pérennise le dispositif en vigueur. C’est un point essentiel.
En revanche, la commission des affaires sociales a souhaité substituer au régime d’interdiction assorti de dérogations un régime d’autorisation dans un cadre strict. C’est un véritable point de désaccord que je ne souhaite pas minimiser.
Très bien ! sur diverses travées de l ’ UMP.
Pourquoi le Gouvernement n’entend-il pas renoncer au principe d’interdiction des recherches sur l’embryon, assorti de possibilités de dérogations ?
Parce que c’est un choix de continuité avec les lois de 1994 et de 2004, et un choix de cohérence avec l’ensemble des dispositions relatives à l’embryon, qui visent à garantir la protection de l’embryon.
Parce que c’est le principe qui permet le mieux de contenir tout risque d’instrumentalisation de l’embryon humain. Les embryons surnuméraires n’ont pas vocation à devenir un objet systématique de recherche, ils ne sauraient être réduits au statut de ressource biologique potentielle pour les chercheurs. Il est important, à cet égard, de n’accorder d’autorisation que dans un cadre dérogatoire précis.
La recherche sur l’embryon n’est pas une recherche comme les autres parce qu’elle touche à l’origine de la vie.
Très bien ! sur diverses travées de l ’ UMP.
Pour conclure sur ce sujet, je tiens à souligner que ce régime juridique d’interdiction assorti de dérogations n’a pas pénalisé la recherche française. Il n’y a donc pas de raison d’en changer et d’opter pour un régime d’autorisation encadré comportant des risques de réification de l’embryon. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émettra un avis favorable à l’amendement de M. Gaudin réintroduisant le système d’interdiction assorti de dérogations.
Applaudissements sur diverses travées de l ’ UMP.
Enfin, je rappelle que le projet de loi permet d’organiser une veille et des débats publics autour des questions soulevées. Le débat consacré à la délicate question de la recherche sur l’embryon pourra ainsi se poursuivre, au vu, notamment, du bilan qui peut en être fait en France comme à l’étranger. Il convient aujourd’hui de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre des avancées médicales décisives, sans que les contraintes aboutissent à bloquer, de fait, toute recherche.
Je constate que, sur certains points, les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat se rapprochent néanmoins. Ainsi, il n’est pas proposé de distinguer les recherches sur l’embryon des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Ce choix est judicieux, car il existe évidemment un continuum entre l’embryon et les cellules souches, qui ne peuvent être prélevées sur l’embryon sans le détruire.
J’espère que le débat qui s’ouvre aujourd’hui nous permettra de cheminer vers un consensus plus large en faveur du maintien d’une interdiction de principe, qui, j’insiste, n’a pas pénalisé la recherche.
Tels sont les points, mesdames et messieurs les sénateurs, qu’il m’a paru important de souligner. Il vous revient d’examiner à nouveau ces propositions. Je ne doute pas que, au-delà de positions partisanes, le débat permettra d’approfondir l’ensemble des enjeux de ce texte.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte soumis à notre commission en deuxième lecture laisse peu de points de réelle divergence entre les deux assemblées. C’est le fruit du travail commun d’approfondissement et d’amélioration rédactionnelle que permet la navette parlementaire. Nous ne pouvons, me semble-t-il, que nous en féliciter. Les sujets abordés par le projet de loi nécessitaient, à l’évidence, un tel travail, ainsi que les débats et échanges nourris que nous avons eus.
Au total, près d’un tiers des soixante-neuf articles encore en discussion après la première lecture au Sénat ont été adoptés dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale.
Parmi les articles modifiés par l’Assemblée et restant donc en discussion, plusieurs nous sont soumis dans une rédaction qui ne pose aucune difficulté pour leur adoption.
Toutefois, certains points appellent des modifications et il convient donc d’examiner précisément les évolutions qu’a connues le texte à l’Assemblée nationale.
S’agissant, tout d’abord, du don d’organe, l’Assemblée nationale a suivi le Sénat pour lever les obstacles au don et ne pas prévoir de contreparties susceptibles de fausser l’altruisme de cet acte. Elle a ainsi confirmé l’interdiction de discrimination concernant le don du sang pour des motifs autres que médicaux et complété l’interdiction de discrimination des donneurs en matière d’accès à l’assurance.
Elle a, cependant, supprimé l’allègement du consentement adopté par le Sénat en matière de collecte des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse et du sang périphérique. Concrètement, comme c’est déjà le cas pour le don de moelle osseuse, le don de cellules hématopoïétiques du sang devra être autorisé par un juge. La commission a confirmé ce choix pour garantir la meilleure protection des donneurs.
L’Assemblée nationale a également rétabli la mention du caractère anonyme et non dirigé du don de cellules hématopoïétiques du sang de cordon, considérant que le rappel partiel des caractéristiques du don était nécessaire pour éviter la mise en place de banques de conservation privées du sang de cordon à des fins autologues. La commission des affaires sociales n’a pas partagé l’analyse de l’Assemblée nationale et a donc rétabli son texte, sous réserve d’une modification rédactionnelle.
Sur la question du diagnostic prénatal, l’Assemblée nationale a entendu les objections du Sénat. Elle n’a donc pas rétabli sa rédaction, qui conduisait à ce que les examens de biologie médicale et d’imagerie, destinés à évaluer un éventuel risque, ne soient proposés à la femme enceinte que « lorsque les conditions médicales le nécessitent ».
Elle a, à la place, prévu que la femme enceinte recevra, lors d’une consultation médicale, « une information loyale, claire et appropriée » sur la possibilité de recourir, à sa demande, à ces examens.
Ce faisant, l’Assemblée nationale a estimé qu’elle répondait aux principales critiques émises tant par le Sénat que par l’ensemble des professionnels concernés et des sociétés savantes. Ces critiques concernent le non-respect du droit du patient à être informé, l’atteinte au principe d’autonomie du patient, l’absence d’égalité de traitement entre les femmes et l’accroissement de la responsabilité pesant sur les professionnels.
Je me réjouis que l’Assemblée nationale ait pu faire ce pas dans notre direction. Elle a, d’ailleurs, adopté sans modification les autres dispositions relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire.
Sur l’anonymat du don de gamètes, je vous rappelle que le Sénat avait confirmé la suppression des dispositions permettant la levée de l’anonymat sous conditions. Le débat se limite donc désormais aux modalités de contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, sur les données personnelles détenues par les centres et sur la mise en place d’un référentiel des bonnes pratiques. Sur ces deux points, le texte de l’Assemblée nationale est très proche de celui que nous avions adopté.
Sur l’assistance médicale à la procréation, l’AMP, plusieurs divergences persistent entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Tout d’abord, les députés ont rétabli la possibilité pour les majeurs n’ayant pas procréé de faire un don de gamètes et de se voir proposer, à cette occasion, leur autoconservation. Cette possibilité est présentée par le rapporteur de l’Assemblée nationale, non comme une contrepartie, mais comme la garantie que les accidents de la vie ne viendront pas faire regretter le don accompli.
La commission des affaires sociales estime dangereuse la possibilité d’autoconservation des gamètes, qui ouvre la voie à l’AMP de commodité, et ce alors que le bénéfice attendu en termes de don est des plus incertains. Elle l’a donc supprimée.
Les députés ont également limité la participation des établissements privés aux procédures d’assistance médicale à la procréation aux seuls cas où le directeur général de l’Agence régionale de santé, l’ARS, aura constaté l’absence d’activité dans ce secteur depuis deux ans. La commission, là encore, n’a pas suivi les députés.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a souhaité procéder à la codification de l’autorisation de la technique de vitrification que le Sénat avait prévue dans un article spécifique afin de préserver la clarté du code de la santé publique et d’encadrer la responsabilité du législateur. Contrairement au rapport de l’Académie de médecine, elle a également réintroduit la conservation des gamètes et tissus germinaux dans la définition de l’AMP.
La commission des affaires sociales a jugé que la responsabilité que prend le législateur en autorisant une technique médicale doit être le plus encadrée possible. Le texte qu’elle a adopté en première lecture est, dans ces conditions, mieux adapté à la réalité médicale et à la nécessité de permettre le retrait rapide de l’autorisation de vitrification des ovocytes si la situation sanitaire l’exige. Elle a donc rétabli le texte du Sénat.
Enfin, l’Assemblée nationale est revenue à son texte d’origine pour la détermination des couples auxquels l’assistance médicale à la procréation est ouverte, écartant tant le texte de notre commission que le texte adopté en séance, qui ouvrait l’accès à l’AMP aux couples homosexuels. La commission des affaires sociales est revenue à son texte d’origine, qui énumère les formes d’union ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation sans inclure les couples homosexuels.
S’agissant de la recherche sur l’embryon, l’Assemblée nationale a finalement rétabli en séance l’interdiction de principe de la recherche sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches, afin d’ériger un « interdit symbolique fort » qui pourra pourtant s’accompagner de dérogations permanentes.
Elle est également revenue à son texte concernant l’essentiel des conditions nécessaires pour qu’une recherche soit autorisée. Il faudra ainsi que les chercheurs prouvent qu’il est « impossible de parvenir au résultat escompté » par une autre méthode de recherche.
Concrètement, cela signifie qu’il faudra avoir engagé des recherches par tous les autres moyens possibles et avoir échoué pour pouvoir mener des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
De plus, les parents ayant donné à la recherche leurs embryons surnuméraires devront être informés de la nature des recherches pour lesquels ceux-ci seront utilisés, ce qui suppose une pré-affectation des embryons.
En pratique, et j’insiste d’emblée sur ce point, les conditions posées par l'Assemblée nationale aboutissent à restreindre considérablement, si ce n’est totalement, la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Elles vont bien au-delà de ce que proposait le Gouvernement dans le projet de loi initial.
L'Assemblée nationale a également supprimé le rapport demandé par le Sénat sur la nécessité de mettre en place des centres de conservation biologiques, conformément aux préconisations de l’Agence de la biomédecine, de l’Académie nationale de médecine et même de l’OCDE.
Sur l’application et l’évaluation de la loi, l'Assemblée nationale a pris, sur plusieurs points, une position inverse de celle du Sénat.
Ainsi, elle a supprimé la clause de révision de la loi au bout de cinq ans, qui avait pourtant fait l’objet au Sénat d’un indéniable consensus.
Elle a supprimé le caractère obligatoire de l’organisation d’un débat public avant toute réforme d’importance en matière de bioéthique, laissant l’organisation de ce débat à la seule initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Elle a supprimé la demande d’un rapport d’activité aux espaces éthiques régionaux, dont le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé aurait fait la synthèse dans son rapport annuel. Elle a en effet considéré que la mesure était inutile, ces espaces n’étant pas encore créés. Mais, précisément, il s’agissait pour nous de pousser le Gouvernement à agir et, de fait, Mme la secrétaire d'État nous avait indiqué que l’arrêté de création de ces espaces éthiques régionaux devrait bientôt être signé.
Enfin et surtout, l'Assemblée nationale a supprimé l’article mettant en place un régime de déclaration d’intérêts applicable aux membres du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, alors que certains députés ont plusieurs fois regretté que les liens d’intérêts de ces membres ne soient pas rendus publics !
La commission des affaires sociales est revenue à la rédaction du Sénat sur ces derniers éléments.
Le point essentiel dans nos débats, chacun le sait, est celui qui concerne la recherche.

L’idée selon laquelle il faudrait, pour encadrer la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, une interdiction de principe assortie de dérogations permanentes repose en dernière analyse sur la nécessité supposée d’un interdit symbolique fort.
Cette formule est celle du Conseil d’État, qui en a évoqué la possibilité pour mieux l’écarter. Comme le Conseil d’État, l’Académie de médecine et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’OPECST, je pense que ce serait là préférer l’ambiguïté et la peur à la clarté et à la responsabilité. J’estime que, en adoptant un tel texte, ainsi que plusieurs de nos collègues nous le proposent par voie d’amendement, nous n’assumerions pas pleinement notre rôle de législateur.
Je souhaite souligner d’abord un point d’ordre juridique.
L’interdiction de principe n’ajoute rien à la protection juridique de l’embryon.

C’est l’article 16 du code civil qui garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. La mise en œuvre de cette garantie réside non pas, comme on le prétend parfois, dans l’interdiction de la recherche sur l’embryon, mais dans la mise en place d’un ensemble de règles cumulatives éthiques, scientifiques et procédurales auxquelles doivent se conformer les chercheurs pour pouvoir pratiquer des recherches destinées à apporter des progrès médicaux majeurs. C’est l’encadrement spécifique de la recherche sur l’embryon, encadrement plus contraignant que pour n’importe quel autre type de recherche, qui constitue ici la vraie garantie des principes de respect de la vie, et non l’interdiction assortie de dérogations.
À cette question de droit s’ajoute une question de fond. On entend que notre société serait inquiète des recherches sur l’embryon et qu’il faudrait donc que celles-ci soient présentées comme exceptionnelles, dérogatoires. Pareille assertion aurait un sens si les dérogations prévues par le texte étaient limitées dans le temps, comme en 2004, ou restreintes à un objet spécifique. Mais telle n’est ni l’intention du Gouvernement ni celle des députés. Or une interdiction de principe qui masquerait des dérogations larges et pérennes n’aurait d’autre fonction que d’induire nos concitoyens en erreur.
À mon avis, ce que demandent les Français, dans tous les domaines, c’est la transparence des décisions publiques et la responsabilité de ceux qui les prennent.

M. Alain Milon, rapporteur. En adoptant une interdiction de principe, nous ne respecterions ni l’une ni l’autre. Plutôt que d’expliquer pourquoi les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires doivent pouvoir être envisagées par les scientifiques, plutôt que de faire comprendre l’intérêt de l’encadrement mis en place en 2004, nous voudrions éluder ce travail de pédagogie pour nous cacher derrière l’argument que ces recherches seraient exceptionnelles. Je ne pense pas que ce serait là assumer nos responsabilités de représentants de la nation : je crains que ce ne soit là faire peu de cas de l’intelligence des Français.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.

M. Alain Milon, rapporteur. L’interdiction de principe avec dérogations est donc inutile et néfaste en ce qu’elle masque les choix que nous faisons.
Applaudissementssur les mêmes travées.

En cette matière, il faut interdire complètement – je reconnais la logique de cette position que je respecte, même si je n’y adhère pas – ou autoriser de manière encadrée. Interdire avec dérogation ne serait pas un compromis, ce serait faire prévaloir l’exception sur la règle, ce qui n’est pas conforme aux principes qui sous-tendent notre démocratie.
Sur les différentes questions relatives à la bioéthique que ce projet de loi nous impose de trancher, la commission des affaires sociales a cherché à mettre en place un régime de clarté et de responsabilité. Il est essentiel que nos choix soient assumés et lisibles. C’est, il me semble, ce que réclament nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l ’ UMP et du RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, six ans après le premier toilettage de 2004, après plusieurs rapports, débats et états généraux, la révision des lois de bioéthique que nous examinons en deuxième lecture était très attendue et indispensable pour adapter notre législation aux progrès de la recherche mais aussi aux évolutions de notre société et aux attentes de la population.
À ce titre, je me félicite du travail qui a été accompli par la Haute Assemblée en première lecture et qui a permis d’améliorer considérablement ce texte. Nous avons transformé un projet de loi relativement frileux en un texte progressiste sur bien des points. Je pense en particulier au diagnostic prénatal, à l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à tous les couples infertiles, qu’il s’agisse d’une infertilité médicale ou « sociale », selon l’expression adoptée, et bien sûr à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
Malheureusement, l’Assemblée nationale est revenue en deuxième lecture sur plusieurs de ces avancées notables.
Les députés, du moins une majorité d’entre eux, ont rejeté l’accès à l’assistance médicale à la procréation à tous les couples. Avec cette mesure, nous acceptions enfin de reconnaître d’autres formes de parentalité. Nous permettions enfin l’exercice du droit à un projet parental quelles que soient les causes de l’infertilité. C’est la raison pour laquelle, avec plusieurs de mes collègues du RDSE, j’ai souhaité déposer un amendement tendant à rétablir cette disposition.
L’Assemblée nationale est également revenue sur l’autorisation de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. En première lecture, le Sénat avait supprimé l’interdiction de telles recherches au profit d’un régime d’autorisation strictement encadrée. Nous avions ainsi mis fin à une certaine hypocrisie ! Malheureusement, les députés ont choisi en deuxième lecture de rétablir cette interdiction. Aussi, je me félicite que la commission des affaires sociales ait à nouveau procédé à la réécriture de cette disposition.
L’interdiction de principe est préjudiciable tant pour les malades que pour les chercheurs.
En effet, les malades aspirent à voir les recherches progresser et développer de nouvelles thérapeutiques susceptibles de leur apporter des chances de guérison. Une telle décision serait également dommageable pour les chercheurs.

Alors que de telles recherches sont menées activement dans douze pays de l’Union européenne ainsi qu’aux États-Unis, au Japon ou en Chine, notre législation handicape à l’évidence nos chercheurs en leur imposant des obstacles. Nous connaissons le retard pris par la France ces dernières années : hélas ! cette situation risque de s’aggraver, quoi que l’on en pense.

Les chercheurs français seront sans doute distancés dans la compétition scientifique internationale qui est déjà marquée par de nombreuses avancées. Ainsi, au mois d’octobre dernier, une équipe américaine a annoncé le premier essai clinique visant à traiter avec des dérivés de cellules souches embryonnaires un patient victime d’un traumatisme de la moelle épinière, pour l’aider à retrouver sa motricité. La recherche embryonnaire en France ne saurait être freinée d’une manière quelconque.
Alors que nous disposons d’équipes de très grande qualité, nous risquons tout simplement de voir un certain nombre de chercheurs, parmi les meilleurs, quitter la France. Le législateur ne doit pas être un frein au travail que mènent ces derniers.

La recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires est nécessaire et légitime. Personnellement, je réfute toute accusation de dérive eugéniste, comme certains l’avancent. Ne pouvons-nous pas faire confiance à nos chercheurs qui sont des femmes et des hommes responsables et respectueux de l’éthique et de la loi ?
Certes, les partisans d’une interdiction de principe se réfugient souvent derrière des arguments spirituels ou religieux, qui sont tout à fait louables et que je respecte, mais je tiens à rappeler que la France est une république laïque.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.

Quelle que soit notre sensibilité, nous ne devons jamais perdre de vue que nous sommes les représentants d’une république laïque. Pour moi, cette expression a un sens très profond.
Même si le Sénat confirme sa position sur l’assistance médicale à la procréation et la recherche, ce que j’appelle de tous mes vœux, il est à craindre, au travers de vos déclarations, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement ne fasse quelque pression pour maintenir le statu quo.

Nous verrons bien ce qu’il en sera.
Enfin, je regrette que nous n’ayons pas franchi le pas s’agissant notamment de la gestation pour autrui. Nous aurions pu permettre l’accès à la maternité à toutes ces femmes stériles sans espoir de grossesse qui sont atteintes d’une malformation génétique ou d’une maladie et qui souffrent encore plus dans leur cœur et dans leur tête que dans leur corps.
L’actualité nous rappelle régulièrement que la grossesse n’est pas nécessaire pour se sentir mère, et l’expérience des parents par gestation pour autrui montre que l’on peut devenir parents même en absence de grossesse. Par ailleurs, les progrès de la génétique permettent à une femme de porter un enfant conçu avec les ovocytes d’une autre femme. Plusieurs pays ont d’ailleurs fait évoluer leur législation en la matière. De ce fait, de nombreux couples n’hésitent pas à se rendre dans ces pays pour avoir accès à cette possibilité. Interdire la gestation pour autrui n’empêchera pas sa mise en œuvre clandestine. Certes, une grossesse pour autrui n’est pas une grossesse classique et il n’est pas question de la banaliser ; il s’agit de l’encadrer juridiquement pour éviter toute dérive.

Autoriser cette pratique aurait apaisé les souffrances de toutes les femmes qui ne peuvent pas porter d’enfant en leur permettant de devenir mères.
Madame la secrétaire d’État, si ce texte a été réellement amélioré en première lecture par notre assemblée, je crains que les modifications apportées par les députés, avec votre assentiment, n’aboutissent à un texte frileux qui ne réponde pas forcément aux attentes des Français. J’ai peur que, dans les années à venir, n’apparaisse le sentiment d’un rendez-vous manqué.
Toutefois, étant par nature optimiste, j’espère que le débat qui s’est ouvert aujourd’hui sera riche. Les conclusions qui en ressortiront détermineront le vote de la majorité du groupe RDSE.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les lois de bioéthique ne sont pas des textes ordinaires. Elles transcendent les clivages et nous parlent de ce que nous avons de plus précieux : l’humain.
Nous voici très avancés dans la discussion de ce projet de loi, une discussion qui a soulevé de nombreux et très importants problèmes éthiques. Sur quelques sujets, le débat est parvenu à des solutions équilibrées.
Ainsi, grâce à l’adoption d’un amendement de notre collègue Valérie Létard, le dispositif d’information de la parentèle a été amélioré pour y inclure les personnes ayant fait un don de gamètes.
Par ailleurs, alors que nous n’étions pas favorables au transfert d’embryons post mortem, celui-ci est aujourd’hui écarté du texte.
Un modus vivendi a également été trouvé pour ce qui concerne le double diagnostic préimplantatoire, désigné sous le terme de « bébé médicament ».
Mes chers collègues, vous savez à quel point je suis opposée à cette technique. Mon sentiment profond est que nous aurions dû l’interdire purement et simplement. Cependant, l’adoption de mon amendement de repli, qui précise que le double diagnostic préimplantatoire ne peut être qu’un ultime recours, est déjà un moindre mal.
Je regrette aussi que nous n’ayons pas, lors de la première lecture, levé l’anonymat du don de gamètes afin de garantir à chaque enfant le droit à connaître ses origines, car l’adoption conforme par l’Assemblée nationale de l’article correspondant a exclu la question de la seconde lecture.
En revanche, restent en débat des questions fondamentales. La plus importante d’entre elles concerne la recherche sur l’embryon, le fragile embryon humain.
La commission des affaires sociales a voté, ce matin, en faveur du régime d’interdiction avec dérogations. Cette position est en harmonie avec le choix de la France de respecter la vie et la dignité de l’embryon humain dès le commencement de son développement.
L’article 16 du code civil dispose ainsi que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Pourtant, depuis 1994, le législateur ne s’est pas départi d’une conception utilitariste de l’embryon humain, qui conduit à distinguer entre les embryons qui répondent à un projet parental et ceux que n’accompagne pas un tel projet, vulgairement appelés « embryons surnuméraires », comme s’ils étaient « en trop » pour l’humanité.
Les uns, destinés à voix le jour, sont considérés comme des êtres humains, alors que les autres vont devenir, demain plus encore qu’en 2004, des matériaux de recherche pour les scientifiques. Le critère de distinction entre ces deux catégories d’embryons est purement subjectif et tient au projet que leurs parents conçoivent pour eux.
La grandeur de la civilisation ne consiste-t-elle pas à reconnaître la dignité inaliénable et intangible de chaque être humain, quel que soit le projet que d’autres ont formé pour lui ?
La réponse à cette question ne fait pour moi aucun doute. Je soutiendrai donc l’amendement de M. Gaudin. Si l’on veut prendre les problèmes à leur source, il faut réduire le nombre d’embryons surnuméraires, n’effectuer aucune congélation et réimplanter immédiatement les embryons artificiellement fécondés. Cela me paraît être la solution la plus sage.
Je crois que nous pouvons encore améliorer d’autres aspects non négligeables du texte. C’est le cas en matière d’aide médicale à la procréation. Sur ce thème, le texte a déjà beaucoup progressé. Je ne peux que me réjouir de la suppression par l’Assemblée nationale de l’ouverture de l’AMP aux couples homosexuels, qui avait été introduite par manque de vigilance au Sénat.

Le texte issu des travaux de la commission des affaires sociales a supprimé, d’une part, la limitation de la participation des établissements privés aux procédures d’AMP et, d’autre part, l’autoconservation.
Mais nous pouvons et devons faire plus. L’assistance médicale à la procréation ne doit être réservée qu’à des couples stables et solides. C’est pourquoi je vous proposerai un amendement visant à préciser que les couples candidats à l’assistance médicale à la procréation devront justifier d’une vie commune d’au moins deux ans. Cela me semble être un minimum et un gage éthique fondamental.
Nous devons aussi améliorer le dispositif du diagnostic prénatal. La réécriture incessante du texte, depuis que le Sénat a choisi de supprimer la mention selon laquelle le DPN serait proposé aux femmes enceintes lorsque les conditions médicales le nécessitent, masque mal l’embarras du législateur, un embarras bien justifié puisque, de fait, c’est un eugénisme d’État que l’on instaure
En effet, le texte, dans la mouture qui nous vient de l’Assemblée nationale, tend à inscrire dans la loi un élément de contrainte qui s’imposera aux médecins à une étape déterminante du dispositif.
Je ne peux que me répéter : il est important d’avoir à l’esprit que 96 % des fœtus diagnostiqués porteurs de trisomie 21 donnent lieu à une interruption médicale de grossesse et que le prélèvement du liquide amniotique à travers l’abdomen provoque deux fausses couches d’enfants « normaux » pour une trisomie dépistée.
L’obligation pour les médecins d’organiser un dépistage prénatal induit une problématique d’eugénisme particulièrement aiguë. Ce constat s’impose aujourd’hui, après quinze ans de dépistage de la trisomie, en raison tant de la mise au point permanente de nouveaux tests que de la volonté de prévenir tout risque.
La trisomie 21 est particulièrement visée par ce dépistage. On signifie ainsi aux futures mères et à toute la société qu’il serait insupportable d’assumer la maternité d’un enfant atteint de trisomie 21. Quel signal envoyons-nous alors aux familles qui ont fait le choix d’accueillir un enfant trisomique ? Cette évolution pourrait être la source d’une tragique stigmatisation de ces personnes.

Je ne peux que vous renvoyer à l’article 16-4 du code civil, aux termes duquel « toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite ».
C’est pourquoi je vous proposerai d’adopter une série d’amendements visant à rétablir un équilibre dans le dialogue médical entre la place du médecin et celle de la femme enceinte dont nous souhaitons renforcer la liberté, sans tout de même trop présumer de son autonomie.
Reste la question des clauses de revoyure. Sur ce point également, nous soutenons pleinement la position du rapporteur, qui a rétabli la révision quinquennale et l’organisation obligatoire d’un débat public avant toute réforme d’envergure.
Il ne me reste plus qu’à féliciter la commission des affaires sociales, sa présidente, Muguette Dini, et son rapporteur, Alain Milon, pour la qualité de leur travail et à vous remercier, mes chers collègues, de votre attention.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en abordant ce second volet de l’examen du texte de révision des lois bioéthiques, nous avons un peu le sentiment que l’histoire se répète, ou plus exactement que, sur ce dossier, la majorité bégaye quelque peu.
En première lecture, en effet, le Sénat, grâce à un vrai dialogue entre la majorité et l’opposition, était parvenu à apporter de substantielles améliorations au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
En commission comme en séance, le groupe socialiste avait défini une ligne claire : ni surenchère ni outrance, mais volonté réelle de construire un texte en prise avec les évolutions du monde, les enjeux contemporains autour de la bioéthique et les aspirations profondes d’une société qui change et qui se pose des questions qu’elle ne se posait pas encore il y a seulement dix ou quinze ans.
Nous ne voulions pas provoquer ou cliver inutilement, mais nous ne voulions pas non plus d’un texte qui se serait contenté de dépoussiérer à la marge la législation existante. Nous souhaitions introduire une inspiration progressiste dans un texte qui paraissait, au premier abord, empreint d’une certaine timidité.
Nous avions d’ailleurs conditionné notre vote à l’adoption d’amendements ou de positions que nous défendions, sur des sujets tels que l’autorisation de la recherche sur l’embryon, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à tous les couples, la promotion du don d’organe, le développement des techniques d’assistance médicale à la procréation ou encore la clause de révision des lois bioéthiques, qui était pour nous garante de progrès pour l’avenir et d’une certaine concordance entre l’évolution du droit et celle des techniques.
À l’arrivée, estimant avoir été assez correctement écoutés et globalement entendus, nous avions voté un texte qui, par bien des aspects, favorisait une certaine forme de consensus.
Puis vint l’examen du texte par l’Assemblée nationale.

Je le résumerai en trois mots : incompréhension, déception et soumission.

Incompréhension, car il a été fait assez peu de cas du travail des sénateurs, du moins dans les domaines majeurs. Et cela vaut pour tout le monde !
Déception, car nous voyons bien que les principaux changements que nous espérions ont été soigneusement écartés.
Soumission, car il est clair que, derrière l’apparente discipline des députés, ce sont les pesanteurs idéologiques et philosophiques – je n’irai pas plus loin – qui risquent, une fois encore, d’emporter la décision finale.
Le surplus d’ambition que nous avions ajouté au texte a tout simplement été gommé. Une certaine partie de la majorité a donc privilégié la voie de la stagnation, je dirais même la voie de la régression.

Jugez plutôt : suppression de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à tous les couples, suppression de la clause quinquennale de révision des lois bioéthiques, mais aussi malheureux rétablissement du principe d’interdiction a priori de la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires.
Sur ce dernier point, nous ne pouvons que faire part de notre abattement et de notre désarroi. Le manque de confiance en la science et la recherche génétique, ainsi que dans les espoirs qu’elle fait naître, est tout simplement désespérant.

La rupture est aujourd’hui consommée, il faut bien le dire, entre, d’un côté, l’univers médical de la recherche et des associations de malades qui promeuvent la thérapie cellulaire, sous la forme d’une recherche permissive mais encadrée, comme nous l’avions préconisé, et, d’un autre côté, une sphère politique conservatrice, intraitable – j’ai envie de dire crispée –, pour qui la recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires – appelées à être détruite d’ailleurs, vous le savez bien –, entrerait en contradiction avec la vie elle-même. Je crois qu’il faudra rechercher où est la contradiction dans ce domaine.

Le professeur René Frydman, père du « bébé du double espoir », qui s’apprête à prendre une retraite bien méritée après des années de recherche et d’activité, l’exprimait en des termes tout à fait éloquents dans un grand quotidien national, il y a quelques jours, au travers d’un exemple vécu dans un autre domaine que celui de l’embryon : « Prenons l’exemple de la congélation d’ovocytes, voilà trois ans que l’on est bloqué sur certaines innovations, comme la vitrification, une technique de congélation très performante. Tous les pays voisins la pratiquent. La France a d’ores et déjà cinq ans de retard sur cette méthode. Sans compter le manque de personnel et de matériel … ». C’est M. Frydman qui s’exprime ici, mais la plupart des chercheurs disent la même chose. Ne nous racontez pas que, avec la procédure de recherche que vous préconisez, les chercheurs français sont à égalité avec les autres ! Ils croulent sous la paperasse et toute une série d’obligations. À l’étranger, personne ne comprend plus rien !
Ce témoignage est pour le moins révélateur de ce qu’est la situation des chercheurs en technologies génétiques dans notre pays, et il émane de quelqu’un qui ne passe pas pour être un scientiste débridé, mais qui, au contraire, a toujours su être pondéré.
Je crois que, aujourd’hui, la recherche française a de quoi se sentir flouée.
Déjà en 2004, on lui avait promis que le maintien des principes d’interdiction de la recherche en embryologie n’était que temporaire, qu’il ne s’agissait que d’un moratoire appelé à disparaître, un « moratoire positif », disait-on alors, qui laissait augurer une véritable ouverture à terme. Sept ans plus tard, il apparaît que la parenthèse est encore loin d’être refermée...
À nos yeux, il s’agit là d’une trahison des espoirs thérapeutiques pour les patients porteurs de maladies génétiques et pour leurs soignants.
Vous comprendrez que, dans ces conditions, devant tant d’inconséquence, devant tant d’obstination, devant tant de rigidité doctrinale, la tentation soit grande parmi nous de voter contre le texte qui nous est soumis. D’autant que nous avons vu ce qui s’est passé en commission, lors des travaux de préparation de cette deuxième lecture : ce matin, nous avons tout de même vécu une réunion assez particulière !
Nous prenons acte, monsieur le rapporteur, de votre bonne foi et de votre volonté de revenir à une rédaction fidèle au texte que nous avions élaboré ensemble en première lecture ; nous vous avons même applaudi, ce qui, d’ailleurs, ne vous a sans doute pas aidé ! Votre attitude conciliante en est l’illustration.
Malheureusement, nous prenons aussi acte du nombre significatif d’amendements déposés par des sénateurs de la majorité, laquelle, malgré les réticences de quelques-uns, s’apprête à revenir sur des évolutions adoptées en première lecture, et à approuver des dispositions encore plus régressives en ce qui concerne la recherche sur l’embryon.

L’amendement de M. Jean-Claude Gaudin est en effet plus régressif que le texte qui nous vient de l’Assemblée nationale.

Je note du reste qu’il contient une erreur, mais celle-ci sera certainement rectifiée.
Aussi entrons-nous dans ce débat avec une inquiétude, mais aussi avec une volonté.
À quoi tient notre inquiétude ? À ce que, sous la pression conjointe, et non dissimulée, du Gouvernement – nous savons où cela s’est passé, madame la secrétaire d’État – et de lobbies intégristes…

… qui n’ont pas hésité, sur Internet, à se montrer menaçants, à la limite diffamants à l’encontre de certains d’entre nous, …

… il y a eu des revirements sur des points centraux du texte.
Notre volonté est de parvenir à ce que les conditions d’un vote unanime du texte soient réunies. Cela signifie que les « points durs » de la discussion doivent faire l’objet d’une issue respectueuse des conclusions auxquelles nous étions arrivés en première lecture ; nous y serons attentifs.
Nous tiendrons donc avant tout compte des conclusions du débat sur trois sujets essentiels à nos yeux.
Le premier est relatif au périmètre des bénéficiaires potentiels d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, que nous souhaitons voir étendu aux couples de femmes, afin de ne pas ajouter, madame Payet, à l’infertilité biologique une forme passéiste d’infertilité sociale. Quelqu’un a d’ailleurs évoqué ce point ce matin sur France Inter, depuis la Réunion.
Le deuxième sujet a trait au maintien d’une clause de révision figurant explicitement dans le texte.
Le troisième concerne la garantie du maintien du principe d’autorisation de la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires
Vous le voyez, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d’État, il est tout à fait envisageable que nous sortions par le haut de cette discussion…

… et que nous adressions ainsi un message clair à l’Assemblée nationale quant à la détermination du Sénat sur ce dossier.
Nous mesurons la complexité et la gravité de la tâche qui nous attend. Le respect de la vie, le droit de l’enfant, la filiation, la parentèle, l’encadrement de l’activité scientifique sont autant de sujets qui méritent que nous en débattions avec le plus grand sérieux, sans a priori et avec le souci du respect mutuel.
C’est dans cet état d’esprit que nous abordons cette deuxième lecture.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la bioéthique visait à construire deux équilibres fragiles. D’une part, un équilibre entre l’éthique et la science : ce qu’il est possible de faire, doit-on le faire ? D’autre part, un équilibre entre l’individuel et le collectif : jusqu’où les demandes individuelles, forcément subjectives, peuvent-elles modifier la norme collective ?
Ces équilibres ont parfois été atteints, et je citerai à cet égard le régime des dons d’organes ou encore l’avancée que constitue le rétablissement, pour l’accès à l’AMP, du double critère médical et social.
En revanche, ils ont été rompus en ce qui concerne la recherche sur l’embryon et, singulièrement, le dépistage prénatal.
Pour ce qui est de la recherche sur l’embryon, le régime d’autorisation, même encadré, est une transgression anthropologique.
C’est une transgression, d’abord, parce que passer du régime d’interdiction, fût-il assorti de dérogations, à un régime d’autorisation encadrée constitue une rupture fondamentale, car l’exception devient tout de même la règle.

C’est une transgression, ensuite, parce que se trouve consacré dans la loi le processus de déshumanisation et de chosification de l’embryon.
Quand devient-on un être humain ? À quel moment, en effet, fixer le seuil d’entrée dans l’humanité ?
Sur cette question, bien sûr, il n’y a pas d’évidence partagée : pour les uns, la vie commence dès sa conception, pour les autres, bien plus tard. Mais, jusqu’à présent, il y avait au moins un consensus, qui s’était exprimé en 1994, en 2004 et récemment encore à l’Assemblée nationale. Dans le doute, la sagesse, je le crois, commandait de nous abstenir de traiter l’embryon comme un simple matériau de laboratoire. En effet, dans le cas inverse, il faudrait apporter la preuve qu’un embryon n’est pas un être humain en devenir. Or qui peut aujourd’hui apporter cette preuve de façon définitive ?
C’est, enfin, une transgression qui n’est pas nécessaire sur le plan scientifique dès lors que, grâce aux cellules pluripotentes induites, ditesIPS – induced pluripotent stem cells –, la science nous propose une voie plus respectueuse de l’éthique et sans doute plus prometteuse pour l’avenir.

En effet, en cinq ans seulement, une douzaine de pathologies ont déjà été modélisées grâce aux IPS, alors que les cellules souches embryonnaires n’ont permis d’en modéliser qu’une demi-douzaine depuis près de quinze ans.
J’ajoute que, si cette transgression n’a pas de justification scientifique, elle n’a pas non plus de justification juridique puisque, en particulier, l’évolution récente de la jurisprudence communautaire sur le statut de l’embryon va dans le sens d’une plus grande protection, comme l’a confirmé le 10 mars dernier l’avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne.
Une transgression injustifiable donc, mais aussi une approche généralisée du dépistage prénatal qui pose un problème de fond.
Pourquoi la trisomie 21 justifie-t-elle une proposition de dépistage systématisée, en rupture avec les pratiques habituelles qui lient le dépistage chez une population donnée aux risques objectifs d’affection de cette population ? Va-t-on demain, selon le même principe, dépister toute la population masculine française pour le cancer colorectal ?
En outre, le dépistage généralisé ne peut pas être la seule réponse vis-à-vis de la trisomie 21. D’ailleurs, au moment de la mise en place du DPN, ses promoteurs avaient exprimé la volonté que le dépistage s’accompagne d’un effort financier équivalent pour la recherche sur la trisomie 21 et pour la prise en charge de cette affection. J’ai redéposé un amendement dans ce sens, qui permettrait, me semble-t-il, d’avoir une approche beaucoup plus équilibrée, en tout cas moins univoque.
Pour conclure, mes chers collègues, je dirai que ce texte nous ramène à nos origines, c’est-à-dire à la conception que nous nous faisons de l’homme, mais aussi à notre avenir. L’embryon est une figure de l’altérité et le traiter comme une chose ne saurait être sans conséquence sur la représentation que l’on se fait de l’humanité.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

« Le Sénat a pris deux décisions avec lesquelles le Gouvernement n’est pas en accord. Nous aurons, je pense, l’occasion de revenir sur ces sujets en deuxième lecture » : c’est par ces mots, madame la secrétaire d’État, que vous avez conclu votre intervention après que notre assemblée eut adopté ce projet de loi en première lecture.
Au cours de son examen en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, compte tenu des amendements déposés par les députés de la majorité, le Gouvernement n’a pas eu à intervenir. C’est en réalité sous une double pression que nos collègues du Palais Bourbon sont revenus sur les deux dispositions adoptées au Sénat concernant, d’une part, la recherche sur l’embryon et, d’autre part, l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples composés de deux femmes.
La première pression, celle du Gouvernement, a été clairement exercée par vous-même, madame la secrétaire d’État. La seconde, qui rejoint la première, l’a été, elle, par des groupes à caractère religieux, organisés et disposant de réseaux, voulant imposer leur vision de la science et de la vie. Il en résulte que ce projet de loi de révision des lois de bioéthique est totalement étanche aux évolutions de notre société ; croyez bien que je le regrette !
Pour les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG, la science et l’éthique médicale sont par nature en évolution constante. Les progrès scientifiques font naître, sur le plan technique, de « nouveaux possibles » qu’il nous revient de confronter à ce que nous considérons comme conforme à l’éthique. Mais les principes éthiques ne sont pas absolus et intangibles ; ils sont eux-mêmes mouvants, soit parce que des progrès scientifiques apportent des garanties nouvelles, soit en raison des évolutions de la société. Car, au final, la médecine, la recherche, la science en général n’ont de sens que si elles sont au service de nos concitoyens ?
En première lecture, j’affirmais devant vous : « Il s’agit de trouver ce subtil équilibre entre ce que la science peut faire techniquement et ce qu’elle peut faire philosophiquement, éthiquement ». Je ne retire rien à ces propos. Mais peut-être devrais-je ajouter qu’il convient également de nous interroger sur la manière dont les progrès techniques peuvent être utiles au quotidien pour nos concitoyens. Le domaine scientifique n’est pas un monde clos. La recherche n’est pas la propriété de ceux qui la pratiquent, et la formidable mobilisation autour des états généraux de la bioéthique en a été la preuve.
C’est pourquoi nous regrettons que l’Assemblée nationale ait supprimé une disposition adoptée par le Sénat permettant aux couples lesbiens de profiter d’une procréation médicalement assistée. Certains considèrent que la PMA n’a qu’une vocation médicale. Nous considérons, nous, qu’elle doit permettre de répondre aux cas d’infertilité sociale, le « M » de PMA devant se référer non plus à une finalité « médicale », mais aux moyens mis en œuvre pour permettre la procréation, c’est-à-dire ceux qu’offre la médecine, ce qui est souligné par l’adverbe « médicalement ».
De la même manière, nous regrettons que l’Assemblée nationale soit revenue sur la rédaction de l’article 23, qui traite de la recherche sur l’embryon et qui constitue le cœur de ce projet de loi. Si nous nous satisfaisons du fait que la commission des affaires sociales du Sénat ait proposé une nouvelle rédaction de cet article, permettant le basculement du régime d’interdiction avec dérogations à un régime d’autorisation contrôlée, nous demeurons inquiets. Nous redoutons en effet que cette disposition, cette avancée majeure pour la recherche, ne disparaisse à la suite de la réunion de la commission mixte paritaire ou, peut-être, au cours de nos débats.
La discussion que nous avons eue à ce sujet a été très nourrie et très intéressante. Je voudrais toutefois revenir sur certains points.
S’il est évident que la recherche en la matière est particulière, en raison même des éléments sur lesquels elle porte, nous ne devons pas perdre de vue certains principes.
Tout d’abord, la recherche ne portera que sur des embryons qui ne font plus l’objet d’un projet parental, c’est-à-dire des embryons qui ne sont voués à rien d’autre qu’à la conservation ou à la destruction.
Rappelons que, pour nous, l’embryon n’est pas un être humain, et c’est ce qui nous différencie de certains de nos collègues.

Ce n’est qu’une potentialité de vie. Or cette potentialité ne se réalisera jamais dès lors qu’il s’agit d’un embryon ne faisant plus l’objet d’un projet parental.
Certains, à l’image de M. Jean Leonetti, considèrent que le régime actuel d’interdiction avec dérogations n’a pas limité la recherche. S’il est vrai que la quasi-totalité des demandes de dérogation ont été accordées, il n’en demeure pas moins que ce régime repose sur un postulat que nous réprouvons : la recherche sur l’embryon serait, par nature, non conforme à l’éthique.
Par ailleurs, les scientifiques en conviennent, si toutes les demandes de dérogation sont satisfaites – ce qui constitue une véritable hypocrisie ! –, la constitution des dossiers entraîne des retards et des complexités dommageables pour la recherche française. Il arrive d’ailleurs que, pour les éviter, les chercheurs se censurent eux-mêmes et renoncent à certains projets.
Enfin, dernier argument développé sur ce sujet par la majorité et contre lequel je m’inscris en faux, le régime d’autorisation contrôlée servirait les intérêts des laboratoires pharmaceutiques et des grands groupes industriels. Ainsi, Jean Leonetti a récemment confié au journal La Croix : « Pour Marc Peschanski, le principe d’interdiction constitue un obstacle pour les investissements financiers des grands groupes industriels. »
Mes chers collègues, cette déclaration pourrait prêter à sourire si le sujet n’était pas si grave et, surtout, s’il n’émanait pas d’un député appartenant à la majorité parlementaire qui a autorisé l’utilisation de sang humain obtenu contre rémunération, une majorité qui a également, avec la grippe A et l’ensemble de sa politique du médicament, servi les intérêts des grands laboratoires et porté atteinte à la recherche publique comme cela n’avait jamais été fait auparavant, …

Bien Évidemment, la question de la recherche publique se pose. Mais elle se pose d’abord et avant tout en termes de moyens !
Permettez-moi de revenir un instant pour conclure sur un sujet qui nous semble fondamental : l’instauration, dans notre pays, d’un registre positif des donneurs d’organes.
Il est légitime que notre droit protège la volonté de celles et ceux qui, pour des raisons personnelles, refusent de donner leurs organes. Il est, en revanche, inacceptable que ce même droit prive d’effet la volonté de celles et ceux qui se sont clairement exprimés en faveur de ce don.
Si la loi reconnaît le droit aux uns de refuser ce don sur la base de l’autonomie de la volonté, elle ne peut, dans le même temps, avoir pour conséquence de nier aux personnes souhaitant participer au don de vie le droit de le faire. Nous estimons que la volonté des uns vaut celle des autres et que les proches doivent accepter de respecter la volonté qu’a exprimée une personne de son vivant, quelle que soit cette volonté. Nous considérons que la vie n’appartient à personne d’autre que soi-même, …

… et que personne, ni aucune considération, ne peut faire obstacle au libre arbitre dès lors que celui-ci a été clairement exprimé et qu’il est strictement encadré. Tel est le sens d’un amendement que nous présenterons tout à l'heure.
Compte tenu du temps de parole limité qui m’a été imparti, je ne puis développer plus longuement les positions et les propositions de mon groupe. Je dirai donc simplement que, comme en première lecture, nous arrêterons notre vote sur l’ensemble du projet de loi en fonction de ce qu’il en adviendra au cours de nos travaux, et nous serons, bien entendu, particulièrement attentif au sort que connaîtra l’amendement déposé par notre collègue Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP. §
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP. – Mme Anne-Marie Payet applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le bicamérisme nous conduit à examiner ce projet de loi en deuxième lecture. Voilà qui est, en l’espèce, bien insolite : comme si, en deux mois, nous avions, les uns et les autres, modifié notre conception de l’homme dans son rapport à la science…
Alors que j’ai toujours avancé des arguments de raison, permettez-moi aujourd'hui, m’exprimant à la tribune sur ce sujet pour une ultime fois, de faire d’abord parler mon cœur pour évoquer brièvement ce qui s’est passé ce matin en commission des affaires sociales.
Oui, j’ai une source, et elle me dit que la vie est un don et un mystère.

Certes, personne n’est obligé de partager avec moi ce sentiment, et je respecte parfaitement les positions de mes contradicteurs. Mais cette source me conduit à penser que la science ne peut pas se servir d’un être humain au profit d’un autre pour élaborer une molécule, en l’occurrence un médicament, en vue de guérir un autre patient. Car je crois qu’il y a une vie cachée dans cette cellule initiale.
En fin de compte, ce qu’il estdemandé au législateur, c’est de sortir du labyrinthe que nous avons construit en acceptant de congeler des embryons surnuméraires. Car ce sont aujourd'hui près de 150 000 embryons surnuméraires – l’équivalent de la population d’une ville comme Aix-en-Provence – que nous conservons dans nos congélateurs !
Au-delà des arguments de raison que je m’efforce de mettre en avant depuis sept ans, ce sont des éléments d’information que je veux apporter en abordant cette deuxième lecture.
Le travail de documentation que je mène systématiquement sur les recherches relatives aux cellules souches m’a permis de constater que, depuis la première lecture, quinze découvertes ont fait l’objet d’une publication, majoritairement aux États-Unis, à partir de cellules souches, avec des cellules aussi variées que des cellules souches embryonnaires animales, des cellules à l’origine de l’endoderme pulmonaire, des IPS obtenues à partir de cellules de peau, des cellules souches du sang de cordon – pour reprogrammer des cellules cardiaques et de la moelle osseuse –, et une seule à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Madame la secrétaire d'État, je tiens ce tableau à votre disposition.
Cette expérience sur des cellules souches embryonnaires humaines a été menée en Corée du Sud pour reconstituer des rétines endommagées et a été suivie, moins de trois semaines après, d’une découverte similaire, réalisée à l’université Harvard, mais à partir des fameuses cellules IPS. Déjà testée sur des souris, elle pourrait permettre de traiter la cécité, notamment la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique et la rétinite pigmentaire.
Il faut d’ailleurs noter que, dans le domaine de la modélisation de pathologies et du criblage, ces nouvelles molécules, les cellules IPS, qui n’ont pas, j’en conviens, monsieur le rapporteur, de vertus thérapeutiques, se révèlent plus efficaces que les cellules embryonnaires. En l’espace de trois ans seulement, les cellules IPS ont permis de modéliser plus d’une dizaine de maladies.
Où est donc, par rapport à cela, la valeur ajoutée de la recherche sur l’embryon ?
De fait, à l’inverse, les Britanniques, qui jouissent depuis vingt ans d’une autorisation absolue en matière de recherches sur l’embryon, n’ont obtenu – les chercheurs présents dans cette enceinte le savent bien – aucun résultat dans ce domaine.
Voilà un premier ensemble de faits, mes chers collègues. Mais ce n’est pas tout !
La révolution scientifique opérée grâce à la découverte, en 2007, du professeur Yamanaka sur les cellules IPS a été récemment suivie par une révolution juridique, et c’est le second élément d’information que je tiens à porter à votre connaissance.
Ainsi, le procureur près la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, en mars dernier, un avis sur la brevetabilité et l’utilisation à des fins industrielles ou commerciales de l’embryon humain.
Il a ainsi précisé qu’« une invention doit être exclue de la brevetabilité lorsque la mise en œuvre du procédé technique soumis au brevet utilise des cellules souches embryonnaires dont le prélèvement a impliqué la destruction ou même l’altération de l’embryon ». Selon lui, « donner une application industrielle à une invention utilisant des cellules souches embryonnaires reviendrait à utiliser les embryons humains comme un banal matériau de départ ».
Il a ajouté que « l’exception à l’interdiction de brevetabilité des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales concerne les seules inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles ». C’est pourquoi j’ai déposé un sous-amendement à l’amendement de notre collègue Jean-Claude Gaudin pour remplacer : « médicaux » par « thérapeutiques. »
En d’autres termes, si l’embryon est un patient, alors oui, on peut effectuer une recherche sur lui à condition que cela soit à son profit direct. Mais dès lors qu’il devient matériau, on a franchi la limite éthique acceptable pour notre société.
À cet égard, j’ai étudié l’ensemble des protocoles qui ont été autorisés en France par l’Agence de la biomédecine – je tiens d’ailleurs à remercier ici sa directrice de nous les avoir transmis –, et je puis vous dire que je n’en ai pas trouvé un seul qui porte sur des cellules embryonnaires provenant d’un embryon dont il aurait impliqué la destruction, ou qui travaille sur des lignées provenant de la destruction d’un embryon.
C'est la raison pour laquelle, me fondant sur ces arguments à la fois juridiques et scientifiques, j’ai déposé un amendement visant à interdire la recherche sur l’embryon lorsque celle-ci porte atteinte à l’intégrité ou à la viabilité de l’embryon.
Avant de conclure, je voudrais vous soumettre une question, mes chers collègues.
Dans le domaine de l’amélioration des techniques de fécondation in vitro, la recherche sur les embryons de mammifères est, elle aussi, une véritable solution alternative puisque les mécanismes du développement embryonnaire sont communs à tous les mammifères. Encore faudrait-il que l’Union européenne permette aux chercheurs de travailler sur l’embryon animal !
En effet, le projet de révision de la directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques exclut désormais les animaux vertébrés non humains vivants, y compris les formes larvaires ou fœtales d’espèces de mammifères. Nous aurons à transposer cette nouvelle directive dans notre droit interne, mes chers collègues. Allons-nous, demain, interdire, avec cette directive européenne, toute expérimentation sur l’embryon animal, mais l’autoriser, aujourd'hui, sur l’embryon humain ?

On nous répète que, de toute façon, ces embryons dépourvus de tout projet parental sont destinés à être détruits. Ce constat, me semble-t-il, appelle deux interrogations essentielles.
D’une part, pourquoi en sommes-nous arrivés à disposer de ces milliers d’embryons surnuméraires ? Que faisons-nous pour enrayer cette grave dérive de nos pratiques médicales ? À cet égard, je tiens à rendre hommage au vote de la commission des affaires sociales, qui a choisi, ce matin, de les limiter.
D’autre part, est-ce parce qu’un être est voué à disparaître qu’il faut l’instrumentaliser ?
Finalement, d’un certain point de vue, la destruction est notre lot commun à tous. Pour autant, céder à l’argumentation instrumentaliste ne fait pas honneur à notre conception de la dignité humaine.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des affaires sociales semblait faire preuve jusqu’à ce matin d’une constance en matière de bioéthique, de sorte que je ne me permettais pas de juger ses décisions, mais seulement de les refuser ; jusqu’à ce que nous acceptions le fameux amendement.
Le choix de mon groupe de soutenir la position du Gouvernement relève non pas d’un aveuglement ou de la soumission, mais de la convergence d’une réflexion engagée bien en amont et fondée sur le respect et la dignité du vivant.
Une loi de bioéthique ne devrait pas seulement être une réponse à des attentes utilitaires d’usagers, de chercheurs. Elle doit fixer un cadre. Il ne peut s’agir du fruit d’un consensus, d’un compromis, dont les règles auraient été élaborées par les utilisateurs.
La vision biomédicale est souvent sacrifiée au profit d’une vision sociétale fondée sur la transparence, le jugement moral d’authenticité et la compréhension par tous.
À droite, nos difficultés de compréhension se manifestent, il faut bien le dire, par une hésitation, voire une confusion ; à gauche, c’est par une cohérence libertaire et la recherche d’une neutralité éthique.
Le but de l’action politique est le service du bien commun, y compris par la fixation d’interdits.
Nous pouvons soutenir que les autorisations encadrées correspondent seulement au respect de procédures et nous affirmons que la matérialisation de l’humain peut être l’enjeu de projets industriels et économiques.
À l’origine de nos difficultés, il y a une conscientisation superficielle, qu’on trouve dans des déclarations de cet ordre : « l’avenir de la médecine est en danger », « la médecine française se prive de possibilités dans un environnement concurrentiel », « l’homme est maître de son destin »…
Assurément, certaines valeurs doivent être défendues, par un personnalisme attentif, par exemple. Mais l’observation quotidienne de notre société n’est pas suffisante pour comprendre les enjeux de la bioéthique.
Les déclarations des grands thuriféraires alimentent des discours opposés. Il en va de même des résultats scientifiques lorsqu’ils sont extraits de leur contexte, d’autant qu’ils font souvent l’objet dans l’instant d’une surutilisation.
Gilles Lebreton nous invite à une réflexion sur l’identité de l’homme : au fond, le véritable objectif de la loi relative à la bioéthique est de cerner le concept de personne humaine. Celui-ci est la synthèse d’une identité psychologique, d’une identité sociale et d’une identité civile. En droit, cette unité autour du sujet le rend détenteur de droits fondamentaux destinés à le protéger.
La confusion qui s’attache à nos débats, et qui laisse les non-initiés indécis, peut s’expliquer par un manque d’accord sur la définition de l’embryon, c’est-à-dire sur son identité. C’est ainsi que la notion de conflit d’intérêts s’invite dans nos débats, alors que ceux-ci devraient seulement porter sur des idées, des convictions et des engagements.
Dans l’esprit de nos concitoyens, l’inacceptable d’hier devient l’interdit d’aujourd’hui, avant d’être l’autorisé de demain. Alors, nous ne comprenons plus : nos valeurs seraient à géométrie variable, fluctuant en fonction des évolutions technologiques et de la pression sociétale.
Il n’est pas question de sacraliser, de figer des concepts immuables. Il s’agit en revanche de se confronter à de nouvelles interrogations. Nous devons tenter de les éclairer et de trouver des réponses, dans le souci du plus grand bien.
À propos de l’identité de l’embryon, faut-il retenir la « personne humaine en devenir » ou la « personne humaine potentielle » ? La question n’est pas hors de propos, car elle conditionne notre choix face à l’interdit.
Dans son avis n° 8 du 15 décembre 1986, le Comité consultatif national d’ethnique a estimé que l’embryon appartenait à l’ordre de l’être, non à celui de l’avoir. La notion de « projet parental » nous est apparue trop faible pour garantir une protection à l’embryon, voire pour le faire accéder à un statut juridique.
Le concept de « personne humaine en devenir » semble plus compatible avec le principe d’autorisation de la recherche sur l’embryon. Nous lui préférons néanmoins le concept de « personne humaine potentielle », compatible pour sa part avec le principe d’interdiction assorti de dérogations : il ne s’agit assurément pas d’un acquis, mais d’un choix.
Je souscris à l’amendement déposé par mon groupe, qui est conforme au dispositif adopté par l’Assemblée nationale ; celui-ci, il est vrai contraignant pour la recherche, se veut protecteur pour l’embryon.
Non identifié, l’embryon n’est ni une personne ni un objet ; au nom du respect du vivant, il doit cependant bénéficier d’une protection.
Aujourd’hui, il nous faut renouer avec les grands principes qui fondent l’identité de la bioéthique : parmi eux, je veux citer la dignité de la personne humaine, l’indisponibilité du corps humain, la gratuité et l’anonymat du don, ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine.
La contrainte imposée à la recherche ne procède pas d’un déni de la raison scientifique ni d’un refus du progrès. Il s’agit d’une mise en garde contre la fascination exercée par les nouvelles technologies. Il s’agit aussi d’un refus de remettre au secteur industriel ou plus généralement au champ économique la maîtrise de la santé publique.
Le projet de loi mentionne des « progrès médicaux majeurs », notion vague qui concernerait les recherches à visée diagnostique et préventive. Si les cellules souches embryonnaires servent au criblage et à la modélisation des maladies, elles constituent des outils : elles permettent de tester des molécules nouvelles en diminuant le coût des essais.
J’observe que le modèle animal – cela a été dit – fait l’objet de réserves énoncées par les directives européennes. On comprend mal, en regard, les résistances qui se manifestent au sujet de l’utilisation des cellules pluripotentes.
Le 31 mars 2011, l’Agence de biomédecine a estimé : « L’utilisation des IPS ne fait aucun doute dans le domaine de la modélisation de maladies, en particulier initialement d’origine génétique, la preuve du concept étant déjà obtenue dans certaines pathologies humaines. »
Il est de bon ton de parler de pragmatisme, d’utilitarisme et de refus de l’obscurantisme. Pour ma part, je me refuse à envisager la science du seul point de vue de son potentiel économique et industriel.
L’application de nos valeurs visant à la protection du corps humain peut être entravée par des choix qui se veulent progressistes et éthiquement neutres.
La sanction viendra de l’Europe, et l’on peut le regretter. Quand, le 10 mars 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un avis relatif à la brevetabilité de l’embryon humain et à son utilisation à des fins industrielles et commerciales, ce fut pour les refuser.
J’ai le plus grand respect pour notre rapporteur, il le sait. Cependant, lorsqu’il parle d’un « interdit symbolique », il vise seulement l’écume et la dimension superficielle du symbole ; il en ignore la signification profonde : l’aide à la compréhension. Il fait valoir que le respect de l’être humain est garanti par l’article 16 du code civil ; je lui réponds que l’encadrement éthique y est insuffisant. L’éthique est reléguée à un système de normes qui doivent être respectées. Il s’agit donc d’un système libertaire qui n’est pas le nôtre.
L’inquiétude de nos concitoyens se porterait sur la bioéthique. Je refuse de me réfugier derrière une transparence qui rend invisible : je lui préfère l’information et la formation sur les sujets de société.

Poser une interdiction de principe serait irresponsable. En effet, je veux rappeler qu’il est plus aisé d’autoriser que d’interdire. Faire appel à l’intelligence des Français, il me semble que c’est faire fi des avatars de la démocratie ; celle-ci est menacée davantage par l’arbitraire que par des dérogations réfléchies et acceptées.
L’interdiction transcende les questions utilitaristes. C’est du vivant qu’il s’agit ! La démarche scientifique conserve la plénitude de sa valeur, tout comme la réflexion philosophique et politique. Nous refusons une chosification, une appropriation du vivant issues de demandes sociales dont nous ne percevons pas les éventuelles conséquences.
Le débat sur le projet de loi de bioéthique doit montrer l’importance que nous voulons donner à la protection de la personne humaine.
Pour conclure, car je vois que j’ai déjà dépassé mon temps de parole, je veux dire que la dignité de la personne humaine et le respect du vivant constituent des fondements de l’éthique biomédicale, alors que la bioéthique est malmenée par des visions minimalistes et la neutralité éthique.
Nous pensons qu’il est possible, grâce aux différents aménagements apportés au projet de loi, de promouvoir une vision du vivant qui soit humaniste, sans pour autant renier notre époque.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

M. Bruno Sido. Ah ! Que pensent les Verts, eux qui sont pour les choses naturelles ?
Sourires sur les travées de l ’ UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les écologistes étaient relativement satisfaits de la version du texte adoptée par le Sénat en première lecture.
En effet, nous tenions particulièrement à mettre un terme au système hypocrite des dérogations accordées pour la recherche sur les embryons et les cellules souches.
Nous nous sommes réjouis de la mise en place d’un encadrement éthique, ainsi que de l’ouverture aux couples de femmes de l’accès à l’assistance médicale à la procréation.
Et puis nos collègues de l’Assemblée nationale ont joué à la perfection la partition qu’on leur avait fournie… Non contents de remettre en cause l’autorisation de la recherche sur les cellules souches et l’élargissement de l’accès à l’AMP, les députés ont encore supprimé la clause de révision des lois de bioéthique, ainsi que l’obligation faite aux membres du conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine et aux experts auxquels elle fait appel de remplir une déclaration d’intérêts ! Et tout cela sous le regard bienveillant du Gouvernement : la majorité est décidément fâchée avec la prévention des conflits d’intérêts…
Il faut dire que les scandales tendent à se banaliser ; pour ne parler que du secteur de la santé, la seule affaire du Mediator est particulièrement éloquente.
Quant au Président de la République, s’il se déclare préoccupé par la prévention des conflits d’intérêts dans le domaine judiciaire, il ne l’est pas autant dans les domaines de la recherche et de la santé…
C’est pourquoi je tiens à rappeler que les écologistes sont favorables à une déontologie de la vie publique qui concerne notamment les acteurs de la santé et de la recherche thérapeutique, domaines où les liaisons entre les laboratoires privés et les agences sont parfois dangereuses.
Nous connaissons le pouvoir de l’Agence de biomédecine et de ses experts, lesquels font autorité dans certaines disciplines comme la transplantation d’organes, la gynécologie, la génétique ou l’hématologie. Il ne s’agit pas là de domaines anodins : nos vies et nos corps sont en jeu !
Le conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine a le pouvoir de déterminer quelles recherches seront menées dans certains domaines sensibles : c’est notamment le cas pour ce qui concerne les recherches conduites sur le cordon ombilical ou sur des cellules souches embryonnaires.
C’est la raison pour laquelle le Sénat souhaitait renforcer l’indépendance des experts de l’Agence de biomédecine. Mais vous, madame la secrétaire d'État, avez déclaré au cours des débats à l’Assemblée nationale : « Le sujet des conflits d’intérêts est largement abordé au cours des assises du médicament. » Comme si un débat sur les conflits d’intérêts n’avait pas lieu d’être pendant l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique !
Madame la secrétaire d'État, lors du débat sur la psychiatrie, alors que je vous interpellais au sujet du manque de moyens dans ce secteur, vous m’avez répondu que ce problème serait traité dans le cadre d’un « grand plan pour la santé mentale ». Permettez-moi donc de vous faire remarquer que ce n’est pas à l’occasion d’« assises » et ou dans le cadre de « grands plans » que se fait la loi. La loi s’écrit ici, avec les parlementaires !

Laisser de côté la représentation nationale rend-il les mesures plus adaptées ? En aucun cas ! Le plan national de développement des soins palliatifs en constitue une illustration. Sur le terrain, les moyens de fonctionnement manquent, les inégalités territoriales persistent et, en définitive, la situation ne s’améliore guère. Nos concitoyens ne sont pas satisfaits : pour eux, il reste toujours très difficile d’accéder à des soins palliatifs.
Je ne prétends pas que la situation serait forcément meilleure si les parlementaires étaient davantage impliqués. Mais je doute qu’un contrôle démocratique minimal, exercé par la représentation nationale, puisse être néfaste...
Fort heureusement, en ce qui concerne la prévention des conflits d’intérêts au sein de l’Agence de biomédecine, la commission des affaires sociales du Sénat a confirmé sa préférence pour la version adoptée en première lecture.
Je me félicite d’ailleurs qu’elle ait rétabli de nombreuses dispositions que nous avions adoptées en première lecture, y compris en ce qui concerne l’autorisation de la recherche sur les cellules souches embryonnaires.
Les sénatrices et les sénateurs d’Europe Écologie-Les Verts n’en resteront pas moins mobilisés sur les sujets qui demeurent en suspens. Je pense en particulier à l’autorisation accordée aux couples de femmes de recourir à l’aide médicale à procréation, ainsi qu’à la reconnaissance par le droit français des enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger.
En outre, je souhaite vivement que, rompant avec une discrimination qui n’a plus lieu d’être, nous autorisions enfin les hommes homosexuels à accomplir cet acte citoyen qu’est le don de son sang.
J’espère que nous saurons garder la tête froide lors de nos débats et retrouver la sagesse qui a présidé à nos travaux lors de la première lecture : ainsi, nous pourrons faire une loi novatrice, progressiste et en phase avec notre temps.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

M. André Lardeux. Au début du siècle précédent, le philosophe Émile-Auguste Chartier disait que si l’on conduisait les trains comme on conduisait l’État, le machiniste aurait une fille sur les genoux.
Sourires
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Certaines semaines, en effet, il ne se passe rien, sinon des débats oiseux et stériles dont l’utilité suscitera des interrogations chez les historiens, à moins que ces derniers n’en comprennent très vite l’unique objectif, qui est d’empêcher le Parlement de travailler efficacement et de se mêler de ce qui le regarde.
Aujourd’hui, une fois de plus, le débat sur la bioéthique a été décalé dans des conditions que, personnellement, je ne juge pas conformes à l’importance du texte considéré.
M. Dominique de Legge applaudit.

Nonobstant, et tout en étant en désaccord sur le fond avec un certain nombre de points du texte, je tiens à saluer le travail fait par notre rapporteur, Alain Milon.

En matière d’éthique appliquée au domaine biomédical, selon moi, l’éthique de conviction l’emporte, et le droit à l’objection de conscience m’oblige à m’exprimer.
L’Assemblée nationale a corrigé plusieurs dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, mais des questions cruciales demeurent qui me conduiront à voter contre le texte, sauf évolution que je ne prévois pas pour l’instant, d’autant que la commission a réintroduit une disposition que, personnellement, je ne peux pas accepter.
Cette disposition centrale se situe à l’article 23, relatif à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires : se pose toujours la question du statut de l’embryon au regard de la singularité individuelle de l’être humain.
L’histoire enseigne que la considération que l’on accorde aux plus faibles, aux plus démunis – et qu’y a-t-il de plus faible et de plus démuni que l’embryon ? –, est le reflet de celle que l’on concède à l’homme. Le manque de respect à l’égard de l’embryon du fait de son absence de capacité peut nous mettre sur le chemin du manque de respect envers tout homme considéré comme sans qualité. C’est pourquoi il était plus simple de proscrire la recherche sur l’embryon, considérant qu’il s’agit d’une vie humaine commencée et que cette vie est sacrée.
L’embryon étant une personne, il ne peut être soumis à la recherche ou à une manipulation aboutissant à sa destruction, car il est une personne unique, dont l’autonomie est absolue et qui ne peut subir d’expérimentation puisqu’il ne peut y consentir.
Certains, pensant déconsidérer cette position, la taxent de retardataire, de ringarde, sous le prétexte qu’elle serait dictée par un « lobby catholique ». C’est un argument bien court, et caricatural ! D’ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi les catholiques ne pourraient pas s’exprimer sur le sujet.

Ce droit d’expression est d’ailleurs garanti par la loi de 1905.
N’étant ni le représentant ni le porte-parole de l’Église, j’assume pleinement mes positions et j’affirme que l’Église n’a jamais exercé la moindre pression sur moi : elle se contente de conseiller, d’interroger ma foi et ma raison, me laissant déterminer le sens de mes votes. Du reste, cela est valable pour tout le monde, chacun ayant sa référence philosophique.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

À partir de là, taxer les uns ou les autres d’hypocrites, de ringards, que sais-je encore, n’a pas de sens. Je ne ferai pas à ceux qui pensent autrement que moi l’injure de les soupçonner d’être le relais des puissants lobbies que sont les multinationales de l’industrie pharmaceutique, lesquelles, bien sûr, veulent rentabiliser leurs mises de fonds.

L’autorisation de la recherche lève le masque de la marchandisation inavouée de l’embryon et confirme la mise en place d’une exploitation de l’homme par l’homme.

Cela est d’autant plus regrettable que d’autres voies de recherche semblent bien plus prometteuses, sans poser les mêmes problèmes éthiques.

Un second point me paraît mériter discussion, c’est la confirmation de la dérive eugéniste de notre société, qui correspond à une demande de plus en plus formulée et acceptée.
L’article 9 confirme que la chasse au trisomique est décidément ouverte.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Il faut faire disparaître ce paria, qui empêche de penser qu’il ne peut y avoir que des hommes parfaits.
Mme Raymonde Le Texier proteste.

Il est vrai que le marché du dépistage est tellement juteux que la vie des plus faibles n’y résiste pas et que l’on ne veut pas voir les affres dans lesquelles on plonge nombre de femmes et de familles. Ce n’est d’ailleurs que le prélude à d’autres traques.

Quelle horreur ! Et quel manque de respect pour les femmes enceintes ! Comment pouvez-vous dire cela ?

Aussi, madame la secrétaire d’État, j’attends avec intérêt de savoir si vous êtes favorable à une redistribution des sommes dépensées pour le dépistage de la trisomie, afin de financer la recherche sur cette même affection et les moyens de remédier à ses conséquences. Êtes-vous disposée à doter cette recherche de financements publics, alors qu’elle en est actuellement exclue ?
Le troisième point que je veux souligner, même s’il n’est plus en discussion, c’est celui de l’anonymat du don de gamètes et de l’accouchement sous X.
Je regrette que l’on nie ce problème. Il faudra, un jour, mettre nos textes en accord avec les engagements internationaux que nous avons pris sur le droit à la connaissance des origines.
Je ne voterai donc pas ce texte qui nous pousse encore plus loin dans la transgression. Nous sommes en train de lever les derniers obstacles avant que le déferlement de l’utilitarisme n’emporte tout, sous prétexte que cela se fait ailleurs, la fin justifiant les moyens et cela devenant la raison des fins.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
TITRE IER
EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS MÉDICALES
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1131-1 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 1131-1, sont insérés des articles L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1131-1-2. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1.
« Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.
« Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause.
« Lorsque est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d’un ou plusieurs enfants ou chez l’un des membres d’un couple ayant effectué un don d’embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
« Art. L. 1131-1-3. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 et à l’article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 1131-1. »
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
I et II. –
Non modifiés
III. – Le second alinéa de l’article 226-28 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code ».
IV. – L’article L. 1133-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « et de l’autorisation prévue à l’article L. 1131-2-1 du même code ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Après l’article 226-28 du code pénal, il est inséré un article 226-28-1 ainsi rédigé :
« Art. 226 -28 -1. – Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende. »
II. – Après l’article L. 1133-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133 -4 -1. – Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de la peine prévue à l’article 226-28-1 du code pénal. » –
Adopté.
TITRE II
ORGANES ET CELLULES
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur » ;
a) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’incompatibilité entre la personne ayant exprimé l’intention de don et la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre d’un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L’anonymat entre donneur et receveur est respecté. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement » sont remplacés par les mots : «, des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé » et les références : « premier et deuxième alinéas » sont remplacées par les mots : « premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas » ;
c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de prélèvement sur une personne mentionnée » ;
2° L’article L. 1231-3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération, les risques que celle-ci » sont remplacés par les mots : « d’un prélèvement et d’une greffe d’organe, les risques que le prélèvement » et est ajouté le mot : « potentiels » ;
3° À l’article L. 1231-4, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les dispositions applicables aux dons croisés d’organes, ».
II à IV. –
Non modifiés

L'amendement n° 8, présenté par MM. Cazeau, Godefroy et Michel, Mmes Le Texier, Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et stable depuis au moins deux ans
par les mots :
, stable et avéré
La parole est à M. Bernard Cazeau.

Cet amendement vise à revenir, s’agissant du lien affectif unissant un donneur d’organe et le receveur, à la formulation adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à modifier la rédaction adoptée par le Sénat sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car, hors du cadre familial, il faut pouvoir vérifier la stabilité d’un lien. Il me semble que c’est une disposition raisonnable et plutôt sécurisante.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
V. - L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement de la personne à un tel prélèvement peut être inscrit, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin doit prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition ou le consentement au don d’organes éventuellement exprimé de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »
VI. - Au 2° de l’article L. 1232-6 du même code, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».
La parole est à M. François Fortassin.

Le présent amendement vise à ajouter au registre national des refus de don d’organes un registre national des consentements au don, à l’instar de ce qui a été mis en œuvre au Canada.
Il est évident qu’un certain nombre de personnes, sans avoir jamais exprimé explicitement un refus, ne sont pas pour autant considérées par leurs proches comme ayant consenti à donner leurs organes si elles devaient un jour se trouver dans une situation extrême. Aussi, dans le cas d’un patient qui est entre la vie et la mort à la suite d’un accident de voiture, par exemple, la famille hésite souvent quant au don d’organes. En revanche, la personne en bonne santé, si elle sait que cela peut contribuer à sauver des vies, donnera certainement son accord pour un éventuel don d’organes.
Par conséquent, avec cet amendement, nous souhaitons l’enregistrement du consentement explicite des personnes en bonne santé à un don d’organes, considérant que cela permettra d’éviter qu’environ un millier de greffons ne soient perdus en raison d’un refus de la famille après un accident.

L'amendement n° 19, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
V. – L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître de son vivant son souhait quant au prélèvement, en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé agrégeant les fichiers positif et négatif de donneurs d’organes. La volonté du donneur est révocable à tout moment.
« Le registre national automatisé mentionné à l’alinéa précédent est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que la personne décédée est inscrite au registre national automatisé, les proches du défunt sont informés de cette volonté et de leur droit à connaître les prélèvements effectués. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition » sont remplacés par les mots : « s’efforce de recueillir auprès de ses proches l’accord ou l’opposition ».
VI. – Au 2° de l’article L. 1232-6 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».
La parole est à Mme Annie David.

Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté par M. François Fortassin puisque nous souhaitons la création d’un « fichier positif » de donneurs d’organes.
Toutes et tous ici, nous avons l’intention de créer un cadre législatif permettant d’encourager la pratique du don d’organes post mortem, qui permet de sauver des dizaines de vies chaque année.
Les associations de malades en attente de greffe espèrent des gestes forts, de vraies décisions courageuses, en accord avec nos principes.
Il ne s’agit pas de stigmatiser celles et ceux qui font le choix de ne pas donner. Comme nous le verrons aussi à l’article 23, dont nous débattrons sans doute demain, cela relève d’un choix personnel et tout à fait respectable.
Il ne s’agit pas non plus de revenir sur le principe du consentement présumé. Toutefois, ce consentement présumé est bien souvent contredit par les familles, non par refus du don, mais simplement par méconnaissance de la volonté réelle du défunt.
Si le consentement présumé reste, à notre avis, une mesure adaptée, nous souhaitons y ajouter la possibilité d’inscrire son nom sur un registre positif de donneurs d’organes. Cet ajout n’est, selon nous, nullement superflu et, de surcroît, la mise en place d’un tel registre ne présente pas de difficulté. Il permettrait simplement à toutes celles et à tous ceux qui détiennent des « cartes de donneur », et ils sont nombreux, d’être reconnus comme tels, alors que ces cartes n’ont actuellement aucune valeur.
On sait que la quasi-totalité de nos concitoyens respectent la décision du défunt lorsqu’ils la connaissent, mais il nous paraît opportun de créer ce fichier positif des donneurs d’organes.
L’efficacité des campagnes d’information sur le don d’organes favorise le dialogue dans les familles, lequel est très souvent à la base de l’acceptation du principe du don. À nos yeux, toutes les mesures qui favorisent le don d’organes, surtout lorsqu’elles ont le mérite d’être simples à mettre en œuvre, doivent être encouragées.

La loi Caillavet repose sur le refus : les personnes qui refusent de donner leurs organes doivent s’inscrire sur le registre national des refus. Par conséquent, toute personne qui ne figure pas sur ce registre est présumée avoir accepté de donner ses organes.
La mise en place d’un registre des donneurs d’organes, registre dit « positif », serait, aux dires des chercheurs et des médecins que nous avons consultés, source d’une complexité supplémentaire.
Étant entendu, premièrement, que le principe est que celui qui ne refuse pas de donner ses organes est considéré comme un donneur implicite, deuxièmement, que la mise en place de ce registre positif entraînerait des difficultés, notamment matérielles, et troisièmement, que, lors de l’examen en première lecture, nous nous sommes prononcés pour une information de l’assuré par la sécurité sociale à réception de sa carte Vitale, afin qu’il sache qu’il est considéré comme donneur sauf en cas d’inscription de son refus sur le registre, nous préférons en rester au registre des refus.
De plus, avec un registre positif, si ceux qui acceptent le don omettaient de faire la démarche de s’inscrire, ils seraient nécessairement considérés comme étant opposés au don. Le nombre de donneurs se trouverait alors considérablement réduit, de même que, finalement, celui des dons, ce qui accroîtrait encore le manque de greffons.
Voilà pourquoi la commission est défavorable à ces amendements.
Je suis tout à fait d’accord avec M. le rapporteur : si ces amendements étaient adoptés, on passerait en quelque sorte d’un régime de consentement présumé à un régime de consentement exprès, ce qui risquerait de fragiliser profondément le système en vigueur. L’avis est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
(Non modifié)
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-2. – Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s’inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance d’intervenants extérieurs. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 1211-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211 -6-1. – Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. »

L’article 5 quinquies AA a déjà fait l’objet d’un important débat dans notre hémicycle. Il s’agissait, chacun s’en souvient, de lever la discrimination dont sont victimes les homosexuels en matière de don de sang.
Cette discrimination, qui date de 1983, c’est-à-dire de l’époque où les pouvoirs publics ont enfin pris conscience de l’existence d’une maladie aux apparences de pandémie, n’est plus scientifiquement justifiée aujourd’hui puisque chaque don fait l’objet d’un questionnaire et d’un test.
La logique qui présidait à l’interdiction s’appuyait sur la notion de « public à risque ».

Il faut avoir le courage de dire que, s’il n’y a pas de public à risque, il existe en revanche des pratiques à risque. C’est sur ce point que mon analyse diffère de la vôtre, monsieur Sido, et c’est pour cette raison que nous soutiendrons l’amendement déposé par nos collègues du groupe socialiste.
La rédaction actuelle de cet article n’est pas pleinement satisfaisante. Si nous ne doutons pas que les uns et les autres ici soient contre les discriminations, nous craignons que, en l’état du texte, les couples homosexuels ne demeurent discriminés. Il suffit en effet que l’homosexualité soit considérée, dans un décret ou une ordonnance, comme une « contre-indication médicale » pour que, nolens volens, cette discrimination perdure.
Nous considérons qu’il faut être plus clair et que la loi doit préciser que les discriminations fondées sur les orientations sexuelles sont interdites dès lors qu’il s’agit de dons de sang ou d’organes. Voilà pourquoi nous voterons en faveur de l’amendement déposé par notre collègue Bernard Cazeau. Nous nous abstiendrons sur cet article si cet amendement n’est pas adopté.

L'amendement n° 9, présenté par M. Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
en dehors de contre-indications médicales
par les mots :
en raison de son orientation sexuelle
La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Fischer a pratiquement présenté cet amendement, ce dont je le remercie.
En évoquant dans cet article des « contre-indications médicales », on évite de prendre en compte le problème des donneurs homosexuels. Il y a là une ambiguïté qu’il convient de lever.
Bien sûr, il faut exclure les donneurs en cas de contre-indication médicale, mais il ne faut pas laisser perdurer la pratique actuelle, qui consiste à interdire les dons des donneurs homosexuels, y compris, comme on l’a vu, de moelle osseuse. Je pense notamment à l’homme ayant mené une grève de la faim à Toulouse.
Le lien entre sida et homosexualité, cela remonte aux années quatre-vingt ! C’est vrai, lorsque le sida est apparu, on l’a assimilé à l’homosexualité. Mais, depuis, les choses ont tout de même évolué ! Aujourd’hui, parmi tous les malades du sida dans le monde, il y a sans doute plus d’hétérosexuels que d’homosexuels.
Cet amendement vise donc à réparer une injustice.

La commission est défavorable à cet amendement.
En effet, dans le cadre des travaux que nous avons menés à l’occasion de la première lecture de ce texte, nous avions retenu la rédaction suivante : « Nul ne peut être exclu du don en dehors de contre-indications médicales. » L’Assemblée nationale a souhaité préciser qu’il s’agissait en l’occurrence du don de sang, et nous n’avons pas cru bon de modifier cette nouvelle version.
Cette rédaction nous semble largement suffisante puisque ce sont bien des contre-indications médicales qui doivent exclure un donneur dans le cadre d’un don de sang, et non pas ses orientations sexuelles.
Je préfère retenir la formule mentionnant l’absence de contre-indications médicales, qui ne stigmatise pas les homosexuels.
Au demeurant, sans doute serait-il utile que le ministère de la santé modifie l’arrêté mis à la disposition des médecins effectuant le prélèvement. Je pense notamment aux questions qui sont posées au donneur, en particulier sur ses relations sexuelles. Mais ce problème ne relève pas du domaine de la loi.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je comprends parfaitement que la contre-indication concernant les hommes ayant des relations avec d’autres hommes soit un sujet sensible.
Les contre-indications sont établies au vu des données épidémiologiques, techniques et scientifiques du moment. Il est vrai qu’elles ont vocation à être révisées régulièrement en fonction de l’évolution de ces données.
Je voudrais simplement rappeler que la majorité des pays européens, qui sont, au même titre que la France, préoccupés par cette question, ont choisi d’appliquer cette règle.
À cet égard, je vous signale que le Conseil de l’Europe s’est saisi de cette question et s’interroge sur le bien-fondé de cette contre-indication. Il devrait adopter une résolution d’ici à novembre prochain pour éclairer précisément les États membres sur le meilleur dispositif et son évolution éventuelle.
Tous les pays, et la France au premier chef, sont en effet particulièrement attentifs aux évolutions susceptibles de modifier les contre-indications actuelles au don de sang. Nous examinerons par conséquent avec une grande attention la résolution du Conseil de l’Europe.

Si j’ai souhaité être cosignataire de cet amendement, c’est parce qu’il me paraît aberrant qu’en 2011 la France puisse cautionner une telle discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Je rappelle que l’annexe II de l’arrêté dit « Bachelot » du 12 janvier 2009, érige en « contre-indication » au don de sang « l’homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme » ! Il est donc évident que nos concitoyens homosexuels et bisexuels masculins sont discriminés, car exclus du don de sang.
Je n’ai pas été convaincu par les explications données, lors de la première lecture, par Mme la secrétaire d’État. Non, l’homosexualité n’est pas un facteur de risque pour le VIH ! Ce n’est pas l’orientation sexuelle, mais bien les comportements à risque qui sont en cause dans la transmission du virus.
Par ailleurs, on essaie de nous convaincre du bien-fondé de cette discrimination au motif que le taux de séropositivité serait plus important chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Je me permets donc de rappeler ici les propos de M. Xavier Bertrand, qui, en 2006, précisait à juste titre qu’« il n’y a pas de groupe à risque », mais « des pratiques à risque ».
Les maladies sexuellement transmissibles ne font pas de discrimination entre les hétérosexuels et les homosexuels. D’ailleurs, aujourd’hui, les hétérosexuels sont plus concernés par les nouvelles contaminations que les homosexuels ! Le virus progresse donc plus vite chez ceux qui ne paraissent pas « à risque » aux yeux de Mme la secrétaire d’État.
Rappelons également que, de nos jours, la sécurité des transfusions sanguines est assurée à plusieurs niveaux et permet d’écarter la quasi-totalité des dons contaminés.
Enfin, au-delà de ces indications chiffrées, je rappelle qu’il s’agit, en pratique, d’un questionnaire réalisé au moment du don. Certains citoyens peuvent tout à fait considérer que leur orientation sexuelle ne regarde qu’eux, car elle relève de l’intimité de leur vie privée. Des hommes peuvent donc ne pas souhaiter indiquer, lors du don, qu’ils ont eu des rapports sexuels avec d’autres hommes. Cette interdiction, indépendamment de son caractère discriminant, est donc inefficace.

Je voterai aussi cet amendement.
En invoquant le principe de précaution pour justifier une telle discrimination, on oublie de dire qu’il est, en définitive, totalement inefficace.
Personne ne sait qui, dans cet hémicycle, est homosexuel et qui est hétérosexuel. À supposer que je sois homosexuel et que je ne veuille pas le déclarer, ce n’est pas un médecin qui voudrait me faire avouer mon homosexualité qui me fera changer d’attitude à cet égard !
Autrement dit, cette prétendue application du principe de précaution, outre qu’elle présente un caractère absolument discriminatoire, est un paravent de papier de soie puisque son efficacité est nulle. Dès lors, pourquoi s’acharner à maintenir cette disposition en l’état ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 quinquies AA est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. – Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organe comme facteur de refus de contrat d’assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. » –
Adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)

Le Gouvernement a déposé sur l’article 6, dont nous allons maintenant discuter, un amendement que la commission n’a pu examiner ce matin. Je demande par conséquent une brève interruption de séance afin qu’elle puisse se réunir.

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont supprimés ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;
c et d) (Suppressions maintenues)
2° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement, » et, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;
3° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;
4°
Suppression maintenue
5° Le cinquième alinéa de l’article L. 1245-5 est supprimé.
III. –
Non modifié

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 16, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ne peut avoir lieu qu’à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement par écrit. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

L’harmonisation du régime juridique des cellules souches hématopoïétiques issues de sang périphérique ou de la moelle osseuse est bienvenue. Toutefois, nous regrettons qu’il soit procédé à cette harmonisation alors que l’on conserve, dans le même temps, un régime que nous considérons comme une entrave à la volonté de don.
La déclaration de consentement devant le tribunal de grande instance est, à notre avis, de nature à décourager le don. Certes, on peut considérer – et c’est certainement la réponse que l’on nous fera – que l’intervention d’un magistrat constitue une garantie, mais celle-ci peut aussi être un frein à la volonté de procéder au don.
Le don de sang, si l’on se réfère à des situations existantes, n’est pas, quant à lui, astreint à cette procédure. De même, le don de sang périphérique est actuellement soumis au régime du simple consentement écrit. L’harmonisation aurait dû être effectuée sur cette base.
Ce consentement écrit est tout à fait suffisant, à notre avis, car il permet de s’assurer de la volonté du donneur. Si vous considérez que cet accord peut être imposé sous pression, que dire, dans ce cas, du don de sang ou du don de sang périphérique ? Doit-on le « garantir » par la vérification d’un juge ? Selon nous, ce contrôle n’est pas nécessaire, les techniques de prélèvement étant aujourd’hui suffisamment simples pour être assimilées à un don de sang ou de plaquettes. Les risques sont très limités, selon la plupart des praticiens.
Finalement, même si cet article 6 procède d’une intention louable, la conséquence de cette harmonisation à rebours est de décourager le don. C’est la raison pour laquelle nous proposons que le consentement soit établi sur la base du régime propre au don du sang, celui du consentement écrit du donneur, bien suffisant à notre avis.

L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
hématopoïétiques
insérer les mots :
et des cellules mononucléées sanguines
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 6, les cellules hématopoïétiques relèvent des dispositions applicables non pas au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, mais aux cellules.
Ces dispositions doivent également s’appliquer aux cellules mononucléées sanguines, qui servent à la préparation de produits de thérapie cellulaire. Celles-ci sont utilisées dans le traitement des hémopathies malignes comme complément des greffes de cellules hématopoïétiques afin de favoriser la prise de la greffe ou d’obtenir un effet antitumoral.
Les critères de sélection applicables aux cellules permettent de mieux répondre à la spécificité des cellules mononucléées sanguines. Il est donc scientifiquement logique et cohérent d’appliquer à ces dernières les mêmes règles de sélection biologique des donneurs que celles qui sont prévues pour les cellules.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 16, car il lui semble que la suppression du recours au juge pour le prélèvement de moelle osseuse limite la protection du donneur.
En revanche, elle émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, qui vise à donner le même statut aux cellules mononucléées sanguines et aux cellules hématopoïétiques issues de moelle osseuse.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques n’est pas totalement dénué de risques pour le donneur. Le prélèvement est invasif, surtout lorsqu’il est opéré dans la moelle osseuse ; lorsqu’il est réalisé dans le sang périphérique, il faut administrer des facteurs de croissance au donneur qui peuvent avoir, comme tout médicament, des effets indésirables.
Ces caractéristiques plaident en faveur du maintien d’un recueil du consentement par le juge, procédure qui constitue une garantie éthique supplémentaire pour les donneurs, le juge vérifiant qu’un médecin leur a bien délivré une information sur les risques du prélèvement.
En outre, cette procédure, désormais habituelle, ne retarde pas ce type de greffes, lesquelles sont rarement réalisées dans l’urgence.

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 16.

Je voudrais revenir sur le don d’organes, et plus spécialement sur l’information de nos concitoyens en la matière.
Mme la présidente de la commission et M. le rapporteur ont fait valoir à juste titre que, dans ce domaine, la France était, parmi les pays de l’Union européenne, pour ainsi dire exemplaire. Les efforts doivent être poursuivis et c’est pourquoi nous nous inquiétons des conséquences de la révision générale des politiques publiques, qui impose des réductions drastiques de moyens à nos hôpitaux publics.
Le problème se pose à Lyon, où est menacée une unité de transplantation hépatique. Certes, le dossier vient de connaître une légère évolution, mais on ne peut que déplorer la diminution des moyens ou la volonté de concentrer sur certains centres hospitaliers ce qui se pratique très bien ailleurs.
Nous considérons que l’information de nos concitoyens en matière de dons d’organes est très importante. Nous l’avons dit lors de l’examen du projet de loi en première lecture : tout doit être mis en œuvre, d’une part, pour que ceux-ci soient pleinement informés sur la législation en la matière – il reste beaucoup à faire à cet égard –, d’autre part, pour que la volonté des femmes et des hommes qui font le choix du don de vie soit pleinement respectée.
Monsieur le rapporteur, la seule apposition sur la carte Vitale de la mention « a été informé de la loi en matière de dons d’organes » n’est, à l’évidence, pas suffisante. En effet, dire que nos concitoyens ont été informés ne garantit en rien qu’ils l’aient été vraiment.
C’est la raison pour laquelle nous considérons qu’il faut encore développer l’information. Cela passe par d’amples campagnes, menées notamment par le biais des grands médias audiovisuels – Mme la secrétaire d'État me répondra peut-être qu’au moins une campagne de ce type est organisée annuellement – et en synergie avec les associations militant pour le don. Mais cela passe aussi par le respect de la volonté du donneur : rien ne sert de multiplier les informations si, in fine, cette volonté n’est pas respectée.
C’est pourquoi nous regrettons la suppression des articles 5 sexies et 5 octies, considérant que tout ce qui peut être tenté en vue de favoriser le don doit l’être.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 10, présenté par MM. Cazeau, Godefroy et Michel, Mmes Le Texier, Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé » sont remplacés par les mots : « par écrit » ;
d) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « par le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « par l’équipe médicale ».
La parole est à M. Bernard Cazeau.

Cet amendement, qui est dans le même esprit que celui qu’ont présenté nos collègues du groupe CRC-SPG, vise à revenir au texte du Sénat au sujet du consentement et de la simplification en matière de prélèvement de cellules hématopoïétiques.
Mon seul argument tiendra dans le rappel des propos d’un de nos collègues députés : « Les prélèvements de cellules souches hématopoïétiques s’effectuent soit dans la partie osseuse soit dans le sang périphérique, pratique que facilitent les nouvelles technologies. Dans ces conditions, faire intervenir le tribunal de grande instance, voire le procureur de la République, revient à prendre un fusil pour tuer une mouche. La simplification opérée par le Sénat allait dans le bon sens. »
Je ne peux que regretter que l’on retienne cette procédure qui allonge les délais, car, contrairement à ce que déclarait Mme la secrétaire d’État, les magistrats sont trop peu nombreux pour traiter ces questions dans de brefs délais.

La commission est défavorable à cet amendement, car la suppression du recours au juge limite la protection du donneur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 est adopté.
Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu’en vue d’un don, à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n’est pas intervenu. Le don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1243-2 est ainsi rédigé :
« Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1241-1. Chacun de ces établissements consacre une part de son stockage au don dédié mentionné au dernier alinéa du même article L. 1241-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1245-2, les mots : « ainsi que le placenta » sont remplacés par les mots : «, à l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, ».

L’article 7 tend à encadrer les conditions de collecte et d’utilisation des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire, ainsi que des cellules du cordon et du placenta.
Notre opinion sur cet article tel qu’il ressort des travaux de nos deux assemblées est mitigée.
Naturellement, nous nous félicitons du fait que les parlementaires aient clairement fait le choix de l’interdiction des banques autologues, c’est-à-dire des banques privées à vocation personnelle ou commerciale.
De la même manière, nous saluons l’initiative de notre collègue Marie-Thérèse Hermange, qui a proposé que le sang issu du cordon ombilical ou du placenta soit considéré comme les organes du corps humain, ce qui en interdit de fait la commercialisation.
Nous nous réjouissons également que la commission ait réécrit cet article afin d’affirmer que le don de ces éléments ne peut être fait qu’à titre gratuit. Cette disposition est cohérente à la fois avec le principe de non-commercialisation prévu à cet article et avec la conception du « don à la française », mais cette précision méritait d’être apportée.
Nous sommes toutefois plus réservés sur un second aspect du travail de réécriture de notre commission, celui qui touche à la possibilité de dérogation au caractère allogénique des banques de collectes de sang issu du placenta ou du cordon.
L’Assemblée nationale avait supprimé la mise en place d’un lieu de stockage spécial destiné au don dirigé, autorisé à titre dérogatoire. Nous considérons que cette dérogation, qui dépasse de loin la simple expérimentation, est contraire aux principes fondamentaux qui doivent prévaloir dès lors qu’il s’agit du don d’organes, singulièrement les principes d’anonymat et d’altruisme.
Nous comprenons bien entendu que des familles puissent avoir besoin de cette dérogation, mais nous redoutons qu’elle ne puisse emporter des conséquences négatives et qu’elle ne soit la première étape sur la voie de l’individualisation du don. Aussi avons-nous décidé de déposer un amendement supprimant ce caractère dérogatoire.
Néanmoins, malgré cette réserve d’importance, nous avons fait le choix de voter cet article, considérant que son adoption était de nature à mettre un terme aux tentations de ceux, à commencer par cinquante députés de la majorité parlementaire, qui plaident en faveur de l’instauration de banques privées à vocation commerciale.

L'amendement n° 17, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Guy Fischer.

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réserver un don à une personne issue de la famille de l’enfant né.
Il est très difficile de devoir écarter une possibilité de don. Cela fait partie des doutes qui nous habitent. Mais le don intrafamilial, s’il est tout à fait légitime lorsqu’il s’agit du don d’organes, ne peut être étendu à toutes les formes de don.
À nos yeux, l’autorisation de la pratique du « bébé-médicament » – terminologie que récuse notre collègue Annie David – n’est pas opportune, et ce pour plusieurs raisons, les plus importantes étant d’ordre philosophique.
Cette pratique contrevient à notre vision du don altruiste, gratuit, anonyme, consenti. En l’occurrence, ce sont les parents qui décident pour l’enfant. On peut même dire que l’enfant naît, au mieux, d’une double volonté : celle d’avoir un enfant, mais aussi celle de soigner un autre enfant.
La privatisation du don ôte tout fondement à celui-ci puisque, par définition, en l’occurrence, le consentement du donneur, c'est-à-dire le bébé, n’est pas relevé. On peut d’ailleurs s’interroger sur la perception que cet enfant, devenu grand, aura de sa naissance. Malgré ce que lui diront ses parents, il aura certainement toujours l’impression d’avoir été un enfant « utile », et pas seulement un enfant voulu.
Le changement de perspective dans la notion de don qu’induit la possibilité de la naissance de bébés-médicaments est discutable. Il introduit en effet le fait que le don puisse être privé, c’est-à-dire qu’il soit soustrait à nos principes de non-privatisation du corps humain et de ses composés.
Nous sommes, vous l’avez compris, très circonspects quant à la possibilité ouverte par la rédaction actuelle de ce texte. Ce don ne pouvant être assimilé à un don intrafamilial « classique », nous considérons, au nom de nos principes éthiques, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une possibilité de privatisation du don.

La commission est défavorable à cet amendement puisque notre collègue propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 7, dont je vous rappelle les termes : « Par dérogation, ce don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée dûment justifiée lors du prélèvement. »
Il ne s’agit donc pas ici du double diagnostic préimplantatoire, le DPI-HLA, mais simplement du prélèvement des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et de placenta.
Si l’enfant qui subit le prélèvement a besoin de soins impliquant l’utilisation du sang de cordon, il est normal qu’il soit prioritaire, au même titre que pourrait l’être son frère ou sa sœur.
La commission est défavorable à cet amendement, car elle considère qu’il convient de laisser à l’enfant né malade la possibilité de profiter des cellules hématopoïétiques, des cellules souches de son sang de cordon et de placenta.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car l’alinéa 3 de l’article 7 ne s’oppose en rien au caractère anonyme du don.
Par ailleurs, la possibilité de faire un don de sang de cordon à un membre de la fratrie est prévue dans la législation actuelle. Il n’y a pas de raison d’interdire cette pratique à visée curative ou thérapeutique pour soigner l’enfant né ou un membre de la fratrie.

L’article 7 est le fruit d’un travail important réalisé depuis plus de deux ans au Sénat, travail qui a contribué à donner une impulsion aux découvertes du professeur Gluckman et d’un professeur de l’hôpital Saint-Antoine, à Paris. Je tiens d’ailleurs à saluer l’écoute que nous avons eue à la fois de la part de nos collègues et du Gouvernement.
Il n’y a pas lieu, me semble-t-il, de s’inquiéter des conséquences de la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 7. Elle vise des banques intrafamiliales dans des situations très précises. Le sang de cordon présente la particularité de permettre de soigner certaines pathologies affectant des populations africaines, notamment la drépanocytose. Avec 800 000 naissances et une population très diversifiée, nous aurions intérêt à encourager l’usage de ces thérapies, y compris hors de notre territoire.
La pratique de la banque intrafamiliale vise quasi exclusivement des soins destinés à des enfants atteints de pathologies spécifiques. C’est pourquoi je demande au Sénat d’adopter l’article 7 dans sa rédaction actuelle.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.

TITRE III
DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE
I. –
Non modifié
II. – L’article L. 2131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1. – I. – Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité.
« II. – Toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et appropriée sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse.
« III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.
« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée.
« IV. – En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d’imagerie à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d’une consultation adaptée à l’affection recherchée.
« V. – Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV du présent article, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus.
« VI. – Préalablement au recueil du consentement mentionné au V et à la réalisation des examens mentionnés aux II et IV, la femme enceinte reçoit, sauf opposition de sa part dûment mentionnée par le médecin ou la sage-femme dans le dossier médical, une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens.
« En cas d’échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l’absence d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.
« VII. – Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie médicale faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence, autorisés selon les modalités prévues au titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie. Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.
« VIII. – La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif est autorisée par l’Agence de la biomédecine. »

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse sont proposés à toute femme enceinte au cours d'une consultation médicale.
La parole est à M. Guy Fischer.

La nouvelle rédaction de l’article 9 proposée par l’Assemblée nationale marque, selon nous, un recul malvenu. Sous couvert de promouvoir une information loyale, claire et appropriée, il vise en fait à rendre plus difficile la pratique des diagnostics prénataux.
Avec une telle mesure, le couple a une véritable démarche à entreprendre pour que soient réalisés des examens prénataux. Auparavant, notre texte prévoyait que les couples se verraient proposer systématiquement ces examens ; avec la nouvelle rédaction de l’article 9, ils doivent prendre l’initiative de les demander.
Nous le savons, nombre de nos collègues souhaitent que le diagnostic prénatal soit pratiqué d’une manière plus restrictive, pour des raisons philosophiques que je respecte. On nous parle des interruptions médicales de grossesse décidées à la suite de la détection de maladies graves. D’aucuns prononcent même le mot « eugénisme ». Chacun est libre de son opinion, mais cette nouvelle rédaction porte clairement le sceau des lobbies intégristes les plus durs.
Si ! sur plusieurs travées de l ’ UMP.

La notion d’information « loyale, claire, et appropriée » laisse une curieuse impression de dénigrement du diagnostic prénatal. Cela fait partie de ces choix philosophiques et religieux que nous ne partageons pas tous et qui ont été fortement exprimés ces quinze derniers jours.
Il ne s’agit pas de viser particulièrement ces personnes qui, par choix religieux, sont très réservées sur les interruptions médicales de grossesse et, partant, sur les diagnostics prénataux.
Soyons clairs : on ne peut qu’être admiratif devant le dévouement que les familles portent à leurs enfants atteints de troubles génétiques graves.
Mais nous devons également considérer d’autres faits. La vie de ces familles et de leurs enfants est très difficile. Handicap mental, espérance de vie très réduite : ce sont des pathologies extrêmement lourdes, dont les effets, tant sur les enfants atteints que sur l’entourage familial, sont incalculables. Certaines pathologies sont si lourdes qu’elles anéantissent la vie de familles entières.
Nous ne pouvons pas occulter le fait que de nombreux couples ne souhaitent pas assumer une telle charge, sans parler de ceux, très nombreux, qui n’en ont même pas la capacité matérielle.
Oui, la détection de maladies très handicapantes lors d’un DPN est très souvent suivie d’une IMG. Mais ce choix n’est en rien automatique : il est mûri. Et parce que ce choix est toujours difficile, il faut le respecter.
C’est pour cette raison que la possibilité de réaliser des DPN ne peut être rendue plus difficile. Ces diagnostics doivent être proposés expressément, et non de manière détournée, en instaurant un filtre supplémentaire. En dernier recours, et si le DPN établit la présence d’une maladie très grave, le couple dispose de l’information la plus large lors de la décision relative à l’interruption médicale de grossesse. Ceux qui souhaiteraient conserver leur enfant peuvent le faire. Les autres doivent de toute manière savoir si leur enfant est porteur ou non d’une maladie grave.
Le sens de notre amendement, qui vise à rétablir l’alinéa 4 de l’article 9 dans sa version initiale, est donc le suivant : clarifier la procédure en essayant de rendre plus simple la décision du couple de réaliser un diagnostic prénatal.
M. René-Pierre Signé applaudit.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse sont proposés, lorsque les conditions médicales le nécessitent, à toute femme enceinte au cours d’une consultation médicale.
La parole est à M. Bruno Retailleau.

L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture, qui est plus claire que sa nouvelle rédaction, même s’il faut reconnaître que cette dernière est meilleure que celle que le Sénat avait votée.
Le problème du diagnostic prénatal tient d’abord au ciblage d’une affection particulière : la trisomie 21. Il ne s’agit pas de dénier tout choix pour les familles, mais il convient simplement de se demander s’il n’est pas préoccupant d’instaurer en France une proposition systématique du dépistage centrée sur une seule maladie.
En outre, avec cette pratique, on s’éloigne de l’usage habituel du dépistage. Le dépistage, en général, est lié à la recherche d’une affection et à l’existence d’un risque pour une population, par exemple parce que la femme enceinte a atteint un certain âge ou qu’il existe un problème héréditaire potentiel.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Payet, M. Détraigne, Mme Hermange et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
reçoit
par les mots :
se voit proposer
2° Remplacer les mots :
loyale, claire et appropriée sur la possibilité de recourir, à sa demande,
par le mot :
relative
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Le code de déontologie médicale, contenu dans le code de la santé publique, indique clairement que c’est au médecin d’ajuster sa prescription à un examen objectif de la situation du patient. Pour quelle raison en irait-il autrement dans le cadre du suivi de grossesse ? La distinction qu’un médecin établit entre ses patients est non pas une atteinte au principe de justice mais bien une adaptation personnelle du médecin à chaque cas particulier.
Il serait par ailleurs absurde et traumatisant d’informer chaque femme enceinte de tous les risques potentiels de maladies et de handicaps qu’elle-même et son bébé encourent. Vouloir tout dépister est illusoire et fait perdre en sérénité la médecine prénatale.
Si ce dépistage n’est destiné qu’à la trisomie 21, il est alors l’instrument de l’organisation d’une pratique eugénique, condamnée par l’article 16-4 du code civil et punie de vingt ans de réclusion criminelle par le code pénal.
En effet, le dépistage de cette affection a comme conséquence quasi inéluctable l'interruption médicale de grossesse. Parce que la proposition de dépistage ainsi ciblée devient une obligation pour le médecin, la formulation de l'alinéa 4 de l’article 9 correspond bien à la mise en œuvre d'une pratique eugénique tendant à la sélection des personnes trisomiques, ce qui est en contradiction avec la loi.
Il est utile d'avoir en mémoire les recommandations du rapport du Conseil d'État sur la révision des lois de bioéthique : « L'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l’enfant parfait, ou du moins indemne de nombreuses affections graves. »
Le Conseil d’État ajoute : « Le cas de la trisomie 21 appelle à la vigilance : en France, 92 % des cas de trisomie 21 sont détectés, contre 70 % en moyenne européenne, et 96 % des cas ainsi détectés donnent lieu à une interruption de grossesse, ce qui traduit une pratique individuelle d'élimination presque systématique des fœtus porteurs.
« Il convient de rester vigilant afin que la politique de santé publique ne contribue pas, par effet de système, à favoriser un tel comportement collectif, mais permette au contraire la meilleure prise en charge du handicap. Il importe également de veiller à ce que le développement des prédispositions génétiques ne se traduise pas par des interruptions de grossesse, sans lien avec le niveau des risques encourus par l'enfant à naître. »

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Payet, M. Détraigne, Mme Hermange, M. Amoudry et Mme Férat, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
appropriée
par les mots :
adaptée à sa situation
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

L'enjeu est de préserver l'équilibre entre la place de la femme enceinte et celle du médecin dans le dialogue médical. L'exigence d'une information « loyale, claire et appropriée » place le curseur du côté de l'autonomie présumée de la femme enceinte, une autonomie en fait limitée pour diverses raisons : sentiment d'infériorité par rapport à la connaissance médicale, fragilité liée à l'état de grossesse, pression sociale… En outre, on rend l'obligation d'information systématique.
Pour rétablir un peu la marge de manœuvre du médecin dans l'information délivrée, cet amendement prévoit de remplacer le terme « appropriée » par les termes « adaptée à sa situation », ce qui permettrait au médecin de dire, par exemple : « Dans votre situation, le risque est très faible. »
Il s'agit ainsi de rétablir le nécessaire équilibre dans le dialogue entre médecin et patiente, sans trop présumer de l'autonomie de la femme enceinte. Cela renforce donc sa liberté.

L’amendement n° 20 tend à revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, qui était d’ailleurs celle du projet de loi initial.
La commission a toutefois approuvé la nouvelle rédaction adoptée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, qui, selon nous, n’a pas une portée très différente, mais qui apaise surtout certaines craintes.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 24 rectifié, la commission a émis un avis défavorable.
Le Sénat a supprimé en première lecture les mots « lorsque les conditions médicales le nécessitent », que le présent amendement tend à rétablir. L’Assemblée nationale a suivi le Sénat en deuxième lecture.
Je l’ai dit dans mon propos introductif, outre qu’il rencontre l’opposition de la quasi-totalité des professionnels et des sociétés savantes, cet amendement remet en question le principe d’autonomie des patients, leur droit à être informés, ainsi que l’égalité de traitement entre les femmes, et il fait peser une responsabilité accrue sur les professionnels.
La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 45 rectifié – à défaut, elle émettra un avis défavorable – au profit de l’amendement n° 44 rectifié, qui, selon elle, apporte une précision utile et importante.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 20.
L’alinéa 4 de l’article 9 du présent projet de loi a effectivement pour objet l’information de la femme enceinte, avec le souci de faire en sorte que cette information soit claire, loyale, appropriée. Il appartient à la femme, à la lumière des éléments qui lui sont délivrés, de demander ensuite à bénéficier d’examens complémentaires.
Cette approche est équilibrée et garantit le droit de la femme enceinte, conformément au code de déontologie médicale.
Les amendements n° 24 rectifié, 45 rectifié et 44 rectifié ont à peu près le même objet. La notion de condition médicale me gêne puisqu’il s’agirait de laisser au médecin le soin de décider dans quelle situation il pourrait procéder à cette information. Or il est une notion qui est, me semble-t-il, encore plus fondamentale, c’est le droit à l’information de la femme enceinte.
Le risque est de créer des disparités de traitement entre les femmes en fonction des appréciations du médecin. Cela est quelque peu contraire au principe de justice et de respect de l’autonomie, en particulier de la femme.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces trois amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
J’apporterai une précision complémentaire. Madame Payet, il est bien question ici, pour le médecin, d’apporter une information sur le dépistage, non de poser un diagnostic. La nuance est importante.

La parole est à M. René-Pierre Signé, pour explication de vote sur l’amendement n° 20.

Je comprends mal pourquoi l’amendement de M. Fischer recueille des avis défavorables. Je ne vois rien de très choquant dans sa proposition : un diagnostic clairement posé et la liberté pour les familles de choisir de conserver un enfant qui, on le sait, sera lourdement handicapé, c’est-à-dire d’accepter une vie très dure.
Il faut avoir vécu près d’une famille au sein de laquelle vit un enfant handicapé pour savoir combien cela rend quotidiennement la vie difficile : je pense aux parents qui retrouvent leur enfant tous les soirs et, avec lui, le chagrin et la douleur, qui sont souvent dans l’impossibilité de travailler tous les deux, de prendre des vacances... Qui n’a pas vécu cela ne peut savoir !
On nous objecte l’eugénisme. Mais est-ce que cet enfant serait heureux ? Je ne parle des enfants atteints de la trisomie 21, qui sont très aimants. Je parle des enfants handicapés profonds, pour lesquels il n’existe aucun espoir d’amélioration et dont la maladie va s’aggraver.
Avez-vous conscience du souci que cela représente pour les parents ? Ils savent qu’un jour ils vont disparaître. Que deviendra l’enfant ? Où sera-t-il placé ? Comment sera-t-il traité ?
Nous voulons, à l’instar de Guy Fischer, que les parents aient le choix d’accepter ou non une grossesse dont l’issue sera aussi désastreuse.
L'amendement n'est pas adopté.

Non, je le retire, madame la présidente, au profit de l’amendement n° 44 rectifié, avec l’espoir que chacun s’y ralliera.

L'amendement n° 24 rectifié est retiré.
Madame Payet, l'amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote sur l'amendement n° 44 rectifié.

Je voterai cet amendement, mais, dans son ensemble, l’article 9 me laisse un goût amer. Quoi que l’on en dise, la tentation eugéniste apparaît en filigrane derrière ces différentes dispositions, et les propos tenus à l’instant par notre honorable collègue me confortent dans cette analyse.
J’en profite, madame la secrétaire d’État, pour réitérer la question que j’avais posée précédemment : le Gouvernement est-il disposé à débloquer des financements publics pour la recherche sur la trisomie 21 ?
L'amendement est adopté.
Pour répondre à la question de M. Lardeux, je précise que trois équipes de recherche travaillent spécifiquement sur cette maladie, sans compter les nombreuses recherches portant sur d’autres pathologies qui peuvent améliorer le diagnostic de la trisomie 21 ou la prise en charge des personnes qui en sont atteintes.
Par ailleurs, un rapport sera prochainement remis au Gouvernement qui fera un état des lieux des recherches sur cette maladie et de leur financement.

L'amendement n° 11, présenté par MM. Cazeau et Godefroy, Mme Le Texier, M. Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Bernard Cazeau.

Je regrette que l’amendement n° 20 n’ait pas été adopté, car il était excellent.
La femme de l’un de mes amis a accouché d’un enfant qui souffre d’une agénésie totale de la partie inférieure de la face. Or il se trouve que l’équipe médicale, par laxisme ou pour d’autres raisons, a trop attendu avant de faire les tests.
S’il pouvait donner son avis, croyez-vous que cet enfant, toujours nourri par voie parentérale, et dont l’espérance de vie risque fort d’être abrégée, consentirait à cette vie de martyr, qui a débuté par une dizaine d’opérations chirurgicales ?
Au risque de choquer certains de nos collègues, je déplore l’obscurantisme qui a conduit au rejet de l’amendement n° 20.

L’amendement n° 11 vise à supprimer la possibilité pour le médecin de communiquer aux femmes présentant un risque avéré et à leur famille une liste d’associations agréées.
Il nous semble pourtant que ces associations peuvent rendre de grands services à ces familles. C’est aussi l’avis des professionnels de santé concernés.
De surcroît, le fait qu’il s’agisse d’associations agréées supprime le risque de voir figurer sur la liste des groupes sectaires.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’avis est défavorable.
À ce stade de la démarche diagnostique, le risque que l’embryon ou le fœtus soit atteint d’une affection grave est avéré, et le rôle de l’équipe médicale consiste à accompagner au mieux la femme, en respectant son choix.
Cette liste d’associations, dont l’agrément est un gage de sérieux, est communiquée au nom du droit fondamental à l’information. Les familles ont parfaitement le droit de refuser cette liste, qui leur est simplement proposée, et elles sont ensuite libres de contacter ou non ces associations, qui disposent d’une expérience concrète de ces maladies.
Cette disposition me semble plutôt équilibrée. En conséquence, l'avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 21, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Notre amendement vise à systématiser la poursuite d’examens à visée diagnostique après la détection via le diagnostic prénatal d’une affection grave touchant l’embryon.
Nous considérons en effet que la simplicité doit prévaloir dans ces cas précis, car la femme ou le couple doit avoir en sa possession tous les éléments d’information pour prendre la décision finale. S’il est vrai que le simple diagnostic prénatal peut suffire à détecter ces affections, il est à notre avis opportun de rendre automatique un second examen à visée diagnostique, pour offrir une information la plus complète possible. De cette manière, nous répondons à une demande des couples, qui veulent davantage d’informations sur la maladie potentielle de leur enfant, mais aussi à tous ceux qui veulent que la décision grave de recourir à une interruption médicale de grossesse soit prise en toute connaissance de cause.
Une telle décision n’est pas anodine ; elle marque très souvent un tournant dans la vie d’un couple et il est important que chacun prenne sa décision de la manière la plus éclairée possible. La systématisation d’un deuxième examen constitue une avancée et apportera à ces familles davantage de tranquillité et de temps pour prendre leur décision.

La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission a estimé que le texte était équilibré et qu’il n’était pas souhaitable de le modifier sur ce point.
L’avis est défavorable.
Je comprends néanmoins l’intention des auteurs de cet amendement, car la rédaction de la phrase que celui-ci vise à modifier peut prêter à confusion. Je voudrais donc lever toute ambiguïté : les mots « peuvent être proposés » ne visent nullement à laisser le médecin libre d’apprécier l’opportunité de ces examens, mais renvoient simplement à la disponibilité de ces derniers.
Si des examens complémentaires susceptibles de confirmer ou d’infirmer un premier diagnostic existent, il est évident que le médecin les proposera, conformément aux bonnes pratiques en vigueur. En revanche, s’ils n’existent pas, il ne pourra pas les proposer, d’où la rédaction retenue.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Payet, M. Détraigne, Mme Hermange et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucun document exigeant le refus de la femme enceinte de se soumettre aux examens mentionnés au II et IV du présent article ne doit être exigé.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

La pratique du recueil par écrit du refus de la femme enceinte de se soumettre à certains examens s'est organisée sans base juridique, et les praticiens se plaignent de cette procédure. Sans les exonérer de responsabilités éventuelles, elle présente en effet l’inconvénient d'être anxiogène et source de pression pour les femmes, lesquelles n'ont plus réellement de liberté de choix face aux décisions qu'elles doivent prendre. Elle dégrade peu à peu les relations entre le médecin et ses patientes, qui devraient rester fondées sur la confiance et l'humanité.

Comme je l’ai dit ce matin en commission, cet amendement me semble inutile et mal rédigé.
L’article 9 prévoit un consentement écrit aux examens du diagnostic prénatal. Il n’y a donc pas lieu de spécifier qu’il ne peut être exigé de refus écrit, celui-ci n’ayant aucune valeur juridique.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je précise en outre que, s’il me paraît indispensable que la femme consente par écrit aux examens qu’on pourra lui proposer pour confirmer un diagnostic, il ne me semble pas souhaitable que son éventuel refus soit consigné par écrit.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote sur l'article.

Je suis très touchée par la compassion de nos collègues pour les parents d’enfants handicapés. D’aucuns ont prétendu que l’on ne se rendait pas compte de leur souffrance. J’affirme ici haut et fort qu’elle est la même pour tous les parents, bien qu’elle s’exprime de façon différente.
Il est terrible de vouloir intenter un procès aux parents pour la façon dont ils assument cette épreuve dans leur vie. Heureusement, nous ne réagissons pas tous de la même manière ! Car il me semble que notre premier travail est d’aider ceux qui ne peuvent pas surmonter seuls leurs difficultés.
Je me réjouis que l’on ait adopté l’amendement n° 44 rectifié, dont les termes ne traduisent aucun dénigrement, mais simplement de la prudence, monsieur Fischer.
Cet article 9 me pose encore un problème. Il prévoit en effet que toute femme enceinte recevra une information, alors qu’il n’y a que 2 % des grossesses qui peuvent comporter des risques. Est-il nécessaire de déployer toute cette artillerie d’examens pour seulement 2 % des femmes ? Comme l’a fort bien dit Mme Payet, la grossesse n’est pas une maladie ; c’est une situation normale pour une femme lorsqu’elle a la chance de pouvoir porter un enfant. Dès lors, le fait de placer le couple dans une situation d’anxiété me paraît assez malsain.
Comme l’a fait observer M. Signé, certains handicaps sont extrêmement sévères. C’est bien pour cette raison que le dépistage systématique de la trisomie 21 est si problématique, car le risque de discrimination existe, ce qui ne manquera pas de dresser les parents d’enfants handicapés les uns contre les autres.
Imaginez ce que pourront ressentir des couples mettant au monde des enfants porteurs de handicaps beaucoup plus graves que la trisomie 21 et qui, le plus souvent, n’auront pas été détectés. Aux uns on aura permis de mener soi-disant une vie « lisse » tandis que les autres auront à affronter une existence très difficile.
Pour cette raison, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne voterai pas l’article 9.
L’article 9 est adopté.
(Non modifié)
I. – §(Non modifié)
II. – Au deuxième alinéa du même article L. 2131-4, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au 3° de l’article L. 2131-5 du même code, les mots : « biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro » sont remplacés par le mot : « préimplantatoire ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 2131-4, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-7, le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies : ».

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mmes Hermange et B. Dupont et M. Darniche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.
La parole est à M. Bruno Retailleau.

Avec cet article, nous abordons ce que l’on appelle, un peu trop rapidement d’ailleurs, je le concède, la technique du « bébé médicament ».
Celle-ci soulève un vrai problème éthique. En effet, elle suppose une sélection en deux phases : lors de la première phase, sont éliminés les embryons porteurs d’une anomalie génétique, puis, dans la seconde, ne sont retenus que les embryons considérés comme compatibles sur le plan immunologique.
En elle-même, cette double sélection pose donc problème et conduit malgré tout, quelle que soit l’intention ayant présidé à sa mise en œuvre, à considérer l’enfant comme un simple « gisement de ressources biologiques ».
Quand on sait que, au-delà même de considérations éthiques, il n’y a eu, jusqu’à présent, que très peu de résultats et qu’il existe désormais des alternatives scientifiques permettant, via le réseau mondial des banques de sang de cordon, d’apporter d’autres réponses, cela ne vaut franchement pas le coup de laisser subsister une telle technique.

L’amendement n° 12, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Michel, Mmes Le Texier, Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-7,
La parole est à M. Bernard Cazeau.

L’histoire de ces bébés que j’appellerai pour ma part « du double espoir » est encore dans tous les esprits. Certains, relayés, il faut le dire, par une frange quelque peu rétrograde de la population, ont critiqué le procédé, évoquant – les guillemets s’imposent – « une instrumentalisation de l’être humain au service des autres » ou encore, allant plus loin, une philosophie « eugéniste ». Rien de moins !
Nous devons sortir des dogmes et regarder la réalité en face. Je ne vois pas, dans ces naissances, où se situe l’instrumentalisation. Au contraire, il convient de rappeler que les couples ayant eu recours à une telle technique désiraient des enfants en bonne santé. Ceux qui viennent de naître en France ou à l’étranger n’ont été altérés ni dans leur psychisme ni dans leur physique. Pour réaliser la quasi-totalité de ces opérations, les médecins ont effectué un prélèvement sur le placenta. Jusqu’à preuve du contraire, le placenta n’est pas une personne !
Les opposants à cette option font valoir qu’elle n’est pas la seule. Il est vrai qu’il est aussi possible de puiser dans les réserves des banques internationales de sang de cordon, offert de manière anonyme par des parents à la naissance de leur enfant. Toutefois, il n’est pas toujours possible de trouver un donneur compatible, comme les scientifiques nous le disent. Dès lors, c’est ce même argumentaire qui est instrumentalisé à des fins idéologiques.
En réalité, certains, ici, refusent l’idée même d’une sélection des embryons, en s’appuyant sur des pseudo-principes, lesquels, à mon avis, cachent des convictions d’un autre âge. Pour ma part, je suis du côté de ces parents, de ces couples qui, venant trouver les médecins, ont des parcours de vie terribles : un enfant de la famille est parfois déjà décédé d’une maladie génétique.
En assouplissant juridiquement ce geste, nous ne satisfaisons pas à un quelconque désir futile. Nous aidons des couples qui se dévouent pour un enfant condamné et en désirent un autre pour le bonheur d’avoir, d’abord, un nouvel enfant et, ensuite, pour aider l’aîné malade. On peut toujours avoir peur d’aller trop loin, mais on doit d’abord faire confiance. Chaque fois que la médecine innove, il faut le savoir, on sauve ou on aide des milliers de vies.

Nous avons déjà examiné en première lecture un amendement similaire à l’amendement n° 28 rectifié, qui vise à supprimer le double diagnostic préimplantatoire, dit DPI-HLA.
Dans la mesure où une telle procédure reste tout de même exceptionnelle, strictement encadrée, et en tout cas efficace, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Par ailleurs, l’amendement n° 12 tend à supprimer un ajout fait par le Sénat, en première lecture, sur l’initiative de nos collègues Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet. La commission n’ayant pas souhaité revenir dessus, elle sollicite également le retrait de cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.
Faut-il le rappeler, la première condition pour qu’un double DPI soit pratiqué, c’est qu’il s’inscrive dans le cadre d’un projet parental.
Ce type de diagnostic, reconnaissons-le, offre un véritable espoir à des familles durement éprouvées par la naissance d’un aîné souffrant d’une maladie incurable. Il convient donc de parler de « bébés du double espoir » et je réfute cette idée de « bébés médicaments ».
Je précise que les dispositions législatives actuellement prévues offrent de sérieuses garanties en termes d’éthique puisque le DPI-HLA n’est utilisé qu’en dernier recours. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 28 rectifié ; à défaut, il y sera défavorable.
Les auteurs de l’amendement n° 12, dans un sens totalement contraire à l’amendement précédent, proposent d’élargir les possibilités de recours au DPI-HLA.
Le double diagnostic préimplantatoire est l’aboutissement d’une démarche longue, difficile, coûteuse. Il s’agit d’une technique sophistiquée, mais délicate, qui doit continuer à n’être utilisée qu’en ultime recours. Il convient de vérifier, au préalable, qu’il n’y a pas d’autres alternatives thérapeutiques pour l’enfant aîné malade, je pense notamment à la possibilité d’une greffe allogénique.
Dans la mesure où il n’y a donc pas lieu de revenir sur le cadre strict actuellement en place, qui est respecté par l’ensemble des équipes médicales, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote sur l’amendement n° 28 rectifié.

Mme la secrétaire d’État, par sa réponse, a donné un peu de chair et d’humanité à l’amendement que nous a proposé notre collègue Bruno Retailleau. J’ai en effet trouvé, cher collègue, que vos explications étaient absolument glaciales, sidérantes, paralysantes !
Sur ce problème spécifique, je répéterai ici ce que j’avais eu l’occasion de dire en commission, mais en m’adressant plus particulièrement à vous, mon cher collègue, ainsi qu’à celles et ceux qui sont prêts à soutenir votre amendement.
Tout le monde, ici, sait combien il est extrêmement douloureux de mettre au monde un enfant porteur d’une maladie grave. Pensez-vous qu’il soit scandaleux qu’une famille confrontée à ce drame éprouve le désir d’avoir un enfant de plus ? Trouvez-vous scandaleux qu’elle souhaite que celui-ci soit en bonne santé ? Pensez-vous qu’il soit scandaleux qu’elle se réjouisse de la venue au monde d’un nouvel enfant, susceptible, éventuellement, de guérir celui dont l’état de santé est extrêmement grave ?
Eh bien, moi, je me réjouis que pareilles situations puissent se produire. Il est tout simplement humain de nourrir un tel espoir et tous, ici, nous devrions le partager.

Je voterai l’amendement proposé par Bruno Retailleau pour un certain nombre de raisons que je ne rappellerai pas ici, car ce serait redondant.
Je veux simplement répondre à Bernard Cazeau. Je conçois bien que lui et d’autres aient pu être heurtés ou blessés par les attaques dont ils ont été la cible sur des sites internet. Cela ne l’autorise pas pour autant à stigmatiser ses collègues en les traitant, par le dénigrement, de rétrogrades, de dogmatiques, …

… de porteurs de convictions d’un autre âge. Voilà des arguments dont j’espérais qu’ils ne seraient pas employés dans cette enceinte.
Nous pouvons, les uns et les autres, avoir une approche philosophique différente d’un certain nombre de problèmes. Vous ne m’empêcherez pas de m’inquiéter des conséquences du double DPI, car le risque existe de vouloir faire naître un enfant non pour lui-même, mais pour un autre.

Je ne sais si M. Cazeau jugera mon intervention glaciale ou non, mais je voudrais revenir, en me plaçant sur un autre terrain que lui, sur l’argument médical qu’il a avancé en matière de sang de cordon, selon lequel il n’y aurait pas suffisamment de donneurs compatibles.
Effectivement, si une vraie politique avait été mise en œuvre dans ce domaine depuis une vingtaine d’années, la question ne se poserait pas aujourd'hui. Cela étant, avec le développement attendu du réseau actuel des banques de sang de cordon, nous disposons, au niveau thérapeutique, d’une solution permettant d’éviter le recours systématique au DPI-HLA.
M. le rapporteur l’a souligné, le double diagnostic préimplantatoire est une procédure qui doit être encadrée et rester exceptionnelle. Depuis 2004, il n’y a eu qu’une seule expérimentation, réalisée d’ailleurs quinze jours seulement avant le vote du projet de loi en première lecture.
C’est la raison pour laquelle nous étions un certain nombre à souhaiter que cette technique ne soit maintenue qu’à titre expérimental dans le présent texte. J’ai donc cosigné l’amendement de Bruno Retailleau. S’il n’était pas accepté, je ne pourrais pas voter l’article 11 bis.
Je suis comme Bernadette Dupont. Personne, surtout aujourd’hui, où nous célébrons la Journée nationale du handicap, après avoir voté, en son temps, nombre de dispositions législatives en faveur des personnes handicapées et imposé des normes techniques en matière d’accessibilité, notamment dans le métro, personne, disais-je, ne peut se permettre de se donner bonne conscience et de nous dire que nous avons un regard glacial sur le monde à vouloir proposer un certain nombre de mesures permettant, par le recours à des techniques thérapeutiques autres, de ne pas pratiquer le DPI-HLA !
Applaudissements sur certaines travées de l’UMP. – MM. Philippe Darniche et Bruno Retailleau applaudissent également.

Je souhaite intervenir, car je viens d’être en quelque sorte mis en cause.
Nous avons naturellement tous le droit, sur ces travées, de défendre différentes options philosophiques et politiques, mais j’attends que l’on oppose à mes arguments d’autres arguments, sans me faire de procès d’intention. Il ne s’agit pas d’une course aux émotions. D’ailleurs, l’émotion est mauvaise conseillère lorsqu’il s’agit de délibérer...
Cette double technique de sélection ne fait-elle pas de l’embryon un gisement de ressources biologiques ? Cette question fondamentale, d’autres que moi l’ont posée, y compris le Comité consultatif national d’éthique, qui avait émis, le 4 juillet 2002, de nombreuses réserves à cet égard.
Par ailleurs, comme vient de le dire Marie-Thérèse Hermange, il existe une alternative. Dans ces conditions, vous comprendrez que nous souhaitions déposer des amendements tendant à soulever ce problème éthique, sans pour autant fermer la porte aux familles confrontées à ces situations ; en effet, je le répète, d’autres solutions s’offrent à elles.
Voilà ce que je tenais à dire, sur le ton le moins glacial possible !
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.

Madame Hermange, vous vous appuyez toujours, pour étayer votre argumentation et défendre vos convictions – c’était déjà le cas lors de la discussion générale –, sur des recherches encore balbutiantes qui n’ont pas encore véritablement abouti. Je ne veux pas dire pour autant qu’elles n’aboutiront jamais...
J’ai, moi aussi, des convictions religieuses : j’ai été élevé chez les jésuites.
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et de l ’ UMP.
Sourires.

Je ne suis donc pas un athée...
Il est effectivement difficile de trouver du sang, qui plus est compatible ; mais je souhaite apporter à la question de Mme Hermange une réponse plus large.
Pour ma part, je mets en balance mes convictions avec mon rôle de législateur. Celui-ci consiste à apporter des solutions au plus grand nombre de nos concitoyens en adoptant une législation adaptée, et non à leur imposer mes convictions. Bien des fois, j’ai voté des dispositions sur lesquelles je me posais des questions...
Je respecte toutes les convictions, contrairement à ce que j’entends souvent dire à mon égard ; pour autant, j’estime que le législateur ne doit pas imposer les siennes.

Certains de nos concitoyens attendent une autre réponse. Je m’efforce donc de faire la part entre mes idées et mon rôle de législateur.

M. Bernard Cazeau. … et non pas seulement pour mettre en avant nos convictions, qu’il faut parfois savoir dépasser !
Protestations sur les travées de l ’ UMP.

Ce débat que je lance mériterait d’être approfondi, mais nous n’en avons pas le temps. Je tenais cependant à préciser ce point, car je suis systématiquement mis en cause sur ces sujets. Il est vrai que ma position est différente de la vôtre, ma chère collègue, car nous n’avons pas la même conception du rôle du législateur.
Sourires

Je souhaite rappeler le texte de l’article 11 bis que nous avions voté en première lecture : « Par dérogation aux dispositions prévues par le sixième alinéa de l’article L. 2131-4, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies ».
Cette rédaction signifie clairement qu’il est possible de recourir au double DPI en l’absence de toute autre thérapeutique, en particulier lorsque l’on ne trouve pas de sang de cordon compatible, afin d’apporter une solution aux familles confrontées à ces situations et ayant, par ailleurs, un projet parental.
J’ajoute que l’enfant qui naît n’est pas un « bébé médicament », car on utilise simplement, pour soigner son frère ou sa sœur malade, le sang de son cordon ou de son placenta.
Il ne faut donc pas faire d’erreur ou de confusion : cet article vise à épuiser toutes les possibilités thérapeutiques, y compris la recherche de sang de cordon compatible, avant de recourir au double DPI. Nous devons offrir aux familles l’ensemble des possibilités ouvertes par la science. Sinon, nous les priverions de tout espoir !
M. Bernard Cazeau applaudit.

Ma chère collègue, la discussion n’est pas close ; vous aurez d’autres occasions de vous exprimer.

Mme la présidente. Souhaitez-vous prendre ma place, mes chères collègues ? Il ne peut y avoir d’autres explications de vote !
Protestations sur certaines travées de l ’ UMP.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 11 bis est adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Roger Romani.