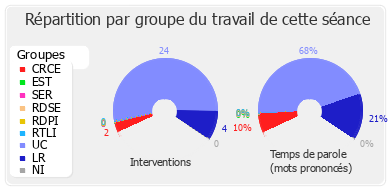Séance en hémicycle du 20 décembre 2010 à 15h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décès d'un ancien sénateur
- Désignation d'un sénateur en mission
- Ratification des nominations à une commission mixte paritaire
- Communications du conseil constitutionnel
- Adaptation du règlement du sénat au traité de lisbonne (voir le dossier)
- Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (voir le dossier)
- Recherches sur la personne (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quinze heures cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jacques Moulinier, qui fut sénateur du Rhône de 2003 à 2004.
Nous présentons à sa famille et à ses proches les condoléances émues de la Haute Assemblée.

Par courrier en date du 17 décembre 2010, M. le Premier ministre a fait part de sa décision de placer, en application de l’article L.O. 297 du code électoral, M. Christian Demuynck, sénateur de Seine-Saint-Denis, en mission temporaire auprès de Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Cette mission portera sur le décrochage à l’université.
Acte est donné de cette communication.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010.
En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du jeudi 16 décembre prennent effet.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le vendredi 17 décembre 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-102 QPC et 2010-103 QPC).
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le lundi 20 décembre 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-104 QPC et 2010-105 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de ces communications.
(Texte de la commission)

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux, présentée par MM. Gérard Larcher, président du Sénat, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, Jean Arthuis, président de la commission des finances, Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, MM. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie, Jacques Legendre, président de la commission de la culture, Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, et Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes (proposition n° 155, texte de la commission n° 176, rapport n° 175).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, mes chers collègues, la proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat, dont nous discutons aujourd'hui, a été rendue nécessaire par l’adoption du traité de Lisbonne et du protocole additionnel.
Le Conseil constitutionnel, saisi après l’adoption du traité de Lisbonne, avait estimé nécessaire que notre Constitution soit modifiée, ce qui fut fait en deux temps, en février et juillet 2008. Ces révisions ont donné naissance à deux nouveaux articles de la Constitution : les articles 88-6 et 88-7.
Ces deux articles, qui reprennent les dispositions du protocole additionnel au traité de Lisbonne, confèrent à notre Parlement, comme à tous les autres parlements de l’Union européenne, de nouveaux pouvoirs. Ces derniers nécessitent, pour être mis en application au sein de notre assemblée, une modification du règlement, laquelle a été élaborée, à la demande du président du Sénat et des présidents de commissions, par nos collègues Jean-Jacques Hyest et Bernard Frimat.
Ce travail a abouti à une proposition de résolution simple, comprenant un seul article, qui vise à modifier certaines dispositions de notre règlement pour rendre applicables les nouveaux droits qui sont conférés à notre Parlement par le traité de Lisbonne.
L’article 88-6 de la Constitution met en œuvre ce qui a été communément appelé le « carton jaune » et le « carton rouge » en matière de respect du principe de subsidiarité. Si l’Union européenne outrepasse les pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, les parlements pourront réagir avant que l’Union ait statué, c’est le « carton jaune », ou après, c’est le « carton rouge ». Dans les deux cas, nos différents organes pourront statuer sans difficulté dans le délai relativement court de huit semaines qui leur est accordé.
Ce délai, qui a été fixé par le traité, nous obligera à faire preuve d’une certaine rigueur dans l’accomplissement de nos travaux : la commission des affaires européennes, puis la commission chargée d’examiner l’affaire au fond devront utiliser intelligemment le délai qui leur est accordé pour que nous ne soyons pas forclos au moment d’émettre un avis motivé ou de saisir, par l’intermédiaire du Gouvernement, la Cour de justice de l’Union européenne.
Il faudra d’autant plus prêter attention à ce délai que le texte que nous examinons aujourd'hui intègre dans notre règlement le droit des groupes parlementaires à demander l’examen d’une proposition de résolution en séance publique. Par conséquent, il faudra être suffisamment rapide pour que la proposition puisse être successivement examinée par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond et par l’ensemble du Sénat en séance publique dans le délai de huit semaines.
La période estivale risque de poser problème : en l’absence de session extraordinaire en juillet ou en septembre, nous sommes en congés parlementaires du 1er juillet au 1er octobre, …

… ce qui risque de rendre difficile le respect du délai des huit semaines.
Toutefois, il semblerait que l’Union européenne soit également, comme les parlements nationaux, en cessation temporaire d’activité pendant les mois de juillet et d’août. Nous ne risquons donc pas grand-chose dans ce domaine ! §
Les deux dispositifs, celui de l’avis motivé, en amont, et celui de la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, en aval, permettront de veiller au bon respect du principe de subsidiarité.
À cela s’ajoutent d’autres dispositions qui obéissent aux mêmes règles que celles que je viens d’indiquer : il s’agit du droit d’opposition du Parlement, prévu à l’article 88-7 de la Constitution, à une modification des règles d’adoption de certains actes de l’Union européenne.
Finalement, notre règlement comprendra trois nouveaux articles : l’article 73 octies, qui détermine les conditions d’application du carton jaune et du carton rouge, l’article 73 nonies, qui transcrit la possibilité ouverte à 60 députés ou à 60 sénateurs de former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, enfin, l’article 73 decies, qui vise à préciser les conditions d’adoption d’une motion tendant à s’opposer à une modification des règles d’adoption des actes de l’Union européenne.
Sur ce dernier point, je vous rappelle que le traité de Lisbonne a prévu des procédures simplifiées, dans lesquelles la règle qui est appliquée n’est plus celle de l’unanimité, mais celle de la majorité. Dans ces cas, en tant que parlement national, nous pourrons nous y opposer pour que la clause passerelle soit abandonnée et que l’on en revienne à la procédure normale de l’unanimité.
Ces modifications du règlement ont fait l’objet de l’approbation unanime des six présidents de commissions permanentes et du président de la commission des affaires européennes, sous l’égide du président du Sénat.
La commission vous engage donc, mes chers collègues, à adopter cette proposition de résolution sans modification.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

La parole est à M. Denis Badré, vice-président de la commission des affaires européennes.

Monsieur le président, mes chers collègues, Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, ne peut être présent parmi nous aujourd’hui. Je vais donc m’exprimer en son nom, en plein accord avec lui.
Pour la première fois, avec le traité de Lisbonne, les Parlements nationaux interviennent au sein même du processus de décision de l’Union européenne.
Cette intervention prend trois formes.
La première est la procédure des avis motivés sur la subsidiarité. Dans cette procédure, les projets d’actes législatifs européens sont transmis directement aux Parlements nationaux. Je ferai remarquer que, si une relation directe entre la Commission européenne et les Parlements nationaux peut apparaître normale chez nos voisins qui ont une tradition parlementaire forte, c’est un peu moins naturel en France. Mais nous en prendrons l’habitude.
Les Parlements nationaux ont dès lors huit semaines – c’est un délai impératif – pour adresser un avis motivé aux institutions législatives de l’Union européenne. Il ne s’agit pas, je le souligne, de se prononcer sur le fond même du texte. La seule question examinée est le respect de la subsidiarité, c’est-à-dire du meilleur niveau pour agir. L’Union européenne ne doit intervenir que si l’objectif poursuivi dépasse les capacités d’action des États membres et qu’une action de l’Union a toutes les chances d’être plus efficace. L’Union ne doit agir que dans la mesure où son action est nécessaire. Elle ne doit pas « charger la barque », aller trop loin dans le détail.
Les avis motivés n’ont un effet contraignant que si un certain nombre de Parlements nationaux en adressent un sur le même texte. Il faut qu’un tiers des Parlements nationaux aient adressé un avis motivé pour que la Commission européenne soit tenue de réexaminer le texte. Ce seuil est abaissé à un quart des Parlements nationaux si le texte concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Ces seuils vont être difficiles à atteindre, soyons lucides. En effet, pour respecter l’égalité entre les Parlements bicaméraux et les autres, on a donné une voix à chaque chambre pour les Parlements bicaméraux et deux voix pour la chambre unique des autres Parlements. Actuellement, il y a treize Parlements bicaméraux et quatorze monocaméraux, c’est-à-dire au total quarante chambres qui auront leur mot à dire.
Pour atteindre le « seuil critique », il sera donc nécessaire de trouver de nombreux alliés. Il faudra constituer des réseaux entre Parlements. Cela demandera de nouvelles habitudes de travail interparlementaire.
Le traité envisage, d’ailleurs, le cas où la moitié des Parlements nationaux adresserait un avis motivé. Dans ce cas, le processus législatif est interrompu et le Parlement européen et le Conseil votent sur la question de la subsidiarité. Si l’un ou l’autre donne raison aux Parlements nationaux, le texte est retiré.
À côté des avis motivés, qui interviennent au début du processus législatif, le traité de Lisbonne accorde une deuxième modalité d’intervention aux Parlements nationaux : la possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. C’est un pouvoir très significatif, même si le recours ne peut porter que sur la subsidiarité et que, là encore, il y a un délai impératif : deux mois après la publication du texte.
Je souhaite souligner en cet instant le rôle de la Cour de Luxembourg, qui semble toujours un peu en retrait et qui est méconnue du grand public. La construction européenne est d’abord fondée sur le droit et la Cour de justice est, avec la Commission, au cœur de la construction communautaire. Le rôle de la Cour de justice de Luxembourg est souvent sous-estimé alors qu’il est essentiel.
Enfin, le traité de Lisbonne met en place une troisième modalité d’intervention des Parlements nationaux : le droit d’opposition à l’utilisation des clauses-passerelles, ces clauses qui permettent, dans certains cas, sans réviser le traité, de changer la procédure de décision de l’Union européenne. Pour cela, il faut d’abord que le Conseil européen ou le Conseil, selon les cas, parvienne à un accord unanime. Ensuite, les Parlements nationaux ont six mois pour manifester leur opposition. Il suffit qu’un seul Parlement national s’oppose pour que la clause-passerelle ne puisse pas jouer.
Dans notre Constitution, nous avons choisi la solution la plus européenne. J’en suis personnellement heureux. Pour que le Parlement français s’oppose, il faut que chaque chambre s’oppose. L’Assemblée nationale ne peut en l’occurrence avoir le dernier mot. Le Sénat dispose donc d’un pouvoir propre important. Si l’Assemblée nationale veut s’opposer à l’utilisation d’une clause-passerelle, elle aura besoin de l’accord du Sénat.
Ces nouveaux pouvoirs ont déjà été pris en compte par les articles 88-6 et 88-7 de la Constitution. Il restait à les traduire dans notre règlement. C’est ce que tend à faire le texte qui nous est proposé.
L’article 73 octies précise les conditions dans lesquelles le Sénat peut, par une résolution, adopter un avis motivé sur la subsidiarité ou décider de former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Le dispositif proposé me paraît être parfaitement dans l’esprit de la démocratie parlementaire. Tout sénateur peut proposer une résolution. À tout moment, un président de groupe peut demander un examen en séance publique.
C’est, en même temps, un dispositif pragmatique. Un premier examen a lieu au sein de la commission des affaires européennes. Si celle-ci adopte une proposition de résolution, cette dernière est transmise à la commission compétente au fond, qui peut la rejeter, l’adopter avec ou sans modification, ou l’adopter tacitement, en laissant expirer le délai de huit semaines sans intervenir. Il n’y a pas de règle précise pour la gestion du délai de huit semaines, l’objectif étant que la commission compétente au fond dispose du meilleur délai possible pour se prononcer.
Ainsi, plutôt que de retenir des règles rigides, on laisse une place aux bonnes pratiques sénatoriales, et c’est très bien. On ne peut tout prévoir et il faut faire confiance aux acteurs de cette nouvelle procédure.
L’article 73 nonies, quant à lui, inscrit dans notre règlement la faculté donnée par la Constitution à soixante sénateurs de former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Cette disposition également est bien dans l’esprit de la démocratie parlementaire puisque, en pratique, c’est un droit dont disposera en particulier l’opposition.
Enfin, l’article 73 decies précise la procédure par laquelle le Sénat peut s’opposer, par le vote d’une motion, à l’utilisation d’une clause-passerelle. Comme le sujet s’apparente à une révision des traités, la commission compétente est la commission des affaires étrangères et de la défense. La décision est prise en séance publique. Ce sont des solutions de bon sens.
On aura compris que j’approuve sans réserve l’excellent rapport de Patrice Gélard. Comme lui, je souhaite que le texte soit adopté sans modification par notre assemblée.
Avant de conclure, je souhaite prolonger quelques instants mon propos. Le traité de Lisbonne a consacré le rôle des Parlements nationaux dans la construction européenne. Cela s’est tout de suite, et très naturellement, traduit dans le contrôle de la subsidiarité, dont nous parlons aujourd’hui. Il est normal que les Parlements nationaux, comme le Parlement européen, puissent s’exprimer sur la répartition des compétences entre les États et l’Union européenne.
L’actualité nous montre, cependant, que le rôle des Parlements nationaux est beaucoup plus large. Ce qui était implicite doit être dit et assumé. La politique de défense et de sécurité relève, pour l’instant, de l’intergouvernemental. Les Parlements nationaux restent compétents pour voter les crédits, pour en contrôler l’usage, pour ratifier des traités de paix. Les budgets nationaux, prérogatives des Parlements nationaux par excellence, vont être mis en coordination et sous surveillance mutualisée des États de l’Union européenne. Les Parlements nationaux ont voté chacun une part de la garantie apportée par le fonds de stabilité européen aux emprunts souverains.
De plus en plus, la relation entre le Parlement européen et les Parlements nationaux va se resserrer. Je cite un dernier exemple : 85 % des ressources du budget européen sont votées par les Parlements nationaux, même si la contribution des États est quasi-obligatoire car elle relève de l’application des traités. Je pourrais citer d’autres exemples montrant que le rôle des Parlements nationaux reste tout à fait majeur dans le cadre de la construction européenne.
En fait, sur cette question de la subsidiarité, mais aussi sur toutes les questions que j’ai énumérées et sur bien d’autres, une excellente concertation entre les Parlements nationaux va devoir être mise en place. De même, un dialogue efficace doit être construit entre le Parlement européen, d’une part, et les Parlements nationaux, d’autre part. La formule de la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des Parlements de l'Union européenne, la COSAC, ou les formules dans lesquelles les commissions du Parlement européen invitent tel ou tel d’entre nous à suivre leurs travaux à Bruxelles ne seront plus suffisantes.
J’insiste sur ce point car nous avons devant nous un grand chantier à défricher. Tout cela fera l’objet, j’en suis sûr, de futurs débats dans notre hémicycle.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, mes chers collègues, le traité de Lisbonne, pour la première fois dans l’histoire de l’Europe, consacre un article spécifique aux Parlements nationaux. Il s’agit de son article 12 selon lequel les Parlements nationaux participent au bon fonctionnement de l’Union européenne. Enfin ! pourrait-on dire.
De mon point de vue, il s’agit là d’une pétition très générale qui pourra avoir des développements très conséquents si les Parlements nationaux acceptent – enfin ! – de prendre en compte la politique européenne et la construction de l’Union européenne, et ce même si le traité de Lisbonne ne donne que deux possibilités aux Parlements européens d’intervenir.
Il s’agit, d’une part, du contrôle du respect du principe de la subsidiarité et, d’autre part, de la possibilité de s’opposer à la modification des règles d’adoption de certains actes de l’Union européenne, c’est-à-dire au passage du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée.
Le groupe socialiste se félicite de cette évolution qui vise à associer plus étroitement les Parlements nationaux aux décisions de l’Union européenne. Est ainsi satisfaite une vieille revendication de la France qui souhaitait que les Parlements nationaux soient mieux intégrés à l’échelon européen pour répondre au défi du déficit démocratique auquel l’Union européenne doit faire face.
La révision constitutionnelle de 2008, en anticipant sur la ratification du traité de Lisbonne, a permis de transcrire dans notre Constitution ces droits reconnus aux Parlements nationaux. C’est l’objet des articles 88-6 et 88-7, créés à cet effet.
L’adoption de la proposition de résolution que nous examinons aujourd’hui, permettra d’insérer dans le règlement de notre assemblée les dispositions nécessaires à l’application de ces nouveaux articles de la Constitution, conformément au traité de Lisbonne.
Ainsi, nous remercions pour cet excellent texte le groupe de travail sur la réforme du règlement du Sénat, dont sont membres Bernard Frimat et Jean-Jacques Hyest. Il est en effet nécessaire de compléter rapidement le chapitre IX bis de notre règlement. Le Sénat a besoin de procédures concrètes et précises pour que les sénateurs puissent faire entendre leur voix à Bruxelles.
Le Sénat, comme les autres Parlements nationaux, joue donc, désormais, le rôle de garant du principe de subsidiarité. Ce principe a été inscrit dans le traité en 1992 afin de guider les interventions de l’Union européenne. Il se définit par la volonté de réserver uniquement à l’échelon supérieur – européen – ce que l’échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. Cette formule vague permet, à mon avis, un certain nombre d’interventions.
Outre le souci d’efficacité de l’action, la subsidiarité doit assurer le maintien d’une certaine proximité entre les citoyens et les lieux où sont prises les décisions qui les concernent. Je ne vais pas détailler à nouveau les procédures retenues, notre rapporteur, Patrice Gélard, l’ayant fait beaucoup mieux que je ne saurais le faire.
Je dirai juste quelques mots sur le droit d’opposition dont disposent les Parlements nationaux dans le cas de la mise en œuvre de ce qu’on appelle les clauses passerelles, qui permettent le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée. Dès lors que le Conseil européen a manifesté l’intention de recourir à une clause passerelle, cette initiative est transmise aux Parlements nationaux, qui ont six mois pour s’opposer à la mise en œuvre de cette clause. Si, à l’expiration de ce délai, aucun Parlement national n’a notifié son opposition, le Conseil européen peut statuer. Encore une fois, cette mesure me semble aller vers une meilleure prise en compte des citoyens européens à travers leur Parlement et l’expression de leurs députés ou sénateurs.
Nous estimons que le texte de la proposition de résolution est à la hauteur des enjeux et qu’il nous permettra de jouer pleinement notre nouveau rôle au sein de l’architecture européenne. Il était temps, me direz-vous !
Les nouvelles procédures retenues présentent l’avantage de ménager un équilibre satisfaisant entre les prérogatives respectives de la commission des affaires européennes et des commissions permanentes comme la commission des affaires étrangères, commissions supérieures, si l’on peut dire, au sein de l’Assemblée nationale comme du Sénat.
De plus, cette procédure est souple dans le sens où elle permet aux acteurs d’organiser leur temps de manière autonome puisqu’il n’y a pas de date butoir entre les différentes étapes mais seulement un cadre général fixé par le traité européen. Toutefois, ce cadre est contraignant et nous devrons faire preuve d’une extrême vigilance pour respecter ces délais, finalement courts, qui nécessiteront une forte réactivité de notre part.
Enfin, nous nous réjouissons particulièrement du fait que la procédure retenue permette à tous les intervenants de provoquer le débat. Ainsi, les présidents de groupe peuvent saisir à tout moment la conférence des présidents d’une demande d’examen en séance publique. C’est un avantage considérable par rapport à la procédure retenue à l’Assemblée nationale qui a transcrit en 2009 ces nouveaux pouvoirs dans son règlement.
De manière générale, le Sénat a choisi une procédure moins contraignante et plus souple que l’Assemblée nationale, ce qui devrait permettre au débat démocratique d’avoir lieu pour que, petit à petit, se construise, avec notre voix et donc celle des citoyens, l’Europe politique que nous appelons de nos vœux.
En conclusion, j’attire votre attention sur la nécessité de travailler conjointement avec l’Assemblée nationale, d’une part, et avec les autres Parlements nationaux, de l’autre. En effet, afin de faire valoir notre opposition éventuelle à la mise en place d’une clause passerelle, le Parlement français devra adopter une motion en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat. C’est une contrainte mais aussi un pouvoir nouveau donné à notre assemblée et qui devrait plaire à nos collègues du groupe RDSE.
De plus, pour qu’une intervention de la part des parlements nationaux sur la base du non-respect du principe de subsidiarité aboutisse, il est nécessaire – je vous le rappelle – d’atteindre certains seuils au niveau européen.
En effet, la Commission a l’obligation de revoir sa copie seulement si un tiers des parlements nationaux émettent un avis de non-conformité. Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent donc mettre fin à la procédure législative que si la majorité des parlements nationaux formulent un tel avis.
Le contrôle de subsidiarité repose, certes, sur l’intervention de chaque parlement national, mais son efficacité en dernier ressort sera fondée sur un effort de concertation interparlementaire, afin d’atteindre les seuils et objectifs que nous visons.
Comme notre collègue et ami Simon Sutour l’a fort justement fait remarquer lors de l’examen de la proposition de résolution en commission mercredi dernier, n’oublions pas que la France est, certes, un des grands pays de l’Europe, mais qu’elle est seulement l’un parmi les vingt-sept États qui composent l’Union.
Il est donc important de souligner que le rôle des parlements nationaux comprend une dimension collective à l’échelon de l’Union.
Afin d’exercer pleinement nos prérogatives, il sera essentiel d’investir dans le développement des réseaux interparlementaires et de dégager rapidement les pratiques les plus propices à une coopération optimale avec nos partenaires européens.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, mes chers collègues, vous le comprendrez, le groupe socialiste votera la présente proposition de résolution.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et au banc des commissions.

Monsieur le président, mes chers collègues, près de trois ans après la modification de la Constitution permettant la ratification du traité de Lisbonne, le Sénat se met à jour, un an et demi après l’Assemblée Nationale. Autant dire que cela n’avait pas l’air très important !
La proposition de résolution concerne la « transposition » dans le règlement du Sénat des dispositions des articles 88-6 et 88-7 de la Constitution.
L’article 88-6 introduit un droit de contrôle du Parlement sur le respect du principe de subsidiarité par les actes législatifs européens.
L’article 88-7 concerne le droit d’opposition reconnu aux parlements nationaux par l’article 48 du traité de Lisbonne.
Avant d’examiner rapidement les dispositions de cette proposition de résolution, je souhaite souligner le caractère presque dérisoire du débat d’aujourd’hui.
En 2008, les défenseurs du traité de Lisbonne promettaient que son adoption renforcerait le rôle des parlements nationaux, notamment via les deux articles que je viens de mentionner. Or ce n’est pas du tout le cas. Un exemple récent le démontre : aucun débat n’a eu lieu sur le plan d’aide à l’Irlande, auquel contribue évidemment notre pays. Mon groupe avait pourtant formulé officiellement une demande en ce sens, dans le cadre de l’article 50-1 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d’organiser des débats de politique générale.
Le Gouvernement et la majorité du Sénat ont refusé cette proposition au double titre, d’une part, que le Président de la République ne devait pas être gêné dans son action et, d’autre part, que les marchés pourraient être inquiets d’une intrusion du politique dans leur sphère.
Une démonstration similaire peut être effectuée s’agissant des politiques budgétaires de chaque État.
L’offensive menée par le Nicolas Sarkozy et les dirigeants européens contre l’indépendance budgétaire des États prend également à contre-pied l’idée d’un renforcement du rôle des parlements nationaux sur des questions importantes.
Il n’est pas possible de défendre l’idée du renforcement des parlements tout en acceptant le principe d’un contrôle préalable des budgets nationaux par les autorités européennes, Commission en tête. Il s’agit, nous le voyons bien, de contester le droit absolu des citoyens à décider des dépenses de leur pays.
En réalité, la mise sous tutelle des États européens, de leurs institutions propres, par la Commission européenne et la Banque centrale européenne, la BCE, se renforce encore avec la crise.
Ce sont bien les « marchés » qui gouvernent l’Europe, au travers d’instances dépourvues de réelle légitimité démocratique. Les agences de cotations et les opinions de M. Trichet pèsent beaucoup plus lourd que les avis ou votes des instances nationales.
Ces deux exemples confirment la faible portée des articles 88-6 et 88-7 de la Constitution, qu’il nous est proposé de rendre applicables aujourd’hui.
Ce que beaucoup, bien au-delà des partisans du non au référendum de 2005, ont appelé le « déficit démocratique » est toujours là. Ce ne sont pas les mesurettes d’aujourd’hui qui y changeront quoi que ce soit !
Le statut de la Banque centrale européenne demeure fondé sur le principe d’indépendance à l’égard des États et a fortiori des parlements nationaux.
Si les souhaits des Français exprimés en 2005 avaient été entendus, le traité de Lisbonne aurait instauré un contrôle politique de la Banque centrale européenne par les parlements européens et nationaux. Nous en sommes bien loin ! Nous voyons bien que, comme je l’ai déjà indiqué, seuls les marchés dictent aujourd'hui leur loi à la BCE.
Plus généralement, nous ne pouvons que le constater, rien n’a changé ! Les institutions européennes n’ont pas été réformées ; elles n’ont pas été démocratisées non plus. Les pouvoirs sont concentrés dans des instances non élues comme, outre la BCE, la Commission européenne ou encore la Cour de justice de l’Union européenne, qui détient – je vous le rappelle – une part importante du pouvoir législatif dans l’Union européenne et, par voie de conséquence, dans chacun des États membres.
À la différence de nos juridictions, la Cour de justice de l’Union européenne statue pour l’avenir par dispositions générales et opposables à tous, comme la loi elle-même.
Qui sont ces juges surpuissants ? Qui les nomme ? Qui les contrôle ? Certainement pas les parlements nationaux, ni le Parlement européen !
Je note enfin que rien n’a été fait pour renforcer la procédure de contrôle a priori de l’élaboration des actes communautaires, l’actuel article 88-4 de la Constitution refusant toujours et encore le caractère de mandat impératif donné par le Parlement aux ministres, contrairement à ce qui existe, par exemple, au Danemark.
Les nouvelles dispositions constitutionnelles à l’égard des parlements nationaux auxquelles cette proposition de résolution fait référence concernent uniquement un contrôle du respect du principe de subsidiarité et un pouvoir d’empêchement relatif de la mise en œuvre de la procédure qui permet de passer du principe de l’unanimité au principe de la majorité qualifiée dans tel ou tel domaine.
En quelques mots, je souhaite souligner que ces dispositions sont de peu de portée, car elles ont peu de chances d’aboutir et concernent des domaines très limités.
Monsieur le rapporteur, vous indiquez dans votre rapport que le contrôle du respect du principe de subsidiarité à l’égard des actes législatifs européens doit se faire dans le cadre d’un avis motivé adressé aux présidents des institutions de l’Union, dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle le projet d’acte européen a été transmis. Ce délai est si court qu’il rend par lui-même la procédure très difficile. Certes, vous nous avez incités à nous dépêcher, mais le fait est là, ce délai est très court.
Par ailleurs, les autorités européennes peuvent « tenir compte » de cet avis – sans plus ! – et il faut qu’un tiers ou 25 % des parlements nationaux se soient prononcés dans le même sens.
Pour le contrôle a posteriori du principe de subsidiarité, grande innovation, les parlements peuvent saisir la Cour de justice, alors que tout Européen pouvait le faire jusqu’alors. Il faut noter que les recours ne peuvent porter que sur le principe de subsidiarité. Là aussi, le délai de réflexion est très court : deux mois.
Enfin, nous n’acceptons pas qu’un recours doive être signé par soixante sénateurs pour être de droit. Nous étions favorables au fait qu’un groupe parlementaire dispose d’une telle prérogative. Un groupe parlementaire ne peut-il pas disposer des mêmes droits que n’importe quel Européen ?

Dernier point important : un parlement national a la possibilité d’opposer son veto à l’utilisation d’une clause passerelle par les autorités européennes. Mais c’est la moindre des choses !
En effet, l’article 48 du traité de Lisbonne prévoit la possibilité d’abandonner la règle de l’unanimité, pourtant fixée comme principe, dans tel ou tel domaine par les parlements ou peuples qui l’ont validé.
Ces clauses passerelles permettent de remettre en cause la souveraineté de chaque État dans des secteurs où elle était maintenue jusqu’à présent. C’est un acte suffisamment lourd pour mériter un avis éventuellement contraire !
Cela étant, la proposition de résolution en elle-même n’est que la mise en musique réglementaire de la Constitution. Elle ne pose donc pas de problème en soi. Par conséquent, nous nous abstiendrons.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, mes chers collègues, il n’est certainement pas dans mes intentions – je dois avouer que ce ne serait sans doute pas non plus dans mes possibilités – de me livrer à une critique de la proposition de résolution qui fait l’objet de ce débat.
Le seul fait qu’une telle proposition résulte de la coopération du président de notre assemblée et des présidents des différentes commissions, avec la contribution sur certains points du groupe de travail formé par M. le président de la commission des lois et notre collègue Bernard Frimat, constitue pour moi et pour mon groupe la meilleure des garanties.
Je suis ainsi conduit à formuler à cette occasion quelques réflexions d’une portée plus générale.
Ma première réflexion porte sur la forme, pour relever la complexité du système institutionnel européen. Je n’en fais aucun reproche puisque cette complexité est liée au fait que la construction européenne est, par nature, une entreprise complexe, à plus forte raison dans les circonstances actuelles : l’échec si fâcheux du projet de traité constitutionnel européen, qui aurait amené une certaine clarté, a conduit à ce traité de Lisbonne qui est, avouons-le, une « monstruosité » institutionnelle.

Ma deuxième réflexion porte sur le fond. Autant il est justifié et nécessaire, compte tenu de certaines initiatives qui témoignent d’un zèle de réglementation excessif de la part de Bruxelles, de mettre en place des dispositifs de protection du principe de subsidiarité, autant il me paraît personnellement contestable de permettre au parlement d’un seul État membre de s’opposer à l’adoption d’une clause passerelle ou de l’équivalent d’une telle clause en matière de coopération judiciaire civile ou de droit de la famille.
Dans les deux cas, il s’agit de passer d’une prise de décision à l’unanimité à la prise de décision à la majorité qualifié – ce n’est pas n’importe quelle majorité ! –, sous condition d’une décision unanime du Conseil européen.
En matière de droit de la famille ou de l’organisation judiciaire, il s’agit uniquement d’affaires ayant des incidences transfrontalières, et non pas de compétence nationale.
Comment ne pas voir qu’une telle faculté de blocage conférée à un seul parlement national dans l’Europe des vingt-sept constitue, même si elle n’est mise en œuvre que rarement, un risque de paralysie qui est la négation même de la démarche communautaire, raison d’être de la construction européenne ? De deux choses l’une : soit on s’inscrit dans une démarche communautaire, et une décision à l’unanimité du Conseil accompagnée d’une décision à la majorité qualifiée devrait suffire, soit on ne veut pas vraiment s’y engager, et alors qu’on en sorte...
Nous sommes en présence d’une de ces dispositions qui conduisent à s’interroger sur le point de savoir si le système institutionnel communautaire est vraiment conçu pour favoriser la construction de l’Europe. Il apparaît quelquefois comme plutôt destiné à la paralyser.
Ma troisième réflexion sera pour rappeler que le principe de subsidiarité ne saurait fonctionner à sens unique. Il ne doit pas seulement nous préserver de décisions prises au plan européen dans des domaines où le cadre national, voire régional, correspond mieux à la nature des problèmes qu’il s’agit de résoudre. Ce principe devrait également – ce serait probablement même plus important – nous déterminer à cesser de prétendre pouvoir traiter correctement au niveau national des problèmes qui appellent manifestement des politiques définies à un niveau supérieur par leur nature même et par l’étendue de leurs enjeux.
Croyons-nous encore pouvoir développer des politiques qui soient à la hauteur de ces enjeux dans les domaines comme celui de la recherche scientifique, des grands moyens de transport, des grandes infrastructures, des ressources énergétiques et des matières premières, de la protection de l’environnement, de la lutte contre la délinquance transnationale, de la sécurité et de la défense ? Excusez du peu !
Il suffit d’évoquer de tels sujets, qui sont essentiels, pour mesurer la terrible insuffisance de nos politiques nationales au regard des exigences du temps présent.
Comme en ont témoigné les propos tenus récemment par le président de la SNCF, M. Pepy, lors de son audition par la commission des affaires européennes, nous devons être conscients du fait que, non seulement nos politiques nationales particulières ne disposent pas des moyens à la hauteur de nos ambitions, mais qu’il leur arrive en outre de se nuire mutuellement par l’effet de leur concurrence, qui affaiblit plus encore leur capacité à rivaliser avec les partenaires mondiaux.
Actuellement, les industries allemandes et françaises, pour ne parler que d’elles, se livrent à une concurrence destructrice au sujet de l’Eurostar, ce qui ne nous permet pas de rivaliser avec les industries chinoises et autres.
Sans doute faisons-nous quelques efforts, surtout verbaux, d’ailleurs, pour, selon les euphémismes en vigueur, « harmoniser », rapprocher ces politiques, et avancer pas à pas dans la voie d’une véritable coopération dont aucun esprit sérieux ne doute de la nécessité. On vient de le voir, par exemple, sur le terrain de la défense. Pour autant, nous sommes bien incapables de faire quoi que ce soit de réellement en commun. On fera l’analyse des problèmes, l’inventaire des situations dans les différents pays, ce qui prendra un an, et pendant ce temps l’histoire s’écoulera !
Cependant, la mondialisation qui bouscule les situations acquises avance, elle, à grand pas, et il est à craindre que les États européens empêtrés dans leurs particularismes, leurs préventions, leurs prétentions, se révèlent incapables de mettre en place des réponses appropriées aux défis de notre temps.
Comme quatrième réflexion, j’évoquerai une réalité que nous rencontrons fréquemment à l’issue des analyses menées au sein de la commission des affaires européennes : dès lors que nous sommes confrontés à des problèmes qui appellent des solutions communes et que l’ensemble des États européens ne parviennent pas dans des délais convenables à mettre en place des réponses appropriées, il appartient aux États qui sont les plus conscients de l’importance des enjeux, de l’urgence et de leurs responsabilités de s’unir, même à quelques-uns, pour définir et mettre en œuvre des politiques communes qui auront au moins l’avantage de se situer à un meilleur niveau d’efficacité. C’est ce que nous appelons communément des coopérations renforcées ou des coopérations volontaires, qui sont probablement le seul moyen qui s’offre aux Européens de ne pas se laisser déborder et marginaliser par le « tsunami » de la mondialisation.
Pour finir, je formulerai une dernière réflexion qui viendra prolonger celle de Denis Badré. Il faut que les parlements nationaux soient plus présents dans les débats européens. Comment y parvenir ? Notre collègue l’a souligné, la COSAC et les différentes réunions qui ont lieu régulièrement sont très utiles, mais tous ces contacts ne sont pas à la hauteur de la complexité des problèmes et des engagements nécessaires. La véritable solution, dans toute construction politique plurinationale, fédérale ou de type fédéral, c’est l’existence d’une seconde chambre. Il est évident que l’Europe a besoin d’une seconde chambre qui devrait être selon moi, c’est une idée que je partage avec M. Badré, issue des parlements nationaux. Serait transposée alors une véritable culture parlementaire nationale au niveau européen. En connexion avec leurs parlements nationaux, les représentants pourraient se consacrer à leur mission de parlementaires, et assumeraient pleinement leurs responsabilités. C’est le schéma classique de toute constitution de type fédéral. Au demeurant, je sais bien que c’est une idée pour l’avenir.
Telles sont les réflexions qui viennent à l’esprit des membres de mon groupe à l’occasion de l’examen de cette proposition de résolution que nous voterons avec confiance, mais non sans inquiétude quant à l’avenir de l’Europe.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, mes chers collègues, il y a un peu plus d’un an, après plusieurs années de difficiles réformes institutionnelles, le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 entrait en vigueur.
Il aura donc fallu près de trois années, de nombreuses tractations, deux référendums irlandais et plusieurs concessions aux États membres pour que ces derniers se mettent enfin d’accord. Cela permettait à l’Europe de souffler un peu sur le plan des réformes institutionnelles.
Une des innovations les plus marquantes du traité de Lisbonne est sans aucun doute la reconnaissance du rôle et de la place des Parlements nationaux dans la construction européenne. Ils en sont devenus des acteurs à part entière. Il s’agit là d’une demande ancienne de la France puisqu’elle s’était déjà exprimée lors de la préparation du traité d’Amsterdam.
Notre pays a toujours œuvré pour que chacun reconnaisse la nécessité de mieux ancrer les questions européennes dans les vies politiques nationales et de développer les liens entre les citoyens et les institutions de l’Union. Une association plus étroite des Parlements nationaux à la vie de l’Union est un des principaux éléments de réponse à cette préoccupation. Le traité de Lisbonne, en mentionnant le rôle des Parlements nationaux dans le corps même des traités, apporte donc une innovation importante.
La révision constitutionnelle du 4 février 2008, préalable à la ratification par la France du traité de Lisbonne, a introduit dans la Constitution française deux articles consacrés à des nouvelles responsabilités conférées aux Parlements nationaux. Je veux parler du contrôle de subsidiarité et de l’exercice d’un droit d’opposition à la mise en œuvre des « clauses passerelles ». La mise en œuvre de ces dispositions est prévue aux articles 88-6 et 88-7 de la Constitution.
Aujourd’hui, les Parlements nationaux ont un rôle européen de première ampleur. Il faut s’en féliciter.
À côté de leur rôle législatif classique d’approbation des actes les plus fondamentaux de l’Union et leur intervention dans la transposition des directives en droit national, ils exercent une fonction de contrôle majeure. Cette fonction s’exerce aujourd’hui essentiellement à l’égard de l’action européenne de chaque gouvernement.
Cette fonction de contrôle est en plein renforcement pour le Parlement français, en raison de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et de la réforme des règlements des assemblées qui en a tiré les conséquences.
La création d’une commission des affaires européennes au sein de chaque assemblée, l’élargissement du champ de l’article 88-4, l’attribution d’une partie de l’ordre du jour au contrôle et la révision de la procédure d’adoption des résolutions européennes sont des acquis de la dernière révision constitutionnelle et une nouvelle étape dans l’évolution du rôle européen du Parlement.
Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ce contrôle s’exercera désormais directement sur l’action des institutions européennes, non pas sur le fond des actes ou projet d’actes, mais sur le respect du principe de subsidiarité. Il s’agit là d’une innovation majeure. Le Sénat pourra adresser à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil de l’Union des « avis motivés » sur le non-respect du principe de subsidiarité par un projet d’acte législatif européen.
Ce contrôle de subsidiarité permettra pour la première fois aux Parlements nationaux d’intervenir directement dans le processus législatif ordinaire de l’Union, en s’appuyant sur des instruments juridiques spécifiques, afin de veiller au respect du principe de subsidiarité. Il s’agit donc d’une procédure européenne mettant directement en rapport les Parlements nationaux avec les institutions de l’Union et incitant les Parlements nationaux à se concerter entre eux, puisque c’est seulement si un tiers des Parlements nationaux ont adressé un avis motivé que le projet d’acte législatif « doit » être réexaminé.
Autre innovation, le Sénat pourra former un recours devant la Cour de justice de l’Union contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.
Enfin, le Sénat participera à l’exercice du droit d’opposition attribué à tout Parlement national dans deux cas : la mise en œuvre des « clauses passerelles » qui permettent le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée pour une décision du Conseil et la détermination par le Conseil de la liste des aspects du droit de la famille pouvant faire l’objet d’une législation européenne selon la procédure de codécision.
Le moment était donc venu pour le Sénat d’adapter son règlement afin de définir les modalités selon lesquelles il exercera ces nouveaux pouvoirs. C’est l’objet de la proposition de résolution que nous allons examiner. Je ne reviendrai pas sur le fond juridique et les modalités de mise en œuvre de ces modifications, le rapport de notre excellent collègue Patrice Gélard nous ayant à cet égard parfaitement éclairés.
Je souhaite insister, au nom du groupe UMP, sur le rôle que notre assemblée doit jouer en matière européenne. C’est à notre avis un rôle très important.
Le contrôle parlementaire sur les affaires européennes forme un domaine où le Sénat a une responsabilité toute particulière. C’est un domaine où les deux assemblées se trouvent placées à égalité. Elles le sont pour la mise en œuvre de l’article 88-4 comme pour l’exercice des responsabilités confiées aux Parlements nationaux par le traité de Lisbonne.
Ensuite, du fait de son enracinement dans les collectivités territoriales de la République, du fait de sa connaissance et de sa pratique des réalités locales, le Sénat a un rôle majeur à jouer pour rapprocher la construction européenne des citoyens.
Les sénateurs sont des relais d’opinion irremplaçables, en contact permanent avec les responsables locaux et territoriaux. Le déficit démocratique existe toujours en matière européenne. Que l’on considère les résultats du référendum sur le traité constitutionnel, le taux de participation aux élections européennes ou même le désintérêt de nos concitoyens pour les problèmes européens, on constate qu’il existe une fracture entre la construction européenne, les enjeux européens et un grand nombre de nos concitoyens.
La crise financière, à cet égard, par son ampleur et les inquiétudes qu’elle engendre, a fait prendre conscience que le sort de notre pays était lié à celui de nos voisins. Il faut maintenant dire et convaincre que notre salut viendra d’un renforcement de l’Union et non de son effacement.
Ce n’est pas l’idée européenne ou même l’idéal européen qui sont en cause, mais c’est plutôt le fonctionnement de l’Union, dont les institutions apparaissent souvent lointaines, difficilement compréhensibles et malaisément contrôlables, pour ne pas dire peu démocratiques.

Les parlementaires français, en général, et les sénateurs, en particulier, doivent réduire cette fracture. Tant la révision constitutionnelle que le traité de Lisbonne leur donnent des instruments pour cela ; ils devront être pleinement utilisés par notre assemblée.
Enfin, il faut souligner que, en matière européenne encore plus que dans les autres domaines, l’influence se construit dans la durée. Le Sénat, par son mode d’élection et son type de rapport avec le Gouvernement, est bien placé pour pouvoir prendre du recul et poursuivre des préoccupations de long terme.
Notre assemblée doit donc assumer pleinement son rôle européen et ainsi apporter sa pierre au processus, si nécessaire, de « démocratisation » de l’Union, car la construction européenne doit devenir de plus en plus l’affaire de tous.
La crise économique actuelle et ses effets dévastateurs sur la zone euro rendent cette mission plus urgente encore. Le Sénat a donc un rôle important à jouer en matière européenne, domaine où il se trouve placé à égalité avec l’Assemblée nationale : s’il parvient à être à la fois enraciné dans les collectivités territoriales et pleinement ouvert sur l’Europe, il pourra être un trait d’union particulièrement utile. À lui de réaliser les adaptations nécessaires. Ce n’est pas en se pliant à la routine administrative ni en se comportant en chambre d’enregistrement que le Sénat confortera sa place dans notre démocratie.
La modification de notre règlement, à laquelle le groupe UMP apporte tout son soutien, nous donne cette opportunité. Sachons la saisir !

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l’article unique.
(Non modifié)
Après l’article 73 septies du Règlement, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 73 octies. –1. Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.
« 2. Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle-ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative.
« 3. Une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition. Si la commission compétente au fond n’a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.
« 4. Le texte adopté dans les conditions prévues à l’alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.
« 5. À tout moment de la procédure, le président d’un groupe peut procéder à la demande d’examen en séance publique selon la procédure prévue à l’alinéa 5 de l’article 73 quinquies.
« 6. Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l’Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement.
« 7. Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne les résolutions du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.
« 8. À l’expiration d’un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d’acte législatif dans les langues officielles de l’Union ou de la publication de l’acte législatif, la procédure d’examen d’une proposition de résolution est interrompue.
« Art. 73 nonies. –1. Le Président du Sénat transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans un délai de huit semaines suivant la publication de cet acte législatif, par au moins soixante sénateurs.
« 2. Ce recours interrompt, le cas échéant, l’examen des propositions de résolution visées à l’article 73 octies portant sur le même acte législatif.
« Art. 73 decies. – 1. Tout sénateur peut présenter une motion tendant à s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas visés à l’article 88-7 de la Constitution.
« 2. Une motion s’opposant à une initiative visée à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne ou à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement.
« 3. La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui rend son rapport dans un délai d’un mois. Le rapport conclut à l’adoption ou au rejet de la motion.
« 4. La motion est discutée dès la première séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à l’article 48 de la Constitution. En cas de rejet, aucune autre motion portant sur une même initiative ou proposition de décision n’est recevable.
« 5. La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l’Assemblée nationale.
« 6. Lorsque le Sénat est saisi par l’Assemblée nationale d’une motion tendant à s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, la motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Elle est discutée avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la transmission de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose.
« 7. En cas d’adoption par le Sénat d’une motion transmise par l’Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l’Assemblée nationale. Il notifie au Président du Conseil européen le texte d’une motion s’opposant à une initiative et au Président du Conseil de l’Union européenne le texte d’une motion s’opposant à une proposition de décision. Il en informe le Gouvernement.
« 8. En cas de rejet d’une motion transmise par l’Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l’Assemblée nationale. Aucune motion tendant à s’opposer à la même initiative ou proposition de décision n’est plus recevable.
« 9. Toute motion présentée en application du présent article et qui n’a pas été adoptée dans un délai de six mois suivant la transmission de l’initiative ou de la proposition de décision devient caduque. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de résolution.
La proposition de résolution est adoptée.

Conformément à l'article 61, premier alinéa, de la Constitution, la proposition de résolution sera soumise au Conseil constitutionnel avant sa mise en application.

L’ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 1 de Mme Catherine Morin-Dessailly à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cette question est ainsi libellée :
« Mme Catherine Morin-Desailly attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation discriminatoire que les femmes continuent de subir au cours de leur carrière professionnelle.
« La réforme des retraites a mis en exergue la question structurelle de ces inégalités. Elles apparaissent dans le parcours professionnel (moindre progression, difficultés d'accès à des postes à responsabilité, temps partiel subi…) et dans les écarts de salaires. Cette double inégalité induit par voie de conséquence des écarts de pensions importants.
« Elle rappelle que la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes avait notamment accordé aux entreprises un délai de cinq ans pour atteindre l'objectif de suppression des écarts de rémunération. Or des bilans font déjà apparaitre l'inefficacité d'une loi qui aurait déjà dû comporter un dispositif de sanctions appropriées. Si la réforme des retraites a eu le mérite d'aborder les inégalités, elle ne saurait suffire à apporter une réponse efficace et pérenne.
« L'échéance de l'objectif de suppression arrivant à terme le 31 décembre prochain, elle interroge le Gouvernement sur les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à une situation d'inégalité persistante, très préjudiciable aux femmes. »
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, auteur de la question.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis le début du siècle, à l’image de Jeanne Chauvin, première femme avocate française – pour n’en citer qu’une –, les femmes se sont battues pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Si, depuis tout ce temps, plusieurs lois ont été adoptées, notamment au cours des trente dernières années, comme le soulignait – à très juste titre – Édouard Herriot, « il est plus facile de proclamer l’égalité que de la réaliser ».
Actuellement, les femmes représentent près de la moitié de la population active. Entre 15 ans et 64 ans, 65, 5 % d’entre elles sont actives, contre 74, 6 % des hommes. Bien sûr, il convient de relativiser ce taux au regard de la nature de l’emploi occupé puisque la part des femmes travaillant à temps partiel a quasiment doublé ces dernières années, passant de 17, 3 % à 29, 4 %.

Par ailleurs, elles sont plus touchées par le sous-emploi, le chômage et les bas salaires.

Enfin, selon une enquête de l’INSEE pour le ministère du travail, publiée le 2 décembre dernier, les femmes occupent des emplois où le travail semble moins épanouissant, exercent moins souvent des responsabilités et accèdent plus difficilement à des formations.
Alors que les femmes ont massivement investi le marché du travail et que leur niveau d’éducation a rejoint, voire dépassé, celui des hommes, il semble aberrant que de telles inégalités professionnelles perdurent.

Il convient de noter que la recherche de l’égalité entre les genres est poursuivie dans le monde entier. Sur le plan international, les Nations unies et l’Organisation internationale du travail, l’OIT, sont les deux principales institutions qui veillent à la prise en compte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’Europe, dès 1957, a affiché, avec le traité de Rome, une politique volontariste d’égalité entre les sexes. Depuis cette date, d’autres textes ont été adoptés pour assurer l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation professionnelle et de protection sociale.
Dans notre pays, le cadre juridique s’est mis en place progressivement. En 1983, la loi dite Roudy a inscrit l’égalité professionnelle dans le code du travail et le code pénal.

En 2001, ce texte a été actualisé et renforcé par la loi dite Génisson, qui définit les axes de la mise en œuvre de l’égalité professionnelle.
En 2006, c’est plus spécifiquement sur l’égalité salariale que nous nous sommes engagés. Il se trouve que le 31 décembre prochain, date fixée par la loi de 2006, nous arriverons à l’échéance du délai accordé aux entreprises pour atteindre l’objectif de suppression des écarts de rémunération.

C’est pourquoi, à quelques jours de cette date butoir, le groupe centriste a souhaité que nous puissions dresser un bilan de l’application de cette loi et, au-delà, débattre avec vous, madame la ministre, des perspectives à envisager.
Je tiens en préalable à rappeler qu’au cours de ce dernier trimestre nous avons eu plusieurs fois l’occasion de débattre de la place faite aux femmes dans la sphère professionnelle. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses n’avancent pas vite et que, lorsqu’elles avancent, c’est toujours à l’initiative du Parlement.

Le 27 octobre dernier, nous avons adopté la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.
Le 15 novembre dernier, dans le cadre du projet de loi de finances 2011, c’est grâce à un amendement de Chantal Brunel…

… que 2, 5 millions d’euros de crédits supplémentaires ont été affectés pour renforcer le service des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. La présidente de notre délégation aux droits des femmes, Michèle André – dont je salue l’implication –, s’était elle-même mobilisée.
Par ailleurs, la loi sur les retraites dont nous avons longuement débattu, a été l’occasion de mettre en lumière la situation très inégale des femmes, dont le montant des retraites ne peut qu’être inférieur à celui des hommes puisqu’elles ont le plus souvent des carrières inégales et morcelées.
Nous avons pu apporter quelques aménagements à la loi, …

… mais bien insuffisants au regard du problème. Il est vrai que ce texte ne pouvait résoudre à lui seul toutes les inégalités structurelles, et qu’il convenait, dès lors, de revenir à la loi de 2006, ce que nous faisons aujourd’hui. Nous attendons ainsi du nouveau Gouvernement qu’il nous dise clairement ses intentions sur le sujet.
En effet, je regrette que, contrairement aux annonces faites par Xavier Darcos, alors ministre du travail, fin 2009, rien n’ait abouti. Pourtant, les chiffres étaient déjà alarmants, puisque la France se situait au 116e rang mondial de la parité. Brigitte Grésy avait rendu au mois de juillet son rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux proposant quarante mesures pour favoriser l’égalité professionnelle. Le Gouvernement affirmait alors vouloir « une véritable révolution culturelle sur un sujet de société où la France est en panne », reprenant ainsi le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy, qui indiquait en 2007 : « Dès le mois de juin, je réunirai une conférence avec les partenaires sociaux afin que l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes soit totale d’ici 2010. »
Maintenant, si nous dressons un bilan détaillé des quatre grands objectifs que nous avions fixés dans la loi du 23 mars 2006, qu’en est-il ?
Il y avait tout d’abord la suppression des écarts de rémunération en cinq ans. Ainsi, nous avons imposé aux partenaires sociaux l’obligation de négocier chaque année pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, avant le 31 décembre 2010, dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires. Il s’avère que, selon le dernier rapport publié par le Forum mondial économique, en matière de perception des inégalités salariales, la France atterrit au 127e rang mondial.

Si l’on détaille, on voit que, dans les entreprises de dix salariés et plus, la rémunération brute totale moyenne des femmes est inférieure de 27 % à celle des hommes, cet écart étant plus élevé pour les plus diplômés et les salariés les plus âgés.
La nouveauté de ce texte résidait dans le dispositif d’incitation des entreprises soumises, non plus à une obligation de moyens, mais à une obligation de résultats pour atteindre les objectifs fixés. J’ai regretté, à l’époque, avec mon groupe, que ce dispositif ne soit pas contraignant. J’avais proposé un amendement visant à sanctionner les entreprises au terme des cinq ans si rien n’était fait. Le Gouvernement m’avait répondu alors qu’un premier bilan serait fait en 2008 et qu’il pourrait être assorti de sanctions. Or, à ma connaissance, ce bilan n’a jamais été fait à mi-parcours.

La thématique de l’égalité professionnelle et salariale est restée insuffisamment traitée au niveau de la branche. Il s’agit seulement du huitième thème abordé en termes de fréquence dans les accords interprofessionnels. Les accords salariaux n’abordent cette thématique que dans moins de 10 % des cas. Certaines préconisations s’apparentent à des mesures mais ne font, en réalité, que reprendre les dispositions législatives et sont finalement des coquilles vides. La leçon à tirer est simple : sans menace de sanctions, les mesures ne sont pas appliquées.
Nous avions également fixé un objectif de neutralisation des effets de l’absence pour cause de maternité afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Or, le taux d’activité des femmes continue de décrocher avec l’arrivée des enfants puisqu’il passe de 73 % pour un enfant de moins de 12 ans à 64 % pour deux enfants et à 40 % pour trois enfants et plus.
Il perdure également une asymétrie des transitions professionnelles après les naissances puisque seulement 6 % des hommes mais 40 % des femmes vivent un changement dans leur situation professionnelle à la naissance d’un enfant.
Alors que l’on vante souvent les mérites du modèle suédois en matière de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, nous oublions trop souvent qu’il existe également une exception française. Notre pays présente deux caractéristiques : un taux de fécondité relativement haut et un taux d’activité féminine important, phénomène qui s’explique par la poursuite depuis plus de trente ans d’une articulation des politiques familiales et des politiques d’emploi, mais également par une forte évolution des mœurs.
Désormais, les femmes ne veulent pas choisir entre maternité et travail mais les conjuguer. Tandis qu’au siècle dernier, les femmes sont sorties de la famille pour entrer sur le marché du travail, les hommes sont désormais plus enclins à investir la famille. Il s’agit d’une aspiration profonde qui affleure et qui pourra largement contribuer, à terme, à l’égalité entre les hommes et les femmes.
La loi de 2006 devait être aussi un soutien à la lutte contre les discriminations au travail, plus particulièrement en favorisant la formation professionnelle tout au long de la vie. On constate que, dans le secteur privé, son taux d’accès est de 32 % pour les femmes contre 45 % pour les hommes. De plus, les femmes doivent réorganiser deux fois plus souvent que les hommes leur vie personnelle pour pouvoir suivre une formation. Dans l’ensemble, les formations suivies par les femmes et les hommes ont des objectifs proches mais des formes différentes puisque 15 % seulement des formations suivies par les femmes sont diplômantes, contre 25 % de celles suivies par les hommes.
Le dernier objectif de la loi visait l’amélioration de la représentation des femmes dans le monde du travail, notamment dans les conseils d’administration des entreprises publiques et les conseils des prud’hommes. Faute d’avoir atteint le but fixé, nous avons, le 27 octobre dernier, légiféré afin d’imposer une représentation équilibrée au sein des conseils d’administration, comme l’avait recommandé le rapport de Mme Gresy. En s’inspirant du modèle norvégien, nous avons ouvert une voie qui pourra – je l’espère – avoir un effet d’entrainement du haut vers le bas.
Néanmoins, je regrette – et je ne suis pas la seule dans cet hémicycle – que la loi ne s’applique pas aux établissements publics, qui devraient pourtant être exemplaires sur le sujet. Lieu d’incarnation des valeurs de la République, le service public garantit, en théorie, l’absence de distinction entre les hommes et les femmes.
Toutefois, des inégalités existent aujourd’hui, en matière de déroulement de carrière, d’accès aux emplois de responsabilité et de conditions de travail. Ces inégalités sont de plus en plus visibles au fur et à mesure que l’on progresse dans la hiérarchie. En effet, dans la fonction publique d’État, les femmes sont majoritaires en nombre mais elles représentent une part plus faible des emplois supérieurs de l’État que dans les fonctions publiques hospitalières et territoriales.
S’agissant des emplois à la décision du Gouvernement, que ce soit dans la magistrature ou dans l’enseignement supérieur, par exemple, alors qu’il y a un grand nombre de femmes « promouvables », elles sont très largement sous-représentées par rapport à leurs homologues masculins.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, malgré les efforts répétés, la situation des femmes stagne, voire se dégrade.

Il est temps de prendre des mesures à la hauteur des besoins.
En tout premier lieu, nous devons améliorer la législation. Et, dans les textes à venir, nous devrons concilier les outils de la conviction et ceux de la contrainte pour rendre possible le contrôle des avancées sur le terrain.
Par ailleurs, favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est essentiel. La majorité des couples étant biactifs, il est certain qu’il nous faut faciliter la vie des parents sans pour autant les délivrer de leur rôle éducatif. Ainsi, la garde d’enfant est un vrai sujet.
Madame la ministre, le Gouvernement s’est déjà fortement engagé, en fixant un objectif de 200 000 nouvelles offres de garde à l’horizon de 2012, dont 14 000 places en crèche. L’effort doit être également poursuivi dans la mise en œuvre de systèmes existants ; je pense, par exemple, aux maisons maternelles expérimentées en Mayenne par notre collègue Jean Arthuis.
Des mesures simples et peu coûteuses existent aussi. Comme le montre le Baromètre 2010 de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, publié en octobre dernier, les petites et moyennes entreprises sont plus actives que les grandes entreprises en matière d’organisation du travail. L’exemple le plus frappant concerne le télétravail, mis en œuvre par 72 % des très petites entreprises, les TPE, comptant moins de dix salariés, mais seulement par 25 % des entreprises de plus de mille salariés. Les PME facilitent également davantage l’accès aux temps partiel, sans conséquences négatives sur l’évolution professionnelle ; elles développent des règles simples de vie quotidienne, comme d’éviter d’organiser des réunions tôt le matin ou tard le soir ; elles participent à la prise en compte des frais de garde d’enfant en cas de formation en dehors des horaires de travail. Voilà des dispositifs simples dont toutes les entreprises pourraient s’inspirer.
Évidemment, une meilleure gestion de la vie professionnelle et de la vie personnelle passe aussi par une plus grande implication des hommes dans la famille.
Désormais, le congé parental peut être pris par les hommes. Je note qu’en juin 2009 les partenaires européens ont signé un accord, inspiré du modèle nordique, qui institue un congé parental de trois ou quatre mois au minimum, dont l’un est obligatoirement réservé au conjoint et qui « tombe » si celui-ci ne le prend pas. Madame la ministre, est-il envisageable de transposer ce dispositif dans le droit français ?

Pour favoriser l’égalité professionnelle, il faut aussi agir en faveur d’une meilleure insertion des femmes au sein des entreprises.
Pour réduire la précarité des emplois féminins, nous pourrions, par exemple, favoriser l’amélioration des conditions de rémunération, notamment en faisant passer le taux de majoration des heures complémentaires à 25 % dès la première heure complémentaire pour les contrats de moins de 16 heures par semaine, ou encore aménager la pluriactivité.
Il convient aussi d’encourager la création de « vivier de compétences » de femmes et d’accompagner ces dernières, par la formation, à prendre des responsabilités. Par exemple, au sein de l’Agence de participations de l’État, Mme Lagarde a fait constituer une liste de femmes répondant aux critères les plus exigeants pour devenir administrateur. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?
Nous devons également aider les femmes à briser le fameux « plafond de verre » en favorisant l’égalité hommes-femmes au sein de toutes les instances de direction – comité de direction, comités exécutifs – ainsi que dans les organes de représentation du personnel, puisque c’est là aussi que se trouve le pouvoir.
Enfin, il faut absolument valoriser « l’atout féminin » pour les entreprises. Comme le démontre une étude menée par Michel Ferrary, égalité peut rimer avec performance. Cette recherche a consisté à croiser le taux de féminisation global et celui de l’encadrement en 2007, avec l’évolution de cinq indicateurs. Les résultats montrent que les sociétés où les femmes sont présentes dans les postes d’encadrement ont connu une plus forte croissance de leur chiffre d’affaires, une rentabilité deux fois plus importante, une productivité en hausse et une création d’emplois supérieure de 150 %.
Cela dit, il faut intervenir largement en amont, notamment au niveau de l’éducation, pour que s’établissent les bons réflexes. En effet, la polarisation professionnelle sur le marché du travail résulte avant tout d’une polarisation sexuelle des étudiants dans le système éducatif. Dès l’école, les jeunes filles devraient être encouragées à investir tous les secteurs, même ceux qui peuvent sembler plus masculins, et à poursuivre leurs aspirations. C’est vrai aussi pour les garçons, car les filles ne sont pas les seules à être victimes des stéréotypes.
Enfin, nous devons impérativement rendre plus effectives nos lois.
Nous pourrions ainsi simplifier les négociations sur l’égalité professionnelle en proposant la mise en place d’un bilan social unique qui traiterait tous les domaines de manière sexuée. En effet, pour de nombreuses sociétés, réaliser, d’une part, un bilan social et, d’autre part, un rapport de situation comparée est une démarche lourde.
Nous pourrions aussi donner du contenu aux accords, comme le préconise le rapport Grésy, en déterminant des leviers de changements assortis d’indicateurs et d’objectifs chiffrés de progression. Je rappelle à cet égard que j’avais proposé une réécriture de l’article 31 de la loi sur les retraites, votée ici au Sénat, pour rendre ce système plus effectif.
Il conviendrait également d’instaurer une logique de transparence et de rendre publics les efforts faits par les entreprises, en suivant le principe name and shame, et de sanctionner les entreprises récalcitrantes en soumettant à condition les allégements de charges ou bien en augmentant la taxe, adoptée lors de la réforme des retraites, à plus de 1 % de la masse salariale.
Nous pourrions enfin permettre aux entreprises d’utiliser directement, en interne, une partie de la taxe de 1 % de leur masse salariale auxquelles elles seront bientôt soumises. Par exemple, elles pourraient déduire de leur taxe certaines dépenses engagées pour favoriser l’égalité salariale.
Telles sont, madame la ministre, mes chers collègues, quelques pistes tendant à favoriser l’amélioration de la situation des femmes, car cet objectif répond tout à la fois à un impératif démocratique qui doit conduire à une plus grande justice sociale pour les femmes, à une nécessité économique dans une conjoncture démographique défavorable – compte tenu du vieillissement de la population et des tensions qui vont en résulter sur le marché du travail, les femmes représentent un vivier de compétences dont les entreprises ont besoin –, et à une exigence sociétale qui doit permettre aux femmes et aux hommes de concilier dans les mêmes conditions leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Madame la ministre, vous l’avez compris, nous attendons que vous indiquiez à notre assemblée, lors de ce débat, les mesures que vous comptez prendre, que ce soit dans un projet de loi global ou par des mesures réglementaires ?
Une nouvelle mission a été confiée à notre collègue députée Françoise Guégot sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique, dont les propositions doivent être remises au cours du mois de décembre. Madame la ministre, pourriez-vous nous apporter des précisions sur le contenu de cette mission et le prolongement que vous comptez y apporter.
Je vous ai posé de nombreuses questions auxquelles nous attendons autant de réponses ; par avance, nous vous remercions.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, de l ’ UMP et du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord remercier notre collègue Catherine Morin-Dessailly d’avoir pris l’initiative de poser cette question, dont le libellé souligne à quel point ce débat reste, toujours et encore, indispensable.
Malgré l’adoption de plusieurs textes comme la loi Roudy de juillet 1983, imposant l’égalité salariale entre hommes et femmes, la loi Génisson de mai 2001, censée renforcer la précédente, ou bien encore celle de mars 2006, la question de la réduction des inégalités professionnelles entre hommes et femmes est loin d’être réglée, bien au contraire ! J’en veux pour preuve le fait que l’obligation imposée par la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, à laquelle il est fait référence, n’existe malheureusement plus aujourd’hui dans notre droit positif !
En effet, cette loi prévoyait des négociations de branches relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, avec pour objectif de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ; ces négociations étaient censées aboutir avant le 31 décembre 2010, c’est-à-dire dans onze jours !
Or l’article 31 du texte de loi portant réforme des retraites a supprimé la date butoir du 31 décembre 2010, sous prétexte que la loi portant réforme des retraites crée une nouvelle obligation à la charge des entreprises en matière d’égalité professionnelle et qu’elle serait plus efficace ! Mais cette nouvelle obligation n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2012. Une obligation certaine a donc été supprimée au profit d’une autre, future et hypothétique…

Avec mes collègues du groupe CRC-SPG, j’avais dénoncé cette manœuvre lors de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites.
Encore une fois, madame la ministre, je suis désolée de constater que ce que votre Gouvernement qualifie d’avancée est en fait synonyme de recul et, comme toujours, les femmes en sont les premières victimes… Telle la vérité de vos actions en faveur de l’égalité homme-femme !
Depuis la promulgation de la loi portant réforme des retraites et jusqu’au 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur d’une nouvelle obligation à la charge des entreprises contenue dans ce texte, toute obligation en matière de réduction des inégalités salariales a donc disparu. Ce vide juridique illustre cruellement la politique du Gouvernement, qui se plaît à communiquer sur l’avancée des droits des femmes, mais qui, dans les faits, et dans les lois, les fait régresser.

Puisque nous parlons aujourd’hui d’égalité entre hommes et femmes et, notamment, d’égalité professionnelle, je pense nécessaire de redire que, dans une société encore largement dominée par les hommes, les droits des femmes ne sont jamais acquis. Dans toutes les sociétés, dès que les droits des citoyens sont remis en cause, les droits des femmes régressent en premier. L’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif encore non atteint dans bien trop de domaines et l’égalité professionnelle n’en est qu’un des aspects !
Nous sommes d’accord avec Catherine Morin-Desailly quand elle constate que la réforme des retraites a mis en exergue la question structurelle des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes, mais nous voudrions ajouter que cette réforme les a aussi concrètement aggravées. Il était nécessaire, me semble-t-il, de commencer par le rappeler.
Lors de la discussion de la loi du 23 mars 2006, nous avions dénoncé son caractère de pur affichage, car ce texte visait uniquement à encourager les entreprises à négocier sur les écarts de salaires. Les déclarations de la ministre de l’époque présentaient cette loi comme le « dernier avis de négociations avant sanction ». En réalité, il n’en est rien : comme souvent, tout est mis en œuvre pour que les entreprises n’aient rien à craindre.
En repoussant à 2012 leur application, initialement prévue en 2010, vous avez profité de l’occasion pour réduire le champ de ces sanctions ainsi que leur montant, puisqu’elles sont dérisoires : 1 % de la masse salariale tout au plus. De plus, les employeurs pourront s’en exonérer du seul fait qu’ils auraient mis en œuvre un plan d’action, même si ce dernier n’est ni financé ni efficace. Enfin, la sanction éventuelle ne pourra pas être prononcée ou augmentée par l’autorité administrative. Comme vous le voyez, c’est un euphémisme que de dire que nous avançons très doucement sur cette question !
La loi du 23 mars 2006 avait été celle des rendez-vous manqués. Sur ordre du MEDEF, des mesures en faveur des femmes initialement contenues dans ce texte avaient été écartées, comme l’allongement du congé maternité ou du congé pathologique et, surtout, la reconnaissance des écarts de salaire comme constitutifs d’une discrimination.
Aujourd’hui, au cours de ce débat sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, nous souhaiterions retenir une définition plus large de cette question.
En effet, l’égalité professionnelle ne se limite pas à ce qui se passe dans l’entreprise. L’égalité professionnelle est un continuum : elle est déterminée aussi bien par les réalités lors de l’entrée dans l’entreprise, que pendant la durée du contrat de travail, avec le salaire, la progression de carrière, etc. L’égalité professionnelle doit aussi exister lors des suspensions du contrat de travail, par exemple, pendant les congés de maternité, ou au moment de la retraite ; comme cela a été dit, la retraite révèle souvent le cumul des inégalités de traitement vécues durant toute l’activité professionnelle.
Cependant, faire rimer égalité professionnelle avec réalité implique, en amont, que l’égalité soit assumée dès le plus jeune âge, dans les conditions même d’enseignement. Si la question du rôle de l’Éducation nationale dans la lutte en faveur de l’égalité est si importante, c’est que le parcours scolaire des femmes traduit, lui aussi, l’ampleur des discriminations dont elles sont victimes.
Certes, de nombreux progrès ont été accomplis, mais ce sont encore trop souvent les jeunes hommes qui, à capacités égales, se voient offrir les postes de responsabilité au sortir des grandes écoles, au détriment des jeunes filles alors que celles-ci représentent 58 % des étudiants à l’université.
De trop nombreuses entreprises continuent d’avoir une politique d’embauche discriminante. Comme le contrat de travail est un contrat conclu en considération de la personne, il sera toujours très difficile de traquer les discriminations à l’embauche. Les mentalités et les pratiques doivent changer et l’ensemble des règles posées par le code du travail et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, auront du mal, à elles seules, à modifier profondément la situation.
Pour faire tomber les stéréotypes, il faudrait changer les mentalités sexistes, puisque les femmes réalisent encore 70 % des tâches dites domestiques et 60 % des tâches parentales. C’est une question d’éducation, loin de tout déterminisme sexuel des tâches et des aspirations. Sans l’égalité domestique et parentale, l’égalité professionnelle n’existera jamais ! À titre d’exemple, savez-vous qu’au Danemark l’État et les pédagogues conseillent aux parents d’offrir des poupées et des dinettes aux petits garçons, de la même manière qu’aux petites filles, pour que ces hommes, une fois adultes, trouvent normal de tenir une poussette, de préparer un biberon ou de s’occuper des tâches ménagères quand leurs compagnes sont au travail. Si cet exemple peut prêter à sourire, il révèle aussi les choix d’une société où l’égalité est une priorité.
De plus, si l’égalité professionnelle dans l’entreprise implique le respect d’obligations par l’employeur, elle implique aussi l’égalité salariale.
Selon l’INSEE, tous temps de travail confondus, les salaires des femmes sont inférieurs de 27 % à ceux des hommes. En 1950, les femmes employées à temps complet percevaient, en moyenne, les deux tiers des salaires masculins ; à partir de 1993, elles ont dépassé les 80 % ; depuis cette date, la progression a été interrompue et l’écart salarial moyen entre hommes et femmes stagne à ce niveau. Faudra-t-il encore attendre cinquante ans pour atteindre l’égalité effective ?
L’inégalité professionnelle est aussi illustrée par le temps partiel subi, véritable facteur de précarité perpétuelle pour les femmes.
L’accession des femmes aux emplois qualifiés, aux postes de direction, aux mandats sociaux comme aux fonctions électives est loin d’avoir atteint un niveau satisfaisant. Il suffit d’observer la composition de notre assemblée, où nous sommes, mes chères collègues, 79 sénatrices pour 342 sièges, c’est-à-dire à peine plus de 20 % de femmes !
Et je n’ose évoquer la réforme des collectivités, qui tire un trait sur la parité dix ans seulement après que celle-ci a été adoptée. Madame la ministre, vous qui, à l’époque, étiez au côté des associations féministes, comment avez-vous pu laisser s’opérer un tel recul ?
Quand comptez-vous mener une politique volontariste en matière de réduction des inégalités professionnelles entre femmes et hommes ?
Quelles mesures bien plus ambitieuses et radicales que celles qu’avait annoncées votre ex-collègue Eric Woerth lors du débat sur les retraites entendez-vous mettre en place ?
Quels moyens proposez-vous pour lutter efficacement contre les discriminations à l’embauche, fixer des critères et des obligations objectives et incontournables pour les entreprises?

Mme Odette Terrade. Telles sont, madame la ministre, mes chers collègues, les remarques que notre groupe souhaitait formuler à l’occasion de ce débat.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur plusieurs travées de l’Union centriste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour, je tiens à remercier Catherine Morin-Desailly d’avoir déposé cette question, qui nous permet, au lendemain de la réforme des retraites, de faire un point sur la situation des femmes au travail.
La féminisation de la population active a beaucoup progressé en quelques décennies. Selon l’INSEE, les femmes représentent 47 % des actifs, contre 34 % en 1962. Mais leur statut s’est-il amélioré pour autant ? Ma longue expérience en entreprise tout comme de multiples études me montrent que non : l’égalité professionnelle et surtout l’égalité salariale ne sont pas encore acquises.
Certes, au cours des quarante dernières années, les progrès ont été nombreux grâce, en particulier, aux six lois votées depuis 1972 qui ont posé des règles destinées à garantir la place des femmes dans le monde du travail.
L’Union européenne a également permis d’avancer. Une dizaine de directives ont progressivement relevé le niveau d’exigence dans la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement pour l’accès à l’emploi, à la formation et aux carrières.
Il existe donc de nombreux textes, mais la richesse même de ce corpus fait mesurer l’écart existant entre ce qu’ils promeuvent et la réalité des situations.
Les femmes, bien plus que les hommes, occupent des emplois peu qualifiés ou au statut précaire, souvent faute de mieux. Plus de 82 % des actifs à temps partiel sont des femmes, souvent par choix, mais plus de 30 % des femmes travaillent à temps partiel parce qu’elles n’ont pas trouvé d’emploi à temps complet : c’est le temps partiel subi.
Bien plus que les hommes, les femmes occupent des emplois temporaires tels que contrats à durée déterminée, stages, emplois aidés, ou sont confrontées au chômage. Et même lorsqu’elles choisissent des formations professionnellement rentables, leur progression de carrière, dès le début de la vie active, paraît moins rapide que celle des hommes.
Je souhaite surtout dénoncer les inégalités salariales : il y a de quoi en être particulièrement indigné lorsqu’on sait qu’elles persistent alors que les filles ont rattrapé, puis dépassé le niveau d’éducation des garçons.
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la rémunération des femmes est inférieure de 27 % à celle des hommes. En outre, l’écart salarial s’avère proportionnel aux diplômes : l’écart est encore plus important pour les plus diplômées puisqu’il peut atteindre 32 % chez les titulaires d’un diplôme de deuxième ou de troisième cycle.
Comment peut-on accepter à notre époque, au XXIe siècle, qu’à travail égal il n’y ait pas salaire égal ? Comment les entreprises peuvent-elles, sans état d’âme, rémunérer davantage un homme, comme si, parce qu’il est du sexe supposé fort, il travaillait forcément plus ou mieux ? Cela relève d’un très long passé de dominance masculine, mais celle-ci ne devrait plus avoir cours aujourd’hui.
En janvier 2005, alors que je venais de devenir parlementaire, le Président de la République fixait un objectif de suppression de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sur cinq ans ; il aurait donc dû être atteint en 2010. J’y ai cru !
Certes, un certain nombre d’accords sur l’égalité salariale ont été signés, et ils tendent d'ailleurs à se multiplier. Mais, en 2010, peut-on dire que la situation a vraiment évolué ?

Je pense qu’il est temps maintenant de changer de méthode.
Un nouveau dispositif a été adopté pour lutter contre les inégalités salariales lors de l’examen du texte sur les retraites, ce qui est assez original, il faut le reconnaître. Il s’agit d’imposer des pénalités financières aux entreprises de plus de cinquante salariés qui n’affichent ni accord sur l’égalité professionnelle ni plan d’action contre les discriminations. Selon un mécanisme inspiré du dispositif applicable pour les seniors, les sanctions pourront atteindre 1 % de la masse salariale. Il est toutefois à craindre que le système proposé ne soit trop vague pour être dissuasif.
Pouvez-vous me préciser, madame la ministre, si l’État a les moyens de vérifier la situation et d’appliquer des sanctions dans chaque entreprise ? Pouvez-vous nous dire comment vous entendez mettre en place concrètement ce dispositif ? Les lois précédentes sur l’égalité nous ont enseigné que les principes restaient sans effet faute de décret d’application précis et faute de moyens réels pour les mettre en œuvre.
Mais je sais aussi que les stocks sont plus difficiles à gérer que les flux. C’est pourquoi je veux attirer votre attention sur les femmes qui ont déjà vingt ou trente ans d’ancienneté dans une ou plusieurs entreprises. Comment la question de leur inégalité salariale peut-elle être réglée ? Jamais les entreprises ne seront financièrement en mesure de régler ces trop longues injustices, sauf à priver tous leurs salariés – hommes ou femmes – récemment embauchés de progression salariale pendant plusieurs années, ce que je ne demande évidemment pas.
Avant de conclure, je voudrais évoquer l’adoption récente de la proposition de loi de Mme Zimmermann visant à instaurer des quotas de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises.
Il apparaît en effet que les femmes sont sous-représentées dans les lieux de décision : les conseils d’administration des sociétés du CAC 40 ne comptent que 10 % de femmes.
La proposition de loi a prévu un objectif de 40 % de femmes dans les conseils d’administration d’ici à cinq ans, avec un palier de 20 % au minimum d’ici à trois ans. En outre, les conseils d’administration exclusivement masculins devront compter au moins une femme dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Je tiens à souligner l’apport du Sénat et le travail du rapporteur, Mme Des Esgaulx : le champ d’application de la loi a été élargi aux entreprises non cotées qui, trois ans durant, remplissent deux critères, à savoir employer plus de 500 salariés et afficher un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros. Cette disposition portera de 700 à 2 000 le nombre des entreprises concernées. Notre assemblée a également introduit un mécanisme de sanction financière, prévoyant une suspension temporaire des jetons de présence.
Cependant, plus encore que l’absence de femmes dans les conseils d’administration, leur absence des comités de direction est choquante dans des entreprises qui comptent souvent au moins autant de femmes que d’hommes. Il suffit de voir les trombinoscopes publiés dans les magazines : quand il y a une femme, c’est parce que l’on a cité la direction des ressources humaines ou celle de la communication ! Il faut donc aller plus loin que les seuls conseils d’administration.
Les encouragements sont indissociables des sanctions, car, dans le pays qui a instauré la loi salique en système de gouvernement politique et économique, on ne peut compter sur la seule évolution naturelle pour voir s’installer une véritable mixité dans les lieux de décision français, non plus que pour obtenir l’égalité salariale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd’hui est la fois important et indispensable.
Il est important parce que les problématiques dont il est ici question sont toujours d’actualité et que, malgré les récentes évolutions sociales et législatives, l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel reste un objectif à atteindre.
Il est indispensable en ce que, parmi les nombreuses évolutions législatives et réglementaires que nous avons connues ces dernières années, il en est une – la loi du 23 mars 2006 – qui fixait une date butoir importante au 31 décembre prochain. C’est en effet à cette date que la loi relative à l’égalité salariale a fixé aux entreprises l’objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes…
Je tiens, moi aussi, à saluer l’initiative de ma collègue Catherine Morin-Desailly, qui nous permet de dresser aujourd’hui un bilan.
Notre débat dépasse naturellement le strict cadre de l’égalité salariale, même si cette question reste centrale tant elle est immédiatement révélatrice des inégalités entre les hommes et les femmes.
Outre l’égalité salariale, la loi du 23 mars 2006 fixe trois objectifs : réconcilier la maternité et l’emploi, promouvoir l’accès des femmes aux postes de décision et diversifier l’offre de formation professionnelle.
S’il est clair que nous avons progressé sur l’ensemble de ces sujets depuis 2006, un travail très important reste à accomplir. Pour nous, parlementaires, ce travail peut prendre deux formes.
Tout d’abord, il s’agit de permettre au débat public de se poursuivre sur ces questions à travers notre mission de contrôle, comme c’est le cas aujourd’hui.
Ensuite, notre rôle passe évidemment par l’initiative législative. En la matière, je me félicite de l’adoption récente par la Haute Assemblée d’une proposition de loi visant à favoriser la parité dans les conseils d’administration et de surveillance. L’intervention du Parlement était devenue indispensable.
Sur le fond, la question de la compétence ne se pose plus et la situation actuelle est préjudiciable aux entreprises françaises, car les femmes sont quasiment absentes des conseils. Ces instances se privent ainsi, tout le monde le reconnaît, d’un potentiel considérable.
Et s’il était nécessaire de légiférer, c’est bien que, hélas, rien n’a changé !
Ce constat, on peut le faire également concernant le chômage. Aujourd’hui, les femmes y sont toujours plus exposées que les hommes. Si elles représentent 47 % des actifs, leur taux de chômage atteint 8, 3 % quand il est de 7, 3 % chez les hommes. S’ajoute à cela une précarité plus importante : outre le fait qu’elles travaillent bien plus souvent à temps partiel, les deux tiers des salariés à bas salaire sont des femmes.
Un autre constat s’impose sur la mise en œuvre de la réforme de 2006 : les négociations collectives étaient un point central et devaient être le moteur de l’évolution des mentalités au niveau de chaque entreprise et au niveau des branches.
Les accords de branche sont bien trop rares aujourd’hui, et, quand ils existent, ce sont parfois des coquilles vides : 10 % seulement de ces accords abordent la thématique de l’égalité professionnelle.
Les procédures de négociations sont trop lourdes, trop contraignantes. Ne serait-il pas possible de les alléger, de les simplifier, pour qu’elles soient plus nombreuses, notamment au sein des petites et moyennes entreprises ?
Une autre piste d’évolution concerne les sanctions qui pourraient être appliquées lorsque les dispositions prévues par la loi de 2006 ne sont pas respectées.
Comme l’a rappelé précédemment ma collègue Catherine Morin-Desailly, l’examen du projet de loi par le Sénat avait été l’occasion pour le groupe centriste de faire valoir la nécessité de telles sanctions. Malheureusement, à l’époque, nos amendements qui allaient dans ce sens n’avaient pas été adoptés. Quatre ans après le vote de ce texte, on put estimer que cette absence de sanction a sans doute été préjudiciable à la bonne mise en application de cette loi.
Il est donc probable qu’à l’avenir de nouvelles initiatives législatives interviennent pour introduire d’autres sanctions ou incitations, comme nous l’avons fait lors de la réforme des retraites.
Plus généralement, il est indispensable de lutter contre la précarité croissante du travail féminin. Le rapport présenté par Brigitte Grésy en juillet 2009 envisageait plusieurs pistes sur ce thème. Elle proposait notamment d’accroître la qualité des emplois à temps partiel en favorisant l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, en améliorant les conditions de rémunération ou encore en favorisant l’encadrement de l’amplitude de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel.
Une autre proposition prévoyait d’aménager la pluriactivité et de favoriser le cumul d’emplois, de manière à permettre aux femmes employées à temps partiel d’augmenter la durée de leur travail et, par voie de conséquence, leur rémunération. À ce jour, il apparaît que 350 000 à 400 000 salariés à temps partiel travaillent simultanément pour plusieurs employeurs. C’est pourquoi il serait opportun de favoriser le cumul d’emplois à temps partiel au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe.
La voie des « tiers employeurs » apparaît également opportune pour donner au salarié la possibilité de bénéficier d’un seul lien contractuel plutôt que d’une multiplicité de contrats.
Toutes ces pistes doivent continuer à être explorées afin que puisse être rapidement atteinte, comme je l’espère, une réelle égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Avant de conclure, je ne peux m’empêcher de vous livrer quelques chiffres concernant la Réunion pour vous montrer à quel point la situation est préoccupante dans nos régions ultra-marines : les Réunionnaises ont un salaire moyen équivalent à 87, 6 % de celui des Réunionnais, et l’écart se creuse pour les cadres et les ouvriers qualifiés ; les femmes occupent seulement 38 % des postes d’encadrement et représentent 25, 5 % des créateurs d’entreprise ; 70 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes ; le taux de chômage des femmes est de 30 %, contre 28 % pour les hommes.
Au-delà de ses différences entre les hommes et les femmes, le problème que nous devons régler de façon urgente est celui de l’absence quasi-totale des Réunionnais aux postes de responsabilité, à la tête des services de l’État, par exemple.
Cette situation avait déjà été dénoncée il y a quelques années par le président de la chambre régionale des comptes, un métropolitain pourtant, dans son discours solennel de rentrée.
Le Président de la République, lors du comité interministériel de l’outre-mer, a pris l’engagement de recruter de préférence des ultra-marins, à compétences égales, à ces postes.
Or, voilà quelques jours, malgré le soutien de Patrick Karam, délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, à la meilleure candidature réunionnaise, c’est un métropolitain qui a été désigné comme directeur du CROUS, alors que, face à lui, il y avait quatre candidatures de locaux, dont trois avec un grade supérieur au sien et une expérience professionnelle ; le quatrième, quant à lui, avait un grade équivalent. C’est un exemple parmi tant d’autres, madame la ministre. Quelle conclusion devons-nous en tirer ? L’élite réunionnaise mériterait bien plus de considération, et les incitations à la mobilité sont mal vécues devant toutes ces injustices.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP. – M. Ronan Kerdraon applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie à mon tour Mme Morin-Desailly de nous donner l’occasion de débattre d’un sujet majeur pour notre société.
Le combat des femmes pour obtenir l’égalité entre les sexes est une cause juste, qui couvre tous les champs de la vie sociale puisqu’il s’agit pour elles de conquérir aussi bien l’égalité politique et l’égalité professionnelle que l’égalité domestique.
Le débat de ce jour sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est surtout un moyen de dénoncer les inégalités régnant, au détriment des femmes, sur le marché du travail.
L’égalité entre hommes et femmes dans le milieu du travail soulève des interrogations spécifiques.
Le principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il est bon de s’en souvenir, a été énoncé formellement pour la première fois en 1951, dans la convention n° 100 de l’Organisation internationale du travail, et inscrit en 1957 dans le Traité de Rome, à l’article 119.
Lorsqu’il se rapporte à un travail de valeur égale, l’ensemble des éléments et conditions de rémunération doit être exempt de toute discrimination fondée sur le sexe.
La politique européenne a enregistré de nouveaux progrès au cours des années 1990, et le traité d’Amsterdam a apporté, en son article 141, un fondement juridique à l’interdiction d’une discrimination salariale entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur.
Malheureusement, la France est un très mauvais élève au regard de l’égalité entre les hommes et les femmes. Pourtant, comme celles qui m’ont précédé à cette tribune l’ont rappelé, il existe un arsenal législatif important : pas moins de cinq lois sur l’égalité salariale ont été votées depuis la loi Roudy de 1983.
La législation française a évolué, passant d’un système paternaliste de protection des femmes, fondé sur des congés spécifiques ou l’interdiction du travail de nuit, à une législation privilégiant la lutte contre les discriminations directes ou indirectes faites aux femmes.
Pour autant, aujourd’hui, en dépit des avancées législatives, les femmes doivent encore se battre pour s’imposer dans la sphère professionnelle.
Les discriminations se retrouvent de bas en haut de l’échelle.
Les femmes sont victimes de ce qui est appelé le « plafond de verre » et qui, dans bien des cas, semble se transformer en plafond d’acier.

Il est consternant de noter que la loi du 23 mars 2006 sur les inégalités de rémunération entre hommes et femmes est restée lettre morte.
La conférence nationale sur l’égalité salariale, lancée en novembre 2007 par Xavier Bertrand, déjà ministre du travail à l’époque, a accouché d’une souris.
Alors que les femmes ont massivement investi le monde du travail – 83% des femmes de 25 à 49 ans travaillent –, elles gagnent 27 % de moins que leurs collègues masculins.
Dans un rapport publié en 2009, Brigitte Grésy, inspectrice générale des affaires sociales, soulignait que « cet écart s’est réduit depuis les années 1960 mais il a cessé de diminuer depuis le milieu des années 1990 ». Or il n’y a jamais eu autant d’accords de branche ou d’entreprise.
En effet, alors que seulement 0, 4 % des accords signés en 2002 abordaient la question de l’égalité professionnelle, ce taux atteignait 5, 2 % en 2008.
Cependant, une analyse qualitative plus approfondie de ces accords montre qu’ils n’ont souvent qu’un faible contenu, parfois limité à de simples déclarations d’intention, faisant alors de ces accords, cela a été dit, des coquilles vides.
Il existe plusieurs freins à une avancée plus déterminée vers l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment le fait que l’essentiel du pouvoir est aux mains des hommes et que, inconsciemment ou non, ils ne jugent pas prioritaire de mettre en place l’environnement institutionnel qui permettrait progresser à cet égard.
Néanmoins, à l’origine de la persistance de ces inégalités, il y a bien évidemment un ensemble plus complexe de causes.
En premier lieu, il convient de remarquer la ségrégation dont sont victimes les femmes sur le marché du travail : elles sont majoritairement cantonnées dans les secteurs, les filières ou les métiers les moins bien reconnus, et donc les moins bien rémunérés.
En deuxième lieu, il faut souligner l’explosion du temps partiel, lequel a bénéficié d’un consensus implicite. Un travail qui libère du temps pour le travail domestique est communément considéré comme un « bon travail » pour une femme.
Par conséquent, les inégalités salariales sont étroitement liées au marché de l’emploi et à la sphère domestique.
À ces raisons s’ajoute la politique menée par les différents gouvernements que vous avez soutenus, mesdames, messieurs de la majorité.
L’augmentation du nombre d’annuités donnant droit à une retraite pleine – la loi Fillon de 2003 – ou encore le récent recul des bornes d’âge ont très fortement pénalisé les femmes. Un retraité touchera deux fois plus qu’une retraitée.
L’encouragement donné aux heures supplémentaires avec la loi TEPA de 2007 a également contribué à accroître les inégalités salariales, dans la mesure c’est prioritairement aux hommes que les employeurs demandent d’effectuer des heures supplémentaires.

La diminution du nombre de fonctionnaires pénalise aussi largement les femmes actives puisqu’une sur quatre est fonctionnaire.
C’est pourquoi la politique doit jouer son rôle en apportant des solutions artificielles justes afin de corriger des effets naturels injustes.
Il faut faire en sorte que les femmes, pendant leur grossesse, ne subissent aucune perte financière, que ce soit à court terme, au regard du salaire, ou à long terme, au regard de la pension de retraite.
Des mesures doivent être prises pour mieux articuler les temps de vie des femmes et favoriser la progression des carrières féminines, en encourageant les structures collectives de garde d’enfant.
Toutes les études vont dans le même sens : la probabilité, pour les femmes, d’accéder à un emploi à temps complet décroît avec l’entrée dans une vie de couple et, plus encore, avec la présence d’enfants, notamment en bas âge, les femmes continuant d’assurer 80 % des tâches domestiques et les deux tiers des tâches parentales. Cela a pour effet de limiter leur investissement temporel au travail et pose le problème du choix entre l’accès aux responsabilités professionnelles et la maternité.
De fait, les femmes connaissent une stagnation de leur évolution de carrière autour de l’âge de 40 ans, ce qui correspond à une conséquence de l’accomplissement des tâches liées à la maternité.
Des pistes de réflexion existent pourtant.
Une première piste pourrait porter sur le développement massif des services aux familles et sur un droit effectif à la garde des jeunes enfants.
La maternité, on l’a vu, a un impact négatif sur l’activité des femmes. À partir de 1994, moment où le congé parental a été étendu à partir du deuxième enfant, le taux d’activité des mères de deux enfants a chuté de 18 % en quatre ans. Plus de la moitié des enfants de moins de trois ans sont gardés par leur mère.
Parallèlement, se pose le problème de la charge des parents malades ou très âgés : dans ce domaine aussi, les besoins grandissent et les politiques publiques montrent leurs insuffisances.
Dans un cas comme dans l’autre, les solutions restent trop souvent individuelles et coûteuses, ce qui oblige les femmes à assumer ces tâches. Elles le paient très cher, à la fois en termes de salaires, de carrière et de retraite. Cela a aussi, bien sûr, des répercussions sur leur indépendance financière, notamment.
Je l’ai dit, l’un des points cruciaux concernant les inégalités professionnelles entre femmes et hommes est la pénurie chronique en matière de garde des jeunes enfants. Se donner les moyens de résoudre cette pénurie exige une volonté politique très forte, car cela demande un investissement important, tant de la part de l’État que de celle des collectivités territoriales.
Cet investissement serait évidemment rentable puisqu’il permettrait d’avoir plus de femmes actives et, par ailleurs, d’offrir à tous les jeunes enfants de moins de trois ans un mode de garde de qualité ou de permettre la scolarisation des enfants dès l’âge de deux ans.

Une autre piste consisterait à revoir l’organisation du travail et à mieux axer la réduction du temps de travail sur l’égalité entre hommes et femmes.
Sans doute faudrait-il aussi sortir de la logique de généralisation du travail à temps partiel et s’orienter plutôt vers la remise en question de la norme du travail à temps plein.
L’OCDE semble désormais aller en ce sens, car elle n’insiste plus, dans ses recommandations, sur l’accentuation du travail à temps partiel, mais sur l’instauration de vraies politiques de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
À ce titre, il pourrait être judicieux de porter un regard sur les expériences étrangères qui peuvent présenter un intérêt particulier. C’est ainsi que, d’une manière générale, dans les pays scandinaves, nous pouvons observer l’existence d’une meilleure articulation des temps professionnels et familiaux.
L’exemple des Pays-Bas mérite également d’être cité. C’est à l’issue d’un large débat, portant sur l’évaluation de la durée du travail selon qu’elle permet un accomplissement satisfaisant des tâches parentales, que des scénarios ont abouti à préconiser une durée de 32 heures de travail hebdomadaire pour les hommes et les femmes. Une loi relative à l’adaptation du temps de travail, votée dans la foulée, permet aux salariés de demander des augmentations ou des diminutions du temps de travail à leur employeur, lequel, en cas de refus, doit prouver son impossibilité de satisfaire cette demande.
La Suède, quant à elle, a instauré un congé de maternité plus long et une durée des congés pour soigner des enfants malades pouvant aller jusqu’à soixante jours.
Peut-être serait-il également souhaitable de déconnecter la période de maternité de la période de travail, afin de rééquilibrer les déroulements de carrière.
Des pays comme le Canada, notamment la province du Québec, ont travaillé de façon très approfondie sur ces questions. Les principales remarques des Québécois sur la manière dont nous abordons la question de l’égalité salariale portent essentiellement sur notre optique, jugée trop étroite, en matière d’inégalités salariales.
Dans nos sociétés dites occidentales, l’une des principales origines des inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail réside dans la distinction, créée artificiellement, entre un travail qui serait productif, c’est-à-dire hors du foyer et donc rémunéré, et un travail improductif, celui qui est accompli à l’intérieur du foyer.
Avec l’arrivée des femmes sur le marché du travail, au moment de la Première Guerre mondiale, cette même distinction s’est perpétuée, en réservant aux hommes les secteurs réputés productifs, dans les domaines techniques ou de direction, et aux femmes les secteurs qualifiés d’improductifs, à savoir la santé, la protection sociale ainsi que les tâches administratives dans les entreprises. Il en est résulté une rémunération moindre dans les secteurs considérés, de fait, comme féminins.
Selon les Québécois, c’est sur cette division du travail, responsable des préjugés de genre, que nous devrions principalement nous pencher.
Le système canadien se fonde sur l’idée que toute personne occupant un poste sous-évalué, considéré comme féminin, doit avoir droit à une rémunération fondée sur la valeur du travail et non sur les préjugés de genre.
Au lieu d’analyser simplement les différences de revenus entre individus exerçant un même travail, la législation canadienne s’intéresse aussi aux inégalités entre les secteurs d’emploi.
De plus, au lieu de laisser la situation se normaliser à partir des plaintes émanant des salariés, ce sont les employeurs qui, au Canada, doivent agir pour constater les inégalités salariales et réduire les écarts salariaux. Par exemple, la législation canadienne impose aux employeurs de plus de dix salariés de suivre un programme d’équité salariale Ce système s’applique aussi bien au secteur privé qu’au secteur public et prévoit des sanctions envers les employeurs qui ne respecteraient pas ce programme.
Mise en œuvre depuis 1997, cette loi canadienne sur l’équité salariale a permis une diminution des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. De 16, 1 % en 1997, ils sont passés à 13, 9% en 2004. Il reste qu’elle n’a pas abouti à l’égalité de fait.
Les cultures et des traditions sont encore lourdes. Certains préjugés ont la vie dure !
Ils sont fondés sur les rapports sociaux entre les sexes et renvoient à la division des rôles au sein de la sphère familiale : accès différenciés à l’éducation et à la formation, répartition inégale du travail domestique, persistance de repères d’un salaire familial masculin assurant la couverture des besoins du ménage et, inversement, d’un salaire d’appoint pour les femmes.
Comme nous le voyons, un changement de mentalité s’impose également du côté des hommes. Ces derniers doivent également prendre part aux tâches domestiques. Lorsque les enfants sont malades, pourquoi serait-ce obligatoirement à la mère de s’absenter de son travail ? Lorsque les enfants sont encore en bas âge, pourquoi le père ne prendrait-il pas un congé parental ? Certains le font, mais ils restent trop rares. Pourquoi les pères ne demanderaient-ils pas à bénéficier d’un horaire aménagé pour pouvoir aller chercher leurs enfants à l’école à seize heures ?
Cette dynamique d’égalité, qui prend en compte l’intérêt des femmes et des hommes, est encore largement sous-estimée.
Heureusement, l’arrivée des jeunes générations, plus sensibilisées que leurs aînées au partage des rôles et aux aléas de la vie professionnelle, pourrait bien modifier les représentations de l’égalité et peser favorablement, demain, sur l’égalité salariale des hommes et des femmes dans les entreprises.
En conclusion, je dirai que la question des inégalités salariales entre hommes et femmes est complexe parce qu’elle témoigne du caractère fortement imbriqué de l’ensemble des inégalités dont sont victimes les femmes dans le monde du travail.
Si l’on souhaite assurer l’égalité entre les sexes, il faut s’en donner les moyens. Il faut agir sur le marché du travail : légiférer efficacement sur l’égalité salariale en appliquant des sanctions dissuasives aux entreprises qui ne respectent pas les lois, combattre le temps partiel subi, favoriser la formation professionnelle des femmes, particulièrement des femmes seules, et aménager leur temps de travail.
Il faut également agir sur la vie familiale et mener une politique volontariste en matière de garde d’enfants.
Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes, il est temps d’agir !
Je tiens à rappeler que le Gouvernement vient de montrer le peu de cas qu’il fait de la situation des femmes dans deux textes majeurs : la réforme des retraites et celle des collectivités territoriales.

M. Ronan Kerdraon. Nous espérons que, en matière d’égalité professionnelle, le Gouvernement, madame la ministre, sera plus attentif et souhaitons connaître ses intentions sur toutes les questions qui ont été soulevées aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
qui l’ont alimenté par leurs interventions de grande qualité.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en effet loin d’être réalisée et cette situation pèse lourdement sur la vie quotidienne des femmes et sur les familles. Un tel état de fait mérite d’être abordé avec lucidité et avec une conviction mise au service de l’efficacité.
Permettez-moi de mentionner quelques données, que plusieurs d’entre vous ont d’ailleurs déjà citées tant elles sont éclairantes.
Tout d’abord, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois : majoritaires parmi les employées, les femmes ne représentent, en 2008, qu’un peu plus du quart des postes d’encadrement des entreprises du secteur privé et semi-public.
Si les femmes représentent 47, 2 % de la population active, force est de constater que la moitié des femmes en activité sont concentrées dans douze des quatre-vingt-six familles professionnelles, essentiellement les métiers des services, de l’éducation et de l’action sanitaire et sociale.
Par ailleurs, les femmes accèdent peu aux hautes responsabilités. C’est le fameux « plafond de verre ». Ainsi, on ne trouve parmi les dirigeants salariés d’entreprise que 17, 2 % de femmes, comme nombre d’entre vous l’ont souligné, et elles ne sont que 5 % à siéger dans les conseils d’administration des grands groupes français.
Tous ces facteurs – la répartition inégale des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les différents secteurs, dans les entreprises et dans les types de postes occupés – se cumulent pour expliquer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, lesquelles se maintiennent au même niveau depuis 1990.
Je remercie Anne-Marie Payet d’avoir apporté un éclairage salutaire sur les difficultés spécifiques de l’outre-mer. Effectivement, les représentations stéréotypées y jouent peut-être encore un rôle plus important qu’en métropole et constituent un frein à l’insertion et à l’égalité. Bien entendu, l’action devra aussi porter à cet égard sur l’orientation des plus jeunes.
Il y a en effet, madame la sénatrice, des femmes tout à fait remarquables outre-mer. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’en rencontrer certaines avec vous.
Je reviendrai tout à l’heure sur l’accompagnement spécifique vers l’emploi des femmes en difficulté et sur le développement d’actions autour de l’articulation des temps.
Catherine Procaccia l’a souligné, tous temps de travail confondus, les salaires des femmes restent inférieurs de 27 % à ceux des hommes.
Face à ce constat, il est crucial d’agir sur l’ensemble des éléments constitutifs du parcours professionnel des salariées. Odette Terrade a rappelé un certain nombre de chiffres et la nécessité d’avoir une vision globale de ces sujets.
L’amélioration de la retraite des femmes implique, par exemple, une réduction des inégalités pendant l’activité, tant en matière de carrière qu’en matière de salaire. Or il ne peut y avoir de réduction des écarts sans diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.
C’est l’objet du rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, institué par la loi du 13 juillet 1983 et enrichi par la loi du 9 mai 2001.
Ce document, qui est soumis pour avis aux institutions représentatives du personnel, rassemble des éléments quantitatifs, c’est-à-dire un certain nombre d’indicateurs chiffrés, toujours utiles, mais aussi qualitatifs, relatifs à la politique de l’entreprise en matière d’égalité, de salaire, de temps de travail, de formation, de promotion et d’articulation des temps de vie professionnelle et familiale.
La réalisation de ce document est un préalable essentiel à la négociation obligatoire sur l’égalité entre les hommes et les femmes, visant à programmer des mesures de suppression des écarts de rémunération en application de la loi du 23 mars 2006.
À l’instar de Catherine Morin-Desailly, j’en appelle à la mobilisation des partenaires sociaux. Ceux-ci pourraient certainement se montrer plus engagés sur les questions d’égalité entre les hommes et les femmes. Je rappelle en effet que la conférence nationale de la négociation salariale a été réunie le 6 novembre 2009. Les partenaires sociaux avaient six mois pour indiquer les sujets sur lesquels ils souhaitaient négocier. Ils ont finalement décliné cette proposition et n’ont engagé aucune négociation. C’est très dommage !
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, le bilan de la négociation collective montre une augmentation du nombre d’accords collectifs signés, tant dans les entreprises que dans les branches professionnelles.
En 2005, on recensait 295 accords d’entreprise traitant de l’égalité entre les femmes et les hommes ; il y en avait 1 290 en 2009, ce qui représente une amélioration notable. Pour ce qui est des accords de branche traitant de cette question, on en comptait 41 en 2005 et 107 en 2009.
Il reste que ce bilan des négociations mérite d’être amélioré, car des inégalités fortes demeurent. À titre d’exemple, 55 % des entreprises n’effectuent pas le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes. Il est donc indispensable de renforcer, à la fois qualitativement et quantitativement, le contenu de ce rapport.
Des mesures importantes ont été prises à cet égard ont été intégrées dans la loi portant réforme des retraites du 9 novembre dernier. Cette loi a renforcé, en son article 99, l’obligation pour les entreprises d’au moins cinquante salariés d’établir un rapport de situation comparée, incluant un plan de résorption des inégalités professionnelles.
À cet égard, je précise à Odette Terrade que les décrets d’application de cet article sont en cours d’élaboration et qu’ils seront publiés avant le 31 mars. Une concertation est actuellement en cours avec les partenaires sociaux concernant les modalités des sanctions que vous appelez justement de vos vœux, madame la sénatrice.
La loi précise notamment que le rapport de situation comparée, qui doit d’ores et déjà comporter un volet prospectif, devra dorénavant contenir un véritable plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan déterminera les objectifs de progression, fondés sur des critères clairs, précis et opérationnels, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre, ainsi qu’une évaluation de leur coût.
Le rapport devra également comporter une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière, par exemple, d’embauche, de formation, de qualification, de conditions de travail, de rémunération, d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
La communication sur le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle sera organisée. L’employeur devra en effet porter à la connaissance de ses salariés, par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen adapté, la synthèse de ce plan, comprenant des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret. Cette synthèse sera tenue à la disposition de toute personne qui la demandera et sera publiée, le cas échéant, sur le site Internet de l’entreprise.
Une autre disposition importante de la loi du 9 novembre dernier est l’application d’une sanction financière en cas d’absence d’accord collectif ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Le montant de la sanction, qui sera fixé par l’inspection du travail, pourra représenter jusqu’à 1 % de la masse salariale des rémunérations et gains bruts. Il pourra être modulé par les services de l’inspection du travail, tant en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle qu’au regard des difficultés objectives particulières que rencontrerait l’entreprise, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Le but, chère Catherine Morin-Desailly, est d’inciter les entreprises à s’engager sur le chemin de l’égalité professionnelle. Toutefois, un peu de contrainte ne nuit pas à la conviction ! §
Les modalités de suivi et de réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action seront fixées par décret, et le produit de la sanction sera affecté au Fonds de solidarité vieillesse.
La loi portant réforme des retraites prévoit également, dans son article 102, que les négociations engagées chaque année sur les objectifs d’égalité professionnelle dans l’entreprise devront également porter sur les conditions dans lesquelles, en cas d’activité à temps partiel, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations lié au maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur d’une rémunération à temps plein.
Plus largement, sur le sujet essentiel et sensible du temps partiel, qui pénalise si souvent les carrières des femmes, je souhaite organiser, au cours du premier semestre de 2011, avec Xavier Bertrand, une table ronde tripartite, rassemblant l’ensemble des parties prenantes, comme je l’ai annoncé voilà quelques jours lors de l’anniversaire de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes.
Cet événement devrait nous permettre d’affiner les pistes existantes et, à tout le moins, de contribuer à sensibiliser le grand public à cette thématique.
Nous le savons, la différence sémantique faite entre le temps partiel choisi et le temps partiel subi est des plus artificielles puisque le recours au temps partiel prétendument choisi est à 80 % féminin.
Pour les femmes qui font le choix de se consacrer à leur famille ou à un proche en situation de dépendance, les conséquences peuvent être dramatiques sur la carrière et la rémunération. Cela est évidemment intolérable. Nous devons briser ensemble ce cercle vicieux.
Toutes ces dispositions doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012. La loi du 23 mars 2006 avait donné aux entreprises un délai de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2010, pour négocier des mesures de résorption des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Je veux, sur ce point, rassurer Mme Terrade : cette date butoir est supprimée et on y a opportunément substitué un dispositif de sanction plus dissuasif. Le dispositif est donc désormais pérenne – Catherine Procaccia y a fait référence dans son intervention. La mise en place va être évidemment renforcée par l’action de l’inspection du travail, chargée d’effectuer des contrôles.
Cela étant, pour progresser vers l’égalité professionnelle, nous devons aussi agir en amont, dès la formation initiale des jeunes filles et des jeunes garçons.
Nous connaissons, nous, une meilleure réussite sur le plan scolaire que les garçons. Les filles sont en effet aujourd’hui en moyenne plus diplômées qu’eux : en 2006, 25 % des femmes âgées de 25 ans à 34 ans disposent d’un diplôme supérieur à bac+2, contre 19, 9 % des hommes du même âge. Tous baccalauréats confondus, à la session 2008, 85, 3 % de filles avaient obtenu leur diplôme, contre 81, 5 % des garçons. Je prie les sénateurs ici présents de nous en excuser ! §
Quoi qu'il en soit, il faut bien constater que les filles n’en tirent pas suffisamment parti au moment de leur choix d’orientation scolaire et professionnelle, car elles sont encore trop peu nombreuses à se diriger vers les filières et les écoles les plus valorisées sur le marché du travail. Elles sont minoritaires dans les formations des secteurs des sciences fondamentales et technologiques, majoritaires dans les séries littéraires et les sciences médico-sociales.
Il est de notre responsabilité collective de mettre fin à ce paradoxe et d’anéantir certains mécanismes de censure que s’imposent les filles elles-mêmes et leurs familles. On sait, par exemple, que les filles accèdent aux filières qui conduisent à des professions plus valorisantes et plus rémunératrices avec des moyennes supérieures à celles des garçons.
Favoriser l’insertion professionnelle des femmes consiste ainsi à assurer l’élargissement des choix d’orientation scolaire et professionnelle des filles, notamment en direction de ces filières prometteuses au regard du marché du travail.
C’est dans cette perspective de diversification des choix professionnels qu’est organisé, chaque année, le Prix de la vocation scientifique et technique des filles, à destination des élèves de terminales : 650 prix, d’un montant de 1 000 euros chacun, sont remis, sur l’ensemble du territoire, à des jeunes filles qui font le choix de s’orienter vers ces filières scientifiques ou technologiques de l’enseignement supérieur, où l’on compte moins de 40 % de filles.
Il est également essentiel d’accompagner les secteurs professionnels et les entreprises dans leur démarche vers l’égalité professionnelle.
À cette fin, des dispositifs spécifiques sont mobilisés, à hauteur de plus de 1 million d’euros par an. Je pense notamment aux aides financières à destination des PME. Il s’agit à la fois d’aides au conseil, pour étudier leur situation en matière d’égalité professionnelle ainsi que la mise en place de mesures, et d’aides à l’action, comme le contrat pour l’égalité professionnelle et le contrat pour la mixité des emplois.
Ces deux contrats permettent la prise en charge par l’État d’une partie des coûts des mesures de sensibilisation, de formation, de promotion ou d’amélioration des conditions de travail, dès lors qu’elles ont pour objectif l’amélioration significative de la place des femmes en termes d’emploi et de qualification.
Toutefois, ces dispositifs sont peu utilisés en pratique. Aussi a-t-il été décidé d’en opérer la fusion de manière simplifier les modalités de leur mise en œuvre et à susciter davantage de mesures en faveur de l’égalité professionnelle. Ce dispositif unique, ouvert aux seules entreprises, permettra de cofinancer des mesures aussi bien individuelles que collectives.
Une autre piste est la contractualisation avec des secteurs professionnels porteurs d’emplois. Je compte notamment développer le travail entamé, il y a quelques années, avec le secteur du bâtiment, en l’occurrence la Fédération française du bâtiment et la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, pour introduire davantage de mixité dans un domaine d’activité où de nombreuses femmes travaillent et obtiennent des qualifications. Le concours intitulé « Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin », lancé par la CAPEB avec le soutien de mon ministère et destiné aux jeunes filles de troisième, s’est déployé dans tous les départements.
Je souhaite également mobiliser d’autres secteurs, tel que celui des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui souffrent aujourd’hui d’une désaffection des jeunes femmes. En France, la proportion de femmes parmi les ingénieurs n’est que de 17 %, et leur nombre est en légère diminution.
Il importe de mieux faire connaître les formations et les métiers, de revisiter une image très stéréotypée du secteur et de valoriser ses atouts. C’est pourquoi un travail avec la branche professionnelle des bureaux d’études techniques, concernée par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, est absolument nécessaire.
Catherine Morin-Desailly a beaucoup insisté sur l’articulation entre temps de la vie professionnelle et temps de la vie personnelle, et cet angle d’analyse me paraît également très pertinent. La palette des mesures concrètes que peuvent, à cet égard, appliquer les entreprises est extrêmement diversifiée.
La fixation d’un entretien avec les femmes enceintes avant leur congé de maternité et à leur retour, afin de leur permettre de reprendre le travail dans les meilleures conditions possibles, s’est concrétisée dans de nombreuses entreprises.
N’oublions pas que la France constitue un modèle de société où l’augmentation du taux d’activité des femmes n’a pas eu d’impact négatif sur l’indice de fécondité.
Les actions à mener impliquent la mobilisation des trois acteurs principaux que sont l’État, les collectivités locales et les entreprises pour guider l’action, en lien avec les initiatives européennes sur l’évolution démographique.
Ce thème, qui fait partie des axes pris en compte dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises, mobilise les acteurs du territoire qui mènent des actions innovantes, financées pour partie par le Fonds social européen ou s’inscrivant dans le cadre de programmes communautaires.
Il convient, en la matière, de valoriser les entreprises qui s’engagent, de saluer des initiatives nouvelles, telles que l’Observatoire de la parentalité, qui fédère les entreprises amies des familles et regroupe d’ores et déjà 130 entreprises.
Le label « Égalité » consacre les organismes novateurs dans leur approche de l’égalité entre les femmes et les hommes, et récompense l’exemplarité de leurs pratiques.
Depuis le 10 mars 2005, date de la première labellisation, un nombre croissant d’organismes, issus de secteurs aussi variés que l’électronique, les transports, les assurances, la communication, l’agro-alimentaire ou les banques, se sont ainsi employés à l’obtenir. Près de 800 000 salariées et salariés travaillant au sein d’entreprises ou d’administrations sont aujourd’hui concernés et bénéficient de cette démarche.
Il nous faut enfin œuvrer à la sensibilisation du grand public, des partenaires sociaux et de la classe politique aux questions des violences et des discriminations salariales auxquelles les femmes sont confrontées dans le monde du travail. Je compte y consacrer une partie du nouveau plan contre les violences. Jusqu’à présent, nous nous sommes surtout préoccupés des violences qui surviennent dans le cadre familial ; il convient de se préoccuper aussi de celles qui existent dans le cadre professionnel.
Une campagne de communication, à la fois pour lutter contre les discriminations salariales et encourager le partage des responsabilités familiales, nous permettrait de porter haut les valeurs qui nous rassemblent. Soyez certains que je mettrai tout en œuvre pour qu’elle soit mise en place dès 2011.
L’entreprise mobilise ainsi différents leviers pour faire progresser l’égalité de traitement. Davantage de femmes ont, de cette façon, accédé à des postes de direction et, même s’il reste des progrès à faire, les écarts de rémunération se sont réduits.
Je souhaite également développer la création d’entreprises par les femmes, source de création d’emplois. Seulement 29 % des entreprises sont créées par des femmes, ce qui est encore insuffisant.
Le Fonds de garantie pour la création, la reprise et le développement d’entreprises à l’initiative des femmes, le FGIF, a permis, en vingt ans, la création de plus de 5 000 entreprises. Institué en 1989 pour faciliter l’accès au financement bancaire par les femmes qui souhaitent créer une entreprise, il leur apporte un soutien personnalisé dans leur démarche.
Ce dispositif, géré par France Active et France Initiative, doit pouvoir être davantage mobilisé et couplé avec d’autres prêts bancaires complémentaires, comme le Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise, le NACRE. Je souhaite pour cela renforcer les partenariats, notamment avec la Caisse des dépôts.
La lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes est donc une action transversale, qui doit se décliner dans toutes les politiques conduites par les différents ministères, ainsi qu’aux niveaux régional et départemental, pour reprendre le concept européen de gender mainstreaming.
Afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique volontariste, pour faire coïncider égalité de droit et égalité réelle, un plan d’action interministériel en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes servira de feuille de route aux décideurs et permettra de concevoir, d’adapter et de mettre en œuvre des programmes appropriés et des stratégies novatrices.
Ce plan, d’une vaste portée, couvrira tous les domaines essentiels pour la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes : accès des femmes aux responsabilités dans la vie politique, économique et associative ; égalité professionnelle et salariale ; accès au droit et respect de la dignité ; articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il comportera une vingtaine d’axes prioritaires d’action, déclinant pour chaque ministère, dans un document unique, une série d’engagements primordiaux. Un comité de pilotage et de suivi regroupant des représentants de chaque administration sera mis en place, afin de suivre, d’ajuster et d’évaluer, ministère par ministère, les actions menées dans le cadre du plan.
C’est ainsi que nous tirerons toutes les leçons utiles du rapport confié à Mme Guégot. Des actions de communication, interne et externe, accompagneront ces travaux au fur et à mesure de leur déroulement.
Le plan d’action interministériel aura vocation à être décliné au niveau régional dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies régionales en faveur des femmes. Il s’accompagnera, par ailleurs, de la réactivation du comité interministériel aux droits des femmes. Ce plan, qui pourrait être d’une durée de cinq ans, sera validé en janvier 2011 lors du comité interministériel, puis lancé par le Premier ministre dans les semaines qui suivront.
J’ai bien entendu ce qu’a dit M. Kerdraon dans la partie de son discours qui concernait l’Europe. Bien entendu, la France a encore du chemin à faire, mais elle n’est pas, tant s’en faut, une mauvaise élève en matière d’égalité professionnelle à l’échelle communautaire.
Les travaux menés au sein de l’Union européenne montrent que la France a mis en place des actions courageuses et efficaces : lois, sanctions, accompagnement des entreprises. Certains États envient même notre efficacité. Quoi qu’il en soit, je porterai ces dossiers relatifs à l’égalité au sein du Conseil. Ainsi, lors du dernier Conseil des ministres européens chargés de l’emploi et des politiques sociales, dit EPSCO, voilà quelques jours, j’ai invité mes collègues à adopter la démarche de la « clause de l’Européenne la plus favorisée » et demandé la saisine de l’Institut européen pour l’égalité des sexes, inauguré en 2010 à Vilnius.
Les interventions dans ce domaine sont donc multiples : actions de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises, action européenne et mobilisation de l’opinion publique.
Je sais pouvoir compter sur les parlementaires de toutes sensibilités politiques pour prendre en compte cet enjeu de l’égalité entre les femmes et les hommes, non seulement au travers du présent débat, que nous devons à l’initiative de Catherine Morin-Desailly, mais aussi de tous les débats d’importance qui vont se succéder.
En tant que ministre en charge des droits des femmes, je veux, avec Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’État, soutenir l’idée selon laquelle le partage des responsabilités professionnelles entre les femmes et les hommes est directement lié au partage des responsabilités familiales, autrement dit au partage des droits mais aussi des devoirs familiaux, à la prise en charge des enfants et des personnes dépendantes, des personnes âgées ou en situation de handicap.
Cela implique notamment de ne pas faire reposer la prise en charge de la dépendance sur les seules épaules des femmes, comme c’est encore trop souvent le cas.
Cette dimension sociétale devra être abordée lors du débat national sur la dépendance, qui doit s’ouvrir très prochainement.
Vous le savez, les femmes sont des prestataires bénévoles pour leur famille, tout en représentant l’immense majorité des salariés à temps partiel dans le secteur des services. Elles sont également les principales concernées par la perte d’autonomie parce qu’elles ont une espérance de vie plus longue. Autant de raisons d’aborder très largement ces questions dans le cadre de ce grand débat sur la dépendance.
Comme vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, nous aurons bien du travail à accomplir dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes au cours de l’année 2011 !
Applaudissements

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec le débat sur cette question orale.
(Texte de la commission)

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, relative aux recherches impliquant la personne humaine [proposition n° 426 (2009-2010), texte de la commission n° 98, rapport n° 97].
Nous reprenons la discussion des articles, que nous avions dû interrompre au terme de notre séance du mercredi 17 novembre.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.
(Non modifié)
L’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121 -16 -1. – On entend par recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l’égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l’objet de la recherche.
« Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1, le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche.
« Les caisses d’assurance maladie prennent en charge les produits faisant l’objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions suivantes :
« 1° Les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou faisant l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée au a de l’article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l’article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 du même code, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une recherche à finalité non commerciale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement ;
« 2° À titre dérogatoire, les médicaments ou produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l’avis conforme de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ces instances s’assurent de l’intérêt de ces recherches pour la santé publique et notamment pour l’amélioration du bon usage et pour l’amélioration de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le promoteur de la recherche s’engage à rendre publics les résultats de sa recherche.
« Lorsque la recherche ayant bénéficié d’une prise en charge ne répond plus à la définition d’une recherche à finalité non commerciale, le promoteur reverse les sommes engagées pour les recherches concernées aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8 du code de la sécurité sociale. Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un recours de pleine juridiction. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

L’amendement n° 3, présenté par MM. Autain et Fischer et Mmes David, Hoarau et Pasquet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le promoteur ne respecte pas l'obligation de reversement visé à l'alinéa précédent, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaire réalisé par le promoteur constaté l'année précédente. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »
Cet amendement n’est pas soutenu.


Cet amendement tend à prévoir une sanction spécifique en cas de non-remboursement à l’assurance maladie des frais encourus lorsqu’une recherche publique est reprise par le secteur privé. Il s’agit donc de préserver les fonds de la sécurité sociale.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, monsieur le président.
L’amendement est adopté.
L’article 2 est adopté.
I. – L’article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, pour vérifier l’absence d’opposition » ;
2° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d’échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine ;
« – la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l’objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
3° Au onzième alinéa, après les mots : « de recherche », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1 » et, après les mots : « des personnes et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Outre les missions qui leur sont confiées en matière de recherches impliquant la personne humaine, les comités sont également consultés en cas d’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d’un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l’article L. 1211-2. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1. »
II. –
Non modifié
III. – L’article L. 1243-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la conservation et la préparation de tissus et cellules », sont insérés les mots : «, des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés issus » ;
2° À la première phrase du même alinéa, les mots : « dans le cadre d’une activité commerciale, », «, y compris à des fins de recherche génétique » et «, après avis du comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l’article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée » sont supprimés. La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »

L’amendement n° 7, présenté par Mme Hermange, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
aux alinéas précédents
par les mots :
au premier alinéa
La parole est à Mme le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 3 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 1131-1 du même code, il est inséré un article L. 1131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131 -1 -1. – Par dérogation à l’article 16-10 du code civil et au premier alinéa de l’article L. 1131-1 du présent code, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins, lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n’a pas exprimé son opposition. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l’opposition est exprimée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une tutelle, l’opposition est exprimée par la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille ou, à défaut, par une personne entretenant avec l’intéressé des liens étroits et stables.
« Il peut être dérogé à l’obligation d’information prévue au premier alinéa lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter avant le début des travaux de recherche un comité de protection des personnes qui s’assure que la personne ne s’était pas opposée à l’examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l’intérêt scientifique de la recherche.
« Lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé au moment où elle est informée du projet de recherche si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave.
« Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 5126-1 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cadre des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut, à titre exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d’autres pharmacies à usage intérieur d’établissements de santé où la recherche est réalisée. » –
Adopté.
(Non modifié)
À la première phrase de l’article L. 1125-3 du même code, les mots : « mentionnés à l’article L. 5311-1 » sont supprimés et la même phrase est complétée par les mots : « ou sur des plantes, substances ou préparations classées comme stupéfiants ou comme psychotropes en application de l’article L. 5132-7 ». –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 5124-9 du même code, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5124 -9 -1. – Les activités mentionnées à l’article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d’établissements publics ou d’organismes à but non lucratif :
« – lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;
« – dans le cadre de recherches sur la personne portant sur des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.
« Ces établissements sont soumis aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5124-2, à l’article L. 5124-3, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5124-4 et aux articles L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11. » –
Adopté.
Après le 6° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Se prononcer sur les orientations souhaitables de la recherche en matière de santé et sur les conséquences, en matière d’organisation des soins, des recherches dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique et veiller au bon fonctionnement des comités de protection des personnes prévus par l’article L. 1123-1 du code de la santé publique. »

L'amendement n° 8, présenté par Mme Hermange, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa (6°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Émettre des recommandations en matière de protection des personnes participant à la recherche et de fonctionnement des comités de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1 du code de la santé publique et veiller au bon fonctionnement de ces comités. » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des recommandations en matière de recherche dans le domaine de la santé et sur les conséquences des recherches ayant un intérêt majeur pour la santé publique. Elle est consultée sur tout projet législatif ou réglementaire concernant les recherches impliquant la personne humaine. Elle désigne le comité chargé du second examen prévu aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9 du code de la santé publique. »
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 161-41 du même code, après les mots : « les commissions mentionnées aux articles » sont ajoutés les mots : « L. 1123-1-1 et ».
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement tend à prévoir une rédaction plus précise de la définition des missions de la HAS, la Haute Autorité de santé, pour ce qui concerne la recherche et les comités de protection des personnes.

Le sous-amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4 de l'amendement n° 8
remplacer les mots :
à la recherche
par les mots :
aux recherches impliquant la personne humaine
II. - Alinéa 6 de l'amendement n° 8, première phrase
remplacer les mots :
des recommandations en matière de recherche dans le domaine de la santé
par les mots :
des propositions sur les orientations souhaitables en matière de recherches impliquant la personne humaine
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 8.
Il convient en effet de compléter les missions de la HAS pour tenir compte de la création, en son sein, de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.
Toutefois, le Gouvernement estime qu’il faut restreindre l’extension de la compétence de la HAS aux seules recherches impliquant la personne humaine puisque la commission précitée n’est compétente que dans ce domaine et non pour l’ensemble des recherches dans le domaine de la santé.
J’ajoute que les orientations de recherche dans le domaine de la santé sont définies par le Gouvernement. Les recommandations formulées en l’espèce répondent à une stratégie politique.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 8, sous réserve de l’adoption du sous-amendement que je viens de défendre.

La compétence de la Haute Autorité de santé nous paraît inclure la possibilité d’émettre des recommandations sur les orientations de la recherche.
La commission n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur ce sous-amendement, dont elle n’a disposé que tardivement. À titre personnel, je pense que la rédaction proposée par la commission est plus adaptée et je m’en remets à la sagesse du Sénat.

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote sur l’amendement n° 13.

Le groupe socialiste, faisant confiance en la sagesse des recommandations de la Haute Autorité de santé, votera l’amendement de la commission des affaires sociales et ne voit pas l’utilité du sous-amendement du Gouvernement.

Tout comme le groupe socialiste, le groupe CRC-SPG votera l’amendement de la commission, mais non le sous-amendement du Gouvernement.
Il n’est pas question de revenir sur les recommandations émises par la HAS sur les recherches sur la personne qui font l’objet de la présente proposition de loi.
Je répète simplement que la politique de recherche dans le domaine de la santé traduit une stratégie qui incombe plus au ministère chargé de la santé qu’à la HAS elle-même.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
I. – Après l’article L. 1123-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123 -1 -1. – Il est institué au sein de la Haute Autorité prévue à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale une Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des comités de protection des personnes. Elle désigne le comité chargé du second examen prévu aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9. Cette commission émet des recommandations sur les évolutions souhaitables en matière de protection des personnes participant à la recherche et de fonctionnement des comités de protection des personnes. Elle est consultée, ainsi que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur tout projet législatif ou réglementaire concernant les recherches impliquant la personne humaine.
« Outre son président, la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine est composée de seize membres titulaires dont :
« 1° Sept membres désignés par l’ensemble des membres des premiers collèges composant les comités de protection des personnes ;
« 2° Sept membres désignés par l’ensemble des membres des deuxièmes collèges composant les comités de protection des personnes ;
« 3° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre en charge de la santé.
« Les membres de la commission nationale doivent être indépendants des promoteurs.
« La commission est présidée par un membre du collège de la Haute Autorité de santé. »
II
« 13° Les modalités d’élection des membres de la commission prévue à l’article L. 1123-1-1 ».

L'amendement n° 9, présenté par Mme Hermange, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1123-1-1. - Les avis et recommandations de la Haute Autorité de santé pris en application du 7° et du treizième alinéa de l’article L. 161-7 du code la sécurité sociale le sont après avis d’une commission spécialisée nommée Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.
La parole est à Mme le rapporteur.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
seize
par le mot :
dix-huit
II. - Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Deux membres de droit : le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
III. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
d'élection
par les mots :
de désignation
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement tend à ce que le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur général de l’offre de soins ou son représentant fassent dorénavant partie de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. Il paraît en effet logique que le ministère chargé de la santé soit représenté au sein d’une instance dédiée à l’examen des questions de recherche impliquant la personne humaine.

La commission ne s’est pas prononcée non plus sur cet amendement. Il me semble que la représentation du ministère chargé de la santé est de droit, mais, si Mme la secrétaire d'État souhaite que cela figure explicitement dans la loi, je n’y vois pas d’inconvénient et donc, à titre personnel, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 10, présenté par Mme Hermange, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Deux personnalités qualifiées désignées par le collège de la Haute Autorité de santé.
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité de santé le soin de désigner les personnalités qualifiées qui siégeront au sein de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, afin de se conformer aux principes régissant la composition des commissions spécialisées de la HAS.
Certes, la HAS désigne les personnalités qualifiées siégeant au sein de ses autres commissions spécialisées. Toutefois, compte tenu de l’importance que le ministère de la santé accorde à la recherche, en particulier aux comités de protection des personnes qu’il agrée, il me paraîtrait plus opportun, en l’espèce, de maintenir une désignation par le ministre chargé de la santé. C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 10.

Nous venons d’adopter un amendement prévoyant une représentation de droit du ministère au sein de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. Je maintiens donc le présent amendement.

Le chemin parcouru par la commission des affaires sociales lors de l’examen du précédent amendement aurait mérité ici une sorte de « retour sur investissement ».
Au nom du groupe socialiste, je soutiens l’amendement n° 10, car nous sommes très attachés à l’indépendance de la Haute Autorité de santé.

Par les temps qui courent, cette indépendance est particulièrement précieuse !

Je voterai l’amendement de la commission.
Madame la secrétaire d'État, puisqu’il est beaucoup question la HAS, je me permets de vous demander quand sera désigné son président. En effet, il est bien beau de vouloir confier une multitude de missions à la HAS, mais il conviendrait aussi de la doter d’un nouveau président…
Monsieur le sénateur, je peux vous dire que la démarche est en cours et qu’on ne manquera pas de vous tenir informé.
L'amendement est adopté.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 4 quinquies, modifié.
L'article 4 quinquies est adopté.
Après l’article L. 1121-16-1 du même code, il est inséré un article L. 1121-16-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-3. – Le premier aliéna de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’est pas applicable aux recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121-1 qui ont reçu l’avis favorable d’un comité mentionné à l’article L. 1123-1.
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut toutefois, en tant que de besoin, saisir pour avis et dans le cadre de ses missions définies à l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée le comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé ». –
Adopté.
(Suppression maintenue)

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le test de la dose maximale tolérée d'un médicament est interdit lorsqu'il est sans lien avec la pathologie du malade auquel il est administré.
La parole est à M. Nicolas About.

Le test de la dose maximale est nécessaire lors des essais de phase 1. Il peut même être une chance pour un certain nombre de malades. Mais il n’existe aucune raison d’administrer à des patients la dose maximale d’un produit dont ils ne sont pas susceptibles de tirer le moindre bénéfice.
C’est pourquoi le présent amendement, auquel je tiens beaucoup, tend à préciser que ce test ne peut être pratiqué sur les participants sains aux essais de phase 1.
Il me paraît utile d’inclure cette disposition dans la loi afin d’apporter un peu plus de sécurité aux patients et de mieux garantir le respect de la personne humaine. Celle-ci doit rester, même dans la phase de recherche, un sujet. Elle peut être un sujet de recherche, mais elle ne doit pas devenir objet ou support de recherche.

L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase de l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, après les mots : « au sens de l'article L. 5121-8, », sont insérés les mots : « sur la première administration à l'homme d'un médicament, ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 16 et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1.
La sécurité des personnes est essentielle et doit évidemment être préservée à tout prix. Monsieur About, je partage votre point de vue : on ne doit pas imposer aux patients des doses excessives.
Néanmoins, dans certaines situations, des évaluations méritent d’être conduites. Par exemple, les personnes atteintes d’insuffisance rénale doivent bien faire l’objet de recherche afin de déterminer la dose maximale de médicament qu’ils peuvent tolérer.
Bien sûr, le malade n’est pas un objet de laboratoire, et en aucun cas il ne doit être utilisé à des fins de recherche sans fondement clinique ou scientifique.
Je propose donc, non pas d’interdire totalement ces recherches, qui sont parfois indispensables, mais de renforcer davantage la protection des personnes qui y participent, en prévoyant que ces recherches sont non seulement réalisées dans des lieux requérant une autorisation spécifique, mais encore soumises à une autorisation expresse de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS.

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement de M. About, reprenant à son compte les raisons que celui-ci a avancées. En effet, les essais de phase 1 doivent être menés sans nuire aux patients.
Je crois en outre que, dans le contexte actuel, cet amendement est particulièrement justifié.
Quant à l’amendement n° 16, il tend à renforcer le contrôle de l’AFSSAPS sur les essais de phase 1. Cet amendement me paraît intéressant mais, tel qu’il est présenté, il entre en concurrence avec celui de Nicolas About, alors que les deux dispositions ne sont pas nécessairement antinomiques.
Dans ces conditions, le Gouvernement, s’il tient à la mesure qu’il propose, devrait peut-être rectifier son amendement afin d’en faire un article additionnel.

Monsieur About, je crois utile, en cet instant, de vous donner de nouveau la parole, afin que vous puissiez apporter votre propre éclairage sur l’amendement du Gouvernement.

Le sujet est en effet très compliqué, monsieur le président.
Tout d’abord, madame la secrétaire d'État, je ne suis pas sûr que, d’une manière générale, le fait que le lieu où sont effectués les travaux de recherche ait fait l’objet d’une autorisation constitue une garantie au regard de l’intérêt du patient. Nous avons vu les limites de cette disposition.
Ensuite, je ne suis pas sûr non plus que l’autorisation de l’AFSSAPS, malgré tout le respect que je dois à cette institution, apporte une garantie pour le patient.

Il est important de rappeler que nous ne parlons pas là de gens en parfaite santé, qui acceptent de faire faire sur eux des recherches et pour lesquels la notion de consentement éclairé a vraiment un sens. Il s’agit de personnes malades, très malades, qui se trouvent même peut-être à un stade ultime de la maladie. On ne me fera jamais croire que de telles personnes sont dans un état où elles peuvent consentir véritablement à ce que l’on fasse des recherches qui n’ont aucun lien avec leur pathologie.

Ces personnes doivent donc être particulièrement protégées.
C’est pourquoi, si je suis prêt à compléter mon amendement, je ne suis pas prêt à le dénaturer.
La rédaction proposée pourrait être la suivante : « Le test de la dose maximale tolérée d’un médicament est interdit lorsqu’il est sans lien avec la pathologie du malade auquel il est administré ou qu’il n’est pas susceptible de lui apporter un bénéfice quelconque. »
Cela est très différent de ce que propose Mme la secrétaire d’État puisque, selon l’objet écrit de son amendement, il s’agit de ne pas imposer à des malades « la prescription de doses excessives d’un médicament lorsque leur pathologie ne le justifie pas ».
On peut considérer que la pathologie de l’insuffisance rénale, par exemple, mérite une recherche aussi poussée que possible, mais pas le malade porteur de cette pathologie, parce que lui ne bénéficiera jamais de la recherche en question. Il convient de faire une grande différence entre la pathologie et la personne humaine qui en est atteinte.
Pour ma part, en tant que médecin, je pourrais dire que je me moque de la pathologie elle-même : ce qui m’importe, c’est mon malade, et je ne veux pas qu’on lui fasse quoi que ce soit qui pourrait lui nuire.

Ce qui intéresse le chercheur, c’est de savoir s’il pourra, demain, utiliser telle nouvelle molécule dans le traitement d’une insuffisance rénale pour des gens qui n’en sont pas du tout au même stade de la maladie que le cancéreux en phase terminale qu’il a devant lui et sur lequel il pourrait être tenté de tester cette molécule, et à très forte dose. Or c’est cela qu’il faut empêcher. Bien sûr, cela fait avancer la science, mais cela n’améliore en rien la situation de ce malade en particulier.
De même, il n’y a aucune raison de tester tel ou tel antimitotique sur un malade qui est au stade terminal d’une insuffisance rénale mais n’a pas de cancer.
Encore une fois, ici, le sujet dont nous nous préoccupons, c’est la personne, non la pathologie.
Si ces essais ont un lien avec la pathologie du malade et qu’il peut en tirer un bénéfice quelconque, aussi minime soit-il, alors oui, on peut les pratiquer ! Mais il ne faut jamais oublier le malade lui-même.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 1 rectifié, présenté par M. About, et ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le test de la dose maximale tolérée d'un médicament est interdit lorsqu'il est sans lien avec la pathologie du malade auquel il est administré ou qu'il n'est pas susceptible de lui apporter un bénéfice quelconque.
Quel est l’avis de la commission ?
Je sais gré à M. About de placer cette discussion sous le signe de la prudence : cela nous permet de recentrer notre réflexion sur le malade et non pas sur un concept, en l’occurrence telle ou telle la pathologie. Notre débat porte, en effet, sur la protection des personnes.
À la lumière des précisions qui viennent d’être apportées, je rejoins M. About.

Je l’ai dit, sur le fond, mon amendement et celui du Gouvernement ne sont pas contradictoires. Ils ne le sont que formellement parce que tous deux visent à rétablir un même article dans une rédaction différente.
Si Mme la secrétaire d’État souhaite absolument que, pour la première administration d’un médicament à l’homme, l’AFSSAPS donne son avis, elle peut le proposer à un autre endroit du texte. Cela apporterait une garantie supplémentaire, mais c’est au Gouvernement de choisir.

La commission ne s’est pas réunie, mais je connais l’esprit dans lequel nous avons travaillé et les discussions que nous avons eues. C’est pourquoi, comme je l’ai indiqué, j’ai émis un avis favorable sur l’amendement n° 1 rectifié.
Bien entendu, comme l’a dit Nicolas About, si le Gouvernement souhaite toutefois introduire cette disposition prévoyant l’avis de l’AFSSAPS, il faudrait en faire un article additionnel.

Madame la secrétaire d’État, dans la mesure où, en l’état, au moins sur un plan strictement formel, votre amendement est en concurrence avec celui de M. About – cela signifie que le vôtre deviendra sans objet si le sien est adopté –, je voudrais savoir si vous le rectifiez de manière à le déplacer ou si vous le retirez.

L’amendement n° 16 est retiré.
La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote sur l’amendement n° 1 rectifié.

Le groupe socialiste avait décidé de voter l’amendement de M. About. Il le votera également dans sa version rectifiée, et celle-ci aurait, à mon sens, de toute façon privé d’objet l’amendement du Gouvernement.
Je me félicite d’autant plus du retrait de l’amendement n° 16 qu’il prévoyait une autorisation expresse de l’AFSSAPS, ce qui est bien plus qu’un simple avis.

J’étais tout à fait opposé à ce que l’AFSSAPS intervienne, de quelque manière que ce soit, dans la procédure relative à la première administration d’un médicament à l’homme.
Chacun le sait, l’AFSSAPS a déjà énormément de difficulté à rendre tous les avis qui lui sont demandés, d’autant que ses ressources lui sont comptées. Je vous rappelle, madame la secrétaire d’État, que l’État ne verse plus de subventions à l’AFSSAPS, faisant confiance aux laboratoires pour assurer le fonctionnement de cette institution et lui retirer le peu d’indépendance qu’elle avait… peut-être.
En effet, le fait que les laboratoires financent en totalité une agence de l’État porte atteinte à son indépendance et à l’impartialité des avis qu’elle peut donner. Cette opinion est très personnelle, mais je crains qu’elle ne soit de plus en plus partagée dans les semaines et les mois qui viennent.
Bref, l’AFSSAPS traverse de réelles difficultés, et elle n’est d’ailleurs pas la seule agence dans ce cas ! Ce n’est pas le moment de lui confier des compétences ou des tâches supplémentaires. L’heure est plutôt à examiner celles qu’elle exerce, à voir comment elle les exerce et à se demander si elle doit continuer à les exercer.
C’est la raison pour laquelle je suis très heureux que vous ayez retiré votre amendement, madame la secrétaire d’État.
Je me rallie, bien entendu, à l’amendement n° 1 rectifié de mon collègue Nicolas About, qui me convient parfaitement.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1125-1 du même code, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article L. 1245-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus » ;
2° Après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de greffe ». –
Adopté.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote.

Comme l’avait annoncé mon collègue Jean-Pierre Godefroy lors de la discussion générale, le 17 novembre dernier, il y avait pour notre groupe trois points non négociables dans ce texte : le consentement écrit, la répartition aléatoire des protocoles de recherches et la composition de la Commission nationale des recherches sur la personne.
Il y a un mois, juste avant que l’examen du texte ne soit interrompu, l’amendement n° 5 du Gouvernement, qui tendait à revenir sur la répartition aléatoire des protocoles de recherche, a fort heureusement été rejeté par notre assemblée.
L’équilibre trouvé en commission étant préservé, le groupe socialiste votera cette proposition de loi. Il reviendra ensuite à la commission mixte paritaire de trouver un ultime compromis l’Assemblée nationale et le Sénat sur les points encore en discussion.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis des conditions dans lesquelles a été examiné ce texte. Grâce à Mme la rapporteur et à Mme la présidente de la commission, à qui je rends hommage, nous avons pu travailler dans un climat de confiance qui a rendu possible l’adoption imminente de cette proposition de loi à l’unanimité.
Il nous faut cependant rester vigilants, car nos collègues députés ne sont pas tout à fait sur les mêmes positions que nous. Il nous reviendra donc de faire prévaloir notre point de vue en commission mixte paritaire.
Si le texte, tel qu’il était nous était revenu de l'Assemblée nationale, ne pouvait nous satisfaire, les amendements qui ont été adoptés en commission font que, aujourd'hui, plus rien ne s’oppose à ce que le groupe CRC-SPG le vote.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à l’instar de François Autain, je me félicite des conditions dans lesquelles nous avons pu examiner cette proposition de loi.
Nous venons de discuter de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et je dois dire, madame la présidente, que vous menez les affaires de la commission des affaires sociales de main de maître ! Quant à vous, madame le rapporteur, tant sur ce sujet que sur d’autres – je pense en particulier à la bioéthique –, vous avez permis à tous les membres de la commission de mieux comprendre les défis qui sont devant nous. En d’autres termes, vous avez toutes deux accompli un excellent travail.
Le groupe de l’Union centriste votera unanimement ce texte. J’espère, pour ma part, que nous n’aurons pas à défendre nos options en commission mixte paritaire parce qu’il sera adopté conforme par l'Assemblée nationale : ce serait tout de même plus simple ! §

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi sera, je l’espère, adoptée à l’unanimité.
Je formulerai deux remarques.
Je déplore que nous ayons dû examiner ce texte de façon morcelée, notamment ce lundi, alors que nous savons que, ce jour-là, les membres de la Haute Assemblée sont moins facilement présents. Bien entendu, les membres de la commission des affaires sociales, eux, étaient là ! §
En revanche, je me réjouis que nous ayons pu étudier ce texte de manière approfondie. Je remercie tout particulièrement notre rapporteur, qui a veillé à fournir toutes les explications nécessaires et qui a été extrêmement attentive à recueillir l’avis de chacun des membres de la commission, de telle sorte que ce texte fasse maintenant consensus.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Mes chers collègues, à mon tour, je tiens à remercier Mme la présidente et Mme le rapporteur de la commission des affaires sociales, ainsi que Mme la secrétaire d'État, mais aussi chacune et chacun d’entre vous de ce climat de coopération qui nous a permis de travailler dans un esprit constructif.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
Mes chers collègues, je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)
L'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente.