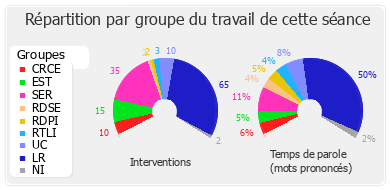Séance en hémicycle du 19 janvier 2021 à 14h30
Sommaire
- Démission et remplacement d'une juge suppléante à la cour de justice de la république
- Garantie du respect de la propriété immobilière contre le squat (voir le dossier)
- Outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Roger Karoutchi.

La séance est reprise.

Mes chers collègues, à la suite de la démission de Mme Corinne Féret, juge suppléante à la Cour de justice de la République, le scrutin pour l’élection d’un nouveau juge suppléant pourrait se tenir jeudi 21 janvier de dix heures trente à onze heures en salle des conférences.
Le délai limite pour le dépôt des candidatures à la présidence serait fixé à demain quinze heures.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Les Républicains, de la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, présentée par Mme Dominique Estrosi Sassone et plusieurs de ses collègues (proposition n° 81, texte de la commission n° 262, rapport n° 261).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « il n’y a pas de justice, il faut que les choses changent » ! Ces quelques mots d’Henri Kaloustian, ancien mécanicien de 75 ans, victime avec son épouse Marie-Thérèse du squat de leur maison de Théoule-sur-Mer l’été dernier, disent presque tout du drame que constitue le squat des biens immobiliers dans notre pays. Ce couple de retraités modestes a constaté, désespéré, le saccage de son domicile, fruit de plus de trente ans d’économies, et l’impuissance des pouvoirs publics pris dans des considérations juridiques kafkaïennes.
Oui, madame la ministre, il faut que les choses changent ! En effet, il n’y a pas qu’une affaire locale qui serait montée en épingle, mais de très nombreuses affaires à travers toute la France depuis de trop nombreuses années. Sur ces travées, chacun d’entre nous pourrait citer un exemple vécu.
Il faut que les choses changent, car le squat de domicile et le déni de justice qui l’accompagne sont d’une violence extrême pour les victimes. Vous voyez votre intimité violée, votre droit le plus légitime bafoué, la force l’emporter sur le respect de la loi, votre toit et votre sécurité, acquis à force de travail et d’épargne, réduits à néant.
Face à ce déni de justice, il existe un abus de droit manifeste, celui de se dire « chez soi » et de prétendre à la protection constitutionnelle du domicile et du droit au logement, alors que le plus simple bon sens montre que le squatteur usurpe, par la force ou par la ruse, le bien de sa victime.
Il faut que les choses changent ! C’est bien pour cela que j’ai déposé cette proposition de loi, soutenue par plus d’une centaine de mes collègues, que je remercie vivement, et portée par le groupe Les Républicains. Je veux apporter des réponses concrètes et rapidement applicables, au-delà de celles qui ont déjà été votées dans la loi ASAP (loi d’accélération et de simplification de l’action publique), qui a, hélas, été pour partie censurée par le Conseil constitutionnel.
Loin de surfer sur un événement médiatique, cette proposition de loi et l’engagement de notre groupe politique à la faire aboutir sont le résultat d’un long travail sénatorial, qui fait honneur à notre assemblée. En effet, les squats de domicile sont une question ancienne et complexe, qui doit être traitée de manière équilibrée et juste dans le respect de nos valeurs républicaines. Le logement est un bien de première nécessité.
Il ne faut pas confondre les squatteurs avec ces locataires en difficulté que l’on cherche à accompagner pour prévenir une expulsion forcément dramatique. De même, nous ne devons pas confondre des criminels qui facilitent et organisent des squats de domicile avec les associations légitimes qui défendent les locataires et cherchent à faire progresser le droit au logement dans notre pays.
Nous ne sommes pas non plus dans une opposition caricaturale entre, d’un côté, riches propriétaires et, de l’autre, pauvres locataires. On l’ignore souvent, mais nombre de locataires, y compris en HLM, sont eux aussi victimes de squatteurs.

Il nous faut donc agir. Mais cet équilibre et cette proportionnalité des moyens juridiques ne sont pas faciles à trouver. Le Sénat les a opiniâtrement recherchés depuis maintenant presque quinze ans. Je tiens à le souligner.
C’est sur l’initiative du Sénat et d’un amendement de notre collègue Catherine Procaccia qu’a été introduit l’article 38 de la loi de 2007 sur le droit au logement opposable, qui donne aux préfets la possibilité d’expulser les squatteurs d’un domicile. Malheureusement, cette disposition est restée peu connue et peu utilisée. On a dressé divers obstacles contre sa mise en œuvre, comme l’obtention de preuves ou le pseudo-délai de flagrance de quarante-huit heures qui empêcherait la force publique d’intervenir.
C’est encore sur l’initiative du Sénat et d’une proposition de loi de notre ancienne collègue Natacha Bouchart qu’une amende de 15 000 euros en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui par voies de fait a été introduite dans le code pénal. De plus, avec cette loi, le squat de domicile est devenu un délit continu, ce qui devait normalement empêcher que l’on oppose aux victimes le pseudo-délai de flagrance de quarante-huit heures.
Las, ce ne fut pas suffisant. En 2018, dans le cadre de la loi ÉLAN (loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), dont j’étais le rapporteur au Sénat, notre assemblée a été obligée de remettre l’ouvrage sur le métier. Nous avons introduit deux modifications dans le code des procédures civiles d’exécution : nous avons supprimé le délai de deux mois pour l’application d’une décision judiciaire d’expulsion, dès lors qu’il y a squat, et supprimé le droit de se prévaloir de la trêve hivernale en cas de squat de domicile.
Malgré ces avancées obtenues par le Sénat, il n’a toujours pas été mis fin aux squats de domicile. Mes chers collègues, vous le savez bien, dans certaines communes, les maires sont obligés de mobiliser la police municipale et leurs concitoyens dans des dispositifs « voisins vigilants » pour éviter les squats.
À la suite de l’affaire de Théoule-sur-Mer, le Gouvernement a simplifié la procédure de l’article 38 dans le cadre de l’examen du projet de loi ASAP. Néanmoins, ce texte n’avait pas vocation à traiter spécifiquement de cette question. C’est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a censuré l’article qui visait à réprimer plus sévèrement les squatteurs. Plus largement, plusieurs questions relatives au squat, qui n’étaient pas de l’ordre de la pure simplification administrative et juridique, n’ont pas pu être introduites dans la loi lors des débats cet automne. Ma proposition de loi a justement pour objet de pouvoir le faire aujourd’hui.
Comme je l’ai souligné, le sujet est complexe. Il faut trouver le juste équilibre entre, d’un côté, la protection de la propriété privée, ce « droit inviolable et sacré », et, de l’autre, la protection du domicile et le droit au logement, qui sont reconnus depuis près de quarante ans comme des principes à valeur constitutionnelle. Il nous faut aussi trouver les moyens juridiques de protéger les victimes de squat, sans pour autant rendre délictuelles des situations de détresse qui doivent trouver une issue sociale et non judiciaire.
Au regard de cette obligation, les termes de la proposition de loi pouvaient être améliorés. Je veux très sincèrement remercier ici le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, le rapporteur Henri Leroy, qui a travaillé avec moi sur cette proposition de loi, et l’ensemble des services de la commission d’avoir cherché, dans un esprit de dialogue et avec toute la rigueur juridique qu’on leur connaît, à atteindre l’objectif qui était le nôtre : protéger les victimes, améliorer l’efficacité des procédures, punir les squatteurs et leurs complices.
Quelles sont donc les avancées concrètes que nous vous proposons d’adopter ?
Nous voulons dissuader plus fermement les squatteurs de domicile. Aujourd’hui, le fait d’occuper par la force le domicile d’autrui est moins sévèrement puni que le fait, pour un occupant légitime, de se faire justice. Cela n’est pas normal ! L’Assemblée nationale et le Sénat étaient parvenus à un accord à ce sujet cet automne. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il s’agissait d’un cavalier législatif dans un projet de loi visant à simplifier le droit. Nous vous proposons aujourd’hui de rétablir ces dispositions dans la loi.
Nous voulons éviter que le squat ne devienne une voie pour faire valoir son droit au logement opposable, une sorte de « coupe-file », car, si les préfets sont désormais fortement incités à procéder à l’expulsion des squatteurs, ils ont toujours l’obligation de les reloger. Or rien ne serait plus injuste que de donner, à notre corps défendant, une prime aux squatteurs au détriment de familles en attente de logement, mais respectueuses de la loi et du bien d’autrui. Nous proposons donc que les juges puissent décider la suspension du droit au logement opposable à titre de peine complémentaire et de manière limitée dans le temps.
Nous voulons dissuader et réprimer ceux qui se rendent complices de squats et, surtout, qui cherchent à les faciliter. De véritables modes d’emploi sont disponibles sur internet. Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à taper « Comment squatter un logement ? » sur le moteur de recherche de votre téléphone portable. Vous trouverez immédiatement des notices vous expliquant comment squatter un logement.
On est glacé à l’idée que, rentrant chez soi d’un déplacement, on puisse trouver la serrure changée et de nouveaux occupants à sa place. Nous proposons donc d’introduire une peine contre la propagande et la publicité en faveur du squat.

Nous voulons clarifier la loi.
On a beaucoup focalisé sur le domicile. Je rappellerai que, dans le cadre de la loi ÉLAN, le Sénat n’avait pu faire adopter le délit d’occupation d’un logement vacant.
Les débats qui ont eu lieu à l’occasion de loi ASAP à l’Assemblée nationale ont montré qu’il ne fallait pas avoir une vision étroite du domicile, compris comme la résidence principale, mais l’étendre à la résidence secondaire et même permettre à des ayants droit d’agir, par exemple pour le compte d’une personne âgée.
Dans la continuité de la position du Sénat et pour traiter toutes les situations, nous vous proposons de faciliter l’expulsion en cas de squat dans les situations interstitielles entre deux locations ou avant un emménagement.
Nous souhaitons éviter que, lors des procédures d’expulsion, la notion de « voies de fait » ne donne lieu à des interprétations jurisprudentielles dénaturant les objectifs de la loi.
Enfin, nous souhaitons encore accélérer la procédure de l’article 38 exécutée par les préfets en réduisant le délai d’intervention à vingt-quatre heures, tout simplement parce que, dans la plupart des cas, les squatteurs commettent des dégradations et que le seul moyen de limiter ces dégâts est d’agir extrêmement rapidement.
Voilà, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les principales dispositions de la proposition de loi, sur lesquelles le rapporteur Henri Leroy aura l’occasion de revenir.
Je terminerai en citant Portalis, grande figure provençale et célèbre juriste, qui soulignait que « les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison » et qu’on ne pouvait laisser leur contestation indécise « sans forcer chaque citoyen à devenir juge dans sa propre cause, et sans oublier que la justice est la première dette de la souveraineté ».
C’est cette dette de justice, de sagesse et de raison à l’égard des victimes de squat que je vous propose de voter aujourd’hui à travers cette proposition de loi !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Alain Marc applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement satisfait de rapporter devant vous la proposition de loi de notre collègue Dominique Estrosi Sassone, cosignée par plus d’une centaine de sénateurs. Les affaires récentes de Théoule-sur-Mer ou du Petit Cambodge nous appellent en effet à mieux protéger la propriété, « droit inviolable et sacré » selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, inscrite dans le préambule de notre Constitution, contre les squatteurs.
Certes, il existe déjà des dispositifs spécifiques pour lutter contre les squatteurs : le délit de violation de domicile de l’article 226-4 du code pénal ou la procédure rapide d’évacuation forcée, créée sur l’initiative du Sénat et, plus précisément, de notre collègue Catherine Procaccia dans la loi DALO du 5 mars 2007 lorsqu’il y a violation du domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal. Mais les affaires évoquées démontrent qu’ils ne sont ni suffisamment dissuasifs à l’égard des squatteurs ni suffisamment connus des propriétaires, voire des préfectures, des forces de police et de gendarmerie et même des parquets.
À ce propos, j’ai été très surpris d’entendre lors de mes auditions que, dans l’affaire de Théoule-sur-Mer, le procureur de la République se serait opposé à une intervention des gendarmes, en invoquant le dépassement d’un délai de flagrance de quarante-huit heures, pourtant non prévu par les textes, puisqu’il s’agit d’un délit continu. La sous-préfecture, quant à elle, paraissait peu au fait de la question et ignorait que la procédure d’évacuation forcée pouvait s’appliquer à une résidence secondaire. C’est finalement parce qu’elle a constaté des faits de violences conjugales au sein du couple de squatteurs que la gendarmerie est intervenue et que les propriétaires ont pu réintégrer leur bien, propriété et domicile.
Ce dysfonctionnement est incompréhensible pour nos concitoyens. Une loi existe, mais elle est mal connue et, donc, mal appliquée. Les ministères interpellés nous annoncent une circulaire prochaine pour y remédier : elle est indispensable, et j’espère, madame la ministre, que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps.
Pour autant, la proposition de loi de notre collègue Dominique Estrosi Sassone n’est pas la énième réaction législative à un fait divers. Il s’agit d’un travail de fond pour compléter de manière utile la législation en vigueur. La commission des lois en a gardé les principaux apports, tout en la recentrant sur le cas des véritables squatteurs, c’est-à-dire ceux qui pénètrent dans les lieux contre la volonté du propriétaire, par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et qui savent donc, sans ambiguïté, ne pas être chez eux, selon les termes consacrés de la jurisprudence.
Les auditions que j’ai menées auprès des ministères concernés, mais aussi de l’Union nationale des propriétaires immobiliers et de la Fondation Abbé-Pierre m’ont convaincu de la nécessité de distinguer la situation des locataires défaillants ou des occupants à titre gratuit qui se maintiennent dans les lieux contre la volonté du propriétaire de celle des squatteurs.
Il y a tout d’abord une question d’opportunité : ces personnes sont entrées dans les lieux de manière licite et elles peuvent être simplement confrontées à un accident de la vie. Pénaliser le locataire défaillant reviendrait en définitive à réintroduire l’emprisonnement pour dettes. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait rien à améliorer pour agir contre les locataires de mauvaise foi qui font du « tourisme locatif », mais c’est un autre sujet. D’ailleurs, avec la commission des lois, nous avons défini, en début d’examen de cette proposition de loi, son périmètre pour l’application de l’article 45 de la Constitution.
Il s’agit également de préserver l’équilibre entre le droit constitutionnel de propriété, garanti par les articles II et XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le droit au logement, qui a été reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle.
Dans cet esprit, la commission a précisé le nouveau délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble, en exigeant une introduction dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Elle a également introduit une gradation des peines pour punir plus sévèrement le squat d’un domicile que celui de locaux non utilisés à cette fin.
La commission a précisé la définition de la nouvelle infraction consistant à faire la propagande ou la publicité de l’occupation frauduleuse d’immeuble pour ne cibler que la diffusion de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission de ce délit. Il s’agit de préserver la liberté d’expression des associations luttant contre le mal-logement, tout en permettant la poursuite de ceux qui incitent au squat en publiant sur internet de véritables modes d’emploi.
Par cohérence, à l’article 3, la commission a exclu de la procédure administrative d’évacuation forcée les locataires ou occupants entrés dans les lieux avec l’accord du propriétaire et qui se maintiendraient contre sa volonté, après résiliation du contrat de bail ou le retrait de l’autorisation. Elle a en revanche élargi l’application de cette procédure dérogatoire aux « locaux à usage d’habitation ». Le Sénat avait déjà voté cette mesure dans le cadre de la loi ÉLAN, sur l’initiative de notre collègue Marc-Philippe Daubresse, alors rapporteur pour avis.
L’article 3 de la proposition améliore ainsi de manière substantielle la rédaction adoptée en décembre dernier dans le cadre de la loi ASAP. Il permet d’apporter une solution lorsque le logement illicitement occupé n’est pas encore le domicile effectif de quelqu’un, par exemple lorsque les squatteurs occupent un logement laissé vacant entre deux locations ou un logement nouvellement acheté.
Enfin, à l’article 4, nous avons maintenu l’exigence d’une entrée dans les lieux par voies de fait pour priver un occupant du bénéfice du délai de deux mois et de la trêve hivernale dans le cadre d’une procédure d’expulsion, tout en précisant la notion de « voies de fait » pour éviter certaines jurisprudences divergentes, généralement peu favorables aux propriétaires.
Mes chers collègues, je vous invite à voter le texte de la commission, qui est efficace et équilibré. Mme la ministre nous dira probablement qu’il est trop tôt pour revenir sur un sujet qui vient de faire l’objet de dispositions dans le cadre de la loi ASAP du 7 décembre 2020… Mais l’auteur de la proposition de loi nous a expliqué de façon remarquable comment on n’avait pas pu aller au bout de ces dispositions.
Pour ma part, je considère qu’il n’est jamais trop tôt pour apporter des solutions à des problèmes qui existent et persistent depuis des années. Il suffit d’aller sur le terrain pour le constater – aller sur le terrain, c’est voir ; rester à son bureau, c’est philosopher ! Et ces problèmes perturbent gravement la vie de certains de nos concitoyens !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC. – M. Alain Marc applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur – cher Henri Leroy –, madame l’auteure de la proposition de loi – chère Dominique Estrosi Sassone –, mesdames, messieurs les sénateurs, les affaires récentes de squat de domicile, à Théoule-sur-Mer ou Saint-Honoré-les-Bains, que j’ai suivies avec beaucoup d’attention, nous ont montré que les dispositifs d’évacuation de domicile squatté n’étaient pas toujours assez clairs, pas toujours assez bien connus par les personnes chargées de les mettre en œuvre. Forts de ce constat, le Gouvernement et les parlementaires ont choisi d’enrichir la loi dite « ASAP », d’accélération et de simplification de l’action publique, adoptée à l’automne dernier, avec un article dédié à cette question.
Les dispositions prises dans le cadre de cette loi ont permis de clarifier le champ d’application, d’encadrer les délais des procédures de lutte contre les squats de domicile, ainsi que de renforcer la procédure d’extrême urgence, placée sous la responsabilité des préfets, car il n’est pas acceptable de se trouver privé de son domicile. Ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel et sont d’application directe, à l’exception de l’aggravation des sanctions, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants.
Il est maintenant essentiel de mieux faire connaître ces procédures spécifiques aux préfets, aux procureurs de la République, aux forces de l’ordre, afin qu’elles puissent être appliquées correctement et immédiatement. La circulaire prévue pour cela, que j’avais annoncée voilà quelque temps, est en cours de signature avec le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux. Elle sortira dans les prochains jours pour apporter aux acteurs de terrain des précisions quant à la mise en œuvre de ces procédures.
Les procédures doivent également être mieux connues de nos concitoyens. C’est pour cela que le site service-public.fr a été corrigé et enrichi dans la foulée de l’adoption de la loi.
Plusieurs faits divers récents ont par ailleurs soulevé des interrogations sur les procédures applicables en cas de squat hors domicile.
S’il y avait urgence à clarifier la situation pour les domiciles – ce que nous avons fait avec la loi ASAP –, il ne faut pas, pour les situations ne relevant pas des domiciles, se laisser emporter par l’émotion au moment de fixer des règles qui s’appliqueront, en fait, à un nombre très important de situations. Dans ces cas, il doit revenir au juge d’apprécier les faits et de faire respecter la procédure judiciaire et le droit de chacune des parties. L’État de droit nous l’impose pour respecter cet équilibre et ne pas élargir le champ des exceptions.
Derrière une occupation sans droit ni titre, il peut effectivement y avoir une multitude de situations différentes.
Du côté des propriétaires, on trouve des collectivités ou des entreprises dont les locaux ont été laissés vides, parfois pendant très longtemps, …
… mais aussi des particuliers dont le loyer constitue une source substantielle de revenus, voire un moyen de rembourser leur emprunt ou de payer leur propre loyer.
Du côté des occupants, on trouve des personnes de mauvaise foi, qui pensent avoir le droit pour eux ou les procédures pour eux, mais aussi des personnes de bonne foi, parfois à la merci de marchands de sommeil, ou des locataires qui, après avoir payé scrupuleusement leur loyer pendant quelques années, connaissent d’importantes difficultés financières, potentiellement aggravées dans le contexte actuel.
Toutes ces situations montrent, au-delà de la question du squat, l’étendue des enjeux de la politique du logement. D’ailleurs, nous avons fait un effort sans précédent, lors de la crise actuelle, pour créer des places d’hébergement, atteignant la semaine dernière 200 000 places d’hébergement ouvertes. Je poursuis la mise en œuvre de la politique dite du « Logement d’abord », et, avec un parlementaire en mission, le député Nicolas Démoulin, nous allons travailler sur la prévention des expulsions locatives, afin d’éviter un maximum de situations dramatiques.
J’en viens maintenant aux dispositions de cette proposition de loi.
Comme vous l’avez présupposé, monsieur le rapporteur, le Gouvernement soutient les avancées et l’équilibre trouvés dans le cadre de la loi ASAP, afin de renforcer la lutte contre les squats de domicile. Il n’est donc pas favorable globalement au texte, tel qu’il est présenté aujourd’hui.
L’article 1er reprend une disposition renforçant les sanctions pénales en cas de violation de domicile, qui, proposée par le Gouvernement et adoptée dans le cadre de l’examen du projet de loi ASAP, avait été considérée par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif et censurée à ce titre. Le Gouvernement y est donc favorable. En revanche, il n’est pas favorable aux articles 2, 3 et 4 et, par conséquent, à l’ensemble de la proposition de loi.
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. L’article 2 crée en effet quatre nouveaux articles dans le code pénal afin de punir l’occupation illicite d’un immeuble. L’objectif de cet article est de viser les cas d’occupation de locaux qui ne sont pas des habitations, comme le cas médiatisé du local du Petit Cambodge à Paris. Malgré les modifications apportées par le rapporteur en commission, il apparaît que la création de cette nouvelle infraction rompt l’équilibre entre droit de propriété et droit à un logement décent.
Exclamations indignées sur les travées du groupe Les Républicains.
Premièrement, seraient recouverts des champs d’infractions déjà existants. Les domiciles sont déjà couverts par l’infraction de violation de domicile, et la jurisprudence pénale retient une acception large de tout lieu dans lequel il y a atteinte à la vie privée. En outre, les infractions liées aux dégradations résultant de l’entrée illicite dans les lieux existent déjà.
Deuxièmement, cette infraction pourrait s’appliquer à des situations dans lesquelles on pénaliserait des personnes se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, par exemple après résiliation du bail, y compris en ayant indiqué pouvoir payer le loyer régulièrement, du fait d’une appréciation possiblement très large de la notion de manœuvre.
Par ailleurs, toujours au titre de l’article 2, la juridiction pourra décider d’instaurer une interdiction pour la personne en infraction de se prévaloir du droit au logement opposable pour une durée de trois ans. Cette disposition soulève une interrogation constitutionnelle forte et constitue une ligne rouge pour le Gouvernement, parce que l’on ne répond pas à la détresse sociale par de nouvelles infractions et sanctions.
Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
L’article 3 vise, quant à lui, à modifier l’article 38 de la loi DALO dans sa rédaction issue de la loi ASAP. Cette procédure, dérogatoire du droit commun, exige une définition stricte de son champ d’application. Élargir celui-ci au-delà de la notion de domicile pose un véritable problème de constitutionnalité, en particulier au regard de l’atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, il faut un délai d’instruction du préfet raisonnable : le réduire de quarante-huit à vingt-quatre heures n’est pas réaliste.
Enfin, l’article 4 a pour objet d’écarter le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et le respect de la trêve hivernale de la procédure d’expulsion pour certaines situations. Ces possibilités existent déjà, lorsque la personne est entrée dans les lieux par voies de fait ; elles sont mises en œuvre dans les jugements. L’extension à d’autres situations, comme l’entrée à l’aide de manœuvres, soulève à nouveau une problématique d’ordre constitutionnel et pose la question de la trêve hivernale, au respect de laquelle le Gouvernement est extrêmement attaché.
Pour conclure, j’indique que le Gouvernement souhaite s’en tenir à l’équilibre trouvé dans la loi ASAP, …
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. … avec le renforcement des dispositions permettant de lutter contre les squats de domicile. Je ne juge pas opportun de modifier cet équilibre, alors même que la loi vient d’entrer en vigueur et que nous n’avons pas le recul nécessaire pour dresser le bilan de son application.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui soulève plusieurs questions particulièrement intéressantes sur le plan humain, sur le plan juridique et sur le plan philosophique. Comme je l’ai indiqué en commission des lois, elle a une vertu : protéger les résidences secondaires et les logements inoccupés de la même manière que les résidences principales. Elle a également une faiblesse substantielle : pécher par une orientation uniquement répressive, dont l’efficacité reste à prouver.
À l’entame de ce débat, je nous invite, chacun et chacune, à nous projeter et à nous identifier aux différents protagonistes dont il va être question dans nos échanges.
Mettons-nous d’abord dans la peau du propriétaire dont le bien a été squatté.

Mesurons le désarroi et la colère de cette personne, de ce couple ou de cette famille.
Mettons-nous ensuite dans la peau d’un squatteur. Essayons de comprendre le parcours de vie
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

… et, parfois, les raisons qui ont pu conduire cette personne, ce couple ou cette famille à entrer par effraction dans le logement d’autrui.
Reconnaissons, mes chers collègues, que, s’il est facile pour chacun et chacune d’entre nous de s’identifier à un propriétaire, il est parfois plus difficile de s’identifier à un squatteur.

M. Hussein Bourgi. Pourtant, ces squatteurs sont des hommes et des femmes comme nous.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Derrière ce vocable globalisant de « squatteurs », il y a des réalités différentes, que je vais essayer de vous exposer si vous voulez bien m’écouter.
Une minorité de squatteurs, tout d’abord, sont des personnes ayant fait le choix de s’inscrire dans la marginalité, en optant parfois pour un mode de vie communautaire.
Une autre minorité de squatteurs, ensuite, sont des hommes et des femmes qui ont été orientés vers un squat par un réseau mafieux ou par des marchands de sommeil. C’est la réalité ! Ne la nions pas ! Ne la minorons pas !
À côté de ces situations, il y a l’écrasante majorité des squatteurs qui sont des personnes pauvres et miséreuses.

Elles sont à la rue, au sens propre comme figuré, en raison des aléas et des accidents de la vie.
Ces gens, ces femmes, ces hommes, je les ai côtoyés, parfois dans ma permanence d’élu local, parfois devant les prétoires des tribunaux. J’ai appris à surmonter mes appréhensions et mes préjugés pour ne pas être tenté de les juger avant même de les avoir connus et écoutés.
Dans les propos que je vais tenir aujourd’hui, j’aurai à cœur de faire preuve de mesure et de tempérance…

… pour ne heurter et ne blesser personne.
Le débat juridique qui nous occupe voit s’affronter deux droits fondamentaux, chacun possédant une valeur constitutionnelle.
En premier lieu, le droit inviolable et sacré à jouir de sa propriété privée, de son bien, droit consacré par l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En second lieu, le droit fondamental de chacun à bénéficier d’un toit et d’un logement décent, découlant des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La confrontation judiciaire entre ces deux normes n’a pour l’heure pas produit une jurisprudence constante, permettant de définir une gradation entre ces deux principes à valeur constitutionnelle. À titre d’exemple, le tribunal de grande instance de Saintes a semblé donner une dimension supérieure au droit au logement, estimant dans un jugement du 28 mars 1995 qu’il appartenait au juge de déterminer l’état de nécessité permettant le maintien d’une personne dans un bien qui n’est pas le sien. A contrario, plus récemment, en 2019, la Cour de cassation a estimé que l’expulsion de squatteurs était une mesure appropriée et proportionnée, eu égard à l’atteinte faite au droit à la propriété par les occupants illégitimes.
Ainsi, en l’absence d’une jurisprudence ferme et constante, le droit varie au gré des faits divers qui défraient la chronique médiatique – cet été, à Théoule-sur-Mer, mais aussi à Rochefort-du-Gard.
La présente proposition de loi en est la parfaite illustration : elle est le prolongement d’un fait divers très médiatisé. En guise de défense, les prévenus avaient justifié le maintien illégitime dans un bien ne leur appartenant pas par l’incapacité des services publics et des bailleurs sociaux à leur trouver un logement dans une commune des Alpes-Maritimes.

Deux enseignements peuvent être tirés de cette affaire.
Tout d’abord, notre système judiciaire est parfaitement à même de traiter ce type de litige
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

… dans la mesure où les prévenus ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis, ainsi qu’au versement de 15 000 euros de dommages et intérêts aux propriétaires de la maison squattée.
Si des procédures existent déjà, quel est donc l’objet réel de la présente proposition de loi ?
Si, dans le cas de Théoule-sur-Mer, les services de l’État et les pouvoirs publics ont manqué de diligence et de célérité, car ils méconnaissaient les leviers dont ils disposaient pour évincer les squatteurs, cela ne justifie pas, de mon point de vue, le vote d’une aggravation des peines encourues. L’envoi d’une circulaire ministérielle aux préfets et aux parquets aurait suffi !
Ensuite, nous pouvons légitimement nous demander si ce fait divers se serait produit avec un plus grand nombre de logements sociaux dans les communes assujetties à la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains).
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

C’est bien là le cœur du sujet : la population française se paupérise. La France compte désormais 10 millions de pauvres. Force est de constater que ce phénomène va de pair avec le mal-logement croissant, qui touche environ 4 millions de personnes dans notre pays.
Alors que la loi DALO de 2007 s’était donné pour mission de garantir un toit à chacun de nos concitoyens, ses promesses et ses objectifs ont du mal à se concrétiser.
Année après année, le rapport de la Fondation Abbé-Pierre résonne comme un constat d’échec, car la France fait du surplace, quand elle ne régresse pas ! Derrière les chiffres du mal-logement, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui errent d’hôtels en hôtels, de centres d’hébergement en centres d’hébergement. Quand ils ont eu la chance de trouver une place ! Parfois, faute de place, ils dorment dans la rue, sur un banc, sur une bouche d’aération, ou devant la porte cochère de nos immeubles.
Dans bien des cas, c’est, hélas, cet état de nécessité qui pousse certaines personnes à investir des habitations ne leur appartenant pas.
Alors que cette misère sociale nécessiterait une refonte totale de nos dispositifs d’hébergement et de logement, afin que ceux-ci fonctionnent avec plus d’efficience, l’auteure de cette proposition de loi nous présente un texte dont les solutions ne sauraient, hélas, endiguer le mal-logement dès la source.

Ce n’est pas avec la surenchère répressive que nous allons régler le problème. Ce n’est pas avec les postures que nous allons apporter des réponses efficaces à un problème dont nous mesurons, mes chers collègues, la complexité.
Gardons-nous des réponses simplistes, car elles sont vouées à l’échec. Gardons-nous aussi des explications manichéennes, car elles seraient nécessairement caricaturales.
Ce n’est pas en alourdissant les sanctions que nous allons dissuader ceux qui n’ont rien ou ceux qui ont peu de squatter. Ces gens-là vivent des minimas sociaux. Il est illusoire de croire, ou plutôt de faire croire, que les tribunaux vont les sanctionner plus lourdement.
Cette proposition de loi entend par ailleurs sanctionner toute publicité ou propagande en faveur de l’occupation frauduleuse d’un lieu. Nous ne pouvons accepter cette pénalisation d’une certaine forme d’action associative
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

, même si elle nous dérange ou nous gêne. Dois-je rappeler que, dans toutes les démocraties, singulièrement en France, c’est parfois l’action non académique et non conventionnelle de certaines ONG qui a fait bouger le droit ? Dois-je rappeler que c’est parfois la désobéissance civile qui a conduit le législateur et les pouvoirs publics à faire évoluer leurs politiques ?
Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Enfin, ce qui de mon point de vue est le plus grave, ce texte vise à priver pendant trois ans une personne reconnue coupable de squat d’un droit au logement opposable. Cette peine complémentaire ressemble davantage à de l’acharnement qu’à une mesure constructive.

Si l’on en venait ainsi à priver pendant trois ans une personne de l’accès au droit au logement social, ne risquerait-on pas de la voir squatter sans répit ? Je crains que cette disposition ne soit une machine à fabriquer des récidivistes. Le bon sens ne voudrait-il pas que l’on accompagne ces individus vers ces dispositifs, plutôt que de les en priver ?
S’attaquant aux conséquences du mal-logement, il va sans dire que cette proposition de loi se trompe de cible.

M. Hussein Bourgi. Pour cette raison, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne saurait la voter en l’état. Pour autant, notre groupe est bien évidemment opposé à toute forme d’angélisme en matière de squat. En ce sens, nous n’acceptons aucunement les occupations frauduleuses de bâtiments ou résidences secondaires. Aussi, nous nous trouverons toujours du côté de ceux qui défendent le droit constitutionnel du propriétaire à disposer de son bien
Marques de doute sur les travées du groupe Les Républicains.

… afin que ces propriétaires puissent continuer à jouir de leurs biens sans crainte, …

Lorsqu’un propriétaire se trouve confronté à un locataire indésirable, …

M. Hussein Bourgi. … la loi doit pouvoir continuer à jouer son rôle. Plus que d’une loi d’affichage…
Marques d ’ impatience sur les travées du groupe Les Républicains.

Merci, monsieur le président. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – MM. Alain Richard et Didier Rambaud applaudissent également.)

Autant vous le dire, je ne vais pas chanter la même chanson…
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à mieux lutter contre les squats, but ô combien louable, si je puis dire, et qu’il convient d’atteindre sans délai.
Depuis des décennies, la loi n’a cessé de renforcer les droits des locataires au point de protéger les squatteurs au détriment, bien sûr, des propriétaires. Nombre d’entre eux passent alors des années à se battre, à grands frais d’avocat, pour tenter d’obtenir la libération de leur logement. Des petits propriétaires qui comptaient sur le fruit du travail de toute une vie pour obtenir un complément de retraite et qui se retrouvent dans les pires difficultés financières pour ne plus percevoir de loyers. Ils n’ont donc plus les moyens d’entretenir leur logement, que les squatteurs saccagent en quelques mois.
Des exemples comme ceux-là, je pourrais vous en citer des centaines à Marseille : les Rosiers, la Maurelette, le Parc Corot, le Campus. Des résidences privées qui sont tombées entre les mains de dealers, de clandestins, de marginaux, tous squatteurs et tous protégés par la loi. Les propriétaires, à bout de forces et sans soutien, finissent par abandonner purement et simplement leurs biens.
Conséquence : des conditions toujours plus draconiennes exigées des locataires, tant les propriétaires craignent – à juste titre, donc – de se retrouver avec des mauvais payeurs occupant leur logement. Cela ne fait qu’accentuer encore davantage la crise du logement, affectant notamment les jeunes, qui ont toujours plus de mal à se loger, qu’ils soient actifs ou étudiants.
La raréfaction de la location entraînant mécaniquement une hausse des loyers, c’est une fois de plus les honnêtes gens à la recherche d’un logement qui sont financièrement pénalisés.
Malheureusement, la commission a décidé de supprimer toute une partie de la proposition de loi pour se concentrer sur les squatteurs qui entrent de force dans des propriétés. Elle a même voulu préserver la trêve hivernale pour les autres squatteurs. La France, ce merveilleux pays où l’on protège les hors-la-loi…
À Marseille, nous sommes confrontés de façon récurrente à ce phénomène.
Souvent issus de la communauté rom, épaulés par des associations d’extrême gauche, dont nous avons un digne représentant ici, ces squatteurs, qui connaissent bien le droit, s’installent sur des terrains nus ou dans des logements inoccupés et les transforment rapidement en véritable décharge. C’est alors tout un quartier qui subit une insécurité matérielle, physique et sanitaire. Combien de fois ai-je dû intervenir personnellement, de jour comme de nuit, pour empêcher le pire ?
Ce texte renforcera les sanctions et facilitera les procédures. C’est évidemment positif. Mais il fait l’impasse sur la réalité du terrain : le manque de moyens policiers ne permet pas d’interventions rapides et le délai de carence n’est que de quarante-huit heures. Au-delà, pour le propriétaire, c’est le parcours du combattant, et cela peut durer des années !
Ce texte a beau renforcer la loi, tant qu’il n’y aura pas assez de policiers pour la faire respecter, elle restera lettre morte.
Protéger les propriétaires, c’est protéger les logements, la location et, donc, les locataires. Pour préserver le droit au logement, nous devons garantir, d’abord, le droit à la protection de la propriété immobilière.

Le Front national parle sans qu’on l’interrompe : c’est un avantage par rapport à l’intervenant du groupe socialiste, monsieur le président !
M. Dany Wattebled applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, des affaires de squat défraient régulièrement la chronique. Elles sont toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Chaque fois, elles nous laissent sans voix. Un brin d’empathie suffit pourtant à comprendre le sentiment d’injustice qui sidère tous ces propriétaires, soudainement privés de la jouissance de leur bien.
Malheureusement, ces affaires ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Nous avons tous connu, que ce soit dans notre vie privée ou au cours d’un engagement local, des affaires de squat qui n’ont pas défrayé la chronique. Ces propriétaires se trouvent alors désemparés et ne peuvent pas compter sur l’indignation médiatique pour faire entendre leurs revendications légitimes. Dans ces cas, un constat s’impose : la loi protège, de fait, les squatteurs davantage que les propriétaires. Or ce sont eux que nous devons ici défendre.
Nous sommes très nombreux sur ces travées, je crois, à considérer que cette situation n’est pas acceptable. C’est chose normale au Parlement, puisque les affaires de squat remettent en cause le droit inviolable de la propriété, consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est d’ailleurs ce qu’a très justement rappelé notre collègue Dominique Estrosi Sassone en présentant sa proposition de loi, dont je salue l’initiative au nom de mon groupe.
Ce texte, tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, répond à des attentes fortes, alors que nombre de nos concitoyens se désolent de l’impuissance publique face à de telles situations d’injustice. Il faut dire que le droit actuel se révèle inopérant en la matière, soit par manque de clarté sur les protections offertes aux propriétaires dont les biens sont squattés, soit par une mauvaise application des dispositions prévues. En tout état de cause, je partage le diagnostic établi par l’auteur et confirmé par la position de la commission : un renforcement du droit actuel s’impose. C’est notamment le cas avec l’article 1er, qui augmente la peine encourue en cas de violation de domicile. Comme cela a été rappelé, le Sénat a déjà adopté cette mesure dans le cadre du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. J’espère qu’une nouvelle adoption permettra enfin d’aboutir à des résultats concrets.
Toutefois, notre action de législateur ne saurait se concentrer sur le cas de violation de domicile, et pour cause : compte tenu de la jurisprudence, la définition du « domicile », quoiqu’elle soit très large et ne distingue pas les résidences principales des résidences secondaires, ne permet pas de couvrir efficacement l’ensemble des cas de figure justifiant cette initiative législative. C’est notamment le cas pour les appartements vides, les locaux professionnels ou même les terrains non construits. C’est pourquoi la création d’un délit autonome d’occupation frauduleuse d’un immeuble, telle que prévue par l’article 2, me paraît opportune. Cette mesure élargit le champ des cas qui seront couverts par la loi.
Les articles suivants de la proposition de loi s’inscrivent dans la même logique. Ils renforcent les pouvoirs de sanction contre les squatteurs et assouplissent les conditions d’application, ce qui devrait rendre le droit applicable plus opérationnel.
Il en est de même des sanctions frappant toute communication visant à inciter au squattage. Nous avons tous à l’esprit certains collectifs et certaines associations qui ont fait de ces actions leur marque de fabrique, voire leur raison d’être. Je ne leur fais pas de procès d’intention, car je sais qu’il s’agit souvent de militants animés par de bons sentiments. Mais force est de le constater : ils alimentent le phénomène des squats, que nous dénonçons, et ils réduisent au silence de nombreux propriétaires dont les biens sont spoliés.
Nous devons être fiers de défendre le droit de propriété, qui se trouve au fondement de notre démocratie. À cet égard, M. le rapporteur a utilement précisé le champ d’application du délit afin de ne pas créer de confusion malvenue.
Pour terminer, j’évoquerai plus généralement la position de la commission sur cette proposition de loi.
Les précisions et restrictions apportées au dispositif permettent de mieux cibler les cas particuliers des squats. Elles adaptent ainsi la lettre de la loi à son esprit. Cela devrait limiter les risques d’interprétation excessive, et c’est heureux. Toutefois, cette focalisation laisse sans réponse bon nombre des cas problématiques rencontrés par nos concitoyens : c’est tout le débat sur l’opportunité d’expliciter, dans le texte de la loi, la façon dont les occupants sans droit ni titre se sont introduits dans l’immeuble. Cette précision limite le dispositif en même temps qu’elle le rend plus opérant dans les cas visés. Cependant, elle exclut du champ de cette proposition de loi un large pan des cas d’occupation illicite. Les problèmes liés aux locataires défaillants ne sont donc pas résolus.
Mes chers collègues, en conclusion, les élus du groupe Les Indépendants approuvent largement ce texte, qui apporte des réponses concrètes aux problèmes de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, je vous sens très motivés par ce débat, et j’en suis heureux !
Nous sommes aujourd’hui appelés à nous prononcer sur un sujet que l’actualité et les chaînes d’information télévisées ont récemment mis en avant avec la fameuse affaire dite « de Théoule » : les difficultés d’expulsion des squatteurs, qui sont réelles.
Les auteurs ainsi que le rapporteur du présent texte ont lié cette initiative parlementaire à ce fait divers. J’aurai l’occasion de revenir sur le fond de l’affaire comme sur cette précipitation, que nous connaissons bien, à proposer une loi par fait divers.
Cette proposition de loi repose sur une prémisse simple : le squat est la conséquence de la carence du droit actuel, insuffisant à dissuader les squatteurs et leurs « complices » et à garantir les droits des propriétaires. Il s’agirait en quelque sorte d’assurer un équilibre, aujourd’hui inexistant, entre le droit au logement et le droit à la propriété. Mais, en fait – je suis certain que vous le pensez tous –, ces deux droits n’ont pas à être mis en concurrence.

Certes, il faut garantir un recours rapide à l’autorité publique pour expulser les occupants illégaux d’un domicile principal ou secondaire. Néanmoins – Mme la ministre l’a rappelé –, la loi ASAP, adoptée en octobre 2020, le permet déjà. Elle a même considérablement durci la répression à l’égard de ces squatteurs. Pourtant, les auteurs de cette proposition de loi proposent d’aller plus loin et, à notre avis, beaucoup trop loin.
Sans trop m’attarder sur le texte originel, que je trouvais caricatural, je me suis attaché à fonder ma réflexion sur les travaux très étayés du rapporteur. Bien plus modérés
Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

… ils n’atteignent cependant pas, selon moi, un juste équilibre.
Chers collègues, je vous remercie de ces applaudissements.

M. le président. Je crains qu’ils ne soient liés à la modération de M. Leroy…
Sourires.
Nouveaux sourires.

Ce que crée le présent texte, c’est bien un délit d’occupation d’un bien immobilier, fondé non plus sur le domicile, mais sur le fait que ce bien serve de logement.
La notion de domicile et sa protection relèvent principalement du droit à la vie privée. Le texte à l’étude étendrait les sanctions actuelles et en infligerait de nouvelles à toutes les personnes qui se maintiennent dans un bien immobilier, quels que soient son usage et sa vacance.
Je salue de nouveau – je constate que ces éloges sont appréciés
Sourires.

Dans l’affaire de Théoule-sur-Mer, le droit actuel est suffisant : seules la mauvaise connaissance et la mauvaise application de cette procédure dérogatoire par les services préfectoraux ont conduit à la situation regrettable que nous avons tous en tête et nourri le sentiment d’un État qui ne protège pas les propriétaires.
Nous le savons, nous le vivons dans toutes nos communes, la problématique du mal-logement est un sujet majeur – notre pays dénombre 3, 9 millions de mal-logés et 300 000 SDF –, que beaucoup des derniers Présidents de la République ont annoncé vouloir résoudre.
Le droit au logement est reconnu comme objectif de valeur constitutionnelle, mais les politiques du logement en France n’ont pas réussi à rendre ce principe effectif. Beaucoup d’associations de droit au logement se battent pour aider les personnes en difficulté. Aucune réquisition d’immeuble vide, privé ou public, n’a jamais été proposée, et nous attendons encore un grand plan d’accueil et d’aide au logement.
Dans ce contexte de progression du mal-logement, est-il réellement approprié de renforcer l’arsenal pénal en étendant en quelque sorte le champ des squatteurs et le périmètre des condamnés possibles ?
Votre proposition de loi ouvre trop de portes pour des sanctions liées, non pas à une situation de squat intolérable, mais à des occupations en lien avec, par exemple, des actions revendicatives
Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.

… militantes, voire de réquisition légitime ou même d’information pouvant être assimilées par ce texte à des incitations au squat sur internet.
L’occupation illicite par des associations ou des collectifs de bureaux vides depuis des années pourra-t-elle être sanctionnée ? Oui !

Qu’en sera-t-il des pénalités encourues pour l’occupation lobby d’une entreprise lors d’une action associative ou militante ?

La loi pourrait-elle s’appliquer à l’occupation d’un terrain sans destination ?
Reste une mesure encore plus problématique : l’interdiction de se prévaloir du droit au logement opposable pour les personnes condamnées pour l’occupation frauduleuse d’un bien. De quoi s’agit-il en fait ? De condamner des personnes privées de logement à ne pas pouvoir bénéficier du droit au logement.
Les propriétaires ne peuvent plus subir les défaillances de l’État, incapable parfois, alors qu’ils sont dans leur droit, de leur permettre de reprendre possession de leur logement.

M. Guy Benarroche. … pour qui le squat est souvent un dernier recours, ne peuvent pas subir les conséquences d’une gestion discutable des services de l’État.
Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.

Voilà quelques éléments suffisamment préoccupants qui conduisent les élus du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires à voter contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE. – M. Alain Richard applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant tout, je remercie sincèrement Dominique Estrosi Sassone de soumettre cette proposition de loi à nos débats.
Sur ces travées, nous avons tous en tête de récentes affaires qui, connaissant un retentissement médiatique, ont choqué l’opinion publique et nous ont aussi, en tant que législateur, interpellés. Je pense à la situation de ce couple de retraités qui n’a pas pu entrer dans sa résidence secondaire de Théoule-sur-Mer, habitée par des squatteurs qui en avaient changé les serrures, ou à celle du Petit Cambodge, ce restaurant meurtri par les attentats de novembre 2015, dont le local était occupé par des militants anti-gentrification. Je pense encore à ces propriétaires de Saint-Honoré-les-Bains, d’Avignon ou du Mans. Fort heureusement, ces situations sont exceptionnelles, mais elles laissent à ceux qui les vivent un sentiment de grande injustice, lequel est tout à fait légitime.
Cette proposition de loi entend, par quatre articles, apporter une réponse aux propriétaires victimes de squat, qui se sentent trop souvent démunis dans la situation qu’ils rencontrent.
L’article 1er aggrave les peines encourues en cas d’introduction ou de maintien dans le domicile d’autrui. Le groupe RDPI soutient cette mesure, déjà adoptée lors de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Cette disposition, votée avec le soutien du Gouvernement, a néanmoins été censurée comme cavalier législatif le 3 décembre dernier par le Conseil constitutionnel. Son inscription dans le présent texte, dans la continuité de l’accord dont elle avait fait l’objet en commission mixte paritaire, nous paraît justifiée.
En revanche, malgré le travail du rapporteur pour garantir, dans le texte issu de l’examen en commission, une conciliation plus équilibrée entre le respect de la propriété immobilière et le droit au logement, nous ne sommes pas convaincus par le reste des solutions proposées. Je pense notamment au nouveau délit introduit par l’article 2, qui pourrait être assorti d’une peine complémentaire par laquelle l’auteur de l’infraction ne pourrait se prévaloir, pendant trois ans, du droit au logement opposable.
Le droit à un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle. De même, pour lutter efficacement contre le squat, il peut paraître assez paradoxal de ne pas essayer d’empêcher les conditions de nature à reproduire les faits pour lesquels les intéressés ont été condamnés.
Je pense également à la division par deux du délai dont le préfet dispose, dans la procédure administrative d’évacuation forcée, pour examiner les demandes de mise en demeure. La loi ASAP n’a été promulguée qu’en décembre dernier. J’y insiste : le délai de quarante-huit heures, introduit par ce texte, a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire et nous semble de nature à garantir une bonne application de cette procédure dérogatoire par les préfectures.
Plus généralement, il est important de rappeler que le législateur, sensibilisé aux problèmes rencontrés par les propriétaires, a récemment adopté des garanties pour renforcer et accélérer la procédure administrative d’évacuation forcée ainsi que la procédure judiciaire d’expulsion, qui s’applique plus largement.
Il en est ainsi de la loi ÉLAN de 2018. Pour l’expulsion des squatteurs dans le cadre de la procédure judiciaire, ce texte a écarté le délai de deux mois pour libérer le lieu occupé, ainsi que la trêve hivernale.
Il y a également la loi ASAP du 7 décembre 2020, déjà citée. Non seulement elle a accru la célérité de la procédure administrative d’évacuation forcée, mais elle a étendu explicitement son application aux résidences secondaires et occasionnelles, ainsi qu’à toute personne dont le domicile est occupé et aux personnes agissant pour leur compte.
Les outils pour lutter contre le squat existent ; ils ont fait l’objet d’un travail conjoint du Sénat et de l’Assemblée nationale dans des rédactions de compromis adoptées en commission mixte paritaire. Toutefois – vous le reconnaissez vous-même dans votre rapport, monsieur le rapporteur –, ils sont méconnus et mal appliqués.
Au regard des difficultés rencontrées par ces propriétaires victimes, il est indispensable de préciser l’interprétation des textes et de mieux faire connaître la procédure administrative dérogatoire à ceux qui ont vocation à l’appliquer. Madame la ministre, vos services préparent une circulaire à cette fin : pourriez-vous nous éclairer sur son calendrier ?
Mes chers collègues, pour toutes les raisons que je viens de formuler devant vous, et parce que nous pensons qu’une nouvelle modification de la loi, faisant évoluer les équilibres actuels, ne serait pas de nature à clarifier et à renforcer les dispositifs en vigueur pour lutter efficacement contre le squat, le groupe RDPI ne votera pas ce texte !
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – MM. Hussein Bourgi et Jean-Pierre Sueur applaudissent également. – Marques de déception sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, derrière les procédures administratives et judiciaires se trouvent souvent des principes essentiels de notre société. Le philosophe John Locke, dont la pensée participa à la constitution de nos régimes démocratiques et libéraux, écrivait ainsi que, « la fin capitale et principale en vue de laquelle les hommes s’associent dans les républiques et se soumettent à des gouvernements, c’est la conservation de leur propriété ».
Il va de soi qu’une telle idée suggère quelques nuances et de nombreux commentaires. Elle n’en rappelle pas moins une dimension essentielle de notre pacte social : garantir la protection du droit de propriété à nos concitoyens. En effet, les patrimoines sont souvent le résultat du travail de chacun ; leur acquisition est souvent le fruit d’efforts, et nous ne saurions admettre qu’ils fassent l’objet d’une appropriation illégitime et illicite d’autres individus, à l’image des squatteurs, sujets de cette proposition de loi.
Certes, le squat résulte de causes complexes, parmi lesquelles la précarité et le mal-logement. C’est d’autant plus vrai actuellement, alors que nous traversons une crise inédite, qui perdure et participe à la paupérisation de notre société, et que nous sommes entrés depuis plusieurs semaines dans la période hivernale. Aussi, il est impératif d’apporter des solutions à ceux qui, dans la détresse, en viennent à occuper illégalement les immeubles. Seulement, les solutions auxquelles nous devons réfléchir ne sauraient se traduire par une forme de tolérance permissive pour le squat et les occupations frauduleuses.
Les modifications apportées au régime des procédures d’expulsion par les lois ÉLAN, puis ASAP ont permis d’offrir de premières réponses aux propriétaires lésés. Mais il est possible d’aller plus loin en affirmant encore davantage les droits des propriétaires démunis. Dans cette perspective, les dispositifs prévus par cette proposition de loi semblent opportuns.
À l’image de ce qui s’est passé à Théoule-sur-Mer l’été dernier, chacun d’entre nous trouvera dans son département des exemples de propriétaires qui ont dû faire face à des squatteurs indélogeables occupant leurs biens immobiliers. Une telle situation est intolérable ; elle résulte souvent de la nécessité de justifier de la qualité de domicile du bien pour bénéficier de procédures accélérées. Pourquoi devoir justifier de l’usage que l’on souhaite faire de ses propriétés pour pouvoir en jouir pleinement ?
Nous ne parlons pas ici de biens sciemment mis en rétention du marché pour spéculer ; mais, hors de ce cas, les propriétés doivent être protégées efficacement. En ce sens, la création d’une nouvelle infraction d’occupation illicite frauduleuse est satisfaisante, tout comme la révision des procédures d’expulsion normales ou simplifiées, qui s’adapteraient mieux à l’ensemble des propriétés.
Le texte permet tout de même une forme de compromis, qu’il convient de souligner, en réprimant davantage l’occupation frauduleuse lorsque celle-ci a lieu dans un domicile. Ainsi, les domiciles restent l’objet d’un dispositif renforcé, sans pour autant que les autres propriétés soient sous-protégées.
Toujours dans un esprit de compromis et de mesure, ce texte sanctionne les personnes qui feraient la promotion du squat en publiant ce qu’on peut qualifier de « mode d’emploi » pour les squatteurs. Pour autant, le dispositif finalement retenu ne devrait pas concerner les associations luttant contre le mal-logement : c’est une bonne chose.
Néanmoins, un aspect de cette proposition de loi pourrait poser une difficulté concrète ; il s’agit des sanctions infligées aux squatteurs. Certes, il faut renforcer l’efficacité des procédures d’expulsion, et il est légitime de vouloir sanctionner davantage les squatteurs ; mais il demeure que les individus sanctionnés sont souvent des personnes en marge, dont les ressources sont réduites, voire inexistantes.
La répression est évidemment nécessaire. Seulement, il ne faut pas qu’elle conduise à un cercle vicieux maintenant les squatteurs dans la précarité. Aussi, nous nous interrogeons sur la possibilité laissée au juge de décider que la personne condamnée pour occupation frauduleuse d’un immeuble ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, des dispositifs du droit au logement opposable.
La menace d’une telle sanction dissuaderait peut-être certains ; mais, en prononçant ces peines, on empêcherait aussi le condamné d’accéder au logement, au risque qu’il récidive en occupant à nouveau frauduleusement un immeuble.
Bien entendu, nous devons compter sur le discernement des juges ; mais si cette disposition était adoptée, il faudrait être vigilant quant à l’application et à l’efficacité d’un tel mécanisme. Il ne doit pas produire pas des effets contraires à ceux espérés.
Cette remarque étant faite, les élus du groupe du RDSE voteront en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et Les Républicains.

Mme Marie-Claude Varaillas. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sans surprise, les sénateurs et sénatrices communistes du groupe CRCE s’opposeront à cette proposition de loi
Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.

Chers collègues, merci de bien vouloir me laisser aller au bout de mon propos !
Soyons clairs : le droit de propriété doit être respecté.
Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Seule la puissance publique, lorsque l’intérêt général l’exige, peut décider de faire primer d’autres droits constitutionnels, aux dépens du droit de propriété, en fixant les conditions de ces aménagements et la juste indemnité pour les propriétaires. C’est notamment le cas lors de la mise en œuvre de la trêve hivernale et du droit de réquisition.
En la matière, la réalité qui se dresse au-delà des questions juridiques, c’est celle du mal-logement dans notre pays. Il faut le savoir : en France, 902 000 personnes n’ont toujours pas de logement, 643 000 personnes sont hébergées, 91 000 vivent dans des abris de fortune, 25 000 dorment à l’hôtel et, depuis la crise sanitaire, 300 000 personnes sont à la rue – hommes, femmes et parfois enfants. Le Président Macron avait pourtant promis, en 2017, que cette situation cesserait.
Dans ces conditions, il nous semble urgent et prioritaire d’agir enfin en ce sens, faute de quoi le renforcement de l’arsenal répressif sera sans effet ou presque.
Comment opposer le droit à ceux dont les droits premiers sont bafoués, notamment le droit d’avoir un toit ? La nécessité est malheureusement plus forte que la loi, et ce que l’on qualifie de délit perdurera, non pas par vice, mais par nécessité vitale.
Nous devons nous interroger collectivement sur ce que cette situation exprime. Au-delà des cas individuels douloureux, il s’agit d’une réalité politique et sociale.
Pour cette raison, nous considérons que cette proposition de loi n’est pas opportune : elle ne traite que l’aspect répressif indépendamment du problème social, je dirai même éthique.
Ainsi, elle punit plus lourdement le squat du domicile, lequel est déjà pénalement sanctionné.
Par ailleurs, elle crée un nouveau délit autonome, élargi à l’occupation de tout immeuble. Cette disposition permet la constitution d’un nouveau délit légalisant des expulsions actuellement illégales et reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette option avait été écartée de la loi ASAP à la suite d’une forte mobilisation des associations du mal-logement : elle fait son retour dans cette proposition de loi, avec un spectre très large, puisque tout immeuble est visé, donc les logements vacants ainsi que les bureaux vacants et les biens inhabitables, tels les garages.
Certes, la commission a réduit la voilure : si tous les immeubles sont touchés par la nouvelle infraction pénale, seuls les logements vacants seraient désormais inclus dans la procédure accélérée ; mais nous parlons quand même de 3 millions de logements.
Cette disposition nous semble inacceptable. Il convient au contraire de sanctionner la rétention de logement, qui, dans le cadre d’un marché ultratendu, fait le jeu de la spéculation.
Cette proposition de loi va plus loin. Elle permet d’attaquer des associations qui revendiquent l’occupation des immeubles vides comme la conséquence du non-respect du droit au logement. Il s’agit pourtant d’un acte politique et citoyen dénonçant le fait que l’État se dérobe à ses responsabilités.

Initialement, la proposition de loi allait jusqu’à fragiliser pénalement les personnes menacées d’expulsion par de nouvelles infractions pénales : un comble !
En outre, en excluant du bénéfice du DALO ces personnes durant trois années, le présent texte traduit une volonté ultrarépressive.
Ce choix semble totalement contre-productif, car parfois ces mêmes personnes ont engagé toutes les démarches en vue de leur relogement. L’État peut même avoir été condamné à les reloger au titre du DALO. C’est donc un contresens manifeste et une violation directe du droit au logement, pourtant constitutionnellement reconnu.
Enfin, comme le rappelaient les associations signataires de la tribune parue dans le journal Libération lors de l’examen du projet de loi ASAP, l’urgence sociale est bien de résoudre la crise du logement.
L’urgence est bien de construire des logements sociaux, a fortiori dans les communes qui ne respectent pas la loi SRU
Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.

… de rétablir les APL – nous avons justement défendu une proposition de loi en ce sens –, de taxer les profits immobiliers, de financer la résorption des bidonvilles et le droit à la domiciliation.
Mes chers collègues, …

… traitons le problème au lieu de l’aggraver, en s’appuyant habilement sur l’émotion que suscitent des situations particulières pour détricoter toutes les protections collectives.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte, que nous considérons comme démagogique et populiste.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER. – M. Alain Richard applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Tels sont les mots qui consacrent le droit de propriété en France, à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faisant par ailleurs l’objet d’une protection constitutionnelle. Cette notion de propriété est l’objet même de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi, tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat.
Cet article a d’autant plus d’écho à la suite des récentes affaires qui ont marqué l’intérêt de nos concitoyens : à Théoule-sur-Mer, un couple de retraités a eu la mauvaise surprise de voir sa résidence secondaire occupée par une famille avec deux enfants ; à Paris, un local du restaurant Le Petit Cambodge a été squatté par un collectif militant anti-gentrification.
Ces affaires révèlent que les dispositifs existants, notamment la procédure de l’article 38 de la loi DALO du 5 mai 2007, en matière de répression de faits de squats dans notre pays ne sont, faute d’instructions claires, ni suffisamment dissuasifs à l’égard des squatteurs ni suffisamment connus des préfectures et des forces de police ou de gendarmerie, voire des propriétaires eux-mêmes. Le résultat, nous le connaissons : c’est l’incompréhension et le désarroi de propriétaires privés de leur bien pendant des mois, qui ont l’impression que l’État respecte davantage les squatteurs que le droit de propriété…
Aussi, je tiens à saluer et à remercier de leur travail nos collègues Dominique Estrosi Sassone, auteur de cette proposition de loi, qui a souhaité « restaurer les droits des propriétaires », et Henri Leroy, rapporteur de la commission des lois. Il a su préserver l’équilibre nécessaire entre le droit de propriété, garanti par les articles II et XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le droit au logement, reconnu comme objectif constitutionnel.
Le but est donc de renforcer la lutte contre le squat.
D’une part, cette proposition de loi aggrave la peine encourue en cas d’introduction ou de maintien dans le domicile d’autrui. Pour rappel, cette mesure a déjà été adoptée par le Parlement lors de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel.
D’autre part, ce texte crée une infraction nouvelle d’occupation frauduleuse d’un immeuble renforçant la protection de tous les biens immobiliers et non du seul domicile.
Les modifications apportées par notre commission ont déjà été rappelées. Mais il me semble nécessaire de revenir sur les plus importantes, afin de bien comprendre l’ambition de cette proposition de loi : mieux protéger la propriété immobilière contre les squatteurs en visant l’ensemble des biens immobiliers.
Tout d’abord, sur la proposition de notre rapporteur, nous avons souhaité préciser que le délit d’occupation frauduleuse est constitué si et seulement si l’auteur des faits s’est introduit dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Sont donc visés spécifiquement les squatteurs et non les locataires qui rencontreraient des difficultés pour honorer leur loyer.
Ensuite, dans un souci de gradation des peines, et afin que ces dernières soient les plus dissuasives possible, nous avons souhaité punir plus sévèrement le squat d’un domicile que celui de locaux qui ne sont pas utilisés à des fins d’habitation. S’agissant de l’occupation frauduleuse d’un immeuble, la commission a considéré qu’une peine réduite à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende serait plus appropriée.
Par ailleurs, à l’heure où de nouvelles formes d’incitation au squat se développent, la commission des lois a voulu sanctionner les personnes qui en proposent de véritables « modes d’emploi ». Il s’agit là de réprimer l’ensemble des méthodes qui incitent à la commission du délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble ou, du moins, la facilitent.
Enfin, toujours pour concentrer les dispositions de cette proposition de loi sur les seuls squatteurs, notre commission a redéfini le champ d’application de l’article 3. Comme indiqué précédemment, ce sont les récentes affaires de Théoule-sur-Mer et du Petit Cambodge à Paris qui ont incité notre collègue auteur du texte à encadrer davantage les sanctions prévues contre les squatteurs.
Ainsi, la procédure de l’article 38 de la loi DALO n’est étendue qu’aux locaux à usage d’habitation, y compris ceux qui sont destinés à le devenir, et le délai accordé au préfet pour examiner la demande de mise en demeure est réduit à vingt-quatre heures. Pour rappel, lors de la discussion du projet de loi ÉLAN en 2018, le Sénat avait adopté un amendement en ce sens sur l’initiative de notre collègue Marc-Philippe Daubresse ; mais ces dispositions n’avaient pas été retenues en commission mixte paritaire.

Je tiens à saluer les différents apports de notre commission des lois. La création d’une nouvelle infraction pénale exclusivement concentrée sur les squatteurs est honorable. Mais ne perdons pas de vue qu’elle sera intrinsèquement liée aux moyens effectivement mis en œuvre pour expulser les squatteurs. Autrement dit, il y a le droit théorique et sa mise en œuvre, et, entre les deux, souvent une décision, voire une volonté, administrative ou politique. Je me permets d’ailleurs, madame la ministre, de faire un parallèle sur cet aspect avec le texte que nous examinerons juste après celui-ci : nous reparlerons du vote de la loi au Parlement, de sa mise en œuvre concrète sur le terrain et du délai qui sépare ces deux étapes.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, à l’heure où les faits de squat se multiplient sur le territoire national, il est nécessaire d’agir, d’encadrer spécifiquement ces actes et de protéger le droit de propriété, inviolable et constitutionnellement garanti. C’est pourquoi le groupe Union Centriste votera pour le texte issu des travaux de la commission des lois.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes très chers collègues, le droit de propriété est affaibli ; pourtant, des parlementaires tentent depuis de nombreuses années de le préserver. Je veux saluer à ce titre l’excellent travail que mène au Sénat notre collègue Dominique Estrosi Sassone, mais aussi les efforts de notre collègue député Julien Aubert ou encore de nos collègues Henri Leroy et Catherine Procaccia. L’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est très clair : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »
Même si le droit de propriété a une valeur constitutionnelle, nous assistons toujours à des violations de domicile et à des occupations de biens immobiliers par des squatteurs. En 2015, une dame de 83 ans avait ému tous les Français en luttant pendant dix-huit mois pour récupérer sa propriété ; à Garges-lès-Gonesse, un propriétaire, dont la maison a été occupée, s’est vu opposer par les squatteurs un ticket de livraison de pizzas pour établir leur présence depuis plus de quarante-huit heures. C’est lamentable ! Les squatteurs savent bien que, passé ce délai, la procédure d’expulsion par la police devient complexe, même si la loi du 24 juillet 2015 rend son déroulement plus acceptable.
L’incapacité de notre droit à défendre concrètement le droit de propriété aboutit à un recours inquiétant à la justice privée. C’est ce qui s’est passé à Garges-lès-Gonesse, où des jeunes de la ville se sont organisés sur les réseaux sociaux pour expulser eux-mêmes les occupants de la maison. Au mois d’août 2018, à Montpellier, un squatteur a été jusqu’à lancer une action contre la propriétaire du logement pour violation de domicile !
Durant l’été 2020, nous avons malheureusement été témoins de telles atteintes au droit de propriété : les médias se sont notamment fait l’écho de la situation de ce couple lyonnais qui a découvert sa résidence secondaire de Théoule-sur-Mer squattée, les serrures changées. Malgré l’absence d’une ordonnance d’expulsion, les propriétaires légitimes ont pu retrouver immédiatement, et en toute légalité, la jouissance de leur bien. Malheureusement, tous les cas – nombreux, même si le phénomène est difficilement quantifiable – ne sont pas médiatisés.
Ces atteintes manifestes au droit de propriété sont inacceptables. Les propriétaires victimes de ces occupations illicites, qui ne font pourtant valoir que leur bon droit, se trouvent dans une situation d’impuissance à laquelle nous devons répondre.
Au regard des situations que nous rencontrons dans nos circonscriptions en la matière, il est normal que nous, qui sommes les représentants du peuple français et les représentants des communes, fassions ce qui est en notre pouvoir pour mieux protéger nos concitoyens. Il ne s’agit pas seulement de faits divers, mais souvent de véritables drames. C’est une réalité, le droit n’est pas respecté, les propriétaires se sentent souvent démunis, voire abandonnés par les pouvoirs publics ; pis, ils estiment que le droit n’est pas de leur côté, mais qu’il protège, à l’inverse, ceux qui occupent leur maison en toute illégalité.
Ces situations anormales et inadmissibles défient ouvertement l’autorité de l’État et la capacité de celui-ci à garantir l’ordre public. Ce n’est pas acceptable dans un État de droit. Si l’État ne remplit pas ses obligations les plus élémentaires, comme celle de faire cesser les atteintes au droit de propriété, alors notre contrat social est en péril. C’est pourquoi il est de notre devoir de parlementaires d’agir en visant deux objectifs : premièrement, protéger le droit de propriété ; deuxièmement, permettre à la puissance publique d’agir et d’agir vite.
Quatre mesures simples garantiront plus de justice pour nos concitoyens en augmentant la peine encourue en cas de violation de domicile, en créant un nouveau délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble, en réduisant les délais légaux permettant le prononcé de l’expulsion, enfin, en mettant en cohérence le code des procédures civiles d’exécution. Le texte proposé par le groupe Les Républicains, que je vous invite à voter, mes chers collègues, permet de lutter contre le recours à une justice privée, conséquence regrettable d’une action publique souvent impuissante.
Permettez-moi de vous rappeler que, dans un pays où les dépenses publiques atteignent 65 % et les prélèvements obligatoires 45 %, on ne peut pas dire que la solidarité nationale est en reste. Or les propriétaires y participent tout au long de l’acquisition de leur bien et même après leur mort, puisque nos droits de succession sont parmi les plus élevés au monde. La moindre des choses est donc de les protéger, d’autant que près de la moitié des propriétaires privés sont de petits propriétaires ayant acquis un bien pour bénéficier d’un complément de revenu. Ne pas les aider revient à valider des politiques antisociales.
Ces propriétaires ont connu des décennies de souffrance et d’angoisse, des citoyens honnêtes ont été broyés par les travers du droit. Ils nous regardent aujourd’hui et attendent que nous nous fassions leur porte-parole. Je vous demande de vous engager sur ces mesures simples, en vous souvenant que nous sommes là pour œuvrer pour la République et pour l’intérêt général.
Pour paraphraser Jaurès, je dirai que le premier des droits de l’homme est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. Ne l’oublions pas !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle est comprise dans notre bloc de constitutionnalité, « la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ». Il s’agit donc d’un droit particulièrement précieux et théoriquement protégé, puisque l’article II de ce même texte en fait un droit « naturel et imprescriptible de l’homme », au même titre que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Or, comme chacun le sait, les faits de squat connaissent en France une recrudescence particulière et révèlent un manque d’application des dispositions législatives en vigueur. C’est ce qui ressort de nombreuses constatations effectuées par les membres de la commission des lois du Sénat.
Le Gouvernement a certes pris, en partie, la mesure de ce phénomène en ajoutant un article 73 à la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, lequel n’a toutefois pas précisé la notion de « domicile », trop subjective et manquant de sécurité juridique. Il était donc nécessaire de renforcer la protection de tous les biens immobiliers, et pas seulement le domicile.
Bien entendu, je m’associe pleinement au texte issu des travaux de la commission des lois et, tout particulièrement, de notre collègue rapporteur Henri Leroy, notamment en ce qu’il permet d’accélérer les procédures d’évacuation et d’expulsion en cas de maintien sans droit ni titre dans un bien immobilier. C’est bien cette sécurité juridique que chaque citoyen est en droit d’attendre.
Au-delà du contenu de cette proposition de loi de notre collègue Dominique Estrosi Sassone, que notre assemblée va s’efforcer de parfaire durant l’examen des articles, je souhaite mettre en exergue un point essentiel et indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie : l’application de la loi.
La France peut, bien sûr, se targuer d’offrir à ses concitoyens une palette de droits que beaucoup de démocraties nous envient. Toutefois, mes chers collègues, nous devons veiller à ce que ces droits s’accompagnent en retour de devoirs, comme celui de respecter la propriété d’autrui ou celui d’appliquer la loi promulguée.
Cet équilibre me semble maintenu par cette proposition de loi, laquelle protège les propriétaires privés tout en respectant le droit au logement, le texte visant les squatteurs et en aucun cas les locataires défaillants.
J’ajoute que, dans le même esprit et pour respecter l’équilibre, il est indispensable de veiller à condamner plus fermement les bailleurs peu scrupuleux qui louent leurs biens sans déclaration fiscale ou les marchands de sommeil qui profitent de situations très délicates.
Certains ont tendance à pointer du doigt les propriétaires. N’oublions pas qu’il s’agit pourtant de concitoyens qui ont épargné, emprunté et investi le fruit de leur travail, payant impôts et taxes ; il convient que le législateur leur apporte les garanties nécessaires au respect de leur droit à la propriété « inviolable et sacré », ainsi que je le précisais en préambule de mon intervention.
Madame la ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris : oui au soutien au droit à la propriété ! Non à la défense, à la justification ou à l’encouragement des squatteurs !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le droit de propriété est un droit naturel et imprescriptible de l’homme. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Voilà ce qui ressort des articles II et XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Pourtant, pas un mois ne passe sans que des propriétaires voient leurs biens confisqués par des squatteurs sans vergogne.
Ces occupations illicites de domicile, de résidence secondaire ou de terrain se multiplient en France. Nous avons tous en tête le triste exemple de Théoule-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, où un couple de retraités a récupéré sa maison saccagée après l’expulsion des squatteurs.
À Oignies, dans le Pas-de-Calais, à Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre, ou encore au Mans, dans la Sarthe, l’histoire est toujours la même : les squatteurs profitent de l’absence des propriétaires pour investir les lieux et mettent à profit toutes les failles de la législation pour s’y installer durablement.
« Sidération », « exaspération », « colère », « révolte », « traumatisme », tels sont les mots des victimes confrontées à ces squats, qui se retrouvent sur le seuil de leur propre porte, impuissantes. Elles doivent alors, bien souvent, s’engager dans un parcours kafkaïen pour récupérer leur propriété et, enfin, rentrer chez elles.
Ces faits génèrent une émotion légitime auprès de l’ensemble de nos compatriotes à laquelle nous devons répondre. Tel est l’objet de notre proposition de loi, chère Dominique Estrosi Sassone.
Lorsque la loi apparaît trop permissive ou pas assez dissuasive quant à l’occupation sans droit ni titre, elle donne lieu à des situations absurdes et intolérables dans lesquelles la charge de la preuve est inversée au détriment des propriétaires, qui doivent se justifier, et au bénéfice des squatteurs, qui se sentent à l’abri de toute répercussion. Ces situations mettent en exergue une faillite de l’État de droit, illustrent notre laxisme et favorisent le sentiment d’impunité de certains délinquants. Il y a donc urgence à colmater les brèches du droit en vigueur, dans lesquelles les squatteurs s’engouffrent au mépris du droit et du respect le plus élémentaire.
Certes, depuis 2007, la législation a évolué vers un durcissement des sanctions et une réduction du périmètre de la protection conférée aux squatteurs, avec, notamment, la création d’une procédure administrative accélérée. Force est de constater que, d’une part, elle n’est pas suffisamment décourageante et que, d’autre part, le problème demeure, voire s’aggrave.
De même, la réponse apportée par le gouvernement actuel, via un amendement au projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, est largement insuffisante et ne réglera certainement pas les anomalies de notre arsenal législatif. En cause : le périmètre encore trop restreint des avancées récentes.
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a, par exemple, permis la non-opposition de la trêve hivernale aux squatteurs, mais cette disposition législative de 2018 ne s’applique que dans les cas où les occupants illégaux se sont introduits par voies de fait dans le logement, c’est-à-dire par effraction.
En outre, le manque d’efficacité des procédures d’expulsion est régulièrement dénoncé. Pour rappel, il appartient au propriétaire de faire constater sous quarante-huit heures une occupation illégale de son bien pour faire valoir la flagrance et, donc, la procédure de l’article 38 de la loi dite « DALO ».
S’agissant des résidences secondaires, il est plus difficile de constater une flagrance en seulement deux jours. Dès lors, il revient au propriétaire d’engager une procédure judiciaire, par nature longue et coûteuse.
Nous ne pouvons cautionner plus longtemps cette complaisance à l’égard des squatteurs. Aussi le but de cette proposition de loi est-il de renforcer la lutte contre le squat par la création de nouvelles infractions pénales. Le dispositif propose donc, d’une part, d’aggraver la peine en cas de violation de domicile et, d’autre part, de renforcer la protection de tous les biens immobiliers.
En outre, afin de rendre pleinement opérationnelle la mise en demeure par le préfet, les délais aujourd’hui prévus par la loi sont réduits à deux titres. Le délai d’instruction de cette demande est fixé à vingt-quatre heures ; si les squatteurs n’ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier est tenu de faire évacuer le logement par la force publique immédiatement à l’issue de ce délai.
Le travail en commission, dont je salue la qualité, a permis de préciser le champ d’application du texte pour le recentrer sur les seuls squatteurs. À cet égard, six amendements du rapporteur ont été adoptés afin de sanctionner les auteurs, tout en préservant l’équilibre nécessaire entre le droit de propriété et le droit au logement, reconnu comme objectif de valeur constitutionnelle.
Madame la ministre, chers collègues, sans droit, il n’y a plus d’État, et sans État qui protège, le pacte social est rompu, ce qui donnera lieu à la justice privée, laquelle, d’ailleurs, s’est manifestée dans certains cas de squat. Les auteurs de cette proposition de loi entendent apporter la démonstration que nous ne sommes pas impuissants lorsqu’il s’agit de faire respecter nos valeurs les plus fondamentales. Il y va de notre responsabilité !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

Je m’associe à cette proposition de loi et, plus particulièrement, à l’objectif visant à restaurer les droits pleins et entiers des propriétaires face à des squatteurs très au fait de leurs droits et des lacunes pénales actuelles, avec, si cela ne suffisait pas, l’aide d’associations qui assurent leur impunité.
L’actualité a malheureusement été un révélateur et a rappelé douloureusement en de trop nombreuses occasions que les dispositions actuellement en vigueur sanctionnent insuffisamment les atteintes au respect du domicile et de la vie privée que constitue le squat. La triste affaire de Théoule-sur-Mer où, pendant une vingtaine de jours, des occupants sans scrupules ont pris possession de la résidence secondaire d’un couple de retraités afin de prolonger leurs vacances dans les Alpes-Maritimes est pleine d’enseignements sur les manquements de notre législation.
Aux termes de l’article 226-4 du code pénal, « l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et « le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, […], est puni des mêmes peines ». L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit de porter cette peine à 45 000 euros d’amende et à trois ans d’emprisonnement.
Il s’agit là d’un durcissement nécessaire et attendu, à même de mieux faire respecter le droit de propriété, lequel doit, à mon sens, prévaloir et primer sur le droit au logement, parfois invoqué pour créer et laisser perdurer des situations inacceptables pour les victimes, révélant l’impuissance de l’État à faire respecter ce droit essentiel qu’est le droit de propriété.

C’est avec plaisir et soulagement que j’ai vu cette proposition de loi inscrite à l’ordre du jour. J’ai en effet été bien seule pendant de nombreuses années à tenter de légiférer contre ce fléau qui bouleverse la vie de personnes souvent modestes et qui se retrouvent à la rue parce que leur logement a été squatté. Les exemples récents ne manquent pas.
Je remercie sincèrement mes collègues et le rapporteur, qui veulent améliorer l’article 38 de la loi DALO, lequel est resté tel qu’il a été voté en 2007, à la suite d’un compromis nocturne que j’avais négocié difficilement avec le DAL, Jeudi noir et le gouvernement de l’époque, alors très frileux. La rédaction avait limité cette mesure – j’avais dû l’accepter – à la résidence principale.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui alourdit les sanctions contre les squatteurs, élargit le champ d’application de l’article 38 et vise à rendre plus efficace l’action des préfets.
Je salue les apports de notre collègue Henri Leroy, en particulier le raccourcissement du délai d’intervention du préfet et la nouvelle infraction de propagande des méthodes de squat. En 2007, déjà, mes chers collègues, j’aurais pu publier la liste des sites existants qui détaillaient les méthodes à mettre en œuvre.
Toutefois, vous le savez, madame la ministre, car nous avons échangé il y a quelques mois sur ce sujet, non seulement l’information des préfets et des forces de l’ordre est défaillante, mais, en plus, certains d’entre eux décident de ne pas faire exécuter les décisions de justice prises. C’est inadmissible, d’autant que la trêve hivernale ne s’applique pas aux squatteurs.
Je crois en votre volonté de faire prévaloir le droit des occupants légaux contre celui des squatteurs, mais il faut que celle-ci soit réellement mise en œuvre et que vous exigiez que les squatteurs soient vraiment expulsés. Si un préfet estime que ces derniers doivent être relogés, il lui revient de trouver une solution qui ne pénalise pas le titulaire.
Vous vous êtes engagée à faire paraître une circulaire à ce sujet, mais, à mon sens, la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui améliorera les choses. Lorsque l’on saura que les squatteurs sont systématiquement expulsés et qu’ils n’ont pas tous les droits, il y en aura peut-être moins.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 2 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 10 est présenté par Mmes Varaillas, Lienemann, Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l’amendement n° 2.

La loi prévoit déjà des sanctions à l’encontre de toutes les personnes reconnues coupables de squat. Alourdir ces sanctions – les doubler, les tripler, voire les quintupler – n’a aucun intérêt. En effet, vous le savez tous, en vertu de l’individualisation des peines, lorsque les mis en cause arriveront devant les tribunaux, leurs revenus, souvent issus des minima sociaux, seront pris en compte, et les magistrats n’appliqueront jamais le montant maximal qui nous est proposé ici. C’est la raison pour laquelle je vous suggère de privilégier l’efficacité plutôt que l’affichage.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 10.

Un article similaire a déjà été adopté à l’Assemblée nationale lors de la discussion de la loi ASAP, puis a été censuré par le Conseil constitutionnel, non pas sur le fond, mais sur la forme. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cette proposition de loi ont introduit cette disposition, laquelle multiplie par trois la sanction pénale du squat du domicile d’un tiers, considérant qu’il suffit d’augmenter les sanctions pour dissuader les éventuels délinquants.
Nous ne partageons pas cette opinion, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les qualités du délinquant : il s’agit, le plus souvent, de personnes fragiles se trouvant dans une situation d’extrême pauvreté. Comment prétendre résoudre cette situation par un accroissement de la sanction pénale, alors qu’il s’agit de répondre à une nécessité absolue, celle d’avoir un toit sur sa tête ? Qui peut sérieusement croire que le squat est une partie de plaisir ? §Soyons sérieux !
Dire cela, ce n’est pas justifier l’infraction, mais considérer que la solution est à rechercher ailleurs. Nous sommes conscients que de plus en plus de personnes investissent dans la pierre, faute de pouvoir compter sur une retraite digne de ce nom. Ces personnes ne doivent pas être mises en difficulté, pas plus que les bailleurs sociaux, par ce type d’infractions.
Pour autant, nous considérons que, quand ces infractions sont la conséquence directe du mal-logement, il revient à l’État de prendre ses responsabilités pour agir vite et pour indemniser les victimes propriétaires, mais en aucun cas il ne nous semble utile de mettre les squatteurs en prison ou de les condamner à des amendes astronomiques, alors qu’ils n’ont déjà pas de quoi payer un loyer.
Il s’agit donc purement d’une mesure d’affichage sans efficacité concrète, qui ne réglera pas le problème, mais risque, au contraire, de l’aggraver, a fortiori dans la période très particulière que nous traversons.
Ces affaires restent marginales, même si elles sont très médiatisées. Nous estimons donc que le quantum de peine actuel est largement suffisant et que les mesures pour lutter contre le squat relèvent de la puissance publique, laquelle doit rendre le droit au logement et à l’hébergement, reconnu par la loi et les traités, enfin effectif. C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.

Je rappelle à nos collègues Bourgi et Varaillas que la mesure contenue dans l’article 1er de la proposition de loi figurait dans le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons relatives à la procédure.
J’entends vos arguments, mes chers collègues, selon lesquels la peine actuelle est suffisamment dissuasive. Ce n’est toutefois pas le cas, ainsi que nous l’avons constaté sur le terrain. Je vous avoue que les ministères concernés nous ont fait savoir qu’elle n’avait été appliquée à Paris qu’à cinq reprises. C’est dire si elle est méconnue !
Pour ma part, je considère que l’argumentation que nous avançons répond à un objectif d’équité et de cohérence : le code pénal punit de trois ans d’emprisonnement le propriétaire qui tenterait d’expulser par la force celui qui occupe illégalement son bien ; il me paraît cohérent que la même peine soit prévue pour le squatteur qui occupe illégalement le domicile d’autrui. Cela ne me paraît ni excessif, ni illogique, ni caricatural.
L’avis est donc défavorable sur ces amendements.
Le Gouvernement étant favorable à l’article 1er, il est donc défavorable aux deux amendements de suppression. Comme cela a été rappelé, une telle mesure avait été adoptée lors de l’examen du projet de loi ASAP, avec l’accord du Gouvernement, mais elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel, non pour des raisons de fond, mais pour des raisons de procédure.
Nous nous trouvons ici dans le cas d’une violation de domicile et non dans le cas très général, cité par ailleurs dans cette discussion, d’atteinte au droit de propriété immobilière. En cas de violation de domicile dans le cadre d’un cambriolage, les peines actuellement encourues sont de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; il paraîtrait bizarre de prévoir des peines plus faibles pour une violation de domicile qui débouche sur un squat. Il me semble donc normal d’aligner les peines.

Notre collègue Bourgi, dont j’ai entendu avec beaucoup d’intérêt le propos lors de la discussion générale, nous indique que ce texte aggraverait les difficultés que rencontrent les accidentés de la vie. Il s’agit souvent, avance-t-il, de personnes dont la recherche de logement auprès des bailleurs privés ou publics n’a pas été satisfaite, malgré son ancienneté.
Monsieur Bourgi, tous les gens qui connaissent ce parcours difficile de recherche de logement auprès des bailleurs ne finissent heureusement pas squatteurs. C’est précisément ce à quoi s’attaque cet article. Cet argument me semble donc particulièrement spécieux.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 1 er est adopté.
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble
« Art. 315 -1. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper, après s’y être introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
« Art. 315 -2. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« La juridiction peut également décider que la personne condamnée ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, du droit garanti par l’État mentionné à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Art. 315 -3. –
Supprimé
« Art. 315 -4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission du délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de 3 750 € d’amende. »

L’amendement n° 11, présenté par Mmes Varaillas, Lienemann, Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Cet article constitue le cœur de cette proposition de loi : il crée un nouveau délit, élargit le champ des procédures accélérées et sanctionne lourdement tant les squatteurs que ceux qui leur prêtent main-forte.
Nous l’avons déjà dit, le remède que vous proposez est pire que le mal. Alors que, chaque année, nous découvrons les chiffres du mal-logement présentés par la Fondation Abbé-Pierre, comment comprendre cette obsession dans les rangs de la droite sénatoriale ?
La loi ASAP a déjà permis d’aller plus loin dans la protection des biens en assimilant les résidences secondaires au domicile. Nous en comprenons les raisons. Pour autant, avec cette proposition de loi, un nouveau pas est franchi. Non, un logement vacant n’est pas un domicile !

Par conséquent, il ne saurait être traité comme tel lorsque sa propriété est bafouée, parce que les conséquences ne sont pas les mêmes.
Nous n’avons eu de cesse de dénoncer le nombre de ces logements vacants – de l’ordre de 3 millions – alors que tant de nos concitoyens souffrent du mal-logement. Il faut travailler à un arsenal juridique, comme nous l’avons proposé en loi de finances, pour taxer plus lourdement ces logements vacants afin de permettre leur remise sur le marché. Il convient également que l’État use enfin de son droit de réquisition pour mettre à disposition ces logements, en indemnisant, évidemment, les propriétaires.
La solution n’est donc pas de pénaliser plus lourdement ceux qui squattent ces lieux qui ne servent à personne, mais bien d’organiser une politique publique du logement et de l’hébergement pour éviter ces situations.
Par ailleurs, l’interdiction pour trois ans de l’accès au droit au logement opposable aux personnes condamnées à ce titre est une mesure injuste et contre-performante. Si le droit au logement opposable était respecté, ces personnes ne seraient pas contraintes à la délinquance. Par cette disposition, vous inversez donc les choses.
Enfin, même si la commission a permis une évolution sur cette mesure, la volonté affichée dans cet article de permettre la condamnation des acteurs de la lutte contre le mal-logement qui font du squat l’arme de la dénonciation de l’abandon par l’État de ses responsabilités est une imposture qui s’apparente au bâillonnement des actions citoyennes et politiques.
Nous ne servirons pas de caution à ces politiques répressives, injustes et antisociales. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

La commission souhaite la création d’un délit spécifique pour incriminer l’occupation frauduleuse d’un immeuble et compléter ainsi les dispositifs anti-squat qui ne pénalisent jusqu’à présent que la violation de domicile. Elle en a toutefois restreint le champ d’application en ajoutant une condition d’entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ce qui permet de viser des squatteurs sans toucher les locataires défaillants.
Pour garantir que la peine encourue soit proportionnée, la commission a prévu que ce délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il paraît en effet raisonnable, dans un souci de gradation des peines, de punir plus sévèrement le squat d’un domicile que celui de locaux qui ne sont pas utilisés à des fins d’habitation.
Enfin, la commission a précisé la définition de la nouvelle infraction consistant à faire de la propagande ou de la publicité en faveur de l’occupation frauduleuse d’immeubles, pour viser seulement la diffusion de méthodes destinées à faciliter la commission de ce délit ou incitant à le commettre. En effet, on ne peut pas ne pas réprimer l’incitation à commettre un délit, d’autant que l’on trouve sur internet de véritables modes d’emploi, expliquant aux squatteurs comment ils doivent se comporter pour tenter d’échapper à l’expulsion ou pour retarder les procédures judiciaires, par exemple en changeant les serrures du logement ou en souscrivant un abonnement d’électricité à leur nom pour donner l’impression qu’ils sont installés chez eux…
C’est la diffusion de ce type d’informations que l’amende vise à dissuader. La liberté d’expression des associations luttant contre le mal-logement ne sera nullement remise en cause.
L’article 2 nous paraît utile et robuste juridiquement. La commission est donc défavorable à l’amendement de suppression.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement de suppression de l’article 2, car il est opposé à la création d’une incrimination d’occupation frauduleuse d’un immeuble, trop large pour plusieurs raisons.
D’abord, l’incrimination serait susceptible de s’appliquer à l’ensemble des occupants qui se maintiennent dans les locaux. J’ai bien compris que la commission s’est efforcée d’en restreindre la portée pour ne pas viser les locataires défaillants. Néanmoins, la simple mention du mot « manœuvres » parmi les méthodes visées ouvre un champ d’interprétation considérable sur le point de savoir si un locataire qui assure pouvoir payer son loyer et finalement ne le paie pas est concerné ou non.
Ensuite, la définition dans la jurisprudence pénale du délit de violation de domicile est plus large que le champ de la procédure administrative permettant au préfet d’agir sur le domicile ; en fait, elle couvre tous les lieux pour lesquels il existe une atteinte à la vie privée, c’est-à-dire tous les locaux d’habitation – les résidences principales comme secondaires –, mais aussi les dépendances et les locaux affectés à l’exercice d’un travail ou d’une profession.
Enfin, le Gouvernement n’est pas favorable à la création d’une peine complémentaire d’interdiction de se prévaloir des recours prévus sur le fondement du droit au logement. Cette mesure me paraît effectivement disproportionnée par rapport à l’objectif à atteindre et insuffisamment protectrice des personnes les plus vulnérables.

Mme Varaillas est tout à fait fondée à faire valoir ses arguments, mais ceux-ci me paraissent sujets à caution. Expliquer que sanctionner par de nouveaux délits les situations dont nous parlons serait une machine à créer de nouveaux délinquants me paraît un raisonnement particulièrement inattendu…
Quant à l’urgence sociale, ma chère collègue, elle a bon dos ! Vous ne pouvez nier la détresse des propriétaires quand l’État est impuissant à garantir un droit aussi essentiel que le droit de propriété. Je rappelle que, en 1789, les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – une référence à laquelle vous serez peut-être sensible – ont fait du droit de propriété, proclamé à l’article XVII, l’un de leurs principes fondateurs, considérés comme inviolables et sacrés, au même titre que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour explication de vote.

Madame la ministre, la peine complémentaire permet au juge d’apprécier s’il y a lieu ou non de déchoir le squatteur de son droit au logement opposable – pour une durée bien délimitée. L’adoption de ce dispositif serait un signal très fort envoyé à une grande partie de nos compatriotes, qui respectent le droit quand bien même ils ont d’importantes difficultés à se loger, voire ne sont pas logés : même sans toit au-dessus de leur tête, ils n’enfreignent pas la loi et ne squattent pas le bien d’autrui !
Vis-à-vis de l’ensemble de nos concitoyens, il nous appartient de montrer que nous ne plaçons pas sur le même pied le squatteur, qui a enfreint la loi, et la personne qui continue, même après plusieurs années, à attendre qu’on puisse lui attribuer un logement social, y compris dans les régions où la tension est particulièrement forte. Cet équilibre n’est que justice. Au demeurant, je le répète, les juges sont à même de décider s’il convient ou non de déchoir du droit au logement opposable.
Mes chers collègues, nous ne pouvons pas continuer à inciter des gens à squatter pour, à la sortie du domicile, se prévaloir du droit au logement opposable comme coupe-file !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Imbert et Joseph, MM. Panunzi, Cadec, Pellevat et D. Laurent, Mmes L. Darcos et Chauvin, MM. Sautarel, Bazin et Lefèvre, Mme Dumont, MM. Burgoa, Laménie, Brisson, Bonne, Saury et Segouin, Mme M. Mercier, MM. Bouchet, Sol et de Nicolaÿ, Mme Lassarade, M. Cardoux, Mme Deroche, MM. Milon, Joyandet, Savin et Gremillet, Mmes Goy-Chavent, Deseyne et Lopez, MM. Cuypers et Vogel, Mme Puissat, MM. Klinger et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Bonhomme, Pointereau, Bascher, Chevrollier, Husson, Chatillon et Rapin, Mmes F. Gerbaud, Garriaud-Maylam et Berthet, M. Belin et Mmes Demas et de Cidrac, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilé à l’occupation frauduleuse le défaut de paiement du loyer pendant une période consécutive de six mois.
La parole est à Mme Corinne Imbert.

Cet amendement vise à accentuer les sanctions contre les locataires ayant cessé de payer leur loyer depuis au moins six mois consécutifs, en assimilant cette situation à une occupation frauduleuse. Ils seront donc passibles des sanctions prévues par cette proposition de loi.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de viser les plus précaires, qui souvent bénéficient d’un accompagnement vers ou dans le logement. Mais les impayés sont aussi un sujet, qui mérite un débat – le plus apaisé possible.

L’amendement de Mme Corinne Imbert vise à assimiler un locataire défaillant en retard de six mois de loyer à un occupant frauduleux au sens du nouvel article 315-1 du code pénal. Le locataire deviendrait ainsi pénalement punissable et pourrait faire l’objet d’une évacuation forcée par le préfet.
Une telle situation poserait, à mes yeux, des questions d’ordre constitutionnel et d’opportunité. La commission a précisément souhaité l’éviter en restreignant le champ d’application du délit aux seuls squatteurs, à l’exclusion des locataires et occupants gratuits.
Il est vrai qu’il faut améliorer les procédures d’expulsion locative, car certains locataires se comportent en voyous, exploitant au maximum les délais et procédures. Mais il s’agit d’un problème distinct du squat, qui devrait faire l’objet d’une réflexion spécifique en vue de définir à quel moment le locataire dépasse la limite acceptable, et ainsi d’épargner les locataires qui subissent des difficultés passagères, mais sont de bonne foi.
Dans ces conditions, je demande le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, avis défavorable.
Oui, la question des impayés de loyer mérite un débat apaisé !
Mais l’idée de prévoir un an d’emprisonnement ne me paraît pas y contribuer.

M. le président. Madame Imbert, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?
Oui ! sur certaines travées du groupe Les Républicains. – Non, il faut le retirer ! sur d ’ autres travées du groupe Les Républicains.

Il importe, j’en ai conscience, de préserver l’équilibre du texte. Reste qu’il y a un petit sujet – nos réactions en témoignent…
Madame la ministre, c’est vous qui enflammez le débat !
Marques d ’ approbation sur les travées du groupe Les Républicains.

… dans le seul souci de ne pas altérer l’équilibre du texte, et en remerciant mes nombreux collègues qui l’avaient cosigné.

L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Imbert et Joseph, MM. Panunzi, Cadec, Pellevat et D. Laurent, Mmes L. Darcos et Chauvin, MM. Sautarel, Bazin et Lefèvre, Mme Dumont, MM. Burgoa, Laménie, Brisson, Bonne, Saury et Segouin, Mme M. Mercier, MM. Bouchet, Sol et de Nicolaÿ, Mme Lassarade, M. Cardoux, Mme Deroche, MM. Milon, Joyandet, Savin et Gremillet, Mmes Goy-Chavent, Deseyne et Lopez, MM. Cuypers et Vogel, Mme Puissat, MM. Klinger et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Bonhomme, Pointereau, Bascher, Chevrollier, Husson, Chatillon et Rapin, Mmes F. Gerbaud, Garriaud-Maylam et Berthet, M. Belin et Mmes Demas et de Cidrac, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilé à l’occupation frauduleuse le fait de ne pas quitter un meublé de tourisme dans un délai d’une semaine suivant le terme prévu de la location.
La parole est à Mme Corinne Imbert – peut-être serez-vous plus chanceuse cette fois-ci, ma chère collègue…
Sourires.

J’en doute, monsieur le président, car je connais l’avis de la commission – évidemment très sage…
Cet amendement vise à accentuer les sanctions contre les locataires d’un meublé de tourisme qui n’auraient pas quitté le logement une semaine après le terme prévu de la location, en assimilant cette situation à une occupation frauduleuse. Le cas se produit de plus en plus fréquemment, qu’on le veuille ou non, sans forcément qu’une réponse juridique existe. Se maintenir dans un logement qu’on a loué à titre saisonnier, c’est aussi ne pas respecter la propriété immobilière !

La commission fera preuve de cohérence sur cet amendement très similaire au précédent. Il s’agit de rendre passible d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende un touriste qui dépasserait d’une semaine l’occupation de son meublé : dans ce cas aussi, il me semble que les mécanismes anti-squat ne sont pas les outils les plus adaptés. Nous sollicitons le retrait de l’amendement ; avis défavorable en cas de maintien.
– et néanmoins similaire à mon explication précédente… –, il me semble que punir de 15 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait de rester une semaine de trop dans un meublé de tourisme est disproportionné. Pour cette raison de fond, l’avis est défavorable.

Merci pour votre avis apaisé, madame la ministre, que toutefois je ne partage pas : j’ai moins de scrupules que vous par rapport à aux occupations prolongées de meublés de tourisme…
Cette fois encore, j’accède à la demande de la commission pour préserver l’équilibre du texte. Mais j’aimerais bien savoir ce qu’on propose dans les situations que j’ai décrites ! Actuellement, il n’y a pas de réponses, et je compte sur vous, mes chers collègues, pour en chercher ensemble.

L’amendement n° 8 rectifié est retiré.
L’amendement n° 6, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La peine prévue au présent article n’est pas appliquée lorsque l’immeuble faisant l’objet d’une occupation frauduleuse appartient à l’État ou à une collectivité territoriale et que la commune dans laquelle s’est produite l’infraction n’a pas respecté les obligations définies à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Nous proposons de réserver les sanctions prévues aux seules situations où, dans l’hypothèse de l’occupation d’un bâtiment public, celui-ci se trouve sur le territoire d’une commune remplissant ses obligations au regard de la loi SRU.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Si la commune ne remplit pas ses obligations en la matière, on peut considérer qu’il s’agit d’une circonstance atténuante pour la personne ayant occupé l’immeuble où les bureaux appartenant à cette collectivité territoriale.

Il est proposé que la peine ne s’applique pas lorsque l’immeuble squatté est une propriété publique située sur le territoire d’une commune ne respectant pas la loi SRU.
L’idée est originale : elle évoque à la fois la dispense de peine et l’état de nécessité. Toutefois, je ne vois pas en quoi le non-respect par une commune des règles issues de la loi SRU pourrait dispenser de peine une personne reconnue coupable du délit d’occupation frauduleuse d’immeubles.

Le droit pénal s’attache aux comportements individuels. Dans une même situation, certains de nos concitoyens respectent les règles, …

… d’autres s’en affranchissent – c’est cela que nous souhaitons sanctionner.

Ainsi, pour prononcer une dispense, le juge doit, aux termes de l’article 132-59 du code pénal, prendre en compte le comportement individuel de la personne reconnue coupable, par exemple son reclassement ou la manière dont elle a réparé le dommage causé.
Si des communes ne respectent pas les dispositifs de la loi SRU, c’est parfois parce qu’elles ne le peuvent pas – et non parce qu’elles ne le veulent pas. Des sanctions financières sont prévues. En tout état de cause, c’est un autre sujet.
L’avis est défavorable sur l’amendement.
M. François Bonhomme applaudit.
Cet amendement, qui vise à créer des cas particuliers, montre bien que l’incrimination pour occupation frauduleuse d’un immeuble, à laquelle le Gouvernement est défavorable dans son principe, serait difficile à manier et à appliquer, dans la mesure où elle met en regard, d’un côté, des situations particulières et, de l’autre, un besoin de logements.
Défavorable à l’incrimination en général, le Gouvernement l’est aussi à l’amendement.

Si le bâtiment concerné est une école en cours de construction ou de rénovation, trouvez-vous normal que l’occupation se poursuive ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 3 est présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 9 est présenté par M. Benarroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l’amendement n° 3.

Il s’agit de supprimer la peine complémentaire consistant à exclure du recours au DALO toute personne dont la responsabilité aurait été retenue dans le cadre d’une procédure pour squat. Ce n’est pas en ajoutant les peines les unes aux autres – en l’occurrence, en privant une personne d’un droit – que l’on résoudra le problème.

Le droit au logement est une avancée considérable, mais, assez souvent, il ne se traduit pas dans la réalité avec autant d’efficacité qu’il serait souhaitable. C’est pourquoi certaines personnes en dénoncent l’ineffectivité par des actions d’occupation, destinées aussi à attirer l’attention et à montrer à quel point certains connaissent des situations de souffrance.
Parmi ces personnes, un certain nombre ont en effet besoin d’être logées. Leur acte est un cri désespéré comme il en existe d’autres. Je ne dis pas qu’il est plus légitime, mais c’en est un aussi, et il faut en tenir compte.
À Théoule-sur-Mer, la situation a été résolue aussi, dans un contexte de carence de l’État, grâce à l’intervention d’un certain nombre d’acteurs de la société civile, y compris un maire, qui ont agi pour reloger la personne qui squattait.
Mes chers collègues, comment pouvez-vous, d’un point de vue logique, considérer qu’on pourrait résoudre le problème en privant du DALO pendant trois ans les personnes condamnées pour squat illégal ? On est en pleine incohérence !

Dans le cadre de ce droit opposable, les personnes n’ayant pas les moyens d’accéder à un logement indépendant et décent peuvent saisir une commission de médiation. Si celle-ci juge leur demande prioritaire, le préfet dispose de trois mois pour formuler une proposition de logement adaptée.
La peine complémentaire tend à éviter un phénomène parfois observé : une forme de priorité au relogement accordée à des squatteurs. La majorité des parlementaires, qui ont été des élus de grande proximité, connaissent parfaitement cette situation. De fait, les préfectures sont parfois tentées de rechercher en urgence une solution de relogement qui mette fin plus facilement à la situation de squat. Pendant ce temps, les personnes en attente de logement qui respectent la loi continuent d’attendre.
Cette peine complémentaire vise à envoyer un signal fort et clair : la violation de la loi ne doit pas avoir pour conséquence de gagner des places dans la file d’attente des personnes en demande de logement. L’avis sur les amendements identiques est donc défavorable.
Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques de suppression, parce qu’il est opposé à la création d’une peine complémentaire d’interdiction de se prévaloir du droit au logement opposable.
En effet, la possibilité d’interdire l’exercice de recours sur le fondement du DALO, destiné à éviter la misère sociale, soulève une interrogation constitutionnelle très forte : il est hautement probable que le Conseil constitutionnel l’estime manifestement inappropriée à la répression d’un délit d’occupation illicite de biens immobiliers d’autrui.
Plus largement, dans les situations dont il a été fait mention, la prise en charge est toujours une prise en charge humanitaire d’hébergement. Pour suivre ces questions depuis quelque temps, je ne connais pas de cas dans lesquels il y aurait eu une accélération du droit au relogement. À Théoule-sur-Mer, en particulier, la situation relevait de l’hébergement : il est normal et légitime de mettre un toit au-dessus de la tête des enfants, qui ne sont pas responsables pénalement du comportement de leurs parents.
La question de la priorité des ménages relevant du DALO se gère avec les réservataires et les préfets, à l’intérieur de la file d’attente. Une nouvelle incrimination judiciaire n’est aucunement nécessaire de ce point de vue.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 5, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 315 -2 -1. – Lorsqu’une personne reconnue coupable de l’infraction définie à l’article 315-1 est un mineur au sens de l’article 388 du code civil, celle-ci est redirigée vers les services départementaux de l’aide sociale l’enfance mentionnés à l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles.
La parole est à M. Hussein Bourgi.

Parmi les squatteurs peuvent se trouver des mineurs, enfants en rupture familiale ou ayant fugué. Plutôt que de les envoyer devant un tribunal, il faut les orienter vers l’aide sociale à l’enfance dont ils relèvent, afin de les sortir de la marginalité qu’ils ont connue dans le cadre des squats.

Il est proposé de dispenser les mineurs de la peine prévue à l’encontre des squatteurs et, en contrepartie, de les orienter vers les services de l’aide sociale à l’enfance.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement n’a pas, à mon avis, pour effet d’exclure les mineurs de la peine prévue en cas de squat.
Sur le fond, je ne vois pas pourquoi le phénomène du squat devrait faire l’objet d’un traitement dérogatoire par rapport aux règles habituelles du droit pénal des mineurs : les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables, et la peine qu’ils encourent est réduite de moitié par rapport à celle prévue pour les adultes.
Quant à l’intervention de l’aide sociale à l’enfance, elle est possible selon les règles de droit commun prévues par le code de l’action sociale et des familles, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans cette proposition de loi. L’aide sociale à l’enfance pourra intervenir notamment si les jeunes squatteurs sont des mineurs isolés.
L’avis sur l’amendement est donc défavorable.
Cet amendement sur le cas particulier des enfants en danger et mineurs isolés est, à mes yeux, une preuve de plus que l’incrimination n’est pas la solution aux problèmes d’occupation frauduleuse d’immeubles. Étant hostile à l’incrimination, je ne puis pas soutenir un amendement tendant à l’amender. Avis défavorable, pour cette seule raison juridique.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 4, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Hussein Bourgi.

Nous entendons supprimer l’incrimination de l’action associative, certes non conventionnelle. Qui aurait imaginé, voilà quelques décennies, engager des poursuites contre l’abbé Pierre lorsqu’il prônait la réquisition des bâtiments vacants ? Faisons preuve aujourd’hui de la même modération et de la même tempérance en ne réprimant pas tout. Il peut arriver que l’action des associations nous interpelle, voire nous dérange, mais elle contribue aussi à faire avancer les choses.

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle infraction, punie d’une peine d’amende, tendant à réprimer la propagande ou la publicité en faveur de méthodes visant à faciliter le squat ou à l’inciter.
Comme je l’ai expliqué dans la discussion générale, la commission a retouché la définition de cette infraction afin de bien cibler ceux qui diffusent de véritables modes d’emploi en ligne, avec tous les conseils et astuces pour retarder le processus d’expulsion et échapper à la justice, sans porter atteinte à la liberté d’expression des associations qui luttent contre le mal-logement.
La commission est attachée à la création de cette nouvelle infraction, qui nous paraît combler une réelle lacune de notre droit pénal. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Il est identique à l’avis émis sur tous les amendements à cet article. Étant défavorable à l’infraction elle-même, je suis défavorable aux amendements qui s’y rapportent.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour explication de vote.

Je remercie le rapporteur pour la précision qu’il a apportée. Nous n’avons surtout pas voulu porter atteinte à la liberté d’expression d’un certain nombre d’associations, qui accompagnent des publics en situation très précaire du point de vue du mal-logement – on pense à la Fondation Abbé-Pierre, mais aussi à l’association, encore plus politique et militante, Droit au logement.
Pour autant, on ne peut tolérer que des sites internet fournissent de véritables modes d’emploi du squat d’un domicile. En faisant une recherche, je suis tombée sur un site intitulé « Comment squatter en cinq étapes »… Voici d’ailleurs les cinq étapes décrites : repère ta maison ; rentre dans les bâtiments et barricade-toi ; attends le passage des flics et des huissiers, mets un faux nom sur la boîte aux lettres, barricade-toi et, une fois que les flics seront passés, tu pourras te considérer comme chez toi ; remets l’eau et l’électricité ; prépare ta défense.
Si un tel mode d’emploi n’est pas sanctionné, j’estime que nous ne faisons pas notre travail. Nous devons faire preuve de sévérité à l’égard de ces sites, que, aujourd’hui, rien ne permet de sanctionner.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 est adopté.
L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;
b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : «, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;
c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, M. Segouin, Mme Lavarde, M. Bazin, Mme Thomas, MM. Cadec et Panunzi, Mmes Belrhiti et V. Boyer, MM. Meurant, Burgoa, Cambon, Sol et Cuypers, Mmes L. Darcos et Raimond-Pavero, MM. Bonne, Grand, Savary, E. Blanc, Lefèvre et Vogel, Mmes Demas et Primas, M. Anglars, Mme Drexler, M. B. Fournier, Mme Di Folco, MM. de Nicolaÿ et Cardoux, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mme Micouleau, M. Dallier, Mme Deromedi, M. Brisson, Mmes Berthet et Puissat, MM. Saury, Genet, Bouchet et Le Rudulier, Mme Schalck, M. Reichardt, Mme Garriaud-Maylam, M. Savin, Mmes Dumont, Lassarade et de Cidrac, MM. Babary, Somon, Boré et Klinger, Mmes Chain-Larché et Dumas et MM. Laménie, Pellevat, Rapin, Allizard, Sido, Gremillet et Gueret, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;
La parole est à Mme Catherine Procaccia.

La charge de la preuve du domicile incombe à l’occupant légal, propriétaire ou locataire.
Pour suivre ces dossiers depuis quinze ans, je puis témoigner que, très souvent, on demande à une personne âgée qui revient de l’hôpital ou de vacances en famille d’apporter une preuve qu’elle ne peut pas fournir, tous ses papiers étant à l’intérieur du domicile, s’ils n’ont pas été détruits par les squatteurs.
Parmi les modes d’emploi, pour reprendre l’expression de Mme Estrosi Sassone, un des plus simples consiste pour le squatteur à se faire établir un contrat, par exemple d’électricité, à son nom : il téléphone, donne l’adresse où il se trouve, explique ne pas connaître le numéro de contrat ni le nom de son prédécesseur, et il reçoit dans les deux ou trois jours une facture ou une attestation… C’est pourquoi, voilà déjà plusieurs années, j’ai demandé qu’on sécurise ces procédures au moyen d’un code-barres.
La seule preuve de domicile est la taxe d’habitation. Mais qui connaît par cœur son numéro de connexion pour la rechercher en ligne ? Imaginez pour une personne âgée…
Dès lors, cet amendement prévoit, de manière simple, que le préfet demande aux impôts, si possible très rapidement, la preuve que le logement appartient bien à M. X ou à Mme Y.

L’idée est lumineuse : qui, en effet, est plus compétent pour identifier les gens que les services fiscaux ?
De fait, le propriétaire ne pouvant plus rentrer chez lui, il ne peut plus prouver qu’il est l’occupant légal. D’ailleurs, même s’il peut rentrer, tout a été détruit, parce que le squatteur a pris la précaution de le faire.
Dans ces conditions, il convient en effet d’autoriser le préfet à s’adresser aux services fiscaux – il n’aura pas la réponse dans les vingt-quatre heures, mais dans la minute qui suit… Ouf !
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Je partage la volonté d’être plus opérationnel pour qu’une personne confrontée à un squatteur puisse prouver la légitimité de son occupation. Il est vrai que, quand les papiers sont à l’intérieur du domicile squatté, la légalité de l’occupation est difficile à établir.
Sur le fond, nous devons continuer à travailler pour simplifier les demandes adressées aux services fiscaux, ou d’ailleurs aux notaires, qui détiennent généralement un double du titre de propriété. Il s’agit d’une préoccupation réelle et sérieuse.
La procédure administrative prévoit que le préfet dispose de quarante-huit heures pour statuer. Je ne suis pas certaine qu’il soit l’autorité la plus à même d’intervenir au titre de la famille. Les ayants droit et les associations qui accompagnent les propriétaires peuvent le faire. Quoi qu’il en soit, je suis prête à étudier les conditions d’une intervention opérationnelle.
Le Gouvernement, défavorable à l’article, émet par cohérence un avis défavorable à l’amendement. Au-delà de la procédure législative, je reste néanmoins disponible pour travailler sur l’opérationnalité de la mesure.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 3 est adopté.
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Après le mot : « locaux », la fin du second alinéa de l’article L. 412-1 est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : «, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » sont supprimés ;
3° Après le mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412-6 est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. » –
Adopté.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour explication de vote.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Je voudrais remercier, très sincèrement, l’ensemble des collègues présents dans l’hémicycle de leur participation à ce débat. Les discussions, on l’a vu, ont été très animées, sur un sujet important qui a suscité de nombreuses interventions, dont certaines sont apparues comme tout à fait légitimes, alors que d’autres m’ont semblé pour le moins idéologiques.
M. Pascal Savoldelli s ’ exclame.

Je remercie encore une fois M. le rapporteur Henri Leroy et M. le président de la commission des lois, ainsi que tous les commissaires aux lois dont le travail a permis d’enrichir le texte que nous soumettons désormais à votre vote. Ils ont veillé à ne pas créer d’amalgame ni d’opposition caricaturale, en évitant d’opposer, d’un côté, des propriétaires présentés comme riches et nantis, alors que pour la plupart ils ne le sont pas, ayant acquis leur bien – qu’il soit principal ou secondaire, pour compléter leur retraite – au prix de leur travail et de leur épargne ; et, de l’autre, des locataires qui seraient tous pauvres. L’équilibre recherché par le rapporteur me satisfait pleinement et je l’en remercie.
En revanche, je regrette la position défendue par les groupes socialiste et communiste, car elle est pour le moins idéologique, politique, voire démagogique. §En effet, alors que ce n’était pas l’objet de cette proposition de loi, vous avez volontairement opposé le droit de propriété au droit au logement. Or le droit au logement n’est pas le droit au squat ! Le droit de propriété est le seul droit constitutionnel qui soit. Le droit au logement, reconnu dans les valeurs républicaines, n’est pas un droit constitutionnel. Nul besoin donc de les opposer, car sur ces travées nous œuvrons tous avec conviction pour accompagner ceux de nos compatriotes qui rencontrent des difficultés pour se loger et pour avoir « un toit sur la tête ». Nous partageons en cela les mêmes objectifs que des associations comme la Fondation Abbé Pierre.
La situation actuelle est le résultat de la défaillance de l’État dans la mise en œuvre du droit au logement, et de l’inefficacité des politiques publiques de l’habitat. Rien ne justifie que les propriétaires aient à assumer cette défaillance de l’État.
Enfin, madame la ministre, l’examen de cette proposition de loi était l’occasion de vous emparer d’un texte législatif mesuré et équilibré pour atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. Nous regrettons que vous ne mettiez pas en conformité vos actes avec vos paroles.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à seize heures cinquante-cinq.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Les Républicains, de la proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage, présentée par M. Patrick Chaize, Mme Sylviane Noël, M. Alain Chatillon et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 585 [2019-2020], texte de la commission n° 266, rapport n° 265).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Patrick Chaize, auteur de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous en venons à présent à un texte que j’avais déposé l’an dernier avec mes collègues Sylviane Noël et Alain Chatillon, et dont l’objectif est de contribuer à consolider l’un des volets les plus délicats de la législation sur l’accueil des gens du voyage : l’équilibre entre, d’une part, la garantie des bonnes conditions d’accueil des personnes choisissant de pratiquer ce mode de vie, et, d’autre part, la lutte contre les installations illicites.
Cet équilibre prend ses racines dans la loi Besson du 5 juillet 2000, qui, en fixant des droits et des devoirs, a jeté les bases de la politique contemporaine de l’accueil des gens du voyage.
Or, comme l’avait déjà diagnostiqué en 2017 notre ancien et regretté collègue Jean-Claude Carle, cet équilibre est de plus en plus fragile.
En effet, vingt ans après la loi Besson, la situation n’est plus exactement la même. Certains groupes de gens du voyage se sont sédentarisés, ou semi sédentarisés. D’autres personnes traditionnellement étrangères à la communauté ont pu adopter des modes de vie itinérants. D’importants flux saisonniers de gens du voyage se poursuivent, et il n’est pas rare qu’ils aboutissent à la saturation des capacités d’accueil des territoires.
De manière plus exceptionnelle, heureusement, la crise du coronavirus a mis à rude épreuve les communautés de gens du voyage, et elle a révélé les dangers que peuvent représenter des aires surchargées.
Enfin, les occupations illicites de terrains demeurent une triste réalité dans les territoires, d’autant plus que la conformité de ceux-ci au schéma départemental ne leur garantit aucunement d’échapper au phénomène.
Là où ils apparaissent, les « campements illicites » entraînent dans leur sillage complications juridiques, tensions locales et dégradations physiques. Ces agissements d’une minorité finissent par porter préjudice non seulement aux propriétaires des terrains, mais aussi à l’ensemble des voyageurs.
Cet état de fait ne doit pas être toléré ni indéfiniment excusé par des circonstances locales : il y va de la crédibilité de la République, garante de l’ordre public.
Les collectivités locales sont au premier rang face à l’ensemble de ces facteurs. Elles sont à la fois les interlocutrices essentielles des voyageurs installés paisiblement, et les victimes plus ou moins directes des occupations illégales, alors même qu’elles poursuivent leurs efforts de création d’espaces d’accueil.
Je ne doute pas que de nombreux collègues, sur ces travées, ont été comme moi sollicités par des maires ou des présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) confrontés à des situations impossibles, auxquelles s’ajoute un appui parfois inadapté des autorités préfectorales et de la justice.
Ce constat avait déjà été dressé en 2017 par Jean-Claude Carle, qui avait déposé une proposition de loi comprenant certaines mesures fortes.
Malheureusement, le texte ambitieux voté à l’époque par notre institution n’avait été que très partiellement repris par l’Assemblée nationale.
Par conséquent, notre décision fut, non sans une certaine circonspection, de privilégier une réponse rapide, pour assister dès que possible les gens du voyage et les collectivités.
Plutôt que de poursuivre une navette au moment où convaincre nos collègues députés semblait difficile, notre choix fut de voter conforme une loi Carle, malheureusement amputée de plusieurs de ses dispositions, en nous promettant néanmoins d’y revenir.
Plus de deux ans après son adoption, c’est avec déception que nous constatons que ce texte d’ampleur limitée n’a pas reçu la mise en œuvre qu’il méritait.
Certes, nous pourrions attendre encore quelques années, pour mieux en évaluer l’impact, comme certains de nos collègues l’ont suggéré.
Cependant, compte tenu de l’urgence de la situation que je vous ai exposée, j’estime que nous sommes dans notre rôle de législateur quand nous proposons et quand nous agissons.
Par conséquent, j’ai travaillé avec mes collègues Sylviane Noël et Alain Chatillon à cette nouvelle proposition de loi.
Elle permettra de restaurer enfin l’équilibre dans les politiques de l’accueil des gens du voyage, et de doter les collectivités des outils nécessaires, en privilégiant l’implication des élus locaux et l’opérationnalité des dispositifs.
Le premier de ces outils vise à renforcer la coopération entre l’État et les collectivités dans l’anticipation et la préparation des flux de gens du voyage.
En développant une stratégie annuelle de gestion des déplacements des résidences mobiles des gens du voyage, le préfet de région contribuera en amont à éviter les surcharges ponctuelles des aires.
Cette nouvelle stratégie permettra de mieux faire circuler l’information, d’anticiper les déplacements et de coordonner l’élaboration des schémas départementaux. Elle impliquera surtout la consultation des élus, car l’écoute est le premier pas pour chasser leur impression d’abandon.
Un deuxième outil que nous prévoyons est l’inscription dans la loi d’un système de réservation préalable des aires. Son application restera facultative afin que les collectivités conservent toute latitude dans leur gestion des aires. Ce système permettra d’harmoniser les démarches des gens du voyage qui souhaitent s’installer, tout en améliorant la maîtrise des collectivités sur les entrées et les sorties des aires.
L’objectif est d’éviter les situations où des arrivées simultanées dépasseraient les capacités d’accueil, et de faciliter l’expulsion des groupes occupant indûment une aire pendant une longue durée.
Enfin, ce système s’articule avec l’approche stratégique d’une coopération entre l’État et les collectivités, telle que nous l’avons précédemment évoquée : le maire ou le président d’EPCI pourra demander au préfet de proposer des aires alternatives.
Grâce à ces deux outils, la liberté d’aller et de venir des voyageurs demeure intacte. L’objectif de ce texte est en effet d’user de dispositifs facultatifs et incitatifs afin de réunir les conditions d’un accueil effectif.
En troisième lieu, nous avons voulu rendre plus robustes les outils de lutte contre les installations illégales.
Il s’agit, très concrètement, de doubler la période durant laquelle la mise en demeure d’expulsion du préfet à l’encontre des occupants illégaux demeure en vigueur. Si les occupants n’ont pas quitté le terrain à l’issue de cette période, l’évacuation par le préfet sera désormais une compétence liée : il n’aura d’autre choix que de l’effectuer.

Grâce à cela, les élus n’auront plus l’impression que les occupants illégaux demeurent dans l’impunité lorsque le préfet choisit, dans le cadre de sa compétence discrétionnaire, de ne pas passer à l’étape suivante.
Enfin, notre texte comprend certaines mesures inspirées de celles déjà votées par le Sénat il y a deux ans, dont l’intérêt et le contenu vous sont familiers.
Il s’agit non seulement de la suppression de la procédure de consignation de fonds, qui nous semble contraire au principe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités, mais aussi de la prise en compte de certaines places d’aires au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), sujet qui retiendra sans doute l’attention de Mme la ministre déléguée, chargée du logement.
Tel est le contenu de cette proposition de loi, que, je l’espère, vous approuverez aujourd’hui.
Avant de passer la parole à Mme la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio, je tiens à saluer la qualité de son travail et de son écoute, pendant nos échanges, au moment des travaux préliminaires.
Grâce à elle et à nos collègues de la commission des lois, ce texte a pu être encore enrichi et amélioré.
Le moment est donc venu de donner aux acteurs locaux de l’accueil des gens du voyage les outils dont ils ont besoin pour remplir leur rôle : c’est le meilleur signal que nous pouvons leur envoyer.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons est, convenons-en, particulière.
Elle l’est tout d’abord parce que l’accueil des gens du voyage est un sujet sensible dans notre pays, et nous savons tous combien il peut être difficile à traiter pour les élus locaux que nous rencontrons toute l’année.
Elle l’est ensuite parce que son examen intervient un peu plus de deux ans après que nous nous sommes collectivement saisis du sujet, lors de l’examen conjoint des propositions de loi de notre ancien collègue Jean-Claude Carle et de notre collègue Loïc Hervé.
Les débats que nous avons eus en commission ont été l’occasion pour certains de mes collègues de dire leur perplexité face à un texte examiné avant qu’un travail d’évaluation ne permette d’identifier précisément des pistes d’amélioration du cadre juridique, tel qu’il résulte de la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Je comprends pleinement cette inquiétude, et je souhaiterais y répondre en deux points.
D’une part, certaines des propositions formulées par le Sénat à l’occasion de l’examen de divers textes – tels que le projet de loi relatif à l’égalité et la citoyenneté ou les propositions de loi évoquées ci-avant – ne figurent pas dans la loi, faute d’avoir été retenues au cours de la navette parlementaire. Or les difficultés auxquelles ces dispositions entendaient répondre n’ont pas pour autant disparu ! Nous sommes donc contraints de réitérer une réponse législative dont la nécessité n’est pas démentie sur le terrain.
D’autre part, force est de constater que des pistes d’amélioration demeurent, tant la politique territoriale d’accueil semble perfectible sur le terrain. Ainsi, les élus locaux ne sont pas toujours en mesure d’anticiper les déplacements de gens du voyage, ce qui rend leur accueil d’autant plus difficile qu’il est imprévu.
Par ailleurs, les stationnements illicites continuent d’être une source de préoccupation pour les élus locaux, qui constatent un recours trop sporadique à la procédure d’évacuation d’office, pourtant prévue dans la loi.
Mes chers collègues, face à ces difficultés persistantes et quotidiennes dans les territoires, le législateur ne saurait rester passif !
La proposition de loi que nous examinons a trois objectifs distincts : elle vise à mieux anticiper les déplacements de résidences mobiles, à améliorer la gestion des aires d’accueil de gens du voyage, et à renforcer la procédure administrative d’évacuation d’office en cas de stationnement illicite.
Pour cela, elle complète les dispositions déjà votées par notre assemblée, en y mêlant des pistes de solutions originales et innovantes, qui constituent des réponses pragmatiques aux difficultés rencontrées sur le terrain.
Parmi les dispositions déjà votées par le Sénat, deux articles visent à faciliter la gestion des aires d’accueil pour les collectivités territoriales concernées.
L’article 4 tend à comptabiliser les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage dans les quotas de logements sociaux auxquels sont soumises certaines communes.
L’article 5 prévoit de supprimer la procédure de consignation de fonds pour les communes et les EPCI qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’accueil.
Ces articles relèvent du bon sens et ont été adoptés par la commission sans modification.
L’article 9, issu d’un amendement présenté par Loïc Hervé et adopté par la commission, reprend également des dispositions déjà adoptées par le Sénat. Il tend à renforcer les sanctions pénales applicables en cas d’occupation en réunion sans titre d’un terrain. Si une interrogation sur l’effectivité de la mesure persiste à ce stade, elle constituera un outil supplémentaire à la main du juge, à qui il reviendra de s’en saisir, dans le respect des droits et libertés fondamentaux.
Par ailleurs, d’autres dispositions du texte développent des pistes de solutions innovantes face aux problèmes régulièrement rencontrés par les élus.
L’article 2, qui prévoit principalement la possibilité pour les communes et les EPCI concernés de subordonner à une réservation préalable l’accès aux aires d’accueil, constitue à cet égard une réelle avancée dans la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Dans la mesure où l’examen en commission a permis de garantir la solidité juridique du dispositif, je me réjouis qu’il puisse désormais être adopté par notre assemblée, car il facilitera la vie des collectivités territoriales concernées.
L’article 1er vise à éviter les risques de saturation des aires d’accueil par l’anticipation des déplacements de résidences mobiles. Il prévoit, dans la rédaction issue de l’examen en commission, une stratégie régionale de gestion de ces déplacements. Ce dispositif permettra d’impliquer le préfet de région et de s’assurer de la coordination, à l’échelle pertinente, de l’action de l’État et des collectivités en matière d’accueil des gens du voyage.
Enfin, l’article 8 tend à répondre au troisième et dernier objectif de la présente proposition de loi, à savoir le renforcement de la procédure administrative d’évacuation d’office en cas de stationnement illicite.
Consolidée, d’une part, via le doublement de la période pendant laquelle la mise en demeure du préfet court et, d’autre part, par l’obligation du préfet de procéder à l’évacuation d’office dès lors qu’à son échéance la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, cette procédure constituera la réponse efficace aux stationnements illicites que les maires et les présidents d’EPCI attendent depuis si longtemps.
En la matière, seule une action forte de l’État, se tenant aux côtés des collectivités concernées, est à même de rassurer ces dernières, qui se trouvent trop souvent démunies, car délaissées, face à un problème qui les dépasse.
Je souhaiterais saisir l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer pour m’adresser à vous, madame la ministre : les collectivités ont besoin que l’État prenne ses responsabilités en ce qui concerne l’accueil des gens du voyage.
Nous savons parfaitement que les schémas départementaux d’accueil sont insuffisamment mis en œuvre, et nous le déplorons. Cependant, nous avons tous aussi, dans cette assemblée, des exemples de communes ou d’EPCI qui se retrouvent dans une situation inacceptable lorsque, respectueux de leurs obligations et confrontés à une occupation illicite, ils voient le préfet opposer une fin de non-recevoir à leurs demandes légitimes d’évacuation.
Par ailleurs, depuis 2009, l’État ne prévoit plus de soutien spécifique à la réalisation ou à l’aménagement d’aires d’accueil et de terrains familiaux locatifs, sauf dans le cas de communes nouvellement inscrites au schéma départemental.
Madame la ministre, face à la sous-exécution des schémas départementaux, pourquoi ne pas restaurer un tel soutien financier, au lieu de procéder à des consignations de fonds contraires aux principes d’autonomie financière et de libre administration des collectivités territoriales ?
Une telle disposition ne saurait être introduite dans un amendement d’initiative parlementaire, en raison des règles de recevabilité financière, mais nous sommes prêts à travailler avec vous pour penser les voies et les moyens d’un soutien réel de l’État aux collectivités en la matière.
En un mot, madame la ministre, les collectivités territoriales sont bien au fait des obligations qui s’imposent à elles, et elles font leur possible pour s’y plier. Elles ont néanmoins besoin des marques de soutien qui leur font défaut dans la situation actuelle. Elles doivent pouvoir compter sur l’État bien davantage qu’elles ne le font. L’ensemble des acteurs du système y gagnerait, à commencer par les gens du voyage, dont l’accueil se trouverait significativement amélioré.
En conclusion, la présente proposition de loi ne réglera pas toutes les difficultés qui se posent aux élus locaux quant à l’accueil des gens du voyage. Le cadre juridique existant souffre, nous le savons, d’un défaut d’application, aux niveaux central et déconcentré, auquel il convient de remédier urgemment.
Elle permettra néanmoins de consolider ce cadre juridique et de donner davantage d’outils aux collectivités pour gérer avec efficacité des situations souvent difficiles. Elle me semble de ce seul fait, mes chers collègues, utile et nécessaire.
Monsieur le président, madame la rapporteure, chère Jacqueline Eustache-Brinio, madame, messieurs les auteurs de la proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, l’accueil des gens du voyage dans des conditions dignes est une responsabilité collective, consacrée notamment dans la loi du 5 juillet 2000, dite « loi Besson ».
Cette loi établit un équilibre entre, d’une part, la liberté d’aller et venir des gens du voyage, leurs aspirations à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et, d’autre part, le souci des pouvoirs publics d’éviter des installations illicites, susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d’occasionner des troubles à l’ordre public.
Le Gouvernement a cet objectif, à la fois favoriser l’accueil des gens du voyage et répondre aux préoccupations des élus locaux confrontés aux installations illicites.
Alors que seulement un schéma départemental sur quatre est pleinement abouti, vingt ans après l’adoption de la loi Besson, votre proposition de loi fait porter les conséquences de ce manque aux seuls gens du voyage.
C’est la raison pour laquelle je ne partage pas la vision du sujet qui préside à ce texte.
La majorité des gens du voyage, ainsi que les associations qui les représentent, sont en effet désireux de s’inscrire dans le respect des lois de la République. Lorsque les aires d’accueil et les aires de grand passage existent et proposent des conditions d’accueil dignes, les installations se passent dans la grande majorité des cas de façon sereine.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Je ne nie pas les problèmes dus à l’installation illicite des gens du voyage ; ils sont réels. Plusieurs dispositions législatives ont d’ailleurs déjà été adoptées pour les sanctionner, à l’instar de celles qui figurent dans la proposition de loi déposée par les sénateurs Jean-Claude Carle, en mémoire duquel j’aimerais avoir une pensée à cet instant, et Loïc Hervé, texte voté en 2018. À mon sens, nous n’avancerons pas sur le sujet seulement avec plus de sanctions.
La présente proposition de loi a pour objectif d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage. Mais elle prévoit essentiellement d’accroître les sanctions envers ces derniers sans proposer d’améliorer ni de revoir les obligations que doivent honorer les communes. À mes yeux, il y a là une contradiction intellectuelle et législative qui pose question.
Les solutions ne pourront être trouvées que dans un dialogue constructif et sincère entre les élus et les gens du voyage, en permettant la mise à disposition d’un terrain décent, ainsi que la scolarisation des enfants, sans discrimination.
La présente proposition de loi ne me semble pas de nature à favoriser un tel dialogue. Son adoption ne ferait qu’exacerber les difficultés en radicalisant les positions des uns et des autres.
À la lecture du texte, il apparaît en effet que les dispositions proposées vont trop loin et pourraient être ressenties comme une nouvelle stigmatisation par les gens du voyage. §Ce sera le cas ! Je regrette de devoir vous le dire. Ces mesures constituent une entrave grave à la liberté d’aller et venir et ne peuvent pas être perçues par les personnes concernées autrement que comme une remise en cause de leur mode de vie. C’est ce qui m’amène à émettre un avis défavorable sur le texte.
L’article 1er propose l’élaboration d’une stratégie de gestion des flux des gens du voyage qui porte en fait atteinte à leur liberté d’aller et venir en leur imposant de s’installer uniquement dans certains endroits. En ce sens, cette disposition posera une difficulté constitutionnelle. De plus, cela fait porter la responsabilité de l’accueil aux seuls territoires qui respectent la loi Besson ; rien n’est prévu pour la faire respecter par les autres. Cet article ne permet pas de répondre au problème fondamental du déficit d’espaces d’accueil pour les gens du voyage, qui alimente la saturation des équipements de manière structurelle et entretient les stationnements illicites.
L’article 2 propose de gérer les flux en installant un système de réservation préalable. Or un tel dispositif serait en réalité inopérant dans les territoires sans équipement et difficilement gérable dans les territoires équipés.
L’article 4 propose de comptabiliser dans la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », les aires d’accueil des gens du voyage au titre du logement social. Je ne souhaite pas mettre en concurrence le logement social et les aires d’accueil alors que nous avons 2 millions de demandeurs de logements sociaux qui ne trouvent pas de réponse. La loi SRU est un outil qui doit être respecté pour la construction de logements.
L’article 5 supprime la procédure de substitution et de consignation des fonds, qui avait été créée par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Cette procédure est un outil de négociation à la main des préfets pour que les communes respectent leurs obligations ; je ne vois pas pourquoi on la supprimerait.
L’article 7 propose de réintroduire un alinéa de l’article 9 de la loi Besson, en prenant en compte la décision du Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité en 2019. Cet article conforte une demande d’associations. Il avait reçu un avis favorable du Gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi de MM. Carle et Hervé. Aussi, sur cet article précis, l’avis du Gouvernement sera favorable.
L’article 8 aggrave la répression des stationnements illicites. Comme je l’ai déjà indiqué, ce n’est, me semble-t-il, pas en augmentant des sanctions qui existent déjà que nous résoudrons le problème.
Enfin, l’article 9 présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’inviolabilité du domicile, en proposant une saisie des véhicules, y compris à usage d’habitation, illégalement stationnés.
(Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Il fait l’objet d’une opposition très forte de la part des personnes concernées. En défendant des positions radicales, il risque de rompre le dialogue pourtant constructif engagé avec l’ensemble des parties prenantes. Le « tout-sanction » est une impasse. Je souhaite que nous en revenions au respect de la loi Besson.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.
En conclusion, je ne suis pas favorable à cette proposition de loi, qui ne résoudra pas le problème des stationnements illicites. Ce texte fait peser sur les seuls gens du voyage le déficit d’aires d’accueil, en menant à une forme de stigmatisation, et il laisse penser que seul un arsenal répressif et coercitif permettrait de régler la question. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi s’attaque au véritable fléau que sont les occupations illégales de terrain par de gens du voyage, occupations illégales qui constituent à l’évidence un nouvel exemple, et à grande échelle, de squat.
Dans les Bouches-du-Rhône, nous ne connaissons que trop bien un tel phénomène, avec une population importante et le pèlerinage annuel aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Et nos communes sont bien dotées, avec près de 400 places sur les aires prévues pour l’accueil de ces populations. Ces aires demeurent mal perçues par les maires, leur construction étant imposée par la métropole. Les grosses communes ont ainsi pu se délester d’une telle charge sur les petites villes et villages de Provence.
Mais, comme vous le soulignez dans votre proposition de loi, cela ne suffit pas : il continue d’y avoir des installations illégales. Tous les étés, des terrains sont squattés, et l’électricité et l’eau sont détournées. À la fin, ce sont les contribuables qui paient ; ce sont encore et toujours les contribuables honnêtes qui doivent payer pour ceux qui ne respectent rien, et surtout pas la loi !
Cet été encore, c’est à Berre-l’Étang qu’un terrain a été illégalement occupé. Et comme le maire ne s’est pas chargé de faire expulser les gens du voyage dans les quarante-huit heures, le camp existe encore aujourd’hui ! La gendarmerie y a pourtant mené une perquisition et a saisi plusieurs armes à feu, non déclarées évidemment… C’est un vrai cauchemar pour les riverains.
Pourtant, dans les communes voisines, ce ne sont pas les aires d’accueil qui manquent ! Mais à ceux qui méprisent la loi, cela ne suffit pas, et ne suffira jamais ! Et ça recommence chaque année, toujours aux frais du contribuable !
Je salue évidemment votre volonté de faire entrer les aires de stationnement dans les quotas de la loi SRU. Tout ce qui peut permettre de préserver notre environnement et nos espaces naturels de la bétonisation est louable, même s’il faudrait évidemment reprendre la loi SRU de fond en comble et tendre vers sa suppression. D’ailleurs, quand déciderez-vous d’inscrire à l’ordre du jour de notre Haute Assemblée la proposition de loi que j’ai déposée sur le sujet voilà plus de cinq mois ?
Il faut revenir au pragmatisme, qui passe par la connaissance précise du terrain. La compétence des aires attribuées aux gens du voyage doit être retirée aux EPCI pour être restituée aux communes.
Ainsi, si les aires d’accueil entrent dans le quota SRU, les maires seront incités, mais libres d’en construire. Tout le monde y trouverait son compte.
Enfin, il est nécessaire de rendre automatique la saisie des véhicules qui occupent encore un terrain après expiration du délai de la mise en demeure. Dans le cas contraire, on sait très bien que les squatteurs en voyage iront s’installer dans la commune voisine. Cela ne ferait que déplacer le problème.
Malgré quelques imperfections, ce texte va néanmoins dans le bon sens. Je voterai évidemment en sa faveur.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la qualité première des maires de notre pays est certainement l’écoute ! Et je pense ne pas me tromper en disant que, cet après-midi, ils sont particulièrement attentifs à nos travaux.
Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés dans cet hémicycle au problème de l’accueil des gens du voyage. Nous n’avons cessé de perfectionner et d’affiner la législation française. Nous sommes guidés en particulier par deux volontés majeures : améliorer les conditions d’accueil et instituer un cadre utile pour nos collectivités.
La proposition de loi que nous examinons, comme son nom l’indique, a pour objet de consolider les outils à la disposition de nos collectivités.
Les dernières discussions sur l’accueil des gens du voyage ont montré des divergences entre les deux assemblées. Je tiens à le préciser, il est important de consolider ce cadre pour qu’il soit efficace et, surtout, appliqué.
Dans mon département, le Nord, je ne compte plus les échanges avec des maires qui voient dans la loi Besson une tendance à inverser la culpabilité, en l’imputant aux élus. Nous avons essayé de combler quelques lacunes lors de l’examen des dispositions proposées par MM. Carle et Hervé, que le Sénat a adoptées. Force est de le constater, nous y revenons.
Je soutiens d’ailleurs plusieurs amendements s’inscrivant dans cet état d’esprit, en particulier sur la peine aggravée relative à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Je plaide pour une indemnisation rapide lors de dégâts subis durant une occupation illicite de terrain. Il est impensable de voir des terrains de football ou des bâtiments dévastés. Il faut que ces dégâts soient réparés rapidement ; ils ne doivent pas être laissés à la charge de la collectivité ou du secteur privé.
La proposition de loi règle plusieurs autres problèmes qui me semblent majeurs.
Le préfet doit être une pièce maîtresse et faire appliquer la loi. L’organisation des flux et la gestion des déplacements, mesures développées dans l’article 1er du texte, sont nécessaires. Nous devons être attentifs aux cas de sédentarisation observés, qui peuvent parfois bloquer les aires prévues pour les gens du voyage.
Sur la commune d’Hazebrouck, dans le Nord, un groupe de gens du voyage a été envoyé vers l’aéroport de Merville, où il y a une aire de grand accueil. Ces personnes ont refusé de s’y installer au motif qu’il y avait déjà un autre groupe. Voilà le type de problèmes que nous pouvons rencontrer. Les situations de ce genre doivent trouver des solutions. La communication entre les élus et l’État est la condition pour réussir un accueil dans les meilleures conditions. Le couple maire-préfet a montré son efficacité ; il doit aussi fonctionner dans ces cas précis.
Il en est de même dans le cas problématique des occupations illicites. Car, si les gens du voyage ont des droits, ils ont aussi des devoirs : le respect de la loi en est un. Là encore, le préfet doit agir, et son autorité doit être respectée lorsqu’il s’agit des mises en demeure. À ce titre, je salue l’allongement de la durée d’applicabilité de la mise en demeure à quatorze jours, contre sept jours actuellement.
Beaucoup d’élus m’ont rapporté des incidents. Je ne vous en donnerai que deux exemples particulièrement parlants.
D’abord, sur la commune de Prémesques, un groupe de gens du voyage s’était installé sur un lieu public. À la suite d’une procédure, il a été expulsé. Le maire n’a pu que constater son retour dans la nuit suivante et au même endroit !
Ensuite, sur la commune de Lesquin, que je connais bien, l’aire de grand passage a été occupée avant même d’être terminée. Ce matin encore, les gens du voyage ont été expulsés ; en partant, ils ont complètement saccagé l’aire. Qui paiera les réparations ? La collectivité, comme d’habitude ! Et je ne parle pas des occupations illégales d’espaces commerciaux, qui occasionnent des pertes importantes pour les commerces.
Ces situations d’occupation illégale sont inacceptables. Les évacuations ne sont parfois pas exécutées dans les temps. La gestion par les forces de l’ordre peut être complexe, surtout quand celles-ci manquent d’effectifs, comme c’est souvent le cas. C’est parfois aussi très dangereux pour les élus, comme en atteste l’agression subie par le maire de Maing en 2020.
Mes chers collègues, le texte que nous examinons est important pour nos territoires, ainsi que pour l’accueil des gens du voyage. S’il ne règle pas tout, il apporte une nouvelle fois des pistes de solutions.
Mais, malheureusement, rien ne peut se concrétiser si la loi n’est pas appliquée. Il y va de la crédibilité des acteurs engagés. C’est pourquoi nous sommes très favorables à la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et Les Républicains. – M. Yves Détraigne applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’ordre du jour est ainsi fait que nous continuons nos travaux aujourd’hui par l’examen d’une proposition de loi visant l’amélioration des relations entre les collectivités et les gens du voyage. Il est proposé d’appréhender et de réguler les flux des gens du voyage, tout en renforçant la lutte contre les occupations illégitimes.
Cet objectif se traduit essentiellement – hélas ! – par un durcissement des conditions d’accueil et par l’extension des possibilités d’expulsion au nom de la lutte contre les occupations illégales. Je le rappelle, la raison d’être prioritaire des textes adoptés en 2017 et en 2018, qui sont encore incomplètement mis en œuvre et que les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent modifier, est la pacification des relations entre les gens du voyage et les communes les accueillant. L’adoption d’un texte maintenant, en particulier de celui qui nous est proposé, n’y contribuera pas.
Sur la forme, ce texte participe d’une inflation législative, d’une course sans fin pour encadrer les conditions de vie et de domiciliation des gens du voyage, et contribue, certes involontairement, à leur stigmatisation.
Depuis trente ans, il y a eu beaucoup de lois sur les gens du voyage, beaucoup de commissions représentatives, beaucoup de schémas directeurs. Mais le constat a été fait par vous tous, mes chers collègues : seule la moitié des places en aires permanentes d’accueil prévues par les schémas départementaux avaient été créées en 2009, et ce chiffre s’élevait à peine 75 % en 2020. Seuls vingt-quatre schémas départementaux sont pleinement respectés aujourd’hui !
Je salue le travail de modération de notre rapporteure et de notre commission sur certains points édifiants, comme la suppression, demandée par la commission, de l’article 8, qui prévoyait la possibilité d’une astreinte solidaire pour les occupants en infraction, et celle de l’article 6, consacré aux craintes liées à des inscriptions massives et ciblées sur les listes électorales de gens du voyage au sein de communes peu peuplées.
Je regrette toutefois l’ajout d’un article sur les méthodes d’expulsion et de renforcement des sanctions pénales en cas d’infraction. Comment justifier de la saisie d’un véhicule qui est aussi l’habitation des gens du voyage ?
Pareillement, le changement de lieu qui pourrait être imposé d’une aire à une autre ne prendrait pas en compte l’ancrage local, même embryonnaire, qui peut exister, en particulier par des tentatives de scolarisation des enfants. Cela va à l’encontre de la possibilité d’une intégration et d’une non-stigmatisation des gens du voyage.
Dans mon département, dont parlait tout à l’heure un autre sénateur, je connais beaucoup d’associations qui s’occupent avant tout de la scolarisation des enfants des gens du voyage, aussi bien à Marseille qu’en Camargue. C’est l’un des moyens d’arriver à une intégration et à une amélioration des relations.
M. Jérôme Bascher s ’ exclame.

Ce texte, s’il entend répondre à un réel besoin de nos collectivités pour au mieux anticiper et gérer les arrivées, séjours et départs des gens du voyage, reste déséquilibré.
Que dire de la décision de supprimer les procédures de consignation à l’encontre des communes et des EPCI défaillants ? Je sais que c’est une demande répétée du Sénat, mais ce n’est pas la nôtre. Ne pas sanctionner les collectivités qui ne respectent pas la loi, c’est sanctionner celles qui, au prix d’efforts, s’y conforment !
Dans la même veine, comptabiliser les aires d’accueil dans les comptages SRU des logements sociaux, c’est aussi décourager les collectivités ayant fait des efforts énormes pour respecter leurs obligations. Et c’est confondre la construction de logements neufs sociaux avec l’accueil provisoire des gens du voyage !
Si l’idée d’une réservation préalable avec réorientation sur des aires libres s’entend pour une meilleure gestion des flux et pour éviter une concentration matériellement impossible, sa mise en place facultative par les collectivités et son caractère qui devient exclusif dans le cas où il y est fait recours laissent songeur quant à la visibilité pour les gens du voyage des démarches à entreprendre.
Dans ce cadre, notre groupe restera vigilant sur les rédactions des décrets qui encadreraient les motifs valables pour justifier les refus d’accueil par les mairies.

Les problèmes existent lorsque deux modes de vie cohabitent. Les difficultés à appliquer les lois de manière sereine sont récurrentes pour un certain nombre de communes. Les dernières lois votées par le Parlement ont vocation à les résorber. Encore faut-il leur laisser le temps d’une mise en œuvre qui puisse faire ses preuves.
Il est important de privilégier l’application des dernières lois votées ici même et de renforcer les méthodes de concertation.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre la présente proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons tous eu au téléphone des maires désemparés par une installation sauvage de gens du voyage arrivés à l’improviste le matin même dans la commune.
Chaque année, la France compte 350 000 à 400 000 personnes appartenant à cette communauté, dont un tiers sédentaire, un tiers semi-sédentaire et un tiers itinérant.
Mercredi dernier, la commission des lois du Sénat a adopté la proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage. Cette proposition, présentée par mes collègues Patrick Chaize, Sylviane Noël et Alain Chatillon, a trois objectifs principaux : mieux anticiper les déplacements de résidences mobiles, améliorer la gestion des aires d’accueil de gens du voyage et renforcer la procédure administrative d’évacuation d’office en cas de stationnement illicite.
C’est l’occasion aujourd’hui d’avoir une pensée émue pour notre regretté collègue Jean-Claude Carle. Ce texte vient d’abord rétablir les dispositions votées par le groupe majoritaire au Sénat et tombées lors de l’examen de sa proposition de loi par l’Assemblée nationale en 2018.
L’article 1er crée un cadre législatif pour les stratégies régionales de gestion de flux. Le deuxième instaure des systèmes de réservation des aires. Le dernier détaille les dispositifs de lutte contre les occupations illégales.
La commission les a complétés, en créant une stratégie régionale de gestion des déplacements et en retravaillant la réservation de places sur les aires. L’enjeu est aussi de répartir équitablement la charge de l’accueil entre communes et EPCI.
Dans mon département, l’Eure, cette concertation entre le préfet, le président du conseil départemental et les présidents des trois communautés d’agglomération est en cours. L’objectif est de mettre à disposition des gens du voyage trois aires de grands passages sur chacun de ces territoires alors qu’il n’en existe aucune aujourd’hui.
Cette volonté de se mettre en règle rendra aussi chaque élu plus légitime à exiger demain l’intervention de la force publique lorsque des installations sauvages ont lieu. Il faut appuyer les maires dans leur lutte contre toutes les illégalités.
Le renforcement des procédures d’évacuation est, dans ce même esprit, proposé par la commission. Un amendement a en effet été adopté pour autoriser la saisie et le déplacement des véhicules, y compris lorsqu’ils sont destinés à l’habitation. Un renforcement des mesures effectives est très attendu à la fois par les élus locaux, qui ont souvent un sentiment d’impuissance, mais aussi par leurs habitants, qui s’agacent de voir ponctuellement des gens du voyage s’installer sans autorisation.
En 2020, la crise sanitaire a touché très durement les gens du voyage. C’est pourquoi le Gouvernement a appelé dès la fin du mois de mars les maires à se montrer à l’écoute et compréhensifs, notamment sur le recouvrement des redevances et charges. L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et les représentants des gens du voyage ont instauré un dialogue constructif, et des reports d’échéances ont déjà été votés par certaines collectivités partout sur notre territoire.
D’une manière générale, ce mode de vie rend difficiles l’accès à certains droits et l’accomplissement de certains devoirs qu’implique une domiciliation. Un régime juridique ad hoc a donc été créé pour répondre à cette situation au fil du temps.
Le livret de circulation, créé en 1969, a été censuré par le Conseil constitutionnel en 2012, puis aboli par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Aujourd’hui, toutes les actions institutionnelles vont dans le sens d’une « normalisation », c’est-à-dire de la fin du statut dérogatoire. Mais des difficultés perdurent quant au stationnement des véhicules et à la scolarisation des enfants. La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement prévoyait en son article 28 la création de schémas départementaux.
La loi Besson du 5 juillet 2000 a prévu que les communes de 5 000 habitants sont obligées de disposer d’un terrain d’accueil dédié. Elles peuvent également transférer cette compétence à un EPCI. En contrepartie de cette obligation, l’État prend en charge les investissements nécessaires à l’aménagement et à la réhabilitation des aires dans la proportion de 70 %, en plus d’une aide forfaitaire. Plusieurs textes réglementaires sont venus détailler les conditions de cet accueil par les collectivités : neuf décrets, sept circulaires et trois arrêtés. Entre 2003 et 2010, les maires ont ainsi déjà vu leur pouvoir renforcé en la matière.
Au mois de novembre 2018, la loi Carle a clarifié les compétences des communes et de leurs groupements en matière d’accueil des gens du voyage au regard de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ou loi Maptam, et de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe.
La présente proposition de loi contient des dispositions utiles, comme le raccourcissement du délai qu’a le juge administratif pour statuer sur les recours ou le fait que la mise en demeure reste active en cas de retour des véhicules dans les quatorze jours pour éviter les « feintes de départ ». De même, le dispositif d’astreinte solidaire de 100 euros par jour et par résidence mobile, payable directement à la commune ou à l’EPCI, semble judicieux.
Cependant, François-Noël Buffet, le président de la commission des lois, dans un communiqué de presse du 13 janvier 2021, a déclaré : « Les collectivités territoriales pâtissent de l’absence de mise en œuvre – au niveau central, comme au niveau local – des mesures législatives déjà votées en la matière, les privant ainsi d’efficacité sur le terrain. » Si l’on veut rajouter une surcouche de législation à cette matière, qui est déjà complexe, il faut le faire avec précaution. À l’échelon national, la Commission nationale consultative des gens du voyage émet des recommandations pour mieux mettre en œuvre la loi. C’est avec tous les acteurs qu’il faut désormais travailler, dans un esprit de conciliation.
Considérant que l’arsenal des lois est déjà assez important sur le sujet, le groupe RDPI se positionne sur une abstention, mais laisse toute latitude à ses membres qui souhaitent voter en faveur de la présente proposition de loi, texte qui renforce la législation existante. Pour ma part, j’émettrai un vote favorable.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est toujours sensible de légiférer sur les relations entre les collectivités et les gens du voyage.
D’abord, sous ce terme valise, ce sont plusieurs réalités qui se confrontent et, souvent, se confondent, laissant parfois place à l’amalgame et à la raillerie.
Surtout, beaucoup d’entre nous ont eu à traiter de ces situations dans le cadre de leurs mandats locaux. Cela peut nous amener, dans la position de législateur et de défenseur des territoires que nous occupons aujourd’hui, à appréhender de tels sujets uniquement par ce prisme, ce qui serait dommageable.
Car, derrière, il y a une réalité, un choix de vie que nous devons respecter, à plus forte raison dans cette période, où les gens du voyage ont été particulièrement touchés.
Dans ce débat, j’en suis convaincue, nous devons suivre la voie de l’équilibre entre la capacité d’accueil gens du voyage et la lutte contre les occupations illicites. Il faut associer liberté d’aller et venir, solidarité et respect de la propriété privée.
Aussi, avant de prévoir davantage de contraintes pour les uns ou pour les autres, il faut s’assurer que les droits de chacun sont respectés. Je crois que le cœur du débat réside là.
Si les schémas d’accueil ont été rendus obligatoires par la loi Besson II, force est de constater qu’ils ne sont pas tous réalisés. Et quand bien même ils sont réalisés, près d’un quart des places ne sont pas effectivement créées. Voilà de quoi alimenter nos réflexions sur l’application des lois !
Nous le savons, il est parfois difficile pour les élus de gérer ces créations, notamment vis-à-vis d’une population peu encline à de nouvelles installations.
Pour avoir connu de telles situations, je sais que la politique d’accueil des gens du voyage est plus complexe qu’il n’y paraît, en raison de l’impossibilité de prévoir les installations et du coût élevé que celles-ci représentent, ainsi que des dégradations qui peuvent parfois être constatées.
À cela s’ajoute aussi une répartition des compétences qui a évolué et des situations parfois compliquées déjà évoquées, auxquelles la proposition de loi de nos collègues Carle et Hervé est venue apporter de bonnes solutions.
En termes de sanctions des occupations illicites, là encore, nous formulons le même constat : celui de l’inapplication des lois, et plus particulièrement de la loi Besson II.
Les préfets, qui ont vu leurs pouvoirs renforcés dans cette loi, devraient se saisir davantage de ces prérogatives. En théorie, cela paraît pourtant simple, les collectivités peuvent le saisir pour deux types de procédures : pour procéder à l’évacuation forcée d’un terrain occupé illégalement après mise en demeure par le préfet ou pour exécuter une décision de justice prononçant l’expulsion du terrain.
Dans les faits, c’est bien différent, et trop nombreuses sont les demandes d’évacuation qui restent sans suite : de quoi décourager de nombreux élus, qui ne se saisissent plus de cette possibilité !
Je pourrais faire exactement le même constat sur l’amende forfaitaire délictuelle en cas d’installation illicite.
On comprend bien ici que le problème est non pas de sanctionner plus durement les occupations illicites, mais bien de les rendre plus effectives.
Le débat que nous avons aujourd’hui est avant tout un constat de la non-application des lois, notamment de la loi Besson II. Pourquoi en adopter d’autres, qui ne seront pas plus appliquées ?
Dès lors, le texte que nous examinons, s’il pose de bonnes questions, n’apporte pas franchement de réponses aux problèmes évoqués sur nos travées.
Le travail de la commission est venu atténuer la portée du texte d’origine, mais, à notre avis, il n’apporterait aucune amélioration effective en cas d’adoption.
À l’article 1er, la stratégie régionale proposée n’apportera pas plus de solutions que le recensement suggéré initialement. Je m’interroge aussi sur la réservation des emplacements ouverte par l’article 2, qui sera très compliquée à mettre en œuvre sur le terrain.
Sur le renforcement des sanctions, j’entends les difficultés que mes collègues peuvent rencontrer, et je souscris à l’idée selon laquelle l’État doit être plus ferme face aux installations illégales. De nouvelles sanctions, pour être acceptées et acceptables, doivent aussi s’accompagner de garanties pour les gens du voyage.
Assurons-nous de l’application des schémas, mobilisons-nous pour que les procédures d’expulsion soient appliquées en cas d’occupation illicite, et anticipons la sédentarisation avant de légiférer une nouvelle fois.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, les élus du groupe RDSE s’abstiendront majoritairement sur cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, l’examen de la présente proposition de loi nous amène à évoquer un sujet sur lequel nous avons travaillé il n’y a pas si longtemps, avec la loi Carle de 2018, qui clarifie les compétences entre communes et EPCI et renforce les sanctions prévues en cas d’occupations illicites.
Nous entendons les problèmes que peuvent rencontrer des élus locaux dans l’organisation de l’accueil des gens du voyage, notamment face aux stationnements illégaux. Nous devons entendre également les représentants des personnes accueillies, qui décrivent parfois des aires d’accueil en béton, manquant de points d’eau et se trouvant dans des lieux insalubres.
L’esprit de la loi Besson défend un équilibre entre le devoir d’accueil et le droit de lutter contre les occupations illicites. Nous souhaitons le maintien de cet équilibre, qui implique plusieurs responsabilités : celle de l’État, celle des élus locaux et celle des personnes accueillies.
La commission des lois a allégé le texte initial, qui allait contre des principes constitutionnels et conventionnels tels que l’égalité et la liberté de circulation, la protection des données personnelles, la liberté de choix du domicile ou encore l’égalité devant l’exercice des droits civiques. Mais ce qu’il en reste ne nous convient pas plus, car le même esprit en structure ses lignes.
Le dispositif de réservation préalable que vous proposez ne résoudra pas les problèmes qui demeurent. Au contraire, il nous semble propice à une mise en concurrence et à une exclusion de personnes, qui, au nom du droit au logement, ont le droit à un accueil. Pour nous, de tels dispositifs incitatifs sont finalement punitifs.
Nous nous opposons également à la comptabilisation des emplacements d’accueil comme des logements sociaux. Cette mesure, déjà proposée, dénature les engagements en termes de logements sociaux. Ces obligations ne sont pas fongibles avec celles d’accueil des gens du voyage ; ce sont deux obligations que doivent distinctement respecter les collectivités.
Les autres mesures, qui allègent, d’une part, les sanctions envers les collectivités qui ne respectent pas leurs engagements en faveur des gens du voyage, et alourdissent, d’autre part, les sanctions pour occupations illicites, ne vont pas dans le bon sens selon nous.
L’efficacité du renforcement des sanctions n’est nullement prouvée, d’autant que celles qui existent déjà peinent à être appliquées. Par ailleurs, amoindrir la force des obligations des collectivités semble au contraire réduire l’efficacité des dispositifs prévus.
Il n’y a pas de problème public national dans l’accueil des gens du voyage, mais des cas particuliers, ponctuels, qui requièrent des solutions. §Globalement, on constate que les choses se passent bien lorsque les responsabilités partagées sont respectées. Nous refusons de tomber dans la stigmatisation et la peur injustifiée, qui nourrissent l’imputation de problèmes à des personnes qui n’en sont pas forcément responsables.
La mise à disposition de structures viables et agréables participe de la lutte contre les occupations illicites et au bon fonctionnement des relations entre élus et personnes accueillies. Il est donc contre-productif de réduire les exigences des normes imposées aux collectivités. Rappelons qu’à la fin de 2018, seuls vingt-quatre départements sur cent avaient complètement satisfait à leurs obligations. Si chaque collectivité peut faire cet effort ou développe la coopération et la solidarité territoriale, les réalités vécues dans certains endroits s’amélioreront.
Nous nous retrouvons tous sur le vrai problème lié à la non-application des dispositifs législatifs existants en raison du manque d’implication des ministères concernés, du manque de réactivité des préfets et de la faiblesse des aides financières, pointée dès 2012 par la Cour des comptes. Lorsque les obligations des collectivités sont respectées, les élus doivent pouvoir obtenir rapidement l’appui de l’État et le concours de la force publique en cas d’occupations illicites.
Madame la ministre, nous mettons aujourd’hui le Gouvernement devant ses responsabilités. Si nous estimons que les réflexions autour de l’adaptation des espaces d’accueil au regard des dynamiques de sédentarisation doivent être menées en concertation avec les élus et les associations représentatives des gens du voyage, il n’est pas nécessaire de légiférer de nouveau et de créer de nouvelles instances ad hoc. Veillons plutôt à ce que les outils existants soient appliqués par les services déconcentrés, les élus et les personnes accueillies, puis évalués. En l’état, plus de répression pénale ne mènera à rien. C’est pourquoi notre groupe votera contre ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE et sur des travées du groupe SER.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, l’accueil des gens du voyage est-il satisfaisant en France ? Le simple énoncé de cette question induit la réponse : non, évidemment non !
Il suffit de sortir d’une campagne sénatoriale – c’est mon cas – ou d’être simplement sénateur au contact des élus locaux pour savoir que ce constat est unanimement partagé.
Bien que la loi Besson ait tenté il y a vingt ans d’organiser les choses, on voit bien qu’il est nécessaire d’y revenir régulièrement. C’est le rôle du Parlement de le faire.
Mes chers collègues, disons-le avec force ici : les efforts des élus locaux sont considérables sur le terrain, les chiffres et l’examen objectif de la situation le prouvent.
Dans leur très grande majorité, ils sont de bonne volonté. Et le pire défaut de la loi Besson est d’avoir fait des élus des délinquants supposés, légitimant les stationnements illégaux par le non-respect, souvent partiel, voire marginal, du schéma départemental dans sa mouture la plus récente.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Il existe un vrai risque de course à l’échalote, les obligations allant croissant de schéma en schéma et aucune intendance publique ne pouvant décemment suivre, notamment sur un plan financier ou foncier.
Au-delà de l’inversion de la culpabilité, disons-le, que l’on soit préfet, juge, policier, gendarme, élu local ou parlementaire, les stationnements illégaux révèlent notre impuissance collective, et tout cela est aggravé par une impunité généralisée. Cette impuissance et cette impunité, nos concitoyens ne la comprennent pas, ne la supportent plus.
Alors oui, assurément, je rends grâce aux auteurs de cette proposition de loi de nous permettre de revenir sur cette question, plus de deux ans après l’adoption de quelques dispositions issues de deux propositions de loi, l’une de notre regretté collègue Jean-Claude Carle, l’autre que j’avais rédigée avec des collègues de mon groupe.
Mais, à ce stade, et avant de développer quelques arguments sur ce texte et nos amendements, je me permets de vous dire, madame la ministre, qu’il serait temps de mettre en application la mesure la plus importante, à savoir les amendes forfaitaires délictuelles.
Votre collègue ministre de l’intérieur m’a indiqué que leur mise en œuvre serait effective en octobre 2021, soit trois ans après le vote de la loi, alors qu’aucun texte d’application n’est nécessaire !
Franchement, on peut écrire des lois au nom du peuple souverain, réussir même l’exploit que ces mesures survivent à la navette parlementaire. Mais ces lois ne sont rien si l’exécutif ne les met pas en œuvre ! Il y va de la crédibilité même de la démocratie et du pouvoir législatif.
Malgré ce contexte, le groupe Union Centriste accueille le texte et le débat qui s’ensuit avec intérêt, et s’est voulu constructif, en proposant des amendements en commission comme en séance. Nous voulons relever la qualité du travail effectué par la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio, qui a enrichi le texte après avoir conduit de très nombreuses auditions avec humanisme et un sens aigu du dialogue et de l’ouverture.
Oui, l’idée d’un schéma à la main du préfet de région est bonne. Oui, la mise en demeure administrative doit être réformée et son délai de validité allongé.
Madame la ministre, cet après-midi, il faudrait que tout le Gouvernement ou presque soit à vos côtés pour discuter des mesures contenues dans le texte initial comme dans les amendements déposés, qui touchent au droit pénal, aux prérogatives des collectivités locales comme à celles des préfets…
Je commencerai par ce qui touche de plus près votre ministère, à savoir la proposition de décompter les places des aires d’accueil au titre de l’article 55 de la loi SRU. C’est une proposition frappée au coin du bon sens, maintes fois évoquée et votée ici, et qui mériterait, je le dis tout simplement, d’être enfin soutenue par le Gouvernement. Le message envoyé aux élus serait fort, pragmatique, concret. De surcroît – énorme avantage dans la période actuelle –, il ne coûterait rien.
En matière de renforcement de l’arsenal pénal, nous proposerons de réintroduire dans ce texte les dispositions communes des propositions de loi Carle et Hervé, qui furent votées au Sénat, mais rejetées à l’Assemblée nationale.
Je voudrais maintenant aborder trois sujets, mes chers collègues.
Le premier est la prise en compte du taux d’occupation des aires d’accueil existantes avant d’envisager la construction de nouvelles aires dans le schéma départemental. Cet amendement de notre collègue Françoise Gatel permettra d’être plus efficients dans la disposition géographique des aires.
Le deuxième est la nécessité de mieux connaître le coût d’ensemble de la politique publique consistant à accueillir et à proposer la sédentarisation aux gens du voyage. On évalue à 400 000 le nombre de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage. Parmi elles, les deux tiers seraient nomades.
Il serait intéressant pour le Parlement de connaître, en investissement comme en fonctionnement, le coût de cette politique publique.
Le troisième sujet n’est pas le moindre, il n’est pas non plus le plus simple à aborder : je veux évoquer la scolarisation des enfants du voyage.
Dans quelques semaines, le Sénat va examiner le texte confortant le respect des principes de la République et va s’engager dans la lutte contre toutes les formes de communautarisme. La question scolaire sera au centre des débats.
Parmi les gens du voyage dans notre pays, des milliers d’enfants sont mal scolarisés, voire pas scolarisés. D’expérience, il apparaît que la seule vérification faite par les services de l’éducation nationale se limite au fait de savoir si ces élèves sont inscrits dans un établissement scolaire en début d’année ou au Centre national d’enseignement à distance (CNED). Mais, dans les faits, beaucoup trop d’entre eux ne vont pas à l’école et ne suivent pas les cours à distance.
À l’adolescence, beaucoup d’enfants du voyage, notamment les filles, quittent le collège. Je pense que nous sommes tous complices de cette situation. Nous fermons les yeux sur la réalité et il y a un travail considérable à mener. Il existait autrefois des classes mobiles et des instituteurs détachés qui allaient au plus près des familles. Cela n’existe plus. Les enfants du voyage doivent pouvoir être libres de choisir leur vie lorsqu’ils atteignent l’âge adulte. C’est un enjeu considérable pour notre école, l’école de la République.
Mes chers collègues, les sujets que nous abordons cet après-midi sont concrets et difficiles.
Les aborder avec franchise nous expose à l’accusation de stigmatiser une population – le débat en témoigne. Ne pas les aborder, c’est ignorer la réalité du terrain et faire fi de notre travail.
Je conclurai en vous disant que, pour nous, sénateurs du groupe Union Centriste, le principal objectif est de faire véritablement respecter l’État de droit. C’est pourquoi nous voterons ce texte, car il réaffirme des préoccupations que nous partageons et apporte des améliorations concrètes au droit.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le confinement a été une épreuve pour tous, mais il a été particulièrement compliqué pour les personnes itinérantes. Il leur était impossible de bouger, alors que cela fait partie de leur identité, leurs activités économiques étaient atteintes – je pense en particulier aux fêtes foraines, aux marchés, aux cirques –, et elles n’étaient pas toujours éligibles aux aides de l’État.
Les difficultés sanitaires et de scolarisation de ces populations ont été démultipliées en fonction de leurs conditions de vie et de leur accès ou non à internet.
Compte tenu de cette situation, les interventions des restaurants du cœur et des banques alimentaires se sont multipliées sur les aires d’accueil pour répondre à ces situations de détresse.
Quelques évacuations ont eu lieu également, dans des conditions qui se sont parfois révélées dramatiques pour la santé de ces personnes.
Les communes ont souvent dû faire des efforts, en diminuant ou en supprimant le forfait d’usage des branchements dans les aires d’accueil.
Rappelons aussi que les règles en matière de circulation, d’identité et de vote de ces personnes dérogeaient au droit commun jusqu’en 2017. On a commencé à sortir de ce régime en 2012, et la loi de 1969, qui établissait ces discriminations – en particulier le carnet de circulation –, n’a été totalement abrogée que par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Mes chers collègues, les voyageurs de nationalité française sont entre 300 000 et 500 000. La loi Besson fixe des objectifs aux communes, transférés ensuite aux EPCI, pour que ces personnes puissent s’établir de manière temporaire et circuler.
En 2016, 76 % des EPCI remplissaient leurs obligations, 79 % en 2019. Il reste donc encore plus de 20 % des EPCI qui ne respectent pas les règles. C’est pire au niveau des départements : 50 % des aires de grand passage ne sont pas réalisées, et seuls vingt-quatre départements – ils étaient dix-neuf en 2016 – remplissaient leurs objectifs en matière de schéma départemental d’accueil.
Cela pose des problèmes, en particulier lors des grands déplacements d’été ou des regroupements religieux de plusieurs milliers de caravanes.
Comment voulez-vous que le système fonctionne s’il existe un tel décalage entre les besoins des gens du voyage, leur nombre, et les places prévues ? C’est un vrai sujet, et l’on doit constater que la loi relative à l’accueil des gens du voyage n’est pas respectée aujourd’hui, alors que cela devrait être notre priorité.
Au cours des dernières années, des procédures simplifiées d’évacuation des occupations illicites ont été prévues pour les EPCI qui respectent leurs obligations, mais, compte tenu du nombre de schémas non respectés, les préfets ne peuvent pas toujours trouver une alternative lorsqu’ils constatent des occupations illicites. Celles-ci peuvent donc durer faute de solution, parce que 25 % des départements seulement remplissent leurs obligations.
Se pose aussi la question de la sédentarisation progressive des gens du voyage, accélérée cette année avec le confinement. Il faut trouver des solutions pour permettre l’usage de terrains dont ils sont parfois propriétaires, mais qui ne sont pas destinés à un usage d’habitation. Rien n’est proposé sur ce sujet dans ce texte, alors que c’est aujourd’hui la priorité de ces populations en matière d’évolution de leur mode de vie.
Madame la ministre, je dois comme d’autres dénoncer la nonchalance, voire la désinvolture du Gouvernement sur ces sujets. Il a fallu attendre trois ans pour que les dispositions réglementaires relatives à la procédure de consignation mise en place par la loi Égalité et citoyenneté soient prises ! Cette procédure permet pourtant, de façon plus douce que le pouvoir de substitution du préfet, d’obliger les EPCI à remplir leurs obligations. Trois ans d’attente également entre le vote de la loi Carle – non pas que nous la soutenions – et sa mise en œuvre !

M. Jean-Yves Leconte. Mes chers collègues, dès lors qu’une loi est votée, bonne ou mauvaise, le Gouvernement doit l’appliquer. Sinon, à quoi bon continuer de légiférer ? Nous déplorons en la matière les dysfonctionnements de l’administration, madame la ministre.
M. Loïc Hervé approuve.

Malgré ces remarques, je veux aussi saluer une partie du travail de notre rapporteure.

L’article 3, qui était probablement inadéquat compte tenu du fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI), a été supprimé, de même que l’article 6, qui prévoyait que les gens du voyage ne puissent pas être plus de 3 % sur les listes électorales des communes. En République, les citoyens sont égaux ! Voilà une proposition étonnante de la part d’un groupe politique qui prétend vouloir lutter contre les communautarismes.

En revanche, nous pensons, comme Mme la ministre, que les articles 1er et 2 entravent trop la liberté d’aller et de venir pour être acceptables. Introduire la région dans les procédures de gestion et de planification pourrait être utile, mais il faudrait déjà réfléchir à la manière de mieux accompagner les départements qui rencontrent des difficultés. Ils n’arrivent pas en effet à mettre en œuvre cette coopération entre les EPCI qui leur permettrait de mieux remplir leurs obligations. Face à cette difficulté réelle d’occupation illicite des terrains, il me semble que la priorité est de faire en sorte que le Gouvernement et les collectivités appliquent la loi.

Il faut favoriser partout les espaces de médiation, plutôt que de stigmatiser des populations en prévoyant des amendes ou des saisies, dont on sait parfaitement qu’elles ne seront pas mises en œuvre.
Pour que la loi soit appliquée, mes chers collègues, encore faut-il qu’elle soit applicable ! C’est parfois la difficulté à laquelle le Gouvernement est confronté avec la procédure d’amende forfaitaire lorsqu’il constate l’absence de solutions.
En tout état de cause, mes chers collègues, nous ne pouvons souscrire aujourd’hui à une démarche qui refuse d’admettre le caractère inachevé de la politique d’accueil et qui veut tout asseoir sur la répression et les amendes. Je rappelle que 85 % des départements ne remplissent pas leurs objectifs en matière de schémas d’accueil.

Tant que l’on n’assure pas l’accueil et la mobilité des gens du voyage, il est difficile de concentrer toute notre politique sur les sanctions – il n’y a souvent pas de solution en cas d’occupation illicite, et les préfets le savent parfaitement. Pour sortir de cette quadrature du cercle, il faut que les collectivités respectent leurs obligations, et il faut les aider à les respecter.
Nous pourrions ainsi réfléchir à des solutions pour mieux accompagner les départements. L’Ille-et-Vilaine ou certains départements auvergnats ont mis en œuvre des dispositifs innovants pour pouvoir répondre aux besoins. Il faut accompagner les départements vertueux.
Sourires.

M. Jean-Yves Leconte. Il nous manque peut-être des outils, mais le tout-répressif n’est pas la solution.
Applaudissements sur les travées du groupe SER et des travées du groupe CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, les années et les textes législatifs se suivent, mais la gestion des gens du voyage reste une problématique récurrente pour les élus, notamment ceux de Haute-Savoie – je l’ai vécu en tant que maire.
Malgré les nouveaux outils que nous avons mis à leur disposition en 2018, les communes sont encore le plus souvent impuissantes face aux installations illicites.
Pas un mois ne passe sans que je sois sollicité par des élus de ma circonscription à ce sujet. Je ne peux qu’attester de leur désespoir, provoqué par leur absence de moyens pour faire respecter la loi, alors même qu’ils se conforment aux obligations mises à leur charge par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, mais également de leur désarroi face à certaines décisions de justice aberrantes.
Nous avons réussi à faire un premier pas en 2018 pour aider les élus, mais les mesures que nous avons alors adoptées ne suffisent pas, force est de le constater. Les collectivités territoriales n’ont toujours pas en main les outils nécessaires pour lutter contre le fléau – je pèse mes mots – des installations illicites. Nous ne pouvons pas continuer à laisser agir en toute impunité ces individus faisant fi de la loi, qui menacent, intimident et invectivent les élus, qui s’installent sans aucune notification préalable ou en méconnaissance des dates de réservation, qui dégradent des terrains communaux ou privés en ne respectant pas les règles les plus élémentaires d’hygiène, et qui laissent de surplus le soin aux collectivités de nettoyer derrière eux.
Les frais engagés pour la remise en état des terrains s’élèvent souvent à plusieurs milliers d’euros, payés par les impôts des contribuables, et pèsent considérablement sur les budgets des collectivités, qui ne peuvent pas les déployer pour des projets qui bénéficieraient pourtant à l’ensemble de leur population.
Comment est-il possible de laisser impunis ces agissements absolument contraires au vivre ensemble, au seul motif qu’ils sont commis par une communauté spécifique ? La loi n’est-elle pas la même pour tout le monde ? Le fait d’appartenir à une minorité empêche-t-il d’être responsable de ses actes et d’en assumer les conséquences, fussent-elles pénales ? La réponse est non, et je soutiens fermement qu’il est absolument indispensable que nous arrêtions de nous cacher derrière les particularités de cette communauté pour renoncer à prendre les mesures nécessaires.
La situation est tout simplement insoutenable, et il est de notre devoir d’y remédier, pour le bien des élus et du reste de la population, qui n’a pas à supporter le poids de ces agissements.
En 2018, lorsque notre proposition de loi a été examinée à l’Assemblée nationale, une grande partie du texte voté au Sénat a été détricotée. Nous étions nombreux à l’avoir déploré. On nous avait dit que cela suffirait. Mais, aujourd’hui, deux ans plus tard, nous devons de nouveau examiner une nouvelle proposition de loi, qui reprend en grande partie les dispositions qui avaient été supprimées à l’Assemblée nationale.
En effet, le texte que nous examinons reprend plusieurs des dispositions qui avaient été adoptées au Sénat : prise en compte des terrains dans la comptabilisation des logements sociaux, suppression de la consignation de fonds, saisie des véhicules d’habitation et déplacement forcé de ces derniers vers un autre terrain en cas d’installation illicite… Quelle perte de temps !
La majorité, arguant du risque de stigmatisation des gens du voyage, n’avait à l’époque pas eu le courage d’ouvrir les yeux sur l’étendue des lacunes de notre législation. J’espère de tout cœur, madame la ministre, qu’il en ira autrement cette fois, afin d’éviter un nouveau débat sur cette problématique dans deux ans.
Je l’avais dit à l’époque, je le répète aujourd’hui : les dispositions que nous proposons ne cherchent absolument pas à stigmatiser les gens du voyage, qui respectent la loi dans leur grande majorité, mais à donner aux élus les moyens nécessaires pour se défendre face à la minorité qui persiste à s’enfoncer dans l’illégalité.
Tout comme Loïc Hervé, je tenais à attirer votre attention sur l’absence de mise en œuvre réglementaire de certains dispositifs que nous avions adoptés, notamment l’amende forfaitaire. Il est tout bonnement aberrant qu’un dispositif voté ne soit pas appliqué, et je ne peux qu’inviter le Gouvernement à rectifier cette lacune le plus rapidement possible.
Je le souligne encore une fois, ce texte comble un vide législatif important. Il apporte des réponses concrètes aux problèmes rencontrés par les élus locaux, et sera encore enrichi par notre débat d’aujourd’hui. Il serait malhonnête d’avancer que les dispositifs actuels sont suffisants.
Ce texte est donc une véritable nécessité pour renforcer les outils dont disposent les collectivités. Tous les acteurs concernés par ce sujet espèrent un vote au Sénat et une lecture rapide à l’Assemblée nationale, en vue d’une application dans les meilleurs délais.
Madame la ministre, vous avez exprimé votre opposition à cette proposition de loi au début de votre intervention. Mais alors, faites-nous des propositions ! Nous sommes prêts à travailler avec vous. Nous reconnaissons tous l’existence d’un problème, et nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser les choses en l’état. Les élus n’en peuvent plus, ils appellent à l’aide !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Loïc Hervé applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les gens du voyage ne sont pas des citoyens de seconde zone. Comme tous les Français, ils ont des devoirs et aussi des droits, qui doivent être respectés, de même que leur mode de vie itinérant.
Mais, vingt ans après la loi Besson, force est de constater que la situation, malgré des évolutions positives, n’est pas pleinement satisfaisante, ni pour les collectivités ni pour les gens du voyage.
La question de leur accueil fait partie de ces sujets sensibles qui entraînent des débats passionnés et virent trop souvent au dialogue de sourds. Sur le terrain, les tensions se multiplient et conduisent dans certaines circonstances à des violences, dans des zones qui en étaient jusque-là préservées.
D’un côté, les gens du voyage s’estiment victimes d’un certain ostracisme, de préjugés, voire d’une mauvaise application de la loi rendant leurs conditions de vie difficiles ; de l’autre, les collectivités ont le sentiment, justifié, de remplir leurs obligations légales et les élus locaux sont confrontés à un véritable désarroi quand ils sont menacés, y compris dans leur intégrité physique, par des occupants de terrains publics ou privés irascibles.
Ces situations, en particulier lorsqu’elles aboutissent à des occupations illégales, des violences ou des dégradations, sont vécues localement comme l’illustration de l’impuissance de l’État et des autorités publiques. De fait, elles contribuent au blues des élus locaux et, surtout, à l’exaspération des habitants.
Dans le Calvados, de nombreux séjours se déroulent sans problème, mais, comme dans d’autres départements, nous ne sommes pas épargnés par ce phénomène de relations conflictuelles, notamment au moment des grands passages et rassemblements qui amènent des flux massifs et incontrôlés de caravanes et de véhicules dans des territoires tranquilles. C’est souvent le cas sur la côte et dans les communes du rétro-littoral comme Pont-l’Évêque.
Dans un passé récent, en tant que maire et président d’EPCI, j’ai moi-même, comme beaucoup d’entre nous, fait l’expérience d’une aire d’accueil plusieurs fois dégradée et de branchements sauvages sur les réseaux par des personnes peu soucieuses de respecter les règles.
Récemment, à Lisieux, des carcasses de voitures, des débris de verre, des détritus ont été abandonnés par des gens du voyage lors de leur départ et les sanitaires ont été dégradés.
C’est dans ce contexte général qu’intervient la présente proposition de loi. Le Sénat a déjà été à l’origine d’évolutions législatives sur ce sujet difficile, auquel nous avons tous été confrontés. On peut d’ailleurs regretter que certains dispositifs n’aient pas été retenus lors de précédentes navettes parlementaires.
Malgré les dernières évolutions du droit, comme l’a relevé la commission des lois, des difficultés persistent tant en matière d’accueil que de lutte contre les occupations illicites. Le texte de la proposition de loi tel qu’il est issu des travaux de la commission apparaît ainsi équilibré, pragmatique et, surtout, opérationnel. C’est bien ce qui est attendu par les collectivités territoriales : un cadre clair, une meilleure anticipation, des règles plus strictes pour faire cesser les occupations illicites, y compris par la contrainte, telle la saisie des véhicules illégalement stationnés.
La comptabilisation des aires d’accueil de gens du voyage au sein des quotas de logements sociaux, déjà votée à deux reprises par le Sénat, constitue à mon sens une mesure qui tient compte du coût et des efforts consentis par les collectivités. La suppression de la procédure de consignation de fonds pour les communes et EPCI me semble aussi constituer un signal fort.
Je forme le vœu que les dispositions les plus emblématiques de ce texte ne soient pas supprimées pour des motifs purement politiques au cours de la suite du processus législatif. Ce serait particulièrement mal vécu par les élus locaux. Continuons à leur redonner confiance pour gérer leur territoire et faisons en sorte que force reste toujours à la loi !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Loïc Hervé applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, j’ai le plaisir et l’honneur de clôturer cette discussion générale en qualité de coauteur de cette proposition de loi visant à mieux réglementer l’accueil des gens du voyage, sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez.
J’ai une pensée très émue pour mon regretté prédécesseur et ami Jean-Claude Carle, auteur d’une excellente proposition de loi déposée le 18 mai 2017 qui visait à compléter et corriger efficacement la loi Besson. C’est un thème auquel il était très attaché.
Hélas ! si ce texte avait fait l’objet d’un large consensus au Sénat en première lecture, une sorte d’angélisme sur certains bancs de l’Assemblée nationale avait conduit à en supprimer les mesures les plus substantielles. Malgré mon action pour tenter de les rétablir en seconde lecture, la messe était déjà dite et, lors de la séance du 23 octobre 2018, j’avais d’ailleurs conclu cette lecture par les mots suivants : « Je voterai ce texte conforme pour préserver les quelques avancées qu’il contient. Je souhaite vraiment que l’amende forfaitaire nous permette d’obtenir des résultats. J’espère que nous aurons très rapidement l’occasion de nous remettre autour de la table pour tenter d’arracher de nouvelles mesures en faveur des élus locaux et de résoudre ce grave problème. En tout cas, prenons date ! »
Je n’imaginais pas que l’avenir me donnerait raison si vite. En effet, nous nous sommes tous rapidement aperçus que les quelques mesures ayant survécu à la navette parlementaire ont montré leurs limites pour résoudre les difficultés vécues par les élus locaux. Les innombrables saisines sur ce sujet par des élus de mon département depuis deux ans n’ont fait que conforter mon sentiment.
Mon département de la Haute-Savoie, doublement frontalier, hautement touristique et très industriel, est en effet particulièrement concerné par cette problématique des occupations illicites de voyageurs itinérants qui provoquent tout au long de l’année la colère et l’exaspération des élus et des citoyens.
Ces agissements délictueux sont fort heureusement le fait d’une minorité, mais parce qu’ils peuvent entraver l’activité économique, contraindre l’exploitation agricole, empêcher le bon fonctionnement des services publics, porter une atteinte grave au droit de propriété ou à la liberté de circulation, ils deviennent absolument intolérables pour tous – élus, citoyens, professionnels, agriculteurs, force de l’ordre.
Aux côtés de mes collègues et amis Alain Chatillon et Patrick Chaize, j’ai donc souhaité reprendre ce problème à bras-le-corps, en retravaillant les dispositifs adoptés par la Haute Assemblée à l’époque et en ouvrant de nouvelles pistes. Celles-ci visent à la fois à améliorer les outils de gestion des flux impliquant tant les collectivités que les préfets, à rénover les pans du droit de l’accueil des gens du voyage qui le nécessitent et, enfin, à donner aux collectivités des outils adaptés pour lutter efficacement et rapidement contre les occupations illégales au moyen de dispositifs plus coercitifs.
Parallèlement, permettez-moi de saluer le travail rigoureux de notre excellente rapporteure, Jacqueline Eustache-Brinio, dont l’écoute et le pragmatisme ont permis d’enrichir considérablement ce texte.

Une partie de notre proposition de loi s’attèle ainsi à rendre plus efficaces les stratégies régionales de gestion de flux par le recensement de ceux-ci et donc à anticiper les saturations afin d’harmoniser les pratiques administratives sur le territoire et de donner une meilleure lisibilité du système pour les gens du voyage eux-mêmes.
Nous proposons également de comptabiliser en tant que logements sociaux les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Ces aires nous semblent en effet répondre en tout point aux caractéristiques de ces logements et cela permettrait une juste reconnaissance de l’important investissement des collectivités pour la réalisation de ces équipements.

Dans le même esprit, nous souhaitons supprimer la procédure de consignation de fonds à l’encontre des communes et des EPCI ne respectant pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, dispositif coercitif portant significativement atteinte à l’autonomie financière des collectivités et à leur libre administration.
Mesure importante, notre texte prévoit le doublement de la durée de la mise en demeure d’expulsion – elle passerait à quatorze jours contre sept actuellement.
Enfin, notre proposition de loi modifie la nature de la compétence du préfet en matière d’évacuation forcée : celle-ci deviendrait une compétence liée et non plus discrétionnaire, imposant ainsi au représentant de l’État d’agir, lorsque les conditions sont réunies. En effet, l’État doit lui aussi prendre toutes ses responsabilités dans la lutte contre les installations illicites. Comme on peut parfois le déplorer, il est intolérable de laisser lettre morte l’action des élus, en ne recourant pas à la force publique pour l’exécution des jugements d’expulsion. Il y va de la crédibilité des élus locaux, de la parole de l’État et de l’absolue nécessité de préserver l’ordre public.
Comme le disait l’écrivain et conseiller d’État, Eugène Marbeau, « la liberté, c’est le respect des droits de chacun ; l’ordre, c’est le respect des droits de tous ». Au-delà du droit, nous avons aujourd’hui le devoir d’agir !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Chapitre Ier
Permettre aux acteurs publics de mieux appréhender les flux afin de garantir de bonnes conditions d’accueil des gens du voyage
L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. – A. – Le représentant de l’État dans la région élabore annuellement une stratégie de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage visant à améliorer la répartition des flux entre les départements de la région et à prévenir la saturation des aires d’accueil.
« Le projet de stratégie est établi par le représentant de l’État dans la région à partir d’une analyse préalable fondée sur :
« 1° Un bilan d’évaluation de la stratégie appliquée l’année précédente ;
« 2° Une analyse de l’efficacité et du respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage existants ;
« 3° Les informations transmises par les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en particulier celles issues du dispositif de réservation prévu à l’article 9-1-1 ;
« 4° Les données et informations recueillies par les représentants de l’État dans chaque département de la région ainsi que, le cas échéant, celles transmises par les représentants de l’État d’autres régions ;
« 5° Toute autre information pertinente recueillie par le représentant de l’État dans la région.
« Le projet de stratégie, auquel est jointe l’analyse préalable, est transmis à la commission prévue au C du présent V, qui rend un avis sur son contenu et formule, en tant que de besoin, des propositions de modification.
« Le représentant de l’État dans la région arrête la stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage au vu de cet avis et de ces propositions. La stratégie ainsi que l’avis et les propositions formulés par la commission prévue au même C font l’objet d’une publication conjointe.
« B. – Le représentant de l’État dans la région coordonne également les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet la commission prévue au C du présent V. Il coordonne l’action de l’État sur les grands passages.
« C. – Dans chaque région, il est constitué une commission consultative, présidée par le représentant de l’État dans la région, composée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.
« Elle assiste le représentant de l’État dans la région dans l’ensemble de ses missions relatives à l’accueil des gens du voyage. Elle se réunit à la demande du représentant de l’État dans la région ou de la moitié des représentants des collectivités territoriales y siégeant.
« Dans la collectivité de Corse, cette commission est présidée par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse et composée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein. » ;
2° Le V bis est abrogé.

L’accueil des gens du voyage est un enjeu très important pour les collectivités locales. Il requiert à la fois de la souplesse et de la réactivité.
Si nous voulons lutter de manière réelle et rapide contre les occupations illégales qui constituent autant de défis à l’autorité publique, nous nous devons de leur donner des moyens efficaces de gestion des flux et des outils adaptés.
Or les moyens opérationnels à la disposition des collectivités pour assurer un bon accueil des gens du voyage restent à perfectionner. L’adoption de la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a certes été une avancée dans la bonne direction, mais il reste que la navette parlementaire n’a pas pu permettre de concrétiser un certain nombre de propositions votées par le Sénat. Il est donc nécessaire d’aller plus loin et de proposer de nouvelles pistes.
Cette responsabilité incombe particulièrement au Sénat, qui est la chambre des élus locaux. C’est en ce sens que cette proposition de loi me semble tout à fait opportune : elle porte la marque de l’expérience vécue par les élus.
En particulier, son article 1er prévoit de créer un cadre législatif pour les stratégies régionales de gestion de flux afin de recenser ces flux et donc anticiper les saturations. Il s’agit d’harmoniser les pratiques administratives sur le territoire national et de donner une meilleure lisibilité du système pour les gens du voyage eux-mêmes.
Cet article répond par ailleurs à une véritable attente des collectivités – départements et blocs communaux –, puisqu’il propose d’associer pleinement dans chaque région les collectivités concernées, en prévoyant une information régulière de celles-ci sur l’ampleur et la répartition géographique des flux de populations, ainsi que la consultation annuelle des départements par le préfet de région au sujet de la mise en œuvre de ces stratégies régionales.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 1er de ce texte met en place des schémas régionaux de gestion des déplacements des gens du voyage. J’ai entendu tout à l’heure – c’est pour cela que je voulais réagir – des chiffres parfois un peu délirants : vingt-quatre départements respecteraient le schéma départemental des gens du voyage et il en manquerait 85 %. Ces deux chiffres me posent un petit problème de mathématiques…
Mais revenons à la réalité ! Lorsque nous parlons de schémas départementaux des gens du voyage, vous le savez aussi bien que moi, madame la ministre, la question est en fait, dans l’état du droit, intercommunale, même si certains voudraient la déplacer vers d’autres niveaux de collectivités, que ce soit la commune, le département ou la région.
Or certaines intercommunalités refusent strictement l’application de la loi. Olivier Paccaud et moi-même connaissons un bon exemple dans notre département de l’Oise et il se trouve que la seule intercommunalité qui refuse d’appliquer la loi est une communauté de communes dirigée par un ancien député communiste – pas de chance !
Exclamations sur plusieurs travées.

Ce qui m’importe le plus, madame la ministre, c’est le volet sanctions. En effet, il faut appliquer le schéma, là où c’est possible, mais il y a des endroits, où le foncier manque – nous le savons bien. Prenons l’exemple des intercommunalités de Corse qui sont soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne : elles ont un petit peu de difficultés à créer des terrains pour gens du voyage – par le plus grand des hasards, ce n’est pas forcément dans ces endroits que les besoins sont les plus importants…
Mais revenons là encore aux faits. Dans une communauté de communes de mon département qui respecte le schéma départemental, le maire d’un petit village, Sacy-le-Petit, qui est plutôt encarté de l’autre côté politique par rapport à moi, s’est fait violenter au printemps dernier – il a vraiment cru y passer ! –, parce qu’il s’opposait tout seul à l’installation de gens du voyage. Nous sommes nombreux sur ces travées à avoir dû nous déplacer des dimanches après-midi – nous savons bien que ces installations ont lieu le dimanche – pour faire la même chose et être pareillement menacés.
Les élus n’acceptent plus de se retrouver seuls, d’être menacés. Les Français n’acceptent plus de telles occupations de propriétés sans conséquence pour ceux qui en sont à l’origine. C’est contre cela, madame la ministre, que vous devez lutter très fermement !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Chauvet, Delahaye et Détraigne, Mme Doineau, M. Duffourg, Mmes Férat et Guidez, MM. Henno et Janssens, Mme de La Provôté, MM. Lafon, Laugier et Le Nay, Mme Létard, M. Levi, Mme Loisier, MM. Longeot, Louault, P. Martin et Mizzon, Mmes Sollogoub et Vérien, MM. Bonhomme et J.M. Boyer, Mmes Canayer, Di Folco et Dumont et MM. H. Leroy, Reichardt, de Legge et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le sixième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains tels que mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret. » ;
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi du 7 novembre 2018, vise à prendre en compte le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, les secteurs étant définis par chaque schéma départemental, afin de mieux mesurer la nécessité réelle de construire une aire supplémentaire, tandis que certaines aires environnantes ont un taux d’occupation très réduit.

Comme l’a rappelé Jocelyne Guidez, cet amendement a déjà été adopté dans le cadre de l’examen de la proposition de loi déposée par Jean-Claude Carle et Loïc Hervé et dont Catherine Di Folco était rapporteure. Il apporte un nouveau garde-fou, en ce qui concerne les prescriptions du schéma départemental.
L’avis de la commission est favorable.
Selon cet amendement, le schéma départemental ne pourra prévoir la réalisation d’aires ou de terrains que si le taux d’occupation moyen des aires ou des terrains existants dans le même secteur est supérieur à un certain seuil.
De mon point de vue, ces limitations constituent un retour en arrière, parce que de nombreux terrains et aires restent à réaliser – c’est le débat que nous avons eu tout à l’heure.
Si nous raisonnons en termes de taux d’occupation, cela risque d’entraîner de la sédentarisation sur certaines aires qui ne sont pas prévues pour cet usage.
Par ailleurs, les occupants d’un terrain sont titulaires d’un contrat de bail dont la durée ne peut être inférieure à trois ans.
L’adoption de cet amendement aurait donc beaucoup d’effets de bord. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er est adopté.
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1°
« II ter. – En cas de stationnement en violation du titre d’occupation prévu au I de l’article 9-1-1 ou en l’absence d’un tel titre, lorsqu’il est requis en application du même I, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la délivrance dudit titre d’occupation peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, s’il fait obstacle à une occupation licite fondée sur un titre d’occupation prévu audit I ou s’il fait obstacle aux opérations d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’aire concernée.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et sur les lieux.
« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II ter reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation d’un arrêté prévu au I ou au I bis du présent article et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II quater, le représentant de l’État dans le département procède à l’évacuation forcée des résidences mobiles.
« II quater. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État dans le département à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » ;
2° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9 -1 -1. – I. – Pour les rassemblements de cent-cinquante résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.
« L’acceptation expresse de la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.
« Tout refus est motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :
« 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;
« 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;
« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.
« II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil.
« Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire desquels sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Primas, M. Courtial, Mme Demas, MM. Bonnus, Bonne, Vogel et D. Laurent, Mme V. Boyer, MM. Mouiller, Savary, Cardoux et Panunzi, Mme Drexler, MM. Burgoa, Bacci et Daubresse, Mmes Micouleau, Borchio Fontimp, Chauvin, Deromedi et L. Darcos, MM. Frassa, Bascher, Brisson, Hugonet et Cambon, Mmes Procaccia, Puissat et Goy-Chavent, M. Bazin, Mmes Canayer, Dumont et Lassarade, MM. Savin et Genet, Mme Imbert, MM. Perrin et Rietmann, Mme Di Folco, MM. Babary et Bouloux, Mme Chain-Larché, MM. Le Rudulier, Cuypers et Calvet, Mme Richer, MM. B. Fournier, Boré, Gremillet et Reichardt, Mmes Garnier, Schalck, de Cidrac et Noël, MM. H. Leroy et Laménie, Mme Lopez, MM. Grand, Pellevat, Rapin, Longuet, Chaize, Sido, Pointereau, Mandelli, Paccaud et Klinger, Mme M. Mercier, MM. Anglars, Allizard et Lefèvre, Mme F. Gerbaud, M. Belin et Mmes Gruny et Berthet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – A. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées de façon permanente.
B. – La taxe est due au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.
La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d’imposition.
Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
C. – Sont exonérés de la taxe :
1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d’imposition ;
2° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
3° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts ;
4° Les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au même I.
Pour l’application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s’entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
D. – Le montant de la taxe est fixé à 200 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 150 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d’imposition.
E. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l’article 887 du même code est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l’administration, est déposée, sur présentation du certificat d’immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s’il est délivré au titre d’une résidence mobile exonérée en application du C, est revêtu de la mention « gratis ».
F – Le récépissé mentionné au E est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.
G. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
H. – Le défaut d’apposition du récépissé dans les conditions prévues au F, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au D, majoré de 40 %.
I. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d’enregistrement.
J. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Cet amendement vise à réintroduire la taxe sur les résidences mobiles terrestres qui avait été introduite dans la loi de finances rectificatives pour 2010 par le Sénat.
Le Gouvernement a fait le choix dans la loi de finances pour 2019 de supprimer cette taxe au nom de « la suppression de taxes à faible rendement ». Pourtant, le produit annuel de cette taxe réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale au prorata des dépenses engagées en application de la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est un levier financier supplémentaire au service des élus pour mener à bien les projets d’aménagements qui sont nécessaires à l’accueil des gens du voyage.
Par ailleurs, cet amendement tient compte des modifications législatives apportées par le Sénat en 2017, à la suite de l’adoption d’un amendement que j’avais cosigné avec Sophie Primas dans le cadre de l’examen de la proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d’accueil des gens du voyage. L’Assemblée nationale avait ensuite supprimé cette disposition.
Le Sénat avait notamment voté l’augmentation de la taxe de 50 euros, afin de renforcer la couverture des dépenses engagées par les collectivités et EPCI, et la transformation du récépissé délivré lors du paiement de la taxe en une vignette que le redevable devait apposer de manière visible sur son véhicule.
Le rétablissement de cette taxe et son articulation pratique, une fois acquittée, pour faciliter les contrôles fourniraient aux communes et aux EPCI des moyens précieux pour les équipements prévus par les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, en améliorant leur financement.
Enfin, cet amendement a le mérite de proposer un outil financier concret et nécessaire pour améliorer l’accueil des gens du voyage dans les territoires.

J’ai bien entendu les arguments qui ont été développés et cet amendement vise effectivement à réintroduire une taxe sur les résidences mobiles qui avait été supprimée par l’article 9 de la loi de finances pour 2019. Cette taxe était assise sur les résidences mobiles utilisées à titre principal et venait compenser le fait que ces résidences ne sont pas soumises à la taxe d’habitation.
Je rappelle cependant que la commission des finances du Sénat a approuvé la suppression de cette taxe pour deux motifs. D’une part, ses coûts de gestion étaient élevés. D’autre part, une telle suppression était cohérente avec le mouvement de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales – pour 80 % des assujettis dans un premier temps.
Il me semble logique de rester cohérent avec la position que la commission des finances du Sénat a adoptée en 2019. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
C’est le même avis, monsieur le président.
Sur la forme, nous estimons que la réintroduction d’une taxe passe nécessairement par un projet de loi de finances, mais je voudrais aussi vous répondre sur le fond.
Tout d’abord, cette taxe avait un rendement très faible, de l’ordre de 10 000 euros par an, ce qui était inférieur aux coûts de recouvrement. Ensuite, cette taxe n’était pas affectée au financement des aires d’accueil. Enfin, alors qu’elle constituait d’une certaine manière le pendant, pour les gens du voyage, de la taxe d’habitation, il n’y a pas beaucoup de sens de la réintroduire au moment même où nous supprimons progressivement la taxe d’habitation pour la totalité des Français.
L’avis est donc défavorable, pour des raisons tant de fond que de procédure.

Je vais rester cohérent avec la commission des finances qui souhaite supprimer les petites taxes, dont les coûts de recouvrement sont plus élevés que le rendement.
Pour autant, le problème soulevé est important et la réponse apportée insuffisante ! Madame la ministre, la véritable question est de savoir qui paye. Certains de nos concitoyens veulent bien accueillir les gens du voyage, mais ils veulent qu’ils payent aussi, ce qu’ils ne font pas – et c’est bien le problème. Nos concitoyens en ont assez !
Je peux vous parler d’intercommunalités dont le premier projet est de construire une aire d’accueil pour gens du voyage. Vous vous rendez compte ! La première augmentation d’impôts est alors destinée aux gens du voyage, et pas pour la mise en commun et la réalisation de projets pour les habitants eux-mêmes, ceux qui payent des impôts !
Il y a un manque cruel d’égalité entre les citoyens et un problème d’acceptation. Je refuse de stigmatiser les gens du voyage, mais il faut que tout le monde paye des impôts. Comme le disait très justement Pascal Allizard, il y a des devoirs et des droits. Payer des impôts fait partie des devoirs !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Madame Estrosi Sassone, l’amendement n° 6 rectifié bis est-il maintenu ?

Non, je le retire, monsieur le président, mais j’ai été sincèrement étonnée par le chiffre que vous avez donné, madame la ministre : cette taxe ne rapporterait que 10 000 euros par an ! Cela me semble extrêmement modique et un peu surprenant.

C’est sûrement la raison, parce que le rendement aurait dû être nettement plus élevé et nous aurions dû encaisser bien davantage.
L ’ article 2 est adopté.
(Supprimé)
Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

L’amendement n° 12, présenté par M. Leconte, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Nous considérons que les aires d’accueil des gens du voyage ne sauraient être assimilées à des logements pérennes destinés à des ménages modestes et donc être décomptées au titre de la loi SRU.
Par ailleurs, en l’absence de bail ou d’occupation de type locatif, aucun mécanisme ne peut garantir l’occupation effective de ces aires à des fins sociales par des personnes sous plafond de ressources, ce qui rend tout à fait impossible une comptabilisation permettant de vérifier la satisfaction des objectifs fixés par la loi SRU.
Cet article nous paraît constituer un contresens juridique, dont la seule motivation repose sur la volonté d’exonérer des communes qui ne remplissent pas leurs obligations légales en matière de gens du voyage et/ou de construction de logements sociaux, en mélangeant deux obligations de nature très différente.
C’est pourquoi nous sommes opposés à cet article.

L’avis est évidemment défavorable. D’abord, cet amendement de suppression de l’article 4 est contraire à la position de la commission. Ensuite, Loïc Hervé a très bien développé l’argumentaire concernant ce sujet. Enfin, c’est une disposition que le Sénat a déjà adoptée à plusieurs reprises.
Le Gouvernement est favorable à la suppression de l’article 4.
Je considère en effet qu’au regard des besoins en logements sociaux on ne peut pas compenser l’absence de tels logements par la création d’aires d’accueil qui sont par ailleurs une obligation législative. Enfin, les dépenses liées à ces aires d’accueil sont déjà déductibles des pénalités liées à l’application de la loi SRU ; un effort a donc déjà été fait dans le sens de cet amendement.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Je suis un peu étonné par cet amendement et par votre réponse, madame la ministre, parce que les dépenses destinées à la réalisation d’aires d’accueil sont déductibles du prélèvement prévu à l’article 55 de la loi SRU, dans le cas où les communes concernées comptent moins de 25 % de logements sociaux.
Il est donc logique de comptabiliser ces emplacements dans le décompte des logements sociaux, les populations y stationnant ayant recours, comme tout le monde, aux équipements de la ville qui sont financés par les budgets locaux.
Il faut absolument maintenir cet article !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 est adopté.
L’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut acquérir…
le reste sans changement
c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 13 est présenté par M. Leconte, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 16 est présenté par M. Benarroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 13.

Nous proposons de supprimer l’article 5, car nous sommes opposés à la suppression du dispositif de consignation de fonds à l’égard des communes qui ne respectent pas leurs obligations légales au titre de l’accueil des gens du voyage.
La procédure de consignation a été mise en place par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté. D’une certaine manière, c’est une sanction douce par rapport à la réelle sanction qui est prévue depuis 2000, c’est-à-dire le pouvoir de substitution du préfet. Ce pouvoir de substitution est particulièrement lourd à mettre en œuvre et, par conséquent, n’a pas été appliqué.
C’est pour cette raison que nous avons mis en place la procédure de consignation ; un tel outil, qui n’allait pas aussi loin que le pouvoir de substitution du préfet, devait inciter les EPCI à agir, en particulier celles qui, de manière flagrante, ne respectent pas leurs obligations.
Paradoxalement, si vous supprimez cette procédure, il ne restera que le pouvoir de substitution du préfet ! Je ne pense pas que ce soit l’idéal…
Par ailleurs, la loi a été votée en 2017, mais les textes d’application n’ont été adoptés qu’en 2020, soit avec trois ans de retard, ce que nous regrettons vivement. En tout état de cause, il n’est évidemment pas possible d’évaluer la procédure de consignation. Or elle le mérite, puisqu’elle constitue une disposition plus douce que le pouvoir de substitution du préfet. En ce qui nous concerne, cette procédure nous semble adéquate.

Pour compléter ce que vient de dire mon collègue Leconte, les travaux préparatoires ont montré que la procédure de consignation décidée dans le cadre de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté n’a pas été mise en place et appliquée de manière pleine et entière. Il nous paraît inopportun de supprimer un dispositif qui n’a pas pu être évalué et qui constitue une mesure plus souple que les autres outils existants.
Il nous apparaît encore plus inopportun de supprimer une mesure de ce type, c’est-à-dire douce, dans un texte qui cherche justement à apaiser les relations entre les collectivités locales et les gens du voyage et qui, d’un autre côté, renforce les sanctions pour les communautés en cas d’infraction.

Ces amendements visent à supprimer l’article 5 de la proposition de loi, ce qui reviendrait à maintenir le dispositif de consignation des fonds pour les communes et EPCI qui ne sont pas à jour de leurs obligations au titre du schéma départemental.
Cette position est évidemment contraire à celle de la commission, mais je voudrais apporter trois arguments qui me semblent justifier notre avis.
Tout d’abord, le dispositif de consignation contrevient aux principes d’autonomie financière et de libre administration des collectivités locales. Cette consignation est souvent perçue comme inutile et vexatoire par les communes et EPCI concernés.
Ensuite, l’existence d’un pouvoir de substitution du préfet semble une procédure nettement plus efficace que la consignation de fonds pour assurer la mise en conformité des collectivités concernées.
Enfin, la portée pratique de cette mesure semble très faible à ce jour.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à ces deux amendements de suppression de l’article 5.
Je ne vous surprendrai pas : étant défavorable à cet article 5 qui supprime la consignation de fonds, je suis favorable à ces amendements !
Je reconnais volontiers que le Gouvernement a mis beaucoup de temps pour adopter les textes réglementaires nécessaires et il est regrettable que ceux-ci soient sortis trois ans après la parution de la loi.
Pour autant, maintenant que ces textes existent et sachant qu’il s’agit d’une mesure graduée préalable à la substitution, je pense qu’il faut lui laisser sa chance. C’est l’une des mesures qui permettent de faire avancer la création des aires d’accueil et de grand passage.

Quand on parle de la loi Égalité et citoyenneté, j’y suis un petit peu sensible, chacun voudra bien l’entendre, pour l’avoir défendue sur un autre banc voilà quelques années.
Cette loi a été promulguée en janvier 2017. C’est vrai, nous pouvons regretter qu’il ait fallu trois ans pour publier les décrets d’application d’un texte qui permet finalement, madame la rapporteure, aux collectivités territoriales, EPCI et communes, de respecter d’abord la loi de la République.
Si nous avons été amenés à l’imaginer en 2017, et qu’elle a été mise en œuvre par décrets en 2020, c’est parce que, depuis la loi Besson de 2000, des communes et des intercommunalités ne sont pas en règle avec le droit. Nous voulions simplement les inciter : le bâton, puisque la carotte ne pouvait pas fonctionner en la matière.
Nous sommes dans une totale cohérence avec un texte qui a été porté par mes amis politiques ici présents. Je soutiens, bien sûr, cette suppression d’article proposée par notre collègue Jean-Yves Leconte.

Je partage bien sûr ce qui a été dit par MM. Leconte et Kanner. C’est vraiment étrange : alors que le Sénat a voté voilà trois ans une disposition qui n’a pas connu le moindre début d’application, vous nous proposez de la supprimer ! Ce serait quand même une démarche logique que de l’évaluer et donc d’attendre quelque temps avant de la supprimer. À cela, madame la rapporteure, vous n’avez pas apporté de réponse.
En fait, je veux surtout intervenir à la suite de votre remarque selon laquelle cette disposition serait contraire à l’autonomie des collectivités locales. C’est un argument un peu répétitif auquel je m’oppose, et ce pour une raison très simple : il existe, mes chers collègues, des centaines de lois qui imposent un certain nombre de choses aux collectivités locales, et l’on ne peut pas arguer de l’autonomie des collectivités locales pour refuser d’appliquer une loi de la République ! L’autonomie des collectivités locales s’exerce évidemment dans le cadre de la loi.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 5 est adopté.

L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Guidez, M. Klinger, Mme Dumont, MM. Decool, Pellevat, Verzelen, Lévrier et H. Leroy, Mme Noël, MM. Chauvet, Wattebled, Meurant et Lafon, Mme Férat, M. Genet, Mme Puissat, M. Canevet, Mmes Vermeillet, Billon et L. Darcos, MM. Longeot, Bonne, D. Laurent, Duffourg, Chasseing, B. Fournier, Menonville, Sautarel, Vogel, Calvet et Le Nay, Mmes Loisier et Jacquemet, M. Favreau, Mme Belrhiti et MM. Lefèvre, Levi, Laugier et Daubresse, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du nombre ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du département concerné en violation de l’arrêté ».
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Cet amendement vise à modifier le périmètre d’application du maintien de la mise en demeure du préfet prévu au quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Le but est de mieux lutter contre les installations illicites en réunion. En effet, le déplacement de ces résidences mobiles dans une ou plusieurs communes d’un même département est régulièrement constaté. Voilà pourquoi il est proposé d’étendre les effets de la mise en demeure au niveau départemental. Cette nouvelle rédaction permettrait d’éviter l’engagement de nouvelles procédures auprès du préfet et rendrait cette mesure plus efficace.

Le présent amendement, effectivement, tend à étendre les effets de la mise en demeure émise par les préfets en cas de stationnement illicite sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI à l’ensemble du département.
Je comprends bien l’intention, mais il ne m’apparaît pas possible de l’adopter en l’état pour plusieurs raisons.
D’abord, le dispositif proposé ne me semble pas proportionné, et c’est un vrai souci. Il reviendrait en fait à interdire à une résidence mobile le stationnement sur l’ensemble d’un département sur le fondement du non-respect d’une interdiction de stationnement sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI. Cet amendement soulève une question d’ordre constitutionnel, car il est contraire aux principes de liberté du choix du domicile et d’aller et venir.
Il est de surcroît difficilement applicable et il nuirait gravement à la cohérence juridique des dispositions relatives aux évacuations d’office. En effet, comme il permettrait d’étendre à un département entier les effets d’une interdiction de stationnement prononcée sur une seule commune, les personnes visées ne pourraient aller nulle part. Il pose un véritable problème technique de mise en œuvre et il n’offrirait pas de véritable solution pour la commune concernée.
J’émets donc un avis défavorable pour des raisons à la fois constitutionnelles et pratiques.
Même avis que Mme la rapporteure pour les mêmes raisons de cohérence et d’architecture juridique. Un arrêté pris au niveau communal ou intercommunal et étendu à l’échelle du département ne me paraît pas opérant.
(Supprimé)
Le III de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rétabli :
« III. – Les dispositions des I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » –
Adopté.
Chapitre II
Rendre plus effectifs et ciblés les dispositifs de lutte contre les occupations illégales
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Au début du quatrième alinéa du II, les mots : « Cette mise en demeure » sont remplacés par les mots : « La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II » ;
3° Au même quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
4° Au cinquième alinéa du même II, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
5°

L’article 8 de ce texte constitue une avancée considérable, très attendue par les élus locaux. Il est en effet tout à fait anormal qu’une collectivité qui a engagé des moyens financiers lourds pour réaliser et entretenir une ou plusieurs aires d’accueil, respectant par là même ses obligations en matière d’accueil des gens de voyage, ne puisse rapidement mettre un terme à l’occupation illicite d’un terrain sur son territoire.
Les tensions sont palpables et le sentiment d’impuissance qui accable les élus est inacceptable. Les maires ruraux sont de plus en plus victimes de menaces ou de faits de violence. En septembre dernier, dans mon département de la Vienne, où, je le précise, le schéma départemental est « dans les clous », le maire de Croutelle, près de Poitiers, était molesté alors qu’il tentait d’empêcher une occupation illicite. Ce n’est qu’une banalité parmi tant d’autres, mais ce n’est plus acceptable. L’État doit conforter la légitimité de ces élus de communes rurales et leur apporter l’appui impératif du respect de la loi.

Les crises des « gilets jaunes » et de la covid-19 ont révélé au grand jour la forte défiance de nos concitoyens à l’égard de nos institutions. Nos maires ne sont pas moins sceptiques, loin de là. Je ne compte plus le nombre de fois où un édile m’a confié avoir cette impression que l’État était impuissant. Cet article 8 vous permettrait de démontrer que le Gouvernement sait faire respecter l’État de droit. Ce dispositif, qui renforce les outils de lutte contre les installations illicites, vous place finalement, madame la ministre, devant vos responsabilités. Nous vous proposons les moyens législatifs d’agir. À vous de vous en saisir ! Ne vous dérobez pas !

L’amendement n° 14, présenté par M. Leconte, Mme Harribey, M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Je vais, d’une certaine manière, répondre aux interventions précédentes : que fait-on si, effectivement, il y a une occupation illicite, mais qu’il n’y a pas de solution alternative possible et correcte, dans des conditions sanitaires acceptables, a fortiori dans une période comme celle que nous vivons actuellement ? Faut-il vraiment lier les préfets avec une obligation absolue ? Non, il faut leur laisser un pouvoir d’appréciation. C’est la raison pour laquelle l’évacuation forcée en cas d’occupation illégale, après une mise en demeure restée sans effet, ne doit pas être une obligation systématique, quelles qu’en soient les conséquences. On ne peut pas dire « quoi qu’il en coûte ! ».
Il faut voir s’il existe des solutions adéquates. Faisons confiance aux préfets. Je comprends parfois les frustrations, mais pouvons-nous vraiment créer un automatisme sans en connaître les conséquences ?

Avec cet amendement, mon cher collègue, vous proposez la suppression de la compétence liée du préfet pour exécuter la mise en demeure si celle-ci n’a pas été suivie d’effet. C’est contraire à la position de la commission, mais là n’est pas le sujet.
Je souhaite préciser que la mise en demeure ne peut être prononcée qu’en cas de trouble à l’ordre au public. Si elle n’est pas suivie d’effet, il semble légitime que le préfet soit obligé d’agir afin d’y mettre fin. D’ailleurs, je vous rappellerai, mon cher collègue, que c’est la solution qui a été retenue tout à l’heure, dans le même esprit, lors de la discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les squats.
C’est un avis favorable, parce qu’il est compliqué de prévoir une compétence liée systématique du préfet en matière d’ordre public. C’est important que le préfet garde une marge d’appréciation s’agissant de la mobilisation des moyens.

Je veux plutôt livrer un témoignage quant à cette obligation d’évacuer les terrains occupés de façon illicite.
Nous avons dans nos territoires de grandes aires d’accueil, mais elles ne suffisent pas ou plus, la plupart du temps, puisque les convois, les groupes qui se déplacent sont de plus en plus importants. Aussi, très souvent, les aires d’accueil, qui relèvent des EPCI, sont complètes, ce qui entraîne des occupations illicites de terrains.
Alors, au lieu de sanctionner ou d’évacuer, est-ce qu’on ne pourrait pas, en amont, limiter le nombre de personnes qui forment ces convois ? Certains comptent jusqu’à 400 caravanes ; ce sont de véritables organisations, avec des pasteurs qui se comportent comme des agences de voyages. Dans ces conditions, l’aire de grand passage ne suffit jamais et on se retrouve avec des occupations illicites, parce qu’il faut bien qu’ils stationnent quelque part. J’y insiste, n’y a-t-il pas la possibilité de limiter en amont la composition de ces convois de plus en plus importants, un phénomène qui résulte finalement d’un business un peu déguisé d’agence de voyages ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 8 est adopté.

L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par MM. Pellevat, Cardoux et Hugonet, Mmes Berthet, Demas, Dumont et Noël, MM. Burgoa, Joyandet, Rapin, Brisson, Saury et Pointereau, Mmes Puissat, Imbert, V. Boyer, Joseph, Thomas et Belrhiti, MM. Charon, Laménie, Savary, Meurant et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Vogel, Cadec et de Nicolaÿ, Mmes Canayer et F. Gerbaud, M. Lefèvre, Mmes Chauvin, Micouleau et L. Darcos et MM. D. Laurent, Panunzi, Genet, Wattebled et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’établissement public de coopération intercommunale prend les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application du 1er alinéa du I de l’article 3 ; ».
2° Après le 2° du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La commune prend les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application du 1er alinéa du I de l’article 3 ; ».
La parole est à M. Cyril Pellevat.

Aux termes du I de l’article 2 de la loi Besson, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV) fixe des obligations pour les EPCI compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, ainsi que pour les communes non-membres d’un tel EPCI qui figurent sur ce schéma.
Il y a deux moyens pour le bloc communal de satisfaire à ses obligations : soit en créant, en aménageant, en entretenant et en gérant des aires d’accueil ; soit en contribuant financièrement à de telles opérations situées en dehors de son territoire.
De par le II de l’article 9, dans une commune soumise au SDAGV ou sur le territoire d’un EPCI compétent, une mise en demeure préfectorale ne peut intervenir que si un arrêté d’interdiction de stationnement de résidences mobiles n’a pas été respecté. Un tel arrêté peut être pris si la commune a satisfait à ses obligations, mais également si elle a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ce faire en raison de mesures déjà mises en œuvre.
Toutefois, l’article 3, qui traite des conséquences du manquement aux obligations du schéma, prévoit également que le préfet puisse mettre en demeure la commune de prendre des mesures nécessaires. Or, lorsque la commune agit dans ces conditions, elle ne peut prendre d’arrêté d’interdiction de stationnement. Cet amendement tend donc à prévoir cette possibilité.

Cet amendement vise effectivement à rendre possible la mise en œuvre de la procédure administrative d’évacuation d’office pour les communes et EPCI défaillants, mais qui respectent les mesures qui leur sont prescrites par mise en demeure du préfet.
La bonne volonté d’une commune qui essaie de rattraper son retard en matière d’accueil des gens du voyage me paraît effectivement pouvoir justifier cette possibilité de prendre un arrêté interdisant le stationnement sur son territoire et, partant, la possibilité de mettre en œuvre la procédure administrative d’évacuation d’office.
Cet amendement, qui a été retravaillé à la suite de nos discussions en commission, me semble relever du bon sens. L’avis est favorable.
L’avis est défavorable, parce que l’application de l’article 2 de la loi Besson prévoit déjà un délai de deux ans, renouvelable une fois, dans lequel, quand la réalisation des aires n’a pas eu lieu, il est possible d’accorder du temps supplémentaire, tout en permettant un arrêté d’interdiction.
Il me semble que ce délai de quatre ans est déjà important. Du coup, l’équilibre global du texte serait rompu si l’on passait en plus au délai de l’article 3, qui porte sur les sanctions en cas de non-prise en compte des besoins des gens du voyage.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par M. Pellevat, Mme Micouleau, MM. Genet et D. Laurent, Mme Borchio Fontimp, MM. Panunzi, Cardoux, Lefèvre et de Nicolaÿ, Mmes Chauvin et F. Gerbaud, MM. Cadec et Vogel, Mmes Canayer, Gruny et Belrhiti, MM. Charon, Laménie, Savary et Meurant, Mme Thomas, M. Hugonet, Mmes Berthet, Demas, Noël et Dumont, MM. Burgoa, Joyandet, Rapin, Brisson, Saury et Pointereau, Mmes Puissat, Imbert, V. Boyer et Joseph et MM. Wattebled et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« …. – Le stationnement sur une aire mentionnée aux 1° et 3° du II de l’article 1er est limité à cinq mois. Ce délai est porté à neuf mois lorsque les résidences mobiles concernées accueillent un ou plusieurs mineurs. En cas de stationnement excédant ce délai, le maire peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II quater du présent article, le maire peut demander au préfet de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.
« …. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain, peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
La parole est à M. Cyril Pellevat.

Le présent amendement a pour objectif de donner aux maires des moyens pour faire respecter les limites de durée de séjour sur les aires d’accueil prévues dans les règlements intérieurs. En effet, ils n’en disposent d’aucun à ce jour.
La limitation à un triple objectif : éviter la sédentarisation des gens du voyage ; permettre à d’autres groupes d’avoir accès aux aires ; permettre aux maires de vérifier régulièrement la sécurité et la salubrité des aires et les remettre en état si besoin.

Cet amendement tend à limiter à cinq mois ou à neuf mois, selon les cas, la durée de stationnement d’une résidence mobile sur une aire d’accueil. Je veux préciser qu’il y a déjà un contexte décrit à l’article 9 de la loi Besson II. L’amendement est donc partiellement satisfait. La problématique qu’il vise relève d’ailleurs plus du niveau réglementaire que du niveau législatif. Je vous propose donc, mon cher collègue, de le retirer, comme en commission ; faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Non, je vais le retirer, monsieur le président, comme nous en étions convenus avec Mme la rapporteure. Cet amendement d’appel avait pour vocation d’ouvrir la discussion sur ces problématiques, au sujet desquelles les élus nous interpellent régulièrement.

L’amendement n° 15 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Wattebled et Henno, Mmes de La Provôté et Sollogoub, M. Canevet, Mmes Billon et Gatel et MM. Le Nay, Maurey, Longeot, Cigolotti et S. Demilly, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 ; ».
La parole est à M. Loïc Hervé.

Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 11 rectifié et 9 rectifié.
Ce sont trois propositions de création d’article reprenant des dispositions déjà votées par le Sénat le 30 octobre 2017.
L’amendement n° 10 rectifié tend à appliquer une peine aggravée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration d’un bien appartenant à autrui lorsqu’elles sont commises au cours d’une installation sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 du code pénal.
L’amendement n° 11 rectifié vise à créer un délit d’occupation habituelle en réunion sans titre d’un terrain.
Enfin, l’amendement n° 9 rectifié a pour objet de permettre l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’occupation en réunion sans titre d’un terrain.

Nous allons quand même les discuter et les voter successivement.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 10 rectifié ?

Cet amendement a effectivement déjà été voté par le Sénat. Avis favorable, bien évidemment.
Je profite de cette intervention pour répondre sur un sujet important sur lequel j’ai été interpellée, à savoir la forfaitisation.
Je reconnais qu’effectivement cette disposition, qui a été adoptée par la représentation nationale, Assemblée nationale et Sénat ensemble, n’est toujours pas mise en œuvre, ce qui n’est pas satisfaisant. Les travaux sont pourtant engagés, mais ils supposent une modification lourde des systèmes d’information pour la perception des amendes. Ce dossier est bien porté par les ministères de l’intérieur et de la justice. Ces adaptations techniques ont démarré pour les amendes liées à l’usage de stupéfiants. Ce sont maintenant les amendes liées à l’occupation illicite des gens du voyage qui sont prévues pour l’automne prochain.
Je voulais juste réaffirmer la volonté du Gouvernement d’appliquer une disposition qui ne nécessite pas de dispositions réglementaires, mais des aménagements techniques assez lourds.
En ce qui concerne les sanctions supplémentaires prévues à l’amendement n° 10 rectifié, je peux entendre la nécessité d’une réponse administrative et judiciaire différente en cas de dégradation dans le cadre d’une occupation illicite, mais la solution juridique retenue ne me paraît pas opérante. Ce point avait d’ailleurs été évoqué lors du débat de 2017. Il vaudrait mieux placer la circonstance aggravante sur l’infraction d’occupation illicite plutôt que sur la dégradation. C’est un avis défavorable en l’état de la rédaction.

Désolé, madame la ministre, mais c’est un peu court. Vous nous dites qu’il aurait fallu faire autrement. Mais que ne déposez-vous un amendement gouvernemental ? On peut être d’accord sur le fait qu’il y a des améliorations à apporter. Ce n’est pas le Sénat qui critique les améliorations de l’Assemblée nationale, bien rares, et celles du Gouvernement, encore plus rares. N’hésitez pas ! Ne soyez pas timide ! Ne restez pas en arrière de la main, madame la ministre ! Proposez ! Nous sommes prêts à accepter.

M. le président. Merci, monsieur Bascher, d’encourager à passer outre cette timidité générale !
Sourires.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Wattebled et Henno, Mmes de La Provôté et Sollogoub, M. Canevet, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Gatel et MM. Le Nay, Maurey, Longeot, Cigolotti et S. Demilly, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un article 322-4-… ainsi rédigé :
« Art. 322-4-…. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322-4-1.
« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article 322-4-1. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable pour des raisons de rédaction juridique, notamment, puisque cet amendement tend à prévoir de l’emprisonnement et une amende supplémentaire lorsque la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires. Or l’article qui fonde ces dernières prévoit qu’elles ne peuvent pas être appliquées plus d’une fois dans une période de vingt-quatre mois. Du coup, juridiquement, je ne peux vraiment pas donner un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Wattebled et Henno, Mmes de La Provôté et Sollogoub, M. Canevet, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Gatel et MM. Le Nay, Maurey, Longeot, Cigolotti et S. Demilly, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article 322-15 du code pénal, avant la référence : « 322-7 », est insérée la référence : « 322-4-1 et ».
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Avis défavorable, ce dispositif m’apparaissant disproportionné. Il accompagne habituellement des infractions qui sont passibles de peines de quinze ans, vingt ans ou trente ans de réclusion criminelle.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Wattebled et Henno, Mmes de La Provôté et Sollogoub, M. Canevet, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Gatel, MM. Le Nay et Maurey, Mme Férat et MM. Longeot, P. Martin, Cigolotti et S. Demilly, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le coût global de la politique d’accueil des gens du voyage sur le territoire national.
La parole est à M. Loïc Hervé.

C’est une demande de rapport. Je sais que le Sénat déteste ce genre d’amendement, mais j’estime qu’il serait nécessaire d’avoir une vision globale du coût de la politique publique d’accueil des gens du voyage, de l’incitation, quand elle a lieu, à la sédentarisation. Beaucoup de collectivités locales, d’EPCI, mais également l’État et les caisses d’allocations familiales interviennent dans ce cadre, donc on a énormément de mal à savoir combien cette politique publique coûte à l’ensemble des comptes publics.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. Mon collègue a pratiquement donné la réponse
Sourires.

Effectivement, la commission des lois n’est absolument pas favorable à ce type de rapport. L’avis est défavorable, comme sur l’amendement qui suit, pour les mêmes raisons. M. Hervé s’en doutait…
Nouveaux sourires.

Avant de le retirer, madame la ministre, j’aimerais bien avoir une réponse. Ces amendements d’appel sont faits, par définition, pour être retirés, et je ne veux pas contrarier Jacqueline Eustache-Brinio maintenant, mais j’y insiste, on a vraiment besoin de ces éléments. On légifère aujourd’hui sur des questions qui sont importantes. Je répète ce que j’ai déjà dit en discussion générale, à savoir que la communauté des gens du voyage compterait de l’ordre de 400 000 personnes, dont deux tiers seraient des nomades : combien cela coûte-t-il aux finances publiques ?
Quand on parle de logement social, on a bien le droit de savoir. En matière de politiques publiques, d’argent public, il y a une exigence de transparence. Aussi, j’aimerais bien que l’on ait des éléments tangibles sur le sujet.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
Nous travaillerons donc à avoir des données plus précises.

L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. L. Hervé, Wattebled et Henno, Mmes de La Provôté et Sollogoub, M. Canevet, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Gatel, M. Le Nay, Mme Férat et MM. Longeot, P. Martin, Cigolotti et S. Demilly, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport donnant un état des lieux sur la scolarisation des enfants des familles itinérantes.
La parole est à M. Loïc Hervé, même si je suppose qu’il va également le retirer, s’agissant, là encore, d’une demande de rapport.
Sourires.

Considérez qu’il est défendu, car j’ai abordé ce sujet en discussion générale. Il porte sur la scolarisation, qui est pour moi le point le plus important. Nous remettrons le sujet sur la table, madame la ministre, lors de la discussion du projet de loi Séparatisme et valeurs de la République. Franchement, je sais que l’on n’a pas le droit de le faire en France, mais il faudrait regarder par catégorie quels sont les enfants qui échappent à l’instruction, qui est quand même obligatoire dans notre pays. Il y a un véritable problème avec la scolarisation des enfants et des adolescents du voyage. C’est très important d’en parler et je ne me priverai pas de le faire lors du débat sur le texte relatif au séparatisme. En attendant, monsieur le président, l’amendement n° 8 rectifié est retiré.
Madame la ministre, j’en profite pour vous remercier de votre réponse circonstanciée sur les amendes forfaitaires délictuelles. C’est un sujet auquel je tiens beaucoup. J’étais d’ailleurs à l’origine de cette proposition, ici, voilà deux ans. Je suis heureux que vous ayez pu confirmer la volonté du Gouvernement d’aller de l’avant à cet égard.
Le troisième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : «, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. » –
Adopté.

L’amendement n° 18, présenté par Mme Eustache-Brinio, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du 3° du I, au 3° du I bis, aux premier, cinquième et avant-dernier alinéas du II et à la deuxième phrase du II bis de l’article 9, et au premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

Je veux tout d’abord, bien sûr, remercier l’ensemble de mes collègues, plus particulièrement Mme la rapporteure et les membres de la commission des lois, qui ont compris l’objectif que l’on s’était fixé dans ce texte. Je veux aussi exprimer mon regret quant à la position du Gouvernement, par votre voix, madame la ministre, car elle ne reflète pas la réalité du terrain.
Que vous n’approuviez pas la totalité des mesures, je peux le comprendre ; que vous rejetiez tout en bloc, je m’en étonne. Cette proposition de loi a été travaillée avec les acteurs de terrain, notamment avec la gendarmerie, les services préfectoraux. Tous ont été associés. Elle se veut pragmatique et concrète. Peut-être serait-il utile, madame la ministre, que vous puissiez entendre ces acteurs de terrain autant que les associations représentant ces communautés. En tout cas, je serai heureux de vous inviter à venir dans le département de l’Ain pour rencontrer l’ensemble des maires concernés par ce sujet. Je suis sûr qu’ils seront disposés à vous apporter toutes les informations que vous souhaitez.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

M. le président. Vous voyez, madame la ministre, vous avez bien fait de venir !
Sourires.
Mêmes mouvements.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 20 janvier 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
De seize heures trente à vingt heure trente :
Ordre du jour réservé au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer le droit à l’avortement (texte n° 23, 2020-2021) ;
Proposition de loi relative aux droits nouveaux dès dix-huit ans, présentée par M. Rémi Cardon, Mme Monique Lubin, M. Rémi Féraud, Mme Sylvie Robert, M. Patrick Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (texte n° 182, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-neuf heures quinze.