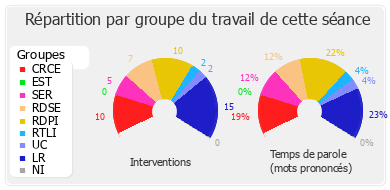Séance en hémicycle du 20 décembre 2011 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidatures à des organismes extraparlementaires
- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Effet du mariage devant le cadi dans les décisions de délivrance des certificats de nationalité française (voir le dossier)
- Conséquences de l'abrogation de la taxe locale d'équipement remplacée par la taxe d'aménagement (voir le dossier)
- Délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité « nutrition-santé-longévité » dans le pas-de-calais (voir le dossier)
- Nomination de membres d'organismes extraparlementaires (voir le dossier)
- Commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Dépôts de rapports du gouvernement
- Conventions internationales (voir le dossier)
- Loi de finances pour 2012 (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Je rappelle au Sénat que, à la suite du renouvellement sénatorial, M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein d’organismes extraparlementaires.
La commission des affaires sociales propose les candidatures de :
- Mme Christiane Kammermann (titulaire), appelée à siéger au sein du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- Mme Colette Giudicelli (titulaire), appelée à siéger au sein du Conseil national du bruit ;
- Mme Marie-Thérèse Bruguière (titulaire), appelée à siéger au sein du Conseil supérieur de la coopération ;
- M. Gérard Roche (titulaire), appelé à siéger au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
- Mme Jacqueline Alquier (titulaire), appelée à siéger au sein du Conseil national de la montagne ;
- M. Jean-François Husson (suppléant), appelé à siéger au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
- Mmes Christiane Demontès et Colette Giudicelli (titulaires), appelées à siéger au sein du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse ;
- M. Yves Daudigny (titulaire), appelé à siéger au sein du comité de surveillance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;
- MM. Gérard Roche et Alain Milon (titulaires), appelés à siéger au sein du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
- Mme Christiane Demontès, M. René Teulade et Mme Isabelle Debré (titulaires), appelés à siéger au sein du Conseil d’orientation des retraites ;
- Mme Muguette Dini (titulaire), appelée à siéger au sein du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ;
- Mme Isabelle Pasquet (titulaire), appelée à siéger au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
- M. Bernard Cazeau et Mme Catherine Génisson (titulaires), appelés à siéger au sein du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ;
- M. Dominique Watrin (titulaire), appelé à siéger au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
- M. Jean-Louis Lorrain (titulaire), appelé à siéger au sein de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
- MM. Jean Desessard (titulaire) et Marc Laménie (suppléant), appelés à siéger au sein du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
- Mmes Catherine Deroche et Michelle Meunier (titulaires), appelées à siéger au sein du Haut conseil de la famille ;
- M. Claude Jeannerot (titulaire), appelé à siéger au sein du Comité d’évaluation de l’impact du revenu de solidarité active (RSA) ;
- M. Hervé Marseille (suppléant), appelé à siéger au sein du Conseil supérieur du travail social ;
- Mme Aline Archimbaud et M. Michel Vergoz (titulaires) et Mme Catherine Procaccia et M. Michel Fontaine (suppléants), appelés à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

J’informe le Sénat que la question orale n° 1448 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat est retirée de l’ordre du jour de la séance du mardi 10 janvier 2012 et remplacée par la question orale n° 1542 du même auteur.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de la question n° 1416, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en avril dernier, déjà, j’avais interpellé M. le ministre de l’éducation nationale au sujet du manque de moyens accordés à la mise en œuvre de l’apprentissage des langues au sein de l’école primaire, moyens qui restent largement insuffisants ou répartis de manière inégale sur le territoire.
Je lui avais alors présenté le cas de l’école primaire Jean-Jacques Rousseau de Talange, exemple typique de la politique menée actuellement. En effet, à partir du cours élémentaire première année, les élèves de cette école, à l’exception de ceux d’une classe de cours moyen première année, qui peuvent bénéficier d’un enseignement de l’allemand, sont dans l’obligation de suivre un cours d’italien, dont l’enseignant est fourni et payé par le consulat d’Italie. Dans un récent courrier, M. l’inspecteur d’académie de Moselle ne dit pas autre chose et confesse même qu’« une parfaite adéquation entre les besoins et l’offre s’avère extrêmement délicate, compte tenu des contraintes techniques et financières auxquelles cette gestion est soumise ».
M. le ministre de l’éducation nationale m’avait à l’époque objecté, pour justifier l’enseignement exclusif de l’italien, que cela correspondait à une forte demande des parents, tout en précisant qu’il se tenait prêt à répondre immédiatement à leur attente si jamais « les enfants et leurs parents souhaitent que l’apprentissage de l’anglais se développe à l’avenir sur ce territoire ».
Depuis la rentrée 2011, force est de constater que les promesses d’avril n’ont pas été tenues en septembre. En effet, comme les années précédentes, les élèves de cours préparatoire des deux écoles primaires de la ville de Talange ne bénéficient toujours pas d’une initiation en langue vivante. En outre, seul l’italien est encore une fois proposé aux élèves de CE1, toujours avec un enseignant fourni et payé par le consulat d’Italie.
Ce statu quo est d’autant plus anormal que, selon un sondage réalisé par la commune de Talange, les parents inscrivant leurs enfants en cours préparatoire à l’école Jean-Jacques Rousseau pour la rentrée 2011 se sont massivement prononcés en faveur de la mise en place d’une initiation à l’anglais dès la classe de CP. Dans son courrier, M. l’inspecteur d’académie feint de ne pas avoir eu connaissance de cette demande afin de mieux repousser la nécessaire évolution vers l’anglais à la rentrée 2012.
Ces manœuvres sont dérisoires et peinent à dissimuler la triste réalité, à savoir l’absence de volontarisme en matière de politique éducative, tout particulièrement pour ce qui est de l’enseignement des langues vivantes étrangères.
Dois-je rappeler à M. le ministre de l’éducation nationale que l’initiation aux langues vivantes étrangères dès l’école primaire constitue pourtant l’un des objectifs principaux de l’enseignement ? Dans le fascicule officiel Mon enfant à l’école CP-CM2, l’un des guides pratiques des parents pour l’année 2011-2012, on insiste d’ailleurs sur l’importance d’une initiation aux langues vivantes dès l’école primaire en précisant clairement, à la page 32, dans le cadre de la section réservée aux programmes détaillés du CP-CE1 : « Dès le cours préparatoire, une première sensibilisation à une langue vivante est conduite à l’oral. Au CE1, l’enseignement d’une langue associe l’oral et l’écrit en privilégiant la compréhension et l’expression orale. »
Dans ces conditions, madame la secrétaire d’État, je demande une nouvelle fois au Gouvernement de m’indiquer quelles mesures il compte adopter afin de remédier à l’inégalité territoriale qui semble s’installer dans l’apprentissage des langues étrangères à l’école primaire. Je souhaite également savoir quelles actions il entend mettre réellement en œuvre pour remplir l’objectif suivant, fixé par le Conseil de l’Europe : chaque bachelier doit être capable de parler et de comprendre au moins deux langues vivantes.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Luc Chatel, que vous interrogez sur l’apprentissage des langues vivantes à l’école primaire, plus précisément sur la situation de l’école Jean-Jacques Rousseau de Talange.
Aujourd’hui, la maîtrise des langues étrangères, notamment de l’anglais, est une nécessité pour les élèves.
C’est pourquoi, comme vous l’avez rappelé, nous avons fixé, en liaison avec le Conseil de l’Europe, un objectif précis : faire en sorte que chaque bachelier soit capable de parler et de comprendre au moins deux langues vivantes.
C’est aussi la raison pour laquelle le ministère de l’éducation nationale a voulu mettre l’accent sur la pratique de l’oral tout au long de la scolarité.
Ainsi, l’enseignement d’une langue est obligatoire dès le CE1, et l’initiation possible au cours préparatoire.
Dans le droit fil de la réforme du lycée, une épreuve orale au baccalauréat en langue vivante 1 a été introduite sous la forme d’un contrôle continu, à parité de coefficient avec l’épreuve écrite, qui demeure une épreuve terminale ponctuelle.
De plus, Luc Chatel a annoncé son ambition de généraliser progressivement l’apprentissage des langues étrangères à partir de trois ans.
Toujours dans la perspective d’un apprentissage moderne, efficace et qui permette une réelle égalité des chances, le ministre a demandé au CNED, le Centre national d’enseignement à distance, de concevoir un service d’apprentissage de l’anglais pour l’ensemble des publics et des niveaux.
Par ailleurs, un comité stratégique des langues, qui réunit des universitaires, des enseignants de terrain et des experts issus d’horizons divers, a été lancé en avril dernier et remettra prochainement au ministre de l’éducation nationale un rapport d’étape.
En ce qui concerne l’école Jean-Jacques Rousseau de Talange, ce sont des raisons historiques qui ont amené l’académie à proposer l’apprentissage de l’allemand et de l’italien.
Alors que le cadre national prévoit l’apprentissage obligatoire d’une langue dès le CE1, les élèves de Talange ont ce petit privilège par rapport aux autres de pouvoir être initiés à une langue vivante dès le cours préparatoire.
M. Jean-Marc Todeschini s’étonne.
Monsieur le sénateur, puisque vous avez évoqué une requête des parents en faveur d’une initiation à l’anglais, je tiens à vous rassurer : il a été demandé à l’inspecteur de circonscription, en liaison avec la directrice de l’école, de porter cette question à l’ordre du jour du prochain conseil d’école, afin d’envisager une évolution progressive vers l’anglais dès la rentrée 2012.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie d’être venue porter la réponse de M. Chatel, mais, après vous avoir écoutée, je crois rêver !
Voilà quelque temps, M. le ministre de l'éducation nationale avait, de façon assez irrespectueuse d’ailleurs, comparé à Babar un candidat à l’élection présidentielle. Aujourd'hui, à la suite de la réponse que vous m’avez lue, il me fait lui-même penser à Pinocchio !
Je vous le dis franchement, sa réponse se veut rassurante, détaillée, mais elle n’est qu’une succession de vœux pieux. La France souhaite développer l’apprentissage des langues, prétend-il ? Aucun effort n’est fait sur le terrain ! Dans ma commune, toutes les écoles sont soumises aux mêmes restrictions, et c’est à un État étranger qu’il revient de financer l’enseignement d’une langue étrangère aux enfants de la République française : trouvez-vous cela normal ?
En outre, 5 700 suppressions de poste viennent d’être annoncées pour la rentrée 2012. Une fois de plus, l’académie de Nancy-Metz va en payer, avec celle de Lille, le plus lourd tribut.
La manière dont est organisé l’apprentissage des langues sur la commune de Talange n’est qu’un exemple parmi d’autres des conséquences dramatiques qu’entraîne la politique de démantèlement de l'éducation nationale menée par le Gouvernement. De nombreuses classes vont fermer à la rentrée prochaine. Lorsque vous me parlez des moyens, je le répète, je crois rêver, d’autant que M. le ministre m’a fait la même réponse au mois d’avril dernier.
À force d’utiliser les enseignants comme variable d’ajustement dans le cadre du budget général et des plans successifs de réduction des finances publiques, je crains qu’un jour nos enfants ne soient amenés à devoir choisir entre l'enseignement des mathématiques et celui du français !
Madame la secrétaire d'État, il est vraiment temps de mettre un terme au démantèlement de l’école de notre République et de redonner à l’enseignement son rôle d’acteur majeur pour construire l’avenir de nos enfants.
Monsieur le sénateur, l’Italie est l’un de nos partenaires privilégiés à l’échelon européen. Ce fut l’un des États pionniers du projet européen, de la construction européenne, l’un des premiers signataires du traité de Paris instituant la CECA et du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne.
En quoi la présence d’enseignants mis à disposition par le consulat d’Italie serait-il un appauvrissement ? Je ne peux pas vous laisser dire cela !

Madame la secrétaire d'État, ne jouez pas à ce jeu avec moi ! Mon père était italien, il est mort italien voilà deux ans, et je suis fier du nom que je porte. Le vrai enjeu, c’est tout simplement l’avenir de nos enfants, à l’heure où le Gouvernement ne veut plus mettre de moyens suffisants dans l’école de la République, cette école qui m’a permis d’être ce que je suis aujourd'hui.

La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 1418, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Je souhaite, madame la secrétaire d'État, revenir sur la question de l’exonération des heures supplémentaires effectuées par des enseignants.
En effet, aux termes de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », plus précisément de son décret d’application du 4 octobre 2007, entrent dans le champ de l’exonération les heures supplémentaires effectuées par les enseignants à la demande des collectivités territoriales, conformément au décret du 19 novembre 1982 relatif en particulier aux études surveillées dans l’enseignement.
Ainsi, l’exonération des charges sociales, CSG et CRDS notamment, est à imputer sur la retenue pour pension puisque l’URSSAF doit, elle, continuer à encaisser les montants dus.
Sur le principe, il est donc demandé aux collectivités territoriales d’avancer ces sommes, qui doivent leur être remboursées chaque trimestre, à compter de l’exercice 2010 – nous sommes tout de même à la fin de 2011 ! –, par le ministère de l’éducation nationale, sur présentation des états justificatifs.
Pour l’heure, fin 2011, il semblerait que ni les inspections d’académie ni les rectorats n’aient encore reçu d’instruction en ce sens de la part du ministère.
Interrogé sur ce même sujet lors d’une séance de questions orales le 21 décembre 2010, le Gouvernement m’avait indiqué, par la voix de Mme la ministre chargée de l’outre-mer, que le ministre de l’éducation nationale avait « récemment saisi le ministre en charge du budget afin que soit déterminée, en lien avec le ministre chargé des collectivités territoriales, la procédure budgétaire selon laquelle les collectivités seront remboursées, le cas échéant, du surcoût lié aux réductions de cotisations décidées dans le cadre de la loi TEPA ».
Une année après et malgré plusieurs relances, force m’est de constater que je n’ai toujours pas obtenu de réponse satisfaisante à cette question.
Je vous demande donc, madame la secrétaire d'État, en espérant ne pas avoir à y revenir dans les mois prochains, de bien vouloir me faire part des avancées sur ce dossier et, si possible, des conditions de son règlement définitif.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Luc Chatel, qui ne peut être présent au Sénat ce matin.
Vous attirez l’attention du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l’exonération des heures supplémentaires versées aux enseignants et effectuées à la demande des collectivités territoriales.
La loi dite « TEPA » du 21 août 2007 a permis de libérer les initiatives en récompensant le travail. Elle a ainsi assuré une augmentation des revenus de nombreux salariés, notamment des enseignants. Ces derniers sont en effet les premiers bénéficiaires du dispositif prévu par la loi précitée puisqu’ils réalisent environ 34 millions d’heures supplémentaires chaque année. Cela représente, pour les enseignants qui font le choix de travailler plus, un complément de traitement de 6 à 8 % d’autant plus appréciable qu’il est défiscalisé, comme le prévoit l’article 1er de la loi.
Il résulte de ce mécanisme une charge budgétaire supplémentaire pour l’employeur qui s’acquitte des cotisations sociales, le circuit de compensation étant déterminé selon les cas.
Votre question aborde le cas particulier des heures supplémentaires effectuées par les enseignants à la demande des collectivités territoriales et payées par ces dernières. Cela concerne principalement les enseignants du premier degré, qui assurent des heures de soutien scolaire à la demande des collectivités territoriales.
En l’espèce, les collectivités sont l’employeur secondaire des enseignants concernés. Elles assurent, sur leur propre budget, le versement direct des indemnités à ces agents. Dans cette situation, les services de l’éducation nationale n’interviennent en aucune façon, ni dans la constatation ni dans le paiement de ces heures supplémentaires.
Le ministre en charge du budget a toutefois été saisi afin que soit déterminé qui prend en charge le surcoût lié aux réductions de cotisations.
Il semble, monsieur le sénateur, qu’il revient à l’État d’assumer in fine le surcoût supporté par l’employeur, c’est-à-dire par les collectivités locales. Toutefois, dans un tel cas, il reste à déterminer le circuit précis pour assurer le remboursement de ce surcoût. En effet, les seuls services de l’éducation nationale n’ont ni la vocation ni les moyens de traiter les milliers de demandes de remboursements qui afflueraient des communes. Ils ont encore moins les ressources budgétaires pour assurer ces remboursements.
Il convient de préciser comment est assuré le contrôle des demandes de remboursements.
Il faut également déterminer les conditions garantissant la légalité de toutes les demandes, sans pour autant empiéter sur le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Tout cela exige une analyse fine et subtile, qui sera sans doute relativement longue. Mais soyez assuré, monsieur le sénateur, que le ministère de l’éducation nationale sera particulièrement attentif à trouver une solution adaptée aux besoins que vous avez soulevés dans votre question.

Madame la secrétaire d’État, je ne vous en veux pas, car ce n’est pas vous qui avez préparé cette réponse. Mais on me répond exactement la même chose qu’il y a un an !
Je suis d’accord sur le fait qu’une analyse particulièrement fine de la situation et des circuits à utiliser est nécessaire. Mais cette mesure est en œuvre depuis plusieurs années, et les collectivités avancent donc depuis des années des sommes qu’elles ne doivent pas ! Il y a quand même un problème !
Faut-il que les collectivités locales, appliquant la loi de manière plus rigoureuse que ne le fait son auteur, c’est-à-dire l’État, ne fassent pas d’avance ? Vous entendrez alors l’URSSAF vous dire qu’elle ne s’y retrouve pas et les enseignants protester que le compte n’y est pas !
S’il faut que les collectivités locales déduisent elles-mêmes de leurs cotisations à l’URSSAF la CSG et la CRDS – et je crois qu’il va falloir en passer par là ! –, cela provoquera pour le coup la pagaille à Bercy et au ministère de l’éducation nationale ! Mais les deux ministres concernés régleront cela entre eux !
Mais on peut aussi attendre les prochaines élections et l’abrogation de la loi TEPA, ce qui réglerait ainsi le problème de fait… Toujours est-il que cette situation me paraît assez ubuesque !

La parole est à Mme Renée Nicoux, auteur de la question n° 1446, adressée à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation.

Monsieur le secrétaire d’État, je tiens à attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par le pays sud creusois face aux déficiences du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC.
Comme vous le savez, le FISAC contribue grandement à l’amélioration et au maintien d’activités sur les territoires. Il a notamment pour objectif de répondre « aux menaces pesant sur l’existence de l’offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales ».
Cependant, il apparaît que ce fonds connaît aujourd’hui de graves dysfonctionnements qui nuisent à l’activité économique de certains territoires en mettant en péril de très nombreuses entreprises.
En effet, depuis 2009, le pays sud creusois s’est imposé comme l’un des premiers territoires limousins à s’inscrire dans une nouvelle démarche collective territorialisée, en faveur du commerce, de l’artisanat et des services.
Cette démarche, qui bénéficie des financements de l’État, de la région Limousin et du département de la Creuse, se décompose en trois tranches opérationnelles, lesquelles courent de février 2010 à juillet 2012. Annuellement, le pays sollicite l’État, à travers le FISAC, pour cette opération.
Or le pays sud creusois est aujourd’hui confronté à une difficulté administrative et financière qui bloque totalement cette démarche.
Par courrier en date du 30 juillet 2010, les services de la préfecture de région accusaient réception de la demande de subvention FISAC du pays pour la deuxième année de son dispositif, soit du 1er août 2010 au 31 juillet 2011.
Selon la procédure, le pays sud creusois aurait dû, ensuite, recevoir une notification ministérielle confirmant l’intervention du FISAC, ceci ayant été garanti par le rapport d’instruction favorable du représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ou DIRECCTE, du Limousin.
Pourtant, à ce jour, le pays n’a toujours pas reçu des services de l’État la notification de la deuxième année de cette opération, alors même qu’il est déjà engagé sur la troisième année du dispositif. C’est pourtant précisément cette notification qui permet de libérer les crédits FISAC et d’honorer les engagements pris à l’égard des entreprises.
Dans un premier temps, et afin de ne pas pénaliser les entreprises de son territoire, le pays sud creusois a décidé d’avancer lui-même les subventions FISAC. Or, il n’est plus aujourd’hui en mesure de le faire, et il a donc dû, dans un souci d’équilibre budgétaire, suspendre le versement de ces fonds.
De nombreuses entreprises ont ainsi été plongées dans la plus grande des incertitudes ; certaines, ayant construit leur plan de financement en fonction de la notification d’aide de l’État à laquelle elles avaient droit, se sont même trouvées dans les plus grandes difficultés.
Monsieur le secrétaire d’État, comment le Gouvernement justifie-t-il un tel dysfonctionnement des services de l’État et quelles décisions compte-t-il prendre pour que les notifications confirmant l’intervention du FISAC parviennent dans des délais compatibles avec le dispositif, et ce afin d’améliorer la réactivité de celui-ci et de rendre possible la liquidation rapide des paiements aux entreprises.
Madame la sénatrice, je dirai d’emblée que l’un et l’autre sommes très attachés à cet outil qu’est le FISAC. Nous en avons longuement discuté hier devant de nombreux artisans de la Creuse, à l’occasion de mon déplacement dans ce département.
Étant sur le terrain trois fois par semaine, je constate à quel point les opérations FISAC bien menées contribuent efficacement à dynamiser le tissu économique local. Et je dois vous faire un aveu : alors que je gère depuis un peu plus d’un an le FISAC, outil utilisé par des collectivités de gauche comme de droite, vous êtes la première personne – et je dis bien « la première personne » ! – que j’entends réagir de la sorte et parler de « dysfonctionnements ».
Je vais donc essayer de vous expliquer comment les choses fonctionnent, car, visiblement, c’est à cet égard que l’information fait défaut dans le débat.
Depuis un an, j’ai tenu à réformer le FISAC pour renforcer son efficacité : son soutien au commerce de proximité ou aux artisans de proximité est ainsi passé de 70 % à 88 %. Une étude fine de l’ensemble des dossiers est nécessaire compte tenu de la tendance de certains à vouloir monter des dossiers d’opérations de restructuration de l’artisanat et du commerce, ou ORAC, en faisant financer par le FISAC des dispositifs n’allant pas directement vers les commerçants et les artisans. Or, c’est de l’argent public, l’argent des impôts des Français, et il est donc indispensable de procéder à une évaluation des actions menées.
En novembre 2010, j’ai alloué au pays sud creusois une subvention FISAC d’un montant de 51 471 euros, dont 25 475 euros ont été versés dès le 3 janvier 2011 à titre d’avance. Le solde sera naturellement versé après présentation du bilan de cette première tranche.
Ce montant s’ajoute aux 216 379 euros accordés à 159 entreprises du département de la Creuse depuis juillet 2010 dans le cadre des démarches collectives territorialisées, ou DCT, financées par le FISAC.
Au total, ce sont plus de 620 000 euros de décisions FISAC que j’ai signées en 2010 et en 2011 au profit des acteurs locaux creusois. La Creuse fait donc partie des départements dans lesquels le FISAC – et, à travers lui, l’État – agit aux côtés des acteurs économiques.
Les fonds publics sont précieux, et notre pratique n’a jamais été – et ne sera jamais ! – celle du guichet ouvert. L’utilisation des dotations FISAC obéit à un impératif d’efficacité en finançant en priorité les actions les plus innovantes et non répétitives, qui ont un impact réel sur les activités commerciales, artisanales et de services.
La demande de subvention présentée par le pays sud creusois pour le financement de la deuxième tranche de sa démarche collective territorialisée a été instruite par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, seule compétente pour cette question. La décision quant à la subvention attribuée sera notifiée – je l’ai d’ailleurs redit hier –aux porteurs du projet dans les tout prochains jours puisque cela doit être fait avant le 31 décembre.
Quant à la troisième tranche, vous comprendrez qu’une saine gestion des finances publiques implique que soit réalisé le bilan des actions précédentes avant toute décision. Et contrairement à ce que vous semblez penser, rien n’est acquis à cet égard. Un bilan sera donc effectué pour le pays sud creusois comme cela se fait pour toutes les opérations FISAC, sur tout le territoire.
Avec 620 000 euros de dotations en deux ans, le pays sud creusois, comme le département de la Creuse et tous les territoires, n’est pas oublié par le FISAC ! Contrairement à ce que vous prétendez, il n’est pas victime d’une « difficulté administrative et financière » ! Il se situe dans un système de bonne gestion, qui doit vérifier que ceux qui bénéficient du dispositif sont bien les commerçants et les artisans. En effet, le FISAC doit servir à ces derniers, et non, comme certains le pensent parfois, à financer telle ou telle structure ou tel ou tel investissement qui ne profite pas directement aux commerçants et aux artisans de ce pays.

Monsieur le secrétaire d’État, je ne suis pas totalement satisfaite par votre réponse.
Vous m’apportez une bonne nouvelle en me disant que 51 000 euros ont été mandatés fin novembre, même si, comme je vous l’ai indiqué hier lors de notre rencontre, ils ne figurent toujours pas sur le compte du pays sud creusois. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ne sont pas dans le circuit.
Vous indiquez que les démarches collectives territorialisées doivent bénéficier directement au commerce ou à l’artisanat. C’est précisément l’objet de la DCT du pays sud creusois, qui vise à soutenir les actions innovantes dans ce domaine. Ces crédits sont gérés au sein d’un comité technique qui se réunit régulièrement et dans lequel siègent les représentants des financeurs, qu’il s’agisse de l’État, du département, de la région.
Ce mode de gestion, je puis vous l’assurer, est tout à fait réglementaire et respecte les directives du FISAC. Je peux donc vous rassurer de ce point de vue : les crédits du FISAC ne sont pas détournés en vue de financer des aménagements ne bénéficiant pas directement au commerce et à l’artisanat ; c’est d’ailleurs tout à fait normal. Je le répète, la gestion de ces crédits est bonne.
Mais je rappelle – et je m’étonne d’être la seule personne à vous poser la question, car je suis également la porte-parole d’autres pays du Limousin confrontés au même problème – que la notification ministérielle confirmant l’intervention du FISAC n’est pas parvenue dans les territoires, ce qui bloque le versement par l’État des avances qui permettraient de faire fonctionner dans de bonnes conditions ce dispositif d’aide à l’artisanat et au commerce.
Les dossiers étant bloqués au niveau du comité de pilotage, le pays sud creusois a bien voulu se substituer à l’État pendant un an en procédant à cette avance ; compte tenu de l’état de ses ressources, il ne lui est plus possible de continuer. Les 51 471 euros que vous annoncez, monsieur le secrétaire d’État, ne correspondent, hélas ! qu’à l’acompte de la deuxième année de l’opération, alors que celle-ci s’achève et que nous entamons la troisième année, le bilan des actions ne devant intervenir qu’à la fin de cette dernière.

La parole est à M. Claude Léonard, auteur de la question n° 1463, adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le prêt viager hypothécaire, introduit dans notre droit en 2006, est une forme de crédit qui s’inspire du droit anglo-saxon et permet à un ou plusieurs emprunteurs âgés, propriétaires de leur logement, de convertir leur capital immobilier en liquidités. Il représente souvent pour eux le seul moyen d’accéder à l’emprunt.
La banque leur propose un prêt garanti par la prise d’une hypothèque sur un bien immobilier à usage exclusif d’habitation : ce prêt porte intérêts qui se cumulent au fil des années. Le capital et les intérêts ne sont remboursés qu’au décès du ou des emprunteurs, le principe étant que la banque se rembourse en procédant à la vente du bien immobilier.
Ce système présente un avantage : des personnes âgées, propriétaires de leur résidence principale, qui ont besoin de liquidités pour une raison ou une autre, peuvent bénéficier d’un emprunt dont ils ne remboursent aucune échéance.
Mais comme souvent, cette belle médaille a également son revers. En l’occurrence, ce prêt viager hypothécaire a un coût non négligeable : une publicité récente du Crédit foncier de France, qui distribue ce type de produit, vient le confirmer : pour un prêt viager hypothécaire de 57 600 euros, la valeur du bien immobilier apporté en garantie étant de 320 000 euros, le coût global du crédit sera de 262 265 euros et le taux effectif global de 9, 30 %. En d’autres termes, les emprunteurs, ou leurs héritiers, rembourseront à l’issue d’une période de vingt ans près de cinq fois la somme empruntée, ce qui semble tout de même excessif.
En comparaison, si un prêt in fine pouvait leur être accordé sur une période de vingt ans, avec le même taux d’intérêt de 9, 30 %, la même garantie hypothécaire et les mêmes frais, le coût global du crédit ne serait que de 164 720 euros, soit le capital de 57 600 euros, augmenté des intérêts, c’est-à-dire 446, 33 euros mensuels multipliés par 240 mois, soit 107 120 euros. On est très loin des 262 265 euros du prêt viager hypothécaire ! En effet, dans le cas du prêt in fine, le capital restant sera de 262 400 euros, les intérêts ayant été payés. Avec le prêt viager hypothécaire, en revanche, il ne restera que 57 735 euros, les intérêts s’étant cumulés et ayant eux-mêmes produit des intérêts.
Je sais qu’en l’état actuel cette dernière solution se heurterait à un problème d’assurance. C’est d’ailleurs étonnant car, avec une garantie hypothécaire et la mise à disposition d’un capital ne représentant qu’une faible partie du bien hypothéqué, la banque ne court aucun risque.
Quoi qu’il en soit, le prêt viager hypothécaire constitue une solution lorsque d’autres ne sont plus possibles. Il conviendrait cependant de le rendre moins onéreux pour les emprunteurs ou leurs héritiers. Je compte sur le Gouvernement pour œuvrer en ce sens.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. François Baroin qui, ne pouvant être présent ce matin au Sénat, m’a confié le soin de vous répondre.
Vous m’interrogez sur le coût des prêts viagers hypothécaires. J’attire tout d’abord votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un produit très spécifique, pour lequel le prêteur supporte, malgré tout, un risque plus élevé que pour les prêts classiques.
Ce prêt permet aux seniors de bénéficier de versements périodiques pour financer leurs dépenses de consommation, et ce jusqu’à leur décès. Son mode de fonctionnement engendre des risques spécifiques, plus élevés que pour un crédit hypothécaire « classique ».
Tout d’abord, la dette s’accroît au cours du temps, puisque le remboursement se fait in fine, ce qui introduit un risque spécifique de longévité : si l’emprunteur vit très longtemps, la dette peut s’accroître au-delà de la valeur du bien hypothéqué. Or, vous le savez, l’espérance de vie augmente chaque année.
De plus, pendant ce délai où la dette s’accroît, l’évolution du marché immobilier présente un risque. Cela n’a pas manqué de peser sur le développement de ce produit, puisque son lancement est intervenu peu de temps avant une période marquée, comme vous le savez, par une incertitude forte pesant sur la valeur des biens immobiliers, voire par des baisses dans certaines régions.
On peut s’interroger sur les mesures qui seraient susceptibles de faciliter la diffusion du prêt viager hypothécaire, et donc de diminuer son prix. Lors de sa création, il a été décidé d’en interdire le démarchage. C’est un frein significatif à son développement, puisque les seniors sont généralement moins mobiles que les autres consommateurs. C’est également un frein à une concurrence plus forte. C’est aussi néanmoins, pour ce public fragile, une protection importante contre les abus. Aussi, le Gouvernement estime qu’il n’est pas souhaitable, à ce stade, de lever les garde-fous prévus par la loi.
Enfin, au-delà des prêts viagers hypothécaires, l’accès au crédit des seniors progresse. Les statistiques de l’Observatoire des crédits aux ménages montrent que les ménages de seniors représentent une part croissante du nombre total de ménages ayant accès au crédit à la consommation : les 55-64 ans représentaient ainsi 16 % des ménages endettés en 2010, contre 13, 4 % en 1989.

La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 1469, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question concerne le droit de la nationalité.
À l’occasion de trois arrêts du 6 juillet 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé que la célébration des mariages respectifs d’un père et d’un fils devant un cadi, c’est-à-dire une autorité religieuse, et non devant un officier d’état civil, était sans incidence sur la transmission de ce statut de droit commun, et donc de la nationalité française, à leurs enfants, et que, en l’absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d’une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut. Ces arrêts faisaient suite à une jurisprudence de cette même chambre du 8 juillet 2010, selon laquelle la filiation est établie dès lors que la désignation de la mère en cette qualité dans l’acte de naissance est suffisante pour établir la filiation maternelle.
M. le garde des sceaux a-t-il bien pris acte de ces arrêts de la Cour de cassation, qui tendent à rappeler des principes fondamentaux en matière de dévolution de la nationalité française, et en a-t-il informé les greffes des tribunaux d’instance ? Nous sommes en effet saisis de cas assez nombreux dans lesquels le greffe du tribunal d’instance refuse de délivrer les certificats de nationalité française au motif que les ascendants des demandeurs ont été mariés religieusement devant le cadi.
Je tiens également à rappeler que, jusqu’en 1960 ou 1962, le mariage devant le cadi était reconnu dans une partie du territoire français.
J’ai écrit à ce sujet à M. le garde des sceaux, mais n’ai pas obtenu de réponse. Voilà pourquoi j’ai souhaité poser cette question aujourd’hui.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Michel Mercier, qui, ne pouvant être présent au Sénat ce matin, m’a confié le soin de vous répondre.
Vous interrogez le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la suite réservée aux arrêts que la Cour de cassation a rendus le 6 juillet 2011 sur les conditions de conservation et de transmission du statut de droit commun aux descendants d’une personne admise en Algérie à la qualité de citoyen français par décret ou par jugement.
À la suite de l’indépendance de l’Algérie, les personnes, selon qu’elles relevaient du statut de droit commun ou du droit local, ont perdu ou au contraire conservé la nationalité française.
S’est posée en jurisprudence la question des conditions exigées pour permettre aux descendants d’une personne admise à la qualité de citoyen français de revendiquer le bénéfice accordé aux personnes de statut de droit commun et d’accéder ainsi à la nationalité française. Fallait-il exiger que cette personne ait eu un comportement présumant son adhésion au statut civil de droit commun, et donc exclure les filiations résultant de mariages célébrés devant les cadis, ou suffisait-il aux descendants d’apporter la preuve d’une chaîne de filiations ininterrompue avec cet ascendant ?
S’appuyant sur la jurisprudence majoritaire en ce sens, il était soutenu, notamment par le ministère de la justice et des libertés, que les mariages cadiaux établissaient la preuve que les personnes avaient en réalité fait le choix de renoncer à leur statut civil de droit commun.
Ainsi, le fait d’avoir un ascendant relevant du statut de droit commun marié par un cadi rompait cette chaîne de filiations, faute de pouvoir produire un acte de mariage dressé par un officier de l’état civil seul habilité à célébrer les mariages. En conséquence, le descendant de l’admis n’étant pas considéré comme ayant conservé la nationalité française, un certificat de nationalité française ne pouvait lui être délivré.
Toutefois, certaines juridictions ont adopté une position différente, consacrée par la Cour de cassation dans les arrêts du 6 juillet dernier que vous avez évoqués. La haute juridiction considère en effet que le mariage cadial ne fait pas perdre le statut civil de droit commun à son bénéficiaire et qu’il est sans incidence sur la transmission du statut de droit commun aux descendants de l’intéressé.
Prenant acte de ce revirement, les greffiers en chef et les services de la Chancellerie tirent les conséquences de cette jurisprudence récente dans les procédures de délivrance de certificats de nationalité. Vous pouvez donc être rassuré à cet égard, monsieur le sénateur.

Évidemment, le garde des sceaux ne peut que prendre acte des arrêts de la Cour de cassation. C’est le minimum dans un état de droit !
Vous n’avez pas vraiment répondu à ma question, monsieur le secrétaire d’État. Je vous ai en effet demandé si le garde des sceaux avait informé de cette jurisprudence les greffiers des tribunaux d’instance.
Dans la réalité, en dépit de ces arrêts de la Cour de cassation, les greffiers perpétuent leurs anciennes pratiques, peut-être par ignorance de cette nouvelle jurisprudence, et continuent à refuser de délivrer les certificats de nationalité française en se fondant sur une certaine interprétation, que vous avez évoquée, de la rupture du statut de droit commun.
Transmettez des exemples précis au garde des sceaux !

Il me semblerait opportun que le garde des sceaux rappelle cette nouvelle jurisprudence aux greffiers des tribunaux d’instance. En attendant, ma question reste sans réponse.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, auteur de la question n° 1445, adressée à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 a modifié la fiscalité de l’aménagement en abrogeant la taxe locale d’équipement et en la remplaçant par une taxe d’aménagement.
Si l’on peut louer la volonté de simplification de la fiscalité – elle est cependant toute relative – dont cette réforme constitue une première étape, certains éléments demeurent néanmoins incompréhensibles pour les élus locaux.
La modification de l’assiette de calcul de la taxe demeurera difficilement vérifiable lors des contrôles, tant les points relatifs à la construction à prendre en compte restent nombreux et conditionnés.
Plus grave encore, l’exonération totale de la taxe pour les constructions effectuées sur des terrains situés en zone d’aménagement concerté, ou ZAC, et, depuis cette réforme, dans le périmètre d’opérations d’intérêt national constitue une véritable anomalie.
Je ne prendrai qu’un seul exemple, celui de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et cela ne vous étonnera pas, monsieur le secrétaire d'État. Dans cette commune, la quasi-totalité des terrains étant constitués en ZAC, toutes les opérations se trouvent de fait exonérées de droit de taxe au bénéfice, hélas ! des promoteurs qui, dans cette zone, tirent les prix vers le haut, ce que chacun sait.
Il semble paradoxal que, dans des communes, certains habitants du bourg étendant leur habitation située hors ZAC soient assujettis à la taxe, alors que ceux dont la résidence est établie quelques mètres plus loin en soient, eux, exonérés.
Cette réforme de la fiscalité de l’aménagement engendre des situations incompréhensibles. De plus, elle semble privilégier certaines opérations réalisées par des promoteurs immobiliers.
Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement envisage-t-il d’évaluer l’impact de cette réforme afin de procéder à un éventuel réajustement ?
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Philippe Richert.
La taxe d’aménagement que vous venez d’évoquer a été créée par la loi du 29 décembre 2010 en vue de simplifier le système existant, qui était devenu, reconnaissez-le, complexe et hétérogène.
L’assiette de cette taxe a notamment été simplifiée : la « surface hors œuvre nette », ou SHON, a été abandonnée au profit du principe d’une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface de construction.
J’en viens à la question que vous avez soulevée. Les exonérations applicables en matière de taxe locale d’équipement ont été reprises pour ce qui concerne la taxe d’aménagement.
Par ailleurs, les exonérations relatives aux constructions en zones d’aménagement concerté ont été étendues aux opérations d’intérêt national, puisque le principe, qui est bon, est le même : il s’agit de ne pas faire payer à deux reprises le coût des équipements publics, une première fois par le biais de la charge foncière et une seconde par l’intermédiaire de la taxe d’aménagement.
Le Gouvernement a pris note des questions que vous soulevez. Cette réforme n’étant applicable qu’à partir de 2012, il n’est pas encore envisageable de procéder à son évaluation. Le Gouvernement a néanmoins demandé la plus grande vigilance sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre qui pourraient être soulevées dans le cadre de cette réforme, afin, si cela s’avérait nécessaire, de procéder après évaluation à des ajustements ultérieurs.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, auteur de la question n° 1443, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais attirer l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur les conséquences particulièrement préjudiciables de l’interdiction imposée à toutes les sociétés qui emploient du personnel saisonnier, notamment les sociétés de propreté, d’établir des avenants temporaires au contrat de travail de leurs employés.
Ces sociétés sont confrontées à une répartition du travail très différenciée selon les mois de l’année. Ainsi, par exemple, certains saisonniers employés au début de la saison estivale voient leur activité croître à partir du mois de mai et atteindre un sommet au mois d’août, avant de « retomber » aux mois de septembre et d’octobre. L’interdiction de principe susvisée est donc mal adaptée aux pratiques de certains secteurs.
La proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoyait initialement l’augmentation temporaire de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif définissant les conditions de ces modifications temporaires, plus particulièrement les cas de recours et les garanties apportées aux salariés sur les dates et les modalités de retour aux conditions initiales de travail.
In fine, ce dispositif n’a pas été retenu et les débats à l’Assemblée nationale qui se sont déroulés au mois d’octobre dernier n’ont pas fait évoluer la situation. Il est bien apparu à cette occasion qu’il existe une confusion entre heures complémentaires et avenant temporaire.
Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'État, d’insister sur un point. Dans un arrêt du 7 décembre 2010, actuellement applicable, la Cour de cassation a considéré que toutes les heures effectuées par un salarié travaillant à temps partiel au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat sont des heures complémentaires majorées à 25 %. La pratique des avenants temporaires est donc plus que risquée et peut faire encourir des sanctions pénales.
Compte tenu de l’effet négatif sur les emplois, j’aimerais que le Gouvernement me précise comment ce dispositif conventionnel peut être préservé et légalisé, afin d’éviter que l’employeur ne préfère le recours à des emplois précaires.
Madame le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Xavier Bertrand, actuellement en déplacement en Ardèche avec le Président de la République.
Vous évoquez la possibilité pour les entreprises employant du personnel à temps partiel d’établir des avenants au contrat de travail modifiant temporairement le temps de travail de leurs salariés, notamment dans le secteur de la propreté.
Comme vous, le Gouvernement est particulièrement attentif au développement de ce secteur, qui contribue à créer de nombreux emplois. L’enjeu de la professionnalisation des activités en cause est essentiel, afin d’assurer une réelle reconnaissance de ces emplois trop souvent dévalorisés. La qualité des emplois proposés dans ce secteur, occupés majoritairement par des femmes, est une problématique importante : limiter le recours aux horaires décalés, réduire les interruptions au cours d’une même journée de travail sont autant d’axes primordiaux, que le Gouvernement entend développer.
S’agissant de la question plus spécifique des avenants temporaires au contrat de travail, qui permettent une augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel, il convient de trouver un équilibre entre la nécessaire adaptabilité de l’organisation du travail au sein de l’entreprise et les garanties offertes aux salariés, afin, notamment, que ceux-ci puissent concilier vie professionnelle et vie familiale.
On ne peut pas dire que le recours à de tels avenants soit aujourd’hui prohibé : la signature de ce type de document en vue d’augmenter la durée contractuelle de travail est déjà possible.
En revanche, une difficulté peut apparaître lorsque la multiplication des avenants successifs au contrat de travail induit un contournement, voire un détournement de la réglementation du travail à temps partiel, en particulier des règles de majoration des heures complémentaires. Il y a là un enjeu important en termes de pouvoir d’achat pour ces salariés, dont les rémunérations sont le plus souvent faibles. C’est sur ce terrain que la jurisprudence a été amenée à encadrer les conditions de recours aux avenants temporaires.
Sous cette réserve, comme Xavier Bertrand l’a indiqué lors du débat sur la « proposition de loi Cherpion », le Gouvernement est favorable au principe d’un dispositif conventionnel, négocié par les partenaires sociaux dans l’entreprise ou dans la branche, encadrant le recours à des avenants temporaires qui fixeraient les garanties apportées aux salariés.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, de nature à faire avancer les choses, et qui me convient parfaitement.
Je tiens cependant à formuler deux remarques.
La convention collective nationale des entreprises de propreté est aujourd'hui probablement la seule convention collective susceptible d’autoriser le recours à des avenants temporaires au contrat de travail. Il convient de laisser les partenaires sociaux négocier sur cette piste intéressante.
Par ailleurs, j’y insiste, il serait absurde que l’emploi de salariés ayant signé un contrat à durée déterminée soit moins onéreux que celui de salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel dont le nombre d’heures mensuel a été augmenté à titre temporaire. Une telle aberration serait, selon moi, contraire aux efforts réalisés par les entreprises pour limiter le recours au travail à temps partiel.
Je le répète, la réponse que vient de m’apporter M. le secrétaire d’État me satisfait pleinement, et je l’en remercie de nouveau.

La parole est à Mme Laurence Cohen, auteur de la question n° 1483, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur la réforme en cours de la formation initiale des orthophonistes.
Je pense qu’il ne vous a pas échappé qu’une certaine inquiétude, pour ne pas dire une grande colère, est ressentie par l’ensemble des professionnels.
La profession a obtenu son statut légal par la loi du 10 juillet 1964, qui a institué un diplôme national : le certificat de capacité d’orthophoniste.
Aujourd’hui, la France compte près de 20 000 orthophonistes. Cette profession n’a cessé d’évoluer pour mieux prendre en charge les différentes pathologies dont souffrent les enfants et les adultes dans le domaine du langage et de se complexifier en même temps que la société.
Depuis 1986, la formation initiale se déroule en quatre ans. Depuis deux ans, au sein des deux ministères de tutelle, à savoir le ministère du travail, de l’emploi et de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, une réforme est en cours pour faire reconnaître un niveau d’études sur cinq ans, correspondant à la délivrance d’un master 2, afin que ces professionnels puissent être davantage en adéquation avec les avancées scientifiques.
Or, contrairement aux revendications légitimes et unanimes des étudiants et des professionnels, le 28 octobre dernier, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez ont annoncé la reconnaissance de leur formation au niveau d’un master 1 et la création d’un métier d’orthophoniste praticien accessible par la poursuite des études en master 2. C’est un non-sens absolu !
Premièrement, de façon tout à fait légitime, ces praticiens font valoir qu’un master 1 ne correspond à aucun grade universitaire, puisque les études supérieures relèvent à présent du système 3-5-8, qui correspond aux niveaux de licence, master et doctorat.
Deuxièmement, la création de deux niveaux va instaurer une scission dans la profession, une hiérarchisation, une orthophonie à deux vitesses, une réduction de fait du champ des compétences d’un certain nombre de ces professionnels.
Comme je l’ai déjà indiqué, les orthophonistes prennent en charge au quotidien des pathologies extrêmement variées et complexes, telles que la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie, l’autisme, la surdité, entre autres, ainsi que des troubles du raisonnement logico-mathématique. Or peut-on classifier les troubles qui nécessiteraient moins de compétences tout en assurant une prise en charge de qualité ?
Dans un contexte de tension démographique et de difficultés d’accès aux soins, l’hyperspécialisation de quelques professionnels ne pourra répondre à la demande croissante de la population, de plus en plus concernée par les troubles de la voix, de la parole, du langage et de la communication. La réforme que souhaite appliquer M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, sous couvert du silence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, ne respecte pas la méthodologie et la définition du métier validé dans le référentiel de compétences.
Au regard de tous ces éléments, comment le Gouvernement entend-il répondre à présent aux désaccords et inquiétudes exprimés par toute la profession ? Quelles garanties compte-t-il lui apporter pour en préserver l’unicité et pour reconnaître le grade de master pour toutes et tous ?
Vous l’aurez compris, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il s’agit non pas de corporatisme, mais d’une question de santé publique, de prévention et de qualité des soins dispensés à de nombreux citoyens et citoyennes. Les orthophonistes sont mobilisés et déterminés à se faire entendre pour eux et leurs patients.
Madame Cohen, le métier d’orthophoniste est particulièrement essentiel pour la société, notamment pour nombre de jeunes. En ma qualité de secrétaire d’État chargé des professions libérales, j’ai eu l’occasion de mesurer le malaise ressenti par de nombreux professionnels, malaise que vous venez d’évoquer. Ce sujet relève de la compétence du ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
M. Bertrand, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence ce matin au Sénat, m’a chargé de vous répondre. Il a la volonté – j’ai pu m’en rendre compte lorsque je lui ai fait part, ainsi qu’à son cabinet, d’un certain nombre d’inquiétudes – de faire avancer le dossier, en association avec les professionnels.
Depuis 2007, le Gouvernement rénove en profondeur les formations paramédicales, pour les mettre au niveau des standards européens. La formation d’orthophoniste bénéficie de cette réforme tout à fait inédite.
Contrairement à ce qui est parfois avancé, la rénovation des formations ne vise pas à allonger les études, qui sont déjà très longues dans notre pays.
La formation actuelle des orthophonistes compte moins de 2 500 heures, stages inclus, étendues sur quatre années, alors que les autres formations approchent, voire dépassent bien souvent, les 4 000 heures.
Concrètement, cette réforme prévoit que la formation des orthophonistes sera enrichie et valorisée au niveau master 1, soit un potentiel de plus de 6 000 heures de formation, travail personnel inclus.
Cela constitue donc, dans l’esprit de Xavier Bertrand, un moyen de mieux valoriser le métier d’orthophoniste, en offrant aux praticiens, grâce à une formation plus intense, des perspectives de progression universitaire d’une ampleur nouvelle. En effet, la formation d’orthophoniste, actuellement assimilée, dans la fonction publique hospitalière, à un niveau bac + 2, sera considérée par les universités, à la suite de cette réforme, comme une formation de niveau bac + 4.
Il n’en demeure pas moins – vous avez souligné cette réalité – que certains estiment que la formation doit être allongée et durer cinq ans minimum, ce qui représente 9 000 heures. Quatre années ne suffiraient-elles plus pour former de bons orthophonistes ? Le ministre de la santé reconnaît les compétences des orthophonistes de notre pays : il sait qu’ils sont déjà de vrais et bons professionnels.
Enfin, concernant les formations complémentaires, j’apporterai quelques précisions : le ministère de la santé a proposé aux orthophonistes que les formations complémentaires qu’ils suivent aujourd’hui soient mieux structurées et fassent l’objet d’une reconnaissance universitaire.
Il n’est nulle part question d’une orthophonie « à deux vitesses ». Dans tous les métiers, les professionnels se forment tout au long de la vie, approfondissent un domaine, se spécialisent ; il n’y a donc pas de raison d’interdire aux orthophonistes d’en faire autant. Xavier Bertrand veut au contraire permettre à ceux qui ont envie de s’inscrire dans un parcours de formation complémentaire d’accéder facilement, durant toute leur carrière, à des formations de niveau master 2 reconnues par les universités.
Il est nécessaire de travailler sur ce sujet. Le ministère de la santé a clairement indiqué sa position aux orthophonistes : si leurs représentants veulent travailler avec le Gouvernement sur cette proposition de formations complémentaires, ce dernier est prêt à travailler avec eux. Mais il ne travaillera pas sans eux.
Ce que je veux simplement vous dire, de la part de Xavier Bertrand, c’est que, en tout état de cause, il faut finaliser le programme de la formation initiale. De nombreuses semaines de travail ont été perdues. Nous devons nous mettre autour de la table – c’est ce que propose Xavier Bertrand – afin que la promotion 2012–2016 bénéficie du nouveau programme, et que le climat puisse rapidement redevenir serein.

Je suis contente d’apprendre que les différents ministres, et notamment M. Xavier Bertrand, sont ouverts à la discussion. Toutefois, j’ai l’impression que ce dernier est un peu autiste, et sourd aux revendications des orthophonistes.
En effet, la profession est unanime sur cette question. Il ne s'agit pas d’allonger absolument la formation des orthophonistes, mais d’éviter qu’il existe deux types de professionnels : ceux qui possèdent un master 1 et ceux qui détiennent un master 2. Il faut dialoguer avec les orthophonistes et entendre les revendications : ils souhaitent continuer à être reconnus comme des professionnels des pathologies du langage.
Vous avez parlé de parcours de formation, mais la formation est au cœur même du métier d’orthophoniste ! Depuis la création de leur profession, les orthophonistes sont perpétuellement en formation continue ! Ils ont toujours eu besoin de valider leurs compétences et de les améliorer.
J’ai l’impression d’assister à un dialogue de sourds. Vous répondez par des argumentations qui ne correspondent pas à l’inquiétude exprimée par les professionnels. En effet, ce qu’ils vous demandent, c’est de ne pas casser l’unicité de la profession et de les reconnaître comme des professionnels des pathologies du langage.
Si vous instituez ces deux masters, certains orthophonistes s’occuperont des troubles du langage oral – je vous assure que ce n’est pas facile –, tandis que d’autres consacreront leur temps aux troubles neurologiques. Or le traitement de ces troubles ne constitue pas l’essence même de la profession d’orthophoniste.
Réfléchissez donc, avec les syndicats de professionnels, aux questions qui vous sont posées, et modifiez la réforme en cours, puisque les orthophonistes réclament le maintien de l’unicité de la profession via l’instauration d’une formation de niveau master 2 pour tout le monde.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, auteur de la question n° 1449, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Madame la ministre, depuis la publication de cette question orale dans le Journal officiel du 3 novembre dernier, vous avez, le 15 novembre, signé l’arrêté pour la mise en place du relèvement des couloirs aériens pour les arrivées face à l’Est à Orly, élaboré par vos services et la Direction générale de l’aviation civile, la DGAC. J’ai donc été contrainte d’ajuster mon propos en conséquence.
Vous le savez, cet arrêté suscite de nombreuses contestations. Les objectifs fixés par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « loi Grenelle 1 », prévoient, à l’horizon 2020, une réduction par passager-kilomètre de 50 % de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des avions, une diminution de 80 % des émissions d’oxyde d’azote et une baisse de 50 % du bruit perçu.
Or le projet de la DGAC déplace les nuisances vers une nouvelle population, sans pour autant supprimer la gêne des riverains, qui continuent à subir les nuisances liées aux décollages. Ce projet ne permettra donc pas de réduire les nuisances.
Madame la ministre, vous avez écrit qu’un relèvement permettrait de diminuer par deux le bruit perçu. C’est faux ; ce n’est pas moi qui le dis, mais Bruitparif, qui indique que le gain sonore moyen est imperceptible.
Depuis la mise en place des nouvelles trajectoires, le bruit effectivement ressenti par les riverains toujours survolés ne change pas. En revanche, beaucoup de nouveaux riverains subissent maintenant ces nuisances et, pis, d’autres encore voient leur lieu d’habitation davantage survolé. Ces nouvelles procédures démontrent par conséquent, sur le terrain, leur inefficacité au regard de l’objectif que vous avez défini.
De plus, l’allongement de dix kilomètres minimum des différentes trajectoires d’atterrissage survolant l’Île-de-France provoquera chaque année le gaspillage de 17 000 tonnes de kérosène et le rejet dans l’atmosphère de près de 45 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire davantage de pollution. Tout cela est incompatible avec les objectifs du Grenelle de l’environnement !
Enfin, l’enquête publique a été faussée par des chiffres de population totalement artificiels ; cela a été démontré. Les préconisations du Parc naturel régional du Gâtinais français et de ses partenaires experts, soutenues par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, l’ACNUSA, ont été repoussées sans réelle étude technique. Le refus de l’expertise d’Eurocontrol n’a jamais été étayé, contrairement à sa réalisation sur un précédent dossier en 2001–2002. Madame la ministre, l’expertise d’un organisme indépendant est-elle crainte ?
À l’initiative de l’ACNUSA, un bureau d’études a procédé, avant la mise en place de ce projet, à la mesure du bruit des avions sur quinze sites concernés par l’évolution des trajectoires.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir m’indiquer les nouvelles mesures et études prévues ; il est en effet nécessaire d’en organiser sur ces territoires. Si leurs résultats étaient en contradiction avec l’objectif poursuivi, envisageriez-vous de suspendre ces procédures afin de travailler plus efficacement à la réduction des nuisances ? Madame la ministre, il s'agit là d’une demande et d’une attente légitimes.
Madame Claire-Lise Campion, l’intérêt général ne peut être à géométrie variable en fonction du lieu d’habitation. Le Grenelle de l’environnement disposait que les critères retenus pour définir l’évolution des trajectoires seraient le bruit, pour les basses altitudes, et la réduction des émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire la minimisation de la distance, pour les hautes altitudes.
C’est à partir de ces deux critères – minimisation du bruit pour les basses altitudes et minimisation de la distance pour les hautes altitudes – qu’a été établi le projet de relèvement des altitudes des trajectoires d’approche dans l’ensemble de l’Île-de-France. Ce relèvement a été mis en œuvre d'abord au Bourget, il y a déjà deux ans, puis à Roissy et à Orly, cette année. Il a permis de diminuer de 3 décibels le bruit entendu au niveau du sol ; comme il s'agit d’une échelle logarithmique, cela représente une division par deux si on enlève le bruit associé, c'est-à-dire le bruit de fond non lié à l’avion.
On ne peut dire à la fois que ce projet a déplacé des avions, diminuant le bruit dans certains endroits mais l’augmentant dans d’autres, et que le bruit a augmenté pour tout le monde. La vérité se trouve dans l’étude d’impact, qui est le fruit de multiples concertations – j’avais d'ailleurs retardé la mise en œuvre du relèvement afin de tenir compte des résultats de toutes ces concertations ; la vérité est que le relèvement a engendré un gain important pour une majorité de Franciliens.
Il existe certes quelques perdants ici ou là, mais ils ne représentent qu’une minorité. En effet, les Franciliens vivant dans des lieux survolés à basse altitude sont désormais bien moins nombreux, et seuls quelques Franciliens habitent dans des lieux « nouvellement survolés », ce survol intervenant en outre à plus haute altitude.
Pourquoi ne pas faire appel à Eurocontrol ? Vous ne pouvez d’un côté fustiger la DGAC et prétendre que des experts locaux manifestement engagés – ils ont bien le droit de l’être – pour la défense de tel ou tel territoire sont plus indépendants que cette direction, et de l’autre réclamer l’intervention d’Eurocontrol, organisme au sein duquel la France est représentée par la DGAC !
Je crois qu’il faut s’en tenir aux faits. Des ressentis assez nets remontent déjà du terrain, et un bilan sera effectué. Ce bilan sera naturellement rendu public et partagé de manière transparente.
Je voudrais rappeler que l’un des présidents d’association les plus virulents sur cette question et que vous suivez était naguère très favorable au relèvement pour des motifs d’intérêt général, avant de changer d’avis voilà deux ans : il avait déménagé… L’intérêt général, je le répète, ne saurait être capturé par des intérêts locaux.

Je vous remercie de ces réponses, madame la ministre. Vous le savez, je partage totalement votre souci de l’intérêt général et, avec un certain nombre de partenaires de notre territoire régional, autour d’Orly et, aujourd'hui, de Roissy, j’ai toujours mis en avant cet intérêt général s'agissant des questions de survol aérien.
Effectivement, peut-être que certains, à titre individuel – je pense à l’exemple que vous venez de citer – soutiennent d’autres positions. Mais ces positions ne sont pas les miennes ; ce ne sont pas celles que nous partageons.
Nous sommes guidés par le souci de l’intérêt général dans notre réflexion sur la modification des trajectoires. J’entends bien ce que vous dites : un bilan de la réforme sera effectué et rendu public. Toutefois, nous ne partageons pas la vision que vous venez d’exposer, et les habitants concernés et les experts ne la partagent pas non plus.
Il existe des organismes indépendants. J’ai cité l’ACNUSA et Eurocontrol, dont le rôle est d’apporter des éléments et arguments complémentaires. Je l’affirme de nouveau : il est nécessaire de faire appel à ces organismes afin de disposer, dans l’attente du bilan que vous avez annoncé, d’un constat sans équivoque ni arrière-pensée. En particulier, il est nécessaire de comparer les mesures de bruit effectuées par l’ACNUSA avant la mise en œuvre de votre projet avec de nouvelles mesures et études. C’est cela que nous attendons, madame la ministre.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 1453, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Ma question concerne les pannes permanentes de la voie auxiliaire sur l’échangeur A 4-A 86. Celles-ci ont chaque fois une origine différente, mais elles paralysent tout le temps la circulation de l’un des tronçons les plus empruntés d’Île-de-France, avec chaque jour 280 000 véhicules dont 25 000 poids lourds. Embouteillé au minimum six heures par jour, cet échangeur est l’un des bouchons les plus importants d’Europe.
La paralysie de l’A 4-A 86 cause des inconvénients majeurs, qui vous concernent directement : ce bouchon, qui entraîne un ralentissement de l’activité et du développement économiques du Val-de-Marne, et plus largement de l’est de la France, constitue aussi un handicap chronique pour les usagers, qu’ils soient salariés ou clients, et a des incidences mesurables sur la qualité de vie des riverains, à cause notamment du bruit et de la pollution engendrée par les gaz d’échappement.
En décembre 2009, deux accidents ont endommagé le dispositif. La voie a été inutilisable pendant six mois, car il a fallu attendre les résultats d’un appel d’offres pour disposer de pièces de rechange spécifiques, ce qui a engendré un long délai de réparation. La réouverture, intervenue en juin 2010, soit quelques jours après que j’eus posé une question orale sur le vol des câbles en cuivre sur l’A 4-A 86, ne fut que de très courte durée, puisqu’un vol de cuivre eut raison de la voie auxiliaire dès juillet 2010 ! Depuis lors, cette voie est hors service. Si je compte bien, cela fait donc un mois de réouverture et près de dix-huit mois de fermeture !
Face à l’inertie de la DIRIF, j’ai suggéré au préfet du Val-de-Marne d’étudier l’hypothèse de l’utilisation des panneaux de signalisation lumineux pour signaler l’ouverture et la fermeture de la voie auxiliaire. Jugeant ma proposition opportune, le préfet l’a transmise au début de l’année 2011 à la DIRIF.
Celle-ci ne m’a toujours pas répondu, mais elle communique régulièrement par l’intermédiaire du journal Le Parisien sur divers sujets. J’ai ainsi appris qu’une dérogation aurait été demandée à votre ministère pour rouvrir cette voie en dépit du dysfonctionnement des barrières, sans que ne soit cependant évoquée l’utilisation des panneaux lumineux pour réguler la circulation. Est-ce exact ? Pourquoi cette dérogation tarde-t-elle à être accordée ?
La presse fait aussi état d’un projet d’aménagement proposé par l’ACTEP, l’association des collectivités territoriales de l’Est parisien, projet qui vise à transformer l’A 4 en une « avenue métropolitaine ». Ce projet à long terme donne-t-il vraiment lieu à des débats et à des études ?
Dans l’attente du « bouclage » du Grand Paris et d’aménagements qui n’aboutiront pas avant plusieurs années, il est devenu urgent d’intervenir.
Lors de ma dernière intervention sur ce sujet, il m’avait été répondu que les pannes de la voie auxiliaire étaient exceptionnelles en raison du caractère de « prototype » de la voie. Cette dernière reste-t-elle toujours un prototype ?
Sa fermeture permanente depuis deux ans est difficilement acceptable pour tous les usagers, en particulier en aval, vers Rungis.
Les élus ne comprennent pas cette passivité des services de l’État et c’est pourquoi j’attends de vous, madame la ministre, que vous m’indiquiez quand et comment la situation va être débloquée et que vous me transmettiez un calendrier précis de mise en œuvre des solutions retenues.
Madame Procaccia, vous attirez mon attention sur les mises hors service répétées de la voie auxiliaire sur l’autoroute A 4, entre Joinville-le-Pont et Saint-Maurice, section d’environ trois kilomètres qui constitue le tronc commun des autoroutes A 4 et A 86 à l’est de Paris.
Pour atténuer les problèmes récurrents de congestion dans les deux sens aux heures de pointe du matin et du soir que vous évoquez, une expérimentation avait effectivement été mise en place en juillet 2005 pour ouvrir de façon dynamique la bande d’arrêt d’urgence à la circulation dans les deux sens.
Or ce dispositif, qui comportait une information dynamique sur l’ouverture ou non de la voie et un système de glissières mobiles d’affectation, n’a pu être correctement maintenu du fait des vols à répétition de câbles et des coûts de réparation sur les glissières mobiles qui se sont révélés très importants. Il a finalement été suspendu en 2009.
Un nouveau dispositif sécurisé et moins sensible aux accidents et au vandalisme est actuellement à l’étude, mais il ne pourra pas être opérationnel avant la mi-2013. (Mme Catherine Procaccia soupire.)
Aussi la DIRIF a-t-elle étudié une solution techniquement plus simple, qui ne nécessiterait que peu d’entretien et de dépenses de fonctionnement et permettrait une ouverture de la bande d’arrêt d’urgence à la circulation dans le sens province-Paris pendant l’heure de pointe du matin, donc de six heures trente à dix heures trente, grâce à l’utilisation d’une signalisation fixe mentionnant ces horaires en aval du tunnel de Nogent-sur-Marne.
La DIRIF a saisi la DSCR, la délégation à la sécurité et à la circulation routières, de cette proposition de dispositif temporaire fixe, lequel nécessite une autorisation d’expérimentation puisqu’il déroge en fait à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière et qu’il n’existe pas de précédent.
La DSCR a demandé un complément au dossier, en particulier sur l’utilisation actuelle de la bande d’arrêt d’urgence, pour vérifier que le dispositif n’induit pas un risque de banalisation de ces bandes par leur ouverture à la circulation sans gestion dynamique.
La DSCR a également souhaité consulter les services de secours pour connaître leur analyse.
La décision de rouvrir la bande d’arrêt d’urgence à la circulation, qui ne pourra donc être prise qu’après analyse des compléments de dossier et avis des forces de l’ordre et de secours, devrait nous permettre de faire la jonction avec le dispositif plus adapté et plus durable qui pourra être mis en place à la mi-2013.

Madame la ministre, j’ai un peu de mal à comprendre que tant d’études soient nécessaires pour l’utilisation d’une bande d’arrêt d’urgence qui a déjà été ouverte à la circulation, d’autant que des panneaux lumineux, qui indiquent en permanence : « voie auxiliaire fermée », existent. Il devrait tout de même être assez simple de signaler que cette voie auxiliaire est ouverte et fermée de telle à telle heure !
Je l’utilise très régulièrement. Elle est certes fermée, mais il suffit de passer trois mètres pour que les automobilistes puissent la prendre. Je ne comprends donc ni la nécessité de toutes ces études ni cet argument d’un risque de banalisation qui est avancé alors que c’est une situation qui dure depuis des années. Pourquoi tant de temps consacré à des analyses sur une situation existante ? Quel est le problème de fond ? On en vient à se demander s’il n’y a pas à la DIRIF quelqu’un qui est obsédé et obstinément opposé à l’ouverture de la bande d’arrêt d’urgence, le résultat étant le blocage complet de la circulation alors qu’il y a moyen de fonctionner autrement !
Par ailleurs, la solution que vous évoquez prévoit une ouverture de six heures trente à dix heures trente, mais ces messieurs de la DIRIF ont-ils pris l’autoroute A 4-A 86 non pas même le soir, mais l’après-midi ? Dès seize heures, seize heures trente, tout est bloqué parce que tout le monde commence à rentrer, tous travaillant à l’ouest puisque nous n’avons rien à l’est ! D’ailleurs, pourquoi ouvrir la voie auxiliaire dans le sens province-Paris et pas dans le sens Paris-province ? Les gens qui habitent en Seine-et-Marne mettent une heure et demie pour rentrer !
J’espérais, madame la ministre, qu’avec votre présence et votre intervention ici les choses allaient bouger, mais je constate que vos services vous parlent encore d’études qui ne me paraissent absolument pas nécessaires. Tout l’Est parisien va donc rester bloqué jusqu’en 2013 pour une bande d’arrêt d’urgence ouverte en 2005 ! Je suis désolée d’avoir à vous dire que je ne suis pas satisfaite de cette réponse.

La parole est à M. Francis Grignon, auteur de la question n° 1454, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Madame la ministre, ayant rédigé ma question, qui porte sur les inquiétudes que suscite l’arrêté du 18 novembre 2011 sur les mâchefers d’usines d’incinération d’ordures ménagères, avant la publication dudit arrêté, je me suis permis de la faire un peu évoluer.
Les entreprises travaillent sur la base de la circulaire de 1994, qui définit les conditions strictes de réutilisation des mâchefers provenant d’usines d’incinération. Ainsi, l’utilisation du mâchefer sur de nombreux chantiers a permis d’économiser l’utilisation de granulats naturels et a de ce fait engendré d’importantes économies.
Or, l’arrêté du 18 novembre 2011 prévoit de rendre certains seuils encore plus drastiques.
Les aménagements de mise en conformité des installations auront une incidence financière pouvant s’élever à plusieurs centaines de millions d’euros à l’échelle nationale. Ainsi, plus de la moitié des usines d’incinération des ordures ménagères françaises ne produiront plus de mâchefers valorisables dès l’entrée en vigueur de cet arrêté. Il ne restera donc que la mise en décharge pour le traitement de ces mâchefers.
Or l’Europe a décidé de la création d’une société européenne du recyclage en adoptant la directive relative aux déchets du 19 novembre 2008. Celle-ci a été transposée en droit français par l’ordonnance du 17 décembre 2010, qui reconnaît formellement la possibilité de transformer des déchets en produits.
Le tout nouvel arrêté ne veut pas prendre en compte cette évolution : il maintient le statut de déchets pour les graves de mâchefers sortant d’une installation de maturation et de transformation, c’est-à-dire après un recyclage qui est justement le garant de la transformation d’un déchet en produit.
Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, si le Gouvernement entend faire évoluer cet arrêté, en particulier s’agissant de la mise en application de ces dispositions au 1er juillet 2012, ce qui paraît un peu précipité.
Monsieur Grignon, l’arrêté ministériel relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux a été publié, vous l’avez souligné, très récemment.
Ce texte résulte de l’engagement n° 264 du Grenelle de l’environnement et des travaux menés depuis par plusieurs groupes de travail sur cette thématique depuis 2009. À ces travaux ont notamment été associés des représentants des syndicats professionnels de l’incinération et des travaux publics, des représentants des collectivités territoriales, lesquelles sont évidemment concernées, et des représentants des associations de protection de l’environnement.
Au-delà des travaux conduits dans ce cadre, l’arrêté ministériel précité a fait l’objet d’une nouvelle concertation auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de la Commission consultative d’évaluation des normes, en octobre et novembre 2011, afin de veiller à ne pas alourdir inutilement la réglementation.
Les seuils de qualité des mâchefers destinés au recyclage en technique routière sont issus d’essais, d’études et de modélisations conduits sur la base d’hypothèses raisonnablement conservatrices au regard des usages prévus. Ils sont cohérents avec les critères de qualité mentionnés dans le guide sur l’acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière qui a été publié par le SETRA, le service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements.
Les mâchefers sont des résidus solides de l’incinération et leur potentiel polluant dépend notamment de la qualité des déchets entrant dans l’installation et des conditions de leur combustion. Compte tenu des travaux de mise en conformité des incinérateurs réalisés depuis 2005, il semble, et c’est important, que les dispositions fixées par l’arrêté précité n’appellent pas de nouveau investissements.
En revanche, la mise en place de filière de gestion des déchets dites « à responsabilité élargie des producteurs », telle que la filière sur les déchets diffus spécifiques, et le renforcement de la performance de la filière relative aux piles et accumulateurs doivent conduire à détourner des déchets qui peuvent souiller, aujourd’hui encore, la fraction résiduelle des déchets ménagers reçus dans les incinérateurs.
Le dispositif, qui prévoit par ailleurs l’apport d’un soutien financier non négligeable aux collectivités, permet de prévenir la production de mâchefers comportant une charge polluante incompatible avec leur valorisation. C’est donc dans son ensemble qu’il est vertueux, et non pas seulement dans certains de ses volets.
Enfin, compte tenu des enjeux attachés à la valorisation des déchets non dangereux notamment en technique routière, l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011 porte les mesures réglementaires et opposables qui permettent de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé humaine pour autant que les critères qu’il fixe et les usages qu’il autorise soient satisfaits par les opérateurs concernés.
J’estime donc que le dispositif est aujourd'hui assez complet, mais il est possible, compte tenu de sa mise en place récente, qu’il soit réévalué d’ici à quelques mois.

J’ai bien évidemment confiance, madame la ministre, en toutes les précisions que vous nous apportez sur ce sujet technique très complexe et je vous remercie de votre réponse.
Je souhaite simplement qu’il n’y ait pas trop d’incidences sur les finances des collectivités locales, qui sont parties prenantes en la matière et qui sont, elles aussi, touchées par les difficultés économiques actuelles. Je suivrai donc avec beaucoup d’attention les effets de la mise en œuvre de l’arrêté.

La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 1464, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

M. Daniel Reiner. Non pas que vos réponses nous satisfassent toujours, madame la ministre, mais au moins venez-vous toujours en personne répondre à nos questions le mardi matin, ce qui n’est pas le cas de tous vos collègues. Permettez-moi de vous en complimenter : c’est, à quelques jours de Noël, mon petit cadeau.
Mme la ministre sourit.

J’attire votre attention sur la difficulté majeure introduite par l'article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales pour le financement des opérations d'investissement des parcs naturels régionaux.
En effet, cet article prévoit que la participation minimale du maître d'ouvrage à un projet d'investissement doit être de 20 %. Or, les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sont dans l'impossibilité de mobiliser un tel autofinancement sur les opérations en investissement dont ils sont pourtant maîtres d'ouvrage.
L'application de cette disposition à compter du 1er janvier 2012 menace en conséquence la mise en œuvre des missions assurées par ces structures, y compris celles que les parcs naturels régionaux conduisent pour le compte de votre ministère, par exemple sur les sites Natura 2000 ou dans les réserves naturelles.
Cette disposition est d’autant plus malvenue que les parcs naturels régionaux présentent des spécificités imposées par le code de l’environnement. Ils ont notamment l’obligation de réaliser des études et des opérations d’investissement dont ils ont la maîtrise d’ouvrage. Ils ne bénéficient par ailleurs ni d’une fiscalité propre, ni d’un transfert de moyens de la part des collectivités membres, ni de dotations d’État. Comme ils ne disposent d’aucune ressource propre d’investissement, leurs opérations sont financées en totalité par des subventions publiques – décret n° 2000–1241 du 11 décembre 2000.
Le 7 octobre dernier, lors du congrès des parcs à Saverne, madame la ministre, alors que vous étiez accompagnée de M. Philippe Richert, vous avez pris l’engagement de faire bouger les choses. À ce jour, il n’en est rien, semble-t-il.
J’ai appris que, jeudi prochain, un rendez-vous était organisé entre le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, M. Joseph, et la Direction générale des collectivités locales. Pour autant, comment la loi pourrait-elle être modifiée avant le 1er janvier 2012 ?
Aussi, madame la ministre, je souhaite savoir si vous entendez bien maintenir la dérogation pour les opérations d’investissement conduites sous maîtrise d’ouvrage des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, telle qu’elle a été prévue dans l’article 1er du décret du 11 décembre 2000. Si tel n’était pas le cas, ces organismes n’auraient plus aucune possibilité de mettre en œuvre des actions concrètes sur leur territoire.
Monsieur Reiner, vous avez raison : le problème est aujourd'hui bien identifié. Pourtant, l'article 76 de la loi n° 2010–1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales n’avait certainement pas pour objectif de créer de telles difficultés ! Il prévoit en effet que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer, à compter du 1er janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.
Cette disposition législative est particulièrement claire, précise et opérationnelle s’agissant des collectivités territoriales ou de leurs groupements bénéficiant de ressources propres. En revanche, comme vous le soulignez à juste titre, monsieur le sénateur, et cela n’avait pas été soulevé lors de l’examen du texte, les syndicats mixtes, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux, mais aussi les syndicats de rivières ou les établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, ne disposent d’aucune ressource propre et, pour leur fonctionnement et leurs investissements, dépendent exclusivement des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier.
Dans ce contexte, monsieur le sénateur, je suis particulièrement attentive aux inquiétudes des parcs naturels régionaux pour lesquels vous connaissez mon profond attachement. Avec le ministre chargé des collectivités territoriales, tout est mis en œuvre pour apporter une réponse de nature à préserver leurs capacités d’actions et d’investissement sur nos territoires.
Une modification de nature législative serait certainement la réponse la plus appropriée. Malheureusement, cela nécessite toujours un peu de temps, il faut trouver un moment dans l’ordre du jour parlementaire, le bon véhicule législatif, etc.
Pour autant, je vous indique d’ores et déjà que le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la partie législative du code général des collectivités territoriales ainsi que le projet de circulaire relative à l’application de la loi de réforme des collectivités territoriales, notamment son article 76, préciseront que les concours financiers des membres du syndicat mixte au budget du syndicat, qu’il s’agisse d’une cotisation annuelle, d’une contribution exceptionnelle ou encore d’une subvention d’investissement, sont pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d’investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d’ouvrage. Cela devrait résoudre le problème en attendant qu’une disposition législative clarifie la situation.
Pour terminer, je tiens à préciser que les dispositions de l’article L. 1111–10 du code général des collectivités territoriales ne concernent pas les opérations de fonctionnement. Elles ne concernent pas non plus les syndicats mixtes ouverts élargis, c'est-à-dire ceux qui sont composés de collectivités territoriales, d’établissements publics de coopération intercommunale et d’autres personnes morales de droit public telles que des organismes consulaires. Ceux-là sont exclus de son champ d’application.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse, qui satisfera, je l’espère, les 46 parcs naturels régionaux qui attendent une réponse précise pour l’année 2012. J’ai bien noté que vous partagiez leur inquiétude – c’est une bonne chose – et cherchiez le véhicule législatif le plus approprié pour apporter une solution pérenne.
En attendant, afin qu’une réponse à ce problème soit proposée dès le 1er janvier, vous avez évoqué un projet de décret. Il faudrait qu’il soit rédigé de telle sorte qu’il entre en application dès le début 2012
Mme la ministre opine.

La parole est à M. Maurice Vincent, auteur de la question n° 1516, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur l’urgence du lancement de l’appel à concession du projet d’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon.
Après vingt ans d’études, l’autoroute A 45 a été déclarée d’utilité publique au mois de juillet 2008. Depuis, aucune décision n’a été prise pour mettre en œuvre ce projet, bien que cette autoroute paraisse indispensable pour mettre fin à une situation qui se dégrade d’année en année non seulement sur toute la longueur de l’A 47 – embouteillages, accidents à répétition, pollutions en zone fortement urbanisée... –, mais également au niveau de la connexion avec l’A 7 à Gisors et à l’entrée sud de Lyon.
Si une amélioration des conditions de fonctionnement de l’actuelle A 450 mérite d’être étudiée à l’entrée ouest de Lyon et s’il est indispensable d’orienter clairement tous les flux de transit en dehors de cette ville, la déclaration d’utilité publique de l’A 45 ne saurait être remise en cause par des hypothèses réfutées depuis longtemps par toutes les études menées. En outre, une telle orientation renverrait aux calendes grecques l’amélioration de l’accessibilité de la région stéphanoise, de l’ensemble de la Haute-Loire et rendrait impossible l’amélioration du contournement de Lyon, aujourd’hui exclusivement situé à l’est de l’agglomération.
L’engagement financier de Saint-Étienne Métropole et du département de la Loire, acté lors de la réunion en préfecture de région du 14 novembre 2011, a permis de répondre à toutes les questions récemment posées en préalable à la décision du lancement de l’appel à concession. Lors de son passage dans la Loire au mois de septembre dernier, le Président de la République s’est engagé à prendre une telle décision « sous trois mois ».
Il est impensable de remettre en cause les engagements successifs de l’État en faveur de l’A 45 et d’ignorer ainsi les intérêts vitaux de ce bassin de vie qui compte plus de 700 000 habitants. Par conséquent, madame la ministre, pouvez-vous nous assurer du lancement rapide de cet appel à concession pour la réalisation de l’A 45 ?
Monsieur Maurice Vincent, le projet d’autoroute A 45 entre Lyon et Saint-Étienne a été déclaré d’utilité publique au 2008. Différents recours ont été présentés : ils ont tous été rejetés par le Conseil d’État le 16 avril 2010. Cet aménagement figure désormais dans la version consolidée de l’avant-projet de schéma national des infrastructures de transport.
Lors de son déplacement le 6 septembre dernier, le Président de la République a rappelé l’importance que l’État attachait à ce projet. À cette occasion, il a demandé qu’un accord soit trouvé auprès des collectivités locales sur la prise en compte, à parité entre l’État et les collectivités locales, de la subvention d’équilibre nécessaire à la concession. Celle-ci s’impose en effet, étant donné la nature du projet. Il a également indiqué que cet engagement des collectivités locales était un préalable nécessaire au lancement de l’appel à concession.
Je me réjouis que les collectivités de la Loire aient fait connaître leur accord pour assurer leur part de financement, confortant ainsi ce projet.
Comme vous le savez, monsieur le sénateur, à la fin du mois de septembre 2011, le Président de la République a demandé au préfet de région Rhône-Alpes de rencontrer les collectivités afin d’obtenir de leur part la formalisation de leurs engagements sur le principe de leur participation au financement de l’A 45. Le rapport du préfet de région est imminent et nous permettra de déterminer les conditions de poursuite de cette opération. Sur ce dossier, il devrait donc y avoir du neuf très rapidement.

Madame la ministre, je prends note de votre réponse et vous en remercie. J’insiste néanmoins sur l’urgence de cette décision, puisque le délai de trois mois est maintenant dépassé. Les milieux économiques et sociaux de l’agglomération seront attentifs au lancement de cet appel à concession, qui n’est pas encore acté.

La parole est à M. Robert Tropeano, auteur de la question n° 1450, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Ma question concerne les difficultés de recrutement des médecins de prévention, notamment dans la fonction publique territoriale.
La loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 a créé les centres de gestion et a par ailleurs défini les missions obligatoires et les missions facultatives qu’ils doivent assurer. S’agissant des missions facultatives, l’article 26-1 précise ainsi que « les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande ».
En outre, les autorités territoriales sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de l’état de santé de leurs agents, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents placés sous leur autorité. Elles peuvent soit créer un service de médecine professionnelle et préventive, soit adhérer au service mis en place par les centres de gestion.
Les conditions réglementaires, l’augmentation de l’absentéisme pour raison de santé, les sollicitations croissantes des collectivités et établissements publics attestent que ce service de médecine préventive est devenu un composant majeur dans la gestion des ressources humaines. Or, à ce jour, les centres de gestion rencontrent des difficultés pour assurer un suivi médical quantitatif et qualitatif pour les agents des collectivités. Il est donc à craindre que la responsabilité des centres de gestion ne soit engagée dans l’éventualité où une collectivité rencontrerait un problème avec l’un de ses agents non suivis.
À ce jour, les centres de gestion rencontrent des difficultés de prévention dans la fonction publique territoriale. En effet, ils essuient des refus de plus en plus fréquents des conseils départementaux de l’ordre des médecins pour le recrutement de généralistes dans les services de prévention de ces centres. Ces positions risquent, à terme, de porter atteinte à l’existence même des services de médecine professionnelle pour les agents de la fonction publique territoriale.
Comment convaincre l’ordre des médecins, au travers de ses conseils départementaux, de faire preuve d’une plus grande souplesse concernant la délivrance de l’agrément des médecins généralistes recrutés par les centres de gestion ? N’est-il pas opportun d’autoriser à nouveau le dispositif de reconversion permettant aux médecins en poste de suivre une formation qualifiante en médecine de prévention ? Quelles sont les intentions du Gouvernement en matière d’amélioration de la médecine préventive pour le bien-être des agents territoriaux ?
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de Xavier Bertrand, qui m’a demandé de vous transmettre la réponse suivante.
Vous appelez l’attention du Gouvernement sur la pénurie actuelle de médecins de prévention et sur les mesures envisagées pour y remédier. Le code du travail réserve l’exercice de cette spécialité aux médecins titulaires de la qualification en médecine du travail.
Face à la baisse préoccupante de la démographie des médecins du travail – 30 % des effectifs d’ici à 2015 –, dans un contexte où les questions de santé au travail et de protection des salariés sont un enjeu social majeur, il est nécessaire de développer l’attractivité de la médecine du travail. C’est l’un des objectifs prioritaires que s’est fixé le Gouvernement dans le cadre de la réforme en cours de l’organisation de la médecine du travail. Plusieurs leviers sont ainsi activés : modifier les conditions d’exercice de la profession, repenser la formation initiale des médecins, développer la formation continue, ou encore organiser une filière de reconversion pérenne vers la médecine du travail.
La loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail et ses décrets d’application ont ainsi ouvert plusieurs voies pour développer l’attractivité de la profession de médecin du travail et favoriser les passerelles vers cette spécialité.
Tout d’abord, les conditions d’exercice de cette profession, dans le cadre de la pluridisciplinarité renforcée et d’un mode de gouvernance rénové des services de santé au travail interentreprises, devraient développer l’intérêt pour cette profession, au centre des enjeux de prévention et de santé au travail.
Par ailleurs, afin de mieux faire connaître la spécialité de médecine du travail aux étudiants, des modifications apportées au texte de l’article R. 4623–44 du code du travail permettront aux étudiants du deuxième cycle des études médicales d’effectuer un stage dans un service de santé au travail.
En outre, afin de faciliter le recrutement dans les services de médecine du travail, la loi du 20 juillet 2011 précitée prévoit que les services de santé au travail, dont font partie les services de médecine professionnelle de la fonction publique territoriale, peuvent recruter un interne de la spécialité à titre temporaire. Le décret d’application de cette disposition est en préparation.
Enfin, le prochain décret d’application modifiera le code du travail pour permettre aux services de santé au travail de recruter des collaborateurs médicaux. Encadré par un médecin du service de santé au travail qualifié en médecine du travail, ce collaborateur, le plus souvent médecin généraliste, mais pouvant relever d’une autre spécialité, sera engagé dans une démarche de formation universitaire en vue de l’obtention de la qualification de spécialiste en médecine du travail auprès du Conseil national de l’ordre des médecins.
Le ministère veillera particulièrement aux conditions et aux critères de formation nécessaires à la qualification ordinale, et organise des échanges avec le Conseil national de l’ordre des médecins afin de sensibiliser les commissions de qualification sur ces sujets.
Les consultations préalables à la saisine du Conseil d’État du projet de décret portant cette mesure sont en cours ; la publication du texte est attendue pour le premier trimestre de l’année 2012.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
Force est de constater que ce problème, rencontré depuis plusieurs années déjà, s’ajoute aux difficultés grandissantes posées par la désertification médicale sur l’ensemble de notre territoire.
Il serait donc souhaitable que le Gouvernement parvienne à s’entendre avec l’ordre de médecins pour trouver rapidement une solution, nécessaire à plusieurs égards.
Il y va, tout d’abord, de l’intérêt sanitaire des agents de la fonction publique territoriale.
Ensuite, il convient d’éviter que les exécutifs territoriaux, c’est-à-dire les maires et les présidents de collectivités, ne se retrouvent confrontés à des risques de contentieux non négligeables, consécutifs à leur mise en cause pénale dans certains cas de maladies professionnelles ou d’accidents de service.
Enfin, il va de soi que les missions conférées par la loi et la réglementation de la médecine préventive puissent être assurées convenablement.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, auteur de la question n° 1452, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, il y a trois semaines, ici même, j’interrogeais le Gouvernement sur la montée préoccupante du chômage en France.
Face à ce bilan catastrophique, je souhaitais savoir quelles dispositions il entendait prendre pour enrayer ce drame économique et social affectant toujours plus de Français.
Je crois que j’ai désormais la réponse à ma question, ayant découvert avec colère, de concert avec mon collègue Bernard Cazeau, que, en Dordogne, l’État avait ni plus ni moins choisi d’abandonner la lutte contre le chômage.
Comment a-t-on pu en arriver là ? Tout simplement parce que l’État, en refusant d’assumer ses engagements, place la maison de l’emploi de Périgueux dans une situation précaire et inquiétante.
Les maisons de l’emploi, faut-il le rappeler, ont été créées à partir de 2005 par M. Borloo, alors ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, avec un objectif clair : développer des outils, à l’échelon territorial, pour favoriser l’emploi.
À Périgueux, un observatoire économique, des partenariats, des formations, des outils numériques et des offres d’emploi, bien sûr, ont été mis en place justement pour faciliter la reprise d’activité. Et cela marche !
Entre 2008 et 2010, quelque 38 000 personnes ont été accueillies, 167 000 ont utilisé le site internet et 1 200 offres d’emplois ont été proposées.
La maison de l’emploi de Périgueux a donc démontré toute son utilité.
Lors de la création de ces structures, l’État s’était engagé à en assurer 80 % du financement, 20 % restant à la charge des collectivités.
Voilà bien le problème aujourd’hui : en 2011, la subvention de l’État aura baissé, tenez-vous bien, de 44 %. En 2012, elle diminuera encore de 34 %. En deux ans, elle sera donc passée de 435 000 euros à 160 000 euros.
Dans ces conditions, vous comprenez bien, monsieur le secrétaire d’État, que les collectivités ne peuvent plus compenser une telle différence, d’autant que l’État doit toujours à la ville de Périgueux les 350 000 euros qu’il s’était engagé à assumer au titre des travaux d’aménagement.
Ainsi, en 2011, la maison de l’emploi terminera l’exercice avec un déficit de 50 000 euros et l’on se retrouve face à un paradoxe qu’il convient de dénoncer : les 19 salariés de cette structure sont maintenant menacés, eux aussi, de perdre leur emploi ! Cette situation est aberrante.
Monsieur le secrétaire d’État, ma question est donc simple : pouvez-vous, ici et aujourd’hui, prendre l’engagement que la maison de l’emploi de Périgueux sera préservée et qu’elle pourra continuer à exercer sa mission de service public, pour l’emploi, en Dordogne ?
Monsieur le sénateur, je vous prie d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Xavier Bertrand, actuellement en déplacement, avec le Président de la République, en Ardèche.
Il est vrai que les moyens affectés au financement des maisons de l’emploi avaient diminué de 22 millions d’euros dans le projet de budget, mais les députés ont ajouté 15 millions d’euros lors des débats. Il fallait le souligner.
Je vous rappelle que ces structures ont été créées alors que Pôle emploi n’existait pas. Il faut tirer les conséquences des réformes et ne pas superposer les structures. L’État ne peut pas financer deux fois la même chose.
Le nouveau cahier des charges, en vigueur depuis 2010, prend en compte cette évolution, les rapprochements des maisons de l’emploi avec d’autres structures générant mécaniquement des économies.
La baisse du budget national consacré à ce dispositif ne s’applique pas de façon mécanique et uniforme à toutes les maisons de l’emploi. Certaines voient leur budget maintenu, tandis que, pour d’autres, la baisse peut être importante, mais cela est toujours lié aux actions mises en œuvre.
Dans un rapport de 2009, Michel Thierry a mis en évidence, notamment, la nécessité de redéfinir les axes d’intervention des maisons de l’emploi et de renforcer l’évaluation, en la recentrant sur la mesure de l’impact.
À la suite de ce rapport, une réforme du dispositif a été mise en œuvre à la fin de 2009. Elle modifie, d’une part, ses modalités de gestion et, d’autre part, le champ d’intervention des structures.
Depuis le 1er janvier 2011, toutes les maisons de l’emploi inscrivent leurs actions dans le cadre de ce nouveau cahier des charges. Les aides financières ont été négociées sur la base de ce document.
Dire que l’État se désengage, alors qu’il finance 70 % du budget des maisons de l’emploi, est évidemment inexact.
Ainsi, les maisons de l’emploi doivent se concentrer sur l’élaboration d’un diagnostic du marché local devant permettre de déboucher sur une stratégie des acteurs locaux de l’emploi et sur l’aide à l’ensemble des employeurs publics et privés pour une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales dans le cadre des mutations économiques. Elles doivent également se concentrer sur le développement local et sur la réduction des freins culturels ou sociaux à l’embauche.
Il appartient au préfet de région, désormais compétent, de choisir, au vu de leur pertinence au regard des caractéristiques du bassin d’emploi considéré, les actions présentant une plus-value justifiant la participation financière de l’État.
Nous avons redonné la main aux préfets et aux services déconcentrés de l’État pour engager les discussions avec les maisons de l’emploi. C’est normal, puisque ce sont eux qui connaissent le mieux les actions mises en œuvre et, surtout, qui sont capables d’organiser l’articulation des actions de chacun. Il leur revient donc la responsabilité de déterminer le niveau et l’orientation des financements de l’État.
Les enveloppes régionales ont vu leur baisse limitée à 25 % des crédits consommés au titre du meilleur exercice, 2008 ou 2009. La détermination de leur montant a également pris en compte le forfait régional moyen par habitant, dans le cadre du précédent conventionnement.
La méthodologie retenue vise à réduire les écarts entre structures, qui pouvaient aller, dans le cadre de l’ancien dispositif, de un à vingt.
Par ailleurs, il sera procédé, en 2012, à une évaluation des actions des maisons de l’emploi, puisqu’elles doivent faire l’objet d’une analyse qualitative.
S’agissant de la maison de l’emploi de Périgueux, les services de l’État ont recherché toutes les solutions afin qu’elle puisse poursuivre son activité de façon satisfaisante : la baisse des crédits a été atténuée, grâce à la mobilisation du Fonds social européen, le FSE, mobilisation qui aurait pu être plus forte si la maison de l’emploi de Périgueux avait travaillé, comme celle de Sarlat, à une optimisation de cette sollicitation ; il a été décidé de procéder au versement des sommes dues de la part de l’État, soit les soldes pour 2010 et 2011, le plus rapidement possible.
Au final, monsieur le sénateur, la dotation de l’État, comprenant les financements du FSE, représente un versement de 371 549 euros, soit une réduction de 64 000 euros par rapport à 2010, quand la ville de Périgueux verse 80 000 euros et le conseil général 30 000 euros. Vous le constatez, l’État fait son devoir !

Monsieur le secrétaire d’État, nous n’allons pas nous lancer dans une bataille de chiffres, mais il me semble important d’en rappeler certains. Ainsi, une subvention de 435 000 euros a été réduite à 160 000 euros, à la suite de deux baisses successives, en 2010 et 2011, respectivement de 44 % et de 34 %. Par ailleurs, il avait été promis, lors de la création de cette maison de l’emploi – M. Jean-Louis Borloo était alors ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et M. Xavier Darcos maire de Périgueux – une somme de 350 000 euros, somme avancée par la ville et jamais remboursée par l’État.
La situation est préoccupante. Encore une fois, les collectivités locales ont été sollicitées pour mettre en œuvre une politique à laquelle, pour ma part, je ne croyais pas trop. Elles ont donc investi et n’ont pas eu, en retour, les subventions promises.
Par la suite, les dotations d’État affectées aux budgets de fonctionnement de ces structures, qui ont fait leurs preuves, se sont réduites comme une peau de chagrin, entraînant une augmentation de la charge des collectivités.
À un moment donné, les collectivités locales se retrouvent face à l’alternative suivante : soit elles pallient le déficit de subventionnement de l’État, soit elles sont obligées de prendre des décisions douloureuses, à la fois pour les demandeurs d’emploi concernés et pour ceux qui travaillent dans ces structures, avec beaucoup de volontarisme, pour apporter la meilleure réponse à ceux qui sont en difficulté.
Enfin, pour terminer, je signale que le déséquilibre des comptes de la maison de l’emploi met également en péril l’espace emploi, qui travaille en étroite collaboration avec elle sur la ville de Périgueux et le département de la Dordogne.

La parole est à M. Jean-Claude Leroy, auteur de la question n° 1474, transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question s’adressait à M. le ministre de l’agriculture, mais je vous la pose bien volontiers.
Je souhaite attirer votre attention sur le cas de certaines entreprises du Pas-de-Calais, implantées en dehors de l’actuelle zone de recherche et de développement du pôle de compétitivité « nutrition-santé-longévité », dont le périmètre a été défini par le décret du 12 juillet 2006, car ces entreprises ne peuvent bénéficier des dispositifs d’aides de l’État en matière de recherche et développement, alors même qu’elles contribuent activement à cet effort de recherche.
Créé notamment par les entreprises de l’agroalimentaire du Nord – Pas-de-Calais, dont certaines à notoriété internationale localisées dans le Pas-de-Calais – Ingrédia, Roquette Frères, McCain –, le pôle « nutrition-santé-longévité » compte, à ce jour, 1 000 chercheurs, dont 650 travaillant directement sur ses thématiques, et plus de 9 000 emplois répartis sur l’ensemble du Nord – Pas-de-Calais, tout particulièrement sur les territoires ruraux où sont implantées ces entreprises agroalimentaires.
Pour encourager leurs efforts en matière de recherche et développement, l’État a mis en place des dispositifs d’aides financières et fiscales, comme le crédit d’impôt recherche, pour les entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité. Ces mesures sont intéressantes, à condition de pouvoir en bénéficier, ce qui n’est pas le cas, monsieur le secrétaire d’État, pour certaines entreprises implantées sur la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, qui participent pourtant activement aux projets de recherche et développement portés par le pôle « nutrition-santé-longévité ».
Ainsi, le fait de n’avoir pu profiter du crédit d’impôt recherche n’est pas sans conséquences pour ces entreprises, qui, faut-il le souligner, consacrent de gros moyens financiers à la recherche et développement. Par ailleurs, alors que d’importants investissements pourraient être réalisés à Saint-Pol-sur-Ternoise, ces entreprises ne peuvent pas non plus bénéficier d’une autre aide de l’État, en l’occurrence la prime d’aménagement du territoire, la PAT.
Il faut savoir que ces entreprises sont des gros employeurs : dans le Ternois, plus de 2 000 personnes travaillent dans le secteur de l’agroalimentaire !
Monsieur le secrétaire d’État, la non-éligibilité de ces entreprises aux aides financières et fiscales de l’État pénalise fortement leurs projets de recherche et développement et constitue un frein au développement économique de tout un bassin d’emploi.
À l’heure où l’aménagement du territoire et la promotion de l’activité sur l’ensemble du territoire sont deux priorités, cette situation, qui aboutit, de fait, au délaissement des secteurs ruraux, est en contradiction avec les objectifs affichés.
Aussi, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous m’indiquer quelles mesures vous comptez prendre pour rendre éligibles ces entreprises aux dispositifs d’aides de l’État ?
Monsieur le sénateur, je vous demande tout d’abord de bien vouloir excuser M. Bruno Le Maire, retenu à son ministère.
Vous avez attiré son attention sur la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité « nutrition-santé-longévité » situé sur votre territoire, et sur les difficultés rencontrées par certaines entreprises pour bénéficier d’aides. Je tiens à vous apporter des précisions à ce sujet.
D’une part, l’objectif de la mise en place des zones de recherche et développement des pôles de compétitivité, décidée lors du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire, le CIADT, du 14 septembre 2004, était de concentrer l’essentiel des moyens de recherche et de développement du pôle sur son territoire, en proposant notamment des exonérations fiscales et des taux de subventions préférentiels, et de faciliter le développement des rapprochements entreprise/recherche/université au sein des territoires des pôles de compétitivité.
L’évaluation de la première phase de la politique des pôles de compétitivité conduite en 2008 a montré que les exonérations fiscales qui découlent de ce dispositif ont rencontré un succès limité. Elles ont donc été considérablement réduites lors du lancement de la phase 2.0 de la politique des pôles de compétitivité en 2009.
Lors du lancement de la phase 2.0 de la politique des pôles de compétitivité, ces zonages ont cependant été maintenus au motif qu’ils matérialisent l’ancrage territorial des pôles.
Néanmoins, une évaluation de la deuxième phase de la politique des pôles de compétitivité a été lancée ce mois-ci. Nous devons attendre les conclusions de l’évaluation qui précisera s’il est pertinent ou non de maintenir ces zonages pour la prochaine phase de cette politique. Dans cette attente, il n’est pas opportun d’envisager une modification de ce zonage de recherche et développement des pôles de compétitivité.
D’autre part, vous évoquez le soutien du crédit d’impôt recherche, CIR, envers les structures de votre territoire ayant une composante de recherche et développement.
Je tiens à vous préciser que le crédit d’impôt recherche est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des entreprises en matière de recherche et développement. Il peut bénéficier à toutes les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles soumises à l’impôt, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité ou leur territoire, et à condition que les activités de l’entreprise correspondent aux activités de recherche et développement qui sont retenues dans l’assiette du CIR, à savoir les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, les activités de recherche appliquée, les activités de développement expérimental.
Aussi, monsieur le sénateur, les acteurs économiques de votre territoire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’éligibilité, peuvent tout à fait prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
Enfin, les entreprises de votre territoire, même si elles ne sont pas concernées par le zonage des aides à finalités régionales, les AFR, peuvent également prétendre au bénéfice de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation, la PAT-RDI.
Celle-ci vise à soutenir l’augmentation de l’effort de recherche et développement des entreprises primées, conformément à la réglementation européenne. Depuis 2007, la PAT-RDI est désormais ouverte à l’ensemble du territoire national.
L’ensemble des entreprises ayant des activités de recherche et développement sur votre territoire peuvent donc bénéficier du dispositif de prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation, sous réserve d’être éligibles.

La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 1477, adressée à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai souhaité attirer une nouvelle fois l’attention du Gouvernement sur les difficultés liées à la sécheresse, et surtout sur les conséquences de celle-ci.
Élu d’un département qui compte, sur deux cent soixante communes, deux cent cinquante classées en zone de montagne, avec une altitude moyenne d’habitats parmi la plus élevée de France, la question posée porte sur les répercussions liées à cette sécheresse.
Conscient que la sécheresse du printemps et du début de l’été avait très fortement pénalisé les productions fourragères de mon département, je me suis permis d’attirer à plusieurs reprises l’attention de M. le ministre de l’agriculture à ce sujet.
En outre, le classement des zones sinistrées étant très discutable, j’avais également insisté sur cette situation très préoccupante, tout en m’interrogeant sur les inévitables anomalies liées au seul système ISOP – Information et suivi objectif des prairies – mis en place et utilisé dans la détermination de ce classement.
Le système est particulier, car on détermine la sécheresse à partir non du sol aride et des vaches qui regardent en l’air, mais des données par satellite ! Pour avoir été associé à cela, je peux dire, sans engager de polémique, que le système manque de bon sens !
Très sincèrement, mes visites dans la plupart des communes de mon département, la Haute-Loire, m’ont permis de confirmer l’étendue de cette sécheresse sur pratiquement l’ensemble de l’espace du département.
Le système satellitaire est reconnu comme étant très discutable en zone de montagne, particulièrement au-dessus de huit cents mètres. La vérité, c’est celle de la réalité du terrain, des granges partiellement vides, de l’inquiétude des éleveurs, d’une économie toujours plus tendue.
Depuis début septembre, – c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, si je peux me permettre cette image –, une nouvelle sècheresse s’est instaurée, aggravant fortement celle du printemps.
La Commission nationale de calamités agricoles, consciente de cette situation, a différé la décision de classement le 12 octobre dernier pour la reporter au jeudi 15 décembre, afin de prendre en compte les deux épisodes de sècheresse.
Monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous m’indiquer les décisions qui ont été prises lors de la Commission nationale de calamités agricoles de jeudi dernier ainsi que les délais dans lesquels les agriculteurs sinistrés, ces éleveurs, pourront percevoir les compensations dues à ce sinistre ?
Monsieur le sénateur, vous avez raison, notre pays a fait face à une situation de sécheresse exceptionnelle cette année, avec de très lourdes conséquences aggravant les difficultés des éleveurs.
Le Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, mobilise depuis la mi-mai tous les moyens pour leur venir en aide ; plusieurs mesures en faveur des agriculteurs sinistrés ont été rapidement décidées.
Le processus d’indemnisation au titre des calamités agricoles a été enclenché dès le 15 juin dernier et les premiers arrêtés de reconnaissance ont été pris le 12 juillet. Les premiers versements d’acompte sont intervenus dès le 15 septembre pour faire face à l’urgence.
La réalisation du bilan définitif des pertes repose sur une analyse de l’ensemble des sources d’informations à disposition : missions d’enquête réalisées auprès des exploitants sinistrés, simulation agro-météorologique ISOP, photo interprétation d’images satellitaires, publications du service statistique du ministère... Ces sources d’information sont croisées et recoupées, afin d’établir un constat fiable. La qualité des dossiers transmis par les préfets de département joue un rôle déterminant.
Un bilan définitif des pertes fourragères a été réalisé lors du Comité national de gestion des risques en agriculture, le CNGRA, du 15 décembre. Concernant, le département de la Haute-Loire, qui avait fait l’objet d’une reconnaissance partielle pendant l’été, le CNGRA du 15 décembre s’est prononcé favorablement pour une extension des zones reconnues en calamités agricoles.
Les taux de pertes définitifs sur les prairies qui avaient été plafonnés pour le paiement des acomptes sont en augmentation dans la majorité des départements, traduisant ainsi l’ampleur de cette sécheresse. En revanche, les pertes sur le maïs ensilage ont été revues à la baisse compte tenu des récoltes.
Le montant total de l’indemnisation des pertes dues à la sécheresse s’élève à 241, 7 millions d’euros. Les agriculteurs recevront, comme s’y était engagé le Président de la République, le solde de leur indemnisation avant le début du mois de février 2012.
Ces indemnisations représentent un élément essentiel du plan arrêté par le Président de la République, avec le report des échéances de prêts contractés par les éleveurs dans le cadre du plan de soutien exceptionnel à l’agriculture, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ainsi que le versement anticipé de 3, 7 milliards d’euros d’aides de la PAC au 17 octobre, complété par le versement de 3, 5 milliards d’euros à partir du 1er décembre.
Monsieur le sénateur, vous voyez qu’à la demande du Président de la République des efforts considérables ont été faits pour aider nos amis éleveurs dans tous les départements, notamment la Haute-Loire.

Monsieur le secrétaire d'État, j’adresse des remerciements au Président de la République, dont vous avez dit qu’il était à l’origine de ces efforts, ainsi qu’au Gouvernement, et je vous remercie de cette réponse qui reflète compréhension, vérité et solidarité.
Monsieur le secrétaire d'État, sincèrement, quand on a vécu ces problèmes, comme moi qui étais agriculteur voilà encore quelques années, je ne prétends pas qu’on les connaît mieux que les autres, mais au moins peut-on souvent mieux les comprendre.
M. Joël Guerriau applaudit.

La parole est à M. Joël Guerriau, auteur de la question n° 1479, adressée à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la France doit se battre face à une concurrence parfois déloyale sur le marché européen des fruits et légumes contre de nouveaux acteurs internationaux.
Depuis de nombreux mois, le Gouvernement exprime son souhait d’alléger le coût du travail agricole pour maintenir la compétitivité de ce secteur. Je salue la mesure d’exonération totale de charges patronales sur le travail agricole saisonnier, ce qui a permis de ramener le coût horaire de 12, 39 euros à 9, 43 euros. Ce sont 491 millions d’euros qui ont été consacrés au financement de cette mesure dans le projet de loi de finances pour 2012. Monsieur le secrétaire d'État, cette mesure demeure nécessaire. Mais, en raison de la concurrence mondiale dans ce secteur, ne faut-il pas l’étendre aux travailleurs permanents ?
Récemment, je me suis rendu à la visite d’une tenue maraîchère en Loire-Atlantique, à l’invitation du ministre de l’agriculture. Je connais sa détermination à agir. Ses dernières annonces indiquent que la mesure visant à alléger les charges patronales pour les salariés permanents ne concernerait que vingt de ces salariés par exploitation. Or, dans le maraîchage, par exemple, les entreprises emploient beaucoup plus de vingt salariés. De plus, ce critère n’incite pas les exploitants à créer des contrats à durée indéterminée.
Cet allégement est dégressif selon le niveau de revenu des salariés permanents : un euro d’exonération pour les personnes dont le revenu est de 1, 2 SMIC, puis une exonération dégressive jusqu’à 1, 4 SMIC et, enfin, une absence d’exonération au-delà de cette rémunération. Ce plan doit bénéficier d’un budget de 220 millions d’euros. Mais combien sera réellement consommé ?
De plus, à la demande de Bruxelles, certains secteurs bancaires et mutualistes bénéficieront de cet allégement. C’est d’autant moins qui sera consacré au travail et à la production sur le terrain.
Les critères retenus pour la mise en place de cet allégement apparaissent restrictifs et sélectifs. Ils excluent un grand nombre d’exploitations agricoles qui ont aussi besoin d’une telle mesure pour améliorer leur compétitivité face à la concurrence européenne et internationale.
En mars dernier, nos collègues députés Jean Dionis du Séjour et Charles de Courson avaient déposé une proposition de loi visant à exonérer totalement les cotisations patronales des salariés agricoles permanents. Cette mesure, compensée par la création d’une contribution assise sur les ventes en grande et moyenne surfaces de produits agroalimentaires, serait acquittée par les distributeurs.
Dans un contexte budgétaire très contraint, qu’envisagez-vous comme marges de manœuvre pour déployer, améliorer et optimiser la compétitivité de l’agriculteur français, acteur de notre croissance ?
Je vous remercie pour votre réponse éclairée sur ce sujet.
M. Jean Boyer applaudit.
Monsieur le sénateur, je vous demande tout d’abord de bien vouloir excuser M. Bruno Le Maire, qui ne peut être présent ce matin.
Vous avez appelé son attention sur les charges sociales dues par les maraîchers, au titre de la main-d’œuvre permanente qu’ils emploient. Le renforcement de la compétitivité de notre agriculture est un axe essentiel de la politique du Gouvernement en faveur de notre agriculture.
C’est la raison d’être du dispositif mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2012, qui permettra de réduire le coût du travail permanent en agriculture de 1 euro par heure au niveau du SMIC. La mesure doit entrer en vigueur après validation par la Commission européenne, avec effet à compter du 1er janvier 2012.
Cette mesure prévoit des exonérations de cotisations sociales pour tous les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole, dans la limite de vingt salariés sous contrats à durée indéterminée par entreprise. Elle s’applique donc à toutes les entreprises et non uniquement à celles qui comptent moins de vingt salariés. Cette exonération est totale pour les rémunérations comprises entre 1 et 1, 1 fois le SMIC. Elle est ensuite dégressive jusqu’à 1, 4 SMIC et devient nulle à partir de ce seuil.
Elle constitue une avancée significative en faveur de l’emploi dans l’agriculture puisque 116 700 entreprises devraient en bénéficier, soit 78 % des exploitations et entreprises agricoles, pour environ 222 000 contrats.
Elle représente 210 millions d’euros d’exonérations de charges sociales patronales supplémentaires. C’est un effort significatif dans un contexte de forte contrainte budgétaire – vous l’avez souligné – qui s’ajoute à celui concernant le coût du travail saisonnier, applicable depuis le 1er janvier 2010 : ces deux dispositifs ne sont donc pas alternatifs, ils sont bien complémentaires !
L’ensemble de ces dispositions montre que le Gouvernement a pris la mesure des enjeux du secteur agricole.
Par ailleurs, la réintégration des heures supplémentaires dans la base de calcul de l’allégement dit « Fillon » ne fait ni plus ni moins que poursuivre la rationalisation de ce dispositif, entamée l’année dernière avec l’annualisation de cet allégement général des charges sur les bas salaires.
Bien évidemment, les heures supplémentaires ouvrent droit à l’exonération générale au même taux qu’une heure « normale » quand bien même elles seraient mieux rémunérées. Il s’agit donc d’une réforme équilibrée qui garantit à l’employeur ayant recours aux heures supplémentaires un coût marginal du travail qui reste inférieur à son niveau d’avant 2007, et ce quelle que soit la rémunération versée, à concurrence de 1, 6 SMIC.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse : nous sommes conscients des avancées significatives que le Gouvernement a engagées pour aider le monde agricole. Lors de la visite du ministre de l’agriculture en Loire-Atlantique, les maraîchers ont d’ailleurs exprimé une certaine satisfaction à ce titre.
Néanmoins, force est de constater que les grandes surfaces ne jouent pas le jeu de la production française : trop souvent, en pleine saison, les promotions à répétition sur des fruits et légumes d’origine étrangère torpillent le marché. Ces pratiques détruisent non seulement des emplois mais nuisent à l’environnement, alors que les ventes devraient respecter un juste prix.
Il s’agit ici de combattre les distorsions de concurrence sur le coût du travail, en préservant le financement de la protection sociale dans le domaine de l’agriculture. Je conçois les réticences que vous éprouvez à soulever un nouveau sujet de mécontentement. Toutefois, puisque l’évolution économique mondiale l’impose, je souhaite vivement que la France puisse optimiser la compétitivité des exploitations maraîchères qui fournissent des fruits et légumes de saison, base de l’alimentation produite en France.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 1467, adressée à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur la situation des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation.
Nous le savons tous, la France a payé un lourd tribut lors des deux dernières guerres mondiales ; il est de notre devoir de défendre les enfants de ceux qui ont donné leur vie pour la France, qui ont subi les tribulations causées par l’absence d’un père et n’ont donc malheureusement pu bénéficier du capital social que ce dernier aurait constitué pour eux, à l’heure d’entrer dans la vie active.
Grâce à la loi du 27 juillet 1917, le statut de pupille de la Nation a été officiellement reconnu, et l’État s’est engagé à leur apporter un soutien financier. Toutefois, les évolutions réglementaires de 2000 et 2004 ont rompu l’égalité de fait entre tous les orphelins de guerre, en instaurant des catégories particulières d’orphelins pouvant recevoir une indemnisation.
Ces décrets contreviennent au principe de la loi de 1917 sur l’égalité de tous les orphelins devant la souffrance : en créant une échelle de valeur des décès, ils conduisent à une rupture d’égalité de fait entre les orphelins.
Aux associations qui l’avaient alerté, le Président de la République avait annoncé, en 2007, son intention d’engager les travaux de rédaction d’un décret unique qui remplacerait ceux de 2000 et 2004, en instituant une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre n’ayant pas bénéficié des précédentes mesures.
Un rapport a donc été remis en 2009, faisant suite à la demande du Président de la République. Les conclusions de ce rapport n’étaient absolument pas satisfaisantes puisqu’elles appelaient à créer des catégories d’orphelins fondées sur le concept de « barbarie ». C’est pourquoi elles ne pouvaient en aucun cas nous satisfaire. Toutefois, en tout état de cause – ce qui est positif – aucune mesure n’a été adoptée.
Monsieur le secrétaire d’État, il y a quelques jours, vous m’avez indiqué par courrier – et je vous en remercie – qu’une solution tenant le plus grand compte de l’équité et aboutissant à une reconnaissance apaisée avait été élaborée et qu’un décret unique était en cours d’approbation.
Vous le savez, les orphelins de guerre et les pupilles de la Nation sont placés dans une situation inadmissible depuis 2004. Les promesses du Président de la République datent de 2007 et, à ce jour, elles n’ont connu aucune traduction concrète.
Je souhaiterais donc entendre un engagement solennel de votre part et de la part du Gouvernement sur la date prochaine de publication d’un décret abandonnant la seule notion de barbarie et adoptant une mesure de réparation unique pour tous les pupilles de la Nation, sur le seul critère que l’ascendant soit mort pour la France.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Monsieur le sénateur, soyez assuré que je connais bien ce dossier extrêmement délicat.
Je mesure tout à fait l’incompréhension qu’expriment les associations depuis que ces deux décrets, l’un du 13 juillet 2000, que vous avez évoqué, et l’autre du 27 juillet 2004, ont rompu l’équilibre entre l’ensemble des orphelins en créant une indemnisation réservée aux orphelins de victimes de la Shoah ou de la barbarie nazie. Je connais leurs attentes : j’ai bien sûr reçu les représentants de l’ensemble des associations.
Également conscient de la différence de traitement dont sont victimes les autres catégories d’orphelins de guerre, le Président de la République – vous l’avez souligné – a demandé au Gouvernement, en mai 2007, de lancer dès que possible les travaux permettant d’aboutir à la rédaction d’un décret unique. Ce décret remplacerait et compléterait les décrets de 2000 et de 2004, en instituant une mesure de réparation pour les orphelins de guerre qui n’ont pas bénéficié des précédentes mesures. Un rapport a été rédigé, distinguant diverses catégories d’orphelins et d’indemnisations : toutes les associations que j’ai consultées se sont opposées à ce que l’on puisse ainsi « saucissonner » les réponses à apporter à ce problème. D’ailleurs, aujourd’hui, s’y ajoutent les associations d’orphelins de la guerre d’Algérie, lesquels demandent également à être indemnisés, ce qui peut se comprendre : de fait, que leur père soit mort en 1939-1945 ou pendant la guerre d’Algérie, les orphelins ont subi les mêmes conséquences.
Depuis lors, les différentes commissions qui ont été réunies sur ce sujet ont mis en exergue des divergences d’appréciation, d’une part entre les différentes associations d’orphelins, je le répète, d’autre part entre les associations d’anciens combattants et associations d’orphelins. En effet, certaines préfèrent « saucissonner », tandis que la grande majorité d’entre elles y est hostile.
Fidèle à l’engagement du Président de la République, le Gouvernement demeure néanmoins favorable à l’adoption d’un dispositif d’indemnisation consacrant la reconnaissance de l’égalité des orphelins de guerre, quels qu’ils soient.
Toutefois, la situation de nos finances publiques, qui résulte directement des crises mondiales, bancaire puis financière, de 2008 et de 2011, impose une rigueur et une vigilance budgétaires durables. Dans ces conditions, la parution d’un décret unique, dont le coût pourrait dépasser les 2 milliards d’euros, ne me paraît pas pour l’heure envisageable. J’espère que l’état de nos finances nous permettra de résoudre ce problème le plus rapidement possible.

Monsieur le secrétaire d’État, les éléments de votre réponse me satisfont, contrairement, bien entendu, aux conclusions que vous nous apportez.
Autant je suis heureux de vous entendre reconnaître que la Nation doit soutenir les orphelins de guerre, autant je peine à comprendre que nous ne soyons pas en mesure d’indemniser les enfants de ceux qui sont morts pour la France : un tel constat signifierait que notre pays est véritablement très mal en point !
Il s’agit là de choix budgétaires tout à fait majeurs : à mes yeux, il est nécessaire – y compris dans la période que nous traversons – de soutenir ceux qui ont souffert de l’absence d’un père et qui, partant, ont été défavorisés. Nous tous dans cette assemblée sommes libres de nous exprimer parce que d’autres ont sacrifié leur vie : il serait donc logique et normal que leurs orphelins puissent être indemnisés par la Nation. C’est pourquoi je regrette notamment la fin de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
Monsieur le sénateur, nous sommes bien entendu tout à fait conscients de notre devoir de mémoire et de la reconnaissance que nous devons témoigner à tous ceux qui sont morts pour la France, notamment durant la guerre de 1939–1945. Je vous assure que le Gouvernement tout entier est uni sur cette ligne.
C’est la raison pour laquelle je vous ai indiqué que nous étions favorables à une telle mesure.
Toutefois, vous conviendrez que, dans les circonstances actuelles, il est impossible de consacrer une somme d’un peu plus de 2 milliards d’euros à cet effort d’indemnisation : en effet, il faut commencer par rétablir nos finances publiques pour que cette mesure soit effective le plus rapidement possible, faute de quoi notre pays serait placé dans une situation budgétaire très difficile, dont les pupilles de la Nation eux-mêmes pâtiraient.

Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé des candidatures pour des organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- Mme Christiane Kammermann pour siéger au sein du Conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- Mme Colette Giudicelli pour siéger au sein du Conseil national du bruit ;
- Mme Marie-Thérèse Bruguière pour siéger au sein du Conseil supérieur de la coopération ;
- M. Gérard Roche pour siéger au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
- Mme Jacqueline Alquier pour siéger au sein du Conseil national de la montagne ;
- M. Jean-François Husson membre suppléant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
- Mmes Christiane Demontès et Colette Giudicelli pour siéger au sein du Comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse ;
- M. Yves Daudigny pour siéger au sein du Comité de surveillance de la caisse d’amortissement de la dette sociale ;
- MM. Gérard Roche et Alain Milon pour siéger au sein du Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
- Mme Christiane Demontès, M. René Teulade et Mme Isabelle Debré pour siéger au sein du Conseil d’orientation des retraites ;
- Mme Muguette Dini pour siéger au sein du Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ;
- Mme Isabelle Pasquet pour siéger au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
- M. Bernard Cazeau et Mme Catherine Génisson pour siéger au sein du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ;
- M. Dominique Watrin pour siéger au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
- M. Jean-Louis Lorrain pour siéger au sein de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
- M. Jean Desessard pour siéger au sein du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et M. Marc Laménie membre suppléant du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
- Mmes Catherine Deroche et Michelle Meunier pour siéger au sein du Haut conseil de la famille ;
- M. Claude Jeannerot pour siéger au sein du Comité d’évaluation de l’impact du revenu de solidarité active (RSA) ;
- M. Hervé Marseille membre suppléant du Conseil supérieur du travail social ;
- Mme Aline Archimbaud et M. Michel Vergoz pour siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer et Mme Catherine Procaccia et M. Michel Fontaine membres suppléants de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.

M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes et de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
Ces documents ont été transmis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale et sont disponibles au bureau de la distribution.
(Textes de la commission)

L'ordre du jour appelle l'examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales.
Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (projet n° 4, texte de la commission n° 198, rapport n° 197).
Le projet de loi est définitivement adopté.
Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à l'accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre 1938 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 6 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord relatif aux rapports intellectuels et artistiques du 19 décembre 1938 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique (projet n° 466 [2010-2011], texte de la commission n° 47, rapport n° 46).
Le projet de loi est adopté.
Est autorisée la ratification de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, signé à Bruxelles le 12 juillet 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne (projet n° 134, texte de la commission n° 189, rapport n° 188).
Le projet de loi est définitivement adopté.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis 2010, la France avance sur le chemin du désendettement, un chemin qui passe d'abord et avant tout par un effort historique de maîtrise des dépenses publiques.
Vous avez pu le constater lors de l'examen du collectif budgétaire, nous avons d'ores et déjà pris un an d'avance sur l'objectif de réduction des dépenses de l'État que nous nous sommes fixé. Nous allons plus loin encore avec ce texte, qui prévoit 1, 5 milliard d'euros d'économies supplémentaires au sein de l'État.
Nous avons beaucoup travaillé avec les députés pour répartir ces efforts et continuer à sécuriser notre trajectoire. Le résultat, c'est un déficit de l'État réduit de 3 milliards d'euros à l'issue de l'examen du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale, le solde négatif s'établissant désormais à 78, 8 milliards d'euros.
Ce budget atteste donc la détermination du Gouvernement et de sa majorité à poursuivre le redressement de nos finances publiques. En agissant ensemble en toute coresponsabilité, l'exécutif et l'Assemblée nationale ont démontré que la réduction des déficits était non seulement une nécessité absolue, mais aussi une priorité largement partagée.
C'est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement regrette que la Haute Assemblée soit restée à l'écart de cette mobilisation d'intérêt national. Ce budget aurait pu et aurait dû être l'occasion de nous rassembler face à la crise.
L'examen de ce texte a bien au contraire mis en lumière l'ampleur des divergences qui séparent la majorité présidentielle de l'opposition, l'Assemblée nationale du Sénat.
Car ce sont bel et bien deux conceptions irréconciliables de la politique budgétaire qui se sont exprimées tout au long de nos débats. Vous avez choisi, mesdames, messieurs les sénateurs, de défaire plutôt que de faire, …
… en vous engageant sur une « autre voie », en réalité une impasse dont vous avez dévoilé la vraie nature, celle d'une hausse brutale et généralisée des impôts, d'un choc fiscal de 32 milliards d'euros…
… qui empêcherait tout rebond de la croissance et pèserait sur le pouvoir d'achat et l'emploi des Français.
Faire le choix d'une augmentation généralisée des impôts, avec pas moins de 42 taxes créées ou modifiées dans ce seul projet de loi de finances, qui s'ajoutent aux 17 taxes créées ou augmentées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, constitue, je le dis très clairement, un contresens radical, sur les plans tant budgétaire qu'économique.
Sur le plan économique, tout d'abord, si ces 42 taxes sont loin, très loin même de former un ensemble cohérent, elles ont un point commun : elles alourdissent comme jamais la charge fiscale pesant sur les entreprises, …
… des entreprises qui devraient à elles seules acquitter 20 milliards d'euros d'impôts supplémentaires en l'espace d'une seule année.
En restreignant aussi fortement la déductibilité des intérêts d'emprunt, vous avez également augmenté l'impôt sur les sociétés de 50 %.
L'effet immédiat d'une telle mesure serait de rendre plus difficile l'accès au crédit et de donner un coup de frein à l'investissement, ce même investissement qu'à gauche l'on dit vouloir favoriser grâce à une modulation, à la baisse ou à la hausse, de l'impôt sur les sociétés. Comprenne qui pourra !
La réalité, c'est que la seule modulation de l'impôt que vous connaissiez, mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité sénatoriale, c'est la modulation à la hausse, et pour toutes les entreprises, petites ou grandes !
Ne vous y trompez pas, ce choc fiscal, ce sont tous les Français qui en paieraient le prix. On n'augmente pas, comme vous l'avez fait, la fiscalité sur les entreprises sans toucher la croissance et détruire des emplois.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Que ce soit au travers des salaires ou des prix, les effets s'en feraient immédiatement sentir sur le pouvoir d'achat des Français, lequel serait également la première victime de votre mesure « anti-heures supplémentaires ». Car en remettant en cause la défiscalisation des heures supplémentaires, vous retireriez 450 euros par an aux 9 millions de Français qui travaillent plus pour gagner plus, bien souvent dans nos petites et moyennes entreprises !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Et tout cela, sans la moindre justification. Car, comme les 35 heures l'ont amplement démontré, le partage du travail, cela ne marche pas, pas plus en période de croissance qu'en période de crise.
La raison en est simple : ce n'est pas en partageant la pénurie que l'on créera de la richesse ! De la même façon, ce n'est pas en alourdissant les charges ou les impôts qui pèsent sur les entreprises que l'on créera des emplois…
L'examen du projet de loi de finances pour 2012 par le Sénat l'a démontré, tous ceux qui refusent de faire porter l'effort d'abord sur les dépenses, tous ceux qui refusent de réaliser des économies et de parler de réformes, tous ceux-là condamnent notre pays à une cure d'austérité fiscale sans précédent, dont notre croissance ne se remettrait pas !
Mesdames, messieurs les sénateurs, la réalité est celle-ci : dans l'un des pays les plus imposés au monde, la hausse généralisée des impôts n'a pas d'avenir.
Le choix que vous avez fait d'un choc fiscal est donc insoutenable, à court terme comme à long terme.
Il est illusoire, en effet, de penser que vous pourriez augmenter les impôts d'une trentaine de milliards d'euros année après année : la France ne le supporterait pas !
Un jour ou l'autre, d'ailleurs, que vous le vouliez ou non, vous devriez faire face à cette évidence : le redressement de nos finances publiques suppose de réaliser des économies sur les dépenses… Vous ne pourrez pas ignorer éternellement cette nécessité !
Cette année déjà, vous auriez pu agir, dans le respect de l'article 40 de la Constitution. Vous pouviez redéployer certains crédits au sein des missions, faire des choix, bref, affirmer une stratégie.
Au lieu de cela, vous avez préféré rejeter purement et simplement les crédits de deux missions sur trois – oui, deux sur trois ! Résultat ? Le budget que vous avez adopté n'accorde par le moindre euro à l'enseignement, à la recherche, à la justice, à la sécurité ou à l'écologie…
En un mot, c'est un budget factice, un peu baroque, même, une sorte d'exercice de style qui apparaît profondément décalé.
Il est décalé d'abord par rapport aux enjeux du moment, mais il l'est aussi parce qu'il augmente les dépenses au bénéfice des seules collectivités locales, alors qu'il ne donne même pas à l'État les moyens de remplir ses missions essentielles ! (
Un tel choix, ni le Gouvernement ni l'Assemblée nationale ne peuvent y souscrire. Aujourd'hui, en effet, aucun acteur public ne peut se dispenser de participer à l'effort que nous demandons à tous les Français. L'État fait des économies, la sécurité sociale aussi : les collectivités locales ne peuvent pas se tenir à l'écart, pas plus qu'elles ne peuvent s'exonérer de cet effort collectif !
C'est pourquoi, avec l'accord des députés, nous avions prévu de demander aux collectivités locales une contribution de 200 millions d'euros à l'effort supplémentaire de réduction des déficits. Cette contribution, modeste, était très exactement proportionnelle au poids que pèsent, dans le budget de l'État, les dotations aux collectivités locales. Elle représentait une baisse de seulement un millième de la dépense publique locale !
Or cet effort, pourtant mesuré, a été jugé insoutenable par le Sénat, qui l'a remis en cause, avant de créer 450 millions d'euros de dépenses supplémentaires au bénéfice exclusif des collectivités locales… Rien, vraiment rien ne peut justifier une inégalité aussi flagrante et aussi radicale dans le traitement des acteurs publics !
Dois-je vous rappeler, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'alors que l'État diminuait le nombre de ses fonctionnaires, les collectivités locales, de leur côté, ont continué de recruter plus de trente-sept mille agents par an ? Nous voyons le résultat : hors mesures de décentralisation, la masse salariale locale a augmenté de 4, 3 % par an entre 2006 et 2010, au lieu de 0, 9 % pour celle de l'État…
Je le dis très clairement, je suis prête à poser la question des normes, encore trop nombreuses, qui pèsent sur les collectivités locales comme autant de charges supplémentaires. Résoudre ce problème était tout l'objet de la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales, présentée par Éric Doligé. Malheureusement, elle ne figure plus à l'ordre du jour de votre assemblée !
Rétablissez-la donc, madame la rapporteure générale !
Nous pouvons aborder ces questions ; mais il faut aussi que, dans le même temps, les collectivités locales deviennent des acteurs à part entière de la lutte contre les déficits.
Le fait est qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, il existe une seule stratégie crédible pour redresser nos finances publiques, et elle est très simple : priorité absolue aux économies sur les dépenses !
Les efforts, en effet, doivent peser d'abord sur l'État et les administrations, raison pour laquelle le projet de loi de finances pour 2012 entérine une baisse historique de 1, 5 milliard d'euros des dépenses de l'État.
Ces économies ont été décidées et réparties par le Gouvernement en toute coresponsabilité avec l'Assemblée nationale ; celle-ci a fait preuve d'une détermination et d'un courage auxquels je veux rendre hommage.
Tous les acteurs publics prennent leur part des efforts d'économies : l'État, bien sûr, qui continue de réduire son train de vie, mais aussi les opérateurs de l'État, appelés à contribuer davantage encore à la réduction des déficits publics. C'est ainsi que, par souci de bonne gestion, nous avons remis de l'ordre dans les taxes affectées, dont le dynamisme était parfois sans commune mesure avec les besoins réels des opérateurs de l'État…
Pour poursuivre et renforcer cet effort, mesdames, messieurs les sénateurs, notre méthode porte un nom très simple et très beau, celui de réforme.
Oui, ce sont nos réformes qui nous ont permis, dès cette année, de faire baisser les dépenses de l'État – fait sans précédent depuis 1945. Et ce sont elles, encore et toujours, qui garantiront le respect de notre trajectoire de retour à l'équilibre, laquelle repose majoritairement sur la maîtrise des dépenses publiques.
C'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre la réforme de l'État au moyen de la révision générale des politiques publiques, la RGPP.
Cette fameuse RGPP aura rapporté 15 milliards d'euros d'économies en 2013. Et d'ores et déjà, nous avons demandé à l'Inspection générale des finances de trouver des pistes d'action pour la période 2013-2016.
De même, pour poursuivre la maîtrise des dépenses sociales et tenir dans la durée l'objectif national de progression annuelle de 2, 5 % des dépenses d'assurance maladie, nous avons demandé aux deux inspections générales compétentes de nous aider à identifier de nouvelles sources d'économies.
Madame la rapporteure générale, la hausse des dépenses publiques n'a rien d'une fatalité ! Encore faut-il avoir le courage de lancer des réformes profondes, comme le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique d'État…
Car personne, mesdames, messieurs les sénateurs, non, personne ne peut prétendre recruter de nouveaux fonctionnaires tout en réduisant les déficits, ni remettre en cause la réforme des retraites tout en ramenant nos finances publiques à l'équilibre…
Prétendre le contraire, c'est mentir aux Français ! D'ailleurs ces derniers comprennent bien que l'on ne se désendette pas en augmentant les dépenses : c'est une vérité de bon sens qu'ils vivent au quotidien.
La priorité des priorités, pour l'État comme pour tous les ménages, doit donc être de réaliser des économies. Les recettes peuvent seulement jouer un rôle complémentaire, et encore à la condition de satisfaire à deux principes clairs : l'équité et la compétitivité.
L'équité, tout d'abord, est au cœur du projet de loi de finances pour 2012, qui instaure une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Celle-ci, je vous le rappelle, est assise à la fois sur les revenus du travail et sur ceux du patrimoine. Jusqu'au retour à l'équilibre des finances publiques, nous demanderons un effort supplémentaire aux Français les plus aisés. J'ajoute que ceux-ci paieront au total trois fois : sur les plus-values immobilières, sur les revenus du patrimoine et sur les revenus du travail.
L'équité préside également à notre effort de réduction des niches fiscales et sociales.
Comme l'OCDE vient de le souligner une nouvelle fois, la meilleure manière de renforcer aujourd'hui la justice fiscale est non pas de créer des tranches supplémentaires d'imposition sur le revenu comme vous le proposez, madame la rapporteure générale, mais de faire converger les taux réels et les taux faciaux d'imposition en réduisant les niches, comme le Gouvernement s'y est employé.
Nous avons en particulier instauré un plafonnement global des avantages fiscaux liés à l'impôt sur le revenu : nous le revoyons d'ailleurs encore à la baisse dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012.
La progressivité de notre système d'imposition, c'est bien l'actuel gouvernement qui l'a restaurée, en donnant un coup d'arrêt historique à ce que l'on appelait pudiquement « l'optimisation fiscale » !
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sous Lionel Jospin, mesdames, messieurs les sénateurs, un couple avec 1 million d'euros par an de ressources pouvait n'avoir rien à payer au titre de l'impôt sur le revenu, s'il choisissait les bonnes niches... Compte tenu du plafonnement global des niches, ce couple paiera au moins 340 000 euros d'impôt sur le revenu en 2012, contribution exceptionnelle comprise !
En redonnant de la progressivité à notre système fiscal, en alignant la taxation des revenus du capital sur celle des revenus du travail ou bien encore en mettant fin aux effets pervers de l'impôt de solidarité sur la fortune, le Gouvernement auquel j'appartiens a fait la réforme fiscale dont notre pays avait tant besoin.
Il suffit de comparer – mettons, au hasard, avec l'Allemagne… On s'aperçoit alors que, si les plus hauts revenus sont davantage taxés en France, les classes moyennes le sont moins : cela est juste et c'est ce que nous souhaitons.
Prétendre le contraire, c'est tout simplement avoir un quinquennat de retard !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.
J'en viens au second maître mot de notre politique fiscale, la compétitivité.
C'est au nom de la compétitivité que, face à la crise, nous avons fait le choix de préserver tous les dispositifs fiscaux et sociaux qui soutiennent la croissance et l'emploi : je pense en particulier aux aides à l'emploi à domicile ou aux allégements de charges sur les bas salaires, qui ont permis d'amortir partiellement le choc des 35 heures.
La baisse du coût du travail est en effet la clé du renforcement de la compétitivité et de la création d'emplois dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, avec l'accord de l'Assemblée nationale, nous avons allégé les charges pesant sur l'emploi dans l'agriculture : nous avons voulu permettre à ce secteur de mieux résister à une concurrence internationale particulièrement intense.
Pour la compétitivité comme pour l'équité, les mots sont bien insuffisants ; seuls les actes comptent. Or nos actes me semblent parler d'eux-mêmes : nous avons supprimé la taxe professionnelle, qui pénalisait l'investissement des entreprises, cet impôt que Mitterrand qualifiait d'imbécile…
Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Nous avons aussi rénové le crédit d'impôt recherche pour donner un coup d'accélérateur à l'innovation qui prépare les emplois de demain.
Enfin, que ce soit en matière d'impôt sur les sociétés ou de TVA, nous avançons désormais sur la voie de la convergence fiscale avec l'Allemagne.
Mme Valérie Pécresse, ministre. La convergence budgétaire et fiscale est en effet notre meilleure arme face à une crise qui nous impose de nous unir pour agir ensemble de manière coordonnée.
Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Converger signifie faire ce que font tous les pays de la zone euro, que leurs gouvernements soient de droite ou de gauche : commencer par maîtriser les dépenses publiques avant d'avoir recours, de manière réfléchie, cohérente et ciblée à la fiscalité. Tous les pays de la zone euro agissent ainsi !

Ils vont dans le mur ! Nous coulerons tous ensemble et vous serez contente !
Dans ce contexte, si la France devait s'engager dans la voie divergente que le Sénat propose, elle se retrouverait isolée en Europe et sa crédibilité n'y survivrait pas !
Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, l'Assemblée nationale a fait le choix de rétablir le projet de loi de finances pour 2012 dans la version qu'elle avait adoptée en première lecture.
Je dois dire que, aux yeux du Gouvernement, ce choix était le seul responsable, même si je reconnais que les débats au sein de la Haute Assemblée ont permis d'affiner et d'améliorer certaines dispositions du projet de loi de finances, par exemple en matière de péréquation entre les collectivités locales.
Mais, sur l'essentiel, notre désaccord est profond, sans doute trop profond pour être surmonté.
Le Gouvernement en prend acte et le regrette, car la France aurait été plus forte si nous avions pu avancer ensemble sur le chemin du désendettement.
Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule stratégie crédible, celle qui inspire le projet de loi de finances pour 2012, en ce qu'elle protège une croissance encore vulnérable, répartit équitablement entre les Français les efforts nécessaires et réduit les déficits.
C'est ce projet de loi de finances, marqué du double sceau de la crédibilité et de la justice, que le Gouvernement a l'honneur de vous soumettre aujourd'hui une dernière fois !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. le président de la commission des finances et Mme Sylvie Goy-Chavent applaudissent également.

Monsieur le président, mes chers collègues, je constate que Mme la ministre, comme à son habitude, a adopté un ton de meeting électoral… Paroles ! Quant à moi, je m'en tiendrai aux actes, en m'attachant à mettre en évidence les ruptures qui existent entre les actes et le discours du Gouvernement.
Je tiens tout d'abord à rappeler que, depuis le débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, le 2 novembre 2011, nous aurons au total débattu pendant cent trente heures : nous avons donc eu le temps de confronter nos visions de la stratégie budgétaire, fiscale et économique que nous souhaitons pour la France et, je vous en donne acte, madame la ministre, elles sont très divergentes et certainement pas compatibles !
Aujourd'hui, mes chers collègues, il m'appartient en tant que rapporteure générale de vous présenter la position de la commission des finances après que la commission mixte paritaire, réunie le 12 décembre, n'est pas parvenue à trouver un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012.
Ce résultat n'est pas surprenant, compte tenu des divergences profondes qui opposent la majorité sénatoriale et la majorité gouvernementale dans le domaine des finances publiques.
Ces divergences sont résumées dans le texte de la motion n° I-1 tendant à opposer la question préalable, que la commission des finances a décidé de soumettre au Sénat. Permettez-moi de vous en exposer maintenant les principales.
D'abord, la trajectoire pluriannuelle construite par le Gouvernement repose sur des hypothèses de croissance surestimées. La confirmation nous en a été apportée par les dernières données que l'INSEE et l'Observatoire français des conjonctures économiques ont publiées : notre acquis de croissance pour 2012 sera négatif, laissant présager de très mauvais résultats, alors qu'il s'agira d'une année charnière dans la trajectoire pluriannuelle d'évolution des finances publiques.
Or le Gouvernement persiste à maintenir des hypothèses de croissance surestimées et des hypothèses d'évolution des dépenses publiques fantaisistes, mettant ainsi en péril la crédibilité des engagements européens de notre pays.

C'est donc qu'il faut tailler davantage et tout de suite dans les dépenses, n'est-il pas vrai ?

Monsieur le président de la commission des finances, je considère, comme je le répète depuis le débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, que, sur la durée d'une législature, nous devrions trouver des marges de manœuvre réparties à parts égales entre les recettes et les dépenses.

Relisez-moi donc : cela vous sera certainement utile pour nourrir vos interventions !
La politique fiscale du Gouvernement se caractérise par une succession de mauvais choix.
Après avoir fragilisé les recettes publiques en début de quinquennat avec la loi TEPA et la réforme de la taxe professionnelle – je rappelle que cette dernière a coûté 5 milliards d'euros de déficit à nos finances publiques –, le Gouvernement taxe maintenant à tout-va, par des mesures de rendement sans cohérence, tout en continuant d'affirmer à l'opinion qu'il s'oppose à toute hausse généralisée des prélèvements obligatoires – le projet de loi de finances pour 2012 comme le projet de loi de finances rectificative reflètent parfaitement ces choix…
En ce qui concerne les dépenses, le décalage entre le discours et les actes est encore plus prononcé, madame la ministre. Le Gouvernement se décrit comme le champion de la maîtrise des dépenses, mais procède à des ouvertures de crédits en fin d'année. Surtout, le Gouvernement annonce qu'il se passera de l'autorisation du Parlement pour procéder à de nouvelles mesures d'économie en cours de gestion. Il préfère détourner de sa fonction la réserve de précaution, dont on sait très bien, au demeurant, qu'elle ne suffirait pas à financer un nouveau plan de rigueur.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.

Enfin, le Sénat doit s'inquiéter de la politique du Gouvernement visant à miner la relation entre l'État et ses territoires, dans une période où il faudrait au contraire susciter la confiance. C'est vrai surtout pour le soutien à la croissance et à l'économie, là où les collectivités locales jouent un rôle décisif.
Pour toutes ces raisons de fond, vous comprendrez, mes chers collègues, que la CMP ait échoué.
Cela étant, le Sénat aura apporté au texte définitif certaines dispositions utiles que je veux rappeler.
Dans le domaine de la fiscalité du patrimoine, nous avons permis deux avancées.
D'une part, nous avions proposé, à l'article 3 bis E, de déplafonner, en baissant le taux, les droits d'enregistrement en cas de cessions de parts de sociétés. Nous escomptions 930 millions d'euros de cette mesure. L'Assemblée nationale a repris à son compte l'idée du déplafonnement, mais a introduit un barème dégressif. Finalement, cette mesure devrait rapporter entre 150 et 200 millions d'euros.
D'autre part, nous avions proposé de maintenir à 1, 1 % le taux du droit de partage, qui devait brutalement doubler et passer à 2, 5 % au 1er janvier, afin de financer l'allègement massif de l'impôt sur la fortune. L'Assemblée nationale ne nous a pas suivis, mais elle a permis que les personnes en instance de divorce à la date de promulgation de la loi de finances rectificative de juillet se voient appliquer le taux de 1, 1 %, quelle que soit la date effective de leur divorce.
Dans le domaine de la fiscalité des entreprises, deux points sont également à signaler.
D'une part, l'initiative du Sénat concernant le régime des jeunes entreprises innovantes a été reprise par les députés dans le collectif budgétaire, dans une version certes atténuée.
D'autre part, la proposition de notre collègue David Assouline et de la commission de la culture tendant à créer, à l'article 5 bis G, une taxe sur les cessions de titres d'un éditeur de services de communication audiovisuelle a aussi été reprise, mais dans une version profondément modifiée par le Gouvernement.
Plusieurs initiatives du Sénat en faveur de l'outre-mer figurent également dans le texte définitif.
Ainsi, comme le préconisait notre collègue Georges Patient à l'article 5 quinquies, le régime de suspension de TVA pour les installations et matériels utilisés pour l'exploration du plateau continental est supprimé ; celui de l'exemption des droits de douane est en revanche maintenu.
Les exonérations sociales du bonus exceptionnel de 1 500 euros, que M. Paul Vergès souhaitait, à l'article 26 bis, proroger de trois ans, seront bien prorogées, mais seulement pour un an.
L'initiative de Georges Patient et du groupe socialiste destinée à régler, à l'article 52 octies, la question des agriculteurs exerçant sans titre en Guyane est reprise.
L'article 52 quinquies, introduit sur l'initiative de Serge Larcher et qui vise à remédier au détournement de procédure effectué par certaines entreprises jouant des niveaux de taxation différents entre la Guyane et la Martinique, a été retenu.
Plusieurs points sont aussi à relever dans le domaine de la fiscalité immobilière et du logement.
À l'article 41, un compromis a pu être trouvé entre la position initiale et la position du Sénat, exprimée après l'adoption d'un amendement de M. Vincent Eblé : le rabot du dispositif « Censi-Bouvard » prévu en 2012 sera assoupli pour certains logements en maintenant l'avantage fiscal au taux de 2012 pour les engagements immobiliers intervenus avant le 31 décembre 2012.
L'article 41 quater, issu d'une initiative de Thierry Repentin, qui prolonge de deux ans l'application d'un droit fixe de 125 euros au titre de la taxe de publicité foncière en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier et de leurs unions pour leurs acquisitions de logements conventionnés, a été retenu par l'Assemblée nationale.
À l'article 46 bis, s'agissant du prêt à taux zéro plus, ou PTZ+, les députés n'ont pas souhaité relever le montant de l'enveloppe « générationnelle » à 1, 2 milliard d'euros comme le souhaitait le Sénat, mais l'ont néanmoins portée de 800 à 840 millions d'euros. Ils ont en outre retenu la suggestion de notre collègue Thierry Repentin d'étendre le bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements appartenant à un organisme d'HLM.
Enfin, il convient d'évoquer le débat sur les finances publiques, s'agissant notamment du dispositif de péréquation, sur lequel nos collègues François Marc et Pierre Jarlier avaient abondamment travaillé, à la suite de l'étude menée par le groupe de travail animé notamment par Charles Guené et Philippe Dallier sur le sujet.
Il me semble important de faire le point sur cette question, notamment pour ceux de nos collègues qui ne sont pas membres de la commission des finances.
L'Assemblée nationale a donné son accord au principe introduit par le Sénat d'un « indicateur de ressources élargi », qui résultait d'une proposition du groupe de travail de la commission des finances.
L'Assemblée nationale a retenu le principe d'un rapport annuel sur l'évolution des mécanismes de péréquation ; elle a en outre conservé certains des apports du Sénat quant à la définition du fonctionnement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, à partir des contributions de nos rapporteurs François Marc et Pierre Jarlier.
Les députés ont notamment supprimé les strates au profit du système de prélèvement logarithmique introduit par la commission des finances, qui gomme les effets de seuil ; ils ont également exclu les 150 premières communes éligibles à la DSU-cible de tout prélèvement et réduit de 50 % le prélèvement des 100 communes suivantes qui sont éligibles à cette dotation – rappelons que le Sénat avait adopté un amendement du groupe socialiste visant à exonérer toutes les communes éligibles à la DSU-cible et à la DSR-cible.
Les députés ont également repris la modification de la pondération des critères de reversement adoptée par le Sénat à la suite d'un amendement de Pierre Jarlier, en majorant à 60 % le critère du revenu par habitant – les critères de l'effort fiscal et du potentiel financier étant pondérés à 20 % chacun.
L'effort fiscal pris en compte dans les reversements a été déplafonné, alors que le Sénat avait proposé de relever le plafond de 0, 9 à 1 par un amendement de la commission des finances.
L'Assemblée nationale a également conservé la disposition introduite par un amendement du président Philippe Marini, qui vise à exclure de tout reversement les collectivités dont l'effort fiscal est inférieur à 0, 5.
La répartition des prélèvements et des reversements s'effectuera en fonction des potentiels et non des produits fiscaux, comme l'a voté le Sénat en adoptant un amendement de la commission des finances.
Enfin, la clause de revoyure que nous proposions est maintenue, même si la date de remise du rapport du Gouvernement est reportée du 1er septembre au 1er octobre 2012.
Les deux autres modifications adoptées par le Sénat ont été rejetées : le plafonnement des prélèvements au titre du FPIC et du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, le FSRIF, a été abaissé de 15 % à 10 % du potentiel fiscal et le revenu par habitant ne sera pas pondéré par le coût du loyer dans chaque région.
Enfin, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a proposé de nouvelles modifications au mécanisme du FPIC : son montant est réduit à 150 millions d'euros en 2012 et n'atteindra 2 % des recettes fiscales du bloc communal qu'en 2016.
Par ailleurs, le nombre d'ensembles intercommunaux éligibles aux reversements est porté de la moitié à 60 % du total du nombre total de ces ensembles.
Les établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, pourront, à la majorité qualifiée, modifier les modalités de prélèvement et de reversement des montants du FPIC entre l'EPCI et les communes membres, en prenant en compte les écarts de revenu par habitant et les insuffisances de ressources de chaque commune.
Si j'ai énuméré les apports auxquels le Sénat tenait et qui, pour partie seulement, ont été repris par l'Assemblée nationale, c'est parce que, madame la ministre, je réfute, et la majorité sénatoriale avec moi, ce que vous dites à l'envi, à savoir que le travail de cette majorité aura été purement virtuel. Ce n'est pas vrai, raison pour laquelle j'ai tenu à procéder à cette énumération sans doute fastidieuse, mais qui servira à l'information de nos grands électeurs.
La navette a été utile, puisqu'elle a permis de faire évoluer l'Assemblée nationale sur certains points, dont je concède toutefois qu'ils sont trop rares.
Cependant, la commission des finances a jugé qu'une nouvelle navette ne serait pas de nature à faire évoluer les positions, même si le Sénat rétablissait son texte à l'occasion de cette nouvelle lecture.
Elle a donc choisi de proposer au Sénat d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable sur le dernier projet de loi de finances initiale présenté par la majorité sortante.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis le début de nos débats, tant en commission qu'en séance, nous avons dressé le bilan de cette majorité sortante : le constat d'échec est patent !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l'on pouvait s'y attendre, la commission mixte paritaire réunie pour examiner le projet de loi de finances pour 2012 n'a pu parvenir à un accord sur un texte acceptable par les deux assemblées.
Ce désaccord ne nous inquiète pas, bien au contraire : il confirme que la majorité du Sénat a changé le 25 septembre dernier. Il est rassurant de constater que gauche et droite ne retiennent pas les mêmes options et que, dans le contexte actuel, l'orientation politique différente des deux assemblées ne peut que se traduire par des approches divergentes sur les questions des finances publiques et des choix budgétaires.
Les appels répétés à l'union nationale face à la crise sont un leurre, et votre politique constitue bien l'expression de choix clairs et partisans, madame la ministre.
Dans la logique qui anime le Gouvernement et les parlementaires de l'opposition sénatoriale, le projet de loi de finances pouvait fort bien se concevoir sur une ligne de partage entre réduction ou, pour le moins, maîtrise de la dépense publique, réduction du poids relatif des dépenses fiscales dans le produit de l'impôt et mise à contribution des collectivités locales, au travers d'un gel des dotations et de la création d'un dispositif de péréquation horizontale venant compléter la péréquation verticale des dotations de solidarité – on peut en effet se douter que ces dernières ne sont pas promises à la plus forte des évolutions dans les années qui viennent !
Ces orientations budgétaires visaient fondamentalement à prolonger l'effort de réduction des déficits, que la non-reconduction d'un certain nombre de dispositions mises en œuvre pour les seules années 2010 et 2011 rendait également plus aisée, de manière strictement comptable.
Dans son équilibre initial, le projet de loi de finances pour 2012 retenait la prévision d'un déficit approximatif de 80 milliards d'euros, somme largement corrigée par une hypothèse de croissance résolument optimiste que les plus récentes études de l'INSEE rendent désormais caduque, puisque nous devrions, d'ici à l'élection présidentielle, entrer dans une période de récession, s'il faut en croire ce que l'on nous annonce.
Il est fort probable d'ailleurs que cette récession a déjà commencé, et que le ralentissement de l'activité entraînera à son tour une contraction de l'emploi, en commençant par réduire le nombre de contrats de courte durée et l'emploi intérimaire, avant de provoquer une stagnation, sinon une baisse des recettes fiscales, laquelle ne sera bien entendu pas sans effets sur l'exécution du budget.
D'une certaine manière, cette récession annoncée et palpable constitue le point d'orgue d'un quinquennat présidentiel où nous aurons toujours couru après la croissance et l'activité, sans jamais rencontrer autre chose qu'une crise économique d'un tour nouveau.
Nous avons, pour notre part, toujours nié que la crise se serait déclenchée en 2008. La surchauffe financière de l'été 2008 et sa réplique actuelle, cette crise de la dette obligataire des États européens venus au secours de leurs secteurs financier et bancaire, ne sont pas le fait isolé d'une simple économie financiarisée qui se serait développée « hors sol », dans une espèce de quatrième dimension.
Elles ne constituent que la queue de la comète, mes chers collègues, la comète de la dérégulation des marchés financiers, que nous avons largement favorisée, en France, depuis les années quatre-vingt. Je pense en particulier à la loi bancaire de 1984, qui ne faisait que prolonger les ruptures de l'été soixante-neuf, quand Richard Nixon, président des États-Unis, suspendait la parité de l'or et du dollar pour financer, notamment, l'aventure vietnamienne.
Vous le voyez, mes chers collègues, nos maux ont des causes structurelles, mais aussi historiques. Souvenez-vous : en 1973, à quelques jours de distance, le ministre de l'économie et des finances d'alors, un certain Valéry Giscard d'Estaing, mettait un terme au droit du Trésor public de solliciter la « planche à billets » pour se refinancer, puis inventait l'un des plus remarquables produits financiers qui aient jamais été proposés à l'épargne publique, le fameux « 7 % » de janvier 1973 ! À l'époque, l'État émit pour 6, 5 milliards de francs, valeur 1973. Dans quel but ? Tout simplement pour compenser une moins-value de recettes fiscales liée à une certaine latence dans l'application et la généralisation de la TVA…
Souvenons-nous aussi qu'une bonne partie de l'emprunt Balladur de 1993 fut consacrée au financement de la suppression du fameux décalage d'un mois de la TVA !
L'avantage de ces petits rappels, c'est qu'ils nous montrent à l'envi que ce qui creuse les déficits publics réside fondamentalement dans la réduction des recettes fiscales, une réduction qui est devenue en quelque sorte la marque principale des politiques publiques depuis quelques années.
La majorité de gauche du Sénat a, dans sa grande sagesse, contrairement à ce que vous pouvez prétendre, madame la ministre, mis en évidence que la mobilisation de recettes fiscales nouvelles était l'une des conditions de la réduction des déficits et, surtout de l'engagement d'une nouvelle politique dans l'intérêt de notre pays et de nos concitoyens.
Oui, nous réaffirmons ici haut et clair qu'il existe bel et bien une autre politique.
Rendre toute son efficacité à l'impôt de solidarité sur la fortune, améliorer la qualité de notre impôt sur le revenu, supprimer une bonne part des dispositifs incitatifs qui polluent et pervertissent l'impôt sur les sociétés, tout cela était contenu dans le projet de loi de finances pour 2012 tel qu'il avait été voté par la majorité sénatoriale.
Que ces apports déterminants du travail sénatorial ne figurent aucunement dans le texte adopté par l'Assemblée nationale est sans doute regrettable, mais il ne doit pas nous faire oublier deux choses.
D'abord, il est finalement plutôt cocasse que ceux qui n'ont pas de mots assez forts pour vouloir réduire les déficits – comprenez le plus souvent en réduisant les dépenses publiques sans préciser forcément lesquelles, bien entendu – ont dû se remettre à l'ouvrage pour l'accroître de nouveau...
Ensuite, que deux conceptions des finances publiques aient finalement été exposées et validées par les deux assemblées constitue somme toute un élément clé du débat public.
Le vrai vote sur le projet de loi de finances pour 2012 n'a pas forcément lieu aujourd'hui, mes chers collègues. Il est même probable qu'il n'aura lieu dans le pays qu'entre avril et juin prochains, entre le premier tour de l'élection présidentielle et le second tour des élections législatives, c'est-à-dire que nous voterons aujourd'hui la motion tendant à opposer la question préalable déposée par la commission des finances sur le texte revenant de l'Assemblée nationale, en l'attente du jugement citoyen qui nous amènera à un travail de réécriture du texte aujourd'hui rejeté par le Sénat.
Et, comme le veut l'usage, je dis mille mercis aux fonctionnaires du Sénat, collaborateurs du groupe et assistants parlementaires, pour leur concours à la qualité de cette discussion enfin menée à son terme !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste-EELV.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce dernier projet de loi de finances du quinquennat du Président Nicolas Sarkozy est le symbole de l'incohérence, de l'instabilité et de l'inefficacité qui ont caractérisé l'ensemble de ses politiques fiscales.
Lorsque notre Haute Assemblée a débuté l'examen de ce projet de loi en première lecture, le Gouvernement semblait consacrer tous ses efforts au maintien du triple A pour notre pays. Or, ce triple A, si sacré, est aujourd'hui en bien mauvaise posture.

Non, mais vous nous dites que ce n'est pas grave, alors nous pouvons conserver le moral !
Monsieur le président de la commission des finances, je considère, comme beaucoup aujourd'hui, que nous sommes financièrement morts, physiquement vivants, politiquement… nous ne savons pas encore, mais vous entretenez l'espoir en estimant que, en matière politique, seule la mort physique est irrémédiable !

Après l'annonce, le 5 décembre dernier, d'un placement « sous surveillance négative » de la France ainsi que de quatorze autres membres de la zone euro, par l'agence Standard & Poor's, c'est l'agence Fitch qui a abaissé vendredi dernier la perspective de notre note, qui passerait de « stable » à « négative ».
Je ne tiens pas à m'attarder ici sur le « diktat » de ces agences, mais il conviendrait cependant de s'interroger pour savoir exactement si ce que l'on dit aux Français est une réalité ou si nous sommes des vendeurs d'illusions…
On nous annonce presque quotidiennement la très probable et prochaine dégradation de notre triple A, la seule inconnue étant le nombre de crans dont la France serait dégradée. Le Gouvernement a d'ailleurs changé de discours pour minimiser les effets d'une telle dégradation. Ce retournement semble pour le moins surprenant.
Cette dégradation aurait ainsi, comme le signale le directeur général de l'Agence France Trésor, des conséquences extrêmement lourdes et il déclarait récemment que « ceux qui prétendent qu'il ne se passera rien le jour où la France perdra son triple A se trompent complètement ». Il estime qu'une dégradation d'un cran de notre note représenterait un surcoût financier important. Et il ajoute : « Une perte de la note aurait des conséquences sur le reste de la zone euro et sur tous les émetteurs français, même les entreprises privées. »
Cette probable dégradation du triple A français tombe au mauvais moment, d'autant plus que l'INSEE a annoncé vendredi dernier que la France était entrée en récession.
Pour 2012, les économistes s'accordent sur un risque de récession, même sans aggravation de la crise des dettes souveraines. En revanche, le défaut de l'Italie, par exemple, plongerait très probablement toute la zone euro, non pas dans une phase de récession mais dans une véritable dépression.
Tout cela est alarmant.
Or, force est de constater que les accords survenus jusqu'à présent au niveau européen, sous l'impulsion du couple franco-allemand, n'ont pas permis de résoudre la question des risques tant d'aggravation de la crise des dettes souveraines que de la contagion. Et, pendant ce temps, la zone euro a besoin d'urgence de retrouver le chemin vertueux de la croissance.
En outre, l'incohérence des hypothèses sous-jacentes adoptées par le Gouvernement pour le projet de loi de finances pour 2012, renforce encore le manque de crédibilité de ce texte. Le Gouvernement a déjà lui-même révisé ses hypothèses de croissance à la baisse, les ramenant de 1, 75 % à 1 %. Or celles-ci continuent d'être soumises à d'importants aléas. Les prévisions de l'OCDE, publiées le 28 novembre dernier, prévoient une croissance de 0, 3 %.
Le Gouvernement ne semble pas s'inquiéter outre mesure de ces perspectives de croissance très alarmantes. Les plans de rigueur successifs qui nous sont présentés marquent l'absence d'une stratégie cohérente. Surtout, nous plongeons notre pays et l'opinion publique dans un climat de profonde incertitude, néfaste pour la croissance.
L'Observatoire français des conjonctures économiques, dans une estimation datant d'octobre, donc avant le « plan Fillon II », a estimé que les politiques restrictives prises par le gouvernement français réduiront la croissance de 1, 6 point en 2012.
S'il est nécessaire de redresser les finances publiques, il est indispensable de ne pas prendre des mesures qui affecteraient la croissance à long terme, comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment.
À ce propos, la suppression, que l'on peut considérer comme injuste et parfois même irresponsable, de la taxe professionnelle constitue une remise en cause inacceptable de l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Or ce sont ces collectivités territoriales qui soutiennent l'investissement dans notre pays…

… et il faut savoir – c'est une cote mal taillée – que 75 000 euros d'investissement correspondent à un emploi, de sorte que si, dans une collectivité, on réduit les investissements de 20 millions d'euros, cela correspond à 300 chômeurs de plus…

… et cela, le Gouvernement ne semble pas le mesurer. C'est ainsi qu'il y a une baisse injuste et injustifiée des concours de l'État aux collectivités.
Je souhaiterais d'ailleurs ici ouvrir une parenthèse.
Il y avait jusqu'à aujourd'hui une redevance sur les concessions hydro-électriques. En l'état actuel du droit, un sixième de cette redevance est reversé, à juste titre, aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. Alors que les députés avaient supprimé cette part réservée aux communes en première lecture, le Sénat, dans sa sagesse, l'avait rétablie en adoptant des amendements déposés par plusieurs membres de notre assemblée. Les députés, en nouvelle lecture, sont revenus à leur rédaction initiale tout en précisant que, dans le cas des plus petites installations, les communes pourraient recevoir une partie des recettes, fixée au maximum à un sixième de la redevance.
Je regrette personnellement que la volonté du Sénat et, surtout, les principes qui nous avait guidés dans cette démarche, n'aient pas été respectés.
Enfin, et c'est le plus important aujourd'hui, la France a besoin d'une réforme fiscale globale et courageuse pour répondre à la crise et retrouver la croissance.
La version du projet de loi de finances pour 2012 adoptée en première lecture par le Sénat avait le mérite de ne pas affaiblir les collectivités territoriales, d'introduire plus de justice sociale et fiscale et, enfin, de tirer les enseignements de la crise financière, notamment en introduisant une taxe sur les transactions financières, à laquelle les membres de mon groupe sont particulièrement attachés, comme ils le sont à l'impôt sur le revenu, qui doit conserver le caractère progressif dont il est doté depuis sa création, au début du XXe siècle.
En l'absence d'une perspective de conciliation entre nos deux assemblées, la majorité du groupe du RDSE apportera donc son soutien à la motion tendant à opposer la question préalable présentée par notre rapporteure générale.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le budget pour 2012 sur lequel nous allons nous exprimer au terme de cette nouvelle lecture, après l'échec de la commission mixte paritaire, sera peu ou prou celui qu'a voté l'Assemblée nationale en première lecture.
Peu de modifications du Sénat ont, en effet, été retenues par les députés, le débat principal portant sans doute sur le seul apport important du Sénat, au-delà des clivages partisans, concernant tout particulièrement la péréquation horizontale.
Sur ce sujet, nous pouvons regretter que les députés n'aient pas retenu comme critère de répartition du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales le revenu moyen pondéré par un coefficient – de 1, de 0, 8 ou de 0, 6 – permettant de prendre en compte le coût du logement.
C'était une idée défendue notamment par notre collègue Philippe Dallier, auquel, en la circonstance, je souhaite rendre hommage.

Nous nous félicitons néanmoins du maintien de la clause de revoyure au 1er septembre 2012, qui était la condition pour qu'une majorité accepte ici la mise en œuvre dès 2012 de la péréquation, qui ne saurait être repoussée ad vitam aeternam.
J'étais de ceux qui, tout en reconnaissant les interrogations que suscitaient les simulations dont nous disposions, ne souhaitaient pas que, face aux difficultés rencontrées, nous différions une fois encore la mise en œuvre de ce principe ; je souhaite également rendre hommage à notre collègue Charles Guené à cet égard.
Cette mise en œuvre ne se fera néanmoins qu'à hauteur de 150 millions d'euros en 2012, …

… au lieu des 250 millions d'euros prévus initialement, pour atteindre le milliard d'euros en 2016, avec des ajustements possibles dans le cadre de la clause de revoyure.
Cette application plus progressive doit permettre d'atténuer l'impact du prélèvement en 2012, qui pourrait poser effectivement problème pour certaines communes contributrices, malgré les ajustements opérés au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Nous nous félicitons également du maintien par les députés de la pondération du potentiel financier agrégé à hauteur de 20 %, du revenu moyen à hauteur de 60 % et de l'effort fiscal à hauteur de 20 %, alors que l'Assemblée nationale avait initialement pondéré le PFIA à hauteur de 40 %, le revenu moyen à hauteur de seulement 40 % et l'effort fiscal à hauteur de 20 %.
La prise en compte plus importante du revenu moyen nous était, en effet, apparue pertinente, afin de mieux prendre en compte les charges sociales pesant sur les communes et, d'une façon plus générale, les charges supportées par les communes et les intercommunalités.
Les députés ont également accepté l'exclusion du bénéfice du FPIC des ensembles intercommunaux ou des communes isolées dont l'effort fiscal est inférieur à 0, 5. En effet, ceux-ci ne sauraient être aidés et bénéficier de la péréquation sans avoir un minimum utilisé leur outil fiscal pour percevoir des recettes.
Par ailleurs, les 150 premières communes éligibles à la DSU-cible seront exonérées de prélèvement, leur EPCI prenant en charge le montant de ce prélèvement. C'était, là aussi, un point important.
En outre, la suppression des strates est bien confirmée en raison des effets de seuil constatés aux entrées et aux sorties. Ainsi que l'a souligné Mme la rapporteure générale, ces strates sont remplacées par l'application d'un coefficient logarithmique, qui vient pondérer la population de chaque ensemble intercommunal, afin de prendre en compte l'accroissement de la richesse avec la taille de la collectivité.
Quant aux autres mesures substantielles proposées par notre assemblée, elles ont quasiment toutes été rejetées par les députés, étant, pour l'essentiel, soit des mesures visant à supprimer des articles – autrement dit des mesures de « détricotage » du texte du Gouvernement par la majorité sénatoriale –, soit des propositions tendant à créer de nouvelles taxes – plus de 30 – ou de nouvelles niches fiscales, 17 au total.
Valider un choc fiscal de 30 milliards d'euros, dont 20 milliards d'euros pour nos seules entreprises, qui subissent déjà de plein fouet la crise économique, est irresponsable au regard de la situation actuelle. Mais nul n'est dupe : l'exercice n'était qu'affichage politique, puisqu'il demeurait totalement virtuel, le dernier mot revenant à l'Assemblée nationale.

Je peux comprendre que la majorité sénatoriale ne partage pas les choix du Gouvernement et exprime son point de vue. Pour autant, je regrette que vous ayez privilégié l'affirmation d'une opposition systématique, chers collègues.

… la recherche d'un échange aurait permis au pays, à la classe politique et au Sénat de sortir grandis.

Comment le Sénat peut-il être crédible en votant un budget excédentaire, alors que vous refusez, dans le même temps, les dépenses, qui sont sans doute, à vos yeux, insuffisantes ?

Peut-être auriez-vous préféré alourdir les prélèvements obligatoires, dont vous regrettez, par ailleurs, qu'ils augmentent dans les proportions que l'on sait ?...
Mes chers collègues, cet affichage n'est pas anodin dans le contexte qui est le nôtre et compte tenu de la crise que nous traversons, surtout sous le regard des agences de notation.
Nous ne pouvons donc que déplorer le manque d'unité nationale sur des sujets essentiels, alors que la crise perdure et que les mois prochains seront encore autant d'épreuves que notre pays devra traverser, et ce quelle que soit la majorité qui sera élue.

La motion tendant à opposer la question préalable que vous avez déposée en est une illustration : elle démontre votre refus d'aborder le débat de façon courageuse et lucide.
Le refus obstiné de la gauche de notre pays de voter la règle d'or témoigne de ce regrettable manque d'unité. Or le manque d'unité nationale renvoie au manque de gouvernance européenne, par ailleurs tant décrié par la gauche.
Pourtant, jamais autant de progrès n'auront été accomplis en aussi peu de temps dans la zone euro, sous l'égide du Président de la République française et de la Chancelière allemande.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.

Si la France devait voir sa note dégradée, ce n'est pas tant le pays qui serait sanctionné – d'autres, tels que l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, voire l'Allemagne, le seraient aussi dans la foulée – que les lacunes en matière de gouvernance de la zone euro et de l'Europe.
La gauche en France aurait beau jeu de faire porter la responsabilité d'une éventuelle perte du triple A sur le Président de la République, qui n'a pourtant eu de cesse d'être au feu pour essayer d'éteindre l'incendie, …

… mais il est vrai qu'elle est plus prompte à gloser qu'à faire de véritables propositions.
Le directeur de campagne de M. Hollande est-il crédible lorsqu'il déclare, parlant de l'action du Président de la République, qu'elle menace depuis cinq ans la signature de la France ? Tout ce qui est excessif est insignifiant, …

Dégrader les notes des pays membres de la zone euro reviendrait à élever de nouveaux obstacles – certes, ils ne sont pas infranchissables, mais il n'en reste pas moins des obstacles ! – sur le chemin de la résorption de la crise de la dette sur lequel la zone euro s'est pourtant bien engagée.
Les agences de notation qui prendraient cette responsabilité n'avaient pourtant pas vu venir la crise des subprimes aux États-Unis, ce qui prouve que leur mode de fonctionnement mériterait d'être revu…En tout cas, la création d'une agence de notation publique européenne indépendante est indispensable.
Dans ce contexte, et pour les raisons que j'ai évoquées, il apparaît donc essentiel, pour le groupe UMP, de voter, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances qui nous est aujourd'hui soumis en nouvelle lecture.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, nous voici de nouveau réunis après 130 heures de débats budgétaires et financiers, et ce dans un contexte très original.
En effet, c'est sans doute la première fois depuis de nombreuses années que l'on examine un projet de budget dont les paramètres ont à ce point évolué depuis la présentation de ce texte au mois de septembre dernier.
Les chiffres sont connus : un déficit de plus de 80 milliards d'euros, c'est-à-dire 362 milliards d'euros de dépenses pour 274 milliards de recettes. En 2012, la France devra donc emprunter sur les marchés financiers 180 milliards d'euros pour financer son déficit et le service de la dette existante. C'est dire si le socle est particulièrement important.
Or, en l'espace de trois mois, la situation s'est profondément dégradée, ainsi que l'a rappelé Mme la rapporteure générale, du point de vue tant de la conjoncture économique et, plus particulièrement de la croissance, que des conditions financières générales.
Au demeurant, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur a annoncé ce matin que le déficit du commerce extérieur explosera cette année, passant de 51 milliards d'euros en 2010 à 70 ou 75 milliards d'euros.

Excusez du peu ! Cela correspond à une augmentation de 50 % en un an ! Dans ce domaine aussi, on voit où en est la France…
Je veux souligner également la dégradation accélérée de la conjoncture générale, avec l'entrée en récession de plusieurs économies occidentales. L'économie d'endettement et de spéculation est aujourd'hui en train de montrer qu'elle est au « bout du rouleau », et les sommets européens ne parviennent pas à rétablir la confiance.
Bref, le diagnostic n'est guère rassurant, quoi que vous en disiez, madame la ministre, et nous ne pouvons pas vous rejoindre sur au moins un de ses éléments.
En effet, madame la ministre, vous avez indiqué, dans votre intervention liminaire, le répétant même à deux reprises, qu'il n'y avait pas d'alternative à la politique conduite par le Gouvernement. Selon vous, il n'y a qu'une solution, celle que le Gouvernement a adoptée !
S'il existe encore une démocratie parlementaire dans notre pays, permettez-nous de vous présenter nos propositions, comme nous nous y sommes employés durant plusieurs semaines.
Vous nous avez accusés de vouloir défaire plutôt que de faire ! Je regrette cette analyse, car nous avons formulé des propositions et fait voter un certain nombre d'amendements, tous plus réalistes les uns que les autres
Mme la ministre fait une moue dubitative.

Nous avons ainsi créé des recettes supplémentaires à hauteur de 11 milliards d'euros.
Nous avons opéré un tri plus ambitieux des dépenses fiscales improductives, car les niches fiscales sont, selon nous, une source à exploiter.
Nous avons manifesté notre souci d'une plus grande solidarité dans l'effort que doit aujourd'hui consentir notre pays, en prévoyant une plus grande progressivité des impôts, notamment de l'impôt sur le revenu, avec la création d'une tranche supplémentaire.
De même, dans un souci de solidarité, nous avons souhaité activer des leviers de croissance. C'est ainsi que nous avons proposé une revalorisation de la prime pour l'emploi.
Nous avons préconisé une plus grande justice fiscale à l'égard des PME, en votant un dispositif visant à solliciter plus les très grands groupes.
Nous avons favorisé les collectivités outre-mer, notamment au travers de quelques dispositifs plus spécifiques. D'ailleurs, certains d'entre eux ont été préservés par les députés.
Nous avons fait voter un certain nombre d'amendements pour le logement.
Enfin, nous avons présenté diverses propositions en faveur des collectivités locales et territoriales.
À cet égard, je regrette, madame la ministre, que le Gouvernement et la majorité des députés ne partagent pas notre point de vue selon lequel les collectivités doivent être des partenaires actifs dans le redressement du pays. Les différentes mesures que nous avions proposées pour revaloriser les dotations et favoriser la péréquation verticale n'ont pas eu l'heur de plaire au Gouvernement, ni à la majorité des députés.
Dans ces conditions, et en considération des 120 amendements votés – c'est considérable ! – aux conséquences budgétaires significatives, la question posée était simple : alors que les membres du Gouvernement en appellent à l'unité nationale autour de la règle d'or et qu'ils invitent le pays à se mobiliser et les collectivités à se serrer les coudes, votre perception des propositions émanant du Sénat allait-elle évoluer ? Le Gouvernement était-il prêt à anticiper cette fameuse règle d'or en acceptant certaines des propositions que nous lui avions soumises ?

La réponse, nous l'avons obtenue : c'est une fin de non-recevoir qui nous a été opposée.

Nos propositions, ils n'en veulent pas ! C'est une opération de communication !

Permettez-moi de vous le dire, mes chers collègues, cet appel à l'union sacrée n'en est pas un ! Il ressemble plutôt à un coup d'épée dans l'eau.
Vous avez rejeté systématiquement les propositions que nous avons formulées dans un esprit constructif. Ne nous dites donc pas qu'il s'agissait pour nous de défaire plutôt que de faire ! Tout ce qui émane de l'opposition est, à vos yeux, irrecevable ! En réalité, votre appel à l'union sacrée ne tient pas la route !
Vous avez conclu votre propos, madame la ministre, en disant que nous avions un quinquennat de retard, une expression qui vaut la peine d'être entendue…
Mais, à considérer le quinquennat qui s'achève bientôt, un chiffre est marquant, qui se suffit d'ailleurs à lui seul comme élément de diagnostic pour toute la période : 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires ! Tel est le bilan du fameux quinquennat de Nicolas Sarkozy, madame la ministre !
Pour notre part, nous aurions préféré pouvoir relancer la machine économique et financière de notre pays sans avoir à supporter ce lourd fardeau, qui pèsera demain sur les épaules du gouvernant qui aura à assumer la charge de la France.
Je terminerai mon intervention en tirant deux enseignements.
Premièrement, la loi organique relative aux lois de finances a incontestablement prouvé ses limites.

En effet, nous n'avons pas été en mesure de faire un travail très construit sur les dépenses du fait de toutes les difficultés de procédure qui nous en ont empêchés.
Deuxièmement, le travail d'évaluation et de simulation a également montré ses limites.
Le Parlement – en tout cas, le Sénat – n'a pas été en mesure de travailler dans de bonnes conditions. Cela prouve, d'une façon plus criante encore, la nécessité pour notre pays d'avoir une agence de chiffrage et d'évaluation indépendante, à l'instar de ce qui s'est fait récemment dans d'autres pays européens. Cela nous permettrait, me semble-t-il, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions.
Mes chers collègues, le Sénat s'est attelé à cette construction pendant des heures, des jours et des nuits depuis un peu plus d'un mois. Ce travail n'ayant pas porté ses fruits, puisqu'il n'a pas eu l'heur de plaire au Gouvernement, nous serons favorables à la motion tendant à opposer la question préalable qui nous sera présentée tout à l'heure par Mme la rapporteure générale.
Incontestablement, deux logiques s'affrontent, et le diagnostic du Gouvernement diffère aujourd'hui du nôtre.
Dans les prochains mois, c'est un projet pour l'avenir de la France qui sera débattu devant le pays. Cela nous conduira à énoncer d'une façon encore plus ambitieuse les différentes propositions que nous avons pu émettre à l'occasion de cette discussion budgétaire.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

: c'est le propre des fins de sessions et le fruit de la répétition des mêmes propos, des mêmes thèses, des mêmes oppositions, des mêmes incompatibilités, des mêmes certitudes.
Mes chers collègues, il s'agit là de la traduction tout à fait naturelle de ce que sont nos institutions ; il n'y a pas lieu de s'en étonner.
Toutefois, au-delà du débat général, que nous n'allons pas à nouveau reprendre, il est bon de souligner que, si le Sénat, dans sa majorité, s'est opposé aux principales options de ce budget, il n'en a pas moins fait correctement son travail sur toute une série d'aspects du projet de loi de finances, certes moins au centre de la stratégie budgétaire et financière. À tel point que, comme l'a rappelé Mme le rapporteur général, dix-neuf articles importants du texte résultent de nos délibérations ! Cela traduit un accord complet ou partiel de l'Assemblée nationale sur nos propositions.
Je voudrais bien sûr remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail, mais plus encore nos collègues de l'Assemblée nationale, et tout spécialement le rapporteur général, mon ancien homologue Gilles Carrez. En effet, même si la commission mixte paritaire n'a pas travaillé comme il serait souhaitable qu'elle le fasse, même si nous n'avons pas examiné, disposition par disposition, vote par vote, les positions respectives de chacune des deux chambres du Parlement, il n'en reste pas moins que, dans la nouvelle délibération de l'Assemblée nationale, le travail du Sénat a été pris en compte, pas autant que nous l'aurions voulu, naturellement, mais très correctement.
Je pense en particulier à l'exemple de la péréquation horizontale des budgets locaux, à laquelle nous accéderons un jour, dans un monde meilleur §et sur laquelle nous avons amplement délibéré.
Mes chers collègues, les délibérations du Sénat sur ce sujet ont été extrêmement utiles : elles nous ont permis de mettre le doigt sur ce qui faisait mal, que nous siégions d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle. Nous avons pu le faire grâce aux simulations que l'on nous a adressées, même si ce fut tardivement.
Ainsi, nos collègues députés, qui, en première lecture, n'avaient pas pu approfondir la question, ont pu s'appuyer sur les échanges que nous avons eus tant en commission qu'en séance publique. Nos délibérations ont, en quelque sorte, semé le doute dans leur esprit… Ayant eux-mêmes approfondi le sujet, ils sont arrivés à un dispositif transitoire qui, s'il n'est pas idéal, est tout à fait défendable.
Madame le ministre, j'en viens maintenant aux sujets de fond et sur nos responsabilités dans une aussi difficile période.
Puisque nous sommes en fin d'année et qu'il s'agit de ma dernière intervention dans l'hémicycle pour l'année 2011, …

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. … je me hasarderai, avec l'accord de mes collègues, à formuler quelques vœux.
Sourires.

Ces vœux s'adressent au Gouvernement, qui a la charge de l'exécutif, sous l'autorité du Président de la République.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur Baylet, que l'on apprécie ou non le chef de l'État, l'intérêt des Français et celui de notre pays est que nous arrivions à faire notre chemin le mieux possible dans les premiers mois de l'année 2012.
M. Jean Bizet et Mme Sylvie Goy-Chavent approuvent.

La pire des politiques, c'est la politique du pire ; c'est le dénigrement de soi-même, le dénigrement de son propre pays.

C'est la mise en évidence de toutes nos faiblesses, de toutes nos difficultés, de toutes nos maladresses. Or personne n'est à l'abri de faiblesses, de difficultés, de maladresses : elles sont inévitables !
Rires.

Mes chers collègues, je me permets simplement d'exprimer le vœu que l'on laisse agir ce gouvernement, compte tenu de la période, particulièrement difficile.
Les perspectives électorales des prochains mois n'excusent pas tout !

… ces illusions dont il faudrait sortir très vite !
Nous sommes à la veille d'élections tout à fait décisives : il n'est de l'intérêt de personne de contracter des accords factices ou de provoquer des rencontres de hasard. Nous sommes bien d'accord sur ce point !
Toutefois, nous devons tous être conscients que la situation que l'on trouvera le 1er juillet prochain, quels que soient alors les responsables, quel que soit alors l'exécutif, ne sera pas meilleure que celle d'aujourd'hui.

Il faudra la prendre en main avec énergie, avec le sens des décisions et sans perdre trop de temps dans les compromis internes et les réglages entre tendances ou entre formations, chacune devant recevoir son lot de consolations ou de satisfactions.

Mes chers collègues, nous voyons, dans le fonctionnement même de notre excellente Haute Assemblée, que, pour la nouvelle majorité, la voie est étroite si elle veut être crédible : vous le savez, et nous l'observons avec intérêt, une majorité complexe, une majorité plurielle, ce n'est pas simple à faire vivre !

Monsieur Carrère, ne simplifiez pas tout à l'excès ! Nous sommes dans un vieux pays, qui vit ses contradictions ; vous les vivez comme je les vis.
Je formule donc le vœu qu'en 2012, quelles que soient les convictions que chacun défendra, nous sachions éviter de dénigrer notre pays, de lui créer des difficultés artificielles à côté des difficultés, bien réelles, qui sont les siennes, et que nous ayons tout simplement le sens de l'intérêt général.

Personne n'a le secret du programme ou de la nouvelle stratégie fiscale qui contentera tout le monde, qui dynamisera la croissance, qui fera progresser l'équité, qui résoudra tous les problèmes et satisfera toutes les corporations.
Chacun sait que la solution pour demain nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de discernement, beaucoup d'équité.
Chacun sait que, vivant dans un monde imprévisible à un degré jusqu'alors inédit, nous avons tous droit à l'erreur.
Au terme de ces travaux, je veux donc simplement que nous sachions nous traiter respectivement avec la bonne foi que nous méritons, au détriment des attitudes toutes faites, des promesses vaines, des certitudes sans lendemain, lesquelles ne feront que renforcer nos fragilités et rendre encore plus redoutables les écueils qui sont devant nous.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Je suis saisi, par Mme Bricq, au nom de la commission, d'une motion n°I-1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,
Considérant que le projet de loi de finances pour 2012 s'inscrit dans une programmation pluriannuelle privée de signification, puisque reposant sur une hypothèse de croissance des dépenses publiques peu crédible et non étayée ;
Considérant que l'empilement des mesures de rendement qui a caractérisé les dernières lois financières trahit l'absence de stratégie gouvernementale en matière de prélèvements obligatoires et confirme la nocivité des principales réformes fiscales conduites depuis 2007 ;
Considérant que les habituelles ouvertures de crédits sollicitées par le Gouvernement en fin d'exercice manifestent l'insincérité de ses prévisions budgétaires et contrastent fâcheusement avec ses engagements de maîtrise de la dépense ;
Considérant que le Gouvernement, en prétendant réaliser des économies grâce à la réserve de précaution, détourne de sa vocation une procédure destinée à respecter l'autorisation parlementaire, et non à s'en dispenser ;
Considérant que la baisse injustifiée des concours de l'État aux collectivités territoriales, ajoutée aux conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l'équilibre des finances locales, mine la confiance qui prévalait entre l'État et les territoires ;
Considérant que le projet de loi de finances pour 2012 est dépourvu de substance, la plupart des mesures dites « de redressement » étant soumises au Parlement à la faveur de projets de loi de finances rectificative examinés dans la précipitation ;
Considérant que l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture sur la plupart des votes du Sénat ;
Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 203, 2011-2012).
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme la rapporteure générale, auteur de la motion.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai présenté dans la discussion générale les motifs pour lesquels nous avons déposé cette motion tendant à opposer la question préalable. Qu'il me suffise de vous inviter à la voter.

M. François Trucy. Le Gouvernement trouve la motion « relativement défendable » !
Rires sur les travées de l'UMP.
Je profite de cette prise de parole pour remercier tous les sénateurs de leur assiduité, de leur ténacité ainsi que de ce qu'ils ont apporté aux débats budgétaires qui nous ont occupés ces trois derniers mois.
Je pense notamment à la question délicate que Philippe Marini a de nouveau évoquée, celle de la péréquation, …
… et notamment de la péréquation horizontale, qui a donné lieu sur ces travées à beaucoup de débats et qui nous a permis in fine d'aboutir à une solution à mes yeux plus porteuse d'équité entre les communes et, en tout cas, plus prudente.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de tous ces apports !
Je rappelle toutefois que le Gouvernement est contre la motion.
M. le président de la commission des finances applaudit.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Joseph Stiglitz résume d'une formule les politiques menées par les dirigeants européens depuis quelques années : « On s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic ».
Sourires.

En somme, Mme la ministre nous a expliqué que le Sénat avait déplacé les fauteuils un peu trop à gauche, et qu'il fallait les repousser vers la droite. Toutefois, elle ne nous a rien dit du cap pris par le Titanic ni de sa destination…
Pour Mme la ministre, le Sénat aurait établi un budget fictif : l'est-il plus que celui qui est proposé par le Gouvernement, s'agissant notamment du taux de croissance qu'il suppose et de l'impact des décisions budgétaires qu'il contient sur la croissance et sur les rentrées fiscales ? Tout à l'heure, nous en avons évoqué les effets, à savoir la dégradation de la balance commerciale. Quant à la suppression de la taxe professionnelle, elle devait, je le rappelle, nous libérer de toutes ces contraintes…
Le budget que nous avons construit serait décalé par rapport aux nécessités du moment, affirme Mme la ministre, avec toute l'autorité de sa fonction.
Mais que sont ces « nécessités du moment » ? S'agit-il de réduire l'endettement ou de diminuer le chômage ? Pour parler en termes keynésiens, qui faut-il choisir, les rentiers ou les travailleurs ?
Exclamations sur les travées de l'UMP.

Quoique Mme la ministre ait déclaré le contraire, cela fait au moins deux politiques possibles !
On a soutenu aussi, avec assurance, et compétence, qu'il était normal que les collectivités territoriales prennent leur part de l'effort.

Pour combien pèsent les collectivités territoriales dans la dégradation de nos finances publiques ?
On leur reproche d'avoir embauché 37 000 personnes, mais préféreriez-vous que l'on ait créé 37 000 chômeurs, voire 700 000, comme durant le quinquennat ?...
Visiblement, cela ne tient absolument pas debout.

En conséquence, vous l'aurez compris, le groupe du RDSE s'associera à la motion tendant à opposer la question préalable.
Personnellement, cependant, je suis quelque peu frustré, car le travail fait en première lecture n'a pas été repris par les députés, alors que des avancées avaient été obtenues, s'agissant en particulier des collectivités territoriales et du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales.
L'Assemblée nationale est ainsi revenue sur l'accord que nous avions arraché ici même et a ramené de 250 millions à 150 millions d'euros l'objectif de prélèvements pour la première année de fonctionnement du fonds. Ces quelques économies devraient, me semble-t-il, satisfaire le président de la commission des finances.

Il était dit que la nuit du 20 décembre ne serait pas celle du 4 août !
Curieux de voir la tournure que pouvait prendre le débat, j'ai déposé un amendement pour rétablir ce montant de 250 millions d'euros, qui me paraît tout de même le minimum du minimum ; mais celui-ci ne sera vraisemblablement même pas examiné.
Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.

Par ailleurs, j'aurais souhaité que, outre les collectivités percevant la dotation de solidarité urbaine, soient également exonérées de prélèvement celles qui touchent la dotation de solidarité rurale, comme le Sénat l'avait prévu initialement. Si l'Assemblée nationale a eu la très bonne idée de maintenir dans la liste les collectivités éligibles à la DSU-cible, elle aurait pu aussi penser aux collectivités éligibles à la DSR-cible au lieu de les en exclure.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je veux dire à quel point je me sens frustré à l'issue de ce débat : à l'heure où notre économie entre en déflation, les véritables problèmes ne sont décidément pas traités !

Au demeurant, les arguments motivant le vote de cette motion tendant à opposer la question préalable ont été parfaitement présentés par Mme la rapporteure générale et par François Marc.
Si j'interviens à cet instant du débat, c'est parce que, par certains de vos propos, madame la ministre, chers collègues de l'opposition sénatoriale, vous avez parfois donné l'impression de vouloir nous faire passer pour de mauvais Français, …

… sous prétexte que nous ne souscrivions pas au projet de budget présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale.
Ayant siégé dans ce même hémicycle entre 1997 et 2002, je ferai un bref rappel, parlant sous le contrôle de M. Marini, qui était alors rapporteur général du budget.

À l'époque, la majorité du Sénat était de droite. Quel sort croyez-vous qu'elle réservait aux projets de budget présentés par le Gouvernement Jospin et adoptés par la majorité de gauche de l'Assemblée nationale ?

Deux années de suite, la droite, au Sénat, a présenté un « contre-budget », pour reprendre le terme employé alors. Il s'agissait non pas d'améliorer le texte, mais d'en proposer un autre.

Et nous pourrions citer bien d'autres exemples. Souvenez-vous des lois de décentralisation !

M. Marc Massion. Mes chers collègues, la démocratie permet l'expression de deux logiques : nous avons chacun la nôtre. Nous l'avons répété au cours des 130 heures de débat, la majorité de gauche au Sénat n'entend pas faire la même politique que vous. Nous sommes ainsi un certain nombre à regretter que nos amendements n'aient pas été davantage pris en considération par l'Assemblée nationale, car nous avons fait loyalement notre travail !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Je mets aux voix la motion n° I-1 tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi de finances pour 2012.
Je rappelle en outre que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 78 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi de finances pour 2012 est rejeté.
Bravo ! et applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC. – Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.

Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt.