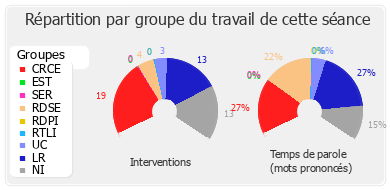Séance en hémicycle du 7 février 2008 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.

La séance est reprise.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes (n°201).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, monsieur le président de la délégation pour l'Union européenne, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 4 juillet dernier, je vous présentais les résultats du Conseil européen des 21 et 22 juin, qui venait de s'accorder sur un mandat pour une conférence intergouvernementale. Je vous faisais part alors de notre optimisme quant au rapide aboutissement de cette conférence intergouvernementale.
Puis les choses sont allées vite, conformément à la volonté du Président de la République, parce qu'il y avait une volonté commune pour sortir l'Europe de l'impasse.
Je ne reviendrai pas sur les dernières étapes d'une négociation serrée et délicate ; nous avons déjà eu l'occasion d'échanger à ce sujet à de très nombreuses reprises.
L'essentiel est là : pour la première fois, vingt-sept États signent un traité européen, et l'Europe concilie, après plus de dix ans de débats, approfondissement et élargissement.
Les chefs d'État de pays qui avaient dit « oui » et ceux de pays qui avaient dit « non » ont trouvé, sous l'impulsion de la France, de l'Allemagne, du Portugal et de tous nos autres partenaires, l'énergie d'écrire une nouvelle page de notre histoire commune.
Le 4 février, le Congrès a approuvé la loi constitutionnelle qui nous permet aujourd'hui de procéder à la ratification du traité de Lisbonne.
Que de chemin parcouru en quelques mois ! J'entends encore les sceptiques et les pessimistes de tous bords qui se lamentaient au printemps dernier sur l'incapacité de l'Union européenne à faire face à ses propres échecs, les Cassandre qui stigmatisaient la perte d'influence irrémédiable de notre pays dans une Union qu'il avait tant contribué à créer et à façonner, et redoutaient qu'on ne puisse aboutir à un nouveau traité fondé sur de nouvelles valeurs !
J'en retire pour ma part une confirmation de plus que nous avons collectivement créé, avec l'Union européenne, une organisation unique au monde, fondée sur le droit, la confiance et la réconciliation entre les peuples, une organisation qui, à chaque échéance importante, sait trouver l'équilibre entre les intérêts de chacun de ses membres et l'intérêt collectif.
Nous sommes plus efficaces à vingt-sept pour régler des problèmes qui nous concernent tous. Et, justement, ce traité nous permettra de mieux répondre aux défis auxquels l'évolution du monde nous confronte.
Avec le traité de Lisbonne, nous tournons la page des doutes et des atermoiements pour passer à une autre étape, plus constructive, car il est urgent d'agir pour une Europe plus démocratique, plus active, et plus protectrice aussi.
Le traité incarne en effet une Europe plus démocratique et plus active : à cet égard, nous remplissons bien la tâche que nous nous sommes assignés lors de la ratification du traité d'Amsterdam ou lors de la conférence intergouvernementale réunie en 2000, lorsque, conscients que nous étions de l'insuffisance des traités, nous demandions le renforcement de la démocratie européenne.
C'est le cas avec le droit d'initiative citoyen et avec le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, qui devient enfin un véritable colégislateur, à égalité avec le Conseil, tant en matière budgétaire que dans un nombre important de domaines passant dans le champ de la procédure de codécision.
C'est surtout le cas, mesdames, messieurs les sénateurs, avec votre nouvelle implication dans le processus de décision européen. Comme l'a déjà dit M. Haenel, c'est une « révolution juridique ». La représentation nationale pourra désormais davantage se prononcer sur les projets européens et veiller au respect des compétences entre les États et l'Union européenne à travers le contrôle de la subsidiarité. Pour la première fois, les parlements nationaux contribueront à la prise de décision européenne et seront les gardiens de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres.
Avec la présidence stable, avec le haut représentant pour les affaires étrangères, avec de nouveaux moyens juridiques, nous pourrons mieux répondre à la demande sans cesse renouvelée d'action de l'Europe dans le monde.
Agir à l'échelon national n'est plus suffisant, ni dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ni dans le combat pour une meilleure sécurisation de l'approvisionnement énergétique, ni pour lutter contre le changement climatique, ni pour dialoguer sur les migrations avec les pays d'origine, ni pour la promotion de la paix. À vingt-sept, incontestablement, nous serons plus efficaces.
Grâce à ces avancées, l'Europe pourra devenir un acteur global sur la scène internationale.
C'est aujourd'hui une urgence, et nous ne voulons pas que cette grande ambition se trouve réduite à une zone de libre-échange.
Pour exister aux yeux du monde, l'Union européenne a d'abord besoin de prouver son efficacité et sa puissance.
Le traité de Lisbonne incarne également une Europe plus protectrice, fondée sur un nouvel humanisme et sur un nouvel idéal européen. Pour la première fois, nos valeurs sont clairement affirmées.
Avec la Charte des droits fondamentaux, avec l'obligation de prendre en compte les objectifs sociaux de l'Union dans toutes les politiques européennes, avec la solidarité entre États membres face aux catastrophes naturelles, avec le remplacement de l'objectif de la concurrence libre et non faussée par celui de la protection des citoyens, avec la reconnaissance du droit des États d'offrir à tous un service public de qualité, sur tout le territoire de l'Union, peut-on considérer qu'il n'y a là aucun progrès dans les politiques sociales ?
Certes, mesdames, messieurs les sénateurs, le traité de Lisbonne ne réglera pas tout. (Ah ! sur les travées du groupe CRC.)
Un traité n'est jamais un projet. Il permet d'en inventer un et de le préserver, de passer des intérêts communs à l'idéal commun.
À cette fin, il faut d'abord que le traité entre en vigueur le 1er janvier 2009 et, pour cela, il faut que l'ensemble des États membres l'aient ratifié. C'est un processus long. C'est la raison pour laquelle le débat du Parlement français revêt, aujourd'hui, une dimension particulière.
Ce traité doit aussi nous permettre de mettre en oeuvre des politiques ensemble.
Je prendrai l'exemple de la coordination des politiques économiques. Elle sera ce que nous voudrons bien en faire.
Le traité nous permet de consolider la portée juridique des décisions prises par l'Eurogroupe, dans lequel ne décident que les membres de la zone euro, et d'unifier notre représentation dans les enceintes financières internationales. Mais c'est par la pratique et par la volonté politique que nous la ferons évoluer.
Je voudrais ainsi citer l'exemple de la démarche effectuée par le président de l'Eurogroupe, le commissaire en charge des questions économiques et financières et le président de la Banque centrale européenne en Chine pour aborder la question du taux de change entre l'euro, le dollar et le yuan.
Il en est de même pour la régulation financière, si indispensable dans ce monde instable.
Enfin, il ne dépend que de nous de faire en sorte qu'il y ait une plus grande réciprocité dans les échanges commerciaux et économiques pour maintenir nos activités en Europe.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont les pays de l'ancien bloc communiste qui, les premiers, ont ratifié ce traité.
Quel symbole ! Quel signe de confiance dans l'Europe nouvelle : c'est de Budapest, cinquante ans après la première insurrection contre le totalitarisme de l'après-guerre, qu'est venue la première ratification !
Redonnons confiance aux peuples, soyons au rendez-vous d'un monde qui attend et qui espère l'Europe.
Soyons fidèles à la France, à ce qu'elle a été pour l'Europe et à ce qu'elle sera demain pour une Europe plus politique et plus influente.
Poursuivons ensemble la formidable aventure humaine que nous avons entreprise ensemble - tous gouvernements et toutes majorités confondus, grâce en particulier aux grands « Européens » qui sont dans cet hémicycle et que je salue -, au service de la paix ainsi que du développement économique et social.
C'est au nom de cette aventure unique au monde que je vous demande ce soir l'autorisation de ratifier le traité de Lisbonne.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le vote du traité de Lisbonne mettra fin à une période de trouble et d'immobilité en Europe : de trouble, parce que les « non » français et néerlandais, exprimés par deux pays fondateurs de la Communauté économique européenne, ont ébranlé l'Union et l'ont fait douter de son avenir ; d'immobilité, parce que la règle de l'unanimité et la recherche de compromis improbables ou précaires empêchaient tout progrès significatif de la construction européenne et, à terme, la condamnaient à l'impuissance, voire au délitement.
Il faut savoir gré au Président de la République de s'être employé avec ardeur et conviction, dès son élection, à rechercher les moyens de sortir de l'impasse et, tout en tenant compte du vote des Français, à donner un nouveau départ à l'Europe.
Il faut également rendre hommage au Chancelier d'Allemagne, Angela Merkel, qui a su convaincre nos partenaires d'aboutir à un règlement acceptable par tous, conciliant le respect de la souveraineté des États membres avec une extension du domaine d'action communautaire.
Comme le constate M. Sauron, « traité réformateur plutôt que refondateur », le traité de Lisbonne ne se substitue pas aux traités existants et il ne les remplace pas : il les complète et les améliore.
Notre excellent rapporteur Jean François-Poncet, dans un rapport remarquable par sa clarté, son exhaustivité et sa concision, décrit avec minutie le dispositif du traité, les nouvelles instances qu'il crée, la nouvelle répartition des compétences comme les avancées importantes qu'il permettra. Aussi me garderai-je de paraphraser, avec moins de talent que lui, ses propos.
Nous ne pouvons que nous féliciter de voir l'Union européenne dotée d'une gouvernance plus efficace et cohérente, de compétences clarifiées, plus étendues et mieux définies, d'un contrôle démocratique perfectionné grâce à l'extension des pouvoirs du Parlement européen et de ceux qui sont reconnus aux parlements nationaux, grâce aussi et surtout à l'extension du domaine des votes à la majorité qualifiée qui rendra possible l'adoption de véritables politiques communes.
Le traité de Lisbonne nous fournit des outils pour forger ces politiques censées apporter des réponses et des solutions concrètes aux questions que se posent les citoyens européens comme aux grands problèmes auxquels ces derniers se trouvent confrontés.
Le Président de la République a énuméré les grands chapitres qu'il entendait ouvrir lors de la présidence française, au second semestre 2008. Il s'agit de l'immigration, de l'énergie, de l'environnement, de la politique étrangère et de défense et, sans attendre l'échéance de 2013, de l'étude des nouveaux fondements d'une politique agricole commune.
Les Européens doivent comprendre que, devant les défis que leur posent l'immigration incontrôlée, le réchauffement climatique, la raréfaction des énergies fossiles et les menaces mettant en cause leur sécurité, la coopération intergouvernementale est insuffisante. Dans ces domaines, seules des actions globales menées sur l'ensemble du territoire de l'Union et financées par le budget communautaire peuvent désormais conduire à des résultats indéniables.
Il est non moins clair que, sans une coopération véritablement harmonieuse entre les instances chargées d'élaborer les politiques budgétaires et fiscales et celles qui s'occupent de la politique monétaire, le développement de l'économie européenne sera constamment freiné. Par exemple, faute de disposer d'un taux de change unique, l'Europe se trouve désarmée devant les États qui utilisent leur monnaie pour promouvoir leurs exportations.
Enfin, pour préserver les acquis de la politique agricole commune, à laquelle la France est profondément et justement attachée, il nous faudra nous adapter aux nouvelles règles du jeu et nouer des alliances nous permettant d'obtenir la majorité qualifiée. Cette recherche demandera autant d'habileté que de constance.
Nous sommes tous conscients de l'importance que revêt, pour l'Europe, l'existence d'une véritable politique étrangère qui soit à l'image de la puissance démographique et économique de l'Union. Or il n'est pas sûr que les instances prévues par le traité favorisent son émergence, tant les attributions respectives du président du Conseil européen, du haut représentant, du président du Conseil des affaires étrangères et du président de la Commission risquent de se chevaucher. Cette complexité peut nuire à l'action commune : il faudra beaucoup de diplomatie et de souplesse pour éviter les conflits, et bien de l'imagination pour les transcender.
Toutefois, sans une défense européenne, la politique étrangère de l'Europe n'aura pas de consistance. La politique de défense ne verra le jour que si elle trouve sa place dans une OTAN rénovée, ce qui suppose un accord préalable avec les États-Unis. Le choix est non pas entre la politique de défense et l'OTAN, mais entre le maintien d'une vision et de structures de l'Alliance qui datent de la Guerre froide et une nouvelle répartition des tâches, au sein de l'Alliance, qui confierait aux partenaires européens une mission propre et une large autonomie.
La seconde condition est l'acceptation, par les pays de l'Union européenne, d'une contribution plus équilibrée à l'effort de défense, qui se traduirait par un accroissement des crédits budgétaires des États membres. L'Agence européenne de défense peut être l'instrument de cette ambition.
Enfin, je voudrais affirmer une conviction : le maintien et le renforcement de l'entente entre la France et l'Allemagne constitue une condition essentielle de la redynamisation de la construction européenne. Chaque fois que nos deux pays ont agi de concert et se sont efforcés de faire converger leurs politiques et leurs analyses, la construction européenne a réalisé des progrès décisifs.
Toutefois, pour que nos politiques convergent, encore faut-il qu'elles soient assises sur des valeurs partagées. La France aura du mal à convaincre ses partenaires si elle ne procède pas à un redressement rapide de ses finances publiques et à des réformes fondamentales qui ne fassent plus douter de son aptitude à s'adapter au monde moderne.

À ceux qui estiment que le traité de Lisbonne ne va pas assez loin dans le sens de l'unité européenne, comme à ceux qui jugent qu'il porte un coup fatal à l'indépendance ou à la souveraineté du pays, je livre cette réflexion formulée par Jean Monnet dans ses Mémoires : « Ceux qui ne veulent rien entreprendre parce qu'ils ne sont pas assurés que les choses iront comme ils l'ont arrêté par avance se condamnent à l'immobilité. Personne ne peut dire aujourd'hui la forme qu'aura l'Europe où nous vivrons demain, car le changement qui naîtra du changement est imprévisible ».
Oui, mes chers collègues, l'avenir de l'Europe réside dans le mouvement, car l'immobilité entraînerait inévitablement son déclin ! C'est pourquoi nous voterons ce traité, avec l'espoir qu'il libère des énergies qui conduiront l'Union sur la voie de prospérité et de la puissance.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, parmi les nombreux accords qui ont jalonné l'histoire de la construction européenne, trois traités ont marqué les avancées les plus décisives : le traité de Rome, qui a créé en 1957 une union douanière entre les six pays du marché commun ; l'Acte unique européen de 1986, qui a supprimé les protections réglementaires et les monopoles d'État fragmentant cette union douanière et qui a donc créé un espace économique sans frontières ; le traité de Maastricht de 1992, qui a fait naître la monnaie unique et lancé la coopération européenne en matière de politique étrangère, de défense, de justice et de police.
Le traité de Lisbonne mérite d'être considéré comme le quatrième texte fondateur. En effet, il résout le problème sur lequel l'Union européenne s'était cassé les dents depuis quinze ans et qui consistait à adapter les institutions de l'Union au choc de l'élargissement
Il s'agissait, en réalité, d'un double choc. Celui du nombre, tout d'abord. À vingt-sept États membres, bientôt à trente et davantage, l'Union, si elle était restée soumise à la règle de l'unanimité, n'aurait pu ni décider ni agir. L'Europe, pour éviter la paralysie, n'avait d'autre choix que de généraliser le vote à la majorité. À vingt-sept, par ailleurs, la règle de l'alternance semestrielle privait la présidence du Conseil européen de continuité et de visibilité. Et le tour de présidence pour des pays comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne ne revenait que tous les quatorze ou quinze ans !
Au choc du nombre s'est ajouté celui de l'hétérogénéité. Je pense ici non pas aux écarts considérables de niveau de vie et de développement entre les anciens membres de l'Union et les nouvelles démocraties de l'Est, mais à un autre choc : depuis le dernier élargissement, l'Union ne compte que six pays dont la population atteint ou dépasse quarante millions d'habitants, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, contre vingt et un dont la population est inférieure à dix millions d'habitants - certains États, comme Malte, Chypre ou le Luxembourg, n'en comptent même que quelques centaines de milliers.
En application des règles en vigueur, un député maltais au Parlement européen représente 67 000 électeurs, contre 860 000 pour un député allemand !

La pondération des votes au Conseil européen et au Conseil des ministres corrigeait cette inégalité, mais très imparfaitement. Aussi une nouvelle définition de la majorité qualifiée s'imposait-elle.
Enfin, la Commission, composée d'un commissaire par État, soit de 27 membres qui tendent tous à se considérer comme les porte-parole de leur pays, cesse de remplir le rôle qui lui est dévolu, c'est-à-dire celui d'un organe collégial veillant au respect des traités et défendant l'intérêt général de l'Union.
Pour reprendre une terminologie qui a beaucoup servi, mais qui résume bien la situation, l'élargissement exigeait un approfondissement. C'est cet approfondissement, recherché en vain pendant quinze ans à travers les traités d'Amsterdam et de Nice, que le traité de Lisbonne réalise.
Je n'ai pas le temps de rappeler la part essentielle prise par la Convention pour l'avenir de l'Europe, présidée par M. Valéry Giscard d'Estaing, dans l'élaboration des innovations institutionnelles qui ont été reprises par le traité de Lisbonne. Permettez-moi seulement de souligner le rôle que deux de nos collègues, MM. Hubert Haenel et Robert Badinter, ont joué, avec beaucoup de distinction, au sein de cette Convention.
Je ne reviendrai pas non plus sur les circonstances qui ont conduit au rejet par la France - je n'évoquerai pas le cas des Pays-Bas - du traité constitutionnel, lors du référendum du 29 mai 2005.
Toutefois, je ne veux pas ignorer la position de ceux qui, dans notre assemblée et hors d'elle, demandent que le traité de Lisbonne soit, comme l'a été le traité constitutionnel, ratifié par référendum.

Je ne m'arrêterai pas aux changements de vocabulaire. Le traité de Lisbonne ne parle plus de Constitution.

Les symboles de l'Union - drapeau, devise, hymne - ont disparu. La libre concurrence cesse d'être un objectif pour n'être plus qu'un moyen. Les services publics obtiennent officiellement droit de cité. Certains jugent que ces changements sont de peu de portée. Je ne partage pas leur sentiment, mais je le respecte.
Je veux, en revanche, attirer l'attention de la Haute Assemblée sur deux données essentielles qui justifient pleinement, à mes yeux, que le Gouvernement ait choisi de faire ratifier le traité par le Parlement.
Tout d'abord, le traité de Lisbonne fait disparaître la troisième partie du traité constitutionnel, celle qui rassemblait en un texte unique l'ensemble des dispositions économiques et sociales dispersées dans les traités et les textes antérieurs. Ce travail de collationnement, de codification ne changeait rien au fond, mais il a créé le sentiment, erroné, que l'Union mettait le cap sur une sorte de libéralisme débridé.
Que la construction européenne ait été, depuis le premier jour, une entreprise d'inspiration libérale ne fait évidemment aucun doute ! Mais le traité constitutionnel n'y ajoutait rien. Que cette vérité n'ait pas été reconnue tient au vent de polémique, pas toujours loyale, ...

... qui a soufflé sur le pays.
Le traité de Lisbonne ne reprend que la première partie du traité constitutionnel, celle qui concernait les institutions.

Or cette partie n'avait suscité, au cours du débat référendaire, que peu d'attention et presque aucune critique - et je fais partie de ceux qui ont animé une bonne cinquantaine de réunions électorales ! -, d'autant qu'elle ne modifiait pas l'équilibre existant entre les dimensions communautaire et intergouvernementale de l'Union.
Aux avancées accordées à la Commission européenne correspondaient, en effet, celles dont bénéficie le Conseil européen. La « supra-nationalité » ne progressait pas. Certains européens le déploraient. Mais le fait était là.
Dans le débat sur le recours à la procédure parlementaire, une seconde donnée doit, à mon avis, être prise en considération.
Contrairement au traité établissant une Constitution pour l'Europe, le traité de Lisbonne n'est pas un traité nouveau remplaçant tous les traités antérieurs. Il s'agit d'un traité « réformateur », comme ceux qui l'ont précédé. Il rassemble dans un texte unique un grand nombre d'amendements aux textes existants. Ceux-ci restent en vigueur, de sorte qu'il faut rapprocher chaque amendement du texte qu'il modifie pour en comprendre la portée.

M. Jean François-Poncet, rapporteur. C'est un véritable travail de chartiste !
Sourires

Lire et comprendre les 448 articles du traité établissant une Constitution pour l'Europe était - chacun l'avait admis - un exercice rebutant, auquel bien peu d'électeurs...

... avaient eu le courage de se livrer. Pourtant, c'était un jeu d'enfant comparé à l'effort qu'imposeraient à chaque citoyen la lecture et la compréhension du traité de Lisbonne.
Mes chers collègues, s'il est un texte qui appelle une ratification parlementaire, c'est bien le traité de Lisbonne.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Nous aurons l'occasion d'en débattre, puisque deux motions dont l'intérêt est indéniable ont été déposées. Nous y répondrons de notre mieux.

Il m'incombe, en tant que rapporteur, de vous rappeler maintenant les principales dispositions du texte qui vous est soumis. Je me contenterai de les énumérer de façon succincte.
Le traité de Lisbonne confère la personnalité juridique à l'Union européenne. Ce n'est pas neutre, car cela lui permettra de siéger dans les institutions internationales, telles que l'ONU, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Le traité de Lisbonne ne reprend pas le texte de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais il rend celle-ci juridiquement contraignante.

Le Royaume-Uni ainsi que la Pologne ont obtenu de déroger à cette obligation.

Dans le cas du Royaume-Uni, cette dérogation s'ajoute à celles dont elle bénéficie pour l'euro, la convention de Schengen, la coopération judiciaire et policière. Son statut de membre de plein exercice de l'Union européenne se trouve, de ce fait, implicitement posé.

Le traité de Lisbonne établit pour la première fois une répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Il distingue trois catégories de compétences, celles qui sont l'apanage exclusif de l'Union européenne, celles qui sont partagées entre l'Union européenne et les États, celles qui appartiennent en propre aux États, ce qui n'empêche pas l'Union européenne d'appuyer leur mise en oeuvre.
Le président du Conseil européen sera désormais élu pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.

Le traité de Lisbonne substitue une présidence stable, exercée à plein-temps, à la présidence semestrielle tournante instaurée par le traité de Rome.
La pondération des droits de vote entre les États disparaît. Pour réunir une majorité qualifiée, un vote devra rassembler au moins 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population. Ce système dit de « la double majorité » règle le différend qui a si longtemps opposé petits et grands États. Il fait droit tout à la fois au principe démocratique de la représentation proportionnelle des populations et à celui de l'égalité entre les États, qu'ils soient petits ou grands.
À partir de 2014, l'effectif de la Commission européenne sera réduit d'un tiers, soit dix-huit commissaires dans une Union à vingt-sept.
Le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui, à la demande du Royaume-Uni, ne portera pas le titre de « ministre des affaires étrangères de l'Union », sera désigné à la majorité qualifiée par le Conseil européen. Il cumulera cette fonction avec les attributions de commissaire européen chargé des relations extérieures, et il sera en outre chargé de coordonner les autres aspects de l'action extérieure de l'Union européenne. Il aura rang de vice-président de la Commission européenne.
Le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité disposera d'un « service européen pour l'action extérieure » - on n'a pas voulu l'appeler « service diplomatique -, qui rassemblera sous son autorité les services extérieurs de la Commission européenne, du Secrétaire général du Conseil européen ainsi que des membres des services diplomatiques des États.
Le traité de Lisbonne reprend les dispositions antérieures sur les coopérations renforcées et introduit la possibilité de créer, dans le domaine de la défense, ce que l'on appelle des « coopérations structurées permanentes » - il faut excuser cette logomachie bruxelloise !
Sourires

Par ailleurs, le traité de Lisbonne prend trois mesures destinées à combler le déficit démocratique dont souffrait l'Union.

Premièrement, il généralise la procédure de la codécision, qui aligne les pouvoirs législatifs et budgétaires du Parlement européen sur ceux du Conseil des ministres, le dernier mot en matière budgétaire revenant au Parlement.
Deuxièmement, il instaure un droit d'initiative citoyen.
Troisièmement, il dispose que, si un tiers des parlements nationaux estime que la Commission européenne n'a pas respecté le principe de subsidiarité, celle-ci devra reprendre l'examen du texte incriminé. Si 55 % des parlements nationaux prennent une telle position et que celle-ci est soutenue par une majorité des membres du Parlement européen, le texte visé ne peut être adopté.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, si la présidence du Conseil européen devient stable, il en va différemment des différents Conseils des ministres - agriculture, industrie, recherche scientifique... -, qui restent soumis à la règle de la rotation semestrielle entre les États membres.
Cela signifie concrètement que quatre personnalités se partageront la conduite de l'Union européenne : le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne, le président « tournant » du Conseil des ministres, et le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui présidera de droit le conseil Affaires étrangères. Il est évident que ce « quadripole » ne simplifiera pas le système, mais il a été l'un des éléments constitutifs de l'accord entre grands et petits pays.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'espère que vous me pardonnerez l'aridité de cette énumération que j'ai résumée à l'extrême, mais que le rapport écrit de la commission développe avec force détails.
Sourires
Nouveaux sourires.

Je formulerai maintenant quelques observations sur les problèmes que soulève la mise en oeuvre du traité de Lisbonne. Elles prendront essentiellement la forme d'interrogations.
La première interrogation concerne le rôle du président du Conseil européen. Il exercera son mandat à plein temps. Il est élu pour deux ans et demi et sera rééligible une fois, de sorte qu'il pourra rester en fonction pendant cinq ans. Ainsi, son mandat aura une durée identique à celui du président de la Commission européenne.
De quel type de présidence s'agira-t-il ? Le président du Conseil européen se contentera-t-il d'être un chairman, sur le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire de fixer les ordres du jour et de présider les réunions du Conseil, de faire en sorte, comme le traité l'y incite, qu'un consensus se dégage au sein du Conseil européen ? Ou bien veillera-t-il, entre les sessions du Conseil européen, comme le mandat à plein-temps qu'il exerce semble l'impliquer, à faire respecter par la Commission européenne et les Conseils des ministres les décisions et les orientations du Conseil européen ?
S'il entend sa mission de cette façon-là, le président du Conseil européen deviendra le coordonnateur suprême de l'action de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne le charge de représenter « à son niveau » l'Union européenne à l'étranger. Le fera-t-il seul ou se fera-t-il accompagner par le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ? Quelle autorité exercera-t-il sur ce dernier ? Qui portera la parole de l'Union à la Maison Blanche ?
De quels services le président du Conseil européen disposera-t-il ? Se pourrait-il qu'il soit un « général sans armée » ou bien disposera-t-il des centaines de fonctionnaires des services du Secrétariat général du Conseil des ministres ?
La deuxième interrogation porte sur le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui porte deux casquettes. Laquelle l'emportera sur l'autre : celle qu'il tient du Conseil européen et qui lui donne la haute main sur la politique étrangère et de sécurité ou celle qui fait de lui le vice-président de la Commission européenne ? J'ai posé cette question à Bruxelles, dans le cadre de la mission d'investigation organisée par la commission des affaires étrangères. Où installera-t-il ses bureaux ?

La question peut paraître secondaire. Elle ne l'est pas !
Fera-t-il allégeance au président du Conseil européen, dont il tient son mandat, ou au président de la Commission européenne et au Parlement européen, qui auront validé son élection comme membre de la Commission européenne ?

La politique étrangère et de défense commune s'imposera-t-elle à toutes les institutions de l'Union européenne ? Quid des États membres qui continueront de décider à l'unanimité de la politique étrangère et de défense, et dont les principaux - la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne - n'entendent pas renoncer à leur autonomie en la matière ?
La réduction du nombre des membres de la Commission aux deux tiers du nombre des États membres à partir de 2014 n'est pas, elle non plus, sans soulever quelques problèmes, bien que ce soit, à mes yeux, une très bonne chose.
La réforme atteindra-t-elle son but, qui est de restituer à la Commission son autorité en tant que gardienne des traités et force d'impulsion pour l'Union ? En application de la rotation égalitaire de ses membres, les grands États comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ne seront représentés à la Commission que pendant cinq ans tous les quinze ans. D'importantes décisions les concernant seront donc prises en leur absence. Les accepteront-ils sans discuter ? Ne faudra-t-il pas, tout en conservant le principe d'une Commission resserrée, réexaminer le mode de désignation de ses membres ?
On pourrait, par exemple, poussant plus loin le renforcement déjà engagé des pouvoirs du président, envisager de lui confier l'entière responsabilité de la composition de la Commission. C'est à lui qu'incomberait alors la tâche délicate de choisir les commissaires, en tenant compte de leur origine géographique et de leurs capacités personnelles, ainsi que des attentes de la majorité du Parlement européen.
Mes chers collègues, toutes ces questions que j'ai soulevées afin de vous faire part des interrogations que le traité pose au moment de son application, la présidence française de l'Union, qui s'exercera lors du second semestre de cette année, devra les examiner et trancher un certain nombre d'entre elles pour que le traité de Lisbonne puisse entrer en vigueur le 1er février 2009 si, à cette date, comme il est permis de le penser, tous les pays l'ont ratifié.
Le traité de Lisbonne dote l'Union des moyens qui permettent à une Europe élargie de fonctionner et de progresser. C'est ce que l'on attendait de ce texte. Mais rien n'est définitivement acquis. Beaucoup dépendra, comme toujours, des hommes et des circonstances.
Considérons les hommes d'abord. Si ceux qui président le Conseil européen, la Commission, le Conseil des ministres et le Haut représentant poursuivent en bonne intelligence les mêmes objectifs et s'assurent du soutien du Parlement européen, l'Union, en dépit du nombre de ses membres, répondra aux espoirs que les opinions placent en elle.
Si, au contraire, les innovations institutionnelles du traité de Lisbonne débouchaient sur des rivalités internes, ce qui n'est ni probable ni impossible, l'Union trébucherait. D'autres réformes plus audacieuses deviendraient alors nécessaires, telles que la création d'une présidence unique rassemblant les trois présidences mises en place par le traité de Lisbonne.
Les circonstances, elles aussi, pèseront d'un grand poids, comme elles l'ont toujours fait. Les progrès de la construction européenne ont toujours répondu aux défis intérieurs ou extérieurs auxquels l'Union était confrontée. Le traité de Rome répondait au défi que constituait l'échec de la Communauté européenne de défense, la CED. L'Acte unique répondait à la prise de conscience de la fragmentation de l'espace économique communautaire, que l'union douanière n'avait que partiellement unifiée. Le traité de Maastricht et la création de l'euro relevaient un double défi : celui de la réunification de l'Allemagne - terrible défi - et celui de l'instabilité monétaire engendrée par les fluctuations du dollar.
Les défis qui, demain, attendent l'Union européenne à vingt-sept sont considérables. Il y a la menace politique du fondamentalisme islamique avec, en perspective, un possible choc des civilisations. Il y a la menace économique, que constitue la concurrence de l'Asie avec les délocalisations dont elle menace notre continent.
Mes chers collègues, ces défis, et bien d'autres sans doute, l'Union ne les relèvera que si, tout en restant fidèle à sa devise « unis dans la diversité », elle met l'accent sur l'unité plus que sur la diversité.

M. Jean François-Poncet, rapporteur. Ce n'est que dans et par l'Union que l'Europe défendra ses intérêts et son identité.
Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le traité de Lisbonne va marquer un second tournant dans la construction européenne. Le premier tournant, c'était le traité de Maastricht, qui a parachevé la construction économique de l'Europe et commencé sa construction politique, tout en ouvrant la voie à un élargissement qui a fait passer l'Union de douze à vingt-sept membres.

Après le traité de Maastricht, nous avons vécu quinze ans de débat institutionnel sans frein. Comment mettre en oeuvre la nouvelle dimension politique de l'Union ? Comment préserver l'efficacité du processus de décision dans une Europe élargie ? Nous avons beaucoup tâtonné pour répondre à ces questions : le traité de Lisbonne est le quatrième traité institutionnel depuis celui de Maastricht, je le rappelle. Mais tout laisse à penser que, s'il est ratifié par tous, ce sera le dernier avant longtemps.

Après l'Europe économique, l'Europe politique aura enfin trouvé sa physionomie.
Bien sûr, cette physionomie peut déconcerter. Les points d'interrogation sont nombreux. Il est difficile de dire comment se répartiront les responsabilités dans l'exécutif tricéphale que ce nouveau traité met en place. Mais, après tout, à l'époque, on disait la même chose de la Constitution de 1958.

Elle aussi dérangeait les classifications des professeurs de droit. Cependant, au bout d'un demi-siècle, elle est toujours là.
Le président Pompidou avait fait à ce sujet une remarque fort juste : « Notre système, précisément parce qu'il est bâtard, est peut-être plus souple qu'un système logique : les corniauds sont souvent plus intelligents que les chiens de race ».

On pourrait sans doute dire la même chose de l'Union, telle que la dessine le traité de Lisbonne : pas vraiment fédérale, pas vraiment confédérale, elle est un système mixte évolutif - Jacques Delors disait « un objet politique non identifié » -, dont les équilibres dépendront largement des personnalités qui seront choisies pour les différentes fonctions. Et cette souplesse est peut-être ce dont une entreprise aussi originale que la construction européenne a le plus besoin.
Au sein de cette nouvelle donne institutionnelle, un point, à mon avis, n'est pas assez souligné. Il s'agit de la place considérable qu'auront désormais les parlements dans la vie de l'Union - Parlement européen et parlements nationaux -, comme vient de le souligner M. le secrétaire d'État dans son intervention.
On a souvent accusé l'Europe d'être une construction trop technocratique. C'est un procès un peu facile et assez injuste, car c'est la défaillance du politique qui crée le technocrate, et non l'inverse.

Mais il est vrai que l'Europe est restée trop longtemps l'affaire des seuls gouvernements. Le contrôle parlementaire demeurait très limité, en droit et plus encore en fait. Cette situation a commencé à changer au fil des traités ; le Parlement européen a conquis de véritables pouvoirs, mais dans certains domaines seulement. Les parlements nationaux, peu à peu, ont appris à mieux contrôler l'action européenne des gouvernements et à se concerter entre eux.
Le traité de Lisbonne va permettre d'aller beaucoup plus loin. Désormais, le Parlement européen, à de très rares exceptions près, va disposer d'un pouvoir de codécision sur la législation et le budget de l'Union. Plus rien d'important ne pourra se faire sans lui.
De manière plus novatrice encore, le nouveau traité va directement associer les parlements nationaux à la construction européenne. Leur rôle ne sera plus seulement de contrôler, plus ou moins bien, la politique européenne de leur gouvernement. Ils interviendront dans le processus de décision européen lui-même, pour veiller à ce que l'Union respecte le principe de subsidiarité, c'est-à-dire n'intervienne qu'à bon escient.
Pourquoi ce changement m'apparaît-il si important ? Lors du référendum sur le traité constitutionnel, j'ai animé quelque cent vingt réunions en faveur du « oui ».
Sourires

J'ai entendu très souvent certaines critiques sur l'Europe, émises pourtant par des électeurs qui allaient approuver le traité. Tout d'abord, l'Europe apparaît souvent trop lointaine, inaccessible, incontrôlable. Ensuite, certaines de ses interventions ne sont pas toujours comprises. Dans certains domaines - sécurité, action extérieure, soutien à la croissance - nombre de nos concitoyens estiment que l'Union n'en fait pas assez ; mais, dans d'autres domaines, ils ont tendance à penser qu'elle en fait trop ou qu'elle le fait mal. Personne ne comprend que l'Europe réglemente la TVA sur la coiffure, la qualité des eaux de baignade ou la protection des dunes. Elle doit être là pour aider à résoudre les grandes questions, non pour faire à la place des pays membres ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes et sans doute mieux, et qui, à la limite, ne regarde qu'eux.

Le traité de Lisbonne apporte une réponse à ces deux critiques. En associant les parlements nationaux à la vie de l'Union, il introduit un relais entre l'Europe et les citoyens. En instaurant un contrôle du respect de la subsidiarité, il tend à recentrer l'action de l'Union vers ses vraies missions.
Il ne s'agit pas, cela va de soi, de jouer les nations contre l'Europe. Il faut en finir avec cette suspicion à laquelle j'ai souvent été confronté, lorsque j'étais membre de la convention. Il n'y a pas d'un côté, les « bons Européens » à Bruxelles et, de l'autre côté, les « mauvais Européens » dans les capitales ! Ce doit être l'objectif de tous, parce que c'est l'intérêt de l'Europe de partager les responsabilités d'une manière qui rende les politiques plus efficaces, plus légitimes, plus proches des citoyens.
Le contrôle de subsidiarité permettra aux parlements nationaux de se faire entendre directement auprès des institutions de l'Union, y compris, le cas échéant, auprès de la Cour de justice dite « de Luxembourg ».
Si l'on considère le rôle important que nous jouons déjà et le rôle nouveau qui va s'y ajouter, on peut dire que les parlements nationaux feront désormais pleinement partie des acteurs de la construction européenne. D'ailleurs, le traité de Lisbonne en prend acte puisque, pour la première fois, un article relatif aux parlements nationaux figure dans le corps même des traités.
Cette situation nouvelle constituera également pour nous tous une responsabilité à assumer. Nous ne pourrons plus nous défausser, comme nous le faisons souvent les uns et les autres, sur Bruxelles. Devant telle ou telle décision européenne qui nous déplaît, on pourra nous demander ce que nous avons fait. C'est pourquoi nous devrons nous doter, ici même, au Sénat, le moment venu, d'un dispositif d'examen des questions européennes qui soit pleinement opérationnel.
Je n'entends pas anticiper sur le futur débat constitutionnel. Je ne suis pas non plus ici pour prêcher pour ma paroisse, comme on dit dans nos campagnes : au contraire, je crois que le bon dispositif sera celui qui fera participer l'ensemble des organes du Sénat, et par là l'ensemble des sénateurs, à l'examen des questions européennes.
Ce que je souhaite souligner, c'est qu'il sera absolument nécessaire d'adapter notre fonctionnement à la nouvelle donne. J'ai d'ailleurs bon espoir : avec les propositions du comité Balladur, nous sommes, à mon avis, sur la bonne voie. Un « comité des affaires européennes », inscrit au titre XV de la Constitution, ne serait pas concurrent, mais bien complémentaire des commissions permanentes, dont les compétences seraient préservées, voire amplifiées dans ce domaine. Notre assemblée disposerait alors de tous les instruments nécessaires pour faire face aux différents aspects de son rôle européen.
Je terminerai cependant mon propos par un regret. Malgré les avancées qu'il contient, le traité de Lisbonne ne règle pas toutes les questions concernant le contrôle parlementaire. En particulier, dès lors que l'Europe de la défense commence à s'affirmer, nous devons trouver une formule pour que les parlementaires nationaux et européens puissent en assurer un suivi régulier, sinon personne ne contrôlera démocratiquement cette Europe de la défense.

La question se pose également pour l'Europe judiciaire et policière, avec la nécessité d'une évaluation d'Eurojust et d'un contrôle sur Europol.
Ce sont des questions pour lesquelles le nouveau traité ouvre des possibilités, mais il faudra de la détermination pour qu'elles se concrétisent. J'espère, monsieur le secrétaire d'État, que la présidence française y contribuera.
Quoi qu'il en soit, je crois avoir montré, si besoin était, que le traité de Lisbonne marque une avancée considérable vers une Europe plus démocratique. C'est une raison essentielle - qui s'ajoute à beaucoup d'autres - pour approuver sans réserve ce texte qui va permettre à l'Europe, après deux ans d'incertitudes, de repartir enfin sur de bonnes bases.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous disposons désormais des instruments pour prendre en temps utile les bonnes décisions correspondant aux attentes de nos concitoyens.
Nos concitoyens sont très impatients, ne les décevons pas !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Après les remarquables interventions de M. le secrétaire d'État, du président de la commission des affaires étrangères, de M. le rapporteur, puis du président de la délégation européenne, je centrerai mon propos sur quelques points.
Je commencerai par un constat politique : mes chers collègues, mesure-t-on bien ce que représente la possibilité qui s'offre à nous, ce soir, de voter le projet de loi de ratification de ce traité ?
Il a fallu d'abord que la Convention, sous la houlette de son éminent président Valéry Giscard d'Estaing - convention à laquelle Hubert Haenel a participé, ainsi que notre collègue Robert Badinter, comme cela a été rappelé tout à l'heure - réussisse à faire passer des propositions.

Chacun a interprété, non sans quelques difficultés d'ailleurs, la signification du « non ». N'est-ce pas une leçon pour que, désormais, les référendums portent sur des questions simples ? Sinon, chacun peut en tirer des conclusions.
Ensuite, il a fallu le mérite et le courage politique du candidat à la présidence de la République Nicolas Sarkozy
Exclamations ironiques sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste

M. Jacques Blanc. Mes chers collègues, s'il n'y avait pas eu ce courage politique, jamais on n'aurait sorti l'Europe de l'ornière !
Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP.

Certes, Mme Merkel s'est mobilisée, au cours de la présidence allemande, mais avec le candidat devenu Président de la République, comme elle le rappelait voilà quelques jours à Paris en présence de Nicolas Sarkozy. C'est ainsi que - j'allais presque dire « par miracle » - vingt-sept pays se sont mis d'accord sur un texte.

Quand on connaît la diversité de la réalité, on mesure combien le fait d'arriver à une proposition approuvée par vingt-sept pays après l'échec des ratifications, est le fruit d'une situation politique exceptionnelle qui démontre la force de l'Europe.

Aujourd'hui, j'exprime le sentiment d'une grande majorité de l'UMP : oui, nous mesurons le résultat du courage et de la volonté politique de la France, qui a ainsi retrouvé sa capacité d'agir !

J'en viens au deuxième point. Si l'on regarde la réalité de ce traité - rassurez-vous, mes chers collègues, je ne reprendrai pas tout ce qui a été parfaitement dit - plusieurs éléments marquent une force politique nouvelle en Europe.
Oui, la démocratie en Europe avance grâce à ce traité, nul ne peut le contester !

Le Parlement européen voit son pouvoir de codécision étendu : c'est capital ! Le Parlement européen, ce sont des femmes et des hommes élus sur l'ensemble de ce territoire ; c'est bien une instance démocratique !

Le rôle des parlements nationaux sera renforcé. Cela impliquera sans doute, M. Haenel vient de le souligner, une certaine réorganisation, non pas pour supprimer une délégation à laquelle on peut appartenir en étant membre d'une commission permanente, mais pour donner à cette délégation, quel que soit son nom, une capacité nouvelle, tout en laissant à chaque commission la possibilité d'avoir une approche européenne forte.
Je reviens un instant sur le contrôle de la subsidiarité, même si je sais que cela vous fait sourire, mes chers collègues.
Mais non ! sur les travées de l'UMP.

La subsidiarité est un élément majeur ; l'Europe a compris qu'elle ne pouvait se substituer à ceux qui pouvaient faire aussi bien qu'elle, à un niveau différent. Ce principe répond à l'attente de ceux qui trouvaient que l'Europe en faisait parfois trop.

En application du principe de subsidiarité, il y a donc une possibilité de contrôle par les parlements et par le Comité des régions. De ce comité, personne n'en parle ici, sauf moi : il faut dire que j'en ai été le premier président et que j'ai été renouvelé hier dans mes fonctions de membre du bureau.
Tout le monde parle de la nécessité de rapprocher les citoyens des instances européennes. Les collectivités régionales et locales ne sont-elles pas à même de faire passer un message européen auprès des populations, dans les villes, les départements, les régions ? Vous savez, comme moi, que les élus locaux sont plus proches des femmes et des hommes de ces collectivités. Si ces élus participent à l'élaboration de la législation européenne par leurs conseils, s'ils contrôlent la subsidiarité et ont le courage de faire passer le message, on répondra à cette exigence de proximité.
Reconnaissons l'avancée que constitue la création du Comité des régions par le traité de Maastricht ! Ce Comité est doté d'un pouvoir de saisine de la Cour de justice, non seulement quand ses prérogatives ne sont pas respectées, mais aussi en cas de non-respect de la subsidiarité. Il existe donc un système de contrôle faisant intervenir parallèlement les parlements nationaux et les collectivités territoriales.
Je me réjouis d'ailleurs que notre délégation ait participé au réseau de monitoring de la subsidiarité mis en place par le Comité des régions, qui représente une réponse concrète aux besoins de proximité.
Le deuxième fait politique majeur, c'est que l'Europe s'est donné des objectifs nouveaux. À côté de la cohésion sociale et économique, l'Europe a désormais un objectif de cohésion territoriale. Cela signifie que l'Europe fera jouer la solidarité en faveur des territoires présentant un handicap. Je pense aux régions de montagne, aux régions périphériques et maritimes, mais aussi aux régions qui sont victimes de choc, industriel ou naturel. Cette nouvelle dimension devra imprégner les politiques européennes. Une telle perspective répond à notre souhait.
L'aménagement du territoire est une clé pour le développement durable. Or l'Europe s'engage pour le développement durable, ce qui suppose un aménagement du territoire équilibré et harmonieux. En allant dans cette voie, en luttant contre le réchauffement climatique, en jouant un rôle moteur dans le monde pour faire passer cette exigence de protection de l'environnement, l'Europe répond à l'attente des uns et des autres. Il y a une cohérence dans cette réponse. Le traité de Lisbonne n'est qu'un outil, mais il permet à l'Europe de prendre en main de telles politiques.
J'évoquerai un autre point dont on parle peu mais sur lequel la délégation a décidé de travailler, à savoir la consécration dans le traité de la politique de voisinage.
Mes chers collègues, la politique de voisinage ne concerne pas les pays candidats à l'élargissement. Au passage, permettez-moi de souhaiter, à titre personnel, que soit levée dans les évolutions constitutionnelles l'exigence de référendum pour les élargissements.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.

Quels territoires peuvent bénéficier de cette politique de voisinage ? Ne croyez-vous pas que le traité de Lisbonne apporte une perspective nouvelle pour donner corps à l'ambition du Président de la République sur l'Union méditerranéenne, ambition que nous pouvons tous partager ?

Mes chers collègues, la Méditerranée est ô combien traversée par les drames, les violences. N'est-ce pas une exigence pour l'Europe, pour la paix, pour la France que d'entraîner le bassin méditerranéen dans un mouvement inverse ? Ne croyez-vous pas que la politique de voisinage, certes bilatérale, conditionne l'avenir de notre pays, parce qu'elle peut concerner les bassins de la mer Noire, de la mer Baltique, mais surtout de la mer Méditerranée ?
Dans les Balkans, une politique de voisinage permettant de déboucher sur une situation nouvelle ne serait-elle pas un signe fort ? C'est la paix qui est en cause, la prospérité ! Il s'agit donc là d'une avancée dont on parle peu mais qui me paraît très significative.
Le préambule mentionne sans complexe l'héritage judéo-chrétien et humaniste !
Ne croyez-vous pas qu'en appliquant un véritable principe de laïcité au lieu de rejeter ou de nier ces héritages religieux - sans oublier l'influence musulmane -, l'Europe pourrait porter un message fort afin d'empêcher le choc des civilisations et apporter une réponse nécessaire à notre société ?
En cet instant, je suis sûr d'exprimer le sentiment d'une grande partie de l'UMP en disant que nous avons une chance formidable que de pouvoir consacrer un succès politique qui favorisera la mise en place d'outils permettant que se développent demain des politiques nouvelles au service de cette civilisation qu'incarnent les valeurs de l'Europe !
Nous respectons donc pleinement nos engagements politiques en nous mettant au service des femmes et des hommes qui attendent de nous des réponses à leurs angoisses - je pense au développement durable -, à leurs espérances - je pense à la paix, à la fraternité, au développement partagé - et en jouant un rôle nouveau d'équilibre dans le monde, et ce d'abord auprès de nos voisins.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la réunion du Sénat cette nuit en toute hâte est la parfaite illustration du mot d'ordre passé entre les chefs d'État et de gouvernement : se débarrasser au plus vite de l'étape de la ratification en contournant soigneusement les peuples !
Eh oui, monsieur le secrétaire d'État, vous avez au moins raison sur ce point, le mot d'ordre a été respecté : tout est allé très vite !
L'élaboration du traité, orchestrée par les États membres sans consulter ni informer les citoyens européens, a été particulièrement rapide entre mai et mi-octobre 2007. Même la méthode conventionnelle est passée à la trappe, monsieur Haenel, au nom de calculs politiques, partant du postulat d'une opposition de principe entre l'Europe et les peuples d'Europe. Ensuite, la signature du traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007, a lancé le top du départ de la course à la ratification.
Dans notre pays, après la révision constitutionnelle adoptée le 4 février dernier à la va-vite, le Gouvernement revient devant notre assemblée pour nous faire enregistrer le projet de loi de ratification, trois jours après.
Alors que le projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne a été adopté hier en conseil des ministres et voté cet après-midi à l'Assemblée nationale, la commission des affaires étrangères du Sénat n'a pas hésité à se réunir, dès ce matin, avant le vote du texte à l'Assemblée nationale, ...

... faisant fi de l'article 42 de la Constitution française de 1958, ...

... qui dispose : « La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis. » Je vous l'ai d'ailleurs fait remarquer, monsieur de Rohan.

La parole est à M. le président de la commission, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères. Je tiens à préciserque, ce matin, la commission n'a fait qu'adopter le rapport de M. François-Poncet, ce qui est parfaitement son droit. Ce n'est que, lorsque nous nous sommes réunis une deuxième fois, à dix-sept heures, que nous nous sommes prononcés sur le texte. En effet, comment aurions-nous pu nous prononcer sur un texte qui n'avait pas encore été adopté et dont nous ne connaissions pas la teneur ?
Applaudissementssur les travées de l'UMP.

M. Robert Bret. La réunion de dix-sept heures a été provoquée par la remarque que j'ai faite ce matin, remarque que vous avez d'ailleurs taxée de « juridisme », monsieur le président de la commission.
Exclamations sur les travées de l'UMP.

On voit comment notre Constitution est appliquée !
Quelle précipitation pour ratifier un traité qui ne doit entrer en vigueur qu'au début de 2009 ! Un tel empressement à liquider l'étape de la ratification atteste du renoncement à combler le déficit démocratique qui gangrène la construction européenne. Ainsi, une fois de plus, l'Union européenne se trouve confrontée à ses contradictions.
L'ambition affirmée de la « relance » de l'Europe est poursuivie coûte que coûte, tandis que l'adhésion des peuples au projet européen est censée découler des bénéfices que les citoyens européens seront supposés tirer des politiques européennes. Vous l'avez d'ailleurs redit ce soir, monsieur le secrétaire d'État.
Or un tel raisonnement place les citoyens européens en position d'extériorité par rapport à la construction européenne. Selon cette vision, l'histoire européenne se construit sans eux.
Les citoyens européens sont alors strictement cantonnés à une posture passive. Cette conception témoigne surtout du peu de cas que les dirigeants européens font de la parole du peuple, qui s'est pourtant massivement et clairement exprimée le 29 mai 2005.
Je rappelle que, par cet acte de souveraineté, le peuple a signifié de la manière la plus forte qui soit son rejet de l'Europe libérale consacrée par la « Constitution européenne » et, à présent, par le traité de Lisbonne. J'insiste sur le fait que ce refus portait sur une conception marchande de l'Europe sans que cela remette en cause l'adhésion populaire à l'aventure européenne. Oui, les peuples ont envie de plus d'Europe, mais pas celle d'aujourd'hui ni celle du traité de Lisbonne !
Aussi, le choix d'accélérer le calendrier et de recourir à la voie parlementaire pour éviter d'avoir à affronter un débat public ne nous semble pas digne d'une démarche démocratique. La démarche poursuivie soustrait l'étape de la ratification au débat public, pourtant inhérent à une telle procédure.
L'autorisation donnée par les parlementaires à la ratification est alors assimilée à un exercice de pure forme expédié en quelques heures loin de tout véritable débat susceptible d'aller dans le sens d'une politisation et d'une démocratisation de la construction européenne. Or, vous le savez, subtiliser le traité de Lisbonne au débat citoyen ne va certainement pas dans le sens d'une réappropriation du projet européen par le peuple ni du renforcement de la légitimation du processus européen.
Dès lors, je déplore que la perspective de la réalisation d'une Europe politique s'éloigne encore un peu plus, et cela parce que le traité de Lisbonne doit passer coûte que coûte et à n'importe quel prix démocratique. Telle est l'idée commune à tous les tenants de la « Constitution européenne » et de son prolongement, le traité de Lisbonne, qui voient là une revanche contre le peuple.
Et dire que l'argument d'une Europe plus démocratique avait été avancé pour faire accepter la Constitution européenne ! Quelle ironie !
Mesurons bien que le choix de la ratification par la voie parlementaire est éminemment politique. Il exprime le manque de courage de soumettre la question directement au peuple.
Chacun doit bien comprendre que l'utilisation de la démocratie représentative pour échapper à l'expression directe du peuple dénature le rôle du Parlement, qui se trouve ainsi, une nouvelle fois, instrumentalisé par l'exécutif. Pourtant, pour se revendiquer de la démocratie, il faut que le peuple soit susceptible d'avoir le dernier mot.
Dans ces conditions, que l'on soit favorable ou défavorable au traité, peut-on passer outre la décision du peuple de mai 2005 en l'annulant par un vote du Parlement ?
Pour reprendre l'expression de Didier Mauss, président de l'association française de droit constitutionnel, le Parlement peut-il désavouer le peuple ? Politiquement, c'était inconcevable ; juridiquement, c'est pratiquement fait !
Tel est donc l'enseignement tiré du « non » français de 2005. Le peuple ayant manifesté un vif intérêt pour la construction européenne et ayant rejeté le traité constitutionnel en toute connaissance de cause, il faut aujourd'hui être prudent et contourner le peuple, l'écarter de la construction européenne pour adopter une copie de la défunte « Constitution européenne ».
Ce déni de démocratie est d'autant plus inquiétant que l'avenir dessiné par le traité de Lisbonne est sombre. On le sait, ce sont malheureusement les peuples et les salariés qui continueront à subir les conséquences.
En prônant la concurrence libre et non faussée, qui reste, monsieur François-Poncet, la référence de toutes les politiques - même si elle n'apparaît plus dans le corps du traité, elle est reprise dans un protocole annexe qui a la même valeur juridique que le traité -, en prônant la libre circulation des capitaux, la liquidation des services publics et l'indépendance de la Banque centrale européenne à l'égard des État, vous soumettez nos concitoyens aux quatre volontés d'une Europe ultralibérale au sein de laquelle les crises se sont multipliées : désordres financiers périodiques, crise de la dette, fuite des capitaux, expansion des flux financiers internationaux, opacité croissante des flux spéculatifs, krachs boursiers à répétition Comment cette Europe de l'argent roi, et même de l'argent fou comme l'illustre le scandale de la Société générale, pourrait-elle répondre aux attentes des peuples, monsieur le secrétaire d'État ?
Elle ne le peut pas. Vous le savez et nos concitoyens le savent. C'est la raison pour laquelle vous avez soigneusement évité tout débat public avec le peuple.
Ne poussez pas trop vite un « ouf » de soulagement. La page ne se tournera pas si facilement, car ce passage en force va laisser des traces. Si vous imaginez que l'Europe peut continuer comme cela longtemps, sans les citoyens, vous vous trompez. Tôt ou tard, ils demanderont des comptes.
Pour le groupe communiste républicain et citoyen, ratifier le traité par voie parlementaire, c'est nuire au peuple. C'est un déni de démocratie, car, vous le savez, ce choix est uniquement déterminé par la volonté de bâillonner le peuple.
Ratifier le traité par voie parlementaire, c'est creuser encore plus le fossé existant entre citoyens et pouvoir politique.
Monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, ce que vous avez appelé à l'Assemblée nationale un « acte majeur » du Président de la République n'est en réalité qu'un acte de frilosité, pour ne pas dire de lâcheté. Cela traduit la peur que vous avez de vous livrer à un débat public sur le contenu de ce traité, et l'on sait bien pourquoi.
Ratifier le traité par voie parlementaire, c'est nuire au Parlement, car, une fois encore, il se place en position de subordonné par rapport au Gouvernement.
Enfin, ratifier le traité par voie parlementaire, c'est nuire à l'Europe, car une Europe construite sans les peuples, voire contre la volonté des peuples, n'a pas d'avenir.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, vous comprendrez que notre groupe ne participe pas à ce hold-up démocratique et vote contre ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC - M. Mélenchon applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le recours à la ratification parlementaire du traité de Lisbonne, fût-elle clairement annoncée à l'avance, pour passer outre le refus référendaire, suscite une véritable gêne. Ne sommes-nous pas dans le registre des chartes octroyées au peuple, qui, inversant la démarche démocratique, peut avoir des conséquences plus graves que l'effet même du refus populaire ?
L'argument avancé pour justifier le recours à une telle procédure est principalement fondé sur le fait que l'isolement de la France et la nécessaire relance de la construction européenne constitueraient des cas de force majeure. Or ces deux arguments ne sont pas convaincants.
La vie, quelle qu'elle soit, continue, et ce n'est pas la forme des institutions qui crée la liberté et la vie. C'est l'inverse. Les institutions doivent respecter la source de la vie ainsi que la liberté de la pensée et de l'existence des personnes et des peuples. Le moteur n'est pas au sommet, mais sur le terrain. La vie n'est pas quantité, mais qualité.
La démocratie doit avant tout être substantielle et ne pas se contenter d'être formelle.
On ne peut non plus considérer l'isolement comme une tare en soi que si l'on a déjà renoncé à toute hiérarchie des valeurs à défendre.
Être isolé parce que l'on a commis un délit est tout à fait différent du fait de l'être parce qu'on défend une position juste. On ne peut pas considérer qu'être isolé est en soi rédhibitoire, sauf si l'on privilégie la dynamique constructiviste par rapport à une dynamique éthique et politique. Or c'est bien là en définitive que se fondent les divergences légitimes entre deux conceptions de la construction européenne, au point que la forme actuellement privilégiée pourrait se révéler ultérieurement avoir été celle de sa dissolution.
Le principe inspirateur de la construction européenne consistait, il y a cinquante ans, à créer des liens économiques étroits entre les États-nations de l'Europe occidentale pour empêcher toute exaspération conflictuelle entre eux.
L'évolution du monde a complètement changé la donne, au point de faire apparaître aujourd'hui deux types de menaces totalement différentes de celles qu'avaient en tête les initiateurs du traité de Rome ; je veux parler de la guerre commerciale et du terrorisme.
La véritable question est donc aujourd'hui de savoir quelle est la meilleure réponse à donner aux conditions de demain.
Je pense personnellement que la suprématie des réseaux de coopération et de coordination politique, économique et sociale correspond plus à la nécessité du temps que la formation de grands ensembles d'exaspération des compétitions inégalitaires, et donc injustes, sous couvert de liberté.
De tels ensembles risquent, en outre, d'être perçus par les autres peuples comme des menaces belliqueuses. La puissance des réseaux, des coopérations et des coordinations me semble plus conforme aux exigences de l'ère d'Internet, à l'instar des microordinateurs qui ont succédé aux énormes machines des années soixante.
L'Europe a un autre rayonnement à faire valoir dans le monde, aux peuples de notre époque, qui attendent autre chose qu'une réponse en termes de structuralisme et de bureaucratie tatillonne.
Il faut nourrir la construction européenne de valeurs humaines pratiquée à tous les niveaux, et pas seulement affirmées dans les textes.
Les pétitions de principe, les catalogues de bonnes intentions sont sans fécondité, surtout quand ils sont en contradiction avec la manière d'appliquer le principe de subsidiarité.
La subsidiarité imposerait que soient mieux définies des compétences partagées ou attribuées aux nations et à l'Union européenne.
Il est spécifié dans le traité de Lisbonne que les parlements nationaux auront leur mot à dire au cas où la subsidiarité serait remise en cause. Mais, ici encore, il s'agit d'une subsidiarité octroyée, c'est-à-dire définie par le sommet. Ne faudra-t-il pas, en effet, réunir la majorité des Parlements concernés, c'est-à-dire mettre en minorité le pouvoir central, pour faire valoir son droit ?
Une grande confusion règne sur cette notion de subsidiarité faute d'admettre qu'elle n'est pas principalement procédurale, mais qu'elle est indissociable de l'essence même de la démocratie, et plus profondément encore de ce qui fonde le sens de la participation des citoyens et des familles à l'organisation de leur destin.
Cela implique que, pour chaque catégorie de problèmes, soit reconnue une compétence au niveau le plus adéquat à partir du terrain, et que soient respectées les valeurs de civilisation sur lesquelles repose la volonté de vivre ensemble. Ce peut être un échelon local, national, international, européen ou mondial, selon la nature du problème.
Seule cette mise en perspective générale exigée par notre époque permet de concevoir un autre dynamisme que celui de la forme de gouvernance kafkaïenne mise en oeuvre depuis plusieurs décennies.
C'est en ce sens que, rassembleur déterminé, démocrate affirmé, européen convaincu, mais pas exclusivement, je ne peux approuver la démarche actuelle qui prétend construire l'Europe, car je pense sincèrement qu'elle en ruine les véritables potentialités et la fécondité !
M. Bruno Retailleau applaudit.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'expliquerai, de la façon la plus brève possible, pourquoi mon groupe votera en faveur du projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne et pourquoi nous acceptons que cette autorisation ait lieu par la voie parlementaire.
Placé entre nos collègues Bernard Seillier et Bruno Retailleau, je sais que la tâche ne sera pas facile pour moi !
Sourires
Les arguments de Bernard Seillier ne nous ont pas convaincus !

Le traité de Lisbonne, M. le rapporteur l'a excellemment dit, présente un certain nombre d'avantages. Néanmoins, il conserve un certain nombre d'ambiguïtés. Il faut éviter d'être trop béat d'admiration devant ce texte et ne pas oublier les questions qui restent pendantes et ne sont pas résolues par lui.
Très naturellement, s'agissant d'en autoriser la ratification, la voie parlementaire qui a été retenue nous semble justifiée. Il s'agit, en effet, de modifier des traités dont l'autorisation de ratification a été donnée par la voie parlementaire et qui n'ont pas fait l'objet d'autres modes de ratification que celle que nous utilisons ce soir.
La modestie du traité de Lisbonne justifie toute à fait cette procédure. Il s'agit en réalité de faire produire aux traités existants tous leurs effets, dans une Europe à vingt-sept, et de rendre efficaces des institutions qui ne le sont plus aujourd'hui.
En revanche, si demain une autre étape européenne devait être franchie, si l'on reparlait de Constitution, de symbole, d'une Union européenne plus forte, il serait tout à fait naturel de demander aux peuples, et d'abord au peuple français, de se prononcer.

Aujourd'hui, il s'agit simplement de faire fonctionner ce qui ne fonctionne plus.
Tel qu'il nous est proposé, le traité de Lisbonne présente trois séries d'avantages.
Tout d'abord, il remet la France dans le circuit européen, ce qui est essentiel. Il n'y a jamais eu de construction européenne sans que la France, avec l'Allemagne, joue un rôle moteur. Depuis l'échec du référendum sur le traité constitutionnel, la France est en dehors du circuit européen, de la pensée européenne, de la construction européenne. Il y a quelques mois, des chefs d'État se sont réunis à Madrid en dehors d'elle. Il est totalement inimaginable de laisser l'Europe se construire sans nous. Le traité de Lisbonne marque donc le retour de la France dans la construction européenne. C'est, pour nous, un avantage tout à fait remarquable.
Le deuxième avantage du traité de Lisbonne est qu'il donne à l'Europe, composée de vingt-sept États membres, les moyens de travailler. Sur ce point également, des progrès ont été réalisés. Ils ont été soulignés par les différents orateurs et je n'y reviendrai pas. Il s'agit de la mise en place de dispositifs plus simples, plus clairs en matière d'organisation des institutions, de mode de votation au sein du Conseil, etc.
Par ailleurs, ce traité permettra à l'Europe de travailler dans de nouveaux domaines, là où les citoyens européens l'attendent : l'énergie, la coopération judiciaire et policière, les questions d'immigration, de contrôle aux frontières. Ce sont de nouvelles politiques que l'Europe pourra mettre en oeuvre grâce au traité de Lisbonne.
Le troisième avantage du traité de Lisbonne est qu'il constitue une avancée de la démocratie européenne. La critique véhémente souvent faite à l'Europe est qu'elle est lointaine, technocratique. Comment pouvait-on faire pour remettre de la démocratie dans l'Europe ?
Le traité de Lisbonne corrige le traité de Nice s'agissant du poids relatif de chacun des États ; c'est un progrès. Désormais, on tiendra compte de la population réelle de chaque État et donc de ce qui est le fondement même de la démocratie : un homme, une voix. Ce principe sera mieux appliqué dans le fonctionnement de l'Union européenne grâce au traité de Lisbonne.
Les pouvoirs du Parlement européen augmentent ; le domaine des codécisions devient de droit commun. Il s'agit d'une avancée démocratique évidente.
Le rôle des parlements nationaux est réaffirmé, ce qui donne un contenu concret à la notion de subsidiarité.
Certes, il n'est pas facile de faire jouer le principe de subsidiarité. Mais, comme en bien d'autres domaines, il nous appartiendra de nous organiser en tant que parlement national pour faire jouer au traité toutes ses potentialités et éviter de reporter sur les institutions de Bruxelles ce que nous aurions pu faire localement.
Au demeurant, ce traité ne règle pas tout et soulève des problèmes.
Ainsi, quelle sera la place du président du Conseil européen, celle du Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ? Quels seront les rapports entre le président du Conseil européen, le Haut représentant et le président de la Commission ?
Si, habituellement, il appartient aux institutions de canaliser la fougue et la passion des individus qui les font vivre, s'agissant des institutions du traité de Lisbonne, il faudra toute la sagesse des individus qui rempliront les postes essentiels prévus par ce texte pour que ce qui constitue des ambiguïtés ne devienne pas, demain, des sources de désaccords institutionnels à l'échelon de l'Europe.
Conscient de ce qu'apporte le traité de Lisbonne, de la possibilité qu'il donne à la France de jouer à nouveau son rôle traditionnel dans la construction européenne, mais tout aussi conscient des problèmes qu'il pose, mon groupe votera en faveur de ce projet de loi de ratification.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

M. Bruno Retailleau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je peux rassurer Michel Mercier, qui a fait aimablement allusion à deux de ses collègues à l'instant : je ne suis pas béat devant ce traité !
Sourires

Il aura donc fallu moins de deux ans pour qu'on nous resserve, par la petite porte parlementaire, ...

... le contenu du traité constitutionnel, qui était sorti par la porte du référendum !
Si, malheureusement, l'Europe se construit sans les peuples, on risque d'encourager la méfiance qui se manifeste en France à chaque élection européenne. L'abstention dans notre pays est trois fois plus forte aux élections européennes qu'aux élections présidentielles.
C'est également le cas dans d'autres pays. Par exemple, en Bulgarie, lors des dernières élections européennes, en mai 2007, le taux de participation s'est élevé à 29 %. Le déficit démocratique est donc bien présent.
Peut-on y remédier, mes chers collègues, en passant subrepticement sur la décision du peuple et en adoptant un traité, certes compliqué, mais qui nous ressert la même « sauce » que le traité constitutionnel ?
En réalité, pour reprendre l'expression qu'a utilisée Hubert Védrine dans son livre, que vous avez sûrement lu, Continuer l'Histoire, il me semble que nous avons manqué une grande occasion, celle d'une triple clarification : clarification sur les pouvoirs entre le centre et la périphérie, entre les États membres et l'Union européenne ; clarification sur les frontières ; surtout, clarification sur le projet.
Je commencerai par la clarification sur les pouvoirs et sur les institutions.
Quand on lit la presse étrangère, on constate que tous les Gouvernements des pays où l'on a voté « oui » affirment que le nouveau traité est le même que le traité constitutionnel ! Ce texte, tout comme le traité constitutionnel, n'a qu'un seul objectif : renforcer la logique fédérale.
Tous les éléments constitutifs d'un super-État européen en devenir sont là : la personnalité juridique, le fait que désormais l'Union existe distinctement des État qui l'ont créée, la primauté du droit communautaire, y compris sur nos constitutions, encore une fois réaffirmée par le biais de la jurisprudence de la Cour de justice.
Il y a toujours plus de domaines de compétence dans lesquels les décisions sont prises suivant la règle de la majorité et non plus suivant la règle de l'unanimité. Nous sommes en train de construire une Europe boulimique.
Certes, je reconnais que l'Europe est légitime dans des domaines où les États restent impuissants, soit parce qu'il s'agit de domaines de dimension transnationale, soit parce que, en vertu du principe de subsidiarité, un certain nombre de problèmes doivent être traités à un échelon supérieur.
Mais, toujours aller dans le sens de l'abandon de souveraineté, c'est vouloir construire un certain type d'Europe, une forme d'Europe fédérale.

Les éléments constitutifs d'un État fédéral sont la monnaie, un service diplomatique. Au demeurant, on aura beau avoir un service diplomatique commun, ce n'est pas demain que le Royaume-Uni et la France partageront la même vision des rapports avec les États-Unis !
Les États européens du Nord ne sont pas près d'avoir la même conception de la politique méditerranéenne, cher Jacques Blanc. Il se passera également du temps avant qu'un Polonais ait la même préhension qu'un Allemand ou un Français du rapport avec la Russie.
Donc, on peut construire en commun et faire fonctionner l'Europe, mais, un jour ou l'autre, les réalités créées par l'histoire, par la géographie, celles qui sont dans le coeur des peuples s'imposeront. Aujourd'hui, l'intérêt communautaire triomphe provisoirement : il n'y a plus, mes chers collègues, d'intérêt national, il n'y a plus que des égoïsmes nationaux qu'il faut absolument combattre.
J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il fallait entreprendre des réformes dans notre pays. Certes, elles sont nécessaires, mais pour qu'elles soient portées, un élan est indispensable. On met un peuple en mouvement non pas en lui proposant d'augmenter la croissance de 1 %, mais parce qu'il a le sentiment d'une appartenance commune. S'il accepte de se « serrer un peu la ceinture », c'est parce qu'il a le souci des générations futures et peut-être aussi parce qu'il pense aux générations précédentes.
Il n'y a pas de clarification non plus sur les frontières.
L'Europe se détache des peuples, mais elle se détache aussi de tout territoire particulier. Les critères de Copenhague sont bien impuissants, mes chers collègues, à projeter sur la moindre carte du continent une délimitation, même si on ajoute le critère de la capacité d'absorption.
Le problème de la Turquie est pendant. Les mécanismes que vous allez voter tout à l'heure auraient pour conséquence, si, un jour, la Turquie était intégrée à l'Union, que le pays le moins européen serait celui qui pèserait le plus, peut-être avec l'Allemagne, au sein du Conseil, au Parlement européen, et sans doute aussi celui qui nous coûterait le plus cher en matière d'intégration.
Ce problème turc, vous l'avez posé, monsieur le secrétaire d'État, puisque vous remettez en cause l'article 88-5 de la Constitution - chaque opinion est respectable - que Jacques Chirac avait imaginé pour nous convaincre que les deux questions, celle de la Constitution et celle de la Turquie, étaient séparées.
À l'époque, je n'avais pas, bien entendu, voté cette révision constitutionnelle. Mais faut-il croire que, demain, une nouvelle révision constitutionnelle interviendra, visant à supprimer cet article ? Peut-être nous l'indiquerez-vous, mais il faut le dire au peuple ; il convient de jamais agir de façon détournée.
La réalité, c'est la question des frontières : il faut dire ce qu'est l'Europe, où elle commence et où elle finit. Je crois que cette incertitude est à la base d'un certain nombre d'incompréhensions.
La troisième clarification qui fait défaut, malheureusement, concerne le projet européen. Quelle Europe voulons-nous ? Une Europe anglo-saxonne, simple zone de libre-échange ?

Une Europe messianique, qui serait une sorte d'avant-garde d'une humanité en voie d'unification et dont nos institutions seraient une sorte de préfiguration ?

Un universalisme cher à la démocratie chrétienne, cher Michel Mercier ?
Une Europe bruxelloise, super-État technocratique, alors que, dans nos collectivités, pour la moindre décision, nous nous heurtons déjà aux injonctions tatillonnes de Bruxelles ?
Je veux bien la grande aventure européenne, mais où est-elle lorsque le Président de la République lui-même se fait rappeler à l'ordre par Bruxelles parce qu'il a le projet ambitieux d'une Union méditerranéenne ou parce qu'il veut aider les pêcheurs de notre pays ? Nous sommes contraints, cher Josselin de Rohan, de construire des usines à gaz pour éviter de nous faire taper sur les doigts par les technocrates de Bruxelles !

Mais où va-t-on ? C'est nous qui sommes responsables de cette situation ; on ne peut pas à la fois déplorer les effets et renchérir les causes.
On ne nous dit pas où l'on va, ni comment on y va. De mécanisme en machinerie institutionnelle, on voit bien se profiler, en filigrane, une unité en devenir, qui doit rester confidentielle, en tout cas dans une prudente indécision au sens étymologique : « Y penser toujours, n'en parler jamais » !
Longtemps, on a cru que l'union économique permettrait de forger l'union politique. Comme l'a écrit Ernest Renan, un Zollverein n'a jamais fait une patrie.
Il a donc fallu changer de méthode et, depuis quelques années, on tente de dépasser le fait national par le droit, un peu comme Jürgen Habermas et son « patriotisme constitutionnel. » Certes, mais les hommes ne sont pas uniquement des êtres de raison ; ils ont une histoire, ils tendent vers une destinée commune, ce ne sont pas des monades totalement désincarnées !
Le point d'inflexion de l'Europe, cette Europe technocratique telle qu'elle apparaît aujourd'hui, se situe aux environs de Maastricht. Pendant une longue période, les États nations et l'Europe se sont développés de façon assez harmonieuse, en tout cas dans un concert mutuel. Puis, un infléchissement s'est produit et, progressivement, l'instrument s'est détaché des corps nationaux. La créature a pris vie et s'est détachée de ses créateurs.
On ne peut pas créer un destin commun en se fondant exclusivement sur des mécanismes institutionnels et juridiques ; il y faut un grand élan collectif. C'est la raison pour laquelle je voterai contre le projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne.
Mme Paulette Brisepierre et M. Bernard Seillier applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis cinquante ans, les Européens ont engagé une construction originale qui n'a aucun équivalent dans le monde. Au fil des années, ils ont bâti à six, puis à neuf, puis à quinze et désormais à vingt-sept, un ensemble juridique, économique, social et politique, fondé sur les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme.
Certes, rien n'est encore achevé, tout est encore imparfait. Mais, au fil du temps, l'Union européenne a assuré à ses habitants un relatif bien-être social et est devenue la première puissance économique mondiale.
Mais surtout, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les peuples européens vivent en paix, une paix renforcée sur le continent en 2004 avec l'adhésion de dix nouveaux États membres issus de l'ex-Europe de l'Est communiste. C'est, à mes yeux, la réussite majeure de l'Europe, que l'on ne rappelle jamais assez et qu'il faut à tout prix préserver.

Malgré cette réussite exceptionnelle, les citoyens européens doutent de l'efficacité de la construction européenne. Il en résulte, chez un nombre grandissant d'entre eux, au mieux une certaine indifférence, au pire des réactions de rejet, comme celles des Français et des Néerlandais en 2005.
On évoque souvent, pour expliquer cette attitude, l'opacité du fonctionnement des institutions, l'éloignement des instances de décision, la bureaucratie « bruxelloise », l'élargissement réalisé trop rapidement, l'essoufflement du projet des Pères fondateurs, l'absence de projets mobilisateurs et, surtout, le déficit démocratique de l'Union.
Il est certain que le débat institutionnel européen a duré trop longtemps et a trop mobilisé les énergies, au détriment de réalisations plus concrètes qui auraient pu rencontrer l'adhésion des citoyens au projet européen.
Le premier mérite du traité, dit traité de Lisbonne, qui nous est soumis est de clore pour un certain temps cette longue période de réflexion, de querelle, sur l'évolution et l'efficacité des institutions de l'Union.
Ce traité, s'il est adopté avant la fin de l'année par les vingt-sept États membres - ce que je souhaite -, devrait permettre d'enrayer la crise de confiance qui a suivi l'échec du traité constitutionnel en 2005, après les « non » français et néerlandais, et favoriser la relance de la dynamique européenne en sommeil depuis deux ans.
II le pourra d'autant plus qu'il est le résultat d'un compromis signé, pour la première fois, par les vingt-sept chefs d'État et de gouvernement de l'Union, à Lisbonne, le 13 décembre dernier.
Certes, comme tout compromis, il ne satisfait totalement personne, et notamment pas les socialistes français. Ce traité manque de souffle, et « l'esprit européen » n'est pas vraiment au rendez-vous ! On est revenu à un exercice classique de type intergouvernemental négociant des « modifications » aux traités existants.
Pour autant, comme tout compromis, il présente des aspects positifs que je rappellerai brièvement.
En premier lieu, il modifie notamment le traité de Nice, toujours en vigueur, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il n'est pas satisfaisant. L'objectif est faible, mais c'est, hélas ! la réalité dans laquelle nous retomberions si, par malheur, était effacé ce que nous sommes en train de construire.
Les dispositions institutionnelles du traité de Lisbonne vont permettre d'améliorer de façon substantielle l'équilibre et le fonctionnement des institutions, les modes de prise de décision, les droits des citoyens et la démocratie au sein de l'Union élargie.
En effet, une architecture plus équilibrée et plus démocratique est instaurée entre les trois principales institutions.
D'abord, le Parlement européen - et nous y attachons beaucoup d'importance - monte en puissance, avec l'accroissement du nombre de ses membres afin de prendre en compte l'arrivée des nouveaux États membres. Les parlementaires européens seront désormais 750, le nombre des représentants de chaque État étant établi en fonction de la taille de sa population.
Le rôle du Parlement européen est renforcé aussi par l'extension de la procédure de codécision avec le Conseil des ministres à quarante nouveaux domaines législatifs. Cela est de la plus grande importance. En fait, la quasi-totalité de la législation européenne sera adoptée par le Parlement européen, mis sur un pied d'égalité avec le Conseil des ministres représentant les États membres.
Il lui reviendra, en outre, d'investir le président de la Commission ainsi que le collège qu'il aura formé, en tenant compte de la majorité politique issue des élections européennes. Cela est également primordial.
Enfin, les parlements nationaux vont devenir des acteurs de la construction européenne, puisqu'ils se voient attribuer un rôle inédit de contrôle du respect du principe de subsidiarité. À ce titre, ils bénéficient désormais d'un « droit d'alerte précoce » en cas de dépassement de ses prérogatives par la Commission.
Ce nouveau droit accompagne la clarification qu'effectue le texte entre les pouvoirs de l'Union et ceux des États membres en distinguant trois catégories de compétences : les compétences exclusives de l'Union, où elle seule légifère - union douanière, politique monétaire, établissement des règles de concurrence, etc. - ; les compétences partagées entre l'Union et les États membres ; enfin, les compétences d'appui, c'est-à-dire les domaines où les États demeurent compétents, mais dans lesquels l'Union européenne peut apporter son appui.
Les parlements nationaux disposent, enfin, d'un « droit d'opposition » à la « clause passerelle », qui permet d'étendre la majorité qualifiée à des domaines jusque-là régis par la règle de l'unanimité. Cette innovation est importante, car l'avenir de l'Europe, vous le savez, se joue aussi dans ce passage de la règle de l'unanimité à celle de la majorité qualifiée.

En outre, alors que la cohésion territoriale est affirmée comme objectif à part entière de l'Union, les conséquences administratives et financières des propositions de la Commission sur les budgets des collectivités territoriales seront examinées et le comité des régions pourra être consulté. Je ne sais pas si cette notion est importante mais, en tout cas, c'est la première fois qu'elle est mise en avant, ce que je considère comme positif.
Ces dispositions nouvelles rapprochent ainsi les débats nationaux de ceux de l'Union.
De son côté, la composition de la Commission est revue de façon à privilégier l'intérêt européen par rapport à l'addition des intérêts nationaux. Cette modification, qui ramènera le nombre des commissaires à dix-huit - au lieu de vingt-sept actuellement - devrait ne prendre effet qu'à partir de 2014.
Enfin, la création de la fonction de « président du Conseil européen », élu pour deux ans et demi et renouvelable une fois, qui ne pourra pas exercer de fonction nationale, donnera enfin un visage à l'Union et à la présidence une stabilité et une visibilité qui manquaient cruellement dans le système actuel des présidences tournantes semestrielles. Certains de nos collègues se sont demandé qui, de ces différents présidents, finirait par l'emporter ? Si la nouvelle fonction ne l'emporte pas, c'est qu'on aura mal choisi celui qui l'exerce !

Cela peut arriver, il faudra y prendre garde ! Mais je crois que la précaution prise devrait permettre de répondre à la question.
Sur le plan institutionnel, les avancées sont donc importantes. D'autant qu'elles sont complétées par d'autres dispositions permettant, elles aussi, une amélioration du fonctionnement démocratique de l'Union. Ainsi en est-il de la révision du mode de décision au Conseil des ministres, fondé sur la « double majorité » - 55 % des États membres et 65 % de la population. Ce système n'entrera en vigueur qu'en 2014, voire en 2017, mais concernera trente-trois nouveaux articles, notamment le contrôle aux frontières, la politique d'asile ou la gestion des fonds structurels.
Certes, la règle de l'unanimité demeure en vigueur pour la politique fiscale ou la politique étrangère. Mais cette dernière progresse malgré tout, avec la création d'un « haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité », disposant d'un service européen pour l'action extérieure, renforçant la présence et l'action de l'Union dans le monde.
Les socialistes considèrent aussi comme positive l'introduction d'une initiative citoyenne européenne : une pétition signée par un million de citoyens peut contraindre la Commission...

... à prendre des mesures dans un domaine où ils estiment son intervention nécessaire.

Dans le même sens, le traité favorise le développement du dialogue avec les associations et conforte le rôle des partenaires sociaux.
Le traité consacre aussi la possibilité de « coopérations structurées » réunissant un groupe d'États - on leur a accordé beaucoup d'importance et elles ont été au coeur des débats de ces dernières années - et institutionnalise l'Eurogroupe, permettant une meilleure coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales des quinze États membres de la zone euro.
Nous approuvons aussi les dispositions concernant la solidarité énergétique et environnementale européenne, le recadrage du principe de concurrence - qui avait joué un rôle important dans l'échec du traité constitutionnel -, la reconnaissance des services publics prévue dans le protocole adjoint au traité, le renforcement de la coopération judiciaire et policière et du cadre d'action de la défense européenne.
Enfin, l'Union est dotée de la personnalité juridique. Ses valeurs fondatrices sont rappelées dans le préambule du traité comme étant « universelles et indivisibles » : respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit, droits de la personne, droits de l'enfant, tolérance, justice, solidarité, citoyenneté, égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont peut-être des mots, mais ce sont des mots qu'on aime entendre et ils ont été repris dans le traité !
Ainsi, l'Union européenne se définit non pas seulement comme un espace économique, mais aussi comme un espace de droits, porteur de valeurs humanistes et sociales, comme nul autre au monde, il faut le souligner !
Malgré ces aspects positifs, force est de constater les graves faiblesses du traité et ses lacunes indéniables. Pour ma part, je regrette certains abandons effectués à la demande de quelques États membres, Grande-Bretagne et Pologne notamment. J'ouvre une parenthèse pour observer que, chaque fois qu'on énumère les caractéristiques de ce traité, la Pologne et surtout la Grande-Bretagne y jouent un rôle de frein excessif ! Il est parfaitement clair, sur ce plan, qu'une mobilisation des Européens s'impose pour changer cet état de fait !

Ces deux pays ont refusé que soient mentionnés dans les textes les symboles de l'Union que sont le drapeau, l'hymne ou la devise. Certes, là n'est pas le plus important, mais je crois à la force des symboles pour convaincre. Je regrette cette manie de supprimer tout ce qui irait dans le sens de la création d'une entité qui dépasserait nécessairement les nations existantes sans leur porter un préjudice inacceptable.

On peut regretter aussi le report de la mise en application de certaines dispositions à 2014, voire à 2017, qu'il s'agisse, on l'a vu, du mécanisme de la double majorité pour la prise de décision au Conseil des ministres ou de la composition de la Commission.
On peut regretter encore les nombreuses dérogations aux dispositions communes ouvertes à certains États membres, toujours les mêmes, notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et dans celui de la Charte des droits fondamentaux. Ces dérogations concernent essentiellement la Grande-Bretagne et touchent au coeur de l'engagement européen. Il faudra s'assurer que cette souplesse ne se réalise pas au détriment des droits, de la sécurité juridique et de l'égalité entre les citoyens européens, autrement dit, qu'elle ne porte pas atteinte à la citoyenneté européenne en devenir.
Surtout, les socialistes regrettent vivement que la Charte des droits fondamentaux ne soit pas intégrée au traité, même si les droits qu'elle proclame se voient reconnaître une force juridique contraignante et si une « clause sociale générale », de large portée, est instaurée.
L'Europe sociale, pour laquelle les socialistes se battent depuis le début, les citoyens européens l'attendent. C'est l'une des raisons fondamentales, liée à un juridisme excessif étalé partout, du rejet par la France du traité constitutionnel qui lui était proposé.

Incontestablement, on peut vanter la construction européenne, mais si le peuple est malheureux et vit l'Europe comme une aggravation de sa condition, il est évident qu'il réagit en manifestant son opposition, ce qui s'est produit et risque de se reproduire sur bien des sujets internationaux, si l'on n'y prend pas garde !

... que les citoyens attendent et sur laquelle nous avons tant insisté, est une fois encore la grande oubliée de ce traité, malgré quelques mesures de principe.

Il faudra donc nous atteler à cette tâche.
D'ailleurs, de façon générale, on pourrait reprocher au traité de Lisbonne que l'application de nombre de ses dispositions, définies comme autant d'intentions, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'harmonisation des normes sociales et budgétaires, des services publics, dépende de la volonté politique des États membres. Par conséquent, la qualité des hommes et des femmes qui seront appelés à exercer de hautes responsabilités au niveau européen aura une importance capitale, cela a été démontré tout à l'heure.
Sur le plan économique, peu abordé dans le traité, on ne voit toujours pas se concrétiser l'émergence, aux côtés de la Banque centrale européenne, d'un gouvernement économique de l'Europe, permettant de remettre la croissance et l'emploi au coeur de la politique économique, en accompagnement de la monnaie unique. Il s'agit là d'un problème essentiel, mais on sait l'opposition irréductible en la matière de quelques États. C'est toujours la même question !
Face à ses faiblesses et à ses insuffisances graves, faut-il pour autant refuser de ratifier le traité de Lisbonne ?

Il serait illusoire de présenter le traité de Lisbonne comme une sorte de panacée. Il comporte des dispositions positives, mais nombre d'autres qui sont insuffisantes ; par conséquent, il faut faire un choix.
Les sénateurs socialistes, fidèles à une longue histoire européenne constitutive de leur identité, ont estimé que ce nouveau traité contenait des avancées significatives qui justifient un vote positif de leur part, du moins de la grande majorité d'entre eux, comme viennent de le faire les députés socialistes.
Comme en 2005, les socialistes se sont à nouveau divisés sur la question européenne. Pourtant, le traité qui nous est proposé n'est plus une « constitution ». Il se borne à modifier les traités existants, en permettant un fonctionnement de l'Union à vingt-sept dans des conditions meilleures qu'auparavant. Ces dispositions, reprises pour l'essentiel du défunt traité constitutionnel, n'avaient pas soulevé alors d'oppositions majeures.
S'agissant du mode de ratification de ce traité, le parti socialiste et sa candidate à l'élection présidentielle de 2007 avaient souhaité un référendum ; le candidat qui est devenu Président de la République souhaitait le contraire, on s'en souvient. Les parlementaires socialistes ont soutenu, la semaine dernière au Sénat et hier à l'Assemblée nationale, une motion référendaire qui a été rejetée par les deux assemblées. Cette question est donc derrière nous.
Aujourd'hui, l'important est de savoir si les avancées contenues dans le traité modificatif répondent aux besoins immédiats de l'Union européenne. En tant que socialiste, j'ai toujours inscrit mon action politique dans la perspective européenne. Ainsi, en 1983, alors que j'étais Premier ministre, il était tentant de quitter l'Europe en sortant du système monétaire européen, le SME. J'ai convaincu François Mitterrand de renoncer au repli sur soi. Il s'est rallié à la position que je défendais et on connaît la suite.
Aujourd'hui, j'ai la conviction que, malgré ses manques, le traité de Lisbonne renforce la démocratie au sein de l'Union européenne et peut remettre sur les rails le projet européen. Telle est ma conviction, partagée par la majorité du groupe socialiste du Sénat.
Les Européens ont donc un nouveau rendez-vous avec leur avenir. À chaque étape de la construction européenne, les socialistes, parfois majoritaires, parfois minoritaires, ont toujours eu l'intelligence, avec d'autres, d'en être partie prenante. Car l'Europe est partie intégrante de l'identité des socialistes : Jean Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand ont toujours porté un message européen, et nous ne l'avons pas oublié.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je pense souvent à la belle phrase de Léon Blum : « Faire l'Europe en pensant au monde ». Plus que jamais, dans le monde globalisé que nous connaissons depuis la chute du mur de Berlin en 1989, quel destin une puissance moyenne comme la France peut-elle espérer se forger seule ?

Face à la montée des dangers et à l'émergence rapide de puissances nouvelles, comme la Chine ou l'Inde - que nous saluons, d'ailleurs -, comment ne pas voir que seule la poursuite de la construction européenne - la France devrait y jouer un rôle moteur - est la seule voie pour affronter des défis comme la croissance économique, la compétition mondiale, la régulation des marchés financiers, la lutte contre le réchauffement climatique, la protection sociale des citoyens européens contre les excès du marché, la paix dans le monde ?

Plutôt que de nous livrer à des débats juridiques où nous trouvons quelque plaisir, nous devrions répondre à ces questions !

Je pense que, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'Europe qui peut nous y aider et qu'il n'existe pas d'autre solution !

Certes, ce traité ne répond pas à tous ces défis, mais ses dispositions vont dans le bon sens.
Il lève une hypothèque sur l'exigence, désormais, de bâtir un projet porteur de sens pour le XXIe siècle. Cette exigence devrait être au coeur de la prochaine bataille des élections européennes de 2009, dont l'enjeu sera plus important que jamais.
Je ne résiste pas à la tentation de vous rappeler quelques paroles prononcées par François Mitterrand en 1995, devant le Parlement européen :
« Ce dont il s'agit, c'est bien d'assurer à l'Europe la place et le rôle qui lui reviennent dans un monde à construire, une Europe puissante économiquement et commercialement, unie monétairement, active sur le plan international, capable d'assurer sa défense, féconde et diverse dans sa culture. Cette Europe-là sera d'autant plus attentive aux autres peuples qu'elle sera plus sûre d'elle-même. »
Cela dépend de nous !

Nous n'y sommes pas encore, mais ces propos demeurent d'une actualité brûlante. Ils résument la conception que se font les socialistes de l'Europe, une Europe qui s'affirme comme une puissance politique dotée d'institutions renforcées, plus efficaces et plus démocratiques, une Europe qui protège et favorise le progrès social et stimule la croissance.
La réalisation de ce projet exigera de nous et de la France encore beaucoup d'efforts, que notre pays devra prendre en compte, monsieur le secrétaire d'État, au cours de sa présidence de l'Union européenne, qui débutera en juillet prochain.
La réalisation de ce projet passe aujourd'hui par la porte étroite de la ratification du traité de Lisbonne, que le groupe socialiste du Sénat, à une forte majorité, va approuver.
Nous le faisons avec les réticences que j'ai exprimées, mais aussi avec la conviction, que je crois largement partagée, d'accompagner ainsi le lent et décisif accomplissement de l'histoire. L'Europe est un chemin difficile, mais elle est notre plus grande chance au début de ce siècle.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a quelques jours, le Congrès, réuni à Versailles, a modifié notre Constitution, afin de rendre possible la ratification par le Parlement du traité de Lisbonne. Il s'agissait d'une révision a minima, strictement limitée aux points de contradiction relevés par le Conseil constitutionnel et adoptée à une très large majorité. En quinze ans, la Constitution a été modifiée à six reprises pour permettre l'approfondissement du projet européen.
La voie est donc ouverte aujourd'hui à la ratification de cet important traité, et par conséquent à son entrée en vigueur lorsque nos partenaires européens auront accompli le même processus que nous. Cela doit permettre à l'Union européenne de sortir par le haut de la crise de confiance dans laquelle elle était plongée depuis les référendums français et néerlandais.
Il s'agit d'un accord politique de premier plan, qui marque non seulement la fin d'une période d'incertitude institutionnelle, mais également des avancées démocratiques importantes et nouvelles au bénéfice des citoyens et des parlements nationaux.
Le nouveau traité, « modificatif » pour les uns, « simplifié » pour les autres, apporte des amendements aux traités antérieurs que la France a ratifiés depuis 1957 : je pense bien sûr au traité de Rome, à l'Acte unique européen, aux traités de Maastricht, d'Amsterdam ou de Nice. En procédant ainsi, le Conseil européen a choisi de recourir de nouveau à la méthode traditionnelle des avancées européennes.
Il ne s'agit donc pas d'un texte nouveau qui définit tous les équilibres institutionnels et toutes les politiques de l'Union européenne en les gravant dans le marbre constitutionnel ; il s'agit d'apporter les modifications indispensables pour que l'Union européenne puisse mieux décider et agir.
Le traité de Lisbonne est d'abord un outil avant d'être un projet européen à long terme. Il n'est pas de même nature que le « traité constitutionnel », qui tendait à changer la nature même de la construction européenne, faisait table rase des anciens traités et présentait une constitution pour l'Europe. Ce n'est pas le cas ici, et cela justifie en grande partie le choix de le ratifier par la voie parlementaire. Ce choix correspond aussi à une promesse du Président de la République faite aux Français lors de la campagne présidentielle, promesse que nous tenons aujourd'hui.
Pour entrer en vigueur le 1er janvier 2009, et s'appliquer ainsi aux élections européennes de juin 2009 et à l'investiture de la future Commission européenne, le traité devra être ratifié d'ici là par les vingt-sept États membres. Il faut donc faire vite ; c'est pourquoi le Président de la République a engagé la procédure de ratification le jour même de la signature du traité, en saisissant immédiatement le Conseil constitutionnel.
Il nous faut donc aujourd'hui franchir une nouvelle étape, après avoir inscrit dans notre Constitution les avancées du traité de Lisbonne. Je ne reviendrai pas sur les principaux éléments de ce traité, largement commentés par notre excellent rapporteur, M. Jean François-Poncet, et par le président de la délégation pour l'Union européenne, M. Hubert Haenel.
Cependant, je crois qu'il faut insister sur les mesures qui donnent de nouveaux droits au Parlement européen comme aux parlements nationaux. Les prérogatives du Parlement européen seront accrues, dans la procédure législative européenne, par le renforcement de la codécision et l'extension du champ du vote à la majorité qualifiée.
Je rappelle que le Parlement européen est l'organe d'expression démocratique et de contrôle politique de l'Union européenne. Le renforcement de ses pouvoirs en fait l'institution la plus sensible aux intérêts des collectivités locales.
Depuis l'Acte unique européen de 1987, les compétences de cette assemblée n'ont cessé de s'étendre. Avec le traité de Maastricht, la procédure de codécision l'élève réellement au rang de colégislateur, à égalité avec le Conseil des ministres de l'Union européenne, et nous savons que les domaines régis par la procédure de codécision touchent souvent de près les collectivités territoriales.
Après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, cette procédure concernait, entre autres domaines, l'établissement et la prestation des services, les réseaux transeuropéens, l'environnement, la culture, ou encore la santé.
Le traité d'Amsterdam a, quant à lui, élargi l'application de cette procédure au Fonds européen de développement régional, le FEDER, à l'emploi, à la politique sociale...
Le traité de Lisbonne, pour sa part, étend encore le champ de la procédure de codécision. Celle-ci devient la procédure ordinaire. Elle élargit ainsi les compétences du Parlement européen et favorise donc indirectement la prise en compte des intérêts des collectivités locales dans le processus décisionnel communautaire.
Il ne serait peut-être pas inutile qu'à l'avenir le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales, entretienne de façon plus institutionnelle des relations avec le Parlement européen ; M. Haenel a très clairement souligné ce point tout à l'heure.

Autre point à noter, le passage à la majorité qualifiée, immédiat ou différé, dans des domaines jusqu'alors régis par la règle de l'unanimité. Les nouveaux transferts portent, par exemple, sur la coopération judiciaire en matière pénale, mais aussi sur la création d'un parquet européen compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.
Je tiens à dire, à ce sujet, que l'apport majeur du traité de Lisbonne en matière de justice est la construction de l'espace judiciaire européen. Depuis 1977, date de la première évocation de cette notion, très peu d'outils communs ont été mis en place. Je tenais à saluer ce progrès, qui aura sûrement un effet d'entraînement pour d'autres dossiers qui mériteraient de connaître de semblables avancées, notamment en matière de justice et d'affaires intérieures.
Les nouvelles prérogatives que le traité reconnaît aux parlements nationaux forment une autre série de dispositions remarquables. C'est un point très important et qui doit être apprécié à sa juste valeur, s'agissant d'un sujet cher à M. Haenel.
Les parlements nationaux disposeront désormais de prérogatives renforcées dans la construction européenne. C'est la première fois qu'un article spécifique est consacré aux parlements nationaux dans un traité. Je vous en donne lecture : « Les Parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union. »

Tout parlement national pourra s'opposer à la procédure de révision simplifiée des traités. En outre, l'Assemblée nationale ou le Sénat pourront s'adresser directement aux institutions européennes lorsque des projets d'acte leur paraîtront en contradiction avec le principe de subsidiarité. Cette prérogative permettra à une majorité de parlements nationaux de s'opposer à une proposition de la Commission européenne qui empiéterait sur les compétences des États membres.
Par ailleurs, une possibilité de recours devant la Cour de justice des Communautés européennes sera ouverte, qu'il conviendra d'utiliser avec discernement, le principe de subsidiarité ne devant pas servir de prétexte pour mettre en échec la construction européenne.
Avec ce traité, la légitimité de la construction européenne sera élargie et renforcée, et nous devons nous en féliciter. Ces progrès contribuent à démocratiser l'Europe et à développer une véritable vie politique européenne, à laquelle nous avons le devoir de participer et que nous devons animer.
Je crois utile de rappeler que, pour la première fois, l'Union européenne se fixe pour objectif de protéger ses citoyens dans le cadre de la mondialisation. Ce point a été évoqué par un certain nombre d'entre nous, notamment par M. Jean François-Poncet. Les préoccupations exprimées par les Français ont été entendues.
La concurrence ne sera plus un objectif en soi pouvant fonder les politiques de l'Union européenne, mais elle sera utilisée comme un outil au service des consommateurs. Nous verrons bien quelle sera l'évolution de la jurisprudence des juridictions européennes à cet égard.
Une autre mesure prévoit que les services publics seront protégés par un protocole ayant même valeur que les traités, et une clause sociale générale impose de prendre en compte des critères sociaux dans la mise en oeuvre de l'ensemble des politiques de l'Union européenne.
Enfin, s'agissant des avancées nouvelles, je veux insister sur les progrès que comporte le traité en matière de politique étrangère et de sécurité commune, au service d'un accroissement du rôle de l'Europe dans le monde. Cela a été nettement mis en lumière par M. de Rohan.
Le traité de Lisbonne ne représente pas le traité idéal dont beaucoup d'Européens rêvent, et il est, sous quelques aspects, en retrait par rapport au projet constitutionnel issu des travaux de la Convention européenne, mais il a le mérite d'exister. Il résulte d'une négociation difficile et représente le maximum atteignable dans les circonstances actuelles. C'est dans les situations de ce genre que l'on peut distinguer ceux qui souhaitent faire progresser l'unité européenne et ceux qui préfèrent le succès de leurs thèses et de leurs intérêts.
Soutenir ce traité est d'autant plus nécessaire que le chemin menant à son entrée en vigueur n'est pas simple. La ratification n'est pas encore acquise partout, et la mise en oeuvre des réformes institutionnelles comporte pas mal de pièges, comme l'a rappelé dans son rapport notre collègue Jean François-Poncet.
À côté des incertitudes - très relatives - sur la ratification du traité de Lisbonne, le vrai problème concerne à mon sens la mise en oeuvre des réformes institutionnelles introduites. Leur application soulève un certain nombre de difficultés, que nous allons devoir analyser rapidement. Ce travail incombera en grande partie à la présidence française de l'Union européenne.
Ce n'est pas un hasard si le Conseil européen a décidé que les « travaux techniques » sur la mise en oeuvre des dispositions institutionnelles du traité de Lisbonne « commenceront à Bruxelles en janvier sur la base d'un programme de travail qui sera présenté sous l'autorité du futur président du Conseil européen », c'est-à-dire le Premier ministre slovène. Les chefs d'État ou de gouvernement avaient ainsi reconnu que les innovations institutionnelles, ou du moins certaines parmi elles, impliquent des difficultés ou suscitent des problèmes qui méritent réflexion.
L'un des aspects essentiels des innovations institutionnelles tient à la création d'une présidence durable du Conseil européen. Elle a été accueillie en général de façon positive, y compris par le Parlement européen, mais des craintes existent toujours que le président de longue durée ne se dote, pour préparer les sommets, d'une structure nouvelle à caractère intergouvernemental, en dehors des institutions communautaires.
Nous verrons à l'expérience, mais il est d'une importance majeure de consacrer l'année 2008 à la mise en oeuvre de ces changements avant d'envisager d'autres chantiers, qui ne font pas l'unanimité dans l'Union européenne et dont l'ouverture pourrait se révéler une erreur en raison d'un pilotage déficient. Je pense bien sûr ici, vous l'avez compris, au projet d'Union méditerranéenne. L'initiative française a eu le mérite de relancer le débat et de placer les relations euro-méditerranéennes au centre de l'actualité. C'est loin d'être négligeable, mais, de toute évidence, la politique méditerranéenne est une question européenne, qui doit être traitée dans l'intérêt de tous.
Tout devra donc être préparé en temps utile afin que les innovations décidées se concrétisent dans de bonnes conditions. Nous devons regarder en avant. Il y va de la réussite de la future présidence française de l'Union européenne.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le traité dont on nous demande d'autoriser la ratification aujourd'hui est d'une nature particulière puisqu'il emporte des transferts de compétence. Nous avons réglé ce problème ces derniers jours en adoptant le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution, dans les deux assemblées, puis au Congrès.
Beaucoup d'arguments de fond ayant été invoqués lors de la discussion de ce texte - j'avais évoqué, quant à moi, des questions juridiques - pour justifier la position de la majorité d'entre nous, je ne fatiguerai pas notre assemblée en les reprenant à cette heure tardive et me contenterai de formuler deux observations qui me paraissent essentielles.
La première concerne la procédure de ratification. Fallait-il un référendum ? Nombre d'entre nous ont été, à juste raison, troublés dans la mesure où, comme l'a indiqué le président Valéry Giscard d'Estaing, les outils du traité de Lisbonne sont pratiquement les mêmes que ceux de la Constitution européenne. Nous sommes en quelque sorte dans une opération à la découpe. La Constitution amoindrie et réduite a donné naissance à ce traité.
Les scrupules que certains peuvent avoir à passer par la voie parlementaire, en évitant le spectre du référendum, alors que le peuple s'est prononcé une première fois, doivent être dissipés parce qu'ils pèsent sur le débat.
Tout d'abord, il s'agit d'un traité. Ensuite, le principe de réalité doit reprendre tous ses droits si nous voulons, comme l'a dit Pierre Mauroy, relancer l'Europe. Enfin, il faut prendre en considération les pouvoirs dont dispose le Président de la République. Ses décisions ou ses choix ne peuvent en aucun cas être subordonnés à l'hypothèque d'une décision antérieure, prise par quelqu'un d'autre.
L'approbation parlementaire est donc une bonne chose.
Deuxième observation, les avancées du traité sont tout de même considérables.
On peut se réjouir de disposer dorénavant d'un président élu pour deux ans, voire pour cinq ans. C'est en quelque sorte une réponse aux sarcasmes d'Henry Kissinger qui demandait : « L'Europe, quel numéro de téléphone ? ». Dorénavant, l'Union européenne aura un représentant bien identifié sur la scène internationale.
On peut aussi se réjouir de l'octroi à l'Union de la personnalité juridique, de la création d'un Haut représentant pour les affaires étrangères, du développement de la codécision législative et de l'intégration de la charte des droits fondamentaux, même si la Grande-Bretagne émet des réserves sur ce sujet.
Il faut insister sur les points de nature à rassurer ceux, qui, dans leur diversité, ont voté « non » en 2005. Ainsi, je rappelle que, comme la France l'avait demandé, la concurrence libre et renforcée n'est plus un objectif de l'Union, et le protocole sur les services d'intérêt général préserve la compétence des États membres, ce qui est un progrès considérable.
Certes, certains éléments ont été retirés du traité : c'est notamment le cas des symboles, le drapeau et l'hymne, auxquels Pierre Mauroy a fait allusion. Mais croyez-vous que la bannière bleue étoilée sera réellement ôtée des bâtiments ? Je ne le pense pas, car les symboles ont la vie dure. N'oublions pas comment Bismarck a fait disparaître le privilège qu'avait le représentant de l'Autriche de fumer le cigare à la Diète de Francfort...
M. le rapporteur et M. le secrétaire d'État ont exprimé leurs réserves sur ce traité, s'agissant notamment du fonctionnement des institutions. Le traité est effectivement extrêmement complexe, et l'articulation entre les quatre piliers ne sera pas chose simple. Par ailleurs, nous avons bien conscience qu'en matière de gouvernance économique, par exemple, face à des pays tels que l'Inde ou la Chine, la maîtrise de certains éléments nous échappe. Et avons-nous les moyens pour lutter contre les mafias ?
En quelque sorte, avec le traité de Lisbonne, l'approfondissement rattrape quelque peu l'élargissement, mais on peut redouter que celui-ci ne reprenne sa course en tête. Nous serions alors obligés de tenter de rattraper un élargissement sans fin, que certains des intervenants ont pu évoquer. Sur cette question, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mes réserves sur l'adhésion de la Turquie, et je n'avais pas voté l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez plaidé pour la suppression de l'exigence du référendum avant tout élargissement. Je suis opposé à l'adhésion de la Turquie, mais je me demande quel pourrait être, demain, le crédit de la France si, après avoir « promené » la Turquie pendant dix ans, elle lui refusait in extremis, par référendum, l'entrée dans l'Union ? Il y va de l'honneur de notre pays, de son crédit, de sa réputation.
« Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple », a écrit Jean-Jacques Rousseau dans Les Confessions. C'est le cas de l'entreprise qu'engagèrent les pères fondateurs de l'Europe, qui ont aujourd'hui disparu, sauf Maurice Faure, à qui nous devons rendre hommage. Il nous faut poursuivre cette entreprise. « Ami, il n'y a pas de chemins ; c'est en marchant qu'on les trace », dit un proverbe espagnol. Le RDSE, dans sa quasi-unanimité, empruntera ce chemin.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP. - M. Pierre Mauroy applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'échelle de la planète, nos destins sont liés et nous voulons en garder la maîtrise collective.
L'Europe des peuples, les Verts la veulent ardemment. En tant qu'Européens et démocrates convaincus, nous avions souhaité en 2005 que se tienne une consultation transnationale des populations à l'initiative des institutions communautaires, car il fallait donner d'emblée le signe que nous devions construire un projet commun. Cela n'a pas été possible et nous avons tiré, pour notre part, les leçons du mécontentement majoritaire des Français.
Tandis que certains voyaient dans le traité un outil d'un changement, l'aspiration des uns à un monde meilleur et le recul nationaliste des autres se sont cristallisés dans le refus de la Constitution européenne en 2005.
L'Europe s'est réveillée grippée.
L'impasse institutionnelle nous oblige à revenir à un scénario de compromis qui se doit de satisfaire les dix-huit pays qui ont approuvé le texte tout en prenant en compte les réticences des pays les plus eurosceptiques et les exigences des citoyens. Mais la diplomatie secrète des conseils a pris le dessus sur le débat public.
La moindre des choses était donc de soumettre le nouveau traité à un référendum. La démarche qui sous-tend le raisonnement du Gouvernement : « s'il existe une éventualité que le peuple dise non, alors on ne lui pose pas la question », est inadmissible !
Le traité quelque peu modifié, mais non simplifié, ne dessine certes pas l'Europe de nos rêves - il reste quelques hypothèques à lever -, mais il traduit une persévérance dans la vision d'un espace élargi, en paix, un espace qu'il faut maintenant « labourer » pour faire émerger un mieux-disant social et environnemental.
Il y a des innovations institutionnelles. Elles ont été largement évoquées : règles de vote à la majorité, rôle renforcé du Parlement européen par le vote du budget de la défense et codécision, ce qui aurait pu nous épargner, en 2005, les OGM en plein champ ! Hélas, la future politique agricole commune sera élaborée selon les anciennes règles.
Le droit d'initiative législative populaire est maintenu.
Nous accueillons favorablement une véritable présidence, la création d'un Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le resserrement du nombre de commissaires. À la place d'un camaïeu de désignations opportunistes, nous souhaitons que les quinze prochains commissaires travaillent en meilleure intelligence avec le Parlement européen.
Après la médiatisation de la conférence de Bali, nous voulons une Europe qui donne le « la » au plan international sur l'urgence d'une prise en compte sérieuse des changements climatiques et sur la nécessité d'une solidarité en matière énergétique.
Nous sommes attachés à nos services publics. Les dispositions des traités ne portent pas atteinte à la compétence des États membres. Les services d'intérêt général dépendent des États. La Confédération européenne des syndicats s'est battue pour imposer que les États aient la responsabilité de les fournir et de les financer.
L'Europe des peuples, certes nous la voulons, mais pas à n'importe quel prix. Nous la voulons sociale, démocratique, et écologique, qui parle fort au coeur des citoyens. Edgar Morin parlerait avec sens d'un projet de « civilisation ».
Alors que la Turquie, pays où les femmes votent depuis 1934, est sommée de se montrer plus laïque, notre Président de la république s'interroge sur les bienfaits de la religion sur la stabilité des sociétés. Au lieu de nous égarer sur des racines religieuses hier nouées dans le sang
Mme Dominique Voynet applaudit.

, laissons ces convictions relever du domaine de l'intime et développons au niveau européen l'ambition d'une compétence culturelle nourrie de diversité, d'échanges, de parcours individuels et de mémoire collective. Fouillons ce qui fait richesse et lien, et non ce qui exacerbe les défiances.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Il y a honte, à la veille de la présidence française, de forger le tout-répressif, fichage ADN en prime - j'espère qu'on ne l'exportera pas à Bruxelles ! - mettant côte à côte des populations exsangues fuyant les conflits armés et les désordres climatiques, et les citoyens convaincus des bienfaits de la solidarité, criminalisés, fichés, dans le cauchemar d'une Europe barbelée.
L'article 11 dispose : « Les droits de l'homme et la démocratie sont un fondement de la politique extérieure de l'Union européenne. »
Il y a honte aussi pour la France à intervenir auprès de Bruxelles pour minorer l'ambition européenne du règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation, et les restrictions des substances chimiques, appelé REACH, qui est le registre des caractéristiques toxiques de certaines de ces substances !
Mme Dominique Voynet et M. Jacques Muller applaudissent.

Avec la mondialisation, les guerres et les perturbations climatiques, des milliers de réfugiés affluent. Nous sous-traitons la répression ; hors de notre vue, des camps sont érigés, grâce à des financements européens, pour maintenir en périphérie les familles en quête de survie. Si ces réfugiés sont à nos portes, c'est que rien dans notre prétendue oeuvre civilisatrice et dans nos échanges commerciaux inéquitables ne leur a permis de rester sereinement chez eux. Ainsi, l'exode des sans-papiers du Congo est le résultat des forêts ravagées pour nos salons en teck !
Les Verts travaillent à une politique de prévention des conflits qui articule clairement le défi humaniste, la justice sociale et la solidarité avec le Sud. Mais cette politique est incompatible avec la prolifération nucléaire, l'impunité pour les pilleurs, le manque d'énergie face aux corruptions et la course aux armements.
Le Grenelle de l'environnement a débouché, grâce au dialogue, sur des propositions ambitieuses. La cérémonie déclarative, placée sous les auspices de MM. José Manuel Barroso et Al Gore, ouvre une responsabilité nouvelle : pour commencer, nous nous devons de respecter intra muros les leçons que nous nous sommes permis de donner aux autres ! Pour l'instant, en matière d'OGM, le Grenelle se fracasse sur la majorité sénatoriale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

L'esprit de bonne gouvernance a permis de mettre en valeur l'apport des usagers, des citoyens et de leur relais associatifs.
À quand un statut européen pour les associations ? À quand également le respect des directives sur la préservation de la nature, l'accès à l'information, la protection de l'eau et la gestion des déchets ?
La présidence française sera l'heure de vérité. Le renforcement du rôle du parlement européen va de pair avec celui des parlements nationaux. Ceux qui, hier encore, se défaussaient en usant de la rhétorique classique : « C'est la faute de l'Europe » devront se responsabiliser.
C'est une chose de plaider à Bruxelles pour la préservation des réserves halieutiques, c'en est une autre d'annoncer des levées de quotas de pêche à Boulogne !
C'est une chose de se proclamer le champion des énergies renouvelables, c'en est une autre de relancer le nucléaire.
C'est une chose d'envisager une politique agricole commune durable, sans pesticides, respectueuse de la biodiversité, ...

... de l'emploi et de la santé, c'en est une autre d'engager des négociations au cas par cas sans éco-conditionnalité.
Ce sont les mêmes qui, le coeur sur la main, promeuvent les OGM au nom de la sécurité alimentaire...

Mme Marie-Christine Blandin.... et font du lobbying pour les agrocarburants !
Mme Dominique Voynet applaudit.

Le rapport de Jean Ziegler, expert des Nations unies, a pourtant montré que la production de ce type d'énergie pour les plus riches entraînait la confiscation des terres au détriment des cultures alimentaires des plus pauvres.
Mme Dominique Voynet applaudit

M. Sarkozy soutient l'idée d'un « new deal écologique » à l'échelon européen et de taxes sur les produits importés des pays qui ne respectent pas le protocole de Kyoto. Nous verrons ce qu'il fera des propositions européennes vertes d'éco-conditionnalité. Taxons également les produits fabriqués dans des conditions non conformes aux règles du Bureau international du travail !
Ces mesures obligent l'Europe à refondre les règles de l'OMC ? Allons-y !
La France qui, isolée, plaide pour la levée de l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine aura bientôt, nous l'espérons, l'occasion de renoncer à cette proposition déshonorante et dangereuse.
L'Europe est fragile parce que ses relations sont placées sous le prisme exclusif de l'économique, ce qui s'est révélé être une impasse.
Nous réaffirmons notre soutien à une Europe culturelle, vertueuse, solidaire et audible dans le monde.
Je souligne que 80 % des sénateurs Verts sont présents sur nos travées ce soir.
Rires sur les travées de l'UMP.

Mme Marie-Christine Blandin. La codécision, l'initiative citoyenne, le renforcement du Parlement nous donnent des outils. À nous ensuite d'assortir d'exigences élevées notre vote - qu'il soit de refus parce qu'il n'y a pas eu référendum ou parce que le compte n'y est pas, ou qu'il soit de soutien parce que nous avons bien l'intention d'en faire quelque chose - pour rendre espoir et avenir aux 492 646 492 habitants que compte l'Europe.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier M. le président de la commission des affaires étrangères, M. le président de la délégation pour l'Union européenne, ainsi que M. le rapporteur, pour son rapport exhaustif et extrêmement précis, ainsi que l'ensemble des orateurs de leurs interventions de grande qualité.
Je répondrai d'abord sur la nature du débat et sur sa portée, évoquées notamment par M. Bret.
La démocratie parlementaire est un élément fondamental du pacte républicain. La démocratie et la souveraineté nationale s'expriment parfaitement dans cet hémicycle. La légitimité du Parlement ne varie pas en fonction des sujets ou des sondages. Il convient de le rappeler ici solennellement. C'est d'ailleurs ce que pensent tous nos partenaires européens, qu'ils aient voté « oui » ou qu'ils aient voté « non », comme les Pays-Bas, et quelle que soit la sensibilité de leurs gouvernants.
Par ailleurs, tous considèrent que ce traité, quelles que soient ses différences avec le traité constitutionnel n'est plus de nature constitutionnelle.
M. Michel Charasse s'exclame.
Enfin, il faut le répéter, le Président de la République a pris ses risques, il a fait montre de courage et n'a fait preuve d'aucune ambigüité à l'égard de nos concitoyens, à un moment où cela n'était pas évident.
Nous avons eu, monsieur Bret, tout le temps de discuter de ce traité depuis le mois de juin dernier.
Vous le savez, je me suis tenu à la disposition de la délégation pour l'Union européenne de la Haute Assemblée. Le débat a lieu depuis 2005 au moins. Les travaux de la commission intergouvernementale ont été présentés ici-même le 4 juillet dernier. J'ai eu l'occasion, à de nombreuses reprises, d'en parler avec vous. J'ai également été présent tout au long des débats sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution, qui a permis à chacun de s'exprimer longuement sur le traité de Lisbonne, comme l'a rappelé Nicolas Alfonsi.
La ratification du traité de Lisbonne permettra de rendre l'Europe plus politique. C'est l'Europe qui protège le mieux contre les spéculations financières internationales - M. Mauroy l'a rappelé - et qui protège le mieux les citoyens dans la mondialisation.
Cela figure d'ailleurs explicitement dans le traité lui-même. La protection des citoyens, voilà un nouvel objectif pour l'Union !
J'observe, et je m'en réjouis, que la très grande majorité des intervenants, quelle que soit leur sensibilité - M. le rapporteur, M. le président de la commission des affaires étrangères, M. le président de la délégation pour l'Union européenne, M. Blanc, M. Mercier, M. Mauroy, en des termes choisis et émouvants, M. Bizet, M. Alfonsi et même Mme Blandin - se sont félicités de la fin de la panne institutionnelle et du renforcement des institutions.
M. Dominique Braye applaudit.
M. Josselin de Rohan a parfaitement souligné les avantages que présente ce traité en matière de politique extérieure et de défense en structurant mieux les coopérations. Monsieur Retailleau, il ne s'agit donc pas d'un traité d'esprit fédéraliste.
Améliorer le fonctionnement des institutions et renforcer leur caractère démocratique constituent véritablement la marque de fabrique, l'essence du traité.
M. Jean François-Poncet, et je l'en remercie, a détaillé les modalités de fonctionnement de ces nouvelles institutions. Le nouveau traité fixe en effet un nouvel équilibre, qui nécessitera des travaux avec nos partenaires, en vue de préparer son entrée en vigueur, comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur. Je sais que nous n'aurons pas le temps de tout faire durant la présidence française, mais nous prendrons avec nos partenaires toutes les décisions nécessaires à l'entrée en vigueur du traité le 1er janvier 2009. Les présidences tchèque et suédoise, qui nous succéderont, auront également un rôle à jouer dans sa mise en oeuvre. Nous travaillerons pour répondre aux questions que vous avez tout à fait légitimement posées ce soir.
Comme M. Haenel, comme vous-même, monsieur le rapporteur, comme M. Mauroy, je crois au génie des institutions, ainsi qu'à celui des hommes et des femmes qui les incarnent ou les incarneront dans le futur.
D'autres questions ont été abordées ce soir.
Le rôle des parlements nationaux est renforcé, notamment en ce qui concerne les politiques de la justice et de la coopération policière. Les parlements nationaux auront la possibilité de faire valoir leurs vues en ces domaines.
L'Europe de la défense, lorsqu'elle sera mise en oeuvre, reposera nécessairement sur les États. Elle sera essentiellement de nature intergouvernementale et sera naturellement soumise au contrôle des parlements nationaux.
J'en viens au contrôle des compétences de l'Union, monsieur Retailleau. Le contrôle de la subsidiarité est à l'évidence renforcé par les dispositions que je viens d'indiquer. J'ajoute - et c'est un élément de clarification et de simplification qu'apporte le traité - que les compétences respectives de l'Union et des États membres sont désormais clairement identifiées, comme l'ont souligné MM. de Rohan et Mauroy.
Le traité permet également d'autres avancées.
Je tiens à souligner, ainsi que M. Blanc l'a fait, la reconnaissance du rôle consultatif du Comité des régions, ainsi que l'intégration des éléments relatifs à la cohésion économique, sociale et territoriale. C'est très important pour certaines zones, en particulier pour les collectivités territoriales d'outre-mer.
M. Mauroy, notamment, s'est interrogé sur le Royaume-Uni et la Pologne. Il est vrai qu'on peut regretter les clauses dites « opt-out » et « opt-in », mais qui dit possibilité de sortir dit aussi possibilité d'entrer. Jusqu'à présent, les États qui ne souhaitaient pas participer à une coopération pouvaient la bloquer. Aujourd'hui, le traité empêche ces pays de bloquer les coopérations dans un certain nombre de domaines. C'est là une avancée qui me paraît tout à fait fondamentale.
Je dirai maintenant un mot sur les relations avec les pays dits « du voisinage » : le traité comporte un nouvel article, l'article 8, qui nous permettra de développer une politique en direction de ces pays. Cette politique a déjà été relancée par la présidence allemande.
Comme l'a souligné M. Retailleau, la question des frontières doit être clarifiée. C'est pourquoi nous avons demandé et obtenu, lors du dernier Conseil européen, qu'un groupe, présidé par Felipe Gonzáles, soit chargé de réfléchir à cette question.
Monsieur Retailleau, les arguments que vous avez invoqués font partie des motifs extrêmement importants qui ont conduit le Président de la République à indiquer très clairement que la Turquie n'avait pas vocation à adhérer à l'Union européenne.
En ce qui concerne le recours systématique au référendum dans le cadre de l'article 88-5 de la Constitution, je me suis exprimé à titre personnel, d'une manière générale et sans viser tel ou tel pays.
En conclusion, je dirai que le traité de Lisbonne n'est pas la panacée, comme vous l'avez souligné, monsieur Mauroy, mais qu'il constitue une avancée majeure, qui permettra de prolonger l'oeuvre des grands européens qu'ont été tous les dirigeants français depuis la signature du traité de Rome, de tous les Européens qu'ont été Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Delors et vous-même, monsieur le Premier ministre, qui avez fait des choix courageux en 1983. Tous s'accordent à dire, et nous avec eux, qu'il faut faire l'Europe en pensant au monde. En effet, ce n'est pas l'Europe qui est boulimique, comme cela a été dit, c'est le monde.
Comment se protéger face aux immenses défis qu'a soulignés Mme Blandin, par exemple, dans un monde qui est aujourd'hui plus dur, plus complexe et sans doute plus dangereux ? L'Europe est bien la seule voie qui permettra de relever ces défis, même si nous savons que cela nécessitera exigence, patience et ténacité. C'est pour cela qu'il est urgent d'avancer !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Avant de passer à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à zéro heure trente, est reprise à zéro heure trente-cinq.

La séance est reprise.
Je rappelle que la discussion générale a été close.

Je suis saisi, par Mme Borvo Cohen-Seat, M. Bret et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n° 2, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes (n° 200, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la motion.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je ne manque jamais de rappeler que, au Sénat, par une sorte de bizarrerie du Sénat, les motions sont présentées après la réponse du représentant du Gouvernement aux orateurs qui se sont exprimés dans la discussion générale. Il conviendrait, me semble-t-il, de modifier notre règlement sur ce point, car il y a là quelque chose d'absolument anormal.
Cette observation liminaire étant faite, j'observe que, à minuit et demi passé, le Sénat est sommé de conclure à marche forcée l'examen du projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. On pourrait même éteindre les lumières pour que cela passe encore plus inaperçu !
Moins de deux mois se sont écoulés depuis la signature du traité par les gouvernements de l'Union européenne, le 13 décembre 2007. Le processus a donc été vraiment très rapide.
Le Président de la République avait donné sa parole, surtout à ses partenaires : la France devait en quelque sorte se « racheter » et figurer parmi les premiers pays à ratifier le traité. Le Président de la République aurait même aimé qu'elle soit la première, mais ce ne sera pas le cas. Ainsi, la France évite avant tout de consulter le peuple et incite les autres pays à en faire autant.
Certains évoquent aujourd'hui la clôture d'un « chapitre difficile ». Certes, pour des responsables politiques, il est toujours « difficile » d'admettre que le peuple les a désavoués. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé le 29 mai 2005. Le peuple a désavoué les principaux états-majors et 93 % des parlementaires.
D'ailleurs, l'enthousiasme qui animait tout à l'heure l'orateur du groupe de l'UMP...

... ne correspondait pas tout à fait à la réalité.
En effet, à l'Assemblée nationale, seuls 336 députés sur 557 ont approuvé le traité.

C'est sûr que vous, les communistes, avec 1, 93 % des voix, vous ne risquez pas d'y arriver !

Certes, c'est une majorité, je vous l'accorde. Mais cela ne correspond pas à l'enthousiasme dont certains ont témoigné dans cet hémicycle.

Ma chère collègue, si vous le souhaitez, je peux vous apporter quelques précisions sur l'adoption du présent projet de loi à l'Assemblée nationale.
La majorité absolue était de 196 voix et 336 députés ont approuvé le texte législatif.
Certes, tous les députés n'ont pas assisté au vote, car certains d'entre eux n'étaient pas en séance, comme cela arrive parfois à l'Assemblée nationale, et même au Sénat.
Sourires

À mon sens, pour revenir sur un vote populaire, il eût été préférable que tous les députés soient présents.
En tout cas, j'estime qu'un chapitre douloureux s'ouvre aujourd'hui, celui d'une Europe qui se construit ouvertement dans le dos des peuples, contre les peuples.
Marques d'ironie sur les travées de l'UMP.

M. Dominique Braye. Moi, je ris, mais vous, tout à l'heure, vous gloussiez !
M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je sais, je « glousse » comme les poules. Je vois qu'en plus du reste, vous êtes extrêmement galant !
Protestations sur les travées de l'UMP.

Tout au long des discussions, nous avons avancé des arguments dénonçant le recours à la voie parlementaire pour ratifier ce traité.
Tout d'abord, nous avons souligné que le traité de Lisbonne reprenait pour l'essentiel le traité constitutionnel rejeté par nos concitoyens le 29 mai 2005.
Jamais la majorité parlementaire n'a reconnu ce fait, pourtant évident, alors que tous les observateurs, eux, l'admettent. C'est le cas du « pilote » du traité constitutionnel européen, M. Valéry Giscard d'Estaing, et de la plupart des autres dirigeants des pays européens, qui s'en prévalent d'ailleurs. Je l'ai déjà dit, mais j'aime à le répéter : dans les pays où le peuple a voté « oui » par référendum au traité constitutionnel européen, on précise qu'il est inutile d'organiser un nouveau référendum sur le traité de Lisbonne puisque celui-ci est identique au traité déjà approuvé. En France, on nous tient le discours exactement inverse : le référendum ne s'impose pas puisqu'il ne s'agit pas du même traité. C'est d'une logique imparable !
Rires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

J'ai d'ailleurs noté que l'éditorialiste du journal Le Monde, qui n'avait rien dit pendant les semaines précédant le débat, a reconnu la légitimité démocratique de la demande de référendum sur le traité, en raison précisément de la similitude entre les deux textes.

Il est évident qu'il faut aller au-delà des différences terminologiques. Certes, le traité n'est plus « constitutionnel » et les symboles ont disparu, mais subsistent les transferts de compétences, la durée illimitée d'application du traité et, surtout, l'intégralité des contenus que le peuple a foncièrement rejetés. Ce que le peuple a rejeté, c'est l'Europe de l'ultralibéralisme, d'une Banque centrale européenne toute-puissante, de l'absence d'harmonisation sociale ou fiscale et de la résignation devant les grands problèmes des sociétés européennes et les désordres mondiaux ! Ce n'est pas l'hymne et le drapeau !

Le porte-parole de l'Élysée, M. Martinon, qui gagne à être connu, s'est bruyamment félicité de la ratification. Selon lui, le Président de la République et les parlementaires qui le suivent auraient « débloqué » l'Europe, que le peuple avait « bloquée ».
Outre le fait que rien n'était bloqué - c'est M. Haenel, président de la délégation pour l'Union européenne, qui le dit -M. Martinon ignore-t-il que, dans une démocratie, la parole du peuple est souveraine et que nul, et surtout pas ses représentants, ne peut la contredire ?
Au fond, le peuple a voulu remettre l'Europe sur les rails de la justice sociale et de la démocratie, et vous n'avez pas voulu l'entendre. Mais n'ayez crainte ! Le peuple français et les autres peuples européens sauront rapidement se rappeler à votre bon souvenir.
Ainsi, vous n'avez pas répondu à la question fondamentale de la similitude entre les deux traités. Vous ne le pouviez pas, car avouer cela dans cet hémicycle, c'était avouer la trahison de la parole du peuple.
Vous avez également fait la sourde oreille à d'autres arguments incontestables.
Le Conseil constitutionnel était-il compétent pour examiner la constitutionnalité des dispositions du traité de Lisbonne ?

Nous avons démontré qu'il ne l'était pas. En effet, en vertu d'une jurisprudence constante, exposée notamment dans une décision du 23 septembre 1992, le Conseil constitutionnel ne peut pas se prononcer sur les choix directement exprimés par le peuple.
Le Conseil constitutionnel aurait dû estimer qu'il ne pouvait être saisi de telles dispositions, le traité de Lisbonne reprenant point par point le traité constitutionnel refusé par le peuple.
Vous n'avez pas répondu sur cet aspect important, car la référence à la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2007 fonde la procédure accélérée à laquelle nous assistons aujourd'hui.
Certains nous demandent comment nous pouvons affirmer l'irrecevabilité constitutionnelle du présent projet de loi, alors qu'une révision de la Constitution est intervenue précisément pour rendre le traité de Lisbonne compatible avec notre loi fondamentale.
Pour mémoire, je rappellerai que soixante-dix sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel le 14 août 1992 en vue de contester la constitutionnalité du traité de Maastricht, et ce après la révision constitutionnelle préalable à sa ratification.
Depuis sa décision du 2 septembre 1992, le Conseil constitutionnel admet la recevabilité d'une telle saisine et considère que la procédure de contrôle de constitutionnalité peut de nouveau être mise en oeuvre « s'il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou plusieurs stipulations du traité ».
Comme je l'ai souligné en présentant la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification, plusieurs points du traité demeurent contraires à la Constitution. Ainsi, la soumission à l'OTAN, le pouvoir absolu de la BCE, l'ouverture à la concurrence des services publics et la remise en cause du principe de laïcité n'ont pas été abordés par la révision constitutionnelle.
Certains observateurs notent d'ailleurs que nous assistons à l'instauration de deux normes constitutionnelles de référence dans notre pays : d'un côté, la Constitution française, qui renvoie explicitement aux principes définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; de l'autre, les normes européennes, qui les contredisent en plusieurs points.
Notre exception d'irrecevabilité est donc parfaitement fondée. Du reste, en 1992, on avait tout à fait admis que des sénateurs, parmi lesquels d'éminents présidents d'aujourd'hui - je veux parler de MM. de Raincourt, Poncelet, Valade -, ainsi que M. Pasqua, puissent contester la constitutionnalité d'un projet de loi autorisant une ratification, et ce même après la révision constitutionnelle s'y rapportant.
Mes chers collègues, vous vous apprêtez à autoriser la ratification d'un traité identique à celui qui a été repoussé par le peuple. C'est la première fois dans notre histoire constitutionnelle qu'un référendum est ainsi contourné par un gouvernement et une majorité parlementaire.
Cet acte grave aurait pu être empêché par le refus de la révision constitutionnelle. En effet, au Congrès, le Président de la République avait besoin des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Pour ma part, je regrette profondément que la gauche ne se soit pas rassemblée
Murmures ironiques sur les travées de l'UMP

... ou encore d'une l'Europe forteresse, obligée de sanctionner et entourée de camps de rétention pour étrangers.
C'était lundi, à Versailles, que le référendum pouvait être obtenu. Le peuple saura reconnaître avec discernement ceux qui ont prôné jusqu'au bout le respect de sa parole.
En fait, outre les aspects constitutionnels que j'ai précédemment rappelés, l'irrecevabilité est une irrecevabilité politique fondamentale.
Très franchement, si le traité était enthousiasmant pour notre peuple comme pour les autres peuples européens, le référendum serait naturel puisqu'il consacrerait les pas franchis dans le sens des aspirations de nos concitoyens. A contrario, le refus du référendum montre à quel point ce n'est pas le cas.
Comme je l'ai indiqué à Versailles, le peuple a le droit de changer d'avis, mais ce n'est certainement pas au Parlement de le faire à sa place.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je vous appelle donc une dernière fois, mes chers collègues, à la raison démocratique : votez cette irrecevabilité, car le déni de la parole du peuple est irrecevable en démocratie !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur certaines travées du groupe socialiste.

Je vous ai écoutée avec beaucoup d'attention, ma chère collègue, mais je me bornerai à vous faire deux ou trois très brèves remarques, ne souhaitant pas ouvrir un long débat sur le sujet.
Je note, tout d'abord, que vous cherchez à démontrer l'indémontrable : vous cherchez à démontrer que le traité de Lisbonne reprend le traité constitutionnel rejeté par référendum.
Protestations sur les travées du groupe CRC.

Je vous ai écoutée sans vous interrompre, madame Borvo. Vous et vos amis pourriez donc avoir la courtoisie de m'écouter !

En quoi les traités sont-ils si différents ?
Ils le sont, bien entendu, dans la forme : l'un était un traité constitutionnel, un traité nouveau, refondant tous les traités précédents ; l'autre ne fait que modifier les traités existants.
M. Michel Charasse proteste.

La différence est tout de même de taille !
Il y a également entre eux une différence d'ambition : le traité constitutionnel répondait, comme son nom l'indique, à une ambition constitutionnelle. Telle n'est pas, à l'évidence, l'ambition des rédacteurs du traité de Lisbonne.
J'ajoute que le traité constitutionnel comprenait trois parties : la première concernait les institutions, la deuxième, la charte des droits fondamentaux, et la troisième rassemblait toutes les dispositions économiques et sociales des traités précédents. Il était, en quelque sorte, l'aboutissement d'un travail de codification.
Le traité de Lisbonne ne compte ni la deuxième partie, ni la troisième partie du traité constitutionnel.

Comment, ma chère collègue, pouvez-vous, dans ces conditions, prétendre que les traités sont les mêmes ? Il est vrai qu'une majorité des dispositions de la première partie du traité constitutionnel y sont en bonne partie reprises.

Permettez, monsieur Mélenchon ! Nous vous écouterons dans un instant. J'ai une impatience folle de vous entendre.

Non ! La teneur de vos propos m'incite en effet à utiliser cet adjectif.
J'affirme que les deux traités sont complètement différents. La première partie du traité constitutionnel n'a jamais fait l'objet de critiques pendant le débat ayant précédé à la consultation.

Vous cherchez, madame Borvo, à démontrer que les deux traités sont similaires, mais ils sont bel et bien différents. Vous pouvez toujours continuer d'égrener vos arguments, mais ils resteront totalement dépourvus de fondement.
Je suis, par ailleurs, stupéfié par le formidable mépris du Parlement que vous avez affiché.
M. Yves Pozzo di Borgo applaudit.

Je songe, en particulier, aux révolutionnaires.
Le référendum tourne au plébiscite, car, comme vous le savez parfaitement, à l'occasion d'un référendum, les citoyens répondent non pas à la question, mais à celui qui leur pose la question.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Eux-mêmes ont dit que les Français ne répondaient pas à la question posée !

Vous avez cité le Président de la République. Comment s'exprimer plus clairement qu'il ne l'a fait ? Candidat, M. Sarkozy avait annoncé que les traités seraient soumis au Parlement, notamment lors de son débat télévisé avec Mme Ségolène Royal, qui avait opté, elle, pour une position contraire. C'est lui qui, à une large majorité, a été élu.

M. Jean François-Poncet, rapporteur. Il est parfaitement dans le droit-fil de la démocratie.
Applaudissementssur les travées de l'UMP.
Madame Borvo, je ne pourrais que reprendre, mais avec moins de brio, les arguments qu'a développés M. le rapporteur et auxquels je souscris totalement.
L'autre pays du « non » y souscrit également puisque, après l'analyse qui a été faite par son Conseil d'État - l'équivalent de notre Conseil constitutionnel -, il est revenu sur les mêmes positions et les mêmes arguments que ceux qui viennent d'être excellemment exposés par M. le rapporteur.
Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement demande le rejet de cette motion.

Je mets aux voix la motion n° 2, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 82 :
Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi, par M. Mélenchon, d'une motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3 du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes (n° 200, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, auteur de la motion.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est tard dans la nuit, et l'on pourrait en tirer argument pour considérer que tout est dit.
Il est tard aussi dans le processus et, dans la mesure où c'est la voie parlementaire qui a été choisie, le résultat peut être préfiguré par la composition de nos assemblées. On pourrait, là encore, considérer qu'il ne sert à rien d'argumenter.

Cependant, la liberté, comme bien d'autres choses, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
C'est une question grave, importante, pour l'avenir de notre patrie républicaine et de notre continent qui nous est posée. Chacun est sous l'empire de sa conscience : il doit dire ce qu'il croit indispensable pour tâcher de convaincre, dire ce qui lui paraît juste et digne pour l'intérêt général.
Vous connaissez la prémisse de mon raisonnement : le peuple ayant, en 2005, par voie de référendum, refusé un texte qui se retrouve pour l'essentiel dans le présent traité, le Parlement n'a pas à démentir ce que le peuple avait alors tranché directement.
Que M. le rapporteur le comprenne bien : nul d'entre nous n'estime que le Parlement ne serait pas légitime à délibérer de quoi que ce soit.
Je crois pouvoir dire que je m'exprime également au nom de mes camarades communistes : nous n'avons jamais dit que le Parlement n'était pas légitime. Nous estimons que, la décision initiale sur ce sujet ayant été prise par référendum, si elle doit être reconsidérée, elle doit l'être par référendum. Nous jugeons en effet que la méthode participe du processus de construction européenne, qui souffre d'un grave déficit démocratique, et que la méthode par laquelle se construit l'Europe compte donc autant que le fond. D'une certaine façon, la forme, c'est déjà du fond.
Je vais à présent développer mes arguments sur le fond, c'est-à-dire sur le contenu du traité.
M. le secrétaire d'État nous a dit que nous devions approuver ce traité parce qu'il favorisera l'émergence d'une Europe plus démocratique. Nous sommes profondément sceptiques ; à dire vrai, nous ne le croyons pas.
La méthode, elle-même, est très inquiétante : le traité constitutionnel avait au moins l'avantage d'avoir été préparé par une convention et d'avoir donné lieu à des débats fort longs - ils ont duré près de deux ans -, avec des étapes intermédiaires et la création d'un site Internet qui en rendait compte.
Or, s'agissant du présent traité, n'était le plaisir d'avoir rencontré, lors des réunions des commissions ad hoc, tel ou tel responsable gouvernemental, nous n'en avons pas eu entre les mains une version consolidée avant le mois de novembre. Je rappelle que ce texte avait connu auparavant trois états de rédaction différents. Je le sais d'autant mieux que j'ai essayé de les suivre.
Ce n'est pas ce que l'on peut appeler une bonne préparation informée pour une discussion sérieuse.
De votre côté, monsieur le rapporteur, vous nous assurez que le présent traité ne reprend que la première partie du texte initial. Je comprends pourquoi vous le dites : le Président de la République avait affirmé qu'il ne procéderait à une ratification par voie parlementaire que si le texte était simplifié et concernait les seules parties institutionnelles.
Il s'était d'ailleurs arrogé au passage le privilège d'interpréter le vote négatif des Français. C'était tout de même assez étrange, mais admettons !
Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un texte simplifié et il ne concerne pas que la partie institutionnelle, bien que vous ayez affirmé à deux reprises qu'il n'avait trait qu'à l'organisation des institutions.
Je relève là deux contradictions.
La première tient aux faits : 198 des 356 amendements modifient les textes antérieurs. Les textes antérieurs ne sont pas maintenus dans leur rédaction d'origine ; ils sont repris tels qu'ils ont été modifiés. Ils constituaient déjà l'ex-troisième partie du traité constitutionnel. Voilà pourquoi cette dernière figure toujours dans le traité de Lisbonne.

Elle l'est sous la forme des amendements qui modifient les textes constituant autrefois la troisième partie.
Par conséquent, le texte n'est pas seulement institutionnel, il ne vise pas le seul fonctionnement des institutions.
Seconde contradiction : on ne peut pas affirmer que ce texte n'est pas une Constitution et déclarer en même temps qu'il ne concerne que l'organisation institutionnelle. L'important n'est pas seulement ce qui est marqué sur l'emballage : c'est aussi le contenu !
Car qu'est-ce qu'une Constitution si un texte qui organise les pouvoirs publics, décrit les rapports entre le Parlement et l'exécutif et précise le pouvoir d'initiative des lois n'en est pas une ? Cela ne fait aucun doute, ce traité a bien une vocation constitutionnelle.

Si je rappelle ces éléments, c'est pour déplorer la faiblesse de la discussion. Certes, ici, au Sénat, le débat, comme d'habitude, est de qualité. Mais tout de même, comment comprendre que, chez un grand peuple comme le nôtre, sur un sujet aussi important, il n'y ait pas eu un seul débat contradictoire sur un quelconque média audiovisuel ? On n'a jamais pu, une seule fois, confronter nos points de vue ! Dès lors, comment savoir qui dit la vérité ?
Je l'admets, je peux me tromper et interpréter tel ou tel point de mauvaise façon.

Mais qu'on me le prouve le texte à la main !
Hélas ! le débat se résume à une simple juxtaposition de monologues, où personne ne répond à personne, où chacun récite continuellement la même litanie d'arguments, sans que l'opinion, si jamais elle s'intéresse à nos discussions, soit capable de dire qui a raison et qui a tort. Que peut-elle d'ailleurs comprendre à une matière aussi compliquée si ceux-là mêmes qui sont chargés de la lui rendre compréhensible et de l'éclairer par leurs contradictions ne le font pas ?
L'intérêt d'un débat, ce sont justement nos contradictions, ce sont elles qui redonnent toute sa signification à la souveraineté populaire, laquelle doit trancher entre les avis des uns et des autres.
De tout cela, nous avons été privés.
Voyons maintenant ce qu'il en est, toujours quant au fond, des prétendues avancées de ce texte en matière de démocratie.
On nous dit que le Parlement européen disposera de pouvoirs accrus et qu'il aura dorénavant le dernier mot.
Franchement, quel Parlement au monde ne peut repousser le budget qu'à la condition de réunir les trois cinquièmes de ses membres ? Où une telle règle existe-t-elle pour prendre des décisions, à part dans les groupuscules ?

Autre exemple : il est décrété que le Parlement n'aura aucune autorité sur l'organisation du marché intérieur et qu'il sera seulement consulté sur les règles de la concurrence. Voilà les « nouveaux pouvoirs » du Parlement européen. Immenses !
Quant aux parlements nationaux, de quels nouveaux pouvoirs disposeront-ils désormais ? J'ai dû, lors du débat la semaine dernière, en demander confirmation pour m'assurer que j'avais bien compris !
Les parlements nationaux pourront vérifier si le principe de subsidiarité est appliqué. Aujourd'hui, il faut être neuf pour le faire. Demain, il faudra être dix. Je parle du principe même de subsidiarité, et non du contenu ou de la possibilité d'amender quoi que ce soit. Il faudra qu'un tiers des parlements se mettent d'accord pour constater que ce principe n'a pas été respecté. Quel exploit ce sera ! Une fois ce constat effectué, ils transmettront leur décision à la Commission. À quoi cette dernière sera-t-elle obligée ? À rien ! §La Commission aura la possibilité de modifier et d'amender, ou de maintenir telle quelle la décision concernée.
Ce que je dis n'est-il pas conforme au texte ?Mais, alors, qu'on vienne me démentir, en public, et le texte en main ! Que ne l'a-t-on d'ailleurs fait avant ? J'aurais peut-être changé d'avis ! Mais je n'ai jamais entendu une réponse précise et technique à cette question.
Enfin, on met en avant le nouveau droit offert aux citoyens de signer une pétition. Ce n'est pas moi qui vous dirai que signer et déposer une pétition n'est pas acte démocratique. Face à une institution, on veut croire qu'elle aura une suite. Mes camarades et moi-même avons d'ailleurs déposé récemment une pétition portant 120 000 signatures à l'attention du président du Congrès du Parlement, M. Accoyer. J'attends bien sûr de connaître la suite qui lui sera donnée avec l'intérêt que vous imaginez.
Là, il s'agit d'un droit de pétition européenne. La grande affaire ! Il existait déjà avant le traité constitutionnel lui-même. Mais aucun nombre minimum n'était précisément exigé. Désormais, c'est écrit : il faut être un million pour pétitionner. Quel grand progrès ! Nous voilà passés du droit de pétitionner à deux à l'obligation de pétitionner à un million ! Et pour obtenir quoi ?

Rien du tout !
La Commission peut prendre en compte la pétition, à la condition que son contenu soit conforme aux traités, mais elle n'y est nullement obligée.

M. Dominique Braye. Heureusement ! Il ne peut pas y avoir d'injonction !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.

Je le comprends parfaitement ! Je veux simplement souligner qu'il est abusif de présenter comme une nouveauté et même un progrès quelque chose qui existait déjà, qui n'a aucune espèce de conséquence et qui élève le droit d'accès de deux signataires à un million. Selon l'usage ordinaire du français courant, on ne peut pas appeler cela un progrès ! Le devoir de vérité m'oblige à le souligner.
Voyons encore un point délicat.
Le traité constitue une Commission qui gardera seule l'initiative des lois votées par le Parlement. Elle comptera moins de membres qu'il n'y a d'États dans l'Union européenne. J'entends bien les optimistes : on peut toujours supposer que chacun de ces membres sera immédiatement en charge, par une sorte d'onction qui lui viendra non pas du suffrage universel, mais de sa propre conscience, de l'intérêt général européen.
Pour autant, je ne vois pas comment l'intérêt général européen peut être formulé autrement que par le suffrage universel. D'ailleurs, plus globalement, comment l'intérêt général peut-il être formulé autrement ?
Mais j'en reviens au fait : il y aura moins de commissaires que d'États membres.
Certains se sont même réjouis de ce que la France y apparaîtrait dorénavant une fois tous les cinq ans, contre une fois tous les quinze ans avec l'ancienne règle.
Je vous demande de considérer qu'en certaines circonstances le résultat du « tourniquet » fera que les Français n'y seront pas. Pourtant, cela a été rappelé tout à l'heure, nous sommes l'un des peuples les plus nombreux d'Europe. Seules six nations comptent plus de 40 millions d'habitants. Mais, dans certaines circonstances, il n'y aura ni Français ni Allemand à la Commission !
Dès lors que les lois ne seront pas votées sous l'empire d'un Parlement fondé sur la légitimité du suffrage populaire, où chacun abandonne sa particularité, comme c'est le cas dans notre nation française et dans les autres, quelle sera la légitimité de ces lois, sachant que, de surcroît, deux des plus grands pays européens pourront être absents de l'endroit qui aura l'initiative de ces mêmes lois ?
Je le dis en ayant à l'esprit l'idée qu'en démocratie il n'y a pas d'autre autorité légitime que celle à laquelle on consent. Et l'on n'y consent et elle n'est légitime que parce qu'elle procède du souverain, c'est-à-dire du suffrage populaire. Tout le reste, c'est l'Ancien Régime ! Et, d'une certaine façon, nous y allons tout droit avec ce dispositif institutionnel !
Voilà les principales critiques que je souhaitais faire sur le contenu démocratique du texte.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez aussi affirmé que l'Europe serait dorénavant plus protectrice. Ô comme nous le voudrions ! Vous avez précisé, dans votre réponse aux orateurs de la discussion générale, que cette Europe nous protégerait contre les mouvements financiers erratiques de la planète.

Comment le nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourrait-il réussir ce prodige, sachant que son article 56, reprenant ainsi très exactement les termes de l'article III-156 de l'ancien projet de Constitution, précise que toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ?
Où et comment commence la protection contre les mouvements financiers erratiques quand un article du traité précise, explicitement, qu'il ne doit être mis aucune barrière à la circulation des capitaux, alors même que cela constitue, nous le savons, la racine de la déstabilisation du monde ?
Dès lors, la question est de savoir non pas si la crise financière ravagera notre pays, mais quand elle le fera !
En outre, comment l'Europe pourrait-elle alors être plus protectrice si ce même traité sur le fonctionnement de l'Union européenne maintient les interdictions d'harmonisation sociale ?
En matière d'emploi, ces harmonisations sont interdites par l'article 129 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Sur les politiques sociales et la protection sociale, elles le sont par l'article 137. Pour la politique industrielle, qui est pourtant essentielle dans les compétitions dont vous avez tous souligné l'importance au niveau mondial, par l'article 176 F. En matière de santé, par l'article 176 E. S'agissant de l'éducation et la formation professionnelle, par les articles 176 B et 176 C. En ce qui concerne la recherche et les technologies, par l'article 172 bis.
Tout bien pesé, ce traité est en retard d'une guerre.
On pouvait imaginer que le précédent méconnaissait l'état de tension du monde, le rôle des fluctuations financières, l'importance qu'il y avait à organiser à l'intérieur de l'espace européen un minimum d'égalité qui permette l'harmonisation fiscale, afin d'empêcher les peuples d'être dressés les uns contre les autres pour leur pain, pour leur dignité, pour leur travail. On pouvait l'imaginer, du moins si l'on avait une vision optimiste et euphorique de l'avenir du monde. C'était la thèse de la « mondialisation heureuse ».
Mais comment le croire aujourd'hui, quand toutes ces compétitions se déchaînent et que nous sommes témoins de leur violence implacable ?
Ce sont pourtant ces règles dépassées que le nouveau traité établit. Cela ne vous empêche pas - et je veux bien croire que ce soit de bonne foi - de venir à cette tribune dire votre espoir d'une Europe protectrice, votre volonté d'une Europe sociale et d'une Europe plus politique. Pourtant, vous vous apprêtez à voter un texte qui prévoit exactement le contraire et qui, loin de s'en contenter, interdit d'emprunter une autre voie. Un texte gravé dans le marbre ! Il ne pourra être modifié à l'avenir que dans les conditions qui étaient celles du traité constitutionnel, c'est-à-dire à l'unanimité.

Vous pouvez toujours prétendre le contraire, mais c'est la réalité ! Auparavant, nous étions six, puis douze, mais désormais nous serons trente. À quel prix l'unanimité sera-t-elle possible ?
J'en viens à présent au recul que nous devons prendre par rapport à l'histoirel'histoire.
J'ai critiqué l'autre jour à cette tribune la méthode actuelle de la construction européenne, ce qui m'a valu d'être contesté, d'une manière extrêmement courtoise et intéressante, par l'ancien Premier ministre, M. Raffarin, lequel m'a rétorqué qu'il y avait une continuité en la matière. Mais bien sûr ! Pour autant, ceux qui ne sont pas capables de voir que cette continuité n'exclut pas l'existence de seuils nient la vie elle-même, qui est précisément faite de transitions et de seuils.
L'Europe à six dans le monde de Yalta, l'Europe à douze dans le monde de Yalta, l'Europe à quinze dans le monde de Yalta, cela n'a rien à voir avec l'Europe à vingt-sept dans le monde d'après-Yalta !
L'Europe initiale n'a pas été faite pour autre chose que pour le monde de Yalta, parce que, dans ce monde, il n'y avait pas de place pour une guerre entre les Français et les Allemands. Il fallait donc prendre toutes les précautions nécessaires pour désamorcer les causes de tensions entre ces deux peuples, qui avaient déjà provoqué trois guerres.
Voilà ce qu'était la première Europe, et tout le monde ne l'a pas acceptée. En France, Pierre Mendès France s'était opposé au traité de Rome parce que ce dernier instituait comme arbitres suprêmes le marché et la libre concurrence.

Selon lui, c'était une tyrannie, car la société humaine, disait-il, ne peut être soumise qu'à la loi de la raison, dont la démocratie est le seul moyen. C'est dire que nos débats ont aussi leur continuité !
Lorsque le Mur est tombé, vous savez comme moi quels problèmes ont été immédiatement posés par la reconnaissance des frontières. C'est un fait historique. Nous autres les Français, nous avons posé comme condition à la réunification de l'Allemagne la reconnaissance de la ligne Oder-Neisse.

Nos amis allemands ont accepté : il leur a fallu un mois et demi pour le faire. Cela fait réfléchir.
Les permanences de l'Histoire sont à l'oeuvre. Je le dis, non pour que nous nous opposions les uns aux autres, mais parce que chaque génération doit réunir de nouveau les conditions de base de la paix. Et quelles sont-elles ? Quand il n'y a plus cette opposition que l'on appelait l'« équilibre de la terreur », qui maintenait la paix, qui nous obligeait, nous, à vivre en paix, quelle est la condition nouvelle de la paix ? C'est un bien mauvais choix que l'on fait que celui qui consiste à jeter les peuples les uns contre les autres dans la compétition pour le travail, pour le droit social, pour la fiscalité. Voilà bien les ressorts de la haine !
Mes chers collègues, j'espère de toutes mes forces me tromper. Mais tel que va aujourd'hui le monde, nous ne pouvons sous-estimer pas les risques de guerre. On ne peut pas jouer avec ces questions-là. !
Dans la vie des nations, la paix n'est pas l'état de nature. C'est une construction politique, et le premier devoir pour réussir cette construction politique, c'est de désamorcer les causes de guerre. Et la première cause de guerre, c'est l'opposition entre les peuples.
Chaque fois qu'une entreprise est délocalisée, nous semons de la méfiance, de la jalousie, parfois de la haine, et ainsi de suite.
Quand un pays prend l'avantage sur les autres parce qu'il réduit les droits sociaux et la fiscalité, cela ne crée aucunement de la conscience européenne.
Voilà ce que je veux dire modestement, à la place qui est la mienne, celle d'un parlementaire qui représente, me semble-t-il, une partie de l'opinion assez vaste pour que vous en ayez eu des échos jusque dans vos propres rencontres.
Le tournant qui a changé définitivement l'Europe a été pris avec l'élargissement, lequel a été mené dans des conditions qui m'ont conduit à m'abstenir ici même sur cette question. D'un seul coup, un seul, on a fait entrer dix nations dans l'Union européenne, sans approfondir les mécanismes de décision démocratique commune.
Puisque nous voulons être un contre-exemple par rapport à celui des États-Unis d'Amérique, dites-moi donc en quoi nous le sommes ! L'Union européenne est moins démocratique que les Etats-Unis ! La Banque centrale européenne est moins soumise au pouvoir politique que ne l'est la Réserve fédérale américaine !

Et je pourrais donner bien d'autres exemples !
Vu la manière dont elle fonctionne aujourd'hui, l'Europe n'est pas un contre-modèle : elle pire que le modèle !
De toute façon, en matière de politique étrangère, nous avons déjà dit que nous ferions comme les Etats-Unis, quoi qu'ils fassent, puisque nous nous inscrivons dans le cadre de l'OTAN, ce qui est également précisé dans le traité.

Voilà ce que sont les conditions générales dans lesquelles nous construisons l'Union européenne.
Cela est totalement étranger à notre identité républicaine. Le Français se définit, non par une vision ethnique ou essentialiste de la nation, mais par son identité républicaine, à la suite de la grande Révolution de 1789, qui est notre contribution à l'histoire universelle. Nous pouvons en être fiers aussi de temps en temps, pour ne pas en rester au chemin selon lequel, chez nous, tout est mal et, chez les autres, tout est bien.
Les transferts de souveraineté ne sont pas un problème pour moi et pour mes camarades. Mais la souveraineté ainsi transférée ne peut être placée que sous un seul et unique souverain : le peuple, le suffrage universel.
C'est à ce prix que se dégagera un intérêt général européen. Il existe, et il se manifestera notamment en faveur de l'harmonisation fiscale et sociale. Mais cela se fera alors contre ces institutions et contre ces traités qui prétendent l'interdire.
Je ne souhaite pas ici jouer les Cassandre. Je veux seulement dire que, pour des Européens convaincus, qui mettaient leurs pas dans ceux d'un homme pour lequel j'avais et j'ai toujours une admiration immense, le président François Mitterrand, pour ceux qui, comme moi, ont voté le traité de Maastricht, une page se tourne.
Cet épisode est une rupture intellectuelle et affective. Cette Europe-là, celle du traité de Lisbonne, je n'ai rien à voir avec elle. Ce modèle de construction de l'Union européenne, à mes yeux, est définitivement hostile aux peuples.
Je vous mets au défi de me citer une seule mesure émanant de cette Europe qui soit conforme à l'intérêt des Français ou à l'intérêt des peuples !
Vous nous dites alors qu'il existe une Charte des droits fondamentaux. Mais citez-nous un seul de ces droits qui ne soit pas déjà connu et adopté par les Français ou qui soit supérieur à la législation française ! Citez-moi un seul de ces droits qui ne soit pas appliqué dans l'un des États membres de l'Union européenne ou dans l'un de ceux qui y entrent ! Car on ne peut pas entrer dans l'Union européenne si on ne reconnaît pas les droits de l'homme ! Et il n'y a pas un seul de ces droits fondamentaux qui soit différent de ceux proclamés par la Déclaration des droits de l'homme.
Tout cela, à mes yeux, c'est de la fumée !
Je vous prie de bien vouloir m'excuser si je m'emporte, mais cette voix de la passion, c'est aussi celle de l'amour d'une idée, l'idée républicaine.
J'achève sur un mot : vive la République européenne, si elle doit naître ! §

J'ai écouté avec beaucoup d'attention le plaidoyer passionné de notre collègue Mélenchon, dont j'ai admiré le talent oratoire, mais dont la dialectique m'a stupéfié.
En effet, il a donné à toutes les dispositions du traité des interprétations totalement personnelles.

Je ne veux pas dire pas qu'il est le seul à penser cela, mais il s'agit tout de même d'interprétations personnelles !

Je ne répondrai pas à chacun de ses arguments, pour la simple raison qu'il me faudrait reprendre l'intégralité de mon exposé.

Au travers de cet exposé, j'ai présenté les dispositions du traité et expliqué l'interprétation que j'en faisais. À notre assemblée de décider si celle-ci lui convient ou non !
Manifestement, mon interprétation ne correspond en aucun point, sans exception, à celle de M. Mélenchon.

Je ne lui ferai donc pas de réponse exhaustive, car nous y serions encore demain matin !

C'est pour cela qu'il faut raccourcir le débat, monsieur le président !

Sur chacun de ces points, en effet, M. Mélenchon resterait sur sa position, et moi sur la mienne !
Je ne prendrai donc qu'un exemple.
M. Mélenchon nous a dit que les pouvoirs du Parlement européen n'étaient nullement accrus. Le Parlement européen aura pourtant un pouvoir législatif exactement identique à celui du Conseil européen. Je me souviens, pour ma part, de l'époque où son rôle était purement consultatif. Avec le traité de Lisbonne, qui donne au pouvoir législatif une extension aussi large que possible, nous sommes parvenus au terme de ce processus, sauf à aller plus loin en dépouillant les États de toute voix au chapitre en matière de législation européenne.
En matière budgétaire, le Parlement européen a désormais des pouvoirs égaux à ceux du Conseil des ministres, ce qui n'était pas le cas. Autrefois, le Parlement ne pouvait intervenir que sur les dépenses facultatives. Les dépenses obligatoires, parmi lesquelles figurait la politique agricole, lui échappaient. Désormais, il est sur un pied d'égalité avec le Conseil des ministres et, en cas de désaccord, s'il réunit une majorité des trois cinquièmes, c'est lui qui a le dernier mot.

M. Jean François-Poncet, rapporteur. Le Parlement européen connaît donc une montée en puissance spectaculaire !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat rit.

Vous pouvez toujours rire, madame Borvo, mais c'est la vérité ! Nous pouvons d'ailleurs l'observer dès à présent : le Parlement est devenu l'un des organes principaux, de l'Union européenne, et il en sera peut-être, dans l'avenir, l'organe principal.
Naturellement, on peut toujours prétendre le contraire et dire que ce sont des histoires, comme tout le reste !
Il y donc deux interprétations radicalement différentes du traité de Lisbonne sont entièrement, et je n'abuserai pas de la patience de mes collègues en défendant, sur chaque point évoqué par M. Mélenchon, une position exactement opposée,
Monsieur Mélenchon, vous avez évoqué des questions importantes.
Je ne reviendrai pas sur celle du Parlement européen, sinon pour rappeler qu'en matière budgétaire, c'est seulement en cas de désaccord avec le Conseil des ministres qu'il doit réunir une majorité des trois cinquièmes, et s'il veut avoir le dernier mot. Dans tous les autres cas, les dispositions budgétaires sont votées à la majorité simple, comme le prévoit l'article 314 du projet de Constitution européenne.
Vous avez également évoqué un certain nombre de domaines précis.
On peut l'approuver ou non, mais je rappelle que nous intervenons dans l'élaboration des directives en matière de médicaments et de santé. Il faut trouver un équilibre entre la subsidiarité que vous souhaitez, monsieur le sénateur, pour les raisons que vous avez expliquées, et l'harmonisation qui doit être conduite au niveau européen.
En matière fiscale, sujet qui n'a pas été abordé, il est vrai que c'est toujours l'unanimité qui prévaut, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais le traité permet d'engager des coopérations renforcées dans ce domaine, sans que les autres États puissent s'y opposer. C'est donc à nous de les engager, si nous le voulons.
Je souhaite revenir sur un point fondamental : la continuité de la construction européenne et l'Europe à vingt-sept.
Je ne peux pas vous laisser dire que l'Union européenne était nécessaire du temps de Yalta, mais qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, ...
... et qu'elle se justifiait surtout dans les relations entre la France et l'Allemagne.
Comme le disait le président Chirac, la paix demeure le premier objectif de l'Union européenne.
Dans son dernier discours, prononcé devant le Parlement européen, et auquel j'ai assisté, le président François Mitterrand ne disait-il pas : « Le nationalisme, ...
Exactement, Michel Charasse ! Et cela reste vrai.
Imaginez, monsieur Mélenchon, ce que serait ce continent si nous n'avions pas donné de perspective européenne aux pays qui nous ont rejoints ! Pensez-vous que les risques de conflit entre les populations seraient moindres, compte tenu des problèmes actuels liés aux minorités ?
Très bien ! sur les travées de l'UMP.
M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'État. Pourquoi croyez-vous que nous ouvrons cette perspective européenne aux pays des Balkans, si ce n'est pour éviter que les conflits ne dégénèrent !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Le maintien de la paix demeure le but ultime de l'Union à vingt-sept !
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons le retrait ou, à défaut, le rejet de votre motion tendant à opposer la question préalable.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix la motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 83 :
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, nous passons à la discussion de l'article unique.
Est autorisée la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

L'amendement n° 1, présenté par MM. Charasse et Mélenchon, est ainsi libellé :
I. - Au début de cet article, ajouter les mots :
Vu les décisions du Conseil constitutionnel des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007,
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Tout acte européen de quelque nature que ce soit contraire aux décisions susvisées du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France.
La parole est à M. Michel Charasse.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à cette heure avancée, je vais essayer d'être rapide, simple et un peu pédagogique, mais sans exagérer.
Comme l'ont rappelé plusieurs collègues tout au long de cette discussion, le Conseil constitutionnel a été préalablement saisi du traité de Lisbonne, comme il avait d'ailleurs été saisi en 2004 du précédent traité, dit « constitutionnel ». Les décisions qu'il a rendues les 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007 ont fixé le cadre constitutionnel de l'action du Parlement et du Gouvernement.
Dans ces deux décisions, le Conseil constitutionnel a indiqué, en gros, que, si les institutions européennes jouaient normalement le jeu, la République ne pouvait être ni menacée ni mise en cause, pas plus que ses principes fondamentaux, notamment ceux qui interdisent le communautarisme ou qui touchent à la laïcité.
Ces points ayant été validés par deux fois par le Conseil constitutionnel et celui-ci ayant écarté toute modification de la Constitution à leur sujet, nous n'avons pas expressément modifié la Constitution sur ces questions en allant, lundi dernier, à Versailles.
Pour prendre position, le Conseil constitutionnel s'est notamment appuyé, outre, naturellement, le texte des deux traités, sur les explications données par le présidium de la convention qui a élaboré le traité de 2004. Or il se trouve que ces explications n'ont pas été confirmées par cette instance ou une autre avant la signature du traité de Lisbonne. On peut donc d'emblée se demander, bien que les deux textes des deux traités soient souvent voisins, si elles s'appliquent bien au second traité comme elles s'appliquaient au premier.
Mais la question qui se pose, mes chers collègues, puisque nous n'avons pas modifié la Constitution sur ces points - et c'est heureux ! -, est la suivante : que va-t-il se passer si un acte européen viole, volontairement ou non, les décisions du Conseil constitutionnel ? Je ne pense pas forcément à une décision de la Commission, du Conseil ou du Parlement - qui, à mon avis, y regarderont à deux fois avant de s'attaquer aux traditions constitutionnelles des États -, mais à une décision de justice. Or la justice européenne nous a appris, comme d'ailleurs la nôtre, et sans doute toutes les autres justices dans tous les pays du monde, à faire quelquefois peu de cas des textes eux-mêmes, quand elle ne s'assoit pas carrément dessus !
Nous nous trouvons donc, mes chers collègues, et pour les mêmes raisons, dans la même situation qu'en juin 1977, lorsque le Parlement a été saisi de l'autorisation de ratifier l'acte européen du Conseil relatif aux élections du Parlement européen au suffrage direct. Le Conseil constitutionnel avait alors dit que cette ratification ne posait pas de problème et que l'acte n'appelait pas de révision de notre Constitution, notamment parce que le Parlement européen n'appartient pas à l'ordre institutionnel français.
À l'époque, méfiant, le législateur avait estimé nécessaire de rappeler dans la loi d'autorisation l'existence de la décision du Conseil constitutionnel interdisant toute extension des pouvoirs du Parlement européen. Les chambres avaient même ajouté à la loi d'autorisation - c'est la seule et unique fois que cet événement s'est produit sous la Ve République - un deuxième article, pour préciser que « tout acte contraire à la décision du Conseil constitutionnel sur l'élection au suffrage direct était nul et de nul effet à l'égard de la France ».
Par conséquent, je crois nécessaire de prendre la même précaution, car l'autorisation parlementaire ne peut naturellement être accordée que si le traité est conforme à la Constitution. Or il ne le sera que dans la mesure où les deux décisions du Conseil constitutionnel seront strictement respectées.
La loi d'autorisation doit donc rappeler cette exigence, qui doit être prise en compte dans le consentement français au moment de la ratification.
Les choses sont simples. Ou bien, comme en 1977, nous faisons figurer l'interprétation du Conseil constitutionnel, qui valide le traité pour tout ce qui touche à la République dans la loi d'autorisation ; c'est ce que propose mon amendement. Ou bien je le retire si le ministre nous dit clairement que, lors du dépôt des instruments de ratification, la France rappellera que le traité ne peut lui être appliqué que pour autant que sa Constitution soit respectée. Elle rappellera aussi cette contrainte particulière : le Parlement français n'a donné son consentement à la ratification qu'après s'être assuré qu'il n'y avait pas de problème pour la préservation de la République « à la française » et les principes fondamentaux sur lesquels elle repose.
Tel est l'objet, monsieur le président, de l'amendement n° 1.

Largement admiratif de la démonstration de notre collègue, je me suis dit qu'avec son immense talent, j'allais presque dire son génie, il démontrerait n'importe quoi !

rapporteur. C'est un compliment que je cherchais à vous faire, cher collègue !
Vous ne vous étonnerez pas que je ne vous suive pas dans une argumentation que je ne suis d'ailleurs pas sûr d'avoir totalement saisie. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe).
Madame, j'ai des limites intellectuelles, c'est vrai, mais il vaut mieux les avouer !
Je m'en tiendrai aux observations suivantes.
À ma connaissance, l'émission de réserves relève de la compétence exclusive de l'exécutif, qui négocie et signe les traités.

J'ajoute que, concernant les traités communautaires, les réserves doivent, pour être valables, être émises au plus tard au moment de la signature du traité. Si elles ne l'ont pas été, elles sont nulles et non avenues du point de vue européen.
Je relève aussi - observation que, j'en suis sûr, M. Charasse balaiera -, que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule expressément que « l'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres ». Cette disposition me suffit !
Par conséquent, d'une part, je ne crois pas que nous puissions émettre une réserve : le faire à ce stade n'aurait aucune portée sur le plan européen. J'estime, d'autre part, que le traité lui-même exprime très clairement ce qu'il y a à exprimer sur le sujet, rendant tout ajout inutile.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je m'en remettrai à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, institution républicaine respectée s'il en est.
D'une part, une réserve interprétative ne peut être d'origine parlementaire, comme l'a rappelé la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003 en son point 18. Vous la connaissez, monsieur Charasse, et je ne me risquerai pas à vous faire la leçon en matière constitutionnelle !
Sourires
D'autre part, dans sa décision du 25 mai 2005, le Conseil constitutionnel a jugé que le visa de ses propres décisions était superflu dans les lois de ratification et que l'exposé était tout à fait suffisant.
Donc, compte tenu du caractère superflu des réserves, quelle que soit leur origine, d'ailleurs, et du fait que le traité prévoit également le respect des Constitutions nationales, je vous propose, monsieur Charasse, de bien vouloir retirer l'amendement que vous avez déposé avec M. Mélenchon. Sinon, je serai contraint d'en demander le rejet.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'argumentaire de notre collègue Charasse repose sur l'existence d'un risque pour notre laïcité. C'est l'existence de ce risque qu'il faut apprécier.
Notre collègue Jean François-Poncet estime qu'il n'y a pas de risque. Il s'appuie sur l'alinéa 1 de l'article 16 du traité de fonctionnement de l'Union européenne: « L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient en vertu du droit national les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. »
Il aurait dû pousser sa lecture jusqu'à l'alinéa 3. En effet, celui-ci crée le cadre juridique qui, en toute hypothèse, permet la mise en cause d'une décision à caractère laïque de la République française : « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ses églises et organisations. »
Le cadre juridique ainsi posé, voici implicitement une nouvelle difficulté : de quelles églises parle-t-on ? Qui établit cette liste ? Je vous rappelle que la République française est montrée du doigt parce qu'elle caractérise comme sectes un certain nombre de groupes qui s'autoproclament « églises » et qui sont reconnus comme telles par d'autres pays. Je pense, en particulier, à la prétendue Église de scientologie, qui vient d'être reconnue en Espagne et qui est considérée en France comme une secte.
À cette raison s'en ajoute une autre. Elle trouve sa source dans l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux, dont vous nous avez dit à l'instant qu'elle a une valeur contraignante, qui va dorénavant s'imposer et élargir le champ des libertés.
Que dit l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux ? « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. » Avec cela, nous sommes parfaitement d'accord. « Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. »
Avec cela, nous ne pouvons pas être d'accord parce que cela veut dire que, sur la base de cet article de la Charte des droits fondamentaux, la loi française qui interdit de se présenter dans un établissement scolaire avec un foulard sur la tête pourrait ne pas être acceptée par l'Union européenne.
On m'a rétorqué que l'article 10 de la Charte n'était que la reprise mot pour mot de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est presque vrai, mes chers collègues. Presque ! Car la Charte n'a pas repris le deuxième paragraphe de cet article, qui permet, précisément, de limiter la liberté religieuse dans l'intérêt public. Or la Charte n'autorise ces limitations à l'article 52-1 que pour des objectifs d'intérêt général, reconnus par l'Union. Mais la laïcité ne fait pas partie des objectifs affirmés par l'Union, bien au contraire !
Enfin, deux cours seraient désormais habilitées à interpréter ces mêmes articles : la Cour de justice des Communautés européennes, celle qui siège à Luxembourg, garante des traités et de la Charte, et la Cour européenne des droits de l'homme, celle qui siège à Strasbourg, garante des droits de l'homme.
Mais il est bien précisé à l'article 52-3 que l'harmonisation des décisions de ces cours différentes ne doit pas faire obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
Par conséquent, un juge pourrait faire appliquer l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux s'il estimait qu'il donne une protection plus étendue que la version plus restrictive d'un autre traité. Or la laïcité est considérée comme une restriction de la liberté de conscience par nos partenaires européens et non pas comme son socle, ainsi que le pensent les républicains français.
Il n'y a donc aucune raison que le Parlement ne vienne pas rappeler des réserves qu'il est en droit de formuler après les décisions du Conseil constitutionnel, à moins que vous n'ayez déjà opté pour une autre version de la laïcité.

Mais alors, il serait bien que quelques-uns d'entre vous aient le courage de l'assumer, comme nous-mêmes assumons nos opinions.

Après la brillante mise au point de mon collègue et ami Jean-Luc Mélenchon, je serai bref.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention et d'amitié, et depuis très longtemps. Je voudrais vous préciser que je me conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003, que vous venez de rappeler : le Parlement ne peut formuler aucune réserve nouvelle ou supplémentaire, et je m'en garde bien ! Mais puisque certaines réserves existent du fait même des décisions du Conseil constitutionnel et que nous ne les avons pas levées à Versailles, je rappelle leur existence et leurs exigences. Ce n'est pas la même chose ! Si je créais de nouvelles réserves, vous ne manqueriez pas de me dire que je viole la règle de recevabilité définie en 2003 et vous auriez raison.
Les réserves visées par mon amendement sont celles du Conseil constitutionnel. Dans une situation analogue, elles ont été intégrées sans inconvénient dans la loi du 30 juin 1977 approuvant l'élection de l'assemblée européenne au suffrage direct.
Donc, je n'ajoute rien, et je ne méconnais pas la décision de 2003 du Conseil constitutionnel. En fait, je crois que le Conseil avait été saisi à la suite de tentatives de dépôt d'amendements à l'Assemblée nationale pour modifier certains articles d'un traité. C'est une horreur absolue, car le Parlement ne participe en rien à la négociation des traités, qui est une prérogative exclusive de l'exécutif.
Soucieux de ne pas éterniser la discussion à cette heure tardive, je vous pose une seule question, une question très simple : comment le Gouvernement - celui-là ou un autre -protégera-t-il la République et ses principes à l'occasion de la mise en oeuvre du traité si les limites posées par le Conseil constitutionnel ne sont pas respectées ? Pour ma part, je n'ai pas vraiment de doutes sur la manière, a priori loyale, dont le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen, le Conseil des ministres appliqueront le traité.
Pour les juges, mon collègue et ami Jean-Luc Mélenchon vient de dire ce qu'il en est. Ce ne serait pas la première fois que la Cour européenne du Luxembourg prendrait des libertés avec le traité !
J'avais appelé l'attention de Jean-Pierre Jouyet sur ce sujet quand a été négocié le traité de Lisbonne. Alors que le traité dit qu'en cas de non-transposition d'une directive la Cour peut infliger une astreinte ou une amende, elle a décidé, toute seule, de son propre chef, de cumuler l'astreinte et l'amende ! Pourtant, dans le traité, figure bien le « ou ». Et les États se couchent devant les juges : ils paient sans rien dire !
Tant qu'il s'agit d'une histoire de gros sous, on peut toujours s'arranger. Quand j'étais ministre, j'ai perdu une fois devant la Cour. Comme j'estimais qu'elle avait violé manifestement les traités, j'ai fait savoir que je ne paierais jamais, que j'allais m'en aller, que je ne viendrais plus au Conseil des ministres et que je ferais la « grève » des contributions françaises. Cela s'est très vite arrangé. Quand on sait se faire respecter, on se fait respecter !
Mais que faire face à une décision de justice qui concerne des tiers et qui leur crée des droits ?
Par conséquent, je vous pose, monsieur Jouyet, cher ami, la question : comment protégez-vous la République ? Le Conseil constitutionnel a très bien cadré les choses, et je suis en plein accord avec ses deux décisions. Je vous demande ce que vous faites si les limites de l'épure sont franchies. (M. Jean-Luc Mélenchon applaudit.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, souhaitez-vous prendre la parole ?
Non ! sur les travées de l'UMP.
Par courtoisie, je vais répondre, monsieur le président, mais, à cette heure, je m'en tiendrai à l'interprétation et à la décision du Conseil constitutionnel sur cette question.
C'est la plus haute juridiction, et elle est garante de la Constitution. Or l'article 1er de celle-ci est extrêmement clair en ce qui concerne le respect du principe de laïcité et l'article 4 du traité de Lisbonne ne l'est pas moins en ce qui concerne le respect de notre Constitution et de nos principes constitutionnels.
Il n'y a donc pas de risque de débordement : le respect de l'article 4 du traité constitue la meilleure protection des principes fondamentaux de notre République.

Ce n'est pas sous l'angle du principe de laïcité que la question de notre collègue Michel Charasse me paraît la plus intéressante, mais sous celui de la dialectique entre la force du droit européen et la force du droit français, y compris celle de la Constitution.
Or cette dialectique a été tranchée de façon très nette dans un arrêt, connu sous le nom de Tanja Kreil/ République fédérale d'Allemagne, rendu par la Cour de justice en 2000 à la suite du recours formé par une jeune femme se prévalant de la directive relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes pour contrecarrer une disposition de la loi fondamentale allemande excluant, ce qui est compréhensible dans le cadre de l'Allemagne, les femmes des emplois militaires comportant l'utilisation d'armes.
Tout ce que je veux dire, c'est que les quelques précautions que nous pouvons prendre, même celles sur lesquelles insiste cet amendement, sont, hélas ! peu de chose : pour moi, il est clair, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice, qu'en ratifiant le traité de Lisbonne nous acceptons de façon absolument définitive la primauté du droit européen, y compris dans ses composantes dérivées, sur notre droit interne et même sur nos normes les plus hautes, c'est-à-dire sur nos normes constitutionnelles.

La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.

Avec tout le respect que j'ai pour Bruno Retailleau, je veux lui dire qu'il vient d'énoncer une grossière contrevérité, car il est tout à fait clair que, si une décision de la Cour de justice mettait en cause, de manière directe ou indirecte, la laïcité, nous aurions la possibilité, avec la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006, d'y opposer la Constitution française et nos valeurs !
Vous ne pouvez pas dire le contraire, monsieur Retailleau, parce que c'est la loi.
Pour les besoins d'une démonstration, on peut dire ce que l'on veut, mais, quand il s'agit du droit, il faut tout de même lire les jugements et les articles de loi, et éviter les affirmations gratuites !

Monsieur le président de la commission, la question n'a pas été résolue lors du débat sur le traité constitutionnel et l'on ne sait toujours pas si les décisions de la Cour de justice priment ni si le Conseil constitutionnel peut intervenir sur ces décisions.

Maintenant, c'est encore pire puisqu'il peut y avoir un conflit de droit entre le Conseil constitutionnel et la Cour de justice, conflit que rien ne permettra de trancher !

Premièrement, je veux bien que l'on utilise tous les arguments, mais citer une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en faisant accroire qu'il s'agit d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes est absolument inadmissible !

La Cour de Strasbourg a une jurisprudence en matière de droits de l'homme, mais la Cour de justice, elle, fait respecter les traités.

On peut ne pas être satisfait de ses décisions, mais cela n'a rien à voir !

Deuxièmement, je trouve certains de nos débats extraordinaires !
Je rappelle, mes chers collègues, que la révision de la Constitution à laquelle nous venons de procéder a été précédée d'une vérification par le Conseil constitutionnel de la conformité de notre loi fondamentale avec le traité de Lisbonne, vérification qui, bien entendu, s'est étendue à tous les principes fondamentaux énoncés dans les deux préambules, notamment ceux que vous avez évoqués les uns et les autres.
Sur la conformité du traité avec ces principes, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire. Il s'agit donc d'un faux débat...

...et de raisonnements que, depuis l'Antiquité grecque, on appelle des sophismes !

Je mets aux voix l'amendement n° 1.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 84 :
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'article unique qui constitue l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
Exclamations sur les travées de l'UMP.

M. Jean Desessard. Il est deux heures du matin et je comprends que certains, pressés de rentrer chez eux, en aient « marre » de ce débat. Qu'ils me permettent néanmoins de leur rappeler, après Jean-Luc Mélenchon, que, avant le référendum, il y avait eu plusieurs mois de débats, partout en France. Une discussion de quelques heures sur un traité aussi important, nous a-t-on dit, que le traité de Lisbonne, c'est donc bien peu !
Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.

Rassurez-vous, mes chers collègues, vous allez voter dans quelques instants, et je sens que vous serez contents, ...

...car j'avais calculé que, si les parlementaires avaient pu voter le traité constitutionnel en Congrès, il y aurait eu 85 % de « oui ». Pourtant, le 29 mai 2005, 54 % des Français ont voté « non »...
D'où vient un tel décalage ?
Évidemment, à entendre M. le rapporteur, dont je ne sais pas s'il se revendique du gaullisme, un référendum ne sert pas à grand-chose puisque les électeurs répondent non à la question posée, mais à la personne qui la leur pose. Eh bien, je dois dire que ce n'est pas l'impression que je garde du débat sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe !

Dans tous les journaux, le contenu du traité a été analysé. J'ai participé à de nombreux meetings et réunions publiques : les gens débattaient sur le fond. Dans les bars, dans les restaurants, dans les réunions, dans les dîners, ils parlaient de projets de société et, s'ils étaient partagés, ce n'était pas spécialement sur Jacques Chirac ! Il s'agissait bien de savoir quelle Europe construire. Et ce débat a traversé les familles, les entreprises, toute la société. Il a fait apparaître un doute, et ce n'est pas à 85 % que nous avons ratifié le traité, mais c'est à 54 % qu'il a été rejeté par le peuple français.
Encore une fois, quelles peuvent être les raisons de ce décalage ?
Peut-être y a-t-il des raisons fiscales et sociales ? Peut-être l'Europe n'est-elle pas simplement pour nos concitoyens une construction politique ? Peut-être doit-elle se préoccuper du pouvoir d'achat, de l'emploi, de la lutte contre l'exclusion ? Toutes questions qui sont absentes du traité, dans lequel il n'y a les conditions ni d'une Europe sociale ni d'une Europe fiscale !
Au contraire, l'Union européenne suscite la concurrence entre les salariés comme entre les États, et les Français l'ont bien compris.
Pourquoi donc cette différence entre le vote des citoyens et celui des parlementaires ? Le Parlement est-il vraiment représentatif de la société d'aujourd'hui ? Mes chers collègues, je suis obligé de vous dire que tel n'est pas le cas, et vous allez d'ailleurs le prouver ce soir ! Le Parlement ne représente pas suffisamment les ouvriers, les employés, la diversité ; il reflète les forces politiques majoritaires, mais il ne couvre pas l'ensemble du champ politique français.
Certains affirment que l'écart entre les 85 % de « oui » et les 54 % de « non » proviendrait du fait que le traité aurait fondamentalement changé entre le 19 mai 2005 et aujourd'hui. C'est à peu près la thèse de M. le rapporteur. Pour ma part, j'en doute ! Certains orateurs ont montré que les deux textes se ressemblaient étrangement ...
D'ailleurs, si le traité a fondamentalement changé, pourquoi les autres peuples européens n'organisent-ils pas de référendum ? Comme l'a souligné Mme Borvo Cohen-Seat tout à l'heure, si ce texte est tellement différent, pourquoi les peuples ne se prononcent-ils pas ?
Mes chers collègues, vous allez voter à 85 % la ratification de ce traité, mais je reste persuadé que si l'on avait soumis celui-ci au référendum le résultat aurait été le même que le 29 mai 2005, c'est-à-dire que la majorité du peuple français aurait rejeté le texte.
Le vote du 29 mai 2005 a eu cette particularité, très importante, d'être principalement de gauche.

Comme dans le cas de M. Retailleau ! Lui aussi est un homme de gauche !

M. Jean Desessard. C'est la gauche qui s'est opposée au traité : elle se voulait européenne, mais souhaitait bâtir l'Europe sociale et fiscale. En effet, l'Europe politique est déjà construite. Il faut améliorer son fonctionnement, certes, mais l'Europe politique sans l'Europe sociale et fiscale, cela ne veut rien dire !
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et sur les travées du groupe CRC.

Je voterai contre ce texte, pour deux raisons.
La première, je l'emprunte à un fin connaisseur du traité, M. Valéry Giscard d'Estaing, qui soulignait, dans un article paru au mois d'octobre dans le journal Le Monde : « Le texte des articles du traité constitutionnel est donc à peu près inchangé, mais il se trouve dispersé en amendements aux traités antérieurs, eux-mêmes réaménagés. On est évidemment loin de la simplification. Il suffit de consulter les tables des matières des trois traités pour le mesurer ! Quel est l'intérêt de cette subtile manoeuvre ? D'abord et avant tout d'échapper à la contrainte du recours au référendum, grâce à la dispersion des articles, et au renoncement au vocabulaire constitutionnel. »
Mes chers collègues, vous me permettrez de ne pas me prêter à cette « subtile manoeuvre », même si d'autres n'hésitent pas à le faire.
La deuxième raison qui me conduit à voter contre ce texte, c'est qu'aucun des motifs qui m'avaient poussé à rejeter le précédent projet de traité n'a disparu, au contraire : avec ce nouveau texte, la BCE peut continuer à imposer le carcan de la déflation aux économies européennes, à mener sa politique de l'euro fort et à se désintéresser de tout ce qui pourrait ressembler à une politique économique et fiscale commune de plein-emploi. Quant à l'Europe sociale, l'expression n'a toujours pas de traduction en bruxellois.
Certes, je le répète, la mention de la concurrence libre et non faussée a été retirée du texte ; toutefois, elle a été réintroduite dans un protocole annexe.
Le traité de Lisbonne, nous affirme-on, représenterait un progrès de la construction européenne. J'estime pour ma part qu'il s'agit d'un progrès sur une voie sans issue, et non sur la grande route de la construction d'une nation européenne capable d'assumer démocratiquement son destin !
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et sur les travées du groupe CRC.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 85 :
Nombre de votants320Nombre de suffrages exprimés307Majorité absolue des suffrages exprimés154Pour l'adoption265Contre 42Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au moment où s'achève ce débat, vous me permettrez tout d'abord de remercier notre rapporteur, M. Jean François-Poncet, auquel j'adresse un salut tout particulier, car il est, avec M. Maurice Faure., l'un des deux négociateurs français du traité de Rome encore en vie.

Je suis certain qu'il s'agit pour lui d'une date importante : cet Européen convaincu se désolait, je le sais, de la panne qu'a connue l'Europe, et il est heureux de la voir redémarrer aujourd'hui.
Notre débat a été digne du Sénat. Chacun a pu s'exprimer et l'a fait avec ardeur. Les orateurs ont exposé leurs convictions et nous les avons écoutés avec beaucoup d'intérêt. Bien entendu, deux camps se sont opposés : ceux qui estiment que ce traité n'est pas une constitution et ceux qui pensent le contraire.
Nous avons d'ailleurs observé, et c'est ce qui fait l'originalité du Sénat, mais aussi son charme
Sourires

À ceux qui considèrent que le débat n'a pas eu lieu nous avons apporté un démenti, me semble-t-il, et nous sommes même allés au fond des choses. Et à ceux qui estiment que nous avons frustré le peuple français en ne le consultant pas, j'ai le regret de dire que celui-ci a été consulté en 2007.
L'actuel Président de la République a clairement présenté le problème de la ratification future du traité européen. Il s'est engagé sur un traité européen refondu et il a obtenu la majorité des suffrages, ...

... qui se sont ainsi ralliés, par la force des choses, à la ligne qu'il avait définie.
On ne peut donc pas prétendre que les engagements pris par le Président de la République vis-à-vis du peuple n'ont pas été tenus. Le débat démocratique a eu lieu et, par ailleurs, notre Constitution permet la ratification des traités par la voie parlementaire ou par la voie référendaire.

C'est la voie parlementaire qui a été librement choisie. La République a été respectée.
C'est un jour important pour l'Europe, en même temps qu'un nouveau départ, et je m'en félicite.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je voulais m'associer aux remerciements de M. le président de la commission des affaires étrangères et vous exprimer à tous ma gratitude pour ce débat.
Monsieur le président de la commission, je vous remercie de vos interventions et me félicite de la collaboration qui a été la nôtre. Monsieur le rapporteur, je salue la technicité de vos propos ainsi que le rôle éminent que vous avez joué dans la construction européenne. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous sais gré à tous de vos contributions, souvent empreintes d'émotion, notamment lorsque M. Mauroy a rappelé les différentes étapes de la construction européenne. Je vous remercie de ces débats de qualité.
Comme vous l'avez souligné, monsieur le président de la commission, la démocratie et les principes républicains ont été pleinement respectés.
Le vote d'aujourd'hui est extrêmement important et marque une étape historique, me semble-t-il. Le monde veut une Europe qui soit confiante et sûre d'elle.
L'Europe attendait de la France un signal. Vous le lui avez adressé à une très large majorité, mesdames, messieurs les sénateurs. Je ne puis que vous en féliciter et m'en réjouir pour notre pays.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 200, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du règlement de la Commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 202, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 203, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 204, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 205, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en matière d'application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'île Heard et aux îles Mac Donald.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 206, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR 1975).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3778 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean François-Poncet un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes (n° 200, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 201 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean Bizet un rapport d'information fait au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la transposition de la « directive services ».
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 199 et distribué.

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, vendredi 8 février 2008, à onze heures quinze et à quinze heures :
- Suite de la discussion du projet de loi (n° 149, 2007-2008) relatif aux organismes génétiquement modifiés (urgence déclarée).
Rapport (n° 181, 2007-2008) de M. Jean Bizet, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 8 février 2008, à deux heures quinze.