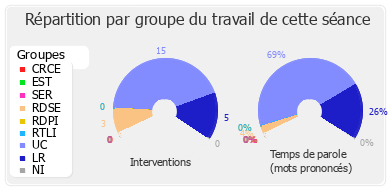Séance en hémicycle du 23 janvier 2007 à 16h00
Sommaire
- Déclaration de l'urgence d'un projet de loi
- Menaces sanitaires de grande ampleur (voir le dossier)
- Suite de la discussion et adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission (voir le dossier)
- Assurance de protection juridique (voir le dossier)
- Prévention et répression des violences (voir le dossier)
- Dépôt d'une proposition de loi
- Textes soumis au sénat en application de l'article 88-4 de la constitution
- Renvoi pour avis
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Michèle André.

La séance est reprise.

Par lettre en date du 23 janvier 2007, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution le Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 170).
(Ordre du jour réservé)

Nous reprenons la discussion des conclusions du rapport de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Francis Giraud, Paul Blanc, Mme Brigitte Bout, M. Jean-Pierre Cantegrit, Mme Isabelle Debré, M. Gérard Dériot, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Alain Gournac, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Christiane Kammermann, MM. Jean-Marc Juilhard, André Lardeux, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Alain Milon, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Esther Sittler et M. Louis Souvet relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Claude Domeizel.

Vous l'avez rappelé ce matin, monsieur le rapporteur, la France a réalisé, ces dernières années, des efforts importants pour faire face aux nouvelles vulnérabilités, notamment aux risques sanitaires.
C'est en particulier au gouvernement de Lionel Jospin et au ministre de la santé de l'époque, M. Bernard Kouchner, qu'il revient d'avoir mis en place le plan Biotox et son fonds de financement à l'automne 2001. Ce sont des circulaires publiées au début de 2002 qui ont également permis la mise en oeuvre ce qui allait devenir, avec la loi relative à la politique de santé publique d'août 2004, les plans blancs et les plans blancs élargis.
Ces rappels liminaires ont pour objet non pas de mettre en exergue, dans un esprit polémique, la plus grande prévoyance du gouvernement que nous soutenions alors par rapport à ceux qui l'ont précédé ou à ceux qui lui ont succédé, mais de souligner l'esprit de responsabilité qui a animé les majorités successives dans un domaine où l'anticipation est une ardente nécessité.
C'est ce même esprit de responsabilité qui conduira tout à l'heure le groupe socialiste à voter en faveur de cette proposition de loi « relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur », sous réserve, bien sûr, des réponses que M. le ministre voudra bien apporter à nos remarques et à nos interrogations.
Dans son intervention, le rapporteur a fait un constat qui est le point de départ de la proposition de loi et que nous partageons tous : en dépit de progrès considérables, lesquels nous autorisent à nous considérer, à juste titre, comme mieux armés aujourd'hui que nous ne l'étions hier pour faire face aux menaces sanitaires - je pense, par exemple, au plan très complet de lutte contre la pandémie grippale -, la France souffre de lacunes incontestables dans l'organisation opérationnelle de la riposte à apporter en cas de crise grave.
Ces faiblesses tiennent aux hommes et aux structures.
Si la loi de 2004 et les mécanismes de plans blancs ont permis la mise en place des procédures, nécessaires et efficaces, de rappel des personnels en formation ou en congé, de réorganisation des conditions de travail ou de réaffectation de certains personnels, rien n'est actuellement prévu pour les professionnels de santé qui viennent en renfort, le plus souvent bénévolement, afin d'aider leurs collègues sur d'autres lieux que leur cadre habituel de travail. Cette aide n'est encadrée ni juridiquement ni financièrement.
En outre, comme le terrible épisode de la canicule ou l'épidémie de chikungunya à la Réunion l'ont montré, il ne suffit pas de faire appel aux bonnes volontés, il faut également connaître avec précision la demande de soins, répartir les professionnels ayant répondu à l'appel en fonction de ces besoins et définir un interlocuteur unique. Bref, il faut une autorité régulatrice et gestionnaire, disposant d'une vision d'ensemble des problèmes.
Enfin, nous devons nous préparer aux risques d'épidémies massives ayant une incidence forte sur la population, y compris sur les professionnels de santé eux-mêmes, et dont nous avons eu un avant-goût, voilà un siècle, avec l'épidémie de grippe espagnole, sans parler de la peste ou du choléra, lequel a sévi dans ma région, qui est aussi la vôtre, monsieur le rapporteur, et que Jean Giono a excellemment évoqué dans Le Hussard sur le toit.
Les simulations de la direction des hôpitaux du ministère de la santé l'ont démontré : les mesures prises jusqu'à présent ne permettraient pas à ces professionnels de faire face à une pandémie, dans la mesure où un certain nombre d'entre eux tomberaient malades ou seraient bloqués chez eux précisément à cause de cette épidémie.
Tel est donc l'état des lieux.
Quelles sont les mesures suggérées par les auteurs de la proposition de loi pour répondre à ces constats ?
D'abord, ils prévoient d'augmenter les ressources en personnel de santé grâce à la constitution d'un corps de réserve sanitaire dont les membres devraient bénéficier d'un statut juridique et financier assurément protecteur.
Ensuite, les auteurs de ce texte préconisent de mettre en place un établissement public « multifonctionnel », oserais-je dire, puisqu'il serait chargé de mener de front pas moins de trois missions différentes : administrer le corps de réserve sanitaire, reprendre les missions du fonds Biotox concernant l'achat, le stockage et la distribution de médicaments et de produits prophylactiques nécessaires à la prévention ainsi qu'à la gestion des crises sanitaires et, enfin, accomplir les tâches d'une entreprise pharmaceutique pour la couverture de la population en besoins de médicaments et de produits médicamenteux non couverts par ailleurs.
Ces réponses sont-elles à la hauteur des enjeux ?
Elles constituent, selon moi, un pas incontestable dans la bonne direction, notamment pour le statut des personnels de santé réservistes. Toutefois, cette approbation d'ensemble ne doit pas dissimuler nos doutes et nos critiques, à commencer par celles qui portent sur la forme même du texte, long, peu lisible, pour ne pas dire abscons, et dont une bonne partie aurait pu tout aussi bien faire l'objet d'une mise en oeuvre par voie réglementaire.
Le point fort de cette proposition de loi est assurément la mise sur pied du corps de réserve sanitaire, accompagnée d'un statut financier et juridique très protecteur, que les membres des autres réserves - je pense à la réserve opérationnelle militaire et à la réserve de sécurité civile - ne manqueront pas de revendiquer tôt au tard.
Le texte prévoit, en effet, un régime de mise à disposition contre remboursement à l'employeur qui permettra au réserviste de bénéficier d'une continuité totale de sa couverture sociale. Celui-ci sera couvert par l'État, à l'instar des fonctionnaires, contre les dommages qu'il pourra subir dans le cadre de ses activités de réserviste et il bénéficiera d'une protection en cas de mise en jeu de sa responsabilité civile et pénale.
De plus, ces dispositions relatives à la protection contre les dommages subis et contre la mise en jeu de la responsabilité du réserviste seront étendues aux professionnels répondant à un ordre de réquisition ainsi qu'à ceux qui, bien que n'étant ni réservistes ni réquisitionnés, seraient conduits à effectuer leur tâche dans des conditions d'exercice exceptionnelles, à la demande du ministre de la santé, notamment dans le cadre de la mise en application du plan « pandémie grippale ».
Dans les conclusions de la commission des affaires sociales figurent à ce sujet des précisions opportunes, notamment sur le principe selon lequel la prise en charge par l'État des dommages subis par le réserviste aura un caractère intégral.
Il s'agit là d'avancées réelles, dont il faut féliciter les auteurs de la proposition de loi.

Ainsi que nous le verrons tout à l'heure lors de l'examen des amendements que j'ai déposés, je souhaite que, au moins sur ce point de la prise en charge intégrale par l'État des dommages subis, des avantages similaires soient envisagés dans d'autres domaines, notamment dans celui de la législation applicable aux sapeurs-pompiers volontaires.
En effet, en l'état, un sapeur-pompier volontaire ayant subi des dommages corporels pendant son activité bénéficie d'une réparation financée par sa commune d'emploi s'il est fonctionnaire communal. Je proposerai que, par parallélisme avec le régime instauré par le texte qui nous est soumis, ce soit, à l'avenir, les services départementaux d'incendie et de secours qui prennent en charge le coût correspondant, comme cela est déjà le cas pour les sapeurs-pompiers travaillant dans le privé.
Au-delà des appréciations positives que l'on peut porter sur le statut des réservistes sanitaires, j'ai cependant déposé, avec mon groupe, plusieurs amendements sur des sujets connexes qui ne nous paraissent pas être traités de manière parfaitement convaincante à travers cette proposition de loi.
Le premier de ces amendements tend à préciser la portée du principe selon lequel les périodes de réserve sont considérées comme des périodes de travail. La proposition de loi prévoit précisément, en effet, que « les périodes de formation et d'activité dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales ».
Mais qu'en sera-t-il des autres avantages non énumérés, par exemple des jours de RTT ? La rédaction retenue semble les exclure, ce qui ne me paraît pas très cohérent.
De même, je souhaite que l'on m'explique où se situe la cohérence dans le choix de fixer une durée maximale, en principe, de quarante-cinq jours cumulés par année civile pour la réserve sanitaire, alors que cette durée est de trente jours pour la réserve opérationnelle militaire ? Quelles sont en particulier les analyses ou les projections à partir desquelles cette norme de quarante-cinq jours a finalement été retenue ?
Enfin, je ferai une dernière remarque sur le corps de réserve sanitaire et ses règles d'emploi.
Comblant un silence de la proposition de loi, notre commission des affaires sociales a souhaité donner la priorité à la réserve opérationnelle et à la réserve de sécurité civile sur la réserve sanitaire chaque fois qu'une même personne relèvera de plusieurs de ces réserves. Or la présence de certains pompiers peut être souhaitable, voire indispensable, au bon fonctionnement du corps de réserve sanitaire. Le texte devrait, de ce point de vue, être moins directif et laisser au directeur départemental du SDIS la possibilité d'autoriser certains pompiers à participer à la réserve sanitaire.
Mes interrogations les plus fortes portent toutefois sur la structure que vous mettez en place, cet établissement public qui, curieusement, n'a pas de nom. N'est-il pas à craindre que sa gestion n'apparaisse en pratique lourde et affectée d'un risque réel d'inefficacité ?
Plusieurs questions ayant trait aux risques de redondance et aux problèmes de coordination que présente la création d'une telle structure me viennent spontanément à l'esprit.
D'abord, quelles seront l'articulation et, surtout, les synergies entre, d'une part, un pôle administratif chargé de la gestion des réservistes et, d'autre part, un établissement ayant essentiellement des fonctions d'achat, de stockage et de distribution de produits et de services à visée prophylactique ou de traitements médicamenteux ?
Ensuite, quelle sera, là encore, l'articulation entre l'établissement pharmaceutique créé au sein de l'établissement public et les autres structures de stockage et de distribution déjà existantes ? N'existe-t-il pas de risques de doublon, par exemple avec la Pharmacie centrale des armées ou la Pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, deux structures efficaces ayant largement fait leurs preuves ?
En outre, quelle sera localement la répartition des rôles entre cet établissement public, le ministère de la santé, les préfets, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, ou DRASS, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou DDASS, les agences régionales de l'hospitalisation, ou ARH, et les structures hospitalières ? Comment nous y retrouverons-nous avec un aussi grand nombre d'interlocuteurs ? Qui assurera l'unité de gestion des réservistes pendant les crises elles-mêmes ?
Enfin, quel sera le rôle du conseil d'administration de l'établissement ? Comme l'a prévu à juste titre notre commission des affaires sociales, celui-ci devra bien comprendre une représentation des régimes d'assurance maladie, dès lors que ces derniers contribuent au financement du dispositif. Dans la mesure où l'établissement agira toujours « à la demande du ministre chargé de la santé », quelles seront sa marge de manoeuvre et son articulation avec le ministère ?
Pour conclure, je voudrais rebondir sur les propos de M. le rapporteur quant au principe et aux conditions de réussite du volontariat.
Oui, les futurs professionnels de santé devront être formés de plus en plus tôt au cours de leur cursus, et de manière systématique, aux problématiques et aux techniques de la médecine de crise ! À cet égard, les conditions de rémunération joueront évidemment un rôle.
Mais le jour où nous serons confrontés à une véritable pandémie touchant l'ensemble du pays et de nos voisins, il ne sera plus question de s'appuyer seulement sur les volontaires ; ce sont tous les professionnels de santé valides sans exception qui devront être mobilisés. À mon sens, il était nécessaire de souligner ce point pour relativiser la portée de la création d'un corps de réserve sanitaire.
Telles sont les quelques réflexions que nous inspire la présente proposition de loi. Celle-ci n'est pas parfaite, loin s'en faut. Mais elle constitue néanmoins une avancée appréciable. C'est pourquoi nous la voterons.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la préparation du système de santé aux menaces sanitaires de grande ampleur est une exigence indispensable pour garantir le bien-être de nos sociétés.
Entre 1993 et 2001, la France s'est dotée d'un dispositif suffisant pour développer le suivi et l'alerte dans le domaine de la sécurité sanitaire, avec la création de plusieurs établissements spécialisés. Je pense notamment à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'Établissement français du sang ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Un travail a récemment été mené pour développer une approche prospective du risque sanitaire, qui permettrait une remontée le plus en amont possible, à proximité immédiate de l'événement concerné, mais également l'évolution possible de ses risques et de leurs conséquences.
Ces dernières années ont été marquées par plusieurs crises sanitaires de grande ampleur, dont la plus importante demeure évidemment la canicule de l'été 2003. À la Réunion et à Mayotte, nous avons également dû faire face au chikungunya. Ces deux crises ont montré la nécessité d'un dispositif d'aide précoce à la décision.
La crise épidémique qui a frappé les îles de l'océan Indien a débuté sur l'île de la Grande Comore au début de l'année 2005, en provenance d'Afrique de l'est. Elle a ensuite affecté Mayotte, Maurice, puis la Réunion au premier trimestre de l'année 2005, avant de poursuivre sa route vers les Seychelles. Le début de l'épidémie en 2005 et les premiers cas survenus aux Comores ont été repérés par l'Institut de veille sanitaire. Après les premiers cas signalés à la Réunion au mois d'avril 2005, les médecins du réseau sentinelle ont été mis en alerte et les équipes de lutte anti-vectorielle ont été activées.
Au début du mois de juin, cette action a été suivie par une mission d'information de l'Assemblée nationale, présidée par le député Bertho Audifax, qui s'est rendue à la Réunion. Son rapport, remis le 4 juillet 2006, a mis en exergue tous les dysfonctionnements et recommandé la mise en place d'un véritable service de prophylaxie.
L'épidémie s'est progressivement développée, pour atteindre un pic entre le mois de décembre 2005 et le mois de février 2006, avec plus de 47 000 cas par semaine. On a alors constaté un débordement des services d'urgence des hôpitaux et une insuffisance flagrante des professionnels sanitaires pour faire face à une épidémie d'une telle ampleur, d'autant que beaucoup d'entre eux étaient également atteints par le chikungunya.
Mais, grâce à un travail commun de la part de tous les acteurs politiques et des instances sanitaires, nous pouvons nous féliciter de la baisse progressive de l'épidémie du chikungunya. Selon les derniers chiffres disponibles, le nombre de cas recensés chaque semaine est désormais compris entre zéro et dix.
Le chikungunya a permis une prise de conscience du risque toujours présent des maladies émergentes, en particulier dans une zone tropicale. Nous avons été frappés par cette maladie, mais si la Réunion avait été touchée par le West Nile, présent à Madagascar et dont les vecteurs sont les oiseaux, le bilan aurait été plus lourd. En effet, celui-ci provoque jusqu'à 15 % de décès dans les populations atteintes. On aurait alors dénombré plus de 23 600 morts. Le risque est d'autant plus grand que les échanges commerciaux et le trafic des voyageurs s'intensifient entre les îles de la zone.
Les collectivités continuent de se mobiliser. Actuellement, 1 300 personnes sont encore sur le terrain. On constate également une grande mobilisation des ministres de la santé de la zone océan Indien, dans le cadre de la coopération régionale. La solidarité joue à fond et les actions sont complémentaires. Ainsi, 2, 2 millions d'euros ont été consacrés à l'implantation à la Réunion du Centre de recherche et de veille sanitaire de l'océan indien. Celui-ci est en cours d'installation et nous permettra de réagir rapidement dès la première alerte.
Monsieur le ministre, il faut, me semble-t-il, tirer les leçons de la crise du chikungunya pour les futures menaces sanitaires, qu'elles soient nationales ou internationales.

Le monde entier doit être solidaire comme nous avons su l'être, à notre niveau, dans l'océan Indien. La solidarité nationale a également été exemplaire. Je pense notamment à l'envoi de professionnels de santé venus renforcer les équipes soignantes au plus fort de l'épidémie, mais cela résultait d'un volontariat individuel non préparé.
En outre, et je sais que vous m'approuverez sur ce point, monsieur le ministre, il n'a pas été simple de mobiliser et de faire participer la population aux actions de prévention. En effet, au début de l'épidémie, 75 % des Réunionnais ne considéraient pas le moustique comme le vecteur de la maladie. Selon les dernières statistiques, ce taux n'est plus que de 30 %. C'est bien. La population joue désormais un grand rôle dans la destruction des gîtes larvaires. Mais il faut encore tenter de convaincre les irréductibles.
Monsieur le ministre, la France est-elle en mesure de faire face en temps réel à une crise sanitaire plus grave que le chikungunya, qu'elle ait lieu sur le territoire national ou à l'étranger ?
La proposition de loi met en place un établissement public administratif chargé de gérer les moyens de réponse opérationnelle sanitaire pouvant disposer d'une capacité en matière pharmaceutique. Les dispositions en vigueur permettent-elles de faire appel au personnel de santé avec le niveau de réactivité qui s'impose dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes pour les intéressés ? Il faut renforcer la coordination parfois encore insuffisante de la gestion de ces moyens sanitaires.
Enfin, la puissance publique ne dispose pas de la capacité d'exploitation pharmaceutique nécessaire pour mettre sur le marché les médicaments indispensables en cas de crise sanitaire et qui ne peuvent pas être mis à disposition dans le cadre des circuits habituels de fabrication et de distribution, ce qui limite l'efficacité de la réponse.
Compte tenu de la variété et du nombre de professionnels concernés, ainsi que des exigences de réactivité que cela implique, les structures du ministère chargé de la santé peuvent-elles aujourd'hui assurer la gestion et l'animation d'une réserve sanitaire ?
La réserve sanitaire comprendra des professionnels en activité, des professionnels retraités et des personnes poursuivant des études médicales ou paramédicales, sous condition de niveau d'études. Il s'agira de volontaires, comme c'est le cas pour les réserves militaire ou de sécurité civile.
Tous les réservistes devront souscrire un contrat d'engagement. Ils bénéficieront des formations nécessaires. La proposition de loi définit également le régime applicable aux réservistes et institue une structure opérationnelle de préparation et de projection des moyens en cas d'urgence ou de crise sanitaire. Cette structure, un établissement public administratif soumis à la tutelle du ministre de la santé, sera chargée de la mise en place et de l'administration de la réserve sanitaire et de la projection opérationnelle des réservistes, à la demande du ministre et en fonction des besoins exprimés par les représentants de l'État. En outre, elle achètera, entretiendra et distribuera les produits et équipements stockés dans le cadre des plans de défense et de sécurité sanitaire.
Le groupe de l'UC-UDF se félicite de la mise en place de dispositifs préparant de manière efficace notre pays à des menaces sanitaires graves. Le Gouvernement a raison de vouloir faire rapidement adopter ce texte. Cependant, pour son application, des questions relatives à la coordination des services se poseront. Les missions internationales, même dans leur dimension sanitaire, ne devront-elles pas être préparées par le ministère des affaires étrangères, en lien étroit avec les unités opérationnelles de la sécurité civile et le service de santé des armées, qui sont rompus à ce genre de missions et connaissent les besoins en personnels et les formations spécifiques à valider ?
De même, la réserve sanitaire ne doit-elle pas être mise à la disposition du Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise et de la Direction de la défense et de la sécurité civiles ? Selon nous, le ministère des affaires étrangères doit une fois de plus demeurer compétent pour en disposer dans l'hypothèse d'une intervention internationale. Nous nous interrogeons donc sur l'articulation de ces différents services entre eux en cas de crise sanitaire.
Sous réserve de ces interrogations, ce texte nous paraît constituer une avancée. Nous le voterons donc. En tant qu'élue de la Réunion, ...

Mme Anne-Marie Payet. ...j'ai pu constater, pendant la crise sanitaire, à quel point nous avions besoin de structure et d'encadrement pour répondre au mieux et dans les meilleurs délais à l'urgence sanitaire.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui constitue une avancée majeure pour la préparation de notre système sanitaire face à des menaces sanitaires de grande ampleur et pour la protection des populations.
Cette démarche est rendue particulièrement nécessaire par l'évolution imprévisible, mais toujours actuelle, de l'épidémie possible de grippe aviaire.
L'année dernière, on annonçait le risque à plus ou moins court terme d'une pandémie de grippe humaine, comparable à la grippe espagnole, qui a causé entre 20 millions et 40 millions de morts en 1918 et 1919. Accompagnée d'avis scientifiques souvent divergents, la médiatisation de ce risque a été très forte.
Aux premiers temps de l'effervescence médiatique a succédé une période plus calme où le danger semble s'être étrangement éloigné, en raison de l'actualité du contrat première embauche, ou CPE. Nombreux sont ceux qui le pensent, le sujet de la grippe aviaire a eu l'importance que les médias, ou simplement nos phobies, ont bien voulu lui accorder. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, car sous-estimer un tel risque serait une erreur.
Depuis plusieurs années, l'Organisation mondiale de la santé redoute une pandémie de grippe humaine. Dès 2004, elle a alerté l'ensemble des pays sur les risques liés au virus H5N1. Très pathogène, celui-ci est répandu et circule depuis longtemps sur l'ensemble de la planète. Sans que l'on puisse être certain que cela se produira un jour, on sait qu'il peut à tout moment muter et se transmettre d'homme à homme. C'est à ce moment-là qu'il deviendrait extrêmement nuisible et provoquerait une épidémie qui atteindrait tous les continents en un temps très court. Quelles que soient les analyses, les scientifiques reconnaissent l'importance de se préparer à la pandémie pour limiter ses conséquences médicales et économiques.
Ce contexte de grippe aviaire ne justifie pas, à lui seul, l'aménagement de notre système sanitaire même s'il doit, certes, nous pousser à agir vite. Nous devons être conscients que l'amélioration de notre réponse sanitaire s'impose au-delà du risque de pandémie grippale, car nos sociétés modernes sont extrêmement fragiles au regard du risque épidémique en général, la crise du chikungunya vient de le prouver. Nous pouvons également craindre des actes de malveillance liés, en particulier, au bioterrorisme.
De nombreux pays ont pris conscience de l'importance de la prévention pour limiter la propagation d'une maladie contagieuse au sein de leur population. La France est l'un des pays les plus en avance sur ce sujet et elle a procédé, ces derniers mois, au stockage de masques de protection et de réserves de produits antiviraux. Il importe maintenant - et c'est l'objet de cette proposition de loi - de garantir des effectifs suffisants de personnel soignant et d'assurer une meilleure coordination des services appelés à gérer la crise.
Dans la conjoncture exceptionnelle d'une pandémie grippale, notre pays pourrait connaître une brutale inadéquation de l'offre en personnel soignant à la demande de soins. On peut imaginer à quel point les hôpitaux risquent d'être asphyxiés et la médecine de ville dépassée. Des mesures sont déjà prévues pour les crises sanitaires, comme le rappel des personnels en formation et en congé ou l'augmentation du temps de travail, mais il est clair que les besoins seront hors de proportion. Des moyens spécifiques supplémentaires doivent donc être dégagés. La proposition de loi apporte des solutions concrètes avec la création d'un corps de réserve sanitaire.
Cette réserve sanitaire reposera sur le volontariat, comme vous l'avez souhaité, monsieur le rapporteur, et comprendra des professionnels en activité, des retraités depuis moins de trois ans et des étudiants des filières médicale et paramédicale. Les deux niveaux d'intervention institués, réserve d'intervention et réserve de renfort, répondront aux besoins réels de la crise.
La proposition de loi permet, il faut le souligner, la sécurisation professionnelle de ces personnels, en particulier en matière de rémunération, de protection sociale et d'assurance. Ce statut très protecteur bénéficiera aux réservistes mais aussi aux personnels non réservistes qui seraient appelés à intervenir en cas d'épidémie de grande ampleur. Les professionnels de santé appelaient de leurs voeux cette sécurisation.
De plus, pour anticiper nos capacités réelles en personnel soignant, la proposition de loi permettra de disposer de données fiables sur les renforts possibles : l'obligation de déclaration des personnels en retraite sera maintenue pour trois ans, par exemple. Leur changement d'adresse devra également être signalé. L'ensemble du dispositif bénéficiera par ailleurs à l'aide humanitaire qui, dans ses phases d'extrême urgence, nécessite une réactivité et une organisation administrative importantes.
Le second point déterminant de la proposition de loi est la création d'un établissement public administratif permettant de gérer les moyens de réponse opérationnelle.
Dans nos sociétés complexes, de plus en plus d'intervenants sont concernés par la gestion des crises. Les conséquences d'une crise sanitaire de grande ampleur, indépendamment des problèmes médicaux proprement dits, sont multiples et complexes. Elles concernent des domaines divers et variés. Il faut d'abord prendre en compte la désorganisation de la vie quotidienne, notamment la fermeture des écoles, les besoins alimentaires de la population, la nécessaire continuité de la distribution d'eau et d'énergie, les transports, le maintien de l'ordre public, etc. Il s'agit ensuite de soutenir la vie économique, malgré les arrêts de travail pour maladie, l'absentéisme pour garde d'enfants ou de personnes malades, le ralentissement des échanges de marchandises. Il faut enfin prévoir des équipements, des stocks en médicaments, vaccins, masques... Répondre à ces nécessités impose des choix et des arbitrages. Or la coordination des acteurs publics est toujours une tâche difficile.
Ayant travaillé à élaborer, en 2001, une réponse à des attaques terroristes, le Gouvernement s'est préparé au problème spécifique d'une menace sanitaire grave dès août 2004. Le plan de lutte gouvernemental définit des principes généraux d'organisation sur le plan national : niveaux d'alerte, rôles respectifs des structures nationales de gestion, de suivi et de décision.
Bien que notre programme d'action soit salué par nos voisins comme étant l'un des plus avancés, il comporte certaines failles. Ainsi, la réserve sanitaire ne pourrait être suivie par les services du ministère comme il conviendrait. Par ailleurs, nous disposons d'importants stocks de matériels et de traitements mais leur gestion reste compliquée et lourde. Enfin, s'agissant des médicaments qu'il faudrait fabriquer en masse en cas de crise, les pouvoirs publics ne disposent pas de la capacité de production nécessaire.
L'établissement public prévu par le présent texte permettra, nous le souhaitons, de remédier à ces problèmes : chargé de la mise en place et de la gestion de la réserve sanitaire, il procédera par ailleurs à l'achat et au suivi des équipements et traitements nécessaires, y compris en ce qui concerne les médicaments. Il est souhaitable que sa mise en place intervienne rapidement, et nous vous faisons toute confiance pour cela, monsieur le ministre.
Identifier toutes les conséquences de la pandémie, se pencher sur chacun de ses aspects médicaux et non médicaux, déterminer les meilleurs moyens de lutte : la tâche du Gouvernement est complexe. De plus, la planification dépasse le cadre national et impose de renforcer les partenariats internationaux.
Je le sais, monsieur le ministre, vous avez à coeur de tout faire pour nous préparer à affronter les nouveaux risques qui peuvent atteindre notre pays. Le pire n'est pas toujours sûr, ...

...encore faut-il être prêt. L'état de préparation du système de soins français est bien avancé et, avec les autres signataires de cette proposition de loi, je me réjouis que nous puissions apporter aujourd'hui notre contribution à cet effort.
Je remercie notre rapporteur pour la clarté de ses propos et son engagement en faveur de cette proposition de loi au service de la protection des populations, conforme à sa vocation de professeur de médecine. Bien évidemment, notre groupe votera cette proposition de loi, en espérant qu'elle recueillera l'unanimité de notre Haute Assemblée.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne démentirai évidemment pas l'orateur précédent et j'annonce, à l'avance, que je voterai, avec l'ensemble de mon groupe, la proposition de loi qui nous est soumise et qui présente un intérêt évident.
Nous avons pu croire, il y a près de vingt ans, que nous vivions la fin de l'histoire : la vie des peuples s'est chargée de nous rappeler que l'histoire ne se termine jamais. Nous avons aussi cru que nous arrivions, compte tenu de l'expansion technique fantastique que nous connaissions, à un monde dans lequel les hommes, grâce à la science, domineraient tout. Nous constatons que la nature n'a pas changé et continue de déchaîner des catastrophes qui résultent du jeu des lois naturelles et quand les hommes s'obstinent à s'exposer, parfois inconsciemment, à un certain nombre de risques pourtant évidents, elle se venge. La maladie est probablement bien traitée par la médecine - et je rends hommage à tous ceux qui s'y consacrent, monsieur le professeur Giraud - mais elle invente toujours, malheureusement, de nouvelles formes auxquelles on ne pensait pas : le chikungunya vient de nous le rappeler, la menace de la peste aviaire nous le rappelle en permanence.
En réalité, nous vivons dans un monde tout aussi dangereux qu'autrefois, peut-être même un peu plus, compte tenu des techniques modernes de production et de notre dépendance énergétique. La mise en place, avec Internet, d'un système de communication tous azimuts extrêmement fragile - contrairement à ce qu'on pense - nous rend tous dépendants les uns des autres et surtout tributaires du moindre accident.
Or, si un accident ou un attentat se produit, ne nous faisons aucune illusion, mes chers collègues, la santé de nos concitoyens sera immédiatement concernée, même une panne électronique de grande ampleur provoquerait un certain nombre de dysfonctionnements et de désordres. Il était donc utile de réfléchir à l'organisation de notre pays face à d'éventuelles difficultés, pandémies, accidents ou catastrophes majeurs et à la préparation de tous ceux qui auront en charge, à cet instant, la préservation de la santé de nos concitoyens.
Je suis donc tout à fait en phase avec vous, monsieur le rapporteur, pour constater que votre proposition de loi vient au bon moment et qu'elle apporte une excellente contribution à l'organisation de nos personnels de santé en cas de crise importante.
J'exprimerai cependant un léger regret, monsieur le ministre. Ce n'est pas la première fois que le mot « réserve » est prononcé, depuis quelques années ou quelques mois, dans cette enceinte. Il l'a été pour les réserves militaires - c'est tout à fait classique -, pour les réserves de sécurité civile, pour les réserves communales de protection civile. De nombreuses réserves ont donc été créées, mais je crains que les volontaires potentiels ne se raréfient en raison de l'affaiblissement de l'esprit civique.
À partir de ce constat, j'exprime la crainte que toutes les réserves ne regroupent à peu près les mêmes personnes - même si la réserve sanitaire suppose des exigences de compétence et de formation particulières. La vie de tous les jours nous apprend que, lorsque des rendez-vous touchant à la protection civile, la défense civile ou la sécurité civile sont organisés, on retrouve les mêmes intervenants ou le même public dans la salle et, par conséquent, les mêmes dévouements. C'est un premier problème que certains de nos collègues, sur diverses travées, ont évoqué tout à l'heure.
Le deuxième problème qui me préoccupe tient à la segmentation de ces réserves : celles-ci vont exister côte à côte, mais se connaîtront-elles, en admettant que des effectifs suffisants permettent de les alimenter toutes ? Ma réponse est un peu dubitative, compte tenu de mon expérience personnelle. Au moment où va s'ouvrir un grand débat national, au cours duquel les questions essentielles seront posées - et je souhaite que cette question soit abordée -, puis-je me permettre de suggérer, me tournant vers vous, monsieur le ministre, qu'une réflexion d'ensemble sur l'organisation de notre pays en temps de crise soit lancée prochainement ?
Pour prendre un exemple simple, le plan de lutte contre la pandémie grippale que vous préparez actuellement comporte, d'après ce que j'ai compris, un certain nombre de dispositions qui prévoient le tri des patients avant l'hôpital, au moment des grands afflux, afin que seuls ceux dont l'état le justifie soient pris en charge à ce niveau de sécurité et de compétence médicale. Très bien ! Ces dispositions conduiront, très certainement, non pas à fermer les hôpitaux, mais à en restreindre très fortement l'accès - ne serait-ce que pour éviter que les simples visiteurs ne deviennent des vecteurs de dissémination du virus. Comment assurera-t-on la sécurité quand, dans le même temps, des pharmacies seront assiégées par des gens réclamant des médicaments, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin ? La rumeur, les communications radiophoniques, télévisuelles ou autres, provoqueront forcément des phénomènes de panique ! Nous aurons donc besoin de beaucoup de monde, juste au moment où, comme par hasard, des éléments qualifiés manqueront parce qu'ils seront malades !
Je souhaiterais, monsieur le ministre, que le Gouvernement lance une réflexion globale sur l'organisation d'ensemble de la gestion de notre pays en cas de crise majeure quelle qu'en soit l'origine, naturelle, technologique, terroriste ou médicale et que l'on envisage l'articulation des différents intervenants. Par exemple, la proposition de loi actuellement soumise à la délibération du Sénat prévoit que le corps de réserve sanitaire sera mobilisé sur ordre du ministre ; dans le même temps, en cas de sinistre, les réserves locales seront mobilisées par le commandant des opérations de secours. Un certain nombre de dysfonctionnements et de difficultés peuvent résulter de l'application de ces deux dispositions ; je souhaiterais qu'on y réfléchisse.
Monsieur le rapporteur, je vous félicite d'avoir pris l'initiative de déposer cette proposition de loi et de l'avoir rédigée de telle manière que nous puissions la voter sans aucune espèce de restriction. Pour ma part, j'ai simplement voulu poser devant le Sénat - et surtout devant vous, monsieur le ministre - le problème de la généralisation de cette réflexion, de la mutualisation des moyens et du caractère interministériel de l'organisation à mettre en place. Nous avons besoin d'une loi organique relative à l'organisation de notre pays dans les périodes de crise qui ne manqueront pas, hélas ! de se produire un jour ou l'autre.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.
Avant de revenir plus longuement, lors de l'examen des articles, sur un certain nombre de questions, je voudrais maintenant prolonger les propos liminaires que j'ai tenus ce matin.
J'indiquerai tout d'abord à M. Autain que, en ce qui concerne l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSSAPS, celle-ci ne peut être juge et partie, car elle évalue les laboratoires et ne peut pas être en même temps exploitant. Il faut rappeler que le nouvel établissement sera placé, pour ses compétences pharmaceutiques, sous le contrôle de l'AFSSAPS, ce qui est un gage de sécurité pour la population, la coordination de l'alerte et la gestion de crise continuant à relever du ministère.
Je voudrais également dire à M. Autain que l'on ne peut, en aucune manière, parler de désengagement de l'État. En effet, l'État est présent, ses interventions sont multiples à l'occasion des crises sanitaires et le renforcement qui a été opéré au cours des dernières années - je remercie M. Francis Giraud de l'avoir souligné - permet précisément de prouver que cette affirmation ne correspond pas aujourd'hui à la réalité. Le nouvel établissement public sera d'ailleurs, d'une certaine façon, un bras armé de l'État, rendant plus efficace son action en la matière.
Par ailleurs, monsieur Domeizel, le rôle central des préfets dans la détermination des besoins est confirmé. C'est la logique de la réserve. Quant au ministère, il aura à décider l'emploi de la réserve et des produits de santé, l'établissement public assurant, pour sa part, la mise en oeuvre concrète de ces décisions.
Pour bien préciser la position de l'État à l'égard du texte présenté par M. Francis Giraud, il me paraît important de relever que la Pharmacie centrale des armées n'est pas, à l'heure actuelle, exploitant pharmaceutique. Ses moyens ne sont pas illimités ; elle répond surtout aux besoins des armées, même si sa collaboration à la préparation de réponses à des menaces sanitaires de grande ampleur est bien sûr possible, comme on peut le voir s'agissant de la grippe aviaire. Nous ne bénéficierions d'ailleurs certainement pas de l'état de préparation actuel si la Pharmacie centrale des armées n'avait pas été en mesure de transformer le vrac de Tamiflu en gélules comme elle a su le faire avec une réactivité remarquable. Je tenais à le préciser, mais la vocation de la Pharmacie centrale des armées reste spécifique.
En ce qui concerne maintenant les missions internationales, madame Payet, il existe des demandes d'État à État en cas de catastrophe sanitaire. C'est bien évidemment le ministère des affaires étrangères qui assure la coordination dans ces circonstances, le ministère de la santé et des solidarités jouant en quelque sorte un rôle de prestataire de services.
En réponse à MM. Alain Milon et Paul Girod, j'indiquerai que, en cas de crise majeure sur tout le territoire, le pilotage sera bien assuré par le ministère de l'intérieur, qui assure logiquement, dans de telles circonstances, la conduite des opérations. Chacun reste bien sûr à sa place, mais une réelle coordination est organisée, selon des modalités prévues avec le ministère de l'intérieur, ainsi qu'avec celui de la défense. Nous nous emploierons également à garantir la cohérence des actions lors de la rédaction des décrets.
En tout état de cause, M. Giraud et moi-même avons eu à coeur de répondre aux questions suscitées par ce texte, afin de bien montrer quelle était la logique suivie. Il est vrai que la réserve que nous mettons en place est très importante, puisqu'un million de personnes peuvent potentiellement être concernées, à savoir l'ensemble des professionnels de santé.
Cette réserve n'intervient pas dans les mêmes circonstances que les autres réserves. L'expérience a en effet montré qu'un certain nombre de besoins n'étaient pas suffisamment satisfaits. Ainsi, lors de la crise sanitaire survenue à la Réunion, où je m'étais rendu en janvier 2006, juste avant le pic de l'épidémie, j'avais jugé indispensable de compléter les effectifs. Des personnels sont donc venus relayer les professionnels de santé locaux dont le comportement a été exceptionnel.
C'est certainement ce qui a évité l'apparition d'une situation semblable à celle que nous avons connue en métropole lors de la canicule de 2003, le système hospitalier ayant pu tenir parce que nous avons anticipé la crise.
Des épidémies comme celle de chikungunya, qui ne sont pas de courte durée, nous montrent que l'on doit absolument prendre en compte la fatigue, physique et morale, des professionnels confrontés à des semaines de crise. Nous sommes obligés de revoir nos grilles de lecture en conséquence et d'intégrer ce facteur. Voilà pourquoi il est important de pouvoir renforcer les équipes, comme ce texte nous permettra précisément de le faire beaucoup plus rapidement.
En conclusion, je dirai à M. Paul Girod que je souscris tout à fait aux vues qu'il a exprimées. Le sujet important dont nous débattons ne fait pas forcément la une de l'actualité en temps normal, pourtant la maturité d'une société se juge aussi à la capacité de cette dernière à se préparer à faire face à toute éventualité.
En effet, ce qui nous est de plus en plus demandé aujourd'hui, ce n'est pas seulement de faire preuve de réactivité, c'est aussi d'anticiper au maximum.
Agir dans la transparence doit également être un principe incontournable si l'on veut éviter les phénomènes de psychose collective, dont vous avez souligné les dangers, monsieur Girod.
À cet égard, j'ai toujours eu à coeur, notamment dans l'optique de la préparation de notre pays devant les menaces de pandémie grippale, de dire les choses clairement. Ainsi, quand on montre qu'il y aura, le cas échéant, des médicaments pour tout le monde, qu'il ne sera procédé à aucune sélection ni à aucun tri, cela permet d'informer la population et de prévenir tout risque d'engorgements aux portes des pharmacies. Certains pourraient en effet penser que les premiers arrivés seront les seuls servis, ce qui n'est pas vrai. C'est la même logique qui a prévalu pour les masques, mais aussi pour les réservations de vaccins.
L'anticipation maximale, la transparence et ensuite la réactivité : voilà ce à quoi je crois. Nous nous donnons les moyens d'atteindre ces objectifs, mais je pense que de tels sujets ne doivent pas être réservés aux spécialistes. Ils passionnent nos concitoyens, et il serait bon que, au-delà des participants à notre débat de cet après-midi, les responsables politiques s'en saisissent, car c'est d'un véritable enjeu de société qu'il s'agit, et non pas simplement d'un enjeu de santé.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. Détraigne, Mmes Payet, Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les fonctionnaires relevant des corps des médecins inspecteurs de santé publique à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut de praticien hospitalier prévu à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les fonctionnaires qui ne demandent pas à bénéficier du droit d'option continuent d'exercer leurs précédentes fonctions. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. - A. Le 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux d'entre eux, médecins, qui exercent leurs fonctions à temps plein peuvent également être affectés dans les services de l'État, auprès des autorités publiques indépendantes à caractère scientifique et des établissements publics nationaux à caractère sanitaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'ils sont affectés dans des structures non hospitalières les praticiens hospitaliers en santé publique ont le titre de praticiens de santé publique. »
B. Dans le 4° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots : « du 30 décembre 1958 », sont insérés les mots : « et les emplois de médecins inspecteurs de santé publique occupés par les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ».
C. Avant le dernier alinéa de l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les missions et prérogatives des médecins inspecteurs de santé publique sont exercées par :
« 1° Les médecins mentionnés au 1°de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, habilités selon des dispositions définies par décret en Conseil d'État ;
« 2° Les fonctionnaires de l'État assurant, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, ces missions et prérogatives en conformité avec leur statut, notamment ceux en position de détachement ou de mise à disposition. »
III. - Les charges pour l'État, résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Valérie Létard.

Avant de présenter cet amendement, je voudrais remercier à mon tour M. Francis Giraud d'avoir bien voulu soumettre au Sénat un texte tendant à organiser l'action de l'État devant des menaces sanitaires de grande ampleur.
La présente proposition de loi a pour objet de pallier les faiblesses identifiées du système de santé publique en cas de menace sanitaire. L'une des faiblesses majeures, maintes fois soulignée, consiste en la pénurie de personnel techniquement compétent pour coordonner et mettre en oeuvre les dispositifs. À quoi cela sert-il de multiplier instructions, circulaires et réglementations si, en bout de chaîne, il n'y a pas de bras pour les appliquer ?
Pour faire face aux menaces sanitaires, le ministère chargé de la santé a besoin de médecins de santé publique suffisamment nombreux et opérationnels, en particulier sur le terrain. Ils doivent être visibles et identifiés par tous les acteurs.
De plus, pour qu'un système fonctionne en situation de crise, il faut qu'il soit efficace en situation courante, que les acteurs puissent se préparer à froid à la crise et qu'ils connaissent précisément les ressources et les réseaux sur lesquels s'appuyer. Précisément, les médecins inspecteurs de santé publique sont, de toute évidence, au coeur du dispositif, parce qu'ils sont spécialistes de santé publique, au service de l'État et formés pour remplir des missions d'intérêt général.
Or, du fait de la faible attractivité du statut de médecin inspecteur de santé publique, soulignée récemment dans un rapport de l'IGAS, les internes de santé publique se tournent prioritairement vers l'hôpital et les carrières privées. Le corps des médecins inspecteurs de santé publique se trouve actuellement dans une situation très préoccupante : le recrutement est en panne, la moitié des effectifs va partir à la retraite dans les cinq prochaines années et des départs volontaires se produisent car ces professionnels ne peuvent pas exercer dans des conditions satisfaisantes les missions sans cesse élargies qui leur sont confiées.
Qu'adviendrait-il, en cas de menace majeure, si le lien entre les professionnels soignants, les réservistes et les autorités sanitaires ne pouvait être assuré par des médecins de santé publique, ces médecins « invisibles » mais essentiels au bon fonctionnement du système, si les professionnels chargés de coordonner les plans d'urgence n'étaient pas au rendez-vous, si la veille sanitaire ne pouvait être assurée correctement en cas d'épidémie ?
Pour toutes ces missions, le rôle des médecins inspecteurs de santé publique apparaît donc incontournable. Depuis trois ans, une réflexion a été conduite sur une fusion de leur statut et de celui des praticiens hospitaliers. En effet, elle semble constituer la meilleure réponse aux difficultés de recrutement et de valorisation du métier de médecin inspecteur de santé publique, tout en assurant une pérennisation de la filière de santé publique, une meilleure interface avec les soignants et un décloisonnement des structures. Les syndicats représentatifs des praticiens hospitaliers soutiennent ce projet, que le rapport de l'IGAS fait figurer au nombre de ses recommandations.
Depuis trois ans, on oppose aux médecins inspecteurs de santé publique l'attente d'un véhicule législatif adéquat. L'administration a préparé elle-même les projets d'articles de loi visant à rendre possible la fusion des statuts et les a transmis aux médecins inspecteurs de santé publique, qui ont ainsi nourri de légitimes espoirs.
Il me semble que la présente proposition de loi pourrait précisément être le véhicule législatif si longtemps attendu. Je rappelle qu'un amendement prévoyant cette fusion avait été défendu par notre collègue Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, lors de la première lecture, en janvier 2004, du projet de loi relatif à la politique de santé publique. Il avait alors été retiré à la suite d'un engagement pris par M. Mattei, mais je l'avais représenté en deuxième lecture, en juillet 2004. À cette occasion, M. Douste-Blazy, à l'époque ministre de la santé, s'était solennellement engagé à faire aboutir rapidement ce dossier. Or nous sommes aujourd'hui en janvier 2007, et la question demeure pendante...
Vous comprendrez donc sans peine, monsieur le ministre, pourquoi notre groupe a jugé nécessaire de soulever à nouveau ce problème du statut des médecins inspecteurs de santé publique. Comptant sur votre volonté de le régler définitivement, je pense que vous ne vous opposerez pas à l'adoption de cet amendement.

Cet amendement a en fait pour objet de proposer une réponse à la crise traversée par le corps des médecins inspecteurs de santé publique. Il s'inscrit dans un débat ouvert lors de la discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique, en 2004, et tend notamment à créer un droit d'option pour le statut de praticien hospitalier.
Cependant, il constitue à ce titre un cavalier, la mesure qu'il porte n'ayant pas réellement sa place dans le présent texte.
Sur le fond, M. le ministre de la santé et des solidarités a rencontré tout récemment, me semble-t-il, les médecins concernés. Il aura certainement à coeur de fournir des éléments de réponse aux auteurs de l'amendement.
Vous comprendrez, madame Létard, que la commission des affaires sociales soit, quant à elle, obligée d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Sourires.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Je pense que ce que vous proposez, madame Létard, à savoir la possibilité d'opter pour le statut de praticien hospitalier, va à l'encontre de ce que nous cherchons à faire. En effet, je voudrais donner aux médecins l'envie d'entrer dans cette profession et de demeurer dans les services déconcentrés de l'État.
Or si l'on met en place l'option que vous prévoyez, on risque d'orienter plus directement les praticiens vers l'hôpital. Ils peuvent bien sûr aussi y avoir leur place, mais je reste persuadé que nous avons besoin de renforcer les services déconcentrés de l'État, même si le passé ne plaide pas forcément en faveur de cette orientation. Quoi qu'il en soit, nous avons voulu montrer que, au travers de la réforme de l'État, nous étions capables de renforcer les missions, les priorités et donc les services de l'État. Nous l'avons fait pour les administrations centrales, et je n'oublie pas, moi qui suis élu local, les services déconcentrés de l'État.
Ne nous voilons pas la face : le statut des médecins inspecteurs de santé publique pose aujourd'hui question. Ce n'est pas un sujet simple, parce qu'il y a, je le sais bien, une demande sous-jacente de meilleure rémunération des postes, de déroulements de carrière plus fluides ouvrant dès le début des perspectives et donnant envie de rester longtemps dans la profession, ainsi que de revalorisation du régime indemnitaire.
Les discussions sont engagées sur tous ces points ; je sais que certains aimeraient que les choses aillent plus vite, mais il existe des contraintes financières. Cela étant, nous allons aboutir.
Par ailleurs, voilà quelques semaines, vous avez peut-être entendu des médecins inspecteurs de santé publique parler de leur rôle dans l'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Bien sûr, leur mission est avant tout de faire de l'éducation à la santé et de la prévention. C'est bien ainsi que j'entends leur rôle, mais ils feront aussi partie de ce corps qui sera habilité à intervenir pour les contrôles, voire pour les sanctions, même si je fais davantage confiance à la motivation et à la compréhension des fumeurs, ainsi qu'à la pression amicale des non-fumeurs.
Toujours est-il que les questions qui ont été évoquées apparaissaient derrière celle du statut. J'ai rencontré les représentants des médecins inspecteurs de santé publique. Nous allons bientôt pouvoir clôturer les discussions, dès que nous aurons confirmation de leur accord. Il m'a été indiqué que, à la suite des dernières propositions qui leur ont été faites, les syndicats représentatifs devaient consulter leurs adhérents pour voir si celles-ci leur convenaient.
En tout état de cause, l'État a besoin des médecins inspecteurs de santé publique. Encore une fois, je le dis très franchement, je préfère qu'ils soient dans les services déconcentrés de l'État plutôt qu'à l'hôpital. Si nous trouvons un accord, je pense que des textes de nature réglementaire pourront paraître au plus tard en avril.
Voilà comment et pourquoi je souhaite conforter la place et le statut des médecins inspecteurs de santé publique. Je vous demande donc, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j'émettrai le même avis défavorable que M. Francis Giraud.

Madame Valérie Létard, l'amendement n° 9 rectifié bis est-il maintenu ?

Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir fourni une réponse aussi détaillée.
Si j'ai cherché au travers de cet amendement à défendre le statut des médecins inspecteurs de santé publique, c'est parce que leur faible nombre les empêche de se faire entendre.
Je compte sur vous pour que l'effectif réduit de ce corps, pourtant essentiel dans le dispositif dont nous débattons aujourd'hui, ne leur porte pas préjudice et pour qu'ils ne soient pas dotés d'un « sous-statut ». D'autant que nous leur demandons d'être deux fois plus actifs qu'hier, et de constituer l'élément charnière au coeur d'un dispositif essentiel pour l'action de l'État dans ces domaines.

Compte tenu des engagements pris par M. le ministre, je retire mon amendement.
On dénombre aujourd'hui environ 550 médecins inspecteurs de santé publique. Je m'engage à augmenter leur effectif dès cette année. Mais il ne suffit pas d'augmenter le nombre de postes, il faut aussi renforcer l'attractivité de cet emploi. Nous allons donc lancer une campagne destinée à valoriser ces médecins inspecteurs de santé publique.
Vous avez parlé de « médecins invisibles », madame Létard. Il est vrai que leur rôle est méconnu, sauf lorsqu'il existe des problèmes de santé publique, comme c'est le cas aujourd'hui dans mon département, car ces médecins sont alors en première ligne.
Avant les départs à la retraite programmés, il faut augmenter les recrutements et proposer un déroulement de carrière beaucoup plus fluide.
I. - Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III intitulé : « Menaces sanitaires graves ».
II. - Le chapitre préliminaire du titre Ier du même livre devient le chapitre Ier du titre III créé par le I, intitulé : « Mesures d'urgence » et comprenant les articles L. 3110-1 à L. 3110-5, L. 3110-6 à L. 3110-9 et L. 3110-10 qui deviennent respectivement les articles L. 3131-1 à L. 3131-5, L. 3131-6 à L. 3131-9 et L. 3131-11.
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1142-23 est ainsi modifié :
a) Dans le sixième alinéa (4°), le huitième alinéa (6°) et le treizième alinéa (4°), la référence : « L. 3110-4 » est remplacée par la référence : « L. 3131-4 » ;
b) À la fin du dernier alinéa (6°), la référence : « L. 3110-5 » est remplacée par la référence : « L. 3131-5 » ;
2° Dans l'article L. 3136-1 tel qu'il résulte du V de l'article 3 de la présente loi, les références : « L. 3110-8 et L. 3110-9 » sont remplacées par les références : « L. 3131-8 et L. 3131-9 » ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 3131-2, à la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 3131-3 et dans la première phrase de l'article L. 3131-5 tels qu'ils résultent du II du présent article, la référence : « L. 3110-1 » est remplacée par la référence : « L. 3131-1 » ;
4° À la fin de la deuxième phrase de l'article L. 3131-5 tel qu'il résulte du II du présent article, la référence : « L. 3110-4 » est remplacée par la référence : « L. 3131-4 » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 3131-9 tel qu'il résulte du II du présent article, la référence : « L. 3110-8 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 3131-8 » ;
6° Dans le dernier alinéa (c) de l'article L. 3131-11 tel qu'il résulte du II du présent article et du IV de l'article 3 de la présente loi, la référence : « L. 3110-9 » est remplacée par la référence : « L. 3131-9 ».
L'article 1 er est adopté.
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par quatre chapitres ainsi rédigés :
« CHAPITRE II
« Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire
« Art. L. 3132-1. - En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué un corps de réserve sanitaire. Ce corps de réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La réserve sanitaire comprend une réserve d'intervention et une réserve de renfort.
« Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire d'intervention ou de renfort.
« Le contrat d'engagement à servir dans la réserve d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.
« Art. L. 3132-2. - Les réservistes doivent remplir les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
« Art. L. 3132-3. - Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et notamment :
« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve d'intervention et la réserve de renfort mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3132-1 ;
« 2° Le délai maximum entre la date de cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début d'activité dans la réserve ;
« 3° Les conditions de vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;
« 4° En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien dans la réserve d'intervention et de renfort, et notamment pour l'accomplissement de missions internationales ;
« 5° La durée et les clauses obligatoires du contrat d'engagement ;
« 6° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.
« CHAPITRE III
« Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
« Art. L. 3133-1. - Lorsqu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.
« Lorsqu'ils accomplissent, sur leur temps de travail, les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes fonctionnaires sont placés en position d'accomplissement des activités dans la réserve sanitaire, lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée.
« L'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 rembourse à l'employeur les rémunérations ainsi que les cotisations et contributions lui incombant d'origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste salarié ou agent public, ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service dans la réserve.
« Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes exerçant habituellement leur activité à titre libéral sont rémunérées.
« Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées sont indemnisées.
« Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et les personnes réservistes sans emploi sont rémunérés pour les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
« Les rémunérations et indemnités prévues par les trois précédents alinéas sont versées par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.
« En cas de sujétions particulières effectuées dans le cadre de la réserve sanitaire, une indemnisation est versée par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1.
« Art. L. 3133-2. - L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée de l'intéressé dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
« Art. L. 3133-3. - Le réserviste peut s'absenter sans l'accord de son employeur pendant une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, à l'issue d'un préavis, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables. Au-delà de cette durée, il est tenu de requérir l'accord de son employeur.
« Lorsque son accord préalable est requis, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du chapitre II du présent titre.
« Art. L. 3133-4. - Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de formation continue des professionnels de santé.
« Art. L. 3133-5. - La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.
« Art. L. 3133-6. - Les dispositions des articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
« Le réserviste victime de dommages subis à l'occasion du service dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
« Art. L. 3133-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et notamment :
« 1° Les modalités du remboursement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3133-1 ;
« 2° Les modalités de rémunération des professionnels de santé libéraux mentionnés au quatrième alinéa du même article ;
« 3° Les modalités d'indemnisation des réservistes mentionnés au cinquième alinéa du même article ;
« 4° Les modalités de rémunération des réservistes mentionnés au sixième alinéa du même article ;
« 5° Les modalités d'indemnisation des sujétions particulières mentionnées dans le dernier alinéa du même article ;
« 6° Le contenu, les conditions et modalités de rupture anticipée et les conditions de renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2 ;
« 7° Les règles applicables au préavis mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-3 ;
« 8° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3133-3.
« CHAPITRE IV
« Règles d'emploi de la réserve
« Art. L. 3134-1. - En cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves à laquelle le système sanitaire ne peut faire face ou lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, le ministre chargé de la santé peut faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.
« L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.
« Art. L. 3134-2. - L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 affecte les réservistes, sur proposition du représentant de l'État dans la zone de défense ou le département concerné, dans un service de l'État ou auprès de personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Les réservistes peuvent également être affectés au remplacement des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou auprès de ces professionnels pour leur apporter leur concours.
« Dans le cadre du contrat d'engagement qu'ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et dans les conditions qui leur sont assignées.
« Sont dégagés de cette obligation les réservistes sanitaires qui sont par ailleurs mobilisés au titre de la réserve opérationnelle ainsi que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours.
« Art. L. 3134-3. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« CHAPITRE V
« Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
« Art. L. 3135-1. - L'administration de la réserve sanitaire est assurée par un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« Cet établissement public a également pour mission de mener, à la demande du ministre chargé de la santé, des actions de prévention et de gestion des risques sanitaires exceptionnels, et notamment d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
« L'établissement public peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
« Lorsque les actions menées par l'établissement public concernent des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, elles sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l'exploitation. Cet établissement est ouvert par l'établissement public et est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-12.
« Art. L. 3135-2. - L'établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'État adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
« Il est administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'État et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Il est dirigé par un directeur général. Celui-ci prend, au nom de l'État, les actes nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre chargé de la santé confie à l'établissement public, notamment celles de l'autorité compétente mentionnée aux chapitres II, III et IV.
« Art. L. 3135-3. - Les agents de l'établissement public sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-4.
« L'établissement public peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions de caractère scientifique ou technique.
« Les membres du conseil d'administration de l'établissement public ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 3135-4. - Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
« 1° Des taxes prévues à son bénéfice ;
« 2° Des redevances pour services rendus ;
« 3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
« 4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° Des subventions, notamment de l'État ;
« 7° Des produits divers, dons et legs ;
« 8° Des emprunts.
« Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.
« Art. L. 3135-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3132-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ne peuvent faire partie de ce corps qu'avec l'autorisation du directeur départemental des services de secours et d'incendie dans le département.
La parole est à M. Claude Domeizel.

Mon amendement ayant trouvé une réponse dans la nouvelle rédaction, je le retire.

L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 2, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3133-4 du code de la santé publique, après le mot :
effectif
insérer les mots :
, y compris
La parole est à M. Claude Domeizel.

Mon amendement a pour objet de préciser la rédaction qui nous est proposée.

Monsieur Domeizel, votre amendement est satisfait et je vous demande donc de bien vouloir le retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 2 est retiré.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3133-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :
à l'occasion du service
par les mots :
pendant les périodes d'emploi ou de formation
La parole est à M. Claude Domeizel.

La commission est favorable à cet amendement de précision très intéressant.
Le Gouvernement y est également favorable. Il s'agit d'un très bon amendement.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 4, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3135-2 du code de la santé publique, après le mot :
État
insérer les mots :
, de l'Assemblée nationale et du Sénat, du président et du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
La parole est à M. Claude Domeizel.

Comme je l'ai expliqué lors de la discussion générale, à la différence du fonds créé par l'article 97 de la loi de financement de la sécurité sociale, l'établissement prévu par cette proposition de loi n'a pas seulement des missions relatives à l'achat de produits ou de services. Il est aussi chargé de l'administration de la réserve sanitaire et, si nécessaire, de l'exploitation d'un établissement pharmaceutique.
En conséquence, il est proposé que le président soit nommé en sus des représentants de l'État.

La commission des affaires sociales a estimé que, compte tenu de l'objet de cet amendement, il était normal que l'État exerce son pouvoir régalien et que le président soit hors quota. L'avis est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3131-4 tel qu'il résulte du II de l'article 1er, les mots : « à l'article L. 3110-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ».
II. - L'article L. 3131-8 tel qu'il résulte du II de l'article 1er est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, la rétribution par l'État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques dont le service est requis en application du premier alinéa bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le représentant de l'État, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative. »
III. - Après l'article L. 3131-9 tel qu'il résulte du II de l'article 1er, il est inséré un article L. 3131-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-10. - En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, les professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées au risque, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. »
IV. - Le c, le d et le f de l'article L. 3131-11 tel qu'il résulte du II de l'article 1er sont abrogés, et le e de cet article devient le c.
V. - Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique tel qu'il résulte du II de l'article 1er et de l'article 2 est complété par un chapitre VI intitulé : « Dispositions pénales » comprenant l'article L. 3116-3-1 qui devient l'article L. 3136-1.

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services » sont remplacés par les mots : « le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, la rétribution par l'État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. »
La parole est à M. le ministre.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22, les mots : « à l'article L. 3110-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 » ;
2° À la fin du sixième alinéa (4°) de l'article L. 1142-23, les mots : « à l'article L. 3110-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ».
II. - Le livre VIII de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier un article L. 3811-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3811-9. - Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Mayotte » ;
2° Il est ajouté au chapitre Ier du titre II un article L. 3821-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3821-11. - Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna » ;
III. - La quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4113-1 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 4122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé le deuxième cycle des études médicales sont autorisées à exercer la médecine au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
4° L'article L. 4141-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologiques sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
5° Les dispositions de l'article L. 4151-6 deviennent le I de cet article ; celui-ci est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
6° L'article L. 4221-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4221-15. - Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requis en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé leur deuxième année du deuxième cycle des études de pharmacie peuvent effectuer les tâches autorisées aux pharmaciens sous réserve que cet exercice soit réalisé au sein d'une équipe comportant au moins un pharmacien diplômé d'État et sous la surveillance de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles ils ont été appelés. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 4221-16 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;
8° L'article L. 4233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du premier et du troisième alinéas ne sont pas applicables au pharmacien réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;
9° L'article L. 4241-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
10° Il est inséré, après l'article L. 4311-12, un article L. 4311-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-12-1. - Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales peuvent effectuer des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'État et sous la surveillance du responsable de l'équipe, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'État d'infirmier ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes infirmiers sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'État et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 4311-15 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;
12° Le troisième alinéa du II de l'article L. 4312-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire, dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;
13° L'article L. 4321-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4321-7. - Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou inscrites en troisième année d'études préparant à ce diplôme peuvent réaliser des actes de masso-kinésithérapie sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un masseur-kinésithérapeute diplômé d'État et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 4321-10 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de résidence »
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;
15° Le premier alinéa de l'article L. 4321-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;
16° Le premier alinéa de l'article L. 4322-2 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;
17° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4322-9 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;
18° Le premier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase, après les mots : « situation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de résidence » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. »
IV. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-6 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe au moins six mois avant la date envisagée ou prévisible l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en accord avec l'entreprise, dans la limite de six mois après la notification, sauf circonstances exceptionnelles. Si le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence. » ;
b) Il est ajouté in fine une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires. » ;
c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé. »
2° Dans le dixième alinéa (9°) de l'article L. 5124-18, les références : « L. 5124-7 et L. 5124-8 » sont remplacées par les références : « L. 3135-1, L. 5124-7 et L. 5124-8 ».

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du 1° du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Dans la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé (trois fois) par le mot : « elle ».
La parole est à M. le ministre.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-5-2. - Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1, et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'État, selon des modalités définies par décret. »
II. - Les rémunérations procurées par l'activité de réserviste mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé libéraux sont assimilées aux revenus tirés de l'activité professionnelle libérale.
Les régimes d'assurance maladie participent, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, au financement des cotisations dues au titre de l'activité de réserviste des professionnels de santé conventionnés, en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 du même code.
III. - Après l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-16. - I. - Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et réalisés par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique durant son affectation donnent lieu :
« - sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces professionnels, à un reversement à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 162-1-7. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« - dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette personne à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition.
« II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de l'État peut fixer les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. » -
Adopté.
Après l'article L. 751-14 du code rural, il est inséré un article L. 751-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-14-1. - Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7, et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'État, selon des modalités définies par décret. » -
Adopté.
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complété par une section 4-7 ainsi rédigée :
« Section 4-7
« Règles particulières applicables aux salariés membres de la réserve sanitaire
« Art. L. 122-24-13. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » -
Adopté.
TITRE V
Dispositions relatives aux fonctionnaires membres du corps de réserve sanitaire
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :
I. - Le sixième alinéa (5°) de l'article 32 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire ».
II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre V, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve ».
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 53, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile ».

L'amendement n° 5, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le III de cet article, remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
trente
La parole est à M. Claude Domeizel.

Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements n° 6 et 7, qui sont de même nature.
Comme je l'ai dit au cours de la discussion générale, nous souhaiterions connaître les raisons pour lesquelles on prévoit quarante-cinq jours dans certains cas et trente dans d'autres. Nous proposons donc de remplacer le mot « quarante-cinq » par le mot « trente ».

Vos amendements tendent à réduire à trente jours la durée annuelle de la réserve sanitaire. Ce délai de trente jours est celui de la réserve opérationnelle militaire. Toutefois, les trente jours militaires correspondent en pratique à un objectif annuel de jours d'entraînement. Les périodes peuvent être portées à cent vingt jours en mission opérationnelle. La période de trente jours est donc une durée minimale.
Les quarante-cinq jours de la réserve sanitaire que nous instituons correspondent, quant à eux, à une estimation moyenne fondée sur les précédents et cette durée pourrait d'ailleurs être dépassée en cas de crise grave.
Il ne serait pas raisonnable de la réduire. Nous vous demandons donc de bien vouloir retirer vos amendements. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

Ces amendements n'avaient pour objet que de connaître les raisons de cette différence de délai. Je vous remercie de vos explications. Je retire donc ces trois amendements.
L'article 8 est adopté.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
I. - Le sixième alinéa (5°) de l'article 55 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire ».
II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre V, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve ».
III. - Dans le troisième alinéa de l'article 74, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile ».

L'amendement n° 6, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le III de cet article, remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
trente
Je rappelle que cet amendement a été retiré.
Je mets aux voix l'article 9.
L'article 9 est adopté.
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
I. - Le sixième alinéa (5°) de l'article 39 est complété par les mots : « et dans la réserve sanitaire ».
II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre IV, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve ».
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 63, avant les mots : « est mis en congé », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile ».

L'amendement n° 7, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le III de cet article, remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
trente
Je rappelle que cet amendement a été retiré.
Je mets aux voix l'article 10.
L'article 10 est adopté.
I. - Le III, à l'exception des 12°, 15° et 17°, et le IV de l'article 4 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna.
II. - Pour ces deux collectivités, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle tels que définis par le régime de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge de l'État, selon des modalités fixées par décret.
III. - Le premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, et le III du même article est applicable à Mayotte. -
Adopté.
I. - Sous réserve du IV du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
II. - Les biens, droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, inséré dans le code de la santé publique par l'article 2 de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I du présent article.
III. - Les dispositions des articles L. 3110-5-1, L. 3110-5-2 et L. 3110-5-3 du code la santé publique sont abrogées à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I du présent article.
IV. - Les dispositions du IV de l'article 4 entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi. -
Adopté.

L'amendement n° 8, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : «, à la charge du service départemental d'incendie et de secours dont ils dépendent ».
La parole est à M. Claude Domeizel.

Cette proposition de loi prévoit que l'État prend en charge la réparation du préjudice lorsqu'un réserviste est victime de dommages subis à l'occasion du service dans la réserve et, comme cela a été ajouté par la voie d'un amendement qui a été adopté tout à l'heure, pendant la formation.
Lorsque les victimes des dommages sont des sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs employés dans le privé, la réparation du préjudice subi est prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours, ou SDIS. En revanche, lorsqu'il s'agit de sapeurs-pompiers volontaires agents communaux - et ils sont nombreux -, elle est à la charge de la commune.
Il existe une différence de traitement selon que l'on est dans le public ou dans le privé et, en l'occurrence, selon que l'on est dans la réservé sanitaire ou dans l'exercice des fonctions de sapeur-pompier.
Imaginons qu'un sapeur-pompier volontaire soit intégré, pour des raisons pratiques, dans la réserve sanitaire. S'il a un accident dans ce cadre, la réparation du préjudice subi sera prise en charge par l'État. En revanche, si l'accident survient pendant l'exercice d'une fonction de sapeur-pompier, elle sera à la charge non pas du SDIS, mais de la commune.
C'est pour le moins anormal. Aussi, je propose d'instaurer une égalité de traitement.

Cet amendement a pour objet de régler un problème que tous les maires considèrent comme très important, mais qui, il faut bien le dire, est sans rapport direct avec le texte.
Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs employés communaux bénéficient d'une prise en charge par leur commune d'emploi en cas de dommages subis pendant leur période de réserve, alors que les pompiers volontaires issus du privé sont pris en charge par les SDIS.
Le présent amendement vise à généraliser cette prise en charge par les SDIS en l'étendant aux employés communaux. Si l'on comprend bien la difficulté que vous soulevez, mon cher collègue, il n'en demeure pas moins que votre amendement constitue un cavalier. Pour cette raison, la commission ne peut y donner un avis favorable.
Sourires.
Au terme d'une même argumentation, le Gouvernement émettra, hélas ! pour vous, monsieur Domeizel, sur cet amendement un avis identique à celui de la commission dans la mesure où il est sans rapport avec l'objet de la présente proposition de loi.
J'ajoute que son adoption entraînerait un transfert de charges vers les collectivités territoriales. J'ignore si vous avez vous-même abordé ce sujet avec elles, mais, si tel n'était pas le cas, je ne voudrais pas vous vous mettiez en difficulté...
En outre, cet amendement ne prévoit aucune compensation.
M. Xavier Bertrand, ministre. Je faisais de la prévention !
Sourires.

Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire par ailleurs employé communal est victime d'un accident, sa prise en charge n'est pas mutualisée au niveau départemental, comme il serait normal qu'elle le soit. Au contraire, il incombe à la commune qui l'emploie de supporter toutes les conséquences du préjudice causé par cet accident du travail.
Aussi, je suis certain que les maires - j'en connais quelques-uns - souhaiteraient que cette dépense supplémentaire soit mutualisée au niveau départemental, ce qui serait normal.
Quant à prétendre que cet amendement est un cavalier, je le conteste. Au contraire, il vise à instaurer une égalité de traitement entre les sapeurs-pompiers réservistes et les sapeurs-pompiers volontaires.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Les charges pour l'État résultant de l'application des articles 2 à 11 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les charges pour les régimes obligatoires d'assurance maladie résultant des dispositions de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement a pour objet de lever le gage. Compte tenu du caractère primordial de ce sujet, il est important que chacun soit placé face à ses responsabilités. L'État, en ce qui le concerne, assume les siennes.
Le financement sera prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. En attendant, dès que le présent texte sera définitivement applicable, l'établissement public bénéficiera des contributions attribuées au Fonds de prévention des risques sanitaires, dont les biens, droits et obligations lui seront transférés en application de l'article 12 de la proposition de loi.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'article 13 est supprimé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifiées, les conclusions du rapport de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi n° 90.
La proposition de loi est adoptée.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, pour la deuxième fois en moins d'une semaine, un texte dont l'examen me vaut le plaisir d'être présent parmi vous au sein de cette assemblée ne fait l'objet d'aucun vote contre.
Rires.
(Nouveaux rires.) Nous verrons ce que nous réservera l'examen des prochains textes !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Jamais deux sans trois ! §Je ne préjuge rien et j'ai bien compris qu'un vote ne laisse en rien présager la suite.
Par excellence, les sujets de santé et de sécurité sanitaire échappent parfois aux clivages politiques, aux barrières virtuelles qui, à l'occasion, séparent les travées de cette assemblée. À cet égard, je sais gré aux uns et aux autres du ton qu'ils ont adopté, au cours tant de la discussion générale que de celle des amendements.
Je remercie l'ensemble des intervenants, le président About et Francis Giraud, le rapporteur. J'en suis convaincu, nous avons fait oeuvre utile et notre pays sera maintenant mieux armé pour faire face aux crises sanitaires. N'allons pas croire que ce texte réglera tout de manière définitive, mais il témoigne d'une vraie prise de conscience et de la façon dont nous avons su tirer tous les enseignements des événements et des crises que nous avons connus. Il reste du travail à accomplir, mais j'ai le sentiment que, grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons franchi un pas important.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, je vais suspendre la séance pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures trente.
(Ordre du jour réservé)

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi présentée par MM. Pierre Jarlier, Laurent Béteille, François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, René Garrec, Patrice Gélard, Charles Guené, Jean-René Lecerf, Hugues Portelli, Henri de Richemont, Bernard Saugey et Mme Catherine Troendle relative aux contrats d'assurance de protection juridique et sur la proposition de loi présentée par M. François Zocchetto visant à réformer l'assurance de protection juridique (nos 160, 85 et 86).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'assurance de protection juridique, dont le succès va croissant avec une progression des cotisations de plus de 8 % par an sur les cinq dernières années, a pour objet, en cas de litige, de garantir une prise en charge des frais de procédure exposés par l'assuré et de lui offrir une assistance en vue du règlement amiable de son différend.
Les principaux domaines dans lesquels intervient cette assurance concernent les litiges liés à la consommation de biens et services, les conflits du travail, les différends sur les prestations sociales ou encore sur la fiscalité, mais assez peu le pénal.
Les litiges relatifs à l'immobilier et à la consommation représentent plus de 50 % des sinistres déclarés aux assureurs alors que le droit des brevets, le droit des personnes et de la famille, ainsi que le droit de la construction sont le plus souvent exclus du champ couvert par ces assurances.
Avec un chiffre d'affaires estimé à un peu plus de 1 milliard d'euros, l'assurance de protection juridique ne représente encore que 0, 5 % du marché des assurances. Son poids économique est donc encore relativement modeste, mais ses perspectives de développement s'avèrent prometteuses.
Toutefois, le fonctionnement actuel de cette assurance pose quelques problèmes, qui ont été soulevés en 2002 par la commission des clauses abusives. Celle-ci a notamment déploré les conditions trop restrictives de mise en jeu de la garantie et dénoncé les relations déséquilibrées qui existent entre les sociétés d'assurance, d'une part, les assurés et les avocats, d'autre part.
Des initiatives ont été prises depuis lors pour favoriser la transparence des contrats et mieux prendre en compte les attentes des consommateurs. Des discussions ont également eu lieu, sous l'égide du ministère de la justice, depuis 2003 pour tenter, malheureusement sans succès, de rapprocher les positions des avocats et des assureurs.
C'est afin de remédier à ce blocage que nos collègues Pierre Jarlier, avec plusieurs cosignataires, et François Zocchetto ont déposé chacun une proposition que la commission des lois a examinée et complétée et dont je vous rapporte aujourd'hui les conclusions au travers d'un texte commun.
Celui-ci a d'autant plus d'importance qu'il s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à faciliter l'accès au droit et à la justice, thème ô combien important pour lequel, monsieur le garde des sceaux, vous avez d'ailleurs souhaité organiser des assises, qui auront lieu la semaine prochaine.
Ce texte, en apportant des aménagements limités au régime de l'assurance de protection juridique, a principalement pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la garantie est engagée et de clarifier les relations entre toutes les parties en présence : assurés, assureurs et avocats.
L'article 1er de la proposition de loi vise à faciliter l'intervention de l'avocat à tous les stades du déroulement d'un litige en rendant obligatoire sa saisine par l'assuré dès lors que la partie adverse est elle-même défendue par un membre de cette profession. Il s'agit donc simplement de rétablir « l'égalité des armes » en permettant à l'avocat d'intervenir, le cas échéant, dès la phase amiable, qui est souvent assurée aujourd'hui directement par les services juridiques de l'assureur.
Ce même article autorise également l'assuré à solliciter une consultation juridique ou des actes de procédures avant même d'avoir déclaré le sinistre, sans que, pour autant, l'assureur puisse lui opposer la déchéance de garantie pour ce motif, contrairement à ce qui se pratique parfois un peu trop facilement aujourd'hui. Bien évidemment, l'assureur ne serait pas tenu de prendre en charge les frais résultant des consultations ou des actes effectués par l'assuré préalablement à la déclaration du sinistre, sauf dans les cas où l'urgence aurait justifié ces démarches préalables.
Toujours avec le même objectif d'éviter que ne soit trop facilement opposée la déchéance de garantie à l'assuré, l'article 1er donne une définition claire du sinistre en indiquant qu'il est constitué par le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. Ce dispositif vise à préserver les droits du consommateur et à empêcher l'assureur de contester la date de survenance du litige pour refuser de mettre en jeu la garantie.
Les articles 2 et 3 ont pour objet de préserver le caractère libéral de l'intervention de l'avocat dans la gestion du sinistre. L'article 2 réaffirme la liberté de choix de l'avocat en indiquant que l'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans que celui-ci en ait fait la demande écrite. L'article 3 rappelle le principe de libre fixation des honoraires entre l'avocat et son client.
Au-delà de ces dispositions, la commission des lois a souhaité compléter le texte proposé par nos collègues pour permettre la transposition, dans le code de la mutualité, des dispositions insérées dans le code des assurances que je viens de vous présenter. En effet, même si leur place est aujourd'hui limitée, les mutuelles participent aussi au marché de l'assurance de protection juridique.
La commission a également prévu d'insérer dans ce texte le principe selon lequel les sommes attribuées en remboursement des frais exposés pour le règlement d'un litige doivent bénéficier prioritairement à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées. Certaines dérives ayant été constatées en ce domaine, il apparaît en effet nécessaire que le législateur rappelle cette règle d'équité.
Enfin, la commission des lois a jugé indispensable de prévoir une articulation entre l'aide juridictionnelle et l'assurance de protection juridique, en précisant que l'aide juridictionnelle ne peut être accordée lorsque les frais qu'elle vise à couvrir sont déjà pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. Il est certain que les deux systèmes d'accès à la justice que sont l'aide juridictionnelle - accordée aux plus démunis - et l'assurance de protection juridique se recouvrent peu et que le bon fonctionnement de ce dispositif nécessitera un travail de vérification systématique de la part des bureaux d'aide juridictionnelle. Mais, compte tenu du nombre croissant de personnes éligibles à l'aide juridictionnelle et de la forte inflation de ce poste dans le budget de la justice - celui-ci a augmenté de 63 % entre 1998 et 2006 -, il convient d'apporter cette précision.
Je n'ignore pas que cette proposition de loi provoque des réactions, notamment chez les assureurs. Elle risque, nous dit-on, de perturber sensiblement le fonctionnement d'un système qui donne toute satisfaction à ses utilisateurs et de conduire à une détérioration des conditions d'accès au droit et à la justice de nos concitoyens dans la mesure où l'intervention plus systématique de l'avocat entraînera une augmentation du coût des interventions et une hausse des primes sur les contrats d'assurance de protection juridique. Cette proposition de loi remettrait également en cause le caractère aléatoire du risque en ouvrant la voie à une couverture de sinistres antérieurs à la souscription de l'assurance et ferait peser une menace sur la mission assurée aujourd'hui, en phase amiable, par les salariés juristes des compagnies d'assurances.
Je voudrais, sur ces différents points, rappeler que le texte que nous examinons n'apporte que des aménagements ponctuels au régime de l'assurance de protection juridique pour remédier à certaines critiques, telles que le manque de transparence et de lisibilité des contrats, le positionnement marginal des avocats et les réticences opposées par les assureurs à la mise en jeu de la garantie, mais ne vise pas à remettre en cause le régime de l'assurance de protection juridique.
La définition du sinistre qui est proposée permettra ainsi de donner une date certaine au point de départ du délai dans lequel l'assuré doit faire sa déclaration et lui évitera de se voir opposer la déchéance de garantie pour déclaration tardive alors qu'il n'aurait, par exemple, pas identifié immédiatement l'origine du sinistre ou qu'il aurait constaté le défaut de la chose livrée depuis quelques semaines mais se serait d'abord adressé à son fournisseur pour tenter d'y remédier avant de saisir son assureur. Vouloir éviter que l'assuré soit déchu de sa garantie pour des motifs de ce type me paraît être plus une mesure de bon sens et d'équité qu'une disposition qui révolutionnerait le droit des assurances, d'autant qu'il est précisé que, bien entendu, l'assureur n'aura pas à supporter le coût de ces démarches préalables.
Faire intervenir un avocat dès lors que la partie adverse est elle-même représentée par un membre de cette profession ne remettra pas non plus en cause le rôle que jouent les services juridiques de l'assureur, tels la délivrance de renseignements par téléphone, le conseil, la consultation juridique ou encore la transaction amiable.
D'ailleurs, ces services fonctionnent bien, puisque 70 % des litiges font aujourd'hui l'objet d'un règlement amiable et que le taux de satisfaction des assurés est élevé. Il s'agit donc simplement de rétablir l'équilibre entre les parties en présence et non pas de porter systématiquement devant les tribunaux un litige qui pourrait être avantageusement réglé par une transaction amiable. La procédure judiciaire ne constitue plus la voie unique de résolution des conflits pour les avocats, comme le montre l'évolution de leurs pratiques professionnelles.
Au demeurant, la liberté que conservent évidemment les assureurs de fixer dans les contrats d'assurance de protection juridique un plafond à la prise en charge des honoraires d'avocats limitera ce risque de dérive, tout comme le fait que la plupart des assurés n'ont généralement pas d'avocat attitré et que l'assureur pourra toujours proposer le nom d'un avocat avec lequel il a l'habitude de travailler à l'assuré, dès lors que celui-ci lui en aura fait la demande écrite.
Bien évidemment, l'intervention plus systématique de l'avocat dans le règlement du litige, la liberté de choix de l'avocat par l'assuré et la libre fixation des honoraires entre l'avocat et ce dernier peuvent conduire à une augmentation globale des charges supportées par l'assureur et, par voie de conséquence, des primes réclamées aux assurés. Mais, il convient de le rappeler, ce dispositif ne remet pas en cause la possibilité pour les assureurs de fixer des limitations contractuelles au remboursement des honoraires d'avocats et, dès lors que les clauses contractuelles seront parfaitement claires sur l'étendue des prestations offertes, des frais pris en charge par l'assureur et de ceux qui restent à la charge de l'assuré, ce dernier sera parfaitement à même de se déterminer sur l'étendue de la garantie qu'il souhaite et sur ce qu'il est donc prêt à payer, ainsi que sur le choix à faire entre une transaction amiable et une procédure judiciaire longue et incertaine.
Telles sont, madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les observations que je souhaitais formuler avant que nous abordions l'examen de ce texte, qui s'inscrit, je le rappelle, dans une démarche souhaitable de facilitation de l'accès au droit et à la justice et dont je remercie nos collègues Pierre Jarlier et François Zocchetto d'avoir pris l'initiative.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, en dépit de la place croissante du droit dans notre société, il est étonnant de constater combien l'assurance de protection juridique est restée jusqu'à présent à l'écart de l'incessante évolution du code des assurances.
Les sept articles qui régissent la matière sont demeurés inchangés depuis dix-sept ans alors même qu'il est avéré qu'ils sont insuffisants.
La diffusion de l'assurance de protection juridique est pourtant soutenue. De fait, la demande potentielle est loin d'être comblée : de plus en plus de particuliers ont conscience que seule une connaissance éclairée de leurs droits permet des rapports équilibrés avec leur bailleur, leur banquier, voire leur assureur...
À ceux d'entre eux dont les revenus sont suffisants pour les exclure de l'aide juridictionnelle, mais que les frais d'un procès peuvent dissuader de faire valoir leurs droits en justice, l'assurance de protection juridique est particulièrement adaptée.
Ainsi, nos voisins belges ont défini avec les autorités publiques les caractéristiques types d'un contrat d'assurance. Celui-ci couvre la plupart des litiges de la vie courante que rencontrent les classes moyennes. Cette garantie leur est très adaptée et les professionnels du secteur s'accordent à dire que le marché est encore amené à progresser significativement.
La clientèle des particuliers n'est au surplus que l'un des éléments à prendre en compte. Le nombre d'entrepreneurs et de PME qui, faute de moyens suffisants pour disposer de leurs propres services juridiques, font appel à cette assurance ne cesse de croître.
Les règles actuelles du code des assurances résultent d'une directive européenne de 1987 qui permet aux législateurs nationaux d'en améliorer le régime en faveur des assurés. La transposition de cette directive en 1989 avait déjà représenté un net progrès en regard des règles alors applicables. Depuis lors, le développement de cette garantie a permis de révéler le caractère flou et laconique de certaines de ses dispositions.
Je souhaite pourtant rendre hommage dès à présent à ceux qui oeuvrent au succès de cette couverture.
Je pense d'abord aux assureurs, qui ont su faire évoluer leurs pratiques au cours de la décennie passée, et tout particulièrement dans les dernières années.
La concertation approfondie que la Chancellerie a engagée avec la profession, avec l'aide du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a permis de révéler des améliorations possibles que les assureurs ont mises en oeuvre. Il s'agit notamment des engagements que la Fédération française des sociétés d'assurance a pris au mois de juin 2003, suivie par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance. Ces engagements ont permis d'apporter une clarification décisive aux contrats proposés. Ils témoignent également de l'attention que prête la profession aux observations des consommateurs et des pouvoirs publics.
Plus récemment, afin de contribuer à la réflexion entreprise sur la question au sein de la Chancellerie, les représentants de la profession ont demandé à M. Jean-Paul Bouquin de réaliser une étude approfondie sur les perspectives d'évolution de cette assurance. Ce travail a été utile à l'ensemble des pouvoirs publics, puisqu'il a notamment permis de chasser nombre d'idées reçues en la matière.
Parmi les professionnels qui ont permis de faire progresser cette garantie, je veux évoquer également les avocats. Je pense en particulier à la transparence et à la rigueur accrues concernant la fixation de leurs honoraires, dont la pratique a été consacrée par un décret de 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession.
L'addition de l'ensemble de ces améliorations a permis, à législation constante, de modifier la pratique de l'assurance de protection juridique.
Les réunions de concertation qui se sont tenues ces dernières années à la Chancellerie se sont prolongées durant une année sous l'égide du Comité consultatif du secteur financier, que mon collègue Thierry Breton a opportunément saisi. C'est notamment dans son enceinte qu'a été pensée et précisée une procédure d'arbitrage particulièrement novatrice lorsqu'un désaccord survient entre l'assureur et son client sur l'opportunité d'engager une procédure judiciaire.
Si je ne peux que me réjouir des avancées évoquées, je dois aussi constater que la concertation a achoppé sur certains points essentiels. Nous sommes probablement arrivés à un stade où la mutation progressive de l'assurance de protection juridique appelle désormais une redéfinition de son assise juridique.
Les deux propositions de loi que MM. Jarlier et Zocchetto ont déposées sur le bureau de votre assemblée arrivent par conséquent à point nommé pour faire arriver à maturité ce produit d'assurance. Ces textes prennent en effet de manière efficace et concrète le relais des négociations que le Gouvernement avait entreprises pour conduire la réforme à son terme. Les ajouts que votre commission des lois y a apportés parachèvent ce travail et confèrent à l'assurance de protection juridique le cadre juridique clair qui lui manquait jusqu'à présent.
Un cadre juridique clair, c'est en premier lieu une définition précise des conditions dans lesquelles l'assureur doit donner sa garantie. La commission des clauses abusives a dénoncé en 2002 la latitude que s'accordent certains assureurs en refusant leur garantie au prétexte que l'assuré n'aurait pas déclaré à temps le litige.
Dès lors qu'il est loisible à l'assureur de faire remonter le litige suffisamment en amont de la déclaration de sinistre pour pouvoir prononcer une déchéance de garantie, l'assuré est placé dans une situation d'insécurité juridique à laquelle il faut remédier.
Il est en effet parfois difficile de caractériser le début d'un litige. En matière de trouble de voisinage, pour ne prendre que cet exemple, il est le plus souvent vain de préciser à quel stade le conflit est véritablement apparu. Votre proposition permet de fixer les parties sur ce point en adoptant comme définition du sinistre le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.
Comme le relève justement la commission, ce dispositif préserve en outre pleinement les droits de l'assureur, dans la mesure où il permet au juge de relever la fraude dès lors qu'un assuré aurait souscrit une protection juridique pour un litige déjà en germe au moment de la souscription du contrat. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est très favorable à cette disposition.
Un cadre juridique clair, c'est également une définition sans ambiguïté des rôles de chacun. Il ne saurait être question de priver l'assureur de son rôle de conseil, y compris sur le plan juridique. Bon nombre de conflits sont en effet résolus grâce à l'intervention rapide de l'assureur et grâce à la compétence de ses services juridiques.
Il est cependant évident que cette assistance ne peut suffire lorsque l'adversaire de l'assuré est lui-même conseillé par un avocat.
Dans ce cas, un avocat doit prendre le relais de l'assureur. C'est une question d'égalité des armes, mais aussi, comme le relève la commission des lois, la garantie que les parties seront placées dans les conditions les plus propices à un accord. En effet, seuls les échanges entre avocats sont confidentiels, ce qui permet à chacun de faire les concessions nécessaires à une transaction.
Un cadre juridique clair, c'est encore l'affirmation du caractère libéral de la profession d'avocat. Qu'il soit rémunéré par un assureur, par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou par son client, l'avocat ne doit rendre compte qu'à ce dernier. Or il lui est difficile de tenir cette ligne de conduite lorsqu'il ne négocie ses honoraires qu'avec l'assureur, comme c'est le cas actuellement pour les avocats dont on dit qu'ils sont dans le « réseau » d'une compagnie d'assurances. Il s'instaure dans ce cas un quasi-salariat qui donne une place prépondérante à l'assureur, alors que l'avocat devrait uniquement se soucier des intérêts de son client.
Chacun le mesure : la défense qui convient à l'assureur n'est pas nécessairement celle qui est la plus adaptée à l'assuré. Le premier veillera en effet à limiter les frais de procédure, les mesures d'expertise et l'exercice des voies de recours, tandis que le second voudra, très légitimement, employer tous les moyens légaux pour faire valoir ses droits.
Bref, il faut en revenir à l'esprit de la directive de 1987, dont l'axe cardinal est l'indépendance de l'avocat. Cette indépendance se traduit par un libre choix effectif du conseil, ce qui n'a été jusqu'à présent, en pratique, qu'un voeu pieux.
Le texte proposé s'inscrit à cet égard dans la pleine réalisation de nos engagements communautaires.
Après ces nécessaires clarifications, la commission des lois propose de consacrer la subsidiarité de l'aide juridictionnelle à l'égard de l'assurance de protection juridique. Je suis tout à fait favorable à cette disposition.
Comme vous le soulignez, ce principe n'est pas inédit en droit interne, puisqu'il a été inscrit dans le dispositif de l'aide juridictionnelle par la loi du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire, dans le cadre de litiges transfrontaliers civils ou commerciaux.
La France s'aligne ainsi sur un dispositif déjà pratiqué par nombre de ses voisins européens, qui permettra de réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle à des personnes dépourvues de tout moyen ou soutien financier.
Dans un contexte d'accroissement sans précédent du budget de l'aide juridictionnelle depuis 2000, l'assurance de protection juridique est appelée à jouer un rôle complémentaire.
Pour prendre un exemple, le contentieux des baux d'habitation et professionnels a été à l'origine de plus de onze mille décisions d'admission à l'aide juridictionnelle en 2004. Or la plupart de ces contentieux auraient pu être pris en charge par la protection juridique, qui est le plus souvent attachée à l'assurance multirisque habitation.
Le texte qui est aujourd'hui proposé permet d'engager, de manière équilibrée et réfléchie, l'assurance de protection juridique dans une nouvelle phase. Je suis particulièrement sensible à l'amélioration de l'accès au droit et à la défense de qualité qu'il va permettre.
Je ne doute pas qu'il contribuera également à favoriser la transaction par rapport au contentieux, à clarifier les droits de l'assuré et à réduire la pression particulière qui s'exerce sur le budget de l'aide juridictionnelle.
Pour l'ensemble de ces raisons, le texte fait l'objet d'une pleine adhésion du Gouvernement, au nom duquel je tiens à saluer MM. Jarlier et Zocchetto pour l'initiative qu'ils ont prise en déposant leurs propositions de loi. Je veux aussi remercier votre rapporteur, M. Détraigne., car les auditions qu'il a organisées et l'attention dont il a fait preuve ont permis à la commission des lois d'apporter aux questions posées les solutions les plus adaptées.
Au terme de mon exposé, je souhaite préciser que quatre amendements relatifs à l'aide juridictionnelle sont soumis par le Gouvernement à l'approbation de votre assemblée.
Il s'agit d'abord de ratifier l'ordonnance du 8 décembre 2005 modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui permet, d'une part, de ne pas tenir compte, lors d'une demande d'aide juridictionnelle, des ressources des parents du mineur poursuivi pénalement lorsque ces derniers manifestent un défaut d'intérêt à son égard, et, d'autre part, de simplifier la procédure de recouvrement des honoraires mis à la charge de la partie perdante par le juge au profit de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale.
Il s'agit ensuite d'organiser la centralisation devant les cours d'appel des recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle, ce qui permettra d'harmoniser la jurisprudence en la matière ; cette mesure est très attendue.
Il s'agit encore de permettre la rétribution, au titre de l'aide juridictionnelle, d'une nouvelle mission non indemnisée jusqu'alors : l'assistance par un avocat d'une personne détenue faisant l'objet soit d'une procédure de placement à l'isolement d'office, soit, à sa demande, d'une mesure de levée d'un placement à l'isolement.
Il s'agit enfin d'étendre aux personnes contestant une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, créée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle, sans condition de résidence habituelle et régulière sur le territoire national. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnes exerçant un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière.
Ces amendements compléteront utilement le dispositif actuel de l'aide juridictionnelle dans le sens d'une plus grande simplification de la procédure, d'une harmonisation des décisions et d'un renforcement de l'accès au droit des personnes les plus démunies.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'assurance de protection juridique permet aujourd'hui de fournir à l'assuré des services visant d'abord à rechercher une solution amiable, puis à prendre en charge, si un procès est nécessaire, les frais entraînés par la procédure.
Cette assurance peut rendre service à un public très varié. Il s'agit souvent de personnes trop riches pour bénéficier de l'aide juridictionnelle d'État, mais trop pauvres pour supporter seules les frais d'un procès, donc de la grande majorité des Français. Par conséquent, c'est bien de l'accès au droit pour le plus grand nombre qu'il est question.
Le texte proposé, sous couvert d'objectifs apparemment louables, est cependant porteur de risques flagrants.
Ainsi, ce qui apparaît en premier, c'est le recours multiplié aux avocats, notamment dans la phase amiable, ce qui ne manquera pas d'entraîner un renchérissement des primes d'assurance.
Par ailleurs, un tel renchérissement ne peut que se voir accru par l'interdiction des conventions d'honoraires proposée par le présent texte. Les tarifs augmentés constitueraient alors, bien évidemment, une gêne pour les assurés. Une sorte de sélection par l'argent viendrait ainsi diminuer le nombre de ces derniers, ce qui entraînerait une baisse du bénéfice évoqué. La disposition risquerait donc d'avoir des conséquences fâcheuses pour le personnel juridique des sociétés d'assurance.
Il paraît en outre certain que la présence de l'avocat dans la phase amiable conduirait à une augmentation du nombre de procédures. Aujourd'hui, on estime que 70 % des dossiers se règlent à l'amiable. Si, demain, la proportion n'est plus que de 20 % ou 30 %, les juridictions pourront-elles faire face ?
Par ailleurs, les assureurs de protection juridique concourent, depuis quelques années, au développement des modes alternatifs de règlement des litiges, notamment la médiation. On peut craindre, là encore, un coup d'arrêt à ces pratiques, d'où un nouveau risque d'engorgement des tribunaux !
Tout porte donc à penser que beaucoup ont ici à y perdre : les citoyens, qui ne pourront plus bénéficier de l'assurance de protection juridique, ce formidable moyen d'accès au droit dont nous nous félicitions tout à l'heure, les avocats, qui seront victimes du recul de l'assurance de protection juridique, mais aussi l'État, qui devra financer un recours accru à l'aide juridictionnelle.
L'initiative paraît donc finalement assez vaine, voire dangereuse.
Enfin, dans la mesure où le comité consultatif du secteur financier est saisi pour rendre un avis sur l'assurance de protection juridique, ce serait la moindre des choses, me semble-t-il, d'attendre communication de cet avis, annoncé d'ailleurs comme étant imminent, avant que nous nous prononcions définitivement.
C'est pourquoi le groupe socialiste votera contre les conclusions proposées.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le contexte dans lequel Pierre Jarlier et moi-même avons déposé nos propositions de loi respectives est celui de l'accès au droit.
Je précise en effet d'emblée, pour répondre à des critiques que je viens d'entendre, mais qui sont également parues dans la presse, que le problème dont nous traitons ce soir est non pas celui de la fragilisation de la profession d'avocat ou de sa supposée paupérisation, mais bien celui de l'accès au droit de nos concitoyens, qui doivent bénéficier d'une égalité de traitement en matière de résolution des litiges, notamment ceux qui appartiennent à ce qu'il est convenu d'appeler les classes moyennes, bien souvent interdites d'accès à l'aide juridictionnelle sans avoir pour autant les moyens d'assumer les frais d'un procès.
Qui dit accès au droit dit aussi transparence. En d'autres termes, il importe non seulement que le traitement soit le même pour tous, mais aussi que chacun comprenne le traitement dont il fait l'objet.
Enfin, la clarté maximale doit prévaloir lorsque l'on est partie à un litige.
Ces propositions de loi visent donc à permettre aux consommateurs de mieux accéder au droit.
Deux moyens principaux se complètent, comme l'a rappelé le garde des sceaux. Il s'agit, d'abord, d'un meilleur traitement de l'aide juridictionnelle, avec une revalorisation des indemnités d'aide juridictionnelle, et, ensuite, de la mise en place d'une véritable protection juridique. Si nous avons la chance, en France, de posséder un système de protection juridique, ce dernier ne donne pas à ce point satisfaction que nous puissions en rester là.
Il me semble utile de faire un bref rappel au sujet de l'aide juridictionnelle, bien que ce ne soit pas l'objet de notre débat ce soir.
Entre 2002 et 2006, alors que le nombre d'affaires traitées par les tribunaux était relativement stable, celui des missions d'aide juridictionnelle a augmenté de 7 % par an, ce qui montre bien la proportion croissante des missions dont le coût est assumé par l'État.
Qu'en est-il de la revalorisation des unités de valeur en matière d'aide juridictionnelle, c'est-à-dire de la rémunération des avocats ?
Entre 2000 et 2005, l'unité de valeur a augmenté de 2 %, c'est-à-dire quatre fois moins que les prix à la consommation. En outre, comme cela a été rappelé par les rapporteurs lors de l'examen des crédits relatifs à la mission « Justice » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2007, depuis deux ans, l'absence de rétribution de certaines missions est à déplorer. À cet égard, je salue les amendements du Gouvernement, qui visent à étendre le champ d'action de l'aide juridictionnelle.
Notre dispositif est donc très fragilisé, ce qui est paradoxal. En effet, si notre pays consacre à l'aide juridictionnelle globalement beaucoup d'argent, et de plus en plus, ce qui le place au deuxième rang de l'Union européenne dans ce domaine, la rémunération, en termes d'unité de valeur, est l'une des plus faibles non seulement au sein de l'Union européenne, mais peut-être même à l'échelon mondial.
Pour conclure sur ce sujet, je salue l'initiative prise par M. le garde des sceaux, qui organise mardi prochain les assises de l'aide juridictionnelle, tout comme je me félicite de l'initiative du Parlement, soutenue par le Gouvernement, visant à revaloriser les unités de valeur, sur la proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois, Yves Détraigne, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007.
Pour en venir au dispositif d'assurance de protection juridique lui-même, il faut rappeler qu'il est largement ignoré des consommateurs. Le problème tient sans doute au fait que cette prestation peut être tantôt autonome, tantôt liée à un autre contrat.
Il ne s'agit pas d'une question abstraite, tant il est vrai qu'environ 35 % des ménages bénéficient aujourd'hui d'une assurance de protection juridique et que de plus en plus d'élus locaux - cela devrait intéresser le Sénat - ont souscrit volontairement des assurances de ce type.
Il reste que l'information fait défaut quant au champ d'application et au fonctionnement des contrats de protection juridique.
Certes, les spécialistes de l'assurance diront que la protection juridique ne constitue qu'une branche mineure de l'assurance, puisqu'elle représente 1 % de l'assurance dommage, soit 600 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.
Toutefois, sachant que chaque ménage consacre actuellement près de 60 euros par an à cette protection juridique, on ne peut considérer cette dernière comme un instrument accessoire.
Pour autant, j'en ai conscience, toute modification concernant la protection juridique constitue un exercice délicat car, d'un côté, l'assurance de protection juridique possède un fort potentiel de développement que les compagnies d'assurances sont les premières à reconnaître et à encourager et, de l'autre, les imbrications de la mise en oeuvre de la protection juridique avec les règles de fonctionnement de la profession d'avocat sont nombreuses.
Aussi, je salue sincèrement les efforts du Gouvernement, qui a conduit depuis plusieurs mois des négociations difficiles avec les compagnies d'assurances et les avocats, mais aussi avec les services du ministère des finances.
Ces négociations ont conduit à une reconnaissance mutuelle entre les différents acteurs de la protection juridique et nous ont permis, à Pierre Jarlier et à moi-même, de déposer nos textes à point nommé, puisque, grâce à ces avancées, nous pouvons aujourd'hui nous comprendre.
Sans revenir en détail sur le texte, je précise simplement qu'il vise à donner une définition plus claire du sinistre, à rappeler le caractère libéral de l'intervention de l'avocat, avec le choix du conseil et la fixation de la rémunération.
Le rapport de la commission, fruit du travail très intéressant accompli par le rapporteur, constituera, me semble-t-il, une base de référence pour les semaines et les mois à venir.
Parmi ses apports, je relève notamment la proposition tendant à rendre l'aide juridictionnelle subsidiaire par rapport à la protection juridique dans un souci de meilleure gestion des deniers de l'État, la subrogation de l'assuré dans la perception des sommes qui seraient dues par la partie défaillante au procès et, enfin, l'alignement du code de la mutualité sur le code de l'assurance - comment n'y avions-nous pas pensé ? Nous pouvons nous en vouloir !
Sourires

Par ailleurs, les amendements du Gouvernement complètent opportunément le dispositif.
Je ne saurais terminer sans remercier ceux qui ont participé à l'élaboration du calendrier parlementaire et qui ont accepté d'inscrire ces textes à l'ordre du jour de nos travaux.
Je souhaite qu'une majorité du Sénat - puisqu'il semble que ce sujet ne recueille malheureusement pas le consensus que j'espérais - donne une nouvelle chance à l'assurance de protection juridique et à l'accès au droit de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ma proposition de loi répond, à mon sens, à une double volonté et à une double nécessité. Il s'agit, d'une part, de rendre la protection juridique plus effective, plus accessible et plus transparente pour le consommateur - ce n'est pas le cas aujourd'hui, mon cher collègue Charles Gautier- et, d'autre part, de permettre aux avocats d'exercer pleinement leur mission dans ce cadre.
Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, parfois hostile, et sommes de plus en plus confrontés à une judiciarisation de notre vie quotidienne.
Les raisons en sont multiples et je ne les aborderai pas ici, car ce n'est pas le sujet de ce jour. Mais rappelons-nous, malgré tout, que la complexité croissante de notre législation, associée à une évolution des mentalités plus exigeantes au regard du droit, est à l'origine de cette évolution constante.
C'est cette montée en puissance du contentieux dans le quotidien des Français qui explique le succès grandissant des contrats de protection juridique proposés par les assurances. C'est, en effet, un moyen privilégié d'accès au droit et à la justice pour tous et non limité par manque de moyens.
Le régime de l'assurance de protection juridique est défini par les articles L. 127-1 et suivants du code des assurances. Il procède notamment de la transposition de la directive européenne du 22 juin 1987.
C'est un dispositif en pleine expansion qui offre des avantages multiples.
En effet, même si elle est facultative, cette assurance est d'un champ très vaste : il couvre à la fois les litiges occasionnés dans les domaines de la consommation, du service, du droit du travail ou de la fiscalité, mais aussi ceux du domaine pénal, dans certaines conditions.
La gamme des contrats offerts aux particuliers est donc très large et les primes, proportionnelles à l'étendue de la couverture, sont d'un montant annuel très variable.
Ces contrats sont régis par plusieurs principes : l'individualisation obligatoire de la garantie et de la prime, les modalités de règlement en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré sur les mesures à prendre et, enfin, le droit pour l'assuré de choisir un avocat ou une personne de son choix pour défendre ses intérêts.
Dans ce cadre, l'assureur apporte donc de véritables prestations de services juridiques, qui peuvent être directement gérées par lui-même, pour 66 % des cas, par un avocat, pour 32 % des cas, et par l'assuré lui-même, pour 2 % des cas.
Outre ces prestations, l'assureur a vocation à prendre en charge également les frais liés au règlement du litige, mais les sommes engagées par l'assurance sont limitées. En effet, le dédommagement par litige est plafonné, le remboursement d'avocat est limité et les contrats fixent, en général, des seuils d'intervention.
Néanmoins, ce type de contrat présente des avantages indéniables au regard de l'accès au droit. D'abord, le rôle de l'assureur est très actif en phase amiable pour favoriser un règlement rapide des litiges. Ensuite, ce type de garantie peut constituer le complément efficace de l'aide juridictionnelle.
Pour autant, l'assurance de protection juridique, telle qu'elle est pratiquée, a suscité de vives critiques de la part de la Commission des clauses abusives, dans la recommandation qu'elle a adoptée le 2 février 2002, comme le rapporteur l'a indiqué tout à l'heure.
En premier lieu, ladite commission constate un manque de transparence et de lisibilité pour l'assuré, au point que ce dernier ignore parfois qu'il bénéficie d'une protection juridique, et d'un manque de connaissance de la nature de l'étendue des garanties auxquelles il a droit.
En second lieu, les acteurs naturels de la défense des justiciables - les avocats - sont marginalisés dans l'exercice de la protection juridique.
Cette situation n'est pas satisfaisante pour au moins deux raisons.
Tout d'abord, l'avocat est souvent absent de la phase amiable du litige, alors qu'il peut apporter une aide précieuse à ce stade tout en garantissant indépendance et secret professionnel.
Ensuite, le marché de l'assurance de protection juridique est capté par quelques professionnels liés aux réseaux des assureurs.
En effet, en dépit du libre choix théorique de l'avocat par l'assuré, ce dernier est le plus souvent désigné par la société d'assurance, qu'elle soit mutualiste ou non.
Une telle situation place inéluctablement l'avocat dans une situation de subordination à l'égard des assureurs.
Enfin, les assureurs manifestent certaines réticences quand il s'agit de faire jouer la garantie, notamment au regard des délais de déclaration de litiges par les assurés.
Cette situation provoque des mécontentements, voire des déceptions chez les assurés quant aux garanties auxquelles ils croient pouvoir prétendre ; mais elle suscite aussi la légitime frustration des avocats, profession qui se sent injustement écartée d'un secteur d'activité pourtant de plus en plus utile.
C'est la raison pour laquelle, avec plusieurs de mes collègues, j'ai pris l'initiative de déposer cette proposition de loi, identique à celle qu'a présentée tout à l'heure notre collègue M. Zocchetto.
Il m'a en effet paru essentiel de clarifier les conditions dans lesquelles la garantie d'un contrat peut être engagée : c'est le sens de l'article 1er ; d'encadrer les moyens de recommandation d'un avocat à l'assuré : c'est l'objet de l'article 2 ; enfin, de réviser le régime de fixation des honoraires de l'avocat pour garantir une réelle liberté de choix de l'avocat par l'assuré, conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusives du 21 février 2002, c'est ce à quoi tend l'article 3.
L'article 1er clarifie d'abord les motifs de déchéance de la garantie du contrat en déterminant le point de départ de la déclaration du sinistre et sa définition : « Est considéré comme sinistre [...] le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. » Le point de départ de la déclaration du sinistre correspond donc à la date à laquelle il est constitué, et ce pour éviter une déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive, comme cela arrive fréquemment.
Dans ce même article, les obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré avant la déclaration de sinistre sont codifiées. En effet, le droit en vigueur n'apporte aucune précision sur ce point, et des pratiques défavorables à l'assuré se sont développées à la faveur de ce vide juridique. Ainsi, toute clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de consultation ou d'actes de procédure antérieurs à la déclaration du sinistre sera interdite. Cependant, dans un souci d'équilibre, et pour limiter les conséquences financières de ces consultations pour l'assurance, il est précisé que celles-ci sont exclues de la prise en charge au titre de la garantie. Une situation d'urgence pourra néanmoins être invoquée pour tenir compte des cas où l'assuré doit agir sans délai pour protéger ses intérêts, comme cela peut se produire en cas de comparution immédiate.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 1er définit les conditions dans lesquelles l'intervention de l'avocat est obligatoire. Il est destiné à assurer une égalité entre les parties en litige et une confidentialité de leurs échanges favorable à la conclusion d'une éventuelle transaction.
L'article 2 clarifie les modalités du choix de l'avocat par l'assuré pour rendre plus effective cette faculté - cette liberté, surtout. Ainsi, l'orientation vers l'avocat recommandé par l'assureur sur la seule demande écrite de l'assuré permettra d'établir avec certitude que la désignation faite par ce dernier procède de son choix délibéré. Autrement dit, la proposition par les sociétés d'assurance du nom d'un avocat à l'assuré « sans demande écrite de sa part » sera tout simplement interdite.
Enfin, l'article 3 clarifie les relations entre l'assureur et son client lorsque celui-ci a recours à l'assurance de protection juridique.
En effet, la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires d'avocat sont fixés en accord avec le client. Cette règle participe d'une manière essentielle du caractère libéral de la profession d'avocat. Aussi, la prédétermination d'un plafond d'honoraires ou de toute autre convention d'honoraires entre l'avocat et l'assureur sera interdite pour éviter toute situation de conflit d'intérêts entre l'assureur et son client.
Cette disposition ne remet pas en cause la possibilité pour les assureurs de fixer des limitations contractuelles au remboursement des honoraires des avocats. Elle permet néanmoins d'exclure tout lien de subordination de l'avocat à l'égard de l'assureur, ce qui me paraît être une mesure d'équité pour cette profession.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi répond, par des ajustements techniques au droit en vigueur, aux recommandations de la Commission des clauses abusives. Elle répond aussi à l'affirmation, répétée avec constance par la commission des lois du Sénat, de la nécessité de réformer l'assurance de protection juridique. Elle tend surtout à offrir aux citoyens un nouveau mode d'accès au droit et à la justice, avec une plus grande transparence dans les contrats et une meilleure implication des avocats dans le règlement des litiges. Enfin, elle répond à un réel besoin de révision de notre législation face à une évolution de notre société qui voit se multiplier les contentieux auxquels ont à faire face les Français dans leur vie quotidienne. Aussi, j'espère que le Sénat soutiendra ce texte.
Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement notre collègue Yves Détraigne de son rapport remarquable et de ses propositions, auxquelles je souscris pleinement et auxquelles s'associera le groupe UMP.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les conclusions de la commission des lois sur les propositions de loi de nos collègues François Zocchetto et Pierre Jarlier relatives, l'une et l'autre, à l'assurance de protection juridique.
L'objet de ces textes est de clarifier les relations entre l'assuré, l'avocat et l'assureur en cas de litige, car, si des principes sont effectivement inscrits dans le code des assurances, les assureurs n'hésitent pas à introduire dans leurs contrats des clauses abusives.
Les dispositions relatives à l'assurance de protection juridique sont prévues aux articles L. 127-1 et suivants du code des assurances et sont issues de la transposition de la directive 87/344/CEE du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance de protection juridique.
L'article L. 127-1 définit la protection juridique comme une « opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers [...] ».
En pratique, la protection juridique se traduit par deux types de prestation : d'une part, un service de renseignements juridiques par téléphone ouvert aux assurés souhaitant être informés de leurs droits et des démarches à accomplir, et, d'autre part, un service de défense des intérêts de l'assuré en conflit avec une autre partie.
Dans ce second cas, qui est celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les services juridiques de l'assurance, l'avocat de la compagnie ou bien celui qui est désigné par l'assuré prendront en charge la défense des intérêts de l'assuré. Or, si le champ d'action de la protection juridique est vaste - il concerne les litiges liés à la consommation, au droit du travail, ou encore avec l'administration -, en revanche, la prise en charge, notamment pour ce qui est des frais et des honoraires d'avocats, est fort limitée. Suivant les contrats, le plafond des prestations prises en charge varie de 80 000 à 300 000 euros.
Dans le strict respect des droits de la personne et de sa défense, l'assurance de protection juridique est donc un moyen d'accès au droit.
Environ un foyer sur cinq est couvert par une assurance de ce type. Les sinistres déclarés restent cependant encore peu nombreux eu égard au nombre de contrats souscrits : en 2002, les treize sociétés membres du Groupement des sociétés de protection juridique annonçaient gérer 450 000 dossiers, pour un peu plus de 9 millions de clients. En pratique donc, peu d'assurés y ont recours.
Les assureurs cherchent bien évidemment à satisfaire leurs clients et à donner une bonne image de cette garantie, dans un marché en plein essor. Néanmoins, ils ne perdent évidemment pas de vue les questions de rentabilité économique, ce qui les conduit parfois à introduire dans leurs contrats des règles limitant leurs engagements, voire des clauses purement et simplement abusives.
C'est ce qu'a pu constater la Commission des clauses abusives : elle a relevé, dans sa recommandation n° 02-03 du 21 février 2002, un certain nombre de pratiques contestables et abusives des sociétés d'assurance.
Il a notamment été constaté que certaines clauses restreignent la liberté de choix de l'avocat, prévoient de déchoir de la garantie l'assuré qui a saisi un avocat sans avoir préalablement déclaré le sinistre, c'est-à-dire consulté le spécialiste de l'assureur, sans que l'assureur ait à justifier d'un préjudice, ou encore refusent au consommateur le choix de son avocat si les honoraires de celui-ci ne sont pas préalablement acceptés par l'assureur.
Les auteurs des deux propositions de loi citent à juste titre, dans leur exposé des motifs, cette recommandation de la Commission des clauses abusives. Ils reprennent donc en partie les quelques remarques que je viens de formuler afin de modifier le code des assurances.
Les propositions de loi visent essentiellement à clarifier les relations entre les assurés, les assureurs et leurs avocats. Cette clarification est nécessaire : nous ne pouvons en effet admettre que des clauses restreignant les droits des assurés et limitant leur possibilité de se défendre correctement soient inscrites dans les contrats d'assurance de protection juridique.
Plusieurs principes sont ainsi énoncés dans les propositions de loi initiales : la généralisation du recours à l'avocat, et ce à toutes les phases de la procédure, lorsque la partie adverse est elle-même défendue par un avocat ; l'encadrement de la pratique des assureurs tendant à suggérer aux assurés le nom d'un avocat ; enfin, la prohibition de tout accord entre l'assureur et l'avocat sur les honoraires de celui-ci.
Hormis quelques modifications rédactionnelles bienvenues, le rapporteur a repris dans ses conclusions les termes des deux propositions de loi initiales. Il nous propose également de les compléter et de coordonner le code de la mutualité avec le code des assurances, ce qui est effectivement une bonne chose ; d'affirmer le caractère subsidiaire de l'aide juridictionnelle - c'est là, monsieur le rapporteur, que le bât blesse - ; enfin, de prévoir que le remboursement par la partie perdante des frais et honoraires exposés par l'assuré reviendra prioritairement à ce dernier.
Néanmoins, le champ d'application du texte reste restreint par rapport aux nombreuses observations de la Commission des clauses abusives : il vise quasi exclusivement les relations entre l'assuré, son avocat et l'assureur. Pourtant, de nombreuses pratiques contestables auraient mérité d'être empêchées par la loi, pratiques que ladite commission considère soit comme abusives, soit comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La Commission des clauses abusives recommande donc que soient éliminées des contrats d'assurance de protection juridique, outre les dispositions concernant le choix de l'avocat, les clauses ayant pour objet ou pour effet « de laisser croire au consommateur qu'il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi » ; « d'imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie, ?l'origine du sinistre? comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre par l'assuré » ; « de laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, sans que l'assureur ait à justifier d'un préjudice ». Mais je ne vais pas énumérer toutes les recommandations, elles sont trop nombreuses.
Les pratiques fort abusives ainsi relevées par la Commission des clauses abusives semblent tout aussi fréquentes lorsqu'il s'agit des relations entre l'assuré et la société d'assurance de protection juridique elle-même.
Nous regrettons donc que les deux propositions de loi initiales se limitent à encadrer plus strictement, bien que ce soit nécessaire, les pratiques des assureurs à l'encontre de leurs assurés en ce qui concerne la seule liberté de choix de leur avocat.
Vous avez manifestement tenté, monsieur le rapporteur, de combler cette lacune et de compléter les protections accordées aux assurés en inscrivant à l'article 4 que « le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées ». Cet ajout constitue un progrès ; mais, compte tenu du nombre important d'abus constatés, il nous semble bien insuffisant.
Par ailleurs, je m'interroge sur le risque que, à terme, l'assurance de protection juridique ne vienne se substituer à l'aide juridictionnelle. Vous avez clairement évoqué cette possibilité, monsieur le rapporteur, en indiquant que l'assurance de protection juridique pouvait constituer un utile « relais » par rapport à l'aide juridictionnelle « d'un poids croissant dans le budget de l'État ».
Encore une fois, et pour des raisons liées à la réduction du déficit budgétaire, ce sont donc les droits des citoyens les plus modestes qui pourraient être remis en cause. Est-il nécessaire, pourtant, de rappeler que les contrats d'assurance juridique ne sont pas gratuits ? Même si les contrats de base coûtent en moyenne entre 55 et 60 euros par an, cette dépense est souvent non prioritaire pour un foyer modeste. Doit-il pour autant renoncer à défendre correctement ses droits dans un litige ? L'aide juridictionnelle est justement réservée à ces cas !
En la voyant ainsi inscrire le principe selon lequel « l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection » à l'article 2, et non plus à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, et préciser dans la loi que les contrats d'assurance de protection juridique pourraient se substituer à l'aide juridictionnelle, je suspecte la majorité de vouloir remettre en cause, à l'avenir, l'aide juridictionnelle.
Protestations sur les travées de l'UMP.

Ma conclusion sera donc brève : bien qu'il apporte des clarifications nécessaires, le texte retenu par la commission ne répond pas suffisamment aux nombreuses critiques émises tant par les associations de consommateurs que par la Commission des clauses abusives et qui sont liées au manque de transparence et de lisibilité des contrats d'assurance juridique, défaut qui risque d'ailleurs de favoriser une augmentation importante de ces contrats.
Surtout, et c'est ce qui motive notre position, la majorité sénatoriale ne semble pas exclure de faire de l'assurance de protection juridique un substitut à l'aide juridictionnelle, à laquelle nous sommes, nous, profondément attachés et qui risque de tomber en désuétude au nom de restrictions budgétaires, et de généraliser ainsi l'assurance privée pour l'accès au droit, voire de la rendre obligatoire. Dans ces conditions, nous nous abstiendrons sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Madame Mathon-Poinat, je ne voudrais pas que ceux qui liront ces débats accordent le moindre crédit à votre assertion : l'assurance de protection juridique ne peut bien évidemment pas se substituer à l'aide juridictionnelle, car il s'agit ici d'assurés, c'est-à-dire de personnes qui ont les moyens de payer une police d'assurance. Or, l'aide juridictionnelle est précisément prévue pour ceux qui, par définition, n'ont pas les moyens de s'assurer une couverture juridique puisqu'ils ont besoin de l'aide de l'État pour trouver un défenseur.
Il s'agit par conséquent de deux dispositifs différents mais complémentaires qui ne peuvent pas se substituer l'un à l'autre.
Je voulais apporter cette précision pour lever toute ambiguïté au cas où il y aurait un doute dans les esprits, mais c'est peu probable.
Après l'article L. 127-2 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 127-2-1 à L. 127-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-2-1. -- Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.
« Art. L. 127-2-2. -- Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
« Art. L. 127-2-3. -- L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. »

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Othily et Mouly.
L'amendement n° 9 est présenté par M. Cambon, Mmes Gousseau et Procaccia.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2-1 du code des assurances :
« Art. L. 127 -2 -1 - Au sens du présent chapitre, le sinistre est constitué lorsque l'assuré a connaissance d'un différend ou d'un litige ou d'une situation pouvant les générer et la garantie de l'assureur ne pourra être acquise que pour un événement dont le fait générateur est postérieur à la souscription du contrat.
La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 3 rectifié.

Cet amendement vise, d'une part, à maintenir dans la définition du sinistre le principe d'ordre public d'aléa sans lequel le contrat d'assurance de protection juridique ne serait plus un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du code civil. Le mot « refus » est supprimé, car il permet à l'assuré de dater lui-même le sinistre et, de ce fait, l'intervention de l'assureur ne dépend plus d'un événement incertain.
Il vise, d'autre part, à permettre à l'assuré de bénéficier le plus en amont possible des prestations offertes par son assureur de protection juridique. En effet, une simple situation contraire aux intérêts de l'assuré peut constituer à elle seule un motif de déclaration de sinistre et donc une intervention de l'assureur.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 9.

Monsieur le garde des sceaux, je voudrais profiter de la présentation de cet amendement pour attirer l'attention du Gouvernement sur les inquiétudes que suscitent les dispositions qui nous sont proposées chez tous ceux qui font de l'assurance juridique et proposent ce type de contrat, et pas seulement les assureurs, représentés au sein de la Fédération française des sociétés d'assurances, la FFSA, ou du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, le GMA, mais aussi les banquiers - nous avons entendu hier le Crédit mutuel, qui fait lui aussi de l'assurance juridique.
Il est certain que la proposition de loi qui résultera de nos travaux va perturber la vie d'un produit dont je ne dirai pas comme les assureurs qu'il fonctionne très bien, mais qui donne relativement satisfaction.
Il est normal que les avocats veuillent intervenir davantage dans la mesure où il s'agit de problèmes juridiques, mais j'attire votre attention sur les 3 000 salariés qui travaillent sur les plates-formes juridiques et qui, eux aussi, sont inquiets des modifications que ce nouveau texte pourrait entraîner sur l'emploi.
Je souhaite que vous puissiez les rassurer et trouver les modalités nécessaires de telle sorte que chacun puisse continuer à travailler.
J'ai lu avec beaucoup d'attention cet article 1er et j'approuve quasiment toutes les dispositions qui y sont prévues, car il apporte des précisions utiles pour l'assuré, en particulier sur les consultations qui sont réalisées avant la déclaration du sinistre et qui seraient désormais prises en charge, et sur la possibilité de l'assistance d'un avocat quand la partie adverse a elle-même un avocat. Ce sont des éléments importants pour l'assuré.
En revanche - c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement - l'article 1er méconnaît un principe de base du mécanisme de l'assurance, puisqu'il occulte complètement la notion d'aléa. Or, vous le savez tous, l'assurance ne fonctionne que sur ce principe.
Je souhaite que l'on revienne sur cette notion d'aléa et que l'on puisse trouver une définition qui corresponde à l'esprit de la loi, mais dans le respect des principes de base de l'assurance.

Ces amendements visent à revenir sur la définition claire du sinistre que l'on veut donner ici. Or cette notion est très importante, parce que c'est avec la connaissance précise de la date du sinistre que l'on peut déterminer le point de départ du délai dans lequel l'assuré va faire sa déclaration.
Les amendements proposés, qui, certes, redonnent une part d'aléa à la définition du sinistre, réintroduisent l'insécurité juridique et le flou dont cette proposition de loi vise précisément à sortir. En effet, on consacrerait un véritable déséquilibre dans les moyens respectifs dont disposent l'assuré et l'assureur pour la définition précise du sinistre.
Par conséquent, compte tenu du fait que l'on revient d'une certaine manière à la case départ, que l'on réintroduit le flou et que l'on rouvre la possibilité pour l'assureur d'opposer très facilement, trop facilement, la déchéance de garantie à l'assuré, la commission émet un avis défavorable.
Je répondrai aux préoccupations exprimées par les auteurs de ces amendements, mais je précise d'emblée que le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission. Je voudrais m'en expliquer très clairement, car un certain nombre d'assureurs ont émis des craintes qui ne me semblent pas fondées.
La Commission des clauses abusives a dénoncé en 2002 les contrats d'assurance de protection juridique qui imposaient à l'assuré de déclarer le sinistre « dès son origine » à peine de déchéance. En effet, il faut penser aux cas où la lente genèse d'un sinistre peut rendre difficile la détermination de sa date de naissance. De nombreux procès en matière de voisinage, de construction ou de droit du travail, ont une origine ancienne et quelquefois nébuleuse. En imposant à son client de déclarer le sinistre dès son origine, l'assureur se réserve en pratique la possibilité de prononcer la déchéance de garantie à sa guise.
Ce qu'interdit la Commission des clauses abusives, le présent amendement aboutit à le rétablir. En imposant à l'assuré de déclarer à l'assureur le litige « dès qu'il a connaissance d'une situation pouvant le générer », il autorise ce que la jurisprudence était parvenue à proscrire et revient ainsi sur un acquis fondamental en faveur des droits de l'assuré.
Indépendamment même de la régression du droit des consommateurs, cette rédaction serait contestable juridiquement. En effet, dès lors que l'assureur pourrait en pratique décider souverainement de sa propre garantie, c'est à son égard que le contrat serait dépourvu d'aléa, sans lequel, comme vous le souligniez, il n'est pas de contrat d'assurance. L'aléa est pour tout le monde : pour l'assuré et pour l'assureur.
Le texte de la commission des lois est, pour sa part, parfaitement fondé juridiquement et conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives. Il vise à définir le sinistre au premier instant où le litige est cristallisé.
C'est une solution équilibrée pour les parties et c'est la seule qui prenne en compte un événement que l'on puisse précisément dater. Elle préserve, par ailleurs, les intérêts légitimes des assureurs en leur permettant de soulever la fraude - c'était votre objection, madame le sénateur - dès lors qu'un assuré aurait souscrit un contrat de protection juridique après la survenance d'un litige.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de rejeter ces amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Othily et Mouly, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2-3 du code des assurances :
« Art. L. 127 -2 -3 - L'assureur se doit d'accepter la demande d'un assuré d'être assisté ou représenté par un avocat lorsque la partie adverse l'est elle-même. »
La parole est à M. Georges Othily.

Cet amendement vise, d'une part, à replacer l'assuré au coeur du dispositif de l'assurance de protection juridique. En supprimant le caractère systématique de la mesure, l'assuré conserve en effet la liberté de choix d'être assisté ou non d'un avocat.
Il permet, d'autre part, de ne pas faire peser de contraintes financières sur l'assuré, ce qui serait le cas si ce dernier avait l'obligation d'être représenté par un avocat, car les honoraires pourraient être supérieurs au montant de la garantie prévu au contrat de protection juridique.

Cet amendement vise à revenir sur la disposition que la proposition de loi a introduite à l'article L. 127-2-3 du code des assurances en prévoyant que l'assuré doit être « assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. »
L'amendement prévoit un dispositif alternatif qui est moins protecteur des intérêts de l'assuré que le dispositif proposé par la commission et par les auteurs des deux propositions de loi. C'est une formule qui apparaît en retrait et qui « romprait l'égalité des armes », pour reprendre l'expression employée lors de la discussion générale, que nous souhaitons mettre en oeuvre au travers de cette disposition.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable.
L'objet de cet amendement est de rendre facultative l'intervention d'un avocat aux côtés de l'assuré quand bien même un avocat assisterait la partie adverse. L'assureur ne serait tenu en pareille hypothèse que d'informer son client de la possibilité de prendre un avocat.
Une telle rédaction ne changerait pas l'état du droit applicable puisque le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques des avocats oblige déjà ces derniers à recommander à l'adversaire de leur client de prendre un avocat. Il est inutile d'amener l'assureur à dire à son client ce que ce dernier s'est déjà vu proposer par l'avocat de son adversaire.
Plus fondamentalement, je ne souscris pas à l'amoindrissement de la protection de l'assuré qu'implique cet amendement.
La rédaction qui est proposée par la commission des lois s'appuie sur la règle salutaire selon laquelle un avocat ne doit transiger en principe qu'avec un de ses confrères.
Laisser l'assureur assister son client et prendre attache directement avec l'avocat adverse est dangereux, et ce pour deux raisons.
Si qualifiés que soient les rédacteurs des sociétés d'assurances, ils ne sont jamais aussi rompus à la négociation que les avocats, ne serait-ce que parce qu'ils n'interviennent qu'en phase précontentieuse.
Surtout, leur assistance à la transaction est affectée d'une faiblesse irrémédiable : entre un assureur et un avocat, il n'est pas de confidentialité qui tienne. Cela signifie que l'avocat adverse a tout intérêt à laisser l'assureur faire des concessions et amoindrir ses demandes, sans jamais conclure de transaction. Ces propositions transactionnelles, l'avocat les produira par la suite devant le juge pour démontrer combien l'adversaire était prêt de lui-même à réduire ses demandes. C'est la règle, et un avocat qui n'utiliserait pas les meilleures stratégies, dont celle-ci, pour défendre les intérêts de son client, encourrait la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est indispensable qu'un assureur ne puisse pas se charger seul du dossier de son client pour le défendre face à un avocat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
L'article L. 127-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. » -
Adopté.
Après l'article L. 127-5 du même code, il est inséré un article L. 127-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127 -5 -1. -- Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. »

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 rectifié est présenté par MM. Othily et Mouly.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Cambon, Mmes Gousseau et Procaccia.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5-1 :
« Art. L. 127 -5 -1 - Quel que soit l'avocat choisi, l'assuré signe préalablement à l'engagement de toute action amiable ou contentieuse une convention d'honoraires précise. Le règlement des sommes dues, dont les honoraires d'avocat, incombant à l'assureur de protection juridique intervient dans des conditions et limites contractuelles identiques quel que soit l'avocat choisi sur présentation des justificatifs et de la convention d'honoraires. »
La parole est à M. Georges Othily, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié.

La possibilité de négociation est un acte normal de gestion optimisée d'une mutualité dans l'intérêt même des consommateurs. C'est en tenant compte de la mutualité de ses assurés que l'assureur peut maîtriser le rapport « montant des primes/montant des sinistres ». Si cette possibilité disparaît, l'absence de maîtrise des coûts du produit d'assurance se traduira par un renchérissement de la cotisation, dont le surcoût sera bien évidemment supporté par les consommateurs.
L'interdiction de négociation constituerait une entorse au principe de la liberté d'entreprendre. L'interdiction faite à deux professionnels de négocier le coût des prestations ne semble pas compatible avec le principe de la liberté contractuelle.
En revanche, les assureurs partagent les préoccupations des pouvoirs publics, à savoir que le libre choix de l'avocat par l'assuré s'exerce dans des conditions d'information complètes et qu'il ne puisse exister aucune discrimination dans l'application du contrat selon l'avocat choisi.
L'assuré ne peut s'engager sans connaître le coût de la prestation. L'information complète de l'assuré pour exercer son libre choix de l'avocat nécessite qu'il connaisse le complément d'honoraires qu'il supportera personnellement au-delà du montant de la garantie prévue dans le contrat d'assurance.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 10.

Je souscris sans réserve à l'argumentaire de M. Othily. Pour ma part, j'ai déposé cet amendement afin de défendre les intérêts des assurés, et non pas ceux des assureurs ou des avocats.
En effet, interrogeons-nous un instant sur les conséquences du principe de non-négociation. Nombreuses sont les personnes qui ne fréquentent pas des avocats tous les jours et qui n'ont pas l'habitude d'aller en justice. Elles pourraient être tentées de choisir un avocat connu et célèbre, sans avoir la moindre idée des honoraires qui leur seront demandés. Bon nombre d'entre nous ignorent le montant des honoraires que prennent les avocats pour assurer la défense d'un client lors d'un procès, encore que nombreux avocats siègent dans cette enceinte. Les assurés risquent ainsi d'accepter les honoraires d'un avocat sans savoir que l'assureur ne les prendra en charge que dans la limite du plafond et qu'ils devront supporter le solde. Un assureur ne peut en effet accepter, pour des affaires similaires, des honoraires de 5 000 euros dans un cas et de 15 000 euros dans l'autre. Les assurés seront donc perdants.
Les associations de consommateurs s'inquiètent de cette pratique qui ne protégera pas les assurés. Dans quelques jours, elles tiendront d'ailleurs une conférence de presse conjointe avec les assureurs.
Je crains, si cet article était adopté dans la rédaction actuelle, que nous n'allions au-devant de vraies difficultés. Des assurés risqueraient en effet de supporter des charges financières importantes liées au règlement d'un sinistre alors que, si la négociation était possible, ou s'ils pouvaient bénéficier d'un conseil sur le montant des honoraires, cela ne se produirait pas.

Les amendements n° 5 rectifié et 10 visent à revenir sur l'interdiction de tout accord sur le montant des honoraires entre l'assureur et l'avocat. Or cet article, comme l'ensemble de la proposition de loi, tend à moraliser et à clarifier cette pratique.
Comme je l'ai déjà indiqué lors de la discussion générale, la plupart de nos concitoyens n'ont pas, et heureusement ! d'avocat attitré. L'assureur ne pourra plus imposer son avocat. Toutefois, lorsque la partie adverse sera représentée par un avocat, il y a fort à parier que la plupart des assurés demanderont à leur assureur - par écrit, comme le prévoit la proposition de loi - de les aider à trouver un avocat. Le risque de dérive me paraît donc très limité.
Nous assisterons sans doute à un élargissement de la gamme des contrats d'assurance de protection juridique. Les primes de certains contrats seront probablement plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui. En tout état de cause, l'assuré choisira lui-même son avocat et connaîtra le montant de la prime qu'il devra acquitter au titre de son contrat de protection juridique. Les réformes, les modifications, les clarifications et les rappels qui sont faits dans cette proposition de loi ne feront pas exploser le système : l'assuré aura toujours accès aux contrats de protection juridique.
Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, la commission est défavorable à ces amendements identiques.
La commission des lois propose à juste titre d'interdire aux assureurs de plafonner les honoraires des avocats qu'ils recommandent.
Les deux amendements tendent à y substituer une obligation faite aux avocats de proposer une convention d'honoraires.
Il ne faut pas résoudre un problème en déplaçant le projecteur sur un autre. Le code des assurances est fait pour régir les contrats d'assurance et non pas la pratique professionnelle des avocats.
J'ajoute que les modalités de fixation des honoraires sont déjà détaillées dans le décret du 12 juillet 2005 sur les règles déontologiques de la profession d'avocat. Ce décret préconise la signature d'une convention d'honoraires et fixe les règles permettant en tout état de cause à ceux-ci d'être prévisibles, et ce sous le contrôle du bâtonnier et du juge.
S'agissant des contrats de protection juridique, le problème est identifié. Pour être l'avocat recommandé par l'assureur, ce qui garantit un apport d'affaires régulier et important, il faut respecter deux conditions qui sont incompatibles avec le mode libéral de l'exercice de la profession d'avocat : ne pas fixer d'honoraires au-delà du montant de la garantie et, d'une manière générale, veiller à ne pas coûter trop cher à l'assureur. Bref, mieux vaut plaire à l'assureur qu'à son client !
L'avocat de réseau est ainsi amené à plafonner ses honoraires à des montants que ses confrères ne peuvent concurrencer, car eux ne bénéficient pas en contrepartie du flux d'affaires apporté par l'assureur. Cette rémunération, artificiellement basse, permet certes à l'assuré de ne pas payer d'honoraires complémentaires, mais elle pervertit fondamentalement le principe essentiel du libre choix, puisque aucun avocat ne peut être en mesure de proposer des honoraires aussi bas que celui de l'avocat de réseau.
En outre, l'avocat de réseau est placé en situation de conflit d'intérêts. Il est amené à veiller aux intérêts de l'assureur quand il ne devrait se préoccuper que de ceux de son client. Or, l'intérêt de l'assureur ne se confond pas avec celui de son client, au contraire, puisque le premier doit limiter les coûts de procédure, alors que le second veut employer tous les moyens légaux pour faire prévaloir ses droits.
Le système ne peut ainsi fonctionner qu'en sollicitant en permanence les qualités déontologiques de l'avocat. Il est indispensable de clarifier les relations entre les acteurs de l'assurance et d'empêcher que l'avocat n'entre dans une relation de salariat de fait avec l'assureur.
Les deux amendements aboutiraient à maintenir une telle relation et c'est pourquoi je demande au Sénat de ne pas les adopter.

Je ne connais pas d'avocat de réseau ni d'avocat privé. Vous nous avez brossé un portrait pour le moins négatif de l'avocat qui traite avec une compagnie d'assurance et qui n'aurait d'autre objectif que de plaire à la compagnie au lieu d'essayer de défendre l'assuré.
Je pense que les avocats, comme les médecins, doivent respecter une déontologie : les médecins soignent leurs patients et les avocats défendent leurs clients, quel que soit le mandat qu'on leur a accordé.
En outre, les réponses de M. le garde des sceaux et de M. le rapporteur portent sur la relation entre l'assureur et l'avocat. M. Détraigne explique dans son rapport qu'ils ne peuvent pas s'entendre puisqu'il s'agit de deux métiers distincts qui fonctionnent selon deux modes très différents. C'est sans doute la raison pour laquelle aucune négociation n'a abouti depuis maintenant trois ans.
J'ai été, la semaine dernière, rapporteur de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de modernisation du dialogue social. Je regrette que des partenaires ne parviennent pas à dialoguer et qu'il faille légiférer.
Ce qui m'importe, c'est l'intérêt de l'assuré. Si cette proposition de loi est adoptée, l'assuré verra le montant de sa prime augmenter. La compagnie d'assurance aura toujours des contrats qu'il ne pourra pas vraiment négocier. M. Détraigne a reconnu que les primes des contrats seraient plus élevées. Or, l'objectif de la proposition de loi est non pas de majorer les contrats, mais de rendre l'assurance plus accessible. Je regrette donc que l'assuré soit en partie oublié.

Mes chers collègues, il n'y a pas lieu de se jeter à la figure la moralité de telle ou telle profession.
Le libre choix de l'avocat est un principe intangible. Or, dans la pratique, ce principe n'était pas respecté. Bien souvent, en effet, les avocats étaient imposés.
L'assuré pourra continuer de choisir l'avocat que lui proposera sa compagnie d'assurance. Il est vrai, madame Procaccia, que beaucoup de gens ne fréquentent pas des avocats tous les jours. La proposition de loi comporte des dispositions afin qu'ils puissent prendre l'avocat que leur proposera leur assureur.
En revanche, le client doit aussi pouvoir librement choisir son avocat. Il connaîtra ses honoraires et saura dans quelle limite il sera remboursé. À en croire de nombreux rapports, le système sera plus sain. Ce sera profitable à l'assurance de protection juridique. Si l'on améliore le système, je suis convaincu que des assurés accepteront de payer un peu plus. Aujourd'hui, ces contrats ne sont pas très onéreux, mais comme la protection est de toute façon extrêmement faible, on ne peut même pas s'en servir. Il faut donc équilibrer le système actuel.
Comme vous l'avez rappelé, madame Procaccia, certaines négociations n'ont pas abouti. Je puis vous dire, après avoir lu plusieurs rapports sur ce sujet, que, si ces négociations n'ont pas abouti, c'est que certaines parties avaient la ferme volonté de ne pas progresser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes obligés de légiférer.
Alors, de grâce, toutes les causes ne sont pas défendables ! D'ailleurs, certains articles sont parus dans la presse que j'ai trouvés très désagréables. Nul ne doit préjuger des décisions du Parlement, à qui il revient de faire la loi. En l'occurrence, il lui appartient de rétablir un équilibre qui n'aurait jamais dû disparaître. Je suis convaincu que cela servira à la fois aux assurés, aux assureurs et aux avocats.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 3 est adopté.

L'amendement n° 8, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 1384 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si les compagnies d'assurances ou les mutuelles prétendent partager les responsabilités alors qu'aucune faute n'a été retenue, cet accord est nul. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Après l'article L. 127-7 du même code, il est ajouté un article L. 127-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-8. -- Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées. » -
Adopté.
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 3-1 est supprimé. -
Adopté.
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 224-2, sont insérés trois articles L. 224-2-1 à L. 224-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-2-1. -- Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont le membre participant est l'auteur ou le destinataire.
« Art. L. 224-2-2. -- Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou l'union, sauf si le membre participant peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
« Art. L. 224-2-3. -- Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. » ;
2° L'article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part. » ;
3° Après l'article L. 224-5, il est inséré un article L. 224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5-1. -- Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union. » ;
4° Après l'article L. 224-7, il est ajouté un article L. 224-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-7-1. -- Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à la mutuelle ou à l'union dans la limite des sommes qu'elle a engagées. ». -
Adopté.

L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après les mots : « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigée : « ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. »
II. Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. »
III. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement vise à permettre aux personnes qui contestent un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, d'être assistées par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Actuellement, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique impose aux personnes de nationalité étrangère, non ressortissantes de l'Union européenne, une condition de résidence habituelle et régulière pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, sauf dans certaines procédures, comme le recours contre un arrêté de reconduite à la frontière.
Or le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire a vocation à se substituer à l'arrêté de reconduite à la frontière.
Il était donc nécessaire de prévoir, comme en cas de recours contre un tel arrêté, la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle sans condition de résidence à l'occasion d'un recours dirigé contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, les recours dirigés contre des refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français doivent être jugés dans un délai de trois mois, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il était donc nécessaire de déroger aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991, qui permettent de demander l'aide juridictionnelle pendant l'instance, en prévoyant de déposer une telle demande au plus tard lors de l'introduction du recours.
Cette dérogation étant propre au recours dirigé contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il est apparu préférable de l'introduire dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'amendement tire enfin les conséquences de la codification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en faisant référence, à l'article 3 de la même loi, aux dispositions de même nature qui iront dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, dont l'adoption permettra aux justiciables qui contestent un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français d'être assistés par un avocat rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui est une bonne chose.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
I. - Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, au vice-président du tribunal des conflits, au président de la commission de recours des réfugiés ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. »
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. »
III. - Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement uniformise le régime juridique des voies de recours contre les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle.
En effet, en l'état actuel du droit, le demandeur ne dispose d'aucun recours pour contester la décision de refus ou d'admission partielle qui lui a été opposée pour un motif lié au montant de ses ressources. En revanche, un recours est ouvert quand l'aide juridictionnelle est refusée pour un motif juridique.
Cette dualité des voies de contestation est régulièrement dénoncée par les justiciables et les avocats, car elle ne reposerait sur aucun impératif légitime.
En vue d'harmoniser également les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle au sein d'un même ressort, il est apparu nécessaire de porter l'examen des recours au niveau des juridictions du second degré des ordres judiciaire et administratif.
En revanche, les recours contre les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Commission de recours des réfugiés demeurent de la compétence de ces juridictions.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application des dispositions prévues par le présent amendement.

Cet amendement tend à simplifier les règles applicables aux voies de recours, en les unifiant, quel que soit le motif de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle, ce qui va dans le sens d'un meilleur accès à la justice et rend plus lisibles les règles de procédure applicables à l'aide juridictionnelle. Une telle proposition est conforme à la philosophie du texte que nous examinons aujourd'hui.
La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 1.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 64-3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Art. 64 -3 - L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
« Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée, sans son accord, de ce placement.
« L'État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement vise à tirer les conséquences, en matière d'aide juridique, de la réforme de la procédure d'isolement des détenus introduite par deux décrets du 21 mars 2006.
Cette réforme a permis aux détenus de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de l'audience préalable à la décision d'une mesure de placement d'office à l'isolement et de prolongation de cette mesure ou à l'occasion d'une demande de levée d'un placement en isolement.
Les dispositions actuelles de la loi du 10 juillet 1991 ne permettent pas de rétribuer l'avocat prêtant son concours au détenu dans ce type de procédure. Il était donc nécessaire de compléter les dispositions de l'article 64-3 de cette loi, afin de poser le principe du droit à rétribution de cette mission qui n'est aujourd'hui pas indemnisée.

À plusieurs reprises, la commission des lois a regretté, notamment dans le cadre de ses avis budgétaires, que certaines missions ne soient pas rémunérées au titre de l'aide juridictionnelle. Elle ne peut donc que se réjouir de l'amendement proposé par le Gouvernement, lequel vise à permettre la rétribution de l'avocat qui prête son concours à un détenu faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office lors de l'audience préalable à la décision.
La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 6.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ratifiée.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. En toute modestie, je pense que, avec cet amendement, je finis en beauté !
Sourires

Nous ne pouvons que nous féliciter que la commission des lois soit saisie pour examiner la ratification d'une ordonnance relative à un texte qui, précisément, la concerne.
C'est vrai ! Cela n'arrive pas souvent !

Bien évidemment, la commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 2.

En effet, cela n'arrive pas souvent, et c'est pour cette raison que nous vous félicitons, monsieur le garde des sceaux. Cette configuration a permis à la commission des lois de vérifier que votre ordonnance était parfaitement conforme à ce que nous souhaitions. Je rappelle en effet que le texte ne se transforme en texte de loi que le jour de sa ratification.
Le jour où il est déposé sur le bureau de l'assemblée !

En revanche, monsieur le garde des sceaux, je ne vous adresse pas mes félicitations au sujet de la ratification de l'ordonnance relative aux sûretés qui, parce qu'elle figure au sein d'un texte intéressant la Banque de France, ne sera même pas présentée à la commission des lois !
L'amendement est adopté.

La proposition de loi est adoptée.
(Ordre du jour réservé)

L'ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 25 de Mme Gisèle Gautier à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité relative au bilan d'application de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre des mineurs.
Cette question est ainsi libellée :
Mme Gisèle Gautier demande à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité de dresser un bilan de l'application de la loi d'initiative sénatoriale n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre des mineurs. Elle l'interroge également sur les suites données aux recommandations adoptées par la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur l'initiative de M. Jean-Guy Branger, dans son rapport d'information établi dans le cadre des travaux préparatoires à cette loi (n° 229, 2004-2005).
La parole est à Mme Gisèle Gautier, auteur de la question.

Madame la présidente, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, voilà maintenant bientôt un an, le Parlement adoptait définitivement, à l'unanimité des deux assemblées et à l'issue de travaux très consensuels, une proposition de loi d'initiative sénatoriale renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
Ce texte, dont notre collègue Henri de Richemont était le rapporteur, était issu des conclusions de la commission des lois sur deux propositions de loi sénatoriales déposées respectivement par M. Roland Courteau et plusieurs de nos collègues du groupe socialiste et par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et nos collègues du groupe CRC, tendant toutes deux à lutter contre les violences à l'égard des femmes, notamment au sein du couple.
L'adoption par le Sénat de ce texte s'inscrivait également dans le prolongement des travaux de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui avait déjà choisi, très en amont du dépôt des deux propositions de loi, ce sujet comme thème d'étude.
La délégation a publié, en mars 2005, après avoir mené un large programme d'auditions, un rapport d'information présenté par notre collègue Jean-Guy Branger, dont je salue l'assiduité au sein de la délégation et qui s'est beaucoup investi - il continue, d'ailleurs - dans l'action contre la violence envers les femmes, notamment dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Je me félicite que le Sénat ait ainsi été à l'initiative de cette loi, car il était nécessaire que le législateur marque clairement sa volonté de lutter contre ce véritable fléau - le mot est revenu souvent dans la bouche des uns et des autres -, resté trop longtemps tabou, que constituent les violences au sein du couple.
Permettez-moi, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, de m'interroger sur les raisons pour lesquelles Mme Ségolène Royal, en tant que candidate à la prochaine élection présidentielle, a déclaré dernièrement dans la presse : « Si je suis élue, ...

... ma première loi sera consacrée aux violences faites aux femmes. » Elle a même ajouté : « Je veux que la loi du silence soit levée et que l'État reconnaisse cette criminalité comme une criminalité à part entière. »

Est-ce de l'ignorance de sa part ? Est-ce un manque d'intérêt, jusqu'à présent, à l'égard de ce grave problème ? J'avoue que je suis contrainte de me poser ces questions.

En tout état de cause, j'avoue avoir été atterrée - le terme n'est pas trop fort - par cette déclaration, qui témoigne d'une méconnaissance de dossiers aussi sensibles et des réponses législatives qui ont été apportées par deux gouvernements successifs, ceux de MM. Raffarin et de Villepin.
J'ai été atterrée, disais-je, d'autant plus que les propositions de loi adoptées à l'unanimité - faut-il le rappeler ? - ont été initiées par sa propre famille politique, voilà à peine neuf mois !
C'est vrai !

Sans vouloir polémiquer davantage, j'estime que cette déclaration devrait nous inquiéter, en tant que citoyen, et, comme on le dit souvent, nous interpeller !
J'ajoute que la Haute Assemblée a largement débattu de cette problématique et n'a jamais accepté, contrairement aux affirmations de Mme Royal, la loi du silence, bien au contraire ! Lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, M. le président du Sénat, M. Poncelet, avait signé solennellement, le 25 avril 2004, à ma demande, la charte « Zéro violence ». D'ailleurs, à cette occasion, chacun d'entre nous, dans cette assemblée, avait porté symboliquement un petit ruban blanc à la boutonnière.
J'abandonne là mes interrogations et mes inquiétudes.
La proposition de loi fut votée le 4 avril 2006 et accompagnée, quinze jours plus tard, d'une circulaire adressée aux magistrats du parquet.
Il m'apparaît autrement plus utile de contrôler l'application des lois existantes que de faire des déclarations précipitées.
Tel est l'objet de la question orale avec débat que j'ai souhaité vous poser, madame la ministre déléguée, et dont la conférence des présidents a bien voulu proposer l'inscription à l'ordre du jour réservé de la Haute Assemblée.
La loi du 4 avril 2006 a tout d'abord renforcé la répression pénale à l'encontre des auteurs de violences commises au sein du couple, en complétant les dispositions qui figuraient déjà dans le code pénal ou qui sont prévues dans d'autres textes, comme la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales ou le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Désormais, le fait que les violences aient été commises au sein d'un couple constitue toujours une circonstance aggravante, que l'auteur de ces violences soit le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime ; il en est d'ailleurs de même pour un meurtre.
Conformément à l'une des recommandations de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, cette circonstance aggravante a été étendue aux violences commises par l'ancien conjoint, concubin ou pacsé de la victime, ce qui est particulièrement judicieux, car les violences les plus graves sont souvent commises par des « ex », après une rupture. En effet, ces personnes sont encore plus virulentes après une séparation.
Par ailleurs, le viol et les agressions sexuelles commis au sein d'un couple, marié ou non, sont désormais reconnus explicitement dans le code pénal ; ils sont également passibles de sanctions aggravées.
En outre, le vol entre époux est dorénavant sanctionné lorsqu'il porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, notamment des documents d'identité ou des moyens de paiement dont la disparition interdit à la victime de s'échapper et de quitter le territoire.
Cependant, il ne suffit pas de prévoir un alourdissement des sanctions pénales si des condamnations ne sont pas prononcées.
À cet égard, il serait intéressant, madame la ministre déléguée, de disposer d'un bilan statistique des condamnations pour violences au sein d'un couple. Dans le cadre de la politique pénale mise en oeuvre par le parquet, il convient aussi de veiller à ce que des suites soient effectivement données aux dépôts de plaintes et qu'une réponse pénale appropriée soit systématiquement et rapidement apportée.
À ce sujet, je souhaite rappeler que la médiation pénale n'apparaît pas toujours adaptée aux affaires de violences au sein du couple, car elle peut être perçue comme mettant sur un pied d'égalité l'auteur des violences et la victime, c'est-à-dire l'agresseur et l'agressé.

Nous en avons longuement parlé dans cet hémicycle, car il s'agit d'un point assez controversé.
La loi du 4 avril 2006 a aussi complété les mesures susceptibles d'être prises pour la protection des victimes. Elle a en particulier élargi aux procédures pénales la possibilité d'une éviction du conjoint violent du domicile familial, qui était déjà prévue en matière civile. Le conjoint, concubin ou partenaire pacsé violent, peut ainsi être contraint de quitter le domicile familial, de s'abstenir de paraître à ce domicile ou à ses abords, et, le cas échéant, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Là encore, il importe que ces mesures soient effectivement appliquées.
Madame la ministre déléguée, je souhaiterais que vous nous indiquiez combien de mesures d'éviction du domicile familial ont déjà été décidées en matière pénale.
Ainsi que le demandent, à juste titre d'ailleurs, certaines associations, il serait également intéressant de réfléchir à une meilleure coordination entre les décisions prises respectivement par les juridictions pénales et par les juridictions civiles concernant, par exemple, le règlement d'un divorce ou la garde des enfants, ce qui arrive fréquemment, lorsqu'on se trouve dans un contexte de violences au sein du couple.
La loi du 4 avril 2006 comporte également des dispositions n'ayant pas de caractère pénal.
Sur l'initiative du Sénat, en particulier de notre collègue M. Robert Badinter, le respect a été inscrit parmi les devoirs réciproques des époux énumérés par le code civil, ce qui revêt une forte valeur symbolique.
Dans le souci de lutter contre les mariages forcés, et conformément à une recommandation de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, le Sénat a également pris l'initiative de relever de quinze ans à dix-huit ans l'âge légal minimum du mariage pour les filles. L'Assemblée nationale a ensuite complété cette mesure par une série de dispositions tendant à mieux lutter contre les mariages forcés, notamment en renforçant la protection de la liberté du consentement, dont l'application devra faire l'objet d'un suivi attentif.
Toutefois, les mesures nécessaires à une lutte efficace contre les violences au sein des couples ne relèvent pas toutes de la loi ; elles relèvent également de dispositions réglementaires ou d'actions concrètes des pouvoirs publics, voire d'une évolution des mentalités.
C'est pourquoi, madame la ministre déléguée, j'ai également souhaité vous interroger sur les suites données à l'ensemble des recommandations formulées en ce sens par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le rapport d'information qu'a présenté notre collègue Jean-Guy Branger.

La délégation, qui souhaite systématiser le suivi de ses recommandations - après tout, à quoi servirait-elle si ses recommandations n'étaient pas prises en compte ? -, vous a déjà interrogée sur ce sujet au printemps dernier. Vous avez bien voulu nous répondre par écrit et nous avons reproduit ces informations dans notre dernier rapport d'activité.
La délégation avait tout d'abord souhaité que des études statistiques puissent être menées à bien pour parvenir à une meilleure connaissance quantitative du phénomène des violences conjugales, encore largement méconnu alors, ainsi que pour évaluer leur coût budgétaire et social. Madame la ministre déléguée, avez-vous de nouveaux éléments d'information à nous fournir sur ce point ?
Afin d'améliorer les conditions de prise en charge des victimes, la délégation avait appelé de ses voeux la mise en place d'une formation adaptée pour les différents professionnels concernés : magistrats, policiers, gendarmes ou encore membres des professions de santé. Le développement de la formation initiale comme de la formation continue, est en effet d'autant plus nécessaire que l'accueil des femmes victimes de violences au sein de leur couple nécessite une grande maturité professionnelle et humaine.
Il semble bien, d'après ce que j'ai entendu dire sur le terrain, que nous connaissions une amélioration significative.

Sur ce point encore, j'aimerais avoir une réponse précise afin que nous soyons complètement éclairés.
La délégation avait également souhaité que les conditions d'accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats puissent être améliorées, ...

... notamment par la mise en place de permanences tenues par les associations d'aide aux victimes.
En outre, elle avait souligné la nécessité de développer des structures d'hébergement adaptées pour les femmes contraintes de quitter leur domicile afin de fuir leur conjoint violent, qu'il s'agisse d'un hébergement d'urgence ou d'un hébergement de plus longue durée. Celui-ci peut être envisagé dans un établissement spécialisé ; il est aussi expérimenté dans des familles d'accueil - peu nombreuses -, par exemple à la Réunion.
Enfin, la délégation avait relevé l'intérêt de la mise en place, en liaison avec les associations et sous la forme de groupes de parole, d'une prise en charge des hommes violents permettant à ces derniers d'avoir une réflexion sur les causes de leur comportement.
Madame la ministre déléguée, je sais que vous menez une politique volontariste dans ce domaine, notamment dans le cadre d'un plan global de lutte contre les violences faites aux femmes, et que vous avez déjà engagé un certain nombre d'actions concrètes. Sans doute nous apporterez-vous de nouvelles précisions sur ces actions ?
L'enjeu de cette lutte est d'importance pour notre société dans son ensemble. On ne peut continuer à tolérer l'intolérable, d'autant que les enfants témoins de violences conjugales en souffrent aussi et reproduisent le même schéma une fois arrivés à l'âge adulte.
Pour combattre efficacement ce fléau, il n'est pas de bonne méthode d'empiler les réformes législatives...

... sans se soucier, ou sans paraître se soucier, de l'application concrète des lois qui existent déjà.

Mme Gisèle Gautier. C'est la raison pour laquelle je vous remercie par avance des réponses que vous voudrez bien m'apporter.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Madame la ministre déléguée, je me réjouis que la question de notre collègue Mme Gisèle Gautier nous donne l'occasion de vous interroger sur l'application de la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre des mineurs, texte promulgué voilà plus de huit mois.
Cette loi a aggravé les sanctions et élargi leur champ d'application aux concubins, aux pacsés et aux ex-compagnons. Elle a pris en compte le viol et le vol entre époux ainsi que les mutilations sexuelles, et a prévu des dispositions pour mieux protéger les jeunes filles contre un mariage forcé. On ne peut qu'être d'accord avec cette amélioration de la prise en compte des violences commises, la plupart du temps, contre les femmes, mais il en existe aussi contre les hommes.
Dans mon intervention du 29 mars 2005, lors de la première lecture du texte au Sénat, j'avais souhaité que cette loi soit appliquée rapidement. Près de deux années plus tard, où en sommes-nous ?
Les chiffres de 2006 ne sont pas rassurants : 113 homicides, soit un tous les trois jours, ont concerné très majoritairement des femmes et quelques-uns des hommes violents tués par leur compagne. À la suite de ces drames, 26 personnes se sont suicidées, 11 ont tenté de le faire, 10 enfants ont été tués. Cela porte à 160 en un an le nombre des victimes de ce fléau !
Par ailleurs, un million trois cent mille femmes auraient été, dans leur vie de couple, confrontées à des violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles.
Le coût global de ces situations s'élève à 1 milliard d'euros, qui inclut entre autres 383 millions d'euros pour des frais d'hospitalisation, de consultation et de médicament, 232 millions d'euros pour des frais de police, de justice et d'incarcération, 89 millions d'euros pour des frais de relogement et de prestations sociales. Ce bilan 2006 n'est pas encourageant !
Nous savons, madame la ministre déléguée, qu'un certain nombre de mesures se sont mises en place au début de cette année et que vous travaillez à améliorer la prise en compte de cette grave question. Mais on voit aussi que cette loi, dont le titre évoque prévention et répression, s'attache plus, pour l'instant, à la répression. Je ne nie pas son importance, mais, pour les victimes, quand la sanction à l'encontre de leur conjoint intervient, le chemin parcouru a été bien long et beaucoup d'entre elles ne trouvent pas ou n'ont pas encore trouvé l'écoute attentive, l'encouragement à réagir, la certitude rassurante qu'elles seront soutenues et aidées.
Par conséquent, j'aimerais savoir ce qui est prévu ou ce qui a déjà été fait dans le domaine de la prévention. En particulier, l'accueil dans les gendarmeries et les commissariats est-il fait par des femmes ? par des personnes spécifiquement formées ? par des personnes ayant déjà une bonne expérience de la vie d'adulte ?
S'agissant de la sensibilisation des magistrats, où en est la formation spécifique ? Envisage-t-on la création d'une juridiction de genre, comme en Espagne ? Je rappelle que, dans ce pays, où 150 000 plaintes ont été enregistrées en un an, des tribunaux spécialisés dans les violences à l'encontre des femmes ont été créés.
En France aussi, il s'agit d'un contentieux massif qui nécessite des juges spécifiquement formés. Ces tribunaux permettraient de mieux articuler les décisions pénales, comme la sanction des violences, et les décisions civiles, comme la garde des enfants. Aujourd'hui, ces décisions sont prises par des magistrats différents et on sait qu'elles sont parfois contradictoires.
J'aimerais aussi savoir ce qui est concrètement prévu ou réalisé pour la formation du milieu médical, pour l'implication des associations et des intervenants sociaux auprès des services de police et de gendarmerie, pour l'édition d'un code du droit des femmes et pour l'instauration d'un numéro d'appel unique.
D'autres questions déjà posées lors de mes deux interventions précédentes sont restées sans réponse. Elles concernent d'abord la sensibilisation, dès le tout jeune âge, au respect de l'autre, en particulier le respect des garçons à l'égard des plus faibles, dont les filles. Elles concernent ensuite la diffusion des spots de sensibilisation. Sont-ils diffusés dans les lycées ? Si ce n'est pas le cas, peut-on envisager de le faire ? Elles concernent enfin la violence inadmissible exercée par les grands frères sur les petites soeurs. A-t-on des chiffres ?
Le phénomène des violences au sein des couples n'est pas en régression. La répression seule ne dissuadera pas un homme violent, car, au moment de lever la main sur sa compagne, il ne se dira pas : « Attention ! Je vais être passible d'une circonstance aggravante. ».
L'éducation au respect de l'autre et de sa dignité, la prise de conscience par les femmes de leur valeur et de leurs droits, sont des voies qui doivent être beaucoup plus exploitées. Il y va de l'équilibre de notre société. Madame le ministre déléguée, nous comptons sur vous pour nous éclairer sur ce qui a déjà été fait et pour continuer à avancer rapidement et efficacement dans ce qui reste à faire.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.

Madame la présidente, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier Mme Gisèle Gautier d'avoir posé cette importante question.
Membre de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, j'ai été élu par ailleurs représentant du Sénat à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Au sein de cette assemblée, je suis membre de la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes et je voudrais faire connaître l'activité de cette importante commission.
À l'occasion de la campagne du Conseil de l'Europe pour combattre la violence contre les femmes, j'ai été désigné par le président du Sénat, M. Christian Poncelet, comme « parlementaire de référence » pour la mise en oeuvre de la résolution sur « les Parlements unis pour combattre la violence domestique contre les femmes ».
J'ai été élu par mes collègues coordonnateur régional du groupe des parlementaires de référence représentant neuf États : outre la France, la Belgique, le Liechtenstein, Monaco, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, l'Irlande et le Royaume-Uni.
Investi de ces responsabilités, qui sont relativement importantes si l'on veut bien accomplir sa mission, j'ai donc participé, le 27 novembre dernier, au lancement de la campagne du Conseil de l'Europe à Madrid, où je vous ai vue, madame la ministre déléguée. J'ai en particulier été amené à récapituler toutes les initiatives prises par notre gouvernement dans ce domaine. Il est bon, je crois, de les rappeler, compte tenu de ce que j'entends ici et là.
Madame la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, vous avez fait une importante communication au conseil des ministres du 22 novembre 2006 en vue de la campagne du Conseil de l'Europe. L'urgence de la lutte contre les violences domestiques ne peut pas être masquée puisque, en 2005, on a encore constaté 113 meurtres. Devant cette urgence, les lois du 12 décembre 2005 et du 4 avril 2006 ont consacré cette lutte comme étant une priorité du gouvernement français.
Le renversement, au profit de la victime, du droit au maintien dans les lieux, et donc de l'éviction de l'auteur de violences, à l'instar de la plupart des législations européennes récentes, est l'un des progrès obtenus.
Je citerai encore l'extension de la qualification de circonstances aggravantes au conjoint pacsé ainsi qu'à l'ex-conjoint.
Ces mesures légales s'accompagnent d'une formation des personnels de gendarmerie comme de police, ainsi que des médecins généralistes, à l'accueil et à l'écoute des victimes.
Des précisions sur ces différents points vous ont été demandées, madame la ministre déléguée. Je sais que vous ne manquerez pas de nous les donner.
Le soutien financier aux associations est également accru. Des dispositions relatives au droit à l'assurance chômage et au bail commun visent également à protéger la victime qui choisit de changer de travail et de domicile. Un numéro d'appel unique permet de mettre en oeuvre toutes les mesures médico-sociales nécessaires.
Enfin, à l'instar de l'approche luxembourgeoise, une place est désormais faite, à côté de la répression, à la prévention de la récidive, en favorisant une modification du comportement de l'agresseur.
Vous me permettrez d'ajouter quelques observations personnelles à cette récapitulation, fondées sur le constat, qui est à mes yeux plus qu'une coïncidence, qu'il existe un parallélisme entre démocratie et lutte contre la violence domestique.
La violence intrafamiliale doit être vigoureusement combattue en vue de son éradication. Il ne s'agit nullement d'un phénomène de mode s'inscrivant dans une victimisation généralisée, alléguée par certains tenants des gender studies. Il s'agit encore moins de souligner le coût financier de cette forme de violence, comme on le ferait pour n'importe quel fléau social, pour les cancers ou les accidents de la route. Il s'agit de combattre une violence qui s'exprime par la brutalité de la force physique aux dépens des mères, des compagnes, des jeunes filles et même des fillettes.
La violence domestique ne reste jamais confinée dans le cercle familial : elle est une école de la violence sociale. Un jeune qui aura été le témoin au sein de sa propre famille de violences exercées contre sa mère et/ou ses soeurs intégrera que la subordination des femmes et la brutalité des hommes sont naturelles et qu'elles sont, par conséquent, une affaire privée. Certaines traditions n'en font-elles pas d'ailleurs un comportement légitime ?
Il faut bien entendu que les autorités publiques protègent les victimes individuelles et que la justice réprime les comportements inadmissibles. Mais la famille, qui forme les hommes et les femmes de demain, doit aussi être le premier foyer du respect de chacun avant que l'école ne prenne le relais.
La civilisation, quelle que soit la forme qu'elle présente, c'est d'abord et toujours le dépassement de la loi du plus fort. La civilisation, c'est la substitution du débat à la force physique ; la civilisation, c'est la renonciation aux rapports de force interindividuels pour leur substituer le respect de la personne humaine et de ses droits inaliénables, égaux et universels.
Il est primordial que ces principes fondamentaux soient inculqués dès l'enfance aux futurs citoyens européens, ainsi qu'à ceux qui se sont installés chez nous.
La vie en société comporte inévitablement le renoncement à ce que les psychanalystes appellent la toute-puissance infantile. La famille patriarcale archaïque reposait sur un certain équilibre : aux hommes les travaux extérieurs exigeant de la force physique, aux femmes les soins des enfants et les travaux domestiques, dont dépendaient tout autant la survie du groupe : cuisine, fabrication des vêtements, des conserves, notamment. La mécanisation de toutes ces tâches, des plus dures aux plus coutumières, ne justifie plus la répartition traditionnelle qui a longtemps fondé une asymétrie juridique.
La perpétuation d'un statut d'infériorité, devenu complètement obsolète, est désormais insupportable, car il est en contradiction avec l'évolution de nos sociétés et avec les valeurs consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, les sociétés européennes rassemblent des hommes et des femmes qui ont vocation à exercer les mêmes métiers, en étant titulaires des mêmes diplômes.
La survivance du schéma patriarcal au sein des familles ne peut que générer des tensions. Lorsque les hommes de la famille sont tentés d'exprimer leurs frustrations sociales par des gestes violents contre les femmes, ils lèsent évidemment des personnes à qui ils dénient le respect de leurs droits. En outre, comme je le disais, cette violence ne restera pas confinée au seul cadre familial. Les garçons qui auront été témoins des violences contre les femmes de leur famille risquent, par réflexe, de recourir à la brutalité pour régler tout différend, sur fond de refus de ces compromis dont est pourtant tissée toute vie collective et du principe d'égalité entre toutes les personnes humaines.
Voici pourquoi je me félicite que le Conseil de l'Europe se soit donné comme mission primordiale, avec l'appui des parlements nationaux, la lutte contre la violence domestique. Il y va non seulement de la protection des femmes, mais également de tout l'équilibre de nos sociétés.
Par ailleurs, je rappelle que la violence domestique ne doit pas être combattue seulement lorsqu'elle se marque par des traumatismes physiques. Le plein respect du principe d'égalité nous impose de lutter tout autant contre des formes de violences plus insidieuses.
Je pense ici aux mutilations sexuelles, que l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, relayée par Amnesty international, a plusieurs fois condamnées comme des violences inadmissibles. À cet égard, les tribunaux français sont exemplaires.
Je pense également aux mariages forcés imposés à de toutes jeunes filles, qui, pour elles, ne sont rien d'autre que des viols. Le Gouvernement et le Parlement français viennent judicieusement de relever à dix-huit ans l'âge du mariage, pour les filles comme pour les garçons, et de renforcer la législation pour empêcher les mariages précoces, souvent imposés.
J'appelle encore notre gouvernement à lutter avec détermination contre la polygamie, qui est toujours une violence contre les femmes. L'INSEE évalue à 10 000, peut-être à 20 000, le nombre de foyers polygames. Au total, de 100 000 à 200 000 personnes seraient concernées.
On nous invite à prendre en considération le devenir sombre des enfants de ces foyers, qui forment le gros des bataillons de l'échec scolaire et de l'exclusion professionnelle. La « décohabitation », qui requiert autant de logements sociaux que d'épouses, ne peut être une réponse de fond à ce problème.
J'ai le souvenir d'un imam autoproclamé de la région lyonnaise qui justifiait la violence physique des maris contre leurs femmes et qui, en même temps - mais est-ce un hasard ? -, avait deux épouses qu'il condamnait à la réclusion, alors qu'il vivait chez une troisième femme. Il avait seize enfants, dont la charge était laissée à la collectivité.
Violences physiques et violences psychologiques sont également destructrices pour toutes les victimes, femmes et enfants.
Je suis déjà intervenu avec force sur les violences psychologiques faites aux femmes au cours de nos débats. Il nous faudra revenir ensemble sur ce sujet.
Enfin, je conclurai en invitant nos gouvernements à lutter contre une forme muette de violence, mais qui a d'importantes conséquences : l'inégalité dans l'accès au savoir.
Priver une jeune fille de l'instruction et de la formation professionnelle, donc de toute autonomie, c'est la condamner à la soumission et donc la désigner comme la victime des excès potentiels d'un compagnon auquel elle ne pourra échapper.
J'ai encore le souvenir d'un père de famille qui refusait d'envoyer ses filles à l'école, non sans prendre soin de réclamer les allocations de rentrée scolaire ! Pouvez-vous nous assurer, madame la ministre déléguée, que l'obligation scolaire est désormais correctement contrôlée ?
Madame la présidente, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, telle est l'approche que j'ai proposée, au nom du groupe des neuf pays qui m'ont élu, pour le lancement de la campagne du Conseil de l'Europe. Telles sont également les observations que je souhaitais vous soumettre, que je veux utiles pour toutes les femmes européennes et qui seront la source d'un message de respect, universel comme le principe d'égalité.
Madame la ministre déléguée, je vous ai écoutée à Madrid, lors du lancement de cette campagne et je sais pouvoir compter sur votre engagement. Vous nous l'avez dit, votre intervention a été grandement appréciée par l'ensemble des participantes et des participants. Vous pouvez également compter sur nous pour faire de 2007 une année importante en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, particulièrement les violences domestiques.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la présidente, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour établir un état des lieux de l'application de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
Gisèle Gautier l'a rappelé, cette loi est issue de propositions de loi que nous avons déposées, mon groupe et moi-même, ainsi que nos collègues socialistes, dès l'automne 2004. À l'Assemblée nationale, nos collègues du groupe des député-e-s communistes et républicains avaient déposé cette même proposition de loi dès le mois d'octobre 2003. Nous attendions donc avec impatience que le Gouvernement se saisisse du problème des violences conjugales.
Aujourd'hui, la loi adoptée en avril 2006 est en vigueur. Mais deux questions se posent : correspond-elle à nos attentes et surtout à celles des victimes ? Est-elle réellement appliquée ?
À la première question, je réponds par la négative. C'est pour cette raison que, avec d'autres, notamment avec des associations qui ne sont pas satisfaites de cette loi, je travaille à l'élaboration d'une autre proposition de loi qui irait beaucoup plus loin.
La philosophie de la loi du 4 avril 2006 repose essentiellement sur une aggravation des sanctions à l'encontre des auteurs de violences conjugales. Le Gouvernement nous a expliqué, lors de l'examen du texte en mars 2005, que la réponse à la violence passait par le droit et le renforcement des sanctions. Notre postulat de départ est quelque peu différent. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduits à ne pas proposer d'aggravations des sanctions.
En effet, les violences conjugales ne peuvent être comparées aux autres cas de violences contre des personnes. Elles sont fondées sur un processus psychologique différent et sur un rapport inégalitaire entre l'homme et la femme au sein du couple. Le rapport Henrion de février 2001 décrit parfaitement le processus des violences conjugales : ces violences « se distinguent des simples conflits entre époux ou concubins ou même des conflits de couples en difficulté ou conjugopathie par le caractère inégalitaire de la violence exercée par l'homme qui veut dominer, asservir, humilier son épouse ou partenaire ».
Ce n'est donc pas un hasard si la femme qui subit ces violences n'a parfois pas le sentiment d'être une victime. Il arrive même qu'on la tienne pour responsable de ces violences et que l'on considère qu'elle a provoqué la situation. Ensuite, elle ne ressent ni le besoin de se défendre ni celui de se plaindre des sévices qu'elle subit. Au contraire, elle éprouve de la honte et de la culpabilité.
Ce sentiment de honte et de culpabilité a longtemps été entretenu par la tolérance dont la société a fait preuve envers les agresseurs et les violences conjugales. « C'est un problème de couple », « Cela ne nous regarde pas », « C'est une simple scène de ménage », telles furent longtemps les phrases employées pour caractériser ces violences et servir d'excuse à la société pour ne pas considérer les violences conjugales comme un trouble à l'ordre public.
De ce point de vue, nous assistons à un retournement de situation inespéré. On ne porte plus aujourd'hui un regard tolérant sur ces violences. De même, on ne méprise plus les femmes qui en sont victimes.
Néanmoins, il ne faut jamais oublier que les violences au sein du couple se produisent toujours dans le cadre d'un schéma psychologique d'emprise, de domination, d'humiliation entretenu par l'agresseur.
De ce fait, l'accompagnement des victimes et la formation des professionnels susceptibles d'être confrontés à ces femmes victimes sont essentiels. Telle est la position que nous n'avons cessé de défendre, que ce soit dans notre proposition de loi ou lors des débats en mars 2005 et en janvier 2006, tout en encourageant le recours aux dispositions législatives existantes.
Il est d'autant plus difficile pour une femme victime de violences au sein de son couple de réagir qu'elle est économiquement dépendante de son conjoint : envisager de le quitter est alors presque impossible. C'est pour cette raison que nous avions déposé des amendements tendant à permettre aux victimes, notamment celles dont les revenus sont inférieurs à 75 % du SMIC, d'être financièrement autonomes, grâce à la solidarité nationale.
Nous insistions également, et nous continuons de le faire, sur le renforcement de la formation des professionnels de santé, des magistrats, des policiers et des gendarmes, de toutes celles et de tous ceux qui sont amenés à rencontrer des femmes victimes de violences conjugales.
En effet, le sentiment de honte influe énormément sur les démarches et les recours entrepris par les femmes auprès des institutions.
D'une part, il n'est pas aisé pour elles de se livrer. Les résultats de l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France de 2000 ont souligné l'occultation des violences conjugales et le silence dont celles-ci sont entourées de la part des victimes elles-mêmes.
Je citerai l'un des constats de cette enquête : « Les femmes ont beaucoup plus faiblement parlé avec d'autres personnes des violences subies au sein de leur couple. Le constat d'un faible recours aux institutions en découle logiquement. Il y a plus de réticences à signaler les brutalités d'un conjoint que celles de toute autre personne : 13 % des cas de violences conjugales, contre 43 % dans les espaces publics et 32 % au travail ».
Les campagnes d'information, telles que les campagnes télévisuelles et d'affichage que nous avons pu voir, sont donc essentielles sur ce plan, afin que les femmes victimes de violence sachent qu'elles peuvent briser le silence auquel elles se condamnent.
D'autre part, nous voyons bien comment, du côté des professionnels de santé ou de justice, il n'est pas aisé non plus d'interpréter des paroles ou des attitudes qui pourraient traduire une situation de violences conjugales. Il est donc essentiel, là aussi, une fois que les femmes ont trouvé le courage de briser le silence, qu'elles puissent parler en toute confiance à une personne attentive, qui sache trouver les mots justes et ensuite engager les actions adéquates.
Cette attitude de la part des professionnels n'est pas forcément spontanée. La formation est donc essentielle, mais, à chaque fois que nous avons formulé une telle proposition, elle a été rejetée. C'est d'autant plus regrettable que c'était également l'une des recommandations formulées par la Délégation aux droits des femmes.
Pourtant, nous l'avons souligné dans les travaux de la Délégation, la seule approche répressive ne peut être satisfaisante pour limiter le phénomène des violences conjugales. Seule une approche globale permettra de lutter efficacement contre ces violences.
Au-delà des professionnels, prévoir dès l'école maternelle une initiation au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes s'avère nécessaire afin de réduire, à l'avenir, l'influence de certains phénomènes sociaux sur la violence masculine à l'égard des femmes. Une fois encore, une telle proposition a été rejetée, et nous le regrettons vivement.
Par conséquent, les différents intervenants, que ce soient les professionnels de santé, l'éducation nationale, les services de police et de gendarmerie, les collectivités territoriales ou les associations, doivent impérativement mutualiser leurs actions pour les rendre plus efficaces.
Je considère que ce n'est pas l'esprit qui a guidé la majorité et le Gouvernement lors de l'examen du texte qui allait devenir la loi du 4 avril 2006. Néanmoins, parce qu'il marquait une étape essentielle dans la reconnaissance des violences faites aux femmes, notre groupe a voté ce texte, en émettant quelques réserves et en insistant sur le fait que nous serions particulièrement attentifs à sa mise en oeuvre effective.
Nous demandons donc au Gouvernement, madame la ministre, de faire le bilan de l'application ou non de certaines dispositions de la loi. Ces éclaircissements sont d'autant plus nécessaires que les chiffres concernant les femmes victimes de violences au sein de leur couple sont toujours élevés : une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon.
Une étude sur les coûts budgétaire et social de ces violences, notamment leurs conséquences en matière d'arrêt de travail, d'assurance, de protection policière, de soins, de traitement judiciaire, de logement, de prise en charge des enfants, etc., a été confiée au Centre de recherches économiques, sociologiques et de gestion, avec, comme première étape, un rapport qui devait être rendu fin 2006. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors que la justice commence à prendre la mesure de ces violences, nous aimerions savoir dans quelle proportion est utilisée la possibilité pour le procureur de la République, dans le cadre de la composition pénale, et pour le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, d'éloigner le conjoint violent du domicile conjugal.
Est-il prévu que l'initiative du parquet de Douai soit davantage généralisée ? L'expérience qui y est menée n'est pas dénuée d'intérêt. Dans cette juridiction, les hommes violents sont systématiquement mis en garde à vue et nombre d'entre eux sont placés pendant quinze jours dans un foyer où ils sont tenus de participer à des groupes de paroles.

Plusieurs parquets se sont inspirés de cette expérience, tels que ceux de Senlis ou de Bordeaux. D'autres parquets sont-ils intéressés ?
S'agissant des statistiques éditées par le ministère de l'intérieur, nous demandions que celles-ci soient sexuées afin de pouvoir dénombrer le nombre de femmes victimes de violences commises au sein de leur couple.
Le 1er février 2005, la Délégation aux droits des femmes auditionnait Michel Gaudin, directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur. Celui-ci nous avait alors indiqué que l'outil statistique ne permettait pas d'isoler les violences conjugales incluses dans la rubrique des coups et blessures volontaires. Il avait toutefois précisé qu'un nouvel outil informatique, appelé système de traitement des infractions constatées, ou STIC-Ardoise, offrirait des statistiques intégrant ce paramètre et devrait être opérationnel en 2007. Pouvez-vous nous dire où en est la mise en oeuvre de ce projet ?
Cette demande d'établir des statistiques sexuées était d'ailleurs formulée par la Délégation aux droits des femmes. Cette dernière recommandait également que soient actualisés les résultats de l'ENVEFF de 2000. Nous saluons le fait qu'une enquête ait été réalisée sur deux ans - en 2003 et en 2004 - à la demande du ministère en charge de la parité par l'ENSAE Junior Études, recensant les morts violentes survenues au sein du couple. Nous encourageons de telles études et souhaitons qu'un travail aussi sérieux que celui qui a été réalisé par l'ENVEFF soit régulièrement effectué.
M. Michel Gaudin nous avait parlé de la mise en place de stages de formation professionnelle pour les policiers amenés à recevoir des femmes victimes de violences conjugales. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ont-ils été mis en place ? Si oui, combien de policiers ont-ils pu en bénéficier ?
Pour ce qui est de l'accueil des femmes victimes de violences conjugales, la Délégation recommandait de coordonner le réseau d'accueil et de prise en charge des victimes en y intégrant les collectivités territoriales, en particulier les communes.
Une circulaire du 24 mars 2005 a demandé aux préfets, en collaboration avec les collectivités territoriales et le secteur associatif, un diagnostic partagé des réponses offertes et des besoins à satisfaire en matière d'accueil, d'hébergement et de logement des femmes victimes de violences. Cette circulaire a-t-elle été suivie d'effets ?
Enfin, la loi du 4 avril 2006 prévoit que le Gouvernement déposera tous les deux ans un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples.

Nous espérons que cet engagement sera tenu, quel que soit le Gouvernement en place l'année prochaine.
Nous attendons de la part du Gouvernement des réponses précises à toutes ces questions et observations.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, parce que vous savions que les violences envers les femmes au sein du couple constituent un phénomène massif qui touche un nombre important de femmes de tous âges, de tous milieux et de toutes origines, nous avions déposé, le groupe socialiste et les Verts, en novembre 2004, une proposition de loi visant à lutter contre ce fléau et contre certaines discriminations dont les femmes font l'objet.
Nous avions d'ailleurs rappelé qu'il s'agissait d'un préalable à tout approfondissement de l'égalité entre les sexes. Nous étions quelques-uns à penser qu'il était temps, en effet, que la France, pays des droits de l'homme, pays où l'égalité figure dans la devise et parmi les principes fondamentaux, ait le courage de dénoncer cette situation, comme avaient su le faire avant nous d'autres pays, comme l'Espagne.
Je remercie le Sénat d'avoir bien voulu inscrire les propositions de loi n° 62 du groupe socialiste et n° 95 du groupe CRC à l'ordre du jour de ses travaux. Je remercie également la commission des lois, son président et son rapporteur. Je n'oublie pas non plus de saluer le rôle ô combien ! important qui fut celui de Michèle André, vice-présidente du Sénat, sur ce dossier.
Enfin, relevons une fois encore, pour mieux souligner l'importance du moment, que c'était la première fois de son histoire que le Parlement se saisissait de ce problème majeur de société.
Certes, la loi du 4 avril 2006, qui est issue de nos différentes propositions de loi et amendements, ne changera pas en quelques semaines, voire en quelques mois, les mentalités.

Raison de plus, avais-je souligné alors, pour agir sans plus attendre.
Cela dit, même s'il reste encore du chemin à parcourir, la loi du 4 avril 2006 constitue un grand pas et une avancée sans précédent, de l'avis même d'un très grand nombre d'associations et de professionnels concernés par le fléau des violences domestiques. Les uns et les autres ne manquent pas de souligner que, grâce à cette loi, les choses ont commencé à bouger.
Bien évidemment, je regrette qu'une grande partie du volet préventif et du volet concernant l'aide aux victimes de notre proposition de loi ait été occultée soit au nom de la séparation de la loi et du règlement, soit en raison du manque de volonté du Gouvernement de débloquer les fonds nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions préventives et d'aide aux victimes.

Je reviendrai ultérieurement sur les nécessaires compléments qu'il conviendra d'apporter au traitement de ce problème gravissime.
Pour le reste, c'est-à-dire pour les dix-huit articles de cette loi, je n'ai jamais entendu la moindre critique de la part des associations de terrain - je parle de celles qui sont impliquées totalement sur ce dossier, nuit et jour, 365 jours sur 365 -, qu'il s'agisse des modifications apportées au code civil sur l'âge légal du mariage des femmes fixé à dix-huit ans ou de l'introduction de la notion de respect à l'article 212 ; qu'il s'agisse des mesures visant à lutter contre les mariages forcés ou relatives à l'introduction du principe de l'aggravation de la peine pour des faits commis au sein du couple, tant par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé, que par l'ex-conjoint, l'ex-concubin ou l'ex-partenaire ; ou qu'il s'agisse enfin du renforcement des mesures d'éloignement du domicile de l'auteur des violences, qui est considéré comme une mesure phare, ou encore de l'incrimination du viol au sein du couple.
Pour résumer mon propos, dès lors que le Parlement, à l'unanimité et dans un consensus général, a adopté les dix-huit articles qui sont d'ores et déjà applicables depuis le 4 avril 2006, la première urgence qui s'impose concernant ce texte est non pas, dans l'immédiat, d'ordre législatif, mais plutôt d'ordre financier : il s'agit de faire en sorte que soient donnés les moyens financiers nécessaires pour une bonne application du dispositif législatif adopté.
Cela n'exclut pas que nous devrons apporter un certain nombre de compléments en matière de prévention, d'aide aux victimes et aux enfants témoins de violences, ou encore en matière de soins aux auteurs de violences.
Je n'insisterai donc pas davantage sur l'ensemble des mesures figurant dans la loi du 4 avril 2006 et qui ont été adoptées à l'unanimité par le Parlement.
En revanche, il me paraît important de m'attarder sur les problèmes rencontrés en matière d'hébergement des victimes, faute de places en nombre suffisant, surtout en accueil d'urgence de nuit. Il s'agit là d'une question récurrente, qui a été soulevée dans bon nombre de départements où j'ai pu me déplacer.

Plusieurs responsables de la gendarmerie ou de la police ont attiré mon attention sur les énormes difficultés qu'ils rencontrent, notamment la nuit, pour héberger, entre autres, les femmes en détresse.
Il reste également à résoudre, en différents endroits, la question des centres de soins pour les auteurs de violences. Cet autre point est important, si l'on veut véritablement réduire le taux de récidive.
Voilà, me semble-t-il, l'une des toutes premières urgences à satisfaire, madame la ministre : assurer les financements nécessaires à la création de places d'hébergement ou de places en accueil d'urgence.
Je faisais remarquer, il y a quelques instants, que la loi du 4 avril 2006 constituait une réelle avancée. Cela m'est confirmé dans nombre de communes ou de départements où je suis invité à commenter cette loi, tant auprès des associations que des élus ou des populations.
Cependant, nous ne devrons pas faire l'économie de nouvelles mesures législatives ou réglementaires dans les délais les plus brefs.
Concernant les propos relatifs à Mme Royal, propos agressifs s'il en est, voire violents §

... je répondrai calmement : je crois savoir que Ségolène Royal a surtout voulu dire...

... que la loi du 4 avril 2006 était une bonne chose, mais qu'elle n'allait pas assez loin, ...

... puisque certaines dispositions que nous avions proposées dans cet hémicycle n'ont été retenues ni par la majorité du Sénat ni par celle de l'Assemblée nationale.

Je rappelle également que Mme Royal s'est toujours intéressée aux violences conjugales. (Mme la ministre déléguée s'exclame.)

Je vous le dis en confidence, je lui ai même emprunté une disposition qui figurait dans une proposition de loi sur ce sujet dont elle était la première signataire. Il fallait rétablir la vérité sur ce sujet : voilà qui est fait !

Ainsi avons-nous besoin d'une action vigoureuse à tous les niveaux, allant de la prévention jusqu'au suivi des victimes et des auteurs de violences. Il nous faut donc agir non seulement en amont afin de prévenir la violence, mais également en aval pour éviter la récidive des autres violences et accompagner véritablement les victimes.
Sur ces deux points, je le répète, ni le Gouvernement, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale d'ailleurs, n'ont, hélas ! suivi les mesures que nous suggérions soit dans le cadre de notre proposition de loi, soit par voie d'amendements.
J'en viens maintenant à quelques remarques.
S'agissant de la prévention, j'ai évoqué à plusieurs reprises l'urgente nécessité de faire évoluer les mentalités. Nos propositions visaient à agir le plus en amont possible - et donc d'abord à l'école -, car, dès le plus jeune âge, les garçons et les filles sont enfermés dans des représentations très stéréotypées de leur rôle et de leur place dans la société.
C'est par l'enseignement du respect des autres et de l'égalité entre les sexes que nous ferons évoluer les mentalités, faute de quoi les mêmes schémas se reproduiront indéfiniment. Le respect et l'égalité des hommes et des femmes sont des domaines tout aussi importants à l'école, au collège ou au lycée que d'autres enseignements.
Au-delà de l'élimination des stéréotypes sexistes des manuels scolaires, je persiste à dire que c'est par un enseignement obligatoire et hebdomadaire que les enfants devraient être formés aux valeurs de respect mutuel et d'égalité entre les sexes selon des programmes très précis.
Madame la ministre, vous ne nous aviez pas suivis sur ce chemin, et c'est bien dommage. Vous nous aviez répondu que toutes les dispositions permettant d'aller dans ce sens étaient déjà contenues dans le code de l'éducation. Je crois d'ailleurs me souvenir qu'en deuxième lecture vous nous aviez indiqué que, en liaison avec le ministre de l'éducation nationale, vous comptiez donner à cette loi la publicité la plus large, notamment auprès des établissements scolaires comme les lycées.

Pouvez-vous me dire ce qui a été fait sur ce point ? En effet, jusqu'à présent, je n'ai rien vu venir.
De la même manière, vous aviez précisé que, lors du renouvellement de la convention pour la promotion de l'égalité des chances entre les filles et les garçons, la question des violences, des mutilations et des mariages forcés serait également traitée en liaison avec le ministre de l'éducation nationale, puisque vous disposiez, selon vous, de tous les outils nécessaires dans le code de l'éducation. Pouvez-vous nous faire savoir ce qui a été fait à ce sujet ? Vous aviez en effet, ici même, pris des engagements précis.

D'une façon plus générale, je reste persuadé qu'il convient de mettre en place une politique de prévention massive, et les associations que j'ai pu rencontrer me l'ont confirmé.
Il faut - cela est réclamé très souvent - un plan d'urgence, d'information, de sensibilisation et de formation de l'ensemble des professionnels concernés. Des initiatives autrement plus importantes et plus nombreuses que celles qui sont engagées actuellement doivent être prises au travers de campagnes générales de sensibilisation par voie de presse, de radio, de télévision, contre toutes les formes de violence au sein des couples et, en général, à l'égard des femmes, notamment sur les lieux de travail.
Par ailleurs, il est impératif de veiller à ce que les émissions publicitaires ne contiennent aucune incitation à la violence et aucune image dégradante de la femme. Dans ce domaine, il importe que soit appliquée la loi de 1986. Je rappelle que cette loi relative à la liberté de communication dispose notamment : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise [...] par le respect de la dignité de la personne humaine ». Pour le respect de la personne humaine et contre certaines images dégradantes de la femme, faisons donc appliquer la loi !
Cela étant, je me dois de relever que des mesures intéressantes sont mises en oeuvre depuis ces derniers mois dans le cadre des commissions départementales, sous l'autorité de la déléguée départementale aux droits des femmes. Je reconnais qu'un excellent travail est accompli, et je veux féliciter celles et ceux qui s'y emploient.
J'ai pu apprécier ce qui a été fait dans plusieurs départements depuis l'adoption de la loi. J'ai pu relever que travailleurs sociaux, magistrats, avocats, associations, psychologues, police, gendarmerie travaillent ensemble depuis maintenant un an, ce qui n'était pas évident au départ.

Toujours en ce qui concerne le volet sur la prévention, je veux revenir sur les problèmes de formation des intervenants.
Remarquons que, dans 24 % des cas, la victime se confie en premier lieu au médecin ou aux associations bien avant de s'adresser à la police, à la gendarmerie ou à la justice. Or certaines études démontrent que les médecins considèrent légitimement que ces situations sont difficiles à gérer, les praticiens étant pris entre leur devoir de protection de la santé de leurs patientes et les impératifs du secret professionnel.
Selon le rapport Henrion, qui a été cité à de nombreuses reprises, la priorité est de convaincre les médecins qu'ils occupent une position clé pour dépister les violences intrafamiliales, conseiller les femmes, prévenir l'escalade et éviter les drames.
J'y insiste encore une fois, madame la ministre, le principe de la formation de tous les acteurs sociaux, médicaux et judicaires doit être posé afin d'améliorer l'accueil, la protection et le suivi des victimes.

J'ai pu vérifier que, depuis peu, un effort a été réalisé en matière de formation des policiers et des gendarmes ; je le reconnais volontiers, et c'est très bien ainsi. Vous le voyez, je suis objectif !

Je sais également que des contrôles sont effectués afin de vérifier que l'accueil des victimes correspond bien à la charte d'accueil élaborée au niveau des services de police et de gendarmerie.
Néanmoins, il est important qu'en matière de formation initiale et continue de l'ensemble des intervenants des mesures concrètes soient prises sans tarder. C'était aussi l'un des points clé de notre proposition de loi.

Faudra-t-il légiférer encore une fois pour avancer ?
L'autre sujet concernant le corps médical porte sur l'incapacité totale de travail, l'ITT. J'ai pu rencontrer plusieurs médecins légistes qui m'ont confirmé l'urgence et la nécessité d'une réelle harmonisation dans ce domaine. Songez que, pour un nez cassé, selon les informations qui m'ont été données, l'ITT est de trois jours dans le sud de la France et de douze jours dans le Nord ou dans la région parisienne. Or chacun ici connaît l'importance qui est accordée à l'ITT, car le certificat médical est le premier élément objectif sur lequel l'autorité judiciaire s'appuie.
Certaines associations, comme le Centre d'information des droits de la femme et de la famille, suggèrent d'ailleurs de créer une nomenclature et insistent sur une nécessaire harmonisation au niveau national.
Après l'amont, que constitue le volet prévention, il faut aborder l'aval, donc l'aide aux victimes.
Là également, je persiste à dire que nous devons améliorer l'aide juridique accordée aux victimes en leur ouvrant le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources.
De même, l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui prévoit un recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages, doit être modifié et élargi à d'autres infractions qui surviennent très souvent au sein du couple. Je vous renvoie sur ce point à notre proposition de loi initiale, qui a d'ailleurs été reprise par le collectif national pour les droits des femmes.
Enfin, la question du recours à la médiation pénale dans le cas des violences intrafamiliales est une nouvelle fois soulevée par les associations. Comme je l'ai déjà dit en première et en deuxième lecture, une telle disposition est totalement inadaptée au problème qui nous préoccupe aujourd'hui.
Avant de conclure, je souhaite m'attarder sur un point capital : les incidences des violences intrafamiliales sur les enfants qui en sont les spectateurs et les victimes collatérales.
Un rapport de l'UNICEF a analysé l'impact de la violence domestique sur les enfants. Les chiffres de cette étude sont alarmants : des millions d'enfants dans le monde sont exposés à la violence domestique. En France, certaines associations évaluent leur nombre à 800 000, et d'autres vont même bien au-delà.
Ce rapport montre que les enfants qui vivent dans un climat de violence ont davantage de risques de devenir eux-mêmes victimes de violences.
Il semble par ailleurs que le développement physique, émotionnel et social de ces enfants soit en danger. En effet, une autre étude réalisée en Australie a révélé que 40 % des adolescents qui sont extrêmement violents ont été exposés, lorsqu'ils étaient enfants, à des violences intrafamiliales.
Enfin, il y a de fortes probabilités que ce type de violence se répète. Les enfants qui grandissent entourés de violence apprennent très tôt que celle-ci peut être utilisée dans le cadre des relations interpersonnelles afin de dominer les autres.
Le taux d'agression est plus important envers les femmes dont le mari a été maltraité lorsqu'il était enfant ou a grandi dans un climat de violence domestique.
Voilà un sujet extrêmement important, que nous n'avons pas traité dans le cadre de la loi du 4 avril 2006.

Nous avons d'ailleurs des propositions à faire, qu'il s'agisse de la sensibilisation de l'opinion publique sur ce sujet ou des sanctions à prendre à l'encontre des personnes qui commettent des violences en présence d'enfants.
Par ailleurs, pour tenir compte d'un autre problème tout aussi préoccupant, nous proposons la création de « lieux neutres » auprès des tribunaux où le parent auteur de violences et exclu du domicile conjugal ou non pourra rencontrer ses enfants.
Notre collègue Raymonde Le Texier a souligné ce problème lors d'une réunion de travail du groupe socialiste. Elle nous a rappelé qu'il avait été récemment reproché à une femme battue par son mari, mais également à l'association qui l'hébergeait, d'avoir dissimulé au père l'adresse réelle de la mère et des enfants. L'affaire devait être jugée en décembre dernier.
Or, toutes les statistiques l'indiquent, c'est au moment de la séparation ou quelque temps après que les femmes victimes de violences courent le plus grand danger. Notre collègue précisait donc que, s'il est légitime de veiller aux droits du père, il importe aussi d'assurer la protection de la mère et de ses enfants.
Ce point soulève le problème du cloisonnement entre le pénal et le civil, mais rend encore plus nécessaire la création de « lieux neutres ». Quelles sont les intentions du Gouvernement à cet égard, madame la ministre ? Le groupe socialiste est prêt, si nécessaire, à déposer une proposition de loi.
M. Jean-Pierre Bel opine.

Le dernier point que je souhaite aborder et sur lequel j'aimerais connaître votre sentiment - mais il s'agit là d'une démarche personnelle - concerne l'article 226-10 du code pénal, qui dispose : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ».
Je m'interroge sur les conséquences de cet article. En France, une femme peut être victime de violences sexuelles, avoir le courage de les dénoncer, mais, si elle est déboutée, elle peut se voir condamnée pour dénonciation calomnieuse. C'est déjà arrivé !
M. Gisèle Gautier le confirme.

Voilà, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce que je souhaitais dire, au nom du groupe socialiste, sur le problème des violences intrafamiliales.
La loi du 4 avril 2006, qui fut adoptée à l'unanimité tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, et j'ajouterais sous les applaudissements, constitue bien une avancée. Mais, pour être clair et concis à la fois, je dirai que le chantier reste ouvert et qu'il ne faut point tarder à y travailler de nouveau.
Quant au groupe socialiste, il est prêt à engager une deuxième étape au travers d'une nouvelle proposition de loi, si nécessaire.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Vous avez eu raison, madame Gautier, de rappeler que la Haute Assemblée est à l'origine de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Ce texte a permis de réaliser des avancées très importantes en matière de prévention et de sanction de ces violences.
Chacun connaît la détermination du Gouvernement à combattre le fléau des violences contre les femmes. Comme vous, monsieur Courteau, je veux rendre hommage à toutes les associations qui s'occupent au quotidien des femmes victimes de violence.
Il est essentiel que nous puissions maintenir notre mobilisation et poursuivre ensemble le travail engagé. C'est dans cet esprit que je tiens à remercier le Sénat d'avoir inscrit à son ordre du jour cette question orale avec débat. Celle-ci représente une excellente opportunité de faire un point précis de l'état d'avancement des mesures qui ont été prises et de tracer les pistes d'action à venir.
Je tiens à saluer le travail accompli depuis plusieurs années par la Délégation aux droits des femmes. J'ai eu à coeur, pendant les dix-huit derniers mois, de faire en sorte que l'ensemble de ses recommandations puissent être reprises.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite d'abord rappeler que les mesures adoptées depuis un an et demi sont désormais appliquées. C'est notamment le cas des dispositions de la loi du 4 avril 2006. La plupart de ces mesures étaient d'application immédiate.
Je pense au passage de l'âge nubile des filles de quinze à dix-huit ans ; vous l'aviez demandé, c'est aujourd'hui réalisé.
Je pense également à la reconnaissance de la notion de viol entre époux ; vous l'aviez suggéré, c'est aujourd'hui chose faite.
Je pense ensuite à l'élargissement du champ d'application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs - pacsés et ex-conjoints - et à de nouvelles infractions - meurtres, viols, agressions sexuelles ; vous l'aviez demandé, vous avez été exaucés. C'est d'ailleurs cet élargissement de la circonstance aggravante qui permettra un relevé statistique automatique complet dès la fin de l'année 2007.
Je pense enfin au renforcement de la possibilité de l'éloignement du conjoint auteur de violences, possibilité qui a en outre été étendue aux pacsés ainsi qu'aux anciens conjoints et aux anciens concubins.
En ce qui concerne l'introduction dans le code pénal de la notion de « violences habituelles » pour les faits de violences au sein du couple, elle est actuellement débattue dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Pour ce qui est de la notion de respect entre les époux, nous l'avons ajoutée au devoir mutuel de fidélité, de secours et d'assistance déjà imposé par le code civil. J'ai demandé à l'Association des maires de France d'en informer l'ensemble des maires afin qu'ils mettent l'accent sur cette notion lors de la célébration des mariages. Cette référence explicite au respect renforcera la liberté de consentement des époux et contribuera à prévenir toute violence ultérieure.
Outre les dispositions de cette loi, le Gouvernement s'est aussi appliqué à mettre en oeuvre les mesures que nous avons annoncées concernant le renforcement de l'accueil et de l'écoute des personnes victimes de violences.
Le 25 mai 2005, Nicolas Sarkozy a signé une convention avec l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, l'INAVEM. Cette convention a pour objet la mise en place dans les commissariats et les brigades de points d'accueil assurés par des associations d'aide aux victimes. Elle a d'ores et déjà permis la création de permanences d'associations dans 130 commissariats et groupements de gendarmerie. Trente travailleurs sociaux sont à pied d'oeuvre au sein des services de police et de gendarmerie. Je suis la première à reconnaître que trente travailleurs sociaux ne suffisent pas, et qu'il faut continuer, mais le processus est enclenché.
Dans le prolongement de cette démarche, le ministère de l'intérieur a signé le 7 mars 2006, avec la Fédération nationale solidarité femmes, la FNSF, et le Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles, le CNIDFF, une convention destinée à améliorer l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge des femmes victimes de violences au sein du couple.
Cette convention a pour objet de créer entre les associations d'aide aux victimes et les forces de sécurité un réel partenariat, allant de la formation des policiers et des gendarmes jusqu'à la présence de ces associations dans les locaux des forces de sécurité.
Par ailleurs, la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat a souhaité que le traitement de ces violences soit mieux intégré dans les programmes de formation continue de l'ensemble des professionnels concernés.
La Délégation aux victimes, inaugurée le 11 octobre 2005 par le ministre de l'intérieur, peut désormais être consultée sur les programmes de formation continue dispensée aux policiers et aux gendarmes.
Mesdames Gautier et Dini, dès décembre 2005, une centaine d'officiers de la gendarmerie ont bénéficié d'une formation nationale comprenant des séances de sensibilisation à l'intervention dans le cadre de violences conjugales.
J'ajoute que mon ministère a publié, en novembre dernier, une brochure à destination de tous les professionnels qui assistent les victimes lors de leurs démarches initiales. Par l'établissement de ce document, j'ai cherché à coordonner l'ensemble des différents acteurs et à leur donner des informations. Cette brochure doit conduire au renforcement des partenariats de terrain.
Je rappelle que les partenaires sociaux, et je leur rends hommage, ont introduit une disposition fondamentale dans la nouvelle convention d'assurance chômage pour les femmes victimes de violences. Désormais, une femme qui quitte son domicile à la suite de violences et qui doit démissionner de son emploi pourra bénéficier de l'assurance chômage. Elle ne sera donc plus dans une situation aussi précaire qu'avant. Il s'agit là, madame David, d'une avancée incontestable.
Parallèlement à ces actions nationales, je saluerai les très nombreuses initiatives locales, notamment l'action de sensibilisation des médecins généralistes menée par le service des droits des femmes dans le Lot-et-Garonne : accompagnement, informations sur les adresses à donner à ces femmes ou indications sur la façon de rédiger un certificat médical.
J'ai demandé au service des droits de femmes d'étendre cette initiative à l'ensemble des départements. Un CD-Rom a été réalisé, des conférences ont été organisées et des premiers contacts sont envisagés avec l'Ordre national des médecins.
Le traitement judiciaire des violences a également fait l'objet de nombreuses améliorations et recommandations.
Le ministère de la justice a diffusé en septembre 2004, à 10 000 exemplaires, un guide de l'action publique relatif à la lutte contre les violences conjugales. Ce guide est bien sûr consultable sur le site Internet de la Chancellerie. Il s'agit d'un outil de sensibilisation des professionnels, qui met l'accent sur la nécessité de renforcer le partenariat entre les magistrats du parquet et ceux du siège.
La loi du 26 mai 2004 relative au divorce oblige le juge aux affaires familiales à prévenir, en amont et en aval, de la procédure d'éviction du partenaire violent.
Vous m'avez demandé, madame la présidente de la délégation, de vous fournir quelques chiffres. L'action du ministère de la justice a porté ses fruits puisque le nombre de condamnations pour violences conjugales est passé de 7 537 en 2002 à 9 767 en 2005. Par ailleurs, 385 mesures d'éloignement du conjoint violent ont été prises pour l'ensemble de l'exercice 2005.
Je ne dirai pas que l'on ne peut pas progresser davantage. Néanmoins, il me semble que la mécanique est enclenchée et que nous devons maintenant faire preuve de vigilance pour aller encore plus loin.
À la suite de la loi du 4 avril, le garde de sceaux a publié une circulaire en date du 19 avril 2006, qui présente aux magistrats les dispositions nouvelles de la loi et rappelle les principales orientations de politique pénale exposées dans le guide de l'action publique.
Cette circulaire établit un protocole de recueil de la plainte et précise la chronologie du processus judiciaire afin d'accroître l'efficacité des circuits d'information et d'améliorer la qualité des enquêtes, des procédures et des décisions de justice. Elle recommande également aux parquets un traitement des procédures en temps réel et indique, pour ce faire, les modes de poursuites qu'il convient de privilégier au regard des particularités de ce contentieux.
Je rappelle que l'éviction du conjoint violent au stade pré-sentenciel est recommandée dans le cadre d'une alternative aux poursuites et surtout d'un contrôle judiciaire requis par le procureur de la République. Dans cet esprit, il est tout à fait possible d'étendre des initiatives aussi remarquables que celles que nous connaissons à Douai.
La circulaire réaffirme également la nécessité de développer les partenariats afin d'améliorer la prise en charge, tant des victimes que des auteurs de violence. Elle prévoit ainsi que « le parquet pourra [...] requérir systématiquement l'association d'aide aux victimes compétente ». Elle demande également au parquet d'être attentif au sort réservé aux enfants des couples confrontés à cette violence.
Par ailleurs, la même circulaire préconise que la médiation pénale soit seulement utilisée dans des cas très précis, car cette procédure met à égalité les conjoints. Or il ne faut pas oublier que l'un est agresseur et l'autre victime.
Enfin, en 2005, l'École nationale de la magistrature a intégré dans sa formation initiale un module destiné à sensibiliser les futurs magistrats à la situation particulière de la victime dans le processus pénal. Ce module vise également à informer ceux-ci des dispositifs associatifs et institutionnels existants.
Dans le guide des professionnels diffusé au mois de novembre dernier figure également un certificat type accompagné de directives précises.
Certes, il convient d'aller vers plus d'harmonisation, tout en respectant le principe de la prescription médicale.
Enfin, il ne faut jamais oublier qu'il revient au juge d'apprécier les faits de manière définitive et de les qualifier. J'ai bien entendu vos remarques, monsieur Courteau, au sujet des ITT, qui sont déterminées différemment d'une région à l'autre, et je mesure l'ampleur des démarches à conduire.
Par ailleurs, vous avez appelé mon attention sur la dénonciation calomnieuse. Nous savons tous ici combien ce sujet est délicat. Pour autant, le délit n'est constitué que si la mauvaise foi est prouvée, et cela relève, bien sûr, de la compétence du juge. Je suis certaine que, dans les mois et les années à venir, la jurisprudence et les textes devront évoluer.
Comme vous pouvez le constater, les progrès accomplis sont importants. Cependant, l'ampleur des violences doit nous conduire à poursuivre notre effort. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité donner une impulsion nouvelle à notre action en annonçant, à l'occasion de la journée du 25 novembre, différentes mesures spécifiques répondant à des besoins concrets, voire vitaux, des victimes de violences.
Je voudrais dire un mot de la façon dont il est possible d'améliorer l'écoute des femmes et l'attention portée aux enfants témoins, et victimes, de ces violences.
Nous mettrons en place, dès le mois de février, un numéro d'appel unique à quatre chiffres, donc facile à retenir, et de faible coût, celui d'une communication locale.
Surtout, ce nouveau dispositif devra être accessible partout en France et chacun devra bénéficier de la même qualité d'écoute. Nous veillerons, bien sûr, à ce que ce nouveau dispositif puisse faire face à l'augmentation du nombre d'appels que suscitera un numéro plus identifiable et plus aisé à mémoriser.
Les frais supplémentaires engagés pour la mise en place de ce dispositif seront supportés par mon ministère dans l'enveloppe 2007 dédiée aux violences conjugales.
J'ai été attentive à ce que la question des enfants témoins de violences conjugales soit intégrée dans les travaux de la réforme de la protection de l'enfance, car les enfants sont trop souvent les victimes indirectes de ce type de violence. Au moins dix enfants sont morts l'année dernière à la suite de violences conjugales. Ils sont, en quelque sorte, les victimes collatérales de ces drames intrafamiliaux. J'ai demandé qu'une collaboration soit développée sur cet aspect avec l'Observatoire national de l'enfance en danger.
Par ailleurs, plusieurs mesures visant à faciliter l'hébergement et le relogement des femmes victimes de violences seront prises dans le courant de l'année 2007.
Dans une circulaire du 24 mars 2005, il a été demandé aux préfets d'élaborer, en collaboration avec les collectivités territoriales et le secteur associatif, un diagnostic partagé des réponses offertes et des besoins à satisfaire en matière d'accueil, d'hébergement et de logement des femmes victimes de violences. Des conventions seront ensuite passées entre l'État, les conseils généraux et les associations afin d'améliorer les réponses apportées.
D'ores et déjà, plusieurs mesures ont été prises pour faciliter l'hébergement et le relogement des femmes victimes de violences.
Je partage l'analyse des différents orateurs sur ce problème. J'ai cherché, durant ces dix-huit derniers mois, à élargir la palette des solutions, car derrière chaque cas de violence se trouve une histoire personnelle. Nous ne pouvons donc pas, dans ce domaine comme dans d'autres, proposer une seule solution. Chaque femme a des besoins spécifiques et nous devons essayer d'apporter les réponses les plus appropriées.
C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité expérimenter l'hébergement en famille d'accueil. Nous avons contacté les DDASS, les départements. Très concrètement, nous avons démarré cette expérimentation au mois de septembre 2006 dans la Drôme, l'Ardèche et à la Réunion.
C'est une formule qui, dans certains cas, semble répondre à des besoins. Je n'ai pas suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir si cette voie doit être amplifiée. Je peux simplement dire que, lorsque les femmes ont besoin d'être très entourées, il s'agit probablement de l'une des réponses possibles.
Les femmes victimes de violences sont aujourd'hui prioritaires pour l'attribution de logements financés par l'allocation logement temporaire - près de 20 000 de ces logements sont budgétés en 2007 - et pour les 600 places nouvelles de CHRS prévues en 2007.
Il ne vous a pas échappé que, ces dernières semaines, j'ai été conduite à travailler de façon très approfondie sur l'ensemble du dossier de l'urgence dans notre pays.
Nous allons mettre en place de nombreuses mesures en matière d'urgence. Nous étudions de très près certaines offres alternatives de logement, afin de proposer des places particulièrement dédiées aux femmes avec enfants ; je pense notamment aux actions menées avec les nombreuses maisons relais.
Par ailleurs, je souligne que j'ai pratiquement achevé les négociations avec l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, et l'Union nationale de la propriété immobilière, l'UNPI, en ce qui concerne les bailleurs sociaux et privés pour qu'ils acceptent de lever la clause de solidarité contenue dans le bail, dans le cas où la personne victime de violences quitte son domicile et souhaite donner congé à son bailleur.
De la même manière, la réglementation devrait être prochainement modifiée pour que, en cas de demande de divorce, seuls les revenus du conjoint faisant effectivement acte de candidature soient pris en compte pour l'attribution d'un logement social.
Je poursuis également le travail concernant le traitement des hommes violents.
Votre délégation, madame la présidente, a souhaité que soient mises en place, en relation avec les associations, des formations destinées aux hommes violents. Quelques associations ont d'ores et déjà reçu des financements tant au niveau national qu'à l'échelon local.
Dans la continuité des travaux conduits par le docteur Roland Coutanceau, un groupe de travail a été mis en place à ma demande, en juillet 2006. Il est composé de représentants des ministères de l'intérieur, de la justice, de la santé, de la cohésion sociale, ainsi que de personnalités qualifiées.
Sa première mission est d'évaluer les progrès réalisés et l'efficience des dispositifs existants en matière de prise en charge et de suivi des hommes auteurs de violences.
Ce groupe de travail a déjà recensé une soixantaine de structures de soins et d'hébergement pour les auteurs de violences. Il va désormais s'attacher à définir un dispositif global d'intervention auprès des auteurs de violence.
En 2007, un protocole de bonnes pratiques va être réalisé pour susciter la création de nouvelles structures prenant en charge les auteurs de violences et pour les fédérer autour d'une pratique professionnelle commune, car, là encore, je crois que les échanges de bonnes expériences sont un élément extrêmement important.
Nous finalisons une plaquette d'information et de sensibilisation à destination des auteurs de violences pour leur rappeler la gravité de leurs actes et les sanctions qu'ils encourent.
Enfin, je voudrais aborder la question générale de l'information sur les violences et répondre aux différentes demandes qui ont été formulées.
Concernant, tout d'abord, le chiffrage des infractions liées aux violences au sein du couple, plusieurs initiatives ont été prises.
Une enquête du ministère de l'intérieur a recensé pour les neuf premiers mois de l'année 2006 les morts violentes survenues au sein du couple. Vous connaissez tous ce chiffre ; nombre d'entre vous l'ont cité.
L'INSEE et l'Institut national des hautes études de sécurité préparent le lancement, en 2007, d'une véritable enquête de victimation, au sens des enquêtes nationales anglo-saxonnes. Les résultats sont attendus pour 2007.
L'enquête « violences et santé » lancée par la direction des études de mon ministère va intégrer, comme vous nous l'aviez demandé, la dimension sexuée.
Lors de mon déplacement à la Martinique - car le phénomène des violences est tout aussi dramatique dans les départements d'outre-mer qu'en métropole -, je me suis engagée à soutenir une étude sur les violences entre les sexes. L'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France n'a en effet pas été conduite dans ce département. Elle le sera grâce aux crédits que j'ai délégués à cette fin pour l'exercice 2007.
Vous souhaitiez qu'une étude soit menée sur le coût budgétaire et le coût social des violences au sein du couple. J'ai demandé à une équipe du CNRS d'effectuer cette étude. Les premiers résultats provisoires rendus publics au mois de novembre 2006 ont identifié de nombreux domaines d'impact de ces violences et ont permis d'évaluer a minima à plus d'un milliard d'euros le coût lié aux violences conjugales. Cette enquête sera poursuivie au cours de l'année 2007.
Pour mieux prévenir ces violences, changer le regard que la société porte sur elles, il est indispensable de mieux informer nos concitoyens.
Une campagne sur les violences au sein du couple, constituée d'une dizaine de courts métrages d'auteurs et de cinéastes reconnus, a débuté le 25 octobre dernier. Ces courts métrages traitent notamment des conséquences des violences sur les femmes enceintes et les enfants, ou encore de leurs répercussions sur le travail. Ils sont diffusés à la télévision, dans les salles de cinéma, dans les festivals français et étrangers, et distribués sous la forme d'un DVD.
En ce qui concerne la sensibilisation des jeunes garçons, j'ai signé avec mon collègue Gilles de Robien une convention pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, dans le système éducatif. Elle place le respect, la lutte contre les stéréotypes sexistes et l'égalité parmi les valeurs qui doivent être mises en avant à l'école.
Le comité de suivi sera installé le 13 février prochain et nous pourrons, à ce moment-là, mesurer effectivement la portée des actions menées dans les établissements scolaires.
Vous m'avez interrogée sur le respect de l'image de la femme.
Mon ministère a signé, voilà plusieurs années, une convention avec le Bureau de vérification de la publicité et, chaque année, au printemps, nous examinons avec ses représentants ce qu'ils appellent leur « pige » annuelle, c'est-à-dire l'ensemble des publicités qui ont été interdites parce qu'elles donnaient une image dégradante de la femme.
Vous avez, madame David, fait allusion au rejet d'amendements sur l'information. Ce rejet, j'y insiste, n'était absolument pas lié à un désaccord de fond ; il se fondait exclusivement sur le caractère réglementaire de ces amendements.
Par ailleurs, une campagne du Conseil de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes, y compris les violences domestiques, a été lancée à Madrid le 27 novembre dernier. J'ai tenu à participer au lancement de cette campagne, qui, comme l'a souligné tout à l'heure M. Branger, durera jusqu'en 2008.
Je partage d'ailleurs l'analyse de M. Branger. Il est important que nous puissions échanger nos expériences avec tous nos partenaires européens afin de lutter contre ce fléau. Nous devons regarder avec beaucoup de gravité les chiffres, qui, malheureusement, dans de nombreux pays, notamment ceux du nord de l'Europe, l'Espagne ou la France, restent, encore aujourd'hui, dramatiquement élevés.
En conclusion, j'aimerais répondre aux voix qui se sont élevées récemment pour demander l'adoption d'une loi-cadre qui traiterait de l'ensemble des violences commises contre les femmes.
La France dispose à l'heure actuelle d'une législation abondante qui couvre très largement le champ des mesures nécessaires à la protection des femmes contre les violences qui leur sont faites. Cette législation est-elle suffisante ? Nos codes sont-ils suffisamment précis en matière de prévention et d'information ? Sont-ils pertinents pour traiter toutes les formes de violence ? Ce n'est pas certain !
C'est pourquoi je n'écarte pas a priori l'idée selon laquelle la France doit encore élargir la panoplie des mesures dont elle dispose. La lutte contre les violences faites aux femmes, au sein du couple ou non, est en effet à mes yeux une priorité absolue.
Il est indispensable que nous puissions réunir dans un code la totalité des textes concernant les droits des femmes.
La connaissance de ces dispositions est essentielle pour renforcer la prévention des violences et la protection des femmes. Pour mieux les connaître, il nous faut, me semble-t-il, engager sans attendre la parution d'un code des droits des femmes, comme il existe un code des droits contre l'exclusion, ne serait-ce que pour avoir une vision exhaustive des droits des femmes, que celles-ci ont parfois conquis de haute lutte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le tabou des violences a mis du temps à disparaître dans notre pays. La dynamique qu'ensemble nous avons enclenchée est forte. Rien n'est jamais acquis. Nous avons le devoir de maintenir notre vigilance, de poursuivre sans relâche notre action.
Je sais que la Délégation aux droits des femmes de votre assemblée agira au quotidien, telle la vigie qui ne manquera pas de rappeler à chacun ses responsabilités. Nous sommes tous conscients que la loi peut beaucoup, mais nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que, au-delà de la loi, c'est la mobilisation de chacun, une mobilisation citoyenne de tous les instants, qui nous permettra de changer définitivement les mentalités.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

En application de l'article 83 du règlement, je constate que le débat est clos.

J'ai reçu de M. Jean Louis Masson une proposition de loi tendant à préciser certaines modalités de contrôle des financements politiques et des campagnes électorales.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 173, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3397 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3398 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3399 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3400 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3401 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3402 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3403 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3404 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3405 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3406 et distribué.
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3407 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3408 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3409 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3410 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3411 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3412 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3413 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/EC instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3414 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3415 et distribué.

J'informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme de la protection juridique des majeurs (n° 172, 2006-2007) dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale est saisie au fond, est renvoyé pour avis à sa demande, à la commission des affaires sociales.

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 24 janvier 2007, à quinze heures et le soir :
1. Discussion du projet de loi (n° 31, 2006 2007) relatif à l'expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens.
Rapport (n° 161, 2006 2007) de Mme Catherine Troendle, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
2. Discussion du projet de loi (n° 155, 2006 2007), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
Rapport (n° 163, 2006 2007) de M. Gilbert Barbier, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (n° 22, 2005-2006) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 24 janvier 2007, à dix-sept heures.
Projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 170, 2006-2007) (urgence déclarée) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 29 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 29 janvier 2007, à seize heures.
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats (n° 125, 2006-2007) ;
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (n° 133, 2006-2007) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : mercredi 31 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 29 janvier 2007, à seize heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures quarante.