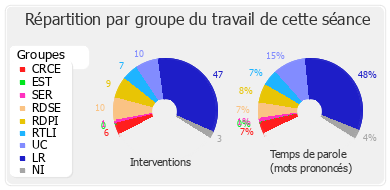Séance en hémicycle du 1er décembre 2015 à 14h30
Sommaire
- Organisme extraparlementaire (voir le dossier)
- Retrait de deux questions orales
- Loi de finances pour 2016 (voir le dossier)
- Compte d'affectation spéciale : services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (voir le dossier)
- Demande de création d'une mission d'information
- Loi de finances pour 2016
La séance
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.

La séance est reprise.

M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.
Conformément à l’article 9 du règlement, la commission des finances a été invitée à présenter la candidature d’un sénateur pour siéger en qualité de membre titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire.

J’informe le Sénat que les questions orales n° 1270 de M. Roland Courteau et n° 1279 de M. Vincent Delahaye sont retirées du rôle des questions orales, à la demande de leur auteur.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 163, rapport général n° 164, avis n° 165 à 170).
seconde partie
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Nous poursuivons l’examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » (et article 51 ter), du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et des comptes d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
La parole est à M. Jean-François Husson, rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en 2016, la mission « Écologie, développement et mobilité durables » contribuera largement à la réduction des dépenses publiques, par une diminution de ses autorisations d’engagement de l’ordre de 8 % et une baisse de ses crédits de paiement de près de 2 %. En outre, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie connaîtra une réduction de 671 emplois, soit plus de 2 % de ses effectifs, ce qui en fera le deuxième contributeur, derrière le ministère des finances et des comptes publics.
La mission fait l’objet d’un traitement budgétaire rigoureux depuis au moins quatre exercices, aussi bien en loi de finances initiale qu’en exécution, du fait d’annulations très substantielles de ses crédits.
Les efforts ainsi demandés au ministère, sans adaptation concomitante de ses missions, font peser plusieurs risques. Les services comme les opérateurs atteignent leurs limites et ont du mal à assurer le renouvellement des compétences humaines, ce qui menace le niveau d’expertise qu’ils peuvent apporter dans la mise en œuvre des politiques en faveur de l’environnement. En outre, la plupart d’entre eux se trouvent aujourd’hui dans une situation de sous-investissement chronique qui les oblige à ponctionner leur fonds de roulement et fragilise leur situation financière. Enfin, l’absence de visibilité sur leurs ressources peut entraver leur capacité à lancer des projets et des interventions.
Mes chers collègues, vous comprendrez que cette situation rende de plus en plus difficile la mise en œuvre des politiques définies par le ministère et ses opérateurs et fasse peser une incertitude sur l’atteinte des objectifs qui nous sont assignés par les directives européennes dans le domaine environnemental, qu’il s’agisse de l’eau, de la biodiversité ou de la qualité de l’air.
Certes, il ne faut pas réduire les moyens d’une politique aux crédits budgétaires qui lui sont alloués. En l’espèce, les ressources extrabudgétaires sont nombreuses, entre les dépenses fiscales, le programme d’investissements d’avenir, la contribution au service public de l’électricité, la fameuse CSPE, ou bien encore les certificats d’économies d’énergie.
Cependant, le Parlement ne dispose que d’une information partielle, voire inexistante, …

… et d’un pouvoir de contrôle des plus limités sur l’évolution, l’usage et l’efficacité de ces moyens, ce qui plaide pour un enrichissement des documents budgétaires dans ce domaine.
Au-delà, je veux insister sur les nombreux défauts qui entachent la politique du Gouvernement dans les domaines écologique, énergétique et environnemental.
Vous le savez, la fin de l’année 2015 et l’année 2016 s’inscrivent dans un contexte particulier, avec l’organisation, en ce moment même, à Paris, de la COP 21, mais aussi avec la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Or le budget pour 2016 ne paraît pas suffisamment ambitieux à cet égard. Plus grave, on ne distingue ni cohérence ni stratégie claire de la part du Gouvernement. Au contraire, nous relevons des contradictions.
Je vais illustrer mon propos par quelques exemples.
Dans le domaine de l’eau et de la biodiversité, on ne peut que regretter le peu d’empressement du Gouvernement à inscrire à l’ordre du jour du Sénat l’examen en séance publique du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, alors même que ce texte a été présenté en conseil des ministres en mars 2014 et examiné à l’Assemblée nationale il y a maintenant plus de six mois. Ce retard a bien évidemment pour conséquence de différer la création de l’Agence française pour la biodiversité, un opérateur qui doit regrouper plusieurs établissements œuvrant dans le domaine de la biodiversité terrestre et marine et qui offre, par ailleurs, d’intéressantes perspectives de mutualisation.
Dans le domaine de la transition énergétique, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, le CEREMA, jeune opérateur issu, en 2014, de la fusion de onze services et ayant notamment pour vocation d’apporter à l’État et aux acteurs territoriaux un appui d’ingénierie et d’expertise sur les projets d’aménagement, voit sa montée en puissance compromise par une réduction très marquée de ses moyens. Cette situation est regrettable, parce que cet opérateur a vocation à devenir un partenaire précieux des collectivités locales dans le contexte actuel de la réforme territoriale et de la baisse de leurs dotations.
Dans le domaine de la lutte contre la pollution, il me paraît prématuré de réduire le montant des bonus accordés aux véhicules hybrides, alors que la vente de voitures de ce type a enfin commencé à prendre son essor en 2015. Je relève cependant avec satisfaction que le bonus en faveur des véhicules électriques sera maintenu à son niveau actuel, ce qui paraît de nature à conforter la dynamique constatée cette année. Par ailleurs, 30 millions d’euros de crédits supplémentaires seront ouverts pour financer l’extension de la prime à la conversion des véhicules diesel de plus de dix ans, contre quatorze ans auparavant.
Enfin, dans le domaine fiscal, le projet de loi de finances pour 2016 ne comporte en fait que très peu de dispositions en faveur de la transition écologique. Si le collectif budgétaire comporte un ensemble de mesures de fiscalité énergétique, en lien avec la réforme de la CSPE, le Gouvernement semble, là encore, ne pas avoir de stratégie globale et cohérente, puisqu’il a fait adopter par l’Assemblée nationale, de façon isolée, dans le cadre de la loi de finances pour 2016, une hausse du prix du diesel ayant vocation à financer des mesures en faveur des ménages modestes, et non des actions en faveur de l’environnement ou au service de la transition énergétique.
En conclusion, mes chers collègues, la commission des finances recommande de ne pas adopter les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

M. Jean-François Husson, rapporteur spécial. En revanche, elle préconise l’adoption des crédits du compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres ».
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur spécial, et M. André Gattolin applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vais vous présenter les programmes 203, « Infrastructures et services de transports », et 205, « Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture », de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », dont je suis le corapporteur, au même titre que Jean-François Husson et Vincent Capo-Canellas. Je vous présenterai également les crédits du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
Comme les années précédentes, je regrette que le budget des infrastructures et services de transport ne constitue pas une mission à part entière, alors qu’il représente un enjeu financier et socio-économique considérable pour notre pays.
Le programme 203, dont je suis le rapporteur, ne présente qu’une partie des dépenses consacrées aux transports, en raison du rôle majeur joué par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, dans le financement des grandes infrastructures.
Établissement public administratif créé en 2004, l’AFITF est financée par des taxes qui lui sont affectées par l’État, auquel elle reverse ensuite une partie de son budget sous forme de fonds de concours, en ayant préalablement « fléché » les sommes ainsi reversées vers des projets précis, qu’il s’agisse des routes, du ferroviaire ou encore du fluvial.
Or, contrairement aux crédits budgétaires, les fonds de concours ne sont qu’évaluatifs et le Parlement ne dispose pas du budget initial de l’AFITF au moment où il examine le projet de loi de finances. En fait, comme le rappelle la Cour des comptes à propos de l’Agence, « l’ampleur du recours à la technique des fonds de concours en provenance de cet établissement permet au ministère de disposer d’une masse de ressources reportables de droit et sans limite ».
Si je ne plaide pas pour une suppression de l’AFITF, je regrette que le circuit budgétaire du financement des infrastructures rende très difficile, voire impossible, de connaître le montant qui leur est effectivement consacré.
Depuis sa création, I’AFITF a engagé 33 milliards d’euros. Selon les éléments qui m’ont été transmis, elle pourrait disposer, en crédits de paiement, de 1, 85 milliard d’euros pour ses dépenses d’intervention en 2016. À la fin de l’année 2015, il lui restait à mandater une somme d’environ 11, 85 milliards d’euros – concernant, à 63 %, le transport ferroviaire –, soit un montant correspondant à plus de six exercices, au regard de son budget actuel. Son équilibre financier apparaît donc pour le moins instable. Selon Philippe Duron, son président, l’Agence aurait besoin de pouvoir décaisser environ 2, 2 milliards d’euros chaque année pour faire face à ses engagements.
Comme vous vous en souvenez, mes chers collègues, l’AFITF aurait dû bénéficier des recettes de l’écotaxe. Or, non seulement elle n’a pas perçu ces recettes, mais elle a dû payer les indemnités accordées à Ecomouv’ en raison de la résiliation du contrat qui liait ce consortium à l’État.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, j’avais estimé à 830 millions d’euros environ la somme totale que devrait débourser l’État à la suite du fiasco de l’écotaxe. L’ardoise est, en réalité, beaucoup plus lourde, puisqu’elle s’élèvera à 969, 2 millions d’euros, montant entièrement financé par l’État, donc par le contribuable, via l’AFITF.
Pour remplacer les recettes que l’Agence aurait dû percevoir au titre de l’écotaxe et lui permettre de faire face aux décaissements engendrés, en 2015, par la résiliation du contrat, la loi de finances pour 2015 lui avait affecté la totalité du produit d’une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, sur le gazole pour les véhicules légers, à raison de 2 centimes d’euros par litre, et le déremboursement d’une partie de l’exonération sur le gazole des poids lourds, à hauteur de 4 centimes d’euros par litre, soit une somme de 1 139 millions d’euros pour l’année 2015.
Les décaissements liés à la résiliation du contrat liant l’État à Ecomouv’ étant nettement moins importants en 2016, l’article 14 du présent projet de loi de finances prévoyait que l’État n’affecterait, l’an prochain, à l’AFITF qu’une fraction du produit du relèvement de la TICPE, pour un montant de 715 millions d’euros.
La situation financière de l’AFITF étant très dégradée, le Sénat a décidé de lui affecter de nouveau, en 2016, l’intégralité du relèvement de la TICPE. J’espère, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement acceptera de faire évoluer sa position sur ce dossier crucial pour le financement de nos infrastructures de transport.
J’en viens au programme 203 proprement dit.
Les crédits qui lui sont alloués connaissent une légère diminution. Sur les 3, 2 milliards d’euros du programme, l’essentiel de la dépense est constitué par la subvention, d’un montant de 2, 5 milliards d’euros, versée à SNCF Réseau, ex-Réseau ferré de France. L’entretien routier et la subvention à l’établissement public Voies navigables de France subiront, pour leur part, une légère érosion par rapport à 2015.
Pour les différentes raisons que j’ai évoquées précédemment – absence de mission propre aux transports, illisibilité du budget qui leur est consacré, situation financière dégradée de l’AFITF et sous-évaluation délibérée du coût, pour le citoyen, du fiasco de l’écotaxe –, la commission des finances propose au Sénat de rejeter les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».
J’en viens maintenant au programme 205, « Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture ». La dotation attendue pour 2016, en baisse par rapport à 2015, s’élève à 187, 3 millions d’euros en autorisations d’engagements et 184, 8 millions d’euros en crédits de paiement.
Le soutien au secteur des transports maritimes, via des exonérations de cotisations sociales patronales, absorbe 34, 7 % des crédits du programme, soit 64, 5 millions d’euros. Le transport maritime français est en effet confronté à une concurrence internationale exacerbée dans le contexte de la mondialisation. Ces crédits baisseront en 2016 en raison des pertes d’emplois dans le transport de passagers ; en revanche, les crédits consacrés aux missions régaliennes de sécurité et de sûreté en mer et à la formation des marins resteront stables.
Je dirai enfin un mot sur le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Ce compte regroupe les crédits destinés à financer les trains d’équilibre du territoire – les TET –, c’est-à-dire une trentaine de lignes structurellement déficitaires dont l’exploitation est assurée par SNCF Mobilités, sous l’autorité de l’État.
Historiquement, la SNCF assurait une péréquation interne entre ses TGV, excédentaires, et les TET, déficitaires. Depuis 2010, l’État affecte des taxes au présent compte d’affectation spéciale afin de compenser le déficit d’exploitation de SNCF Mobilités dû aux TET, ainsi que la régénération du matériel roulant.
Le déficit d’exploitation de ces lignes s’est aggravé ces dernières années, la fréquentation des TET ayant diminué de 20 % depuis 2011, notamment en raison de l’essor du covoiturage. Pour tenir compte de cette réalité, les crédits de ce compte atteindront 216, 2 millions d’euros en 2016, soit une hausse significative de 13, 3 % par rapport à 2015.
La commission des finances a reconnu la nécessité de renouveler le matériel roulant de l’ensemble des lignes TET, qu’elle préconise de maintenir, tout en soulignant que la moyenne d’âge de ce matériel est de trente-cinq ans. Le Gouvernement a annoncé le renouvellement, d’ici à 2025, du matériel roulant sur les lignes TET structurantes.
La commission des finances propose donc au Sénat d’adopter les crédits de ce compte d’affectation spéciale sans modification.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, mes chers collègues, je vais vous présenter le programme 170 « Météorologie », ainsi que le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », dont je suis le rapporteur spécial.
Le programme 170 « Météorologie » retrace la principale subvention de l’État à l’opérateur Météo-France pour un montant de 199, 8 millions d’euros, en baisse de 4 millions d’euros par rapport à 2015.
Ainsi, l’augmentation du budget prévisionnel de Météo-France pour l’année 2016, en hausse de 5 % – à environ 405, 6 millions d’euros – par rapport aux crédits ouverts pour 2015, constitue en réalité un trompe-l’œil : elle s’explique uniquement par la hausse de la subvention inscrite au programme 193 destinée à financer la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques EUMETSAT qui ne fait que « transiter » par le budget de Météo-France. Si l’on exclut cette subvention, le budget de l’opérateur baissera en réalité de 3, 8 millions d’euros en 2016. Les crédits du programme 170 diminuent donc pour la quatrième année consécutive.
Après la suppression de 85 équivalents temps plein travaillé en 2015, Météo-France verra ses effectifs diminuer de 78 équivalents temps plein travaillé en 2016, ce qui permettra de réduire la masse salariale de 5, 5 millions d’euros par rapport à 2015.
Cet effort considérable a des conséquences sur le réseau, dont la réorganisation, décidée en 2008 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, ou RGPP, visait à réduire sur la période 2012-2016 de 108 à 55 le nombre d’implantations locales de l’opérateur, afin de ne conserver que 7 directions interrégionales et 48 centres météorologiques et stations spécialisées. D’ici à la fin de 2015, 45 fermetures seront intervenues ; 8 autres suivront en 2016.
Il faut aussi souligner la poursuite de la baisse des dépenses de fonctionnement de Météo-France puisque, selon son budget prévisionnel, l’établissement entend réaliser 2 millions d’euros d’économies sur ce poste, soit un recul notable de près de 5 %.
En dépit de ces efforts considérables et de ces mesures de rigueur interne, Météo-France aura recours, pour la troisième fois d’affilée en 2016, à un prélèvement de 1, 1 million d’euros sur son fonds de roulement pour combler son déficit d’exploitation.
En 2016, quelque 22 millions d’euros seront consacrés aux investissements, en particulier à la modernisation des réseaux d’observation – radars, réseaux au sol, radiosondage – et au renouvellement des équipements de stockage des données.
Lors de son audition, le président-directeur général de Météo-France a mis en avant sa volonté de « rehausser la courbe de l’investissement à partir de 2017 », ce qui me paraît légitime.
L’activité de prévision devient en effet de plus en plus intensive en capital et repose sur des technologies de calcul de plus en plus puissantes. Ainsi, comme je l’avais souligné l’année dernière, le Royaume-Uni s’est récemment doté d’un supercalculateur, quinze fois plus puissant que celui de Météo-France, pour un montant de 120 millions d’euros. Si Météo-France veut maintenir son rang, il sera donc contraint d’investir davantage à l’avenir. Pour y parvenir, il lui faudra nécessairement augmenter ses ressources commerciales. Le contrat d’objectifs et de performance qui sera négocié en 2016 devrait mettre l’accent sur ce point.
Dans cette perspective, l’établissement public devra se concentrer sur deux axes : premièrement, reconquérir des parts de marché dans le secteur des services au grand public en prenant pleinement en compte l’évolution des usages – le profond renouvellement du site internet en 2013 et celui de l’application mobile à l’été de 2015 vont déjà dans ce sens et ont permis de développer l’offre commerciale en ligne qui bénéficie d’environ un million de visites quotidiennes – ; deuxièmement, accroître le volume des prestations météorologiques aux professionnels, un marché estimé à 40 millions d’euros environ pour le territoire français en 2014 et dont Météo-France détient déjà 50 %. Selon l’opérateur, 40 % des entreprises seraient en effet « météo-sensibles », c’est-à-dire ayant besoin d’informations météorologiques.
Compte tenu des efforts réalisés par Météo-France pour réduire ses dépenses, les crédits du programme 170 appelaient de ma part un avis favorable, certes nuancé par la crainte que ces ressources ne se révèlent insuffisantes à l’avenir. Toutefois, eu égard à l’avis de mes corapporteurs sur l’ensemble des autres programmes de la mission « Écologie », j’ai proposé, avec eux, que la commission des finances rejette l’ensemble des crédits de la mission.
Pour clore le chapitre relatif à Météo-France, je voudrais vous faire part de mon étonnement et de ma désapprobation devant la lenteur avec laquelle l’État a tranché la question du renouvellement dans ses fonctions du président-directeur général de Météo-France. L’établissement est ainsi resté six mois avec un président intérimaire, ce qui ne me paraît pas la meilleure des choses.
J’en viens à présent au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », dit « BACEA », lequel retrace les activités de production de biens et de prestation de services de la direction générale de l’aviation civile, la DGAC.
Hors emprunt, les recettes de ce budget annexe devraient s’élever en 2016 à un peu plus de 2 milliards d’euros, en croissance de 1 % par rapport à 2015.
Il s’agit, pour l’essentiel, de redevances acquittées par les acteurs du transport aérien en rémunération des services rendus par la DGAC, ainsi que de la taxe de l’aviation civile, la TAC, due par les entreprises de transport aérien et dont le montant s’élève à 393, 9 millions d’euros en 2016.
Ce budget annexe étant approvisionné par des recettes provenant exclusivement du secteur du transport aérien, il est corrélé à l’évolution de ce dernier. Si le trafic aérien a connu une forte croissance de 45 % entre 2003 et 2014, la part du pavillon français est passée de 54, 3 % en 2003 à 44, 8 % en 2014. Ce chiffre traduit la forte concurrence des compagnies à bas coût et des compagnies du Golfe sur lesquelles nous aurons l’occasion de nous interroger. Face à ces acteurs agressifs, un certain nombre de compagnies françaises, en particulier Air France, ont du mal. Je n’aurai malheureusement pas le temps de m’attarder sur ce point.
Nous pouvons envisager quatre mesures pour soutenir le transport aérien : affecter 100 % de la TAC au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », ce qui permettrait à la DGAC, par acte réglementaire, de baisser à due concurrence les redevances aéroportuaires pesant sur les compagnies françaises ; élargir la base de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite « taxe Chirac », même si je mesure combien ce point est délicat ; alléger les cotisations sociales sur le personnel navigant, mesure qui nécessitera sans doute une négociation européenne ; enfin, réfléchir à une évolution de la taxe de sûreté, l’État pouvant peut-être y prendre davantage sa part.
L’effort d’investissement au titre du BACEA se réduit légèrement, de l’ordre de 1, 9 %, pour atteindre 252, 6 millions d’euros. La hausse très forte des investissements consentis ces dernières années permettra cependant d’assurer le respect des engagements.
Enfin, alors que la dette du BACEA n’avait cessé d’augmenter, nous ne pouvons que saluer la réduction du niveau d’endettement, lequel, après avoir été diminué de 57, 2 millions d’euros en 2015, baissera de 107 millions d’euros en 2016.
En conclusion, la commission des finances propose au Sénat d’adopter les crédits du budget annexe.
Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je dirai un mot tout d’abord du programme 174, « Énergie, climat et après-mines », dont notre commission des affaires économiques s’est saisie pour avis.
La quasi-totalité des crédits couvrant les droits des anciens mineurs sont en baisse cette année, ce qui est logique au regard de l’évolution démographique.
Pour le reste, je regrette que l’action dédiée à la « lutte contre le changement climatique », qui finance le dispositif national de surveillance de la qualité de l’air, voie ses crédits diminuer à nouveau de 6 %, sans qu’aucune explication soit fournie et alors même que nous accueillons la COP 21.
Fort heureusement, les ressources dédiées à la politique énergétique vont bien au-delà de ce seul programme : si l’on inclut la TVA réduite sur la rénovation énergétique des logements, la dépense fiscale atteindra l’an prochain près de 3, 5 milliards d’euros. Elle sera notamment marquée par la montée en charge du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE.
À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous vous engager à évaluer l’efficacité de ce crédit d’impôt contesté ? Je pense en particulier à l’étude récente de l’UFC-Que Choisir qui le juge coûteux, sans effet d’entraînement sur le marché et orientant mal les dépenses des ménages, car fondé sur la nature des équipements et non sur le niveau de performance énergétique.
Nous nous interrogeons également sur le financement de la transition énergétique, objet de circuits extrabudgétaires complexes : un fonds de financement géré par la Caisse des dépôts et consignations, une enveloppe spéciale créée en son sein, le tout doté, en théorie, de 1, 5 milliard d’euros sur trois ans. Le problème est que, à ce jour, le compte n’y est pas : en additionnant toutes les ressources annoncées, il manque encore 150 millions d’euros. Qu’en sera-t-il exactement ?
À l’opposé, je me réjouis de la budgétisation annoncée de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, dont nous discuterons dans le cadre du collectif, ce qui apportera de la clarté et facilitera le contrôle parlementaire.

Enfin, au-delà de ce projet de loi de finances, j’ai souhaité évoquer dans mon rapport la situation préoccupante d’Areva et examiner la pertinence du plan de sortie de crise.
Sans revenir sur les erreurs du passé, j’observe que la réorganisation envisagée est justifiée du point de vue industriel : un « nouvel Areva » recentré sur son cœur de métier, le cycle de l’uranium, et une répartition des rôles clarifiée avec EDF dans le domaine des réacteurs, qui doit remettre « l’équipe de France » en ordre de bataille pour l’export.

En outre, d’indispensables mesures de compétitivité et de financement sont également prévues pour assurer la viabilité du groupe.
Sur ce dernier point, il est essentiel que l’augmentation de capital du « nouvel Areva » soit à la fois adaptée à ses besoins de financement et la plus rapide possible. Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d’État, nous préciser les intentions de l’État en la matière ?
Notre commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat en ce qui concerne l’adoption des crédits du programme 174.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, mon propos concernera seulement la pêche et l’aquaculture, qui constituent un secteur économique modeste par le chiffre d’affaires, mais essentiel à l’animation des territoires littoraux et à la France.
Si l'on ne compte que près de 16 000 pêcheurs en France métropolitaine, la filière emploie environ 100 000 personnes dans la maintenance des navires, les criées, le mareyage, le transport ou encore les conserveries de poissons.
La conjoncture dans le secteur de la pêche est globalement meilleure depuis deux ans : les prix du poisson se maintiennent à un niveau élevé et les charges de carburant ont tendance à être contenues, du fait de la baisse des prix du pétrole. Pour autant, les inquiétudes du monde de la mer ne sont pas levées.
Les craintes sont d’abord budgétaires. Certes, les crédits pour 2016 baissent peu par rapport aux crédits pour 2015. La pêche reste un secteur soutenu, à hauteur de 46, 8 millions d’euros, contre 47, 9 millions d’euros en 2015, soit une baisse de 2, 1 %. Les enveloppes de soutien sont maintenues : la recherche scientifique bénéficie de 6, 8 millions d’euros, le contrôle des pêches de 6, 2 millions d’euros et les caisses chômage intempéries des marins de 6, 5 millions d’euros. Il reste également 20 millions d’euros au titre des mesures de soutien économique cofinancées par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP.
La vraie inquiétude budgétaire concerne le FEAMP : quand pourra-t-il être réellement mis en œuvre ? Tout nouveau retard fait courir le risque de ne pas pouvoir consommer l’enveloppe de 588 millions d’euros attribuée à la France pour la période 2014-2020.
Enfin, l’interprofession France filière pêche apporte un soutien indispensable au secteur, avec 30 millions d’euros, collectés sur une base volontaire et redistribués pour la promotion du pavillon français et l’investissement dans les navires. L’accord instituant France filière pêche arrivera à son terme en 2016. Il est indispensable qu’il soit reconduit, sinon les actions financées grâce à cette manne risquent de disparaître.
Au-delà des inquiétudes budgétaires, je m’interroge sur notre stratégie en matière de pêche et d’aquaculture et sur la place que nous leur réservons. Ainsi, 85 % de notre consommation provient de produits importés, ce qui prouve que nous avons des marges de manœuvre gigantesques pour tendre vers plus d’autosuffisance. Toutefois, dans la mesure où la pêche est limitée par les quotas, qui concernent 50 % des espèces pêchées, il faudra développer l’aquaculture marine. Cette stratégie n’a jamais réussi en France. Elle s’est heurtée notamment au problème de la sélection de sites nouveaux pour les fermes aquacoles.

Autre inquiétude, la flotte de pêche de plus de 12 mètres, stratégique pour la pêche française puisqu’elle est à l’origine de 70 % des captures, a beaucoup vieilli, avec des navires de 26 ans en moyenne. Il faut profiter de la meilleure conjoncture pour investir, remotoriser les bateaux, s’adapter aux nouvelles contraintes de la politique commune de la pêche, notamment l’obligation de débarquement de toutes les captures.
Un rapport d’experts a été rendu au Gouvernement pour réclamer la modernisation de la flotte. Je souscris aux objectifs et à la plupart des propositions qu’il énonce. Quelles suites lui seront-elles apportées ?
Le Comité interministériel de la mer, le CIEM, du mois d’octobre dernier a annoncé une nouvelle ambition pour la pêche et l’aquaculture. Ne ratons pas le virage de la modernisation de notre flotte ! Sinon, que deviendront nos ports de pêche ?
La commission des affaires économiques s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur les crédits de la pêche et de l’aquaculture.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour la deuxième année consécutive, j’ai l’honneur de rapporter, pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, les crédits des politiques de la biodiversité et de la transition énergétique. Ils concernent trois programmes au sein de la mission « Écologie » : le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », le programme 159 « Information géographique et cartographique » et le programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».
Ces trois programmes concentrent environ 883 millions d’euros. Ils ne sont pas, en volume, les programmes les mieux dotés au sein de la mission. Pour autant, ils constituent le support de réformes récentes et d’orientations politiques nouvelles, adoptées en 2015 ou en cours d’adoption.
Je ne reviendrai pas sur la description purement budgétaire de ces crédits. Notre commission a fait siennes les conclusions du rapporteur spécial de la commission des finances Jean-François Husson et a émis un avis défavorable à leur adoption.
En ce qui concerne le programme 113, le seul dont les crédits pour 2016 sont en légère augmentation, mon inquiétude porte sur trois points.
Il s’agit d’abord – je rejoins en cela les propos de mon collègue Jean-François Husson – de la suspension du financement de la future Agence française pour la biodiversité : quelles sont les intentions du Gouvernement s’agissant de l’inscription de son projet de loi à l’ordre du jour du Sénat ? Je le précise, non seulement l’Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture, mais le Sénat a fait son devoir en déposant un rapport, adopté au début du mois de juillet.

Le Sénat fait très souvent son devoir. Dans le cas qui nous occupe, il l’a fait et nous sommes fin prêts, l’arme au pied, pour l’examen de ce texte.
Il s’agit ensuite du prélèvement, cette année encore, de 175 millions d’euros sur les fonds de roulement des agences de l’eau, prélèvement d’autant plus inapproprié que les missions de ces agences sont étendues par le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Il s’agit enfin – je m’attarderai sur ce sujet un très court instant – des moyens spécifiquement dédiés à la politique de préservation des milieux marins, notamment ceux de l’Agence des aires marines protégées, qui me paraissent insuffisants au regard des enjeux.
Je souhaite attirer votre attention, monsieur le secrétaire d’État, sur un point qui me paraît grave. J’ai été le premier président de cette agence, dont j’avais d’ailleurs proposé la création. Ses budgets ont toujours été adoptés. Pourtant, lors du vote du dernier budget, les présidents des conseils de gestion se sont soit abstenus soit ont voté contre. Quant aux représentants des collectivités locales, ils ont voté avec leurs pieds, si vous me permettez cette trivialité, car ils étaient tous absents lors des réunions du conseil d’administration. Heureusement, les représentants de l’État étaient là, ce qui a permis l’adoption de ce budget.
Je n’ignore pas non plus le point de vue exprimé par le personnel, auquel il faut toujours prêter une attention particulière. Je pense notamment à l’un de ses représentants, M. Olivier Gallet, qui appartient à la CGT. Il est venu dire que l’agence ne pouvait plus accomplir ses missions, qui sont complexes et ne se réduisent pas à des interventions sur des bateaux. Des missions juridiques sont également effectuées. En effet, quand il s’agit de rendre un avis conforme pour l’établissement d’une porcherie dans le Finistère, on ne peut pas écrire n’importe quoi ! Actuellement, les personnels de l’agence ont atteint la limite de leur capacité à assumer la totalité de leurs missions.
J’attire donc votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, avec beaucoup de courtoisie et sans aucune agressivité. À l’occasion de la présentation de ce rapport budgétaire, j’exprime simplement dans cet hémicycle notre inquiétude.
Je terminerai par l’évocation d’un point extrêmement positif. Je me suis rendu cette année, après avoir été invité l’année dernière, sur le site de l’Institut national de l’information géographique et forestière, l’IGN. La visite était passionnante : j’ai rencontré des fonctionnaires remarquables et pu me rendre compte du soutien apporté par l’IGN à de nombreuses PME et start-ups innovantes intervenant dans la lutte contre le changement climatique. Je tenais à le dire.
Sur le programme 174, enfin, je déplore l’insuffisance des crédits dédiés à la politique énergétique. Mais c’est une autre histoire, que mon collègue Jean-François Husson a déjà évoquée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, rapporteur pour avis.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai l’honneur de vous présenter brièvement l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur les crédits relatifs à la prévention des risques, à la météorologie et au budget du ministère de l’écologie.
Les crédits alloués à la prévention des risques technologiques, naturels et sanitaires sont encore en baisse cette année. Le Gouvernement explique une nouvelle fois cette diminution par la surévaluation des plans de prévention des risques technologiques, les PPRT, mais c’est une justification très partielle. En effet, deux sujets au moins me semblent très insuffisamment pris en compte dans ce budget.
Il s’agit tout d’abord de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES. Ses compétences, vous le savez, se sont fortement étendues, avec la prise en charge de nouvelles missions : délivrance des autorisations de mise sur le marché des pesticides et des biocides, phytopharmacovigilance et toxicovigilance. Au vu de l’ampleur croissante de ces missions, le maintien des emplois sur une durée triennale est un pur effet d’optique. Compte tenu du changement de périmètre, les moyens de l’agence sont en réalité clairement en baisse. Je suis extrêmement inquiet de cette évolution.

Dans ma région, fortement agricole et viticole, les hôpitaux et les centres de médecine du travail tirent depuis un certain temps la sonnette d’alarme sur le dossier des pesticides. Nous sommes probablement à l’aube d’un scandale sanitaire, et le Gouvernement crée des contraintes budgétaires supplémentaires qui affectent l’agence chargée de garantir notre sécurité.
Le deuxième sujet d’inquiétude est relatif au budget alloué à la sûreté nucléaire. Cette année encore, rien n’est fait pour anticiper la hausse de la charge de travail de l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ASN, qui doit franchir un palier dans son action. Or le budget pour 2016 ne permettra pas d’y faire face. Très concrètement, la question posée est celle de la réforme du financement de la sûreté nucléaire dans notre pays. Le Gouvernement est censé remettre sous peu un rapport sur le sujet. Quand pourra-t-on disposer de ses conclusions ?
Je n’aborderai pas dans le détail les crédits alloués à Météo-France, plus faibles que jamais, notre collègue Vincent Capo-Canellas l’a souligné, ni ceux du ministère de l’écologie, dont le niveau est également préoccupant.
Le compte n’y est pas, monsieur le secrétaire d’État. La transition énergétique ne fait clairement plus partie des priorités du Gouvernement pour 2016.

La prévention des risques constitue pourtant une mission régalienne de l’État. Nous n’avons pas le droit de jouer avec la sécurité de nos concitoyens.
Au vu de l’insuffisance de ces crédits pour 2016, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis défavorable sur leur adoption.
Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable sur l’adoption des crédits relatifs aux transports aériens de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » et du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2016.
Il nous est en effet apparu que la situation financière du budget annexe s’améliore nettement en 2016, avec un résultat d’exploitation en hausse de 34 %, une diminution inédite des dépenses de personnel et un désendettement important de l’ordre de 8 %. L’encours de dette retrouve un niveau proche de 2009 et valide a posteriori la gestion contracyclique du budget de la direction générale de l’aviation civile, la DGAC, qui avait refusé d’augmenter le montant de ses redevances au plus fort de la crise du transport aérien, afin de ne pas pénaliser davantage nos compagnies aériennes.
En ce qui concerne le secteur aérien en général, nous abordons un tournant. Les pratiques déloyales de certains pays tiers minent la compétitivité de nos compagnies, de nos aéroports et de notre industrie aéronautique. Il n’est un secret pour personne que certaines cités-États du Moyen-Orient subventionnent massivement leur secteur aérien, afin d’attirer les flux de trafic.
L’étude Fair skies, publiée en mars 2015 par les trois plus grandes compagnies américaines, chiffre à 42 milliards de dollars le montant total des aides dont Emirates, Etihad Airways et Qatar Airways auraient bénéficié en dix ans. Les États-Unis ne sont eux-mêmes pas en reste, puisque des avantages fiscaux à hauteur de 8, 7 milliards de dollars sont accordés par le seul État de Washington à Boeing, pour l’inciter à produire le prochain B 777X, soit une somme supérieure au coût total de développement du programme !
Face à l’agressivité de nos concurrents, il devient urgent d’apporter une réponse forte au niveau européen. Il n’est plus possible de se contenter d’une politique limitée au seul contrôle aérien dans le cadre du ciel unique. L’Europe doit parler d’une seule voix pour soutenir la compétitivité de nos compagnies, renforcer l’attractivité de nos hubs et défendre notre industrie aéronautique.
Pour imposer davantage de transparence aux États du Golfe, l’Europe doit se doter d’un outil réellement efficace et dissuasif, à l’image de l’instrument législatif dont disposent les États-Unis. Quant à l’Agence européenne de sécurité aérienne, elle doit viser le même objectif de soutien à la filière que son homologue américaine, qui utilise régulièrement son pouvoir normatif pour retarder la certification des nouveaux modèles d’Airbus, en invoquant des motifs techniques.
La Commission Juncker a annoncé qu’un nouveau « paquet aviation » serait présenté lors du Conseil de décembre 2015. Monsieur le secrétaire d’État, comment s’orientent les discussions et que comptez-vous mettre en œuvre pour accélérer les choses à Bruxelles ? L’heure n’est plus à la candeur. Ces sujets progressent beaucoup trop lentement au niveau européen. Il faut impérativement que la France se mobilise pour obtenir les conditions d’une concurrence équitable.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Hervé Maurey applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les crédits consacrés en 2016 aux transports ferroviaires, collectifs et fluviaux, y compris ceux du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », relatif aux trains d’équilibre du territoire, suscitent à plusieurs égards l’inquiétude de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Le premier sujet d’inquiétude est bien sûr le budget de l’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.
Vous nous aviez assuré l’année dernière, monsieur le secrétaire d’État, que les frais de résiliation du contrat signé avec Ecomouv’ – près d’un milliard d’euros, tout de même ! – ne seraient pas prélevés sur le budget de l’AFITF. Cette parole n’a pas été respectée : dès 2015, l’agence a dû assumer 528 millions d’euros de dépenses à ce titre.
En conséquence, elle s’est trouvée dans l’obligation de différer plusieurs engagements de crédits – 158 millions d’euros destinés aux transports ferroviaires et collectifs – et, surtout, n’a pu commencer à rembourser la dette accumulée vis-à-vis de SNCF Réseau en 2013 et en 2014, laquelle atteint aujourd’hui, mes chers collègues, près de 700 millions d’euros.
Le déficit total de notre système ferroviaire s’élève à environ 45 milliards d’euros, et tout laisse penser, au regard de sa trajectoire financière, que ce montant atteindra bientôt 60 milliards d’euros. Qui paiera, et comment ?
La situation de l’AFITF ne s’annonce pas meilleure en 2016, puisque le Gouvernement a réduit la part du produit de la TICPE – la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – affectée à l’AFITF de plus de 400 millions d’euros.
Le Sénat a fort heureusement rectifié cette erreur, monsieur le secrétaire d’État, lors de l’examen de la première partie de la loi de finances. Le budget initialement prévu n’aurait pas permis à l’AFITF d’assumer effectivement l’ensemble de ses engagements. Ceux-ci concernent pourtant la totalité des infrastructures qui font l’attractivité de notre pays.
J’espère donc, monsieur le secrétaire d’État, que vous convaincrez l’Assemblée nationale de maintenir cette rectification.

S’agissant plus spécifiquement du transport ferroviaire, nous attendons toujours le retour effectif de « l’État stratège », maintes fois annoncé lors des débats sur la loi portant réforme ferroviaire, mais qui peine encore à s’affirmer.
Quatre domaines au moins mériteraient de faire l’objet d’une politique beaucoup plus volontariste de la part de l’État.
Premièrement, l’accélération de la modernisation du réseau est une nécessité, comme l’ont établi les audits successifs réalisés par l’École polytechnique de Lausanne en 2005, en 2012 et en 2015.

Vous le savez, monsieur le secrétaire d’État : la situation actuelle de notre réseau ferroviaire est des plus préoccupantes.
Deuxièmement, l’État aurait dû reprendre en main la gestion des trains d’équilibre du territoire dès la fin de l’année 2013. Malheureusement, le Gouvernement a une nouvelle fois repoussé cette échéance.
Troisièmement, alors qu’il faudrait au contraire promouvoir le fret ferroviaire, celui-ci s’apprête à subir une hausse de 6, 3 % des tarifs des péages, en distorsion totale avec le niveau de l’inflation. En quoi cette décision est-elle cohérente avec la dégradation de la situation économique des entreprises ou avec les engagements de la COP 21 ?
Enfin, les membres de notre commission vous ont déjà plusieurs fois alerté, monsieur le secrétaire d’État, sur la nécessité du renforcement – il faudrait plutôt parler de « sauvetage » – de la filière industrielle ferroviaire française.
Face à tant de motifs d’inquiétude, la commission n’a eu d’autre choix que d’émettre un avis défavorable sur les crédits destinés aux transports ferroviaires, collectifs et fluviaux pour 2016.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

La parole est à M. Charles Revet, rapporteur pour avis. (Mme Chantal Jouanno applaudit.)

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne vais pas entretenir un suspense inutile : la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’est déclarée défavorable à l’adoption des crédits relatifs au transport maritime du projet de loi de finances pour 2016.
La légère érosion des crédits par rapport à l’année écoulée n’est rien comparée à l’inquiétante insuffisance globale des montants dédiés aux transports maritimes. Nous avons pu, pour la première fois, disposer d’une évaluation consolidée du niveau de ces crédits, grâce à un document de politique transversale dont je réclame la réalisation depuis de nombreuses années.
Le constat est alarmant : nous consacrons moins d’un dixième de point de PIB à notre politique maritime, alors que nous possédons la deuxième zone économique maritime mondiale, avec une superficie maritime supérieure à la superficie terrestre de l’Europe entière !
En matière maritime, nous allons, semble-t-il volontairement, à rebours de toute logique économique et historique. Nous savons en effet que l’avenir d’une nation se décide depuis toujours dans ses ports. Toutes les grandes économies du monde possèdent des ports puissants et de nombreux navires pour exporter leurs productions. Il s’agit d’une loi intangible, de la Venise d’hier à la Chine d’aujourd’hui !
Que constate-t-on, aujourd’hui, s’agissant de la France ?
Le trafic de nos grands ports maritimes ne fait que diminuer, quand celui de nos voisins continue d’augmenter. Le tonnage du seul port de Rotterdam représente presque le double de celui de nos sept grands ports maritimes réunis. Le port d’Anvers manutentionne plus de conteneurs que l’ensemble des ports français. Il est devenu, aux yeux de nombreux acteurs économiques, le « premier port français », eu égard au nombre de conteneurs qu’il traite à destination ou en provenance de l’Hexagone.
Quant à notre flotte de commerce, elle subit de plein fouet la concurrence internationale et connaît une inquiétante augmentation des dépavillonnements et des faillites d’entreprises.
Alors que 90 % des échanges mondiaux transitent par la mer, nous devrions rougir du manque d’ambition de nos politiques et de la faiblesse consternante de nos investissements dans ce domaine. Ils sont dérisoires comparés aux efforts consentis par notre pays en direction de l’autre frontière du futur, le secteur aérospatial. On ne luttera pas contre la concurrence internationale par des mesures de simplification administrative !
Je salue évidemment les mesures annoncées à l’occasion du CIMER, le comité interministériel de la mer, qui s’est tenu le 22 octobre dernier. Mais soyons honnêtes : nous savons d’ores et déjà que cela ne suffira pas à inverser la tendance !
La seule solution est d’ordre économique : les pouvoirs publics doivent directement soutenir la compétitivité de notre pavillon et de nos hubs portuaires. Les directives européennes le permettent et nos voisins danois, britanniques ou italiens ne s’en privent pas !
En définitive, nous sommes bien loin des annonces grandiloquentes, chaque année répétées et jamais suivies d’effets, autour du lancement d’une politique maritime ambitieuse ou d’une nouvelle stratégie nationale de la mer et du littoral.
Nous devons regarder la réalité en face et assumer la responsabilité de ce que nous votons : nous avons de l’or bleu dans les mains et nous sommes en train de mutiler notre pays en refusant sa vocation maritime !
Je ne peux que confirmer l’avis défavorable de la commission.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Roux, rapporteur pour avis.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis défavorable sur les crédits consacrés pour 2016 aux transports routiers, y compris sur le compte d’affectation spéciale du bonus-malus automobile, intitulé « Aides à l’acquisition de véhicules propres ».
J’avais pour ma part appelé à émettre un avis favorable, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, et à rebours du climat pessimiste ambiant, il me semblait nécessaire de souligner trois avancées positives, engagées en 2015, et qui influeront profondément sur l’avenir du transport routier.
La première de ces avancées concerne l’accord conclu par l’État avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Cet accord permet la réalisation du plan de relance autoroutier, qui représente 3, 3 milliards d’euros d’investissements, mais aussi un rééquilibrage des relations contractuelles entre l’État et ces sociétés, dans un sens plus favorable à l’État et aux usagers.
Deuxième avancée : la libéralisation du transport par autocar permet le développement d’une nouvelle offre de transport collectif.
Troisième avancée, enfin, notre pays s’engage sur la voie de la transition énergétique par le choix de modes de transport plus durables. En particulier, l’instauration d’une prime à la conversion, accordée pour la mise au rebut d’un véhicule polluant ancien, va dans le bon sens, puisqu’elle agit sur le parc roulant existant, dont on sait qu’il est le plus polluant.
Par ailleurs, le Gouvernement a chargé un groupe de travail d’examiner la contribution du transport routier de marchandises au financement des infrastructures de transport. À l’issue de ces réflexions, il a choisi de maintenir en 2016 la hausse de la fiscalité sur le gazole au lieu d’instaurer une vignette, ce qui aurait engendré des coûts de gestion.
Le budget d’intervention de l’AFITF, fixé par le Gouvernement à 1, 9 milliard d’euros pour 2016, est supérieur à celui du présent exercice. Bien entendu, il sera nécessaire, à l’avenir, de dégager des moyens supplémentaires. Au regard du contexte actuel, mon inquiétude est cependant limitée pour l’année prochaine. D’ailleurs, les dépenses consacrées par l’AFITF à l’entretien et à la modernisation des routes devraient augmenter.
En dépit de ces éléments positifs, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a déploré l’insuffisance du budget de l’AFITF, ce qui l’a conduite à émettre un avis défavorable sur les crédits destinés aux transports routiers pour 2016.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. André Gattolin.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le temps n’est pas si lointain où les écologistes s’attiraient des railleries en évoquant le réchauffement climatique. Combien de fois nous a-t-on répondu : « Où est le problème ? Quelques degrés de plus, ce sera agréable, on pourra tomber la veste ! »
Il est vrai que le changement climatique est un risque difficile à appréhender. Ses effets ne sont pas aussi circonscrits, aussi fulgurants ni aussi sanguinaires que ceux du terrorisme. On peut mourir de la dégradation de l’environnement et du climat, mais indirectement et, le plus souvent, à petit feu.
Pour autant, et heureusement, la gravité de la situation climatique n’est plus sérieusement contesté aujourd’hui. On peut d’ailleurs savoir gré au Président de la République d’avoir contribué à cet éveil des consciences en choisissant d’accueillir à Paris la COP 21.
Alors, comment croire que le présent budget est celui du pays hôte de cette conférence, dite « de la dernière chance » ?

Comme chaque année, les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » sont en baisse et les suppressions d’emplois qui affectent le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en font l’un des départements ministériels les plus touchés par la déflation des effectifs.
S’il ne fallait citer qu’un seul chiffre, je rappellerais que 7 476 emplois équivalent temps plein ont été supprimés en trois ans, ce qui représente une baisse des effectifs de l’ordre de 20 %.
À ce rythme, nous pouvons nous attendre à la disparition prochaine du ministère de l’écologie et à son remplacement, à Bercy, par un « secrétariat d’État à la fiscalité écologique au service du redressement productif de la nation » !
À ces données de départ peu engageantes s’ajoutent les nombreuses contractions de dépenses qui ne manqueront pas d’émailler l’exécution budgétaire de l’année à venir.
Comme le note d’ailleurs notre rapporteur spécial Jean-François Husson, en 2015, les effets cumulés de la réserve de précaution et des diverses annulations en cours d’année ont réduit d’environ 10 % les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » votés en loi de finances initiale.
Le tableau de ces difficultés serait incomplet si je n’évoquais pas l’existence de ressources extrabudgétaires et de dépenses fiscales significatives.
Les premières relèvent, pour un grand nombre d’entre elles, soit de circuits de financement que je qualifierai d’assez opaques, comme les programmes d’investissement d’avenir, soit d’une affectation seulement très partielle à la transition écologique, comme l’illustre le cas de la CSPE, la contribution au service public de l’électricité.
Quant aux dépenses fiscales, leur rattachement technique à la mission « Écologie, développement et mobilité durables » n’en fait ni des dépenses environnementales – je pense notamment aux multiples exonérations de TICPE sur les énergies fossiles – ni nécessairement des dépenses bien calibrées – je pense, cette fois, aux questions soulevées par le crédit d’impôt pour la transition énergétique.
Si le CITE s’apparente à une dépense de guichet dont, par définition, l’anticipation peut être complexe, l’explosion de son coût laisse malgré tout soupçonner soit un mauvais ciblage initial soit une sous-estimation inquiétante des besoins.
M. le secrétaire d’État chargé du budget répond systématiquement aux questions portant sur la baisse du niveau des crédits, en nous renvoyant au volume de ces dispositifs. Vous conviendrez que cette réponse n’est pas toujours convaincante !
En outre, il est pour le moins osé de prétendre que la hausse d’une dépense fiscale peut compenser l’amoindrissement de services et de ressources humaines dotés de compétences et de capacités d’expertise ! Ce ne sont pas les bouquets de travaux éligibles au CITE qui préviendront les prochaines catastrophes météorologiques à la place des 80 % de départs en retraite qui ne sont pas remplacés à Météo-France. Une fois de plus, la prévention des risques est sacrifiée pour laisser place à de futures coûteuses réparations.
S’il apparaît donc clairement que l’écologie constitue une des principales variables d’ajustement budgétaire du Gouvernement, l’opacité et la complexité de la structure en jeu ne permettent toutefois pas de s’en faire une idée précise.
C’est pour cela que, depuis un an maintenant, je demande au secrétaire d’État au budget de fournir à la représentation nationale une vision consolidée des sommes effectivement alloués à de véritables fins écologiques. Pour que l’évaluation ait un sens, il faudrait également y intégrer de manière distincte toutes les dépenses anti-écologiques.
Voilà deux ans, des organisations non gouvernementales avaient évalué à 20 milliards d’euros le montant des niches favorables au carbone. Il faudrait également y ajouter le coût faramineux des subventions implicites de l’État à l’industrie nucléaire. Au passage, je rappelle que, à la fin du mois de juillet, l’entreprise EDF a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne à rembourser à l’État français 1, 37 milliard d’euros d’aides fiscales indues perçues en 1997.
Malgré de grands discours du Président de la République, le Gouvernement n’a, pour l’heure, encore jamais vraiment saisi la dimension transversale de l’écologie.
Pourtant, quitte à se lancer dans une politique de l’offre, il y avait une occasion formidable dans le principe même de développer les aides aux entreprises. Il suffisait de poser, au moins partiellement, la condition de la réduction de l’empreinte écologique, que ce soit par une reconversion intégrale de leurs activités ou par une optimisation partielle de leurs procédés.
De même, la fiscalité écologique n’a de sens que si son produit est réinvesti dans l’adaptation de l’économie aux nouvelles contraintes environnementales et climatiques. Malheureusement, le Gouvernement a choisi dès le début de l’affecter au financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, qui perpétue le vieux modèle productiviste. Aujourd’hui, il l’utilise pour alimenter le budget général, allant jusqu’à réinventer une sorte de vignette automobile, en affectant la fiscalité sur le diesel aux baisses d’impôts en faveur des contribuables les plus âgés.
Tout en s’en défendant, le Gouvernement alimente lui-même l’idée d’une écologie punitive, nous faisant ainsi passer à côté de son énergie positive et créatrice.
Face à un budget toujours en baisse et à une fiscalité écologique reléguée en projet de loi de finances rectificative, les écologistes proposent de rebaptiser la mission « Écologie, développement et mobilité durables » en « mission impossible » et voteront donc contre ces crédits.
Mme Chantal Jouanno applaudit.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne sais pas si c’est la période qui l’exige, mais certains nourrissent une vision particulièrement négative de ce qui nous est proposé aujourd’hui ; nous venons d’en avoir l’illustration.
Pour ma part, je préfère défendre une vision plus positive, en parlant des trains qui arrivent à l’heure, …
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

L’examen de ce budget intervient entre deux événements majeurs pour l’écologie et le développement durable : d’une part, l’entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été promulguée le 17 août dernier ; d’autre part, la vingt et unième Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ou COP 21, qui a débuté hier et se tiendra jusqu’au 11 décembre à Paris.
Si je fais référence à ces deux marqueurs, ces deux temps forts du quinquennat, c’est parce que les problématiques du développement durable sont tout à la fois locales, nationales et internationales.
À l’échelon national, la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du budget pour 2016 regroupe le développement des énergies renouvelables, l’optimisation des réseaux et des services de transports, la préservation des paysages et de la biodiversité, la gestion quantitative et qualitative de l’eau, la politique maritime et aussi, bien entendu, la prévention des risques.
Nous l’avons entendu, les crédits alloués à cette mission et au ministère ont, cette année encore, été réajustés.

Je ne vais pas m’appesantir sur les données chiffrées. Je me garderai d’en tirer des conclusions hâtives et définitives. En effet, de nombreuses actions transversales à dimension écologique sont mises en place avec les crédits d’autres missions.
Aussi, au lieu de me livrer à un bilan purement comptable, je préfère m’attarder sur quelques actions concrètes du Gouvernement et des acteurs des territoires en faveur de l’écologie et du développement durable.
Prenons par exemple l’appel à projets pour les territoires à énergie positive pour la croissance verte, ou TEPCV. Je rappelle qu’il a pour objectif d’inciter les collectivités, quelles qu’elles soient, à réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à préserver la biodiversité et à proposer un programme global pour un nouveau modèle de développement, plus sobre et plus économe.
Je salue la mise en place de cette mesure. Je vais en suivre très concrètement l’évolution, puisque j’ai signé le 18 novembre dernier avec Mme la ministre une convention TEPCV, en tant que présidente du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Il s’agit là d’une très belle initiative, qui ouvre de nouvelles perspectives de développement dans tous les territoires et au plus près des citoyens.
Les collectivités locales ne sont pas en reste. Ainsi, après avoir pris l’initiative de différentes aides à l’isolation des logements ou au développement des chauffe-eau solaires, j’ai pu lancer la troisième édition de l’opération « Familles à énergie positive », une compétition conviviale, ouverte à tous, qui consiste à réaliser des économies d’énergie et d’eau sur la saison de chauffe, en réalisant des « écogestes » simples. Nous travaillons sur les comportements, ce qui n’est pas le plus facile.
Pour autant, je n’oublie pas que de nombreux chantiers demeurent.
Par exemple, j’aurais souhaité que nous allions plus loin, avec des incitations fortes en faveur des moyens de transport plus écologiques, mettant l’accent, en particulier, sur la multimodalité.

Il faut également favoriser le transport ferroviaire par rapport au transport routier, tant pour les voyageurs que pour les marchandises. Il est insupportable pour nos concitoyens de mettre plus de temps aujourd’hui qu’il y a dix ou quinze ans pour aller de certaines villes de province à Paris ! C’est un vrai problème et vous le connaissez aussi bien que moi, monsieur le secrétaire d’État.
J’ai bien noté que le budget du programme 203, « Infrastructures et services de transports », était préservé, avec tout de même une baisse de 0, 5 %, et que la priorité serait accordée à la sécurité et à l’amélioration de la qualité des infrastructures et des services de transports, mais le développement des transports en commun, de la multimodalité, l’incitation aux transports propres, tout particulièrement pour les entreprises ou les collectivités locales, aurait également dû faire partie des priorités.
En outre, j’aurais aussi aimé voir dans ce budget des moyens supplémentaires visant à une prévention plus efficace des catastrophes naturelles. Monsieur le secrétaire d’État, tout le sud de la France est régulièrement touché par les intempéries. Je pense par exemple aux inondations qui nous ont frappés au mois de novembre 2014. J’en profite pour saluer les maires de Rasiguères, de Banyuls-sur-Mer ou d’Argelès-sur-Mer, dont les communes figurent parmi les 139 reconnues en état de catastrophe naturelle.
Les coûts provoqués par ces catastrophes naturelles pèsent lourdement sur le budget de nos collectivités et sur celui de l’État. Il me semble donc indispensable d’accorder plus de moyens à la sensibilisation du public et à l’investissement dans la recherche.
J’en viens à présent à la COP 21, qui doit aboutir à un accord contraignant sur la réduction des gaz à effet de serre.
Il s’agit probablement de la plus importante conférence des Nations unies sur le climat de la décennie. On peut se réjouir que la France ait l’honneur d’accueillir les délégations venues de 195 pays.
Je salue l’ensemble des contributions des départements de France à la COP 21 qui prouvent l’implication totale des collectivités locales dans l’engagement en faveur du développement durable.
Nous comptons sur le Président de la République et sur le Gouvernement pour que la France tienne son rôle durant cette manifestation – il reste du travail à faire ! –, en s’engageant à réaliser des efforts significatifs pour lutter contre le changement climatique et en entraînant dans cette voie la majorité de nos partenaires internationaux.
En conclusion, si je soutiens la politique gouvernementale, sur le plan tant local qu’international, j’ai néanmoins conscience des efforts qu’il nous reste à produire pour promouvoir une politique plus ambitieuse encore en faveur du développement durable.
Applaudissements sur les travées du RDSE et sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous abordons en ce début d’après-midi l’examen de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » pour 2016.
Mon intervention portera notamment sur les points saillants des programmes dont j’ai plus particulièrement la charge : biodiversité, prévention des risques, information géographique et cartographique. Je ne manquerai pas d’évoquer la question des déchets, la responsabilité élargie des producteurs et la biomasse.
Le programme 113, « Paysages, eau et biodiversité », de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » se fixe deux objectifs principaux : d’une part, assurer la gestion intégrée de la ressource en eau ; d’autre part, préserver et restaurer la biodiversité.
À ce titre, il a trois priorités : d’abord, préserver les sites remarquables et aménager les paysages du quotidien ; ensuite, protéger les espaces naturels terrestres et maritimes, ainsi que les ressources ; enfin, préserver, restaurer et valoriser la biodiversité.
Au-delà de ces crédits, il faut relever le constat fait par Michel Lesage : « Ce montant ne reflète pas […] la totalité de l’action de l’État en matière de paysages, eau et biodiversité. » Les acteurs impliqués et les politiques menées sur ces questions sont si nombreux et si éclatés qu’il est difficile, voire impossible, de disposer d’une approximation fiable au plan national des flux financiers réellement engagés.
Néanmoins, on peut résumer que les crédits de ce programme, d’un montant total de 276, 3 millions d’euros, sont en hausse de 3 millions d’euros. Ils sont destinés, pour les deux tiers, aux opérateurs et, pour un tiers, aux collectivités, aux entreprises et aux associations. Ainsi, si l’on regroupe toutes les actions ayant un rapport avec l’eau, on constate que plusieurs milliards d’euros y sont consacrés.
Je prends l’exemple de la seule amélioration de l’état écologique des eaux et des actions menées en faveur de la biodiversité et des paysages. Les sommes engagées s’élèvent à près de 4 milliards d’euros.
Je le rappelle, la directive-cadre sur l’eau adoptée le 23 octobre 2000, qui définit un cadre européen pour la gestion et la protection des ressources en eau des pays de l’Union européenne, fixait un objectif de 66 % de bon état écologique des eaux de surface d’ici à 2015. Si les indicateurs de performance présents dans le projet de loi de finances indiquent que ce taux sera de 43, 5 % en 2016, il est néanmoins stable depuis 2012. La révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, est l’occasion pour les comités de bassin de redéfinir une cible pour l’atteinte du bon état écologique des eaux à l’échéance de 2021, qui permettra de réajuster la cible à l’échéance de 2017.
Les crédits de l’Agence française de biodiversité ne sont pas budgétés dans le projet de loi de finances pour 2016, puisque la loi n’est pas encore votée. Un processus de préfiguration de l’Agence a été mis en place. Le groupe de travail a rendu un rapport d’étape au mois de juin 2015. Selon Michel Lesage, le retard pris par l’examen du projet de loi relatif à la biodiversité au Parlement a « aidé plus qu’il n’a desservi le travail des préfigurateurs ». Notre collègue député ajoute : « L’année supplémentaire dont ils ont bénéficié pour conduire leurs travaux leur a notamment permis de lancer des expérimentations qui faciliteront la mise en place effective de l’Agence. »
Les crédits alloués aux sites et paysages pour 2016 sont en légère hausse, de 0, 76 million d’euros, pour atteindre 6, 76 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. La politique du paysage, la politique des sites et le classement au patrimoine mondial bénéficieront, respectivement, de 3, 3 millions d’euros, de 3, 27 millions d’euros et de 0, 16 million d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Je précise que je siège au sein de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Le travail que nous y effectuons pour la protection et la gestion des sites classés, au moyen d’incitations destinées aux acteurs concernés par la conservation de ces lieux, est remarquable. Il s’inscrit dans le cadre du plan d’action pour la reconquête des paysages que Mme la ministre de l’écologie a lancé.
Les priorités pour 2016 en matière d’aires marines protégées sont la poursuite de la mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin et la gestion des parcs naturels marins, auxquels s’ajoutent le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon, crée en 2014, et le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, créé en 2015. Ces priorités seront évidemment poursuivies une fois que l’AAMP, l’Agence des aires marines protégées, sera intégrée au sein de l’Agence française de la biodiversité, dont elle constituera le « noyau dur ».
Pour 2016, les crédits de l’AAMP – autour de 23, 1 millions d’euros – sont stables. J’ai procédé à une visite des aires marines de l’Iroise et pu constater le travail formidable qui y était conduit.
S’agissant du financement des agences de l’eau, j’entends ici et là certaines critiques sur leur contribution au redressement de nos comptes publics.
S’il est vrai que la règle « l’eau va à l’eau » constituait un principe fort, je tiens à rappeler que, dans le cadre du dixième programme d’intervention des agences de l’eau, la loi de finances pour 2012 a plafonné les recettes des agences à 13, 8 milliards d’euros sur la période 2013-2018, soit 2, 3 milliards d’euros par an, et qu’un arrêté conjoint du ministre de l’environnement et du ministre du budget a plafonné les dépenses à 13, 3 milliards d’euros sur la même période, soit 2, 21 milliards d’euros par an.
Sur le programme 159 « Information géographique et cartographique », on ne peut que constater que les crédits demandés en 2016, soit 95, 8 millions d’euros, sont stables puisqu’ils étaient de l’ordre de 96 millions d’euros en 2015.
Il en est de même pour la subvention à l’Institut national de l’information géographique et forestière, l’IGN, qui s’élève à 95, 6 millions d’euros pour 2016 contre 96, 5 millions d’euros pour 2015.
La connaissance du climat est devenue fondamentale pour l’État et les collectivités territoriales, dans un contexte de changement climatique et de prévention des risques naturels. Les crédits inscrits au programme 170 ont pour objectif unique le financement des missions confiées à l’établissement public Météo-France.
Vous aurez compris, monsieur le secrétaire d’État, que je voterai bien sûr ces crédits, contrairement à la majorité sénatoriale.

Chers collègues de la majorité sénatoriale, si, par hasard, vous reveniez au pouvoir et si vous mettiez en œuvre les propositions qui sont faites par vos leaders, j’aimerais bien savoir comment vous feriez pour économiser plus de 100 milliards d’euros sur le budget !
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Je voudrais en venir maintenant aux déchets.
Nous avons mis en place, avec la loi de 1992, la responsabilité élargie des producteurs. Au fil du temps, un certain nombre de sociétés chargées de prélever les contributions des metteurs en marché et de les redistribuer aux collectivités ont été agréées.
Si je m’inquiète aujourd’hui de l’ouverture à la concurrence, c’est parce que je vois les effets qu’elle a produits dans les pays voisins. Essayons donc de préserver l’originalité du système français, qui a prouvé son efficacité ! Nous devons rapidement travailler sur ce dossier, mais aussi nous donner un peu de temps : avant d’accorder de nouveaux agréments, prenons un délai d’un an pour nous permettre de constater les effets de la mise en concurrence des sociétés.

Je l’ai dit, au vu des résultats qu’elle a produits, je m’inquiète beaucoup.

Je m’inquiète aussi de constater que nous n’avons pas pu mettre en œuvre la TGAP incitative que nous avions souhaitée.
Enfin, je considère que la biomasse constitue une source importante d’énergie renouvelable que nous utilisons insuffisamment dans notre pays. Elle a l’avantage d’être stockable : nous pouvons l’utiliser quand nous en avons besoin. Mettons donc en place les outils nécessaires. Le Fonds chaleur a permis de soutenir de nombreuses installations. Il nous faut continuer dans cette voie, si nous voulons utiliser puissamment cette ressource dont nous disposons à profusion.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les rapporteurs nous ont présenté, d’une manière particulièrement lucide et éclairante, le travail qu’ils ont mené pendant plusieurs semaines.
À propos des débats liés au climat et à la conférence qui se tient actuellement au Bourget, une question se pose peut-être à certains, non seulement dans cet hémicycle, mais aussi sur les trottoirs de nos villes : au fond, à un moment où la barbarie sauvage frappe les rues de la capitale et alors que des coalitions se forment pour coordonner une guerre, dont on espère l’issue, mais dont on ne connaît pas les conséquences, est-il si important de parler de réchauffement climatique ? En somme, certains sont tentés de dire : « La COP 21, on s’en fiche un peu ! » §Nous l’avons entendu !
C’est bien évidemment une erreur de le dire ou de le penser.
À un moment où l’on assiste, à travers le monde, à des migrations très importantes, alors que des populations, souvent affamées, viennent de l’Est pour s’installer durablement sur le continent européen, on voit bien que les conséquences du réchauffement climatique sont déterminantes : ce sont des raisons économiques qui sont pour beaucoup responsables de ces migrations.
Alors que les chefs d’État ou de gouvernement se sont retrouvés au Bourget pour la conférence sur le climat, il est important de souligner tout à la fois les enjeux pour la planète et les défis auxquels notre pays est confronté et que nous devrons relever.
Pour la planète, les contours de notre futur doivent être dessinés ; ils sont tout à la fois économiques, écologiques et géopolitiques. Les actions que nous avons à mener pour corriger les dérèglements climatiques ont une influence considérable sur le mode de vie des populations, notamment les plus exposées, et les pays qu’elles occupent.
Il y a également ce qui nous incombe à nous, et la France, monsieur le secrétaire d’État, n’a pas à rougir de la situation qui est la sienne dans le monde face au défi climatique. En Europe, elle est ainsi le deuxième pays, après la Suède, pour les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, très loin devant certains de nos concurrents, notamment l’Allemagne.
Au Bourget, une phrase importante a été prononcée par le Président de la République : il a souhaité un accord « contraignant » et « universel ».
M. Roland Courteau approuve.

C’est là que le bât blesse. Je ne parle pas de l’aspect contraignant du traité, mais de la façon donc chaque pays entend respecter les accords qu’il aura négociés et auxquels il aura souscrit.
Le Premier ministre de l’Inde a ainsi expliqué hier que le développement économique de son pays passait par l’utilisation massive du charbon. Quant à la Chine, elle affiche des ambitions très vertueuses, mais la part du charbon dans sa production d’énergie est aujourd’hui considérable. Et savez-vous, mes chers collègues, que c’est l’immense continent australien qui produit le plus de CO2 et de gaz à effet de serre par habitant ?
Le mot d’ordre doit être : « Sus au CO2 ! » Ne laissons pas des pays choisir un mix qui vienne contrarier les ambitions que l’ONU veut formuler dans le cadre de la conférence sur le climat. Il serait trop facile qu’un pays comme la France continue à pratiquer avec obstination une politique qui nous place parmi les meilleurs élèves et que d’autres, autour de nous, emploient sans compter les ressources fossiles dont ils disposent.
Monsieur le secrétaire d’État, il est important que la question du carbone soit posée. Le carbone a un prix ; ce prix doit être le plus élevé possible. Que ce soit par le biais d’une taxe carbone ou du système d’échanges de quotas, il faut absolument pénaliser l’utilisation des hydrocarbures !
Certes, la France continue d’utiliser ces derniers. Notre consommation d’énergie primaire fait appel, rappelons-le, pour les deux tiers à des ressources fossiles, mais des gouvernements éclairés et constants ont heureusement fait en sorte que puissent être installés de façon durable des systèmes de production d’électricité qui ne produisent ni CO2 ni gaz à effet de serre. Je pense notamment au nucléaire, et je ne peux ici que saluer les déclarations courageuses de la ministre chargée de l’énergie, qui a souhaité que la France puisse construire dans les années qui viennent de nouvelles centrales produisant de l’électricité à partir du nucléaire.
Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes ici tout près du Bourget. Nous avons la ferme résolution de contribuer à lutter contre les conséquences des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, mais, de grâce, ne privons pas notre pays des ressources qui font sa force, notamment à un moment où notre économie est tellement touchée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

M. Ladislas Poniatowski. Auriez-vous quelque chose à demander à Ségolène Royal ?
Sourires.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est sans doute un exercice cruel que d’avoir à présenter ces crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » ! Hier, le Président de la République avait, à la COP 21, un discours particulièrement engagé pour l’environnement et, aujourd’hui, son gouvernement nous dit exactement l’inverse puisqu’il nous tient un discours où il n’est question que de restrictions budgétaires drastiques pour l’environnement. La contradiction frôle ici la caricature !
J’éprouve une certaine compassion pour Ségolène Royal, car je ne voudrais pas que, contre sa volonté, elle soit la ministre qui ait à son actif la plus forte baisse du budget de l’écologie.

Les chiffres sont cruels, comme l’a rappelé M. Husson. Depuis 2012 au moins, le traitement du ministère de l’écologie a été rigoureux, voire drastique.
Si l’on compare la loi de finances pour 2012 aux crédits qui nous sont aujourd’hui présentés, la baisse est de 26% : par rapport à celui de 2010, on passe à 30 % de baisse.
La baisse continue, et elle touche des missions que l’on pourrait qualifier de régaliennes : la politique de lutte contre les changements climatiques subit une baisse de 6 % ; l’ADEME, qui est le bras armé du ministère et sur laquelle on fait peser de nombreuses missions, a vu ses crédits réduits de 20 % depuis 2012 ; la politique de prévention des risques, Pierre Médevielle l’a rappelé, perd 8 % de ses moyens et la baisse atteint même 20 % pour les installations classées !
En termes d’emplois, vous faites mieux que la RGPP, que vous dénonciez pourtant : le taux de non-remplacement des départs à la retraite n’est pas d’un sur deux, mais de deux sur trois. Au palmarès des ministères, le ministère de l’écologie est ainsi le deuxième, après le ministère de l’économie, à perdre le plus d’emplois ! Et on veut nous faire croire que l’écologie est une priorité…
Or, cette politique budgétaire drastique n’est en rien compensée par une réforme de la fiscalité écologique, réforme pourtant tant de fois annoncée.
Nous attendons toujours une stratégie claire qui permettrait, par exemple, de réduire progressivement la dépense fiscale ou les subventions en faveur des énergies fossiles, de taxer à leur juste valeur les pollutions les plus nocives pour la santé, de donner des signaux clairs sur le prix du carbone.
Des décisions sont parfois prises, en fonction de l’actualité immédiate, mais il n’est jamais question d’une stratégie fiscale cohérente, qui permettrait de remplacer les prélèvements obligatoires qui pèsent sur le travail par des prélèvements sur la pollution. Résultat : la France est le mauvais élève de l’Europe sur ces deux points.
Depuis 2012, vous faites un peu tout et son contraire. Le domaine des transports en donne une illustration particulièrement intéressante, alors que vos discours regorgent de références aux transports publics et aux véhicules propres.
À l’automne de 2012, vous avez baissé de 3 centimes la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
L’année dernière, vous l’avez augmentée, ce que vous faites de nouveau cette année pour le diesel. Vous la baissez sur l’essence dans la loi de finances et vous l’augmentez de nouveau sur l’essence dans la loi de finances rectificative, pour ne la diminuer que sur l’essence contenant 10 % de biocarburant !
Autre exemple, en 2012, pour des raisons politiques parfaitement rappelées par Marie-Hélène Des Esgaulx, vous supprimez l’écotaxe poids lourds. Aujourd’hui, vous en faites payer le prix à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF. Dans le même temps, la loi Macron prévoit de développer le transport par autobus.
Les contradictions successives sont votre marque de fabrique écologique.

J’en conviens, monsieur Grosdidier.
Après ces données générales, venons-en à des missions qui me tiennent à cœur. Je dirai tout d’abord un mot de la lutte conte les changements climatiques et le développement des énergies renouvelables.
Le DPT climat, ou document de politique transversale climat, s'élevait en 2010, si j’en crois les chiffres avancés par Guillaume Sainteny, un économiste reconnu dans ce domaine, à quelque 9, 95 milliards d’euros. Il est aujourd'hui, à l’heure même où nous accueillons la COP 21, de 3, 53 milliards d’euros.
Le Gouvernement s’est également engagé à doubler le fond chaleur. Or pas un euro supplémentaire n’est inscrit dans ce budget ! Au contraire, vous ponctionnez l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, de 90 millions d’euros sur ses fonds de roulement.
On ne peut pas être le champion des discours de la COP 21 et dans le même temps assumer que son propre gouvernement consacre plus de 30 milliards d’euros par an – toujours selon les chiffres de Guillaume Sainteny – à des soutiens publics directs ou indirects et à des dépenses fiscales pour les énergies fossiles !
La deuxième mission qui me tient à cœur est la biodiversité.
Nous étions très favorables au projet de loi qui a été présenté en conseil des ministres il y a un an et demi. Nous sommes à la fin de 2015, et nous n’avons toujours rien voté. Nous en avons discuté en commission, nous avons préparé des amendements, nous sommes en particulier très favorables à la création de l’Agence française de la biodiversité. Toutefois, pas un euro supplémentaire n’est prévu dans la loi de finances. Le projet est-il définitivement enterré ?
J’en viens à une troisième mission, qui pourrait être la première d'ailleurs, je veux parler des risques. Comme certains l’ont souligné, les crédits de paiement du programme baissent de 8 %. Vous trouverez toutes les explications possibles, je n’en doute pas, mais dois-je rappeler que le coût des catastrophes naturelles a été multiplié par quatre en trente ans ? Dois-je rappeler que la pollution de l’air, sujet bien connu dans ma région, est responsable de quelque 20 000 décès prématurés par an en France ?
Il aurait été logique, la gestion du risque étant une politique régalienne, de renforcer les moyens dans ce domaine, tout particulièrement ceux de l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui a été souvent précurseur et qui a fait office de lanceur d’alerte. Je pense, par exemple, aux problèmes liés au bisphénol A ou à la pollution de l’air. Or vous faites l’inverse : vous affaiblissez l’ANSES en lui confiant toujours plus de missions, notamment sur les biocides et sur les phytosanitaires, sans lui donner de moyens supplémentaires.
Monsieur le secrétaire d’État, je ne dénonce pas la rigueur budgétaire. Je la comprends, car elle est nécessaire. Je ne dénoncerai jamais le recentrage des missions de l’État sur celles qui sont prioritaires. Toutefois, à mes yeux, le climat, les risques, la préservation de la biodiversité font partie de cette priorité ! La biodiversité est le fondement de la pharmacopée, de l’agriculture, de la cosmétique.
Surtout, je n’accepte pas dans cet hémicycle l’indécence politique, l’indécence de discours qui font de l’écologie un slogan, alors qu’il apparaît clairement aujourd'hui avec ce budget que l’écologie n’est pas votre priorité ! Mes chers collègues, vous l’aurez compris, nous voterons contre ce projet.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains. – M. André Gattolin applaudit également.

Le projet de loi de finances rectificative prévoit tout de même de nombreuses dispositions dans ce domaine !

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que la COP 21 a ouvert ses portes, l’examen de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » revêt bien sûr une dimension particulière.
En effet, les moyens alloués à l’écologie devraient logiquement permettre de traduire les engagements du Gouvernement, dont l’objectif, entre autres, est la réduction de 40 % des émissions totales de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 1990, avec un objectif complémentaire de diviser par quatre les émissions totales d’ici à 2050.
Pour y parvenir, il faudrait diminuer les émissions de 9 à 10 millions de tonnes par an au cours des trente-cinq prochaines années, ce qui appelle des politiques publiques ambitieuses et un financement adapté. Or force est de constater que le compte n’y est pas.
Examinons cette mission budgétaire. On note une baisse de 105 millions d’euros des crédits de paiement, le budget passant de 6, 59 milliards d’euros à 6, 49 milliards d’euros. La baisse est assez faible, me direz-vous, mais elle s’inscrit dans une courbe descendante depuis plusieurs années. Ainsi, chaque année, le ministère voit fondre ses crédits : de 740 millions d’euros en 2013, de 500 millions d’euros en 2014 et de 400 millions d’euros en 2015 dans le cadre du budget triennal 2015-2017.
Il est à noter que le ministère de l’écologie paie l’un des plus lourds tributs aux 5 milliards d’euros de mesures supplémentaires d’économies budgétaires, fragilisant la crédibilité des politiques mises en place.

Limiter l’intervention publique, c’est-à-dire décrédibiliser la politique et la démocratie pour les remplacer par une gouvernance des marchés, voilà fondamentalement ce qui est à l’œuvre aujourd’hui !

Par ailleurs, les crédits concernant le programme « Infrastructures et services de transports » restent quasi stables cette année, ce qui est heureux. Cela traduit pourtant l’absence de moyens nouveaux permettant de relancer l’activité ferroviaire.
Les recettes supplémentaires que nous proposons régulièrement ne sont toujours pas envisagées. À l’inverse, la loi Macron a privé de 500 millions d’euros les autorités organisatrices de transports par la modification du seuil du versement transport, qui passe de neuf à onze salariés. Toutefois, j’arrête là sur ce thème ; nous y reviendrons sans doute le 10 décembre prochain, à l’occasion du débat sur la proposition de loi permettant de maintenir et de développer sur l’ensemble du territoire national une offre de transport ferroviaire régional de qualité.
Ajoutons que les sommes allouées à l’AFITF sont en nette diminution, de 424 millions d’euros, soit une baisse de 37, 2 %. Nous regrettons ce choix d’attribuer une fraction plus faible de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, à cette structure. Avec 1, 9 milliard d’euros de recettes, l’AFITF ne pourra engager qu’un programme minimum de travaux, alors même que les besoins sont évalués à 2, 2 milliards d’euros et que le secteur routier continue de recevoir une fraction de la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui est en augmentation, puisqu’elle passe de 375 à 450 millions d’euros.
Plus globalement, nous regrettons que la fiscalité écologique, renvoyée à la loi de finances rectificative, soit la grande absente du projet de loi de finances pour 2016, et qu’une réflexion globale ne soit pas menée.
Il faudra bien un jour s’attaquer réellement à la question de la fiscalité et s’interroger sur les modalités de l’intervention publique. Aujourd’hui, les politiques environnementales passent le plus souvent par des dépenses fiscales, c’est-à-dire par des exonérations ou des crédits d’impôt. La dépense fiscale est difficilement maîtrisable et les effets d’aubaine sont toujours présents, ce qui fait perdre toute signification et toute lisibilité à l’impôt.

Ainsi, le crédit d’impôt pour la transition énergétique coûtera 1, 4 milliard d’euros en 2016. Le taux à 5, 5 % de TVA sur les travaux énergétiques des locaux à usage d’habitation représente, pour sa part, quelque 1, 12 milliard d’euros. C’est sans doute une mesure d’incitation qui a son utilité. Pour autant, nous avons besoin d’une lisibilité globale.
Nous regrettons, enfin, dans la droite ligne des projets de loi de finances précédents, la contribution des agences environnementales de l’État aux politiques d’austérité. Ainsi, nous sommes opposés au prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’ADEME par l’article 14 de ce projet de loi. Le prélèvement annuel sur le fonds de roulement des agences de l’eau est maintenu encore cette année, à hauteur de 175 millions d’euros, rompant avec le principe fondateur en ce domaine qui veut que « l’eau paye l’eau ».
Surtout, je voudrais mettre l’accent sur les suppressions d’emplois. La baisse des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » a des conséquences directes sur la masse du personnel : quelque 515 postes ont été supprimés l’an dernier et 671 le seront en 2016. C’est considérable ! Nous atteignons là un seuil critique en deçà duquel les missions de service public ne pourront plus être remplies. Je voudrais ici rendre hommage aux personnels, qui continuent à exercer leurs missions dans des conditions difficiles.
Nous avons souhaité la création d’une Agence pour la biodiversité. Celle-ci est repoussée au 1er janvier 2017. Or les plafonds d’emploi de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA, ceux du groupement d’intérêt public ATEN, l’Atelier technique des espaces naturels, mais également ceux des parcs nationaux perdent en tout 26 équivalents temps plein. Dans quelles conditions cette agence va-t-elle pouvoir voir le jour et travailler ?
Par ailleurs, les crédits de l’action de la lutte contre le changement climatique sont en baisse de 2 millions d’euros. Ceux de Météo France perdent 78 équivalents temps plein. C’est vraiment préoccupant. Au fond, tout est fait pour que les missions soient transmises au secteur privé.
Les sénateurs du groupe CRC ne voteront pas ces crédits, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et marquent un décalage évident entre les annonces et les moyens budgétaires.
Cette position que nous affirmons avec conviction n’est pas un jugement sur l’action du ministère proprement dite. Vous agissez, monsieur le secrétaire d'État, avec Mme Royal, et vous le faites savoir. Nous recevons régulièrement des messages de votre part. Vous savez écouter et, même si vous avez un sens aigu de la mise en lumière de vos actions, vous agissez avec conviction. Il fallait que cela fût dit aussi.
Pour autant, vous n’avez pas, je le crois, les moyens de votre politique.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC. – M. André Gattolin applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comment ne pas évoquer à mon tour la COP 21 ? Dans cette course contre la montre face au dérèglement climatique, nous mesurons tous l’importance et l’urgente nécessité pour les 196 pays d’assurer une véritable solidarité climatique.
Il est important de fixer des objectifs, certes, mais également de donner à chacun les moyens de les réaliser, en allant le plus vite possible. Dans le cadre de cette COP 21, force est de reconnaître que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui est aussi une loi de transition écologique, fait de la France un modèle et une référence. J’y reviendrai en fin de propos.
Concernant le programme 174, qui concerne plus particulièrement la commission des affaires économiques du Sénat, il ne représente qu’une faible partie des moyens qui sont et seront consacrés à la politique énergétique.
En effet, il me paraît important de le rappeler, les financements de la politique énergétique de la transition énergétique passent par d’autres canaux de financement. On ne peut, dès lors, mesurer l’action du Gouvernement, dans un domaine aussi important que celui-ci, uniquement à l’aune de ce seul budget. Certes, les crédits de ce programme sont en baisse, mais cela témoigne de leur participation à l’effort budgétaire.
Il faut reconnaître également que cette baisse est due, en tout cas pour partie, à la réduction structurelle des dépenses dédiées à l’action n° 4, Gestion économique et sociale de l’après-mines, liée elle-même à la baisse régulière du nombre de bénéficiaires en 2015. Or cette action couvre 93 % de l’ensemble des crédits de ce programme.
Cela étant, la politique énergétique, je le redis, est transversale et bénéficie de nombreux moyens extrabudgétaires qui seront consacrés au financement de la transition énergétique. J’y reviendrai, non sans m’être attardé quelque peu sur la contribution au service public de l’électricité, la CSPE créée en 2003, pour financer des missions de service public.

Cette contribution est perçue, je le rappelle, sur la facture des seuls consommateurs finals d’électricité.
L’effort, au fil des années, s’est accru et devrait atteindre plus de 6, 3 milliards d’euros en 2015 et quelque 7 milliards d’euros en 2016, tandis que le déficit de compensation cumulé pour EDF est de l’ordre de 5, 5 milliards d’euros.
Au rythme de progression actuel et en considérant l’effort à effectuer dans les prochaines années, nous ne pouvons plus faire l’économie d’une réforme. Ce changement est donc indispensable, et j’apprécie que la loi de finances rectificative permette de réexaminer ce dispositif dans le cadre d’une réforme à laquelle le Sénat s’était associé lors de l’examen de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Il était nécessaire que l’assiette de financement des charges de service public soit graduellement élargie aux énergies carbonées, comme le permet la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, avec l’augmentation progressive de la fiscalité carbone.
Il n’était plus possible de continuer à faire supporter par le seul consommateur d’électricité le coût des charges de service public.
Il était également devenu indispensable qu’il y ait un contrôle du Parlement renforcé et une meilleure transparence des charges.
Bref, nous ne pouvions différer la mise en œuvre d’un cadre juridique robuste, avec une CSPE qui deviendrait une accise à part entière.
Permettez-moi de revenir sur un point que j’ai évoqué précédemment en indiquant que de nombreux moyens extrabudgétaires étaient aussi consacrés au financement de la transition énergétique. La montée en puissance du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, dont le montant pour 2016 atteint 1, 4 milliard d’euros, soit plus du double de la somme provisionnée pour 2015, est là pour le prouver. Le taux de TVA à 5, 5 % en faveur des travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, dont le coût est évalué à 1, 12 milliard pour 2016, complétera utilement ce dispositif.
Il faut relever la mise en place du fonds dédié à la transition énergétique, qui devrait être doté de 1, 5 milliard d’euros sur trois ans, entre 2015 et 2017, ainsi que d’une enveloppe spéciale consacrée à la transition énergétique, créée au sein de ce fonds. Celle-ci permettra de soutenir les projets « territoires à énergie positive pour la croissance verte », mais aussi l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, consacrée à la rénovation thermique, ainsi que la bonification des aides de l’ADEME au titre du fonds chaleur, l’économie circulaire des « territoires zéro gaspillage zéro déchet » et le développement de 1 500 méthaniseurs.
Faut-il également rappeler la ligne de crédits ouverte par la Caisse des dépôts et consignations en faveur des collectivités, afin d’assurer la rénovation des bâtiments publics ? Ou encore le programme des investissements d’avenir et les moyens financiers que BPI France y consacre ?
C’est avéré : avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la France montre l’exemple en matière de lutte contre le dérèglement climatique en se dotant d’un nouveau modèle de croissance plus soutenable.
Je sais que le Gouvernement souhaite que les décrets nécessaires soient rapidement publiés. Tout laisse à penser que ce sera le cas, au vu de la cadence des réunions du Conseil supérieur de l’énergie, que je convoque presque chaque semaine !
Sourires.

Il est vrai que beaucoup a été fait au cours de l’année écoulée. La loi de transition énergétique pour une croissance verte a impulsé une dynamique positive pour doter la France d’une réelle capacité d’entraînement sur le plan européen, d’abord, puis mondial, lors de cette COP 21. Il faut le souligner, la France est le seul pays à avoir gravé dans la loi une progression réelle du prix du carbone.
Ces derniers mois, nous avons partagé l’ambition du Gouvernement de mettre en place un ensemble de dispositifs législatifs capables de favoriser l’avènement d’un nouveau modèle de développement, porteur d’activités nouvelles et d’emplois durables, conciliant donc écologie et économie.
Grâce à l’ensemble des actions engagées, la France est en première ligne pour le climat, à la hauteur de son histoire. Nous pouvons établir un parallèle entre 1789, avec la proclamation à Paris de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et 2015, avec l’inscription de ces nouveaux droits de l’humanité dans le cadre de la COP 21.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
Sourires sur les travées de l'UDI-UC.

Ce qui constituera aussi une sorte de révolution, dans nos têtes d’abord, …
Nouveaux sourires, sur les mêmes travées.

M. Roland Courteau. … mais aussi dans nos modes de production et de consommation, donc dans nos modes de vie. L’urgence est là, car « pour la première fois, l’humanité est en mesure d’anéantir sa propre espèce. »
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais évoquer le programme 203, « Infrastructures et services de transports ».
Comme beaucoup de vos prédécesseurs, monsieur le secrétaire d’État, vous êtes confronté au problème que nous rencontrons depuis plusieurs décennies, depuis que nos budgets sont en déficit : les investissements civils constituent une variable d’ajustement budgétaire, rendant difficile le financement des infrastructures de transport, dont le besoin est pourtant réel, et d’abord pour la croissance. Loyola de Palacio rappelait ainsi, lorsqu’elle était commissaire chargée des transports au sein de la Commission européenne, que le déficit d’infrastructures en Europe coûtait 0, 7 point de croissance chaque année sur le continent.
Toutes les enquêtes menées sur l’attractivité de la France indiquent que les infrastructures de transport en constituent un élément. De nombreux projets sont en cours, des travaux sont engagés, mais nous sommes face à une impasse dans le financement, qui nous oblige, d’ailleurs, à une humilité collective.
La taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, avait été créée pour financer les transports, avant d’être entièrement reversée au budget général. En 1995, la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dite « loi Pasqua », a institué le Fonds d’investissement des transports terrestres et des voies navigables, le FITTVN, qui a été doté de certaines redevances domaniales, de la redevance hydroélectrique et d’une taxe autoroutière.
Quelques années plus tard, le FITTVN a été emporté par une réforme menée par Lionel Jospin, à laquelle, d’ailleurs, son ministre des transports ne souscrivait pas. Puis, nous avons créé l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, considérant qu’un nouvel outil était nécessaire pour imaginer de nouvelles recettes.
Le Grenelle de l’environnement a ensuite été voté unanimement, avec une recette affectée à l’AFITF permettant de financer les infrastructures. Après des manifestations, plus personne ne s’est souvenu que nous avions collectivement voté le Grenelle de l’environnement ! Aujourd’hui, les uns reprochent au Gouvernement d’avoir abandonné, les autres d’avoir signé un mauvais contrat qui aurait coûté trop cher.
Avec tout cela, le problème du financement des transports est toujours devant nous. L’an dernier, nous y avons consacré une partie de la TICPE – la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques –, que nous rognons un peu cette année, parce qu’il faut bien assurer l’équilibre budgétaire.
Pour autant, Marie-Hélène Des Esgaulx l’a rappelée à juste titre, certains financements sont assurés, avec un stock présent de 11, 8 milliards d’euros, dont 63 % pour le ferroviaire.
Dans ce contexte, et malgré ces difficultés, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement a eu le courage – je ne dis pas l’irresponsabilité, parce que je lui en suis reconnaissant – de lancer de nouveaux projets et d’inscrire dans la continuité le financement de quelques infrastructures, comme le canal Seine-Nord, d’une part, et la liaison ferroviaire Lyon-Turin pour les voyageurs et pour les marchandises, d’autre part. Cela n’a pas toujours été le cas dans le passé ! Il a, de même, pris des engagements vis-à-vis de l’Union européenne concernant la part de financement que la France apportera, conjointement avec l’Italie, à ce dernier projet.
Nous sommes lucides et, comme la Cour des comptes l’avait annoncé, nous avons constaté notre incapacité à financer cette infrastructure sur des ressources strictement budgétaires.
Michel Destot et moi-même avons formulé des propositions dans notre rapport sur le sujet, comme la mise en place de l’eurovignette. Ce dispositif constitue une chance offerte par la Commission européenne, dans la mesure où, à la différence de l’écotaxe, d’une part, il s’agit d’une recette prélevée sur le territoire concerné par l’infrastructure à réaliser et, d’autre part, on ne peut l’affecter qu’au financement de l’infrastructure pour laquelle elle est levée. Cela la place à l’abri des tentations prédatrices menaçant les recettes affectées aux transports dans notre pays, dont je viens de rappeler les effets.
Monsieur le secrétaire d’État, le Premier ministre nous a indiqué que nous pourrions mettre en œuvre l’eurovignette dans le projet de loi de finances pour l’an prochain, dès lors qu’il s’agira de financer un chantier en cours. Il ne faudrait pas, en effet, que cette réalisation se fasse au détriment des autres besoins de financement d’infrastructures.
Par conséquent, nous serons amenés à prendre en cours d’année un certain nombre de décisions préparatoires à la mise en place de l’eurovignette, afin de rédiger les textes réglementaires et d’adopter les quelques dispositions législatives probablement nécessaires, certaines pouvant s’inspirer de ce qui avait été prévu pour l’écotaxe. Ce travail préparatoire est nécessaire, si nous voulons être opérationnels l’an prochain et ainsi, au moins, garantir l’essentiel du financement de ce projet.
Je souhaite donc saluer cette décision du Gouvernement, mais aussi rappeler que, malheureusement, si celle-ci règle partiellement le dossier du Lyon-Turin, elle ne résout pas le problème du financement de nos infrastructures dans son ensemble.
Mes chers collègues, cela nous oblige à une réflexion collective responsable pour définir la voie à suivre en période de fortes contraintes budgétaires. Certains choix doivent être faits, en harmonie. Je suis de ceux qui ont regretté les discussions sur le versement transport, qui ont abouti à en réduire l’assiette au moment où nous avons besoin de financement pour les infrastructures de transport collectif en ville.
De même, il me semble essentiel d’obtenir une réponse au sujet du rendement très faible de la taxe créée dans la loi Borloo sur l’immobilier, pour financer les infrastructures grâce aux effets d’aubaine existant dans ce secteur.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si les aléas de la diplomatie écologique ne permettront peut-être pas au Président de la République d’obtenir un accord universel et contraignant pour limiter le changement climatique, un constat est, à l’inverse, unanime et sans équivoque : le budget présenté aujourd’hui témoigne d’un désengagement important du Gouvernement dans le domaine des grandes actions environnementales.
Pourtant, François Hollande déclarait, il y a encore quelques jours : « À la COP 21, il ne suffira pas de prononcer de bonnes paroles, il faudra aussi s’engager sur des objectifs contraignants ». Il devait sans doute penser que les collectivités territoriales et les acteurs privés prendraient le relais…
Nous sommes en effet en droit d’attendre de cette mission consacrée à l’écologie qu’elle soit à la hauteur des engagements du Président de la République.
En effet, ce cycle de deux ans, entre 2015 et 2016, est décisif, sinon pour le monde, au moins pour la France, en matière de protection de l’environnement. L’année 2015 a été celle de l’adoption de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte et elle a marqué le début d’un cycle législatif, avec l’examen du projet de loi relatif à la biodiversité. Cette année, également, un processus de rencontres internationales de premier plan autour du climat arrive à son terme, avec la COP 21. L’année 2016 sera pour sa part celle de la mise en œuvre véritable de la nouvelle politique publique environnementale du Gouvernement.
L’écologie est présentée comme l’un des principaux ressorts de la vie politique française, mais, paradoxalement, les renoncements du Gouvernement sont nombreux et les discours bien plus éloquents que les actes !
J’en veux pour preuve cette décevante loi relative à la transition énergétique et le millefeuille de dispositions éparses et inintelligibles qu’elle contient, qui m’a, d’ailleurs, interdit de la voter. Nous avions besoin d’un texte embrassant les questions énergétiques, l’aménagement du territoire, les transports et le logement ; nous avons obtenu une loi de programmation bavarde et peu efficace.
D’autres décisions ont également illustré ce renoncement. C’est le cas de l’abandon du projet d’autoroute ferroviaire qui devait relier le Pas-de-Calais aux Landes et qui constituait pourtant, selon le secrétariat d’État aux transports, « une concrétisation » de la transition énergétique, mais aussi de l’abandon de l’écotaxe, un gâchis financier de 800 millions d’euros et une faute politique. « Nous ne sommes pas allés jusqu’au bout », a déclaré Manuel Valls à ce sujet.
Notons également des pas en arrière en matière de pollution, avec la baisse des subventions de l’État à l’Association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France, Airparif, ou le non-remboursement au STIF, le Syndicat des transports d’Ile-de-France, du manque à gagner, qui représente tout de même quelque 50 millions d’euros, consécutif à la gratuité des transports en commun lors des pics de pollution.
Entre valse-hésitation et désengagement, le message est brouillé. Quelle politique environnementale le Gouvernement entend-il défendre ?
Les crédits qui nous sont soumis aujourd’hui contribuent à alimenter ce doute. Ils ne sont clairement pas à la hauteur des défis que le Gouvernement s’est lui-même fixés. Comme notre excellent collègue Jean-François Husson l’explique dans son rapport : « Il s’agit d’un budget contradictoire avec les ambitions affichées par le Gouvernement pour favoriser la transition écologique et énergétique ».
Poursuivons notre énumération des contradictions. La question des moyens alloués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, en constitue une illustration probante. Alors que celle-ci a vu ses missions élargies par la loi de transition énergétique, ses moyens seront une nouvelle fois amputés, après que ses dépenses de fonctionnement ont diminué de 7 % en 2013, de 4 % en 2014, puis de 3 % en 2015.
Un autre exemple décisif du caractère contradictoire de ce budget réside dans la « baisse paradoxale des crédits dédiés à la lutte contre le changement climatique dans le contexte de l’accueil de la COP 21 par notre pays », pour citer encore les propos de notre rapporteur.
Enfin, une baisse notable de 6 % a touché les crédits alloués au financement des centres de contrôle technique, ainsi que des études, expertises et expérimentations liées aux véhicules. Cette diminution n’est pas un bon signal, alors que nous traversons une crise particulièrement grave depuis les révélations sur les véritables taux d’émissions de certains véhicules appelés « voitures du peuple » !
Au vu de ces éléments, c’est donc sans surprise que le groupe Les Républicains ne votera pas ces crédits.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à remercier les orateurs qui soutiennent le budget du Gouvernement, mais également Jean-Claude Lenoir et Michel Bouvard, qui ont su trouver les mots pour situer notre débat dans les exigences qu’imposent la situation particulière de notre pays et la réunion de la COP 21.
Le débat peut certes être « cruel » pour le Gouvernement, mais quel est le projet de ceux qui regrettent la suppression de l’écotaxe ?
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Dans ce temps de débat démocratique, il serait extrêmement intéressant de savoir si le rétablissement de l’écotaxe fait vraiment partie du projet de la droite. En effet, aujourd'hui, l’un de ses chefs de file dans une région est un ancien chef de file de la bataille contre l’écotaxe !
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Si nous voulons que le débat aille jusqu’au bout, il faut tout dire clairement.
De même, le Gouvernement s’engage dans un programme de 50 milliards d’euros d’économies sur plusieurs années. Ce n’est pas simple, mais notre situation budgétaire l’exige. J’entends que certains disent que 50 milliards d’euros ne suffisent pas et qu’il faudrait économiser 100 milliards d’euros, ou plus encore…
Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Toutefois, ils refusent de toucher au budget de la défense – bien sûr –, de la police – naturellement –, de la justice – cela va sans dire –, des collectivités locales – ce n’est pas possible –, de l’environnement… Que restera-t-il à la fin ? Si nous ne voulons pas que le débat soit « cruel », essayons donc de le maintenir à un niveau exigeant, car c’est ce qu’attendent les Français !
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain.
Ce budget accompagne la mise à neuf de la loi de transition énergétique. Permettez-moi d'ailleurs d’excuser Ségolène Royal, qui est retenue à la COP 21.
Concernant la rénovation énergétique, le crédit d’impôt transition énergétique, simplifié et renforcé en 2015, sera prolongé en 2016. La nouvelle obligation de certificat d’économie d’énergie en faveur de la lutte contre la précarité entrera en vigueur au début de 2016 et permettra de soutenir la rénovation chez les ménages modestes en lien avec l’ANAH, les collectivités et les associations.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, contribuera aux efforts d’économies via un prélèvement de 90 millions d’euros sur son fonds de roulement, mais le niveau atteint par ce dernier permettra de maintenir sa capacité d’engagement, soit 590 millions d’euros, l’année prochaine.
Conjugués aux 205 millions d’euros de subventions annuelles du fonds de financement de la transition énergétique pour la croissance verte, les moyens de l’ADEME vont permettre d’amplifier les dynamiques territoriales.
Le fonds a d’ores et déjà permis de créer 215 territoires à énergie positive partout en France, grâce à une aide financière de 500 000 euros par territoire visant à financer des investissements immédiats dans des actions concrètes : rénovation d’éclairages publics, acquisition de véhicules électriques par les collectivités, rénovation énergétique de bâtiments publics, actions de sensibilisation du public.
Quelque 106 millions d’euros sont affectés à ces territoires en 2016, et le nombre de territoires à énergie positive devrait être doublé. Ainsi, plus de la moitié de la population française habitera un territoire à énergie positive.
Plus de vingt villes respirables seront soutenues, et de nouvelles collectivités seront prochainement désignées lauréates du deuxième appel à projets « territoires zéro gaspillage zéro déchet ». Un appel à projets « PME des territoires à énergie positive », centré sur l’efficacité énergétique et l’économie circulaire, sera lancé prochainement.
Le soutien aux mobilités propres, notamment la mobilité électrique, sera poursuivi grâce au maintien du bonus pour les véhicules électriques et à l’extension de la prime à la conversion aux diesels de plus de dix ans.
La mise en œuvre de la loi de transition énergétique transparaît également dans le volet fiscal du projet de loi de finances, celui-ci prévoyant l’amorce de la convergence des fiscalités du diesel et de l’essence.
Mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cadre de la loi de finances rectificative, vous serez appelés à voter une réforme ambitieuse de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, ayant le triple objectif de sécuriser le financement de la transition énergétique grâce à un cadre juridique rénové, d’améliorer le contrôle parlementaire sur les ressources et les charges du service public de l’électricité, en les inscrivant directement dans le budget de l’État – il s’agit d’une réponse concrète aux interrogations de la commission des finances sur les dispositifs extrabudgétaires –, et de poursuivre la trajectoire de progression de la composante carbone de notre fiscalité énergétique, ce qui permettra de renforcer le prix du carbone, de stabiliser la fiscalité de l’électricité en 2017 et de mieux faire contribuer les énergies fossiles au financement de la transition énergétique.
Cette réforme essentielle est soutenue par 6, 3 milliards d’euros d’effort public en 2015, dont 4 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables électriques. L’effort public sera porté à 7 milliards d’euros en 2016 et potentiellement à 7, 5 milliards d’euros en 2017.
Vous m’avez interrogé sur la situation de l’entreprise Areva. Le Gouvernement s’est engagé pour consolider la filière nucléaire, notamment par le rapprochement entre Areva et EDF. Cette dernière entreprise devrait ainsi prochainement détenir une participation majoritaire dans Areva NP, qui regroupe les activités industrielles de construction des réacteurs, d’assemblage de combustibles et de services à la base installée, Areva conservant une participation stratégique. Recentrée sur le cycle du combustible, Areva sera une entreprise rentable, une recapitalisation par l’État et d’autres actionnaires lui redonnant les moyens de poursuivre son développement.
En matière de transports, le budget pour 2016 confirme la priorité donnée à la sécurité, à l’amélioration de la qualité des infrastructures et des services.
Le budget pour 2016 aura les trois priorités de celui de 2015 : la sécurité et la qualité des infrastructures et des services, le rééquilibrage entre les modes de transport et le respect des règles économiques et sociales, notamment la lutte contre le dumping social. En baisse d’environ 1 %, le budget des infrastructures et services de transport est maintenu à un niveau comparable à celui de 2015.
S’agissant de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, le Gouvernement s’était engagé à assurer un niveau de dépenses opérationnelles de 1, 9 milliard d’euros en 2015, en 2016 et en 2017. Ce niveau sera pratiquement atteint en 2015, de même qu’en 2016, avec un montant de dépenses opérationnelles prévisible de 1 milliard d’euros et 855 millions d’euros.
Les recettes de l’AFITF sont assurées par l’affectation d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, cette solution de substitution à la disparition de l’écotaxe retenue l’année dernière ayant été pérennisée par le groupe de travail que j’ai animé pendant plusieurs mois.
Je tiens également à préciser que les recettes de l’AFITF seront aussi alimentées en 2016 par une participation de 100 millions d’euros des sept principales sociétés concessionnaires d’autoroutes et que l’accord conclu le 9 avril dernier prévoit en outre que ces sociétés financeront plus de 3 milliards d’euros de travaux sur le réseau qui leur est concédé. Ce point me paraît important pour le développement des territoires comme pour les entreprises de travaux publics, d’autant que 55 % de ces travaux seront effectués par des PME sans lien avec les sociétés concessionnaires.

En somme, ce sont les automobilistes français qui paieront, et non les étrangers !
Au-delà de 2016, certains engagements de l’AFITF viendront apporter leurs effets. Je tiens à redire clairement, comme je l’ai fait devant la commission en réponse à Louis Nègre, ainsi qu’à l’Assemblée nationale, que le Gouvernement assurera ses engagements. Il faudra donc trouver ensemble une ressource pour alimenter le budget de l’AFITF en 2017, qu’il s’agisse du maintien de l’attribution de la totalité des recettes venant de la TICPE – non pas les 715 millions d’euros qui sont dans le budget de l’AFITF, mais le 1, 1 milliard d’euros que représente la TICPE –, ou de la levée d’une autre ressource.
En ce qui concerne la priorité du report modal, le Gouvernement poursuivra son action en faveur du fret ferroviaire, du fret fluvial, du transport combiné des autoroutes ferroviaires et de la mer, mais aussi grâce à l’avancée des grands projets de ligne ferroviaire Lyon-Turin et de canal Seine-Nord Europe, qui ont vocation à s’inscrire dans le réseau transeuropéen de transport. Comme l’a rappelé Michel Bouvard, le Gouvernement a porté cette année ces deux dossiers très importants, qui ne relèveraient pas du possible aujourd’hui sans les quelque 40 % de subventions consenties par l’Europe.
Au moment où l’on examine l’action du Gouvernement, il me paraît nécessaire d’apporter ces précisions, afin de rééquilibrer certaines appréciations. En outre, il nous faudra réfléchir à l’instauration de recettes dédiées, au travers des rapports que le Gouvernement a demandés pour alimenter sa réflexion. J’ajoute que ces infrastructures de dimension européenne sont nécessaires pour notre pays.
Permettez-moi de répondre à M. Raison, qui a abordé de nouveau la question de l’autoroute ferroviaire : comme je l’ai déjà indiqué lors des débats en commission, le projet n’est pas abandonné ; il est au contraire question de lui donner une dimension européenne – j’ai rencontré à ce sujet mon homologue espagnole – et de le sécuriser au niveau juridique.
S’agissant du budget des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture, les crédits sont également maintenus au niveau de l’année dernière. Le développement de l’aquaculture semble nécessaire, puisque nous importons 85 % de notre consommation et que la politique commune de la pêche nous impose des objectifs et des quotas visant à préserver la ressource.
Concernant la pêche maritime, le programme opérationnel du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP, devrait être approuvé formellement de manière imminente. Je pensais qu’il serait approuvé aujourd'hui, mais nous n’avons pour l’heure qu’un accord de principe de la commission. Je précise que cet accord est extrêmement important, car le FEAMP représente 588 millions d’euros, soit une augmentation de 70 % par rapport au programme précédent.
S’agissant du renouvellement de la flotte de la pêche, le rapport de l’Inspection générale des finances qui m’a été remis en début d’année insiste sur la mobilisation des instruments fiscaux visant à favoriser l’investissement vers les PME. Les amendements nécessaires ont été votés dans le projet de loi de finances.
Dans le domaine aérien, la dotation du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », qui augmentera de 1 % en 2016 par rapport à 2015, permettra d’atteindre les objectifs fixés, comme il me semble que la plupart des orateurs l’ont fait observer.
Par ailleurs, la Direction générale de l’aviation civile, ou DGAC, poursuit sa politique de réduction des coûts structurels, au moyen d’une redéfinition de l’implantation géographique de ses services et d’une optimisation de leurs dépenses de fonctionnement. Grâce à ce niveau de ressources et à cet effort de performance, quelque 252 millions d’euros d’investissements seront réalisés en 2016, ce qui assure la poursuite de l’engagement de la DGAC.
Il faut également souligner que ce budget de l’aviation civile permettra d’accélérer le désendettement de la DGAC et de l’État. En effet, le désendettement net du budget annexe s’établira à 107 millions d’euros en 2016, après 57 millions d’euros en 2015, grâce à quoi le stock de dettes sera ramené à 1, 117 milliard d’euros.
L’année 2016 verra aussi l’adoption du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui ouvrira la voie à la création effective de l’Agence française pour la biodiversité ; cette agence, dont la préfiguration, désormais entrée dans sa phase opérationnelle, se poursuit de manière satisfaisante, verra ses moyens légèrement augmentés l’année prochaine, à 276 millions d’euros.
Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit aussi une extension du principe de spécialité des agences de l’eau au financement de la biodiversité au sens large, afin de permettre à ces organismes de financer des actions allant au-delà de leurs interventions actuelles en faveur de la biodiversité aquatique et des zones situées en deçà des douze milles nautiques. La mission relative au financement des politiques publiques de préservation des ressources en eau, de la biodiversité et des milieux marins, qui va être lancée, proposera de nouvelles pistes innovantes pour consolider les moyens alloués à la reconquête de la biodiversité.
L’accent sera mis en particulier sur les milieux littoraux et marins, notamment par le biais de la création de nouveaux parcs naturels marins, de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et de la désignation de sites Natura 2000 en haute mer, sans oublier la poursuite de la mise en œuvre de la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin ».
S’agissant de l’Agence des aires marines protégées, elle connaît une nette expansion de ses missions, du fait notamment de la création de nouveaux parcs marins. Aussi, le Gouvernement, qui n’en ignore rien, propose d’entreprendre une évaluation des équivalents temps plein travaillé supplémentaires nécessaires à cet opérateur, étant entendu que les effectifs de celui-ci ont déjà été largement préservés.
Dans le domaine de l’eau, les nouveaux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux seront adoptés d’ici à la fin de l’année ; ils permettront de poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux et la restauration des zones humides, ainsi que de s’adapter aux évolutions liées aux changements climatiques. Le prélèvement de 175 millions d’euros opéré sur les agences de l’eau préservera, dans le cadre des dixièmes programmes, un niveau d’intervention ambitieux, équivalent à celui des neuvièmes programmes.
Les inondations meurtrières qui se sont produites voilà quelques semaines dans le sud-est de la France nous ont rappelé à quel point la prévention des risques revêtait une importance majeure face aux dérèglements climatiques. Pour cette raison, la dotation du programme « Prévention des risques », qui finance la prévision des crues, comme celle du fonds Barnier, est préservée.
Quant à la subvention attribuée à Météo France, fixée à 198 millions d’euros, elle tient compte des gains issus de la réforme de son organisation territoriale que cet établissement a entreprise depuis plusieurs d’années.
La situation de cet établissement est contrainte, mais maîtrisée, et le budget adopté par son conseil d’administration pour 2016 lui assure un fonds de roulement et une trésorerie suffisants, ainsi qu’une capacité d’investissement lui permettant de conserver une place de premier ordre au plan mondial. Après s’être équipé d’un nouveau supercalculateur en 2013 et avoir mené à bien la modernisation de ses réseaux d’observation, il achèvera sa réforme territoriale l’année prochaine.
Dans le domaine des risques technologiques, le Gouvernement poursuit l’élaboration des plans de prévention des risques technologiques associés aux sites classés « Seveso seuil haut », dont 85 % ont d’ores et déjà été approuvés. En matière de sûreté nucléaire, il continue à augmenter les effectifs de l’Autorité de sûreté nucléaire, à hauteur de dix renforts par an, conformément à la programmation triennale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous vous proposons d’allouer 1, 7 milliard d’euros aux organismes de recherche pour leur permettre de faire progresser la connaissance et de fournir des données nécessaires à l’éclairage des politiques, ainsi que pour soutenir l’innovation. En vérité, la recherche constitue un levier essentiel de la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a d’ailleurs redéfini le cadre et les modalités d’élaboration de la stratégie nationale de la recherche énergétique.
Je ne veux pas conclure sans évoquer, à la suite de M. Husson, rapporteur spécial de la commission des finances, la situation du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, ou Cerema. L’État a consenti un effort sensible pour préserver les moyens de cet opérateur, qui joue un rôle majeur dans la transition écologique et énergétique.
En effet, les ressources financières de ce centre pour 2014 ont été supérieures à celles dont avaient disposé l’année précédente les onze services préexistants, et la dotation de l’État a été reconduite à l’identique en 2015 ; quant aux moyens humains de cet établissement, ils ont également été préservés. En 2016, le Cerema contribuera, comme l’ensemble des opérateurs de l’État, aux efforts budgétaires nécessaires. Il s’engage sur un modèle économique qui lui permet de réaliser des économies sur ses dépenses et d’instaurer une dynamique fondée sur l’investissement et sur une hausse pérenne de ses propres ressources.
Pour conclure, je signale que les crédits alloués à l’Institut national de l’information géographique et forestière, l’IGN, sont maintenus au niveau de 95 millions d’euros, pour permettre à cet organisme de poursuivre ses mutations techniques et économiques et de renforcer ses liens avec les acteurs du territoire en déployant des outils d’information géographique.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les précisions que le Gouvernement tenait à vous apporter en réponse aux orateurs qui se sont succédé à la tribune et à la suite des débats, fort riches, qui se sont tenus au sein de la commission.
Aussi, le Gouvernement demande au Sénat d’approuver ces orientations, …
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. … qui correspondent à la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, qui est un engagement fondamental de notre politique, comme à notre volonté de faire de la France un pays exemplaire à l’heure de la COP 21 !
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Michel Le Scouarnec applaudit également.

Nous allons maintenant procéder au vote des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », figurant à l’état B.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Écologie, développement et mobilité durables
Infrastructures et services de transports
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
Météorologie
Paysages, eau et biodiversité
Information géographique et cartographique
Prévention des risques
Dont titre 2
41 931 062
41 931 062
Énergie, climat et après-mines
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
Dont titre 2
1 944 985 262
1 944 985 262

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits.
Ces crédits ne sont pas adoptés.

J’appelle en discussion l’article 51 ter, qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».
Écologie, développement et mobilité durables
(Intitulé nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l’évolution du financement des commissions locales d’information nucléaire définies à l’article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national.
Ce rapport examine en particulier les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base, perçue par les commissions locales d’information et leur regroupement, dont le produit serait plafonné et l’excédent reversé au budget général de l’État. –
Adopté.

Nous allons procéder au vote des crédits du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », figurant à l’état C.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens
Soutien aux prestations de l’aviation civile
Dont charges de personnel
1 142 277 693
1 142 277 693
Navigation aérienne
Transports aériens, surveillance et certification

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits.
Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres », figurant à l’état D.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Aides à l’acquisition de véhicules propres
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits.
Ces crédits sont adoptés.

Nous allons procéder au vote des crédits du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », figurant à l’état D.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits.
Ces crédits sont adoptés.

Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », ainsi que du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et des comptes d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Par lettre en date du 30 novembre 2015, M. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, a informé M. le président du Sénat que son groupe demandait, en application de l’article 6 bis du règlement, la création d’une mission d’information sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte.

La conférence des présidents sera saisie de cette demande lors de sa prochaine réunion.

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2016.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Nous poursuivons l’examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Santé » (et article 62 quinquies).
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Alain Gournac applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2016 ouvre 1, 257 milliard d’euros de crédits pour la mission « Santé », soit un budget en hausse de 4, 7 % par rapport à 2015.
Cette dotation, qui a été réduite de 8, 5 millions d’euros par l’Assemblée nationale, représente une enveloppe relativement modeste par rapport aux 200 milliards d’euros de dépenses annuelles prises en charge par l’assurance maladie, et plus encore par rapport aux 493 milliards d’euros de dépenses supportées chaque année par l’ensemble des administrations sociales.
Les crédits de cette mission n’en financent pas moins deux aspects importants de la politique sanitaire de notre pays : les agences sanitaires et la politique de prévention des agences régionales de santé, les ARS, à travers le programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », et l’aide médicale d’État, l’AME, ainsi que l’indemnisation des victimes de l’amiante, au titre du programme 183, « Protection maladie ».
En ce qui concerne le programme 204, un nouvel effort est demandé aux opérateurs sanitaires, dont les subventions pour charge de service public baisseront l’an prochain de 3, 1 %, et les effectifs d’une cinquantaine d’équivalents temps plein travaillé.
Trois agences, amenées à fusionner en 2017, sont cependant épargnées : l’Institut national de veille sanitaire, l’INVS, l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé, l’INPES, et l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS, trois organismes dont le regroupement, souhaitable compte tenu du caractère complémentaire de leurs missions, n’appelle aucun commentaire particulier, sinon qu’il faudra veiller à conserver l’efficacité et la réactivité de l’EPRUS.
En effet, cette agence, peut-être la plus importante des trois, constitue en effet un outil essentiel en cas d’épidémie ou d’attaque terroriste, puisqu’elle assure sur le plan logistique l’approvisionnement en médicaments. Elle n’emploie que 50 salariés, mais peut compter sur 2 000 réservistes ; elle dispose de sept plateformes de stockage réparties sur le territoire national.
En réalité, la hausse des crédits de la mission « Santé » résulte exclusivement de l’augmentation des fonds alloués à l’AME : la dotation de l’État pour les trois types d’AME, en hausse de 10 % par rapport à la prévision initiale pour 2015, atteindra 744 millions d’euros en 2016.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’il existe trois types d’AME
Tout d’abord, l’AME dite « de droit commun », dotée de 700 millions d’euros de crédits en 2016, est réservée aux étrangers qui se trouvent en situation irrégulière sur notre territoire depuis plus de trois mois.
Ensuite, l’AME pour soins urgents représente une dotation forfaitaire de 40 millions d’euros : ce dispositif correspond à la prise en charge par l’assurance maladie d’un ensemble de dépenses qui sont notamment liées aux soins délivrés à des patients étrangers dont le pronostic vital est engagé.
Enfin, l’AME dite « humanitaire » est réservée à des patients étrangers bénéficiant d’une autorisation ministérielle, pour un montant de 4, 5 millions d’euros en 2016.
Il n’en reste pas moins que le nombre de demandeurs de l’AME tend aujourd’hui à s’accroître. Même si les dépenses sont relativement stabilisées, dans la mesure où elles sont en partie compensées par une baisse du coût moyen de l’aide pour chaque patient, elle-même consécutive à la réforme de la tarification des soins hospitaliers, nous dénombrons aujourd’hui près de 300 000 bénéficiaires d’une carte d’AME, soit environ 5 000 patients supplémentaires en une année.
Par conséquent, un resserrement du dispositif d’accès aux soins gratuits sur les soins urgents, inspiré du système allemand, me paraît pertinent.
Tenant compte d’une proposition de notre collègue Roger Karoutchi, adoptée en octobre dernier dans le cadre du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, la commission des finances vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter un amendement qui vise à réduire les crédits relatifs à l’AME dite « de droit commun » de 200 millions d’euros.
Naturellement, mes chers collègues, nous sommes confrontés à un exercice difficile, car le prochain projet de loi de finances rectificative prévoit que ce poste budgétaire bénéficiera d’une dotation supplémentaire d’environ 85 millions d’euros pour couvrir la fin de l’année 2015.
Néanmoins, nous devons également prendre en compte les remarques répétées de la Cour des comptes, qui nous appelle à élaborer des critères plus pertinents, afin que le dispositif, qui, comme chacun le sait, pose quelques problèmes, atteigne ses véritables objectifs.
Enfin, la commission des finances a examiné l’article 62 quinquies du présent projet de loi de finances, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement : il prévoit une remise de créance au profit des personnes débitrices du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA. Il s’agit de salariés qui, à la suite de revirements jurisprudentiels, bénéficient désormais d’un arrêt définitif de la Cour de cassation, qui semble stabiliser le droit en vigueur.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, d’adopter les crédits de la mission « Santé » sous réserve du vote de l’amendement visant à réduire de 200 millions d’euros l’AME dite « de droit commun », et d’adopter l’article 62 quinquies sans modification.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, mes chers collègues, je résumerai l’avis de la commission des affaires sociales sur la mission « Santé » en trois points.
Tout d’abord, la commission s’alarme de l’érosion significative des crédits de prévention alloués dans le cadre du programme 204. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, je pense notamment aux dépenses d’accompagnement dans le domaine de la lutte contre le sida et les hépatites, qui diminuent de plus de 18 %, ainsi qu’aux crédits dédiés à la lutte contre les maladies neurodégénératives, qui sont divisés par deux. À l’heure où chacun s’entend sur la nécessité de faire de la prévention un véritable pilier de notre politique de santé, cette restriction nous semble être un choix particulièrement inconséquent !
En ce qui concerne la poursuite de la diminution des subventions pour charges de service public qui sont versées aux agences sanitaires, la situation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, semble nous appeler à la plus grande vigilance. Cette jeune agence, mise en place à la suite de la crise du Mediator, doit tout à la fois assumer de nouvelles missions, se moderniser et réaliser des efforts de productivité, ce qui en fait un opérateur sous forte tension.
Les difficultés d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont connues : je ne citerai pour exemple que les retards significatifs pris dans le traitement des signalements et des demandes d’autorisations de mise sur le marché, les AMM, ou encore la perte d’influence considérable dont souffre l’agence à l’échelle européenne.
Depuis 2012, l’ANSM a pris sa part dans les efforts d’économies légitimes demandés aux opérateurs sanitaires de l’État. Il convient désormais de veiller à ce que l’évolution de ses moyens ne soit pas plus rapide que sa capacité d’adaptation. De ce point de vue, il nous paraît indispensable que les moyens de l’agence puissent être stabilisés à compter de 2017.
Enfin, s’agissant des dépenses de l’AME, outre une nouvelle sous-budgétisation des crédits, la commission des affaires sociales regrette le désengagement de l’État à l’égard de l’assurance maladie. En effet, malgré les apurements de dette intervenus par le passé, l’assurance maladie assume à nouveau un reste à charge croissant.
Au-delà de la nécessité de parvenir à une présentation des crédits conforme au principe de sincérité budgétaire, il importe d’approfondir les efforts entrepris en vue d’une meilleure maîtrise du dispositif de l’AME, dans le respect, bien sûr, de son objectif sanitaire.
En conclusion, et compte tenu de ces considérations, la commission des affaires sociales a jugé que, en l’état, les crédits de la mission « Santé » ne pouvaient recueillir un avis favorable de sa part.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Élisabeth Doineau applaudit également.

Je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.
Dans la suite de la discussion, la parole est à Mme Aline Archimbaud.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial, madame la rapporteur pour avis, mes chers collègues, la mission « Santé » de la loi de finances est l’un des leviers d’action en faveur de notre politique de santé publique.
Les chiffres indiquent que le budget général de cette mission est en hausse de 4, 7 % en 2016. Compte tenu de l’importance des programmes qu’il finance, nous aurions donc pu pleinement nous en réjouir.
Pourtant, en y regardant de plus près, on s’aperçoit rapidement que cette hausse globale masque des disparités entre les programmes. En effet, d’un côté, le budget du programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », est en baisse de 2, 6 % – cette année encore –, quand, de l’autre, les crédits du budget du programme 183, « Protection maladie », augmentent.
Je regrette que la prévention soit négligée au sein des diverses actions, alors que l’on sait qu’elle procure des économies substantielles à moyen et long terme. Je pense plus particulièrement à l’action n° 12, Accès à la santé et éducation à la santé, dont le budget baisse de presque 5 % cette année, et à l’action n° 14, Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades, dont les crédits sont, eux, amputés de plus de 13 % par rapport à l’année dernière !
Les maladies chroniques constituent pourtant l’une des principales sources de dépenses pour l’assurance maladie, car elles touchent de plus en plus de personnes dans notre pays.
Ces maladies sont liées à des facteurs environnementaux, à la dégradation de notre qualité de vie et au vieillissement, et doivent faire l’objet non seulement d’un traitement le plus précoce possible, mais aussi de mesures de prévention renforcées, si l’on veut éviter de devoir traiter des pathologies devenues, faute de soins, très lourdes et très coûteuses. Il ne nous semble donc pas du tout opportun de soumettre l’action n° 14 à un tel effort budgétaire.
L’aide médicale d’État a également pour objectif d’anticiper le développement de pathologies plus graves. Si ce dispositif voit son budget augmenter cette année, la majorité sénatoriale compte toutefois, si l’on en juge par les amendements qui seront examinés dans quelques instants, en réduire les crédits de manière drastique.
Certes, l’AME est un dispositif de solidarité, mais il s’agit aussi d’un dispositif fondamental en matière de santé publique, puisqu’il permet d’éviter le développement de maladies qui ne font pas de différence entre les patients bénéficiant d’une protection sociale et les autres, et qui se développent sur le terreau de la misère !
Ensuite, outre que l’AME correspond à une vision humaniste de la société, que nous sommes nombreux à partager, elle empêche les personnes malades d’être prises en charge tardivement, alors que leur situation est devenue urgente.
L’amendement qui a pour objet de restreindre le bénéfice de l’AME aux patients dont les pathologies sont les plus urgentes nous paraît donc contre-productif. S’il était adopté, mes chers collègues, des pathologies simples qui auraient pu être soignées rapidement et avec un coût modeste ne seraient pas traitées et pourraient dégénérer en maladies graves.
Plusieurs rapports de l’IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et de l’IGF, l’Inspection générale des finances, qui portent sur l’évolution des dépenses de l’AME et qui datent respectivement de 2007 et de 2010, ainsi que de nombreuses études d’associations comme Médecins du Monde, montrent clairement les effets négatifs du report de soins sur les dépenses. Par ailleurs, à qui reviendrait la décision de déterminer ce qui est urgent ou non, ce qui est grave ou ne l’est pas ? Le choix pourrait paraître totalement arbitraire !
L’amendement qui tend à mettre en place le paiement d’un droit annuel pour bénéficier de l’AME s’inscrit dans la même logique que les franchises qui ont déjà été mises en œuvre en 2011, avant d’être supprimées en 2012. Il s’agit d’une mesure fortement dissuasive pour les populations précaires et très démunies qui, devant un tel obstacle, renonceraient tout simplement à se soigner. L’expérience a bien montré par le passé que ce type de mesures n’a aucun effet positif sur le niveau des dépenses de l’AME, dans la mesure où elles conduisent notamment à un report des soins de la part des patients.
Je souhaiterais également évoquer en quelques mots les dispositions relatives à l’accompagnement et l’indemnisation des victimes de l’amiante, qui figurent dans le présent projet de loi de finances.
Tout d’abord, la contribution de l’État au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est reconduite pour l’année 2016, l’Assemblée nationale ayant même augmenté son montant en première lecture. Nous nous en réjouissons, même si nous estimons que, compte tenu de l’ampleur de l’épidémie des maladies liées à l’amiante et de la responsabilité de l’État, qui a trop tardivement interdit ce matériau cancérogène, elle pourrait être bien plus élevée !
Ensuite, nous soutenons fortement la mesure qui figure à l’article 62 quinquies : elle prévoit une remise de créance en faveur des victimes ou ayants droit débiteurs du FIVA. Après plusieurs années de combat, que cela soit enfin acté est une excellente chose !
Enfin, même si le dispositif ne concerne pas encore tout le monde, nous saluons la mesure inscrite à l’article 57 du présent projet de loi de finances. Cette mesure donne le droit aux fonctionnaires qui ont contracté une maladie liée à l’amiante d’avoir accès à une indemnisation. C’est un pas supplémentaire vers l’objectif d’une indemnisation de tous les malades de l’amiante.
À ce sujet, madame la secrétaire d’État, nous attendons avec impatience la création, espérée par beaucoup, d’une voie d’accès individuelle à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante, afin qu’il n’y ait plus aucun malade laissé de côté.
Mes chers collègues, si nous trouvions le texte adopté par l’Assemblée nationale plutôt équilibré, malgré les regrets que je viens d’exprimer, nous réservons notre vote et prendrons notre décision en fonction des débats qui se dérouleront tout à l’heure et des amendements qui seront votés sur cette mission.
M. Bernard Lalande applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, madame la rapporteur pour avis, mes chers collègues, alors que nous nous sommes penchés tour à tour sur la loi de santé, puis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, nous nous retrouvons aujourd’hui dans cet hémicycle pour voter les crédits de la mission « Santé » du présent projet de loi de finances.
En 2016, ces crédits s’élèveront à 1, 26 milliard d’euros pour les deux programmes de cette mission : le programme 204, « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », et le programme 183, « Protection maladie ».
Cependant, la hausse d’un peu plus de 4 % des crédits de la mission « Santé » laisse entrevoir de nombreuses disparités et les arbitrages rendus entre les différents programmes de la mission : le programme 204 voit ainsi ses crédits diminuer de presque 2, 5 %, alors que le programme 183 bénéficie, lui, d’une hausse de près de 10 %.
En ce qui concerne le programme 204, je regrette que les crédits liés à l’éducation à la santé, la prévention des risques infectieux et la prévention des maladies chroniques soient en baisse.
L’éducation à la santé, prévue à l’action n° 12, est primordiale. En effet, la santé des jeunes passe par la prévention du tabagisme, de l’alcoolisation – en particulier de l’alcoolisation aiguë – et par une meilleure alimentation, comme le décrit le programme 204. L’éducation à la santé contribue non seulement à combattre les inégalités sociales, mais aussi, en insistant sur la prévention des maladies, à réduire les dépenses de santé : il n’y a pas de maladie plus facile à traiter que celle qui ne se développe pas !
Que dire par ailleurs des crédits relatifs aux risques infectieux ? Alors que notre société est bousculée par des débats souvent ubuesques sur les vaccins, la diminution – même faible – de ces crédits est un mauvais signal. De plus, les maladies infectieuses restent un enjeu de santé publique, même au XXIe siècle.
Que dire aussi des crédits portant sur les maladies chroniques, qui incluent la santé mentale et la lutte contre les addictions ? Ils sont également en baisse, alors que, malheureusement, de plus en plus de Français sont concernés.
Il est vrai que l’espérance de vie a considérablement augmenté, mais, de toute évidence, c’est l’espérance de vie en bonne santé qui compte, et non l’espérance de vie tout court. De plus, en matière de santé mentale, la précarité sociale fait bien souvent le lit des troubles psychiatriques. Or la psychiatrie, hélas, reste le parent pauvre de la médecine en France.
Toutefois, la participation de l’État au financement des actions de prévention du Fonds d’intervention régional, le fameux FIR, demeure stable, à hauteur de 124, 5 millions d’euros. Cela permet une meilleure appréhension des besoins locaux et de la mise en œuvre de politiques de santé publique, notamment au titre de la prévention, en intégrant le financement avec les agences régionales de santé de centres de dépistage du cancer du sein, d’actions d’éducation et d’accès à la santé, etc.
Toujours en ce qui concerne ce programme, je ne puis que me réjouir de la création, prévue d'ailleurs par le projet de loi santé, d’une grande agence de santé publique. Cette agence regroupera des compétences importantes, permettant un travail plus coordonné sur les politiques, des dispositifs de prévention aux interventions « urgences », de la production de connaissances à la mise en place et au suivi d’actions. Cela s’inscrit dans la lignée des efforts de rationalisation que toutes les agences sanitaires doivent continuer à mettre en place.
Le programme financera huit opérateurs sanitaires de l’État, dont l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette institution reste relativement jeune, sa création faisant suite à une refonte de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS, après, disons-le, le scandale du Mediator.
Si elle est centrale de par ses responsabilités en matière de qualité des produits de santé, son fonctionnement reste à parfaire. Son activité, en particulier au travers des délais de traitement des autorisations de mise sur le marché, restera l’un des indicateurs de performance de notre politique de santé et du médicament, car il faut bien parler d’une politique du médicament !
Dans le même esprit, c’est-à-dire s’agissant des indicateurs choisis, le Gouvernement met en perspective ses objectifs de développement de la prévention avec une analyse de sa politique de santé au moyen d’outils appropriés.
Reste un sujet qui m’est cher : si le plan cancer III apparaît comme un élément positif, il n’y a, hélas, toujours aucune avancée sur le plan annoncé en matière de soins palliatifs. Notre retard dans le domaine est important et l’attente, des professionnels comme des patients, grande.
J’en viens au programme 183, « Protection maladie », qui, comme vous le savez, mes chers collègues, comprend le financement de l’Aide médicale de l’État et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
L’augmentation d’environ 10 % de la prévision de dépenses pour l’AME répond au problème récurrent de sous-budgétisation de ces dépenses, qui crée une tension financière sur le budget de la sécurité sociale. Il est à observer que la dépense annuelle par bénéficiaire est relativement stable, aux alentours de 2 830 euros, depuis 2007.
Le principe même de l’AME est essentiel. Le dispositif a d’abord une visée humanitaire : soigner les personnes en situation de première nécessité. La question est bien de savoir, non pas si ces personnes doivent être là – elles le sont –, mais si elles ont besoin de soins, étant rappelé que le devoir d’un médecin est et sera toujours de soigner.
Néanmoins, l’AME répond aussi à une préoccupation de santé publique, en particulier en contribuant à la lutte contre les maladies infectieuses et les maladies de la précarité, comme la tuberculose, qui concernent non seulement l’individu, mais aussi l’entourage et la population générale.
Pour autant, s’il me paraît nécessaire de conserver un budget alloué à I’AME, il ne faudrait pas que celui-ci dérive vers une prise en charge de pathologies qui, selon moi, ne sont pas incluses dans le périmètre du dispositif ? Je pense notamment à certaines maladies chroniques.
Quant à l’opportunité de transformer l’AME en aide médicale d’urgence, cette option peut paraître recevable, mais il conviendrait de ne pas bruler les étapes et d’évaluer d’abord les coûts de toutes modifications et transferts en ce sens.
Par ailleurs, la dotation de l’État au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante reste faible par rapport à celle qui est consentie par la branche « accidents du travail-maladies professionnelles » – la branche AT-MP – du régime général. Si le scandale de l’amiante est encore dans tous les esprits, la gestion de ce scandale et des indemnités correspondantes est tout aussi problématique, notamment s’agissant de certains trop-perçus.
Pour toutes ces raisons, et malgré quelques réserves, le groupe RDSE, dans sa grande majorité, votera les crédits de la mission « Santé », si toutefois ils ne viennent pas à être modifiés.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial, madame la rapporteur pour avis, mes chers collègues, le budget de la mission « Santé » de l’État, qui atteint 1, 257 milliard d’euros, est sans commune mesure avec le montant des prestations de protection sociale, évaluées, pour 2014, en France, à près de 689 milliards d’euros, dont 244 milliards d’euros pour la santé.
Reconnaissons toutefois que les objectifs ne sont pas les mêmes. La mission « Santé » a un périmètre bien plus limité, l’essentiel des actions sanitaires relevant des lois de financement de la sécurité sociale.
Le projet de loi de finances pour 2016 tend à prévoir une augmentation de 4, 7 % des crédits de la mission « Santé » par rapport à 2015. Le déséquilibre dans l’affectation des budgets entre les deux programmes de la mission est de plus en plus criant. Les crédits du programme 204 diminuent de 2, 4 %, tandis que ceux du programme 183 augmentent de 10 %. Ces évolutions s’expliquent principalement par l’accroissement des dépenses d’AME. J’y reviendrai.
Tout d’abord, le programme 204 se caractérise par un maître mot : la rationalisation. Ce programme devra faire face à une baisse de crédits de 9 millions d’euros par rapport à 2015 pour financer, à titre principal ou complémentaire, huit opérateurs sanitaires de l’État. Il s’agit d’un effort important, car il fait suite à une diminution de 4, 4 % des crédits en 2015. Plus de 100 équivalents temps plein seront supprimés sur la période couvant les années 2015 et 2016.
Dans une période de redressement des comptes publics, chacun doit faire sa part. Toutefois, si les efforts demandés aux agences sanitaires devaient s’ancrer à un tel niveau dans la durée, il serait à craindre que celles-ci ne soient plus à même d’assurer leurs missions.
J’en veux pour preuve le cas de l’ANSM, qui représente 40 % du budget du programme et se trouve dans une situation précaire. Créée en 2012, l’agence a vu le nombre de ses missions substantiellement augmenter. Elle doit être plus productive, mais les moyens pour répondre à un tel objectif n’ont pas suivi. Pis, depuis 2012, l’État n’a cessé d’amputer son fonds de roulement, preuve que le Gouvernement ne sait plus où chercher les économies, sans se risquer à des réformes courageuses, et pénalise les bons gestionnaires !
Les professionnels du médicament se plaignent des délais de l’ANSM, notamment s’agissant du traitement des demandes d’autorisation de mise sur le marché. Notre industrie pharmaceutique, l’un des fleurons de notre pays, doit pouvoir compter sur une agence nationale solide, réactive et modernisée pour perdurer et, surtout, maintenir sa place sur le marché national et au niveau européen.
La rationalisation demandée par le Gouvernement aux agences sanitaires passe aussi par des fusions. Il est vrai que le nombre d’agences publiques n’a cessé de se multiplier au cours des dernières décennies, ce que nous avons été plusieurs à critiquer.
Le projet de loi santé tend à prévoir, dans son article 42, la fusion de trois agences sanitaires centrées sur la prévention. L’INPES, l’INVS et l’EPRUS vont donner naissance à l’Agence nationale de santé publique. Espérons que, à terme, les synergies s’opèrent pour gagner en efficacité, car je regrette l’érosion des crédits de prévention alloués au niveau national, notamment concernant les maladies chroniques et la qualité de vie des malades. Cette mesure entre en contradiction avec les annonces gouvernementales inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou dans le projet de loi santé. Or chacun sait que la prévention réduit les dépenses de soins à long terme. Aujourd’hui, le nombre de patients en affection de longue durée se multiplie.
Par ailleurs, le budget du programme 183 semble devenu incontrôlable. Les crédits consacrés à l’AME progresseront de 10 % en 2016. Nous pourrions nous dire que cette forte hausse permettra de partir sur un budget sincère, n’appelant pas de rectificatif… Rien n’est moins vrai !
Comme l’indique notre rapporteur spécial, Francis Delattre – que je félicite, ainsi que ma collègue de la commission des affaires sociales, Corinne Imbert, de leur travail et de la clarté de leur exposé –, la prévision actualisée de dépenses d’AME pour 2015 est d’ores et déjà supérieure de près de 20 millions d’euros aux 744 millions d’euros de crédits inscrits pour ce dispositif en 2016. Dès lors, comment imaginer que le programme 183 ne sera pas sous-budgétisé ?
Depuis l’entrée en vigueur du dispositif, en 2001, les dépenses d’AME ont crû chaque année à un rythme soutenu. Ainsi, entre 2002 et 2015, les dépenses d’AME de droit commun sont passées de 377 millions d’euros à plus de 750 millions d’euros, soit une progression de près de 100 %.
Derrière le problème financier de la sous-budgétisation de l’AME, se cache en réalité la question du fonctionnement même de ce dispositif. Le droit de timbre de 30 euros a été supprimé en 2012. Je ne discuterai pas de l’opportunité de le rétablir, d’autant plus que faire payer une fois 30 euros ne permettra pas de financer le dispositif et ne dissuadera pas spécialement d’y avoir recours.
Dans la continuité des propos tenus par mon collègue Vincent Delahaye à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, l’instauration d’un ticket modérateur pour chaque prestation, permettant d’accéder à un panier de soins défini limitativement, serait une voie à approfondir.
Nous sommes en revanche réservés sur la proposition du rapporteur spécial Francis Delattre. Ce dernier suggère de diminuer de 200 millions d’euros les crédits de l’AME pour tirer les conséquences d’un article du projet de loi sur le droit des étrangers, tendant à remplacer l’AME par une aide médicale d’urgence. Nous aurons l’occasion d’expliquer plus en détail notre position lors de l’examen de cette proposition.
Nous sommes aujourd’hui dans une impasse avec un budget de l’AME en constante augmentation et en constante sous-évaluation. Le Gouvernement doit agir et clarifier ses positions, notamment en présentant un budget sincère, mais il doit avant tout mettre en place un système de contrôle et d’évaluation. Par exemple – ma collègue Corinne Imbert y a fait référence –, il serait souhaitable d’obtenir un accès aux informations contenues dans la base Réseau mondial visas 2 du ministère des affaires étrangères.
Enfin, il est regrettable de constater, une fois de plus, à l’instar de la Cour des comptes, que « pour faire face à l’insuffisance récurrente des crédits AME, toutes les autres lignes budgétaires du programme sont progressivement réduites, voire annulées ». Je veux citer en exemple l’annulation de la dotation de l’État au FIVA en 2014 et sa sous-budgétisation en 2015. Il est nécessaire que l’État s’engage plus fortement, en 2016, en faveur des victimes de l’amiante. Il ne doit pas laisser la seule branche AT-MP assumer cette charge.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas, en l’état, les crédits de la mission « Santé ».
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains.
Mme Jacqueline Gourault remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la discussion du budget de la mission « Santé » de ce projet de loi de finances doit être menée, à notre avis, en parallèle avec l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé.
Alors que le Gouvernement a fortement communiqué sur les objectifs ambitieux contenus dans ce projet de loi en matière de prévention, l’augmentation du budget de la mission « Santé » est limitée à 4, 7 %. Certes, ce taux dépasse le curseur des 3 % imposé par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, mais nous ne pouvons que regretter vivement les réductions de budget induites sur certaines actions.
Le Gouvernement a mis en avant les mesures de prévention destinées à lutter contre l’obésité et le cancer. En réalité, ces moyens supplémentaires ont été retirés à d’autres dispositifs. Ainsi, les crédits de l’action n° 12, Accès à la santé et éducation à la santé, ont diminué de 5 %, ceux de l’action n° 13, Prévention des risques infectieux et des risques liés aux soins, de 13, 6 %, ceux de l’action n° 14, Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades, de 13, 3 % par rapport à 2015.
En définitive, il s’agit d’un transfert de crédits, qui ne répond pas aux besoins de prévention, car, malheureusement, les enveloppes restent contraintes.
Dans le champ de l’accès à la santé et de l’éducation à la santé, par exemple, comment voulez-vous agir concrètement en amont des maladies si vous réduisez les moyens consacrés à l’éducation à la santé, premier pas vers une action globale en faveur de la prévention ?
L’accès et l’éducation à la santé permettent de prévenir les comportements à risque et de réduire leurs conséquences. Ces dispositifs s’adressent à tous les publics, y compris, et de manière prioritaire, aux populations les plus précaires. Pour notre groupe, une politique ambitieuse en matière de prévention ne peut reposer que sur une augmentation des moyens.
De même, comment voulez-vous lutter pour la « prévention des risques infectieux et des risques liés aux soins » en réduisant les moyens qui y sont consacrés de 8, 3 millions d’euros ? D’autant que l’on constate une baisse de la vigilance dans les pratiques liées aux transmissions du VIH, des infections sexuellement transmissibles et des hépatites.
Madame la secrétaire d'État, je veux ici attirer votre attention sur la mise en œuvre d’un plan d’échange des seringues à l’intérieur des prisons, dont il n’est pas question dans cette mission, alors qu’il s’agit bien de santé publique !
Enfin, comment pouvez-vous réduire de 13 % les crédits de l’action Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades, alors même que vous indiquez que, « touchant près de 15 millions de personnes, ces maladies chroniques sont à l’origine de 60 % des décès, dont la moitié avant l’âge de 70 ans » et que, « à ce titre, elles constituent un défi pour le système de santé tant sur le plan financier que dans l’organisation des soins » ?
Le choix du Gouvernement consiste à opérer un recentrage des moyens destinés aux actions de prévention autour de la gratuité des examens de dépistage des femmes, la prévention de l’obésité chez les enfants à risque, la prise en charge intégrale du parcours de contraception des mineures.
Nous soutenons les choix que vous faites et les publics qui sont ciblés, mais nous déplorons que ces choix se fassent au détriment d’autres secteurs, alors que la prévention a toujours été le parent pauvre de la politique de santé publique. En outre, dans le projet de loi relatif à la santé, vous avez mis les centres de santé au cœur des politiques de santé publique, mais il s’agit maintenant de leur accorder les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Plus généralement, il faut agir sur les conditions de vie, de travail, l’information au système de santé, réduire les barrières financières, agir sur les déterminants de santé pour mener une politique de prévention à la hauteur des besoins. Nous en sommes malheureusement encore très loin.
S’agissant du programme « Protection maladie », dont 60 % des crédits sont destinés à l’aide médicale de l’État, nous devons augmenter les moyens pour les populations réfugiées. Vous l’aurez deviné, mes chers collègues, nous sommes en total désaccord avec l’amendement de la commission des finances : ce n’est pas un scoop !
L’État doit intervenir pour prendre en charge les soins sans distinction d’origine et de nationalité des malades, car il est de notre devoir de les soigner et d’éviter les risques d’épidémie. Nous refusons toute politique qui discrimine, exclut, oppose les populations entre elles, notamment parmi les plus pauvres et les plus fragiles.
Enfin, le projet de loi relatif à la santé, qui est actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, prévoit la réorganisation des établissements publics et entraîne une diminution de 3, 1 % des subventions pour charge de service public allouées aux opérateurs sanitaires.
Cette diminution des crédits prévue en 2016 s’ajoute à la réduction de 4, 4 % des dotations allouées en 2015. C’est d’autant plus paradoxal qu’il est dans les intentions du projet de loi d’améliorer le contrôle, notamment à la suite du scandale du Mediator.
En clair, vous demandez aux agences de faire plus avec moins de moyens ! Vous ne pouvez indéfiniment prétendre améliorer la transparence et la démocratie sanitaire si, dans le même temps, vous réduisez les effectifs et les subventions pour effectuer les contrôles. Membre du conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, je sais les difficultés rencontrées.
Vous faites de la prévention du cancer du sein chez les femmes une priorité, mais, en parallèle, vous réduisez la subvention annuelle de l’Institut national du cancer de 6, 5 millions d’euros. Comment voulez-vous améliorer la recherche dans ces conditions ? Je crois que le Gouvernement a une vision budgétaire à court terme qui, au fond, remet en cause la santé publique pour l’avenir.
Naturellement, il est difficile de dresser en si peu de temps le bilan d’une mission qui touche à de nombreux secteurs. Toutefois, avant de conclure, je veux souligner que notre groupe, malgré les critiques que j’ai formulées par ailleurs, est favorable à l’article 62 quinquies qui est rattaché aux crédits de cette mission : les associations représentant les victimes de l’amiante demandaient depuis de nombreuses années que celles-ci ne soient pas obligées de rembourser les sommes perçues indûment en raison de l’instabilité des règles d’indemnisation.
Mes chers collègues, nous jugeons les moyens de la mission « Santé » largement insuffisants et nous sommes choqués qu’en cette période de crise, d’afflux de populations chassées par les guerres ou le réchauffement climatique, le Sénat puisse proposer une diminution des crédits destinés à l’aide médicale de l’État.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre les crédits de la mission « Santé ».
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial, madame la rapporteur pour avis, mes chers collègues, en préambule de mon intervention sur la mission « Santé » du projet de loi de finances pour 2016, je veux remercier avec respect toute la communauté soignante, qui, lors des odieux attentats du 13 novembre dernier, a accompli ses missions avec un investissement exemplaire.
Nous sommes fiers de la médecine en France, de celles et de ceux qui la servent, quels que soient leurs fonctions, leur mode d’exercice et leur lieu d’exercice. Rien ne sera plus comme avant ; il y a désormais un avant et un après-13 novembre. En tant qu’élus de la nation, nous nous devons de mesurer notre responsabilité. Le débat politique doit évidemment reprendre ses droits, car il est le fondement de la démocratie.
Lors de la réunion de la commission, notre rapporteur n’a pas souhaité donner un avis positif sur la mission « Santé » du budget 2016, en raison, en particulier, du programme 183 sur les crédits de financement de l’aide médicale de l’État. De ce fait, les sénateurs socialistes de la commission ont émis un avis négatif sur son rapport. Selon la règle mathématique « moins par moins égale plus », je ne perds pas espoir que notre débat devienne positif…
En tout état de cause, le groupe socialiste du Sénat accompagne le Gouvernement et émet un avis positif sur les crédits de la mission « Santé ». En effet, avec 1, 26 milliard d’euros, ces crédits sont en hausse de 4, 7 % par rapport à 2015. Si certains peuvent considérer cela comme insuffisant, l’augmentation est substantielle dans un contexte d’encadrement budgétaire.
Deux programmes placés sous l’autorité de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé se répartissent ces crédits : 44 % sont consacrés aux politiques de prévention, de sécurité sanitaire et à l’offre de soins – le programme 204 –, et 56 % à l’aide médicale de l’État – le programme 183.
La mission « Santé », dans le cadre de sa programmation pluriannuelle, s’inscrit dans une politique globale de santé et vise trois grands objectifs : développer la politique de prévention, assurer la sécurité sanitaire et organiser une offre de soins de qualité de façon égale et adaptée entre nos concitoyens et entre les territoires.
L’année 2016 sera marquée par une réorganisation des agences sanitaires, avec la création de l’Agence nationale de santé publique. Cette nouvelle agence, en regroupant l’ensemble des missions jusqu’alors dévolues à trois opérateurs – l’Institut national de veille sanitaire, l’InVS, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES, et l’Établissement de préparation et de réponses aux urgences sanitaires, l’EPRUS –, doit permettre de développer une action plus efficace en matière de santé publique et d’améliorer la réponse aux risques sanitaires. Le groupe socialiste du Sénat approuve cette création et sera attentif à sa bonne mise en œuvre.
Mme la rapporteur pour avis, même si nous ne partageons pas sa vision globale sur la mission « Santé », fait des analyses intéressantes sur les difficultés rencontrées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la subvention à cette agence représentant à elle seule 40 % du montant total du programme 204.
Nous serons attentifs aux évolutions touchant cette jeune agence, tant il semble qu’elle rencontre des difficultés d’organisation et de fonctionnement, comme l’ont mis en évidence la Cour des comptes en 2014 et l’Inspection générale des affaires sociales en 2015.
Après avoir souligné la qualité et l’intérêt du rapport de Mme Imbert sur certains aspects, j’en viens à ce qui nous oppose principalement sur cette mission, à savoir l’aide médicale de l’État, puisque c’est sur ce point précis que notre rapporteur justifie le vote négatif de la majorité sénatoriale.
Il me paraît important de faire un rapide rappel historique au sujet de l’AME, tant celle-ci alimente nombre de fantasmes et de contrevérités.
L’aide médicale de l’État, telle qu’on la connaît aujourd’hui, est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et est octroyée sous de strictes conditions que je ne rappellerai pas, M. le rapporteur spécial les ayant déclinées. Toutefois, il faut savoir que l’aide médicale de l’État n’est pas née avec la réforme créant la couverture maladie universelle, en 1999 : les étrangers ont toujours été couverts par l’aide médicale depuis sa création au XIXe siècle, en 1893. Ce qui a changé en 1999, c’est que l’aide médicale est passée d’un système de couverture santé des démunis à un système de couverture santé des seuls étrangers démunis sans titre de séjour.
Les étrangers en situation irrégulière ont bénéficié de la couverture santé de droit commun dans des conditions identiques aux Français, soit en tant que personnes démunies, et ce depuis 1893, soit en tant que travailleurs, aucun titre de séjour n’étant demandé pour être affilié à la sécurité sociale de sa création en 1945 à 1993. C’est la réforme dite « Pasqua » de 1993 sur l’immigration qui a exclu les « sans-papiers » de toute prestation sociale, à l’exception de l’aide médicale.
Le dispositif de l’aide médicale de l’État a connu de nombreux aménagements. Ainsi, en 2007, ont été mises en œuvre des mesures destinées à en améliorer la gestion : création expérimentale d’un titre sécurisé, extension du dispositif du tiers payant contre génériques, contrôle médical étendu aux bénéficiaires de l’AME.
Malgré l’opposition de la gauche, plusieurs mesures remettant dangereusement en cause ce dispositif ont été votées en 2011 : restriction du panier de soins aux seuls actes dont le service médical est important ou modéré, ce qui est bien difficile à déterminer, création d’un ticket d’entrée annuel par adulte bénéficiaire de l’AME.
Conformément à l’engagement du Président de la République François Hollande, la gauche a supprimé, en 2012, le droit de timbre et l’obligation d’obtenir un agrément préalable pour la délivrance de soins hospitaliers programmés coûteux, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les associations agréées pouvant de nouveau constituer les dossiers.
Parallèlement, la modification du mode de tarification à l’hôpital public des bénéficiaires de l’aide a permis, en 2012, de réaliser une économie de 25 % par rapport à ce qu’auraient coûté les séjours selon l’ancienne tarification. L’instauration du droit de timbre n’avait en réalité permis qu’une dégradation de l’état de santé des personnes concernées du fait du report des soins.
J’ai souhaité faire ce rapide rappel historique pour la sérénité de nos débats. Je veux, mes chers collègues, insister sur le fait que, pendant longtemps, l’hôpital a associé une fonction d’hospitalité à une fonction soins pour les plus démunis. D’ailleurs – Alain Milon ne me démentira pas –, le centre hospitalier universitaire de Lille s’appelait la Cité hospitalière.
Je veux également rappeler l’action entreprise par Xavier Emmanuelli avec le SAMU social, sous la présidence de Jacques Chirac, assurant l’hospitalité pour les plus démunis en lien avec les actions des collectivités locales, essentiellement les municipalités et les départements, l’hôpital se recentrant plus spécifiquement sur sa fonction soins.
L’aide médicale de l’État a un coût budgétaire important, je n’en disconviens pas : 744 millions d’euros, en progression de 9, 9 % par rapport aux crédits initialement alloués. Toutefois, c’est une dépense totalement légitime, au titre de l’humanisme, de la solidarité, mais aussi en termes de santé publique.
Je suis très concernée par ce sujet, étant élue d’un département, le Pas-de-Calais, qui connaît une crise très importante dans l’accueil des migrants. Je puis vous garantir que ceux d’entre eux qui souhaitent bénéficier de l’aide médicale de l’État ne sont pas des fraudeurs.
S’il faut être attentif à la fraude – le Gouvernement l’est, comme nous le sommes tous collectivement –, je veux insister sur ce constat : dans les cas de détournement, il y a deux protagonistes, à savoir ceux qui le sollicitent et ceux qui en permettent la réalisation.
En conclusion, je veux dire une nouvelle fois que le groupe socialiste du Sénat votera les crédits de la mission « Santé » du budget 2016. Dans le contexte très particulier que nous vivons, il me paraît important de nous retrouver sur l’essentiel, à savoir nos valeurs humanistes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur spécial, madame la rapporteur pour avis, au moment où l’Assemblée nationale vote le projet de loi relatif à la santé, je tenais à exprimer, au nom de mon groupe, notre étonnement face à l’entêtement du Gouvernement, qui s’obstine à faire voter un texte qui fait toujours l’unanimité des professionnels de santé contre lui.
De notre point de vue, ce texte aurait mérité de faire l’objet d’un moratoire, d’autant plus que la mesure la plus emblématique qu’est le tiers payant généralisé et obligatoire ne doit être appliquée qu’en 2017. L’urgence était donc d’entendre les professionnels et non de persister dans une voie qui mettra à mal l’équilibre entre les deux piliers de notre système de santé, à savoir la médecine publique et la médecine libérale.
J’en viens à l’examen des crédits dévolus à la mission « Santé », qui peuvent paraître bien dérisoires comparés à ceux du projet de loi de financement de la sécurité sociale, alors qu’ils n’en sont pas moins importants, puisqu’ils traitent à la fois de la prévention, de la sécurité sanitaire et de l’aide médicale d’État.
Toutefois, force est de constater que, à l’image du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le projet de loi de finances pour 2016 manque de souffle, notamment en matière de prévention.
Certes, le projet de loi relatif à la santé contient des mesures sur le renforcement de la lutte contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les plus jeunes, sur l’information des jeunes adultes en ce qui concerne l’examen de santé gratuit, sur la signalétique nutritionnelle sur les emballages alimentaires, mesures que nous avons d’ailleurs approuvées.
J’appelle néanmoins votre attention, mes chers collègues, sur les crédits de l’action Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades », du programme 204. Cette action baisse de plus de 13 % par rapport à la loi de finances initiale de 2015, pour être dotée de 54, 3 millions d’euros. Elle contribue, en termes de volume, davantage aux efforts d’économies que toutes les autres actions de ce programme réunies. Pourtant, les mesures liées à l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson, devraient être à mon sens l’une des priorités. Là encore, le Gouvernement manque d’ambition.
Cette mission manque également de propositions de réformes, tout particulièrement s’agissant de l’aide médicale d’État. Ce sujet récurrent mérite que nous l’abordions de manière sereine. Nous nous retrouvons tous pour affirmer que ce dispositif est nécessaire en matière de santé publique. Toutefois, il n’est pas raisonnable de se contenter, à chaque projet de loi de finances, d’approuver une augmentation substantielle des crédits dédiés à l’AME.
M. le rapporteur spécial a très bien décrit la situation. Dans le rapport sur le projet de loi de finances pour 2015, le recensement des dispositifs existants dans d’autres pays européens est riche d’enseignements ; je retiendrai les deux suivants.
Tout d'abord, sur une sélection de douze pays, seuls trois – la France, la Belgique et l’Italie – autorisent l’accès à des soins de santé sans frais au-delà des services d’urgence, sous certaines conditions.
Ensuite, l’AME, telle qu’elle existe en France, se distingue par son caractère très large de l’accès aux soins gratuits. L’Espagne, qui disposait jusqu’à une date très récente d’un dispositif proche de celui qui existe en France, a revu drastiquement les conditions d’accès aux soins gratuits pour ces populations en 2012, principalement en réponse à la crise financière affectant le pays.

Cette année, le rapport souligne la sous-budgétisation des crédits alloués à l’AME. En effet, le projet de loi de finances rectificative pour 2015 prévoit l’ouverture de plus de 87 millions d’euros supplémentaires afin de couvrir les besoins.
La proposition d’aide médicale d’urgence adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration constitue une piste intéressante de réforme, sur le modèle du dispositif existant en Allemagne.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera les crédits de la mission « Santé », sous réserve de l’adoption des amendements qui seront présentés par M. le rapporteur spécial, Mme la rapporteur pour avis et M. le président de la commission des affaires sociales, que je tiens à féliciter de la qualité de leurs travaux. Les amendements qui sont à nos yeux les plus importants sont ceux qui visent la diminution des crédits de l’AME et le droit aux informations demandées par les caisses primaires d’assurance maladie.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des finances, mes chers collègues, le projet de budget qui nous est présenté est le premier qui intervient après la loi de santé. L’idée est non pas de revenir sur les débats que nous avons eus ici, mais de juger les actes dans la durée. On le sait, les intentions louables d’un projet de loi de finances en matière de santé, énoncées en autorisations d’engagement, deviennent parfois de beaux souvenirs le temps des crédits de paiement venu.
Les moyens budgétaires de la mission « Santé », d’un montant de 1, 2 milliard d’euros, permettent certes de poursuivre les missions de prévention sanitaire et de modernisation de l’offre de soins. Toutefois, les crédits des deux principaux programmes de cette mission connaissent une évolution contraire.
Le projet de budget traduit l’augmentation attendue des dépenses au titre de l’aide médicale de l’État, tandis que le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » connaît une baisse certaine de ses crédits.
La grande nouveauté de cette mission « Santé » du projet de loi de finances pour 2016, c’est l’intégration, depuis sa réforme, du Fonds d’intervention régional, le FIR, comme outil de financement de projets innovants en matière de prévention et d’offre de soins. Il s’agit de l’action n° 18, Projets régionaux de santé, qui regroupe l’ensemble des crédits de prévention, de promotion de la santé, de veille et de sécurité sanitaires alloués aux agences régionales de santé par l’intermédiaire du Fonds d’intervention régional.
La réforme, décidée en 2015 et effective en 2016, visant à transférer aux ARS l’essentiel de la gestion du FIR, qui fera désormais l’objet d’un budget annexe pour chaque ARS, permettra, espérons-le, de clarifier les actions, de spécifier les modes d’interventions, notamment entre le sanitaire et le médico-social, et de pérenniser les projets. Pourtant, je doute que cela suffise.
Certes, cette réforme du FIR n’est pas une mauvaise chose, mais le processus mérite d’être clarifié, sa gestion et son pilotage précisés et améliorés ; les moyens qui y sont consacrés, soit 124, 54 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement, sont stables par rapport à 2015. Rappelons que les crédits du programme n° 204 sont complétés par un financement spécifique des trois régimes d’assurance maladie abondant le FIR, en provenance notamment de leurs fonds de prévention.
Dès lors, comment ne pas pointer ce qui ressort de la pratique pour les professionnels, à savoir le manque de lisibilité dans l’attribution des fonds ? Ce n’est que par le biais d’une circulaire qu’ont été précisées, en 2015, les missions financées par le FIR, les orientations nationales pour l’année, les ressources du FIR, les règles d’attribution et de gestion des crédits par les ARS, les modalités de suivi des dépenses, les normes d’évaluation des missions financées.
Notons pour la présente discussion que, en 2015, le FIR a fait l’objet de gels au titre des mises en réserves pour la régulation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie d’un montant de 30 millions d’euros, contre 75 millions d’euros l’exercice précédent. La dotation de l’État a par ailleurs fait l’objet d’une réserve prudentielle de 10 millions d’euros appliquée à l’enveloppe votée en loi de finances pour 2015. Qu’en sera-t-il cette année ?
Avec la gestion du FIR, se pose aussi la définition du rôle des ARS. Parle-t-on d’agences techniques chargées de mettre en place une politique sanitaire centralisée dictée par des circulaires ministérielles ou d’outils et d’organismes disposant de marges d’actions pour adapter une politique sanitaire et de santé aux réalités d’un territoire donné ? On ne peut conférer à ces agences une seule dimension technique ; à la lecture des crédits, la dimension se révèle maintenant politique.
Se pose alors la question du contrôle politique de ces agences, dans la mesure où l’autonomie sans contrôle démocratique a pour corollaire le risque d’iniquité entre territoires de santé. Je le répète, nous parlons de plus de 124 millions d’euros d’autorisations d’engagement pour 2016. Peut-on faire l’économie de la clarté ?
Comme j’évoquais au début de mon intervention les intentions louables des autorisations d’engagements, je tiens à la lisibilité à l’heure des crédits de paiements. C’est pourquoi je renouvelle ici le vœu formulé lors de l’examen de la loi de santé, à savoir l’inscription dans le code de la santé publique que, chaque année, les agences régionales de santé présentent un bilan complet devant le Parlement de la répartition financière des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation et des FIR, ainsi que de leur bilan comptable complet.
Par respect du principe de transparence, il doit être demandé aux agences régionales de santé, madame la secrétaire d'État, de justifier l’utilisation des deniers publics devant la représentation nationale.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Élisabeth Doineau applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, dans le cadre de l’examen de la mission « Santé » du projet de loi de finances pour 2016, je m’attacherai plus précisément à l’action relative à l’aide médicale d’État, qui constitue l’essentiel du programme 183. À cet égard, je tiens à rappeler, comme l’a dit Jean-Pierre Godefroy, l’inscription de 10 millions d’euros en faveur du FIVA.
Les crédits consacrés à l’AME sont fixés à 744, 5 millions d’euros pour 2016, soit 700 millions d’euros pour l’aide médicale de droit commun couvrant les dépenses avancées par la Caisse nationale d’assurance maladie, 40 millions d’euros au titre des soins urgents et 4, 5 millions d’euros destinés à des dispositifs particuliers, dont les gardés à vue. La dépense moyenne annuelle pour un bénéficiaire de l’AME reste stable : elle était de 2 846 euros en 2007, de 2 829 euros en 2008 et de 2 823 euros en 2014. Elle représente moins de 0, 2 % des dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base. Je dis cela pour redonner la mesure du débat et rappeler la réalité des chiffres.
La dépense est-elle justifiée ? La réponse de tous les experts et de tous les responsables dans ce domaine est unanime. Oui, la dépense est nécessaire ! Elle l’est d’abord du point de vue de la santé publique ; elle l’est aussi du point de vue économique ; elle l’est, enfin, au titre des valeurs qui fondent notre pays.
La responsabilité de l’État est d’assurer la sécurité sanitaire sur l’ensemble du territoire national : permettre que des personnes éventuellement porteuses de maladies contagieuses, qui plus est en situation précaire, ne se soignent pas ou retardent le moment de consulter un médecin ou un service comporte un risque de propagation qui ne peut être ni pris ni accepté.
En outre, les prises en charge retardées entraînent une dépense beaucoup plus élevée pour la collectivité, particulièrement à l’hôpital, avec la mobilisation de structures lourdes et d’un grand nombre de personnels. Le coût de ce phénomène de report de soins nous est connu, de même que ses conséquences sur les services d’urgence. C’est pourquoi le maintien de l’accès aux soins est aussi un facteur de la maîtrise des coûts.
Deux rapports conjoints de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances soutiennent sans ambigüité cette analyse : en 2007, à l’issue d’une mission d’audit, la mise en œuvre d’un droit d’entrée pour l’AME est déconseillée et la définition d’un panier de soins qualifiée d’« irréaliste » ; en 2010, les conclusions d’un second rapport consacré à l’analyse de l’évolution des dépenses au titre de l’aide médicale d’État, tendent à démontrer que l’instauration d’un droit d’entrée risque de se révéler contre-productive, en incitant à un recours tardif à l’hôpital avec des frais ultérieurs plus élevés, en faisant courir des risques sanitaires aux intéressés, mais aussi à l’ensemble de la population dans le cas de maladies transmissibles.
Ces conclusions contredisent directement et clairement le bien-fondé des mesures de restrictions d’accès à l’AME adoptées en loi de finances pour 2011, au point que la publication du second rapport, achevé en novembre 2010, a été retardée de quelques mois après l’examen du projet de loi de finances, car ses conclusions devaient déranger !
À partir de 2012, ce gouvernement a pris des décisions exactement inverses aux précédentes en abrogeant ces mesures non recommandées et en mettant en œuvre celles qui l’étaient, comme, j’y insiste, la création d’un titre d’admission sécurisé à l’AME, la mise en place d’un processus d’instruction des dossiers modélisée dans le cadre d’un plan de maîtrise harmonisé sur l’ensemble du territoire et permettant un contrôle interne, la reconnaissance au service du contrôle médical d’une compétence générale pour les prescriptions délivrées aux bénéficiaires de l’AME.
A également été mis en œuvre, comme cela était recommandé dans le rapport de 2010, un nouveau mode de tarification des prestations hospitalières pour les bénéficiaires de l’AME en MCO, médecine chirurgie obstétrique, mode qui permettra en 2016 une économie de 60 millions d’euros.
Cette réforme a été poursuivie au travers de la loi de financement de la sécurité sociale de 2015, avec l’extension de ces règles de tarification et de facturation à la délivrance des soins urgents.
S’agissant de la nature des soins délivrés, le décret du 3 février 2015 exclut du panier de soins couverts les médicaments à faible service médical rendu. Je rappelle, pour éviter tout fantasme, que les frais liés à la procréation médicalement assistée ou aux cures thermales sont d’ores et déjà exclus de l’AME.
Les crédits consacrés à l’aide médicale d’état sont donc l’objet d’un encadrement strict rationnel, préservant l’objectif de cette mission, qui est d’assurer une prise en charge la plus précoce possible dans un souci essentiel de santé publique.
Pour mémoire – Catherine Génisson l’a bien souligné tout à l’heure –, mes chers collègues, l’aide médicale date, sous la forme de secours, de 1793, et, sous celle d’une assistance médicale gratuite, de 1893. Par conséquent, pendant deux cents ans, toute personne dépourvue de ressources pouvait être soignée, sans aucune considération d’origine.
Je n’oublie pas non plus de mentionner les conclusions des rapports précités sur la fraude : celle-ci serait marginale et concernerait seulement 54 cas en 2014, pour un préjudice de 130 000 euros. Les propositions de restrictions de droits de nouveau soumises à notre approbation aujourd’hui ne s’appuient réellement sur rien, hormis des a priori, voire certains préjugés. En tout état de cause, elles sont dangereuses pour la santé, mais aussi pour les finances de notre protection sociale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Madame la présidente, madame la présidente de la commission des finances, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à revenir sur quelques-uns des points soulevés au titre de cette mission, lors des débats en commission et dans cet hémicycle.
Tout d’abord, j’évoquerai le niveau des crédits alloués aux actions de prévention.
La préservation des crédits dédiés à la prévention est un choix politique fort dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Aussi, je ne peux laisser dire que les chiffres contrediraient l’intérêt que le Gouvernement marque pour la prévention.
M. Delattre et Mme Imbert l’ont souligné : sur toute la durée du triennal, les crédits de prévention de la mission « Santé » sont maintenus au niveau fixé en 2014, c’est-à-dire à 162 millions d’euros. En particulier, 130 millions d’euros sont mobilisés au profit des fonds d’interventions régionaux. Il s’agit très concrètement d’encourager les comportements favorables à la santé à travers la prévention des maladies chroniques, la nutrition et la lutte contre l’obésité, la prévention des pratiques addictives, ou encore d’agir au titre de la santé environnementale, et ce en fonction des caractéristiques sanitaires et sociales des territoires.
Au sujet des crédits de prévention nationaux, je le répète : la baisse des crédits de l’action 14, Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades, correspond presque totalement à la diminution de la dotation accordée à l’Institut national du cancer, l’INCA, et en aucun cas à une réduction des sommes allouées aux programmes de prévention.
Ainsi, les crédits de prévention sont intégralement préservés de l’effort demandé au titre du programme budgétaire 204, qui se concentre essentiellement sur les opérateurs.
L’assurance maladie vient prolonger l’effort de l’État en faveur de la prévention, premièrement, par sa contribution aux dépenses de prévention des agences régionales de santé, les ARS, à hauteur de 220 millions en 2015, deuxièmement à travers le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires, le FNPEIS, dont la dotation atteindra 455 millions d’euros en 2017.
De surcroît, il est important de le rappeler : la priorité que nous attribuons aux actions de prévention se traduit sur le versant de l’autre texte financier pour 2016, le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je songe à l’extension de la gratuité des examens de dépistage et de surveillance intégrale aux femmes ayant certains antécédents familiaux de cancer du sein, et qui doivent faire l’objet d’une surveillance spécifique ; à la mise en place d’une approche innovante de prévention de l’obésité chez les enfants à risques, conjuguant l’intervention de professionnels tels que des diététiciens et des psychologues et un bilan d’activité physique ; ou encore à la prise en charge de l’intégralité du parcours de contraception des mineures.
C’est donc bien l’ensemble de ces crédits qu’il convient d’examiner pour apprécier l’effort public en faveur de la prévention.
Ensuite, plusieurs orateurs l’ont indiqué, l’effort que nous demandons aux opérateurs est significatif.
Sur la durée du triennal, les agences sanitaires sont mises à contribution à hauteur de 1 % de leurs dépenses hors rémunérations. Toutefois, ces économies ne sont pas le fruit d’une politique de rabot : nous avons refusé ce choix de facilité. C’est par la transformation de notre système sanitaire que nous dégageons ces économies.
Ont été rappelées les synergies, qui pourront notamment résulter d’une meilleure coordination entre la veille sanitaire et l’opérationnel au sein de la nouvelle agence nationale de santé publique. Cette future instance ne doit pas être la simple juxtaposition de trois entités, mais un établissement efficient disposant d’une réelle cohérence d’ensemble. Voilà pourquoi le choix a été fait de lui laisser le temps nécessaire à son installation, et de n’effectuer aucune ponction sur ses réserves et sur ses effectifs en 2016.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, a, plus spécifiquement, fait l’objet de diverses interventions en commission. À ce sujet, je rappelle que la répartition de l’effort entre les huit opérateurs a été établie en tenant compte du niveau de fonds de roulement et de trésorerie de chacun d’eux.
J’en viens au financement par l’État du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA.
Lors des débats en commission, s’est fait jour une préoccupation légitime à propos du paiement des offres d’indemnisation. J’attire votre attention sur le fait que, depuis 2015, l’État a rétabli sa contribution au FIVA, ce qui devrait permettre de réduire de manière très substantielle les délais de présentation des offres.
Par ailleurs, si les dossiers d’indemnisation des victimes de l’amiante ont subi des retards, c’est notamment à cause de conflits de jurisprudences entre cours d’appel. Or – les rapporteurs l’ont souligné –, dans le cadre de l’article 62 quinquies, le Gouvernement compensera intégralement l’abandon des créances résiduelles du FIVA vis-à-vis des victimes de l’amiante ou de leurs ayants droit qui avaient bénéficié d’un trop-perçu du fait des évolutions jurisprudentielles.
J’en viens au budget de l’aide médicale d’État, l’AME.
En 2016, nous prévoyons 700 millions d’euros pour l’AME. Ce chiffre est fondé sur une hypothèse réaliste de progression tendancielle des effectifs, car identique aux années précédentes.
Dès cette année, l’écart entre la prévision et la consommation de crédits se réduit par rapport aux exercices antérieurs, ce qui prouve que nous gagnons en précision dans l’évaluation de la dépense. Ainsi, l’ouverture de crédits en fin de gestion devrait atteindre 101 millions d’euros au titre de l’année 2015. Ce montant sera donc nettement inférieur à celui des années 2014 et 2013, au cours desquelles ont été dépassés les 150 millions d’euros.
En quoi consistent les propositions visant à supprimer l’AME pour la remplacer par une aide médicale d’urgence ? Il s’agit, concrètement, de limiter la prise en charge des adultes en situation irrégulière sur le territoire national au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës.
Or la dépense d’aide médicale d’État est nécessaire, je tiens à le rappeler, non seulement parce qu’elle est conforme à nos valeurs, mais aussi parce qu’elle permet de prévenir les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l’urgence.
Loin de favoriser la régulation de la dépense, une limitation de l’AME aux soins urgents et prioritaires entraînerait un recours aux soins hospitaliers plus tardif et partant plus coûteux. On le sait : aujourd’hui, pour les patients bénéficiant de l’AME au titre des seuls soins urgents, la durée moyenne de séjour et la prévalence de certaines pathologies graves sont bien plus élevées que pour l’AME dite « de droit commun ».
M. Roger Karoutchi manifeste sa circonspection.
Enfin, j’évoquerai les moyens mis en œuvre pour maîtriser la dépense, pour rendre plus fiable l’instruction des dossiers et pour améliorer les procédures de contrôle.
À ce titre, nous avons demandé au directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, la CNAM, d’intensifier les contrôles exercés lors de l’ouverture des droits. Cette directive vaut pour l’AME comme pour d’autres prestations, pour les bénéficiaires comme pour les professionnels de santé.
Toutes les personnes ayant déposé un dossier en déclarant n’avoir aucune ressource voient leurs moyens d’existence faire l’objet d’un contrôle approfondi. Dans ce cadre, les demandeurs sont convoqués pour un entretien à la caisse primaire d’assurance maladie, ou CPAM, dont ils dépendent.
Sur les 204 480 notifications d’ouverture de droits adressées en 2014, 29 405 se sont soldées par des refus. Le taux de refus s’établit ainsi à près de 15 %. Par ailleurs, 160 agents spécialement formés sont chargés de contrôler les dossiers de demande et les conditions d’attribution de la prestation. Il est donc inexact d’affirmer qu’aucune action n’a été engagée par l’assurance maladie en la matière !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Aline Archimbaud applaudit également.

Nous allons procéder à l’examen des crédits de la mission « Santé », figurant à l’état B.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Protection maladie

L'amendement n° II–142 rectifié, présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Protection maladie
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. Force est de le constater, cette proposition, que la commission des finances a déjà soumise au Sénat l’an dernier, soulève une polémique assez redoutable... Pour autant, on ne peut considérer qu’il y aurait, d’un côté, les bons, les gentils et, de l’autre, les irresponsables !
Protestations sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Bien entendu, il ne s’agit pas de remettre en cause l’utilité de l’aide médicale de l’État, l’AME, ou de compromettre l’accès aux soins qu’elle permet. Cet amendement tend simplement à le limiter, non de manière drastique mais dans des proportions assez raisonnables, afin de rendre cette aide soutenable financièrement et, surtout, acceptable par l’ensemble de nos concitoyens.
Mes chers collègues, nous sommes toutes et tous des élus politiquement responsables. Or nous toutes et tous rencontrons, dans nos villes, dans nos territoires, des personnes plus ou moins âgées dont les ressources sont proches du SMIC, …

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. … qui nous exposent toutes les difficultés auxquelles elles se heurtent pour obtenir des soins.
Mme Nicole Bricq et M. Jean-Louis Carrère s’exclament.

Je veux bien croire que les remises en cause de l’AME sont souvent exagérées. Mais ces critiques se fondent malgré tout sur une réalité, à laquelle nous devons avoir le courage de répondre. Il y va de notre responsabilité ! Le sentiment d’iniquité, qui nous vaut d’entendre tant de commentaires durant toutes les campagnes électorales, exige une réaction de notre part.
Vous invoquez souvent, dans cet hémicycle, l’unité nationale
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.

Sur un sujet comme celui-ci, il serait bon d’aboutir à un accord utile, soutenable et acceptable par l’ensemble de la population.
À cet égard, la solution que nous proposons est assez simple. Pour ce qui concerne la soutenabilité, je me permets de vous renvoyer au modeste rapport que j’ai rédigé. Je le dis notamment à l’intention de Mme Bricq, qui apprécie l’analyse des rapports et des courbes, et qui, j’en suis certain, a déjà pris connaissance de ce document.
Certes, les prévisions sont difficiles à établir. Je relève toutefois qu’en 2012, au titre de l’AME, les courbes des prévisions et des dépenses effectives étaient parfaitement identiques : ce coût s’établissait à 588 millions d’euros.
Dès lors, nous proposons de fixer les crédits de l’aide médicale d’État à 500 millions d’euros, en maintenant naturellement le montant obligatoire de 40 milliards d’euros au titre de l’assurance maladie, et en conservant les 4 milliards d’euros de crédits restant.
Peut-on, en ayant à l’esprit la situation de 2012, déclarer que cette proposition met à bas l’AME ? Non ! Ce que nous souhaitons, c’est engager le débat et la réforme. Au titre de la soutenabilité financière, la Cour des comptes elle-même formule des remarques qui devraient nous interpeller.

Madame la présidente, il s’agit là d’un sujet particulièrement complexe.

Je suis au regret de vous indiquer que les temps de parole sont impératifs.
Monsieur le rapporteur spécial, si ce sujet n’était pas si grave, je le qualifierais volontiers de « marronnier » : chaque année, cette question est soulevée de la même manière, et les mêmes arguments sont exposés.

Vous évoquez sans cesse les valeurs ; cependant, mes valeurs ne sont pas les vôtres, madame la secrétaire d’État !
Figurez-vous que je m’en étais aperçue… Cela étant, permettez-moi de vous répondre, car même si, en définitive, nous ne sommes pas d’accord, nous pouvons débattre de manière enrichissante. L’hémicycle de la Haute Assemblée est précisément le lieu du débat !
Le sentiment d’iniquité, qui peut se propager au sein de la population, est souvent entretenu par des arguments occultant la réalité suivante : soigner des personnes malades, c’est prévenir la propagation de maladies graves et contagieuses, c’est épargner, à cette population même qui éprouverait un sentiment d’iniquité, de contracter diverses affections, c’est éviter des épidémies. Il faut le rappeler.
Même si certains ou certaines assimilent les étrangers à des bactéries, …
… les véritables bactéries, elles, peuvent frapper diverses personnes qui ressentent l’iniquité dont vous vous faites l’écho.
Vous avez mentionné les valeurs, et avec raison : elles sont on ne peut plus importantes en ce moment – je songe en particulier aux valeurs républicaines !
Mme Sophie Primas s’exclame.
Parallèlement, vous avez relevé le goût de Mme Bricq pour la lecture des rapports et l’analyse des courbes… Selon moi, ces expressions sont réductrices. Elles conduisent à mésestimer le talent politique de Mme Bricq, son attachement à un certain nombre de valeurs, auxquelles je souscris, vous le savez bien, et son sens de l’être humain, au nom desquels elle intervient souvent et avec pertinence sur des sujets tels que celui-ci.
Pour l’ensemble de ces raisons, vous le comprendrez, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain et sur les travées du groupe CRC.

Ce n’est pas mon amendement, c’est celui de la commission des finances !

Je ne reprendrai pas les propos que j’ai tenus au cours de mon intervention générale. Toutefois, je l’avoue, je suis très surprise des arguments employés par M. le rapporteur.
Si certaines personnes éprouvent un sentiment d’iniquité dans l’accès aux soins, ce n’est pas à cause de notre couverture sociale en tant que telle : le modèle social français est le plus protecteur au monde. C’est tout particulièrement vrai de notre protection sociale.
Si ce sentiment existe, c’est du fait des difficultés d’accès à l’hôpital, c’est parce que l’on ne trouve pas de médecins traitants en milieu rural ou dans les banlieues. Ce n’est pas à cause d’un déficit de protection sociale !
Si l’on extrapolait votre argumentation, monsieur le rapporteur, on pourrait dire, finalement, qu’un étranger a le droit de mourir.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

C’est ce que vous dites en prévoyant un critère quantitatif, car cela signifie qu’il faut encadrer le budget de l’aide médicale de l’État. Ceux qui auront dépensé plus que cette aide ne seraient donc pas soignés.

Mme Catherine Génisson. Je remarque d’ailleurs, mon cher collègue, que Mme Natacha Bouchart, maire de Calais, qui connaît bien le sujet des migrants, n’a pas signé cet amendement des Républicains visant à réduire l’AME.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC. – Mme Aline Archimbaud applaudit également.

Vous connaissant un peu, monsieur le rapporteur, je ne vous accuserai certainement pas de ne pas avoir de cœur. En revanche, sans doute avez-vous un peu perdu la mémoire !
Historiquement, l’AME, qui ne s’appelait pas ainsi au départ, existe en France depuis la fin du XIXe siècle. Il faut le rappeler !
Vous avez cité la courbe des chiffres pour 2012. Je vous parlerai, quant à moi, des deux missions de l’IGAS, conduites en 2007 et en 2010.
C’est en 2010, justement, que vous vous êtes mis, tout à coup, à lutter contre l’AME.
J’ai fait les comptes : les dépenses que vous avez inscrites dans le projet de loi de finances, à hauteur de 5 milliards d’euros actuellement, vous les faites payer aux populations les plus fragiles.

Vous avez fait la même chose, il y a quelques jours, en diminuant de 650 millions d’euros les crédits de la prime pour l’activité. Vous le faites, aujourd’hui, en diminuant ceux de l’AME de 200 millions d’euros. Et demain, lorsque nous examinerons la mission « Travail et emploi », vous ferez de même en supprimant près de 1 milliard d’euros de crédits qui devaient financer les contrats aidés en 2016.
À ce compte-là, vous allez réussir à présenter un projet équilibré sur le dos des plus faibles. En effet, vous avez tellement déséquilibré le projet de budget que vous êtes désormais obligés de « gratter » partout. Et vous le faites sur les dépenses sociales ! Ce n’est pas une histoire de cœur, c’est la réalité des chiffres.
Mme Sophie Primas s’exclame.

Nous vous disons, une fois encore, que votre combat n’est pas le bon !
Par ailleurs, du strict point de vue de la santé, où vont aller ces étrangers s’ils ne sont pas soignés ? Où avez-vous vu qu’en France on laissait une personne sans soins ? Cela n’existe pas !
Ces étrangers se rendront donc aux urgences, dans un état de santé encore plus dégradé et in fine ils coûteront plus cher à l’assurance maladie !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

L’argument invoqué par M. le rapporteur nous paraît particulièrement déraisonnable.
Alors que nous débattons du financement de la santé publique, on nous propose de moins soigner, ou plutôt de le faire uniquement, comme on peut le lire dans l’exposé des motifs de l’amendement, en cas de « douleurs aiguës » et de « maladies graves ».
Tout médecin vous dira qu’il est évidemment beaucoup plus intéressant d’éviter que ne surviennent ces maladies graves. Qui va décider de leur degré de gravité ? On voit bien que l’argumentation ne tient pas !
Cet amendement vise également à prévoir le paiement d’un droit annuel, ce qui est une façon de dissuader les personnes dépourvues de moyens de se soigner. Il n’est pas raisonnable de prévoir, dans un texte relatif à la santé publique, de ne pas soigner des malades !
Il s’agit là d’une question de santé publique non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour l’ensemble de la population, car les maladies peuvent alors se développer dans tout le pays, y compris – interrogez les médecins, mes chers collègues ! – des maladies infectieuses très contagieuses.
M. le rapporteur nous demande d’être politiquement responsables. Soyons-le en ne mentant pas aux gens !
Cette argumentation est totalement démagogique et mensongère ! Nous savons en effet, comme vient de le dire Nicole Bricq, que ces personnes seront soignées de toute façon. Mais si l’on refuse de les soigner en amont, cela coûtera beaucoup plus cher et ce sera plus difficile.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de voter cet amendement.
MM. Michel Le Scouarnec et Jean-Pierre Godefroy applaudissent.

Je ne répéterai pas les propos, que j’approuve, de mes collègues.
L’AME, c’est un dispositif de prévention. En Seine-Saint-Denis, cette aide bénéficie à 16 % de la population. Je me vois mal dire à ces personnes, du jour au lendemain, que leurs droits sont supprimés.
En outre, notre territoire comptant des aéroports, nous sommes exposés à des maladies potentiellement transmissibles. Nous avons évoqué à un moment donné la grippe H1N1. Comment vacciner les populations s’il faut faire un tri et demander à chaque personne si elle bénéficie de l’AME ? Il est tout à fait déraisonnable de prévoir de telles mesures !
Nicole Bricq l’a dit mieux que moi, il est regrettable de renvoyer dos à dos les populations les plus vulnérables tout en protégeant les personnes mieux pourvues socialement. Dans le même esprit, vous avez voulu baisser l’imposition des redevables à l’impôt de solidarité sur la fortune...
Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, comme lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons le sentiment que ce sont les populations les plus vulnérables que vous voulez toucher. J’espère que nous nous trompons, mais dans ce cas vous devez nous le dire.
Quoi qu’il en soit, il est hors de question pour nous de voter cet amendement en l’état, de même que celui qui sera présenté par M. Milon.

Je partage la colère de Mme la secrétaire d’État et de mes collègues qui viennent de s’exprimer à propos de cet amendement.
Vous essayez, monsieur le rapporteur, d’opposer des populations qui rencontrent des difficultés, certes différentes, et de les mettre dos à dos.

mieux vaudrait faire la preuve que notre système de protection sociale et de santé publique peut apporter une réponse médicale à toutes les populations en difficulté.
Nicole Bricq a eu raison de dire, et elle l’a fait de très belle manière, que vous vous en prenez, encore une fois, aux plus faibles.
J’ajoute, pour aller dans le sens d’Evelyne Yonnet, que vous n’avez pas hésité, au moment de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à proposer encore davantage d’exonérations de cotisations patronales et de cadeaux à ceux qui ont, d’ores et déjà, beaucoup de moyens.
Mme Sophie Primas s’exclame.

Nous ne voterons donc pas cet amendement, comme l’a annoncé Laurence Cohen dans son intervention générale.
Nous ne pouvons vous donner raison lorsque vous mettez dos à dos des populations qui ont besoin d’obtenir des réponses fortes en termes de santé.

Je l’ai dit dans mon intervention générale, le groupe UDI–UC s’abstiendra sur cet amendement. Toutefois, contrairement aux collègues qui viennent de s’exprimer, je ne stigmatiserai pas notre rapporteur.
Les Français attendent que l’on trouve les moyens de répondre à des besoins exprimés par certaines populations en matière de santé. Il ne s’agit pas de donner des leçons : nous devons, tous ensemble, trouver la solution.
M. le rapporteur l’a dit, et nous en sommes tous d’accord, le budget de l’AME a beaucoup augmenté. Or nous avions sous-budgétisé – nous en sommes tous responsables ! – ce programme. C’est la réalité, et la logique voudrait que nous trouvions des solutions.
Quelles solutions pouvons-nous trouver ensemble sans nous donner des leçons les uns aux autres ?
Le groupe UDI–UC s’abstiendra sur cet amendement pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le projet de loi relatif au droit des étrangers en France est toujours en discussion. Peut-être pourrons-nous, dans le cadre de son examen, trouver les solutions que nous cherchons.
Par ailleurs, nous pensons, et je rejoins Annie David sur ce point, que, dans la situation actuelle, il nous faut certes réfléchir, mais pas stigmatiser les populations en difficulté.
On sait que plus de 70 % des dépenses d’AME de droit commun sont des dépenses hospitalières. Or la réforme de la tarification des séjours hospitaliers en médecine, en chirurgie et en obstétrique a entraîné une baisse des recettes pour les hôpitaux. Réduire le budget de l’AME, de nouveau, de 200 millions d’euros reviendrait donc, selon nous, à pénaliser les hôpitaux.
Pour toutes ces raisons, il est important de trouver une solution à la sous-budgétisation de l’AME.

Quand on s’envoie à la tête quasiment le mot « assassins », c’est que l’on n’a pas beaucoup d’arguments.

Tout d’abord, il faudrait lire les amendements en entier ! Il n’a jamais été question – relisez l’exposé des motifs de l’amendement – de supprimer la médecine préventive et la prophylaxie, pas plus que de limiter l’AME aux situations d’urgence. Absolument jamais !
Ensuite – comment le croire ? –, en douze ans, la dépense en matière d’AME a quadruplé. Dans deux rapports, la Cour des comptes a dénoncé ces dérapages. Des études et des missions §ont fait état d’un certain nombre de situations. Qui peut dire que tout cela n’a pas de sens, pas d’intérêt ?
Personne ne veut stigmatiser qui que ce soit, surtout en ce moment. Nous n’y avons intérêt ni d’un côté ni de l’autre. Mais là n’est pas le sujet ! La question est la suivante : comment le système peut-il être, à terme, soutenable et pérenne, si on ne le contrôle pas davantage ? En effet, si la dépense continue à ce rythme, alors très naturellement ceux qui disent qu’il faut tout supprimer l’emporteront.
Vous avez dit, madame la secrétaire d’État, que l’AME n’avait pas été sous-budgétisée, et vous avez ajouté ensuite que, selon les données constatées en fin d’année, 101 millions d’euros ont été ajoutés aux 700 millions prévus initialement. Cela signifie que la dépense s’est élevée en 2014 à 800 millions d’euros.
Nous verrons bien à quel niveau se situera la dépense finale en 2015... Mais on sera passé en quinze ans, de 2003 à 2018, de 200 millions d’euros à 1 milliard d’euros ! Et vous nous dites qu’il n’y a aucun problème et qu’il ne faut rien changer ? Cela n’a pas de sens !
Si nous voulons préserver l’AME, recentrons-la sur l’essentiel pour faire en sorte qu’elle soit pérenne et financièrement soutenable. Dire cela n’est diffamatoire ou désagréable à l’égard de personne !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Roger Karoutchi a bien présenté l’affaire. Et, en tant que médecin, il est bien évident que je ne suis pas un homme de cœur...
Francis Delattre se penche sur ce problème depuis un certain temps, parce que celui-ci l’interpelle. Il sait de quoi il parle, car il entend ce qu’on lui dit sur le terrain !
Il s’agit de mener véritablement une politique qui soit comprise par l’ensemble de nos concitoyens et de traiter ceux-ci à égalité, ni moins bien que certains, ni mieux. À cet égard, sans doute avons commis une erreur quand nous avons supprimé, il y a quelques années, le ticket modérateur, la fameuse participation de 30 euros.
À l’époque, c’était une décision plus dogmatique que comptable, qui nous conduit aujourd’hui à nous demander s’il faut diminuer le budget de l’AME. Alors ne nous faites pas de procès d’intention !
Je n’avais pas spécialement l’intention de soutenir cet amendement, mais je suis interpellé par les réactions qu’il a provoquées. Aussi, je le voterai. Ces crédits sont destinés à financer les soins de la génération actuelle, lesquels sont aujourd’hui financés à crédit : on emprunte en effet plus de 2 milliards d’euros pour couvrir l’ensemble des dépenses, les recettes actuelles ne suffisant pas.
C’est la raison pour laquelle il faut être attentif à cette question. M. Delattre propose de nous conformer au modèle allemand. Que je sache, l’Allemagne n’a pas maltraité les personnes concernées ! L’amendement me semble donc tout à fait acceptable et mérite d’être soutenu.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Je suis d’accord avec M. Karoutchi quand il dit que tout ce qui est excessif est vain.
Justement, monsieur Delattre, votre amendement est excessif et vain ! Comme l’a dit ma collègue Annie David, depuis que nous avons commencé à examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puis le projet de loi de finances, vous n’avez cessé de proposer des amendements prévoyant des exonérations de cotisations patronales – et je parle ici non pas des PME-PMI, mais du grand patronat.

Je ne comprends pas ! Vous semblez pourtant d’accord pour dire que tout le monde doit être soigné dans les mêmes conditions.
Au groupe CRC, nous pensons qu’il est possible en 2015 de prévoir un droit à la santé pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire, quelles que soient l’origine sociale ou la couleur de peau de la personne qui doit être soignée. Cela est possible parce que les budgets sont suffisants.

Mme Laurence Cohen. Aller grappiller à droite et à gauche au détriment des populations les plus fragiles
Mme Catherine Procaccia s’exclame.

Si les enveloppes sont restreintes, il faut faire en sorte de disposer de budgets plus importants, en votant de nouvelles recettes. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou l’inverse.
Pour toutes ces raisons, comme je l’ai indiqué dans mon propos introductif, nous ne voterons pas cet amendement.

Sur un tel sujet, ce sont toujours les mêmes phrases qui reviennent. Certains disent : « La France ne peut pas recevoir toute la misère du monde ».

D’autres ressortent des citations : « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire. »
Chacun participe à ce débat selon sa conscience. Toutes les idées sont légitimes et recevables !
Néanmoins, il y a des problèmes concrets, et aussi le serment d’Hippocrate. Lorsqu’un malade arrive à l’hôpital, le médecin doit le soigner. Si l’on diminue les crédits, qui payera ? Ce sont les hôpitaux qui se retrouveront en difficulté, ou la sécurité sociale si elle accepte de prendre en charge le déficit.
Au-delà des questions métaphysiques, il y a un problème de chronologie : actuellement, le Parlement examine le projet de loi relatif au droit des étrangers en France, qui comporte certaines mesures portant sur la santé. Attendons que la discussion de ce texte soit terminée ; si des mesures prévoyant de traiter en urgence les personnes qui arrivent chez nous sont adoptées, nous pourrons, à ce moment-là, diminuer le budget de l’AME. Cependant, mes amis
L’orateur se tourne vers les travées du groupe Les Républicains.

Aussi, comme l’a indiqué ma collègue Élisabeth Doineau, notre groupe s’abstiendra sur cet amendement.

Chers collègues du groupe Les Républicains, je ne vous comprends pas bien : l’équilibre de notre protection sociale ne se joue pas sur quelques millions d’euros de l’AME.
Je le dis sans chercher à faire de procès d’intention : que visez-vous derrière cette remise en cause permanente de l’AME ? En effet, vous avez voulu la supprimer, vous l’avez amendée et, aujourd’hui, vous proposez de diminuer ses crédits.
Nous pouvons tous être d’accord sur un point : l’AME ne doit pas être un guichet ouvert, géré avec laxisme. Des mesures ont d’ailleurs été prises. Comme je l’ai déjà dit, le rapport de Claude Goasguen et Christophe Sirugue indique que la fraude est très marginale depuis la sécurisation des titres en 2010.

Des contrôles sont opérés a priori et a posteriori par les agents de la Caisse nationale d’assurance maladie. Je l’ai dit, ils ont permis de mettre à jour 54 cas de fraude en 2014 pour un préjudice de 130 000 euros.
Mon raisonnement est simple : il y a sur notre territoire des Français de souche, d’autres qui sont français depuis moins longtemps, des étrangers en situation régulière et, malheureusement, des étrangers en situation irrégulière. Historiquement, tous ont toujours été soignés. Dans notre pays, lorsqu’une personne a besoin de soins, quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient, il faut la soigner. C'est aussi simple que cela !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Nous n’avons pas relevé de problèmes de santé aussi graves que ceux que vous décrivez.
Puisque l’on parle de valeurs, c'est essentiellement l’équipe municipale qui s’est débrouillée de leur trouver des logements, de les équiper et de faire participer tous les acteurs économiques du secteur.
En parlant de valeurs, il me semble que le sentiment d’équité, au niveau d’une ville comme d’un pays, est essentiel. §Sur ce sujet, même si je reconnais qu’à bien des égards la critique est parfois exagérée, il y a néanmoins un véritable problème.
Les services de la commission des finances peuvent en témoigner, je me suis rendu dans tous les hôpitaux de la région parisienne : les professionnels nous ont demandé de mieux réguler la situation. Dans les services d’urgence de nombre d’hôpitaux, la police est appelée pratiquement tous les jours parce que des pressions sont exercées sur le personnel.

Doit-on laisser les services hospitaliers face à des situations aussi difficiles ? Le sujet est évidemment ardu, mais si nous ne faisons rien, ces personnels quitteront les secteurs difficiles de la région parisienne.
Que devons-nous faire, alors ? Nous avons rencontré tous les acteurs du secteur, y compris les caisses d’assurance maladie, dont celle de Paris qui représente 24 % de l’AME. Ils ont regretté le manque de moyens pour exercer un contrôle. Or nous souhaitons qu’ils puissent contrôler. Ils ont débusqué des trafics, pour des sommes beaucoup plus importantes que celles que vous avez indiquées, monsieur Daudigny.
Nous devons prendre ce dossier en main pour éviter que les démagogues ne disent n’importe quoi.
Lutter concrètement contre les trafics, cela relève aussi de nos valeurs. Aujourd’hui, il faut donner des signes. Et il ne s’agit pas de dire aux étrangers qu’ils ne peuvent pas être soignés ! Il faut savoir que, dès lors qu’ils ont déposé une demande d’asile, les réfugiés ont accès immédiatement à la CMU. §Il n’y a aucun problème sur ce sujet.

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. Puisque 300 000 personnes bénéficient d’un ticket, il est tout de même normal que ceux qui financent l’AME puissent savoir si l’argent est dépensé correctement et que des contrôles sont effectués.
Applaudissementssur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le rapporteur, je voudrais vous rassurer. Lors de mon intervention à la tribune, j’ai expliqué que nous avions mis en place des contrôles des bénéficiaires de l’AME, comme de tous les bénéficiaires de l’assurance sociale. Il est en effet important, pour qu’un système de solidarité perdure, qu’il puisse être contrôlé afin de débusquer d’éventuelles possibilités de fraude.
De nombreux contrôles ont donc été effectués. Je vous ai cité les chiffres précédemment. Par ailleurs, 160 agents ont été spécifiquement formés pour travailler sur ces éventuelles fraudes, et, je le redis, quelques-unes ont été effectivement trouvées.
Lorsque vous parlez des tensions dans les services d’urgence de la région parisienne, je sais que vous ne visez pas en particulier les étrangers, et singulièrement les bénéficiaires de l’AME. Car ces tensions qui peuvent exister s’expliquent souvent par un afflux massif de malades, même si cela ne justifie en rien les attitudes violentes de certains, qui sont répréhensibles et doivent être condamnées.
La question n’est donc pas de savoir si nous allons moins bien soigner certaines personnes parce qu’elles sont étrangères. En effet, comme cela a été dit à plusieurs reprises, il est important que l’ensemble des personnes vivant en France, quelle que soit leur nationalité, ne soient pas atteintes de maladies parce que certains seraient mal soignés.
La question est bien de maintenir le niveau de soins, même pour de petites maladies, parce que celles-ci peuvent parfois dégénérer en pathologies beaucoup plus graves.
Nous sommes d’accord sur les principes. Dans notre pays, tout le monde est soigné. On ne déshabille pas certains pour habiller d’autres. Au contraire, j’y insiste, il faut continuer à soigner tout le monde. Si nous ne regardions que l’aspect financier des choses – l’aspect humain est important aussi, vous l’avez rappelé –, nous irions au-devant de grands problèmes, qui finiraient par nous coûter beaucoup plus cher qu’actuellement.

Je mets aux voix l'amendement n° II-142 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 82 :
Nombre de votants343Nombre de suffrages exprimés302Pour l’adoption147Contre 155Le Sénat n’a pas adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

L’amendement n° II–258, présenté par M. Milon, Mmes Canayer et Cayeux, MM. Cardoux et Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Gruny, Giudicelli et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Morisset, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert et Savary, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Protection maladie
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. Alain Milon.

La variole est une maladie infectieuse hautement contagieuse, grave, et contre laquelle il n’existe pas de traitement efficace. Le seul véritable moyen de lutte est la prévention par la vaccination.
Dans les années 1980, la vaccination de la population contre la variole a été interrompue en raison de l’éradication de cette maladie au niveau mondial. Toutefois, il existe encore des stocks de virus, qui sont détenus à des fins d’expérimentation par des laboratoires habilités.
Or, dans la période que nous traversons, on ne peut écarter le risque d’un détournement des stocks existants à des fins malveillantes ou la possibilité que le virus soit recréé par un procédé de biologie de synthèse pour être ensuite disséminé.
Face à cette menace, notre pays s’est équipé d’un stock de vaccins antivarioliques de première génération, conformément au plan national de lutte contre la variole établi en 2006. Mais cette stratégie est aujourd’hui dépassée au regard des recommandations internationales et nationales, en particulier les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, qui soulignent la nécessité de privilégier désormais les vaccins de troisième génération.
L’avantage du vaccin de troisième génération réside dans l’absence des risques d’effets secondaires graves – notamment d’effet létal – associés à ses prédécesseurs. En outre, il ne se réplique pas dans les cellules humaines et ne comporte pas de sérum, de conservateur, ni, je le précise à l’intention de certains collègues, d’adjuvant aluminé. Il permet donc de mobiliser plus efficacement les équipes d’intervention en cas d’attaque biologique.
Dans son avis de 2012 relatif à la révision du plan variole, le Haut Conseil de la santé publique recommande la constitution d’un stock de 250 000 doses de vaccins dans le cadre d’un scénario intermédiaire d’attaque. Ces vaccins seraient réservés aux intervenants de première ligne, c’est-à-dire les plus exposés en cas d’épidémie.
Le présent amendement nous donne les moyens de mettre enfin en œuvre cette recommandation. Le coût unitaire du vaccin étant estimé à 15 euros, cet amendement majore de 3, 75 millions d’euros les crédits de l’action 16 du programme 204, qui retrace la subvention de l’État à l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS. Il minore du même montant les crédits de l’action 2 du programme 183.
Cette mesure permettrait de renforcer immédiatement les équipes de première ligne qui seraient appelées à vacciner ou à diagnostiquer et traiter, soit environ 100 000 personnes au total.
Votre amendement, monsieur le sénateur, vise à insérer un article disposant que le ministre de la santé doit assurer l’existence sur le territoire d’un stock de 250 000 vaccins antivarioliques non réplicatifs de troisième génération. Ces vaccins seraient réservés aux intervenants de première ligne en cas de menace terroriste à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national.
Les pouvoirs publics français sont tout à fait conscients des risques liés à la variole et sont investis pour assurer un haut niveau de protection de la population. C’est pourquoi le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale a initié en novembre 2013 la révision du plan interministériel de lutte contre la variole, datant de 2006. Cette révision associe l’ensemble des ministères concernés, dont le ministère qui est chargé de la santé.
Dans ce cadre, l’Institut national de veille sanitaire a été saisi d’une demande portant sur la stratégie de vaccination, afin de définir les conditions optimales de protection. Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 21 décembre 2012 seront pris en compte pour élaborer une stratégie de prise en charge sanitaire qui comprendra notamment l’acquisition de vaccins.
Ces travaux sont d’ores et déjà achevés et les arbitrages interministériels sont en cours. Le nouveau plan de lutte contre la variole sera donc élaboré sur ce fondement et il restera classifié pour des raisons de sécurité. La diffusion d’informations trop précises sur la stratégie de lutte retenue faciliterait effectivement leur éventuel contournement à des fins malveillantes.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, j’y serai défavorable.

Le sujet exposé par notre collègue Alain Milon est tout à fait d’actualité. J’ai moi-même abordé ce sujet ce matin, lors de la séance de questions orales.
J’ai bien écouté la réponse de Mme la secrétaire d’État et en effet la question est grave. Aujourd’hui, environ 25 millions de nos concitoyens ne sont plus couverts par la vaccination antivariolique compte tenu de l’arrêt de celle-ci dans les années 1980. Cela dit, j’entends bien les arguments développés par Mme la secrétaire d’État, qui demande le retrait de l’amendement ; cela ne relève cependant pas de notre responsabilité.
Enfin, je ne reviens pas sur le débat que nous venons d’avoir sur l’amendement n° II-142 rectifié, mais je regrette que les crédits de cet amendement tendant à instaurer une protection antivariolique soient pris sur l’aide médicale de l’État.
L’amendement est adopté.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Santé », figurant à l’état B.
Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits, modifiés.
Ces crédits ne sont pas adoptés .

J’appelle en discussion l’article 62 quinquies qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Santé ».
Santé
(Intitulé nouveau)
Les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l’indemnisation d’un même préjudice ou de l’application, pour le calcul du montant de l’indemnité d’incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d’incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables. –
Adopté.

L’amendement n° II–195, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 62 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la caisse d’assurance maladie chargée d’instruire la demande par délégation de l’État accède aux informations contenues dans le fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme la rapporteur pour avis

Le travail d’instruction des demandes d’AME réalisé par les caisses d’assurance maladie n’est pas facilité – c’est un euphémisme – par le caractère souvent déclaratif des informations fournies par les requérants.
Selon les informations transmises par les caisses, il arrive que l’étude des demandes d’AME laisse pressentir que les demandeurs disposent d’un visa et donc qu’ils sont en principe couverts par une assurance. Or, en l’état actuel du droit, les services instructeurs n’ont pas accès aux informations leur permettant de vérifier l’existence éventuelle d’un visa et de connaître, le cas échéant, la nature et la durée de validité de ce document. Certaines personnes sont ainsi admises à l’AME alors qu’elles n’y sont pas éligibles, avec les conséquences financières que cela emporte.
Il nous paraît donc nécessaire de consentir à la demande des caisses, qui souhaiteraient pouvoir accéder aux informations contenues dans le fichier de délivrance des visas du ministère des affaires étrangères.
Tel est l’objet de cet amendement de la commission des affaires sociales, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités selon lesquelles cet accès sera mis en place. Il pourrait s’agir d’un accès indirect ; par exemple, les directeurs des caisses transmettraient périodiquement une demande de renseignements aux services du ministère à partir d’une liste de requérants.
Cette mesure contribuerait ainsi à assurer une meilleure maîtrise financière du dispositif en évitant les prises en charge indues – je précise que l’on se situe là en amont de l’attribution des droits et donc de la série de contrôles que Mme la secrétaire d’État a mentionnés tout à l’heure. Cette mesure permettrait d’accompagner les caisses dans les efforts qu’elles réalisent pour améliorer l’efficience des procédures et optimiser la maîtrise de la dépense publique.

Il s’agit d’une revendication de toutes les caisses d’assurance maladie, notamment de la région parisienne. Elles ont en effet du mal à établir une collaboration cohérente avec le ministère des affaires étrangères. L’accès à ces informations relatives aux visas leur permettrait surtout de mieux contrôler les demandes. Tout le monde semblait s’accorder pour considérer que, dans un souci de clarté pour nos concitoyens, les caisses d’assurance maladie ont besoin de ces éléments pour faire leur travail.
C’est un excellent amendement de Mme la rapporteur ; la commission émet donc un avis favorable.
Madame la sénatrice, je tiens à préciser qu’il existe déjà des échanges d’informations avec les services de l’État chargés des affaires consulaires, dès lors qu’il a été procédé aux déclarations adéquates auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.
Les organismes de sécurité sociale et les services de l’État chargés des affaires consulaires se communiquent en effet toutes les informations visant notamment à vérifier les conditions de délivrance des documents d’entrée et de séjour sur le territoire français. Voilà pour le ministère des affaires étrangères.
Pour ce qui concerne le ministère de l’intérieur, il existe une application : l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, ou AGDREF2. Cette application permet notamment de connaître la situation des étrangers et donc la nature de leur visa. Cet outil est d’ailleurs en train d’évoluer pour améliorer encore le contenu des informations disponibles et ainsi enrichir les échanges de renseignements.
Aussi, puisque votre demande est en grande partie satisfaite, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.

Notre collègue maintient, me semble-t-il, son amendement, donc je souhaite indiquer que mon groupe ne le votera pas.
Voilà un instant, à propos de l’amendement n° II-142 rectifié, notre collègue Yves Daudigny évoquait les sommes dérisoires dues à ce que vous assimilez à la fraude à l’AME.
En outre, Mme la secrétaire d'État nous dit que l’évolution en cours du dispositif permettra de communiquer aux caisses les informations que vous estimez nécessaire de leur délivrer.
Pour ma part, je veux rappeler, à l’intention de mes collègues de la majorité sénatoriale, que les fraudes patronales s’élèvent aujourd'hui, selon la Cour des comptes, à 20 milliards d’euros.
J’aurais aimé, chers collègues, que vous preniez des initiatives, à l’occasion de ce projet de loi de finances, comme, d'ailleurs, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour permettre un meilleur contrôle, dans les entreprises, de l’emploi de travailleurs détachés ou du travail illégal, notamment par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les DIRECCTE.

Oui, j’aurais aimé que vous déposiez des amendements visant à enrichir le texte en ce sens…

Mme Annie David. Non, ce n’est pas nous ! Vous savez très bien, monsieur Dallier, que je n’en fais pas partie…
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

En tout état de cause, il aurait été beaucoup plus intéressant et, pour parler le langage que vous affectionnez, efficient, pour les caisses du budget, de prévoir un meilleur contrôle de la fraude patronale.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des amendements que nous venons d’examiner. On s’en prend toujours aux mêmes, aux plus faibles, aux plus défavorisés, à ceux qui ont le plus besoin de notre soutien. Eh oui, mes chers collègues, il y a encore, en France, un peu de solidarité et un peu de soutien à apporter à des populations en difficulté.
C’est à cette population que vous vous en prenez. Nous ne voterons donc pas cet amendement.

Nous ne voterons pas non plus cet amendement, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, Mme la secrétaire d'État a expliqué, de manière extrêmement précise, que les moyens de contrôle que vous demandez, à juste titre, madame la rapporteur, existent déjà. Nous ne voyons donc pas de raison de maintenir cet amendement.
Ensuite, il ne me semble pas utile d’éveiller la suspicion quand cela n’est pas justifié.
Enfin, pour ce qui concerne la fraude sociale, des études très sérieuses réalisées récemment ont montré que les causes agitées par certains pour expliquer, par exemple, les difficultés financières de l’assurance maladie ou la situation des finances publiques relevaient du fantasme. Ces études ont notamment montré que la fraude sociale avait une part tout à fait minime dans les difficultés financières que nous rencontrons par ailleurs.

Je vais le maintenir, madame la présidente.
Madame la secrétaire d'État, je vous ai bien entendue. J’ai compris que mon amendement était en grande partie satisfait. J’en déduis qu’il ne l’est pas totalement, raison pour laquelle je le maintiens.
Il ne s’agit ni de discrimination ni de suspicion. Il s'agit de respecter les règles d’éligibilités à un droit, mais aussi de faciliter la tâche à la fois de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui, comme me l’ont expliqué leurs représentants, que j’ai auditionnés, rencontrent des difficultés dans l’instruction d’un certain nombre de dossiers.
Au demeurant, je me réjouis d’apprendre que les conditions d’accès aux visas seront prochainement satisfaites.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62 quinquies.
Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Santé ».

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Égalité des territoires et logement » (et articles 54 à 56 bis.)
Madame la ministre, mes chers collègues, j’indique au Sénat que la conférence des présidents a décidé d’attribuer un temps de parole de sept minutes au rapporteur spécial, de trois minutes aux rapporteurs pour avis, puis de quarante-cinq minutes aux orateurs des groupes.
Le Gouvernement disposera ensuite de quinze minutes pour répondre aux commissions et aux orateurs.
Puis nous aurons une série de questions de deux minutes maximum chacune, avec la réponse immédiate du Gouvernement ou de la commission des finances, pour une durée totale de quarante-cinq minutes.
La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Philippe Dallier, rapporteur spécial de la commission des finances. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai sept minutes pour vous parler de 18 milliards d’euros de crédits budgétaires, de l’hébergement d’urgence, de la réforme des aides personnelles au logement, ou APL, du financement des aides à la pierre, de la création FNAP… Je réclame donc votre indulgence, ainsi que celle de la présidence de séance. À l’impossible, nul n’est tenu !
Sourires.

Ce budget présente pour première caractéristique de connaître une forte hausse, de près de 33 % en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Toutefois, cette hausse est essentiellement due à la montée en puissance du pacte de responsabilité et de solidarité et au transfert, au budget de l’État, de 4, 7 milliards d’euros de cotisations sociales. Il faut donc entrer dans le détail des crédits de la mission pour y voir clair et, malheureusement, c’est là que les choses se gâtent.
Pour ce qui concerne le programme 177, « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », je commencerai par saluer la poursuite de l’effort budgétaire en direction de la création de places d’hébergement de toutes natures.
Cependant, malgré une augmentation de près de 6 % des crédits du programme, je ne peux que constater, comme l’an dernier, que ceux-ci seront nettement insuffisants. En effet, avec 1, 5 milliard d’euros, ces crédits sont d’ores et déjà inférieurs de 85 millions d’euros à ce que sera le réalisé de 2015, tel qu’il nous apparaît aujourd’hui, après deux décrets d’avance et un dernier abondement à venir dans le prochain projet de loi de finances rectificative.
Quant à l’objectif de réduction du nombre de nuitées hôtelières encore affiché pour l’année prochaine, autant dire, mes chers collègues, qu’il relève du vœu pieu !
Madame la ministre, cette situation d’insincérité chronique des crédits de ce programme n’est plus acceptable.
S’agissant du programme 109, « Aide à l’accès au logement », il convient, au-delà du mouvement de rebudgétisation du financement du fonds national des aides à la pierre, le FNAL, de s’attarder sur les réformes retenues par le Gouvernement concernant le calcul des aides.
Rappelons que l’objectif initial du Gouvernement était ambitieux, puisqu’il s’agissait de réaliser 1 milliard d’euros d’économies. Au final, le Gouvernement n’espère plus trouver qu’environ 200 millions d’euros.
Pourtant, les idées ne manquaient pas dans les nombreux rapports disponibles, qu’il s’agisse de ceux de la commission des finances du Sénat, des enquêtes réalisées par la Cour des comptes en application de l’article 58, alinéa 2, de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, des rapports des grands corps de l’État, du rapport de notre collègue député François Pupponi…
Vous auriez donc pu aller plus loin, madame la ministre, tout en préservant le caractère indéniablement redistributif de ces aides.
À cet égard, la commission des finances souhaiterait que soit étudiée la définition d’un véritable taux d’effort minimal, mais également que soit revu le sujet manifestement tabou de l’APL étudiant, versée aujourd’hui sans condition de ressources des parents.
Je me réjouis cependant que l’idée d’une dégressivité des aides au-delà d’un loyer plafond, que je défends ici depuis plusieurs années, ait enfin été retenue pour lutter contre leur caractère parfois inflationniste.
Revenons aux crédits eux-mêmes, en partant de ce que sera la situation, à la fin de l’année 2015, du FNAL, vis-à-vis duquel l’État aura une dette aujourd’hui estimée à 215 millions d’euros.
Les crédits proposés pour 2016 ne permettront pas de résorber cette dette. En espérant que les réformes engagées permettent bien d’économiser les 200 millions d’euros attendus, il faudrait encore que les autres hypothèses que vous avez retenues, madame la ministre, se révèlent exactes !
Vous tablez sur une progression de 100 millions d’euros de la part encore versée au FNAL par les employeurs. Or celle-ci ne peut résulter que d’une amélioration de la conjoncture économique !
Vous comptez aussi sur une baisse du nombre des allocataires et/ou des montants versés. Mais, pour l’obtenir, il faut également que la conjoncture s’améliore sensiblement et que le nombre de chômeurs diminue ! Permettez-moi d’en douter, surtout après la publication des chiffres du chômage du mois dernier... Peut-être obtiendrez-vous une stabilisation du nombre des allocataires et des sommes à engager – nous le souhaitons, du reste ! Toutefois, envisager une baisse nous semble déraisonnable.
Dans ces conditions, il est quasiment certain que le programme 109 est, au total, sous-doté d’environ 300 millions d’euros.
Madame la ministre, sur les aides personnelles comme sur l’hébergement d’urgence, l’insincérité chronique ne peut plus être la règle.
Je veux maintenant évoquer les aides à la pierre, qui relèvent du programme 135, « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».
Dans le projet de loi déposé à l’été par le Gouvernement, il ne restait plus que 100 millions d’euros de crédits de paiement, autant dire rien, puisqu’un prélèvement exceptionnel de 100 millions d’euros sur la trésorerie de la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, était opéré par ailleurs au profit du budget général de l’État. Eh oui, mes chers collègues, 100 millions d’euros moins 100 millions euros égalent bel et bien zéro ! Ce tour de passe-passe budgétaire s’inscrit dans une tendance lourde, qui fait craindre à beaucoup la disparition totale de ces crédits budgétaires.
Heureusement, le Président de la République a décidé de se rendre au congrès HLM de Montpellier et, manifestement, il a eu peur d’y arriver les mains vides. C’est ainsi que 150 millions d’euros de crédits budgétaires sont opportunément venus abonder les 100 millions d’euros initialement prévus…

Tant mieux pour les aides à la pierre, dont les crédits budgétaires progressent, ainsi, sensiblement !
Autre nouveauté importante de ce budget : la création du FNAP, que la commission des finances considère comme une bonne décision. À l’évidence, cette création peut ouvrir une nouvelle ère dans la gestion des aides à la pierre, mais à deux conditions : que l’on redonne de la visibilité aux acteurs, en cessant de changer les règles du jeu chaque année – je comprends tout à fait que les bailleurs sociaux en aient absolument assez de ces changements permanents – et que la création du FNAP ne soit pas le signe avant-coureur de la disparition complète des crédits budgétaires. Sur ce point, chacun s’interroge…
Quant au prélèvement de 270 millions d’euros qui sera opéré sur la CGLLS pour alimenter le Fonds en 2016, en complément des 250 millions d’euros de crédits budgétaires, la commission des finances n’a pas souhaité y toucher, considérant qu’une enveloppe permettant de répondre aux besoins doit être garantie.
En conclusion, madame la ministre, je dois vous dire que j’ai longtemps hésité avant de prendre une décision sur les crédits de la mission.
Oui, je le répète, votre budget comporte des points positifs. Cependant, il se caractérise par une sous-budgétisation bien trop importante.
Certains, rapportant les quelque 400 millions d’euros manquants aux 18 milliards d’euros de crédits, considéreront peut-être notre trait bien épais.
Vous me permettrez, mes chers collègues, de suivre un raisonnement différent. Le projet de loi de finances pour 2016 qui nous est présenté prévoit une réduction du déficit de seulement 1 milliard d’euros par rapport à l’année dernière, ce qui est déjà bien faible… Or 400 millions d’euros manquent sur cette seule mission, soit 40 % de la réduction du déficit affichée !
Dans pareil cas, la LOLF étant ce qu’elle est, le Parlement ne peut que déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce qui n’aurait strictement aucun sens, compte tenu de ce que je vous ai dit sur les crédits du FNAL ou sur l’hébergement d’urgence.
En revanche, vous, madame la ministre, par voie d’amendement, vous pouvez au moins rebaser les crédits de l’hébergement d’urgence de 85 millions d’euros, pour les maintenir à leur niveau de 2015, et ceux des aides personnelles au logement de 215 millions d’euros, afin d’absorber à coup sûr la dette de l’État à l’égard du FNAL.
Sur cette base, la commission des finances du Sénat pourrait revoir sa position, mais, en l’état actuel des choses, je ne peux que proposer, en son nom, le rejet des crédits de la mission.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Égalité des territoires et logement » connaissent une forte augmentation pour des raisons comptables et se caractérisent par la mise en place de deux réformes : celle qui concerne les aides personnelles au logement, ou APL, et celle qui a trait aux aides à la pierre.
S’agissant de la réforme des aides personnelles au logement, les économies attendues dépendent très largement des critères retenus. À cet égard, je regrette que le Gouvernement ne soit pas en mesure, à ce stade, de nous indiquer avec précision les seuils exacts qui seront arrêtés, que ce soit pour la valeur du patrimoine ou pour la dégressivité de l’aide, et qu’il nous place ainsi dans l’incapacité de nous prononcer sur les crédits du programme en parfaite connaissance de cause.
J’ajoute qu’il est très difficile de dire si les montants prévus seront à la hauteur des besoins en 2016 puisque, depuis 2008, les prévisions sont toujours inférieures à l’exécution constatée.
S’agissant de la réforme des aides à la pierre, l’article 56 prévoit la création du fonds national des aides à la pierre, dont les ressources proviendront d’une fraction d’euros des cotisations versées par les organismes d’HLM – à hauteur de 270 millions d’euros –, des subventions de l’État et de la majoration du prélèvement sur les communes carencées en logements sociaux.
L’augmentation des crédits de l’État destinés aux aides à la pierre est certes bienvenue, mais elle ne doit pas dissimuler le fait que l’État n’assume plus la part principale de ce financement. J’ajoute que nous ne disposons d’aucune visibilité sur les crédits qui seront réellement affectés au FNAP ni sur leur pérennité. Des gels de crédits avant affectation au FNAP ne sont pas à exclure.
Les cotisations des bailleurs augmentent de 125 %, pour atteindre 270 millions d’euros. Le taux maximal de cette cotisation est porté à 3 %, alors même que l’assiette a été élargie au supplément de loyer dans la limite de 75 %
Ces augmentations, qui anticipent le probable désengagement de l’État, auront nécessairement des conséquences sur les capacités d’investissement des bailleurs sociaux. Il n’est pas exclu que ces hausses soient répercutées in fine sur le loyer des locataires du parc social.
Le prélèvement de 3 % équivaut à une baisse de 20 % sur les travaux d’entretien ou encore à une baisse significative des investissements dans la production et la rénovation de logements.
En conséquence, je vous proposerai un amendement visant à modifier la contribution des bailleurs sociaux.
Je vous proposerai également que la cotisation versée par les sociétés d’économie mixte puisse aussi reposer sur le produit du supplément de loyer.
S’agissant de la gouvernance du FNAP, je vous proposerai, enfin, que des représentants des métropoles puissent siéger en son sein.
Pour terminer, je dirai un mot sur les ressources de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH : à l’heure où se déroule la COP 21 et après avoir posé des objectifs ambitieux dans la loi sur la transition énergétique, il est anormal que l’Agence n’ait pas de ressources pérennes, alors qu’elle doit aider à la rénovation de 50 000 logements par an. Je déplore également que les financements du Fonds d'aide à la rénovation thermique, le FART, ne soient assurés que pour l’année 2016, alors même que chacun reconnaît les effets positifs du programme Habiter mieux.
En conséquence, la commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur l’adoption des crédits de cette mission.
Très bien ! et applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – Mme Valérie Létard applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’avis de la commission des affaires sociales est centré sur le programme 177 consacré à l’hébergement et à l’accompagnement vers le logement.
Les crédits consommés en 2015, majorés de plus de 220 millions d’euros, soit une hausse de 16 %, par rapport à la loi de finances initiale, n’ont pas permis de faire face aux besoins croissants, une demande d’hébergement sur deux restant sans réponse.
Or les crédits demandés pour 2016 sont inférieurs de plus de 85 millions d’euros au montant qui sera consommé en 2015, soit une différence de moins 5 %. Des crédits supplémentaires seront sans aucun doute apportés en cours d’exercice.
Cette insincérité budgétaire – comme je l’avais souligné l’année dernière – ne permet pas aux acteurs associatifs de disposer de la visibilité nécessaire pour inscrire leur action dans la durée.
Outre leur insuffisance récurrente, c’est la répartition des crédits entre l’accompagnement vers le logement et la réponse à l’urgence qui pose problème.
En effet, tous les ans, on constate qu’une partie des crédits destinés à financer le logement adapté est réaffectée en cours d’exercice vers l’hébergement d’urgence. De plus, l’augmentation du nombre de places d’hébergement sur les dernières années a concerné essentiellement l’hébergement d’urgence et l’hôtel, le nombre de places en centres de réinsertion demeurant stable.
La réussite du plan de résorption du recours à l’hôtel suppose de sortir de la gestion de l’urgence qui caractérise actuellement le programme 177, ce que les crédits demandés ne permettent pas d’envisager. S’il est bienvenu, ce plan ne permettra vraisemblablement que de ralentir la progression du nombre de nuitées hôtelières, mais nullement de le réduire.
Enfin, Le programme 177 est fortement affecté par la crise migratoire actuelle, en raison à la fois de la saturation des dispositifs spécifiques et du nombre de personnes en situation irrégulières qui ne souhaitent pas demander l’asile en France ou dont la demande a été rejetée.
On peut noter la progression de plusieurs chantiers devant conduire, à terme, à améliorer le pilotage budgétaire de la politique d’hébergement. Je pense à la mise en œuvre des services intégrés d’accueil et d’orientation, les SIAO, ainsi qu’à l’étude nationale des coûts et à la généralisation progressive sur les territoires des diagnostics territoriaux.
Malgré cela, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur l’adoption des crédits de la mission, en raison de l’insincérité et de l’insuffisance des crédits du programme 177.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe applaudit.

Madame la présidente, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, d’une année sur l’autre surgissent les mêmes travers, reviennent les mêmes questions.
Une fois de plus, le périmètre de la mission a été largement modifié à la suite du transfert à l’État du financement de l’allocation de logement familiale.
Une fois de plus, les crédits inscrits en loi de finances sur le programme 177 et le programme 109 sont insuffisants et doivent faire l’objet d’abondements importants en cours d’année, ce qui, comme le remarque notre rapporteur de la commission des affaires économiques, pose la question de la sincérité de ce budget.
Autre travers constant, celui de la boulimie législative relancée par l’annonce d’un volet logement dans le projet de loi « égalité et citoyenneté », actuellement en préparation. Souhaitons, madame la ministre, que ce texte permette des simplifications bienvenues et, surtout, qu’il soit le point de départ d’une stabilisation des dispositifs, gage de sécurité et de confiance pour les ménages et tout le secteur de la construction et du logement.
Car une autre constante existe depuis 2012, celle de la baisse ininterrompue des permis de construire et des mises en chantier : plus de 55 000 emplois perdus dans le bâtiment entre octobre 2013 et avril 2015 ; sur les 150 000 logements sociaux programmés en 2014, seulement 106 414 ont été réalisés ; un objectif de 500 000 logements par an, mais 350 600 mises en chantier sur un an à fin septembre 2015. Les derniers chiffres semblent indiquer une légère reprise ; il était important qu’elle arrive ; espérons qu’elle durera.
Permettez-moi de revenir rapidement sur quatre points de cette mission.
Premièrement, le vote en première lecture par l’Assemblée nationale du renforcement, à hauteur de 96, 02 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, des crédits de l’hébergement d’urgence du programme 177 au titre de l’engagement de la France à accueillir 30 000 réfugiés, dont une partie pour l’hébergement d’urgence et l’autre – 26 millions d’euros – pour l’APL.
De son côté, le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, a abondé les moyens alloués à l’immigration et à l’asile de 72, 4 millions d’euros, dont une partie sera consacrée à l’aide aux communes pour l’hébergement et le logement des personnes réfugiées et l’autre à la prise en charge des demandeurs d’asile.
Madame la ministre, j’aimerais comprendre comment vont s’articuler les programmes 303 et 177 ? Entre hébergement d’urgence et hébergement de demandeurs d’asile, le tout avec des financements de chaque côté, on a beaucoup de mal à voir comment tout cela va évoluer. Quels sont ces 30 000 réfugiés appelés à être pris en compte dans le cadre des dispositifs d’hébergement de droit commun ? On comprend la nécessité d’un financement supplémentaire, mais combien de personnes peuvent être accueillies aujourd’hui dans de bonnes conditions dans le cadre de cet hébergement d’urgence de droit commun, déjà « embolisé » par l’accompagnement de déboutés du droit d’asile et de personnes en situation irrégulière ? On a beaucoup de mal à comprendre comment les deux cadres budgétaires vont pouvoir coexister et ce qui va se passer d’amont en aval du dispositif.
Deuxièmement, le financement pérenne de l’Agence nationale de l’habitat – sujet déjà évoqué lors de la discussion de l’article 14. On ne peut remplir les objectifs ambitieux de rénovation énergétique, en particulier ceux du parc privé, comme nous l’ont précisé les deux rapporteurs, si nous ne donnons pas à l’Agence, eu égard au nombre croissant de missions qui lui sont confiées, les moyens pérennes de son action.
Dans le débat sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte, j’avais proposé de créer un fonds de financement de l’ANAH. La question reste plus que jamais d’actualité. On a rappelé que le FART était bien pris en compte pour 2016, mais que se passera-t-il ensuite ?
Vous savez que deux politiques nouvelles ont été affectées à l’ANAH : les conventions financières avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, et les programmes de requalification des centres-bourgs. Or ces deux nouvelles missions dévolues à l’ANAH n’ont pas de traduction financière.
Ce n’est pas dramatique pour 2016, qui est une année charnière, mais où trouver les ressources pour 2017 ? Comment accompagner ces deux nouvelles politiques publiques qui vont monter en puissance alors qu’il a fallu, afin de pouvoir boucler le budget, supprimer les crédits « Habiter mieux » pour les ménages modestes ? Comment mettre en place un programme Habiter mieux à la hauteur des ambitions de la COP 21, c’est-à-dire à même de financer les ménages modestes ? Comment le ministère de l’environnement et le ministère du logement peuvent-ils utiliser les moyens du fonds de transition énergétique pour servir les ambitions de la COP 21 et les besoins de notre pays ?
Troisièmement, la réforme à la marge des aides au logement engagée dans cette loi de finances. Bien que le terrain ait été préparé, que les rapports soient nombreux et que l’effet inflationniste de ces aides ait été largement dénoncé, le Gouvernement peine à les réformer de manière structurelle.
Pour ma part, je retiendrai la sixième recommandation de la Cour des comptes qui nous invite à réfléchir à une fusion des APL avec les minima sociaux et la prime d’activité. Et je souhaiterais que le Sénat puisse être force de proposition sur cette question.

Quatrièmement, l’effort de construction. La question du foncier reste primordiale dans les zones tendues.

La Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier a présenté, dans son rapport de janvier 2015, une évaluation relative à la mobilisation du foncier public, laquelle est loin d’être satisfaisante à ce stade.
En conclusion, sur le foncier, comme sur la garantie universelle des loyers, la GUL, et comme sur bien d’autres dispositifs revus depuis 2012, la législation a été rendue toujours plus complexe au détriment de l’efficacité. C’est toute la chaîne du logement qui en pâtit.
Comme nous l’avons dit en commission des affaires économiques, notre groupe se trouve en difficulté pour aborder positivement une proposition de budget qui n’est pas à la hauteur des ambitions.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, une fois encore, je constate que les crédits « logement » ne sont pas à la hauteur des besoins et, en tout état de cause, pas de nature à répondre à la crise qui conduit au mal-logement de plus de 3, 5 millions de nos concitoyens.
Nous sommes bien loin des 150 000 logements sociaux par an, promis par le Président de la République, puisque la prévision de réalisation pour 2015 correspond à 108 000 logements.

Les objectifs pour 2016 sont de 135 000 logements, dont seulement 35 000 logements très sociaux financés à l’aide d’un prêt locatif aidé d’intégration, ou PLAI. Or je rappelle qu’au moins 1, 7 million de nos concitoyens attendent un logement social.
À l’heure où la courbe du chômage tarde, hélas ! à s’inverser, nous estimons qu’il est urgent d’engager réellement un effort de construction permettant de conforter le secteur du bâtiment qui a perdu, selon la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ou CAPEB, plus de 51 000 emplois.
Concernant l’hébergement d’urgence, nous regrettons la sous-budgétisation chronique de ce programme, même si un effort a été consenti pour répondre à l’urgence humanitaire que représente l’accueil des migrants.
Pour autant, le nombre de personnes hébergées à l’hôtel ne cesse d’augmenter ; le 115 ne répond plus. Trop de nos concitoyens dorment dans la rue, alors même que le droit au logement est un droit constitutionnel qui devrait conduire notamment à accroître le nombre de places en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ou CHRS.
S’agissant des aides personnelles, les crédits ont fortement augmenté. Ils traduisent la reprise des financements par le budget de l’État, mais témoignent aussi de la violence de la crise sociale. La volonté du Gouvernement de maîtriser cette dépense, notamment au travers de l’article 55, est légitime, mais malheureusement vouée à l’échec. Nous pouvons nous interroger sur le mouvement engagé dans les années soixante-dix, qui a conduit à la montée en puissance des aides à la personne au détriment des aides à la pierre. Nous contestons cette évolution en considérant que, si l’offre de logements était plus importante, le marché serait moins tendu, les loyers moins chers et la masse globale des APL serait par conséquent moins lourde pour les finances publiques.
À nos yeux, la solution pour contenir le niveau des aides au logement doit s’appuyer davantage sur le niveau de l’effort de construction, donc sur l’offre.
Concrètement, les APL sont aujourd'hui nécessaires pour nombre de nos concitoyens, afin de se loger dignement. Nous demandons leur versement au premier euro, dès le premier mois. D’ailleurs, nous trouvons tout à fait inefficace d’arrondir ces aides à l’euro inférieur, mais c’est un détail.
Je veux également attirer votre attention sur le fait que le budget de l’action 3, Sécurisation des risques locatifs, est en nette diminution. Cela traduit la baisse d’ambition du Gouvernement, qui a renoncé à l’instauration de la garantie universelle des loyers, la GUL. Nous regrettons l’abandon de ce dispositif, qui, grâce à nos amendements, permettait la prise en charge des accidents de loyers des locataires. C’était une avancée réelle.
Le Gouvernement a remplacé ce dispositif par la caution locative étudiante. Bien que positive, son périmètre est largement restreint. Un autre dispositif, VISALE, devrait bientôt entrer en vigueur. Il serait financé par le 1 % logement – en fait, 0, 45 % – et prendrait la forme d’un cautionnement pour les plus précaires. Nous regrettons que ce futur dispositif n’ait pas un caractère universel.
J’en viens à ce qui nous semble aujourd’hui le plus problématique, à savoir le désengagement de l’État du financement de la construction publique. Le premier problème que nous identifions est la baisse des dotations aux collectivités. En effet, l’effort de production est porté principalement, depuis des années, par les collectivités territoriales, et tout particulièrement les communes. Baisser leurs dotations, c’est aussi pénaliser la construction.
Ce projet de loi de finances tend à créer un fonds national des aides à la pierre, ou FNAP. Ce changement de gouvernance marque le fait que les crédits de l’État ne constituent plus l’essentiel du financement des aides à la pierre. Nous déplorons un tel désengagement, en considérant que le financement des aides à la pierre majoritairement par les bailleurs sociaux, au travers de la Caisse de garantie du logement locatif social, revient à faire peser l’effort de construction sur la solidarité entre les locataires. La participation des bailleurs représente ainsi 370 millions d’euros, contre un apport de l’État de 100 millions d’euros, transformés en cours d’examen en 250 millions d’euros.
Il aura ainsi fallu la fronde du secteur HLM et des associations de locataires pour que le Gouvernement fasse marche arrière et renonce à aller au bout de sa logique d’externalisation du financement de la politique du logement.
Par ailleurs, les aides à la pierre concernent aujourd’hui les seuls logements des prêts locatifs aidés d’intégration, les PLAI. La subvention unitaire est stabilisée à 6 500 euros, ce qui semble bien peu au regard du coût de la construction. Elle était de 12 000 euros en 2010 ; elle a donc été divisée par deux en six ans. Cela relativise largement la nouvelle aide accordée aux maires bâtisseurs, à hauteur de 2 000 euros par logement construit. Le compte n’y est pas !
À ce titre, on peut également déplorer que la Caisse des dépôts et consignations ne joue pas suffisamment son rôle de levier.
Nous proposons depuis plusieurs années l’instauration d’un prêt à taux zéro pour les offices d’HLM. M. le Président de la République est allé en ce sens, en annonçant lors du congrès HLM la baisse du taux de commissionnement des banques au titre de l’épargne réglementée. Cela va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin.
Nous regrettons, enfin, que ce projet de loi de finances encourage l’investissement locatif au travers du dispositif Pinel – nous n’avons rien contre vous personnellement, madame la ministre –, qui conduit encore une fois à ce que les sommes liées aux dépenses fiscales dépassent les crédits de la mission. Nous ne partageons pas cette orientation, qui fait que, pour un euro dépensé en faveur d’une intervention directe de l’État, près de deux euros sont consacrés à la défiscalisation. D’ailleurs, il y a pléthore de dispositifs…
Pour le droit au logement, nous avons besoin d’une politique publique ambitieuse permettant la construction de 500 000 logements par an, économes en énergie et garantissant le droit à chacun d’y accéder et de s’y maintenir. Il y va de notre intérêt à tous.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget qui nous est présenté pour le logement doit être considéré au regard non seulement de la mission que nous examinons, mais aussi de l’ensemble de la politique gouvernementale mise en œuvre. Je pense notamment à la politique fiscale, qui a de plus en plus d’importance en matière de logement.
Ce budget intervient à un moment où l’horizon se dégage dans le secteur du logement et de l’immobilier. Le nombre de permis de construire est reparti à la hausse, avec une augmentation de 3 % pour la période d’août à octobre 2015 par rapport à la même période l’an dernier. Les mises en chantier progressent depuis quatre mois, et on repasse au-dessus des 350 000 logements.
Les professionnels de l’immobilier, peu coutumiers de grandes déclarations optimistes, estiment que la reprise est désormais engagée et qu’elle devrait se confirmer. Tout cela ne tombe pas du ciel, il aura fallu des politiques gouvernementales pour soutenir ces activités. Le dispositif dit Pinel de soutien à l’investissement locatif, singulièrement amélioré et renforcé en 2014, a manifestement eu un effet très positif dans cette reprise.
Mais considérons les choses de plus près. Cette mesure contracyclique ne doit pas s’installer dans la durée, ce afin d’écarter tout effet inflationniste. À l’heure actuelle, les dérives d’hier semblent avoir été évitées. Le dispositif paraît donc bien calibré.
En tout cas, dans le secteur de l’investissement locatif, on peut espérer un effet booster de la mise en œuvre opérationnelle du logement locatif intermédiaire, qui monte en puissance. Les dispositifs d’amélioration de la TVA, le Fonds de logement intermédiaire et les mécanismes juridiques étant en ordre en marche, on devrait voir cette année les concrétisations de cette politique, destinée à soutenir la construction et à offrir des logements à coût abordable aux classes moyennes.
Je veux saluer les récentes décisions du Président de la République et du Gouvernement concernant l’accession sociale à la propriété. Le doublement de la quotité finançable dans le neuf, le renforcement du différé de remboursement et l’augmentation des plafonds de ressources sont à l’évidence des éléments favorables.
De ce point de vue, madame la ministre, j’espère qu’on ne manquera pas d’observer l’évolution des prix. Le plafond de ressources étant assez haut, il ne faudrait pas qu’on assiste à des effets inflationnistes. J’espère que le Gouvernement restera attentif à cette question.
Nous avons voté, dans le cadre de la première partie de ce projet de loi de finances, l’expérimentation d’un foncier différé pour l’accession très sociale. J’espère qu’elle sera retenue par le Gouvernement. Cette orientation très sociale viendrait compléter les mesures en faveur de l’accession sociale à la propriété. Tous ces éléments concourront, madame la ministre, à soutenir la construction.
Avant d’évoquer la construction de logements sociaux, je veux saluer l’arbitrage gouvernemental concernant les APL et soutenir les améliorations apportées par nos collègues députés.
Je le sais bien, il existe une forte pression pour baisser les crédits de l’aide à la personne. Malgré tout, au regard de la situation de nos concitoyens en termes de chômage et de précarité, ces aides constituent aujourd'hui un amortisseur social. Je connais les arguments relatifs à leur éventuel effet inflationniste. Pour autant, la baisse de ces aides ne m’aurait pas paru une idée judicieuse. J’approuve la position du Gouvernement, qui n’a pas cédé aux sirènes de ceux qui voulaient « fermer les robinets de l’APL » tout en refusant la régulation des loyers.
Pour contrer tout effet inflationniste, il faudra sans doute, un jour, baisser le montant des aides à la personne, mais à la condition d’avoir régulé les loyers. Force est de le constater, le Gouvernement a fait le bon arbitrage en ne cédant pas à la tentation d’une baisse drastique des aides à la personne.
Au demeurant, nous constatons que le taux d’effort moyen de nos concitoyens pour se loger ne cesse de croître depuis dix à quinze ans. C’est préoccupant, car cette situation pèse sur le pouvoir d’achat, notamment, des plus démunis.
J’évoquerai rapidement le Fonds national d’aide au logement, le FNAL. Nous sommes quelque peu indécis s’agissant de la proposition de transférer au FNAL des sommes auparavant destinées à l’aide à la pierre dans le logement social, via la CGLLS. Il s’agit notamment des aides fiscales accordées en cas de plus-values immobilières, lors de la vente d’un bien destiné à la réalisation de logements sociaux. Une telle disposition pose une vraie question, dont nous voulons débattre, celle des aides à la pierre.
Les agréments de logements sociaux augmentent, ce qui constitue un point positif. Par ailleurs, le budget consacré à l’aide à la pierre progressera cette année. Au-delà du débat sur l’opportunité de ce fonds d’aide à la pierre, où je fais partie de ceux qui craignent qu’un tel fonds ne soit une étape vers le désengagement de l’État, notre groupe sera très vigilant s’agissant des garanties apportées sur le montant des aides et la partie budgétaire de celles-ci. Nous veillerons également à ce que cette décision n’implique pas, car ce serait redoutable, une augmentation de la cotisation des organismes d’HLM adossée aux loyers.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En conclusion, au-delà des efforts du Gouvernement en matière fiscale pour soutenir le mécanisme de la COP 21 et de la transition énergétique, qui est en marche dans notre pays, ce budget concourt, selon moi, au renforcement de la construction, donc à l’emploi. Par ailleurs, il est de nature à améliorer l’accès au logement. Par conséquent, au-delà des questions que nous nous posons sur l’aide à la pierre, que nous souhaiterions voir garantie par le Gouvernement, notre groupe votera ce budget, amendé par l’Assemblée.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la ministre, je souhaite, dans le peu de temps qui m’est imparti, aborder trois sujets de transparence et d’équité s’agissant de la politique du logement.
Je fais partie des parlementaires ayant eu l’occasion de travailler, voilà une quinzaine d’années, à la mise en place de la loi organique relative aux lois de finances, qui recommande que, pour chaque politique publique, nous disposions d’une évaluation à coût complet de la politique mise en œuvre par l’État. Bien évidemment, une telle disposition s’applique au ministère du logement comme aux autres ministères.
Or, depuis janvier 2013, a été mise en place la loi dite « Duflot », qui recense un certain nombre d’actifs fonciers de l’État susceptibles de contribuer à des opérations de construction.
Même si le rythme de mobilisation de ces terrains est très lent, c’est une politique légitime et sans doute souhaitable, afin de concourir à l’effort de production de logements.
Le problème, c’est que ces actifs, qui sont affectés à d’autres ministères, ne sont pas pris en compte dans le budget du ministère du logement. Cela signifie qu’aujourd’hui contribuent à la politique du logement sur leur budget au travers du droit de retour qu’ils ont d’autres ministères. Nous avons ainsi cédé à ce jour, si je me reporte aux derniers chiffres donnés pour l’exercice 2015, 122 millions d’actifs fonciers de l’État, pour 47 millions d’euros.
Une décote de 75 millions d’euros a donc été appliquée aux budgets de différents ministères – le ministère de la défense ou le ministère des affaires étrangères, notamment – sans que cette opération ne soit retracée dans les comptes du ministère du logement.
Cette décote représente pour l’État un manque à gagner. Je souhaite donc qu’elle fasse l’objet d’une consolidation, au même titre que les dépenses fiscales mises en œuvre dans le cadre de la politique du logement – il s’agit bien d’une moindre recette, donc d’une dépense fiscale.
La conséquence, c’est que les crédits de votre projet de budget, madame la ministre – c’est une bonne nouvelle pour vous : cela signifie qu’ils progressent ! – sont en réalité supérieurs de 75 millions d’euros à ceux que voteront les parlementaires !
Mais il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour la transparence budgétaire. C’est là le premier problème que pose l’application de la loi Duflot.
Deuxième problème : ce ne sont pas vos services, madame la ministre, qui déterminent le taux de la décote, mais ceux des communes.
Ce sont elles, en effet, qui exercent la compétence en matière de politique du logement et de politique foncière, et qui déterminent à quel coût l’opération de construction peut être réalisée.
Certaines collectivités territoriales, et en particulier la Ville de Paris, bénéficient ainsi d’une sorte de droit de préemption sur le budget de l’État, qui n’est pas sans poser un problème d’équité entre les collectivités.
En effet, sur la plus grande partie du territoire, en dehors de l’Île-de-France, la plupart des collectivités doivent faire l’effort de trouver du foncier qu’elles dédieront gratuitement à la construction de logements sociaux.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.

M. Michel Bouvard. Elles doivent même accorder des subventions aux organismes de logement afin de les aider à boucler les opérations.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame de nouveau.

Dans le même temps, d’autres collectivités connaissent une situation d’exception, qui se traduit par des décotes faramineuses au service de la construction d’un très petit nombre de logements.
Un exemple me vient spontanément à l’esprit, celui de la bibliothèque universitaire de l’Institut national des langues et civilisations orientales : le montant de la décote s’est élevé à 4, 8 millions d’euros, sur une valeur vénale totale de 6, 2 millions d’euros, pour produire 18 logements, soit 267 000 euros de décote par logement !
Cette question mérite que nous progressions ensemble. Cette pratique, qui pose de vrais problèmes de transparence et d’équité, n’est en effet pas saine du point de vue budgétaire !

J’aborde brièvement un autre sujet : celui des zonages.
Madame la ministre, je m’efforce depuis des années, avec d’autres, de faire évoluer le zonage des aides à l’habitat et à la construction. Le critère actuellement retenu est celui de la pression locative existante, donc de la longueur des listes d’attente des organismes de logement. Il ne tient aucun compte ni du coût du foncier, ni de celui des constructions, ni du niveau des loyers.
Autrement dit, nous avons depuis plusieurs décennies, sous tous les gouvernements, sanctuarisé un système qui crée de profondes iniquités.
Je demande de nouveau, solennellement cette année, que l’on puisse revoir cette question. Qui croira que les salariés des grandes stations de sport d’hiver – notamment les enfants du pays – peuvent s’y loger à des prix comparables à ceux qui sont pratiqués dans les Landes, en Corrèze ou en Lozère ? Personne !

M. Michel Bouvard. Je conclus, madame la présidente. Les dispositifs actuels de zonage sont vecteurs d’iniquité et d’inefficacité.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des finances, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier Mme Estrosi Sassone, dont le rapport remarquable fait au sein de notre commission des affaires économiques a permis que nous ayons un bon débat sur le sujet.
Le secteur d’activité de la construction et du logement reste malmené, malgré les tentatives faites pour revenir sur les effets désastreux de la loi ALUR et autres textes d’encadrement du secteur de la construction et du logement.
Dans un environnement déjà atone, le nombre de logements autorisés a reculé, entre juillet 2014 et juillet 2015, de 4, 2 %, et le nombre de chantiers engagés de 1, 2 %.
Le logement privé et le logement intermédiaire sont au point mort ; seul le logement social, produit à grand renfort d’argent public et de stigmatisation des communes carencées, se maintient à un rythme de construction d’environ 120 000 logements par an.
Votre politique du logement s’est cristallisée, depuis 2012, autour du seul logement locatif social, alors que nos territoires ont fortement besoin d’un parc de logements diversifié, et que le financement du logement social a l’inconvénient de reposer sur un pilotage difficile à suivre des aides à la pierre et des aides à la personne.
L’article 56 du projet de loi de finances prévoit la création d’un fonds national des aides à la pierre.
Ce nouveau fonds va notamment se substituer au fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux, créé par la loi du 18 janvier 2013.
Ce fonds avait pour mission de gérer les pénalités majorées des communes carencées, celles-ci devant être reversées – c’est ainsi que le dispositif nous avait été présenté – soit aux EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, soit aux EPF, les établissements publics fonciers, des territoires concernés.
Les collectivités ont ainsi perdu le bénéfice de cette manne, sans disposer d’aucune visibilité sur son utilisation effective.
En réalité, cette ponction du budget des communes carencées justifie avant tout le désengagement de l’État du financement des opérations de logement, au détriment des organismes d’HLM et des collectivités territoriales.
Au titre des aides à la pierre, la communauté urbaine de Perpignan, en 2015, recevra seulement 1 200 000 euros de crédits de paiement au lieu des 2 200 000 euros contractualisés. Cela va obliger notre collectivité à assurer, pour le compte de l’État, l’avance des demandes de paiement des organismes, afin de ne pas les mettre en difficulté en termes de trésorerie.
L’État est en train de reproduire avec les collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre ce qu’il a déjà fait avec les organismes d’HLM : il n’honore pas ses engagements financiers.
En résumé, il serait donc opportun – nous en sommes convenus en commission des affaires économiques – de lancer une évaluation des mécanismes de financement du logement social, celui-ci reposant de plus en plus sur d’autres acteurs que l’État.
Nous assistons désormais, sur nos territoires, à une multiplication du nombre de logements sociaux sans locataires. Les copropriétés ne peuvent plus être entretenues, et les collectivités n’ont plus les moyens de financer la construction et l’entretien des équipements publics, écoles, réseaux de transport et d’assainissement.
Nous sommes également confrontés à une désertification et donc à une dégradation de l’habitat dans les centres-villes, au profit de logements sociaux neufs situés en périphérie, qui coûtent cher à la collectivité publique.
Le financement de l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, n’est pas sécurisé, et de nombreux projets de réhabilitation devront être reportés.
Sur la seule communauté urbaine de Perpignan, les dossiers qui ne pourront être financés en 2015, faute de crédits de l’ANAH, représentent un montant total de près de 500 000 euros, alors même que la plupart des projets s’inscrivent dans le périmètre du futur programme de renouvellement urbain de notre centre-ville.
Les dispositions de ce projet de budget ne sont pas à la hauteur des difficultés que rencontrent tant les collectivités que les organismes d’HLM pour faire face à leurs besoins.
La politique du logement doit être repensée en tirant la leçon des erreurs commises dans l’élaboration des textes, tous plus dogmatiques qu’efficaces, votés ces dernières années.
Nous devons abandonner la politique de la punition au profit d’une politique de la construction et de la réhabilitation du patrimoine existant.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Gatel applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits alloués pour 2016 aux trois actions du programme 177, « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », s’élèvent à 1, 44 milliard d’euros. Ils sont en hausse de 6 % par rapport à la loi de finances pour 2015 et continuent donc d’augmenter, comme chaque année depuis 2012.
L’action 11, Prévention de l’exclusion, a pour objet les allocations et prestations d’aide sociale versées aux personnes âgées et handicapées, ainsi que les actions de prévention et d’accès au droit. Ses crédits augmentent de 1, 3 million d’euros par rapport au budget précédent.
L’action 12, Hébergement et logement adapté, représente 95 % des crédits du programme 177. Ses crédits augmentent également – de 69 millions d’euros –, ce qui permettra de financer un total de 103 500 places d’hébergement, soit plus de 10 000 places supplémentaires en un an.
Les crédits de l’action 14 « Conduite et animation des politiques de l’hébergement et de l’inclusion sociale », passent de près de 16 millions à 10 millions d’euros.
Toutefois, cette baisse s’explique en grande partie par le transfert budgétaire du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire, le FONJEP, vers le programme 163 « Jeunesse et vie associative ».
J’attire tout particulièrement votre attention sur deux orientations fortes de l’action 12.
En 2016, l’État sera mobilisé pour répondre au défi des migrations, avec l’objectif de créer 5 000 places de logement adapté pour les réfugiés et 1 500 places d’hébergement d’urgence pour les personnes sans solution sur le territoire national.
Il s’agit bien de sincérité budgétaire, contrairement à ce qu’a dit tout à l’heure M. le rapporteur spécial !
Par ailleurs, le plan triennal 2015-2017 de réduction du recours aux nuitées hôtelières sera poursuivi cette année, avec le développement de solutions alternatives.
L’objectif sur trois ans est de remplacer 10 000 nuitées hôtelières par la création de 2 500 places d’hébergement d’urgence pour les familles, de 9 000 places en intermédiation locative et de 1 500 places en pensions de famille.
Ces augmentations sensibles de crédits risquent cependant d’être insuffisantes.
Je tiens de ce point de vue, mes chers collègues, à relayer l’inquiétude des acteurs de terrain, qui accompagnent nos collectivités territoriales dans l’aide à l’insertion des personnes vulnérables.
Je connais bien ces acteurs, que nous avons auditionnés dans le cadre de la commission des affaires sociales : le SAMU social, la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs, la Croix-Rouge, les Restos du cœur, ATD Quart Monde, la FNARS – Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale –, l’Union sociale pour l’habitat. J’en profite pour saluer leur travail remarquable.
Chaque année, les crédits votés en loi de finances initiale au titre du programme 177 se révèlent insuffisants, et font l’objet d’une réévaluation en loi de finances rectificative.
Au regard du 1, 5 milliard d’euros finalement engagé en 2015, les crédits prévus pour 2016 me paraissent insuffisants.

Je rappelle que 3, 5 millions de personnes sont mal logées en France, dont 140 000 sans domicile – un quart d’entre elles ont moins de 30 ans.

Ces crédits sont calculés pour répondre au mieux à l’urgence de la situation actuelle. Toutefois, ils ne permettent pas d’offrir le minimum à de nombreuses familles de nos banlieues et des territoires isolés, et notamment aux milliers d’enfants hébergés.
En outre, ils ne nous donnent pas les moyens d’anticiper les prochaines migrations de réfugiés politiques et climatiques, à propos desquelles des réponses doivent être apportées à l’échelle européenne.
J’appelle donc le Gouvernement à poursuivre et à amplifier sa politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en vue de renforcer l’égalité des territoires.
Malgré les inquiétudes dont j’ai fait part, je vous invite à voter en faveur des articles du projet de loi de finances 2016 relevant du programme 177 concernant l’hébergement, le parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le logement constitue une priorité pour nos concitoyens, peut-être même la priorité des priorités.

Il représente en effet leur premier poste de dépenses, et grève très souvent lourdement leur pouvoir d’achat.
Chacun ici considère que le droit de vivre dans la dignité, c’est avant tout le droit au logement. L’État – quelle que soit l’orientation politique du Gouvernement – doit donc se donner les moyens d’élever la politique du logement au rang de priorité nationale.
C’est aujourd’hui, madame la ministre, en tout cas depuis que vous êtes en charge de ce poste, votre priorité et nous savons combien votre engagement est total.
D’ailleurs, je me réjouis que la construction reparte. Les derniers chiffres sont positifs.
Mme la ministre opine.

Madame la ministre, dans ce secteur, entre la prise de décision et le résultat, il faut des mois, souvent des années.
Mme la ministre acquiesce.

La complexité et l’éparpillement de la politique du logement ont longtemps nui, et continuent de nuire à son efficacité. Son coût est estimé à 40 milliards d’euros, soit presque 2 % du produit intérieur brut national. De ce point de vue, la France fait des efforts importants, mais il en faut souvent plus. Il y a urgence, car 3, 5 millions de nos concitoyens sont encore considérés comme « mal-logés ».
Faciliter l’acte de construire, c’est aussi un moyen de développer l’économie.
L’acceptabilité du poids de cette dépense publique par le contribuable dans un contexte budgétaire contraint implique de concentrer les efforts sur ceux qui en ont le plus besoin.
Nous le savons – on le constate depuis des décennies, quel que soit le gouvernement –, c’est d’abord l’absence de vision prospective et de réelle politique d’aménagement du territoire qui est souvent à l’origine des difficultés actuelles et des déséquilibres entre l’offre et la demande de logements. Le besoin de logements ne remonte pas à 2015, ni même à 2012 ; c’est malheureusement le résultat de décennies d’absence d’une politique d’aménagement du territoire suffisante. Nous connaissons les débats – certains y ont fait référence tout à l’heure – entre secteurs tendus et détendus. Il est peut-être urgent d’essayer de faciliter l’arrivée de populations dans des territoires et des départements où il n’y a pas suffisamment d’habitants, au lieu de les concentrer toujours au même endroit.

J’en viens à la construction des logements.
Nous constatons actuellement, je l’ai indiqué, une reprise des mises en chantier. À ce stade de l’année, nous avons dépassé la barre des 350 000 logements. C’est une très bonne nouvelle, mais, vous le savez, cela demeure encore insuffisant pour faire face à l’accroissement de la démographie. Il faut donc poursuivre l’effort entrepris.
Les normes de construction – nous en avons souvent parlé ici –, les délais et les contentieux renchérissent encore le coût de la construction. Le rapport pour avis de la commission des affaires économiques fait état de 30 000 logements bloqués pour ces raisons. C’est encore beaucoup trop ! C’est l’un des véritables chantiers sur lesquels le Parlement peut agir.
Les freins doivent être levés si l’on veut relancer l’emploi dans un secteur fragile et encore en difficulté. Il convient de poursuivre les actions en ce sens pour parvenir à enrayer la crise de l’offre de logement. Ce n’est pas facile, nous le savons.
Je retiendrai deux des caractéristiques principales des crédits de la mission « Égalité des territoires et logement » : la lisibilité et l’efficience.
En matière de lisibilité, j’évoquerai la création d’un fonds national des aides à la pierre ou le transfert de l’allocation de logement familiale au sein de la présente mission, dont le financement était auparavant assuré par la branche famille de la sécurité sociale.
À ce titre, la réforme des aides personnelles au logement, qui représentent 18, 2 milliards d’euros, constitue un impératif pour concentrer les efforts sur ceux qui en ont le plus besoin et cibler plus efficacement les ménages les plus précaires.
C’est le sens de la prise en compte du patrimoine des bénéficiaires dans le calcul du revenu fiscal de référence à partir d’un seuil de 30 000 euros. La dégressivité des aides au-delà d’un loyer plafond permettra de contrer en partie les effets inflationnistes.
Madame la ministre, nous devons veiller à ne pas pénaliser certains ménages en difficulté ou à réduire le fort effet redistributif de ces aides pour des économies qui pourraient être mineures.
L’efficacité sociale de ces aides constitue donc l’un des chantiers sur lesquels nous devons poursuivre notre réflexion dans les années à venir, dans l’objectif de contenir une dépense qui ne cesse de progresser.
Dans ce budget, il y a des moyens de lutter contre la fraude aux aides personnalisées au logement, les APL. À mon sens, c’est important, notamment pour des raisons d’équité. Un amendement de la commission a pour objet la remise d’un rapport visant à étudier la création d’une base de données interministérielle relative au logement ; un tel document nous éclairerait sur l’utilité du dispositif.
L’accession à la propriété progresse ; elle doit être favorisée – c’est l’un de vos objectifs fondamentaux –, en particulier pour les jeunes. Nous soutenons pleinement l’élargissement des critères d’octroi du prêt à taux zéro intervenus avant et pendant l’examen du projet de loi de finances. Nous pouvons, me semble-t-il, saluer l’action que vous avez menée à cet égard.
Enfin, je tiens à saluer la hausse des crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ». Je pense que c’est une bonne chose.
Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE votera avec conviction les crédits de la mission « Égalité des territoires et logement ».
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste et républicain.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur spécial, madame, monsieur les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, il nous revient d’examiner les crédits de la mission budgétaire « Égalité des territoires et logement ».
Je souhaite vous exposer les grandes lignes et les évolutions de la politique que le Gouvernement mène en matière de logement et d’hébergement. Mon propos me permettra également d’apporter quelques éléments de réponse aux interrogations qui ont été soulevées.
Dans l’ensemble de ses composantes, mon ministère est doté d’un budget à la hauteur des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour relancer la construction, aider les ménages à se loger et assurer l’hébergement des plus fragiles.
Un an après la présentation du plan de relance, les chiffres de la construction commencent à se redresser. Bien entendu, nos efforts doivent se poursuivre. La reprise des ventes se confirme, ce qui montre la bonne adaptation des mesures prises dans le cadre du plan de relance. Les ventes des promoteurs progressent ainsi de 18 % au troisième trimestre 2015 par rapport au troisième trimestre 2014. Les permis de construire et les mises en chantier sont repartis à la hausse depuis le début de cette année ; et je remercie M. Mézard de l’avoir rappelé.
Nous savons l’importance du logement parmi les préoccupations de nos concitoyens ; cela a été évoqué. Mais les problématiques se posent différemment selon les territoires. Nous devons donc adapter certains de nos dispositifs, et telle est bien notre volonté.
Ainsi, nous avons choisi de refonder le financement du logement social, afin de le pérenniser et de le sécuriser.
Pour ce faire, nous créons un fonds national des aides à la pierre, qui bénéficiera d’une gouvernance paritaire, entre l’État et les bailleurs sociaux ; je m’y engage devant vous. Le montant de ces aides s’élève à 500 millions d’euros.
Conformément aux engagements pris par le Président de la République, lors du dernier congrès de l’Union sociale pour l’habitat, l’USH, au mois de septembre dernier à Montpellier, le Gouvernement a déposé et fait adopter à l’Assemblée nationale un amendement visant à porter sa participation à 250 millions d’euros en 2016. Je peux vous confirmer une nouvelle fois que celle-ci sera maintenue à un niveau substantiel en 2017. Il est donc inexact de parler de « désengagement de l’État », comme j’ai pu l’entendre à plusieurs reprises aujourd'hui.
Par ailleurs, j’ajoute que le financement du logement social ne se limite pas aux subventions de l’État. Il faut également y ajouter 4 milliards d’euros d’aides fiscales, principalement le taux réduit de TVA à 5, 5 %, l’exonération d’impôt sur les sociétés ou l’abattement de taxe foncière, ainsi que les financements des collectivités et d’Action logement.
J’évoquerai maintenant le livret A. Outre la baisse du taux, la diminution de la rémunération des banques, annoncée par le Président de la République au congrès de l’USH, créera une enveloppe d’environ 200 millions d’euros, qui sera redistribuée aux bailleurs, sous forme de bonifications d’intérêts dès l’année prochaine, …
… selon des modalités en discussion avec les acteurs du secteur, notamment le mouvement HLM.
D’une manière générale, notre politique en direction du logement social doit être confortée pour renforcer la mixité sociale dans nos villes et nos quartiers. Quinze ans après l’adoption de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », il m’apparaît indispensable de repenser les outils pour que ce texte soit mieux appliqué et que la mixité sociale progresse concrètement dans notre pays.
Un projet de loi est en préparation, qui devrait être déposé au Parlement au premier trimestre de l’année 2016. Il portera sur la production de logements sociaux, sur leur attribution, ainsi que sur la politique des loyers.
Je souhaite également aborder l’hébergement, objet du programme 177.
Vous le savez, depuis plusieurs mois, notre pays doit faire face à l’accueil de réfugiés fuyant des zones de guerres. Nous engagerons donc 279 millions d’euros pour accueillir 30 000 personnes supplémentaires au cours des deux prochaines années.
Cet effort n’obérera nullement celui qui est réalisé en direction des personnes en situation de grande précarité. Je le rappelle, entre 2012 et 2015, nous sommes passés de moins de 82 000 à plus de 110 000 places pérennes d’hébergement. De nouveaux crédits viennent d’ailleurs d’être ouverts en 2015 pour l’hébergement de ces publics, qui, je tiens à le redire très clairement ici, n’entrent pas en concurrence avec les réfugiés. Cela a, au contraire, permis de prévoir plus de 13 000 places mobilisables pour faire face aux besoins supplémentaires d’hébergement cet hiver.
Ce rappel était nécessaire, car j’entends certains s’escrimer à tenter de faire croire le contraire et d’opposer les uns aux autres. Ce n’est pas acceptable.
Comme M. le rapporteur pour avis l’a rappelé, j’ai lancé au mois de mars dernier un plan triennal pour réduire le recours aux nuitées hôtelières, afin de sortir de la gestion d’urgence et d’encourager les solutions de substitution, notamment par l’intermédiation locative, avec 9 000 places prévues.
Ces modes d’hébergement sont non seulement mieux adaptés pour mettre en place un parcours de réinsertion, mais également moins coûteux. Vous avez été plusieurs à souligner la dynamique des crédits d’hébergement et la difficulté à provisionner les crédits suffisants.
Cependant, je tiens à préciser que l’État consent un effort exceptionnel pour 2016, en augmentant les crédits de ce programme de 160 millions d’euros, dont 90 millions d’euros étaient prévus dans le texte initial et 70 millions d’euros ont été ajoutés à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement par l’Assemblée nationale.
Le projet de loi procède également à une réforme des APL, à la suite des propositions du groupe de travail présidé par François Pupponi et réunissant des députés de toutes sensibilités politiques.
Comme je vous y invitais l’an dernier lors du débat sur les APL accession, votre commission des finances a demandé à la Cour des comptes un rapport sur ce sujet, qui a nourri la réflexion du Gouvernement. Nous nous sommes également appuyés sur un rapport d’inspection, qui vous a été transmis sous la forme d’une revue de dépenses.
Au final, le Gouvernement a retenu trois mesures, qui vont dans le sens d’une plus grande équité dans le calcul des aides.
Monsieur le rapporteur spécial, tout en saluant ces propositions, vous souhaitez que nous allions plus loin. En l’occurrence, vous proposez l’instauration d’un taux d’effort minimal. Je dois vous le dire, cette proposition ne me semble pas opportune ; son adoption conduirait à pénaliser les ménages les plus modestes qui habitent dans le parc social, notamment les familles monoparentales et les familles nombreuses.
Je suppose que nous aurons l’occasion d’aborder plus largement le sujet lors de l’examen de l’article 55, qui maintient l’APL accession. En effet, nous avons fait le choix de renforcer résolument l’accession à la propriété.
En effet, si la vente de logements neufs est en progression de 18 % au troisième trimestre, l’accession reste encore trop faible et diminue même en Île-de-France.
Face à ce constat, nous avons décidé de consolider et d’amplifier les dispositifs de relance que nous avions mis en place. Ainsi, les critères d’octroi du prêt à taux zéro seront élargis pour rendre ce prêt encore plus efficace et permettre à davantage de ménages modestes d’accéder à la propriété, notamment les jeunes.
Dans le neuf, nous souhaitons, notamment, relever le plafond de revenus pris en compte, porter la quotité empruntée à taux zéro jusqu’à 40 % de l’opération et augmenter le différé d’amortissement à cinq ans au moins pour toutes les tranches de revenus.
Dans l’ancien, nous élargirons à toute la France le bénéfice du prêt à taux zéro, sous condition de travaux de réhabilitation à hauteur de 25 % du prix d’achat. Un amendement au présent projet de loi de finances a été adopté en ce sens par l’Assemblée nationale et un décret est en préparation pour la mise en œuvre de cette mesure dès le 1er janvier 2016.
Un autre moteur de la construction est le dispositif d’investissement locatif intermédiaire. En vigueur depuis un an, il connaît un succès certain et a besoin de stabilité ; les professionnels sont unanimes sur ce point. Pour répondre à votre question, monsieur Bouvard, j’indique que cette stabilité concerne également le zonage qui y est associé et que nous avons corrigé en août 2014, alors qu’il n’avait pas changé depuis une dizaine d’années.
Les mesures du plan de relance de la construction que nous avons engagé feront l’objet d’un comité de pilotage, réunissant prochainement les acteurs du logement. Il visera à s’assurer de leur bonne diffusion et à suivre les effets de ce plan sur la construction et sur les prix. C’est une question que vous avez soulevée, madame la sénatrice Lienemann : les aides publiques doivent bénéficier immédiatement et directement aux ménages.
Afin de favoriser la rénovation énergétique pour les ménages et les copropriétés, le crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, et l’éco-prêt à taux zéro sont reconduits. Vous le savez aussi, la meilleure manière de lutter contre les effets inflationnistes consiste à instaurer des conditions permettant une offre suffisante sur chaque segment du marché immobilier.
C’est l’objet même du plan de relance, conduit par le Gouvernement, qui agit sur tout le parcours résidentiel – je sais que ce sujet vous tient particulièrement à cœur, madame la sénatrice. Je constate à ce jour que l’augmentation des ventes s’accompagne d’une maîtrise des prix et que l’ensemble des professionnels s’accordent pour saluer la bonne adaptation des mesures et des dispositifs que nous mettons en œuvre.
J’ai d’ailleurs obtenu la semaine dernière des engagements des banques et des professionnels pour développer la distribution de l’éco-prêt à taux zéro auprès des ménages modestes et des copropriétés. En la matière, les résultats étaient insuffisants.
Pour mener notre politique, l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, est un opérateur précieux, et nous agissons pour pérenniser son action sur le plan à la fois environnemental et social.
J’ai entendu les craintes exprimées par plusieurs d’entre vous sur ce point. Aussi, je veux vous rassurer sur le fait que le budget de l’ANAH sera sanctuarisé l’année prochaine. L’agence contribuera ainsi à la rénovation de plus de 78 000 logements, dont 50 000 avec amélioration énergétique grâce au programme « Habiter mieux », pour lequel le ministère de l’écologie accentuera son soutien financier.
Au total, dans ce projet de loi de finances, les dépenses de mon ministère en matière de logement et d’hébergement s’élèveront à 18 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 14 milliards d’euros au titre des dépenses fiscales.
Voilà très rapidement brossées les grandes orientations de la mission, et plus largement de notre politique.
Elles nous permettent, d’une part, d’accélérer le plan de relance de la construction et de favoriser la rénovation et, d’autre part, de mieux accompagner les parcours résidentiels et les projets de vie de nos concitoyens. J’aurai l’occasion, mesdames, messieurs les sénateurs, de compléter mon propos dans le cadre du débat interactif et spontané et au cours de l’examen des articles rattachés.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures vingt, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq.