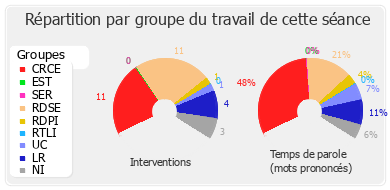Séance en hémicycle du 10 mai 2011 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (projet n° 361, résultat des travaux de la commission n° 488 rectifié, rapport n° 487 et avis n° 477).
Mes chers collègues, je vous rappelle que la commission des affaires sociales, lors de sa réunion du 3 mai dernier, a rejeté le texte résultant de ses travaux.
En conséquence, et en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion porte sur le texte adopté par l’Assemblée nationale et transmis par le Gouvernement.

Sur les conditions d’application de l’article 42 de la Constitution, précisément, monsieur le président.

Nous vivons une situation inédite, au demeurant susceptible de se reproduire : le texte qui vient en discussion en séance publique est non celui de la commission, mais celui qui résulte des travaux de l’Assemblée nationale.
Ce matin, la commission des affaires sociales s’est réunie et a désigné un nouveau rapporteur. Celui-ci a-t-il fait un rapport ? Je l’ignore, mais je ne doute pas que la réponse ne soit affirmative ; lui-même nous le confirmera certainement tout à l’heure.
La commission a procédé ensuite à l’examen des amendements et en est arrivée, me dit-on, jusqu’à la fin de l’article 1er. D’après ce que j’ai pu lire, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion demain matin, à neuf heures trente, en vue d’examiner la suite des amendements. Or les services du Sénat ont fixé au lundi 9 mai, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance. Nous nous trouvons donc dans une situation originale, qui voit la discussion d’un texte commencer alors que tous les amendements n’ont pas été examinés par la commission.

La commission parviendra-t-elle, demain matin, à achever l’examen des quelque 500 amendements ? Nul ne le sait.
Dans ces conditions, monsieur le président, deux questions se posent.
La première a trait à notre ordre du jour. Nous sommes convoqués en séance publique cet après-midi, ce soir et cette nuit. Or, je le répète, la commission doit se réunir demain matin à neuf heures trente. Dans ces conditions, quid de la séance de nuit ? De toute façon, nous ne pourrons pas aller au-delà de l’article 1er.
La seconde question porte sur le délai limite pour le dépôt des amendements en séance. Je vous demande, monsieur le président, de prolonger ce délai, car enfin, il est absolument ubuesque que, alors même que la commission n’a pas encore examiné tous les amendements, nous ne puissions plus en déposer. Il conviendrait au moins de prolonger ce délai jusqu’à la fin de la discussion générale, comme cela se faisait avant la réforme constitutionnelle.
Tel est le sens de mon rappel au règlement, monsieur le président.
M. Jean-Louis Carrère applaudit.

Monsieur Michel, je vous donne acte de ce rappel au règlement, à propos duquel je souhaite apporter quelques précisions.
Tout d’abord, ce ne sont pas les services du Sénat qui ont fixé au lundi 9 mai, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance sur le présent projet de loi. C’est la conférence des présidents, organe rassemblant, je le rappelle, les vice-présidents du Sénat, les présidents de groupes politiques et de commissions, ainsi que moi-même, bien sûr, qui en a décidé ainsi lors de sa réunion du 6 avril dernier. À cette date, à l’évidence, elle ne pouvait pas savoir si la commission parviendrait ou non à élaborer un texte. C’est généralement ainsi que cela se passe, et la situation actuelle n’a donc rien d’exceptionnel au regard de la prévisibilité de nos travaux.
Marques de scepticisme sur certaines travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Ou bien la commission élabore et publie un texte, auquel s’appliquent alors les amendements examinés en séance, ou bien elle n’élabore pas de texte, et les amendements portent sur le texte adopté par l’Assemblée nationale et transmis par le Gouvernement, ce qui est le cas en l’espèce.
Autrement dit, la décision de la conférence des présidents s’applique quelle que soit l’issue des travaux de la commission. Cela vaut d’une manière générale, car c’est nécessaire pour que nos travaux se déroulent de manière ordonnée.
Au surplus, lors de sa réunion du 4 mai dernier, la conférence des présidents a confirmé le délai limite alors même qu’elle avait connaissance de la décision de rejet du texte de la commission, et il était alors évident que les amendements porteraient sur le texte adopté par l’Assemblée nationale. C’est le cas des 481 amendements déposés par les sénateurs et les groupes politiques, montrant que ces derniers avaient une claire conscience de la situation.
J’en viens, mon cher collègue, au second point de votre intervention qui peut se résumer ainsi : jusqu’où la discussion peut-elle aller, en l’état actuel des travaux de la commission ? J’ai bien noté qu’il y avait un peu plus de 180 amendements déposés sur le seul article 1er. En l’occurrence, cela laisse à la commission le temps nécessaire pour examiner la suite…
Enfin, je rappelle que, en coordination avec le Gouvernement, le président de séance – j’échangerai quelques mots sur ce point avec celui qui me succédera à ce fauteuil – peut, à tout moment, en liaison avec la commission et sa présidente, décider les interruptions nécessaires pour permettre à nos travaux, sur un sujet très important, de se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.
Sourires

Je ne peux qu’adhérer à ce qui vient d’être dit. Cela étant, monsieur le président, il faut que nous puissions travailler autrement.
Pour participer aux réunions de la conférence des présidents, je connais fort bien le contexte dans lequel nous avons décidé de cet ordre du jour et des conditions du travail en séance.
Compte tenu de l’évolution du dossier, qui aurait pu imaginer que les travaux de la commission s’achèveraient sans qu’un texte soit voté et que nous discuterions le texte du Gouvernement ?
Non, c’est le texte de l’Assemblée nationale.

C’est révélateur de la différence des points de vue qui peuvent s’exprimer sur le sujet puisque la majorité, à un moment donné, a désavoué Mme la présidente-rapporteur, contraignant la commission des affaires sociales à désigner à la hâte, ce matin, un nouveau rapporteur.
Nous n’avons pas intérêt, selon moi, à continuer à travailler de cette manière, car cela discrédite d’une certaine façon le travail parlementaire, même si nous sommes un certain nombre à attacher beaucoup d’importance au travail en commission.
À force d’accélérer l'examen des textes et de raccourcir les délais, nous sommes soumis à des conditions de travail proprement insoutenables. Je ne veux pas anticiper, mais je crois savoir que nous allons être une nouvelle fois appelés à siéger en session extraordinaire au mois de juillet et que celle-ci se poursuivrait au-delà du 14 juillet.
Contraindre les parlementaires à travailler dans de telles conditions, n’est-ce pas les traiter avec une sorte de mépris ? Voilà ce que, au nom de mon groupe, je tenais à dire.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, monsieur Fischer.
Nous en venons maintenant à la discussion générale.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui est soumis à votre examen vise à renforcer les droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et à mieux individualiser leur prise en charge, notamment par la création de soins ambulatoires sans consentement.
Il s’agit aussi, avec ce texte, d’empêcher que l’institution judiciaire ait, à très brève échéance, à relever un redoutable défi. En effet, dans sa décision du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a donné au législateur jusqu’au 1er août 2011 pour mettre notre législation en conformité avec la Constitution et, à défaut, toutes les mesures d’hospitalisation sans consentement – d’office ou à la demande d’un tiers – en cours feront l’objet d’une mainlevée automatique.
Je veux, en cet instant, insister sur les conséquences fâcheuses qui s’attacheraient à tout retard dans l’adoption de ce projet de loi.
Je veux aussi rappeler que la question prioritaire de constitutionnalité est l’une des innovations introduites par la réforme de la Constitution adoptée en 2008. Chaque jour qui passe montre combien cette réforme est protectrice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Je pense donc que, chaque jour, ceux qui ont « oublié » de la voter nourrissent des regrets amers. Ce n’est pas M. Mézard, ici présent, qui me contredira !
Sourires
Nouveaux sourires.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis donc fondé à vous reprocher de ne pas l’avoir votée !
Nouveaux sourires.
Le volet judiciaire du projet de loi vise à mettre le droit français en parfaite conformité avec les exigences constitutionnelles. Que requiert donc la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 ? Elle indique que, en application de l’article 66 de la Constitution, il est nécessaire d’instaurer un contrôle systématique des mesures d’hospitalisation sans consentement par le juge judiciaire, « gardien des libertés individuelles ».
L’occasion nous est ainsi une nouvelle fois donnée de constater l’efficience de la révision constitutionnelle de 2008. Je me permets de souligner au passage que le texte qui vous est soumis aujourd’hui est, de par son ampleur, comparable à celui portant sur la réforme de la garde à vue. Il aboutit à la création d’une nouvelle procédure permettant de garantir de façon systématique les droits des patients.
Le projet de loi prévoit ainsi un contrôle de plein droit du juge dans les quinze jours suivant l’admission du patient en hospitalisation complète. Il apporte une garantie supplémentaire en imposant que, après ce premier contrôle, le juge judiciaire intervienne de six mois en six mois, aussi longtemps que s’applique la mesure.
Ce nouveau dispositif, qui renforce notablement la protection des droits et libertés des patients par rapport à la situation actuelle, est pleinement conforme aux exigences constitutionnelles.
En instaurant ce contrôle systématique, nous marquons un véritable progrès. Cependant, le nouveau dispositif exigera des juridictions un effort supplémentaire considérable, car ce sont près de 80 000 décisions juridictionnelles nouvelles par an qui sont à prévoir. Pour permettre la mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions possibles, j’ai d’ailleurs obtenu du Premier ministre la création de 80 emplois de magistrats et de 70 emplois de greffiers, ainsi qu’une enveloppe complémentaire de 5 millions d’euros pour financer l’aide juridictionnelle.
À l’issue de la discussion à l’Assemblée nationale, nous sommes parvenus à un dispositif équilibré, respectueux de l’intérêt des patients et conforme aux exigences constitutionnelles. J’appelle votre attention sur cet équilibre et les risques que l’on ferait courir à la viabilité du dispositif de contrôle en voulant « toujours plus de juge », même là où son intervention n’est pas absolument nécessaire.
Gardons-nous de confondre les rôles en voulant faire jouer au juge celui de l’autorité administrative ou celui du médecin. La réforme ambitieuse que nous sommes en train de bâtir ensemble ne fonctionnera que si chacun remplit l’office qui lui revient : à l’autorité sanitaire la responsabilité des soins et de l’expertise médicale, à l’autorité administrative le maintien de l’ordre public, à l’autorité judiciaire la garantie des libertés individuelles.
Je veux insister sur ce que doit être, au sens des exigences constitutionnelles, l’office du juge dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, qu’il s’agisse de l’hospitalisation complète ou des nouvelles mesures de soins ambulatoires sans consentement.
S’agissant de l’hospitalisation complète sans consentement, le texte prévoit un dispositif de contrôle automatique qui permet à chacun des acteurs d’exercer ses prérogatives dans le respect des droits du patient.
Quel est ce dispositif ?
Le nouveau contrôle de plein droit dans les quinze jours de l’admission en hospitalisation sans consentement, puis, le cas échéant, tous les six mois tant que dure la mesure, permet au juge des libertés et de la détention de s’assurer de la proportionnalité de la privation de liberté que constitue l’hospitalisation complète. Par ce dispositif, nous mettons notre droit en pleine conformité avec les exigences de l’article 66 de la Constitution.
Le texte apporte des garanties procédurales supplémentaires en prévoyant que le juge statuera au terme d’un débat contradictoire et que tout patient qui ne serait pas en mesure de comparaître personnellement pourra être représenté par un avocat.
Le texte prévoit également que les audiences pourront se tenir par visioconférence si le patient y consent et si des motifs médicaux le justifient. Ce recours à la visioconférence, qui impliquera l’aménagement de salles spécifiques au sein des hôpitaux, nous permettra de pallier certaines difficultés pratiques évidentes. Il s’agit, d’une part, de permettre au juge de statuer dans les délais extrêmement courts qui lui sont impartis pour décider du maintien en hospitalisation complète, alors même que le juge des libertés et de la détention, en raison de son caractère polyvalent, ne sera pas en charge de ce seul contentieux, et, d’autre part, de répondre à la difficulté d’amener les malades dans les tribunaux.
Je suis tout à fait conscient que certaines pathologies sont incompatibles avec la tenue d’une visioconférence et que le déplacement des malades est parfois impossible. C’est pourquoi la proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois, M. Jean-René Lecerfde prévoir un certificat médical pour la visioconférence et l’utilisation de ces salles spécifiques pour la tenue d’audiences foraines a retenu mon attention. Toutefois, il appartiendra, bien sûr, au juge de décider en dernier ressort.
On le voit, cette nouvelle procédure judiciaire va profondément modifier les pratiques des tribunaux et des hôpitaux et justifiera une mobilisation de tous pour faire en sorte que cette réforme soit, au 1er août prochain, un succès.
Je suis sûr que les professionnels impliqués dans la présente réforme feront les mêmes efforts. Nous leur donnons des moyens.
Il faut aussi que le Parlement garde la bonne mesure des choses.
Cette mobilisation de tous à laquelle nous appelons sera, nous n’en doutons pas, à la hauteur de l’importance de cette réforme.
Sachons maintenant ne pas en faire trop en demandant aux juges de prendre des décisions qui ne relèvent pas de leur office. Aucune autorité ne doit ni ne peut se substituer à une autre : le juge n’a pas plus vocation à se substituer à l’autorité administrative qu’il n’a vocation à intervenir dans le champ des autorités sanitaires.
C’est la raison pour laquelle il ne m’apparaît pas souhaitable que le juge puisse, lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, ordonner des soins ambulatoires. Ce serait dévoyer le rôle du juge. En effet, nous sommes ici dans une matière civile et non pénale : les personnes hospitalisées ne sont pas des délinquants : ce sont des patients.
Le juge civil n’aurait pas les moyens d’assurer le suivi des soins qu’il ordonnerait, alors que le juge pénal dispose, lui, des services d’insertion et de probation pour effectuer le suivi des personnes concernées. Prévoir une telle mesure reviendrait à demander au juge d’ordonner une obligation de soins sans moyen de la contrôler ou de la sanctionner, ce qui n’est pas acceptable.
Confier au juge une telle mission, ce serait en outre oublier que le juge n’a aucune légitimité pour arbitrer entre les très nombreuses modalités de soins auxquelles peut concrètement renvoyer un programme de soins. Et l’on ne saurait envisager que le juge doive se borner à ordonner des soins sans en définir les modalités précises ni être en mesure d’apprécier le degré d’atteinte aux libertés qu’elles impliquent.
Aller dans cette direction imposerait au juge de recourir dans tous les cas à une expertise et de s’en remettre en pratique à ses conclusions, ce qui ne saurait être satisfaisant. Comment, en effet, ne pas rappeler la lourde tâche qui est déjà confiée aux experts psychiatres, dont le nombre trop réduit ne permettrait pas de faire face à cette nouvelle mission, qui reviendrait à leur demander, dans des délais très contraints, de proposer, le cas échéant, un protocole de soins ? En outre, le risque que le juge ne puisse obtenir ces expertises dans les délais impartis lui imposerait de prendre une décision non éclairée, ce qui n’est pas davantage acceptable.
C’est, enfin, pour des raisons du même ordre que je ne peux a fortiori que vous inviter à refuser toute extension systématique de l’intervention du juge aux nouvelles mesures de soins ambulatoires sans consentement.
Un programme de soins sans consentement n’a pas vocation à conduire à l’exercice d’une contrainte physique à l’égard du patient. Il ne s’agit pas de soins forcés, à la différence de l’hospitalisation complète. L’intervention automatique du juge, dès lors, n’apparaît pas nécessaire. Pour autant, cela ne veut pas dire que les patients concernés n’auront pas accès au juge : le recours au juge restera toujours possible à la demande du patient ou de ses proches, selon des modalités qui ont été clarifiées et simplifiées par le décret du 20 mai dernier.
Le projet de loi prévoit donc des garanties proportionnées à chaque situation et permet à chacun des acteurs, médicaux, administratifs et judiciaires, de rester dans son rôle, avec un recours juridictionnel systématique pour l’hospitalisation complète, selon les modalités que j’ai évoquées à l’instant, et un recours juridictionnel facultatif pour les soins ambulatoires sans consentement.
Un tel équilibre procédural assure la garantie effective des droits des patients, tout en leur permettant de bénéficier des soins les plus adaptés à leur situation.
Je crois par ailleurs qu’en permettant à la fois la saisine du juge administratif pour apprécier la légalité externe des mesures de placement et celle du juge judiciaire telle que je viens de la décrire, le système français offrira des garanties fortes en matière de protection des droits et libertés. Unifier les deux contentieux au profit du juge des libertés et de la détention ne serait pas incohérent. Toutefois, une telle unification risquerait d’alourdir l’office du juge judiciaire et, alors qu’il est appelé à statuer dans des délais très contraints, de le détourner de sa mission qui est d’apprécier la proportionnalité de la privation de liberté au regard de la situation médicale du patient.
Ce n’est pas sans raison que l’on parle d’un surcroît de charge pour les magistrats. Une étude que nous avons réalisée montre bien que, même si la situation varie à l’évidence d’une juridiction à l’autre, le travail sera considérable lorsque la juridiction compte dans son ressort un nombre relativement important d’hôpitaux psychiatriques. Par exemple, pour Paris, il faut s’attendre à 6 522 affaires supplémentaires, soit vingt-cinq affaires de plus par jour ! Cela représente quelque vingt-cinq heures additionnelles de temps-magistrat et douze heures et demie de temps d’audience supplémentaire ! On voit donc le poids d’une telle réforme sur une juridiction aussi importante.
La situation sera à peu près la même à Lyon puisqu’il y a trois hôpitaux psychiatriques dans le ressort du tribunal de grande instance. Ensuite, viennent plusieurs tribunaux qui ont un ou deux hôpitaux psychiatriques dans leur ressort.
Je pense aussi aux petits tribunaux qui se trouvent dans un secteur abritant une grosse structure pénitentiaire et un établissement psychiatrique important, et où un magistrat unique est à la fois juge de l’application des peines et juge des libertés et de la détention.
Vu l’effort considérable que nous allons demander aux magistrats, un concours exceptionnel de recrutement a été lancé.
M. Guy Fischer s’exclame.
Monsieur Fischer, vous pouvez concourir, si vous voulez !
Sourires
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’objectif du Gouvernement est clair et peut, me semble-t-il, être partagé par tous : il s’agit de renforcer les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et de permettre de mieux individualiser les soins pour mieux répondre à chaque situation.
Que certains aspects du texte méritent d’être amendés, clarifiés, cela ne fait aucun doute. D’ailleurs, le Gouvernement lui-même vous proposera des amendements. Toutefois, en ce qui concerne le rôle du juge, je tiens à renouveler mon appel à la prudence et à l’équilibre.
Il nous appartient de créer une procédure entièrement nouvelle. La garantie des droits des patients s’en trouvera considérablement renforcée et la seule existence d’un contrôle de plein droit du juge entraînera de fait une diminution des abus, lorsqu’ils existent ; je songe en particulier aux sorties d’essai, qui durent fréquemment plusieurs années et dans le cadre desquelles aucun suivi n’est garanti.
Il s’agit là d’une véritable révolution et je crains que, en la complexifiant outre mesure et en faisant du juge ce qu’il n’est pas – il n’est ni médecin ni préfet –, nous ne mettions en danger la réforme elle-même, qui s’imposera de toute façon à tous au 1er août prochain.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je me suis limité à aborder le volet strictement juridique du texte. Je laisse à Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé, le soin d’évoquer les autres aspects de ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP ainsi que sur plusieurs travées de l’Union centriste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi vise certains points précis de la réforme des soins psychiatriques.
C’est un texte qui porte sur un domaine particulièrement sensible non seulement sur le plan médical et technique, mais également aussi, j’en ai bien conscience, sur le plan humain.
Je tiens à remercier la présidente de la commission des affaires sociales, Mme Muguette Dini, ainsi que son rapporteur, M. Jean-Louis Lorrain, de même que l’ensemble de ses membres, du travail qu’ils ont déjà effectué. Nous avons bien entendu les interrogations et les inquiétudes qui se sont exprimées en commission. Nous sommes prêts à apporter, au cours de ce débat, toutes les réponses à ces interrogations, qui sont absolument légitimes.
Le projet de loi que vous allez examiner porte une réforme attendue depuis une quinzaine d’années par les professionnels de la psychiatrie, mais aussi par les patients et leurs familles.
Ce texte concerne les patients qui souffrent de troubles mentaux sévères, ce qui rend impossible leur consentement aux soins.
Vous le savez, les troubles mentaux touchent un cinquième de la population française. En 2008, ce sont 1, 3 million de personnes adultes qui ont été prises en charge à ce titre, dont 70 % exclusivement en ambulatoire. Sur ce nombre total de personnes souffrant d’une maladie mentale, chaque année, pour environ 70 000 d’entre elles, soit seulement 5 % des malades, leurs troubles rendent impossible leur consentement aux soins.
Il me paraît important de rappeler, alors que s’ouvre l’année des patients et de leurs droits, que toute atteinte à leur liberté ne peut être motivée que par des raisons liées à leur état de santé, comme l’a rappelé Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Quelles sont les raisons qui nous conduisent à engager cette réforme ?
L’accueil des malades psychiatriques selon des modalités spécifiques, et notamment quand ils ne peuvent pas consentir aux soins, a été prévue dès 1838 par la loi obligeant tous les départements de France à construire un établissement spécialisé dans l’accueil des malades psychiatriques. C’est pourquoi ces établissements sont bien connus et identifiés par l’ensemble de nos concitoyens.
Il aura fallu attendre 1990 pour réformer cette loi, pour prévoir que l’hospitalisation libre est la règle et pour que l’hospitalisation sous contrainte devienne une exception, dûment motivée et encadrée. Néanmoins, cette loi de 1990 n’a pas résolu tous les problèmes, comme l’ont démontré différents rapports : elle ne permet pas d’offrir aux malades qui ne peuvent pas consentir aux soins les formes contemporaines de prise en charge, notamment extrahospitalières ; elle n’a pas non plus permis de résoudre le cas des personnes qui doivent être hospitalisées, mais pour lesquelles aucun proche ne peut en faire la demande.
Ce projet de loi ne remet pas en question les fondements du dispositif actuel, qui permet une prise en charge soit à la demande d’un tiers, le plus souvent un membre de la famille, soit sur décision du préfet. Mais il comble les lacunes de la loi de 1990 que je viens d’évoquer concernant la prise en charge ambulatoire et l’hospitalisation sans demande d’un tiers. Il comprend aussi des avancées substantielles, telles que l’intervention du juge des libertés et de la détention, afin de répondre à la décision du Conseil constitutionnel.
M. le garde des sceaux vient de le rappeler, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé, le 26 novembre dernier qu’« en prévoyant que l’hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, les dispositions relatives au maintien en hospitalisation sur demande du tiers méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution ».
Le Conseil Constitutionnel nous donne donc jusqu’au 1er août pour corriger la loi actuelle.
L’un des objectifs majeurs de ce texte consiste à remplacer la notion d’hospitalisation par celle de « soins ». En effet, ce sont bien les soins qui sont nécessaires à un malade, et non pas le fait d’être placé dans un hôpital psychiatrique. Il appartiendra au médecin d’adapter précisément ces soins aux besoins du malade, en privilégiant toujours la recherche d’une alliance thérapeutique entre le patient et lui.
Je rappelle que les soins psychiatriques peuvent suivre diverses modalités : il peut s’agir d’entretiens, d’ateliers thérapeutiques, de traitements médicamenteux. Ces soins, qui sont souvent conjugués, peuvent avoir lieu dans des services hospitaliers fermés, mais aussi, si l’état du patient le permet, au plus près de son lieu de vie : ce peut être le centre médico-psychologique, le foyer, la rue, la maison de retraite.
Vous le savez, les médecins, dans leurs pratiques quotidiennes, cherchent déjà à offrir des soins ambulatoires aux patients qui ne peuvent consentir à ces soins. Ils utilisent pour cela le dispositif de la sortie d’essai. Cependant, la sortie d’essai telle qu’elle est prévue dans la loi de 1990 est un simple « essai de sortie », après une longue hospitalisation. Ce n’est donc pas une forme de prise de charge ; il n’y a pas de programme de soins défini. Il nous faut donc bien combler cette lacune.
Nous souhaitons que les médecins puissent proposer à leurs malades un véritable programme de soins à l’extérieur de l’hôpital, comme une forme de prise en charge pleine et entière, et non pas comme un sas entre l’hospitalisation et la vie ordinaire. Le texte permet ainsi au médecin de prescrire des soins extérieurs dès le début de la prise en charge, c’est-à-dire à l’issue d’une période d’observation de 72 heures, sans avoir besoin d’enclencher une longue hospitalisation. Le médecin définira avec son patient un programme de soins, ce que nous appelions jusqu’à présent le « protocole de soins ».
Le programme de soins précisera le type de la prise en charge, les lieux de traitement et la périodicité des soins.
Cette avancée majeure permettra de mieux définir le rôle de chacun, patient et équipe soignante, en affirmant la place centrale du médecin : il restera le seul à même de modifier le programme de soins du malade.
Notre texte rénove d’autres aspects de la loi de 1990 et met ainsi en œuvre les préconisations des différents rapports d’évaluation de cette loi. C’est le cas de la période d’observation et de soins de 72 heures que nous proposons d’instaurer, et qui est demandée par les professionnels depuis le rapport Strohl de 1997.
Il s’agit d’éviter au maximum les hospitalisations sans consentement, en apportant au patient des soins psychiatriques intensifs au moment de la crise. Au bout de trois jours, bien souvent, les psychiatres parviennent à obtenir le consentement de la personne : elle va mieux, comprend la nécessité de poursuivre des soins et s’engage d’elle-même dans une démarche thérapeutique, à l’hôpital ou en ambulatoire. Cette période de 72 heures donne donc davantage de chances aux patients d’éviter qu’une mesure de contrainte trop longue ne soit enclenchée à leur encontre.
S’agissant des patients dont le consentement est encore trop fragile à l’issue de ces trois jours, qui peuvent être soignés à l’extérieur mais qui ont besoin d’un étayage particulier, le psychiatre pourra désormais leur proposer une prise en charge en ambulatoire avec un programme de soins.
Le projet de loi apporte enfin une réponse au sujet douloureux des personnes isolées, qui ont absolument besoin de soins psychiatriques mais pour lesquelles aucun tiers ne se présente pour formuler une demande. Les médecins, les équipes soignantes nous le disent : nombre de personnes atteintes de maladies psychiatriques chroniques ont perdu tout lien avec leur famille et leurs proches. Les psychiatres voudraient bien les soigner mais, sans demande formulée par un tiers, ils n’ont pas le droit de leur porter secours, ce qui est très pénible pour un médecin. Vous le savez, les équipes passent beaucoup de temps à rechercher ces tiers.
Nous avons entendu les professionnels et avons donc prévu que le directeur de l’établissement pourrait prononcer l’admission d’un patient, même lorsqu’il n’est pas possible de recueillir la demande d’un proche. Cette possibilité est limitée au seul cas de péril imminent pour la santé du patient et elle est entourée de garanties particulières en termes de respect des droits. Il s’agit d’une mesure essentielle, qui permettra à toutes les personnes dont l’état de santé est très grave, aussi ténu que soit le tissu social dans lequel elles s’insèrent, d’accéder aux soins psychiatriques.
De la même façon, nous rendons possible le fait qu’un psychiatre s’oppose à la demande de levée d’hospitalisation formulée par un tiers. Il arrive en effet qu’une personne soit hospitalisée sans son consentement pour des troubles mentaux graves, mais que le directeur mette fin à cette hospitalisation parce qu’un proche du malade en fait la demande En application de ce projet de loi, pour éviter une rupture de soins qui serait dangereuse pour le patient, le psychiatre pourra s’opposer à cette demande.
C’est donc bien l’accès aux soins et la continuité des soins psychiatriques que le projet de loi renforce.
L’accès aux soins sera également amélioré grâce à une disposition introduite par l’Assemblée nationale, concernant les personnes en situation d’urgence psychiatrique. Vous connaissez bien ces situations, mesdames, messieurs les sénateurs : il arrive qu’une famille vous appelle parce que son enfant est en pleine crise psychiatrique, et il faut intervenir immédiatement. Qui intervient ? Qui transporte ce jeune vers l’établissement de santé ? Certains territoires ont imaginé des réponses coordonnées.
Le projet de loi impose que les acteurs locaux – hôpitaux, SAMU, services départementaux d’incendie et de secours, police, gendarmerie –, sous l’égide de l’agence régionale de santé, définissent entre eux une organisation adaptée, afin de répondre à toutes ces situations, quel que soit l’endroit du territoire de santé où il faut intervenir.
Outre qu’il renforce les droits et libertés des patients, le projet de loi apporte un soin particulier à la situation de certains patients atteints de troubles très spécifiques, pour lesquels les dangers liés à une rechute apparaissent plus sérieux. Il s’agit des patients qui sont ou ont été hospitalisés d’office, soit pour irresponsabilité pénale, ce qui est le cas des auteurs d’un crime dont le discernement était totalement aboli au moment des faits, soit en unité pour malades difficiles, ou UMD.
L’Assemblée nationale a souhaité que ces antécédents ne soient pas recherchés sur la vie entière du patient, mais seulement sur une durée qui sera fixée par décret en Conseil d’État.
Pour ces patients, dont le nombre est extrêmement limité, une procédure particulière sera enclenchée lorsque leur sortie est envisagée. En effet, l’avis du psychiatre traitant devra être accompagné de l’avis d’un collège pluriprofessionnel de soignants – psychologues, infirmiers, assistant social – et de deux expertises. Le préfet disposera ainsi d’informations tout à fait complètes et étayées et pourra prendre dans de meilleures conditions cette décision qui est particulièrement sérieuse.
J’insiste sur le fait que, pour ces patients comme pour tous les autres, les certificats proposant des prises en charge extrahospitalières ou des levées de mesure devront être établis par un psychiatre.
Le psychiatre est la personne centrale dans ce dispositif : c’est lui qui propose de lever l’hospitalisation ; c’est lui qui propose le programme de soins et qui le définit ; c’est encore lui qui demande, le cas échéant, la ré-hospitalisation ou la fin des soins.
L’Assemblée nationale a d’ailleurs confirmé ce rôle essentiel du psychiatre en instaurant une saisine automatique du juge des libertés et de la détention si le préfet ne donne pas suite à la demande du psychiatre de mettre fin à l’hospitalisation d’une personne.
Enfin, vous le savez, ce projet de loi vient répondre à une question prioritaire de constitutionnalité. Le bien-fondé des hospitalisations complètes sans consentement, dès lors que leur durée excède quinze jours, puis six mois, sera désormais soumis au contrôle systématique du juge des libertés et de la détention. Dans ces intervalles, et à tout moment, la personne peut recourir au juge ; il s’agit du recours « facultatif », au moment où le patient en ressent la nécessité. La saisine automatique est une mesure exceptionnelle. Elle porte sur une privation de liberté d’aller et venir qui est, elle-même, exceptionnelle.
Le Gouvernement a fait le choix de ne pas prévoir cette saisine automatique pour les autres formes de prise en charge, qui ont lieu en ambulatoire. En effet, il importe tout d’abord que la procédure soit plus légère en extrahospitalier qu’en intrahospitalier, sauf à décourager les psychiatres de prescrire des soins à l’extérieur, dont on sait qu’ils sont plus difficiles à organiser. De plus, le patient suivi en ambulatoire est présumé aller mieux que le patient hospitalisé et être davantage capable de saisir le juge en cas de besoin.
Je souligne aussi que ce juge, le patient le connaîtra, puisqu’il l’aura rencontré au quinzième jour de son hospitalisation : il sera donc plus aisé pour le patient de le saisir à nouveau. D’autres personnes peuvent également signaler au juge une situation qui apparaîtrait anormale, et la commission départementale des soins psychiatriques, la CDSP, continue d’être chargée de vérifier le bien-fondé de mesures qui pourraient sembler disproportionnées.
En outre, si les soins apparaissent trop pesants pour ce patient, il est fort probable que celui-ci aura rompu son programme de soins et sera retourné en hospitalisation complète, où il verra donc un juge sous quinze jours.
Enfin, et surtout, il serait incompréhensible pour nombre de patients qu’on leur impose un transport vers le juge alors qu’ils respectent leur programme de soins et que tout se passe bien.
Faudra-t-il aller chercher les patients chez eux pour les amener chez le juge ? La saisine automatique pour les patients qui ne sont pas enfermés à l’hôpital nous semble aller à l’encontre du respect des droits et libertés de ces personnes, sans apporter de véritable garantie supplémentaire. En effet, si le patient estime que son programme de soins est excessif, il doit avant tout en parler avec son médecin et l’équipe soignante qui le suit.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi sur lequel vous allez vous pencher aujourd’hui est essentiel, tout d’abord, pour garantir à tous les malades un meilleur accès aux soins. La psychiatrie française peut désormais franchir le pas qu’ont franchi ses voisins européens. Elle peut résolument se tourner, comme l’ont fait la chirurgie ou la médecine, vers la prise en charge ambulatoire pour l’ensemble des personnes qui en ont besoin. Elle peut offrir à tous des formes de soins psychiatriques modernes, dans tous les lieux de la cité, des soins qui permettent aux patients de rester, au maximum, insérés dans leur communauté.
La psychiatrie française peut leur offrir cette qualité des soins. Elle a été l’une des premières à s’ouvrir vers l’extérieur avec la politique de secteur.
Le projet de loi s’inscrit dans l’évolution que les psychiatres ont eux-mêmes donnée à leur pratique.
Il apporte des garanties supplémentaires au bénéfice de l’ensemble des acteurs concernés en mettant au cœur du dispositif le psychiatre et l’équipe soignante, avec pour seul but d’assurer l’accès aux soins, la continuité de ceux-ci, l’alliance thérapeutique, la protection des personnes et le respect des libertés.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP ainsi que sur plusieurs travées de l’Union centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui est particulièrement important, car il concerne la situation de personnes parmi les plus fragiles, celles qui souffrent de troubles mentaux.
Lorsqu’on aborde ce sujet, nous devons avoir à l’esprit trois impératifs essentiels qu’il nous faut concilier : la nécessité de donner au malade les meilleurs soins possibles afin de favoriser sa guérison ou, au moins, l’amélioration de son état de santé ; l’obligation de ne limiter la liberté des personnes que dans des proportions strictement nécessaires, pour éviter qu’elles ne nuisent à elles-mêmes ou qu’elles nuisent à autrui ; enfin, la préservation de la sécurité des personnes, parfois menacée par le comportement de certains malades.
Une réforme de la loi de 1990 est attendue depuis longtemps. Elle a été préconisée par de nombreux rapports depuis 1997, rapports dont le texte qui nous est soumis reprend de nombreuses propositions.
D’emblée, je souhaite saluer le travail accompli par Mme Dini en qualité de rapporteur. Ce travail important et approfondi a permis à chacun de nous de faire mûrir sa position, afin que nous puissions chercher tous ensemble les moyens de construire une réforme équilibrée.
Pour ma part, monsieur Fischer, j’ai le sentiment d’être un rapporteur à temps plein et pleinement responsable, et j’entends tenir complètement ce rôle dans un débat qui touche à un domaine auquel je suis amené à m’intéresser depuis une trentaine d’années, ne serait-ce qu’en tant qu’élu.
Dès à présent, il me faut souligner que cette loi serait vaine si elle n’était pas accompagnée des moyens nécessaires pour la mettre en œuvre et de mesures ambitieuses pour l’organisation de la psychiatrie et de la santé mentale dans notre pays.
Madame la secrétaire d'État, nous attendons avec impatience le plan de santé mentale que vous êtes en train de préparer. Nous espérons qu’il répondra aux attentes des malades et de leurs familles, ainsi qu’à celles de tous les intervenants en psychiatrie.
Ce plan est nécessaire et urgent : il est le complément indispensable du projet de loi dont nous débattons aujourd’hui.
Quelles sont les principales dispositions de celui-ci ?
En premier lieu, le projet de loi se donne pour objectif de diversifier les formes de prise en charge des malades faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement.
Alors qu’actuellement une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que sous la forme d’une hospitalisation complète, le projet de loi tend à dissocier le principe de l’obligation de soins et les modalités de dispensation de ces soins. Un régime de « soins sans consentement » est ainsi substitué au régime de l’hospitalisation sans consentement.
Les modes de prise en charge alternatifs à l’hospitalisation complète incluraient obligatoirement des soins ambulatoires ; ils pourraient également prendre la forme de soins à domicile ou de « séjours » effectués dans un établissement psychiatrique.
En cas de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète, un « protocole de soins » serait établi dans les 72 heures de l’admission du malade par un psychiatre de l’établissement. Ce protocole définirait le ou les types de soins imposés au malade, les lieux de leur réalisation, ainsi que leur périodicité.
Dans tous les cas, la prise en charge d’un malade sans son consentement débuterait par une période d’observation et de soins de 72 heures sous la forme d’une hospitalisation complète. Au cours de cette période, deux certificats médicaux devraient évaluer la nécessité de la mesure de soins sans consentement : le premier serait établi dans les 24 heures suivant l’admission, le second dans les 72 heures.
Le texte prévoit que, lorsque les certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, un psychiatre de l’établissement propose, dans un avis motivé, la forme de prise en charge du malade et, s’il envisage une forme de prise en charge alternative à l’hospitalisation complète, le protocole de soins applicable.
En cas d’admission à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement aurait compétence pour retenir la forme de prise en charge proposée par le psychiatre ainsi que le protocole de soins établi par celui-ci. En cas d’admission sur décision du représentant de l’État, le préfet aurait compétence pour décider de la forme de prise en charge en tenant compte de la proposition établie par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
En deuxième lieu, pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le projet de loi modifie les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention contrôlera les mesures de soins sans consentement.
La saisine du juge est prévue dans deux cas : d’abord, comme cela se pratique déjà actuellement, sur l’initiative de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement ou d’autres personnes intéressées, aux fins d’ordonner la levée de cette mesure ; ensuite, et cela de façon obligatoire, sur l’initiative du directeur de l’établissement ou du préfet, aux fins de contrôler de plein droit la nécessité du maintien de toute mesure de soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète.
Le juge devrait obligatoirement statuer sur l’hospitalisation sans consentement d’une personne, avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de son admission en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, puis tous les six mois lorsque le patient est maintenu en hospitalisation complète.
Le texte prévoit que le juge statue après débat contradictoire et que l’audience peut avoir lieu en utilisant la technique de la visioconférence.
Les ordonnances du juge pourraient faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et cet appel pourrait revêtir un caractère suspensif si le juge ordonnait la mainlevée de l’hospitalisation.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a prévu une saisine obligatoire du juge des libertés lorsque le préfet refuse de faire droit à une demande de levée de soins psychiatriques émanant du psychiatre.
En troisième lieu, le projet de loi met en place des procédures particulières pour la sortie des soins sans consentement des personnes ayant été déclarées pénalement irresponsables ou ayant fait un séjour en UMD.
L’article 1er prévoit la création d’un collège de soignants composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement : un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre n’y participant pas et un membre de l’équipe pluridisciplinaire. Ce collège devrait se prononcer avant la levée des soins sans consentement des personnes concernées.
En outre, deux expertises devraient obligatoirement être réalisées par des psychiatres extérieurs à l’établissement d’accueil.
L’Assemblée nationale a complété ce dispositif pour prévoir la fin de l’application de celui-ci cesse après une certaine durée, durée dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Enfin, le projet de loi contient plusieurs autres mesures d’importance.
Il crée une nouvelle procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent, qui pourrait être mise en œuvre sans la demande d’un tiers. Cette nouvelle voie d’accès aux soins pourrait notamment concerner les personnes isolées ; elle pourrait également être utilisée dans des situations où la demande d’hospitalisation est particulièrement difficile à formuler pour les membres de la famille.
Le projet de loi renforce le droit à l’information des personnes recevant des soins sans leur consentement.
Il procède à une réécriture des dispositions du code de la santé publique relatives à l’hospitalisation sans consentement des détenus, sans toutefois en modifier le contenu.
Les autres dispositions du projet de loi sont de moindre importance et visent à opérer des coordinations ou à prévoir son application outre-mer.
Mes chers collègues, ce projet de loi n’est certainement pas parfait, mais il me semble que notre tâche consiste précisément à rechercher les moyens de l’améliorer et de renforcer sa cohérence : c’est cet exercice que nous devons essayer d’accomplir ensemble.
Ce matin, la commission a donné de nombreux avis sur divers amendements et ces avis ne sont pas tous compatibles entre eux.

Sur le point le plus délicat de ce texte, à savoir les soins psychiatriques sans consentement hors de l’hôpital, je comprends parfaitement toutes les objections qui peuvent être soulevées. L’expression même de « soins psychiatrique sans consentement hors de l’hôpital » paraît d’ailleurs contradictoire dans les termes. Il me semble cependant que nous pouvons rechercher les voies et moyens d’une amélioration plutôt que de renvoyer à plus tard l’introduction de ce concept.
Vous le savez, mes chers collègues, sans l’intervention du Conseil constitutionnel, nous n’aurions probablement pas été saisis de ce texte : il faut profiter de l’occasion qui nous est donnée pour accomplir un travail de modernisation de la psychiatrie attendu depuis longtemps. En ce début du XXIe siècle, il est normal que les modes de prise en charge des patients évoluent et il est souhaitable que, lorsque l’hospitalisation est évitable, ces derniers puissent être accompagnés dans leur milieu habituel. C’est pourquoi nous ne pouvons renvoyer ce travail à plus tard, sauf à risquer de ne jamais l’accomplir.
Notre collègue Alain Milon a présenté un amendement tout à fait utile qui clarifie des points importants.
Cet amendement précise tout d’abord qu’une personne faisant l’objet de soins sans son consentement est prise en charge par tous les outils thérapeutiques de la psychiatrie adaptés à son état ; je souscris à cette proposition.
Il fait référence – proposition à laquelle je souscris également – non plus à des formes de soins mais à des lieux de soins, en distinguant les unités d’hospitalisation à temps plein des autres lieux de soins que sont les unités alternatives, les lieux de consultation, les lieux d’activités thérapeutiques et le lieu de vie habituel du patient, liste à laquelle j’ajouterai même : la rue.
Enfin, il remplace la notion de « protocole de soins » par celle de « programme de soins », qui me paraît beaucoup plus adapté, car la notion de protocole semble un peu trop rigide.
À titre personnel, je vous proposerai, mes chers collègues, de sous-amender l’amendement de M. Milon pour le compléter et apporter de nouvelles précisions.
D’abord, je suis profondément convaincu qu’il ne faut plus parler de « soins sans consentement » mais de « soins psychiatriques auxquels une personne n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux ». Cela revêt à mes yeux une très grande importance. Le soin, c’est le dialogue, …

… et la confusion se fait entre la nécessité de l’obligation et des modalités de sa mise en œuvre. Ce changement marque mieux qu’il faut distinguer entre l’obligation qui est faite au patient de se soigner et les modalités des soins qui seront, bien sûr, discutées entre le psychiatre et le malade.
En outre, je vous proposerai de mieux préciser les conditions de modification du programme de soins et de prévoir un entretien entre le psychiatre et le malade, entretien au cours duquel le médecin recueillera l’avis du patient.
Enfin, le sous-amendement que j’ai préparé prévoit aussi que le détail des traitements médicamenteux ne figurera pas sur le programme de soins.
J’espère que cette nouvelle rédaction apaisera les inquiétudes et qu’elle permettra d’avancer dans la recherche d’un vrai consensus sur cette réforme.
Sur les autres dispositions du projet de loi, des améliorations sont également possibles. Ainsi, la commission a donné un avis favorable sur un amendement qui modifie la composition du collège chargé de donner un avis avant la levée de l’hospitalisation des patients ayant séjourné en UMD ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale. Il paraît préférable que l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle soit dans ce collège, et non un seul de ses membres, afin d’assurer une véritable collégialité. Ce point fera certainement l’objet d’une discussion.
De même, la commission a accepté des amendements qui visent à fixer à dix ans le délai du droit à l’oubli à l’issue duquel la procédure d’examen renforcée n’est plus applicable aux patients qui ont été déclarés irresponsables ou ont séjourné en UMD.
Monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je forme le souhait que nos débats permettent de faire progresser la réflexion et de dégager des solutions attendues, notamment par les malades et leurs familles.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées de l ’ Union centriste et du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, notre assemblée est saisie du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, déposé le 5 mai 2010 à l’Assemblée nationale.
Ce projet de loi a été complété par une lettre rectificative du 26 janvier 2011, qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010, prise à la suite du renvoi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a distingué les conditions d’admission à l’hospitalisation sans consentement et le maintien de cette hospitalisation.
Il a estimé conformes à la Constitution les conditions d’admission au motif que, si son article 66 exige que toute privation de liberté individuelle soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il n’impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté.
Pour ce qui concerne le maintien de l’hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la question suivante : le rôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, impose-t-il que, au-delà d’une certaine durée, la privation de liberté ne puisse être prolongée sans décision de l’autorité judiciaire ? Il y a répondu par l’affirmative, rappelant les exigences constitutionnelles selon lesquelles la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge judiciaire intervient dans le plus court délai possible et établissant la nécessité absolue d’un contrôle juridictionnel de plein droit des décisions de maintien en hospitalisation sans consentement.
Dès lors, deux questions se sont posées quant aux délais.
Sur le délai nécessitant l’intervention d’une autorité judiciaire, le Conseil constitutionnel a estimé que celui de 48 heures applicable en matière de garde à vue n’était pas transposable à l’hospitalisation sans consentement. Prenant en compte la spécificité de la problématique médicale, il a retenu en l’espèce un délai de quinze jours.
Sur le délai dans lequel le juge judiciaire doit statuer, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation pour imposer les plus brefs délais.
Enfin, considérant qu’une abrogation immédiate des dispositions du code de la santé publique jugées inconstitutionnelles emporterait des conséquences manifestement excessives au regard des exigences de la protection de la santé et de la prévention des atteintes à l’ordre public, il a reporté au 1er août 2011 la date de mise en conformité avec la Constitution.
Dans une certaine mesure, mes chers collègues, et sans chercher à faire un mauvais jeu de mots, je dirai que nous délibérons, nous aussi, sous la contrainte… §

Ce sont les décisions du Conseil constitutionnel ! Et les questions prioritaires de constitutionnalité sont tout de même un acquis considérable au regard des libertés.
C’est l’article 62 de la Constitution !

Devant l’étroite imbrication des questions de santé et des questions juridiques, et contrairement à la commission des lois de l’Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat a souhaité se saisir pour avis du volet judiciaire du présent projet de loi, c'est-à-dire essentiellement des articles 1er à 5.
Cette saisine lui est apparue nécessaire en raison des nombreux points qui intéressent directement son champ de compétence. Je citerai les libertés individuelles et les garanties juridictionnelles qui s’attachent à leur privation, les modalités de contrôle de l’autorité judiciaire – visioconférence, délais d’intervention, possibilités d’appel suspensif –, l’impact de la réforme sur l’organisation judiciaire, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ou la protection de l’ordre public.
Mes chers collègues, je profite de l’opportunité qui m’est offerte pour regretter que, à propos de nombreux textes récemment examinés par le Parlement, il n’y ait pas eu plus souvent une appréhension partagée entre justice et santé. Je pense, par exemple, à la loi pénitentiaire, dont la discussion n’a pas permis d’examiner à fond les problèmes relatifs à la santé, qu’elle soit somatique ou psychiatrique.

Je pense aussi à la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, dont j’étais coauteur et dont le rapporteur était Jean-Pierre Michel, adoptée à l’unanimité par le Sénat et qui finira bien, un jour, par être examinée par l’Assemblée nationale.

Vous le savez, l’hospitalisation sous contrainte est régie par un droit ancien et stable : c’est la loi Esquirol de 1838 qui a distingué le régime du placement volontaire, à la demande de la famille, et celui du placement d’office, confié au préfet. Elle n’a été modifiée qu’en 1981 par la loi Sécurité et liberté, puis surtout en 1990 par la loi Évin. Celle-ci a certes consacré le droit des personnes hospitalisées contre leur gré, mais elle a conservé les deux modes d’hospitalisation sans consentement prévus par la loi de 1838 : le placement d’office est remplacé par l’hospitalisation d’office et le placement volontaire cède la place à l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Actuellement, sur les 80 000 hospitalisations contraintes – la moitié est prononcée pour schizophrénie – que l’on dénombre chaque année dans notre pays, 63 000 ont lieu à la demande d’un tiers et 17 000 sont décidées d’office.
Le projet de loi réforme le droit de l’hospitalisation sous contrainte, en cherchant à concilier trois principes de même valeur, mais qui sont parfois largement antagonistes : le droit à la protection de la santé, la sécurité des personnes, les libertés individuelles.
Il ouvre une solution alternative à l’hospitalisation complète en faisant de l’enfermement une modalité de soins parmi d’autres. L’objectif est d’adapter la loi à l’évolution des soins psychiatriques et des thérapeutiques désormais disponibles, qui permettent à de nombreux patients d’être pris en charge par des soins ambulatoires, c'est-à-dire extrahospitaliers, encadrés.
Comme de nombreux collègues de la commission des lois, je suis plutôt favorable à l’extension des soins obligatoires sous contrainte, tout en rappelant qu’ils exigeront des moyens adaptés.
Le dispositif, si fréquemment critiqué, de la sortie d’essai est supprimé. Les personnes internées sous contrainte seront placées en observation pour un délai maximal de 72 heures en hospitalisation complète ; deux certificats médicaux de psychiatres devront alors établir s’il faut poursuivre les soins et déterminer la nature de ces derniers.
Dans le présent projet de loi a été retenu le choix de ne pas recourir systématiquement au juge judiciaire pour les soins ambulatoires sous contrainte : l’intervention du juge est donc obligatoire pour l’hospitalisation complète, mais facultative pour les soins ambulatoires.
Le texte qui nous est soumis prévoit un dispositif spécifique applicable à certaines personnes susceptibles de commettre des actes graves de violences : celles qui ont été reconnues pénalement irresponsables et qui font ou ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office judiciaire ; celles qui font ou ont fait l’objet d’une hospitalisation en UMD. Dans ces cas, les sorties seront plus encadrées ; le juge des libertés et de la détention devra recueillir l’avis d’un collège de soignants et, s’il envisage la mainlevée de l’hospitalisation complète, ordonner une expertise judiciaire supplémentaire. Le préfet ne pourra mettre fin à l’hospitalisation d’office judiciaire qu’après avis d’un collège de soignants et deux avis concordants sur l’état médical du patient émis par deux psychiatres étrangers à l’établissement d’hospitalisation.
Par ailleurs, ce texte encadre la notion de tiers susceptible de solliciter une hospitalisation contrainte. En contrepartie, il crée une nouvelle procédure : l’admission sans tiers, en cas de péril imminent.
S’agissant des conséquences sur l’organisation judiciaire, l’étude d’impact évalue le nombre de saisines nouvelles à 61 000 pour les juges des libertés et de la détention ; les besoins en termes d’emploi seraient de 77 à 80 magistrats, de 59 à 61 fonctionnaires de catégorie B et de 7 à 8 fonctionnaires de catégorie C.
Enfin, le texte prévoit que l’audience du JLD – juge des libertés et de la détention - pourra s’effectuer par visioconférence, dans des locaux adaptés de l’hôpital.
Les députés ont apporté plusieurs modifications au projet de loi.
Ils ont introduit un droit à l’oubli, c’est-à-dire le retour au droit commun pour les deux catégories de patients susceptibles de présenter un danger pour autrui, passé un délai de plusieurs années après la fin de leur hospitalisation.
L’Assemblée nationale a prévu une saisine automatique du JLD par le directeur de l’établissement d’accueil du patient lorsque le préfet n’ordonne pas la levée de l’hospitalisation complète alors que le psychiatre estime que cette hospitalisation n’est plus nécessaire.
Elle a également prévu que, lorsque le JLD ordonne la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète, sa décision prend effet dans un délai de 48 heures, afin que le psychiatre de l’établissement puisse, le cas échéant, établir un protocole de soins et que le patient puisse recevoir un traitement contraint sous forme de soins ambulatoires. La commission des lois s’interroge cependant sur la constitutionnalité d’une telle disposition puisqu’une personne demeurera contrainte pendant 48 heures alors que la décision de mainlevée aura été prononcée.
Au nom de la commission des lois, je vous proposerai d’étendre quelque peu la compétence du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles : en le dotant de la capacité de transformer une mesure d’hospitalisation complète en soins ambulatoires – je sais que M. le garde des sceaux ne partage pas mon point de vue, mais j’espère que nos échanges permettront d’aboutir à une solution consensuelle ; en prévoyant le contrôle de plein droit du JLD sur les mesures d’hospitalisation partielle sous contrainte ; enfin, en unifiant le contentieux de l’hospitalisation sous contrainte, par la création d’un bloc de compétence judiciaire.
Je vous proposerai également de permettre au juge de statuer dans des conditions garantissant la sérénité des débats, en prévoyant qu’il pourra se prononcer en chambre du conseil et non publiquement, mais aussi en prévoyant que la visioconférence sera adaptée à la situation des personnes malades, et j’ai bien noté l’accord de M. le garde des sceaux sur ce point.
Enfin, je vous proposerai d’envisager l’évolution, à terme, du statut de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
Monsieur le président, mes chers collègues, le Contrôleur général des lieux de privation des libertés, dans son rapport d’activité 2010, qui vient d’être rendu public, fait observer que, dans les établissements de santé, se pose avec acuité la question de l’équilibre entre les droits des personnes, les exigences du soin et les indispensables mesures de sécurité. Il note : « Cet équilibre n’est pas souvent réalisé de manière satisfaisante. » J’espère que le présent projet de loi marquera un progrès significatif sur cette question particulièrement sensible.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur plusieurs travées de l ’ Union centriste et du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous le savons, la maladie mentale est, pour des centaines de milliers de familles, un drame du quotidien qui justifie pleinement de lever nombre de tabous et, surtout, de trouver des moyens.
Quel équilibre difficile à instaurer entre maladie, soins, contrainte et liberté ! Or le présent projet de loi complexifie les procédures à tel point que je me suis demandé s’il ne relevait pas d’une pathologie juridique, c’est-à-dire d’une coupure de l’esprit, au sens d’une perte de contact avec la réalité.

Il suffit de se reporter au problème de la visioconférence ou à la multiplication des certificats médicaux, entre autres, pour s’en convaincre. Plus de règles, moins de droits !
Le projet de loi s’intitulant « Droits et protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et modalités de leur prise en charge », il devrait avoir pour finalité fondamentale les malades et ceux qui les soignent, sans être vicié par le volet sécuritaire et sa déclinaison médiatique. Notons de surcroît que, sans une décision du Conseil constitutionnel, il n’aurait jamais été examiné par le Sénat.
De ce choc de priorités antagonistes est né un texte qui a le triste privilège d’être rejeté tant par la majorité des psychiatres des hôpitaux que par les syndicats de magistrats. Son examen chaotique en commission des affaires sociales est d’ailleurs révélateur de ce rejet.
Alors que les troubles mentaux se classent aujourd’hui au troisième rang des maladies en termes de prévalence, la véritable urgence, nous le savons tous, est de lutter contre l’état catastrophique de ce secteur de santé et le manque dramatique de médecins psychiatres, en particulier dans les hôpitaux.
En 2008, déjà, la commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, avait déploré que la question de la maladie mentale ait été évoquée dans le débat public à propos de textes qui ont alimenté la confusion avec la délinquance, la violence et la dangerosité.
De mon côté, j’avais déjà eu l’occasion de souligner cet amalgame dangereux entre troubles psychiatriques et dangerosité lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale en cas de trouble mental.
Dans le projet de loi présenté aujourd’hui, la possibilité d’une décision prise sans le consentement de l’intéressé consacre l’entrée dans un système d’obligation de soins dont l’hospitalisation ne sera désormais qu’une des modalités envisageables et qui pourra comporter des soins ambulatoires sans consentement.
La dérogation au droit qu’a tout malade de consentir aux soins dont il fait l’objet ouvre un champ inédit dans la mesure où la contrainte pourra être exercée non seulement entre les murs de l’établissement, mais également hors ces murs, sans accroche territoriale, ce qui rend plus difficile le contrôle de la nécessité ou de la proportionnalité des mesures prises, ainsi que la sortie de cette situation d’exception.
Si, tel qu’il découle de la décision du Conseil constitutionnel, ce contrôle par le juge des libertés et de la détention nous semble pleinement correspondre à la mission de garantie des libertés individuelles que la Constitution assigne au juge, il est toutefois impératif de mettre en place les moyens nécessaires en termes d’effectifs et de formation.
Nous avons entendu les inquiétudes et mises en garde des professionnels : il apparaît clairement que de nombreuses dispositions de ce texte sont inapplicables et dangereuses, notamment celles qui concernent le transfert de l’ensemble des contentieux vers l’autorité judiciaire dès le mois de septembre 2012. Or la décision du Conseil constitutionnel contraint le législateur à judiciariser les soins sans consentement dès le 1er août 2011. Par ailleurs, si le ministère a annoncé le recrutement d’effectifs supplémentaires, ceux-ci ne rejoindront leurs juridictions que, au mieux, un an après l’entrée en vigueur de la loi. Il y aura donc manifestement un engorgement des prétoires, une asphyxie des juridictions de l’ordre judiciaire.
D’autres dispositions du projet de loi nous apparaissent inopportunes. Les prescriptions médicales pour les soins ambulatoires doivent demeurer déontologiquement indépendantes. Il serait dangereux d’instaurer une discrimination par des procédures spécifiques supplémentaires.
J’ajoute, mes chers collègues, que ce texte complique considérablement les procédures par l’entretien et le développement d’une dualité juridictionnelle, avec une prépondérance laissée à l’administratif, aux préfets, aux directeurs d’hôpitaux... On se demande d’ailleurs pourquoi vous n’y avez pas ajouté le « citoyen assesseur » ; cela viendra sans doute !
Sourires

De plus, les psychiatres hospitaliers doivent voir leur indépendance professionnelle garantie face à ce dispositif qui multiplie les certificats médicaux et les soumet aux instances administratives. Il faut en revenir à un système de nomination spécifique au niveau ministériel, indépendante des pouvoirs administratifs locaux, une indépendance qui leur a été sournoisement retirée par le décret statutaire d’octobre 2010, et qui est l’indispensable garant des libertés individuelles dans le domaine de l’hospitalisation sous contrainte.
En conclusion, nous souhaitons que ce texte se limite aux modifications de la législation actuelle découlant de la décision du Conseil constitutionnel, afin que nous prenions le temps d’élaborer, en concertation avec tous les acteurs, une réforme vraiment adaptée.
En effet, un tel dossier mériterait plus que d’autres un consensus profond, et nous attendons toujours un grand « plan santé mentale » équivalent au « plan cancer » ou au « plan Alzheimer », qui fasse enfin de la santé mentale un objectif prioritaire de santé publique. À nos yeux, ce texte ne répond pas à cet objectif et c'est pourquoi la majorité des membres du RDSE ne le votera pas.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
M. Bernard Frimat remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a tout juste un an, notre groupe organisait au Sénat un colloque sur le thème : « Psychiatrie : entre pressions sécuritaires et contraintes économiques, quelle place pour le patient ? »
La richesse des débats que nous avions eus alors m’autorise à affirmer ceci : le texte que nous examinons aujourd’hui n’est pas le texte qu’attendaient les malades et leurs familles, le texte qu’attendaient les médecins, le texte qu’attendaient les magistrats, le texte que nous attendions.
Lancé en novembre 2008 à la suite d’un fait divers, certes tragique, survenu à Saint-Égrève, dans l’Isère, selon la méthode habituelle de l’actuel Président de la République qui consiste à jouer sur l’émotion et les peurs, ce texte possède tous les attributs des lois « émotionnelles », des lois « d’affichage ». Il laisse de côté toutes les questions qu’un vrai projet de loi sur la psychiatrie et la santé mentale aurait dû aborder, pour ne conserver qu’une vision limitée, étriquée, bornée, de l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiatriques.
Il occulte en effet plusieurs faits essentiels. Si les questions liées aux troubles mentaux sont complexes, si nous ne pouvons taire les difficultés que rencontrent soignants, magistrats, proches, malades, et si les pouvoirs publics, particulièrement les maires, peuvent parfois se sentir démunis, il convient de rappeler quelques évidences.
Selon un rapport de l’IGAS de 2005, seuls 2, 7 % des actes violents sont commis par des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Notre collègue Guy Lefrand, député UMP, le dit lui-même dans le préambule de son rapport : « Les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont douze fois plus victimes d’agressions physiques, cent trente fois plus victimes de vols et ont vingt-cinq ans d’espérance de vie en moins que nos concitoyens. »
La brutalité de ces chiffres, qui démontrent que ces personnes sont bien souvent d’abord des victimes, se double d’une autre réalité : celle de la mise à mal de la psychiatrie publique, qui a notamment enregistré, en vingt ans, la suppression 40 000 lits ! Si l’on y ajoute les suppressions de postes, le recul de la sectorisation, l’abandon de la prévention, on comprend que les personnes les plus malades échappent aux soins. Comme me le disait un président de commission médicale d’établissement, dans l’hôpital psychiatrique public, c’est désormais la « lutte des places » !
Ce texte est-il à la hauteur de ce que nous devons aux personnes atteintes de troubles psychiatriques ?

Évidemment non, mes chers collègues ! Vous l’avez compris, nous pensons que ce texte sécuritaire va totalement à l’encontre de ce que nous sommes en droit d’attendre.
Manquant d’ambition, il est également flou, imprécis, opportuniste... Pour notre part, ce sont les raisons de fond qui nous avaient conduits, malgré certaines avancées réelles introduites par notre rapporteur Muguette Dini, à rejeter ce texte en commission.
Le Gouvernement avait pourtant annoncé la couleur. On nous parlait d’un triple objectif : un objectif de santé, un objectif de défense des libertés individuelles et un objectif de sécurité.
Disons-le clairement : en ce qui concerne l’objectif de santé, nous ne voyons rien. Rien en faveur d’une meilleure prise en charge des malades, rien sur l’ambition de redonner à tous les acteurs du monde psychiatrique – soignants, malades, familles, magistrats – les moyens de soigner et d’accompagner. L’étude d’impact reste, sinon très optimiste, à tout le moins parfaitement irréaliste, surtout dans le contexte de la « révision générale des politiques publiques », qui se traduit par leur réduction tous azimuts. Ce qu’elle préconise en termes de moyens, ce n’est ni plus ni moins qu’un pansement sur une jambe de bois !
C’est pourtant d’une politique cohérente et même d’un sauvetage massif qu’a besoin la médecine psychiatrique française. Le comble, c’est que nous savons tous ce qui est nécessaire : plus de postes, plus de lits, pour un meilleur suivi à l’hôpital ou en dehors. La médecine psychiatrique française mériterait certainement autre chose qu’un jugement à courte vue, motivé par une politique opportuniste.
L’objectif de santé n’est à l’évidence pas satisfait, je le répète. J’en veux pour preuve supplémentaire le titre II, intitulé « suivi des patients ». Dans toutes ses dispositions, il n’est question que de l’encadrement des soins sans consentement, sans que les objectifs de traitement soient abordés.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la pertinence même de l’expression « soins sans consentement », d’autant que, nous le savons, l’absence de consentement du malade est souvent, en particulier en matière psychiatrique, une des causes de l’échec du traitement. Écoutez l’avis du docteur Roger Ferreri, chef de service dans l’Essonne : « On mélange tout, la contrainte n’est pas du soin, c’est une décision de la société. La société a le droit de se protéger, mais lorsque vous mettez quelqu’un dans une chambre d’isolement, vous n’avez pas le droit de penser que c’est pour son bien. »
Mais ce texte vise-t-il véritablement le traitement des malades ? C’est bien ce qui nous conduit à douter de l’objectif « sanitaire » du texte.
En effet, le cœur du projet de loi est à l’évidence l’objectif sécuritaire. L’ordre public serait menacé par ces personnes en souffrance ! Quelle curieuse conception de la maladie psychiatrique que celle qui consiste à considérer les patients comme des fauteurs de troubles en puissance plutôt que comme des malades ! La logique sécuritaire du texte, facilitant l’internement ou la contrainte tout en limitant les droits des personnes souffrant de troubles mentaux, découle pourtant de cette conception de la maladie mentale comme facteur d’atteinte à l’ordre public.
De notre point de vue, l’appréhension de la prise en charge des personnes présentant des troubles psychiatriques sous le seul angle sécuritaire est, vous l’avez compris, non seulement réductrice, mais également inacceptable. L’intervention du préfet se situe dans la droite ligne de cette conception. Sous prétexte de maintien de l’ordre public, nombre de principes gouvernant le régime des libertés des personnes, de nos libertés individuelles, sont battus en brèche.
Je pense, par exemple, à la création d’une période d’observation de 72 heures en hospitalisation complète. S’apparentant à une véritable garde à vue psychiatrique, cette mesure est à la fois inapplicable par son immense flou et, plus encore, profondément contraire à nos principes au regard des libertés individuelles.
On peut s’interroger quant à l’opportunité d’une telle mesure alors que le régime de la garde à vue vient d’être réformé pour en atténuer les abus. De fait, cette mesure ne présente aucune différence de forme avec la garde à vue : elle est aussi arbitraire et, par définition, aussi privative de liberté. Les garanties qui entourent cette période d’observation sont, selon nous, bien trop faibles pour constituer une véritable atténuation du pouvoir du préfet.
Comment imaginer que cette période d’observation de 72 heures puisse être décidée par le préfet sur le fondement d’un motif aussi flou que le « péril imminent » ? Comment accepter que le préfet puisse être quasiment le seul à en juger, le médecin ne servant là que d’auxiliaire de police ?
Votre texte n’est pas assez clair sur les garanties qui entourent cette notion, et nous avons les plus grandes craintes concernant son application concrète. En effet, il prévoit de conférer une autorité exorbitante – peut-être peut-on parler de tous les pouvoirs – au représentant de l’État, et non à un médecin ou à un juge. Sous le couvert de la nécessité de protéger la société, la loi tend à créer un régime d’exception, une situation dans laquelle nos concitoyens atteints de troubles psychiatriques pourraient être internés sans avoir véritablement leur mot à dire.
Dans cette optique, l’intervention du juge des libertés et de la détention semblait positive, même si cet élan de respect des droits fondamentaux n’est évidemment pas sans rapport avec la décision du Conseil constitutionnel. Bien sûr, il faut se satisfaire du fait que l’hospitalisation sans consentement puisse être contestée par la voie judiciaire, même si nous estimons que l’intervention du juge devrait être possible dans un délai plus court.
Toutefois, lorsque nous lisons le projet de loi, nous avons une curieuse impression : celle que votre cabinet, madame la secrétaire d’État, pour ne pas déroger pas au caractère globalement liberticide de ce texte, a encadré cette disposition de sorte que son effet positif soit très limité.
Ainsi, le délai annoncé est bien trop long : deux semaines, c’est inadmissible s'agissant d’une mesure privative de liberté. En matière de droit des étrangers maintenus en rétention, par exemple, et pour évoquer une situation comparable, l’intervention du juge des libertés est obligatoire après quatre jours, puis le président du tribunal de grande instance peut se prononcer après douze jours ; autrement dit, la mesure de rétention est examinée deux fois.
Dans ces conditions, comment imaginer que, lorsqu’il s’agit de cas psychiatriques, le JLD puisse être totalement absent au cours des douze premiers jours d’hospitalisation ?
Le rôle de ce magistrat suscite une deuxième interrogation.
Selon nous, votre texte, madame la secrétaire d'État, ne fait que donner l’illusion que le juge décide. En effet, compte tenu du manque de moyens criant du système judiciaire, qui ne permet pas d’examiner les cas de façon approfondie, il y a fort à parier que la décision du juge reposera sur un consentement présumé en faveur de l’hospitalisation, d’autant que rien ne vient renforcer concrètement les droits des personnes hospitalisées.
De fait, alors que nous aurions pu imaginer que ces « prisonniers psychiatriques » bénéficieraient des avancées récentes de la procédure de garde à vue, rien ne le laisse prévoir ici. À la lecture des dispositions de ce projet de loi qui sont censées garantir la défense des libertés individuelles, nous craignons que cet objectif ne soit hors de portée.
Autre mesure que nous ne pouvons que combattre : la création d’un véritable « casier psychiatrique ». Comment admettre qu’une décision d’hospitalisation puisse être prise sur la base d’antécédents psychiatriques datant de plus de vingt ans ? N’y a-t-il pas là un non-respect flagrant du « droit à l’oubli » ?
Oui, mes chers collègues, là encore, le droit des malades est abandonné et sacrifié à l’objectif sécuritaire. Ces personnes atteintes de troubles psychiatriques, il faut les repérer, les ficher, les suivre, les pister, parce qu’elles sont supposées inguérissables ! Comme le sont sans doute les jeunes un peu agités de nos quartiers, ces jeunes dont certains se proposent de repérer les comportements déviants dès le berceau.
Ce traitement sécuritaire de la maladie psychiatrique le prouve : vous avez imaginé un texte qui enferme, non qui guérit.
Enfin, comment ne pas évoquer votre définition des « soins sans consentement », qui englobent les anciennes hospitalisations d’office et sur demande d’un tiers. Le texte prévoit, et c’est une nouveauté, que ces soins pourront être délivrés à l’hôpital et en ambulatoire. C’est le cœur de votre réforme.
Selon nous, il convient d’être très prudent s'agissant de cette fausse bonne idée qu’est la délivrance des soins à domicile. Certes, le patient quitte un environnement hospitalier et les familles peuvent se sentir rassurées. Néanmoins, une telle solution soulève plusieurs questions : qui assume la responsabilité du malade ? Est-ce la famille ? Qu’en est-il du secret médical ? Comment interviennent les soignants dans ce contexte ? Il n'y a aucune réponse à ces interrogations dans le projet de loi !
Derrière cette mesure, se trouve simplement le problème fondamental que nous avons déjà évoqué : notre médecine psychiatrique, après quarante années d’une remarquable évolution, se délite, se meurt. Nos hôpitaux voient leurs moyens se réduire drastiquement de PLFSS en PLFSS, avec des personnels moins nombreux, plus sollicités, en souffrance eux aussi.
La VAP, la valorisation de l’activité en psychiatrie, le pendant dans ce secteur de la tarification à l’activité, n’a d’autre but que de contraindre à sélectionner les patients. Demain, l’hôpital public choisira-t-il les moins malades, les moins vieux, les moins fous ? Telle est, en tout cas, une fois encore, la réflexion qui m’a été faite à Lyon par un psychiatre.
En clair, cette mesure nous donne l’impression que l’on cherche à se débarrasser à moindre frais d’une population et à en transférer la charge à des familles complètement démunies.
Parce que ce texte ne pose aucunement la question du traitement, cette disposition est très cohérente avec sa logique d’ensemble, celle de la prise en charge du trouble psychiatrique dans sa seule dimension sécuritaire, en oubliant ses aspects thérapeutiques.
Enfin, ce texte nous interpelle par son esprit général, notamment parce qu’on offre au préfet un rôle prépondérant dans le choix de l’encadrement, voire un pouvoir véritablement discrétionnaire puisqu’il peut imposer une réadmission du patient en hôpital psychiatrique en cas de problème lors du parcours de soins.
Oui, madame la secrétaire d'État, même si vous vous en défendez, vous ne considérez la psychiatrie que sous l’angle de l’ordre public. Votre texte condamne et stigmatise les personnes atteintes de troubles mentaux, sous couvert d’en protéger la société. Il banalise un régime d’exception, et c’est très grave !
Nous ne pourrons que citer l’opinion des soignants, par exemple le docteur Hervé Boukobza, porte-parole du Collectif des 39, qui constate avec nous le recul fondamental marqué par ce texte puisqu’il affirme : « La psychiatrie a besoin de soins, de se montrer hospitalière, et non pas d’endosser les habits du carcéral et du tout médicament, comme le sous-tend ce texte de loi. »
C’est non pas de répression, d’enfermement et de contrainte qu’ont besoin d’abord ces personnes, mais d’un accompagnement fondé sur la confiance, de soins et de moyens offerts à leurs soignants.
La psychiatrie mérite une véritable loi-cadre qui définisse ses missions et ses moyens, ces derniers devant être pérennes. En conséquence, nous ne pourrons que voter contre ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le présent projet de loi, relatif aux soins psychiatriques sans consentement, est un texte intermédiaire entre, d’une part, une simple mise en conformité constitutionnelle de la législation en vigueur, et, d’autre part, une réforme-cadre du droit de la santé mentale. Et c’est bien ce caractère d’entre-deux qui le rend problématique.
En effet, je le rappelle après d’autres, une intervention législative était imposée par la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 qui, prise sur le fondement d’une question prioritaire de constitutionnalité, a donné au Gouvernement jusqu’au 1er août 2011 pour organiser un recours systématique du juge judiciaire en cas de maintien d’une hospitalisation sans consentement.
Cette décision se comprend bien, l’autorité judiciaire étant constitutionnellement « gardienne de la liberté individuelle ». Ce qui est étonnant, c’est que ce contrôle systématique n’ait pas été prévu plus tôt !
Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel établit une distinction entre les conditions de l’hospitalisation, selon qu’il s’agit d’une admission sans consentement ou d’un maintien de l’hospitalisation. Il les estime conformes à la Constitution dans le premier cas, mais pas dans le second.
Ainsi, le texte qui nous est soumis prévoit, d’une part, un contrôle de plein droit, par le juge des libertés et de la détention, des hospitalisations sans consentement avant le quinzième jour lorsque leur durée doit se prolonger au-delà de cette échéance, et, d’autre part, l’intervention de ce magistrat tous les six mois en cas de prolongation.
Le Gouvernement aurait pu se borner à organiser ce contrôle, mais il n’en est rien, puisque l’objet de ce texte n’est pas seulement judiciaire, il s’en faut : le projet de loi comprend également un volet médical, qui réforme en profondeur le système établi jusqu’à présent par la loi du 27 juin 1990.
En effet, l’objectif de ce texte est de remplacer la notion d’« hospitalisation sans consentement » par celle de « soins sans consentement », en développant par conséquent des solutions alternatives à l’hospitalisation complète ; il est aussi de créer une nouvelle procédure d’hospitalisation sans consentement « en cas de péril imminent » pour la santé du malade et une période d’observation de soins de 72 heures ; il est encore de renforcer le suivi des patients réputés les plus difficiles ; il est enfin d’élargir et d’accroître les droits des personnes en soins sans consentement.
La simple énumération de ces mesures, tant médicales que judiciaires, nous permet de nous rendre compte qu’il ne s’agit pas, loin de là, d’un texte à vocation exclusivement sécuritaire, contrairement à ce qui a pu lui être reproché.
Tout en allant bien au-delà de ce qu’imposait la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur le fondement de la question prioritaire de constitutionnalité, le présent texte n’est pas pour autant la grande loi sur la santé mentale préconisée par la commission Couty en 2008 et par l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé en avril 2009.
Dans une telle loi, ce dossier serait abordé sous toutes ses facettes, à savoir la prévention des troubles psychiatriques, l’accès à des soins rapides et adaptés, donc l’offre de soins du point de vue tant de sa quantité que de sa répartition, le suivi de personnalité, la rénovation de l’hospitalisation sans consentement elle-même et l’organisation des soins aux détenus.
Cette loi-cadre, nous l’appelions de nos vœux parce que seule une approche globale nous paraît garantir une réforme cohérente en la matière.
Nous regrettons que ce ne soit pas ce choix qui ait été fait et que l’on ait préféré opter pour un entre-deux. Les difficultés auxquelles nous sommes à présent confrontées sont inhérentes à cette décision ; ce n’est pas un hasard si elles concernent tant le volet médical du projet de loi que son volet judiciaire.
Ce qui est reproché à ce texte, c’est de ne pas aller assez loin dans l’explicitation de ce que seraient ces fameux « soins ambulatoires sans consentement ». Et c’est tout l’enjeu de l’énorme travail réalisé par Muguette Dini avec la commission des affaires sociales. Ses amendements n’ont pas été intégrés au texte, mais ils ont eu le mérite majeur d’avoir mis en lumière l’importante lacune du projet de loi sur ce point. Il s'agit déjà d’un acquis tout à fait considérable à mettre à l’actif de la Haute Assemblée.
En résumé, voilà un texte qui est audacieux sur le plan de la rénovation du système et qui va donc dans le bon sens. La réforme médicale dont il est porteur n’a rien d’anecdotique. Elle présente l’immense avantage de responsabiliser les médecins. Il s'agit aussi d’un texte fondamental sur le plan des droits et libertés, dont le volet judiciaire ne saurait être différé.
Bref, au travers de ce texte, on parvient à un équilibre entre ces trois grands enjeux du dossier que sont la santé, les droits individuels et la sûreté. Toutefois, le projet de loi ne saurait être adopté en l’état, car il est incomplet.
Aussi, mes chers collègues, nous ne sortirons de cette situation – c’est la logique même ! – qu’en comblant les lacunes de ce texte, c’est-à-dire en le poussant un peu plus loin.
À l’évidence, la notion nouvelle de « soins ambulatoires sans consentement » demeure problématique. C’est pourquoi nous soutiendrons l’amendement de clarification et de compromis présenté par notre collègue Alain Milon et sous-amendé par le rapporteur de la commission des affaires sociales, Jean-Louis Lorrain.
Cet amendement tend à préciser que les soins psychiatriques sans consentement sont administrés au moyen de tous les outils thérapeutiques adaptés à l’état du patient et à établir une typologie non plus des formes de soins mais des lieux de soins. Ainsi a-t-il pour objet de distinguer clairement les unités d’hospitalisation à temps plein de ces autres lieux de soins que sont les unités alternatives à l’hospitalisation à temps plein ou les lieux de consultation, les lieux d’activités thérapeutiques ou les lieux de vie habituels du patient.
Les dispositions du sous-amendement du rapporteur de la commission des affaires sociales seront sans doute, elles, de nature à rassurer le corps médical quant au plein maintien de sa liberté de prescription.
Sous réserve de ces modifications d’importance, le groupe de l’Union centriste soutiendra cette réforme, même s’il attend qu’elle soit complétée dans les meilleurs délais pour une rénovation globale du cadre des soins psychiatriques.
Il ne me reste plus qu’à féliciter nos commissions et nos rapporteurs de l’excellence de leur travail, notamment Muguette Dini et Jean-Louis Lorrain, avec tout de même, si vous me le permettez, mes chers collègues, une mention spéciale pour la présidente de la commission des affaires sociales, qui, avec le courage et la détermination que nous lui connaissons, est allée jusqu’au bout de ses convictions.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, en enfermant ce projet de loi dans une approche résolument sécuritaire, le Gouvernement caricature la réponse qu’il entend apporter à une grave question, dont l’étude d’impact nous révèle toute l’ampleur.
En effet, ce document nous rappelle que, en 2005, plus du tiers des Français ont souffert d’au moins un trouble mental dans leur vie. C’est bien la preuve que cette question de santé publique appelait une réponse ambitieuse.
Elle n’est certes pas apportée avec ce texte partisan et confus, même après les modifications qui ont été votées par la majorité à l’Assemblée nationale et qui étaient elles-mêmes en retrait par rapport aux propositions de la commission des affaires sociales de cette chambre, voire de son rapporteur.
Pour notre part, nous souhaitions la grande loi globale de santé mentale dont notre pays a bien besoin. Ce texte aurait amélioré, après vingt ans d’application, la loi du 27 juin 1990, dont l’un des points forts, je le rappelle, a été de consacrer l’hospitalisation libre comme le régime habituel de l’hospitalisation, alors que, auparavant, depuis la loi de 1838, on ne connaissait que les modes de placement sous contrainte.
Aujourd’hui, on nous présente un projet de loi qui est perçu par les milieux professionnels concernés comme d’essence sécuritaire. Doit-on s’en étonner ? Bien sûr que non !
En effet, ce projet de loi est né à la suite d’un fait divers dramatique, qu’a rappelé d'ailleurs notre collègue Guy Fischer. En novembre 2008, dans une rue de Grenoble, un étudiant est tué par un malade mental en fugue d’un établissement de soins. Quelques jours plus tard, le Président de la République annonce un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques, avec la multiplication des chambres d’isolement, la mise en place de bracelets électroniques, etc.
Le Président de la République exige également une nouvelle loi sur les hospitalisations sans consentement avec, en ligne de mire, non pas la dangerosité d’une infime minorité des malades – du reste, souvent sans soins au moment des faits dramatiques dans lesquels ils sont impliqués –, mais la dangerosité supposée de tous nos concitoyens ayant recours à des soins psychiatriques dans le champ large, divers et complexe de la maladie mentale.
D’une manière générale, ce qui ressort de ce projet de loi, dans sa version initiale, c’est l’idée de garantir la sûreté, non des malades qui, pourtant, en ont légitimement le plus besoin, mais des non-malades en insistant, par exemple, sur les prérogatives du préfet.
En 2006, déjà, le gouvernement dans lequel l’actuel Président de la République était ministre de l’intérieur avait dû renoncer, face à la mobilisation de nos concitoyens, à associer maladie mentale et dangerosité dans la loi sur la prévention de la délinquance. Les malades mentaux étaient, en quelque sorte, assimilés à des délinquants.
Aujourd’hui, avec ce projet de loi, le Gouvernement revient à la charge : la question du trouble à l’ordre public prédomine sur la préoccupation sanitaire et sur celle de la qualité des soins à donner aux malades.
L’ossature de ce projet de loi demeure donc sécuritaire.
Observons, par ailleurs, que le point central du projet de loi qui nous est soumis est celui des soins sans consentement avec, notamment, la création de la notion de soins sans consentement en ambulatoire. Si cette approche est difficile à admettre d’une manière générale dans le champ médical tant il est délicat de vouloir et de pouvoir soigner les personnes sans leur consentement, elle est encore plus délicate en psychiatrie.
En effet, en psychiatrie, outre le recours aux médicaments, fussent-ils très performants, la relation ou l’alliance thérapeutique entre le malade et son thérapeute est essentielle. Elle repose sur la confiance. Il s’agit d’un contrat implicite – et souvent explicite – qui appelle le consentement du patient si l’on recherche effectivement des résultats thérapeutiques. En la matière, l’imposition de soins sans consentement en ambulatoire, prévue par ce projet de loi, pose problème.
Notons également que ce texte était sur le point d’être soumis au Parlement lorsqu’est intervenue la décision rendue le 26 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité visant à qualifier la nature juridique de l’hospitalisation d’un malade sans son consentement. La décision du Conseil constitutionnel dispose que ce type d’hospitalisation est, non une simple mesure de protection, mais une mesure de « détention » par privation, pour la personne concernée, de sa liberté d’aller et de venir, au sens de la Constitution.
Cette décision a donc conduit le Conseil constitutionnel à rappeler au Gouvernement que, s’agissant d’une privation de liberté, les mesures d’hospitalisation sans consentement doivent être soumises au contrôle effectif du juge judiciaire et que, en conséquence, les dispositions de la loi de 1990 ne prévoyant l’intervention de l’autorité judiciaire qu’en cas de demande de sortie du patient rejetée par l’autorité compétente étaient inconstitutionnelles.
Cette décision impose que le juge statue dès lors que la mesure est prolongée au-delà de quinze jours, puis à intervalles réguliers. Demande est donc faite au Gouvernement et au législateur de mettre en conformité notre législation en la matière avant le 1er août 2011.
Remarquons que la brièveté de ce délai n’est pas sans poser des problèmes très pratiques de faisabilité matérielle – manque de magistrats, de personnel, de lieux d’audience adaptés… –, faisabilité sur laquelle le Gouvernement se montre peu loquace.
Cette décision du Conseil constitutionnel est donc venue contrarier le projet de loi « tout-sécuritaire » que le Gouvernement et le Président de la République envisageaient de faire voter au Parlement. La réécriture du projet initial, aussitôt entreprise dans la hâte et la confusion, avec un ersatzde consultation des acteurs concernés – associatifs, professionnels, institutionnels – nous donne une production incrémentale d’un projet de loi où peu d’acteurs s’y retrouvent ; et ce n’est là qu’un euphémisme !
Les auditions conduites nous ont confirmé l’insatisfaction généralisée et, parfois, une opposition frontale audit projet, pour des motifs multiples, pertinents et solides.
Une bonne synthèse de cette insatisfaction se retrouve dans l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, adopté en assemblée plénière le 31 mars 2011.
Ainsi, je retiendrai que, concernant les interrogations sur le régime à venir, celui-ci est loin de faire l’unanimité chez les professionnels, les malades et leurs proches. Leurs inquiétudes, de tous ordres s’agissant de procédures complexes, se focalisent sur la crainte que la réforme ne renforce au-delà de l’indispensable la contrainte pesant sur les malades.
À la différence de nombreux pays, la France a progressivement renoncé à une politique de secteur qui avait suscité de grands espoirs, au profit d’un renforcement du recours à l’hospitalisation ; c’est d’autant plus paradoxal que nous savons l’importance des restructurations budgétaires et que des milliers d’emplois et de lits sont supprimés dans les hôpitaux.
Dans un contexte marqué par une insuffisance de moyens et des difficultés de recrutement des spécialistes médicaux et infirmiers, une concurrence non résolue entre les dépenses exigées pour les établissements et la médecine des secteurs, ce séjour obligatoire en établissement, prévu par le projet de loi, favorise la formule de l’internement.
En outre, le système d’expertise sur lequel reposent tout le jeu des certificats et l’examen par un collège des différentes étapes du nouveau dispositif est jugé par beaucoup très complexe, voire pratiquement inapplicable compte tenu de l’insuffisance des effectifs, et surtout inégalement réparti sur le territoire. D’où la crainte que ce système d’expertise « ne puisse dégager le sort des malades mentaux de l’amalgame qui conduit à privilégier un point de vue sécuritaire, et, pour éviter tout risque, enfermer plutôt que d’organiser les moyens d’un accompagnement. »
L’un des grands dangers de cette loi, c’est de faire passer le sécuritaire avant le thérapeutique. C’est une ineptie que tous les rapports mettent en avant en affirmant, chiffres à l’appui, que ce sont avant tout les personnes souffrant de troubles mentaux qui sont victimes de violences.
De plus, pour beaucoup de professionnels, l’impression s’est fait jour que nous nous dirigeons vers une « judiciarisation » renforcée de la psychiatrie, qu’ils réfutent non sans fondement : les malades mentaux ne sont pas de dangereux délinquants.
À cela s’ajoute le fait que la loi reste bien floue sur la portée réelle, en termes de libertés publiques, de cette innovation que constituent les soins sans consentement en ambulatoire.
Qu’impliquent-ils, en pratique, pour le droit d’aller et venir, pour la protection du domicile, pour les rapports avec les proches et dans d’autres lieux de vie ? Qu’en est-il du libre choix de son médecin par le malade, des actes de la vie courante ? La conséquence d’un refus de se prêter au traitement est-elle le retour ou l’envoi en établissement ? Il est difficile, à la seule lecture du projet, de mesurer les véritables sujétions autres que médicales. Celles-ci doivent être précisées et assorties de garanties.
D’où « le sentiment que la concertation permettant un véritable consensus dans ce domaine très sensible n’est pas allée assez loin et que la concomitance des réformes et des moyens n’est pas réalisée. Le patient sera plus isolé que jamais dans une société hostile et face à une réforme dont il constituera le “ cobaye ”. Plus particulièrement, il ne paraît pas acceptable de retenir des critères comme le passage devant la justice ou dans des unités pour malades difficiles pour imposer à un malade, parce qu’il a eu un épisode critique, un régime juridique plus sévère. Il a droit à ce que l’appréciation de son cas se fasse sur la seule base des nécessités de son traitement et sous la responsabilité de son médecin, qui doit évidemment appréhender tous les problèmes liés à la vie en société de son malade ».
Concernant le contrôle du juge sur les décisions prises sans le consentement du malade, on « se demande si la réforme n’est pas restée au milieu du gué et s’il n’aurait pas été plus opportun de faire intervenir le contrôle du juge dès la décision initiale d’hospitalisation et non pas simplement a posteriori ».
« Même si le Conseil constitutionnel n’est pas allé aussi loin, la question peut légitimement être posée. C’est en effet une solution qui fonctionne apparemment bien dans certains pays qui ont mis en pratique ce recours au juge dans la réponse au problème. Il est d’autre part clair que le sort des intéressés n’est pas facilité par la succession de mesures impliquant des responsabilités successives. On ajoutera que toutes les appréciations reposent évidemment sur des avis médicaux, dont la contestation est malaisée et ce d’autant plus que le juge interviendra alors que le diagnostic et même le traitement seront déjà décidés. Pour écarter cette option pourtant souhaitée par les associations de malades et une partie des magistrats, l’étude d’impact avance l’argument assez théorique qu’il ne serait pas bon que le juge des libertés et de la détention appelé à exercer une fonction de contrôle ait pris position dès l’origine. »
Mais le Conseil constitutionnel a, lui, surtout avancé l’argument de la surcharge de travail des juges, ce qui est prévisible et doit être anticipé sérieusement. Nous pensons que le Gouvernement, pour des raisons d’économies budgétaires, a plutôt été sensible à ce dernier argument. Pour notre part, nous estimons que cet élément ne doit pas déterminer la réponse. À partir du moment où l’on s’engage dans une réforme d’importance, il faut se donner les moyens matériels et humains suffisants pour la mettre en œuvre.
« Dans le même ordre d’idée, il est étonnant que le contrôle du juge ne porte pas sur les soins sans consentement lorsqu’ils sont prescrits en ambulatoire. Le placement des soins ambulatoires hors du contrôle du juge paraît dénué de fondement : il y aurait au contraire grand intérêt à ouvrir au juge ce contentieux particulièrement sensible au regard du respect de la vie privée. »
S’agissant d’un autre point de ce projet de loi, on pourrait aussi imaginer que soit créé un bloc de compétences au profit du juge judiciaire – c’est, du reste, ce qui est proposé par le rapporteur de la commission des lois –, « afin que celui-ci connaisse de l’intégralité du contentieux du soin psychiatrique contraint : la concurrence entre la compétence du juge administratif pour connaître des décisions du directeur de l’établissement et celle du juge judiciaire pour décider du maintien de l’hospitalisation sous contrainte ou de la mainlevée de celle-ci, n’est guère satisfaisante. »
Concernant la mise en œuvre du contrôle juridictionnel, des difficultés pratiques apparaissent à l’évidence. La possibilité d’un recours à la visioconférence pour organiser ces audiences, prévue par le projet, est, par exemple, un point de vive contestation. « Des raisons budgétaires ne sauraient justifier cette pratique hautement critiquable dans un contentieux qui s’adresse à des personnes en situation, souvent, d’extrême fragilité. Le dialogue entre le juge et le patient est rendu difficile, sinon impossible, la place de l’avocat – qui ne pourra se trouver à la fois au tribunal et auprès de son client – lui interdit en toute hypothèse d’exercer sa fonction dans des conditions satisfaisantes. C’est donc l’effectivité même du recours organisé sous forme d’auditions à distance qui est compromise. »
Enfin, beaucoup de professionnels du champ psychiatrique et de nombreux magistrats, ainsi que leurs représentants, se déclarent « des plus préoccupés par la procédure de recours suspensif, à l’initiative du préfet et du directeur de l’établissement d’accueil, qu’instaure le projet de loi, en cas de désaccord avec la décision de mainlevée du juge ». La crainte est « que le principe de précaution n’affecte une fois encore les droits des patients tout en discréditant les pouvoirs et l’autorité du juge ».
À la lumière de ces questionnements, pour ne pas dire de ces inquiétudes, on en vient à la conclusion que ce projet de loi manque de la maturité nécessaire à une réforme convaincante du régime actuel de la prise en charge de la maladie mentale. Il semble que la réflexion ne soit pas aboutie, tant sur la question du contrôle par l’autorité judiciaire de la mesure de contrainte que sur celle de la gestion de la contrainte à l’extérieur de l’hôpital psychiatrique.
Dans cet exercice ultrasensible, qui demande une approche requérant le trébuchet du pharmacien, un esprit de mesure s’impose pour trouver un juste équilibre entre trois dispositifs également prioritaires.
D’abord, un dispositif sanitaire au service des malades. Le patient ne doit pas disparaître derrière sa pathologie. Son parcours ne peut se résumer à un condensé d’existence borné par la médicalisation, nonobstant les avancées dans le domaine des médicaments, et/ou l’enfermement.
Ensuite, un dispositif judiciaire qui garantit les libertés fondamentales de tous les citoyens, a fortiori lorsqu’ils sont en état de faiblesse ou malades.
Enfin, un dispositif de sécurité des personnes garantissant l’ordre public, visant à la protection de la société, et dont doit également bénéficier le malade. Ce dispositif ne doit pas être un « tout-sécuritaire », rejetant la présence des malades mentaux hors de la cité, car abusivement déclarés dangereux par hypothèse. Cela, vous en conviendrez, mes chers collègues, est scandaleux !
Le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui ne réalise pas ce juste équilibre.
À défaut de pouvoir intégrer ce texte dans une authentique et grande loi de santé publique toujours en attente, et privé de l’espoir de pouvoir bénéficier des quelques réelles avancées proposées par Mme le rapporteur initial de ce projet devant notre commission des affaires sociales – propositions qui, et je l’en remercie, gommaient plusieurs dispositions particulièrement critiquables et critiquées par l’ensemble des professionnels et associations concernées – puisque son rapport a été rejeté la semaine dernière, notre groupe a déposé de nombreux amendements. Certains de ceux-ci reprennent d’ailleurs quelques amendements pertinents déposés par celle qui était le rapporteur initial, amendements que nous avions approuvés lors de l’examen en commission.
D’autres amendements s’inscrivent dans la même veine que ceux, souvent très justifiés, que défendra le rapporteur pour avis de la commission des lois.
Notre objectif est d’améliorer un texte initial alambiqué, assemblage de procédures complexes, au point d’être souvent contradictoires, et qui, en faisant mine d’afficher le renforcement des garanties des droits des personnes, rendent prépondérantes des décisions administratives dictées par la présomption de dangerosité des malades psychiatriques et non fondées sur l’évaluation médicale des nécessités de soins, ce qui est pour le moins déplorable, voire scandaleux, pour nous comme pour nombre de nos concitoyens et pour la grande majorité des professionnels concernés !
Pour l’ensemble des raisons que je viens d’évoquer rapidement, mon groupe votera contre ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai beaucoup hésité avant d’intervenir dans ce débat. Ce matin, j’étais prêt à demander à ne plus figurer sur la liste des orateurs. Lorsqu’on est directement concerné par un sujet comme celui-ci, il est toujours difficile d’en parler avec sérénité, et l’exercice auquel je vais me livrer devant vous est particulièrement impudique et douloureux pour moi.
Si j’ai néanmoins persisté dans mon idée de prendre la parole, c’est parce que ce texte a suscité une agitation qui, selon moi, relève plutôt de la caricature ou des préjugés idéologiques. Je pense que, pour les familles, il est particulièrement insupportable de voir le problème abordé de cette façon.

Je vais vous parler de mon fils, que rien, apparemment, ne prédestinait à être concerné par la maladie psychiatrique : il a eu son bac et a entamé des études supérieures avant, un beau jour, de sombrer dans la schizophrénie. Sombrer est le mot juste, car c’est bien d’un naufrage qu’il s’agit.
Aujourd'hui, mon fils est clochard : il joue de la musique dans les rues d'Athènes et passe le reste de son temps à ramasser des mégots, qu’il conserve précieusement.
Cette dérive s’est produite assez brutalement ; elle s’est manifestée par des hurlements qu’il poussait dans la rue « pour chasser les démons », ainsi que par des menaces et des brutalités envers ma femme. Nous avons cherché un moyen de l’aider, mais il n'est pas facile de soigner quelqu'un qui ne se reconnaît pas malade et qui, de surcroît, considère que tous les médecins sont systématiquement des êtres malfaisants.
Après quelques mois, et grâce à l’appui d'un psychiatre qui a accepté de venir chez moi et de rencontrer mon fils un peu par surprise, j’ai réussi à obtenir une hospitalisation. Certes, on était un peu à la limite du droit au regard de la loi de 1990, mais qu'importe : il a au moins pu être soigné à ce moment-là. Au bout d'un certain temps, il a bénéficié d'une permission de sortie, qui s'est traduite, comme c'est généralement le cas, par un arrêt progressif, mais prématuré, du traitement. Les soins n'ont donc pas eu le succès que nous escomptions. Le problème a perduré et a donné lieu à toute une série de péripéties qu’il n'est pas opportun de relater ici.
Je veux insister sur le fait que, pour la famille, pour les proches, pour les amis, cette situation a été particulièrement pénible.
Aujourd'hui, je considère que la vie de ce garçon est gâchée. Il est dans une situation de souffrance particulière, car tout n’est que déceptions à ses yeux et il ne comprend pas pourquoi il en est là.
Il est en outre victime de violences beaucoup plus qu’il n’est auteur de violences : tout le monde peut en effet abuser de lui sans difficulté ; il est d'une grande naïveté et, par conséquent, il est une proie facile.
Mes chers collègues, si je vous raconte ce drame personnel, c'est surtout pour vous demander d'aborder ce débat dans un état d'esprit positif. Il me semble nécessaire aujourd'hui que nous examinions l’une après l’autre les dispositions que contient ce projet de loi pour déterminer celles qui sont utiles aux malades. Je souhaite vivement que nous appréhendions les questions sous-jacentes à ce texte en ayant le souci de penser d'abord aux malades et sans entrer dans d'autres considérations que, malheureusement, l’on a trop entendues.

En tant que membre de la commission des lois, j'ai bien noté les propositions qu’a formulées Jean-René Lecerf. J'ai également pris connaissance d'un certain nombre de celles qu’a avancées la commission des affaires sociales. De mon point de vue, ce texte peut être amélioré et prévoir un meilleur contrôle, notamment juridictionnel.
J’espère sincèrement que toutes les dispositions qui permettront d’assurer un meilleur fonctionnement de la loi de 1990 seront adoptées au cours de cette discussion.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, de l ’ Union centriste et du RDSE. – Mme Patricia Schillinger applaudit également.

Monsieur le président, avant de commencer mon intervention, je précise à l’attention de mon collègue que, à l’instar de certains des membres du groupe du RDSE, je m'inscris exactement dans cette démarche qui se veut généreuse et prend en compte les vrais besoins en soins de nos malades fragilisés.
Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, certains l'ont souligné avant moi et d’autres le répéteront, la Haute Assemblée est confrontée à une situation inédite : après le travail en commission, qu'il s'agisse de la commission des affaires sociales saisie au fond ou de la commission des lois saisie pour avis, le texte qui nous revient et qui nous est aujourd'hui proposé est celui de l'Assemblée nationale, non amendé.
Comment ne pas regretter ce retour ex ante, qui ignore les longs et fructueux débats conduits par M. le rapporteur pour avis avec la rigueur et le talent qu'on lui connaît ? Je tiens ici à saluer la qualité extrême de son travail et je regrette, bien sûr, le sort réservé aux amendements proposés par la commission des lois et par la commission des affaires sociales que nous aurions dû voir intégrés aujourd'hui à ce texte. Je veux dire ma déception de ne pouvoir discuter d’un texte qui aurait pu être ainsi enrichi.
Madame la secrétaire d'État, je n'interviendrai que sur le volet judiciaire du présent texte, qui relève de la compétence de la commission à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir.
Ce projet de loi tend à définir un nouvel équilibre entre trois principes à valeur constitutionnelle : le droit à la protection de la santé, la protection de l'ordre public et la protection de la liberté individuelle. Il semble bien qu’il soit la conséquence directe d'un avis rendu par le Conseil constitutionnel le 26 novembre 2010, déclarant contraire à la Constitution l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7, qui ne soumet pas le maintien de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement à une juridiction judiciaire, gardienne des libertés individuelles.
S'il est bien légitime que soient corrigées ces dispositions, nous pouvons néanmoins nous interroger sur l'ampleur du nouveau dispositif, qui répond une nouvelle fois à un fait d’actualité, ce que je regrette, sans qu’ait été pris le temps d'examiner toutes les incidences des choix opérés. En particulier, le hiatus semble grand entre les décisions prises notamment en termes de santé et leurs conséquences en matière judiciaire.
Je n'en veux pour preuve que les termes mêmes de l'avis du Conseil constitutionnel qui, statuant sur les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement, indique : « 38. Considérant, en troisième lieu, que l’article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement ; que le droit de saisir ce juge est également reconnu à toute personne susceptible d’intervenir dans l’intérêt de la personne hospitalisée ; […] »
Ma question s’adresse à M. le garde des sceaux : pourquoi avoir généralisé cette mesure et systématisé le recours au juge judiciaire pour toutes les hospitalisations sous contrainte ?
Le système proposé met aujourd'hui en grande difficulté autant le milieu judiciaire que le monde des hôpitaux psychiatriques et les psychiatres eux-mêmes. Il suffit de voir et d'entendre les réactions nombreuses des professionnels pour mesurer leur désarroi.
Ce projet de loi trop complexe aurait dû en réalité faire l'objet de deux textes distincts, car il aborde des sujets spécifiques.
Je souhaite en particulier insister sur l'inquiétude des magistrats qui voient augmenter leur charge de travail de manière insupportable : l'étude d'impact elle-même a souligné l'absolue nécessité de créer des emplois dont on est en droit de savoir comment ils seront financés.
Ainsi, nous assisterons à la multiplication du nombre des cas soumis au contrôle judiciaire dans les quinze jours à compter de l'admission ou de la décision d’admission, à la multiplication du nombre des contrôles, eux-mêmes répétés tous les six mois, à la multiplication des expertises psychiatriques, qui nécessiteront le concours de collèges de soignants, dans un contexte médical dont on connaît la fragilité.
Des délais brefs seront imposés au juge, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui seront très vite inacceptables. Des débats contradictoires devront être organisés entre le juge et les médecins, sans qu'il soit précisé de quels médecins il s'agit.
Le recours à la visioconférence sera difficile, sinon impossible à mettre en œuvre : cette mesure ignore manifestement l'organisation des hôpitaux psychiatriques et leur manque de moyens budgétaires pour mettre en place des équipements.

En conclusion, mais nous y reviendrons au cours de la discussion de ce texte, face à une intention louable, protéger des personnes fragilisées, le Gouvernement propose un dispositif dont la complexité ne pourra parfaitement garantir le respect d’aucun des trois principes républicains essentiels que nous avons rappelés.
Dans ces conditions, je veux être confiante dans le bon sens, la sagesse, le réalisme des membres du Gouvernement qui, j'en suis sûre, écouteront nos interrogations et nos inquiétudes, qui sont celles des personnes fragilisées et de leurs familles, pour donner toute priorité aux soins.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées de l’UMP

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, dans le monde, 400 millions de personnes sont concernées par un trouble mental. À l’échelon national, presque un Français sur quatre souffre de nos jours d’une de ces formes de trouble ; en outre, on observe que ce type de maladies touche de plus en plus de jeunes adultes et des personnes âgées. Cela doit nous faire prendre conscience que ces maladies affectent la vie de bon nombre de nos concitoyens, de tous âges et de toutes conditions, qu’elles détériorent parfois leur qualité de vie et met aussi souvent en danger leur insertion dans la société.
Peu de personnes souffrant de ces troubles en parlent publiquement. La santé mentale, c’est intime, caché, secret, tabou et les préjugés négatifs ont malheureusement la vie dure. Cela devient public lorsque l’expression du trouble et de l’angoisse commence à être trop intense, quand sont perturbés la vie familiale, le milieu du travail ou, plus généralement, la société. En effet, l’image du malade mental reste aux yeux du grand public très archaïque : celui-ci reste une personne imprévisible, dangereuse dont le placement en établissement psychiatrique est nécessaire pour qu’elle soit suivie et soignée.
L’objet de la psychiatrie est non pas le trouble mental, mais l’être humain souffrant de trouble mental. La société évolue et, pourtant, les « malades mentaux » ont été les moins écoutés et les moins considérés du système de soins pendant longtemps, tant il est vrai que le trouble psychique inquiète toujours par son étrangeté, contribuant malheureusement à renforcer l’isolement de celui qui en souffre.
Montaigne n’écrivait-il pas en son temps : « On construit des maisons de fous pour faire croire à ceux qui n’y sont pas enfermés qu’ils ont encore la raison » ? Or tout changement profond en santé mentale passe par un changement d’attitude de la société à l’égard de ces concitoyens.

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, en vingt ans, nous passerons de 10 % à plus de 20 % de Français touchés par au moins une pathologie mentale. En trente ans, le nombre de dépressions déclarées a été multiplié par six. Il est donc bon de rappeler que tout le monde peut être concerné de près ou de loin par un trouble psychique.

D’ailleurs, au cours de ces dernières années, le nombre de personnes suivies a très considérablement augmenté, que ce soit dans des structures publiques ou privées. Comme dans les autres domaines, des réformes sont nécessaires, car le chantier est, j’en suis convaincu, immense.
Madame la secrétaire d'État, parler de santé mentale, c’est parler de bien plus que de médecine, c’est aussi se préoccuper d’insertion et être attentif à l’accompagnement social des personnes concernées mais aussi à celui de leur entourage proche. C’est aussi déployer les moyens suffisants dont la psychiatrie a besoin ; je pense en particulier à la formation et, plus encore, à celle des infirmiers psychiatriques.
Le champ de la santé mentale est donc particulièrement étendu, plus que ne l’est tout autre domaine de la santé : il recouvre à la fois une dimension individuelle et une dimension sociétale.
La santé mentale occupe une place considérable au sein de notre système de santé, du fait de la fréquence des troubles, mais aussi en raison d’une offre importante, mais insuffisante, en équipements et en personnels.
L’angoisse est partout aujourd’hui : il y a une explosion de la demande « psy » et l’on attend des spécialistes qu’ils répondent dans l’urgence. La consommation de psychotropes est très importante, puisque la sécurité sociale rembourse plus de 315 millions d’antalgiques et 122 millions d’hypnotiques et de tranquillisants. Certes, prescription ne signifie pas consommation, mais est-ce à dire que les Français ont mal, sont mal ou vont mal ?
Par ailleurs, il est certain que les changements de repères structurants pour l’être humain, au sein tant de l’entreprise que de la société, se reflètent au niveau des troubles de la personnalité, avec une augmentation des affections de type borderline, diagnostic fréquemment retenu aujourd’hui.
Enfin, il convient de mentionner un autre changement : l’attitude du malade par rapport à la maladie. Autrefois très passif et sommé de suivre ce qui lui était imposé, il est devenu un partenaire et, si possible, un acteur de son traitement. La nécessité de l’information du patient est aujourd’hui un truisme et il faut aller plus loin dans son implication.
Il est vrai que le traitement est une démarche de longue haleine. Pour pouvoir traiter quelqu’un, il faut établir un lien avec lui, afin de pouvoir travailler ensemble, ce qui prend du temps. C’est pourquoi l’examen de ce projet de loi semble être le signe d’une avancée, de la volonté de créer un climat de confiance, d’échange et, par conséquent, de protection. Néanmoins, je précise que, si l’on peut comprendre la volonté de renforcer la sécurité de nos concitoyens, il faut être conscient qu’elle nécessite la mise en place de moyens considérables, dont l’évocation est absente du présent texte.
On aurait pu espérer un texte de santé mentale beaucoup plus abouti que celui qui nous est proposé aujourd’hui. En ce qui concerne les moyens, il est en effet, je le répète, indispensable d’examiner aussi le volet santé. Quels moyens seront mis en place en termes de personnels soignants, qui forment une chaîne complète : médecins, psychiatres, et surtout infirmiers ? Sur ce dernier point, quel effort sera fourni pour améliorer la formation de ces personnels, notamment les infirmiers psychiatriques dont j’ai demandé le rétablissement voilà déjà deux ans dans un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé ?
Je note toutefois que le projet de loi ajoute des étapes intéressantes dans la procédure de suivi des patients durant les tout premiers jours, étapes qui n’existent pas aujourd’hui et qui vont dans le sens d’une meilleure prise en compte des droits des malades. Mais j’espère que le psychiatre ne sera pas mis sous la tutelle du juge, qui est certes le protecteur des libertés, mais qui est un tiers dans la relation entre le médecin et le malade.
Il faut savoir donner du temps au temps. En effet, il est illusoire de penser que quelqu’un puisse sortir d’une dépression en quelques semaines seulement. Dans ce laps de temps, il est toujours envisageable de guérir les symptômes, mais si aucun travail n’est effectué sur le vécu du patient, une rapide rechute est à craindre.
La protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques est peut-être, avant tout, un état d’esprit, par lequel on montre que la vie a, en elle, quelque chose de formidable et de très intéressant. Parfois, il faut également savoir se confronter à la peur et constater que l’on dispose de toutes les ressources nécessaires pour la dépasser.
Ensuite, il convient de rappeler un principe essentiel : on ne laisse jamais un individu s’enfermer dans des comportements où il ne se nourrit pas ; on ne le laisse pas, si possible, se marginaliser. Cependant, la question d’un référent demeure non résolue : les patients sont souvent relativement isolés, même s’ils sont bien entourés, et personne ne se sent autorisé à prendre la responsabilité de veiller à ce qu’ils ne s’enferment pas dans des conduites de refus. Nous touchons là l’un des problèmes essentiels de notre société, qui est certes dotée de moyens et d’informations très riches, mais qui souffre également d’une irresponsabilité généralisée.
De plus, au-delà de leur propre maladie, les patients souffrent bien souvent de troubles qui touchent à leur estime de soi et à leurs liens sociaux. En raison de la peur de la récidive ou de la décompensation, ils tombent parfois dans les pathologies secondaires de la maladie que sont les stratégies d’adaptation, les échecs familiaux, les troubles cognitifs, les conduites antisociales et les échecs scolaires ou professionnels. Il faut apprendre aux patients à vivre avec et veiller à ne pas leur renvoyer en permanence des images non valorisantes.
Madame la secrétaire d’État, je suis favorable à une déontologie de l’information psychiatrique, afin de relever le double défi de faire face à la souffrance des patients et d’apporter des réponses collectives, cliniques, médico-sociales et sociales, au profit de personnes le plus souvent vulnérables.
De même, comme je l’avais souligné dans le rapport que j’avais établi au nom de l’OPEPS dont j’ai parlé tout à l’heure, il est nécessaire d’adapter l’organisation territoriale de la psychiatrie aux besoins de la population, de créer une spécialisation de niveau master pour les infirmiers et de renforcer les coopérations entre professionnels de santé mentale en développant la notion de réseau. L’un de mes amendements va dans ce sens.
La question des soins ambulatoires devrait également être abordée dans le cadre plus large d’une loi d’ensemble sur la santé mentale, car elle nécessite, par exemple, de réfléchir à l’organisation de réseaux de psychiatrie.
« N’ayez pas peur des fous ! » Tel est le message que nous ont adressé, à chacun d’entre nous, des aumôniers d’établissements publics de santé mentale. Méfions-nous que, sous couvert de défendre la protection des droits des personnes malades, les soins sans consentement deviennent le modèle de soin psychique, faisant de l’exception, parfois nécessaire, la règle.
Comme le soulignaient également ces hommes d’église, sans nier la complexité des situations auxquelles nous sommes confrontés face à la maladie mentale, soyons prévoyants face au risque de disparition d’un modèle de psychiatrie, qui semble le plus pertinent. La psychiatrie institutionnelle a transformé des institutions aliénantes, quasi carcérales, pour en faire un des outils au service de la singularité du sujet ouvert sur la cité.
En matière de santé mentale, le politique est plus que jamais dans son rôle d’arbitrage. Il doit répondre à la question de savoir jusqu’où il peut aller pour faire avancer une question sensible sur un sujet aussi douloureux, tout en ne basculant pas dans une vulgarisation excessive, qui se traduirait par de mauvais choix politiques.
Il est temps de faire en sorte que la question de la santé mentale ne soit plus seulement l’affaire des spécialistes, mais constitue également une partie de notre conscience collective, plus éveillée. Au-delà de notre contribution, il nous faut refonder un investissement collectif sur ces sujets, c’est-à-dire trouver des points d’entrée convaincants et durables.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi aborde un sujet très délicat, qui se situe au confluent des enjeux de liberté publique et de sécurité publique. Cependant, il faut le dire d’emblée très clairement, il ne réussit pas à atteindre le point d’équilibre nécessaire entre ces deux impératifs, tel qu’il a été défini depuis longtemps par une jurisprudence constante du Conseil d’État.
Ce projet de loi est avant tout un texte sécuritaire, …

… dans lequel l’aspect médical peut être subordonné aux interventions, non seulement du préfet, mais aussi du juge.
Mon propos se limitera à l’irruption du judiciaire pour la protection des libertés publiques, qui ne sera en pratique le plus souvent qu’une illusion très difficile à mettre en œuvre, et qui n’apportera, à mes yeux, pas de garanties réelles.

De quelles informations disposera le juge pour aller à l’encontre du diagnostic médical ? En effet, l’internement sans consentement, soit à la demande d’un tiers soit à la demande de l’autorité préfectorale, est avant tout un traitement pour le malade psychiatrique dont l’état est évolutif, avant d’être une mesure privative de liberté. Le juge va donc s’immiscer dans ce traitement pour en décider éventuellement l’arrêt.
C’est le Conseil constitutionnel, dont la pratique du terrain, de ses difficultés et de ses exigences est certainement très grande, qui nous oblige à légiférer sous contrainte !
Sourires

D’ailleurs, depuis la dernière réforme de la Constitution, le Conseil constitutionnel entend se comporter comme une cour suprême. Encore faudrait-il que sa composition fournisse les garanties d’indépendance et d’impartialité qui caractérisent une telle instance. Or ce n’est pas le cas, même si ses membres sont honorables. Leur nomination est politique et, pour certains d’entre eux, il faut le dire, politicienne.

De plus, la présence des anciens présidents de la République ne fait que renforcer cet aspect. Qu’ils siègent ou non importe peu : il suffit qu’ils puissent siéger dans une affaire où ils pourraient emporter une majorité souhaitée.
Quoi qu’il en soit, le contrôle par le juge judiciaire peut se révéler difficilement praticable, comme d’autres dispositions du projet de loi.
En effet, les moyens sanitaires et judiciaires très importants qui seront requis par l’application de ce texte contrastent fortement avec les effectifs actuels, tant de la magistrature que des intervenants en psychiatrie, médecins et personnels infirmiers. À cet égard, l’étude d’impact n’apporte pas de réponse satisfaisante, bien au contraire.
Je voudrais d’ailleurs rappeler que, dans le rapport que Christiane Demontès, Gilbert Barbier, Jean-René Lecerf et moi-même avions consacré, voilà un an, aux troubles mentaux en milieu carcéral, nous n’avions pas retenu la solution imposée par le Conseil constitutionnel, qui ne nous avait pas semblé opportune, même si certains y avaient songé !
Déjà en 1978, l’article 40 de l’avant-projet de code pénal prévoyait de permettre à l’autorité judiciaire d’ordonner le placement puis la sortie de la personne atteinte de trouble mental. Cette solution avait finalement été écartée, car elle était très contestée, comme d’autres d’ailleurs. Elle tendait en effet à confondre le rôle du juge et celui du médecin.
Il n’en reste pas moins que l’intervention du juge, qui est obligatoire grâce au Conseil constitutionnel – très au fait des difficultés du terrain, ainsi que je l’ai déjà dit –, posera de nombreux problèmes qui ont été abordés, notamment par M. le rapporteur pour avis. Ce dernier a essayé, comme à son habitude, de les minimiser, mais le débat permettra peut-être de les approfondir et de les surmonter.
Je me bornerai donc à évoquer le point qui me paraît le plus crucial, à savoir les modalités d’intervention du juge.
De quel juge s’agit-il ? Le texte parle du juge des libertés et de la détention, qui est déjà submergé de travail et le sera encore plus avec la réforme de la garde à vue.
De plus, l’intervention du juge nécessitera la tenue d’une audience, avec un greffier, en présence d’un avocat, au sein de l’établissement hospitalier, du moins je le suppose. Les établissements concernés ont-ils déjà inscrit à leur budget les crédits nécessaires pour disposer, dès le mois d’août, de locaux permettant ces audiences, même s’ils ne sont pas somptueux, et l’entretien du malade avec son avocat ? Des financements sont-ils prévus par le ministère de la santé et les agences régionales de santé pour ces nouveaux investissements immobiliers ? J’en doute ! Quand on connaît la situation budgétaire des établissements hospitaliers aujourd’hui, qu’ils soient publics ou privés, on mesure bien les difficultés qui ne manqueront pas d’apparaître.
Ensuite, la possibilité pour le juge de demander une expertise – le juge ne se fiera pas forcément aux dires des médecins qui suivent le malade –, nécessitera de faire appel à des médecins extérieurs à l’établissement. Dans mon département, il faudra solliciter des experts se trouvant en dehors du ressort de la Cour d’appel, c’est-à-dire à Strasbourg, Nancy ou Dijon. Quel temps mettront-ils pour rendre leur expertise ? Ce délai doit-il être ajouté aux quatorze jours imposés par le Conseil constitutionnel ? Il me semble que oui, mais cela n’est pas évoqué dans le texte.
Par ailleurs, le juge devra rendre sa décision par l’intermédiaire d’une ordonnance, qui sera susceptible d’appel. Le texte prévoit une procédure totalement farfelue ; je pense, pour ma part, que l’appel devrait être interjeté selon la procédure de droit commun, c’est-à-dire devant la cour d’appel. Cet appel doit-il être suspensif ? Vraisemblablement. Le malade pourra-t-il sortir en cas d’appel de la décision du juge, par le préfet ou le ministère public, qui peuvent être représentés à l’audience ? Je le crois.
Pourquoi l’intervention du juge, qui est prévue pour les internements en hôpital, ne le serait-elle pas également pour contrôler l’application des soins ambulatoires sous contrainte, nouvelle modalité prévue dans le projet de loi qui ne sera peut-être plus là en fin de discussion ? Ce serait une bonne chose.
Le juge devrait également pouvoir, s’agissant d’un malade ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office antérieure, décider sa sortie en soins ambulatoires sous contrainte et contrôler la mise en œuvre de cette mesure, à intervalles réguliers à définir.
Enfin, le juge judiciaire devrait pouvoir statuer sur l’arrêté même d’internement émanant du représentant de l’État, comme l’a proposé, je le crois, la commission des lois. Or le texte a prévu que cet arrêté d’internement relève du juge administratif. C’est une complication supplémentaire ajoutée à une procédure déjà très compliquée.
Le Conseil constitutionnel a admis que la loi puisse organiser des blocs de compétences. En l’occurrence, ceux-ci doivent être réalisés, me semble-t-il, au profit des juges judiciaires.
Ce texte – je le répète, car c’est l’un de mes « dadas » – nous permet une nouvelle fois de percevoir la complication extrême de notre système juridique, à savoir l’existence de deux ordres de juridiction parallèles, la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, qui ne se rencontrent jamais sauf, éventuellement, au niveau du Tribunal des conflits.
Certes, le Conseil constitutionnel a estimé en 1987 que ces deux ordres de juridiction avaient une base constitutionnelle ; je pense que c’est un bon sujet de méditation pour une prochaine modification de notre Constitution, certainement plus adéquate que l’introduction, dans la norme suprême, de l’équilibre des finances locales que nous présente actuellement le Gouvernement.
Mon collègue Jacky Le Menn vous a exposé la position de notre groupe sur ce texte. Vous comprendrez que la pseudo-garantie judiciaire n’y change rien : nous sommes résolument contre ce projet de loi !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes face à un projet de loi qui privilégie le sécuritaire au détriment du sanitaire.
Ce qui nous divise profondément dans le traitement de ce sujet, madame la secrétaire d’État, c’est notre conception, notre approche de la folie. Faut-il avoir peur des fous ? Faut-il punir ou guérir ? Et comment guérir ? Par la parole ou par la seringue ?
Votre projet de loi, madame la secrétaire d’État, s’inspire d’une vieille représentation populaire, celle du fou dangereux, du fou errant, et ne s’intéresse pas à la souffrance psychique de milliers de Français.
Ce texte ne s’appuie en rien sur la réalité clinique du soin en psychiatrie. §
Votre souci n’est pas que la loi soit appliquée – sinon vous auriez prévu davantage de moyens –, encore moins d’améliorer la situation de ceux qui auront à en subir les effets. Non, ce projet de loi ne sert qu’à afficher la force de l’État-gendarme.

Une fois de plus, la loi dénigre un corps professionnel : après les policiers, les enseignants, les chercheurs, les magistrats, ce sont, aujourd'hui, les personnels hospitaliers.
Était-ce si compliqué de s’appuyer sur les avis des psychiatres quand on prétend réformer la psychiatrie ?
Au lieu de cela, le chef de l’État et le Gouvernement se sont emparés du sensationnel – un fait divers dramatique – pour mieux entretenir une logique sécuritaire et répressive des politiques publiques.
Dans ce projet de loi, on se préoccupe peu des conditions d’accueil des malades, de la formation pour les professionnels, et encore moins des budgets pour l’ensemble de la psychiatrie. Un véritable projet de loi sur l’organisation de la santé mentale défendrait le secteur. Ce n’est pas le cas ici.
En filigrane, on retrouve votre refus de la prise en considération des problèmes sociaux des patients, l’obligation de soins désignée comme la seule réponse efficace et le médicament comme seul soin fiable.
L’idée de ce texte, c’est de garantir non la sûreté des malades mais celle des non-malades.
Vers quelle dérive allons-nous si la question du trouble à l’ordre public prédomine sur la préoccupation de la qualité des soins ? Si au lieu d’examiner la situation des 82 % de malades qui choisissent l’hospitalisation libre, on préfère se concentrer sur la minorité qui est hospitalisée sous contrainte ?
Selon vous, il est préférable d’enfermer un malade, même s’il n’est pas dangereux, plutôt que de courir un risque à l’extérieur. Étant donné le manque de moyens, on ne peut pas enfermer tout le monde à l’hôpital psychiatrique ; donc, on va enfermer les gens chez eux !
Vous allez tenter d’imposer un contrôle social généralisé de la normalité des comportements, sans même vous poser la question de l’applicabilité d’un tel objectif.
Ce projet de loi tend à introduire la rupture du lien entre le soignant, le soigné et son entourage, en mettant en place une défiance généralisée, sans s’appuyer sur la compétence des équipes soignantes.
Un véritable dialogue doit aboutir à des décisions de soin prises avec le patient et non contre sa volonté. Vous vous en remettez au pouvoir de la chimie, des injections, au détriment de la thérapie par la parole. §
Ce texte va produire l’inverse de l’effet escompté.
Alors, qu’aurions-nous souhaité, nous qui attendons depuis presque quinze ans la modernisation de la loi de 1990 ?
Premièrement, un bilan de cette loi aurait permis un recul critique, un progrès. Nous aurions également souhaité que les vingt-deux mesures d’urgence réclamées par les états généraux de la psychiatrie de 2003 soient prises en compte.
Les écologistes, avec d’autres, souhaitent ouvrir les hôpitaux à la cité, en mettant en place des structures ouvertes, plus diverses et qui communiquent avec l’extérieur, en améliorant l’offre d’hôpitaux de jour, de structures alternatives comme les appartements thérapeutiques, en autorisant davantage de sorties d’essai.
Il faut aussi rendre l’hôpital plus attractif pour les jeunes diplômés et améliorer la formation, car le besoin de personnel soignant est cruel.
Enfin, il faut impérativement favoriser l’hospitalisation libre. La contrainte ne doit pas être systématisée.
En 2009, le Gouvernement a alloué 70 millions d’euros aux hôpitaux psychiatriques. Ils ont servi à mettre plus de barreaux aux fenêtres et de caméras de surveillance… Pire, interdiction a été donnée aux directeurs d’hôpitaux d’utiliser ces moyens pour d’autres objectifs, alors que, depuis dix ans, 50 000 lits ont été supprimés !
Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas de ceux qui veulent faire des économies de moyens et n’apporter que le médicament et la contention comme réponses aux patients.
À l’heure actuelle, les hôpitaux fonctionnent à flux tendus. Faute de place, certaines personnes qui voudraient être hospitalisées librement passent par des hospitalisations à la demande de tiers. Le directeur d’établissement est alors contraint de faire sortir un patient, qui peut encore avoir besoin de soins, pour en laisser entrer un autre. C’est insupportable !
Alors, avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « nous disons que tout cela est insupportable », car la logique de l’enfermement tire tout le monde vers le bas.
Les sénatrices et sénateurs d’Europe Écologie-Les Verts sont indignés par ce texte !
Madame la secrétaire d’État, à vous embourber dans le tout sécuritaire, à persévérer dans le fantasme du risque zéro, vous ne réglerez rien, sauf à attiser la peur du malade et à rendre encore plus difficile le travail des équipes médicales et des magistrats.
Vous l’aurez compris, nous sommes opposés à ce texte. En guise de conclusion, je vous rappelle que la liberté aussi est thérapeutique !
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
En écoutant les intervenants des différents groupes, je suis moi aussi affligée. Après le témoignage poignant de l’un de vos collègues, la lecture caricaturale que vous faites de ce texte n’est pas à la hauteur !
Nous prévoyons une alternative à l’enfermement, nous sommes particulièrement attentifs aux patients afin de les remettre en liberté et non plus uniquement les enfermer, afin de leur proposer une prise en charge moderne en ambulatoire, de rester dans leur environnement, auprès de leur famille, et vous taxez ce projet de loi de sécuritaire et liberticide !
Nous évoquons de nouvelles modalités d’accueil thérapeutique, notamment dans la rue où j’ai pu constater qu’il était possible, avec des équipes mobiles, de prendre en charge des personnes désocialisées, et vous nous parlez de piqûres et d’injections !
Votre lecture du projet de loi est complètement biaisée. Ce texte a pour objet, dans l’intérêt des malades, de proposer une nouvelle forme de soins. Pourquoi la prise en charge ambulatoire, qui est possible pour le cancer, le diabète, le VIH, les maladies infectieuses et autres, serait-elle interdite en psychiatrie, alors que c’est une forme moderne répondant aux attentes des usagers et des familles ?
Cette lecture caricaturale du texte m’afflige. Vous êtes vraiment très loin de ses objectifs, en tout cas de la volonté du Gouvernement de moderniser la loi du 27 juin 1990 pour l’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles formes de prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Je suis saisi, par Mme Borvo Cohen-Seat, M. Fischer, Mmes Pasquet, David et Hoarau, M. Autain et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, d'une motion n°83.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la motion.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, chers collègues, le règlement veut que la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité soit défendue après la clôture de la discussion générale. Cette règle, je le répète, me semble un peu bizarre. Peut-être faudra-t-il, un jour, la modifier. Cela étant dit, madame la secrétaire d'État, votre réponse n’était guère convaincante et ma défense de la motion d’irrecevabilité ne s’en trouvera pas gênée.
Pourquoi cette motion d’irrecevabilité ?
Tout d’abord, il faut savoir dire « non » à une politique dont la déclinaison sécuritaire dans tous les domaines est inquiétante et cache la dégradation tout aussi inquiétante des politiques publiques, en l’occurrence en matière de santé et particulièrement de santé mentale.
Ce projet de loi – le législateur est habitué à cette pratique – était annoncé par le discours du Président de la République à Antony, le 2 décembre 2008, qui peut se résumer ainsi : à la suite d’un épouvantable fait divers, le Président de la République « se faisait fort » d’empêcher que cela ne se reproduise, en généralisant la contrainte et l’enfermement.

Le rapporteur pour avis de la commission des lois prend soin de dire qu’il faut éviter tout amalgame entre troubles psychiatriques, délinquance et dangerosité, et de rappeler que c’était le cas dans le projet initial de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, sur lequel la majorité avait été obligée de « surseoir ».
D’ailleurs, notre rapporteur étaye son propos en précisant que les individus souffrant de troubles mentaux sont très rarement impliqués dans des actes de violence à l’égard de tiers – dans 3 % des actes de violence grave, me semble-t-il –, sont plus souvent victimes qu’auteurs des violences, soit sept à dix-sept fois plus que l’ensemble de la population, et sont souvent aussi, hélas ! auteurs de violences sur eux-mêmes, qu’il s’agisse de mutilations ou de suicides.
Pourtant, le texte qui nous est proposé est centré sur le faible nombre de patients susceptibles de présenter un danger pour autrui, non pas pour s’intéresser spécifiquement à eux, mais pour édicter des mesures concernant l’ensemble des personnes atteintes de troubles psychiques, soit plusieurs centaines de milliers.
Or pour l’ensemble des malades et de leurs familles, pour la société et, en l’occurrence, pour le législateur, la question qui se pose est celle de la dégradation de la psychiatrie, des moyens de l’hôpital public et de l’abandon de la psychiatrie de secteur.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, cité par notre collègue, a récemment critiqué avec sévérité l’état des lieux actuel de l’hospitalisation psychiatrique et les effets du parti pris uniquement sécuritaire des pouvoirs publics, à savoir « le grand retour de l’enfermement pour tous les malades », par peur : peur des professionnels, les psychiatres, et peur des préfets, rappelés à leur responsabilité directe par une circulaire de 2010.
Il faut dire stop !
Les psychiatres, au-delà de leurs divergences – elles existent –, les personnels, tous ceux qui sont concernés – les malades, les familles, les associations – demandent une grande loi de santé mentale digne de notre époque.
Permettez-moi de rappeler les propos que tenait Lucien Bonnafé en 1985, propos toujours ô combien actuels : « Je pense que la loi qui se substituerait à la loi de 1838 devrait concerner l’organisation d’une médecine publique préventive et curative, ouverte à tous, mais particulièrement adaptée aux besoins des catégories de personnes que leur âge, leur maladie ou leur dépendance ne mettent pas toujours en mesure de prendre elles-mêmes l’initiative d’actions préventives ou de soins que leur état exige : malades mentaux, vieillards, enfants et adolescents, sujets soumis à la dépendance d’une drogue. »
Ce projet, rêvé, mais qui n’a jamais été mis en œuvre, est à la fois d’une grande actualité et tellement précurseur. Lucien Bonnafé précisait ainsi à l’article 1er du projet de loi qu’il imaginait : « L’autorité judiciaire ainsi saisie ayant tout pouvoir d’exercer les contrôles qu’elle estime utiles et d’imposer l’arrêt des traitements imposés et de la limitation des libertés, sous réserve d’entendre le malade lui-même, le médecin et, plus largement, ceux qui participent aux soins et aux contraintes, et l’entourage. »
Ce que vous nous proposez aujourd’hui est aux antipodes de ce qu’imaginait Lucien Bonnafé.
Aussi, après le refus général de légiférer à contresens sur la santé mentale, permettez-moi de dire, madame la secrétaire d’État, que le texte du Gouvernement continue de poser de sérieux problèmes de libertés. Je dis « continue », parce que le Gouvernement a dû modifier son projet de loi initial pour tenir compte, contraint et forcé, de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel en novembre 2010 imposant l’intervention du juge des libertés et de la détention. Il a dû réviser, par lettre rectificative, le contenu du texte.
Or, si le Gouvernement tient compte de l’impératif posé par les juges constitutionnels d’une révision législative avant le 1er août 2011, il ignore le constat formulé en filigrane par le Conseil constitutionnel, à savoir que les soins psychiatriques pratiqués sous contrainte sont d’abord et avant tout des mesures privatives de liberté. Or votre texte, madame la secrétaire d’État, renforce considérablement tous les aspects des soins sous contrainte !
Comme le dit la Commission nationale consultative des droits de l’homme : « L’hospitalisation complète sans consentement devient l’une des phases ou modalités d’un parcours de soins sans consentement impliquant des obligations ou contraintes qui peuvent s’exercer en établissement, mais aussi hors des murs, au domicile ou dans d’autres lieux de vie, comme par exemple dans une habitation protégée ou dans une maison de retraite. »
Le malade passe par une sorte de garde à vue psychiatrique de soixante-douze heures, au terme de laquelle soit il demeure en hospitalisation contrainte, soit il est placé en soins ambulatoires sans consentement.
Dans le même temps, le projet de loi renforce l’hospitalisation sans consentement puisqu’il ajoute à l’hospitalisation contrainte et à l’hospitalisation à la demande d’un tiers, l’hospitalisation en l’absence de tiers, en cas de « péril imminent ».
On voit bien le sens de cette réforme : il s’agit de renoncer à une politique de secteur – la preuve en est que les moyens des secteurs ont disparu – et de renforcer le contrôle social par la contrainte, avec à la clé de nombreux problèmes, par exemple en ce qui concerne les soins ambulatoires sous contrainte, que vous semblez considérer, madame la secrétaire d’État, comme étant la panacée.
Vous tentez de gagner la confiance des familles, dont on comprend les souffrances, en leur affirmant que des protocoles rigoureux seront mis en œuvre. En réalité, il n’en est rien, comme l’atteste l’article 2 de ce projet de loi : en effet, bien qu’il y soit question d’un suivi thérapeutique, aucun n’en est organisé. Nous connaissons d’avance le seul protocole qui sera suivi : le non-respect du parcours de soins imposé aux patients, c’est-à-dire principalement le traitement médicamenteux, entraînera de facto l’intervention d’une équipe. Il s’agira non pas d’une équipe médicale ayant pour mission de tenter de rétablir la relation indispensable entre le patient et le soignant, mais d’une équipe médicale d’urgence, accompagnée, le cas échéant, des forces de l’ordre. Sa mission sera, au choix, d’injecter de force le traitement au patient ou de le conduire vers un nouvel établissement, où il sera de nouveau privé de sa liberté.
Ce dispositif n’est pas sans rappeler la rétention de sûreté. Vous faites comme si le patient était libre de refuser son traitement. Or ce refus entraîne immédiatement l’application d’une mesure privative de liberté !
Comme le soulignait Robert Bennett : « Si vous arrivez à contrôler le processus du choix, vous pouvez contrôler tous les aspects [d’une] vie ». Voilà comment, dans les faits, vous contraigniez les patients à opter pour un renoncement ou pour un autre : soit ils renoncent à leur liberté de mouvement, soit ils renoncent à un parcours thérapeutique construit, élaboré en collaboration avec l’équipe médicale. Nous comprenons les associations de parents ou de proches de personnes atteintes de troubles mentaux qui cherchent des solutions, mais le retour au domicile sans aucune forme d’accompagnement médical n’est pas la bonne solution, ni pour eux ni pour les malades, sauf à considérer que, un jour, les familles seront responsables du suivi par les malades de leur traitement…
Vous réduisez la psychiatrie au traitement de la crise, plus d’ailleurs dans un souci d’ordre public – soyons francs – que dans l’intérêt du malade. J’en veux pour preuve la circulaire mettant en place les schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération, les SROS 3, en psychiatrie : elle prévoyait clairement que la mission de la psychiatrie était de dépister les troubles et de mettre en place un traitement ou de traiter la crise, puis de passer la main au médecin généraliste.
J’en viens au contrôle de la privation de liberté, c'est-à-dire aux droits des patients, soit des centaines de milliers d’hommes et de femmes qui souffrent de troubles psychiatriques.
Le projet de loi ne manque évidemment pas de rappeler les droits et les possibilités de recours des malades – le Conseil constitutionnel veille ! Mais nous le savons, et le Contrôleur des lieux de privation de liberté l’a largement signalé, l’exercice de ces droits par des personnes moralement fragilisées et privées de contact avec des tiers est quasiment impossible.
Or le contrôle par le juge judiciaire au-delà de quinze jours que vous avez été obligés d’instituer est loin d’être conforme aux préconisations du Conseil constitutionnel en général, qui réclame une intervention dans un « délai le plus court possible, habituellement estimé à quarante-huit heures ». Alors que la période obligatoire d’observation de soixante-douze heures s’apparente à une garde à vue psychiatrique, le malade est loin de disposer des mêmes garanties que celles qui sont imposées aujourd’hui pour la garde à vue !
Par ailleurs, la question d’une intervention a priori du juge des libertés et de la détention méritait d’être posée, ce qui est loin d’être le cas.
De même, il est peu acceptable que le contrôle du juge judiciaire, qui se prononce – certes tardivement – après un délai de quinze jours en cas d’hospitalisation contrainte, ne porte pas du tout sur les soins ambulatoires sous contrainte.
Autre sujet de préoccupation : ce projet de loi opère un renversement des rôles entre autorité administrative et autorité médicale.
Les soignants deviennent des auxiliaires de police, puisqu’ils ont comme priorité la lutte contre les troubles à l’ordre public.
Quant aux préfets, ils se voient confier des pouvoirs supplémentaires, y compris dans le champ médical. Ainsi pourraient-ils désormais décider, contre l’avis du corps médical, de prolonger l’hospitalisation complète et sans consentement d’un malade hospitalisé d’office.
Les préfets pourront donc effectuer des choix à vocation thérapeutique sans avoir la formation adéquate, à moins que ces éventuelles décisions ne revêtent en réalité un aspect uniquement sécuritaire ? Si tel devait être le cas, il s’agirait évidemment d’une violation manifeste de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a un caractère constitutionnel.
De la même manière, ce projet de loi renforce considérablement le processus applicable aux sorties thérapeutiques en substituant à une autorisation tacite du préfet une autorisation expresse. S’il n’était pas illégitime que le préfet soit informé de telles sorties, il n’est en revanche pas acceptable qu’il puisse s’y opposer, sa non-réponse étant une présomption de refus. Or ces sorties ont une vocation médicale et font pleinement partie du processus de soins. Il s’agit, selon l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, de « favoriser [la] guérison, [la] réadaptation ou [la] réinsertion sociale » des personnes ayant fait l’objet « d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office ».
Si l’appréciation de l’état de santé mentale de la personne relevait jusqu’à présent des seuls médecins, tel ne sera plus le cas si ce projet de loi est adopté, car il légalise la circulaire du 11 janvier 2010, signée à la fois par le ministre de la santé et celui de l’intérieur.
Ajoutons que l’acceptation ou le refus de sortie par le préfet n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Ce n’est pas acceptable !
Nous considérons également que le « casier psychiatrique » n’est conforme ni au principe du secret médical ni aux libertés fondamentales. Celui-ci est censé permettre aux préfets d’interrompre ou non l’hospitalisation sous contrainte. La circulaire susmentionnée préfigurait d’ailleurs cette situation, puisqu’elle exigeait que les circonstances de l’hospitalisation – dates, antécédents d’hospitalisation d’office – soient relatées.
Ce casier tend à faire croire que la psychiatrie est une médecine prédictive. Ceux qui défendent cette théorie font mine de croire, ou veulent faire croire, qu’il serait possible de deviner le comportement d’une personne malade sur le seul fondement d’un historique. Ils ne croient pas à la notion de guérison ni même à celle d’évolution. Cela fait écho à la théorie du criminel-né de Lombroso : certains seraient nés pour devenir criminels.
Ce fichier, qui donne plus de prérogatives aux préfets, crée ainsi, discrètement, mais sûrement, une nouvelle police : la « police sanitaire », la famille et les médecins devenant tout à tour des délateurs éventuels et des auxiliaires de police.
Au surplus, le projet de loi prévoit que le recours engagé contre la décision du juge des libertés et de la détention de lever la mesure d’hospitalisation complète sera suspensif. Or l’effet non suspensif des recours est un principe de portée générale ; il a un caractère fondamental, en liaison étroite avec la présomption de légalité des actes administratifs dont résulte leur force exécutoire immédiate. Cette dérogation est largement attentatoire aux droits des personnes.
Enfin, il n’est pas acceptable de proposer le recours à la visioconférence dans les rapports entre le juge et les personnes hospitalisées en psychiatrie. Indépendamment de la question des moyens, comment osez-vous seulement penser à une pareille mesure ?
Ce projet de loi, mes chers collègues, est nourri par la défiance à l’encontre des médecins, que l’on oppose aux citoyens, et la peur, alimentée notamment par les discours de ceux qui voudraient nous faire croire à une société sans risques.
Le poète portugais Alexandre O’Neill a écrit : « Je pense à tout ce que la peur va posséder et j’ai peur, c’est justement ce que la peur attend de moi ». Je refuse que cette peur, instrumentalisée à dessein, l’emporte sur la raison, qu’elle se nourrisse sans raison d’elle-même, qu’elle gagne sur les libertés individuelles et sur l’humanité.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à refuser cette vision désespérante de l’autre et à voter cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. §

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cette motion.
Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Mes chers collègues, tout au long de ce débat, je donnerai à la fois l’avis de la commission et mon avis personnel. N’y voyez pas là un symptôme de schizophrénie ; je serai plutôt un Janus à deux faces !
Selon moi, ce projet de loi n’est pas inconstitutionnel, bien au contraire : l’un de ses objets essentiels est de mettre le droit relatif à l’hospitalisation sans consentement en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel en date du 26 novembre 2010.
À titre personnel, je vous demande donc, mes chers collègues, de rejeter la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la motion n° 83, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe CRC-SPG, et l'autre, du Gouvernement.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 203 :
Le Sénat n'a pas adopté.

conduite par M. Miroslav Antl, président de la commission des lois et des affaires constitutionnelles. La délégation a été accueillie au Sénat par notre collègue Patrice Gélard, vice-président du groupe d’amitié France-République tchèque.
Cette visite marque la poursuite de la coopération parlementaire entre nos deux pays.
Au nom du Sénat de la République, je souhaite la bienvenue à nos collègues sénateurs et je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié entre nos deux pays.
Applaudissements

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Nous poursuivons l’examen des motions.

Je suis saisi, par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n°1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme Christiane Demontès, auteur de la motion.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, la santé mentale, nous l’avons encore constaté cet après-midi, est un sujet humainement et médicalement sensible.
Concept large, elle recouvre, selon l’Organisation mondiale de la santé et l’Union européenne, trois dimensions : les troubles mentaux tels que les troubles psychotiques, la détresse psychologique ou souffrance psychique, qui traduit un état de mal-être, enfin, la santé mentale positive qui conditionne une existence réussie.
Ces trois dimensions sont évolutives, comme cela est souligné dans le rapport du groupe de travail présidé par Viviane Kovess-Masféty, du Centre d’analyse stratégique : c’est l’ensemble « des grands intégrateurs ou domaines de la vie collective que sont l’école, la famille, le quartier de résidence, etc. qui est désormais perçu de manière ambivalente dans leur contribution positive et négative au bien-être ».
En d’autres termes, dans une société qui place les capacités concurrentielles, d’innovation et d’adaptation au centre de son économie, et qui, dans le même temps, fait l’apprentissage d’une hétérogénéité sociale et culturelle renouvelée, la santé mentale est devenue un point essentiel et médiatisé.
Le texte que nous examinons ne concerne, cela a déjà été dit, que les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Il s’agit d’une portion infime des 20 % de nos concitoyens qui sont, à des degrés divers, concernés par les troubles mentaux. Ainsi, 1, 3 million d’entre eux sont pris en charge, dont 70 % en ambulatoire – vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État –, et 1 % de notre population, soit 600 000 personnes, souffre de schizophrénie.
Les pathologies psychiatriques sont la première raison de l’attribution d’une pension d’invalidité. Elles sont le second facteur médical d’arrêt de travail, et leur prise en charge globale représente de 3 % à 4 % du PIB européen. C’est dire l’importance sociale, économique mais surtout humaine que revêt la question de la santé mentale.
Ce texte ne concerne donc qu’une partie minime de cette population en souffrance, soit environ 70 000 personnes qui, chaque année, sont hospitalisées sans consentement, à la demande d’un tiers ou en hospitalisation d’office.
Ce chiffre est en France, selon les périodes considérées, deux à quatre fois plus élevé qu’au Royaume-Uni et deux fois plus important qu’en Italie pour des populations à peu près similaires. Notre pays est l’État européen qui fournit à la Cour européenne des droits de l’homme le plus grand nombre de contentieux relatifs à la psychiatrie.
Ajoutons à ce court bilan – et ce n’est pas la moindre des dimensions –, que les familles et l’entourage sont souvent en prise directe avec ces souffrances et éprouvent aussi bien des difficultés.
L’ensemble de ces données doit nous inciter à nous interroger sur notre faible capacité à dialoguer, à trouver des solutions alternatives à cette extrême violence – même si elle est parfois incontournable – qu’est l’hospitalisation sans consentement.
Cette forme de prise en charge spécifique s’inscrit depuis la loi fondatrice de 1838, réformée par la loi de 1990, dans un régime dérogatoire. À la demande d’un tiers ou en raison d’un trouble grave à l’ordre public, ou bien encore du fait d’une mise en cause de la sécurité des personnes et dans leur intérêt propre, ces patients sont les seuls malades pour lesquels la loi autorise un maintien à l’hôpital sans leur consentement.
Je rappelle que le texte de la loi de 1990 disposait qu’elle devait être révisée cinq ans après son adoption. Vingt ans après, toujours rien…
Le projet de loi qui devait nous être présenté l’automne dernier avait pour ambition affichée de réformer la loi du 27 juin 1990, que les familles comme les professionnels jugeaient nécessaire de modifier, car elle était en décalage avec la lettre et l’esprit de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Nous avions espéré travailler sur une grande loi de santé mentale comme l’avait promis la ministre de la santé de l’époque, Mme Bachelot, à l’occasion de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST.
Affirmer que la psychiatrie française est en grande souffrance est un euphémisme. Notre collègue Alain Milon, dans son rapport de 2009 sur la prise en charge psychiatrique en France, jugeait son état « des plus inquiétants ». Mais comment en serait-il autrement lorsque la politique constante de ces dernières années a été de fermer plus de 55 000 lits sans que des structures alternatives de prise en charge telles que des appartements et/ou des centres d’accueil thérapeutiques aient été ouvertes ?
Comment ce secteur de la santé publique pourrait-il bien se porter quand le mot d’ordre est d’effectuer des hospitalisations de plus en plus courtes avec, pour corollaire, l’éviction de patients non encore stabilisés et qui ne savent pas où aller ?
Et que dire de l’impact de ces décisions sur la qualité de notre système de prise en charge et de soins, alors que près de 10 % des effectifs de soignants ont disparu en cinq ans, que les parents qui recherchent une place en hôpital de jour n’en trouvent pas, et que les demandes de rendez-vous sont satisfaites parfois des mois après leur formulation ?
Nous sommes face à un système au bord de l’éclatement qui, malgré la qualité de l’ensemble des personnels, notamment des soignants, génère bien souvent désespoir et sentiment d’abandon.
L’urgence d’une grande loi sur la santé mentale est une évidence qui n’est toujours pas satisfaite. À la place, le Gouvernement, contraint par la décision prise le 26 novembre dernier par le Conseil constitutionnel, présente au Sénat un texte à l’architecture et à la cohérence précaires nonobstant son accent sécuritaire.
Plus que jamais, et quoi que vous en disiez, madame la secrétaire d’État, le fonds de commerce de la crainte, de la stigmatisation et de l’exclusion a pris le pas sur les considérations sanitaires. Je dis plus que jamais, parce qu’en 2004 le ministre de l’intérieur avait eu l’intention, cela a été dit par M. Desessard, de réformer l’hospitalisation sous contrainte via une loi de prévention de la délinquance. Cet amalgame avait été jugé légitimement scandaleux, à tel point qu’il a été contraint de retirer son texte ! Mais devenu Président de la République, il a, au détour d’un drame, réitéré. Comment ne pas se souvenir du discours d’Antony, de l’annonce de la multiplication des chambres d’isolement, des contrôles préfectoraux sur les sorties et des bracelets électroniques pour les malades ? L’amalgame entre malade, délinquant, prévenu, détenu est donc de mise au plus haut niveau de l’État.
Dès lors, comment être surpris que ce projet de loi ait réussi le tour de force de faire presque l’unanimité des professionnels et d’un grand nombre de familles contre lui ?
Ce texte a donc bien pour objet de constituer une réponse à cette dimension complexe et centrale qu’est le soin sans consentement.
Il s’inscrit dans une triple problématique.
La première a trait à l’évaluation des risques que présente le malade, la seconde aux soins et à l’amélioration qu’ils apportent à son état de santé. Enfin, par voie de conséquence, est posée la question du maintien ou non en hospitalisation sans consentement.
Ces dimensions nous permettent de saisir combien ce texte est appréhendé sous le sceau de la sécurité publique et non sous celui de la santé publique.
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, aucun texte n’a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Nous examinons donc le texte de l’Assemblée nationale, qui demeure trop peu protecteur quand sa vocation sécuritaire persiste. Son architecture est déséquilibrée, et son contenu très insuffisant.
Une des sources principales de ce déséquilibre réside dans le fait que le texte ne s’inscrit pas toujours dans la même logique. Il en est ainsi de la judiciarisation du parcours de soins. Elle est de mise notamment via le contrôle systématique, par le juge des libertés et de la détention, des hospitalisations sous contrainte au bout de quinze jours, puis de six mois. Il en va de même s’agissant du respect des principes généraux de notre droit et, plus singulièrement, du principe du contradictoire, qui s’impose à toute décision civile, administrative, pénale ou disciplinaire.
À ce propos, comment imaginer que la visioconférence puisse être un outil adapté pour des personnes atteintes de troubles psychiatriques ? Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours du débat.
Ce texte présente donc de nombreuses insuffisances. Le malade et la garantie du respect de ses droits doivent évidemment se trouver au premier rang. La prise en compte de la souffrance, la nécessité d’établir des relations de confiance avec le psychiatre et l’équipe soignante nous semblent aussi mal appréhendées. Ce défaut prévaut également pour des éléments comme la prise en compte des possibles évolutions médicales de la personne, le droit à l’oubli et l’information due à la famille ou à l’entourage. Enfin, je pense au doute concernant la gestion que le Gouvernement compte faire de la sectorisation. C’est aujourd'hui l’élément essentiel de l’organisation des soins psychiatriques en France. Or rien n’est précisé à ce sujet dans le texte.
La mise en œuvre de ce projet de loi nous semble, quant à elle, problématique. L’étude d’impact démontre que le nombre de juges et de greffiers nécessaires à la mise en application du texte n’est pas, ou du moins ne sera pas, au rendez-vous le 1er août. Quels sont les moyens financiers et en personnels dévolus au suivi des malades, pourtant si indispensable ?
Contrairement à ce que vous avez affirmé, madame la secrétaire d’État, le présent projet de loi n’est donc pas « nuancé et équilibré ». Comment le serait-il d’ailleurs puisque, loin de la nécessaire prise en compte des réalités et des urgences de terrain, le Gouvernement a choisi de privilégier une fois de plus la logique sécuritaire et l’opportunisme politique qui caractérisent si bien son action ?
Il eût été nécessaire d’élaborer un plan de santé mentale incluant la recherche, l’accompagnement, la formation, la prévention ainsi que des moyens financiers et en personnels adéquats. Tel n’est malheureusement pas le cas.
Mes chers collègues, compte tenu des éléments que je viens d’évoquer et du fait que le projet de loi ne répond pas à l’objectif affiché dans son exposé des motifs, en l’occurrence « l’amélioration de la qualité et de la continuité des soins », nous vous proposons d’adopter la présente motion tendant à opposer la question préalable. §

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission a émis un avis favorable sur cette motion tendant à opposer la question préalable.
Mais, en réalité, l’adoption d’une telle motion ne constituerait pas une réponse adaptée aux interrogations que la législation actuelle suscite.
Le contrôle juridictionnel imposé par le Conseil constitutionnel doit impérativement entrer en vigueur à partir du 1er août prochain. Par conséquent, nous n’avons pas assez de temps pour envisager le dépôt d’un nouveau texte, et nous devons d’ores et déjà adopter un certain nombre de mesures pour nous mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles.
C'est la raison pour laquelle je suis, à titre personnel, défavorable à l’adoption de la présente motion.
Avis défavorable.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 204 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance, de cinq à dix minutes.

M. le président. Je vous en accorde dix, madame la secrétaire d’État : ainsi, vous ne serez en retard que de cinq minutes !
Sourires.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinq.

La séance est reprise.
Les deux motions ayant été repoussées, nous passons à la discussion des articles.
TITRE Ier
DROITS DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES

L'amendement n° 41, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune mesure de soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète ne peut être décidée sur le fondement d’une atteinte à l’ordre public défini à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Guy Fischer.

Cet amendement vise à revenir sur une ancienne disposition, qui est contestée par de très nombreux professionnels de la psychiatrie ainsi que par une partie des associations de malades ou de proches de malades, puisqu’elle confie à la psychiatrie une mission qui ne devrait pas être la sienne : celle de faire respecter l’ordre public. À moins qu’il s’agisse – c’est notre conviction – non pas d’un transfert de mission, mais d’un prétexte, la psychiatrie servant de justification à une mesure privative de liberté jusqu’alors non encadrée.
Même si le Gouvernement tente d’être rassurant en affirmant que l’application de ce projet de loi n’entraînera pas d’augmentation des soins pratiqués sous contrainte, nous ne devons pas perdre de vue que la France est déjà le pays européen qui recourt le plus à des mécanismes d’hospitalisation contrainte pour motifs psychiatriques. Il est aussi l’un de ceux qui prescrit le plus de psychotropes, sans résultats satisfaisants. La psychiatrie actuelle, qui tend, par manque de moyens, à reposer sur ces deux piliers que sont les médicaments et l’enfermement est, effectivement, en échec.
Cet échec est d’autant plus important que les motifs d’enfermement ne sont pas médicaux et que, comme le souligne le docteur Hervé Bokobza, l’on tente – c’est le cas avec ce projet de loi – de transformer le psychiatre en le mettant « dans une position d’expert en ordre public, et non plus de soignant ».
Convenez, mes chers collègues, que le fait de tenter d’apporter des soins à une personne qui souffre, de tenter avec elle, et non contre elle, de l’emmener vers la voie de la guérison est une chose bien différente que de l’enfermer, ne serait-ce que soixante-douze heures, afin de faire cesser le trouble qu’elle cause à la société.
L’ordre public renvoie d’abord et avant tout à la tranquillité des autres acteurs de l’espace public. Or le rôle des psychiatres est-il vraiment de priver de liberté un individu durant soixante-douze heures, de lui administrer contre son gré des médicaments et de l’inscrire sur un casier psychiatrique, ce qui pourrait un jour se retourner contre lui, uniquement pour faire cesser un trouble ? Nous ne le croyons pas.
Naturellement, des équipes soignantes doivent intervenir. Cela implique de s’interroger sur la politique de secteur, politique abandonnée pour des motifs tant idéologiques qu’économiques, et sur la question du temps disponible.
Cet amendement n’a pas pour objet de laisser les personnes en souffrance seules ni, comme certains pourraient être tentés de le dire, d’exposer nos concitoyens à des risques. Cependant, c’est sans doute un point de désaccord fondamental avec la majorité et le Gouvernement, nous considérons que les personnes en souffrance psychique ne sont pas toutes dangereuses pour autrui, quand bien même l’expression de leur souffrance troublerait l’ordre public.
Tels sont les éléments que je souhaitais rappeler à l’occasion de la présentation de cet amendement.

La commission a émis un avis favorable.
Cet amendement vise à supprimer le critère de l’atteinte à l’ordre public pour les hospitalisations sans consentement. La portée de cette notion a déjà été réduite, puisque le trouble doit être grave pour mettre en œuvre ce type d’hospitalisation. Il n’apparaît pas souhaitable d’aller au-delà. C’est pourquoi, à titre personnel, j’émets un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
L’hospitalisation à la demande de l’autorité publique ne peut être effective que lorsqu’il est établi que la personne nécessite des soins médicaux et que, par ailleurs, il est constaté que son comportement présente des risques pour l’ordre public ou pour la sécurité des personnes.
Le code de la santé publique ne renvoie pas à la définition de l’ordre public du code général des collectivités territoriales, mais cette notion est très encadrée, notamment par la jurisprudence.
Pour être tout à fait honnête, j’avoue que je ne comprends pas bien l’objet de cet amendement, sauf à considérer que ses auteurs souhaitent purement et simplement supprimer la procédure même de l’hospitalisation à la demande de l’autorité publique.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 42, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La nation assure la satisfaction des besoins en santé des populations atteintes de troubles ou pathologies mentales tant au travers des soins intra hospitaliers qu’extrahospitaliers.
La parole est à Mme Annie David.

Aux termes de cet amendement, la nation doit assurer la satisfaction des besoins en santé des populations atteintes de troubles ou de pathologies mentales, au travers des soins tant intra hospitaliers qu’extrahospitaliers.
Le 25 octobre 2002, le docteur Maryvonne Wetsch, psychiatre à l’hôpital Esquirol de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, démissionnait de son poste de chef de service en déclarant, dans une lettre adressée à son ministère de tutelle : « Je refuse de faire comme si je pouvais gérer convenablement les soins psychiatriques nécessaires. »
Depuis, rien n’a vraiment changé, si ce n’est que les difficultés se sont multipliées en raison de l’application de règles financières et comptables, et de la mise en œuvre aveugle de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui conduit à des réductions de personnel. Cela revient également, dans un secteur qui repose essentiellement sur le relationnel, qu’il s’agisse de rencontres ou de prévention, à amoindrir la qualité de la prise en charge des patients.
La situation est telle que des soignants que nous avons rencontrés nous ont informés que certains établissements avaient externalisé une partie de leur surveillance des patients à des sociétés privées de gardiennage, recourant notamment à des maîtres-chiens. Voilà comment aujourd’hui sont traitées les personnes en grande difficulté psychique.
Cette réduction constante des moyens entraîne une diminution notable des soins réalisés, au point que certains professionnels ont l’impression de n’avoir d’autre choix, pour effectuer leur travail dans les conditions économiques imposées, que d’entraver plus encore la liberté de leurs patients. Le 5 mai 2010, une directrice d’établissement intervenant à l’occasion d’un colloque organisé par mon groupe sur la psychiatrie affirmait que les normes et les protocoles qu’on lui imposait revenaient, dans le contexte actuel, à « mal traiter les patients », pour reprendre ses propres mots. La « bien-traitance », c’est-à-dire le respect du malade, nécessite du temps ; or le temps manque cruellement quand le personnel fait défaut.
Ce qui est vrai dans les murs des hôpitaux l’est encore plus hors les murs, comme le prouvent les fermetures de plus en plus nombreuses de centres médicaux psychologiques, qui sont pourtant indispensables. Leur disparition sonne la fin des soins psychiatriques de proximité.
Cette réalité est également attestée par l’abandon, de la part des pouvoirs publics, de la politique de secteur dont l’ambition est de suivre les patients dans la cité, c’est-à-dire de garder le contact avec eux et de maintenir les soins lorsqu’ils quittent l’hôpital.
Comme le souligne à juste titre la psychiatre Marie-Noëlle Besançon, la politique de secteur « était pourtant la façon idéale, car elle intègre la prévention, le traitement et la réhabilitation de la personne dans la ville et dans la vie. » Cet abandon, tant politique que financier, tend à laisser croire qu’« il n’y a pas de volonté politique de suivre les gens de manière correcte ».

La commission a émis un avis favorable.
Cet amendement vise à prévoir une sorte de droit aux soins pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Or le droit à la santé est déjà inscrit dans la Constitution. C’est pourquoi, à titre personnel, je suis défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à cette disposition, car elle est déjà satisfaite.
En effet, le code de la santé publique précise, d’une part, que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne et, d’autre part, qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès aux soins et à la prévention.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, la commission n’a pas pu étudier ce matin l’amendement n°43 rectifié, car il n’était pas encore en distribution. Je demande donc une brève suspension de séance afin que les membres de la commission puissent se réunir et l’examiner rapidement.
Exclamations sur plusieurs travées de l’UMP.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.

La séance est reprise.
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :
À compter de la promulgation de la présente loi, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris ne peut plus accueillir les personnes faisant l’objet de soins sans consentement, même à titre provisoire.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Cet amendement, qui concerne exclusivement l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, l’IPPP, prévoit qu’à compter de la publication de la présente loi plus aucune personne faisant l’objet de soins sans consentement, même à titre provisoire, ne sera admise dans cet établissement qui déroge au droit commun.
En effet, comme vous le savez, l’IPPP n’est pas un établissement public de santé, puisqu’il dépend de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police, ce qui en fait, en réalité, un service de police comme les autres, et ce depuis le 28 février 1872.
Or, bien que l’IPPP ne soit pas un établissement de santé, les personnes qui sont interpellées par les services de police au motif qu’elles troublent l’ordre public sont systématiquement dirigées vers ce service, en violation totale du droit positif. Comme le soulignait Alain Lhostis en mars 2011, à l’occasion d’un vœu présenté au Conseil municipal de Paris, « il s’agit là d’une survivance d’une conception sécuritaire de la maladie mentale qui assimile les malades mentaux à des délinquants potentiels ».
La fermeture de ce lieu apparaît donc comme nécessaire politiquement et juridiquement.
C’est en tout cas le constat formulé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui réclame en ces termes la fermeture de l’IPPP : « L’infirmerie psychiatrique ne dispose d’aucune autonomie, elle est un service d’une des directions de la préfecture de police de Paris. L’IPPP entretient le doute sur la distance entre considérations d’ordre public et considérations médicales. » Il conclut ainsi son observation : « le Contrôleur recommande au Gouvernement le transfert des moyens de l’IPPP aux autres hôpitaux ».
Il y a peu, à la suite du dépôt par le groupe des élus communistes et du parti de gauche de la mairie de Paris, le Conseil de Paris a émis le vœu que le maire de la capitale saisisse le Gouvernement pour lui demander de fermer l’IPPP et de transférer son activité et ses moyens à l’hôpital Sainte-Anne.
Notre amendement s’inscrit donc dans cette même logique, qui consiste à refuser que perdure une exception historique qui n’a ni fondement juridique ni sens médical.

Cet amendement prévoit que l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris ne puisse plus accueillir les personnes faisant l’objet de soins sans consentement.
Le statut de l’IPPP pose de réels problèmes, ainsi que l’a souligné le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans des recommandations publiques du 15 février dernier.
Toutefois, j’estime que ce sujet est véritablement délicat et nécessite de prendre le temps de la réflexion. C’est pourquoi je proposerai, à l’article 14, un amendement prévoyant la remise d’un rapport sur le fonctionnement de l’IPPP.
L’interruption de séance a permis à la commission de se réunir ; elle a émis un avis défavorable sur cet amendement n° 43 rectifié.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Nous avons été très attentifs à la suggestion du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, et c'est la raison pour laquelle, pendant le travail de commission, le Gouvernement s’est engagé à transformer cette infirmerie psychiatrique en établissement de soins.
Toutefois, il ne nous paraît pas opportun d’inscrire ce changement dans la loi. Je donnerai un avis favorable à l’amendement, que nous étudierons ultérieurement, prévoyant la remise d’un rapport sur les modalités de transformation de cette infirmerie.

Madame la secrétaire d’État, comme vous l’avez dit, ce qui est important aujourd’hui, c’est de faire évoluer l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en un hôpital psychiatrique de droit commun. C’est effectivement un des apports de ce texte.
Jusqu’ici, l’IPPP n’était que l’un des services de la préfecture, ce qui n’apportait donc pas toutes les garanties aux personnes hospitalisées sous contrainte. Sa transformation en hôpital psychiatrique, qui est prévue par l’amendement n° 27 rectifié à l’article 3, permettra d’assurer ces garanties. Je ne voterai donc pas l’amendement n°43 rectifié.

Madame Hermange, je tiens à vous rassurer : c’est bien l’esprit de notre amendement ! Nous ne souhaitons pas fermer purement et simplement cet établissement, nous demandons juste qu’il ne puisse plus accueillir les personnes faisant l’objet de soins sans consentement, en tant qu’il fait partie de la préfecture de police.
À la suite des préconisations qui ont été faites en février dernier, nous voulons que cet établissement cesse de porter atteinte à la liberté des personnes qui y sont enfermées.
Je le répète : nous demandons non pas que ce lieu soit fermé, mais simplement qu’il évolue. Je vous rappelle que tel était également l’objet d’un vœu adopté par le Conseil de Paris : les élus parisiens aimeraient eux aussi voir ce lieu apporter une meilleure réponse aux besoins des personnes qui y sont internées.

Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 205 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à l’organisation des soins psychiatriques et à la promotion de la santé mentale. Ce projet de loi comporte les dispositions nécessaires à l’organisation des dispositifs de soins, de prévention et d’accompagnement concernant les troubles psychiatriques et les handicaps psychiques, notamment les modalités d’articulation des interventions de premier et de second recours avec les établissements et services participant à la sectorisation psychiatrique selon les dispositions de l’article L. 3221-4 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Le texte que nous examinons aujourd’hui ne concerne qu’une partie, si importante soit-elle par ailleurs, de la nécessaire réforme globale de la loi de 1990. Cela a été dit à maintes reprises dans la discussion générale, et nous l’avons répété lors de la présentation de notre motion tendant à opposer la question préalable, Mme Bachelot-Narquin s’était engagée, au cours des débats sur la loi HPST, non seulement à présenter une grande loi sur la santé mentale, mais également à promouvoir la santé mentale.
Nous le savons tous, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ainsi que les instances européennes rendent ce travail nécessaire. Qui plus est, nombreux sont les rapports de l’IGAS et des ministères des affaires sociales, de la justice ou de l’intérieur qui appellent à une réforme améliorant la prise en charge des personnes qui ont besoin de soins psychiatriques dans les cadres intra-hospitalier et extra-hospitalier. Notre collègue député Jean-Marie Le Guen tout comme ici même Alain Milon ont, depuis des années, préconisé la tenue d’états généraux de la santé mentale. La crise est générale, récurrente et le plan santé mentale 2005–2008, hélas ! n’a pas arrangé la situation.
Partout en France, depuis des années, les professionnels soignants, aux côtés des familles de patients, dénoncent la lente et continue dégradation de la psychiatrie dans notre pays.
Les fortes contraintes financières auxquelles sont soumis les établissements hospitaliers sont également un facteur important de dégradation.
Le projet de loi que nous appelons de nos vœux doit comporter les dispositions nécessaires à l’organisation des dispositifs de soin, de prévention et d’accompagnement concernant les troubles psychiatriques et les handicaps psychiques.
Les mesures simplifiant l’accès aux soins à l’hôpital et hors l’hôpital, le rôle des SAMU, les programmes post-hospitalisation, la formation de ceux qui hébergent les malades, la nécessité de diminuer le nombre de malades qui sont peu ou pas pris en charge parce qu’ils sont sans domicile fixe, dépourvus de lien familiaux, à la rue, en prison et de ceux qui font la navette avec l’hôpital, sont quelques-unes des dimensions que devrait intégrer un tel texte.
Dans cet objectif, les modalités d’articulation des interventions de premier et de second recours avec les établissements et services participant à la sectorisation psychiatrique doivent occuper une place particulière. En effet, il est essentiel que les soins de premier recours fassent l’objet d’une attention particulière. Leur inscription dans un cadre de proximité et les divers volets que sont la prévention, l’éducation à la santé, le dépistage, le diagnostic, le traitement, la surveillance et le suivi des patients doivent également être améliorés et appréhendés en fonction des possibles orientations vers le système de soins plus spécialisés ou soins de second recours.
Parce qu’il y a urgence depuis de trop nombreuses années, parce que l’attente des professionnels comme des familles n’a que trop duré, parce que la question de la santé mentale ne peut être posée uniquement au détour d’un dramatique fait divers honteusement exploité, parce qu’il s’agit d’un impératif de santé publique, nous demandons que, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à l’organisation des soins psychiatriques et à la promotion de la santé mentale.

L'amendement n° 475 rectifié bis, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau d'une des deux assemblées un projet de loi sur la santé mentale tournée vers la prise en charge du sujet malade dans le respect des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l'exercice d'une psychiatrie moderne. »
La parole est à M. Jacques Mézard.

Au travers de cet amendement, nous proposons, nous aussi, d’ajouter avant l’article 1er un article additionnel, précisant que « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau d’une des deux assemblées un projet de loi sur la santé mentale tournée vers la prise en charge du sujet malade dans le respect des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l’exercice d’une psychiatrie moderne ».
Je l’ai dit lors de la discussion générale, M. Jean-Louis Lorrain a indiqué dans son rapport que le présent projet de loi ne serait pas venu en discussion devant le Parlement sans la décision du Conseil constitutionnel de novembre 2010 – et c’est la réalité. Pourtant, il semble très clair que ce projet de loi n’est pas le texte que nos concitoyens attendent depuis 1990. Un nouveau projet de loi devait être présenté dans un délai de cinq ans, ce qui n’a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes en 2011 et nous avons déjà seize ans de retard, que l’on peut d’ailleurs imputer aux diverses majorités qui se sont succédé.
Il n’en reste pas moins que ce texte sur la santé mentale est indispensable, car la situation de la psychiatrie en France – nous le savons tous – est difficile : il n’y a pas assez de psychiatres et une nouvelle organisation moderne serait nécessaire pour aider les centaines de milliers de familles qui sont confrontées à des problèmes délicats et qui en parlent peu à l’extérieur. Cette situation justifie de manière très urgente qu’un véritable texte soit présenté. Nous le savons bien, le présent projet de loi ne répond aucunement à ces impératifs.

L’avis de la commission est favorable.
Ces amendements prévoient le dépôt d’un projet de loi sur la santé mentale dans les six mois : il s’agit d’une injonction au Gouvernement, qui serait contraire à la Constitution. À titre personnel, j’émets un avis défavorable.
Ces amendements visent à proposer le dépôt, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’un projet de loi, pour l’un, relatif à l’organisation des soins psychiatriques et à la promotion de la santé mentale et, pour l’autre, sur la santé mentale. Il n’est pas d’usage qu’une loi prévoie le dépôt d’un projet de loi sur le bureau d’une assemblée.
Ce qui préoccupe les professionnels, c’est que la psychiatrie et le secteur de la santé mentale continuent en effet d’évoluer : il s’agit, avant tout, d’évolutions des pratiques professionnelles, de développement de liens entre psychiatres et médecins généralistes ou entre équipes sanitaires et équipes médico-sociales pour assurer l’accès aux soins et la continuité des prises en charge.
Tout le monde le sait bien, la qualité des pratiques ne se décrète pas, et on ne peut forcer les gens à travailler ensemble. Beaucoup d’entre eux le font d’ailleurs déjà, et la loi actuelle ne les en empêche absolument pas. La loi HPST s’est même inspirée de ce que la psychiatrie a inventé, c’est-à-dire la responsabilité géodémographique et le lien entre le sanitaire et le médico-social.
Nous devons désormais déployer les bonnes pratiques et les bonnes organisations, renforcer l’intérêt à agir en la matière et nous fixer quelques priorités clés. Cela fera l’objet du plan de santé publique, qui sera bien sûr élaboré en concertation avec l’ensemble des professionnels.
La première réunion du comité de pilotage se tiendra prochainement afin de partager un diagnostic commun. Ce diagnostic est essentiel pour dépasser les a priori. Il s’appuiera sur l’analyse des données d’activité et de démographie et les données financières disponibles. L’objectif est bien celui de la qualité – qualité de vie des patients et de leurs familles, qualité des pratiques professionnelles – et la réduction des inégalités territoriales.
Par ailleurs, la psychiatrie, comme l’ensemble des activités de soins soumises à autorisation, doit faire l’objet de décrets sur les conditions d’autorisation de l’activité, ce qui permettra de décrire les conditions d’exercice et de clarifier la place des différents établissements autorisés en psychiatrie, dont les établissements sectorisés.
À ce jour, nous ne sommes donc pas certains que la loi qui organise les soins en France ne soit pas valide pour la psychiatrie. Elle nécessite sans doute d’être complétée à la marge. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement serait favorable à ce qu’un bilan vous soit présenté sous douze mois, bilan qui, après concertation, fasse le point sur les compléments législatifs et réglementaires qui apparaîtraient nécessaires.
Pour ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements.

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 86.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG voteront naturellement en faveur de cet amendement qui prévoit qu’à compter d’un délai de six mois suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement déposera sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à l’organisation des soins psychiatriques et à la promotion de la santé mentale.
Nous l’avons répété fort souvent, et la motion tendant à opposer la question préalable que nous avons déposée en commission des affaires sociales sur le présent projet de loi en est une démonstration, il n’est pas acceptable que nous légiférions sur une modalité de prise en charge des patients atteints de troubles mentaux en dehors d’un texte plus global. Nous réclamons ce grand texte sur la santé mentale.
Cette extraction des soins sans consentement d’une mesure plus globale démontre que l’objet du projet de loi dont nous discutons aujourd’hui est moins sanitaire que médical, et qu’il est, surtout, sécuritaire. Car si vous aviez réellement voulu parler de santé mentale, si vous aviez véritablement voulu aborder la question des soins, il vous aurait fallu les aborder tous, et non exclusivement les soins sous contrainte, qui doivent, logiquement, demeurer une exception.
Si une loi sur la psychiatrie est indispensable, c’est que les besoins sont grands. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, « les maladies mentales se classent au troisième rang des maladies en termes de prévalence et sont responsables du quart des invalidités ». L’OMS retient cinq maladies mentales parmi les dix pathologies les plus préoccupantes pour le XXIe siècle : la schizophrénie, le trouble bipolaire, l’addiction, la dépression et le trouble obsessionnel compulsif.
À cet égard, le texte que nous examinons aujourd’hui ne constitue pas une solution appropriée. Il est partiel et donne l’impression que la seule réponse susceptible d’être aujourd’hui formulée en matière de maladies mentales réside dans l’enfermement plus ou moins long des patients et dans l’encadrement non médical, mais médicamenteux.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous sommes opposés à ce qu’un décret en Conseil d’État puisse définir les protocoles de soins applicables. Si ces protocoles prédéfinis, dont on voudrait nous faire croire qu’ils sont duplicables sur chaque patient, trouvent effectivement leur sens dès lors qu’il s’agit d’imposer des normes et non de dispenser des soins, s’ils peuvent avoir leur raison dans un cadre judiciaire, ils constituent, selon nous, des aberrations en matière médicale puisque, par définition, chaque patient est singulier, chaque soignant est différent et chaque relation nouée entre les deux est particulière.
Tout cela, ce projet de loi l’ignore, car, précisément, il concerne non pas la psychiatrie, mais le traitement sécuritaire des troubles psychiatriques.
Aussi, nous voterons en faveur de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

Alors que nous arrivons à l’article 1er, je souhaite vous soumettre une proposition d’organisation.
À l’issue des prises de parole sur l’article 1er, nous aurons à examiner, après le premier amendement qui est un amendement de suppression, la bagatelle de quelque 130 amendements en discussion commune. En supposant que chacun de ces amendements soit présenté en trois minutes, et même si nous travaillons cette nuit jusqu’à deux heures, cela conduira à ce que les avis sur les amendements ne pourront être donnés que demain après-midi. Mes chers collègues, sans remettre en cause votre agilité intellectuelle, qui est remarquable, j’estime qu’il ne sera pas facile de vous prononcer demain après-midi sur des amendements qui auront été exposés ce soir.
Le règlement nous obligeant à une discussion commune, je voudrais proposer au Sénat de procéder de la manière suivante : après avoir écouté les prises de parole, je mettrai en discussion l’amendement n° 44 de M. Fischer, qui est un amendement de suppression, puis les amendements n° 439 rectifié de M. Mézard et 483 rectifié de Mme Escoffier, qui, tous deux, proposent une nouvelle rédaction de la totalité de l’article.
Si ces derniers ne sont pas adoptés, nous pourrions alors discuter les quelque 130 amendements restants en les découpant alinéa par alinéa, ce qui devrait rendre la discussion un peu plus simple. Il est toutefois de la pleine souveraineté du Sénat d’accepter ou de refuser cette proposition.
Quel est l’avis de la commission ?

La commission a considéré, à l’unanimité, que c’était effectivement une meilleure solution.

Je consulte le Sénat sur cette proposition d’organisation de la discussion.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

M. le président. Je me réjouis d’avoir réussi, sur un texte difficile, à obtenir l’unanimité du Sénat.
Sourires.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, n’ayant pu intervenir tout à l’heure dans la discussion générale, je trouve opportun, alors que va s’ouvrir la discussion sur l’article 1er, de rappeler un certain nombre de choses.
Je souhaiterais rappeler l’attachement du Gouvernement au vote de ce projet de loi, et d’un texte équilibré. On entend sur la question beaucoup d’avis et de témoignages poignants, comme cela a encore été le cas tout à l’heure à cette tribune. Je voudrais rappeler toutefois combien ce texte est nécessaire, dans la mesure où il permet un accès à des soins immédiats pour les personnes souffrant de troubles mentaux mais ne disposant pas de tiers susceptible de formuler cette demande de soins. Je pense en particulier aux personnes isolées socialement.
Je voudrais dire aussi qu’il s’agit d’un projet de loi protecteur des libertés. Le Gouvernement en est fortement convaincu. L’article 1er nous donnera bien évidemment l’occasion d’en discuter, puisqu’il permet de répondre à la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 qui a fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité. Il est en effet nécessaire, pour les patients hospitalisés à temps plein, et dont la liberté d’aller et venir est donc momentanément supprimée, que le juge des libertés et de la détention soit saisi non pas de façon facultative, comme aujourd'hui, mais de façon automatique.
Vous le savez, le projet de loi vise également à améliorer l’information des patients et des familles, ainsi que le fonctionnement des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques. Comme Nora Berra l’a rappelé tout à l’heure, il prévoit un certain nombre de précautions supplémentaires, contrairement à ce qui a pu être dit.
Le renforcement des droits et des libertés qu’il comporte s’accompagne d’un soin particulier porté à la situation de certains patients atteints de troubles très spécifiques, pour lesquels les dangers liés à une rechute apparaissent comme plus sérieux. Je pense aux patients hospitalisés d’office, soit pour irresponsabilité pénale, soit en unité pour malades difficiles. Nous savons bien que le nombre de ces patients est très limité, qu’une procédure particulière devra être enclenchée lors de la sortie, et que l’avis du psychiatre devra être assorti de celui d’un collège pluriprofessionnel de soignants.
Vous qui attachez de l’importance à ce texte, vous savez qu’il y a eu un grand nombre d’ouvertures de la part du Gouvernement.
Aujourd'hui, on parle bien de « soins psychiatriques auxquels la personne n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux ». C’était une attente. Le Gouvernement y a répondu. Vous savez aujourd'hui que l’on n’évoque plus les « formes » de la prise en charge, terme trop imprécis, mais bien les « lieux » de la prise en charge. Je pense notamment à « l’unité hospitalière temps plein », versus d’autres lieux. Car, si les soins psychiatriques sont les mêmes, ils s’exercent aussi dans différents lieux.
Il n’est en outre plus question de « domicile », mais bien du « lieu de vie habituel », ce qui inclut non seulement le foyer, l’accueil familial thérapeutique et l’EHPAD, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais aussi la rue. La notion de « domicile » était trop restrictive et a pu faire penser à l’effraction de domicile qui n’est à aucun moment autorisée, ni prévue, sauf intervention liée à une urgence grave.
De la même manière, nous n’évoquons plus le terme de « protocole » mais bien la notion de « programme de soins ». Il en est question dans l’article 1er, et je voulais le dire en préambule. Le terme « protocole » fait trop penser à la prise de médicaments et à un caractère standard de la prise en charge. La notion de « programme de soins » est bien mieux adaptée. De plus, ce programme ne peut être modifié que par un psychiatre, en fonction de l’évolution de l’état de santé, et non pour d’autres motifs, la définition du programme s’appuyant d’ailleurs sur un entretien entre le psychiatre et le patient.
Enfin, si le programme précise les types de soins, leur lieu d’exercice et leur périodicité, c’est-à-dire leurs modalités dans le temps et dans l’espace, dans le strict respect du secret médical – j’insiste sur ce point –, il ne peut faire mention des détails du traitement médicamenteux, qui ont vocation à figurer sur une ordonnance distincte.
Voilà le cœur de l’article 1er que je voulais rappeler avant que la discussion ne s’ouvre. Comme l’a déclaré Nora Berra tout à l’heure, l’objectif du Gouvernement est que le patient soit au cœur du dispositif et des attentions, en donnant davantage de place aux élus et en s’assurant qu’une réflexion éthique soit organisée dans les établissements accueillant ces personnes, dont les capacités de consentement sont altérées du fait de leurs troubles mentaux.
En la matière, nous ne pouvons réussir seuls. Il nous faut le concours des familles et des associations, au service des seuls patients.
TITRE Ier
DROITS DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES
I. – Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de soins psychiatriques » ;
2° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques » ;
3° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « faire l’objet de soins psychiatriques » ;
b) Au second alinéa, le mot : « hospitalisée » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques » ;
4° L’article L. 3211-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « hospitalisée » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques » et les mots : « hospitalisation libre » sont remplacés par les mots : « soins psychiatriques libres » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet. » ;
5° Après le même article L. 3211–2, il est inséré un article L. 3211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -2 -1. – Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge :
« 1° Sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 ;
« 2° Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1, et le cas échéant des séjours effectués dans un établissement de ce type.
« Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un protocole de soins est établi. Ce protocole définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Après le même article L. 3211–2, il est inséré un article L. 3211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -2 -2. – Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
« Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
« Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le protocole de soins. » ;
7° L’article L. 3211-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « est hospitalisée » sont remplacés par les mots : « fait l’objet de soins psychiatriques », les mots : « cette hospitalisation » sont remplacés par les mots : « ces soins » et les mots : « limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement » sont remplacés par les mots : « adaptées, nécessaires et proportionnées à la mise en œuvre du traitement requis » ;
– à la seconde phrase, le mot : « hospitalisée » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
« b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211–12–1 ;
« L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » ;
c) Au 2°, sont ajoutés les mots : « et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 » ;
d) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; »
e) Les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ;
f) Au dernier alinéa, les références : « 4°, 6° et 7° » sont remplacées par les références : « 5°, 7° et 8° » ;
8° L’article L. 3211-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -5. – Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques, prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète, conserve à l’issue de ces soins la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés. » ;
9°
Supprimé
10° Les deux derniers alinéas de l’article L. 3211-7 sont supprimés ;
11° L’article L. 3211-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -8. – La personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil. » ;
12° L’article L. 3211-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -9. – Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
« 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
« 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
« 3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° La première phrase de l’article L. 3211-10 est ainsi rédigée :
« Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur. » ;
14° L’article L. 3211-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -11. – Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » ;
15° L’article L. 3211-11-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation complète » ;
a bis)
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’absence » sont remplacés par les mots : « de sortie accompagnée » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’une hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre » et les mots : « du psychiatre » sont remplacés par les mots : « d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorisation explicite du représentant de l’État dans le département est requise dans le cas des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12. » ;
16° L’article L. 3211-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -12. – I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
« La saisine peut être formée par :
« 1° La personne faisant l’objet des soins ;
« 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
« 3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
« 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
« 5° La personne qui a formulé la demande de soins sans consentement ;
« 6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
« 7° Le procureur de la République.
« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure.
« II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3213-1 du présent code et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
« Lorsqu’il s’est écoulé depuis les hospitalisations mentionnées aux 1° ou 2° du présent II des délais supérieurs à des durées fixées par décret en Conseil d’État, ces hospitalisations ne sont pas prises en compte pour l’application du même II.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« III
17° Après le même article L. 3211–12, sont insérés des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3211-12-1. – I. – L’hospitalisation complète d’un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706–135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214–3 ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212–4 ou du III de l’article L. 3213–3 ;
« 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation sans consentement en application de l’article 706–135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211–12 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706–135 ou L. 3211–12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au cinquième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
« Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211–12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211–9. Toutefois, lorsqu’il s’est écoulé depuis les hospitalisations mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 3211–12 des délais supérieurs à des durées fixées par décret en Conseil d’État, ces hospitalisations ne sont pas prises en compte pour l’application du présent alinéa.
« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sa décision prend effet dans un délai maximal de quarante-huit heures pendant lequel un protocole de soins peut être établi conformément à l’article L. 3211-2-1.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211–12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5–1. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsqu’il s’est écoulé depuis les hospitalisations mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 3211–12 des délais supérieurs à des durées fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211–12–2. – Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211–12 ou L. 3211–12–1, le juge statue après débat contradictoire.
« À l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est entendue, le cas échéant assistée de son avocat, ou représentée par celui-ci. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.
« Après que le directeur de l’établissement d’accueil s’est assuré de l’absence d’opposition du patient, le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience se déroule dans une salle d’audience reliée par un moyen de télécommunication audiovisuelle à une salle située dans l’établissement dans les conditions prévues par l’article L. 111–12 du code de l’organisation judiciaire. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, l’avocat doit pouvoir s’entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l’établissement, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
« Art. L. 3211–12–3. – Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 3211–12–1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l’article L. 3211–12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l’article L. 3211–12–1.
« Art. L. 3211–12–4. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211–12 ou L. 3211–12–1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l’article L. 3211-12-2.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République, à la requête du directeur de l’établissement d’accueil lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre II du présent titre, du représentant de l’État lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre III du présent titre ou d’office, peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète, jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
« Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours ou, lorsqu’il a ordonné une expertise avant l’expiration de ce délai, dans un délai de quatorze jours. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
« Art. L. 3211 -12 -5. – Lorsque le juge prononce la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12 ou du III de l’article L. 3211-12-1, le patient peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies.
« Dans ce cas, un protocole de soins est établi en application du 2° de l’article L. 3211-2-1. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 111–12 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « du code de la santé publique, ».
III

« Garde à vue psychiatrique » : ces mots, avant d’être les miens, sont utilisés par les professionnels de la psychiatrie et de la justice eux-mêmes pour qualifier la période d’observation de soixante-douze heures qu’entraîne toute hospitalisation sous contrainte. Nous avons en effet le sentiment, alors que ce projet de loi vise des personnes atteintes de pathologies parfois très lourdes, que ceux qui sont ici pris en compte sont non pas des malades, mais de véritables criminels que la société doit mettre à l’écart pour assurer sa propre sécurité. Comme Michel Foucault l’avait présagé il y a bien des années, nous sommes passés du modèle du sujet responsable à celui de l’individu dangereux porteur de risques.
Or, comment juger de la dangerosité d’un individu s’il est placé sous camisole chimique dès le début de la période d’observation ? Où se situe, dès lors, la prise en charge thérapeutique dont ont besoin ces personnes atteintes de troubles mentaux ?
Alors que le Conseil constitutionnel impose l’intervention du juge des libertés et de la détention dans le cas de toute hospitalisation sous contrainte, celui-ci n’intervient que quinze jours après son commencement, puis tous les six mois. Dès lors nous étonnons-nous du fait que le Gouvernement n’aille pas au bout de la logique qu’il semble suivre, car, si la période d’observation peut s’apparenter à une garde à vue, le patient n’en reste pas moins privé de tous ses droits fondamentaux et par là même soustrait au contrôle de l’autorité judiciaire.
Si nous saluons l’intervention du juge des libertés et de la détention dans ce domaine, nous sommes convaincus que c’est dès le début de la période d’observation qu’il doit pouvoir statuer sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte. Combien d’individus en effet se retrouveront enfermés de force, sans justification réelle, du fait de la seule pression subie par certains fonctionnaires, victimes de la paranoïa ambiante ?
La probabilité est forte que, en raison de la situation actuelle de notre système judiciaire, de ses manques – déjà considérables – de moyens et de son engorgement, la décision de maintenir un patient au sein d’une unité de soins psychiatriques soit dépourvue de tout examen approfondi et que le juge, faute de moyens supplémentaires et de compétences sur les maladies mentales, se fonde sur l’avis d’experts médicaux débordés. Pis, le magistrat pourra être tenté de suivre aveuglément l’injonction administrative.
Cette logique de soins forcés fait apparaître l’hospitalisation complète comme une sanction, et non plus comme un rouage de la chaîne de soins.
Il est clair à nos yeux que la « politique de soins » – s’il en est vraiment une dans ce texte – que veut nous faire adopter le Gouvernement est bien plus sécuritaire que sanitaire. Elle entre également en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci stipule en effet que, « si la privation de liberté n’est pas justifiée par l’aliénation, elle est alors arbitraire » et que « l’internement ne peut se prolonger sans la persistance d’un trouble mental médicalement constaté ».
Depuis quand nos préfets disposent-ils d’une formation médicale les rendant aptes à juger de l’état pathologique de personnes atteintes de troubles psychiatriques ?
L’autre point majeur de cet article est la possibilité de contraindre une personne à se soigner à son domicile et sans son consentement. Non seulement ce texte remet en cause le principe même du secret médical en plaçant le malade, contre sa volonté, sous l’autorité de ses proches, mais il ne précise en aucune manière quelle responsabilité incombe, dans la surveillance du malade, aux personnes vivant à son domicile.
Enfin, il ne faut pas oublier que l’hospitalisation forcée est une mesure d’une grande violence. Cette violence vient s’ajouter à la souffrance des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont, comme l’explique M. Lecerf dans son rapport, bien plus souvent victimes qu’auteurs d’actes de violence, qu’il s’agisse de violences qu’elles exercent sur elles-mêmes ou de violences subies. Les personnes atteintes de troubles mentaux sont douze fois plus victimes d’agressions physiques et cent trente fois plus victimes de vols que la population générale et leur espérance de vie est plus courte. L’Inspection générale des affaires sociales rappelle, dans un rapport de 2005, que seuls 2, 7 % des actes violents sont commis par des personnes souffrant de troubles psychiatriques.
Cette loi sur la psychiatrie est l’indice d’un État qui préfère punir que guérir, comme l’explique si bien le docteur Daniel Zagury, psychiatre, médecin-chef au centre psychiatrique du Bois-de-Bondy et expert auprès des tribunaux. Parce que nous refusons cette logique répressive et sécuritaire, nous ne voterons pas cet article.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en raison des auditions de la mission commune d’information sur le Mediator, il ne m’a pas été possible de participer autant que je l’aurais voulu aux travaux de la commission des affaires sociales sur ce projet de loi. Je souhaitais donc m’en excuser. J’ai tenu cependant à prendre la parole sur cet article pour souligner deux points qui me paraissent essentiels et que nous avons retrouvés lors de plusieurs de débats récents dans cet hémicycle.
Tout d’abord, notre droit – je dirais même : notre démocratie – repose sur le principe de la liberté du consentement. Le législateur ne peut décider, sans en peser toutes les implications, de faire prévaloir la société sur l’individu. Oui, nous devons protéger la société, garantir la sûreté de tous, mais ceci ne peut se faire en exigeant de chaque personne d’abdiquer son droit inaliénable d’être considérée en elle-même et pour elle-même ! À cet égard, je souligne un apport de l’article 1er de ce projet de loi, qui dispose que le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, peut statuer non pas publiquement, mais en chambre du conseil, car la publicité de l’audience pourrait avoir, dans certains cas, des conséquences désastreuses. J’irais même jusqu’à me demander dans quelle mesure la publicité de l’audience ne devrait pas constituer une faculté exceptionnelle.
Je m’inquiète du risque que nous courons si nous permettons, avec ce projet de loi, à des médecins, à des chercheurs, et même aux juges, d’agir sur les personnes malades sans qu’elles en soient véritablement informées, voire d’user de contrainte à leur encontre. Si, par exemple, on leur administre demain un médicament qui, dans dix ans, posera un certain nombre de problèmes, qu’adviendra-t-il ?
Pour ma part, madame la secrétaire d’État, je trouve très intéressante la possibilité qu’offrent les soins ambulatoires sans consentement. Vous l’avez dit tout à l’heure, les soins ambulatoires sont pratiqués dans toutes les pathologies : pourquoi ne pas le faire dans ce type de pathologie, et plus particulièrement au sein des prisons, où l’on ne peut espérer agir réellement pour la réinsertion de certains prisonniers sans commencer par une prise en charge thérapeutique ?
Je regrette cependant, madame la secrétaire d’État, que l’on renvoie au décret l’essentiel de la définition des modalités de ces soins ambulatoires sans consentement hors de prison, car cette définition pose de nombreuses questions que nous n’avons pas le temps d’examiner pour nous prononcer valablement. De même, je regrette que le Gouvernement ne nous ait pas présenté une loi de santé mentale qui nous aurait permis d’appréhender les soins sans consentement dans le contexte plus général de l’ensemble des formes de prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux.
Madame la secrétaire d’État, vous nous avez annoncé un plan de santé mentale. Il aurait peut-être été préférable que nous ayons connaissance du contenu de ce plan et surtout des moyens – car, vous le savez bien, le problème des moyens se pose également – mis à disposition des soignants, des malades, des familles, avant de nous prononcer sur les mesures que vous nous proposez aujourd’hui.
Dans le contexte actuel, l’attente de nos concitoyens est immense en matière de santé et de confiance dans les autorités sanitaires. Certes, nous avons besoin d’une politique sécuritaire, nos concitoyens l’attendent également, mais toutes les personnes atteintes de troubles mentaux ne sont pas, pour autant, des criminels en puissance. C’est la raison pour laquelle nos concitoyens souhaitent une politique de la personne : ce chantier reste ouvert devant nous.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP. – Mme la présidente de la commission des affaires sociales applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi s’inscrit dans un contexte difficile où le manque de moyens dans les services psychiatriques et le déficit de formation des infirmiers sont criants : le nombre de lits en hôpital psychiatrique a été réduit de moitié en vingt ans.
Que penser de ce projet de loi ? Une première analyse rapide pourrait nous faire conclure à quelques avancées.
La première de ces avancées est la diversification annoncée des modes de prise en charge du patient, alors que le cadre de la loi de 1990 prévoit uniquement l’hospitalisation complète. L’article 1er de ce projet de loi prévoit que le patient puisse également bénéficier de soins ambulatoires : le rapport Strohl d’évaluation de la loi de 1990, le rapport Piel-Roelandt de 2001 ainsi que le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2005 préconisaient déjà cette évolution.
La seconde avancée qui semble se présenter tiendrait à l’intervention automatique du juge des libertés et de la détention après quinze jours d’hospitalisation, grâce à la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010.
Or ces éléments, qui pourraient s’apparenter à des avancées en première analyse, ne peuvent en réalité s’apprécier comme tels, tout simplement parce qu’ils s’inscrivent dans un ensemble qui n’existe pas encore, cette fameuse « loi de santé mentale » que nous attendons, et qui aurait dû lui donner sens. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons souscrire à l’approche privilégiée par le Gouvernement dans le présent projet de loi.
Ce projet de loi n’est pas pertinent, car il n’envisage la pluralité des modes de prise en charge que sous l’angle des soins sans consentement. Or les psychiatres sont unanimes : soigner sans consentement est antinomique. Le principe de la contrainte rompt, par définition, le consentement et la confiance nécessaires à la thérapie. De plus, l’article 1er méconnaît le rôle du patient dans sa propre guérison et nie le contrat implicite qui le lie à son médecin.
En fait, de nombreux collègues ont insisté sur ce point, ce projet de loi s’articule autour de préoccupations sécuritaires qui l’emportent sur l’aspect sanitaire et en font un texte très « tronqué ».
Enfin, le projet de loi me paraît dangereux au regard du respect des libertés : il instaure une période initiale « d’observation » et de soins en hospitalisation complète de soixante-douze heures. Cette disposition, qui ne prévoit pas l’intervention d’une autorité judiciaire, fait l’unanimité contre elle et est assimilée à une « garde à vue psychiatrique ».
Ainsi, l’article 1er ne respecte pas l’équilibre qu’il aurait dû trouver : offrir à la personne qui souffre de troubles mentaux les meilleurs soins, protéger cet individu contre lui-même et éviter qu’il ne puisse nuire à autrui, ne limiter sa liberté que dans les limites strictement nécessaires.
Le Gouvernement a annoncé « un grand plan de santé mentale » pour l’automne et il nous est demandé de nous prononcer aujourd’hui sur ce texte, sans connaître le contenu de ce plan : c’est véritablement impossible !
Je regrette donc, vous l’aurez compris, que ce projet de loi ne soit pas la grande « loi de santé mentale » attendue et qu’il n’ait rien prévu de concret pour améliorer, sur les plans social, humain et sanitaire, la qualité et la continuité des soins indispensables. C’est pourquoi nous ne saurions voter cet article, comme le reste du projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 1er porte sur les modalités de prise en charge des personnes faisant l’objet de mesures de soins sans leur consentement et sur le contrôle de ces mesures par le juge des libertés et de la détention : il est donc au cœur de la réforme.
Malheureusement, cette réforme intervient à la suite d’un fait divers survenu à Grenoble et crée, aujourd’hui, de nouvelles conditions d’hospitalisation et de soins sous contrainte. Une minorité de patients sont concernés et ce texte ne résout pas les nombreux problèmes actuels de la psychiatrie.
Ce projet de loi s’articule principalement autour de préoccupations sécuritaires qui vont jusqu’à étendre la contrainte aux soins ambulatoires. On s’oriente ainsi vers l’élargissement de la prise en charge sans consentement et vers la difficulté de plus en plus grande pour les patients de sortir des hôpitaux.
On peut se demander si l’obligation de soins, qui consiste à imposer à la personne de se rendre aux consultations, ne va pas renforcer son angoisse face aux soins et la braquer un peu plus.
Depuis une circulaire de 2010 adressée aux préfets pour leur demander de redoubler de précautions avant d’autoriser les personnes en hospitalisation d’office à bénéficier de sorties d’essai accordées par les médecins, de nombreux préfets refusent systématiquement les sorties préconisées par les médecins. Malheureusement, ce projet de loi renforce les prérogatives des préfets pour maintenir à l’hôpital des patients qui, médicalement, pourraient sortir. Il n’est pas tolérable d’enfermer des personnes dans un lieu pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les soins. Même si le projet de loi prévoit que le juge se prononcera régulièrement sur toutes les hospitalisations sous contrainte – d’abord au quinzième jour, puis tous les six mois –, le préfet aura toujours le dernier mot, car il pourra faire appel de la décision du juge par l’intermédiaire du parquet.
Il est inacceptable de renforcer l’intrusion étatique dans le contrôle des soins, car il s’agit bien, ici, de donner la priorité à la défense de l’ordre public.
Par ailleurs, le fait que la liberté individuelle soit préservée par la présence du juge dans le dispositif ne nous rassure pas, car la justice est déjà bien encombrée.
De plus, ce projet de loi prévoit la possibilité de garder un malade en observation pendant soixante-douze heures à partir de son arrivée à l’hôpital. Cette garde à vue, qui devrait permettre de décider des modalités de soins, est devenue une « garde à vue psychiatrique », apparemment sans garantie particulière pour le patient. On veut donc stigmatiser la maladie mentale pour faire peur au public, on érige en principe la contrainte, en supprimant le consentement et la confiance, nécessaires pour la thérapie.
Or, ceux qui travaillent auprès des malades non seulement dénoncent la volonté de légiférer sur une question complexe comme l’obligation de soins, mais nous informent aussi que, lorsque l’hospitalisation est forcée, on rencontre plus d’échecs. Ils dénoncent également la possibilité de prodiguer des soins sans consentement au domicile d’un patient, car cette pratique, à leurs yeux, résume les soins à la contrainte et aux seuls traitements médicamenteux, alors que, depuis de nombreuses années, ils travaillent sur la confiance et le consentement. La solution ne repose pas uniquement sur l’enfermement des malades, qu’il soit physique ou chimique.
Enfin, je souhaiterais évoquer le problème du « casier psychiatrique ad vitam æternam », qui empêche la réintégration dans la société des personnes victimes de troubles mentaux. Il est essentiel d’instituer un « droit à l’oubli » pour les antécédents psychiatriques, qui ne devraient pas être mentionnés au-delà de dix ans.
Pour conclure, l’article 1er tend davantage à garantir la sûreté des non-malades que des malades eux-mêmes, tout en insistant sur l’importance du rôle du préfet. Il est certain que la prise en considération du trouble à l’ordre public l’emporte sur la question de la qualité des soins. Les professionnels souhaitent un grand plan pour la santé mentale et non une réforme sécuritaire. Il devient urgent de traiter la psychiatrie d’une manière thérapeutique, avec une volonté politique et des moyens. En effet, les malades ont besoin d’un accompagnement humain de qualité et, pour cela, il faut des moyens humains, madame la secrétaire d’État.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, madame le secrétaire d'État, mes chers collègues, jusqu’ici, considérant les humains, nos voisins proches ou lointains, avec un humanisme bien ancré, on les désignait par des mots simples : « jeunes », « vieux », « adultes », « ouvriers », « cadres », « chefs d’entreprise », « fonctionnaires », « aviateurs », « docteurs », « bonnes sœurs », « artistes »… Chacun s’y reconnaissait sans réfléchir ni hausser la voix.
Depuis un certain temps, notamment après les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis, après des morts violentes survenues en France, morts n’ayant plus rien à voir avec la rationalité, qui laisse alors place au délire, un vocabulaire nouveau est apparu, caractérisant ces hommes et ces femmes ayant connu un déchirement de la conduite.
Ce quelque chose de tragique est à rapprocher de la folie amoureuse, des crimes passionnels à l’égard desquels, c’est à noter, les jurés se montrent, très souvent, extrêmement indulgents. On constate que la folie est fragilité et composante incontournable de l’humain. L’inacceptable est inexplicable et la dogmatique du contrôle social, qui domine le projet gouvernemental, n’y peut rien, n’y pourra rien.
La peur s’est installée, ou plutôt a été installée. Comme le disait Franklin Roosevelt en 1933 – retenez la date ! – : « La seule chose dont nous devons avoir peur, c’est de la peur elle-même. » Bien avant, Dostoïevski s’exprimait ainsi : « Ce n’est pas en enfermant son voisin qu’on se convainc de son propre bon sens. » On est passé du droit à la sûreté au droit à la sécurité, qui « repose sur l’illusion d’une vie sans dangers et légitime l’intrusion dans les vies individuelles », écrit la juriste Mireille Delmas-Marty. C’est l’avènement d’un mythe de la sécurité totale. Les sociétés de la peur en arrivent à appeler le voisin « pas comme eux » un barbare, à crier au forcené, au déséquilibré, à l’arriéré, à l’aliéné, au fou, comme autrefois on criait au loup.
Qui est le barbare ? L’être étrange, l’être humain qui a quitté la ligne, l’attitude commune, l’homme dont le discours hoquette et s’égare, dont la conscience traverse des gouffres ? L’homme qu’on ne regarde pas, à qui l’on ne sourit pas, qu’on laisse à l’écart, de l’autre côté, vers les rives de l’indéfinissable, dans un périmètre restreint ? Ainsi se déconstruisent les liens sociaux. La guerre civile habite l’âme. C’est dénégateur d’humanité. Le virus de la barbarie s’empare de trop d’entre nous.
J’ai déjà été confronté à ce problème d’hommes et de femmes fracturés, fissurés, éclatés, parfois bousillés. C’était en 1981, quand, ministre de la santé du deuxième gouvernement Mauroy, j’avais constitué la commission Demay, du nom de son animateur, afin d’élaborer « Une voie française pour une psychiatrie différente ».
Le résultat fut un texte d’élan qui faisait l’Histoire, dans un moment où la société n’avait pas peur et rêvait d’avenir, alors qu’aujourd’hui le texte gouvernemental est un texte de banqueroute qui cisaille l’Histoire.
Le rapport Demay traite humainement des actes inhumains, le texte gouvernemental traite inhumainement la part de folie dans l’homme. Je veux lire des extraits de la réponse des psychiatres coauteurs dudit rapport : « Tout trouble mental est évolutif ; l’expérience prouve que la chronicité n’est pas irréversible […] La fonction des professionnels du champ de la psychiatrie est celle d’accompagnement de leurs patients et celle, éventuellement, de défense vis-à-vis du corps social et vis-à-vis des puissances de tutelle […] Il est indispensable que les soignants puissent s’abstraire des valeurs morales, sociales, politiques dominantes. Celles-ci ne peuvent en aucun cas constituer le facteur déterminant de leur conduite professionnelle […] Le concept de prévention, s’il se réfère à une notion de normalité, le concept de guérison, s’il se réfère à une normalisation [vont] à l’encontre de toute démarche thérapeutique dans le champ de la psychiatrie. »
Le rapport Demay fait œuvre de culture, de liberté, de construction d’« en commun », d’anti-barbarie enfin, et juge sans détours la pensée de l’actuel Président de la République, incapable de recul, d’interrogations, de doutes devant toute chose de la vie, surtout émotionnelle.
À tous ces êtres que nous considérons et respectons, l’État impose la norme, alors que la normalité, c’est la victoire de l’état sur le devenir, de l’identité sur la différence. Il ne faut plus d’hommes, de femmes entrés dans des histoires closes et privés du « risque de vivre », seul moyen pourtant d’avoir le « risque de guérir », tout cela étant caché par l’abominable mensonge du risque zéro.
C’est un malheur pour un pays que de vouloir des lois particulières.
C’est un bonheur de connaître le poème du Grec Constantin Cavafis En attendant les barbares :
« – Pourquoi nous être ainsi rassemblés sur la place ?
« Il paraît que les barbares doivent arriver aujourd’hui.
« – Et pourquoi le Sénat ne fait-il donc rien ?
« Qu’attendent les Sénateurs pour édicter des lois ?
« C’est que les barbares doivent arriver aujourd’hui.
« Quelles lois pourraient bien faire les Sénateurs ?
« Les barbares, quand ils seront là, dicteront les lois.
« – Pourquoi notre empereur s’est-il si tôt levé,
« et s’est-il installé, aux portes de la ville,
« sur son trône, en grande pompe, et ceint de sa couronne ?
« C’est que les barbares doivent arriver aujourd’hui.
« Et l’empereur attend leur chef
« pour le recevoir. Il a même préparé
« un parchemin à lui remettre, où il le gratifie
« de maints titres et appellations.
« – Pourquoi nos deux consuls et les préteurs arborent-ils
« aujourd’hui les chamarrures de leurs toges pourpres ?
« Pourquoi ont-ils mis des bracelets tout incrustés d’améthystes
« et des bagues aux superbes émeraudes taillées ?
« Pourquoi prendre aujourd’hui leurs cannes de cérémonie
« aux magnifiques ciselures d’or et d’argent ?
« C’est que les barbares doivent arriver aujourd’hui ;
« et pareilles choses éblouissent les barbares.
« – Et pourquoi nos dignes rhéteurs ne viennent-ils pas, comme d’habitude,
« faire des commentaires, donner leur point de vue ?
« C’est que les barbares doivent arriver aujourd’hui ;
« et ils n’ont aucun goût pour les belles phrases et les discours.
« – D’où vient, tout à coup, cette inquiétude
« et cette confusion (les visages, comme ils sont devenus graves !) ?
« Pourquoi les rues, les places, se vident-elles si vite,
« et tous rentrent-ils chez eux, l’air soucieux ?
« C’est que la nuit tombe et que les barbares ne sont pas arrivés.
« Certains même, de retour des frontières,
« assurent qu’il n’y a plus de barbares.
« Et maintenant qu’allons-nous devenir, sans barbares ?
« Ces gens-là, en un sens, apportaient une solution. »

L'amendement n° 44, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.

Le Conseil constitutionnel a considéré que le juge des libertés et de la détention devait impérativement intervenir dans le cas d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. Il a pour cela posé une date limite, le 1er août de cette année, et nous contraint à légiférer dans l’urgence.
Or je constate que le Gouvernement s’est saisi de l’opportunité créée par cette décision, rendue à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC, pour insérer des dispositions qui n’ont aucun rapport avec le rôle du juge des libertés et de la détention.
Cette QPC, qu’a évoquée tout à l’heure M. Bertrand lors de son passage éclair au banc des ministres, ne sert en réalité que de prétexte puisque l’essentiel des mesures contenues dans ce projet de loi sont dédiées à l’organisation des soins sans consentement.
Sur ce texte, le Gouvernement nous donne l’impression d’avoir joué la montre. Connaissant le recours engagé par un justiciable, il n’a pas demandé son inscription à l’ordre du jour de l’une des deux assemblées, alors que son dépôt date tout de même du 10 mai 2010, il y a un an. Sans doute attendait-il, madame la secrétaire d'État, que les juges constitutionnels rendent leur décision pour imposer un examen en urgence et priver ainsi les parlementaires de toutes latitudes. Si telle n’était pas sa volonté, c’est en tout cas la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
Or, voyez-vous, l’intervention du juge des libertés et de la détention, si nous ne la contestons pas, nous semble trop tardive. De plus, les missions dévolues à ce dernier sont trop limitées, particulièrement au vu du rôle exorbitant que le projet de loi attribue aux préfets.
Enfin, le texte demeure étrangement silencieux pour ce qui est des moyens financiers nécessaires à son application ; Mme Hermange l’a d’ailleurs souligné voilà quelques instants. Lorsqu’on connaît la situation du ministère de la justice, on sait qu’il aura bien des peines, par exemple, à financer la télé-audience, pourtant prévue, au-delà même de ce que l’on peut penser de cette disposition, à laquelle, pour ma part, je suis fortement opposée, et pas seulement pour un problème financier.
On sait également que la mise en œuvre du projet de loi nécessiterait dans chaque établissement psychiatrique la mobilisation d’au moins deux professionnels.
Tout cela se faisant à coût constant, on devine que la première conséquence sera la réduction du nombre de soignants. Ce n’est pas ainsi, me semble-t-il, que l’on pourra répondre aux besoins de malades en grande difficulté.
Bref, mes chers collègues, tout porte à croire que le projet de loi sera au final inapplicable, exception faite, bien sûr, des mesures sécuritaires qu’il contient. Aussi, le seul moyen de se préserver d’une telle situation réside dans la suppression, un à un, des articles qui le composent. C’est ce que nous vous invitons à faire.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe CRC-SPG. – M. André Vantomme applaudit également.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui vise à supprimer l'ensemble des dispositions de l'article 1er.
À titre personnel, je me dois de dire que ces dernières sont utiles et nécessaires, notamment celles qui prévoient normalement le contrôle du juge des libertés et de la détention sur les hospitalisations. C'est la raison pour laquelle je suis moi-même défavorable à l’amendement.
Le Gouvernement ne peut être favorable à la suppression de l'article 1er du projet de loi, qui fonde l'ensemble des modifications proposées au régime des hospitalisations psychiatriques sans consentement et qui comporte en particulier, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, les dispositions prises pour la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel sur le contrôle que doit exercer le juge sur lesdites hospitalisations.

Je mets aux voix l'amendement n° 44.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 206 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 439 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du livre II est ainsi rédigé :
« Droits et protection des personnes atteintes d'un trouble mental »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3211-12, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais » ;
2° Après l’article L. 3211-12, sont insérés les articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 3211 -12 -1. - I. - L'hospitalisation d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l'État dans le département, lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 ou L. 3211-12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° et 2° du présent I une expertise, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres mentionné au II de cet article, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au quatrième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
« III. - Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
« IV. - Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211 -12 -2. - Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge statue après débat contradictoire.
« À l'audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.
« Art. L. 3211 -12 -3. - Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l'article L. 3211-12-1.
« Art. L. 3211 -12 -4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L'appel formé à son encontre n'est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l'article L. 3211-12-2. »
III. - Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 3212-4 est complété par les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil » ;
2° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212 -7. - Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si l'hospitalisation est toujours nécessaire.
« Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement dans les trois jours précédant l’expiration de la période en cause.
« Le défaut de production d’un des certificats susvisés entraîne la levée de l'hospitalisation.
« Les copies de ces certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. Une copie du certificat mentionné au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement. »
IV. - Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3213-1, après la référence : « L. 3222-5 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement » ;
2° L'article L. 3213-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Dans les quinze jours, puis un mois après » sont remplacés par les mots : « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit » ;
b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les copies des certificats médicaux prévus au présent article sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. Une copie du certificat médical établi, en application du premier alinéa du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit l’hospitalisation est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil. » ;
3° L'article L. 3213-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213 -4. - Au vu du premier certificat mentionné au premier alinéa de l'article L. 3213-3, le représentant de l'État dans le département peut prononcer le maintien de l’hospitalisation pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'État, après avis motivé d'un psychiatre, dans le département pour une nouvelle période de trois mois puis pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l'État à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
« En outre, le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié l’hospitalisation ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »
V. - Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 3214-2 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 3211-12 » est remplacée par les références : « L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d'un psychiatre intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;
c) Au second alinéa, après la référence : « L. 3211-12 », est insérée la référence : « ou L. 3211-12-1 » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 3214-3, après la référence : « L. 3222-5 », sont insérés les mots : « et le juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement ».
La parole est à M. Jacques Mézard.

Cet amendement a pour objet de réécrire complètement l’article 1er, tout simplement pour mettre en conformité la situation avec la décision du Conseil constitutionnel de novembre 2010.
Dans son intervention lors de la discussion générale, le rapporteur nous a rappelé, je l’ai dit tout à l’heure, que c’est parce qu’il y avait eu la décision du Conseil constitutionnel que ce texte a été présenté au Sénat, sinon nous n’en aurions pas été saisis.
Puisque le Sénat n’a pas voté la suppression de l’article 1er, il nous est apparu sage de réécrire ce dernier en calant sa rédaction sur les nécessités découlant de la décision du Conseil constitutionnel.
Les ajustements, notamment par lettre rectificative, dont ce projet de loi a fait l’objet au cours de son élaboration et l’imbroglio parlementaire inédit survenu lors du vote final de la commission des affaires sociales témoignent, s’il en est besoin après tout ce que nous avons déjà dit, combien la réforme proposée de l’hospitalisation sous contrainte est mal préparée et mal ficelée.
Que dire de la période d’observation de soixante-douze heures, qui s’apparente, cela a été dit, à « une garde à vue psychiatrique » ?
Que dire de la multiplication des avis médicaux, disposition qui ignore totalement l’insuffisance sur le terrain des moyens dévolus à notre système de santé ?
Outre les deux certificats nécessaires à l’admission du patient, nous avons compté pas moins de six avis de psychiatres dans la semaine qui suit cette admission : un certificat à vingt-quatre heures, un autre à soixante-douze heures, puis un avis motivé proposant la forme de prise en charge, un nouveau certificat entre le cinquième et le huitième jour et, enfin, un avis conjoint de deux psychiatres pour la saisine du juge, saisine qui sera désormais systématique en cas d’hospitalisation complète.

Et ce n’est pas fini ! Pour certains malades, ceux qui sont déclarés irresponsables pénalement ou qui séjournent dans une unité pour malades difficiles, et dont la dangerosité apparaît comme élevée, il faut ajouter à ces six avis celui d’un collège de soignants composé de deux psychiatres et d’un membre de l’équipe participant à la prise en charge, ainsi que deux expertises émanant de deux psychiatres étrangers à l’établissement. Voilà potentiellement dix psychiatres mobilisés ! Sur le terrain, nous le savons tous, c’est un système strictement irréaliste, …

Pour ces derniers malades, le projet de loi crée un nouvel outil : le casier psychiatrique, dont nous aurons sans doute l’occasion de reparler.
Certes, il faut tenir compte des antécédents, mais faisons davantage confiance aux psychiatres. Or, madame la secrétaire d'État, par le décret statutaire d’octobre 2010, vous avez détruit l’indépendance des psychiatres hospitaliers en supprimant la nomination ministérielle.
Tout cela n’est pas raisonnable ! Vous n’ignorez pas la pénurie de spécialistes médicaux et d’infirmiers, notamment en zones rurales. Vous n’ignorez pas les problèmes de fonctionnement des services psychiatriques dans nos hôpitaux publics, l’impossibilité pour nombre d’entre eux de pourvoir les postes de praticiens hospitaliers.
Comment ce texte, alambiqué, qui a fait l’objet d’un certain nombre de modifications de la part du Gouvernement lui-même et vient de donner lieu à de nouveaux amendements qui viennent d’être déposés par le rapporteur de la commission des lois, ce qui est tout à fait logique, ce texte qui est un assemblage de procédures complexes, voire contradictoires, qui accordent de surcroît la prépondérance aux décisions administratives, pourrait-il être applicable ?
En fait, nous le savons tous, la réflexion est bien loin d’être aboutie sur l’étendue du contrôle judiciaire des mesures de contrainte, la gestion de la contrainte à l’extérieur de l’hôpital psychiatrique. Le renvoi à des décrets de manière systématique, évoqué voilà quelques instants par notre collègue Mme Hermange, est révélateur de l’absence de finition de ce texte.
C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de limiter le texte à la seule exigence du Conseil constitutionnel d’un contrôle juridictionnel du maintien de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l’expiration des quinze premiers jours. Ce serait sagesse, …

… comme l’a dit, d’ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Le Sénat s’est souvent distingué par sa sagesse ; aussi, je ne doute pas, mes chers collègues, que vous serez sensibles à cet argument.
Par souci d’efficacité et, là encore, dans un esprit constructif, cet amendement prévoit que le contrôle du juge des libertés et de la détention est étendu à toutes les procédures d’hospitalisation, à la demande d’un tiers et sur décision du préfet, le Conseil constitutionnel ayant déjà été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur les articles L. 3213–1 et L. 3213–4 du code de la santé publique en ce qu’ils portent atteinte au droit à la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire, garantie par l’article 66 de la Constitution.
Ainsi, tout a été réuni dans le même article : le principe du contrôle et ses conséquences sur chacune des procédures d’hospitalisation.
Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement, s’il est adopté, permettra de poursuivre la concertation pour élaborer ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire une réforme convaincante qui soit tournée vers la prise en charge de la maladie mentale, dans le respect des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l’exercice d’une psychiatrie moderne.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

L'amendement n° 483 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais ».
II. – Le chapitre II du titre 1er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 est complété les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil » ;
2° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé :
« Dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si l’hospitalisation est toujours nécessaire.
« Au vu de ce certificat et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application du II du présent article, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement dans les trois jours précédant l’expiration de la période en cause.
« Le défaut de production d’un des certificats susvisés entraîne la levée de l’hospitalisation.
« Les copies des certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. » ;
3° Après l’article L. 3212-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3212 -7 -1. – L’hospitalisation d’un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des articles L. 3212-1 à L. 3212-3.
« La saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, une expertise en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des articles L. 3212-8 et L. 3212-9. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au troisième alinéa du présent article doit être produite. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas été saisi ou n’a pas statué dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, la mainlevée est acquise.
« Le juge statue après débat contradictoire. À l’audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application du présent article est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli, un peu plus simplifié que celui qui vient d’être présenté très largement et excellemment par mon collègue Jacques Mézard.
Comme je l’avais souligné dans mon intervention lors de la discussion générale, un dispositif est absolument nécessaire et nous avons été nombreux à rappeler l’attention que nous portons à ces malades, à ces personnes fragilisées et aux soins que nous voulons pouvoir leur apporter, ainsi qu’à leur famille.
Pour autant, le texte tel qu’il est proposé, dont nous proposons de modifier l’article 1er, est très complexe. Jacques Mézard vient de rappeler le nombre d’expertises médicales requises, de psychiatres dont l’avis médical serait sollicité.
Au travers de cet amendement, nous proposons purement et simplement l’application stricte de la décision du Conseil constitutionnel, telle que nous l’avons déjà évoquée à plusieurs reprises cet après-midi, afin de mettre sur pied un dispositif respectueux des personnes, de leurs droits, et des trois principes vertueux et institutionnels que j’ai cités précédemment.
C’est donc un dispositif qui, s’il était adopté, nous permettrait de repartir sur de nouvelles bases, considérablement améliorées. Je ne doute pas que notre assemblée aura la sagesse, comme cela vient d’être dit, de choisir cette solution.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

L’amendement n° 439 rectifié réduit l’ensemble des dispositions de l’article 1er à la seule création d’un contrôle juridictionnel sur les hospitalisations sans consentement. Cependant, bien d’autres dispositions sont également nécessaires, notamment en ce qui concerne les droits des patients. La commission a émis un avis favorable. En revanche, à titre personnel, j’émets un avis défavorable.
L’amendement n° 483 rectifié vise à réécrire l’ensemble des dispositions de l’article 1er en les réduisant, comme l’amendement précédent, à la seule création d’un contrôle juridictionnel sur les hospitalisations sans consentement. La commission a émis un avis favorable. À titre personnel, estimant que l’article 1er doit être maintenu, j’émets un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 439 rectifié qui remet en cause l’équilibre du projet de loi.
Il tend à instaurer une intervention du juge dans les quinze jours de l’admission en hospitalisation sans consentement, puis tous les trois mois au lieu des six mois prévus par le texte. De telles saisines feraient peser une charge très lourde sur les juridictions, comme sur les équipes médicales.
Par ailleurs, l’amendement n’apporte aucune précision sur les modalités de tenue de l’audience et supprime la possibilité de tout recours suspensif.
L’amendement n° 483 rectifié s’inscrit dans la même démarche que le précédent. Aussi, le Gouvernement émet, là encore, un avis défavorable.
J’ajoute que cet amendement introduit le contrôle de plein droit du juge dans le chapitre sur l’hospitalisation à la demande de tiers, alors même que ce contrôle concerne tant l’hospitalisation d’office que l’hospitalisation à la demande de tiers.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Droits et protection des personnes atteintes d’un trouble mental »
La parole est à M. le président de la commission des lois.

Cet amendement vise à remplacer l’intitulé actuel du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, « Lutte contre les maladies mentales », par un intitulé moins stigmatisant pour les personnes atteintes d’un trouble mental et qui met, en outre, l’accent sur l’intervention désormais systématique du juge judiciaire en cas d’hospitalisation sous contrainte. Nous proposons, par coordination avec l’intitulé du projet de loi, le titre suivant : « Droits et protection des personnes atteintes d’un trouble mental ».

La commission émet un avis favorable. Cet amendement vise à remplacer l’intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, consacré à la lutte contre les maladies mentales, par un nouvel intitulé qui viserait les droits et la protection des personnes atteintes d’un trouble mental.
Toutefois, deux motifs s’opposent à ce changement d’intitulé. D’une part, le livre II concerne non seulement les droits et la protection des personnes, mais également l’organisation de la psychiatrie. D’autre part, il paraît préférable de conserver l’expression « maladies mentales », car elle est plus précise que celle de « trouble mental », peu signifiante pour les professionnels.
M. Jean Desessard s’exclame.

C’était l’explication de vote de M. Lorrain, pas l’avis de la commission !
En réalité, aucun enjeu juridique ne s’attache à cette question. Le code de la santé publique a été recodifié voilà peu, et la troisième partie de ce code, dans laquelle s’insère le titre II relatif à la lutte contre les maladies mentales, s’intitule désormais « Lutte contre les maladies et dépendances ». Elle comporte différents livres, dont les intitulés commencent tous par les termes « Lutte contre ». Le bon ordonnancement de ce code exige que l’on conserve ce parallélisme des formes.
Par ailleurs, la dénomination proposée, en mentionnant les droits et la protection des personnes atteintes d’un trouble mental, prêterait à confusion par rapport au livre Ier de la première partie du code de la santé publique, intitulé « Protection des personnes en matière de santé », et à son titre Ier, intitulé « Droits despersonnes malades et des usagers du système de santé ».
Pour ces raisons, je vous demande, monsieur le président Hyest, de bien vouloir retirer cet amendement.

Monsieur le président de la commission des lois, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous aurons l’occasion de défendre des points plus importants. Cet amendement étant surtout d’ordre symbolique, j’accepte de le retirer.
Marques d’ironie sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Y a-t-il des oppositions sur cette éventuelle séance vendredi prochain ?...
La parole est à M. Guy Fischer.

Nous y sommes opposés par principe ! Lorsque nous avons appris que seuls deux jours seraient consacrés à l’examen de ce texte, nous nous sommes demandé comment il serait possible d’y parvenir dans des conditions dignes, permettant d’aller au fond des problèmes.
Nous ne souhaitons pas que le Sénat siège ce vendredi. Car cela va continuer jusqu’à la fin juillet ! On nous a en effet avertis qu’il y aurait une session extraordinaire, qui se prolongerait après le 14 juillet...
Voilà comment travaille ce gouvernement, …

M. Guy Fischer. … et c’est inacceptable ! Notre réponse est donc : non, non et non !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.

Pour notre part, nous voulons continuer notre travail, en collaboration avec le rapporteur, la présidente de la commission des affaires sociales et le président de la commission des lois, afin de faire évoluer ce texte dans le sens que nous souhaitons, de ne pas perdre le fil et d’être psychologiquement prêts à poursuivre.

Je consulte le Sénat sur l’ouverture éventuelle d’une séance vendredi prochain.
La modification de l’ordre du jour est adoptée.

M. Jean Desessard. J’espère que ceux qui ont voté pour seront là vendredi ! En général, c’est Pasqua qui est là le vendredi !
Sourires.

L’ordre du jour s’établit donc comme suit :
Mercredi 11 mai 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 :
1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011 ; texte de la commission, n° 488 rectifié, 2010-2011) ;
Le soir :
2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (n° 492, 2010-2011).
Jeudi 12 mai 2011
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 468, 2010-2011) et projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 469, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

À 15 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :
2°) Questions d’actualité au gouvernement ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite des projets de loi organique et ordinaire relatifs aux collectivités de Guyane et de Martinique ;
4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (texte de la commission, n° 460, 2010 2011) ;
5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (texte de la commission, n° 471, 2010-2011) ;
La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mercredi 11 mai 2011, le matin ;

6°) Projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 473, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, avant 17 heures, le mercredi 11 mai 2011.

Vendredi 13 mai 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :
- Suite éventuelle du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures deux.