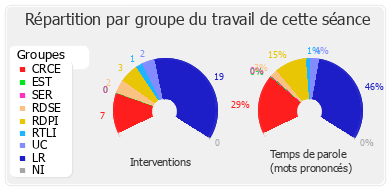Séance en hémicycle du 23 juin 2010 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes et de la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Dans la discussion des articles, nous continuons l’examen des amendements à l’article 1er.
L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par Mmes Payet, Férat et Morin-Desailly et MM. Détraigne, Merceron, Soulage, Amoudry et Deneux, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette dispense temporaire peut être délivrée à la personne majeure menacée de viol ou de toute autre agression sexuelle au sens des articles 222-23 et 222-27 du code pénal. Les personnes victimes de ces deux dernières infractions et menacées de subir des représailles après un dépôt de plainte peuvent aussi se voir délivrer une ordonnance de protection, si aucune mesure de contrôle judiciaire n'a été prise en amont. Les personnes victimes de la traite des êtres humains au sens des articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal ou du proxénétisme au sens des articles 225-5 à 225-10 du même code peuvent aussi se voir délivrer une ordonnance de protection.
II. - Alinéa 19, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette inscription est levée à la demande de la personne concernée.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Cet amendement vise à élargir l’ordonnance de protection aux personnes sans lien conjugal, qui peuvent être, elles aussi, menacées de viol, d’autres agressions sexuelles ou de représailles à la suite d'une plainte déposée contre des agresseurs n’ayant pas fait l'objet de mesures de contrôle judiciaire.
La durée de l'ordonnance de protection est fixée à quatre mois. Elle peut être prolongée si une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Mais d'autres procédures civiles ayant trait aux violences faites aux femmes peuvent être engagées durant ce délai de quatre mois et, in fine, l’outrepasser.
Seules les femmes majeures victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé peuvent bénéficier de l'ordonnance de protection. Or les femmes victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme sont, elles aussi, souvent en grand danger.
Par ailleurs, si le juge ordonne, à la demande d'une personne menacée de mariage forcé, l'interdiction temporaire de sortie de territoire et si cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République, cette inscription doit pouvoir être levée à la demande de la personne concernée.

Cet amendement a deux objets.
D’une part, il vise à prévoir que la personne intéressée peut demander la levée de l’interdiction temporaire de sortie du territoire dont elle bénéficie.
À mon sens, une telle précision est inutile. En effet, ayant sollicité une telle interdiction du juge civil, la personne concernée est tout aussi compétente pour en demander la suppression, le juge ayant seulement à vérifier si elle agit de son plein gré et si elle est en état de liberté intellectuelle.
En l’occurrence, madame Payet, la pratique, la procédure et la technique répondent totalement à votre préoccupation, dont, au demeurant, je ne conteste pas la légitimité.
D’autre part, l’amendement tend à étendre le bénéfice de l’ordonnance de protection aux personnes menacées de viol ou d’agression sexuelle.
J’appelle votre attention sur le fait que l’ordonnance de protection n’a pas une portée universelle, elle n’a pas vocation à s’appliquer à tous les faits de violence : elle concerne les relations au sein d’un couple. C’est un dispositif civil qui permet d’organiser la séparation civile des membres du couple, afin de garantir la protection de l’un contre l’autre. Elle n’est donc pas adaptée dans les situations où la victime n’a aucun lien civil avec son agresseur potentiel. Dans le cas que vous avez évoqué, ma chère collègue, la femme concernée ne vit probablement pas avec son agresseur. Le juge n’a donc pas à lui attribuer un domicile que, par hypothèse, elle ne fréquente pas.
En revanche, de telles situations relèvent de la compétence du procureur de la République et du juge pénal, qui a infiniment plus de pouvoirs que le juge aux affaires familiales, même si nous envisageons dans ce texte de renforcer sensiblement les prérogatives de ce dernier.
En créant de la confusion, nous risquons d’amener les victimes à se fourvoyer dans des procédures qui ne sont pas adaptées.
Madame Payet, je peux vous rassurer quant à la situation que vous avez en tête. Ce type de cas est déjà traité par des procédures extrêmement efficaces. En revanche, il ne le serait pas par le dispositif que vous proposez d’instituer par votre amendement.
C'est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, pour des raisons d’opportunité et de force de notre texte, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

L'amendement n° 2 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Collin, Barbier et Plancade, Mme Escoffier et MM. Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Après les mots :
mariage forcé
insérer les mots :
ou de mutilation sexuelle
La parole est à Mme Françoise Laborde.

Le texte que nous examinons a pour objet de lutter contre l’ensemble des violences commises au sein des couples, notamment à l’égard des femmes.
Comme le souligne l’exposé des motifs, et les différents orateurs qui se sont succédé l’ont également rappelé, les violences coutumières comme le mariage forcé et les mutilations sexuelles sont également des formes de violences à l’égard des femmes totalement inacceptables dans notre pays. Elles doivent donc absolument être visées par le texte que nous examinons.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que l’ordonnance de protection peut être rendue dans les cas de menaces de mariage contraint. Dans la proposition de loi initiale, les personnes menacées de mutilation sexuelle étaient également visées par une telle disposition. Hélas, cette référence a disparu lors de son examen à l’Assemblée nationale.
Notre amendement a donc pour objet de réintroduire dans le texte une référence aux violences de ce type en prévoyant que les personnes craignant des mutilations sexuelles auront également la possibilité de demander une ordonnance de protection.

Madame Laborde, à certains égards, je pourrais reprendre les observations que j’ai formulées tout à l’heure.
Dans les cas de mutilation, peut-être plus encore que dans les autres cas, il ne faut surtout pas amener la victime à se fourvoyer. En l’occurrence, comme il s’agit de mineurs, le juge compétent est le juge des enfants. Or celui-ci – ce point a d’ailleurs suscité nombre de débats au sein et en dehors de la commission – dispose de prérogatives extrêmement larges. Il a des pouvoirs répressifs, des pouvoirs éducatifs et des pouvoirs de protection ; c’est donc déjà un juge protecteur.
Par conséquent, nous ne devons pas laisser les victimes de mutilations sexuelles s’égarer en s’adressant au juge aux affaires familiales. Il s’agit de mineurs. Nous devons les aider, notamment en recommandant aux associations d’orienter ces victimes vers le juge compétent. Mais, de grâce, n’envoyons pas les victimes de mutilations sexuelles devant le juge aux affaires familiales ! Ce serait pour elles une énorme perte de temps et cela pourrait même menacer leur sécurité et leur santé.
C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
À mon sens, la protection des victimes menacées de mutilation sexuelle relève de la compétence non pas du juge aux affaires familiales, mais bien du juge pénal.

Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.
J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Monsieur le président de la commission des lois, si vous souhaitez absolument que le texte soit adopté ce soir, …

… vous devriez faire en sorte que les membres du groupe UMP soient suffisamment nombreux en séance !
Quant à moi, je souhaite qu’on prenne le temps qu’il faut pour examiner au fond les dispositions proposées !

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 233 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 44, présenté par Mmes Terrade, Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 515 -14. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée à la personne majeure menacée de viol ou de toute autre agression sexuelle au sens des articles 222-23 et 222-27 du code pénal par le juge, saisi par la personne menacée ou, avec son accord, par le ministère public, à l'issue de la procédure prévue par l'article 515-10 du présent code.
« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 515-11.
« Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà pendant toute la durée des procédures civiles et pénales en cours. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.

Cet amendement a pour but de permettre aux femmes menacées de viol et de toute autre agression sexuelle de bénéficier de l’ordonnance de protection. Il s’agit donc d’une extension du dispositif institué par l’article 1er.
En effet, les menaces de viol ou d’agression sexuelle peuvent provenir de personnes qui ne sont pas membres de la famille, mais auxquelles la femme menacée est confrontée de manière régulière parce qu’elles font partie de leur entourage social ou de leur voisinage.
Ces femmes sont donc placées dans une situation proche de celle des violences familiales, mais elles ne peuvent bénéficier de l’ordonnance de protection prévue par ce texte. Or, selon l’enquête « Cadre de vie et sécurité » menée au début de l’année 2007, les femmes sont autant exposées à la violence dans leur ménage qu’en dehors. Les violences sexuelles restent toutefois moins fréquentes à l’intérieur qu’à l’extérieur du ménage. S’agissant des agressions sexuelles commises à l’extérieur du ménage, 70 % des victimes disent en connaître l’auteur, et une fois sur deux, le viol a eu lieu dans le quartier de résidence de la victime. C’est pourquoi nous jugeons trop restrictif le dispositif tel qu’il est proposé.
Lorsqu’une femme est menacée de viol, elle ne souhaite pas nécessairement porter plainte. En outre, si des procédures sont engagées, elle peut se trouver pendant la durée de celles-ci en situation de danger dans l’hypothèse où la personne poursuivie demeure dans son entourage. Le bénéfice de certaines mesures de l’ordonnance pendant toute la durée des procédures, si elles sont engagées, peut contribuer à lever cette difficulté.
La création de l’ordonnance de protection est le pilier de ce texte. Nous ne pouvons laisser ces femmes en marge de ce dispositif de protection. L’extension de ce dispositif permettrait d’envoyer un message fort et d’inverser le niveau de tolérance ou d’indifférence à la violence subie par ces femmes.

Là encore, il faut éviter une grave erreur d’aiguillage. Avec les cas auxquels vous faites allusion, ma chère collègue, on ne se situe pas dans la violence banale, on se situe dans le crime : une menace de viol, c’est un crime.
Si une personne est menacée d’un viol, le meilleur conseil qu’on puisse lui donner, c’est tout simplement d’aller au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte. En vérité, elle en a déjà généralement l’idée, mais elle peut hésiter à franchir le pas.
Si elle se décide effectivement à le faire, dans les deux heures qui suivent sa déclaration, l’auteur des menaces peut être mis en garde à vue. Pendant quarante-huit heures, « il va être au frais » – pardonnez-moi cette expression – et la personne menacée est protégée. Passé les quarante-huit heures, un juge d’instruction peut prendre toutes les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre dans le cadre de l’ordonnance de protection. Mais il peut également en prendre beaucoup plus !
L’intérêt de la victime est de ne surtout pas aller perdre son temps devant un juge aux affaires familiales, quels que soient les progrès que nous faisons faire à la rapidité de sa saisine. Dans le cas que vous évoquez, le conseil que doit suivre la victime est de recourir directement à la procédure pénale, à la plainte, et d’aller au commissariat ou à la gendarmerie.
Votre intention est fort louable, mais, de grâce, comprenez que vous rendriez un très mauvais service à la personne menacée d’une agression sexuelle si vous lui indiquiez qu’elle a intérêt à se rendre devant le juge aux affaires familiales. Ce n’est décidément pas le chemin qu’elle doit prendre.
Dans un souci d’efficacité d’une loi à laquelle nous voulons donner une portée forte, et bien que je sois, avec vous, totalement convaincu de la nécessité d’offrir la meilleure protection aux personnes victimes de telles menaces, je ne peux pas donner un avis favorable sur votre amendement. C’est pourquoi je vous suggère de le retirer.
L'article 1 er est adopté.

L'amendement n° 32, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La mise en disponibilité demandée par un fonctionnaire ou assimilé est accordée de droit lorsque ce dernier bénéficie d'une ordonnance de protection tel que prévue par les articles 515-9 et suivants du code civil. »
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

En l’état actuel du droit, une mise en disponibilité est accordée de droit à un fonctionnaire qui en fait la demande dans les cas suivants : pour donner des soins à son conjoint, son enfant ou un ascendant victime d’un accident, d’une maladie ou d’un handicap ; pour élever un enfant de moins de huit ans ; pour suivre géographiquement son conjoint ou son partenaire pacsé ; pour se déplacer en vue de l’adoption d’un enfant ; pour exercer un mandat d’élu local ; enfin, dans la fonction publique hospitalière, pour rechercher un emploi quand son poste a été supprimé.
Eu égard à la gravité de la situation pouvant conduire une personne à bénéficier d’une ordonnance de protection, cet amendement vise à ajouter à la liste des motifs de disponibilité de droit dans la fonction publique le fait d’être protégé par une telle ordonnance.
On le sait, la violence au sein du couple surgit dans tous les milieux sociaux. La sécurité de l’emploi, qui devrait en principe être un atout au regard des situations de précarité subies par nombre de victimes de violences, peut également se révéler être une contrainte si, dans sa situation de danger, une personne ne peut bénéficier de l’éloignement physique temporaire d’avec l’auteur des violences lorsque cela s’avère nécessaire.
Or, dans les univers de la fonction publique, il n’est pas rare que les membres d’un couple travaillent dans la même administration, la même collectivité, le même établissement scolaire ou hospitalier. C’est particulièrement vrai dans les départements d’outre-mer, alors même que l’insularité et l’exiguïté du territoire ont des conséquences spécifiques dans les situations qui nous occupent.
Cet amendement vise donc à faciliter, pour un fonctionnaire, une démarche de mobilité géographique ou professionnelle motivée par une recherche de sécurité dès lors qu’il bénéficie d’une ordonnance de protection. Ainsi, l’employeur ne pourrait ni lui opposer un refus pour nécessité de service ni lui imposer un préavis.

Cet amendement vise à ajouter un nouveau cas de mise en disponibilité de droit d’un fonctionnaire : lorsqu’il bénéficie d’une ordonnance de protection. Pourquoi pas ? Mais la liste des disponibilités de droit pour motif familial est fixée par un décret du 16 septembre 1985. Ce point relevant du domaine réglementaire, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Je me permets cependant de faire remarquer que la mise en disponibilité de droit des fonctionnaires a pour conséquence la suspension du traitement. Dès lors, je ne suis pas certain que, dans les situations que nous visons, la mise en disponibilité soit une solution bien opportune.
Comme l’a indiqué le rapporteur, ce sujet ne relève pas de la compétence du législateur. En l’état actuel du droit, ce sont les décrets du 16 septembre 1985, pour la fonction publique de l’État, du 13 janvier 1986, pour la fonction publique territoriale, et du 13 octobre1988, pour la fonction publique hospitalière, qui définissent les cas dans lesquels l’agent est mis en disponibilité de plein droit à sa demande.
Sur le fond, ces textes prévoient déjà le bénéfice d’une disponibilité de droit pour des motifs familiaux. Il existe également une disponibilité pour convenance personnelle qui permet à l’agent, sans avoir à justifier d’une quelconque situation ou de conditions particulières, d’être placé hors de son administration ou service d’origine pour une durée maximum de trois ans renouvelable, dans la limite de dix ans.
Dans ces conditions, je considère que cet amendement est d’ores et déjà satisfait. Toutefois, monsieur le sénateur, je peux vous indiquer que l’attention des administrations et des employeurs des trois versants de la fonction publique sera appelée sur la gestion – avec la diligence, l’efficacité et la confidentialité qui s‘imposent – de la situation des agents bénéficiant d’une ordonnance de protection. Une circulaire précisera à cet égard les dispositions des décrets que j’ai cités et ce point sera en outre évoqué lors des séminaires des directeurs des ressources humaines de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.
Au regard de ces explications, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement ne pourrait être que défavorable.

Je formulerai trois observations.
D’abord, je signale que, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, se trouvent des mesures qui relèvent du domaine réglementaire.
Ensuite, je fais remarquer qu’on accorde une mise en disponibilité à des fonctionnaires pour suivre géographiquement leur conjoint ou leur partenaire, ou pour se déplacer afin d’adopter un enfant. Ne peut-on pas l’autoriser également dans les cas de violences ? Au demeurant, ce n’est jamais qu’une possibilité qui est ainsi offerte au fonctionnaire concerné.
Enfin, monsieur le rapporteur, vous disiez tout à l’heure qu’il fallait donner une portée forte à cette loi. Nous avons l’occasion de le faire en y inscrivant cette disposition.
Par conséquent, monsieur le président, je maintiens cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n° 32.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement sont défavorables à cet amendement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 234 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 33, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les centres de gestion des collectivités territoriales et les autres employeurs des fonctions publiques d'État, hospitalière et territoriale, peuvent mettre en place des dispositifs compatibles avec le principe d'égalité, visant à faciliter l'aboutissement des demandes de mutation, de détachement ou de mise à disposition des fonctionnaires ou assimilés bénéficiant d'une ordonnance de protection telle que prévue aux article 515-9 et suivants du code civil. »
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

Que la commission et le Gouvernement me disent à quels amendements ils sont favorables ; je ne donnerai plus d’explications que lorsqu’ils recevront un avis favorable. Cela nous permettra d’aller plus vite !
Je considère donc que celui-ci est défendu.

Comme pour l’amendement précédent, la commission émet un avis défavorable.
Mes chers collègues, nous sommes en train de procéder par scrutin public sur des dispositions qui relèvent en fait du domaine réglementaire. Nous perdons notre temps alors que des sujets qui méritent des débats plus approfondis, je pense en particulier à la médiation, nous attendent.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 53-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. » ;
2°
« 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. »

L'amendement n° 49, présenté par Mmes Terrade, Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 5
I. - Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La parole est à Mme Odette Terrade.

Cet amendement a pour objet de renforcer l’obligation d’information due aux victimes.
Le texte prévoit déjà que les officiers et agents de police judiciaire devront informer les victimes de leur droit à demander une ordonnance de protection.
Cependant, si les victimes ne connaissent pas les moyens mis à leur disposition pour échapper à l’auteur des violences qu’elles subissent, elles ne connaissent pas non plus les peines encourues par ce dernier.
Or l’audition des associations a révélé que cette absence d’information dissuade souvent les femmes de faire appel à la justice : ne pouvant pas évaluer les effets de leur démarche, les victimes craignent les éventuelles représailles dont elles pourraient faire l’objet.
Il paraît donc nécessaire d’offrir aux victimes une parfaite lisibilité des moyens juridiques mis à leur disposition et des conséquences que leur démarche aura sur les auteurs des violences qu’elles subissent.

Je comprends, là encore, les raisons qui sous-tendent cet amendement. Néanmoins, force est de constater que l’officier de police judiciaire délivre déjà à la victime un grand nombre d’informations. Il ne paraît pas opportun d’ajouter à la liste cette nouvelle information, car, deux fois sur trois, une victime qui est déjà à la limite de ne pas maintenir sa plainte la retire effectivement lorsqu’on l’informe des peines encourues par l’auteur des violences qu’elle subit.

La mesure que vous proposez, madame Terrade, n’est donc pas une bonne solution.

Je ne suis pas d’accord avec M. le rapporteur.
L’information des victimes est extrêmement importante, notamment dans les phénomènes d’emprise, qui s’accompagnent, ne l’oublions pas, d’une inversion de la culpabilité. Il est donc essentiel de rétablir la victime dans son statut de victime pour l’aider à sortir de cette situation.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er bis est adopté.
1° L’article 375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » ;
2° §(nouveau) Le dernier alinéa de l’article 373-2-6 du même code est ainsi rédigé :
« Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » –
Adopté.
Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° L’interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6, 375-7 et 515-13 du code civil. » –
Adopté.
I. – Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affairesfamiliales en cas de violences
« Art. 227 - 4 - 2. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. 227 - 4 - 3. – Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
II. – Après l’article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4 ainsi rédigé :
« Art. 141 -4. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du 9° et du 17° de l’article 138. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge d’instruction.
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.
« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d’instruction.
« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.
« À l’issue de la mesure, le juge d’instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
« Le juge d’instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. »

L'amendement n° 63, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Le dernier alinéa de l'article 141-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. » ;
IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 394 du même code est complétée par les mots : «, ainsi que celles de l'article 141-4; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
I. – Après l’article 142-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 142-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 142 -12 -1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 142-5, l’assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, commises :
« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
« Le présent article est également applicable lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 131-36-12, il est inséré un article 131-36-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 131 -36 -12 -1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l’encontre d’une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises :
« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. » ;
2° Après l’article 222-18-2, il est inséré un article 222-18-3 ainsi rédigé :
« Art. 222 -18 -3. – Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 222-48-1, la référence : « et 222-14 » est remplacée par les références : «, 222-14 et 222-18-3 ».
III. – Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.
De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.
Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

L'amendement n° 66, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises
par les mots :
condamnée pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement est extrêmement important, car c’est bien en pensant à toutes les femmes qui sont mortes que nous nous devons de trouver des dispositifs assurant aux victimes de violences au sein du couple une réelle protection.
Je vous le dis d’emblée pour éviter toute confusion, le dispositif que nous souhaitons introduire dans la loi est très différent du bracelet électronique d’assignation à domicile que vous connaissez. Il a été expérimenté en Espagne et a pour objet de protéger la femme d’une potentielle approche de l’homme qui lui veut du mal.
À l’alinéa 8 de l’article 2 bis, la commission des lois du Sénat a modifié le texte adopté par l’Assemblée nationale et le Gouvernement souhaite, pour une part, revenir à celui-ci en substituant la prise en compte de la peine encourue à celle de la peine prononcée, s’agissant de la possibilité de placer sous surveillance électronique mobile une personne ayant commis des violences ou des menaces à l’encontre soit de son conjoint, partenaire ou concubin, soit des enfants de celui-ci.
Le Gouvernement comprend la volonté de la commission des lois de mettre en cohérence avec les dispositions du droit actuel les nouvelles dispositions relatives au placement sous bracelet électronique des auteurs de violences commises au sein du couple. La commission des lois a ainsi fixé comme condition une peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée, par dérogation à la règle générale qui exige une peine de sept ans d’emprisonnement prononcée, et n’a pas voulu retenir comme condition une peine de cinq ans d’emprisonnement encourue.
Toutefois, cette solution, si elle est cohérente avec la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, ne l’est pas avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
En effet, au stade de l’instruction, il est possible de placer sous surveillance électronique mobile une personne poursuivie et présumée innocente dès lors que la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement. Une condamnation à une peine de cinq ans n’a donc pas à être exigée pour placer un conjoint ou compagnon dangereux sous surveillance électronique.
La disposition proposée par votre commission créerait une situation paradoxale : une personne pourrait être placée sous bracelet électronique jusqu’au jour de sa comparution à l’audience et, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, le bracelet électronique lui serait obligatoirement retiré, étant entendu que, si elle est condamnée à une peine d’au moins d’emprisonnement, le dispositif sera rétabli à la sortie de prison.
Par conséquent, il paraît au Gouvernement nécessaire de mettre le dispositif proposé en cohérence avec la loi pénitentiaire en prévoyant d’appliquer le même critère pour les prévenus et pour les condamnés. C’est la peine encourue, et non la peine prononcée, qui doit servir de base pour permettre un placement sous surveillance électronique.
De plus, en pratique, le texte de la commission limite considérablement le recours au placement sous surveillance électronique mobile des auteurs de violences au sein du couple.
Quelques éléments statistiques me semblent de nature à éclairer votre assemblée.
Les chiffres que livre le rapport du député Guy Geoffroy témoignent de la faiblesse de la durée moyenne d’emprisonnement ferme dans les cas de violences faites aux femmes. En ce qui concerne les violences exercées par le conjoint ou par le concubin suivies d’une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, la durée moyenne d’emprisonnement ferme était de quatre mois et demi en 2006. En ce qui concerne les violences sans incapacité de travail, la durée moyenne de l’emprisonnement ferme était d’un peu plus de quatre mois.
Par sa trop grande rigueur, la rédaction proposée par la commission limiterait l’apport du dispositif de surveillance électronique.
Par ailleurs, le rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales montre que les violences volontaires sur conjoint entraînent, dans une très large majorité de cas, des incapacités temporaires de travail inférieures à huit jours. Selon les modalités prévues par la commission des lois, dans 91, 5 % des 32 587 cas de violences sur conjoint constatés par les directions départementales de la sécurité publique et dans 84, 1 % des plaintes enregistrées par les services de la préfecture de police de Paris, les condamnations à des peines de prison sont trop faibles pour pouvoir appliquer le dispositif de surveillance électronique.
Or une des spécificités des actes de violences envers les femmes au sein des couples est l’escalade dans le temps. Une très forte majorité des crimes ont été précédés par des humiliations, puis par des menaces, puis par des coups de plus en plus violents. C’est ce que Mmes Dini et Kammermann ont très bien fait ressortir au travers de témoignages particulièrement émouvants.
Selon le rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, seulement 9 % des femmes victimes de violences osent porter plainte. Pourquoi ? Parce qu’elles savent que la mesure d’éloignement sans contrôle effectif de celle-ci ne sera pas forcément respectée. Elles ont peur, elles vivent dans la terreur, d’autant que c’est justement au cours des périodes d’éloignement décidées par le juge que le risque de passage à l’acte est extrêmement élevé.
D’après une étude réalisée en 2006, 41 % des crimes ayant entraîné le décès du conjoint ont lieu au moment de la séparation.
Le Gouvernement souhaite prendre ses responsabilités pour que le dispositif anti-rapprochement apporte, dans le cadre de cette expérimentation, la meilleure des protections.
C’est au juge qu’il appartient de décider : nous devons faire confiance au juge !
Pourquoi instituer une différence entre le pré-sentenciel, c'est-à-dire le moment où la personne fait l’objet d’un contrôle judiciaire et peut être placée sous surveillance électronique, et le post-sentenciel, pour lequel un tel placement nécessiterait une condamnation effective de cinq ans au moins ?
Et que faisons-nous de ceux qui sont condamnés avec sursis ?
Si je m’exprime avec tant de force devant votre assemblée, c’est parce que le Gouvernement est totalement mobilisé sur ce sujet, compte tenu des chiffres concernant ces femmes qui ont perdu la vie alors qu’un tel dispositif aurait permis de les protéger.
Qu’allons-nous dire au petit Ibrahima, le fils de Tania, poignardée le 16 février dernier par son ex-compagnon, alors en sursis avec mise à l’épreuve pour des menaces de mort proférées à son encontre ? Sa mère aurait pu être sauvée si le dispositif de surveillance électronique avait été mis en place. Demain, si une rédaction trop restrictive est adoptée sur ce point, c’est une autre Tania qui ne sera pas protégée…
Des millions de femmes nous regardent : elles attendent que la peur change de camp. C’est à nous de faire en sorte qu’il en soit ainsi. C’est une page de notre histoire que nous écrivons avec l’expérimentation de ce dispositif, qui permettra d’offrir la sécurité à de nombreuses femmes dans notre pays.
Il est donc plus qu’essentiel, aux yeux du Gouvernement, de revenir à l’équilibre initial du texte et de prévoir que les auteurs de violences au sein du couple pourront être placés sous surveillance électronique lorsqu’ils seront condamnés pour des violences ou des menaces passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et non condamnées effectivement à cinq ans.
Je souligne que le principe de proportionnalité est respecté, car ces délits incluent les menaces de mort répétées à l’encontre du conjoint, mais aussi les violences ayant entraîné des interruptions temporaires de travail, c'est-à-dire des délits graves, pour lesquels il y a tout lieu de craindre une surenchère.
C’est la mémoire de toutes ces femmes mortes de manière absurde qui l’exige de nous, qui l’exige de vous !
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous présente cet amendement : le Gouvernement prendra ses responsabilités pour qu’une nouvelle Tania ne vive pas dans la terreur. Il ne faut pas que, demain, une femme puisse se dire qu’elle aurait pu bénéficier de la surveillance du conjoint violent si celui-ci avait simplement encouru une peine d’emprisonnement de cinq ans ! Or la rédaction retenue par la commission va réduire la portée du dispositif du bracelet électronique, car, je vous l’ai dit, les peines effectivement prononcées sont, en moyenne, largement inférieures à cinq ans.

Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous dire, avec le plus grand respect, que ni la qualité de votre discours ni son caractère enflammé ne suffisent à emporter notre conviction.
Nul ne peut douter de l’engagement sincère de notre commission, ainsi que de tous nos collègues présents ce soir, dans ce combat contre les violences faites aux femmes. Mais nous devons procéder avec justesse, sauf à risquer, je le répète une nouvelle fois, de priver cette loi de la portée que nous voulons lui donner.
Vous avez été très complète dans vos explications, madame la secrétaire d’État ; je vais donc devoir vous répondre sur l’ensemble des points que vous avez soulevés.
Depuis 2005, la loi autorise le placement sous surveillance électronique mobile d’une personne dans plusieurs hypothèses : avant la condamnation, dans le cadre d’une assignation à résidence ; pendant l’exécution de la peine, dans le cadre d’une libération conditionnelle ou d’un aménagement de la peine ; après l’exécution de la peine d’emprisonnement, dans le cadre d’une surveillance judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une mesure de surveillance de sûreté. Le placement sous surveillance électronique s’apparente alors moins à une peine complémentaire – c’est là que réside, me semble-t-il, la confusion – qu’à une mesure de sûreté visant à prévenir la récidive d’individus qui, ayant purgé leur peine, sont toujours considérés comme dangereux.
L’article 2 bis de la proposition de loi vise à faciliter, par rapport au droit en vigueur, le placement sous bracelet électronique de l’auteur des violences conjugales dans deux hypothèses : premièrement, dans le cadre de l’assignation à résidence, en permettant un tel placement lorsque le mis en examen pour violences conjugales encourt une peine de cinq ans de prison, et non sept ans comme pour les autres infractions ; deuxièmement, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, à titre de mesure de sûreté, après l’exécution de la peine.
Aujourd’hui, le droit positif permet un placement sous bracelet électronique dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire lorsque la personne a été effectivement condamnée à sept ans de prison et que sa dangerosité a été constatée, ce qui signifie qu’une expertise est nécessaire.
S’agissant d’une mesure de sûreté destinée à prévenir la récidive, votre commission a considéré que le placement sous bracelet électronique après l’exécution de la peine devait être réservé, comme le prévoit le droit actuel, aux individus les plus dangereux. Dans le texte qu’elle a élaboré, elle a même admis que le seuil de la peine soit abaissé à cinq ans, conformément aux souhaits des députés, mais à la condition qu’il s’agisse de la peine prononcée et non pas de la peine encourue.
L’amendement du Gouvernement soulève donc une difficulté très importante au regard de lois que nous avons votées et de principes que nous avons réaffirmés encore très récemment !
Je me doute bien que la loi que nous allons voter et dont les termes seront, je l’espère, approuvés par les députés, ne fera pas l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 61 de la Constitution. Mais, dorénavant, le nouvel article 61-1 de la Constitution ouvre ce recours à n’importe quel justiciable. Eh bien, je peux d’ores et déjà vous annoncer que, si nous adoptons cet amendement, le premier avocat venu, qui n’aura pas besoin d’être un major de promotion, déposera une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, nous savons déjà que, dans sa décision du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a précisé que le placement sous surveillance électronique mobile devait s’appliquer à des personnes condamnées « pour certaines infractions strictement définies et caractérisées par leur gravité particulière ».
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous imaginer de placer sous surveillance électronique une personne condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis ?

Mais ce serait contraire à la décision du Conseil constitutionnel !
Vous ne pouvez pas vous livrer à des expérimentations en matière de droit pénal.
J’emploie des arguments forts pour tenter de vous convaincre, madame la secrétaire d’État : j’ai la conviction que, si nous votons cet amendement, nous commettons, constitutionnellement parlant, une erreur qui se retournera contre notre loi ! C’est la raison pour laquelle, sans tenir un discours enflammé, mais avec la même conviction que vous, j’émets au nom de la commission des lois unanime, un avis défavorable sur cet amendement.

Mes chers collègues, je ne suis pas juriste, je ne suis qu’un simple médecin généraliste. Je sais néanmoins que nous sommes le législateur, c’est-à-dire que nous faisons la loi.
J’ai toujours été partisan de la prévention et j’estime que le fait de placer quelqu’un sous bracelet électronique est une mesure de prévention, qui permet d’éviter que des événements irréversibles ne se produisent.
Vous voudrez bien m’en excuser, monsieur le rapporteur, mais, en toute conscience, je ne peux pas suivre vos arguments de juriste. En effet, c’est la prévention qui m’importe avant tout : il s’agit d’éviter un meurtre, car il faut appeler les choses par leur nom. Il ne s’agit pas d’attendre qu’un meurtre soit perpétré pour dire ensuite : « Ah, si nous avions su ! ».
Il en va de même dans d’autres situations que j’ai connues dans ma vie professionnelle : dans le cas des malades psychiatriques, il faut parfois adresser des injonctions thérapeutiques pour éviter que des actes irréversibles ne soient commis.
Voilà pourquoi, pour ma part, je voterai cet amendement.

Sur ce point, je suivrai entièrement notre rapporteur, et d’abord pour les raisons juridiques qu’il a exposées : nous voulons tous que cette loi soit votée, qu’elle soit appliquée et qu’elle protège les victimes. Or le risque d’une déclaration de non-conformité par le Conseil constitutionnel met déjà cette volonté à mal.
Ensuite, madame le secrétaire d’État, je dispose, moi aussi, d’exemples très concrets et très précis. Aujourd’hui, ce qui cause le plus de mal et qui contribue à protéger les auteurs de violences, ce n’est pas le port ou non du bracelet électronique, c’est la médiation pénale utilisée à tort.
Hier, à la tribune, j’ai évoqué le cas d’une femme qui en était à sa troisième médiation pénale et qui, malgré cela, était toujours poursuivie par son ex-mari. Cette femme m’a rappelée aujourd’hui. Dans l’intervalle, des mesures ont été prises, son ex-mari a été mis en examen, placé en garde à vue et, tout simplement, rappelé à l’ordre. Ce rappel à l’ordre a suffi et cette femme n’est plus harcelée : son mari s’est calmé, il va être jugé et devra subir la peine prononcée contre lui, mais le bracelet électronique n’est pour rien à son changement de comportement !
Si nous devons nous battre, c’est beaucoup plus contre la médiation pénale employée à mauvais escient que pour le bracelet électronique. Les victimes seront bien mieux protégées !

Je suivrai également l’avis de la commission.
Madame la secrétaire d’État, je crois que le bracelet électronique n’empêche malheureusement pas les personnes violentes de passer à l’acte, y compris en cassant leur bracelet électronique.
Par ailleurs, il est précisé dans l’objet écrit de votre amendement que le dispositif du bracelet électronique doit être applicable aux victimes. Cela m’amène à vous faire une proposition, parce que l’on ne peut pas décider, juste comme cela, de faire porter un bracelet électronique à des gens qui, en l’état de la législation, ne sont pas passibles de ce type de mesure. En revanche, si les pouvoirs publics voulaient s’en donner les moyens, ils pourraient doter les femmes d’un téléphone portable qui leur permettrait d’appeler à l’aide en cas de risque d’agression par leur conjoint ou leur compagnon, même s’il a accompli sa peine ou s’il n’a pas été condamné à une peine ferme.
J’ajoute que, même si je ne suis pas favorable à la surenchère en la matière, je crois que les peines doivent être exécutées. Des dispositifs doivent ensuite être mis en œuvre, en fonction de la peine, pour empêcher la récidive.
Je vous suggère donc de faire en sorte que les victimes soient dotées d’un moyen d’appel quand elles sont menacées.

Quand on légifère, il faut veiller à respecter scrupuleusement l’équilibre entre la juste répression et le respect des libertés publiques. Si nous adoptons cet amendement, le bracelet électronique sera applicable aux auteurs de violences conjugales passibles de cinq ans d’emprisonnement, mais pas aux auteurs d’agressions sexuelles ! Peu à peu, l’application de cette mesure va se répandre, alors que le Conseil constitutionnel avait adopté une position extrêmement ferme et restrictive – M. le rapporteur vous a lu l’extrait de la décision. Vous vous rappelez, mes chers collègues, que vous aviez émis d’expresses réserves, à l’époque, sur l’obligation de port du bracelet électronique par des personnes ayant purgé leur peine.
Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas de l’usage du bracelet électronique pour l’assignation à résidence – nous sommes d’accord, madame le secrétaire d’État ! – ni de son emploi comme modalité d’application d’une libération conditionnelle. Il s’agit d’obliger une personne à porter un bracelet électronique après l’exécution de sa peine : l’application de cette mesure a été réservée par le législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, aux cas les plus graves.
Lors de sa mise en place, le bracelet électronique ne s’appliquait qu’aux auteurs de crimes ayant exécuté une peine de dix ans ou plus. Ce seuil a été ramené à sept ans. Jusqu’où descendra-t-on ? On peut penser que cela n’a aucune importance, mais il n’y a aucune raison, une fois la peine exécutée, et sauf dangerosité particulière, de prolonger la peine par une privation de liberté. Nous devons être extrêmement prudents, car on ne peut pas improviser dans ce domaine, madame le secrétaire d’État, malgré tous les cas que vous pourrez nous citer !

Monsieur Blanc, faire du droit, c’est aussi respecter la Constitution et les libertés publiques et penser aux conséquences de nos décisions ! On va ensuite nous demander d’utiliser le bracelet électronique pour toute une série d’autres délits et nous aboutirons à un système qui n’aura plus aucun sens et sera complètement contraire à l’équilibre que nous avons trouvé pour ce qui concerne la peine de sûreté et le suivi socio-judiciaire.
Le placement sous surveillance électronique mobile vise à lutter contre la menace de récidive, après qu’une personne a été condamnée et a exécuté sa peine. Il ne s’agit pas de l’utiliser simplement parce que l’on entend condamner quelqu’un à une peine légère. Cela n’a aucun sens au regard de l’équilibre de l’échelle des peines et de notre système pénal.
Bien entendu, il est plus populaire d’insister sur l’horreur de tel ou tel cas. D’ailleurs, pour ma part, je souhaite que les magistrats soient plus sévères et les peines prononcées plus longues, car nous sommes beaucoup trop tolérants avec certains individus. Mais le placement sous surveillance électronique mobile ne résoudra pas le problème. En revanche, il détruira un équilibre de notre droit, l’équilibre nécessaire entre les libertés et la répression.
La commission des lois vous propose donc unanimement, mes chers collègues, de rejeter l’amendement du Gouvernement.
Madame la secrétaire d’État, quelle que soit votre force de conviction, nous sommes le législateur et nous avons le devoir de faire respecter les grands principes de notre droit !
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste, du RDSE et de l’UMP.

Après ce plaidoyer du président Jean-Jacques Hyest, quels arguments supplémentaires ajouter ?
S’est ouvert, en réalité, un débat de conscience entre ceux qui, à juste titre, considèrent que la prévention de crimes potentiels et possibles passe par une répression supplémentaire et ceux – dont je suis – qui pensent que nous avons le devoir de fixer des normes, des règles.
La création du bracelet électronique a donné lieu à de longs débats au sein de cet hémicycle et, comme M. Jean-Jacques Hyest l’a rappelé, la peine prononcée pour déclencher la mise en œuvre de cette mesure est passée de dix ans à sept ans.
Pour ne pas rallonger le débat, je soulignerai simplement deux éléments problématiques.
Le premier est l’abaissement du seuil de la peine que je viens d’évoquer. Dix ans, sept ans, cinq ans… Passerons-nous ensuite à deux ans, un an, six mois ? Le placement sous bracelet électronique doit conserver une signification : il doit s’appliquer à des situations relativement graves.
Le second, encore plus préoccupant, a trait au fait que la peine visée est, non plus prononcée ou exécutée, mais potentielle. Aucune condamnation réelle n’a encore été énoncée et on ne sait d’ailleurs pas quelle sera la teneur de cette condamnation. Nous entrons donc dans le domaine du virtuel, ce qui est dangereux, dans la mesure où nous ne savons pas où tout cela s’arrêtera.

Nos collègues, en évoquant le placement sous bracelet électronique, parlent d’une peine. À l’heure actuelle, c’en est une effectivement, mais, dans ce cas précis, et bien que je ne sois pas du tout juriste, je ne le conçois pas ainsi. La personne qui portera ce bracelet aura pour seule contrainte de ne pas approcher à moins d’une certaine distance de sa victime potentielle.
Que cherchons-nous à faire ? Mme la secrétaire d’État ayant été très claire sur ce point, je serai brève : notre objectif est de protéger dans l’immédiat – cet immédiat au cours duquel les actes graves sont commis – des femmes potentiellement en danger, dont le conjoint violent n’a pas encore été condamné. La peine que nous souhaitons infliger à ce dernier consiste simplement à lui interdire de s’approcher à moins de 400 mètres du domicile de sa compagne.

Il ne s’agit pas d’une assignation à résidence : il est question d’empêcher la personne d’approcher à moins de 400 mètres d’un lieu précis.
Pour ma part, soucieuse de la protection de la victime, je voterai l’amendement du Gouvernement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais encore apporter quelques éclaircissements, notamment sur le plan du droit.
Pardonnez-moi de le dire, mais lorsque certains me parlent de dispositions liberticides, …
… lorsque la notion de liberté est évoquée, les propos tenus reflètent une certaine incohérence.
Je respecte votre rôle de législateur. Initialement, je l’étais moi-même et en tant que membre du Gouvernement, auteur de projets de loi, je le suis encore quelque peu.
Nous sommes en train de travailler ensemble à la définition d’un nouvel outil.
Dans le dispositif de surveillance dont nous débattons, le juge peut très bien demander, au stade présentenciel, qu’une personne placée sous contrôle judiciaire porte un bracelet électronique. Dans ce cas, il n’y a pas eu condamnation, mais vous acceptez le port du bracelet électronique.
Voir le dispositif fonctionner concrètement apporte un certain nombre d’informations.
Monsieur Hyest, vous évoquez une privation de libertés, …
… mais il s’agit simplement d’empêcher l’agresseur potentiel d’approcher dans un rayon de moins de 400 mètres de la victime.
M’étant rendue en Espagne pour voir de quelle manière le dispositif fonctionne dans ce pays, laissez-moi vous expliquer comment les choses se passent : la personne qui porte le bracelet électronique est surveillée sur écran vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept ; dès lors qu’elle s’approche de moins de 400 mètres de sa victime potentielle, qui a, elle aussi, un boîtier, une sonnerie s’enclenche. Sa privation de liberté consiste donc à lui interdire de s’approcher de la victime. Voilà le dispositif !
Permettez-moi d’insister : un juge peut décider qu’une personne placée sous contrôle judiciaire, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, porte un bracelet électronique. Il aura estimé qu’au regard des menaces qu’elle a proférées, au regard de sa dangerosité, elle ne doit pas se trouver dans un périmètre de moins de 400 mètres autour de sa victime potentielle.
Avant la condamnation, la présomption d’innocence prévaut. Vous acceptez néanmoins que le dispositif soit appliqué à une personne placée sous simple contrôle judiciaire. Cela, vous l’autorisez !
Dans le cas d’espèce, il n’en va pas de même. Pourtant, en tant que législateur, vous devez aussi faire confiance au juge : celui-ci prendra une décision motivée, en fonction du risque encouru par la femme, et tous les maris ne se verront pas imposer une surveillance électronique mobile. Je rappelle, en outre, que les violences faites aux femmes entrent très largement dans le champ de la subjectivité.
Donc, dans le cas où un juge estimerait qu’une personne encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et déciderait de limiter cette peine à deux ans avec sursis, le placement sous bracelet électronique ne serait pas de rigueur et le condamné pourrait, en quelque sorte, repartir dans la nature !
Placé sous contrôle judiciaire, un homme devrait porter le bracelet électronique ; condamné à une peine avec sursis, il ne le porterait plus !
Vraiment, je regrette de devoir le dire, il y a une incohérence dans la rédaction de l’article 2 bis.
Comment, mesdames, messieurs les sénateurs, pouvez-vous laisser le juge imposer le port d’un bracelet électronique à un homme présumé innocent et, au moment de la condamnation, conditionner le port de ce bracelet au fait que la peine soit encourue ou effective ?
Un seuil de cinq ans est évoqué. Cinq ans ! Je peux vous assurer que pour infliger à une personne une peine de cinq ans d’emprisonnement pour violences conjugales, il en faut vraiment beaucoup !
Effectivement, il faut qu’elle ait pratiquement tué !
Faut-il attendre, mesdames, messieurs les sénateurs ?
Il n’est pas question, ici, du placement sous surveillance électronique mobile intervenant dans le cadre d’une assignation à résidence et d’une privation de liberté. Ce dispositif vise à protéger les femmes concernées par ces violences, en s’appuyant sur la subjectivité du juge. L’homme a proféré des menaces et eu des gestes indélicats : le juge, qu’il décide de le placer sous contrôle judiciaire ou qu’il lui inflige une peine avec sursis, pourra lui imposer le port du bracelet électronique.
Ce dispositif, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le refuseriez ? S’il ne prononce pas une peine minimale de cinq ans, le juge ne pourrait pas décider du placement sous surveillance électronique mobile.
Le Gouvernement prend ses responsabilités et assume sa position !
Je m’exprime avec passion et avec force, parce que j’ai rencontré un certain nombre de femmes au sein des associations, parce que je me suis rendue en Espagne et que j’ai vu des femmes disposant du boîtier être immédiatement alertées par la police dès lors que leur conjoint était entré dans le périmètre interdit.
J’ai entendu parler de téléphone… Le dispositif que j’évoque n’a rien à voir ! Quand l’homme violent se trouve juste dans votre dos, avec un couteau, il est trop tard pour prendre votre téléphone !

Croyez-vous vraiment qu’une telle situation sera impossible avec le bracelet électronique ?
Madame Borvo Cohen-Seat, je vous invite à aller voir le système fonctionner en Espagne. Avec le bracelet électronique, l’agresseur potentiel ne peut pas approcher de la victime. S’il le coupe, immédiatement, le dispositif sonne, les forces de sécurité sont alertées, la femme est prévenue. Elle est en sécurité !
Encore une fois, il s’agit d’interdire à l’homme d’approcher à moins de 400 mètres de sa victime potentielle, et non de se placer dans le cadre d’une privation de liberté. Ce dispositif vise simplement à protéger une femme qui risque de se faire massacrer !
Les violences faites aux femmes sont tellement subjectives et imprévues que nous devons nous doter non seulement d’un arsenal législatif – nous l’avons renforcé et vous êtes également en train de le raffermir –, mais aussi de moyens technologiques efficaces, qui interviennent sur toute la chaîne des poursuites judiciaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes libres de votre vote, en conscience, mais, au-delà, il y a aussi la cohérence du droit.
Vous avez votre propre interprétation, j’ai la mienne. J’estime que, dès lors que le placement sous bracelet électronique est envisagé pour une personne placée sous contrôle judiciaire, donc présumée innocente, le juge doit pouvoir, s’il décide d’infliger une peine encourue, et non effective, opter pour un dispositif de surveillance électronique mobile afin de protéger la femme.
Au-delà de toute interprétation d’ordre constitutionnel, il faut effectivement protéger, de toutes nos forces, ces femmes qui risquent d’être victimes de l’irréparable.

Chacun a sa conscience, madame la secrétaire d’État, mais permettez-moi de vous dire que vous mélangez trois éléments. Par conséquent, le dialogue est impossible !
Vous mélangez les mesures préventives prises dans le cadre de l’assignation à résidence, l’application de la peine et ses modalités.
Pour ma part, j’estime que, dans l’hypothèse où des faits graves sont commis par un individu au sein d’un couple, votre position remettrait en cause toutes les décisions de justice.
Chaque juge décide effectivement la peine applicable en fonction des faits. D’ailleurs, le bracelet électronique peut être une des modalités d’exécution de la peine.
En l’espèce, il s’agit de tout autre chose : nous parlons d’un dispositif exceptionnel.
Je ne vais tout de même pas vous relire les considérants de la décision du Conseil constitutionnel de 2005 !
En fait, la peine doit être proportionnée et la disposition en cause s’applique pour des peines exécutées. Madame le secrétaire d’État, la seule chose que je vous reproche, c’est d’avoir détourné une procédure exceptionnelle.

Vous n’aviez pas à inscrire le dispositif proposé dans le cadre du suivi socio-judiciaire !
Je le répète : vous avez détourné une procédure exceptionnelle, réservée aux faits les plus graves et destinée à éviter la récidive.
En voulant banaliser un dispositif exceptionnel, non seulement vous commettez une erreur en droit, mais, de surcroît, vous le privez de tout impact, car les magistrats qui seront en la matière les décideurs se garderont bien d‘ordonner une mesure qui ne respecte pas le droit !
Par conséquent, la commission des lois maintient son avis défavorable sur l’amendement n° 66.
Je comprends votre passion, madame le secrétaire d’État, mais les passions sont bonnes quand elles sont raisonnables !

Certes, je ne suis ni juriste ni très ancienne dans cette assemblée. Je m’étonne quand même d’entendre constamment faire référence à 2005 alors que nous avons aujourd'hui à notre disposition des technologies nouvelles.

Elles ont évolué ! En 2005, le bracelet électronique tel que Mme le secrétaire d’État le propose maintenant n’existait pas ! Mme Dini et moi-même avons compris la même chose. Et il me paraît important de faire référence à la prévention.

Parce qu’une vie n’a pas de prix, parce que je suis favorable à la prévention et à la protection, je voterai l’amendement du Gouvernement.

Monsieur le président, ce que j’ai à dire, je l’exprimerai à titre personnel. Le groupe socialiste réagira et votera en son âme et conscience.
Je suis d’accord avec vous, madame la secrétaire d’État : pour qu’un individu soit condamné à cinq ans d’emprisonnement, il faut vraiment qu’il en ait fait beaucoup ! Pour avoir vu trop de femmes blessées, voire tuées par leur partenaire, qu’il soit leur compagnon ou leur conjoint, je tiens absolument à leur assurer une protection très forte. Point n’est besoin d’insister davantage.
Je soutiens, à titre personnel, l’amendement du Gouvernement, afin que la plus grande protection soit apportée aux victimes et aux femmes.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 bis est adopté.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « lorsque » sont insérés les mots : «, conformément à l’intérêt de l’enfant, », et les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale » ;
3° Le premier alinéa de l’article 373-2-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »
II. –
Supprimé

L'amendement n° 50, présenté par Mmes Terrade, Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa de l'article 371-1 est ainsi rédigé :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. » ;
II. - Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d'un des parents pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de l'autre parent, le juge aux affaires familiales doit refuser le droit d'hébergement au parent auteur des violences. Il doit en outre organiser le droit de visite de ce parent dans un espace de rencontre qu'il désigne. L'exercice de ce droit de visite doit avoir lieu en présence d'un représentant de la personne morale habilitée visée à l'article 515-11. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Cet amendement a pour objet de protéger les enfants et le parent victime de violences. En effet, il ressort des auditions des associations de défense des victimes de violences que l’exercice de l’autorité parentale, comme celui des droits de visite et d’hébergement, est souvent utilisé par les auteurs de violences comme un moyen de pression sur les victimes ou alors est une occasion renouvelée de passage à l’acte.
Pourtant, la commission des lois a décidé de revenir sur la rédaction de l’article 3, qui nous semblait répondre à un véritable besoin. La violence conjugale a des conséquences sérieuses, dans l’immédiat comme à long terme, sur tous les membres de la famille.
Quel que soit l’acte de brutalité commis, les enfants sont affectés. Leur santé physique et leur équilibre émotionnel sont systématiquement mis en péril par les scènes de violence.
Comme le rappellent de nombreuses associations, il s’agit non de remettre en cause la coparentalité, mais de protéger l’enfant et le parent victime de violences. Je soutiens cette position.
Nous ne nions pas la difficulté de trouver un juste équilibre entre le souci de protéger l’enfant en l’éloignant du parent violent et la nécessité de maintenir des relations avec ce dernier, comme y invite le droit.
Au vu des réalités, force est toutefois de constater que la présence d’un enfant n’est pas un rempart contre la violence. Comment peut-on imaginer que l’hébergement de l’enfant chez le parent violent se fera dans la sérénité ? Comment concevoir qu’il puisse être de l’intérêt de l’enfant ? Est-il raisonnable de fixer la résidence de l’enfant et de statuer sur le droit d’hébergement de l’autre parent en faisant abstraction des violences conjugales ? Si un conjoint violent peut être un bon père de famille, il reste, cependant, un danger potentiel pour la mère.

L’amendement n° 50 vise, d’abord, à définir l’intérêt de l’enfant. Or telle qu’elle est considérée par les juges, cette notion me paraît d’ores et déjà prendre en compte la protection de ce dernier et le respect de ses droits.
Toute énumération visant à la définir pourrait en limiter le champ et l’affaiblir. Car cette notion de l’intérêt de l’enfant, elle est tous les jours en cours de définition devant les différents tribunaux. Et elle s’étend !
Si l’amendement n° 50 était adopté, il risquerait de créer des dangers d’interprétation a contrario. Établir une liste, c’est restreindre le champ. Parce qu’il n’y a pas lieu de distinguer quand la loi n’opère aucune distinction, il ne faut pas permettre aux juges de différencier.
Cet amendement fait référence aux « besoins fondamentaux » de l’enfant. Mais ce dernier n’a-t-il pas des besoins tout à fait légitimes qui doivent être protégés sans qu’ils soient nécessairement « fondamentaux » ? Avec l’adoption de ce texte, on reviendrait sur la jurisprudence des juges aux affaires familiales.
L’amendement n° 50 tend, ensuite, à obliger le juge à priver du droit d’hébergement le parent condamné pour violences sur l’autre parent. Il vise également à contraindre le magistrat à organiser le droit de visite dans un espace de rencontre médiatisé, ce droit étant exercé sous la surveillance d’une association habilitée.
L’idée qui sous-tend cette proposition, c’est que l’auteur des violences, quelle que soit leur gravité, ne peut pas être un bon parent et qu’il instrumentalisera le droit de visite pour nuire à l’autre parent. Non ! Cette idée est loin de faire l’unanimité et la situation visée n’est pas celle dont traitent habituellement les tribunaux.
De plus, cet amendement remet en cause le principe cardinal au nom duquel il importe de maintenir, dans la mesure du possible, un lien entre l’enfant et ses deux parents. Il est contraire à l’idée selon laquelle il revient au juge de tout mettre en œuvre, lorsque cela est envisageable, afin d’instaurer un apaisement entre les époux.
Il est d’ores et déjà prévu qu’un parent puisse être totalement privé du droit de visite et d’hébergement pour des motifs graves. Je parle d’expérience, cela se produit beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Dès lors que deux témoignages et un certificat médical font craindre au juge aux affaires familiales des violences particulières, susceptibles d’avoir un retentissement sur la psychologie de l’enfant et de le marquer, il puise dans les trames informatiques à sa disposition et prononce le sursis à statuer sur le droit d’hébergement de l’enfant jusqu’à ce qu’une enquête sociale soit ordonnée. Au vu des résultats de cette dernière, il précisera et définira ensuite sa position.
Mais d’ores et déjà, même dans des situations où cela vous paraît inimaginable, le juge sursoit à accorder le droit de visite et d’hébergement au parent violent.
En outre, la proposition de loi, telle qu’elle est actuellement rédigée, prend déjà en compte cette problématique des violences puisque l’article 3 bis impose au juge de la considérer lorsqu’il devra se prononcer sur l’attribution de l’autorité parentale.
De la même manière, l’article 3 vise à garantir la sécurité de la victime lors de « la remise directe de l’enfant à l’autre parent ». L’introduction de l’adjectif « directe » sur l’initiative du Sénat apporte une précision supplémentaire. En effet, la remise de l’enfant, c’est quelquefois le moment critique, celui où peuvent se cristalliser d’anciennes violences.
Le Sénat a procédé à une révision totale des pouvoirs du juge aux affaires familiales. En tout cas, il l’a invité à redoubler d’attention au moment de la remise de l’enfant.
C’est la raison pour laquelle, tout en reconnaissant que l’amendement n° 50 n’est pas dépourvu d’intentions louables, j’émets, au regard de ses effets, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.
Sur le premier volet de l’amendement, je ne suis pas favorable à la réintroduction de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale définissant l’intérêt de l’enfant. Je rejoins tout à fait M. rapporteur : toute énumération dans une définition limite le champ de la notion et l’affaiblit.
Je ne suis pas plus favorable au second volet de cet amendement qui prévoit l’automaticité des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Une telle disposition ne permettrait pas au juge de statuer dans l’intérêt de l’enfant sur chaque situation familiale.
Or l’intérêt de l’enfant suppose que le juge apprécie concrètement les relations de l’enfant avec chacun de ses parents et en tire toutes les conséquences quant aux mesures à ordonner.
Je rappelle que les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, tels qu’ils résultent de la proposition de loi, permettent la remise de l’enfant au sein d’un espace de rencontre désigné à cet effet, mesure de nature à protéger la victime contre une réitération des violences et à éviter des pressions.
De surcroît, le juge peut prévoir que les visites qui s’effectuent dans un espace de rencontre se font en présence d’un représentant de la personne morale chargée d’accompagner la victime.
En tout état de cause, les textes en vigueur permettent déjà au juge, s’il l’estime nécessaire, de prendre en compte les violences commises par l’un des parents pour décider de confier l’exercice de l’autorité parentale au seul parent victime ou de limiter les droits de visite et d’hébergement du parent auteur des violences.
Pour toutes ces raisons, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 50.

Nous nous abstiendrons lors du vote de l’amendement n° 50.
Il était question tout à l’heure de protection des victimes. En cas de violences commises au sein des couples, la première victime est, selon moi, d’abord l’enfant qui est présent.
Pour autant, je ne pense pas que la première mesure adéquate pour protéger ce dernier soit d’autoriser systématiquement les deux parents à le voir. Le droit de l’enfant à voir ses deux parents n’est pas nécessairement positif. Mais l’interdiction de voir l’un d’entre eux n’est pas forcément non plus une bonne idée.
Il faut d’abord savoir si l’on est en présence d’un phénomène de conflit violent ou d’emprise.
Dans ce dernier cas de figure, oui, il faut retirer certains droits au parent auteur des faits reprochés. Le parent capable d’exercer une emprise sur son conjoint ne pourra jamais être un parent aimant et structurant mais sera, au contraire, un parent déstructurant.
Dans l’hypothèse d’un conflit familial, les deux parents peuvent conserver leurs droits.

Ayant déjà eu ce débat, nous connaissons notre total désaccord.
L’enfant qui a été souvent le témoin des violences est lui aussi largement victime. Si le père est condamné, il semble impensable de lui confier la garde de l’enfant. Pour nous, il ne peut pas être un bon père.

Comme ma collègue Virginie Klès l’a dit, nous ne sommes pas favorables au I de l’amendement n° 50. En revanche, nous sommes très favorables à son II.
Ne serait-il donc pas possible, monsieur le président, de procéder à un vote par division ?

Il y a une cohérence dans l’amendement n° 50, comme il y en a une dans l’avis de la commission, et l’on peut difficilement, me semble-t-il, scinder les deux parties de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6 rectifié quater, présenté par Mmes Payet et Morin-Desailly et MM. Merceron, Soulage, Amoudry et Deneux, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées
II. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, si une procédure pénale est engagée pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la part d'un des parents à l'encontre de l'autre ou sur les enfants, la résidence de l'enfant est déterminée automatiquement par le juge aux affaires familiales chez le parent qui n'est pas poursuivi. La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal à l'issue de la procédure engagée. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Cet amendement prévoit que la résidence de l’enfant sera fixée par le juge aux affaires familiales chez le parent qui n'est pas poursuivi dans le cas où une procédure pénale est engagée par un parent pour violences perpétrées par l’autre. Le juge ou le tribunal pourra modifier cette décision à l'issue de la procédure engagée.
Évidemment, au regard de l'article 373-2-8 du code civil, le juge peut statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cependant, l'expérience prouve que tout est fait pour maintenir ce lien parental, même si des violences importantes sont exercées sur l'un des parents par l'autre.

L'amendement n° 62, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 8
1°) supprimer les mots :
Le premier alinéa de
2°) remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
un alinéa ainsi rédigé
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 6 rectifié quater.

L’amendement n° 62 est rédactionnel.
Quant à l’amendement n 6 rectifié quater, son adoption aboutirait à ce qu’une sanction puisse être prononcée même dans l’hypothèse où les faits ne seraient pas nécessairement avérés, ce qui serait, évidemment, lourd de conséquence.
Loin de garantir la protection de l’enfant, la détermination automatique de sa résidence risquerait au contraire de lui nuire, car elle produirait une automaticité des plaintes et conduirait à l’instrumentalisation du juge.
J’ajoute que si nous adoptions une telle disposition, nous interdirions au juge d’utiliser la possibilité que lui donne actuellement le code civil de fixer la résidence chez un tiers, par exemple chez les grands-parents, lorsqu’il apparaît que l’intérêt de l’enfant n’est de résider ni chez le parent violent, ni chez l’autre, pour d’autres raisons ou peut-être parce qu’il y a des phénomènes concurrents de violence.
J’émets donc un avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° 62, car il permet une meilleure compréhension de l’article 373-2-9 du code civil.
L’amendement n° 6 rectifié quater a pour objet de prévoir que, si une procédure pénale est engagée contre l’un des parents pour des faits de violence commis sur l’autre parent, la résidence de l’enfant est obligatoirement fixée chez celui qui n’est pas l’auteur de violences.
Je ne peux qu’être défavorable à un tel amendement, pour les raisons invoquées à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 30.
En effet, le juge doit pouvoir statuer au cas par cas, conformément à l’intérêt de l’enfant, et donc sans automaticité.
Surtout, une telle disposition porte en elle le germe d’une très grande instrumentalisation des procédures pénales. Un parent mécontent de la décision du juge aux affaires familiales n’aura plus qu’à déposer plainte pour des faits de violence contre son ex-conjoint afin d’obtenir que la résidence de l’enfant soit automatiquement fixée à son domicile. Un tel mécanisme n’est pas envisageable.
De plus, prévoir que la décision ayant fixé la résidence de l’enfant chez le parent victime pourra ensuite être modifiée par le juge à l’issue de la procédure pénale n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, qui ne doit pas avoir à changer de résidence au gré des procédures pénales, fondées ou non, et des décisions judiciaires rendues.
Je précise de surcroît qu’il n’est pas concevable, comme le suggèrent les auteurs de l’amendement n° 6 rectifié quater, que le tribunal correctionnel ordonne le transfert de résidence d’un enfant, seul le juge aux affaires familiales étant compétent pour statuer sur ce sujet.
La disposition en cause conduirait à une multiplication des contentieux devant le juge aux affaires familiales, ce qui fragiliserait encore davantage les enfants qui, on le sait, ont besoin de stabilité.
C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite à ne pas adopter cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.

L'amendement n° 34, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes morales habilitées visées au dernier alinéa de l'article 515-11 du code civil, chargées d'assurer l'accompagnement d'une personne victime de violence conjugale bénéficiant d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du même code, peuvent percevoir et administrer, de façon temporaire, les allocations familiales dues au profit des enfants concernés, en lieu et place de l'allocataire en titre, lorsque ce dernier est la personne mise en cause.
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

Cet amendement vise à permettre à des personnes morales de percevoir et de gérer les allocations familiales versées pour les enfants d’une personne victime de violences conjugales bénéficiant d’une ordonnance de protection en lieu et place de l’allocataire en titre si ce dernier est la personne mise en cause et si le parent victime ne peut être lui-même allocataire, pour des raisons administratives ou économiques. Cette mesure se justifie même en l’absence d’une situation nécessitant l’intervention du juge des enfants ou du juge des tutelles.
Alors, le juge aux affaires familiales statue sur cette possibilité, dans le cadre de l’ordonnance de protection, et non pour les raisons qui conduisent habituellement à une mise sous tutelle.

Cet amendement étant un amendement de coordination avec l’amendement n° 30, qui a été rejeté, devrait être lui-même repoussé, sauf à ce que ses auteurs le retirent.

L'amendement n° 51, présenté par Mmes Terrade, Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut également être saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur le refus de consentement de l'autre parent à l'accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l'enfant. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.

Il est vrai que le rétablissement de cet article peut sembler inutile, le juge aux affaires familiales étant déjà compétent pour statuer sur le refus de l’un des parents de soumettre son enfant à des soins médico-psychologiques.
Toutefois, cet amendement a aussi pour finalité de faciliter l’accès à l’information, de réunir dans un seul texte toutes les procédures et instruments disponibles afin de protéger l’enfant.
C’est pourquoi nous ne pensons pas qu’il soit redondant de rappeler le droit en vigueur dans cette proposition de loi, dont l’objet est précisément de renforcer la protection des victimes de violences conjugales.
Trop souvent, les femmes victimes n’ont pas de connaissance précise de leurs droits. C’est pourquoi, dans un souci de clarté et d’accessibilité, le législateur se doit de rassembler dans un même texte les dispositions susceptibles de faciliter leurs démarches.
L’amendement n° 51 est d’autant plus important que, comme le rappelle la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, les conséquences des violences conjugales sur les enfants sont non négligeables, même si elles sont encore peu évaluées en France. Ainsi, dans 10 % des cas recensés de violences conjugales, ces dernières étaient exercées aussi sur les enfants.
De même, la mission susvisée cite des études qui soulignent à quel point la concomitance entre les violences exercées envers la femme et celles qui sont commises envers un ou plusieurs enfants est fréquente.

Cet amendement n’est pas mal fondé, mais il est inutile, car je puis vous assurer, madame Schurch, que, l’intérêt de l’enfant n’étant pas encadré, la mesure que vous préconisez est très souvent prise : le juge dispose déjà d’un tel pouvoir et il est donc inopportun de le préciser dans la loi.
Cet amendement vise à rétablir une disposition qui figurait dans la proposition de loi initiale et mentionnait expressément la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il se prononce sur le refus d’un parent d’accepter que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques.
Cependant, en pratique, le juge statue d’ores et déjà sur ce type de litige, sur le fondement de l’article 373-2-6 du code civil, qui lui donne compétence pour trancher toutes les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en veillant à la sauvegarde des intérêts de l’enfant.
Il n’existe pas de liste limitative recensant les hypothèses de désaccords entre les parents et le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
L’article 373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. » –
Adopté.
Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est ainsi rédigé :
« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent. » –
Adopté.
Au deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, après les mots : « qui a recueilli l’enfant », sont insérés les mots : « ou un membre de la famille ». –
Adopté.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. » ;
2° L’article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l’étranger qui bénéfice d’une ordonnance de protection en vertu de l’application de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

L'amendement n° 17, présenté par M. Courteau, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Sueur, Yung, Bodin et Mirassou, Mmes M. André, Blondin, Cartron, Lepage, Schillinger, Ghali et Printz, M. Mazuir et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger comme suit ces alinéas :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et en accorde le renouvellement.
La parole est à M. Yannick Bodin.

L’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé. Toutefois, lorsque cette dernière a été rompue en raison de violences conjugales que l’étranger a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.
La proposition de loi, telle que modifiée par la commission des lois, dispose que l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et accorde le renouvellement, et non plus « peut en accorder le renouvellement », mais seulement dans le cadre de l’ordonnance de protection.
Nous vous proposons d’aller un peu plus loin et de prévoir que l’autorité administrative doit accorder d’office le renouvellement de la carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » à l’étranger dont la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, sauf si la présence de cet étranger constitue une menace pour l’ordre public.
J’insiste en particulier sur le fait que laisser à l’autorité administrative le soin de décider de ce renouvellement est susceptible de créer des différences selon le département où est déposée la demande.
L’actualité donne en effet plusieurs exemples – ils pourront se reproduire demain – qui démontrent que le renouvellement, non pas sous la pression de l’opinion publique, mais parce qu’il paraît relever de la bonne justice et du bon sens, doit être accordé d’office. Or on constate, hélas, que, d’une administration à une autre, la réponse n’est pas toujours la même.

Réglons donc une bonne fois pour toutes la question, car la situation des femmes concernées le justifie : n’ajoutons pas à leur détresse l’angoisse supplémentaire d’ignorer ce qu’elles vont devenir et décidons de leur accorder d’office un titre de séjour compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve.

J’estime que l’équilibre défini, de façon très pragmatique, à l’Assemblée nationale et qui consiste à lier le renouvellement automatique de la carte de séjour temporaire au fait de bénéficier d’une ordonnance de protection est satisfaisant et devrait tout de même donner grandement satisfaction aux auteurs de l’amendement n° 17.
La commission des lois, qui a repoussé divers amendements sur ce point, souhaite en tout état de cause en rester à cet équilibre, afin que la loi puisse être mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Pour les conjoints de Français, la proposition de loi prévoit déjà la délivrance et le renouvellement automatique du titre de séjour dès lors que la victime bénéficie d’une ordonnance de protection. Ce faisant, elle complète le dispositif actuel du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel il est possible d’obtenir du préfet le renouvellement du titre de séjour en raison des violences conjugales alléguées qui ont conduit à la rupture de la vie conjugale.
Ce système est cohérent : l’ordonnance de protection concerne des violences aggravées avérées, graves et reconnues par le juge qui donnent lieu à la protection immédiate de la victime en termes de droit au séjour.
Si aucune ordonnance de protection n’a été délivrée par le juge, les violences peuvent être prises en compte lors du renouvellement du titre de séjour, mais le préfet conserve un pouvoir d’appréciation indispensable à une évaluation globale de la situation de l’intéressée. Souvent, les situations sont complexes et doivent faire l’objet d’un examen minutieux au cas par cas, que seul le préfet est en mesure de réaliser.
Le texte actuel conserve donc une logique qui ne doit pas être remise en cause par un regroupement de l’ensemble des dispositifs de protection sur le même plan, emportant les mêmes conséquences au regard du séjour.

Notre proposition tendait à aider le Gouvernement à résoudre la présente question. Il est souhaitable, en effet, que ce dernier n’ait pas à intervenir après la décision d’une autorité préfectorale adoptée en fonction d’une interprétation non conforme au texte.
L’adoption de l’amendement n° 17 reviendrait donc à conférer au Gouvernement une certaine « tranquillité ». En effet, s’il se met en situation de devoir intervenir, il prend un risque, ...

... et les Français pourraient ne pas comprendre de telles décisions prises à l’encontre de personnes en détresse.
Puisque vous choisissez de courir ce risque, nous maintenons cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n° 18, présenté par M. Courteau, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Sueur, Yung, Bodin et Mirassou, Mmes M. André, Blondin, Cartron, Lepage, Schillinger, Ghali et Printz, M. Mazuir et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
Cet amendement n’a plus d’objet, monsieur Courteau.
L’article 5 est adopté.
Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection » ;
2° Sont ajoutés deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 316 -3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Art. L. 316 -4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. »

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 38, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 5 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 316-4. - Après la décision judicaire définitive concernant la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal, sauf si la décision déclare que le fait n'a pas été commis. »
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

Quelque chose m’échappe dans l’article 6.
La loi doit aussi bien condamner les criminels que protéger les victimes. Cependant, dans le monde réel, comme nous le savons, cela ne se passe pas toujours ainsi, et le méchant reste parfois impuni, faute de preuves suffisantes. Insuffisance de preuve ne signifie pas automatiquement inexistence des actes, mais révèle parfois, bien au contraire, habileté de l’agresseur.
Comme cela a déjà été indiqué, la preuve des violences conjugales est difficile à établir, même quand celles-ci sont physiques, et d’autant plus lorsqu’elles sont psychologiques. Une victime sous emprise porte plainte tardivement, alors que les marques de violence ne sont plus visibles. S’agissant des séquelles des violences psychologiques, il n’est pas facile de prouver la relation de cause à effet entre le comportement de l’agresseur et l’état de détresse psychique de la victime. Tout cela est bien complexe !
Faudrait-il, alors, ajouter au désastre de n’avoir pu condamner le criminel le drame de ne pouvoir protéger la victime, déjà vulnérable par ailleurs ? Peut-on vraiment, sans risquer le déni de justice, lier nécessairement l’obtention d’une carte de résident à la condamnation de la personne mise en cause ?
Les violences au sein d’un couple sont d’une nature particulière. Dans le cas présent, l’absence de condamnation peut avoir des conséquences désastreuses pour la victime, d’autant plus si l’auteur des violences est relaxé : la victime peut nourrir des craintes quant à son séjour, son droit au travail, et demeurer dans la précarité avec ses enfants.
Pourquoi donc une personne de nationalité étrangère en situation de danger avéré, ayant bénéficié – et pour cause ! – d’une ordonnance de protection et qui s’est engagée dans un parcours d’insertion et de stabilisation, devrait-elle nécessairement compter sur la condamnation de son bourreau, au terme d’un délai parfois bien long, pour avoir droit à la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français ?
Sécurisons ce dispositif : ne lions pas l’accueil d’une victime sur notre terre des droits de l’homme au sort que la justice réservera à l’auteur des violences qu’elle a subies. Au lieu de créer une nouvelle double peine dans notre droit, donnons un signe fort aux victimes !

L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Morin-Desailly et MM. Détraigne, Merceron, Soulage et Deneux, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
peut être délivrée
par les mots :
doit être délivrée
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Il ne me semble pas souhaitable d’aller au-delà de ce que prévoit, d’ores et déjà, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’égard des personnes victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme, qui peuvent se voir délivrer une carte de résident en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause.
Je demande donc aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi j’émettrai, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.
Défavorable aux deux amendements, monsieur le président.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 6 est adopté.
Un rapport remis par le Gouvernement sur l’application des dispositions prévues à l’article 515-9 du code civil aux ressortissants algériens soumis à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010.

Selon l’article 6 bis de la proposition de loi, un rapport relatif à la situation des femmes algériennes qui bénéficient d’une ordonnance de protection doit être présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010.
Les ressortissantes algériennes ne se voient pas appliquer le droit commun pour ce qui concerne le séjour sur le territoire français. Il existe un vide juridique dans les accords franco-algériens à propos de la rupture de la vie commune. Les femmes algériennes qui quittent le domicile conjugal, à la suite de violences, ne peuvent renouveler leur titre de séjour. Nous demandons donc que les conditions plus favorables du droit commun s’appliquent à elles.
L’accord franco-algérien ne comporte aucune disposition spécifique dans un tel cas de figure. Néanmoins, il peut être demandé une application par analogie du dispositif prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ces situations. Cette analyse est confortée par la circulaire du 31 octobre 2005 dans laquelle le ministère de l’intérieur recommande aux préfets d’apprécier la situation des Algériennes conjointes de Français qui sont séparées de leur époux en raison des violences subies selon les mêmes modalités que celles que prévoit le code précité.
La CIMADE relève toutefois que les préfectures, malgré la circulaire susvisée, ne renouvellent plus les premiers certificats de résidence des femmes algériennes qui ont rompu la communauté de vie à la suite de violences conjugales.
De plus, dans une décision du 3 avril 2008, la cour administrative d’appel de Paris, corroborant la majorité des décisions des tribunaux administratifs, a estimé que le préfet ne commettait pas d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour d’une ressortissante algérienne victime de violences conjugales, dans la mesure où l’accord franco-algérien ne prévoit pas de protection spécifique. Cette décision a été confirmée, notamment par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 décembre 2008.
Cette situation n’est pas admissible et ne semble pas correspondre à la volonté du Gouvernement. C’est sans doute la raison pour laquelle il a précisé, lors du débat en séance publique à l’Assemblée nationale, que « l’ensemble des dispositions de la loi qui ne contreviennent pas à cet accord seront pleinement applicables aux ressortissantes algériennes, qu’il s’agisse de l’aide juridictionnelle, de l’ordonnance de protection ou de la délivrance de la plupart des autorisations de séjour. »
En l’absence d’application de la circulaire qui a été prise, il convient de préciser le droit existant.
L’article 6 bis est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. - Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu de l'article L. 313-11 ou L. 431-2, dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. »
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Cet amendement, que j’ai déposé devant la commission des lois et que mes collègues socialistes ont eu l’élégance de reprendre quasiment in extenso, vise à compléter les dispositions de la proposition de loi en matière de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour aux femmes étrangères confrontées à la violence conjugale. Inspiré par des faits qui m’ont été rapportés par plusieurs consulats français d’Afrique du Nord, il a pour objet d’aider les femmes étrangères confrontées au vol de leurs documents d’identité et titre de séjour par leur conjoint.
Le scénario est simple : à l’occasion d’un retour dans le pays d’origine de l’épouse, le conjoint, le plus souvent français ou binational, dérobe ses pièces d’identité et son titre de séjour. Placée dans l’impossibilité, au moins temporaire, de rentrer en France, l’épouse doit, la plupart du temps, faire face à une procédure de répudiation ou de divorce devant une juridiction locale, moins protectrice des droits des femmes que les tribunaux français. Dans certains cas, ce fait s’accompagne d’une séquestration de la femme, et éventuellement des enfants du couple, par la belle-famille. Dans d’autres cas, la victime, complètement isolée et désemparée, se retrouve sans ressources, incapable de faire face aux dépenses de la vie courante familiale.
Il importe donc de permettre à ces femmes de rentrer en France, tout au moins le temps de stabiliser leur statut juridique, pour éviter une répudiation unilatérale par leur époux, de les aider à reprendre la vie commune ou, le cas échéant, à régler les modalités du divorce.
Bien que contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, la répudiation est pourtant parfois transcrite par le tribunal de Nantes, faute d’une saisine suffisamment rapide.
À la suite du vol de leurs papiers d’identité et du retour de leur mari en France, l’obtention du visa de retour est bien souvent impossible pour ces femmes. Elles sont donc pieds et poings liés face à leur époux indélicat.
En cas de vol de documents – fait qui constitue une violence à lui seul –, l’interruption de la vie commune ne devrait en aucun cas constituer un obstacle au renouvellement ou au remplacement du titre de séjour volé.
Si les violences physiques, depuis la loi du 20 novembre 2007, sont prises en compte par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention et le renouvellement du titre de séjour, la violence morale dont fait preuve le conjoint qui vole les documents d’identité de son épouse, entrave sa liberté de circulation et l’abandonne sur le plan moral et matériel n’est pas encore réellement reconnue par les pouvoirs publics français.
La délivrance d’un visa de retour devrait pourtant être de règle et de droit, sauf en cas de restriction liée à l’ordre public, et se répercuter ainsi sur l’instruction générale relative aux visas et sur le code susvisé.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Courteau, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Sueur, Bodin et Mirassou, Mmes M. André, Blondin, Cartron, Schillinger, Ghali et Printz, M. Mazuir et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère, bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu de l'article L. 313-11 ou L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le conjoint français a, lors d'un séjour à l'étranger et dans le cadre d'une tentative d'abandon, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
La parole est à M. Richard Yung.

Le présent amendement est très proche de celui de Mme Garriaud-Maylam : je constate avec plaisir que nous sommes pleinement en accord.
Cet amendement a pour source notre expérience commune de sénateurs des Français de l’étranger et notre connaissance de la situation de femmes étrangères résidant en France qui se trouvent en situation de détresse. Il vise à les aider à rentrer en France après un séjour dans leur pays d’origine, même lorsque leur époux leur a volé leur titre de séjour.
En 2007, j’ai été contacté par une ressortissante algérienne bénéficiant d’un titre de séjour français qui avait été trompée et abusée par son mari.
Après une visite en Algérie, le mari de cette femme est rentré en France, sans elle, mais en prenant ses papiers – son passeport algérien et sa carte de séjour française. Elle ne pouvait donc pas revenir dans notre pays. Elle s’est fait refaire un passeport algérien mais, lorsqu’elle s’est présentée au consulat général de France pour demander une nouvelle carte de séjour, elle a été confrontée à une situation de blocage, le consulat ne sachant pas comment traiter son dossier. Plusieurs jours de négociations ont été nécessaires. Disant cela, je n’émets aucune critique envers le consulat ; ce cas précis n’est pas prévu par la loi.
Il est primordial de mettre un terme à ce type de situation afin que les femmes confrontées à de telles difficultés puissent rentrer en France, pays dans lequel elles vivent.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux autorités consulaires françaises de délivrer un visa de retour à ces femmes.
Cet amendement, qui est presque identique au précédent, introduit une notion supplémentaire, la « tentative d’abandon » de la part du mari, autrement dit une volonté de répudier ou de divorcer et d’utiliser des moyens de fait contre l’épouse.

L’amendement de notre collègue Mme Garriaud-Maylam a l’avantage d’être codifié. Je vous propose de l’adopter, monsieur Yung, et de retirer le vôtre, qui serait ainsi satisfait.
De nombreuses femmes étrangères bénéficiant d’un titre de séjour, du fait de leur mariage avec un conjoint français, binational ou étranger disposant d’un titre de séjour en France, se voient dérober leurs pièces d’identité et leur titre de séjour à l’occasion de vacances dans leur pays d’origine.
De ce fait, l’épouse ne peut pas rentrer en France et le mari peut engager une procédure de divorce dans le pays d’origine, tout en sachant que les dispositions alors applicables seront moins favorables à la femme que celles qui sont en vigueur en France.
Au regard des préoccupations exprimées, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Je suggère à M. Yung de rectifier son amendement afin de le rendre identique à celui de Mme Garriaud-Maylam ?

J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 19 rectifié bis, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Courteau, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Sueur, Bodin et Mirassou, Mmes M. André, Blondin, Cartron, Schillinger, Ghali et Printz, M. Mazuir et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -2 -2. - Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu de l'article L. 313-11 ou L. 431-2, dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. »
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 et 19 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.

Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6 bis.
Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « civiles », sont insérés les mots : «, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ». –
Adopté.
Au deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, les mots : « déclarant que la réalité du fait n’est pas établie » sont remplacés par les mots : « déclarant que le fait n’a pas été commis ».

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Courteau, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Sueur, Yung, Bodin et Mirassou, Mmes M. André, Blondin, Cartron, Lepage, Schillinger, Ghali et Printz, M. Mazuir et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
du code pénal, les mots :
insérer les mots :
« de relaxe ou de non-lieu déclarant » sont remplacés par les mots : « de relaxe ou de non-lieu, déclarant » et les mots :
La parole est à Mme Virginie Klès.

Il s’agit d’un amendement de clarification tendant à l’ajout d’une virgule.
Une règle de grammaire barbare, appelée, dans mon enfance, « mise en apposition », exige un nombre pair de virgules entre le sujet et son verbe.
Aux termes de la rédaction actuelle, le non-lieu « déclarerait » que les faits de dénonciation calomnieuse sont inexacts, alors que ce doit être la décision d’acquittement qui procède à une telle déclaration.

Ne prétendant pas être un excellent grammairien, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement !
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Ne voyant pas l’intérêt de cette rectification, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 20 rectifié.
Protestations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Oui, mais vous savez, le Gouvernement et la grammaire…
L'amendement est adopté.
L'article 8 est adopté.

L'amendement n° 21, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Courteau, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Sueur, Bodin et Mirassou, Mmes M. André, Blondin, Cartron, Schillinger, Ghali et Printz, M. Mazuir et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 225-10-1 est abrogé ;
2° À l'article 225-25, les mots : «, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.
II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.
La parole est à M. Richard Yung.

Le présent amendement a pour objet d’abroger le délit de racolage passif institué par l’article 50 de la loi du 18 mars 2003. Depuis lors, le fait de racoler, activement ou passivement, est punissable de deux mois de prison et de 3 750 euros d’amende.
La création de cette infraction devait permettre de lutter contre les troubles à l’ordre public, notamment les nuisances dont les riverains se plaignaient, et d’éradiquer les réseaux étrangers de proxénétisme.
Nous partageons avec la majorité l’objectif de lutter contre ces réseaux mafieux de proxénétisme et de traite des personnes prostituées. Pour autant, nous sommes opposés au délit de racolage passif, injuste, inefficace et dangereux.
Il est injuste parce qu’il n’est pas défini, étant constitué par une simple négation, une absence d’action, qui, par ailleurs, ne cause préjudice à personne.
De plus, il soumet les personnes prostituées à un régime spécial. Or la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949, ratifiée par la France, exige l’abrogation de toute disposition ou pratique conduisant à les inscrire dans les registres spéciaux ou à les soumettre à des conditions exceptionnelles de surveillance.
Une simple application du droit commun est possible. La stigmatisation des prostituées par le biais de la création d’articles spécifiques nous semble infondée. Il suffit de mettre en œuvre les dispositions existantes relatives aux atteintes à la moralité ou à la tranquillité publique – tapage nocturne, exhibition sexuelle ou trouble au bon voisinage.
Par ailleurs, le délit de racolage passif est inefficace. Il n’a en rien contribué à lutter contre le trafic d’êtres humains ou le proxénétisme. Depuis son entrée en vigueur, aucun procès pour traite des êtres humains n’a eu lieu.
Ce délit est enfin dangereux parce qu’il conduit les personnes prostituées à se rendre dans des zones de plus en plus lointaines, des zones de non-droit. Des femmes dont les camionnettes sont saisies et non restituées sont obligées de travailler dehors, dans des conditions beaucoup plus dangereuses. Elles sont ainsi fragilisées, en particulier lors la négociation, si j’ose dire, du préservatif.
La France est un pays abolitionniste dans lequel la prostitution n’est pas interdite. Or l’introduction du délit de racolage passif dans notre droit l’a fait glisser progressivement vers un régime prohibitionniste. La confusion entre la répression du racolage et celle de la prostitution s’est ainsi installée.
Le comportement des policiers s’est, par ailleurs, radicalisé – gardes à vue abusives, fouilles humiliantes ou contraventions injustifiées. Vous le savez, il faut faire du chiffre… Pour illustrer mon propos, je souhaite vous citer, mes chers collègues, le cas d’une femme prénommée Evelyne, qui a été interpelée vingt-six fois en deux mois et demi. Sa comparution immédiate a eu lieu le 30 décembre 2004 ; elle a été condamnée à trois mois de prison, mais cette condamnation a été cassée pour vice de forme.
Au mois de février dernier, lors de l’examen de la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, une députée du groupe UMP Mme Chantal Brunel avait déposé un amendement similaire à celui que je vous présente. Nos motivations divergent quelque peu, mais, sur le fond, nos positions convergent.
Mme Brunel avait retiré son amendement en séance publique, Mme Morano lui ayant promis la mise en place d’un groupe de travail.
Plus de trois mois ont passé. Quid de ce groupe de travail ? S’est-il réuni ? Quelles sont ses conclusions ?
N’ayant à l’heure actuelle obtenu aucune information supplémentaire, nous souhaitons la suppression du délit de racolage passif.

Cette thématique n’ayant été abordée que par la voie d’un amendement extérieur, la commission des lois n’a pu ni organiser d’auditions sur ce sujet très important, qui mérite une réflexion approfondie, ni réaliser les recherches nécessaires. C’est uniquement pour cette raison que j’émets un avis défavorable.

Le Sénat doit examiner au mois de septembre le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Ce sera le moment de vérifier la pertinence du dispositif adopté.

Alors tout est dans tout et réciproquement !
Lors du vote de la disposition en cause, certains avaient émis des doutes.
Monsieur Yung, je préférerais que vous retiriez votre amendement, quitte à en présenter un similaire dans le cadre de l’examen du projet de loi que j’évoquais à l’instant.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le groupe de travail que j’avais annoncé à l’Assemblée nationale a été constitué ; il s’est réuni dix jours après l’intervention de Mme Brunel et doit rendre ses conclusions avant la fin de ce mois.

Voilà quelques semaines, nous interrogions, dans cet hémicycle, le ministre de l’intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question du racolage passif. Si j’ai bonne mémoire, sur presque toutes les travées, nous nous étions prononcés en faveur de la suppression du délit de racolage passif, estimant que le but poursuivi n’avait pas été atteint.
L’ensemble des associations, quelles que soient leur façon de penser, leur philosophie, leur action en matière d’accompagnement des personnes prostituées, demandent instamment au Gouvernement de revenir sur le délit de racolage passif.
Notre pays est en train de passer de l’abolitionnisme à la prohibition. En soumettant les personnes prostituées à des pénalités, nous en faisons des victimes de violences.
Faut-il encore attendre et instituer de nombreux groupes de travail pour confirmer cette analyse ? Celui que vous avez mis sur pied, madame la secrétaire d’État, doit, selon vos dires, remettre ses conclusions à la fin du mois. C’est demain !

Effectivement, en France, la prostitution n’est pas interdite, elle est même admise fiscalement – chacun le sait –, ce qui est d’ailleurs assez paradoxal.
Le délit du racolage passif est mal défini. Quels critères retenir ? Par ailleurs, depuis sa mise en place, l’efficacité de cette disposition n’est pas avérée.
Comme l’a dit M. Yung, on renvoie les personnes prostituées dans des zones difficiles et dangereuses.
Pour ma part, je voterai l’amendement n° 21.
L'amendement n'est pas adopté.
Le 3° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire est complété par un e et un f ainsi rédigés :
« e) À la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
« f) À la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. » –
Adopté.
L’article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. 66 - 1. – Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil. » –
Adopté.
I. – Après le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l’ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »
II. – Le premier alinéa de l’article 4 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s’applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement. »

L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Collin, Barbier et Plancade, Mme Escoffier et MM. Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
un nombre suffisant de logements
Insérer les mots :
, répartis géographiquement,
La parole est à Mme Françoise Laborde.

L'article 10 tend à réserver, dans chaque département, des logements destinés aux victimes de violences conjugales. Ces logements doivent être répartis sur l’ensemble d’un département, en tenant compte non seulement de la répartition démographique des populations, mais aussi des problèmes différents, notamment économiques, que peuvent rencontrer les victimes de violences dans les zones les moins peuplées.
C’est pourquoi le législateur doit veiller à ce que ces logements dédiés soient répartis en milieu urbain, dans les villes les plus importantes des départements, comme en zone rurale et sur les territoires à moindre densité de population.

Cet amendement me paraît satisfait par le droit positif. Par conséquent, la précision qu’il vise à introduire ne semble pas utile. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Depuis la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009, les femmes victimes de violences font partie des personnes prioritaires pour ce qui concerne l’accès à un logement social.
Le droit au logement opposable est géré à l’échelon départemental, sauf en Île-de-France, où il relève du niveau régional. Mais la pratique révèle que l’État privilégie un logement dans la commune d’origine.
L’article 10 de la présente proposition de loi prévoit la passation de conventions spécifiques avec les bailleurs pour réserver les logements en cause.
Madame Laborde, les dispositions de votre amendement, dont je comprends l’intérêt, risquent néanmoins d’être inopérantes et de freiner la conclusion de quelques conventions. Certains bailleurs, comme les offices communaux ou intercommunaux, ne pourront répondre à l’objectif de répartition géographique sur l’ensemble du département, ce qui nuira à la conclusion de ces conventions.
Par ailleurs, flécher de manière trop précise la localisation de ces logements limitera la fluidité et la rotation des habitations au sein du parc HLM.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention passée entre l’État et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d’un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l’ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. » ;
2° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». –
Adopté.
Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple est présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. Cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de l’éducation nationale, aux personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.

Nous souhaitions inscrire dans la loi la formation initiale et continue de tous les professionnels qui se trouvent confrontés aux violences faites aux femmes au sein des couples.
Je le répète, nous touchons là à un point essentiel : il est de la plus haute importance, selon nous, que ces professionnels disposent d’une connaissance approfondie de ce phénomène particulièrement complexe, pour mieux dépister les violences et mieux accueillir, assister et accompagner les victimes. Mes chers collègues, n’oublions surtout pas que ces violences sont d’un type particulier !
D'ailleurs, cette demande faisait l’objet de l’article 4 de la proposition de loi n° 118 déposée par les membres du groupe socialiste. Elle figurait également en bonne place dans la première proposition de loi de 2006, puis dans celle qui suivit, en 2007. C’est dire si, pour nous, cette formation a toujours été une préoccupation constante !
En effet, comme les associations l’ont fait remarquer, nous pouvons regretter le manque de coordination entre les différentes administrations et les personnels confrontés aux violences intrafamiliales.
Très souvent, les formations dispensées sur la question sont aussi en nombre limité et effectuées sur la base du volontariat, donc par les personnes les plus motivées. Pour certaines professions, il existe bien une formation initiale, à laquelle sont associées des formations complémentaires, dans le cadre de la formation continue. Toutefois, ces dernières, à ma connaissance, ne sont pas obligatoires.
Je conviens que la liste des personnels devant obligatoirement bénéficier d’une formation initiale et continue telle que nous l’avions établie dans notre proposition de loi était relativement restrictive. Je souscris tout à fait aux propos de M. le rapporteur et des membres de la commission des lois, qui soulignent la nécessité d’y ajouter les personnels de l’éducation nationale, comme le prévoit l’article 11 A du présent texte, mais aussi les agents de service de l’état civil, les policiers municipaux et les agents de l’administration pénitentiaire, sans oublier – j’insiste sur ce point – les avocats, ou encore les agents d’animation sportive ou culturelle.
Néanmoins, il faut préciser que de telles dispositions sont confrontées à l’irrecevabilité financière, en application de l’article 40 de la Constitution. Nous nous satisferons donc de l’article 10 bis B, qui précise qu’un rapport sur la mise en place d’une formation spécifique sera remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2011.
En outre, je crois savoir que le Gouvernement a pris des engagements. Madame la secrétaire d'État, je souhaiterais, tout simplement, savoir précisément lesquels.

L’article 10 bis B est en effet important.
Le cinquième des femmes victimes de violences physiques et le tiers des victimes de violences sexuelles n’ont ni porté plainte, ni enregistré de main courante, ni parlé à qui que ce soit.
Trop souvent, les femmes victimes de violences restent murées dans leur silence. Le rapport sur l’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes indique que « des lacunes subsistent dans le repérage des femmes victimes de violences, étape pourtant fondamentale dans un contexte de sous-estimation de ces violences. » Toutes les femmes que nous avons rencontrées ont mis l’accent sur la nécessité de former les professionnels et de leur fournir un outil méthodologique d’aide à l’entretien.
Les députés ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils ont souhaité que des formations spécifiques puissent être dispensées à l’ensemble des personnes appelées à prendre en charge les victimes de violences.
Pourtant, ces dispositions ont été déclarées irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, tout comme les amendements visant le même objet que nous avions déposés en commission et en séance.
Il est vrai que le Parlement doit être informé, qu’il doit disposer de données exactes, connaître la situation, avertir d’autres acteurs et les associer aux efforts. C’est pourquoi nous sommes favorables à l’article 10 bis B, dans sa rédaction actuelle.
Toutefois, une forte volonté politique est nécessaire pour que le recul de ces violences devienne une priorité. C’est pourquoi nous estimons que la présente proposition de loi doit prévoir des formations systématiques pour les professionnels concernés, en particulier les juges, les policiers et les médecins. Le rôle des parlementaires est de veiller à ce que des programmes spécifiques soient conçus pour ces personnels et dotés de fonds suffisants.
Il s’agit de donner les moyens nécessaires, afin de mieux détecter les violences, pour que les victimes prennent la parole. Policiers, gendarmes, assistantes sociales, médecins, magistrats, les professionnels et les personnels de ces différentes administrations voient encore trop souvent leurs actions, qui peuvent être contradictoires, insuffisamment coordonnées.
La lutte contre la violence domestique implique une action concertée et décloisonnée des pouvoirs publics et des professionnels en contact avec les victimes.
En région Auvergne, des formations ont été dispensées dans tous les départements aux référents « violences intrafamiliales » des brigades de gendarmerie, voire, en Haute-Loire, aux représentants de la police ; aux intervenants à domicile, mais aussi aux infirmiers et aides-soignants, formés à la détection des violences, notamment dans le Cantal ; enfin, aux assistants sociaux et aux associations.
Toutefois, il reste très difficile de créer des formations communes. En 2009, une stratégie progressive de maillage du territoire a été mise en place, notamment dans les zones rurales qui sont dites « blanches » car elles sont moins concernées par les actions dans ce domaine.
Toutefois, à ce jour, en France, seuls trente-deux départements ont désigné un référent « violences conjugales ».
De plus, les actions menées en région Auvergne étaient soutenues par le biais du groupement régional de santé publique, le GRPS, qui a inscrit dans ses formations un programme à part entière sur l’impact de la violence conjugale sur la santé des femmes.
Là encore, de nombreuses pistes sont compromises par la révision générale des politiques publiques, car, avec la disparition du GRSP cette année et la mise en place des ARS, les agences régionales de santé, les orientations du nouveau dispositif ne sont pas connues à ce jour.
Comment dès lors espérer faire de la prévention via la formation des médecins ou des urgentistes dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires, qui rencontrent 50 % des victimes sans détecter les problèmes de violence auxquels ces dernières sont confrontées et les traitent pour des maux divers sans aller à l’essentiel ?
C’est pourquoi nous regrettons que le Gouvernement, qui n’est pas soumis aux aléas de l’irrecevabilité de l’article 40, n’ait pas inscrit dans un texte législatif ce mécanisme de formation systématique. En effet, ce serait là assurer un maillage complet du territoire, afin de mieux repérer les violences dont sont victimes les femmes.

Il me semble important, comme notre collègue vient de le souligner, que cette formation soit commune et pluridisciplinaire. D'ailleurs des missions communes relatives à la situation des enfants maltraités sont obligatoirement menées dans les départements depuis la loi de 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance, dispositif qui n’est pas systématiquement appliqué. Il faut donc non pas des formations distinctes pour les policiers ou pour les travailleurs sociaux, mais une approche pluridisciplinaire.
En matière de prévention, je voudrais évoquer une expérience que j’ai découverte lorsque je m’occupais de protection de l’enfance, afin de souligner que la maternité peut être un lieu de prévention, dès lors que 800 000 naissances s’y produisent chaque année.
Ainsi, à Draguignan, lors de consultations de gynécologie, un médecin à l’écoute des dysfonctionnements pouvant survenir au sein des couples a mis en place une sorte d’équipe et réunit tous les intervenants autour d’une table, afin de poser un diagnostic adéquat et de proposer une ordonnance avant qu’un drame ne survienne. Madame la secrétaire d'État, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à vous rendre sur place.

Mes chers collègues, au début de l’examen des articles de cette proposition de loi, M. le président de la commission des lois a précisé les contraintes, notamment horaires, auxquelles est soumise la présente discussion. Je me suis moi-même efforcé de les rappeler à la reprise de la séance. Or je constate que nous ne pourrons achever l’examen de ce texte dans les horaires impartis, c'est-à-dire avant minuit.
La parole est à M. le président de la commission.

Je rappelle que la conférence des présidents avait proposé d’achever l’examen de ce texte demain, à partir de dix-neuf heures parce que la journée est réservée à l’initiative parlementaire et que d’autres textes doivent être débattus auparavant.
Il ne reste plus que vingt-deux amendements à examiner, et nous pourrons toujours être plus concis si le temps nous manque !

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 24 juin 2010.
À neuf heures :
1. Proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux (n° 268, 2008-2009).
Rapport de Mme Anne-Marie Escoffier, fait au nom de la commission des lois (n° 519, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 520, 2009-2010).
2. Proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n° 191, 2009-2010).
Rapport de M. Paul Blanc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 530, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 531, 2009-2010).
À quinze heures :
3. Proposition de loi sur le recours collectif (n° 277, 2009-2010).
Rapport de M. Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois (n° 532, 2009-2010).
4. Question orale avec débat n° 62 de M. Serge Lagauche à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sur l’égalité des chances dans l’enseignement primaire et secondaire.
M. Serge Lagauche attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sur l’abandon progressif du principe de justice sociale dans la politique éducative depuis 2002.
Que ce soit, avec la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ou plus récemment avec le volet éducatif du plan Espoir banlieues, on assiste à la multiplication des dispositifs de sélection des élèves « méritants » au détriment de la promotion collective, gage de justice sociale.
Ce n’est pas critiquer la mise en œuvre des mécanismes d’admission préférentielle dans les filières sélectives du supérieur que de souhaiter que le Gouvernement s’intéresse tout autant à ces 150 000 élèves, qui chaque année, se retrouvent sans qualification à l’issue de leur parcours scolaire. La volonté de faire émerger une élite doit s’accompagner d’une volonté de faire progresser parallèlement l’ensemble des élèves et, en particulier, ceux qui ont le moins de chance de réussir.
De nombreuses actions sont engagées dans la prévention des sorties sans qualification. Au vu des chiffres persistants en matière de décrochage scolaire, il convient d’engager sans tarder une évaluation de ces dispositifs.
Premièrement, concernant les 170 000 élèves déclarés en situation de handicap, scolarisés en 2007, les professionnels déplorent unanimement un dépistage trop tardif. D’une part, les enseignants référents sont submergés par le nombre de dossiers arrivés trop tardivement, d’autre part, il semblerait utile de redéfinir le rôle des auxiliaires et des employés de vie scolaire.
Deuxièmement, on constate une persistance d’un échec scolaire plus élevé parmi les élèves socialement défavorisés, phénomène d’ailleurs amplifié par la dérégulation de la carte scolaire. Dès lors, ne doit-on pas redéfinir les missions et le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) pour plus d’efficience ? De même, ne conviendrait-il pas de s’interroger sur les capacités d’accueil des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) et des sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ? Comment faire pour que les aides personnalisées et les stages de remise à niveau dans l’enseignement primaire répondent mieux aux besoins des élèves ?
La mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses et exceptionnelles pour les élèves présentant des handicaps dans leurs apprentissages – qui peuvent se combiner – tels que difficultés socio-économiques, troubles linguistiques, cognitifs, comportementaux ou médicaux dès la petite enfance, est donc urgente. Il faudrait l’assurer par une politique ciblée en premier cycle et en secondaire permettant de réduire le nombre d’élèves en décrochage scolaire en particulier dans les territoires qui font face aux plus lourds handicaps et ainsi réduire l’énorme coût social des adultes qui n’ont pas acquis les qualifications de base indispensables pour trouver leur place dans la société.
Il souhaite donc connaître les dispositifs que le Gouvernement pourrait mettre en place pour éviter aux élèves les plus en difficulté le décrochage scolaire, tout comme il a mis en place des dispositifs d’admission préférentielle dans le supérieur pour ceux en situation de réussite issus de milieux sociaux défavorisés.
À dix-neuf heures et, éventuellement, le soir
5. Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes (n° 340, 2009-2010) et de la proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (n° 118, 2009-2010).
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (n° 564, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 565, 2009-2010).
Avis de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 553, 2009-2010).
Rapport d’information de Mme Françoise Laborde, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 553, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à minuit.