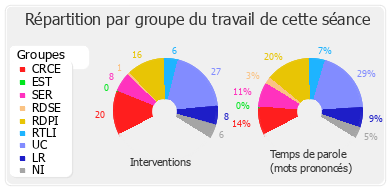Séance en hémicycle du 5 février 2015 à 15h00
Sommaire
- Questions cribles thématiques (voir le dossier)
- Candidatures à deux organismes extraparlementaires
- Accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire (voir le dossier)
- Adoption définitive en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Nominations de membres de deux organismes extraparlementaires
- Modernisation du secteur de la presse (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques, posées à M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur la situation de l’emploi.
Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe.
Je rappelle également que ce débat est retransmis en direct sur France 3 et sur Public Sénat.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour le groupe CRC.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’année 2014 a été une année noire pour l’emploi : 300 000 chômeurs supplémentaires, explosion des contrats de courte durée.
Les jeunes et les plus de cinquante ans sont particulièrement touchés : le contrat de génération a des effets limités et les emplois d’avenir n’ont aucune pérennité.
Avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE – et le pacte de responsabilité, vous avez surtout distribué des dizaines de milliards d’euros aux grands groupes économiques.
C’est pourtant imperturbablement dans cette impasse que le Gouvernement persiste.
Pourtant, il y aurait beaucoup d’emplois à sauver dans le Pas-de-Calais, par exemple. Le site d’Arjowiggins à Wizernes est menacé de fermeture d’ici à juin 2015 : 307 salariés en CDI, plus les intérimaires et les emplois indirects, sont concernés par cette décision.
Arc International perdra plus de 200 emplois malgré la reprise de l’entreprise par un fonds d’investissement américain.
Au sein de la compagnie MyFerryLink, interdite d’accès au port de Douvres, ce sont également 600 emplois qui sont menacés de suppression.
Rien que dans mon département, j’aurais pu citer aussi Mecaplast, Tioxyde, Stora Enso, la Française de mécanique, Bridgestone, et j’en passe.
Sur le sujet très sensible du travail détaché, illégal ou détourné, on ne peut s’en tenir au statu quo, monsieur le ministre.
Or, lorsque Pierre Laurent interpelle le Gouvernement sur le plan social chez Sanofi, celui-ci répond qu’il a été négocié. En fait, il a été annulé par la justice ! Mais à coup de modifications du code du travail, vous avez rendu impuissants les salariés face à cette saignée !
Monsieur le ministre, quand comptez-vous inverser votre politique en donnant notamment le pouvoir aux salariés de s’opposer à ces logiques destructrices, souvent financières ?

Monsieur le sénateur, dans ma réponse aux autres questions qui me seront posées au cours de cette séance, je reviendrai sur certains des thèmes que vous avez abordés à l’instant, notamment celui du travail détaché.
Vous évoquez une situation d’échec ; je ne l’ai pas niée. Effectivement, sans qu’il soit nécessaire d’en rajouter, 188 000 demandeurs d’emploi supplémentaires de catégorie A se sont inscrits à Pôle emploi en 2014. Cette situation perdure depuis 2010. Entre 2008 et 2014 inclus, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits auprès de l’Agence a augmenté de 1, 3 million. J’aurai l’occasion de préciser les choses tout à l’heure.
La chute de l’emploi industriel, que vous avez évoquée, notamment dans les entreprises de votre département, mais pas uniquement, date de fort longtemps – deux dizaines d’années – et s’est accélérée depuis 2000. Ainsi, la part de l’emploi industriel dans l’emploi total de notre pays est passée au cours de cette période de 17, 5 % à 11 %. Cette dégradation est donc nette et elle est liée à une perte de compétitivité indéniable des entreprises.
Pour y remédier, le Gouvernement a fait un choix à travers le pacte de responsabilité et de solidarité, celui de redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour investir, pour développer l’apprentissage, pour s’occuper des jeunes et créer de l’emploi.
Pardonnez-moi la brièveté de ma réponse, monsieur le sénateur, j’en suis désolé, mais je ne peux faire autrement. J’aurai l’occasion d’y revenir.

Je comprends bien les contraintes de temps, mais j’avais également évoqué la question des droits des salariés dans les entreprises, qui ne peut demeurer sans réponse. Ainsi, dans le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le Gouvernement propose de réduire encore les pouvoirs d’intervention des salariés et de contrôle de l’administration en cas de licenciements collectifs.
Je le dis très clairement, nous sommes prêts, pour notre part, à travailler sur tous les dossiers, comme je le ferai demain avec Alain Vidalies sur le dossier MyFerryLink.
Il est temps de défendre le pavillon français et de s’opposer à des décisions unilatérales qui bafouent les intérêts nationaux.
Monsieur le ministre, vous avez parlé de l’emploi industriel. Il existe dans ce domaine beaucoup de projets innovants que l’État devrait promouvoir et accompagner, par exemple la production d’éco-emballages à base de chanvre en lien avec le site Stora Enso de Corbehem, dans mon département.
Très souvent, trop souvent, il faut s’opposer aux intérêts égoïstes des multinationales et de leurs actionnaires pour réaliser ces projets.
En avez-vous le courage et la volonté politique ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le ministre, dans le contexte de croissance économique ralentie que nous connaissons, le chômage continue de progresser.
M. Philippe Dallier s’exclame.

Il frappe plus particulièrement les plus de cinquante ans, mais aussi – et surtout – les jeunes, qui ont de plus en plus de mal à s’insérer sur le marché du travail.
Dans cette perspective, vous avez notamment impulsé une politique volontariste visant à permettre à ces jeunes sans emploi d’acquérir une première expérience professionnelle.
Pour cela, vous avez largement développé les contrats aidés et il faut souligner que les moyens budgétaires débloqués dans ce but ont été à la hauteur de l’enjeu : près de 500 000 contrats aidés étaient budgétés en 2014 ; 445 000 le seront en 2015.
Cet effort remarquable doit cependant – et ce sera le sens de ma question – être mis en perspective au regard de deux éléments.
Le premier est de savoir quel est leur impact réel sur l’évolution du chômage.
Le second concerne les types de contrat qu’il convient de privilégier.
Il apparaît en effet que les contrats aidés créés dans le secteur marchand, comme les contrats initiative emploi, dont le coût est moins élevé, permettent une meilleure insertion de leurs bénéficiaires dans l’emploi.
On sait en revanche que les contrats aidés dans le secteur non marchand, comme les contrats d’accompagnement dans l’emploi ou les emplois d’avenir, s’adressent à des publics jeunes, souvent très éloignés de l’emploi, auxquels ils donnent une première chance professionnelle et l’occasion de s’insérer sur le marché du travail.
Au-delà de leur coût, on voit donc bien que le recours aux contrats aidés doit être adapté en fonction des publics ciblés et de ses effets attendus.
Dans ces conditions, monsieur le ministre, au regard de la situation actuelle, comment comptez-vous renforcer l’efficacité de ces contrats ?

Monsieur le sénateur, la politique en faveur des contrats aidés n’est pas nouvelle et elle permet de préparer différents publics à l’insertion dans l’emploi. Il est donc normal que l’État les développe.
Vous avez rappelé les chiffres : 445 000 emplois aidés ont été budgétés dans la loi de finances initiale pour 2015. À certaines périodes, à la fin des années quatre-vingt-dix, on a compté jusqu’à 800 000 emplois aidés
M. Philippe Dallier s’exclame.

La différence avec la période antérieure à 2012, c’est que beaucoup d’emplois aidés étaient utilisés à des fins électorales.
Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.
M. François Rebsamen, ministre. Il s’agissait en fait de contrats très courts
Mme Catherine Procaccia et M. Philippe Dallier s’exclament.
, le contraire de ce que demandaient des structures de lutte contre la pauvreté aussi sérieuses que le collectif ALERTE ou la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, la FNARS.
M. Francis Delattre s’exclame.
Au cours d’une visite à Dijon précédant le lancement du Grenelle de l’insertion, le Président de la République nouvellement élu, Nicolas Sarkozy, s’était déclaré favorable à l’allongement de la durée des contrats aidés, six mois ne permettant pas une véritable insertion dans le monde du travail. Aujourd’hui, nous en sommes à onze mois.
Monsieur le sénateur, vous vous êtes interrogé sur la différence qui existe entre les contrats aidés dans le secteur marchand et les contrats aidés dans le secteur non marchand. Depuis que je suis ministre, l’administration me répond que les contrats aidés dans le secteur non marchand permettent une meilleure insertion des publics. Il n’en demeure pas moins que je suis assez sensible à ce que vous avez dit, monsieur le sénateur : je considère qu’il faut favoriser les emplois aidés dans le secteur marchand également. C’est pourquoi la loi de finances initiale a prévu le financement de 80 000 emplois dans le secteur marchand à destination des seniors et des chômeurs de longue durée.
M. Francis Delattre s’exclame.

M. Claude Bérit-Débat. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Mme Catherine Procaccia s’exclame.

(M. Francis Delattre s’exclame.) Quel est le type de contrat le plus efficace : dans le secteur marchand ou dans le secteur non marchand ? Étant précisé que dans le secteur marchand, – mais n’est-ce pas un effet d’optique ?
M. Philippe Dallier s’exclame.

Je suis un fervent défenseur de ces contrats. §– ces contrats peuvent assurer une meilleure insertion et représenter une meilleure réponse à la demande de travail.
Votre réponse me satisfait pleinement, monsieur le ministre.

M. Claude Bérit-Débat. Dans la mesure où on va marcher sur deux béquilles, sur deux pieds, sur deux jambes
M. Francis Delattre s’exclame.

, secteur non marchand et secteur marchand, je vous encourage à poursuivre dans cette voie.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux évoquer la situation préoccupante et catastrophique du secteur du BTP. Il pèse sur le maintien de ses emplois une grave inquiétude.
À la situation économique catastrophique que connaît ce secteur, aux effets négatifs de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », s’ajoutent de lourdes contraintes administratives : je pense ici non seulement au compte pénibilité, dont M. Sapin lui-même dit qu’il est impraticable, mais aussi et surtout à la réglementation extrêmement contraignante qui pèse sur le travail des mineurs. Certes, celle-ci a une vocation préventive, mais elle rend tout simplement impossible l’apprentissage d’un vrai métier dans l’entreprise.
Ainsi, en Bretagne, depuis cinq ans, le secteur du BTP a perdu 800 postes d’apprenti, alors que celui-ci a une longue tradition quantitative et qualitative de formation.
Je voudrais également évoquer, monsieur le ministre, la question des salariés détachés d’entreprises localisées dans l’Union européenne. Nous le savons, bon nombre d’entre elles ne respectent pas la réglementation en vigueur, soit sur les conditions de travail, soit sur les salaires.
Le nombre d’emplois détachés est passé de 26 000 en 2008 – je le dis de mémoire – à plus de 200 000 en 2013, et atteint 300 000 si l’on compte aussi les emplois détachés non déclarés.
Cette situation a contribué, en Ille-et-Vilaine, à une perte de 2 000 emplois dans le secteur du BTP.
Certes, la loi Savary de 2014 a mis en place un dispositif assez coercitif pour lutter contre la fraude, mais, vous le savez, monsieur le ministre, les fraudeurs ne connaissent pas les 35 heures ! Ces entreprises incitent nombre de salariés à travailler le soir, le week-end et les jours fériés, et il est indispensable de mieux cibler ces contrôles.
Monsieur le ministre, quelles seront vos propositions concrètes pour un meilleur ciblage de la lutte contre la fraude destructrice d’emploi ?

Surtout, comment le Gouvernement compte-t-il concilier sa volonté très louable en matière de développement de l’apprentissage et la réglementation très stricte qui constitue un frein à l’embauche ?

M. François Rebsamen, ministre. Madame la sénatrice, je ne reprendrai pas les différents éléments de votre question, mais je partage vos préoccupations. Il est vrai qu’il y a eu une dégradation assez sensible de l’emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il est vrai qu’il y a une augmentation très sensible du nombre de travailleurs détachés, ce qui, en soi, n’est pas un problème lorsqu’ils sont déclarés.
Mme Françoise Gatel opine. – M. Philippe Dallier s’exclame.

Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur les dispositions que nous comptons prendre pour lutter contre le travail détaché illégal, c’est-à-dire non déclaré.
Vous le savez, les parlementaires ont adopté la loi dite « Savary » dont l’objet est la lutte contre le travail détaché illégal. Pour ce faire, nous allons augmenter, bien sûr fortement, l’amende administrative afin de lui donner un effet dissuasif. Nous allons prochainement avoir la possibilité de suspendre les prestations de services internationales en cas de manquement grave aux règles de détachement. En outre, à la demande de la fédération du bâtiment, qui le réclamait depuis près de dix ans, nous allons mettre en place une carte d’identité professionnelle.
Je suis heureux de pouvoir apporter une réponse positive en la matière, car de nombreux freins s’opposaient à l’instauration d’une telle carte.
Nous allons également, dans le domaine de l’apprentissage, apporter une réponse concrète à la suite de la réunion qu’avait organisée le Président de la République le 19 septembre pour lever les freins à l’apprentissage. Je vais prendre un décret sur les travaux dits dangereux des jeunes, qui sera publié prochainement, avant le mois de mai. Il permettra de faciliter l’accès des jeunes à l’apprentissage – sans pour autant les mettre en danger –, par une déclaration et non plus une demande d’autorisation des entreprises. Cette mesure sera conforme à ce que vous attendiez. De plus, les objectifs de contrôle vont être réévalués à la hausse. Je prendrai d’ailleurs dans les semaines qui viennent, avec M. le Premier ministre, une initiative très forte pour lutter contre le travail illégal.

Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour favoriser le développement de l’apprentissage, mais aussi, je le répète, pour assurer les contrôles le week-end et les jours fériés. À cet égard, il m’est arrivé, lors d’une promenade dans ma commune, de m’approcher d’un chantier et de voir les peintres s’enfuir comme une volée de moineaux. C’était un dimanche après-midi, monsieur le ministre !

Mme Catherine Procaccia. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une étude récente de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, vient bouleverser bon nombre des idées reçues sur les CDI. Elle montre, chiffres à l’appui, qu’un peu plus d’un tiers des contrats à durée indéterminée sont rompus avant la fin de la première année, un chiffre étonnant eu égard à la situation de l’emploi, et d’autant plus paradoxal que le taux de ces ruptures anticipées est en augmentation.
M. Jean Desessard s’exclame.

Autre bouleversement des idées préconçues, la première cause de rupture anticipée n’est pas la fin de la période d’essai, mais la démission du salarié, dans plus de 16 % des cas.
L’étude souligne la très faible part des licenciements, qui s’élève à quelque 3 %, et celle, complètement marginale, des ruptures conventionnelles.
Enfin, il apparaît que la part des CDI rompus avant le premier anniversaire est particulièrement élevée chez les 15-24 ans : plus de 45, 6 %, et qu’une démission sur deux concerne les personnes les moins qualifiées.
Ces chiffres, monsieur le ministre, doivent vous interpeller autant que moi. Les jeunes sont-ils instables ? Sont-ils mal préparés aux réalités du travail salarié ? Ils montrent en tout cas l’inefficacité des politiques publiques qui incitent les entreprises à proposer des CDI aux jeunes sans qualification.
Le CDI n’est donc plus synonyme de stabilité ni de fidélité pour l’entreprise, puisque 50 % des contrats sont rompus la deuxième année, et 60 % la troisième année.
Monsieur le ministre, puisque le CDI n’attire plus les nouvelles générations du XXIe siècle, envisagez-vous, comme l’a fait un moment le Premier ministre, de rapprocher les obligations contraintes des différents contrats afin de faciliter la vie des entreprises, en particulier celles qui sont de taille modeste ?
À défaut de créer un contrat unique, comme le suggèrent les économistes et notre prix Nobel français Jean Tirole, allez-vous proposer l’alignement des dispositions des contrats courts, CDD et CDI de courte durée ?

Madame la sénatrice, je partage votre analyse : les ruptures conventionnelles ont connu un franc succès depuis leur mise en place en 2008-2009. Ce succès ne se dément pas, puisque celles-ci ont augmenté de 6 % en 2014, pour atteindre le chiffre record de 333 000.
Rappelons que, entre 2012 et 2013, – il n’y a donc pas de lien avec la politique menée – ces ruptures avaient baissé de 2 %.
Le chiffre moyen mensuel enregistré depuis 2009 oscille entre 25 000 ruptures les mauvaises années, si je puis dire, et 30 000 les bonnes années.
Vous le savez, les partenaires sociaux sont très attachés à ces ruptures conventionnelles.
Elles permettent une certaine souplesse, que le ministre du travail peut regretter de temps à autre, mais qui existe. Ces ruptures traduisent la fin des CDI dans environ 20 % des cas, pour des raisons que vous avez évoquées, madame la sénatrice, et qui résultent non seulement de la conjoncture, mais aussi, bien souvent, de quelques rares licenciements et de très nombreuses démissions négociées. Je ne saurais en tirer des conclusions sans m’attirer immédiatement les foudres des partenaires sociaux. Aussi, je vous laisse le soin de formuler des commentaires.
Cette évolution est-elle le signe que le CDI est dépassé ? Même si la part des salariés embauchés en CDD continue d’augmenter en dépit des dispositions qui avaient été prises afin d’alourdir la fiscalité des entreprises y recourant de façon excessive, la proportion des employés en CDI a peu varié depuis quinze ans et reste largement majoritaire : 87 % des salariés.
Faut-il passer à un autre type de contrat, le contrat unique ? Je pense que nous avons en France tous les types de contrat nécessaires pour permettre la souplesse indispensable aux entreprises tout en apportant des garanties aux salariés.
Cette question, j’en suis désolé, mériterait une analyse plus approfondie. C’est pourquoi je suis prêt à reprendre cette discussion.

Monsieur le ministre, vous m’avez répondu d’une façon très globale sur les ruptures conventionnelles, sur les types de contrat de travail, les CDI. Or je vous interrogeais uniquement sur l’étude de la DARES au sujet de ces jeunes de dix-sept à vingt-cinq ans qui démissionnent, pour 40 % d’entre eux, dès la première année. Ma question portait donc sur un cas très spécifique, d’autant que je précisais bien que le taux de démission par rupture conventionnelle était marginal, à savoir 1, 7 %.
Quant au contrat unique, j’évoquais ce contrat seulement pour les périodes courtes. Si 40 % des salariés démissionnent ou sont licenciés la première année, alors qu’ils sont employés en CDI, cela signifie qu’un tel contrat pose un problème. Ne serait-il pas lié à toutes les charges qui pèsent sur les CDD…

… et aux contributions qui ont été augmentées très récemment dans la loi de sécurisation de l’emploi ?

Monsieur le ministre, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 714 000. À la moitié du quinquennat de François Hollande, l’augmentation est déjà de 610 000. Je vous fais grâce de l’évolution des chiffres du chômage de longue durée, des jeunes, des seniors et du sous-emploi chronique ; ces chiffres, vous les connaissez mieux que moi.
Ce ne sont pourtant pas les mesures fiscales favorables aux entreprises qui ont manqué – le CICE en est un bon exemple –, ni les mesures de « flexibilisation » du marché du travail, ou pour libérer « la croissance » et l’activité, pour reprendre l’intitulé d’un projet de loi qui fait l’actualité.
Après comme avant le changement, le diagnostic et les remèdes sont toujours les mêmes ; les résultats aussi, apparemment.
Pourtant, la conjoncture semble n’avoir jamais été aussi favorable. Comme le rappelait Michel Sapin dans un récent entretien, il n’y a plus d’excuses externes – taux de l’euro, coût du pétrole, politique monétaire restrictive de la Banque centrale européenne – ou interne – poids des charges et des impôts – à faire valoir pour expliquer l’absence de croissance en France.
M. Francis Delattre s’exclame.

Or, absence de raison, visiblement, n’est pas raison. D’où cette supposition : si, au lieu de s’acharner à libérer d’entraves imaginaires une mystérieuse croissance toute prête à bondir, on essayait de créer la croissance par l’investissement public, tout spécialement par celui des collectivités territoriales suspectes de trop dépenser ?

M. Pierre-Yves Collombat. Qu’en pense le maire de Dijon, monsieur le ministre ?
Sourires.

Merci, monsieur le sénateur, pour votre question et la note d’humour qui la conclut !
Il est vrai que le nombre d’inscrits à Pôle emploi a augmenté, entre 2008 et 2012, de 740 000. Ce n’est pas la peine d’en rajouter, monsieur le sénateur, car depuis le début de ce quinquennat la hausse atteint 550 000. Je ne le nie pas, les raisons en sont assez évidentes.
Dans notre pays, nous avons fait collectivement §le choix du chômage de masse. En effet, nous avons toujours privilégié la sécurisation la plus générale par rapport à la mise en compétition.
Je citerai quelques exemples pour illustrer mon propos.
Dans les pays voisins, on constate un développement formidable du temps partiel, mais il n’est pas comptabilisé dans les chiffres de l’emploi. Soyons clairs : ce n’est pas ce que je suggère. Ainsi, en Grande-Bretagne, il existe le « contrat zéro heure ». Ce n’est pas ce que nous voulons, mais cela permet de ne pas compter comme chômeurs les personnes qui sont embauchées selon un tel contrat, notamment de quinze minutes. L’Allemagne, quant à elle, recense 7, 5 millions d’employés dotés de « mini-jobs », qui ne sont pas comptabilisés comme demandeurs d’emploi.
En France, il existe la catégorie de ceux qui travaillent plus de 78 heures. Nous les considérons comme des chômeurs au titre de la catégorie C.
Par conséquent, comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur, comparaison n’est pas raison.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse de stricte observance libérale.
M. Vincent Dubois applaudit. – M. Philippe Dallier sourit.

Le choix serait entre le chômage de masse et la précarité. Vous ne l’avez pas dit, mais c’est la réalité.

M. Pierre-Yves Collombat. Mon problème est le choix entre la politique de l’offre – poursuivie depuis le précédent quinquennat, mais je pourrais dire depuis vingt ans – et la politique de la demande. Keynes notait déjà qu’il avait fallu un certain temps pour que, à son époque, on réalise qu’une crise sérieuse se profilait à l’horizon. J’espère que cela durera moins longtemps, mais je crains que non.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – MM. Jean-François Longeot et Vincent Dubois applaudissent également.

Monsieur le ministre, selon l’INSEE, le 31 décembre 1960, notre pays comptait 20 583 000 personnes en situation d’emploi. Cinquante-deux ans plus tard, le 31 décembre 2012, 26 319 000 personnes travaillaient, soit une augmentation de 27, 9 %.
Durant la même période, toujours selon l’INSEE, le nombre d’heures travaillées dans la totalité des branches est passé de 43, 501 milliards à 39, 872 milliards, soit une diminution de 8, 3 %.
Cela signifie qu’un travailleur de 2012 passe 28 % moins de temps au travail que son père en 1960. Comment l’expliquer ? Par un ralentissement de l’activité ? Non, car durant ces cinquante-deux ans le PIB par habitant a été multiplié par trois.
M. Alain Richard opine.

Ainsi, un travailleur de 2012 crée autant de richesses en une heure que 3, 8 travailleurs de 1960. Il y a besoin de moins de main-d’œuvre, ce qui entraîne deux conséquences majeures : la hausse du chômage et la précarisation des travailleurs – à la fin de 2014, plus de 83 % des embauches étaient réalisées en contrat à durée déterminée.
Aussi, je m’intéresse au mouvement de fond qui traverse nos sociétés depuis les Trente Glorieuses : l’augmentation de la productivité. Mécanisation hier, robotisation aujourd’hui et intelligence artificielle demain : ce processus n’est pas achevé ! Les moyens techniques optimisent sans cesse davantage le temps de travail, d’où la nécessité d’un partage du travail.
Dans les années soixante et soixante-dix, la diminution du temps travail salarié avait une connotation positive. Le véritable problème, c’est que le fruit de ces gains de productivité a été accaparé par le capital, au lieu d’être consacré à l’emploi. Entre 1978 et 2012, les dividendes versés aux actionnaires des sociétés non financières ont quasiment triplé, passant de 3 % à 9 % de la valeur ajoutée totale. Dans le même temps, la part de cette valeur ajoutée allouée à la masse salariale a chuté de 8 %.
Dès lors, monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour que tout le monde ait accès à l’emploi dans une société où l’emploi, dans sa globalité, sera moindre ?

Monsieur le sénateur, vous posez là une question de fond à laquelle, vous en conviendrez, il est difficile de répondre en deux minutes.
La durée annuelle du travail s’est réduite dans tous les pays développés depuis 1950, et même depuis le début du XXe siècle. On faisait travailler les ouvriers la nuit, y compris les enfants. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, …
… même si, sur un tout autre plan, je vais prendre des dispositions afin de permettre aux jeunes d’avoir accès à l’apprentissage pour un certain nombre de travaux.
Ce mouvement de réduction du temps de travail s’est opéré de diverses manières. Tout d’abord, vous l’avez rappelé, il résulte de l’effort de productivité accompli dans tous les pays développés. Ensuite, en France et dans l’Europe entière, il procède de la réduction de la durée collective du travail. Enfin, le temps partiel s’est développé.
Vous le savez, il faut distinguer le temps partiel choisi du temps partiel subi. Nous avons essayé de lutter contre le temps partiel subi tout en facilitant le temps partiel choisi. Mais, dans ce domaine comme dans les autres, les solutions varient beaucoup selon les pays.
Il y a quelques instants, j’ai cité le cas de l’Allemagne, où le taux d’employabilité – pardonnez-moi ce terme technique, qui n’est pas très élégant – est bien moins élevé pour les femmes qu’en France.
Pour l’heure, faute d’un nombre suffisant de crèches ou d’aides à domicile, les Allemandes, pour élever leurs enfants, optent souvent pour le travail à temps partiel, qu’il soit choisi ou subi – je ne me prononcerai pas sur ce point.
La baisse tendancielle du temps de travail est-elle un mouvement inéluctable ? Voilà la question de fond que vous posez.
Si, malgré « l’alignement des planètes » que l’on observe actuellement en matière économique – sur ce front, la situation générale devrait s’améliorer en 2015 –, la croissance ne redémarrait pas dans notre pays, la question que vous posez devrait sans doute être soumise à tous.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, vous avez compris ma question même si, vous l’avez dit vous-même, vous ne pouviez pas y répondre réellement en deux minutes. En définitive, ne courons-nous pas derrière une croissance qui ne reviendra pas ? Aussi, plutôt que de distribuer l’argent au capital en demandant aux salariés de travailler plus, ne pourrait-on pas privilégier la masse salariale et partant embaucher davantage ? Voilà la question !
Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC.

M. Jean Desessard. Dès lors, quelles mesures prendre pour rétablir un équilibre, pour que les salariés disposent d’une masse salariale plus large et pour que cette somme soit répartie plus équitablement entre eux ? Tel est le sujet dont nous pourrons débattre, lorsque nous disposerons d’un peu plus de temps…
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Vincent Dubois applaudit également.

Monsieur le ministre, pour ma part, je tiens à insister sur un sujet qui, je l’espère, peut être évoqué en deux minutes. Il s’agit de l’évolution des chiffres du chômage en tant que tels.
La définition du chômage retenue par le Bureau international du travail, le BIT, fait référence dans l’Europe entière pour les comparaisons internationales. Or, en observant les statistiques, j’ai fait le constat suivant : par le passé, les chiffres du BIT étaient très proches de ceux de Pôle emploi. En 2010, un écart s’est fait jour entre les deux modes de calcul. Cette différence s’est creusée au point que le BIT recense aujourd’hui, pour la France, quelque 2, 8 millions de demandeurs d’emplois, tandis que nos services publics en dénombrent 3, 4 millions.
Certes, les deux définitions retenues pour déterminer la catégorie des demandeurs d’emploi divergent quelque peu. Mais, à mon sens, les différences ne sont pas suffisantes pour expliquer un écart aussi grand. Dans un cas comme dans l’autre, on considère l’ensemble des personnes disponibles pour l’emploi et n’exerçant aucune activité. L’absence d’indemnisation ne conduit-elle pas tout simplement le BIT à ignorer un certain nombre de demandeurs d’emploi ?
(M. Claude Dilain opine.) Le cas échéant, cette réflexion pourrait conduire à une concertation destinée à faire évoluer notre propre méthode de dénombrement.
M. Claude Dilain opine de nouveau.

Pour évaluer ce que donnent ou non nos politiques économiques, nous sommes appelés à dresser à tout moment des comparaisons avec nos partenaires européens, lesquels utilisent tous la même statistique. Aussi, il serait utile de déterminer s’il existe un biais d’une part ou de l’autre. §

Monsieur le sénateur, vous posez là une question de fond, qui suscite d’ailleurs bien des quiproquos et des incompréhensions.
Le nombre de demandeurs d’emploi recensés par le BIT sert aux comparaisons internationales. Il est actuellement, pour la France, de 2, 880 millions environ. Quant au nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi, il est de l’ordre de 3, 480 millions. En conséquence, on observe un écart de plus de 600 000 personnes entre ces deux chiffres.
Cette situation m’a interpellé, comme elle interpelle toutes celles et tous ceux qui cherchent à dresser des comparaisons chiffrées dignes de ce nom. En effet, en 2009-2010, on n’observait pas d’écart entre ces deux chiffres : le BIT dénombrait alors 2, 5 millions de chômeurs en France, et ce chiffre correspondait exactement au nombre des demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi.
Parmi les phénomènes expliquant l’écart actuel, qui, je le répète, s’élève à 600 000 personnes, je relève deux facteurs en particulier.
D’une part, je songe à la suppression de la dispense de recherche d’emploi dont bénéficiaient auparavant les seniors : les personnes concernées se sont retrouvées inscrites à Pôle emploi, alors qu’elles ne l’étaient pas avant ! Leur situation n’a pas changé, mais elles représentent 180 000 demandeurs d’emplois supplémentaires pour les années 2008 à 2012. S’y sont ajoutés 200 000 seniors depuis 2012. Au total, près de 400 000 personnes sont entrées, sans changer de situation, dans la catégorie des demandeurs d’emploi au sens de Pôle emploi.
D’autre part, la réduction de six à quatre mois de la durée de travail nécessaire pour bénéficier des droits au chômage a sans doute eu pour effet d’augmenter le nombre d’inscriptions.
Il s’agit là d’un véritable sujet, et je ne manquerai pas d’y revenir dès que l’occasion se présentera.

Pas de commentaire dans un échange aussi bref !
Monsieur le ministre, nous devons précisément nous poser la question de l’avenir et de la pertinence de cette catégorie particulière « dispense de recherche d’emploi ».
Les personnes concernées sont potentiellement employables. Certaines d’entre elles souhaitent retrouver une activité. Qu’elles soient dispensées de recherche d’emploi, au regard de leur droit à indemnités, pour des raisons de nature sociale ou pour éviter l’engorgement des services concernés, cela peut se concevoir. Mais il s’agit bien de demandeurs d’emploi ! Je peine à concevoir que des personnes employables n’ayant pas atteint l’âge de la retraite et ne disposant pas de droits complets ne soient plus comptabilisées comme demandeurs d’emploi. Procéder ainsi, ce serait une manipulation statistique.
Aussi, il me semble nécessaire d’approfondir cette question. Pour sa part, le BIT ne dénombre que les personnes recherchant activement un emploi. À mon sens, il faut commencer par se demander si cette notion de dispense définitive de recherche d’emploi ne mérite pas d’être revue.

Monsieur le ministre, nous connaissons malheureusement tous, dans nos départements, des entreprises en difficulté, des femmes et des hommes, de l’ouvrier au chef d’entreprise, qui désespèrent de pouvoir sauvegarder leur activité.
Les chiffres sont là, ils sont durs, très durs : 3, 5 millions de chômeurs en décembre et la poursuite de la chute de l’apprentissage.
Ils sont plus alarmants encore pour la Bourgogne, que nous avons en commun : au troisième trimestre, l’emploi salarié marchand se dégrade, avec un recul deux fois plus important que la moyenne de la France métropolitaine.
Peut-être me direz-vous, monsieur le ministre, que la hausse ralentit. Mais l’horizon de la baisse s’éloigne un peu plus chaque mois ! Vous venez de constater un certain « alignement de planètes » avec la baisse conjointe du prix du pétrole et de l’euro. Nous ne pouvons pourtant pas attendre éternellement le salut de conditions extérieures !
« Que faire ? », alors, pour reprendre une célèbre interrogation.
Vous avez recours aux emplois aidés, comme tous les gouvernements avant vous. C’est juste, mais il s’agit d’une réponse partielle. Nous savons que 60 % des personnes ayant occupé un emploi aidé non marchand se trouvent malheureusement en situation d’inactivité six mois après la fin de ce contrat.
Vous avez mis en place le CICE, certes, mais son impact est ralenti par le décalage d’un an inhérent à son caractère de crédit d’impôt. De plus, il ne s’impute pas directement sur la feuille de paie. Le lien avec le coût du travail n’apparaît donc pas clairement aux yeux de certains.
Face à cette situation, nous devons continuer à alléger un certain nombre de contraintes, de toutes natures, qui pèsent sur le travail. Hausse des points de cotisation retraite, complémentaires santé, impact du dispositif de pénibilité, de nombreux retours du terrain nous permettent d’affirmer que beaucoup de contraintes supplémentaires ont au contraire été introduites.
Il y a le chantier de la simplification de l’environnement de l’entreprise et la négociation sur les instances représentatives du personnel, les IRP. Vous reprenez la main sur ce dernier sujet, monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer qu’il ne conduira pas à faire peser de nouvelles contraintes sur les très petites entreprises ?
Il y a également le chantier de la remise en route de l’apprentissage et la revalorisation de la voie professionnelle.
Monsieur le ministre, quel est votre plan d’action pour les six prochains mois ? Les réunions de programmation du travail gouvernemental ont eu lieu, quel est, de votre point de vue, le plan de match ?

Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, nous partageons le fait d’être élus d’une belle région où, heureusement, le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. Je me permets de le rappeler car vous savez que, de région à région, les variations sont importantes : 8, 5 % en Bretagne, 13 % dans les zones industrielles les plus touchées. Tel n’est toutefois pas le sens de votre question.
Nous avons entrepris un certain nombre de réformes structurelles, que je cite sans les développer.
Nous avons mis en place des réponses pour aider les publics les plus fragiles à retrouver un emploi. On peut en penser ce que l’on veut, mais les emplois d’avenir sont aujourd’hui un succès.
Nous avons amélioré, avec les partenaires sociaux, les incitations à la reprise d’emploi. Ainsi, les droits rechargeables constituent un dispositif intéressant pour rendre de l’attrait au fait de reprendre un emploi.
Nous avons réformé la formation professionnelle, de manière substantielle, à travers la mise en place du compte personnel de formation. Il va permettre à des chômeurs de se former, ce qui n’était pas le cas auparavant et c’est pourquoi je disais que tout le monde avait fait le choix du chômage de longue durée.
Malgré des difficultés initiales, nous avons relancé l’apprentissage. J’ai donné l’exemple des décrets qui vont être publiés et du regain d’inscriptions pour septembre et octobre. Nous constaterons les effets positifs de ces mesures l’année prochaine.
Les partenaires sociaux ont également mis en place la loi de sécurisation de l’emploi.
Enfin, nous avons entamé la réforme du conseil des prud’hommes, afin de garantir plus de sécurité.
Je prends devant vous l’engagement que vous me demandez de prendre : il n’est pas question d’alourdir les contraintes qui pèsent sur les PME et les TPE. Au contraire : ce qu’il faut faire, tout en garantissant les droits des salariés, auxquels il n’est bien entendu pas question de toucher, c’est donner à ces petites et moyennes entreprises, où se trouvent les gisements d’emplois, plus de souplesse, de facilité et d’agilité, afin qu’elles puissent embaucher.

Le Président de la République évoquait ce matin, au cours de sa conférence de presse, la revalorisation de la voie professionnelle, avec ses lycées, et de l’éducation prioritaire. Il faut passer des mots aux actes.
Permettez-moi à ce sujet de regretter que le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre, ait retiré, par exemple, Brienon-sur-Armançon des zones d’éducation prioritaire ou que la région Bourgogne ait fermé un lycée professionnel à Migennes.
Vous le voyez, si nous nous retrouvons sur un certain nombre de pétitions de principe, encore faut-il que les actes suivent ! C’est vraiment crucial. Je suis persuadé que c’est à l’échelon « micro », et non pas à l’échelon « macro », que résident les solutions. C’est parce qu’un artisan ou une PME vont créer un emploi de plus que, petit à petit, nous réussirons à gagner ce combat !

Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur la situation de l’emploi.
Mes chers collègues, avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger, d’une part, au sein de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages et, d’autre part, au sein du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.
La commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire a fait connaître qu’elle propose les candidatures de M. Gérard Miquel et de M. Alain Fouché pour siéger au sein de ces organismes extraparlementaires.
Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

L’ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire (proposition n° 203, texte de la commission n° 253, rapport n° 252).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec plaisir que je reviens devant vous pour l’examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi déposée par les sénateurs Alain Richard et Jean-Pierre Sueur, que la Haute Assemblée a adoptée le 22 octobre dernier.
Oui, c’est avec plaisir que je vous retrouve cet après-midi, car cette séance marquera, selon moi, la fin de la remise en cause, douloureusement vécue sur les territoires, de conseils communautaires, constitués de bonne foi sur la base d’accords locaux mais fragilisés par le rappel de certains principes constitutionnels sur lesquels je ne reviendrai pas.
Je tiens de nouveau à saluer la réactivité et la justesse de l’initiative des sénateurs Alain Richard et Jean-Pierre Sueur pour trouver le plus rapidement possible une solution à ces difficultés rencontrées depuis l’été dernier dans de nombreux départements. Ils l’ont fait avec intelligence et pragmatisme, emportant la conviction tant du Gouvernement que du Parlement dans son ensemble.
En effet, votre proposition de loi a été adoptée le 18 décembre dernier par l’Assemblée nationale, qui a introduit quelques modifications, afin de prendre en compte l’avis du Conseil d’État et d’apporter quelques précisions, élaborées en bonne intelligence par le rapporteur de l’Assemblée nationale, Olivier Dussopt, et par vous-même, monsieur Alain Richard.
Le texte sur lequel vous allez vous prononcer, mesdames, messieurs les sénateurs, a donc été coélaboré par les deux assemblées. Il s’agit d’un texte transpartisan, qui a, de plus, reçu, l’aval total du Gouvernement. Tout cela est assez rare pour être souligné.
Le fait que vous vous soyez prononcée, madame le rapporteur, pour une adoption sans modification, afin d’assurer, dans le prolongement des travaux de la commission des lois, un vote conforme, illustre la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour trouver une solution efficace et rapide au problème qui nous était posé. Je crois que cet objectif peut être atteint aujourd’hui, même s’il sera sans doute nécessaire, pour sécuriser pleinement la solution trouvée dans l’éventualité d’une nouvelle question préalable de constitutionnalité, d’envisager une saisine du Conseil constitutionnel, en application de l’article 61 de la Constitution.
En conclusion, en mon nom et au nom de Bernard Cazeneuve, empêché aujourd’hui, je remercie les auteurs de cette proposition de loi, ainsi que l’ensemble des groupes parlementaires, qui, par leur soutien, ont conféré davantage de force à ce texte attendu par les élus locaux, et je les remercie également de bien vouloir l’adopter.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mmes Françoise Gatel et Jacqueline Gourault applaudissent également.

nationale, le Sénat est appelé à examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire.
Déposée par nos collègues Alain Richard et Jean-Pierrerespectives.
Ce texte réintroduit la faculté d’unconstitutionnel.
En première lecture, le Sénat s’est attaché à renforcerdevant le suffrage.
Saisie à son tour, l’Assemblée nationale, suivant sondémarche sénatoriale.
Entre-temps, le Conseil d’État a été saisi par le Premier ministre sur la constitutionnalité du recours à un accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires, lequel lui a également demandé, en cas de réponse positive, les marges de manœuvre offertes au législateur pour encadrer la répartition issue d’un tel accord.
Les principes contenus dans l’avis rendu le 20 novembrepar le Conseil d’État ».
Par ailleurs, la proposition de loi a été complétée par lesrépartition antérieure des sièges de l’organe délibérant.
En première lecture, la commission des lois a modifié sur trois points l’article 1er relatif aux nouvelles modalités de composition de l’organe délibérant des communautés de communes ou d’agglomération par accord des conseils municipaux. D’abord, pour exclure de l’attribution autorisée d’un siège supplémentaire par rapport à l’effectif qui résulterait de l’application de la proportionnelle démographique les communes ayant bénéficié de la garantie du siège de droit pour toute commune. Ensuite, pour attribuer à ces communes un siège supplémentaire au cas où leur représentation serait inférieure de plus d’unpart dans la population totale de l’intercommunalité.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de notrenationale.
Au terme de ses travaux, selon les mécanismes de l’accord local, un écart à la limite des 20 % serait autorisé dans deux cas précisément déterminés.
En premier lieu, lorsque la répartition des sièges par application des principes légaux, notamment l’attribution d’un siège au moins à chaque commune et l’interdiction pour l’une d’entre elles de détenir plus de la moitié des sièges, conduirait à un écart de représentation d’une commune supérieur à 20 % de la moyenne. Cette dérogation ne serait cependant possible que si l’accord, au pire, maintenait ou, au mieux, réduisait cet écart.
En second lieu, lorsque, par application de la représentation proportionnelle à la population, une commune obtiendrait un siège de conseiller communautaire, elle pourrait en obtenir un second en vertu de l’accord, pour permettre « une représentation plurielle et paritaire de chacune des communes au sein de l’organe délibérant ».
Ainsi que le précise le rapporteur de l’Assemblée nationale, ce tempérament lui a été suggéré par notre collègue Alain Richard, auteur de la proposition de loi. Ce dispositif permettra aux communes d’être pleinement parties prenantes à la vie intercommunale.
L’Assemblée nationale a renforcé la majorité qualifiée exigée pour l’adoption de l’accord local – les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale ou l’inverse –, en y intégrant le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale.
Cette condition, déjà très présente dans le droit en vigueur, à commencer pour ce qui concerne la création d’un établissement public de coopération intercommunale, devrait favoriser un fonctionnement harmonieux de la communauté.
L’Assemblée nationale a étendu les principes retenus pour encadrer l’accord local à la faculté aujourd’hui offerte aux communes, hors la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de créer et répartir un volant de sièges au plus égal à 10 % du nombre total de sièges résultant de l’application des règles légales.
Pour les communautés de communes ou d’agglomération, ce dispositif est ouvert aux communes qui n’auraient pas conclu d’accord local. Cette décision est prise à la majorité qualifiée des deux tiers/moitié.
Aux termes de l’article 1er, la répartition des sièges supplémentaires sera soumise aux mêmes règles que celles qui ont été retenues pour encadrer l’accord local en ce qui concerne les écarts de représentation à la moyenne.
L’article 1er bis, résultant de l’adoption d’un amendement du rapporteur de l’Assemblée nationale, fixe les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements des conseils municipaux en cas d’annulation de la composition d’un organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre. Cet article vise à compléter l’article L. 5211–6–2 du code général des collectivités territoriales, qui règle la composition d’un organe communautaire entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de création d’un EPCI à fiscalité propre, de fusion d’établissements ou d’extension du périmètre intercommunal, pour y intégrer expressément l’hypothèse de l’annulation par le juge administratif de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire.
En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement visant à assouplir la constitution des listes de conseillers municipaux non titulaires d’un mandat communautaire afin de pourvoir les sièges supplémentaires attribués à une commune par rapport au nombre qu’elle détenait lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
Désormais, les communes auront la possibilité de constituer des listes incomplètes. Ainsi, lorsque le nombre de candidats figurant sur une liste incomplète sera inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus seront attribués à la liste qui aurait obtenu la plus forte moyenne suivante.
L’innovation proposée contribuera à une meilleurepourvoir.
Le nouvel article 1er ter procède aux coordinationsdécoulant de l’article 1er.
L’article 2 permet aux intercommunalités touchéesrénovée par le présent texte pendant une période de six mois à compter de sa promulgation. Le Sénat en avait adopté le principe sous réserve d’une clarification rédactionnelle.
Le dispositif a été complété par la commission des lois de l’Assemblée nationale, puis modifié, en séance publique, avec l’adoption d’un amendement du Gouvernement.
D’une part, en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’agglomération dont l’organe délibérant a fait l’objet d’un accord local avant le 20 juin 2014, il sera procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges communautaires dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Il s’agit ainsi de fixer la nouvelle répartition et le nombre de conseillers communautaires à élire avant le début des opérations électorales, lesquelles doivent être organisées dans les trois mois après l’annulation définitive, en application de l’article L. 251 du code électoral.
D’autre part, les dispositions résultant de l’article 1er bis permettant la constitution de listes incomplètes afin de pourvoir les sièges supplémentaires attribués à une commune seraient applicables.
Ces précisions complètent utilement la faculté ouverte aux intercommunalités par l’article 2.
L’intitulé de la proposition de loi initiale qui visait expressément les communautés de communes ou d’agglomération a été modifié en conséquence de l’insertion, à l’article 1er, de modifications applicables à toutes les catégories d’EPIC à fiscalité propre, y compris les communautés urbaines et les métropoles.
Monsieur le ministre, il me reste à vous interroger sur une incertitude qui appelle une précision de votre part. Pourriez-vous préciser les conséquences sur l’exécutif d’une intercommunalité des modifications affectant la composition du conseil municipal de l’une des communes membres ?
Aux termes des travaux des deux assemblées, et au bénéfice de votre réponse, monsieur le ministre, la commission des lois a considéré que le législateur, au fil de la navette, s’est efforcé de préserver dans les meilleures conditions de sécurité juridique la faculté d’un accord local pour faciliter le consensus intercommunal.
C’est pourquoi elle a adopté la présente proposition de loi sans modification.
La commission des lois soumet donc à la délibération du Sénat le texte ainsi établi pour la proposition de loi.
MM. Robert Laufoaulu et Jean-Claude Frécon ainsi que Mme Françoise Gatel applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, pour répartir dans une intercommunalité – communauté de communes ou communauté d’agglomération – le nombre de sièges, nous avions, depuis la loi de 2010, deux solutions : soit appliquer le tableau, qui résulte de la répartition proportionnelle en fonction de la population ; soit passer un accord « en tenant compte » de la population – c’étaient les termes exacts.
Au sein de mon département du Loir-et-Cher, dans à la communauté de communes de la Sologne des Rivières, à laquelle appartient Salbris, une commune que je connais bien, un accord avait été passé à la majorité qualifiée, avec plus des deux tiers des communes membres représentant plus de la moitié de la population. Or cette majorité qualifiée s’était faite contre la ville-centre de Salbris, si bien que le Conseil constitutionnel, après la question prioritaire de constitutionnalité posée par le maire de Salbris, a jugé que la répartition des sièges était manifestement disproportionnée par rapport à la réalité de la population des communes membres. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que les dispositions de cet accord méconnaissaient le principe d’égalité devant le suffrage et devaient être déclarées contraires à la Constitution.
Le problème concernait Salbris, mais cette décision s’appliquait, dans un grand nombre de cas, aux communes qui avaient passé un accord local, soit 90 % des communes !
Nous savons que, postérieurement à la date de la publication de la présente décision, au mois de juin 2014, quand le conseil municipal d’au moins une des communes membres était renouvelé, il fallait répartir de nouveau les sièges. Tel était également le cas lorsque les communes ont des instances en cours ou lorsque les intercommunalités sont impactées par un changement de périmètre, et nous sommes en période de changement de périmètre, passé ou à venir. Cette décision impactait par conséquent un grand nombre de communautés de communes.
Il fallait donc trouver une solution respectueuse du principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre. Je remercie nos collègues Alain Richard et Jean-Pierre Sueur d’avoir proposé cette modification, qui permettra, j’en suis sûre, de soulager un certain nombre de situations.
Je ciblerai les points les plus importants, et en premier lieu la modification des conditions de majorité. Si l’accord des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse est toujours requis, en complément, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de l’intercommunalité, devra donner son accord. Autrement dit, il y a une sorte de droit de veto §de la commune-centre, dès lors qu’elle représente plus du quart de la population total de l’intercommunalité.

Mme Jacqueline Gourault. Je suis d’accord avec cette décision : c’est ce qui existait autrefois, et qui avait été supprimé par la loi de 2010. On ne peut pas faire de bon accord contre la ville-centre
M. Pierre-Yves Collombat s’exclame de nouveau.

En deuxième lieu, j’évoquerai le nouveau dispositif de l’accord local. La répartition se fait non plus « en tenant compte » de la population, mais « en fonction » de la population, ce qui permet de mieux respecter la proportionnalité, laquelle est, au regard de la loi et du principe de l’égalité devant le suffrage, un point très important.
L’accord local sera encadré par les principes suivants. Les trois premiers sont inchangés : chaque commune dispose d’au moins un siège ; aucune commune ne pourra détenir plus de la moitié des sièges ; le nombre de sièges octroyés par la loi pourra être majoré, en cas d’accord, jusqu’à 25 % de sièges supplémentaires.
Toutefois, il y a désormais un autre élément : la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter du tunnel de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf dans deux cas.
Premièrement, on pourra déroger aux 20 % lorsque la répartition effectuée en cas de désaccord, c’est-à-dire en appliquant le tableau, conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale, tant que l’accord passé n’amplifie pas cet écart de représentation, ou le réduit ; deuxièmement, lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne contribuerait à l’attribution d’un seul siège.
En conclusion, soit on applique le tableau – je me permets de le dire, il y a des endroits où cela fonctionne –, soit on fait un nouvel accord, qui doit respecter une répartition « en fonction » de la population, et non pas « en tenant compte » de la population – ce qui est plus précis – et en respectant le tunnel des 20 %, principe constitutionnel que chacun connaît.
Le groupe UDI-UC est ravi de voter cette proposition de loi.
Mme Françoise Gatel et M. Jean Desessard applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il me paraissait judicieux de revenir en quelques minutes sur le parcours accompli par cette proposition de loi depuis que nous l’avons déposée, en rappelant que l’intention à l’origine de ce texte était purement palliative, ou réparatrice.
Certains collègues entreprennent de leur côté un parcours de portée constitutionnelle, souhaitant que la règle constitutionnelle d’égalité du suffrage soit corrigée, pour permettre, du moins s’agissant des élections locales, des écarts de représentation supérieurs à un écart de 1 à 1, 5. En effet, quand on dit « 80 % à 120 % de la moyenne », cela signifie que, selon les situations, un électeur d’un secteur pèsera une fois et demie un électeur du secteur voisin.
Pour ma part, je ne me suis pas placé dans cette problématique. Il m’a semblé que dans un délai relativement bref – cela a tout de même pris plus de six mois –, on pouvait trouver une solution qui rétablisse la possibilité d’un accord local. Un tel accord était souhaité dans la plupart des communautés de communes ou d’agglomération et restait d’autant plus nécessaire que nous sommes dans une période de mobilité des communautés : un grand nombre de conseils communautaires allaient être remis en cause.
La proposition de loi que nous avons élaborée se cale pour l’essentiel dans l’écart de plus ou moins 20 %, mais tentait, en interprétant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, d’ouvrir un peu plus cette possibilité d’écart de représentation.
Je souligne que, dans une décision de 1995, le Conseil constitutionnel avait énoncé de façon extrêmement précise ce que devait être, selon lui, la représentation des communes dans une communauté de communes ou d’agglomération. La réforme de 2010, sur ce point, a appliqué de façon stricte les principes énoncés par le Conseil constitutionnel dans la partie « barème démographique », soit les paragraphes II à V de l’article L. 5211–6–1 du code général des collectivités territoriales, mais elle a rétabli dans le I du même article la possibilité d’un accord local qui sortait de ce barème de représentation. D’où cette remarque simple : nous avons au moins la certitude que le Conseil constitutionnel admet le principe d’un accord local.

Effectivement, même si ce point n’a pas été expressément soulevé en 2010, dans la saisine qui lui fut adressée à l’encontre de la loi de réforme des collectivités territoriales, le simple fait qu’il y ait une alternative au barème démographique aurait sauté aux yeux du Conseil constitutionnel et, s’il considérait qu’il fallait s’en tenir au barème démographique, il aurait écarté dès le départ cette disposition ; or, il ne l’a pas fait. Nous savons donc que nous avons la possibilité de rétablir une base d’accord local, la question étant l’étendue des écarts.
Je ne reprends pas ce qu’a dit très justement le rapporteur, Mme Troendlé, pour bien décrire ce qui a changé. Je souligne simplement que nous pouvons avoir, notamment avec M. Collombat, une différence d’appréciation sur l’exigence de faire figurer la ville la plus importante dans les partenaires de l’accord local. On peut certes défendre l’idée que, dès l’instant où des communes atteignent la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, elles pourraient, en se coalisant, – comme à Salbris, mais il y a d’autres cas – imposer à la commune principale le prélèvement d’une partie de sa représentation. Dans la mesure où l’idée de principe, respectueuse de l’autonomie communale, est celle d’un accord local, cette stratégie diverge de l’idée d’un accord ! Pour ma part, il m’a paru, au contraire, plutôt cohérent avec la démarche d’accepter cette condition supplémentaire de l’accord local.
L’un des critères de droit à l’aune desquels sera appréciée l’opportunité de rétablir la possibilité d’un accord local de répartition tient au motif justifiant la dérogation au principe d’égalité devant le suffrage. En effet, le Conseil constitutionnel exige, pour admettre une dérogation à ce principe, qu’elle repose sur un motif d’intérêt général. Or je conviens que, en première lecture, nous n’avons pas été très explicites à cet égard ; je tâcherai cet après-midi d’être plus précis.
Un argument a déjà été exposé par Mme le rapporteur : pour que les communes participent pleinement à la vie de l’intercommunalité, il est préférable qu’elles puissent s’appuyer, à chaque fois que cela est possible, sur au moins deux délégués, ce qui permet, en outre, de réaliser la parité. Je rappelle que, dans le même esprit, lorsque le conseiller territorial a été instauré, le Conseil constitutionnel a accepté la disposition fixant un nombre minimal incompressible de quinze conseillers territoriaux pour former un conseil général, alors même que ce seuil aurait entraîné une surreprésentation assez substantielle des électeurs de certains départements au sein du conseil régional. Il a donc jugé que le droit pour une collectivité territoriale d’exercer pleinement ses prérogatives, par une organisation appropriée, constituait un motif d’intérêt général suffisant.
Ce principe doit valoir aussi pour les communes les plus faiblement représentées au sein des intercommunalités, dans la mesure où les communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent désormais les compétences des communes dans un grand nombre de domaines. C’est si vrai que les délégués au conseil communautaire sont fortement sollicités par leurs collègues de la municipalité et par les habitants au sujet de toute une série de missions assumées par l’intercommunalité. En outre, les conseils communautaires comportent généralement quatre, cinq, six, voire sept commissions spécialisées. Or il n’est pas très facile pour un délégué unique de siéger dans tous ces organes.
Mes chers collègues, il me semble donc que de réels motifs de bonne administration et d’exercice de la libre administration des communes justifient que l’on facilite l’extension de la représentation des plus petites communes.
Par ailleurs, nous avons tenu compte des observations présentées par l’Assemblée nationale sur un certain nombre de sujets. En particulier, nous devons à nos collègues députés deux apports pratiques touchant à la procédure applicable en aval, lorsqu’un conseil communautaire est remis en cause.
D’une part, agissant un peu dans l’urgence, nous avions négligé une circonstance possible : nous avions bien prévu la possibilité de rouvrir un accord local de répartition dans le cas d’un conseil communautaire antérieurement transformé, mais les députés ont remarqué que cette transformation pourrait très bien se produire dans les mois à venir. En effet, des contentieux pourront encore se déclarer, sans compter les recompositions futures d’intercommunalités. Nos collègues députés ont comblé cette lacune, et ils ont eu raison.

D’autre part, les députés ont soulevé le problème un peu délicat de la « dés-élection », comme l’appellent mes collègues élus du Val-d’Oise. Nous sommes encore peu familiers de cette procédure, mais elle va entrer dans le paysage local. En effet, des conseillers communautaires ont été élus en mars dernier au suffrage universel direct, sur les listes des candidats aux élections municipales. Or, à la suite des accords locaux de répartition dont nous allons rétablir la possibilité en resserrant les écarts de représentation autorisés ou à la suite des fusions d’intercommunalités qui interviendront l’année prochaine, certaines communes verront le nombre de leurs délégués réduit. En pareil cas, la loi de 2013 prévoit que les conseils municipaux doivent procéder de nouveau à la désignation de leurs délégués au conseil communautaire.
Nos collègues députés ont remarqué une faiblesse dans ce dispositif que, pour ma part, j’avais trouvé bien conçu : si une commune dispose d’un assez grand nombre de conseillers communautaires par rapport au nombre de ses conseillers municipaux, l’obligation pour la minorité municipale de déposer une liste complète pour l’élection des délégués risque de priver cette minorité de son droit à un représentant au sein du conseil communautaire. Les députés ont opéré, à juste titre, la rectification nécessaire.

Espérons que la présente proposition de loi, si nous l’adoptons définitivement, stabilisera pour un certain temps le droit de constitution des intercommunalités.
Pour assurer cette stabilité, j’ai prévu de déférer au Conseil constitutionnel la loi issue de cette proposition de loi. J’invite tous ceux de nos collègues qui souhaitent s’associer à cette saisine à se manifester sans tarder, puisque nous devons agir dans des délais assez brefs. Je précise qu’il ne s’agit pas de ce qu’on appelle une « saisine blanche », consistant à demander simplement au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité d’une loi, sans présenter la moindre observation de droit. Même si la loi du moindre effort a été à l’origine d’un grand nombre de progrès de l’humanité, il me semble qu’il est préférable d’argumenter un petit peu !
Sans doute, cette saisine destinée à obtenir la réponse du Conseil constitutionnel, que j’espère évidemment positive, ne nous garantira pas absolument contre de nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité, mais au moins aurons-nous appelé clairement l’attention des juges constitutionnels sur le point central : la possibilité d’un écart de représentation un peu supérieur à 20 % dans certains cas.
Mes chers collègues, espérons que, en prévenant les incertitudes juridiques lors des prochains débats intercommunaux et les jeux de pression contentieuse qui peuvent être dommageables, nous aurons facilité le retour à la sérénité de la vie locale intercommunale !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Mme Jacqueline Gourault remplace M. Jean-Pierre Caffet au fauteuil de la présidence.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la présente proposition de loi de nos collègues Alain Richard et Jean-Pierre Sueur vise à sécuriser juridiquement les accords conclus entre les communes composant une intercommunalité pour la répartition des sièges des élus communautaires. Ce texte a été rendu indispensable par la décision du Conseil constitutionnel de censurer les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant les modalités d’un tel accord.
L’objet de la proposition de loi est simple et clair : il s’agit, d’une part, de réintroduire la possibilité d’un accord, plus restreint pour respecter la décision constitutionnelle, et, d’autre part, de rendre un peu de souplesse aux règles de représentation des communes pour sortir du simple critère démographique.
Ce droit d’adaptation est bienvenu, car il convient que chaque intercommunalité puisse tenir compte de ses spécificités. En effet, le nombre des habitants ne peut fonder à lui seul une représentation équitable et juste des communes au sein du conseil communautaire. Le sentiment de non-représentation, voire de relégation, aujourd’hui fortement ressenti dans la société française trouve sans doute en partie sa source dans de petites communes périurbaines, exclues des décisions de l’intercommunalité du fait de la faiblesse de leur représentation.
En tant qu’écologistes, nous militons pour que les territoires peu peuplés soient représentés dans toutes les instances démocratiques. En effet, ce n’est pas parce qu’une campagne compte peu d’habitants qu’elle est vide et sans intérêt ! Les territoires, la faune, la flore et les paysages doivent être suffisamment représentés pour être correctement défendus.
Plus généralement, la proposition de loi nous conduit à nous interroger sur la légitimité démocratique de l’intercommunalité. En effet, au fil du temps et des lois, les intercommunalités ont acquis des compétences de plus en plus stratégiques : transports, eau, déchets, habitat, et parfois police, tous services publics qui sont fondamentaux.
Les écologistes ont toujours soutenu la montée en puissance des intercommunalités, car, selon nous, l’action publique doit, pour être efficace, s’exercer à l’échelle d’un bassin de vie cohérent. Or le bassin de vie correspond aujourd’hui le plus souvent à l’échelle intercommunale.
Les dernières élections municipales ont donné lieu à une innovation : le fléchage, sur les bulletins de vote, des élus municipaux appelés à siéger au conseil communautaire. Les écologistes n’en demeurent pas moins favorables à l’élection des élus communautaires au suffrage universel direct, le même jour que l’élection des conseillers municipaux. Cette mesure ne signifierait pas la fin des communes. Au contraire, nous reconnaissons et respectons l’attachement des habitants à leur commune : tout le monde connaît son maire, et la commune reste une institution politique dont les citoyens se sentent proches, par laquelle ils se sentent reconnus et qui leur semble accessible. Nous souhaitons simplement que, désormais, les citoyens connaissent aussi bien leurs élus communautaires, dont les compétences sont primordiales pour l’aménagement de leur bassin de vie.
Dans la perspective de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires, le groupe écologiste votera cette proposition de loi, qui sécurise de manière utile les accords de représentation des communes.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre position à l’égard de cette proposition de loi est à peu près la même qu’en première lecture.
Les sénateurs de mon groupe ne sont pas favorables à l’intercommunalité forcée inscrite dans la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, à laquelle nous nous sommes opposés. Nous nous sommes également abstenus sur la proposition de loi relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération, présentée par Alain Richard en 2012, dont les dispositions avaient pour seul objectif de faciliter la création d’intercommunalités contraintes, jusqu’alors refusées par certaines communes en raison, notamment, de la faiblesse de leur représentation au sein des futurs conseils communautaires. Et pour cause : la loi du 16 décembre 2010 – nous en avons malheureusement la confirmation en ce début d’année 2015 – n’était que la première étape d’un processus conduisant, selon nous, à l’évaporation de la commune, et donc du lien des élus communaux avec la population !
Cependant, principe de réalité oblige, il faut aujourd’hui trouver des solutions aux problèmes nés de la décision du Conseil constitutionnel de juin dernier : une décision dont je rappelle qu’elle résulte de l’application du regroupement intercommunal forcé, qui ne participe pas au développement de la démocratie locale. Preuve que certains de nos collègues ont une étonnante capacité à voter des lois une année, puis à regretter, les années suivantes, les décisions du Conseil constitutionnel visant à les faire respecter !
Comme nous l’avons expliqué lors de l’examen de la proposition de loi constitutionnelle tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires, nous sommes attachés non pas à la représentation des territoires en soi, mais au pouvoir et à la responsabilité des élus locaux, démocratiquement choisis, qui représentent les femmes et les hommes vivant et travaillant dans leur commune. C’est bien parce que la décision du Conseil constitutionnel remet en cause ce pouvoir et cette responsabilité que nous avons voté la présente proposition de loi en première lecture.
La surreprésentation de la commune dite centre et la représentation quasi nulle, voire nulle, d’un certain nombre de communes participent, selon nous, à la technocratisation des conseils communautaires, au sentiment d’éloignement de la prise de décision et, surtout, à la rupture du lien entre la commune et l’intercommunalité. Comment décider et mettre en œuvre des projets intercommunaux au service de tous, si une partie des communes n’ont pas voix au chapitre ?
La deuxième lecture de cette proposition de loi intervient entre l’adoption par le Sénat en première lecture du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et l’examen de celui-ci par l’Assemblée nationale. Pendant la discussion de ce projet de loi, nous avons refusé l’augmentation à 20 000 habitants, proposée par le Gouvernement, du seuil obligatoire pour les intercommunalités. Nous n’avons pas non plus soutenu la proposition de certains collègues du groupe socialiste consistant à augmenter ce seuil à 15 000 habitants. Les défenseurs d’un relèvement des seuils, certes assorti de nombreuses exceptions, ont soutenu qu’il était nécessaire au développement des territoires.
Je rappelle que, selon le document distribué en séance par Mme Lebranchu, 623 intercommunalités seraient obligées de fusionner dans l’hypothèse d’un seuil à 20 000 habitants et 475 dans l’hypothèse d’un seuil à 15 000 habitants, sur un total de 2 145 établissements publics de coopération intercommunale. Ces chiffres ne sont pas anecdotiques, surtout vu les conséquences qui ont résulté, dans un certain nombre de départements, de la première génération d’intercommunalités forcées.
Comme en première lecture, les sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen voteront la présente proposition de loi, améliorée entre-temps par l’Assemblée nationale, pour encore et toujours éviter de corseter la démocratie locale.
Que nos collègues députés veuillent bien nous permettre de les alerter : il est bon de faciliter et de sécuriser l’accord local de répartition, mais il serait dès lors incompréhensible, sauf à tomber dans la schizophrénie, qu’ils reviennent sur la suppression par le Sénat du rehaussement des seuils intercommunaux initialement prévu dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Mme Éliane Assassi. Pour redonner toute sa force au travail parlementaire et contribuer à redonner du sens à l’engagement politique, nous devrions éviter de voter une loi pour, quelque mois plus tard, en proposer une autre visant à atténuer les méfaits de la première.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, s’il restait quelques élus ruraux ignorant que toutes les communes n’étaient pas égales dans l’intercommunalité, le Conseil constitutionnel s’est chargé, dans une décision rendue le 20 juin 2014, de le leur rappeler ! Comme on sait, cette décision a annulé le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui permettait de déroger – dans des limites d'ailleurs très strictes – au tableau de répartition des sièges entre communes au sein des intercommunalités prévu par la loi de réforme des collectivités territoriales, dite « loi RCT ».
Je parle d’égalité des communes, et non de leurs habitants, ce que le Conseil constitutionnel confond sciemment en imposant la représentation des communes proportionnellement à leur taille dans les conseils communautaires. Son raisonnement mérite que l’on s'y arrête, ce qui est rarement fait. Je cite le quatrième considérant : « les établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales [exerçant] en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ».
Autrement dit, même si, prise globalement, une intercommunalité n’est pas une collectivité territoriale – ce que reconnaît le Conseil constitutionnel dans son troisième considérant –, prise compétence par compétence, cette intercommunalité l’est quand même puisqu’elle exerce chacune desdites compétences en lieu et place des communes, qui, étant des collectivités territoriales, doivent elles-mêmes élire leurs organes délibérants sur des bases essentiellement démographiques. En bon français, cela s'appelle un sophisme !
Après la validation des comptes de campagne d’Édouard Balladur et de Jacques Chirac et le rejet de ceux de Jacques Cheminade en 1995, après la validation du seuil minimum de quinze conseillers territoriaux par département prévu par la loi RCT en 2011, ce monument à la gloire de l’État de droit mérite la visite ! Comme on sait, dans la République libéralisée à la Française, l’État de droit a une légitimité supérieure à celle de l’État démocratique. Tout simplement parce que ceux qui y exercent le pouvoir ne sont pas élus et sont en communication directe avec le ciel, tandis que les autres – les parlementaires, par exemple – sont soumis aux pressions du vulgaire.
Il est donc clair que, pour le Conseil constitutionnel, les intercommunalités ne sont plus des coopératives de communes liées entre elles par des accords – leurs statuts étant des sortes de contrats –, mais des communes sans la compétence générale. Peu importe s’il n’y a rien dans la Constitution, puisque c’est le Conseil constitutionnel qui fait la Constitution, et non l’inverse !
Aujourd’hui, avec ce texte, une nouvelle étape est franchie. Le pouvoir des communes au sein de l’intercommunalité n’est plus proportionnel à leur taille, mais progresse avec elle. Ainsi, une commune représentant 25 % de la population d’une intercommunalité pourra faire prévaloir son point de vue sur l’accord à la majorité qualifiée de communes représentant le reste de la population, parce que ces dernières, individuellement, sont plus petites. Avec ce texte, les plus grosses communes se voient dotées d’un droit de veto dans un domaine aussi essentiel que la constitution des organes délibérants des communautés.
La version initiale de ce texte – celle votée en première lecture par le Sénat – avait des ambitions bien modestes, mais elle nous convenait. Celle qui nous arrive de l’Assemblée nationale, donnant aux communes-centres le pouvoir de s’opposer à toute modification, même modeste, de la représentation souhaitée majoritairement par les autres, lui ôte tout intérêt. Cette version aurait été inspirée à la commission des lois de l’Assemblée nationale, nous murmure-t-on, par le Conseil d’État, devenu législateur. Dans la Chine impériale, on appelait cela « gouverner derrière le paravent » ! À moins que ce ne soit une bonne manière rendue à je ne sais quels élus d’une commune-centre craignant de se retrouver dans la situation de Gulliver ligoté par les Lilliputiens…
Mais, ce qui me navre le plus, c’est que le Sénat, qui est à l’origine de la proposition de loi et qui est la seule chambre où la voix des petites collectivités peut encore être entendue, n’affirme pas ce qui fait sa légitimité : représenter toutes les collectivités locales, en particulier les plus petites, celles dont la dispersion justifie une représentation spécifique du territoire.
Voter conforme, c'est voter un texte au mieux inutile, un texte qui laisserait croire aux communes petites et moyennes, avant les prochaines échéances départementales, qu’elles auraient été entendues, alors que c'est exactement l’inverse. En un mot, c'est voter un texte méprisant – je pèse mes mots – pour les petites communes. Il est des moments où le symbole compte plus que les accommodements à prix cassé ! C'est pourquoi je ne voterai pas ce texte.

Madame le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, l’enjeu de ce texte est de trouver un nécessaire équilibre entre l’application de la proportionnalité démographique et la prise en compte de situations locales particulières. En effet, la simple arithmétique ne suffit pas à prendre en compte la spécificité de chaque territoire.
Bien que le code général des collectivités territoriales fixe dans les paragraphes II à VI de l’article L. 5211-6-1 la répartition des sièges dans les communautés de communes sur la base d’un strict principe de proportionnalité, le Sénat avait intégré la possibilité de passer des accords au niveau local entre communes membres. Il faut dire que près de 90 % des communautés de communes ou des communautés d’agglomération reposent sur des accords locaux. Or le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2014, a considéré que l’accord local sur la répartition des sièges, tel que prévu par l’article précité du code général des collectivités territoriales, « méconnaissait le principe d’égalité devant le suffrage ». C’est donc une nouvelle version de cette possibilité qui est aujourd’hui discutée au Sénat.
Il faut saluer le souci du législateur d’introduire plus de souplesse afin de rendre la coopération des communes aussi efficace que possible. Comme les débats l'ont montré lors de l’examen du projet de loi NOTRe, un territoire n’est pas qu’une addition d’habitants ; c'est surtout un regroupement qui est le fruit d’une histoire et d’une géographie. Il convient de garder cet aspect en mémoire lorsque nous écrivons la loi ; c'est bien ce qu’ont fait les auteurs de ce texte en permettant les accords locaux, voire en les encourageant.
Le texte qui nous revient de l’Assemblée nationale prend davantage en compte le rôle central de la ville-centre, nommée ville « dont la population est la plus nombreuse ». Il est en effet plus que nécessaire de renforcer la place de la ville-centre autour de laquelle viennent s’agréger des communes de plus petite taille. Elle joue un rôle central dans l’organisation de la communauté de communes, rôle que l’application stricte du barème arithmétique renforcerait.
En outre, il ne faut pas jouer la carte des petites communes contre la grande. Je rejoins en ce sens le rapporteur du texte. Un accord local doit être un outil de souplesse, fruit d’un consensus, et non un outil politique pour mettre en difficulté une ville-centre. Dans un tel cas, et c’est ce qui a provoqué la censure du Conseil constitutionnel, le principe de proportionnalité devrait alors faire l’objet d’une stricte application.
Le sujet des intercommunalités est complexe. Ces dernières se sont trop souvent développées de manière opaque et anarchique en étant le fruit d’arrangements locaux « entre amis », au détriment de véritables projets communs au service des populations – je sais de quoi je parle, puisque j’en suis la victime. Ce texte devrait pouvoir renforcer la transparence des accords locaux organisant les communautés de communes. C’est pourquoi je le voterai.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au-delà des mots, au-delà des volontés, il existe des réalités. Au sein des territoires, qui constituent la richesse de notre pays, ces réalités sont vécues, perçues et relayées par les élus locaux que nous représentons ici. Le territoire s’apprend, se défend, s’invente et se réinvente. Il est le cœur de l’identité. Le territoire est un lieu de vie, de pensée et d’action : il est marqué par une identification.
La décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 est apparue comme extrêmement dure pour nos territoires, notamment les territoires ruraux. Seule reste en vigueur, après cette décision, la règle de représentation démographique. Pis, si l’on traduit concrètement cette décision, le conseil communautaire ne serait qu’une réunion du conseil municipal de la ville-centre, dans son intégralité. Si un maire d’une commune rurale ne peut être présent à un conseil communautaire, personne ne sera là pour le remplacer, personne ne représentera la ruralité dans le conseil communautaire.
Monsieur le secrétaire d'État, chacun d’entre nous sait ici que, dans un contexte de baisse drastique des dotations aux collectivités, les orientations politiques et budgétaires des conseils communautaires seront essentiellement en faveur du territoire urbain. Nous devons éviter qu’une décision constitutionnelle ne cristallise de plus en plus notre organisation territoriale et politique autour d’une France urbaine, au détriment de la France rurale. Voici une réalité territoriale : la France se fracture de plus en plus, entre les territoires urbains et ruraux. Je ne fais ici aucune opposition entre l’urbain et le rural, mais j’indique simplement une réalité dont les maires du département de l’Eure me témoignent.
Mes chers collègues, je salue l’initiative qui a été prise avec cette proposition de loi, qui permet aux communes de déroger au principe de proportionnalité démographique pour les sièges de conseillers communautaires en autorisant l’accord local de représentation. En première lecture, le Sénat s’est attaché à renforcer l’encadrement de l’accord local proposé pour resserrer les écarts à la proportionnelle démographique. Je me réjouis que l’Assemblée nationale ait poursuivi la démarche sénatoriale, sur la base de l’avis du Conseil d’État saisi par le Premier ministre.
En 2010, j’avais accueilli avec beaucoup de soulagement – j’étais alors maire d’une commune rurale du département de l’Eure – les accords dérogatoires prévus par la loi de décembre 2010. J’ai également salué les améliorations apportées par la proposition de loi d’Alain Richard en 2012. Or la décision du Conseil constitutionnel de juin 2014 place les élus locaux dans une situation plus que particulière. En effet, ce sont les élus locaux qui construisent les intercommunalités sur la base d’accords locaux, qui tendent à introduire plus de justice dans la représentation des communes dans le conseil communautaire, dans la concertation et dans l’intérêt de leur territoire. Dans le département de l’Eure, où je suis élue, près de 80 % des intercommunalités ont conclu de tels accords.
Les élus locaux sont également dans une situation paradoxale, entre une décision du Conseil constitutionnel qui restreint leurs initiatives sur la création d’intercommunalités et une réforme territoriale présentée par le Gouvernement qui tend à confier aux intercommunalités de nouvelles compétences et donc à accroître leur poids dans l’organisation territoriale. Un peu de clarté pour nos élus locaux est, me semble-t-il, nécessaire. C’est pourquoi la proposition de loi va dans le bon sens. Laissons les initiatives locales se faire ! Laissons les élus locaux former les intercommunalités telles qu’ils les perçoivent et les vivent !
J’ai écouté attentivement la position du Gouvernement mardi soir, à l’occasion de la discussion générale sur la proposition de loi constitutionnelle du président Gérard Larcher et de Philippe Bas. Monsieur le secrétaire d'État, je n’ai pas saisi, encore une fois, la cohérence de votre ligne et celle du parti socialiste. Pourquoi être favorable à une proposition de loi autorisant l’accord local de représentation des communes membres d’une intercommunalité, qui n’a pas d’autre objectif que celui de déroger au seul critère démographique de représentativité, et émettre dans le même temps un avis défavorable sur une proposition de loi constitutionnelle qui souhaite inscrire cela dans la Constitution ?
Permettez-moi de m’interroger ! À l’heure où de nombreux socialistes prétendent qu’il n’existe que des réformateurs et des conservateurs, n’est-ce pas réformateur que de vouloir aller au-delà des conseils communautaires ? N’est-ce pas réformateur que de vouloir inscrire dans la Constitution les notions figurant dans le présent texte pour sortir enfin de cette simple règle arithmétique ? N’est-ce pas conservateur que de dire oui aux conseils communautaires et non à la prise en compte constitutionnelle des territoires ?
En ce temps de crise économique, de crise morale et de crise politique, je pense que, au-delà du conservatisme et du réformisme, il nous faut faire preuve de courage politique. Du courage politique, monsieur le secrétaire d'État, il en faut pour aller au bout des réformes ! Voilà pourquoi j’apporterai mon soutien à l’ensemble de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi des sénateurs Alain Richard et Jean-Pierre Sueur, examinée aujourd’hui en deuxième lecture, est essentielle et attendue par les nombreux EPCI – plus d’une centaine sur le territoire – que la censure du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 a fortement impactés ou fragilisés.
À la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, les sages de la rue Montpensier ont jugé que les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales dérogeaient au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune « dans une mesure qui est manifestement disproportionnée », annulant de ce fait le principe même d’un accord local initialement inscrit dans la loi du 16 décembre 2010 à la demande générale des élus locaux et nationaux.
La décision du Conseil constitutionnel a privé les communes de la possibilité de conclure un accord local : il n’y a plus d’aménagement possible en considération de l’histoire partagée et des enjeux de chaque territoire. Seule reste en vigueur l’unique règle de représentation purement démographique avec l’application du tableau de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans mon département, je citerai le cas de la communauté de communes du Genevois, touchée par les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Cette communauté de communes est composée de 38 000 habitants répartis sur 17 communes : après la censure du Conseil constitutionnel, elle ne dispose plus que de 42 conseillers communautaires, contre 52 auparavant. Certes, toutes les communes sont représentées, mais deux voient le nombre de leurs délégués passer de trois à deux et huit d’entre elles n’ont plus qu’un seul délégué. Or le développement territorial que peuvent impulser quatre bourgs représentant 13 000 habitants, autour d’une ville-centre de 12 000 habitants, ne correspond en rien aux douze autres collectivités.
L’accord local qui avait été trouvé permettait d’équilibrer la représentation du territoire entre une part prépondérante accordée à la représentation au prorata de la population et une représentation minimale de chaque commune. Il s’agissait de trouver des points d’équilibre et de déterminer une gouvernance adaptée aux enjeux de chaque territoire. La solidarité sur un territoire ne se mesure pas seulement en nombre d’habitants ! Une telle solution profiterait nécessairement aux grosses communes, entraînant de fait une opposition entre l’urbain et le rural.
Il y avait donc urgence : urgence pour les élus locaux de décider de leur représentativité dans leur intercommunalité ; urgence à sécuriser une telle disposition dans un cadre juridique conforme, en apportant notamment une réponse à l’instabilité liée au possible renouvellement des instances de l’intercommunalité. D’ailleurs, je rappelle que les sénateurs Gélard, Leleux, Milon, Carle et l’ensemble des membres du groupe UMP ont déposé, le 3 septembre dernier, une proposition de loi allant en ce sens.
Les ajustements opérés par l’une et l’autre des assemblées dans le cadre de ce texte ont permis de trouver un équilibre, aussi contraignant soit-il : préserver dans les meilleures conditions de sécurité juridique la faculté d’un accord local pour faciliter le consensus intercommunal, dans le respect du principe de l’égalité devant le suffrage.
Redonner un fondement aux accords locaux tout en les encadrant, c’est respecter la démocratie dans sa double composante, démographique et territoriale, ce que le présent texte a essayé de préserver.
Écouter les dynamiques locales, avoir confiance dans leur travail et l’intelligence locale, c’est aussi la mission de notre mandat. Notre histoire est unique : les communes sont le socle de notre pays et de notre démocratie. Sachons écouter leurs représentants et préserver leur représentativité et leur investissement !
Je voterai ce texte, car il préserve un peu de démocratie locale.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
(Non modifié)
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :
« 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;
« 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
« La répartition des sièges effectuée par l’accord prévu au 2° respecte les modalités suivantes :
« a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV ;
« b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« c) Chaque commune dispose d’au moins un siège ;
« d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
« e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
« – lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par l’accord maintient ou réduit cet écart ;
« – lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l’attribution d’un seul siège. » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Dans les métropoles et les communautés urbaines, à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et à défaut d’accord conclu dans les conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des III et IV.
« La part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV et du présent VI ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
« 1° Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l’attribution effectuée en application du présent VI maintient ou réduit cet écart ;
« 2° Lorsqu’un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d’un seul siège en application du 1° du IV.
« Dans les métropoles et les communautés urbaines, la répartition effectuée en application du présent VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune à plus de la moitié de l’effectif de l’organe délibérant.
« La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est prise à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. »

Je tiens à résumer brièvement le problème que soulève à mes yeux ce texte.
On ne peut pas faire une intercommunalité contre la ville-centre, affirmiez-vous tout à l’heure, madame la présidente. Je constate que, désormais, on peut la faire contre toutes les autres communes, représentant 75 % de la population. Cherchez l’erreur… Mais ce n’est pas une erreur, c’est le produit d’une volonté. Il me navre qu’elle soit très largement partagée.
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
Le 1° de l’article L. 5211-6-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou d’annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sexe », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, » sont supprimés. –
Adopté.
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4-1 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ». –
Adopté.
(Non modifié)
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de l’organe délibérant d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
En cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la répartition des sièges de l’organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.
Le 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à la désignation des conseillers communautaires destinée à pourvoir les sièges répartis en application des deux premiers alinéas du présent article. –
Adopté.

Personne ne demande la parole pour explication de vote sur l’ensemble de la proposition de loi ?...
Je mets aux voix la proposition de loi dans le texte de la commission.
La proposition de loi est définitivement adoptée.

Voilà un exemple de navette bicamérale positive sur une proposition de loi de nos collègues Alain Richard et Jean-Pierre Sueur !
La parole est à M. le secrétaire d’État.

Je m’en voudrais de ne pas répondre à l’interpellation amicale et souriante, mais précise de Mme le rapporteur concernant les membres de l’exécutif communautaire.
L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales relatif au bureau des EPCI à fiscalité propre dispose en son cinquième alinéa que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant ». Par conséquent, seuls les membres du bureau qui perdraient leur mandat de conseiller communautaire perdent leur fonction exécutive et ont vocation à être remplacés. Il en est de même du président, qui ne doit abandonner ses fonctions de président que s’il perd son mandat de conseiller communautaire. En revanche, concernant les vice-présidents, qui tiennent leur délégation du président de l’EPCI, si ce dernier est remplacé, c’est l’ensemble du bureau qui doit être renouvelé.
Une note conjointe du secrétariat général du ministère de l’intérieur et de la Direction générale des collectivités territoriales, en date du 15 juillet 2014, que je vous ferai parvenir, madame le rapporteur, a d’ailleurs précisé ces éléments d’information concernant les exécutifs locaux, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures dix.

Je rappelle que la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Gérard Miquel membre de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages et M. Alain Fouché membre du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse (proposition n° 202, texte de la commission n° 259, rapport n° 258).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, la presse tient dans notre pays une place à part. Par la diversité des titres, la pluralité des opinions qui s’y expriment, sa participation au débat démocratique, la presse française n’est pas seulement un pouvoir ou un contre-pouvoir, elle est simplement l’espace de liberté et de débat qui rend possible la vie en démocratie, elle en est même le corollaire indispensable.
L’examen de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse vient à point nommé, parce que la liberté de la presse ne doit pas rester une pétition de principe, une liberté virtuelle, un slogan de manifestation. La liberté de la presse doit avoir les moyens de s’exercer pleinement. Or elle ne s’exerce qu’à la condition d’avoir des journaux nombreux, divers, robustes financièrement et confortés dans leur liberté.
Nous examinons évidemment cette proposition de loi dans un contexte très différent, dont nous ne pouvons nous abstraire, de celui dans lequel s’est tenu le débat à l’Assemblée nationale. Notre pays vient de vivre la pire attaque terroriste depuis la fin de la guerre. Ne nous y trompons pas, l’attaque abjecte contre Charlie Hebdo voilà un mois visait certes à décimer une rédaction, mais aussi à frapper au cœur la République. Douloureux rappel : les Français ont sans doute pris conscience à cette occasion que ce cœur, précisément, c’est la presse.
Nous contribuons aujourd’hui à répondre à l’immense espérance née le 11 janvier dernier, en affirmant avec solennité et dignité que la France se lèvera toujours pour défendre les valeurs de la République, au premier rang desquelles figurent la liberté et la laïcité.
Je veux le dire ici, à la tribune du Sénat, en reprenant les mots prononcés par le Président de la République lors du 70e anniversaire de l’Agence France-Presse : « Nous n’insultons personne lorsque nous défendons nos idées, lorsque nous proclamons la liberté. […] Le drapeau français, c’est toujours celui de la liberté. »
Le temps de l’émotion, vive encore, commence à laisser place au temps de la réflexion et de l’action : la réponse face à cette attaque sera évidemment multiple, mais je pense que notre travail d’aujourd’hui en fait partie. En rénovant le cadre de la distribution de la presse, en assurant l’avenir de l’Agence France-Presse et en créant ce nouveau statut d’entreprise solidaire de presse d’information, nous contribuons au maintien et au développement du pluralisme des médias dans notre pays.
Je suis heureuse de voir que le travail en commission a permis un débat très ouvert, où chaque famille politique a pu formuler des propositions d’amélioration du texte, dont plusieurs ont pu être acceptées. Ce travail collectif, dont je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, montre que l’avenir du secteur de la presse est un sujet transpartisan, un enjeu républicain et démocratique, qui prend évidemment un relief particulier dans ce contexte dramatique.
Après le travail d’orfèvre réalisé à l’Assemblée nationale par Michel Françaix, que je veux de nouveau saluer, le rapporteur du Sénat, Philippe Bonnecarrère, a effectué un travail constructif, lequel, à bien des égards, a permis d’utiles enrichissements du texte, ce dont je le remercie. Je veux enfin saluer l’investissement du groupe CRC sur ce texte. Pierre Laurent au Sénat et Marie-George Buffet à l’Assemblée nationale se sont particulièrement impliqués. Si nous ne sommes pas d’accord sur tout – le débat le révélera sans doute –, nous nous rejoignons au fond sur l’essentiel et le niveau d’ambition à avoir pour le secteur de la presse.
Je ne reviendrai pas sur la crise structurelle que traverse la presse, dont le diagnostic est largement connu et partagé : la révolution numérique bouleverse les modèles économiques de ce secteur, mais aussi les usages de lecture. Ces mutations ne remettent pas en cause les principes fondamentaux qui gouvernent la presse : la garantie du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, notamment politiques, qui ne saurait être effectif sans la possibilité d’une distribution libre sur l’ensemble du territoire et d’un égal accès à la presse par tous les citoyens.
Cette proposition de loi se décline en trois volets : le renforcement de la régulation de la distribution de la presse ; la modernisation de la gouvernance de l’Agence France-Presse et sa mise en conformité avec les exigences communautaires ; enfin, la création d’un nouveau statut d’entreprise solidaire de presse d’information.
Le titre Ier de la proposition de loi répond aux enjeux de la refondation de la distribution de la presse, en renforçant la régulation du secteur.
Le système coopératif de distribution de la presse est un pilier fondamental de l’information pluraliste dans notre pays. Il garantit à tout éditeur le droit d’être distribué et permet ainsi la mise en œuvre effective de l’objectif constitutionnel de préservation du caractère pluraliste des courants d’expression. Cependant, il connaît aujourd’hui, à tous ses niveaux, une crise profonde liée au déclin de la diffusion physique de la presse, qui fragilise les messageries, les dépositaires, les diffuseurs et les éditeurs de presse. Ainsi, la principale société coopérative de presse, et la seule à distribuer les quotidiens, Presstalis, est engagée dans une restructuration profonde, indispensable à sa pérennité, et qui implique une véritable réorganisation industrielle de la filière de distribution. Les dépositaires se réorganisent également, dans des conditions douloureuses. Enfin, de nombreux diffuseurs voient leur activité fragilisée ; leur nombre en France est passé de 29 749 à la fin de l’année 2008 à 26 816 à la fin de l’année 2013.
Aussi, dans le respect des principes fondateurs hérités de la loi Bichet – égalité de traitement des titres, caractère coopératif du système et gouvernance paritaire –, il convient de procéder à trois évolutions, en s’appuyant sur les avancées apportées par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse.
D’une part, il importe de renforcer les logiques de solidarité coopérative au sein de la distribution de presse. Grâce à cette proposition de loi, le législateur définit plus précisément les modalités et les critères de solidarité fondant les barèmes des messageries, qui seront soumis à une procédure d’homologation. Le renforcement de la transparence qui en résultera permettra enfin d’objectiver les fondements économiques des barèmes. De manière globale, les principes de coopération et d’équilibre financier général seront désormais inscrits parmi les finalités de la régulation de la distribution de la presse.
Je prends bonne note de la modification de cette procédure d’homologation que propose la commission de la culture du Sénat en conférant la compétence de principe à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’ARDP, après avis du président du Conseil supérieur des messageries de presse, le CSMP. Après réflexion et consultation de la profession, il apparaît que la solution proposée par la commission, sous réserve d’un aménagement que je vous proposerai, est une avancée que le Gouvernement souhaite soutenir. Nous y reviendrons dans le débat.
D’autre part, le texte vise à conférer à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse un pouvoir renforcé pour assurer une mise en place rapide des réformes indispensables du secteur, tout en maintenant le rôle représentatif et décisionnel du Conseil supérieur des messageries de presse.
Enfin, le texte a pour objet d’ouvrir de façon encadrée le « dernier kilomètre » de distribution de la presse aux éditeurs de presse. Je note les craintes que peut susciter cette disposition. Cependant, la baisse de la diffusion imprimée rend indispensable la recherche de mutualisation entre les réseaux de distribution sur le dernier kilomètre. Cette disposition, qui s’appuie sur les nombreuses expérimentations qui ont d’ores et déjà eu lieu, permettra aux éditeurs de la presse quotidienne régionale, la PQR, dotés de leur propre réseau de distribution d’acheminer vers les points de vente les titres de la presse quotidienne nationale, la PQN, désireux de signer des contrats de distribution.
Le titre II de la proposition de loi parachève la consolidation de l’Agence France-Presse en modernisant le cadre juridique dans lequel se développe l’Agence, tant sur le plan de sa gouvernance que de la conformité au droit européen.
Seule agence internationale non anglophone, l’Agence France-Presse participe pleinement du rayonnement de la France et apporte, conformément à l’article 2 de son statut, une information exacte, impartiale et digne de confiance. Le Président de la République a pu ainsi rappeler toute l’importance de l’AFP en fêtant les soixante-dix ans de cette dernière en janvier dernier.
Toutefois, l’Agence est elle aussi confrontée à la crise que subissent ses clients traditionnels, alors même que la concurrence internationale s’accroît avec la création d’une agence chinoise. Le Gouvernement avait ainsi décidé de diligenter une mission sur l’avenir de l’AFP. Le rapport définitif du député Michel Françaix propose de renforcer la capacité d’investissement de l’Agence pour qu’elle puisse consolider son modèle grâce au développement de produits innovants, notamment avec la création d’une filiale de moyens. Je sais les craintes que la création de cette filiale a pu susciter. Cependant, non seulement le choix de cette option ne comporte aucun danger pour l’Agence, mais il permet, au contraire, de répondre efficacement à son besoin de financement.
Parallèlement, l’État accompagne le développement de l’AFP en lui accordant un traitement budgétaire très favorable en loi de finances initiale pour 2015 – avec une augmentation de 2 millions d'euros –, en finalisant la négociation d’un contrat d’objectifs et de moyens ambitieux et en achevant la refonte de la convention d’abonnement.
Ces dispositions de modernisation de la gouvernance de l’Agence et de mise en conformité avec le cadre communautaire parachèvent ainsi la consolidation du modèle original de l’AFP.
À l’issue de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, plusieurs évolutions dans la gouvernance ont été proposées.
Je citerai, en premier lieu, une modification de la composition du conseil d’administration, où les représentants des éditeurs de presse seraient moins nombreux, où siégerait une nouvelle catégorie d’administrateurs – des personnalités qualifiées nommées par le conseil supérieur de l’AFP – et où serait enfin fixé un objectif de parité femmes-hommes.
Je signale, en deuxième lieu, une modification de la composition du conseil supérieur : les membres dont le mandat devient renouvelable une fois ne pourront le cumuler avec un mandat au conseil d’administration et devront être des personnes en activité.
Je souligne, en troisième lieu, la participation de la commission financière, sans voix délibérative, aux séances du conseil d’administration.
J’appelle enfin votre attention sur la quatrième avancée, l’allongement du mandat du président-directeur général de l’AFP de trois à cinq ans.
Sur l’initiative du rapporteur, M. Bonnecarrère, la commission de la culture du Sénat a fait une proposition de réforme plus radicale de la gouvernance de l’Agence, qui consiste à faire fusionner le conseil supérieur et la commission financière en une nouvelle commission de surveillance. Cette solution mériterait un examen et une concertation plus approfondis pour en mesurer finement toutes les implications. Le moment où cette proposition intervient ne le permet pas. C’est pourquoi il me semble prématuré – et même aventureux juridiquement – de choisir cette option ; nous aurons l’occasion d’en débattre.
Par ailleurs, la clôture de la plainte pour aide d’État, déposée par un concurrent de l’AFP auprès de la Commission européenne, appelle des aménagements au statut de 1957 afin de transcrire les mesures nécessaires pour assurer le plein respect du droit européen de la concurrence, conformément aux demandes de la Commission européenne.
D’abord, le calcul de l’abonnement de l’État, aujourd’hui défini par référence aux tarifs de la presse française, doit se faire par référence au barème des « clients entreprises » de l’Agence.
Ensuite, l’Agence doit également mettre en place une comptabilité séparée pour les activités ne relevant pas des missions d’intérêt général de l’AFP.
Enfin, le régime de faillite spécifique de l’AFP, prévu par l’article 14, est revu pour soumettre les droits des créanciers au droit commun, sans que l’État puisse être appelé en garantie.
Je sais la sensibilité de ces deux dernières dispositions, qui ne sont cependant que des modalités de protection de l’Agence. En effet, la mise en place d’une comptabilité séparée et la réforme du régime de faillite sont nécessaires pour respecter le cadre européen.
La pleine conformité de l’Agence au droit communautaire constitue une sécurisation indispensable pour son bon fonctionnement sur le marché européen.
Le titre III de la proposition de loi est une opportunité pour le développement de la presse et les nouveaux acteurs qui peuvent émerger dans ce domaine.
La création d’un nouveau modèle d’entreprise dans le secteur de la presse est une formidable motivation pour les entrepreneurs de la presse d’aujourd’hui. Elle pourra répondre aux besoins de tous ceux qui ont des projets innovants dont la viabilité est compromise par la difficulté de lever les fonds nécessaires au démarrage du projet et qui peinent ensuite à les conserver sur la durée, alors qu’ils en ont besoin pour consolider l’activité de leur entreprise.
L’entreprise solidaire de presse d’information permettra ainsi à de nouveaux projets éditoriaux d’émerger. Le choix de ce statut, inspiré des entreprises de l’économie sociale et solidaire, correspond à la volonté des actionnaires de renoncer à une partie des bénéfices pour les réinvestir dans l’activité de la société. Ces entreprises demeurent néanmoins des entreprises commerciales. Elles opteront simplement pour un modèle qui renforce leur obligation de mise en réserve des sommes nécessaires à la pérennité de l’activité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le soutien de nos concitoyens au pluralisme de la presse et à la liberté d’expression, qu’ils ont été si nombreux à manifester partout en France, peut – et doit – prendre la forme d’un soutien financier à des projets éditoriaux nouveaux ou à la consolidation de titres de presse qu’ils souhaitent voir perdurer. C’est pourquoi, au-delà de ce statut nouveau d’entreprises solidaires de presse, le Gouvernement, en lien étroit avec les sénateurs socialistes, vous proposera d’offrir au citoyen qui investit dans la presse un avantage fiscal inspiré de celui qui marque les engagements politiques et sociaux dans notre pays, comme l’adhésion à un parti, à une association ou à un syndicat professionnel.
Cette nouvelle disposition fiscale, annoncée par le Président de la République lors des soixante-dix ans de l’AFP, a aujourd’hui toute sa place dans la proposition de loi. J’avais d’ailleurs indiqué, lors de la discussion à l’Assemblée nationale, que le Gouvernement travaillerait et ferait rapidement des propositions sur ce point.
Je voudrais remercier l’ensemble des groupes politiques de la Haute Assemblée qui, partageant cet objectif commun, ont tous déposé de nombreux amendements. Je veux, en particulier, remercier très chaleureusement les sénateurs du groupe socialiste, notamment le sénateur David Assouline, dont l’expérience sur les sujets qui touchent à la presse n’est plus à démontrer.
L’amendement déposé par le groupe socialiste correspond au but précis poursuivi par le Gouvernement. En accord avec M. le sénateur et avec, je l’espère, l’assentiment de tous les groupes – je sais avoir votre accord, monsieur le rapporteur –, le Gouvernement complétera et précisera cet amendement par un sous-amendement, respectant ainsi le travail parlementaire important qui a été réalisé et auquel je souhaite rendre hommage en m’adressant à toutes les travées.
Cette disposition permettra de soutenir tous les titres de presse d’information politique et générale et, parmi eux, en particulier, les entreprises solidaires de presse pour lesquelles l’avantage fiscal sera plus incitatif. Elle répond aussi aux attentes de Charb, qui avait travaillé au sein de Charlie Hebdo à un texte de loi de cette nature pour encourager les financements participatifs de la presse écrite et le soutien au pluralisme de la presse.
En se rassemblant autour de cet amendement, la Haute Assemblée adresserait, me semble-t-il, un signal extrêmement puissant en direction de la presse et permettrait une véritable avancée en faveur d’un financement citoyen de la presse. Nous en débattrons dans quelques instants.
Dans le titre III de la proposition de loi figurent également des dispositions diverses intéressant le secteur de la presse et les journalistes. Nous aurons l’occasion de débattre de ces sujets, comme la procédure d’habilitation des journaux d’annonces légales ou l’accès des parlementaires et des journalistes dans les lieux privatifs de liberté pour lesquels je pense souhaitable de conserver les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.
Enfin, les réformes concernant la presse ne relèvent pas toutes de cette proposition de loi. Le Gouvernement progresse également sur la protection du secret des sources des journalistes et la réforme des aides directes.
Je sais votre sensibilité au sujet de la protection du secret des sources des journalistes, qui se traduit par vos propositions d’amendements au présent texte. Je sais aussi que le Parlement attend depuis longtemps des avancées en la matière.
La protection du secret des sources des journalistes est, comme le rappelle la Cour européenne des droits de l’homme, « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». Soyons très clairs, le Président de la République s’est engagé cette année à ce qu’un texte soit présenté au Parlement pour améliorer cette protection. Je répète ici cet engagement, ce sera fait durant l’année.
Le Gouvernement souhaite des dispositions équilibrées. À la demande du Premier ministre, nous y travaillons très activement avec la garde des sceaux, Christiane Taubira, en veillant au respect scrupuleux de tous nos principes à valeur constitutionnelle : la liberté de la presse, comme la sûreté et la sécurité de nos concitoyens. La tragédie que nous venons de vivre atteste de l’impérieuse nécessité de ne plus opposer ces exigences républicaines.
Par ailleurs, je note également votre préoccupation relative aux aides au pluralisme et au soutien aux titres d’information politique et générale. En la matière, je respecterai, monsieur le sénateur Laurent, l’engagement pris devant Marie-George Buffet à l’Assemblée nationale. Ces réformes relèvent du pouvoir réglementaire, et je vous informe qu’un décret sera pris dans les prochaines semaines pour étendre le bénéfice de l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires aux titres hebdomadaires et mensuels relevant de cette catégorie.
Pour conclure, je crois que nous apportons, avec cette proposition de loi, avec les réformes que je viens d’annoncer, une réponse adaptée à l’ampleur du défi que doit relever la presse de notre pays, en cette heure où nous mesurons combien elle est précieuse et fragile.
J’entre dans ce débat avec la certitude que nous ferons aujourd’hui œuvre utile, pour la presse, bien sûr, mais sans doute aussi et surtout pour la qualité de notre vie démocratique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi issue de l’Assemblée nationale consacrée, pour l’essentiel, à la distribution de la presse et au statut de l’AFP. Il s’agit de dispositions importantes pour l’ensemble des sociétés concernées. Force est aussi de reconnaître que ces dispositions ne constituent pas la grande loi sur la « modernisation de la presse » qui serait pourtant nécessaire non seulement pour assurer la pérennité du secteur de la distribution, conforter le modèle économique de la presse, favoriser sa transition numérique, mais aussi pour donner à l’AFP les moyens de son développement à long terme.

Le texte qui nous est proposé ne mérite donc ni louanges ni excès de critiques. Il constitue une étape, qui vise d’abord à résoudre des problèmes ponctuels. C’est en ayant à l’esprit cette caractéristique que la commission de la culture l’a examiné, faisant le choix de ne pas en modifier le périmètre. Si le délai de trois semaines dont nous avons disposé ne nous permettait pas d’envisager un texte plus ambitieux, nous avons apporté des améliorations réelles et favorisé la recherche d’un accord avec l’Assemblée nationale.
Nous avons suivi deux axes : nous avons d’abord effectué un travail de synthèse entre les acteurs et la rédaction issue de l’Assemblée nationale ; nous avons ensuite réalisé un travail d’approfondissement de ce texte, nous attachant, conformément au souci bien connu du Sénat, à une bonne qualité d’écriture du texte de loi.
Je ne reprendrai pas, après que Mme la ministre l’a fort bien fait, l’exposé de la proposition de loi. Je rappellerai simplement que ce texte est lié aux engagements pris par le Gouvernement de mettre en conformité le statut de l’Agence France-Presse avec le droit européen avant le 27 mars 2015. C’est cette date butoir qui explique la brièveté du temps qui nous a été imparti pour l’examiner.
Je profite de cette occasion pour donner acte au Gouvernement de la qualité de ses échanges intervenus avec la Commission européenne. Dans l’approche du dossier de l’AFP, la Commission européenne a fait preuve de beaucoup de tact, de mesure et de pondération. La réponse donnée par le Gouvernement, les engagements qu’il a pris au nom de notre pays me paraissent parfaitement adaptés – je le dis après avoir pris une connaissance aussi approfondie que possible des documents fort longs qui nous ont été transmis.
Les autres dispositions de la proposition de loi ont été ajoutées afin de profiter de la fenêtre législative. C’est le cas, par exemple, des dispositions relatives à la modernisation de la gouvernance de l’AFP. Ces dispositions, qui ont fait l’objet d’un rapport du député Michel Françaix remis au Premier ministre, sont reprises d’une proposition de loi déposée en mai 2011 par notre collègue Jacques Legendre, que je salue ; il s’était beaucoup investi dans la rédaction de ce texte, et David Assouline y avait également apporté sa contribution.
Si je rappelle cette antériorité de notre commission, c’est pour mieux justifier le fait que la proposition de loi que nous examinons comprend des mesures devenues, me semble-t-il, largement consensuelles, sauf sur un ou deux points. La commission s’en est d’ailleurs fait l’écho, puisque la quasi-totalité de ces dispositions ont été adoptées, sinon à l’unanimité, tout du moins à une très large majorité, émanant de tous les groupes.
Les propositions de la commission concernant l’AFP se limitent à deux aspects.
Le premier est relatif au profil des cinq personnalités qualifiées. Nous sommes restés raisonnables : nous ne proposons aucune modification des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. Nous souhaiterions cependant que ces cinq personnalités puissent justifier d’une véritable expérience au niveau européen ou international. Il est en effet paradoxal que le conseil d’administration d’une agence de presse mondiale soit à 100 % franco-français ! Nous proposons donc qu’au moins trois de ces personnalités soient de nationalité étrangère, ou bien, si elles sont françaises, qu’elles puissent justifier d’une expérience au niveau européen – l’AFP a un grand rôle à jouer pour rendre compte aux citoyens du monde entier des discussions menées à Bruxelles ou à Strasbourg ! – ou international.
Le second aspect vise à constituer un véritable contre-pouvoir, dont je soulignerai le caractère indispensable, au sein de l’entreprise, face au conseil d’administration et à son président. L’objectif est de mieux distinguer ce qui relève des fonctions de direction de ce qui incombe normalement aux organes chargés de la supervision et de la définition de la stratégie.
L’APF est une maison qui n’est dotée d’aucune supervision. J’ai été étonné, je dois l’avouer, par la faiblesse de ses instances de direction. Ainsi, son conseil d’administration se réunit seulement deux fois par an. Quant au conseil supérieur, il se réunit une fois par an – peut-être s’est-il déjà réuni deux fois au cours d’une année, mais personne n’en a gardé le souvenir – pour examiner, tout au plus, une plainte déposée par un « usager », mot qui désigne non pas un usager de l’information, mais un client de l’AFP. Or si un client de l’AFP n’est pas d’accord, il se désabonne, ce qui ne s’est produit qu’à cinq reprises depuis 2010.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, cette situation ne peut plus durer. Il n’est pas possible que cette maison ne dispose d’aucun lieu où sa stratégie serait exposée, examinée et contrôlée.
Le financement du plan d’investissement, lequel s’élève à 30 millions d’euros, via la création d’une filiale de moyens qui pourra emprunter à hauteur de 26 millions d’euros, aura pour conséquence de porter l’endettement de la société à un niveau jamais atteint par le passé. Parallèlement, les choix d’investissement de l’AFP ne feront l’objet d’aucun examen contradictoire. J’ajoute que, selon les propres dires du président de sa commission financière, la situation de l’Agence n’est pas bonne et son résultat sera négatif en 2014.
J’y insiste : il faut bien avoir à l’esprit que l’AFP, qui est endettée et dont les fonds propres sont négatifs, pourra, grâce à la création de cette filiale de moyens, emprunter 26 millions d’euros supplémentaires. C’est de la déconsolidation pure et simple de dette, mais cette dette pèsera tout de même sur l’Agence, qui aura l’honneur et l’avantage de la rembourser en acquittant des redevances à sa filiale de moyens ainsi que de la TVA, ce qui représente une majoration de la charge d’intérêts.
On se souvient que, pour trouver de la trésorerie, l’Agence a déjà recouru à un crédit-bail immobilier, dit aussi lease-back, sur son siège. Mis à part le partenariat public-privé, je n’ai pas trouvé de moyen connu de déconsolidation de dette que n’aurait pas utilisé l’AFP !
En faisant ce constat, votre commission souhaite vous alerter, mes chers collègues, ainsi que le Gouvernement, sur le fait que l’AFP a besoin non pas tant d’une nouvelle gouvernance que d’une gouvernance « véritable », qui permette de nouvelles pratiques dans la gestion de la société.
Nous savons que les personnels sont très attachés à leur entreprise et conscients de la nécessité de faire évoluer la situation tout en garantissant l’indépendance de l’Agence. Votre commission propose donc de fusionner le conseil supérieur et la commission financière, afin de créer une véritable « commission de surveillance » de l’AFP. Cette commission reprendra les missions relatives à la déontologie et au contrôle financier des deux structures fusionnées, car il conviendra de respecter les engagements pris par la Commission européenne. Elle pourra surtout, sur le modèle de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, ou encore de l’instance chargée de la gestion au sein des centres hospitaliers, discuter de la stratégie de l’Agence.
J’ai bien entendu la réserve que vous avez exprimée, madame la ministre : selon vous, expertiser ce dispositif prendra du temps. Or, du temps, je ne crois pas que vous en disposiez. En effet, si le programme d’investissement de 30 millions d’euros – lequel nécessitera, je le rappelle, un emprunt supplémentaire de 26 millions d’euros – devait se solder par un échec, vous seriez privée de toute autre solution : les moyens destinés aux missions d’information générale que l’État peut financer ont été dépensés, sous le contrôle de la Commission européenne, et nous n’avons pas la possibilité de faire un apport en capital au bénéfice de l’Agence.
Vous n’avez donc aucun droit à l’échec. Seules deux solutions s’offrent à vous : soit le modèle de gouvernance choisi comprend un président et un conseil d’administration, soit il comprend un directoire et un conseil de surveillance. D’aucuns pourront me rétorquer que le conseil de surveillance n’est pas la bonne solution. Si celle-ci n’était pas retenue, il faudrait mettre en place un véritable conseil d’administration. Or ce conseil d’administration n’existe pas et n’existera jamais !
Tout d’abord, le pouvoir de nomination des présidents de l’AFP ne revient pas au conseil d’administration, sinon sur un plan purement juridique. Chacun sait, en effet, que ce pouvoir relève d’instances politiques.
Ensuite, le conseil d’administration n’a aucun pouvoir de révocation.
Quant à l’actionnaire principal – permettez-moi d’employer ces termes, bien que l’AFP ne dispose pas d’un capital –, c’est-à-dire l’État, il ne siège pas au sein du conseil d’administration. La situation de l’Agence ne sera donc jamais celle de la SNCF ou d’EDF, entreprises auprès desquelles l’État prend ses responsabilités.
Il n’y aura donc pas de véritable conseil d’administration au sein de cette entreprise, pour la raison de principe suivante : l’AFP est une agence d’information mondiale. Qui, de par le monde, achèterait les informations diffusées par l’AFP – et c’est ce que nous souhaitons tous – si celle-ci devait ressembler à l’agence Tass ou à l’agence Chine nouvelle, avec, à ses côtés, un État l’assistant, organisant, et siégeant à son conseil d’administration ?
Le principe, légitime, de l’indépendance de l’AFP, a donc pour corollaires les principes suivants : son actionnaire ne peut siéger au sein de son conseil d’administration ; ledit conseil est lui-même très faible ; la gouvernance de l’Agence est inexistante.
La commission a donc convenu, à la quasi-unanimité, que le conseil de surveillance était la solution à retenir. J’espère également vous en convaincre, madame la ministre.
Je précise que le président du conseil supérieur de l’Agence, le conseiller d’État Thierry Lefort, ainsi que celui de la commission financière, le conseiller maître à la Cour des comptes Daniel Houri, ont donné leur plein accord pour cette solution. La société des journalistes, la SDJ, qui représente la majorité des journalistes de la société, a fait part de son enthousiasme et le SNJ-AFP soutient également cette proposition. Même les syndicats d’employés dits « non-journalistes » de l’AFP, qui expriment quelquefois des positions divergentes, n’y sont pas opposés. Je remercie, encore une fois, les membres de la commission de nous avoir très largement soutenus. J’ai bien noté, en particulier, la forte approbation de nos collègues socialistes.
Concernant les dispositions relatives à la distribution de la presse, l’état des lieux n’est guère plus réjouissant. C’est pourquoi nous devons être vigilants afin de préserver l’indépendance de la presse et des journalistes, laquelle passe également par une modernisation de sa distribution et par une migration réussie, un basculement, vers le numérique. Je vous donne volontiers acte, madame la ministre, des indications fort pertinentes dont vous nous avez fait part sur ce sujet.
Je ne m’étendrai ni sur la diffusion de la presse « papier », qui est en chute libre, ni sur la situation économique pour le moins complexe de Presstalis et des Messageries lyonnaises de presse, les MLP. Ces deux entreprises, dont les relations sont apaisées, ont fait de gros efforts et restructuré leur activité. Les MLP ont aussi renouvelé leur gouvernance. Les deux groupes ont, par ailleurs, entamé un processus destiné à déployer une solution informatique commune. Le décroisement des flux logistiques est également en cours.
Dans le même temps, ces deux messageries connaissent une situation fort tendue en termes de trésorerie, bien que l’une déclare s’approcher de l’équilibre et l’autre d’un exercice bénéficiaire. Quoi qu’il en soit, sans les aides publiques, aucune ne serait en mesure de poursuivre son activité, toutes deux affichant des fonds propres négatifs, à hauteur de 8, 6 millions d’euros pour les MLP et de 181, 2 millions d’euros pour Presstalis.
En réalité, l’ensemble de la filière de distribution est en sursis. Ainsi, les kiosquiers disparaissent progressivement à force de paupérisation. Le montant moyen des commissions que leur reversent les messageries s’élève à 11 000 euros bruts annuels. Par ce chiffre, il faut comprendre non pas le revenu, mais le chiffre d’affaires avant paiement des charges et des rémunérations ! Je vous laisse juges, mes chers collègues, des difficultés de ce secteur...
À défaut du « grand soir », c’est-à-dire d’un texte plus large qui répondrait aux enjeux de l’évolution du modèle économique de la distribution, cette proposition de loi prévoit des évolutions utiles du modèle de régulation des messageries de presse. Je ne développerai pas ces évolutions, mais j’indique que nous avons salué l’article 1er en commission, qui donne une traduction législative au principe de la péréquation. Nous avons également soutenu la position de M. Françaix et du Gouvernement sur l’article 7, en prévoyant une mutualisation intelligente des moyens de distribution. Il est en effet proposé de dénouer les contrats d’exclusivité entre la presse quotidienne nationale et Presstalis, c’est-à-dire, concrètement, de permettre à la PQN d’utiliser les moyens de distribution de la PQR.
Il s’agit ici d’aider la presse quotidienne régionale, via l’amortissement de ses coûts de distribution et d’offrir à la PQN des possibilités nouvelles de bénéficier d’une distribution de qualité. Nous avons essentiellement proposé deux modifications, qui ont fait l’objet d’une approbation générale.
Nous avons modifié l’article 1er en vue de transférer à l’Autorité de régulation le soin d’homologuer les barèmes et prévu, en jouant sur les durées, quelques modalités complémentaires relatives au pouvoir de réformation. Je vous remercie, madame la ministre, de nous avoir donné acte du travail ainsi réalisé.
Lors de l’examen des articles, j’évoquerai différents sujets, notamment les questions que soulève l’article 15, celles qui sont relatives au comité d’entreprise, au pluralisme, la possibilité de défiscaliser des souscriptions au bénéfice des entreprises de presse lors de la discussion de l’amendement n° 4 de David Assouline, sous-amendé par le Gouvernement. Sur ces points, la commission a déjà donné son accord, et j’ai indiqué à nos collègues qu’ils pourraient compter sur mon soutien.
Au final, mes chers collègues, vous aurez compris que notre démarche a consisté à améliorer cette proposition de loi plutôt qu’à en contester le bien-fondé. Nous avons cherché à apporter une valeur ajoutée sénatoriale forte. Vous apprécierez si elle est bien à la hauteur de l’espérance et de la confiance que vous mettez traditionnellement dans le travail de la Haute Assemblée.
Nous souhaitons qu’un accord global puisse être trouvé sur ce texte au-delà des clivages politiques ; tel a d’ailleurs été le sens de la mission qui m’a été confiée. L’avenir de la presse le justifie, sans pour autant que celle-ci soit dispensée de son effort de modernisation.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Philippe Bonnecarrère vient de présenter la position de la commission sur cette proposition de loi. Nous pouvons unanimement saluer la qualité de son travail et nous féliciter des apports significatifs que le Sénat est aujourd’hui en mesure d’apporter à ce texte adopté par l’Assemblée nationale.
L’état d’esprit qui nous a animés lors de l’examen de ce texte est conforme au souhait de la nouvelle majorité du Sénat, qui désire conduire un travail législatif de qualité avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement dans le droit fil de la lettre et de l’esprit de nos institutions. Il faut dire que le sujet qui nous occupe aujourd’hui se prête particulièrement à cette œuvre d’enrichissement. Qui plus est, depuis de nombreux mois, que ce soit avec l’ancien rapporteur de ce texte, David Assouline, ou avec Philippe Bonnecarrère, notre commission a conduit des débats nombreux, approfondis et constructifs.
À la suite du rapporteur, je me dois de rappeler que les dispositions de la proposition de loi relatives à l’Agence France-Presse sont largement issues d’une proposition de loi déposée en son temps par notre collègue Jacques Legendre, que je salue moi aussi. Quant aux mesures qui concernent la régulation des messageries de presse, elles visent à améliorer la loi de 2011, qui a fait l’objet d’un large accord.
Madame la ministre, dans cet hémicycle ne se trouvent aujourd'hui que des femmes et des hommes attachés à l’existence d’une presse forte, libre et indépendante, tous fiers de l’Agence France-Presse et déterminés à assurer son avenir.
Vous avez reconnu des points de convergence importants sur des dispositions essentielles de la proposition de loi. Je pense au fait de permettre, à l’article 7, à la presse quotidienne régionale de distribuer la presse quotidienne nationale ou au renforcement du conseil d’administration de l’AFP. Certaines dispositions proposées par le Sénat qui avaient suscité des interrogations de vos services ou de certaines parties prenantes font aujourd’hui consensus, qu’il s’agisse de l’article 1er, qui prévoit de confier à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse la responsabilité d’homologuer les barèmes des messageries, ou de la réduction à un mois du délai supplémentaire accordé à l’ARDP dans le cadre de son pouvoir de réformation.
Un accord semble donc à notre portée si chacun veut s’en donner la peine. Je vois deux conditions pour atteindre cet objectif.
En premier lieu, il faut reconnaître l’apport très important du Sénat sur la gouvernance de l’AFP. Le rapporteur a souhaité compléter le volet relatif au conseil d’administration par un volet consacré aux instances de contrôle. Sa proposition de créer une « commission de surveillance » constitue à l’évidence un progrès particulièrement nécessaire. Les syndicats ne s’y sont pas trompés, qui soutiennent sans réserve la disposition et expliquent qu’il ne saurait être question de revenir en arrière.
Le travail du rapporteur a montré que la situation de l’AFP n’était pas aussi bonne qu’on l’imaginait, notamment en raison d’une gouvernante défaillante. Tous ceux qui sont attachés à l’AFP doivent donc se retrouver pour répondre à cet enjeu. Philippe Bonnecarrère, par son écoute et sa disponibilité, a montré qu’il était prêt à prendre en compte toutes les suggestions pour améliorer encore la rédaction qui a fait l’objet d’un très large accord en commission.
En second lieu, il convient de rester dans le cadre raisonnable du périmètre de la proposition de loi et de ne pas chercher à ajouter des dispositions qui, pour intéressantes ou pertinentes qu’elles soient, soulèveraient des problèmes juridiques qui en rendraient l’adoption difficile. Je pense en particulier à la question de la protection juridique des sources des journalistes à laquelle nous sommes très attachés et qui, à ce titre, mérite d’être traitée de manière complète et approfondie dans un texte particulier. Madame la ministre, vous avez annoncé que le Président de la République confirmait l’engagement qu’un texte uniquement dédié à ce sujet soit rapidement inscrit à l’ordre du jour des travaux du Parlement ; je m’en réjouis.
J’ai aussi à l’esprit la question très sensible des annonces judiciaires et légales. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cette proposition de loi ne refonde pas le modèle économique de la presse, notamment pour l’adapter à l’ère numérique. C’est un chantier très vaste et très complexe ; je le sais pour avoir beaucoup travaillé sur ces sujets ces deux dernières années. Dans ces conditions, modifier l’un des aspects de ce modèle ne peut avoir que des effets contre-productifs et déstabilisateurs sur l’ensemble du système, dont nous ne pouvons mesurer l’étendue des conséquences. J’en appelle donc à la raison pour que chacun mesure les limites inhérentes à l’initiative dans le cadre qui nous est imparti si nous voulons être efficaces.
Je terminerai en évoquant un sujet qui nous concerne tous et que vous avez évoqué, madame la ministre, à savoir l’amendement dit « Charb » relatif au soutien que peuvent apporter les citoyens au financement de la presse. Cette question a fait l’objet d’un long débat en commission. Très sensibilisés, l’ensemble des sénateurs ont pris position afin qu’une solution efficace et adaptée soit trouvée.
Des propositions de rédaction ont circulé, qui n’avaient pas toujours été expertisées et dont on mesure aujourd’hui les risques qu’elles présentent pour notre système d’aides à la presse. Une nouvelle proposition de rédaction est maintenant en discussion, sur laquelle nous pouvons nous accorder et à laquelle le Gouvernement semble prêt à se rallier, compte tenu de certaines précisions complémentaires. En tout état de cause, c’est bien sur l’initiative de nos collègues de la commission de la culture que ce débat aura été engagé, ce qui témoigne, là encore, de notre engagement à tous.
Compte tenu de l’importance du sujet, mes chers collègues, je crois que nous avons l’obligation de trouver le meilleur accord possible, qui respecte à la fois notre volonté d’aider la presse tout en respectant nos obligations européennes sans fragiliser l’édifice de notre dispositif d’aides à la presse. Rappelons à quel point ce secteur est à la fois précieux et fragile. C’est ce que n’ont cessé d’affirmer le rapporteur du Sénat et le rapporteur de l’Assemblée nationale, et il faut leur faire confiance.
Si nous sommes capables d’avancer ensemble sur ces deux sujets, nous serons très proches d’un accord qui montrera que la représentation nationale est unie pour aider la presse. Plus que jamais, dans ce domaine, nous avons besoin de ce message d’unité pour témoigner de notre détermination à protéger la liberté d’expression et les valeurs de notre démocratie.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte nous rassemble aujourd’hui, au-delà de nos clivages politiques, pour légiférer sur plusieurs sujets concernant le secteur de la presse. Qu’il s’agisse de la distribution de la presse, du fonctionnement de l’Agence France-Presse ou du développement d’une offre solidaire, cette proposition de loi permet plusieurs avancées. J’exprimerai cependant quelques réserves, tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, notre groupe déplore les conditions d’examen de ce texte. Du fait de l’engagement de la procédure accélérée et d’une inscription tardive à l’ordre du jour de nos travaux, notre rapporteur, comme il l’a souligné en commission, n’aura eu que trois semaines pour étudier les articles et organiser les auditions des acteurs du secteur, ce qui est bien peu au regard de la technicité des thèmes traités.
La procédure accélérée est devenue nécessaire à partir du moment où le Gouvernement a pris du retard pour mettre en conformité notre droit avec les observations de la Commission européenne en matière de concurrence, ce qui fait qu’il se trouve au pied du mur, comme cela est déjà arrivé à plusieurs reprises. Je pense notamment à un récent projet de loi dont je suis la rapporteur, qui transpose de façon très tardive des directives européennes sur les droits d’auteur et les œuvres orphelines.
Ce sont des méthodes qui ne respectent ni le Parlement ni l’ampleur des enjeux.
Sur le fond, je regrette que, face à la crise que traverse l’ensemble de la chaîne de la presse, le Gouvernement ne propose que des ajustements aux dispositifs existants, loin de la grande réforme attendue. Madame la ministre, vous avez toutefois annoncé un projet de loi à venir.
Depuis les états généraux de la presse décidés par le précédent gouvernement, qui ont dressé un état des lieux de la chaîne de la presse avec l’ensemble des professionnels, les rapports se sont succédé : érosion et vieillissement du lectorat, chute des ventes et des recettes liées à la publicité et aux annonces, déstabilisation du réseau de distribution, réduction du nombre de points de vente, manque d’adaptation au numérique... Les défis sont multiples.
Il devient urgent de réaliser une réforme globale permettant à la presse de s’adapter à de nouvelles pratiques, car les effets de la crise s’amplifient depuis 2012, avec une baisse de la vente au numéro de plus de 12 % sur l’année 2013 et de 3, 52 % entre janvier et octobre 2014, selon le rapport législatif de Michel Françaix à l’Assemblée nationale. En chiffres d’affaires, la baisse du marché a été de plus de 25 % sur la période 2009-2013.
Aussi, nous nous interrogeons sur les projets du Gouvernement en la matière et serons particulièrement attentifs à vos déclarations, madame la ministre.
Certes, cette proposition de loi ne correspond pas à l’ampleur des attentes, mais le groupe UMP la soutiendra, car elle présente plusieurs dispositions équilibrées et pragmatiques.
Le texte a été encore enrichi en commission. Je tiens à féliciter notre rapporteur de la qualité de son travail et de son écoute. Je rappelle en particulier l’importance des amendements relatifs à l’AFP visant à modifier les règles de gouvernance.
Le texte initial reprenait déjà plusieurs dispositions issues d’une proposition de loi de Jacques Legendre, déposée en 2011, mais jamais inscrite à l’ordre du jour de nos travaux. Il s’agit notamment de l’ouverture du conseil d’administration à des personnalités qualifiées pour coller davantage à la réalité de l’AFP et de la prolongation du mandat du président de l’AFP pour lui permettre de mener à bien ses projets de réforme.
Monsieur le rapporteur, vous avez demandé la présence de personnalités qualifiées pouvant « justifier d’une véritable expérience au niveau européen ou international », ce que j’approuve entièrement. Vous êtes allé bien plus loin encore : constatant la faiblesse des instances de direction, vous avez créé une véritable « commission de surveillance » à partir de la fusion du conseil supérieur et de la commission des finances, jusque-là assez démunis. Il s’agit donc d’une garantie de contre-pouvoir et de vérification des résultats d’autant plus nécessaire que l’AFP n’est pas épargnée par la crise. J’espère que les députés nous suivront sur ce point.
J’en viens à la distribution de la presse. Je pense que la proposition de loi, qui s’appuie sur le dispositif créé par la loi du 20 juillet 2011, dont Jacques Legendre est également à l’initiative, renforcera encore la régulation du secteur.
Je profite de ce sujet pour vous interroger, madame la ministre, sur le rapport Jevakhoff, du nom de son auteur, inspecteur général des finances, remis l’été dernier au Gouvernement. Ce rapport n’a pas été rendu public et rien ne permet de dire qu’il le sera, tant il semble avoir créé une certaine confusion en préconisant la fusion entre les deux messageries de presse existantes et la redéfinition de leurs missions, avec un sous-traitement de la dimension logistique. S’il est évident que le Gouvernement n’est pas prêt à suivre les mesures radicales préconisées par ce rapport, celui-ci comporte-t-il des pistes que vous pourriez suivre ?
J’évoquerai enfin les aides qui peuvent être apportées à la presse, notamment par des participations de citoyens. Trois amendements ont été déposés. Je défendrai l’un d’eux, qui tend à encourager par une défiscalisation l’aide financière qui serait apportée à des entreprises de presse par des particuliers ou des entreprises.
Comme nous le verrons tout à l’heure, nos propositions divergent quant à leur portée, puisqu’il pourrait s’agir soit de souscriptions au capital, soit de dons ou de bonifications d’emprunt. Néanmoins, ces amendements révèlent un véritable consensus pour développer ce type de soutien. L’utilité des dons à Charlie Hebdo pour soutenir le pluralisme de la presse est venue illustrer la nécessité d’encourager cette forme d’aide, et nous espérons rencontrer l’assentiment du Gouvernement.
Notre groupe apportera bien évidemment son vote à ce texte, qui va dans le bon sens. Il invite le Gouvernement à se saisir rapidement des problèmes récurrents rencontrés par la presse, car à la réflexion doit un jour succéder l’action.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Comme vous l’avez souligné, madame la ministre, ce débat intervient alors que notre pays vient de connaître un moment de douleur et d’émotion après avoir été frappé au cœur, après cette attaque contre la liberté de la presse.
Nous sommes trop peu nombreux à nous intéresser à la liberté de la presse dans les assemblées parlementaires. Pour ma part, lors de la réforme constitutionnelle de 2008, j’avais déposé un amendement tendant à préciser que la loi fixe les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ». Si le Sénat l’a adopté, c’est parce que nous connaissons dans cette enceinte l’importance du mot « liberté », qui se concrétise avant tout par la liberté de la presse.
Charlie Hebdo en est le symbole. Ce journal a été attaqué, dénigré par des gens qui pensaient souvent avoir de bonnes intentions. Pourtant, les mêmes ne se sont pas trop émus lorsque ses locaux situés dans le XXe arrondissement ont été brûlés et certains se sont même demandé si ces journalistes n’en avaient pas un peu trop fait, s’ils ne l’avaient pas mérité.
Je veux rendre hommage à ce journal engagé. Par le dessin, par l’humour, il a toujours répondu présent lorsqu’il s’est agi de lutter pour la liberté et contre le racisme. Contrairement à ce qui a pu lui être injustement reproché, il n’a jamais cédé un pouce sur ce terrain ! Ne mélangeons pas tout : en France, on est libre de critiquer comme Charlie – c’est autorisé par la loi –, mais on n’a pas le droit d’être raciste ou antisémite, c’est puni par la loi ! Comme la confusion a très souvent été faite dans le débat public, je tiens à rappeler cette distinction.
Dans ce contexte, la proposition de loi a un sens, même s’il s’agit juste de corriger quelques archaïsmes. En disant cela, je ne remets pas en cause la loi Bichet et la loi définissant le statut de l’AFP, qui ont représenté de grandes avancées pour la liberté de la presse ; je veux simplement dire qu’il faut adapter au monde du XXIe siècle certaines procédures et organisations, qui ne permettent plus de faire vivre les valeurs fondamentales que portent ces textes. Jacques Legendre et moi-même, en qualité de rapporteur, avions commencé à le faire. Nous poursuivons cette œuvre avec la proposition de loi déposée par Michel Françaix à l’Assemblée nationale.
La proposition de loi qui nous réunit cet après-midi aborde des sujets très variés, qui, une fois n’est pas coutume, font globalement consensus dans nos assemblées. Il faut dire que les différents dispositifs proposés sont placés sous le signe de l’urgence : une urgence de nature économique et européenne au départ, qui s’est récemment mue en une urgence politique et éthique à la suite des événements dramatiques que nous venons de connaître.
Nous ne pouvons pas laisser le droit qui consacre la liberté de la presse, qui se niche souvent dans les détails, contesté par les faits. D’aucuns considéreront que nous nous préoccupons de détails alors qu’il y a tant à faire pour la presse. Il faudra en effet se pencher sur la crise que traverse la presse aujourd'hui, notamment sur les aides et sur leur conditionnement – Mme la ministre s’y est engagée devant nous – et remettre beaucoup de choses à plat afin que la liberté de la presse puisse perdurer à l’heure de la révolution numérique et être protégée par nos lois.
Madame Mélot, vous déplorez le recours à la procédure accélérée pour l’examen de la présente proposition de loi. Ne sombrons pas dans le ridicule : ce texte est venu en discussion à l’Assemblée nationale dans le cadre de la niche parlementaire socialiste. Nous avons de la chance qu’il arrive jusqu’à nous aujourd'hui, car ce n’est pas toujours le cas. Si nous n’allons pas assez vite ce soir, nous devrons attendre la niche socialiste du mois prochain pour voter la proposition de loi au Sénat. Imaginez qu’il y ait en plus deux navettes, nous y serons encore dans un an ! S’il nous fallait autant de temps pour faire face à l’urgence, nos concitoyens pourraient considérer que nous ne sommes pas à leur écoute, pas dans le coup.
Il m’arrive parfois à moi aussi de déplorer le recours à la procédure accélérée pour des textes portant sur l’organisation de notre société ou sur l’organisation territoriale et qui comptent des dizaines et des dizaines d’articles. J’estime en effet qu’il est bien de pouvoir consacrer du temps au débat et d’avoir du recul, ce que permettent plusieurs navettes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je défends le Sénat. Mais, en la circonstance, je pense très franchement que votre critique est juste une posture.
J’en viens à la situation de l’AFP.
L’information dans le monde étant un enjeu fondamental, nous avons la chance de compter en France l’une des trois grandes agences de presse de rang mondial et la seule agence européenne dans cette compétition internationale. Dans tous les autres domaines, qu’il s’agisse de l’audiovisuel ou d’internet, beaucoup de choses nous échappent ou s’imposent à nous dans le cadre de rapports de force difficiles à relever face à des géants, tels que Google, qui détiennent les tuyaux. Nous devons donc absolument faire en sorte que l’AFP demeure le joyau que nous connaissons.
Les propositions de modernisation que nous faisons ne remettent pas en cause, contrairement à ce que certains disent, le statut spécifique de l’AFP, qui lui donne sa puissance. Au contraire, elles lui permettront de répondre à des impératifs, que ce soit pour son développement ou pour faire face à des injonctions européennes, qui sont concrètes et qu’on peut parfois combattre, mais ne jamais ignorer sous peine d’être balayé.
Le point de non-retour a été atteint lors du dépôt, en août 2011, d’une plainte devant la Commission européenne, saisie par l’agence de presse allemande – c’est normal, ce sont des concurrents, pourquoi s’en priveraient-ils ? –, qui remettait en cause la légalité du système français de financement de l’Agence par abonnements de l’État. Ce système aboutissait à financer l’Agence à près de 40 % par le biais de ces abonnements, qui constituaient, de fait, des subventions déguisées – 115 millions d’euros annuels pour 350 abonnements, contre 3, 75 millions d’euros pour les abonnements du gouvernement allemand. Les Allemands ont estimé qu’il y avait concurrence déloyale.
L’État a heureusement reçu l’aval de Bruxelles sur son projet de schéma clarifiant les relations entre l’État et l’AFP, lequel devrait trouver une traduction dans le COM 2014-2018 qui sera signé très prochainement. Il était primordial de trouver une solution pour conforter la situation financière de l’AFP, désormais, je le répète, seule agence de presse internationale européenne face aux deux autres grosses agences dans le monde.
Je me suis saisi de la question de la gouvernance de l’Agence depuis plusieurs années. Ainsi, en novembre 2010, alors rapporteur pour avis des crédits destinés à la presse, je m’inquiétais déjà en ces termes : « […], plus de 81 % des membres du conseil d’administration sont des représentants des clients potentiels de l’Agence. En raison de leur origine et de leurs activités, ils ne peuvent être considérés comme à même d’incarner et de défendre l’intérêt supérieur de l’Agence. » Dès lors que le client siège au conseil d’administration, il ne peut fixer des prix désintéressés. Une telle situation n’était financièrement pas favorable à l’Agence.
Après des années de réflexion, nous sommes sur le point de parvenir à une modification statutaire, grâce à l’initiative législative des députés socialistes, que je tiens à saluer.
Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par Mme la ministre et par M. le rapporteur, qui a fait dans le peu de temps qui lui était imparti un excellent travail, dont je salue la précision. J’évoquerai simplement le second objet du texte : la distribution de la presse.
Le texte que nous examinons aujourd'hui vient après un travail que, encore une fois, Jacques Legendre et moi-même avons effectué et qui a permis des avancées. Il s’agit aujourd'hui de les préciser et de les conforter. Alors qu’on nous avait dit à l’époque que les réformes que nous souhaitions mettre en œuvre entraîneraient des catastrophes, chacun s’accorde aujourd'hui à dire que nous avons bien fait de nous engager sur ce terrain. Il aura donc fallu lutter contre quelques frilosités et aussi lever certaines préventions, parfois justifiées, compte tenu du contexte difficile du secteur de la distribution. Je rappelle que la révolution numérique a touché de plein fouet les personnels du secteur de la distribution de la presse, tel Presstalis, alors que leurs métiers se sont longtemps développés, qu’ils bénéficiaient d’un statut et d’acquis. Je pense que nous avons pas mal avancé sur cette question, tout en respectant les uns et les autres et en préconisant la négociation.
Aujourd'hui, je souscris entièrement aux propositions du Gouvernement. Nous étudierons les précisions apportées par M. le rapporteur lors de l’examen des amendements. Si nous en soutenons quelques-unes, nous sommes plus prudents sur d’autres, voire opposés à certaines, mais, dans tous les cas, elles ne remettent pas en cause la réforme proposée par l’Assemblée nationale sur le fond.
Pour terminer, je veux aborder deux sujets, ce qui me permettra d’être bref lors de l’examen des amendements. Je souhaite en effet que le texte puisse être voté ce soir avant vingt heures. Pour cela, il nous faudra ne pas défendre trop longuement nos amendements, lesquels ont déjà été largement débattus en commission.
Le premier concerne la possibilité pour les journalistes d’accompagner les parlementaires lorsque ceux-ci visitent une prison, comme la loi leur en donne le droit. Quand les parlementaires visitent des prisons, ils le font avec sérieux ! De plus, il est toujours un peu hypocrite d’interdire aux journalistes de venir. Quand ils le veulent, les journalistes nous attendent à la sortie et nous leur racontons. Il arrive aussi que des détenus transmettent aux journalistes des images – cela s’est produit dernièrement aux Baumettes. Cette vidéo réalisée par des prisonniers, qui peuvent mettre n’importe quoi ou couper ce qu’ils auront voulu, se retrouve ensuite sur toutes les chaînes d’information.
Il vaut mieux que des journalistes, qui ont une déontologie et qui sont tenus au respect d’une éthique, puissent nous accompagner. Cette transparence, encadrée, me semble préférable. Je ne comprends donc pas pourquoi la commission a souhaité supprimer cette disposition que prévoyait la proposition de loi. L’un de mes amendements vise à la rétablir.
Le deuxième sujet a trait à un combat qui tenait à cœur à Charb, un combat qu’il a mené avec fougue, sur la possibilité d’une défiscalisation pour l’actionnariat dans les entreprises de presse d’information générale et politique. Nous aurons l’occasion d’en débattre tout à l’heure. En attendant, je suis content qu’une telle mesure fasse consensus.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui – malheureusement, dirai-je – tombe à point nommé, après les terribles événements que nous venons de connaître, même si l’origine de ce texte et les ajouts apportés par l’Assemblée nationale en décembre sont antérieurs à l’attentat survenu le 7 janvier dernier à Charlie Hebdo.
Ce texte, sur le fond, est opportun parce qu’il apporte quelques réponses à la crise de la presse écrite qui s’est accentuée ces dernières années et parce qu’il sécurise la situation de l’AFP. À petites touches, il a l’avantage de proposer des améliorations à notre système d’aides qui, à force de stratifications successives, manque de lisibilité et, surtout, de cohérence, au point de perdre souvent de vue les finalités assignées au soutien accordé à ce secteur si particulier – particulier en ce qu’il participe, au premier chef, au pluralisme de l’information et du débat public.
On peut certes s’étonner de la part belle faite dans ce texte à la question de la distribution et de la diffusion des titres. Il est bon de rappeler que, depuis la Révolution française, le législateur a toujours, et à juste titre, attaché un intérêt majeur au fait de rendre le plus large possible l’accès des citoyens à l’information. La liberté d’expression ne serait en effet que peu de chose sans une pleine liberté de circulation des idées et, donc, de la presse.
Il est, en revanche, juste de s’interroger quand on analyse le prévisionnel budgétaire pour 2015 et que l’on constate que ces aides à la diffusion représentent près des deux tiers des aides directes accordées à la presse, hors AFP. Notons, de plus, que l’attribution de ces aides, comme la plupart des autres aides, ne tient pratiquement pas compte de la nature et de l’apport informatif spécifiques de chacun des supports.
Vous l’avez compris, je n’évoquerai pas ici l’ensemble des points qui composent ce texte ; nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des amendements. Pour synthétiser les choses, je dirai simplement que le groupe écologiste du Sénat considère que, globalement, ce texte constitue une avancée et, à moins que des amendements qui en altéreraient l’esprit ne soient adoptés, nous voterons en sa faveur.
Je veux plutôt profiter du temps de parole qu’il me reste pour revenir sur certains fondamentaux supposés présider à l’attribution d’aides publiques à la presse et qui, au regard de la réalité des choses, nous enjoignent de repenser prestement notre système d’aides actuel.
Pourquoi aide-t-on la presse – en l’occurrence, ici, les entreprises de presse ? Cette question est, elle aussi, légitime, car nous évoluons dans un système économique à dominante toujours plus libérale et que nous aidons, en l’espèce, des entreprises qui appartiennent toutes au secteur privé. Les aide-t-on simplement comme on aide d’autres entreprises du secteur marchand, parce qu’elles créent de l’emploi ou qu’elles sont menacées d’en perdre sous l’effet de la concurrence internationale ? C’est en partie probable, mais en partie seulement, car, lorsqu’on met en vis-à-vis le volume élevé d’aides accordées et la taille assez réduite de ce secteur en termes d’emplois ou de chiffre d’affaires, on se doute bien que ces aides relèvent de raisons qui ne sont heureusement pas strictement économiques. Non, si nous aidons la presse écrite, c’est en premier lieu au nom du pluralisme et de la diversité de l’information, qui enrichissent la vivacité du débat dans notre pays !
Voilà pour le principe ! Car, dans les faits, lorsqu’on étudie en détail, titre par titre, le global des aides perçues par chacun d’eux, il y a parfois de quoi tomber de sa chaise !

Rendons grâce d’ailleurs à l’actuel gouvernement qui, à défaut d’avoir pour l’instant osé remettre à plat le mécanisme d’attribution de ces aides, a engagé depuis 2012 une opération de transparence en rendant publiques les sommes allouées à chacun des deux cents titres les plus aidés. Je vous encourage fortement, mes chers collègues, à en prendre connaissance. Vous réaliserez l’injustice souvent flagrante du système actuel ou, tout au moins, l’aberration de certains des critères retenus au regard des preux objectifs affichés.
Permettez-moi d’en citer juste quelques exemples : en 2013, le magazine Télé Star, au douzième rang en volume d’aides perçues, devance l’hebdomadaire Le Point, au quatorzième rang ; mieux encore, Le Canard enchaîné, au quatre-vingt-sixième rang, se place après Gala et Point de vue et précède à peine, avec 4 500 euros d’aides en plus, Le Journal de Mickey et Closer. Et les hebdomadaires d’information sans publicité comme Politis sont totalement pénalisés !
Mais prenons, pour finir, le cas de Charlie Hebdo. Ce titre, en très grande difficulté financière jusqu’à peu et qui est aujourd’hui brandi comme notre étendard national de la liberté d’expression, comme un symbole de l’attachement de notre République à la laïcité, n’apparaît pas dans le classement des deux cents titres les plus aidés en 2012-2013. Les seules misérables aides dont Charlie Hebdo a bénéficié ces dernières années relevaient des aides automatiques dont jouissent l’ensemble des titres de presse, quel que soit leur objet. Il existe bien une ligne spécifique dans le budget de la culture et de la communication de la France, intitulée « Aides au pluralisme », mais elle n’est dotée que de 11, 4 millions d’euros et concerne exclusivement les quotidiens et la presse régionale.
Les écologistes se battent depuis des années pour que soit engagée dans notre pays une réforme profonde des aides à la presse. Ces dernières semaines, le Président de la République a eu le courage de réaffirmer, haut et fort, notre attachement à la liberté d’expression et aux valeurs de la république ; il a aussi lancé un appel public à idées pour réformer notre pays. Nous avons ici, à la faveur horrible des événements récents, l’occasion d’opérer une remise à plat allant au-delà du texte qui nous est soumis aujourd’hui. Nous n’avons pas le droit d’esquiver cette invitation !
Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme cela a été dit par tous les orateurs qui m’ont précédé, cette proposition de loi intervient dans un contexte douloureux qui nous a rappelé tragiquement que la liberté de la presse est plus que jamais un combat. Les millions de manifestants en France et dans le monde ont dénoncé les attaques inadmissibles contre Charlie Hebdo et se sont rassemblés pour affirmer leur attachement à cette liberté de pensée et d’expression.
Dans ces conditions, au lendemain de ces attentats terroristes, se pose à nous, législateurs, la question de savoir comment garantir encore mieux l’existence d’une presse d’information libre et indépendante. Cela passe par la défense sans faille des principes et des moyens de cette information libre et pluraliste, par la défense de chaque titre menacé – il y en a tous les jours, et je pense à La Marseillaise ou à Nice-Matin, repartis provisoirement mais dont on sait que les difficultés demeurent –, par la promotion des valeurs et la défense des savoirs, de la connaissance, de la culture, de la création et de l’information pour lutter contre l’ignorance et la censure.
La liberté, surtout celle de la presse, n’est rien sans la garantie matérielle de ses conditions d’existence. Or la presse connaît une crise très grave, une crise de la vente, singulièrement de la presse papier, et du pluralisme qui, l’un comme l’autre, ne cessent de s’éroder.
Cette proposition de loi reste très partielle comparée à tous les enjeux qu’il serait nécessaire d’aborder. Elle n’est pas l’ambitieux projet d’ensemble dont la presse et le droit à l’information ont besoin dans ce pays. Elle s’attache à des dispositions particulières.
Concernant la distribution de la presse, qui est toujours garantie en France par la loi Bichet de 1947, cette proposition de loi s’inscrit dans les principes de cette loi tout en tentant d’améliorer encore la gouvernance du système coopératif.
L’application du principe de solidarité interprofessionnelle est difficile. Dans la situation actuelle de repli général du marché, l’existence de deux messageries reste une difficulté du secteur, notamment pour ce qui est de la distribution des quotidiens. Ce texte propose de nouveaux ajustements du mode de gouvernance des systèmes coopératifs de presse. Nous nous félicitions, pour notre part, de la réaffirmation dans la loi du principe de solidarité ainsi que de l’évocation qui est faite, en l’absence de coopération totalement harmonieuse des deux messageries, d’une possibilité de mutualisation renforcée entre les sociétés de messagerie de presse. Nous continuons cependant à penser qu’il faudrait aller plus loin, en prévoyant et en organisant la fusion de ces deux coopératives en une structure unique de distribution de la presse. Ce serait nettement plus efficace et rationnel dans les conditions que nous connaissons aujourd’hui. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous sommes plus réservés sur la disposition visant à créer une exception à la clause d’exclusivité des réseaux de distribution des messageries.
Concernant l’AFP, qui se trouve elle aussi affaiblie et en situation difficile alors qu’elle représente un bien précieux pour l’information en France, plusieurs tentatives de réforme ont émergé qui, sous prétexte de modernisation de l’Agence, ont tenté de mettre en cause son statut unique et son indépendance, qu’il convient plus que jamais de protéger.
Aujourd’hui, le débat rebondit en lien avec une décision de la Commission européenne, qui a été saisie d’une plainte d’une agence de presse allemande concernant les aides accordées par l’État français à l’AFP, qui seraient, paraît-il, contraires aux règles de la concurrence. La Commission a néanmoins admis – c’est un point positif – la nécessité de ces aides, reconnaissant le caractère d’intérêt général des missions de l’AFP. Elle demande cependant l’adoption d’une série de mesures, dont la distinction dans les versements de l’État entre compensation des missions d’intérêt général et paiement des abonnements commerciaux, en prenant un acte normatif qui matérialiserait l’obligation pour l’AFP de filialiser et développer les activités autres que celles d’intérêt général.
La proposition de loi admet les conséquences de la requête de la Commission européenne. Cela nous inquiète, car l’activité de l’AFP relève, à nos yeux, entièrement d’une mission d’intérêt général. Les dispositions que prévoit le texte ouvrent donc une fragilité, sur laquelle notre vigilance sera totale. Distinguer dans les comptes de l’AFP certaines activités, c’est introduire une fragilisation dans laquelle des forces qui voudraient mettre en cause l’indépendance et la pérennité de l’Agence pourraient s’engouffrer. Nous serons donc vigilants sur ce point et proposerons une série d’amendements qui renforcent et protègent les garanties du statut de l’Agence.
Je termine mon propos en évoquant une disposition, essentielle à nos yeux, qui est venue s’ajouter en cours de discussion : je veux parler de ce que nous appelons désormais « l’amendement Charb ».
Nous avions déjà proposé une telle mesure lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, après avoir été saisis par Charb lui-même, à une époque où il s’inquiétait de l’existence de Charlie Hebdo, qui, au mois de décembre dernier, était loin d’être assurée. Nous avons donc déposé à nouveau ce texte sous forme de proposition de loi, tout de suite après les événements.
Il s’agissait, dans notre esprit, non seulement de rendre hommage aux victimes des attentats survenus à Charlie Hebdo, mais plus fondamentalement de nous inscrire dans le souhait de Charb de conforter les mécanismes de soutien à la presse, en particulier en favorisant la possibilité de défiscalisation des dons émanant de particuliers effectués au bénéfice d’associations ou de fonds de dotation exerçant des actions pour le pluralisme de la presse.
Cette pratique ne repose aujourd’hui que sur un simple rescrit fiscal, de valeur inférieure à la loi. Cette disposition apportera donc, si elle est adoptée, un surcroît de sécurité juridique, sans aucune incidence financière pour l’État.
Évidemment, si notre assemblée tout entière pouvait se rassembler autour de cette mesure, ce serait un beau symbole de défense de la liberté d’expression et du pluralisme. Nous le souhaitons vivement.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – MM. André Gattolin et David Assouline applaudissent également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la liberté d’expression a été évoquée ce matin, dès le début de sa conférence de presse, par le Président de la République à propos des événements qu’a connus la France au début du mois de janvier avec la tragédie qui s’est produite dans les locaux du journal Charlie Hebdo. En 1789, la liberté de la presse était l’une des doléances les plus fréquentes, après celles qui concernaient les taxes et l’autorité politique des États généraux.
Plus de deux cents ans plus tard, celle qui est aussi appelée le « chien de garde de la démocratie », la presse, est confrontée à une crise majeure, qui touche quasiment tous les fondements de son édifice.
Cette crise est d’abord économique : face à la mutation du lectorat et à l’émergence de nouvelles sources d’accès à l’information, souvent gratuites, la presse écrite traditionnelle a bien du mal à tirer les marrons du feu et à convaincre de son utilité. Et pourtant…
Il s’agit ensuite d’une crise de confiance. Au mois de janvier 2014, une enquête IPSOS soulignait que, alors que seuls 21 % des Français déclarent ne pas avoir confiance dans l’armée ou 32 % dans l’école, ce pourcentage s’élève à 77 % pour ce qui concerne les médias. C’est un signe de défiance envers un traitement de l’information qui est parfois considéré, non sans raison, comme partial. Cette crise de confiance menace notre pacte républicain, puisque, avec la révolution numérique, elle laisse une place béante à la désinformation, voire à l’obscurantisme. Les événements qui ont eu lieu au début du mois dernier en témoignent dramatiquement.
Face à cette crise structurelle, tout l’enjeu réside donc dans la transformation de ce processus de destruction programmée en innovation créatrice. Car la révolution informationnelle, elle, est incontournable.
À ce titre, la proposition de loi soumise à notre examen, enrichie par la commission de la culture, ébauche une réflexion intéressante, bien qu’incomplète, sur la régulation du secteur. La réforme du fonctionnement du Conseil supérieur des messageries de presse ainsi que l’homologation des barèmes par ce dernier doivent permettre un plus grand respect des principes de transparence et de péréquation des coûts de distribution des quotidiens.
À l’heure où la presse écrite subit de plein fouet une baisse drastique de ses ventes, le mécanisme de péréquation inter-coopératives visant le financement de la distribution de la presse quotidienne nationale est plus que jamais en difficulté. Comme l’a fait remarquer le président de l’ARDP, il est largement détourné, dans la mesure où « les éditeurs les plus puissants entrent dans une stratégie de chantage avec les messageries afin d’obtenir les tarifs les plus avantageux, au détriment des éditeurs les plus modestes et les moins influents ».
Dans le même fil, nous saluons la création d’un statut d’entreprise solidaire de presse d’information, qui permettra de développer des modes de gestion à la fois démocratiques et participatifs au sein des organes de presse. Ce statut encouragera l’émergence de nouveaux titres et favorisera leur viabilité en permettant de lever les fonds nécessaires au démarrage et à la pérennisation de leur activité. Il s’agit donc aussi d’une mesure en faveur du pluralisme de la presse
Par ailleurs, la présente proposition de loi encadre strictement l’utilisation des bénéfices : une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice est affectée à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise. De plus, une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice devra être affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire. Cette mesure resterait toutefois lettre morte si le Gouvernement ne s’était pas engagé à l’accompagner d’un volet fiscal destiné à rendre plus attractive la participation des lecteurs à des projets innovants ou la reprise d’entreprises en difficulté par le biais de financements participatifs.
Enfin, le texte réforme la gouvernance de l’AFP issue de la loi de 1957. Forte de plus de 2 000 journalistes et techniciens, d’un chiffre d’affaires de 287, 8 millions d’euros en 2013 dont 40 % proviennent d’abonnements de l’État, l’AFP dispose de l’un des réseaux les plus complets et les plus maillés au monde. Tous les journaux français sont abonnés à l’AFP. Les difficultés de cette agence sont donc aujourd’hui principalement liées à son financement et à son mode de gouvernance. L’ouverture du conseil d’administration à des personnalités qualifiées et à l’international, l’instauration du principe de parité, la création d’une commission de surveillance qui cumulerait les compétences en matière de déontologie du conseil supérieur et la compétence financière de la commission financière engagent une évolution significative de l’AFP, dont les statuts de 1957 ont fait leur temps.
Si nous estimons qu’elle ne va pas assez loin pour permettre de parler de modernisation véritable du secteur de la presse – en particulier, le système d’aides à la presse nous semble aujourd’hui dépassé, et le rôle du numérique dans l’information citoyenne nous paraît incontournable –, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui amorce une politique des petits pas constructive et utile, que les membres du groupe du RDSE approuveront.
M. André Gattolin applaudit.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l’infamie qui a frappé la liberté de la presse et notre pays, les orateurs précédents s’étant exprimés sur ce sujet. Mais je m’associe à leurs propos.
Chacun le sait, la presse écrite traverse aujourd’hui une crise majeure. Effondrement des ventes, vieillissement du lectorat, diminution du nombre de points de vente, raréfaction des recettes liées à la diffusion – publicité, annonces : je n’insisterai pas sur chacun de ces maux, dont les précédents intervenants ont déjà fait état.
Si elle n’en est peut-être pas la cause première, l’émergence du numérique a bien sûr très brutalement accentué le déclin de la presse écrite. La transition de celle-ci vers le numérique lui impose une mue profonde et, pour ce faire, elle doit être accompagnée.
C’est dans cet esprit que la commission a permis au fonds « presse et pluralisme » de concourir à des actions de développement numérique et de modernisation technologique de la presse.
Mais, plus globalement, la situation actuelle pose trois questions principales très concrètes.
La première concerne les aides publiques à la presse. Faut-il les restructurer ? Dans l’affirmative, selon quels principes directeurs ?
C’est tout l’objet du rapport Cardoso, de 2010, qui a jeté un véritable pavé dans la marre, en révélant l’importance des aides directes qui placent les journaux sous perfusion publique. Dans ce rapport, quinze propositions sont formulées. Si elles étaient mises en œuvre, elles constitueraient une réforme authentiquement structurelle du secteur.
La deuxième question centrale à laquelle il faut bien répondre si l’on veut moderniser le secteur porte sur la messagerie, c’est-à-dire le système de diffusion de la presse papier. En réalité, elle est intrinsèquement liée à la première, puisque le soutien à la distribution représente l’essentiel des aides publiques à la presse, soit plus de 80 % du total des aides budgétaires prévues par la loi de finances pour 2015.
Encore une fois, cela a été dit, la principale messagerie de presse, Presstalis, ex-NMPP, se trouve dans une situation financière très difficile. Son déficit est structurel.
L’un des problèmes bien identifiés est dû au fait que le système de distribution fait coexister deux coopératives, Presstalis et les Messageries lyonnaises de presse, les MLP, qui, au lieu de se compléter, se concurrencent. C’est pourquoi le rapport commandé par le Gouvernement à Alexandre Jevakhoff et Daniel Guérin préconise la fusion des deux messageries. Mais à quel prix ? Une telle fusion se traduirait en effet par de nouvelles coupes massives dans les effectifs cumulés des deux coopératives d’éditeurs. Le sujet est à ce point sensible que le rapport n’a pas été publié, comme l’a souligné Mme Mélot. De lourdes décisions devront par conséquent encore être prises.
La dernière question relative à la modernisation du secteur de la presse tient à sa régulation et à sa gouvernance.
C’est sur ce point que se concentre la proposition de loi, dont nous ne pouvons que soutenir résolument les dispositions.
Certaines mesures ne sont pas nouvelles pour le Sénat, puisqu’elles reprennent celles d’une proposition de loi de Jacques Legendre résultant elle-même des travaux de la commission.
Si le présent texte est encore plus directement issu du rapport de notre collègue député Michel Françaix, il a aussi été très substantiellement amélioré par la commission, sous la houlette de son rapporteur, Philippe Bonnecarrère, dont je tiens à saluer l’excellence du travail, ce avec d’autant plus de fierté qu’il appartient au groupe UDI-UC, au nom duquel je m’exprime aujourd’hui.
Sur le fond, la proposition de loi a deux objets principaux : réformer la régulation du système coopératif de distribution de la presse et moderniser la gouvernance de l’AFP.
Pour ce qui concerne la régulation de la distribution, nous ne pouvons que soutenir l’orientation générale du texte qui, tout en maintenant la répartition bicéphale des rôles entre le CSMP et l’ARDP, renforce les pouvoirs de cette dernière.
En particulier, l’article 1er opère la traduction législative du principe de péréquation. Son apport principal vise l’homologation des barèmes. À ce sujet, le travail de M. le rapporteur a été déterminant, puisque l’homologation des barèmes est désormais confiée à l’ARDP, et non plus au CSMP comme le prévoyait le texte initial, ce qui est beaucoup plus respectueux des impératifs de confidentialité des tarifs et des règles de concurrence.
L’article 7 permet d’envisager une réforme plus substantielle. Il ouvre la voie de la mutualisation des réseaux de distribution en donnant une base légale aux expérimentations de distribution des quotidiens nationaux par la PQR.
Quant à l’AFP, la proposition de loi n’a pas vocation à répondre aux difficultés les plus structurelles auxquelles l’Agence est aujourd’hui confrontée. Mais, en améliorant sa gouvernance, elle doit contribuer à lui donner les moyens humains et organisationnels de mieux le faire. Dans cet esprit, nous ne pouvons que nous féliciter du renforcement de l’expertise du conseil d’administration.
Là encore, M. le rapporteur a substantiellement amélioré le texte, en y faisant inscrire la précision en vertu de laquelle trois des cinq personnalités qualifiées qui intégreront le conseil d’administration pourront justifier d’une véritable expérience à l’échelon européen ou international. Cela concrétise l’objet même de la réforme.
Cependant, l’apport le plus important de la commission est à rechercher dans la structure même de la gouvernance de l’AFP. Le texte prévoit maintenant de fusionner le conseil supérieur et la commission financière en une véritable « commission de surveillance » de l’AFP. Il s’agit de constituer, au sein de l’entreprise, un réel contre-pouvoir au conseil d’administration et à son président. La nouvelle commission de surveillance contrôlera le conseil d’administration et discutera de sa stratégie. Sa création est soutenue par les actuels présidents du conseil supérieur et de la commission financière : il s’agit donc d’une mesure consensuelle, dont la mise en œuvre est une urgence à l’heure où l’AFP va devoir piloter un plan d’investissement sans précédent pour se moderniser.
En conclusion, je dirai quelques mots sur le titre III de la proposition de loi qui aborde la question du droit pour les parlementaires de visiter les lieux de privation de liberté accompagnés de journalistes. Élargir ce droit aux centres éducatifs dans le cadre du présent texte n’était pas des plus opportuns. La commission a donc bien fait de revenir sur cette disposition introduite par l’Assemblée nationale. De même, la création par la commission d’un filtre préalable – les visites nécessiteront l’accord de la commission compétente de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire – détermine un bon équilibre entre liberté de la presse et impératif de sécurité.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe UDI-UC soutiendront résolument cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, même si le titre de la proposition de loi que nous examinons est ambitieux, puisque le périmètre évoqué est celui de la modernisation du secteur de la presse, nous sommes tous conscients que ce texte n’épuise pas le sujet, loin de là.
Nous aurions sûrement pu donner plus d’ampleur à cette proposition de loi en procédant à l’étude et à l’ajout de mesures de nature à renforcer les différents segments de la presse, qui, quels qu’ils soient, font face aux mêmes défis – Mme la ministre l’a souligné –, eu égard à un lectorat qui s’étiole parfois et à des modes de lecture qui évoluent. Cependant, il fallait prendre en un temps rapide des dispositions pour conforter le rôle de l’AFP dans le contexte européen. Ce texte en est le vecteur. Il permettra de remplir nos obligations de ce point de vue ; c’est parfait.
J’en profite pour rendre un hommage appuyé aux femmes et aux hommes de l’AFP, avec lesquels j’ai travaillé au cours de fonctions antérieures. Pour eux, le soleil ne se couche jamais ; ils permettent la diffusion d’une information de source francophone partout dans le monde.
Si j’ai souhaité prendre la parole dans ce débat, alors même que je ne suis pas membre de la glorieuse commission de la culture, de l'éducation et de la communication – peut-être tiendrai-je donc des propos peu orthodoxes –, c’est pour évoquer deux sujets qui me sont chers.
L’un est lié à la rédaction même du texte, et plus précisément à son article 1er, tandis que l’autre a une visée plus prospective, sous forme d’appel au Gouvernement et aux parlementaires. Comme cela a été relevé, il reste encore bien des choses à dire et à élaborer.
Je m’arrêterai d'abord sur la refonte, ou plutôt, car « refonte » est un bien grand mot, sur l’ajustement du système coopératif, notamment en matière d’homologation des barèmes. Est traité le niveau central, mais je veux que nous réfléchissions également à la rémunération des distributeurs qui sont au contact du client. Cette profession souffre elle aussi énormément, et ne voit pas nécessairement de perspectives. Elle constitue pourtant un élément de maillage précieux, notamment dans les territoires ruraux, où les points de vente, qui associent plusieurs activités, constituent souvent le dernier commerce.
Pour maintenir ce maillage propre à assurer la pénétration de la presse, il conviendrait sûrement de réfléchir, je le répète, à l’amélioration de la rémunération des distributeurs. Ceux-ci représentent une chance pour les territoires. J’ai d'ailleurs lu que les repreneurs des enseignes Maison de la presse et Macpresse voyaient une véritable richesse dans le réseau de 1 200 points de vente qu’ils ont racheté à Presstalis. Un service de proximité – cet enjeu nous est cher dans un certain nombre de territoires – peut être assuré grâce à ce réseau.
S'agissant plus spécifiquement de la péréquation, qui est évoquée à l’article 1er de la proposition de loi, je constate, à la lecture du rapport, qu’elle est organisée entre les quotidiens, quels qu’ils soient, et les magazines. Faut-il retenir un champ aussi large que l’ensemble des quotidiens ? Ne faut-il pas restreindre la péréquation aux quotidiens d’information politique et générale, dans la mesure où ce sont principalement eux qui rencontrent des difficultés ? Entre 18 et 20 millions d'euros sont en jeu. Je tenais à soulever cette question.
Par ailleurs, il faudra naturellement repenser le système pour l’avenir. Certains ont évoqué ce que pourrait être, à terme, l’évolution des deux structures existantes. J’avoue ne pas avoir de religion définitive. Je sais que certains envisagent de distinguer une structure gérant plus particulièrement les flux chauds – les quotidiens et les hebdomadaires – et une structure dédiée aux flux froids – les journaux qui peuvent arriver à j+3 ou j+4 –, dont les impératifs ne sont pas forcément les mêmes. Je pense qu’il faut continuer à y réfléchir avec les acteurs dans les mois à venir.
Le second point que je souhaite évoquer n’est pas nécessairement lié à la présente proposition de loi, mais un texte peut servir de prétexte. Il s’agit de la situation d’une presse dont on parle moins. Chacun reconnaît l’apport de la presse d’information politique et générale à la vitalité de notre démocratie. Cependant, dans les régions, un certain nombre de titres y contribuent également : je veux parler de la presse dite « agricole et rurale ».

Derrière des titres qui fleurent bon nos terroirs, cette presse a souvent un contenu beaucoup plus large, qui traite de l’actualité nationale ou internationale.

Oui, par exemple, ou encore Terres de Bourgogne.
Outre cette presse agricole et rurale, la presse hebdomadaire régionale peut être d’un apport considérable. Les membres du Gouvernement utilisent d'ailleurs régulièrement ce vecteur pour s’adresser à certains lecteurs.
On a le sentiment que, de plus en plus, un fossé se creuse entre ceux qui relèvent du statut de la presse d’information politique et générale et les autres, alors même que tous font face aux mêmes défis. C’est sur ce point que je veux attirer votre attention, madame la ministre, mes chers collègues de la commission de la culture.
Un certain nombre de titres de la presse dite « spécialisée », mais qui ne l’est pas nécessairement au regard de son contenu, n’ont pas accès au fonds soutenant, par exemple, le passage au numérique et, par voie de conséquence, la modernisation. À partir de 2016, ce fonds sera réservé à la presse d’information politique et générale, mentionnée à l’article 39 bis A du code général des impôts. Il y a là une forme d’iniquité.
Certes, les territoires ruraux ne sont pas bien lotis en matière d’accès au numérique. Madame la ministre, je sais que, dans vos précédentes fonctions, vous avez œuvré pour améliorer cet accès, mais force est de le constater, nous aurions eu besoin que vous poursuiviez votre action pendant encore quelque temps, afin d’avoir une meilleure desserte. La presse des territoires ruraux mériterait elle aussi qu’on l’aide à relever les défis de demain.
Cela étant, la présente proposition de loi prévoit de créer le statut d’entreprise solidaire de presse d’information. Pourquoi ne pas réfléchir à d’autres catégories ? Pourquoi rester figé sur la distinction entre les titres d’information politique et générale et les autres ? Pourquoi ne pas envisager un statut de presse de territoire pour des titres qui ont un intérêt général ?
Je voulais soumettre ces quelques pistes de réflexion à la Haute Assemblée. Je sais que les questions que j’ai soulevées ne seront pas réglées ce soir, mais le rôle du Sénat est aussi d’éclairer l’avenir, de tracer des perspectives.
Après avoir voté mardi la proposition de résolution européenne du groupe CRC relative au traité transatlantique, je m’apprête à voter une proposition de loi du groupe socialiste. Peut-être devrais-je me surveiller… En même temps, j’ai été élu de façon indépendante, et c’est cette indépendance d’esprit que j’exerce aujourd'hui. Je pense ne pas déroger au mandat que m’ont confié les électeurs de l’Yonne en me ralliant au texte qui nous est soumis ce jour. Plaisanterie mise à part, nous faisons œuvre utile ; c’est bien là le principal.
Applaudissements sur certaines travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Titre Ier
Dispositions relatives à la distribution de la presse
L’article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l’approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d’assurer l’égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique, efficiente et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, y compris des surcoûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens et qui ne peuvent être évités.
« Dans le respect du secret des affaires, les barèmes des messageries de presse et ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation.
« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet un avis à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de la réception de la proposition tarifaire. Elle peut refuser d’homologuer des barèmes si elle estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte des observations formulées par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Si de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans le délai d’un mois à compter d’un refus d’homologation, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse détermine les barèmes applicables. »

Je souhaite profiter de l’examen de cet article pour évoquer la problématique du hors presse, qui échappe à l’application des barèmes coopératifs et de la péréquation prévue pour couvrir le surcoût lié à la distribution des quotidiens.
Il semble que passer de la catégorie « presse » à la catégorie « hors presse » s’avère très aisé. Il suffit, par exemple, d’être rangé dans la catégorie « assimilé librairie », « encyclopédie », « produit multimédia » ou de n’avoir qu’un nombre limité de parutions pour tomber dans le hors presse. Ce changement de catégorie permet au titre concerné d’échapper à l’application des barèmes et de rentrer dans une négociation de gré à gré, en s’exonérant de l’effort collectif en faveur de la distribution des quotidiens.
À travers la présente proposition de loi, le législateur prévoit de renforcer le principe d’une péréquation pour couvrir les surcoûts liés à la distribution des quotidiens qui ne peuvent être évités, mais un mécanisme simple permet d’échapper à cette péréquation. Il me semble donc que nous risquons de passer à côté d’un élément essentiel d’égalité de traitement devant une charge collective.
Chacun a bien compris que le sujet était important, mais nous nous sommes heurtés à un problème juridique pour traiter cette question par voie législative. Nous ne pouvons intervenir que sur le domaine coopératif des barèmes, et non pas sur le hors barème, et donc sur le hors presse, car cela relève des pouvoirs réglementaires dévolus au CSMP.
Madame le ministre, j’aimerais avoir votre sentiment sur ce sujet. Il serait regrettable de consolider un système tout en laissant ouverte la voie pour y échapper avec la plus grande facilité. Ne serait-il pas souhaitable que vous demandiez au CSMP de s’emparer de ce sujet dès la promulgation de la loi, afin de garantir, par la voie d’une prochaine décision, que l’application de la péréquation s’impose également aux produits hors presse ?
Madame la sénatrice, comme vous l’avez vous-même souligné dans votre question, le hors presse n’entre pas dans le champ de la loi Bichet, que cette proposition de loi vise à modifier. À l’heure actuelle, la péréquation via le CSMP n’est possible qu’entre les familles de presse. Nous pouvons œuvrer pour que le CSMP soit particulièrement vigilant concernant la frontière entre ce qui relève d’un côté, du hors presse et, de l’autre, de la presse, et donc de la péréquation. Cependant, l’examen du présent texte n’est probablement pas le bon cadre pour évoquer ce sujet.
Puisque j’ai la parole, j’en profite pour répondre à une autre question, que vous avez posée lors de la discussion générale. Elle concerne le rapport Jevakhoff. Vous avez pu constater que la plupart des pistes esquissées par ce rapport avaient été rendues publiques. Comme je l’ai dit tout à l'heure, nous devons travailler à une plus grande mutualisation entre les différents acteurs de la distribution, a fortiori – c’est une évidence – dans le contexte de baisse des volumes que nous connaissons actuellement. Le Gouvernement présentera les pistes qu’il privilégie dans les tout prochains mois.

L'amendement n° 3, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Après les mots :
coûts de la distribution,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens.
La parole est à M. David Assouline.

Après les explications que nous avons obtenues en commission, je retire cet amendement.

Le Sénat vient de parfaire le travail de l’Assemblée nationale quant au renforcement de la régulation de la distribution de la presse, en confiant à l’ARDP une nouvelle compétence d’homologation des barèmes des sociétés de messagerie. Pour que l’ARDP puisse étayer sa décision sur les connaissances de la profession et l’expertise que peut apporter le CSMP, nous proposons que le président du Conseil supérieur transmette un avis motivé – c’est cet adjectif qu’il s’agit d’ajouter – à l’ARDP sur les barèmes dont il a été destinataire.
Par ailleurs, il est évident que l’ARDP pourra solliciter des expertises extérieures pour consolider son analyse des barèmes qui lui sont transmis avant de prononcer sa décision de validation ou de refus d’homologation.

La commission n’a pas pu examiner cet amendement, mais, à titre personnel, j’y suis favorable, dans la mesure où la double précision que vous nous avez apportée, madame la ministre, est objectivement pertinente.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er est adopté
(Non modifié)
L’intitulé du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 17. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.
« Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 18-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « exerce les missions définies aux articles 18-11 à 18-16. Elle comprend trois » sont remplacés par les mots : « comprend quatre » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l’Autorité de la concurrence. » ;
3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce mandat est renouvelable une fois. Il n’est pas révocable. » ;
4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans. » –
Adopté.
(Non modifié)
La première nomination d’une personnalité qualifiée, en application du 4° de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, intervient dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée du mandat restant à courir des membres de l’autorité.
Lors du premier renouvellement des membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, deux membres dont le mandat n’est renouvelé que pour deux ans sont désignés par tirage au sort. –
Adopté.
Le deuxième alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. » –
Adopté.
I. – L’article 18-5 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés et les mots : « ces organismes pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots : « cet organisme pourrait être condamné » ;
1° bis
« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. » ;
2°
Supprimé
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016. –
Adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
L’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse relevant de l’article 2 peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution aux points de vente et homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi. » ;
2° La première phrase du 11° est ainsi modifiée :
a) Les mots : « leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;
b) À la fin, les mots : « de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;
3°
Supprimé
4° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune. »

L'amendement n° 17, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre Laurent.

Nous souhaitons émettre une réserve sur l’exception au principe de distribution de la presse par des sociétés coopératives. Tel est le sens de cet amendement.

La commission émet un avis défavorable, car le dispositif proposé à l’article 7, qui permettrait à la PQR de distribuer la PQN, est une vraie avancée en matière de mutualisation. Il tend ainsi à mettre en place un système de briques : une brique Presstalis, une brique MLP, une brique PQR, une brique La Poste. Objectivement, cet article 7, tel qu’il est ressorti des travaux de l’Assemblée nationale, est un progrès, que l’on raisonne sur l’aspect économique ou juridique.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 du texte de la commission, que les auteurs du présent amendement proposent de supprimer, visent à offrir un cadre de distribution sur l’ensemble du territoire pour les titres de presse quotidienne nationale qui souhaitent conclure des accords de distribution avec les titres de presse quotidienne régionale concernant l’accomplissement des derniers kilomètres vers les points de vente, réalisant ainsi des économies substantielles en termes de frais de transport. Le Gouvernement, considérant également qu’il s’agit d’une avancée, émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 27, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 13° Détermine les conditions de la mise en commun des moyens par les messageries en créant une société commune. »
La parole est à M. Pierre Laurent.

Cet amendement de cohérence vise à encourager une coopération plus importante entre les deux messageries, tout en affirmant clairement l’objectif d’aller vers la fusion des deux entités pour retrouver un système unique de distribution.

Il n’est pas pertinent d’aller vers une fusion entre Presstalis et les MLP. Il y a eu, au contraire, une amélioration de leur gestion, ainsi qu’une meilleure coopération par la mise en place d’un système d’information unique qui est en cours de déploiement. Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, l’année prochaine, le décroisement des flux qui revient à faire en sorte qu’il y ait non pas deux camions qui partent du dépôt, mais un seul, sera opérationnel.
J’ajouterai un dernier argument auquel vous serez sensible, monsieur Laurent : vous comprenez bien que la fusion entre Presstalis et les MLP entraînerait immédiatement un plan social.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Il lui semble que la constitution d’une société commune doit rester une faculté. À cet égard, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale est équilibré.

À une époque de crise aigüe et de guerre absolue entre Presstalis et les MLP, j’avais moi-même pensé qu’on en viendrait peut-être à pousser à cette fusion pour arrêter les dégâts. Aujourd’hui, la paix règne plutôt entre les deux structures, avec une répartition des tâches. Si la rationalité l’emportait in fine, et que l’on jugeait que cette fusion serait la bonne solution, je n’y serais pas opposé, mais il faudrait que les deux sociétés en aient envie. L’instaurer par la loi, sans grand débat, ne me semble pas un très bon signal. C’est justement parce que ces entités ont été obligées de discuter qu’elles ont pu arriver à fonctionner ensemble, tout en se répartissant le travail.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article 18-12 de la même loi, il est inséré un article 18-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 18 -12 -1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse d’inscrire une question à l’ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.
« Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de presse ne se conformerait pas à la demande de l’autorité prévue au premier alinéa, cette autorité peut se substituer au Conseil supérieur des messageries de presse en faisant appel aux moyens du conseil à cet effet. »

L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Bizet, Duvernois et J. Gautier et Mme Duchêne, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. François Commeinhes.

M. le rapporteur nous ayant apporté des éléments rassurants sur les délais, qui seront maîtrisés, je retire cet amendement.
L'article 8 est adopté.
L’article 18-13 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 18-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse prises en application de l’article 12 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L’autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d’un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. » ;
b) Après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elles doivent être motivés. » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « après les avoir éventuellement réformées, » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent…
le reste sans changement
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce recours n’est pas suspensif. » ;
5° bis
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la cour d’appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

L'amendement n° 28, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, la référence : « L. 231-3, » est supprimée ;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles 283 à 288 » sont remplacées par la référence : « de l’article 227-24 » ;
b) À la même phrase, les mots : « ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « entre dans le champ du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’information » sont remplacés par les mots : « la communication, » ;
3° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l’article 11, les mots : « de nationalité française, » et « domicilié et résidant en France, » sont supprimés ;
5° Au 2° de l’article 15, le montant : « 76, 22 euros » est remplacé par le montant : « 100 € » ;
6° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la communication » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l’information et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la communication et le ministre chargé de l’économie ». –
Adopté.
Titre II
Dispositions relatives à l’Agence France-Presse
L’article 3 de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Il est institué une commission de surveillance chargée de surveiller l’Agence France-Presse. Elle se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.
« La commission de surveillance est garante de la pérennité de l’Agence France-Presse, elle veille au respect des obligations énoncées à l’article 2 et contrôle les comptes et la gestion de l’Agence France-Presse dans les conditions énoncées à l’article 12.
« La commission de surveillance comprend des comités spécialisés, dont un comité de déontologie et un comité financier. Elle en fixe le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
« La commission de surveillance approuve le contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence France-Presse présenté par le président-directeur général. Elle peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence France-Presse qui n’ont pas de caractère obligatoire. Elle est consultée par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l’Agence France-Presse.
« Le président-directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l’activité, de la gestion et de l’indépendance de l’Agence France-Presse.
« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.
« Elle rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale ainsi que du respect de l’indépendance et de la déontologie de l’Agence France-Presse dans un rapport qui est remis au Parlement avant le 30 juin. »

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 33 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° 19.

Je reprendrai les arguments qui ont été avancés par Mme la ministre. En l’absence d’évaluation du nouveau dispositif proposé, nous souhaitons nous en tenir, pour le moment, aux instances actuelles de gouvernance de l’AFP.
Cet amendement est identique à l’amendement n° 19, auquel le Gouvernement est bien évidemment favorable. Madame la présidente, je le retire au profit de ce dernier.

Pour les raisons que j’ai présentées dans mon exposé liminaire, la commission émet un avis défavorable. La commission de surveillance en cause est à la fois nécessaire et urgente, monsieur Laurent. Qu’une telle maison, endettée et ne dégageant pas de ressources, emprunte 26 millions d’euros et lance un plan d’investissement de 30 millions d’euros qui n’a fait l’objet d’aucun contrôle dans l’entreprise soulève un problème, sachant qu’aucune possibilité de repli n’existe. En effet, avec l’accord donné par la Commission européenne, le système des missions d’intérêt général a été utilisé à plein, et, de surcroît, il ne permet pas à l’État d’apporter un capital.
Pour atteindre ce qui s’apparente à une véritable obligation de réussite, il y a donc urgence à moderniser la gestion, avec un pouvoir de décision du P-DG, assisté de son conseil d’administration, et contrebalancé par la commission de surveillance.
Je tiens juste à préciser ma position en rappelant que le conseil supérieur, qui est l’instance de déontologie de l’Agence, est reconnu comme autorité administrative indépendante par le Conseil d’État. Par conséquent, il faudrait s’interroger sur la compatibilité de la mission de cette structure avec les compétences financières et stratégiques que propose de lui adjoindre la commission en la fusionnant avec la commission financière. J’ai un doute sur la conformité juridique de cette mesure.

En commission, j’ai soutenu M. le rapporteur dans sa volonté de créer cette commission de surveillance. En cela, nous avons été à l’écoute d’un certain nombre de syndicats de rédacteurs de l’AFP qui jugeaient qu’il n’y avait pas d’instance permettant de surveiller, au sens positif du terme, la gouvernance.
Mme la ministre vient de nous apporter un élément que nous n’avons pas pu évaluer en commission : le conseil supérieur étant une autorité administrative indépendante, la fusion, c’est-à-dire la disparition de cette autorité, rend le dispositif instable juridiquement.
Dans ces conditions, et malgré les convictions que j’ai exprimées en commission, je choisis de m’abstenir.

Je mets aux voix l’amendement n° 19.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission de la culture.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 93 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 29, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
approuve
par les mots :
donne un avis sur
La parole est à M. le rapporteur.

La commission modère ses audaces en introduisant une précision rédactionnelle : la commission de surveillance, qui a survécu à la tentative de suppression des auteurs de l’amendement précédent, ne fera que donner son avis sur le contrat d’objectifs et de moyens, alors que le texte initial de la commission prévoyait de le lui faire approuver.
Avis défavorable. En effet, le Gouvernement désapprouve la création de la commission de surveillance proposée par la commission.
L’amendement est adopté.
L’article 11 A est adopté.
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
aa §(nouveau)) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de surveillance est composée comme suit : » ;
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;
a bis §(nouveau)) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Deux membres en activité de la cour des comptes, désignés par le premier président ; »
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance élit son président.
« La commission de surveillance est composée de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de la commission de surveillance sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration. » ;
1° bis
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de surveillance peut être saisie par un usager ou une organisation professionnelle de presse de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l’article 2. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « La commission de surveillance qui dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Le conseil est saisi » sont remplacés par les mots : « La commission est saisie » ;
d) Après le même dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité de déontologie mentionné à l’article 3. » ;
1° ter
« Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an. »
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »
c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par la commission de surveillance en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, trois d’entre elles au moins possédant une expérience significative au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 9, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
– sont ajoutés les mots : «, sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;
b bis (nouveau)) Au troisième alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
d (nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « au conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « à la commission de surveillance » ; 3° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article 11, les mots : « financière prévue à l’article 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « de surveillance prévue à l’article 3 » ;
4° (Supprimé)
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir. Le conseil d’administration procède à un débat d’orientation sur la stratégie de l’Agence France-Presse dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Les membres de la commission de surveillance prévue à l’article 3 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. La commission de surveillance entre en vigueur à l’issue de cette nomination et se substitue alors au conseil supérieur et à la commission financière.
IV. – §(Non modifié) Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 5° de l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 20, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion- télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;
1° bis L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »
c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
- sont ajoutés les mots : «, sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
4° L’article 12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette commission comprend trois membres en activité de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.
III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.
IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 5° de l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.
La parole est à M. Pierre Laurent.

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 19. Je considère qu’il est défendu.

L’amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) supprimé ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;
1° bis L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;
2° L’article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »
c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
- sont ajoutés les mots : «, sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
4° L’article 12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.
III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés à l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés à l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise tout d’abord à rétablir la structure de gouvernance de l’AFP adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
La proposition du Sénat de constituer une commission de surveillance en fusionnant la commission financière et le conseil supérieur est intéressante, mais elle arrive trop tardivement dans le débat, sans avoir été préalablement expertisée. Elle risque de rompre l’équilibre proposé par les auteurs de la proposition de loi qui souhaitaient renforcer le conseil d’administration en conservant les trois instances formant aujourd’hui la gouvernance de l’Agence. Elle rompt aussi le mécanisme subtil de gouvernance mis au point dans la loi de 1957 qui tient compte des spécificités de l’Agence.
Il ne faut pas oublier que le conseil supérieur de l’AFP est reconnu par le Conseil d’État comme une autorité administrative indépendante, ainsi que je le rappelais tout à l’heure. Son rôle d’instance de déontologie pourrait être compromis s’il se voyait confier des compétences financières et stratégiques.
Cet amendement vise, en outre, à rétablir la possibilité de faire appel à des membres honoraires de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, là où la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale prévoit de limiter ces nominations à des membres en activité ; tel est le cas au 1° ainsi qu’au 4°de l’article 11 de la présente proposition de loi. Il paraît préférable de laisser à ces hautes juridictions la souplesse nécessaire pour honorer tous les mandats qui leur sont confiés dans différents organismes ou commissions.
Pour ce qui concerne plus précisément le Conseil d’État, rappelons que, dans tous les organismes dans lesquels les textes imposent la présence d’un conseiller d’État – il en existe 642 –, le code de justice administrative prévoit que l’on peut nommer soit un conseiller d’État en activité soit un conseiller d’État honoraire.

L’amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Après les mots :
en activité
insérer les mots :
ou honoraires
La parole est à Mme la ministre.
Afin d’assurer une représentation effective des membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes au sein de la commission de surveillance de l’AFP, je propose de rétablir la possibilité de nommer des membres honoraires.

L’amendement n° 30, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, les mots : «, président, avec voix prépondérante » sont supprimés ;
II. - Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;
...) Au dernier alinéa, les mots : « du conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « de la commission de surveillance » ;
III. - Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Au deuxième alinéa, les mots : « il est saisi » sont remplacés par les mots : « elle est saisie » ;
...) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
...) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 20, 36 et 35.

L’amendement n° 30 est purement rédactionnel. Il tend à permettre à la commission de surveillance d’élire elle-même son président.
Les amendements n° 20 et 36 visent, de nouveau, à supprimer la commission de surveillance que nous avons créée à l’article 11 A. Par cohérence, la commission y est donc défavorable.
J’attire toutefois l’attention du groupe CRC sur le fait que, dans son enthousiasme à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, il a balayé la possibilité d’internationaliser le conseil d’administration qui représentait pourtant une avancée adoptée à l’unanimité par la commission. Je rappelle que, aux termes de la rédaction adoptée par cette dernière, trois des cinq personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration devront posséder « une expérience significative au niveau européen et international ».
Par ailleurs, pour donner un peu de vie à ce conseil d’administration qui n’en a pas en réalité, nous avions prévu qu’il se réunisse au moins une fois par trimestre.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 35, je ferai deux observations.
Tout d’abord, madame la ministre, nous avons anticipé sur votre amendement en réduisant le nombre de conseillers à la Cour des comptes de trois à deux, pour tenir compte des contraintes de gestion des ressources humaines de cette haute juridiction.
Ensuite, sur la possibilité de nommer des conseillers honoraires, j’aurais été tenté de m’en remettre à la sagesse du Sénat. Notre assemblée est-elle attachée à voir siéger au sein d’une commission, chaque fois que cela paraît justifié, des conseillers en activité ou accepte-t-elle de laisser le chef de corps choisir de nommer, selon les cas, des conseillers en exercice ou à la retraite ? On conçoit aisément les arguments qui pourraient étayer le choix de l’une ou l’autre solution. J’admets volontiers qu’il faille tenir compte des contraintes rencontrées par ces hautes juridictions en termes de gestion des ressources humaines. Je serais donc plutôt enclin à vous suivre, madame la ministre.
J’ajoute cependant que le Sénat pourrait être amené un jour à poser la question de savoir si l’on peut continuer à accepter que de hautes juridictions soient représentées par des magistrats retraités, ce qui peut poser des problèmes au moins statutaires, sinon déontologiques. Sous cette réserve, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 35.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 20, sous réserve qu’il soit rectifié. Je serais en effet favorable au retour au texte de l’Assemblée nationale, à une nuance près : il convient de rétablir la possibilité de nommer des membres honoraires du Conseil d’État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation au sein du conseil supérieur et de la commission financière. Si l’amendement n° 20 ainsi rectifié n’était pas adopté, le Gouvernement a déposé les amendements n° 36 et 35 que j’ai présentés tout à l’heure.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 30, j’émets un avis défavorable.

Monsieur Laurent, que pensez-vous de la suggestion de rectification de Mme la ministre ?

J’y suis favorable, madame la présidente, et je rectifie mon amendement en ce sens.
Puisque vous m’avez donné la parole, je me permets de répondre à M. le rapporteur qu’il ne doit pas nous prêter des motivations imaginaires. Nous ne sommes pas partisans du statu quo, mais nous pensons que cette réforme nécessiterait un débat plus large, à l’occasion duquel d’autres pistes que celles qu’a esquissées la commission pourraient être étudiées. Pourquoi ne pas réfléchir, par exemple, au rôle des salariés dans la gouvernance de l’AFP ?

Mes chers collègues, afin que nous disposions d’une version rédigée de l’amendement n° 20 rectifié permettant à la Haute Assemblée de se prononcer en toute connaissance de cause, je vais suspendre la séance quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à dix-neuf heures trente.

La séance est reprise.
Je suis saisie d’un amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) (supprimé)
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion- télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
b ter) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière. » ;
1° bis L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2. » ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie ; »
c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l'agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;
« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories ; »
d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d'administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d'administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d'administration. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
- sont ajoutés les mots : «, sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration » ;
c) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
4° L'article 12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l'un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration. »
II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.
III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l'article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.
IV. – Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 5° de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d'administration, qui ne sont pas modifiés.
Je le mets aux voix.
L'amendement n’est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1°
Supprimé
2° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – La commission de surveillance est saisie de l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses.
« Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.
« Dans la négative, elle renvoie l’état au président-directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d’administration en vue de la réalisation de cet équilibre.
« La commission de surveillance est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l’Agence France-Presse. Elle nomme les commissaires aux comptes et approuve leur rapport sur les comptes annuels. Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général.
« La commission de surveillance dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place. Elle adresse, tant au président-directeur général qu’au conseil d’administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.
« Si la commission de surveillance constate que, malgré ses observations, le conseil d’administration n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier de l’agence, elle peut demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d’administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 17.
« La mission de l’administrateur provisoire prend fin dès l’installation du nouveau conseil.
« La commission de surveillance apure les comptes de l’Agence France-Presse.
« Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l’Agence France-Presse au conseil d’administration.
« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité financier mentionné à l’article 3. » ;
3° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d’une comptabilité séparée. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;
4° Le second alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la première phrase, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »

L'amendement n° 21, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Patrick Abate.

Je serai bref, de manière que nous puissions terminer ce soir l’examen de cette proposition de loi.
Nous ne sommes pas favorables à tout ce qui va dans le sens d’une privatisation, même partielle, de l’entreprise Agence France-Presse. Au contraire, nous pensons que, pour répondre aux injonctions de la Commission européenne, il faudrait renforcer le statut et le caractère public de l’entreprise.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 12.

La commission émet un avis défavorable sur un amendement qui vise, en fait, à revenir sur les engagements pris par notre pays vis-à-vis de l’Agence France-Presse. À l’évidence, ceux-ci étaient justifiés et la négociation avec la Commission européenne a été bien menée par le Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » ;
2° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d'une comptabilité séparée. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence ; elle prévoit les conditions de leur révision. » ;
3° Après la première phrase du second alinéa de l’article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »
La parole est à Mme la ministre.
En cohérence avec l’amendement du Gouvernement visant à écarter la proposition de fusion du Conseil supérieur et de la commission financière, il est proposé ici d’en revenir au texte de l’Assemblée nationale.
Cet article est très important, car il permet de mettre le statut de l’AFP en cohérence avec le droit de de l’Union européenne.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Si nous devions en revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, les deux articles précédents, tels que nous les avons votés, n’auraient plus d’objet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
(Non modifié)
La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article 1er, les mots : « et dans l’ensemble de l’Union française » sont supprimés ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le neuvième alinéa est supprimé ;
2° bis
3° À la première phrase du second alinéa de l’article 14, les mots : « doit saisir, dans le délai d’un mois, le » sont remplacés par les mots : « transmet toutes les informations utiles, dans le délai d’un mois, au » et les mots : « d’un projet de loi » sont remplacés par les mots : « afin de permettre à celui-ci d’adopter une loi » ;
4° Après le mot : « article », la fin de l’article 15 est ainsi rédigée : « L. 249-1 du code de commerce. » ;
5° À l’article 17, les mots : « règlement d’administration publique fixera » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État fixe ». – (Adopté.)

L'amendement n° 1, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information peut, à l’initiative d’un seul journaliste, constituer un Conseil de rédaction.
« Dans l’hypothèse où l’entité juridique comporte plusieurs titres, il peut être constitué un Conseil de rédaction par titre.
« Le Conseil de rédaction est composé de tous les journalistes professionnels qui contribuent à la production de contenus journalistiques pour celui-ci, quels que soient le support et la technique utilisés.
« Le Conseil de rédaction est doté de la personnalité juridique.
« Le Conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives.
« Les modalités de son fonctionnement et de l’exercice de ses missions lui sont conférées par la présente loi. »
II. – Le Conseil de rédaction :
- s’assure au quotidien que tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;
- s’assure que les journalistes qui en sont membres sont à l’abri de pressions ou tentatives des pressions au but d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;
- s’assure que les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts ;
- est consulté sur la désignation, la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre ;
- formule des avis préalables sur l’élaboration et la modification de l’organisation de la rédaction ;
- assure, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires ;
- se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre ;
- reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse touchées par l’entité juridique visée à l’article 6 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et s’assure de leur utilisation au bénéfice de la qualité de l’information et du pluralisme ;
Le Conseil de rédaction est également informé et consulté :
- lors de mouvements capitalistiques importants représentant plus de 5 % du capital de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité ;
- avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- lors d’une procédure de sauvegarde, lors d’une procédure de redressement judiciaire et lors d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lorsque le Conseil de rédaction a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité, il peut demander que lui soient fournies des pièces comptables ainsi que des explications, sans pour autant se substituer aux prérogatives des autres instances représentatives existantes au sein de l’entité juridique.
Les conditions d’exercice de ce droit à information seront fixées par décret.
Le Conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.
En cas de disparition de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité, le Conseil de rédaction conserve sa personnalité juridique pendant douze mois.
III. – Le Conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement de toutes ses missions mentionnées au II.
IV. – L’article L. 2328-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait d’entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d’un Conseil de rédaction est puni des mêmes peines, assorties d’une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entité ainsi que l’obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l’objet au titre de ses manquements. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre….
Reconnaissance juridique du Conseil de rédaction
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Madame la présidente de la commission, j’ai bien entendu ce que vous avez dit dans la discussion générale sur le périmètre de la présente proposition de loi. Mais, s’agissant d’un texte relatif à la modernisation du secteur de la presse, et ne connaissant pas par avance l’état d’esprit de la commission, j’ai décidé de déposer cet amendement dont le texte reprend celui d’une proposition de loi que j’avais déposée en septembre dernier.
Mon objectif est d’ouvrir le débat sur un sujet qui n’est pas mineur, mais qui est une sorte de serpent de mer. Il s’agit de donner un statut aux rédactions. Plusieurs de nos collègues, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, défendent cette proposition.
Les journalistes bénéficient en effet de droits individuels et non pas collectifs. Autrement dit, la rédaction en tant que telle, celle qui fait vivre et anime le journal, n’a pas d’existence. Cela pose problème, compte tenu de la financiarisation de la presse et de la disparition ou du rachat de nombreux titres que l’on constate aujourd’hui.
Cet amendement est complexe, j’en conviens ; il détaille notamment la composition du conseil de rédaction et les droits dont il jouit. Le principe, je le répète, est de permettre à la rédaction d’exister en tant que telle.
Je comprends bien que cet amendement, dans son principe même, mériterait d’être débattu plus longuement.
Je ne vous propose pas de créer un kolkhoze au sein des journaux ou un contrepoids au comité d’entreprise, non plus qu’une structure concurrente de la direction du journal. Je dis simplement que ceux qui animent le journal, c’est-à-dire les journalistes, doivent pouvoir bénéficier d’un droit collectif qui pourrait passer par une reconnaissance juridique des rédactions.
Tel est, brièvement résumé, l’objet de cet amendement.

La commission a émis un avis défavorable.
Cet amendement est important. Il tend à créer un conseil de rédaction qui ne disposerait pas seulement de fonctions consultatives, puisqu’il assurerait, « de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média […]. »
Ce conseil de rédaction, auquel appartiendraient de plein droit l’ensemble des journalistes, pourrait donc suivre une politique rédactionnelle différente de celle qu’aurait fixée le directeur de la publication du journal.
Je formulerai d’emblée trois observations.
Première observation : depuis la loi de 1881, le droit est assez clair, et c’est le directeur de la publication qui est responsable pénalement et civilement. Aussi, je ne vois pas très bien comment il pourrait continuer à l’être s’il ne pilote plus la rédaction de la publication qu’il est censé diriger.
Deuxième observation : au regard du droit des sociétés, il serait tout de même peu banal que les actionnaires d’un titre de presse n’aient plus aucune possibilité de donner leur avis sur la direction suivie par l’entreprise dont ils seraient les propriétaires.
Troisième observation : au regard du droit du travail, l’adoption de votre amendement, madame Goulet, conduirait à faire régresser le statut des journalistes. Ceux-ci sont très attachés à la clause de cession et à la clause de conscience. Comment pourraient-ils faire jouer cette dernière clause pour s’élever contre une politique éditoriale qu’ils auraient contribué à déterminer au sein du comité de direction, le directeur de publication n’ayant plus cette responsabilité ?
Je pourrais vous opposer d’autres arguments allant tous dans le même sens, madame Goulet.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Je partage l’analyse juridique de M. le rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de revenir très largement sur des principes fondamentaux issus de la loi de 1881 qu’il vient de rappeler, à savoir la responsabilité éditoriale et pénale du directeur de la publication et la clause individuelle de conscience des journalistes, sanctuarisée par le code du travail.
J’ajoute que, dans ses différentes décisions y afférentes, le Conseil constitutionnel a toujours considéré que le pluralisme de la presse écrite se trouvait dans la diversité des titres, à l’inverse de l’audiovisuel, où il doit prévaloir au sein de chaque antenne.
Plus généralement, je partage le souhait de Mme Goulet de voir l’activité des journalistes s’exercer dans des conditions garantes de leur indépendance, mais sa proposition, me semble-t-il, va bien au-delà de ce qui est compatible avec la liberté éditoriale des titres de presse.
Pour renforcer la confiance du public dans les titres de presse écrite, et dans le cadre de la profonde réforme des aides à la presse qui est souhaitée par le Président de la République, je projette de mieux subordonner les aides contractuellement au respect de règles déontologiques.
J’aurai donc l’occasion de revenir devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, avec des propositions de réforme allant dans ce sens.

Le phénomène de concentration de la presse – essentiellement la presse quotidienne régionale – entre les mains de financiers, ou de personnes ayant des intérêts sans grand lien avec elle, a connu son point d’orgue ces dernières années. Mais on continue à faire semblant de croire que des journaux sont différents, alors que leur contenu est en réalité identique, et ce quels que soient les supports !
J’ai moi-même défendu l’idée que les rédactions soient dotées d’un statut juridique afin d’assurer leur indépendance. Mais cette réforme, dont certaines conséquences viennent d’être énumérées, nécessiterait un vrai débat, car elle remettrait complètement en cause la loi de 1881. Il faut en avoir conscience.
Il faudrait alors considérer que le directeur de la publication n’est plus responsable pénalement. Or vous ne le proposez pas, ma chère collègue.
Il faudrait aussi faire en sorte que les journalistes puissent continuer à invoquer leur clause de conscience, droit fondamental pour eux.
Pour les raisons qui ont été évoquées, peut-être faudra-t-il un jour faire bouger les choses, pour la presse écrite comme pour la presse audiovisuelle, tant il est vrai que la concentration est un phénomène qui nuit au pluralisme et à l’indépendance des médias.

J’ai bien compris que mon amendement ne s’insérait pas dans le périmètre de ce texte et qu’il comportait des failles. J’aimerais néanmoins que la commission se penche sur ce problème : soit on exclut complètement l’idée même d’un statut juridique de la rédaction, pour des raisons juridiques, techniques et politiques, soit on essaie d’en trouver un.
Quoi qu’il en soit, on ne peut pas rester en apnée ou en lévitation sur ce sujet, parce que le Syndicat des journalistes, lors de sa dernière assemblée générale, à laquelle participait d’ailleurs notre collègue André Gattolin, s’est emparé de cette question, qui est un vrai sujet.
Bien que n’étant pas du tout spécialiste de la matière, j’ai travaillé cet amendement avec le Syndicat des journalistes et des associations pour essayer d’aboutir à une solution juridique qui fait défaut actuellement, situation qu’il serait assez délicat de laisser perdurer.
En effet, à voir les problèmes que rencontrent des titres comme France Soir, Libération, Le Monde, on se rend bien compte que les journalistes, en tant que collectif, ne sont absolument pas protégés des mouvements financiers. C’est bien de cela qu’il s’agit aujourd’hui dans un contexte de financiarisation extrême. Mes chers collègues, d’un côté, on multiplie les aides, et, de l’autre, on refuserait un droit collectif aux rédactions ?
Pour l’heure, madame la présidente, je retire mon amendement, dans l’espoir qu’il sera retravaillé par la commission et redéposé, sous ma signature ou sous une autre.
(Non modifié)
Après l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne peut adopter le statut d’entreprise solidaire de presse d’information.
« Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut :
« 1° L’objet social d’une entreprise solidaire de presse d’information est d’éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts ;
« 2° Pour la gestion de l’entreprise solidaire de presse d’information, une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice est affectée à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire. » –
Adopté.
(Non modifié)
La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « après avis de la commission prévue ci-dessous » sont supprimés ;
b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : «, après avis de la commission prévue au cinquième alinéa de l’article 2, » sont supprimés ;
3° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
– à la fin du second alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte ;
« 2° À l’article 2 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d’une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes :” ;
« b) Au 3°, le mot : “décret” est remplacé par les mots : “arrêté du préfet”. » ;
c) Le 3° du IV est ainsi modifié :
– le b est abrogé ;
– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa du c, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;
d) Le 3° du V est ainsi modifié :
– le b est abrogé ;
– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
e) Le 3° du VI est ainsi modifié :
– le b est abrogé ;
– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa du c, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;
– au d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
f) Le 4° du VII est ainsi modifié :
– les d à f sont abrogés ;
– au début du premier alinéa du g, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa du g, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;
g) Le 4° du VIII est ainsi modifié :
– les c à e sont abrogés ;
– au début du premier alinéa du f, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa du f, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;
h) Le 4° du IX est ainsi modifié :
– les c et d sont abrogés ;
– au début du premier alinéa du e, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa du e, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, ».

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Mélot, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
arrêté du préfet
insérer les mots :
, après consultation obligatoire des organisations professionnelles des entreprises de presse dont le siège est situé dans le département, ou dont un ou plusieurs titres ont une édition départementale
La parole est à Mme Colette Mélot.

La publication des annonces légales sur la vie des sociétés est un enjeu économique essentiel pour la presse régionale et départementale, mais aussi pour le pluralisme.
Plusieurs centaines de titres sont habilités à publier ces annonces et en tirent des recettes souvent essentielles à leur équilibre financier, dans un contexte marqué par la contraction du marché publicitaire et l’érosion du lectorat de la presse papier.
Cette publication représente un marché de l’ordre de 193 millions d’euros.
Jusqu’à présent, une liste annuelle était préparée chaque année par une commission consultative départementale, composée notamment de directeurs de journaux. Elle était publiée par arrêté du préfet.
Le Gouvernement a été contraint de supprimer les commissions départementales pour tenir compte des objectifs de la directive européenne Services en matière de concurrence, en raison d’un risque de conflit d’intérêts. Cependant, il est évident que ces commissions départementales permettaient l’élaboration de listes au plus près des réalités du terrain.
Je pense qu’il nous appartient, en tant que représentants des territoires soucieux de protéger une presse de proximité, de ménager encore une consultation de cette presse, même si ce ne peut plus être sous la même forme.
Cet amendement ne revient ni sur la définition des critères d’habilitation à la publication ni sur la fixation d’une liste par arrêté préfectoral. Je ne vois donc aucun obstacle à son adoption, et je suis prête à revoir sa rédaction si cela était nécessaire.

La commission estime que cet amendement alourdirait le dispositif et imposerait une plus grande restriction au regard des autorisations données par les préfets. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable, y compris sur un plan technique.
Madame Mélot, je serais tenté, mais n’y voyez aucune discourtoisie de ma part, de vous prier de bien vouloir retirer votre amendement.
Si nous commençons à ouvrir la boîte de Pandore des dispositions concernant les annonces légales, je crains que nous n’allions à l’encontre de cette logique de presse de territoire ou de maillage territorial que vous évoquiez.
Je me permets d’inviter nos collègues, comme je l’avais fait devant la commission, à faire preuve d’une très grande prudence au regard de la sensibilité exceptionnelle du milieu de la presse sur la question des annonces légales.
Nous avons une situation équilibrée. Tout mouvement sur ce terrain se traduira immédiatement par un déséquilibre.
Je vous le répète, mes chers collègues, n’ouvrez pas cette boîte de Pandore !

Mes chers collègues, permettez-moi, à cette heure, de faire le point de nos travaux.
Je dois normalement lever la séance à vingt heures. J’accepterai de prolonger nos travaux de quelques minutes pour que nous puissions terminer l’examen de cette proposition de loi, mais cela requiert de la part de chacun la plus grande concision. En tout état de cause, nous ne pourrons siéger au-delà de vingt heures dix.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 5 rectifié ?
Le Gouvernement émet un avis défavorable, madame la présidente.

Je remercie le rapporteur des éléments qu’il vient de verser au débat. Je pense qu’il était important d’attirer l’attention du Sénat sur les difficultés de la presse régionale, mais il serait effectivement imprudent d’ouvrir cette boîte de Pandore.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
L'article 14 bis est adopté.

L'amendement n° 2 rectifié undecies, présenté par MM. Commeinhes, Béchu et Bizet, Mme Des Esgaulx et MM. Gilles, Cadic et Roche, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, après les mots : « judiciaire ou technique » sont insérés les mots : « ainsi que les services de presse en ligne ».
La parole est à M. François Commeinhes.

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et pour ne pas allonger les débats, je retire mon amendement sans plus de précision, madame la présidente.
(Supprimé)

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 est présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 23 est présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : «, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 9.

Cet amendement me tient à cœur, mais, dans la mesure où je l’ai défendu en commission et de nouveau lors de la discussion générale, je pense avoir largement plaidé ma cause !

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, à l’issue de débats qui ont suscité, je le reconnais, des arguments relativement équilibrés de part et d’autre.
Le Gouvernement est favorable au rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. En effet, l’accès des journalistes aux lieux de privation de liberté constitue un progrès pour la liberté de la presse et pour l’information des citoyens.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Mme la présidente. En conséquence, l'article 15 est rétabli dans cette rédaction.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.

L'amendement n° 25, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’édition, d’une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I et sur les archives de son enquête, ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au même I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière dans les cas suivants :
« 1° La prévention ou la répression d’un crime ;
« 2° La prévention d’un délit d’atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement ;
« 3° La prévention d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal et puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° La répression d’un délit mentionné aux 2° et 3° du présent II, lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l’auteur du délit, lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
« Les mesures envisagées portant atteinte au secret des sources doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.
« IV. – La détention ou le stockage chez un hébergeur, par une personne mentionnée au I, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
La parole est à M. Pierre Laurent.

Compte tenu de ce que nous a dit Mme la ministre dans son propos liminaire, je retire mon amendement. J’espère néanmoins qu’un travail législatif sur le secret des sources des journalistes sera entamé prochainement.

L’amendement n° 25 est retiré.
L'amendement n° 4, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199… ainsi rédigé :
« Art. 199… – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction de leur impôt sur le revenu au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à l’article 39 bis A.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. David Assouline.

Cet amendement important a été l’occasion pour notre assemblée de se rassembler lors des débats en commission. Il tend à répondre à l’un des souhaits exprimés par Charlie Hebdo, Charb en particulier, peu de temps avant le drame : la mise en place d’un dispositif d’incitation fiscale en direction des particuliers pour soutenir la presse d’information politique et générale.
Le Président de la République, lors de la présentation de ses vœux à l’AFP, a notamment annoncé qu’il soutiendrait des initiatives parlementaires allant dans ce sens. L’examen d’une proposition de loi sur la presse était donc l’occasion d’avancer.
La commission de la culture a voté hier à l’unanimité cet amendement : signé du groupe socialiste, il ne peut porter qu’un nom, celui de Charb. Ce dernier estimait en effet qu’il constituait techniquement un véhicule adapté en tant que mécanisme d’incitation fiscale en faveur de la presse.
Toutefois, il fallait que le Gouvernement, non seulement accepte de lever le gage, mais sous-amende notre rédaction après des expertises techniques, afin d’éviter tout contournement ou toute perversion du dispositif que nous voulons, notamment en fixant des plafonds.
L’ « amendement Charb » ainsi sous-amendé constituera une avancée pour tous.

Le sous-amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 4
A. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le 15 ter du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :
«15 ter.
« Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse.
B. - Alinéa 4
1° Avant les mots :
Les contribuables
insérer la référence :
2° Remplacer les mots :
peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret,
par les mots :
au sens de l’article 4B bénéficient
3° Remplacer les mots :
de leur impôt sur le revenu
par les mots :
d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018
4° Remplacer les mots :
exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à
par les mots :
définies au I de
C. - Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1. sont retenus dans la limite annuelle de 1000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« 3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« 4. La réduction d’impôt mentionnée au 1. ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à cette réduction d’impôt. »
II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
D. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Ce sous-amendement est défendu, madame la présidente.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 9, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement, qui permet de lui donner une solidité technique.
Tous les groupes de notre assemblée ont, en commission, donné leur accord sur le principe de cette défiscalisation liée à la souscription.

Nous avons déposé un amendement allant dans le même sens et nous apportons donc notre ferme soutien à celui-ci.
Il s’agit d’un moment important de notre discussion, puisque nous nous apprêtons à adopter, tous ensemble, une disposition fidèle à l’esprit de Charb : l’amendement Charb !

L’adoption de l’amendement du groupe socialiste, sous-amendé par le Gouvernement, va permettre la défiscalisation des souscriptions au capital d’entreprises de presse. C’est une avancée pour le financement de ces entreprises à un moment où, nous l’avons tous rappelé, le secteur traverse une crise difficile.
J’anticipe, mais notre amendement n° 15, identique à l’amendement n° 24 du groupe communiste, qui avait déjà déposé une proposition de loi en ce sens, représente également une aide financière à la presse, quoiqu’il s’inscrive dans un cadre très différent.
Comme l’a souligné M. le rapporteur, alors que le présent amendement prévoit une aide fiscale pour les souscriptions au capital d’une société, notre amendement n° 15 a pour objet d’encourager les dons, notamment de simples particuliers, aux associations ou aux fonds de dotation.
Le champ d’application de l’amendement socialiste n’est donc pas du tout le même et trouvera bien moins fréquemment à s’appliquer. Surtout, notre proposition correspond à un dispositif déjà existant, et vise à le consolider.
Actuellement, un rescrit fiscal permet en effet aux particuliers ou aux entreprises de bénéficier du régime du mécénat lorsqu’ils apportent une aide financière aux associations redirigeant ces fonds vers la presse, de façon pluraliste. Je tiens à souligner que ce principe a été posé sous la précédente majorité.
Il s’agit ce soir de s’assurer que ces dons vont bien continuer à bénéficier d’une défiscalisation.
Si le dispositif ici proposé venait à représenter la seule défiscalisation possible et remplacer le rescrit que je viens d’évoquer, alors le secteur de la presse serait gravement affecté.
Il suffit de regarder ce qui s’est produit pour Charlie Hebdo. L’association Presse et pluralisme, créée en 2007 par les représentants de tous les syndicats de presse écrite, a très rapidement rassemblé les dons, manifestant ainsi qu’elle était la structure appropriée pour la gestion de cette aide.
Cette association existe grâce au rescrit. Elle était d’ailleurs intervenue bien avant, lorsque Charlie Hebdo ne parvenait pas à boucler ses comptes pour l’année 2014. Son action contribue à garantir le pluralisme de la presse, là où les aides à la presse du Gouvernement peuvent se révéler insuffisantes.
À ce jour, trente-neuf journaux bénéficient de ce système.
Je pointe l’insuffisance du dispositif tel qu’il risque de sortir de nos débats si la Haute Assemblée ne vote pas notre amendement.
Nous sommes donc favorables à l’amendement de M. Assouline, …

… mais nous souhaitons le compléter, pour enfin donner une base législative à un dispositif qui fonctionne d’ores et déjà.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également concourir à des actions de développement numérique et de modernisation technologique de la presse dans des conditions déterminées par décret. »
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Le fait d’ouvrir aux fonds de dotation la possibilité de financer les entreprises de presse qui sont des entreprises commerciales du secteur concurrentiel me semble déroger trop fortement aux principes qui ont conduit à la création de ces fonds.
M. le rapporteur a proposé à la commission un mécanisme de financement de la modernisation de la presse fondé sur une extension du champ des fonds de dotation créés par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Nous venons de débattre de ce sujet : il me semble préférable de proposer un levier fiscal plus directement destiné aux citoyens qui souhaitent investir dans la presse par le biais du financement participatif.

Dans la mesure où les mécanismes en question ne sont pas contradictoires, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Commeinhes, Mme Mélot et M. Retailleau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f du 1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« f bis) D’associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article de l’article 39 bis A.
« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier ; »
2° Après le 2° du g, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou dont la gestion est désintéressée, et qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article de l’article 39 bis A.
« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° 24.

Mes chers collègues, il s’agit là de notre version de l’« amendement Charb », dont nous avions, à l’origine, fait une proposition de loi.
Nous venons de voter l’amendement n° 4, présenté par David Assouline. Le présent amendement couvre un champ plus large.
Cela étant, ces deux dispositifs ne me semblent pas contradictoires. Voilà pourquoi nous maintenons notre amendement.

Les trois voies –celle qui est proposée par M. Assouline, celle des fonds de dotation et celle de l’amendement « Presse et pluralisme », correspondent à trois véhicules techniques distincts.
La commission ne s’est pas permis de hiérarchiser ces trois modalités. Elle a émis un avis favorable sur chacune d’elles, et partant sur ces amendements.
Cela étant, il n’échappe à personne que le Gouvernement a la possibilité de s’opposer à ces dispositifs, en refusant, au regard des divers éléments dont il dispose, de lever le gage.
Le dispositif qu’il s’agit en quelque sorte de consacrer par la loi existe déjà et ne serait pas remis en cause par l’amendement de David Assouline, sous-amendé par le Gouvernement, que le Sénat vient d’adopter.
En conséquence, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements identiques.

Madame la ministre, cet avis de sagesse va-t-il jusqu’à la levée du gage ?
Sourires.
Les amendements sont adoptés.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Blandin, M. Gattolin, Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une meilleure répartition des aides directes à la presse écrite, en vue de mieux assurer le pluralisme et la diversité des différents titres.
La parole est à M. André Gattolin.

Mes chers collègues, d’un commun accord, nous avons décidé d’être brefs, et je vais m’astreindre à respecter cette règle.
Il me semble avoir résumé le problème dont il s’agit lors de la discussion générale.
Le Gouvernement a fait de petits pas pour améliorer les aides à la presse et pour les rendre plus équitables au regard des principes fondamentaux de la liberté de la presse. Toutefois, nous sommes encore trop loin du but. À la lecture de la liste des titres qui sont les plus aidés, on ne peut s’empêcher de s’interroger …
Il serait bon que le Gouvernement nous indique plus clairement, dans un rapport à remettre d’’ici au 31 juillet prochain, les orientations qu’il fixe à cet égard. Même s’il doit, par la suite, procéder étape par étape, cette clarification, que nous demandons depuis deux ou trois ans déjà, serait la bienvenue.

À titre personnel, je ne suis pas favorable à l’amendement n° 10 rectifié. Toutefois, par loyauté, je me dois de préciser que la commission a émis un avis favorable.
Le Président de la République m’a chargée de lui proposer, à brève échéance, une réforme ambitieuse des aides à la presse. Je l’ai déjà précisé : il s’agira notamment de perfectionner les mécanismes d’aide au pluralisme, en soutenant la presse nationale à faibles ressources publicitaires, au-delà des seuls quotidiens.
Le premier volet de cette réforme doit être déployé dans les trois prochains mois. Les mesures qu’il contiendra seront principalement d’ordre réglementaire, mais je souhaite bien entendu que le Parlement soit tenu étroitement informé de leur mise en œuvre.
Cela étant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement n’est pas adopté.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la revalorisation et la réaffectation des aides publiques de l’État aux sociétés de journaux et de publication périodiques de la presse écrite et numérique, notamment concernant l’affectation de ces aides aux titres d’information politique et générale tels que définis par l’article 39 bis A du code général des impôts, et prévoit la possibilité d’élargir ces aides au-delà de la presse quotidienne.
La parole est à M. Pierre Laurent.

Mes chers collègues, cet amendement tendant aux mêmes fins, je vais le retirer. Nous n’en veillerons pas moins à ce que les engagements pris par Mme la ministre soient tenus.
Vous pouvez compter sur notre vigilance pour que le dossier des aides à la presse continue d’avancer !
Je retire l’amendement, madame la présidente.

L’amendement n° 26 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 94 :
Nombre de votants344Nombre de suffrages exprimés325Pour l’adoption325Le Sénat a adopté.
Applaudissements.

Mes chers collègues, je ne saurais trop insister sur le fait que cette prolongation de séance était tout à fait exceptionnelle ; il s’agissait d’un texte particulièrement important.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 février 2015, à quatorze heures trente et le soir :
1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel ;
Rapport de Mme Colette Mélot, rapporteur pour le Sénat (n° 229, 2014-2015) ;
Texte de la commission mixte paritaire (n° 230, 2014-2015) ;
2. Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (Procédure accélérée) (n° 223, 2014-2015) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois (n° 272, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 273, 2014-2015) ;
3. Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon (Procédure accélérée) (n° 222, 2014-2015) ;
Rapport de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (n° 274, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 275, 2014-2015) ;
4. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 16, 2014-2015) ;
Rapport de M. Ladislas Poniatowski, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 263, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 264 rect., 2014-2015) ;
Avis de M. Jean-François Husson, fait au nom de la commission des finances (n° 236, 2014-2015) ;
Avis de Mme Françoise Férat, fait au nom de la commission de la culture (n° 237, 2014-2015) ;
Avis de M. Louis Nègre, fait au nom de la commission du développement durable (n° 244, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures dix.