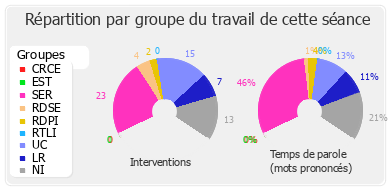Séance en hémicycle du 12 janvier 2009 à 15h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à quinze heures cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

En application de l’article 40 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué à M. le président du Sénat le texte d’une décision rendue le 8 janvier 2009 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté la requête concernant les élections sénatoriales du 21 septembre 2008 dans le département de l’Ardèche.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la présente séance.

J’informe le Sénat que, saisie en application de l’article L. 461-1 du code de commerce, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur le projet de nomination de M. Bruno Lasserre aux fonctions de président de l’Autorité de la concurrence.

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement a inscrit à l’ordre du jour prioritaire du mercredi 14 janvier au soir une déclaration du Gouvernement sur la situation au Proche-Orient.
L’ordre du jour de la séance du mercredi 14 janvier s’établira donc comme suit :
À 15 heures :
- Suite du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ;
Le soir :
- Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur la situation au Proche-Orient.
Acte est donné de cette communication et les conditions d’organisation du débat suivant cette déclaration seront précisées ultérieurement.

Pour la clarté de l’organisation de nos travaux, la commission des affaires culturelles demande la réserve des articles 8 et 9 du projet de loi jusqu’à demain seize heures.
Il est favorable, monsieur le président.

La réserve est de droit.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 1er, à l’amendement n° 5.
I. - Le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« I. - La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, des émissions de radio ultramarines ainsi que tout autre service de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.
« L'ensemble des services de télévision qu'elle édite et diffuse assure la diversité et le pluralisme de ses programmes dans les conditions fixées par son cahier des charges.
« Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, dont les caractéristiques respectives sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l'intermédiaire de filiales.
« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l'accès de tous les publics à ses programmes.
« France Télévisions veille à ce que sa nouvelle organisation garantisse l'identité des lignes éditoriales de ses services. Cette organisation assure le pluralisme et la diversité de la création, de la production et de l'acquisition des œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne.
« Elle reflète dans sa programmation la diversité, notamment ethnoculturelle, de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes. »
II. - Au premier alinéa du V de l'article 44 de la même loi, les mots : « et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I » sont supprimés. Au premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 ».
III. - Au second alinéa du V de l'article 44 de la même loi, les mots : « d'une filiale, propre à chacune d'elles et » sont remplacés par les mots : « de filiales ».
IV. - France Télévisions diffuse dans les régions des programmes qui contribuent à la mise en valeur de la richesse de ces territoires.
Elle conçoit et diffuse à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, des émissions et des programmes reflétant la diversité de la vie économique, sociale et culturelle régionale, les activités créatrices ainsi que l'information de proximité.
Au travers de sa grille de programmes, elle contribue fortement, s'il y a lieu, à l'expression des langues régionales.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le sixième alinéa du I de cet article :
« Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production. À cette fin et dans les conditions fixées par son cahier des charges, les unités de programme instituées en son sein comprennent des instances de décision collégiales.
II. - Supprimer le troisième alinéa du même I.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise à proposer une rédaction unifiée des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pour éviter la constitution, au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions, d'un « guichet unique » qui empêcherait le service public de diffuser des programmes de genre, de style et d'inspiration différents. La diversité éditoriale est la marque du service public ; elle ne doit pas être mise en péril par sa nouvelle gouvernance.
C'est pourquoi la commission propose également de préciser que l'organisation de France Télévisions comprend des unités de programme, au sein desquelles les instances de décision sont collégiales.
Sur ce point, la commission a souhaité concilier deux impératifs d'égale valeur : le premier est la liberté d'organisation de France Télévisions, qui doit pouvoir mener une vraie politique d'achat et disposer d’une vraie capacité de négociation avec les producteurs qui lui proposent d'investir dans des programmes et dans des œuvres ; le second, tout aussi essentiel, est l'impératif d'expression de la diversité créatrice sur les écrans publics. Aussi toutes les décisions ne doivent-elles pas être prises par un seul homme, dont les goûts, les envies et les opinions influeraient inévitablement, parfois même involontairement, sur les décisions d'achat.
Entre cet impératif d'unification des politiques d'achats et celui d'expression de la diversité, la commission pense avoir trouvé un point d'équilibre, celui de la collégialité. Le principe d'une prise de décision collective garantit en effet que la personnalité des décideurs, si éminents soient-ils, n'influera pas sur les œuvres commandées par France Télévisions et que la diversité des inspirations continuera à s'exprimer sur le service public.


L’amendement qui vient d’être présenté parle d’identité. Fort bien ! Mais, ce faisant, il élude discrètement la question du lieu où s’élabore l’identité, du lieu qui la fait vivre et l’invente au quotidien.
Avoir une identité, c’est bien ; avoir l’autonomie de la définir, c’est mieux !
Nous ne nous opposons pas frontalement à la création d’une seule entité « France Télévisions », à l’instar de Radio France. Nous aurions pu le faire si nous avions confondu le projet et ses risques, qui sont réels – la perte d’image, la pérennité menacée, l’érosion des acquis sociaux.
Nous préférons que chacun se responsabilise sur chaque arbitrage, à commencer par celui-ci : si les différentes antennes doivent bénéficier des synergies de la maison mère, celle-ci leur apportant, notamment, toutes les facilitations de gestion, de commandes, de formation, de performance technologique, de moyens, de définition collective de critères communs, chaque antenne doit rester maîtresse de la définition de sa ligne, de son ton et de sa programmation. Cette « autonomie » constitue aussi une garantie pour la liberté de l’information et les droits de ceux qui la font.
Dans un contexte de pilotage vertical, d’intimidations, de pressions, de placement d’amis, de pluralisme étiolé, de tentative de parole unique et de mise en scène laudative de l’homme providentiel – ce qui, au demeurant, fait bien rire nos voisins européens… –, nous sommes aujourd’hui contents de pouvoir « regarder l’autre chaîne » pour faire quelques vérifications. Si, demain, cette possibilité n’apportait rien de neuf, la démocratie serait en berne.

Le sous-amendement n° 439, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du second alinéa du I de l'amendement n° 5.
Le sous-amendement n° 440, également présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du I de l'amendement n° 5 :
A cette fin, les unités de programme instituées en son sein comprennent des instances de sélection collégiales.
La parole est à M. Ivan Renar, pour présenter ces deux sous-amendements.

Ces deux sous-amendements sont fortement apparentés, le second constituant, en quelque sorte, une solution de repli.
L’amendement n° 5, qui reprend, tout en le modifiant, un amendement adopté par l'Assemblée nationale, pose problème pour deux raisons.
Premièrement, il entretient l’idée que les directions des différentes unités de France Télévisions, ainsi que la direction de France Télévisions elle-même, ne sont pas composées de gens responsables. En conséquence, aucun espace de liberté ne leur est laissé.
Si je ne m’abuse, la direction de France Télévisions reçoit des milliers de projets chaque année et, si l’on commence à instituer des commissions un peu trop rigides, les délais d’examen de ces projets vont s’allonger. Or les producteurs se plaignent déjà que les délais sont trop longs.
Il est matériellement impossible pour une seule personne d’examiner l’ensemble des projets. À l’évidence, c’est impensable ! Concrètement, si les membres de la commission ne sont pas d’accord, le projet risque fort d’être bloqué. Pour cette raison, il serait, en tout état de cause, préférable de créer des commissions de sélection plutôt que des commissions de décision. Tel est, notamment, l’objet du sous-amendement n° 440.
Deuxièmement, je ne crois pas que l’organisation des unités de programme puisse relever des cahiers des charges. Il me semble que cette décision relève des compétences du seul président de France Télévisions, sous le contrôle, naturellement, du conseil d’administration. Sinon, le dernier mot reviendrait au CSA, celui-ci ayant le pouvoir de contrôler les cahiers des missions et des charges.
Pour parler franchement, le dispositif prévu par l’amendement n° 5 risque de privilégier les gros producteurs, qui ont déjà leurs entrées à France Télévisions. Or il me semble toujours préférable, dans ce domaine, de privilégier la diversité des producteurs.
Si les deux sous-amendements que nous proposons étaient adoptés, ils nous permettraient de voter en faveur de l’amendement n° 5.
Le premier tend à supprimer la dernière phrase du paragraphe I de cet amendement, ajoutée par l'Assemblée nationale.
Le deuxième tend à modifier cette même phrase qui se lirait ainsi : « À cette fin, les unités de programme instituées en son sein comprennent des instances de sélection collégiales. »
Cette rédaction, simple et compréhensible, atténuerait l’aspect bureaucratique des conséquences que pourrait avoir l’amendement de la commission.

L'amendement n° 247, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
des lignes éditoriales de ses services
par les mots :
et l'autonomie éditoriales des chaînes et des services
La parole est Mme Marie-Christine Blandin.

Dans la mesure où le projet de loi organique vise à accroître la force de la courroie de transmission et des méthodes uniques, il nous semble indispensable de garder dans l’édifice des espaces créatifs libres, autonomes, qui ne seront pas contraints et réduits à l’aspiration unique ni surtout aux affres des cinquante tampons administratifs pour commande conforme.
Même si le président de l’entreprise unique se montre très ouvert, ce dont on peut douter eu égard à son mode de nomination, il ne pourra pas être « multi-schizophrène » et inspirer des tons variés pour plusieurs antennes. La ligne éditoriale doit dépendre du bouillonnement endogène de ceux qui travaillent ensemble, qui se sentent sous une même étoile, qui inventent au quotidien et sûrement pas d’une réunion au sommet une fois par semaine et soumise à la voix de son maître.

L'amendement n° 311, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
le pluralisme et la diversité
insérer les mots :
des programmes,
La parole est à M. David Assouline.

L’alinéa que nous souhaitons compléter a été introduit dans le texte lors de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une amélioration puisqu’il donne obligation à France Télévisions de veiller à ce que la nouvelle organisation garantisse notamment le pluralisme et la diversité de la création et de la production des films et téléfilms.
Nous souhaitons que l’impératif de pluralisme et de diversité s’applique à tous les programmes et pas seulement aux œuvres. Ainsi, en visant l’ensemble des programmes, seront incluses toutes les émissions dites de flux, émissions divertissement, magazines, talk shows, etc. Ce type d’émission doit aussi contribuer à la diversité et au pluralisme.

L'amendement n° 308, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Les unités de programmes chargées des investissements dans les œuvres audiovisuelles d'expression originales françaises et européennes veillent à assurer la diversité de la création en prévoyant en leur sein la présence d'une pluralité de décisionnaires.
La parole est à M. David Assouline.

À l’occasion de la transformation de France Télévisions en entreprise unique, la direction du service public envisage de concentrer les unités de programme aujourd’hui spécifiques à chaque chaîne et de nommer un décideur unique par genre audiovisuel – fictions, documentaires – responsable pour l’ensemble des chaînes du groupe.
Les auteurs de la création audiovisuelle – fictions, documentaires, animations – et plus largement l’ensemble des professionnels participant à cette création – producteurs, distributeurs, techniciens – sont très inquiets de ces projets de réorganisation de France Télévisions.
Comme nous l’avons indiqué lors d’un précédent débat, et nous aurons l’occasion de le répéter, nous ne sommes pas hostiles à la transformation de France Télévisions en entreprise unique. Cela devrait permettre d’en moderniser l’organisation et le fonctionnement.
Toutefois, il est fort à craindre que le passage à l’entreprise unique, tel qu’il est proposé aujourd’hui, ne se fasse au détriment de la diversité et du pluralisme de la création et ne conduise en fait à son uniformisation.
Cet amendement vise à endiguer ce risque. Les éléments communiqués par France Télévisions elle-même mettent en évidence que les responsables n’auront ni autorité ni budget et que les décisions d’investissement dans les œuvres audiovisuelles seront concentrées dans quelques mains uniquement, au risque de fermer les portes de toutes les chaînes du service public à des projets ambitieux et de faire prévaloir le seul regard d’un décideur devenu unique. L’harmonisation des décisions reviendrait ainsi à étouffer la création.
Notre amendement tend donc à prévoir que la constitution d’unités de programme par genre au niveau du groupe maintienne le principe et l’existence de responsables dotés d’une autonomie de sélection et des capacités financières leur permettant de développer des programmes de création.

Bien que la commission n’ait pas examiné les deux sous-amendements déposés par le groupe CRC, par cohérence j’émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 439 et favorable sur le sous-amendement n° 440, qui s’inscrit dans l’idée que la collégialité permettrait d’exprimer des choix, éditoriaux notamment, sans remettre en question l’entreprise unique, laquelle permet de trouver un équilibre d’ensemble entre création et gestion.
En revanche, ne souhaitant pas la remise en cause du principe de l’entreprise unique, la commission ne peut qu’être défavorable au sous-amendement n° 249.
Pour les mêmes raisons, elle est également défavorable à l’amendement n° 247, qui tend à garantir l’autonomie éditoriale des différentes chaînes.
La commission est par ailleurs hostile à la reprise du terme de « pluralisme », qui, lorsqu’il est appliqué aux programmes, n’a guère de signification. Elle estime qu’il est plus opportun de parler de « diversité des programmes », et c’est pourquoi elle propose une nouvelle rédaction de cet alinéa. Dans ces conditions, elle ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 311.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 308. Elle considère en effet que l’un des objets primordiaux de la constitution de l’entreprise unique est précisément de limiter le nombre de décisionnaires autonomes en matière d’achat de programmes dans les différentes chaînes. Connaissant les craintes qu’éprouve le monde de la création à l’idée de la constitution d’un guichet unique au sein de l’entreprise France Télévisions, elle a prévu, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, un certain nombre de mesures de nature à apaiser ces craintes.
Notre objectif, je le répète, est de définir une forme d’équilibre entre entreprise unique et meilleure maîtrise des moyens de gestion, allant de pair avec un souci de création et donc d’identité particulière réservée à cette dernière.
Monsieur le rapporteur, je comprends certes les préoccupations qui ont motivé le dépôt de l’amendement n° 5, mais je souhaite que vous acceptiez d’en modifier quelque peu la rédaction.
Je doute qu’il soit opportun d’instituer des décisions collégiales au sein des unités de programme. Les nombreuses conversations que j’ai eues avec les professionnels m’ont confortée dans l’idée que les décisions doivent être prises par des personnes qui s’engagent. Il faut qu’il puisse y avoir des coups de cœur.
Une décision collégiale au sein de chaque unité de programme risque d’aboutir à la recherche du plus petit dénominateur commun. Elle peut, dans les faits, être à l’origine d’un manque d’audace dans le choix des programmes, d’où ma réticence à adopter ce mode de décision.
Je vous propose donc un sous-amendement qui ne modifierait qu’une partie de l’amendement n° 5. Ce dernier se lirait ainsi : « Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Télévisions veille, par ses choix de programmation et ses acquisitions d’offres audiovisuelles et cinématographiques, à garantir la diversité de la création et de la production dans les conditions fixées par son cahier des charges. »
Cette rédaction présente à mes yeux l’avantage de ne pas faire référence à une décision collégiale au sein des unités de programme.
Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 249. En effet, la diversité est une notion forte pour l’identité éditoriale des différentes chaînes et la notion d’autonomie me paraît contradictoire avec le principe de la société unique.
Le Gouvernement est également opposé au sous-amendement n° 440, qui se réfère à la dimension collégiale sur laquelle je suis très réservée, et à l'amendement n° 247, qui reprend l’idée d’autonomie.
En revanche, il est favorable à l’amendement n° 311, qui ne semble pas soulever de difficulté.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 308, qui vise à introduire l’idée d’une pluralité de décisionnaires, car cela risquerait d’alourdir et de complexifier les processus de choix.


La commission des affaires culturelles n’a bien entendu pas étudié ce sous-amendement, pas plus qu’elle n’avait examiné les sous-amendements de nos collègues communistes, mais je crois pouvoir dire que, si elle l’avait fait, elle n’y aurait pas été favorable.
En effet, nous nous sommes efforcés d’aboutir à un équilibre entre gestion, entreprise unique et création. De ce point de vue, la collégialité, à défaut d’en être l’alpha et l’oméga, de constituer la solution unique, nous semble être la bonne méthode. C’est un peu la situation que l’on connaît dans les maisons d’édition avec les comités éditoriaux : le débat est collégial et la décision se prend au niveau de l’entreprise unique.

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 441.

Ce débat me paraît révélateur.
Je me réjouis que la commission aille jusqu’au bout de ce qu’elle considère comme possible. Ce possible, que nous avions contesté dans un débat constructif, est incarné par le mot « collégialité » qui, selon la commission, suffit à encadrer les intentions premières : une décision unique et un guichet unique, au détriment de la diversité et du pluralisme.
En commission, les rapporteurs ont considéré que la collégialité respectait l’état d’esprit du projet de loi. On nous a soupçonnés de paranoïa parce que nous redoutions qu’il n’y ait un décideur, un guichet unique au détriment d’une pluralité d’acteurs.
Or, comme le montre le sous-amendement n° 441, le Gouvernement considère que la « collégialité » est encore de trop. Cela conforte nos craintes, à savoir que le projet vise bien à supprimer toute diversité.
L’esprit de la loi telle qu’elle est rédigée consiste bien en un rabotage, au travers de l’entreprise unique, de toute la diversité de la création, des guichets, des partenaires en chair et en os. Ceux-ci peuvent parfaitement avoir un coup de cœur pour une œuvre sans que ce choix ne remonte jusqu’au grand financier, qui aura de toute façon le dernier mot et qui, lui, décidera plutôt avec la main sur le portefeuille qu’avec le cœur.
Il me semble donc que le sous-amendement proposé par le Gouvernement rend les intentions de la loi un peu plus claires.
Je suis également content de voir les rapporteurs de la commission s’enferrer dans l’illusion que le terme « collégialité », qu’ils ont retenu, suffira à encadrer le dispositif. Au demeurant, leur détermination va dans le bon sens car cette question reviendra à plusieurs reprises dans le débat. Nous pourrons ainsi retrouver l’état d’esprit commun qui a prévalu au sein de notre commission des affaires culturelles, à savoir conserver la diversité des guichets pour permettre une collégialité réelle. Celle-ci doit être pluraliste et ne peut encourager l’uniformisation.

Nous avons accepté, à l’article 15, un certain nombre d’amendements qui confortent l’architecture globale que nous avons définie. Je le répète, il s’agit de créer une entreprise unique, dont la principale motivation ou une des motivations essentielles sera bien la création. C’est ce chemin que nous essayons de construire ensemble, au sein de la commission des affaires culturelles, et que nous vous proposons aujourd’hui, mes chers collègues.

Bien que n’appartenant pas à la commission des affaires culturelles, je m’intéresse tout de même aux problèmes de la télévision et il me semble que les positions de la commission et du Gouvernement se heurtent sur un seul mot, le mot « décision ».
Madame le ministre, la position que vous avez prise en indiquant que la diversité des programmes sera assurée dans les conditions fixées par le cahier des charges me paraît un peu courte. La commission est allée plus loin et a prévu l’existence d’instances collégiales.
Je crois donc, je le répète, que le mot qui sépare les uns et les autres est le mot « décision ». En supprimant ce terme, qui ne va pas avec le reste de l’article, nous pourrions sans doute aboutir à un accord entre la commission et le Gouvernement, accord qui permettrait de maintenir l’existence des instances collégiales dans le texte. Cette notion est importante pour garantir la diversité.

Cela peut paraître étonnant, mais, un peu pour les mêmes raisons que celles que notre collègue Jean-Pierre Fourcade vient d’énoncer, je souhaite insister sur mon sous-amendement n° 440.
Ce sous-amendement ayant reçu l’accord des rapporteurs, que je remercie, je suis prêt à retirer mon sous-amendement n° 439. En effet, en proposant l’expression « instances de sélection collégiales » à la place de celle d’« instances de décision collégiales », il tend au moins à trouver un terme rassembleur.

Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. Jean-Pierre Fourcade ?

Compte tenu de ce que nous venons d’évoquer, cette proposition nous semble naturellement aller dans le bon sens et elle est conforme à ce que propose le sous-amendement déposé par Ivan Renar. Le mot « sélection » paraît effectivement plus approprié.
Il est également nécessaire de souligner, à ce moment du débat, que nous souhaitons voir figurer un certain nombre de garanties de bon équilibre dans la loi. Certes, il faut se référer au cahier des charges, mais la commission estime aussi important de mentionner la notion d’instances collégiales.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'amendement n° 5.

Je veux ajouter quelques mots sur ce sujet pour éviter toute confusion.
Si le périmètre de la collégialité est réduit à la sélection, j’aimerais bien savoir qui décide.
Pour apporter un éclairage, en particulier à ceux qui n’ont pas entièrement suivi le dossier, je rappelle qu’il existe aujourd’hui plusieurs guichets, qui comprennent chacun des décideurs. En créant une entreprise unique, nous rationnalisons le sommet du dispositif, ce qui peut présenter un avantage. Par exemple, nous pouvons éviter qu’un projet ne tire bénéfice de deux guichets différents.
Mais le système est intéressant à partir du moment où il tient compte de l’avis des guichets qui resteraient en place. En effet, ces entités sont des structures de proximité. Elles disposent d’un gisement de connaissances et permettent de diversifier les demandes.
Ainsi, quand on n’a pas été bien reçu dans un guichet, on peut être mieux écouté dans un autre. Le dispositif offre une chance, notamment aux petits producteurs, de pouvoir frapper à plusieurs portes. La pratique quotidienne démontre qu’une œuvre peut être refusée dans un guichet, puis acceptée dans un autre et rencontrer un grand succès. Si seul le premier refus avait prévalu, elle n’aurait jamais été connue !
De quoi s’agit-il ici ? La commission cherche à bâtir un système dans lequel la pluralité des acteurs subsiste et le choix ne revient ni au guichet particulier ni à un grand « manitou » qui, du sommet, tiendrait les finances et jugerait des œuvres recevables ou irrecevables en fonction de considérations financières ou d’accointances avec de grands producteurs. La décision serait prise par les différents guichets et par le guichet unique, de manière collégiale.
Dire que la sélection est collégiale, c’est s’en remettre à une personne ou au guichet unique pour prendre la décision. Pour ma part, je soutiens l’autonomie des différents guichets et je considère la décision collégiale comme un progrès. Nous évitons ainsi que quelqu’un ne prenne seul la décision.
Par conséquent, monsieur Thiollière, accepter cet amendement tel qu’il est maintenant proposé constituerait un retrait à l’égard de la doctrine que vous avez bâtie dans votre rapport. La collégialité ne serait plus défendue pour décision, mais uniquement pour avis.

Je ne vais pas alimenter ce débat car il entre dans des subtilités de plus en plus fines, qui vont finir par m’échapper.
Pour moi, le sous-amendement du Gouvernement, qui renvoie directement au cahier des charges, est très significatif. De ce fait, l’amendement n°5, modifié par le sous-amendement de M. Ivan Renar, paraît aller tout à fait dans le bon sens, dans le sens de la collégialité et, finalement, de la décision. C’est écrit en toutes lettres !
L'amendement est adopté.

En conséquence, les amendements n° 247, 311 et 308 n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 248, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les chaînes gardent leur autonomie éditoriale.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

J’avais préparé cet amendement de repli dans le cas, sans doute improbable, où nos amendements précédents ne seraient pas compris ni votés… Ce rejet était improbable, disais-je, pourtant, il a visiblement vu le jour en raison de la souplesse du Gouvernement sur ce texte !
La phrase que je propose d’ajouter au texte de loi évoque de nouveau l’autonomie éditoriale, qui a précédemment été invoquée au titre de la diversité et du plaisir à concevoir ensemble.
Madame la ministre, j’ai vraiment l’impression que cette autonomie éditoriale vous fait peur, au même titre que la collégialité dont vous craigniez qu’elle n’engage certains à ne pas prendre leurs responsabilités.
Il ne faut pas considérer l’autonomie comme un acte de sécession. Il faut l’entendre comme ce que l’on demande à un enfant ou à un adolescent. Trouve ton autonomie ! Trouve l’ingéniosité qui te permettra de construire ton propre projet, avec tous tes atouts et dans le cadre des règles communes d’une société au sein de laquelle tu t’épanouiras !
Pour nous, c’est cela l’autonomie : le droit de penser seul, le droit d’avancer des propositions, le droit de mettre en musique sa propre partition !
Monsieur le président, je vous remercie de m’avoir laissé défendre cet amendement, même si tous les votes précédents le rendent caduc contrairement à l’amendement suivant de mon collègue David Assouline, qui apporte des éléments supplémentaires précis.
Je retire donc mon amendement.

L’amendement n° 248 est retiré.
L'amendement n° 307, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de France Télévisions déterminent leur ligne éditoriale et leur positionnement. Ils ne sont pas tenus de réaliser les projets proposés par les unités de programme de France Télévisions.
La parole est à M. David Assouline.

La transformation du groupe France Télévisions en entreprise unique trouve une justification réelle dans la nécessité de proposer aux Français un média audiovisuel public global, capable de diffuser une offre de programmes diversifiés sur l’ensemble des supports existants.
Toutefois, cette réorganisation de notre télévision publique ne doit pas revenir à constituer une société dans laquelle toutes les décisions seraient centralisées et ainsi soumises à une direction dépendant étroitement du pouvoir. C’est précisément ce dont nous débattons depuis tout à l’heure !
Qui plus est, les Français sont particulièrement attachés à leurs chaînes publiques. Chacune d’entre elles a construit depuis longtemps une ligne éditoriale originale, identifiée par le public au travers d’émissions de référence. Pensons par exemple à Thalassa, programme emblématique du service public et, également, marque de fabrique de France 3.
L’autonomie des chaînes publiques dans la définition de leurs programmations contribue, de manière essentielle, à la diversité des programmes et au pluralisme de l’information.
Notre amendement tend donc à inscrire dans la loi l’assurance pour les chaînes de France Télévisions de rester dotées de la capacité de définir leurs lignes éditoriales et leurs positionnements propres.
Cette disposition constituerait d’ailleurs, pour les producteurs français d’œuvres audiovisuelles, la garantie que la télévision publique continuera à commander et à programmer des documentaires, des fictions, des magazines de qualité en fonction de lignes éditoriales diversifiées.

La commission n’est pas favorable à cet amendement, encore une fois pour les questions de principe que nous avons déjà longuement évoquées et sur lesquelles je ne reviens pas.
Nous soutenons l’entreprise unique. Nous pensons même que le projet de loi permet de faire aboutir un processus entamé, en 2000, avec la création de la holding France Télévisions et une coordination de plus en plus forte entre les différentes lignes éditoriales des chaînes. C’est la raison pour laquelle nous tenons à ce principe.
Il est défavorable, monsieur le président, pour les mêmes raisons que celles qu’a exposées M. Thiollière.
L’amendement n’est pas adopté.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 6, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.

Si elle souscrit à l’objet du dernier alinéa du I de l’article 1er, la commission ne peut cependant que constater son caractère largement redondant avec la législation existante. En effet, le premier alinéa de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, créé par la loi du 31 mars 2006, précise déjà que les sociétés de l’audiovisuel public « mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la société française ».
Par ailleurs, la commission, qui a débattu de cette question, n’estime pas souhaitable de citer spécifiquement la « diversité ethnoculturelle », laquelle ne représente qu’un aspect – même s’il est essentiel – de la diversité de notre pays. À cet égard, elle attache également de l’importance à ce que, par exemple, la présence et la place des femmes soient assurées dans les programmes ; or, comme je l’ai souligné au cours de la discussion générale, il reste beaucoup de progrès à faire en la matière !
Enfin, rappelons que l’article 1er A du présent projet de loi, en confiant au CSA le soin de rendre compte chaque année au Parlement des actions conduites par les chaînes pour que leur programmation reflète la diversité de la société française, incite naturellement celles-ci à développer lesdites actions.
Pour toutes ces raisons, la commission vous propose, mes chers collègues, de supprimer ce dernier alinéa du I de l’article 1er.

L’amendement n° 300, présenté par Mme Khiari, MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel, Fichet et Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :
notamment ethnoculturelle
La parole est à Mme Bariza Khiari.

J’ai toujours été favorable à la promotion de la diversité sous toutes ses formes : sociale, ethnique, culturelle, religieuse, de genre, de préférence sexuelle, de vie… La diversité, et personne n’y verra de paradoxe, s’inscrit nécessairement dans la variété tant de ses formes que de son contenu. Les médias publics se doivent de refléter le mieux possible cette diversité sous ses multiples formes.
La rédaction du dernier paragraphe de la première partie de l’article 1er me paraît fort étrange. Je suis surprise que le législateur croie bon d’ajouter en incise « notamment ethnoculturelle » au mot diversité. Que veut-on dire par là ? Quel message essaie-t-on de faire passer tant aux chaînes qu’au peuple français ?
À mon sens, nous sommes en présence d’un cas typique de fausse bonne idée : sous prétexte que les médias accordent encore trop peu de place aux personnes issues de l’immigration, on voudrait corriger cet état de fait en mettant au premier plan la diversité ethnoculturelle. Cela me chagrine, car, en agissant ainsi, on stigmatise davantage les populations visées au lieu de les aider. En effet, il en résulte l’impression qu’il s’agit d’une diversité particulière nécessitant un travail spécifique, alors même que les populations concernées sont soucieuses de s’intégrer comme des membres à part entière de la société française. Voudrait-on les dissocier plus encore des « citoyens normaux » qu’on ne s’y prendrait pas mieux !
Je reste soucieuse de la nécessité de promouvoir la diversité ethnique, mais au même titre que la diversité sociale, de genre, de préférence sexuelle, etc. On ne doit pas donner l’impression de conférer un statut particulier à certaines catégories de la population.
Pire, cette mention me rappelle les statistiques ethnoraciales auxquelles le Président de la République a finalement renoncé. On ne doit pas renouer avec un vieux démon des quotas qui, plus que tout, serait préjudiciable au combat mené.
En supprimant l’épithète « ethnoculturelle », la Haute Assemblée réaffirmerait les valeurs de notre République. Cette mention affaiblit la cause que l’on croit défendre grâce à elle.

L’amendement n° 299, présenté par Mme Khiari, MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel, Fichet et Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
À la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
dans les programmes
par les mots :
dans l’ensemble de ses programmes.
La parole est à Mme Bariza Khiari.

Cet amendement porte sur le même thème que le précédent mais aborde un autre aspect, que nous avons déjà évoqué à propos du CSA.
La visibilité de la diversité est essentielle en ce qu’elle offre au téléspectateur une vision proche de la réalité de la société. Elle assure une prise de conscience nécessaire de la richesse de notre pays. Plus encore, ce qui est visible est, par là même, audible. Dès lors, la diversité affichée sur les écrans permet à de nombreuses populations de passer du statut d’éléments marginaux de la société à celui de parties constitutives de notre société et de notre République.
La visibilité est donc un catalyseur partiel de l’intégration, dont il peut de toute évidence former l’un des piliers principaux. On se sent en effet moins exclu quand on a le sentiment, en regardant son poste de télévision, que la société vous accepte.
Plus encore, l’évolution des mentalités qui se fait jour par le biais des médias est un élément structurant et prépondérant. Les médias contribuent grandement à construire les représentations et peuvent participer à une meilleure compréhension de l’autre.
La nouvelle rédaction proposée dans l’amendement n° 299 tient compte de l’importance d’une action globale sur l’ensemble des programmes.

L’amendement n° 201, présenté par MM. Hérisson, P. Dominati et Juilhard, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Elle veille à donner une capacité d’acquisition et de production de programmes propres à France Ô en lui réservant 1 % du coût financier de l’ensemble de la grille des chaînes qui la composent.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?

Sur le fond, nous sommes tout à fait d’accord avec les amendements n° 300 et 299, et nous avons déjà eu l’occasion, lors de la discussion d’autres articles, d’aborder cette question de la spécificité « ethnoculturelle », qui nous laisse, nous aussi, dubitatifs.
Ces deux amendements seront en réalité satisfaits par l’adoption de la proposition de la commission et, de ce fait, n’auront plus d’objet. J’en demande donc le retrait.
Sur l’amendement n° 6, auquel, sur le fond, il adhère, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. En effet, comme l’a souligné la commission, les obligations de diversité figurent déjà dans la loi de 1986.
Je m’en remets également à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 300, car il est exact que, finalement, la diversité peut englober cet aspect « ethnoculturel ».
En revanche, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 299, car il lui paraît tout de même très contraignant de poser que chaque programme doit refléter la diversité de la société.

La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote sur l’amendement n° 6.

Je voudrais apporter mon appui à l’amendement présenté à l’instant par Mme Bariza Khiari.
Comme la commission, je suis sûr que l’accord est général dans cet hémicycle pour ne pas accepter, quelles que soient les circonstances, des définitions qui ne mettent pas que l’organisation de la programmation elle-même en difficulté, et Mme le rapporteur a présenté les choses d’une façon qui était peut-être destinée à rendre cette suppression acceptable sans que son motif philosophique apparaisse.
La République française n’a pas à connaître une ethnodiversité qui n’existe pas en son sein.

Toutes les occasions de refuser les définitions de ce type sont les bienvenues, parce qu’elles nous permettent de nous rappeler ce qui nous rassemble.
Cela ne signifie pas que les Français soient tous identiques, qu’ils n’aient pas d’origines diverses, qu’ils n’aient pas de culture qui les précède dans leur existence actuelle. Cela signifie que la France est le résultat de l’amalgame de tout cela.
Voilà ce qu’est la France, voilà de quelle façon elle se fera ! La France est en devenir, la France est en construction, et tous ses enfants y participent à égalité. Le résultat, nous le partageons tous, de la même manière que, aujourd’hui, nous partageons tous le goût du couscous ou celui de la bouillabaisse – vous le savez mieux que personne, monsieur le président !
Sourires

C’est la raison pour laquelle il ne peut être en aucune façon question de reconnaître si peu que ce soit des faits qui ne nous intéressent pas, non pas que nous les méprisions, mais parce que nous ne voulons pas les figer.
Il est en revanche une diversité sur laquelle, pour ma part, je voudrais attirer l’attention de ceux qui font les programmes : il pourrait être important que les héros des séries télévisées qui ont du succès soient plus souvent des femmes, que l’on y voie davantage d’ouvriers, de plombiers-zingueurs, d’électromécaniciens…, au lieu des habituels politiciens ou policiers. Car telle est la France et, si elle veut se donner à voir, si elle veut encourager ses enfants à participer à tous les efforts qui la forgent, alors, il faut qu’elle montre à égalité de dignité tous ceux qui la composent et non pas toujours les mêmes : blancs, masculins et riches.

Je comprends bien que l’expression « notamment ethnoculturelle » puisse poser problème. Cependant, l’adverbe « notamment » n’est pas exclusif : il est distinctif de l’une des formes de la diversité à laquelle il convient de prêter une attention particulière, parmi les autres et non contre elles.
Il est bien vrai, et ma collègue l’a souligné, que « la télévision actuelle est majoritairement blanche, bien portante, “cadre” et masculine ». Cela plaide en faveur d’un effort portant sur toutes les formes de la diversité.
Je partagerais totalement l’idée d’un vocable générique de la diversité si toutes les formes de celle-ci évoluaient de la même façon ou si elles étaient toutes défendues avec la même vigueur et avec les mêmes résultats. Or ce n’est pas le cas !
La réalité est ce qu’elle est et, quand un gouvernement, dans un contexte de résistance des mentalités, veut réellement faire avancer l’acceptation d’une différence, il le fait en s’appuyant sur une loi contraignante, comme ce fut le cas avec la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Non seulement ce texte réaffirme le principe de l’obligation, pour les entreprises comptant au moins 20 salariés, d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés, mais il va jusqu’à renforcer les sanctions, à créer des incitations et à étendre celles-ci aux employeurs publics. Je me garderai bien de critiquer l’ingérence de cette loi dans la politique des entreprises ! Et, pour ma part, je considère que, demander des indicateurs de résultats, ce n’est pas fixer des quotas !
Prenons un autre exemple : la question de la parité et de l’égalité entre hommes et femmes a avancé grâce à la loi du 9 mai 2001, qui explicitait clairement ses objectifs sur des points précis.
Objectivement, la visibilité des femmes à la télévision a évolué, et les résultats sont nettement plus significatifs que pour la visibilité de la diversité des origines. Concrètement, en 2007, la part des femmes dans les journaux télévisés a été de 19, 5 %, contre 80, 5 % pour les hommes. C’était encore trop peu, mais c’était déjà bien plus qu’en 2005, où la part des femmes était de 15 % : quatre points de plus en deux ans, là où la diversité des origines a gagné… un point en dix ans ! Dans le même récent rapport du CSA, en effet, on apprend que, « s’agissant des animateurs et présentateurs, la part des personnes “vues comme non-blanches” passe de 6 % en 1999 à 7 % en 2008 ».
Lorsqu’un Noir a présenté, en 2006, le journal télévisé sur TF1, cela a eu indiscutablement une forte portée symbolique et a d’ailleurs donné lieu à d’innombrables articles et débats dans les médias, ce que ne produit plus l’apparition d’une nouvelle femme dans un journal télévisé !
Il y a donc des domaines où les pratiques et les mentalités évoluent réellement et d’autres où les choses stagnent lamentablement. Il faut en prendre acte et agir en conséquence. Toute autre attitude serait hypocrite et irresponsable.
Je terminerai mon propos – j’ai envie de dire mon plaidoyer – en citant encore une fois ma collègue Mme Bariza Khiari, dont l’intervention jeudi dernier sur le rôle fondamental des médias dans l’évolution des mentalités m’a décidément marqué : « Pour rapprocher les gens, pour briser ces frontières parfois indicibles, pour lutter contre les discriminations, il faut veiller non seulement à rendre visible la diversité, mais aussi à la faire voir sous des formes un peu plus positives. L’enjeu est essentiel. La visibilité est le catalyseur partiel de l’intégration, dont il peut constituer de toute évidence l’un des principaux piliers. On se sent en effet moins exclu quand on a l’impression, en regardant son écran, que la société vous accepte. Les médias jouent un grand rôle dans l’évolution des mentalités, dans la capacité de chacun à briser les stéréotypes de représentation de l’autre. »
En définitive, je crois profondément aux avancées démocratiques exprimées par des actes politiques forts, qui ont pour mission historique de bouleverser le rythme d’évolution du corps social afin de lui donner la dimension humaniste et équitable qui fonde notre civilisation moderne.

Je souhaite apporter quelques éléments de réponse aux collègues qui viennent de s’exprimer.
Monsieur Mélenchon, je vous rassure : le débat dans l’hémicycle n’est pas la répétition des débats que nous avons en commission. Quand nous avons proposé la suppression de cet alinéa, il était bien entendu que le terme « ethnoculturelle » nous dérangeait. C’est une des raisons qui ont conduit Michel Thiollière et moi-même à proposer d’emblée cet amendement.
En ce qui concerne les femmes, il est vrai que des progrès ont été réalisés, mais je vous renvoie à un rapport que Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité, a confié à Mme Michèle Reiser, membre du CSA et présidente d’une commission qui a réfléchi sur l’image des femmes dans les médias. Il démontre que, si de réelles avancées ont été accomplies sur ce point, des améliorations peuvent encore être apportées.
Selon un recensement cité dans cette étude, la France est très largement en dessous d’une moyenne mondiale qui établit à seulement 21 % la présence des femmes dans les médias, contre 79 % pour les hommes. La France affiche en effet un pourcentage légèrement inférieur à 18 % quant à la présence de femmes dans les médias.
J’attire votre attention sur le fait que, d’après une étude menée actuellement par le CSA, les seize chaînes de la TNT réservent 37 % de place sur les écrans aux femmes. Dans la presse hebdomadaire, les hommes font trois fois plus souvent l’objet de photos que les femmes et les journaux télévisés ne comptent que 32 % de prises de parole par des femmes.
Tels sont les éléments que je voulais apporter à la réflexion en cours, afin de montrer à quel point nous partageons tous cette préoccupation de voir très largement s’améliorer, sur les chaînes de télévision, la diversité dans tous ses aspects.
L'amendement est adopté.

En conséquence, les amendements n° 300 et 299 n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
I. - Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.
« À travers sa grille de programme, France Télévisions contribue, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. »
II. - Supprimer le IV de cet article.
La parole est à M. Michel Thiollière, rapporteur.

Il nous semble que la diversité, c’est aussi celle de nos territoires.
L'Assemblée nationale a souhaité inscrire dans la loi la mission régionale du service public. La commission approuve ce choix et elle a tenté à son tour de définir cette mission qui est assurée à titre principal par France 3, chaîne des régions par excellence.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le fait que France Télévisions non seulement diffuse, mais également conçoit des programmes en région : l'existence de directions régionales et d'antennes locales est ainsi directement garantie. De plus, cette nouvelle rédaction, qui vise à se substituer au IV de l’article 1er, consacre le principe des décrochages régionaux, y compris aux heures de grande écoute, et affirme explicitement que ces émissions à caractère régional peuvent être reprises au niveau national.
Notre commission a la conviction que le potentiel de France 3 est sous-exploité : cette chaîne, à laquelle nous sommes tous si attachés, dispose en effet d'un réseau local suffisamment dense et de qualité pour produire plus de programmes régionaux qu'elle ne le fait aujourd'hui. Nous en voulons pour preuve le site « Culturebox » que France 3 a mis en place et qui propose l'ensemble des émissions culturelles réalisées en région.
Permettez-moi, en l’absence du président Jacques Legendre, de dire au passage que « Culturebox » n’est pas nécessairement la dénomination la plus heureuse et qu’il conviendrait sans doute de lui trouver un nom français.
Tous ces programmes pourraient être repris au niveau national : cela permettrait d'affirmer l'identité de France 3, que sa vocation régionale distingue, par exemple, de France 2.
Je crois utile d'apporter ici une précision essentielle : la commission n’estime ni souhaitable ni nécessaire de porter atteinte au caractère national de France 3 et elle mesure l'intérêt de disposer d'une rédaction nationale au sein de cette chaîne ; mais la grille de France 3 a vocation, plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, à comporter des programmes réalisés en région.
Enfin, cet amendement conserve la précision apportée par l'Assemblée nationale, qui avait souhaité consacrer le rôle singulier que joue France 3 en matière d'expression des langues régionales dans les territoires où celles-ci sont encore vivaces. Au moment où le Constituant a consacré leur existence, il serait incompréhensible que cela ne figure pas parmi les missions du service public.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission présente cet amendement, en soulignant que France 3 a peut-être tendance à négliger de façon un peu trop régulière ce qui se passe en région et à ne pas le relayer suffisamment au niveau national ; nous en avons certainement tous de nombreux exemples en tête.

Le sous-amendement n° 250, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'amendement n° 7, après les mots :
France Télévisions
insérer les mots :
par sa chaîne France 3
II - Procéder à la même insertion dans le troisième alinéa du I du même amendement.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Il ne manque, dans l’amendement présenté par la commission, que la mention d’un nom : celui de France 3.
La commission Copé, chargée de réfléchir à l’avenir de la télévision publique sans publicité, a proposé de renforcer l’identité régionale de France 3 par un renversement de son mode de fonctionnement : « Au lieu d’une chaîne nationale et de décrochage en région, elle ferait place à un réseau de chaînes régionales, faisant une plus grande place aux rendez-vous d’information de proximité, avec un décrochage national. »
Voilà une curieuse idée de la part d’une commission à la française parce ce que cela fait penser au fédéralisme des Länder allemands, fédéralisme tant redouté en France quand on parle de décentralisation…
C’est bien la preuve que ces propositions ont été faites à la hâte, sans concertation avec les personnels et les professionnels de l’audiovisuel, au risque du démantèlement de France 3, sur laquelle les grands groupes de la presse quotidienne régionale jettent un regard gourmand.
Élus locaux et régionaux vivent depuis des décennies avec France 3. Nous en connaissons les atouts, nous nous considérons, vis-à-vis des habitants de nos collectivités, comme directement concernés par son avenir, car c’est un indispensable élément d’animation de nos territoires.
Les responsables successifs ont souvent eu, hélas, un regard un peu trop parisien. Nous disposons là d’un bijou inégalé en Europe et, dans un univers passablement globalisé, les habitants ont aussi besoin de miroirs et d’ouvertures de proximité. Pour eux, l’écran de France 3, c’est l’outil du penser et agir local et global.
Nous avons bien perçu, vendredi dernier, les réticences du Gouvernement à nommer les chaînes : on préfère la grande firme mère, dirigée par un obligé de l’Élysée.
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Mais, devant le risque de dégâts collatéraux, la commission éprouve tout de même le besoin de présenter un amendement concernant les missions de France Télévisions à l’échelon local.
Il faut, me semble-t-il, aller jusqu’au bout des choses. Vous avez entendu l’argumentation de M. Thiollière : il a cité au moins six fois France 3 en défendant son amendement. Alors, madame la ministre, pourquoi ne pas faire figurer le nom de cette chaîne dans la loi ?

L'amendement n° 289, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Au début du deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots :
Elle conçoit
insérer les mots :
, produit, fabrique
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Cet amendement vise à introduire de nouveau les notions de production et de fabrication parmi les nobles missions des services de France Télévisions, et il s’agit cette fois-ci de France 3 et de la palette de ce qu’elle sait faire : la conception, la création, l’achat, la programmation, la diffusion.
Les antennes régionales de France 3, nous le constatons souvent, souffrent déjà des contraintes très rigides des décrochages. Elles disposent de moyens techniques mobiles vieillissants. Pourtant, elles ont une cote d’amour très élevée dans le cœur des spectateurs. Elles proposent d’ailleurs des fictions fort bien réalisées et qui, sans doute parce qu’elles se nourrissent d’une mosaïque de mémoires collectives, rencontrent un succès qui n’a rien à voir avec celui de certains programmes nationaux.
Mes chers collègues, vous avez tous vu, à des degrés différents selon vos régions, ces réalisations endogènes, comme ces productions judicieusement commandées.
Même si Mme la ministre nous a dit dans la nuit de jeudi que rien n’empêchait aujourd’hui la création et la production en interne, nous nous devons de rassurer les spectateurs, ainsi que les professionnels, sur cette possibilité que nous souhaitons durable. En effet, quand on demande à une antenne locale de prêter son matériel à des producteurs privés, alors qu’elle a elle-même un projet en interne qu’elle ne pourra pas réaliser, les doutes grandissent et il serait mieux d’écrire dans la loi ce que vous nous avez dit jeudi.

La commission souhaite définir dans la loi l’esprit dans lequel doivent fonctionner les groupes de l’entreprise unique, ou entreprise commune, comme on l’appelle maintenant en son sein, qui favorise la diversité et qui permet à l’expression des territoires de se donner aussi à voir et à entendre au niveau national.
Il s’agit non pas de s’attacher à une chaîne et à son nom, mais de définir le contenu que nous souhaitons voir repris en main par le service public. Telle est la raison pour laquelle la commission, tout en en partageant l’esprit du sous-amendement n° 250, émet un avis défavorable à son sujet, car il tendrait à figer les choses en l’état.
Quant à l’amendement n° 289, il va encore plus loin : il vise à « ossifier » France 3 dans ses moyens de production. Or la commission souhaite garantir la liberté et l’indépendance qui sont mises en œuvre par les moyens de France Télévisions. Aussi bien la commission est-elle également défavorable à cet amendement.
J’adhère totalement au contenu de l’amendement n° 7, mais il me paraît relever davantage du cahier des charges que de la loi ; c’est pourquoi je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
Le sous-amendement n° 250 vise à réintroduire la notion juridique de France 3. Le Gouvernement y est donc défavorable.
Il en va de même concernant l’amendement n° 289. Je rappelle une nouvelle fois que plus de 50 % des programmes de France Télévisions sont produits en interne. Cette possibilité existe déjà dans la loi de 1986 et il ne me semble donc pas nécessaire de l’expliciter.

Il serait effectivement souhaitable de préciser qu’il s’agit de France 3, comme l’a demandé Mme Blandin. Faute de cette mention, l’amendement de la commission sera moins clair, mais je le voterai de toute façon, le considérant comme un amendement de repli.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'amendement n° 289 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 309, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle garantit l'indépendance éditoriale de ses rédactions et le respect du pluralisme politique, dans ses différents services. »
La parole est à Mme Catherine Tasca.

Cet amendement est un rappel au nécessaire respect du pluralisme politique – j’ai même envie de dire un rappel à l’ordre.
Il est aujourd’hui évident que le rôle joué par les médias dans la société en général n’est absolument plus comparable à ce qu’il était il y a quarante ou cinquante ans.
La « société de l’information » est une réalité à l’heure où la vie de nos concitoyens, dans ses différentes dimensions sociales comme dans la sphère privée, est de plus en plus marquée par les médias.
Selon une étude récente, chaque Français de 13 ans et plus a eu, en moyenne, en 2007, plus de 41 contacts par jour avec un « support média ou multimédia », les 15-24 ans ayant eu, pour leur part, plus de 45 contacts quotidiens. De plus, neuf Français sur dix regardent la télévision tous les jours, huit sur dix écoutent la radio ou lisent la presse écrite et plus du tiers d’entre eux « surfent » sur internet.
La notion de « média de masse » n’a donc jamais été autant d’actualité et doit conduire le législateur à considérer le rôle des médias dans la société et l’espace public comme un véritable pouvoir dont il convient de mieux encadrer l’exercice pour éviter que ses utilisateurs n’en abusent.
Tel est d’ailleurs le sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a reconnu le pluralisme comme objectif de valeur constitutionnelle, en affirmant dans une décision du 18 septembre 1986, par exemple, que le respect du pluralisme de l’expression des différents courants politiques et socioculturels sur les supports de communication audiovisuelle est l’« une des conditions de la démocratie ».
Or l’évolution actuelle de l’économie du secteur de la communication et les liens étroits qu’entretient le Président de la République avec la plupart des patrons de presse, de radio et de télévision nous font penser que cette garantie apportée par le Conseil constitutionnel au pluralisme est devenue insuffisante.
En effet, à l’heure de la dématérialisation de l’information, des groupes de communication intégrant une multiplicité de supports, de contenants et de contenus dominent le marché. En France, cette concentration va au-delà du secteur de la communication ; tous ces grands groupes tirent une part substantielle de leurs revenus de commandes publiques.
Ce phénomène de concentration, unique au monde, est d’autant plus inquiétant que l’actuel chef de l’État entretient des relations de proximité affirmée avec tous les patrons de ces grands groupes et ne se prive pas d’en user, voire d’en abuser, pour influencer la ligne éditoriale des principaux médias du pays.
La réforme du mode de désignation des responsables de l’audiovisuel public n’est sans doute pas étrangère à cette manière de faire.
Ces pratiques justifient l’inquiétude des journalistes quant à l’évolution des conditions d’exercice de leur métier, alors que certaines voix, dans la majorité, relaient les revendications des industriels et des financiers qui ont investi dans la presse en demandant que le législateur assouplisse encore les règles d’emploi et de déontologie d’une profession dont l’indépendance est une condition absolument nécessaire au pluralisme.
Dans ce contexte, le service public audiovisuel a donc une responsabilité particulière et contribue de manière essentielle au pluralisme de l’information, dont il doit constituer une garantie substantielle. En ce sens, l’indépendance de la télévision publique doit être regardée comme l’« une des conditions de la démocratie ».
C’est pourquoi il convient de compléter la loi du 30 septembre 1986 pour donner une portée légale à l’indépendance éditoriale des rédactions de France 2, France 3 et France Ô ainsi qu’au respect du pluralisme politique sur l’ensemble des antennes de France Télévisions.

La commission est favorable à la garantie de l’indépendance éditoriale des rédactions, et a d’ailleurs adopté un amendement en ce sens jeudi dernier.
Toutefois, elle éprouve les plus grands doutes à l’idée d’organiser le respect du pluralisme politique dans les différentes rédactions et services de France Télévisions. Elle craint, en effet, que cette disposition ne puisse servir de base légale à une politique de recrutement au sein de France Télévisions, qui veillerait alors à composer ses services et ses rédactions en procédant à un savant équilibre entre les différentes sensibilités politiques.
Mme Catherine Tasca s’étonne.
L’indépendance éditoriale des rédactions est une réalité qui s’impose à nous en permanence et qui perdurera, d’autant qu’elle s’appuie sur la loi de 1881, sur les dispositions constitutionnelles et sur la loi de 1986. Elle me semble donc suffisamment garantie.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Levons tout malentendu : l’amendement n° 309 ne vise nullement à faire en sorte que le recrutement des journalistes et des personnels reproduise l’éventail des différentes sensibilités politiques.

Monsieur Pasqua, ne nous ressortez pas cette vieille lune selon laquelle la droite serait maltraitée partout où l’on pense et tous les journalistes seraient forcément de gauche ! Vous pouviez encore le faire croire dans les années 1970.

Franchement, nous dire aujourd'hui que les rédactions sont truffées de journalistes liés à la gauche, alors que sont placés, tous les jours, à tous les postes de commande, dans le privé comme dans le public, des amis de l’actuel pouvoir politique ! Car c’est cela que tout le monde perçoit !

C’est d’ailleurs l’un des enjeux de notre débat.
Mais là n’est pas le sujet de mon intervention.
L’amendement n° 309 vise simplement à préciser que la nouvelle organisation garantit l’indépendance des rédactions et le respect du pluralisme politique. Nous devons veiller à garantir l’indépendance et le pluralisme des lignes éditoriales lors des échanges de points de vue et des prises de position. Ce point ne prête pas à confusion, madame le rapporteur.
Quant à Mme la ministre, elle ne s’embarrasse pas de nuances dans sa réponse : aujourd'hui, l’indépendance des médias ne pose pas problème ; toutes les garanties sont déjà apportées. Mais si tout était bordé, si les lois et les jurisprudences garantissaient tout, on ne pourrait connaître aujourd'hui la situation que Mme Tasca a décrite tout à l'heure !
Peut-on, oui ou non, aujourd'hui, vivre de la commande publique et par ailleurs posséder des médias ? Oui, et massivement même ! C’est le cas de Bouygues ou d’un autre groupe qui vend des Rafale et possède dans le même temps un groupe de presse. Un éminent sénateur représente d’ailleurs bien ici cette confusion des genres !
Aujourd'hui, les médias occupent une telle place dans la vie quotidienne des Français qu’il est de l’intérêt de tous de poser le problème, y compris de notre intérêt à nous en tant que membres de la représentation parlementaire : nous devons veiller à ce que le pouvoir politique, quel qu’il soit – car les alternances auront lieu, messieurs de l’UMP, et vous défendrez peut-être alors ce principe ! –, n’empiète jamais sur l’indépendance et le pluralisme des médias. Quels que soient les pouvoirs politiques, nous devons défendre non pas nos petits intérêts personnels, mais tout ce qui fait avancer la démocratie.
Nous continuerons à insister sur ce point, car c’est l’un des enjeux de société des prochaines années. Les médias ont pris une place telle dans la vie politique que l’on ne pourra même plus, à un moment donné, parler librement à l’extérieur des enceintes parlementaires. Or ce qui ne pourra pas se dire dehors ne se dira pas non plus dedans. Comme le disait Victor Hugo, il y aura le silence au dehors ! Et vous verrez, mes chers collègues, que vous pourrez difficilement dire, y compris dans les couloirs de notre assemblée, que vous êtes choqués par la manière dont le Gouvernement s’est conduit en n’attendant même pas le vote du Sénat pour demander au président de France Télévisions de supprimer la publicité. Si certains d’entre vous ont pu faire savoir qu’ils n’étaient vraiment pas contents, comme je l’ai lu dans une dépêche de l’AFP qui les a précisément nommés, c’est parce qu’il y a des médias indépendants.
Lorsqu’il ne sera plus possible de faire part de son opinion à l’extérieur, ce sera encore moins possible dans les enceintes parlementaires. La liberté des médias intéresse tous les hommes et toutes les femmes politiques qui veulent défendre la démocratie, a fortiori les parlementaires !

Le mieux est souvent l’ennemi du bien.
Très sereinement, j’indique que je ne voterai pas un amendement qui vise à demander à chaque journaliste la carte de son parti politique, car c’est franchement inacceptable !
Très bien ! sur les travées de l ’ UMP.

J’interviens sur cette question parce que j’ai été journaliste, responsable de rédaction, puis rédacteur en chef, pendant trente-six ans.
Dès lors qu’un rédacteur en chef sait que tel journaliste est proche d’un parti politique, il commettrait justement une erreur en l’envoyant couvrir le congrès de ce même parti, …

… et ce pour différentes raisons.
En effet, pour démontrer qu’il n’est pas trop proche de ce parti et qu’il ne prend pas position, le journaliste en question aura tendance à amplifier les idées inverses.
Mes chers collègues, il ne faut surtout pas mettre le doigt dans un tel engrenage. Il faut rester tout à fait indépendant et essayer d’être objectif même si, vous le savez aussi bien que moi, l’objectivité n’existe pas en matière d’information. Les journalistes ne peuvent que s’efforcer de tendre vers l’objectivité. Et cela tout simplement parce que, dans une rédaction, quelle qu’elle soit, les sources d’information et les dépêches sont déjà sélectionnées par les rédacteurs en chef des agences. Le journaliste est donc déjà lié par une sélection des informations en amont.
De plus, dès lors que vous discutez dans une rédaction des problèmes politiques, il n’y a définitivement plus d’objectivité possible.
Mon cher collègue, vous pouvez dire tout ce que vous voulez et digresser sur les responsables, l’expérience m’a prouvé jusque très récemment qu’il est très difficile d’être objectif. Vouloir instaurer un équilibre politique, c’est pire que de ne pas en parler !

Nous ne pouvons pas laisser passer cette caricature de nos propositions. On nous parle là d’un amendement qui n’a pas été déposé ! Tous ceux qui prendront la peine de lire notre amendement pourront vérifier que ce qui y est écrit ne correspond nullement à l’histoire qu’on nous raconte ! Il ne s’agit nullement d’un partage des cartes des partis politiques entre les différents professionnels.
Nous souhaitons préciser que France Télévisions « garantit l’indépendance éditoriale de ses rédactions et le respect du pluralisme politique, dans ses différents services », afin de préserver les conditions d’exercice du journalisme et la totale indépendance du travail des équipes rédactionnelles. Il n’est donc pas question, et vous le savez bien, de s’amuser à demander des comptes politiques à chacun des acteurs !
Vous êtes en train d’agiter une espèce de croquemitaine, mais, fort heureusement, aujourd’hui, vous n’avez aucune chance de faire peur à qui que ce soit. À moins que vous ne cherchiez plutôt à faire oublier la tentation très forte, chez l’autorité la plus élevée du pays, de confier à ses amis les plus proches les postes à responsabilités importantes en matière d’information...
Nous le répétons, cet amendement ne traite absolument pas de la couleur politique des journalistes : il ne vise qu’à réunir les conditions objectives d’un travail indépendant des équipes dans les rédactions de France Télévisions.

Je remercie notre collègue Catherine Tasca de nous avoir apporté ces précisions à propos de sa proposition, et son intervention me permet de souligner le caractère tout à fait étrange des propos tenus précédemment.
Je voterai cet amendement et je veux expliquer pourquoi.
J’ai compris qu’il s’agissait ici, en matière de respect du pluralisme politique, de l’objet final et non du point de départ.

M. Jean-Luc Mélenchon. Or le pluralisme politique n’est pas toujours respecté. À regarder les petits écrans, on a l’impression, dans de nombreuses circonstances, qu’il n’existe qu’un parti dans ce pays
Protestations sur les travées de l ’ UMP

À propos d’objectivé, je dis tout de suite à notre collègue del Picchia, qui a donné un point de vue d’ancien professionnel, que personne ne fait une telle demande !
Par définition, nous savons tous, philosophiquement, que la vérité est inaccessible à l’intelligence humaine. On ne peut que l’approcher par la confrontation des points de vue.
Sourires

Voilà ce qui la rend possible !
Que demande-t-on au service public ? De permettre aux citoyens d’approcher le sujet en connaissant les diverses voies qui y conduisent. Mais c’est le contraire de ce qui se passe ! Pourquoi ? Ce n’est pas, monsieur del Picchia, parce que tel ou tel journaliste a la carte de tel ou tel parti. En tant que citoyen, c’est bien son droit d’être engagé, et je l’en félicite. Là n’est pas le sujet et, de toute façon, les choses ne se passent pas comme cela.
En vérité, la production de l’information est socialement déterminée. Si vous examinez la composition des rédactions, vous découvrirez une masse X de journalistes ayant un CDI et protégés de cette manière dans l’exercice de leur métier, et une masse Y, beaucoup plus importante, composée d’une foule d’intérimaires et de travailleurs précaires, donc sans aucune des conditions sociales leur permettant de faire valoir leur esprit critique. Par conséquent, remonte du bas vers le haut un conformisme socialement contraint, auquel personne ne peut se soustraire !
La défense du pluralisme politique concerne donc non seulement l’objet final de ce qui est produit, mais aussi les conditions initiales de la production de l’information dans les entreprises publiques. Voilà pourquoi ces deux questions se touchent et, que l’on soit de droite ou de gauche, on a raison de dire qu’il s’agit là d’un bien commun.
Une information factuelle, une information qui éclaire le point de vue des citoyens, est préférable au martèlement d’un point de vue unique, quel qu’il soit d’ailleurs, qu’il concerne les orientations politiques au sens le plus étroit du terme ou philosophiques au sens plus large.
Nous ne gagnons rien à ce que la parole officielle, en tout cas ressentie comme telle par nos concitoyens – « C’est vrai puisque c’est dans le journal ! », disait-on autrefois –, soit perçue comme un discours unique, parce que vous n’empêcherez pas la diversité de s’exprimer dans la société et d’être ressentie de manière confuse, au détriment, pour finir, de la démocratie elle-même, si les citoyens finissent par penser que toute parole qui leur est proposée est un mensonge ou un trafic.
Veillons donc aux conditions sociales de la production de l’information. Soyons vigilants en rappelant le principe du pluralisme politique comme l’accomplissement de ce travail politique. Alors, nous aurons fait de la bonne besogne.
Et n’allez pas dire qu’ici quelqu’un veut contrôler les cartes de parti, parce que, finalement, c’est très facile à faire : tous ceux qui sont au placard sont de gauche et tous les autres sont de droite !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
L'amendement n'est pas adopté.

Maintenant que le vote a eu lieu, je veux ajouter un mot, monsieur Mélenchon.
J’ai connu un directeur de journal qui se faisait lire la veille ce qui allait paraître le lendemain. Ainsi, lorsque vous aviez beaucoup parlé, vous pouviez constater que vos propos étaient peu repris dans l’édition du lendemain !

M. Jean-Luc Mélenchon. Une de ces histoires marseillaises auxquelles la plupart d’entre nous ne comprennent rien !
Sourires

M. Gérard Longuet. Une histoire marseillaise et, si j’ai bien compris, socialiste !
Nouveaux sourires.

L'amendement n° 312, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout journaliste de la société France Télévisions a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »
La parole est à M. David Assouline.

Ce que vient de dire le président Jean-Claude Gaudin va dans notre sens puisqu’il a l’air de déplorer ce qu’il a subi. Il faut donc garantir que cela ne sera plus possible, quel que soit le pouvoir en place.
C’est là que l’on perçoit bien les limites de votre raisonnement : vous vous plaignez quand vous subissez, mais vous ne voulez rien changer dans les textes !
Avec l’amendement n° 312, nous allons plus loin. Nous souhaitons préciser dans la loi elle-même les conditions de cette indépendance des rédactions et des journalistes de France Télévisions.
On me rétorquera que ce n’est pas nécessaire puisque leur indépendance est garantie par la jurisprudence, la convention collective, la charte, etc. Mais, puisqu’il y a débat et qu’il convient de préciser les choses, notamment pour l’audiovisuel public, nous proposons une série d’amendements visant à inscrire dans la loi ce qui constitue depuis le début du siècle la ligne de conduite à tenir pour l’indépendance des journalistes.
Je vous rappelle les termes de la Charte des devoirs professionnels des journalistes français. Ce document, qui date de 1918, est toujours d’actualité.
« Un journaliste, digne de ce nom,
« - prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ;
« - tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ;
« - ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ;
« - n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle ;
« - s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ;
« - ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;
« - ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ;
« - ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ;
« - ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures ;
« - garde le secret professionnel ;
« - n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;
« - revendique la liberté de publier honnêtement ses informations ;
« - tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;
« - ne confond pas son rôle avec celui du policier. »
À l’heure où les entorses à ces règles de déontologie sont de plus en plus nombreuses, notamment par les immixtions incessantes de l’exécutif dans les organes de presse et les médias audiovisuels, et les invectives de ce même exécutif contre les rédactions, allant jusqu’à la demande de démission des journalistes jugés insuffisamment complaisants envers le pouvoir, il nous semble important de faire figurer dans la loi les principaux objectifs de cette charte, afin qu’elle s’applique légalement aux journalistes de France Télévisions.
Par conséquent, nous tenons à préciser que tout journaliste de la société France Télévisions a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté, et qu’il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.

La commission des affaires culturelles a émis un avis favorable.
Elle considère en effet qu’il est important, notamment pour rassurer les journalistes, de préciser les garanties de l’indépendance éditoriale des rédactions, même s’il est vrai que ces garanties figurent déjà dans la convention collective, entre autres, et qu’il n’était, dès lors, pas absolument nécessaire de les faire figurer dans la loi.
Toutefois, elle considère que leur mention dans le texte constitue un signe fort vis-à-vis des journalistes et elle démontre ainsi son attachement à leur indépendance.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui relève de la convention collective. Je ne vois donc aucune raison de faire figurer cette précision dans la loi, d’autant que cela s’inscrit dans le droit fil des différentes lois sur la presse.
En outre, le projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes apporte une réponse à l’une des préoccupations portées par cet amendement.

Au sein de la commission des affaires culturelles, nous avons des désaccords, mais, parfois, nous voulons aller dans le même sens et les uns font alors un pas vers les autres.
Après avoir refusé l’amendement que j’ai défendu précédemment, la commission a estimé sur ce point qu’il s’agissait d’un vrai sujet et que, sur le plan politique, il y avait un intérêt à inscrire notre proposition dans la loi, même si certains considèrent que ce n’est pas nécessaire sur le plan juridique. Il faut en effet lever des préventions, comme on le fait dans bon nombre d’autres articles. Madame la ministre, les juristes sauraient mieux que moi vous citer toutes les dispositions qui, dans ce texte, ne sont pas strictement nécessaires. N’avez-vous pas vous-même demandé au conseil d’administration de France Télévisions de supprimer la publicité, alors que cette mesure est l’un des objets essentiels du projet de loi ?
Notre assemblée est devant un choix. Après des échanges, la commission des affaires culturelles, qui compte des juristes reconnus, a estimé qu’il était utile d’inscrire notre proposition dans le texte, car c’était un signe adressé aux médias et aux journalistes quant à l’importance que nous attachons à l’indépendance de ces derniers. Par la même occasion, cela témoigne du travail constructif qui peut être le nôtre au sein de cette commission. Y renoncer constituerait un retour en arrière par rapport à cet état d’esprit.

Franchement, je n’éprouve pas le besoin d’inscrire une telle disposition dans la loi. Je vais toutefois voter l’amendement pour m’épargner le procès d’intention qui ne manquerait pas de m’être fait !
La seule chose qui me gêne, c’est la mention du refus de divulguer ses sources. Je préférerais préciser dans un sous-amendement que le journaliste ne pourra pas refuser de divulguer ses sources si l’autorité judiciaire le lui demande.


Je voudrais compléter les arguments qui ont été avancés sur la protection du journaliste et les éventuelles pressions d’ordre politique.
Il s’agit du refus « de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à l’insu [du journaliste] ou contre sa volonté ». Dans ce cas, il s’agit de la protection non seulement politique, mais aussi esthétique, morale : ce que l’on appelle en France le droit d’auteur, le droit patrimonial à l’intégralité de la création.
On ne peut ni découper une photo, ni gommer quelqu’un. Si, demain, on s’avise de glisser dans un reportage des images filmées – je prends un exemple au hasard ! – dans une autre cité HLM, dans une autre banlieue, pour d’autres événements, un journaliste ayant participé à ce reportage doit avoir le droit, afin de ne pas cautionner une telle pratique, de refuser sa signature.
Madame la ministre, vous avez été un fer de lance dans la défense des droits d’auteur, faisant adopter le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, qui a permis de créer la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, l’HADOPI. Il faut, me semble-t-il, poursuivre votre action législative, faute de quoi nous serons amenés à considérer qu’il ne s’agissait là que d’une mesure politico-technique.
Ce qui est ici en question, c’est bien la noblesse des droits d’auteur.

Je considère que mon sous-amendement contredirait la remarque que j’ai faite sur l’amendement. Dans ces conditions, je le retire.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 313, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le III de l'article 44 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout journaliste de la société Radio France a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »
La parole est à M. David Assouline.

Cet amendement s’inscrit dans la même perspective que le précédent.
Nous venons de rappeler les termes de la charte des devoirs professionnels des journalistes qui, je le précise, figure dans l’avenant pour les entreprises de l’audiovisuel du secteur public de la convention collective nationale de travail des journalistes. À la suite du vote qui vient d’avoir lieu, les principes qu’elle met en avant se retrouvent désormais dans la loi, et c’est très important.
L’indépendance de l’information et de la programmation dans les futures sociétés de programme, notamment à Radio France, va se trouver menacée du fait des dispositions contenues dans le projet de loi dont nous débattons, particulièrement lorsqu’il est prévu que le responsable d’une société peut être nommé et, surtout, révoqué d’un simple trait de plume présidentiel.
Les journalistes auront, plus que jamais, besoin des textes et dispositions leur permettant d’affirmer leur déontologie et de conserver leur indépendance et celle des rédactions du service public.

Comme sur l’amendement précédent, la commission a émis un avis favorable.
Le Gouvernement est, à l’évidence, également défavorable à cet amendement.
Les dispositions en question, auxquelles nous sommes tous évidemment très attachés, figurent déjà dans la convention collective. Il suffit d’ailleurs d’écouter et de regarder les différentes chaînes de France Télévisions et de Radio France pour constater que, contrairement à ce qui a été affirmé, les rédactions sont aujourd’hui totalement indépendantes : elles en apportent la preuve tous les jours.
Le fait d’inscrire dans la loi des dispositions figurant dans la convention collective pourrait laisser penser que la réforme entreprise exige de prendre des dispositions supplémentaires pour protéger l’indépendance des journalistes. Un tel message serait, à mes yeux, négatif.

Bien que je ne sois absolument pas un spécialiste de ces questions, je m’étonne que nous soyons aujourd’hui amenés à discuter de telles dispositions.
Qui peut penser, en effet, que l’un des membres de notre assemblée voudrait contester à un journaliste, de France Télévisions ou de Radio France, le « droit de refuser une pression » ? Qui peut croire qu’on viendrait dénier à un journaliste le droit de « refuser de divulguer ses sources » ?
Les dispositions prévues se contentant d’énumérer des évidences, ces amendements constituent un piège ridicule. Pour ma part, je me suis abstenu lors du vote sur l’amendement précédent, et je m’apprête à faire de même sur celui-ci. En effet, voter pour ces amendements ou même voter contre, c’est reconnaître implicitement qu’il peut effectivement y avoir des atteintes à l’indépendance et à la déontologie des journalistes, alors qu’il n’en est rien.

Notre débat peut être aiguisé et violent ; il peut également être serein.
Vous venez de nous expliquer, monsieur Gaillard, que la probabilité d’observer de tels procédés est infime.
Je reprends l’exemple des reportages manipulés en ce sens qu’on y introduit des images prises plus ou moins longtemps auparavant, peut-être simplement parce qu’on ne dispose pas d’images plus récentes, mais qui sont mêlées à des images renvoyant à l’actualité. Certains peuvent même penser qu’il n’y a pas de mal à agir ainsi. Il reste que, dans un tel cas, le journaliste qui ne cautionne pas le procédé doit avoir la possibilité de ne pas signer l’émission en question.
Il faut savoir que cela n’arrive pas occasionnellement, mais souvent. Il existait même une émission qui pointait régulièrement ces procédés : elle s’intitulait Arrêt sur images. Elle devait tellement déranger qu’on l’a supprimée !
Par conséquent, le fait d’introduire de telles précisions dans la loi est, à nos yeux, loin d’être facultatif.

Il ne faut pas chercher malice ! Si, dans la majorité, certains considèrent que voter un amendement comme celui-ci revient à reconnaître l’existence des pratiques qu’il entend empêcher et emporte par là même condamnation de ceux qui exercent présentement le pouvoir politique, cela signifie en fin de compte qu’on ne peut plus légiférer !
Lors de l’examen, cet été, de la réforme constitutionnelle, j’ai défendu ici même, au nom du groupe socialiste, un amendement visant à insérer à l’article 34 de la Constitution certaines dispositions relatives à l’indépendance, au pluralisme et à la liberté des médias. On aurait alors pu prétendre qu’il s’agissait d’évidences et que, en incluant ces dispositions dans la Constitution, on disait implicitement que le Président de la République ou le pouvoir étaient contre cette indépendance ! Cela n’a pas de sens !
Si vous êtes pour, chers collègues de la majorité, laissez-vous donc un peu aller ! N’ayez pas tant de préventions ! Si vous considérez que ces dispositions définissent une bonne pratique, fussent-elles évidentes, inscrivez-les donc dans la loi ! Personne ici ne peut dire que les procédés visés par cet amendement n’existent pas. Vous pouvez toujours affirmer, bien sûr, que de telles pressions n’émanent pas du pouvoir politique.
J’en reviens à l’exemple qui a été donné par Mme Blandin. Il s’agit d’une pratique courante, notamment à la télévision. Je pense notamment aux images illustrant le conflit au Proche-Orient. Le plus souvent, ce procédé est utilisé quand on ne dispose pas d’images sur un sujet d’actualité, mais qu’on veut nous faire croire le contraire. De même, certaines images censées illustrer les émeutes en banlieue, avec jets de pierre et incendies, passent en boucle. Parfois, ces images « ne mangent pas de pain ». Mais d’autres fois, elles travestissent la réalité. Les journalistes, pour se protéger, doivent avoir le droit de dire : ceci n’est pas ma production, ceci n’est pas mon œuvre.
Par conséquent, puisque nous sommes tous d’accord sur le fond, adoptons cet amendement ! Si vous refusez de le faire pour ne pas accorder une victoire à l’opposition, notre débat restera totalement superficiel. Au lieu d’essayer de nous convaincre les uns les autres, nous nous contenterons de nous opposer. Jusqu’à présent, nous avons débattu au fond, sans pratiquer d’obstruction. Si vous voulez changer de style de débat, alors que le travail de la commission a permis de trouver des consensus, nous en changerons également !

Monsieur le président, bien que j’aie quelques scrupules à allonger le débat, je souhaite intervenir sur ce point.
De conviction libérale, je tiens à vous dire, cher David Assouline, que votre amendement ne me dérange absolument pas. Tout ce qui peut protéger la liberté est naturellement le bienvenu.
Mais la loi doit être ultime. Nous observons aujourd’hui une vie conventionnelle libre, ouverte et transparente, qui a permis d’établir une charte. Celle-ci a été négociée par les patrons de l’audiovisuel et leurs employés, c'est-à-dire les journalistes. Cette convention est beaucoup plus vivante, libre et proche des réalités que ne le seront jamais les textes législatifs, qui n’interviennent qu’en retard et en retrait.
Par ailleurs, vous évoquez un monde qui n’existe plus, un monde où il n’y avait de place que pour une télévision d’État, et où il était indispensable en effet que le législateur fixe des règles – et Dieu sait que nous avons légiféré sur ce sujet ! – parce que le système était fermé.
Nous sommes aujourd’hui dans un système totalement ouvert, où la moindre erreur personnelle – il m’arrive naturellement d’y succomber, comme chacun d’entre nous, peut-être même plus souvent que d’autres –, le moindre mot maladroit, le moindre écart de comportement, le plus petit abandon du « politiquement correct » vous font immédiatement repérer par un système de censure extrêmement vigilant : je pense à internet et à la multiplication des chaînes de télévision.
À titre personnel, j’ai été étonné de découvrir un entretien que j’avais eu dans ma voiture avec un auto-stoppeur muni d’une caméra, d’abord sur une télévision danoise, trois mois après, puis dans une édition locale de France 3. Il est vrai que, à l’époque, j’étais président de région : lorsque je disais une ânerie, mes propos revêtaient donc une certaine importance !
Sourires

Vous le voyez, monsieur Assouline, la société va aujourd’hui beaucoup plus vite que la loi. La liberté est assurée par la multiplication de l’offre et la confrontation permanente d’expressions libres. Faisons en sorte que la loi n’intervienne que dans l’exception. Or, manifestement, dans notre pays, la règle veut que la liberté du journaliste soit largement assurée.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Je suis d’accord avec tout ce qui a été dit sur les droits des journalistes. Selon moi, il n’y aura jamais trop de débats ou de textes pour les affirmer. En effet, on le voit partout dans le monde, les atteintes aux libertés les plus élémentaires dans le domaine de la vie sociale sont monnaie courante.
Même si je ne souhaite pas sous-amender l’amendement n° 313, pour ne pas compliquer les choses, j’estime que la rédaction proposée pourrait être enrichie de la façon suivante : « Tout journaliste de la société Radio France a le droit et le devoir de refuser toute pression, … » En effet, les mots « droit » et « devoir », loin de s’opposer, se complètent.
Ces sujets sont fondamentaux. C’est l’honneur du Sénat que de discuter et d’adopter un tel amendement.
Certes, beaucoup de choses ont pu séparer les miens et Michel Debré, le père de la ve République. Mais nous nous rejoignions lorsqu’il affirmait que, en cas d’atteinte aux libertés fondamentales, l’insurrection était un devoir.

Je parle sous le contrôle des vieux gaullistes ! J’ai été nourri de ces affirmations, comme beaucoup d’entre vous, d’ailleurs.
Il est bon que la représentation nationale envoie ce signal positif.

On n’analyse pas bien l’enjeu. Les meilleurs garants de l’indépendance journalistique, ce sont les journalistes eux-mêmes.

Aucun texte de loi ne pourra imposer aux journalistes de se comporter de façon indépendante s’ils ont fait le choix, par exemple, de se soumettre à des pressions. Cela relève de leur liberté et de leur responsabilité.
Le texte que nous examinons doit viser à préserver les journalistes qui s’estimeront victimes de pressions ; sans doute ne s’agit-il pas de la majorité d’entre eux, certains sachant se défendre et d’autres pouvant être consentants. Ce texte doit simplement permettre à ceux qui le veulent de réagir et de se défendre pour exercer leur métier en toute liberté. Il s’agit non pas d’une disposition d’interdiction, mais bien d’une disposition qui préserve un espace de liberté et une marge de défense pour les journalistes. Je ne vois pas du tout quelles craintes un tel texte pourrait inspirer.
Nous ne faisons que rappeler les principes de pluralisme de l’information et d’indépendance des journalistes. Dans le contexte de démultiplication de l’offre que M. Longuet a évoqué, les journalistes, de par leur formation professionnelle, doivent faire vivre eux-mêmes leur indépendance. Mais, en cas de menace ou d’atteinte à leur indépendance, la loi doit leur donner les moyens de résister.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 314, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la redevance audiovisuelle. »
La parole est à M. David Assouline.

Je précise que, dans cet amendement, nous avons employé le terme redevance, qui était utilisé dans le projet de loi. La commission proposera de la rebaptiser « contribution », ce qui nous convient d’ailleurs fort bien ; il faudra donc, le cas échéant, modifier le texte de notre amendement en conséquence.
Il s’agit de garantir que la redevance constitue la principale source de financement de la télévision publique. À l’heure où le financement de ce secteur est de plus en plus menacé, il nous semble opportun de rappeler ce sain principe, d’autant qu’en France, tout le monde en convient, le tarif de la redevance est manifestement insuffisant pour assurer un financement pérenne et garanti aux organismes destinataires.
À 116 euros, ce tarif est très en deçà de celui qui est pratiqué ailleurs en Europe. Je rappelle rapidement les montants de cette taxe chez quelques-uns de nos voisins : 316, 24 euros au Danemark, 204, 36 euros en Allemagne, 194, 5 euros au Royaume-Uni et 99, 6 euros en Italie. La moyenne européenne se situe aux environs de 165 euros.
Je rappelle que, depuis 2002, le tarif de la redevance n’a jamais progressé – il a même été ramené à l’euro inférieur en 2005, la conversion du franc en euro ayant fait apparaître des centimes – et n’a même pas été indexé sur le coût de la vie.
Avant 2002, le gouvernement de Lionel Jospin procédait, chaque année, à la revalorisation de la redevance : le montant de cette taxe est ainsi passé de 700 francs, soit 106 euros, en 1997, à 764, 20 francs, soit 116, 50 euros, en 2002 ; il y a donc eu une augmentation de 10 euros pendant cette mandature. Si elle n’était pas de nature à nous faire rattraper notre retard par rapport à nos voisins européens, cette progression avait au moins le mérite de suivre l’inflation. À l’époque, le débat consistait à essayer d’obtenir une augmentation supérieure au strict taux de l’inflation.
Avec le retour de la droite au pouvoir et la non-augmentation de la redevance pendant sept exercices budgétaires – ce qui représente une perte de 14 euros en volume –, on a fini par oublier que l’augmentation annuelle de la redevance était auparavant une chose naturelle. S’est ainsi répandue l’idée selon laquelle le courage politique revient à proposer une hausse de cette taxe égale à l’inflation, hausse qui, par le passé, était complètement acquise.
Toutes ces raisons nous poussent à demander que figure dans le projet de loi la mention légale de la redevance comme ressource principale de France Télévisions.
Cette demande se justifie encore davantage à l’heure où l’on supprime l’autre source de financement naturelle de France Télévisions, à savoir la publicité, sans que cette perte de recettes soit compensée de façon garantie, affectée et pérenne. Or l’indépendance d’un média suppose la garantie de son financement.
On me rétorquera sans doute qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la loi que la redevance constitue l’essentiel des revenus puisque c’est déjà le cas aujourd'hui. Certes, mais la situation sera peut-être différente à l’avenir. En prenant acte dans la loi que, aujourd'hui comme demain, le service public est d’abord financé par la redevance – la contribution, dans le nouveau vocabulaire –, on fait en sorte que cet état de fait ne soit jamais inversé. Nous préparons ainsi les débats que nous aurons par la suite sur le montant de la redevance. Au final, il s’agit bien de réhabiliter un système qui a été progressivement discrédité ou vilipendé.

La commission considère que cet amendement pose un principe absolument essentiel, qui est en totale adéquation avec les travaux passés et présents de la commission. Nous avons formulé un certain nombre de préconisations concernant la redevance, notamment depuis 2004. Je tiens particulièrement à citer notre ancien collègue Louis de Broissia, qui a été le plus ardent défenseur du principe d’indexation de la redevance.

En effet !
La commission considère que la redevance doit constituer le financement majoritaire de l’audiovisuel public et, par là même, nous permettre d’avoir une télévision publique et non une télévision d’État. C’est d’ailleurs bien le cas aujourd'hui puisque la redevance finance, aux deux tiers, l’audiovisuel public. Il nous semble important d’inscrire ce principe dans la loi.
Lors de l’examen de l’article 19, nous aurons un certain nombre de discussions sur la redevance, notamment sur la revalorisation de son montant, mais aussi de son image. C'est la raison pour laquelle Michel Thiollière et moi-même proposons un changement d’appellation : nous voulons que nos concitoyens comprennent bien à quoi sert cette « participation à une action commune ». C’est la définition du mot contribution, qui nous semble beaucoup plus valorisant et compréhensible pour nos concitoyens. Ces derniers ne savent pas toujours que la redevance participe au financement de neuf chaînes de radio, de cinq chaînes de télévision et de quatre orchestres, qui ne sont d’ailleurs jamais cités. Il est important qu’ils l’apprennent. En effet, si 70 % de nos concitoyens pensent que le produit de la redevance est affecté à l’État, ils ne savent pas ce qu’il est précisément destiné à financer.
Monsieur Assouline, j’ai cru comprendre que vous étiez finalement d’accord avec le nom proposé par la commission : « contribution pour la télévision et la radio publiques ». Il est évident que, dans ces conditions, si votre amendement est adopté, comme la commission le souhaite, la rectification nécessaire sera apportée ultérieurement.
J’adhère à l’idée selon laquelle la redevance est la ressource naturelle et majoritaire de l’audiovisuel public. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 314.
Sur l’appellation qui est proposée par la commission, je comprends bien qu’il soit intéressant que les Français aient davantage conscience de ce qu’ils contribuent à financer en acquittant la redevance. Mais la redevance, que la commission souhaite appeler « contribution pour la télévision et la radio publiques », finance aussi l’INA. Il est vrai que la « redevance audiovisuelle » ne fait pas non plus explicitement mention de l’INA. Nous pourrions peut-être l’appeler « contribution à l’audiovisuel public », expression qui me semble moins ciblée sur les télévisions et les radios, à l’exclusion d’autres institutions.

En tout état de cause, madame la ministre, les éventuelles modifications terminologiques seront débattues plus tard dans l’examen du texte.
Je mets aux voix l'amendement n° 314.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 116, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La société France Télévisions adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. Lors de la fusion-absorption par France Télévisions, tous les contrats en cours subsistent entre l'employeur et le personnel de la nouvelle société. La société France Télévisions assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Depuis de nombreuses années, les personnels de France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO adhèrent à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, qui concerne les techniciens et les administratifs, ainsi qu’à l’avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. Le projet de fusion-absorption des sociétés de programmes ne doit pas être prétexte à la remise en cause de ces conventions.
Soucieux de l’intérêt des salariés, qui manifestent leurs légitimes inquiétudes, nous proposons d’amender ce texte afin que France Télévisions, qui accueillera demain les personnels de l’ensemble des sociétés de programme actuelles, adhère à cette convention collective ainsi qu’à celle qui est liée à l’avenant audiovisuel de la convention intéressant les journalistes.
Il est essentiel que le projet de loi garantisse le respect de ces conventions dans le cadre de la nouvelle structure. C’est le sort de milliers de salariés qui est en jeu. Il serait inhumain et socialement injuste que les conventions et accords collectifs qui sont applicables au sein des sociétés qui seront absorbées soient rendus caducs par la création de l’entreprise unique.
Il s’agit de respecter ceux qui font la télé, en ne bradant pas leurs droits. Plus le projet de loi sera clair et sans équivoque, plus le personnel sera rassuré quant à son avenir au sein du groupe.
Ces conventions collectives, qui ont fait l’objet de négociations entre les salariés et la direction de France Télévisions, sont plus avantageuses que le droit commun du code du travail.
Comme certains esprits chagrins déplorent toujours les prétendus privilèges des salariés alors qu’ils ne s’offusquent guère du bouclier fiscal, par exemple, nous souhaitons avoir la garantie que la fusion-absorption ne conduira pas à un nivellement par le bas, mais bien par le haut.
Puisque vous envisagez de nouvelles négociations entre partenaires sociaux, il est important pour les salariés que le projet de loi garantisse sans ambiguïté que les conventions collectives resteront le socle de l’entreprise unique et qu’elles ne pourront en aucun cas être moins favorables aux personnels.
Cet amendement vise donc à écarter toute remise en cause des conventions collectives de l’audiovisuel public. En effet, nous ne pouvons accepter que le principe de la création d’une société unique ait des conséquences sociales préjudiciables aux salariés.
La simple justice veut que le niveau social garanti par les deux conventions collectives actuelles soit maintenu et étendu aux autres services publics audiovisuels. Cela doit être le fil conducteur des nouvelles négociations.
Alors que les personnels de France Télévisions sont déjà fortement éprouvés depuis un an, la moindre des choses est que le passage à l’entreprise unique ne se traduise pas par une dégradation de leurs droits et de leurs conditions salariales. D’autant que, à rebours de bien des préjugés, le coût de ces conventions, loin d’être excessif, reste sans commune mesure avec le coût exorbitant de la suppression de la publicité que vous vous refusez pourtant à remettre en question.

Il ne revient évidemment pas au législateur de préempter les décisions de la société France Télévisions, a fortiori lorsque celles-ci concernent la politique sociale de l’entreprise. Aussi n’est-il pas opportun de prévoir l’adhésion de France Télévisions à telle ou telle convention collective.
Par ailleurs, la commission des affaires culturelles se doit de rappeler que l’Assemblée nationale a précisé explicitement dans le projet de loi, à l’article 51, que l’article L. 2261-14 du code du travail s’appliquait à la fusion-absorption réalisée par la loi. En l’absence de conclusion de tout nouvel accord collectif, les salariés de France Télévisions conserveront donc individuellement les avantages qu’ils avaient acquis sous l’empire de leur précédente convention collective.
Je rappelle au demeurant que les différentes chaînes du groupe France Télévision n’avaient pas adhéré aux mêmes conventions collectives.
S’agissant du maintien des contrats existants, l’amendement est d’ores et déjà satisfait, l’Assemblée nationale ayant précisé à l’article 51 que l’article L. 1224-1 du code du travail était applicable en l’espèce.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Comme vient très justement de le rappeler Mme le rapporteur, toutes les conventions et accords collectifs conclus au sein des sociétés absorbées continueront à produire leurs effets pendant un certain temps.
Je le répète, une grande négociation collective va bientôt s’ouvrir et les contrats de travail des salariés des sociétés absorbées seront automatiquement transférés, selon les dispositions que vient de mentionner Mme Morin-Desailly.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.

Mes chers collègues, à la demande de Mme la ministre, qui souhaite s’exprimer devant la presse pour rendre hommage à Claude Berri, dont nous venons d’apprendre le décès, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures trente.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 118, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s'engagent à garantir le maintien d'unités de programmes et de décisions qui leur sont propres et spécifiques afin de veiller à ce que leurs lignes éditoriales, en particulier en matière d'œuvres patrimoniales, contribuent à l'expression de la diversité des regards et de la création française. »
La parole est à M. Jack Ralite.

Avant de présenter cet amendement, qui concerne les unités de programmes et la diversité patrimoniale, je voudrais revenir sur la réponse de Mme la ministre à ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin.
Lorsque les choses changent, les personnels demeurant en fonction conservent leurs droits le temps que la négociation aboutisse à un accord. Cependant, lorsque des personnels partent en retraite, ceux qui les remplacent n’ont pas les mêmes droits. C’est à ces derniers qu’il nous semblait nécessaire d’offrir des garanties.
Lorsque nous avons débattu de la liberté des journalistes, certains ont objecté qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer dans la loi les précisions demandées sous prétexte que tout le monde était pour la liberté des journalistes. Je constate que, lorsqu’il s’agit des droits des travailleurs, ceux-là restent bouche cousue !
Pour ce qui est de l’amendement n° 118, nous souhaitons assurer à France Télévisions les moyens d’être à la hauteur de l’exigence de pluralisme et de diversité culturelle constitutive de ses missions. Cependant, une chose est de parler de diversité et de pluralisme, une autre est d’imaginer et de construire les conditions financières et structurelles de leur développement.
Le nouvel alinéa introduit par l’Assemblée nationale à l’article 1er, disposant que « France Télévisions veille à ce que sa nouvelle organisation garantisse l’identité des lignes éditoriales de ses services » et précisant que « cette organisation assure le pluralisme et la diversité de la création » ne nous semble donc pas suffisant, particulièrement dans le contexte actuel de sous-financement de l’audiovisuel public.
Si ceux qui ont proposé l’entreprise unique avaient pour seul objectif de réaliser des économies, nous redoutons, pour notre part, que ces économies ne portent avant tout sur la création. Cela risque d’être la première conséquence non seulement de la suppression de la publicité mais également de la transformation en société unique. En effet, cette transformation, conduite au nom du sacro-saint principe de rationalisation, fait craindre une réduction des lieux de décision éditoriale. Cette crainte est fondée puisqu’il s’agit là de l’une des propositions de la commission Copé. Les auteurs, les professionnels et leurs organisations, telles la SACD – société des auteurs et compositeurs dramatiques – et la SCAM, – société civile des auteurs multimédia –, n’ont eu de cesse d’alerter la représentation nationale sur le risque d’un formatage généralisé encouru en raison du « guichet » unique.
De ce point de vue, maintenir des unités de programmes identifiées distinctes, c’est préserver les capacités de création et la diversité. C’est pourquoi il est proposé de compléter le deuxième alinéa de l’article 43-11 par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’engagent à garantir le maintien d’unités de programmes et de décisions qui leur sont propres et spécifiques afin de veiller à ce que leurs lignes éditoriales, en particulier en matière d’œuvres patrimoniales, contribuent à l’expression de la diversité des regards et de la création française. » Qui oserait se dire opposé à l’expression de la diversité des regards ?
Je voudrais maintenant évoquer la façon dont les œuvres patrimoniales doivent être considérées. Elles ne sont pas les seules diffusées à la télévision. Parmi les œuvres culturelles en général figurent les œuvres d’auteurs, fruits de la création artistique. De ce point de vue, il convient d’observer la plus grande prudence lorsque la question de l’organisation est abordée.
Le risque de s’enfermer dans le filet de l’utilité est effectivement toujours réel. Or l’utilité est la négation de l’art, voire, lorsqu’il y est systématiquement recouru, sa mort.
S’agissant de la question des connaissances qu’il s’agit d’apporter, je me ferai l’écho d’un témoignage, à mon avis éblouissant, d’une institutrice. Elle déclarait que sa première tâche était d’aider les enfants, dès leur plus jeune âge, à accéder à l’arbitraire du signe. Voilà qui n’est pas du domaine du rationnel, mais qui ressort de celui de l’intuition.
Vous voyez bien comment on ne peut pas en déduire qu’il faudrait le suffrage universel pour choisir les créations. J’ai toujours à l’esprit cette phrase : « La différence entre un artiste et un politique, c’est que l’artiste n’a pas besoin de majorité. »
Récemment, je relisais l’Abécédaire de Deleuze. Il y explique que la force de la gauche est de décider qu’un être, s’il est pour la liberté et la création, doit d’abord être « au-delà du mur de soi ».
La décision constitue une difficulté. Prenons l’exemple de l’actuelle exposition Picasso. Tous les visiteurs, quelles que soient leurs connaissances artistiques, en ressortent heureux. Or, il y a trente ans, on se moquait de Picasso : des mères de famille commentaient les gribouillis de leurs enfants en bas âge en disant que c’était « du Picasso » !

L’exposition ne présente pas que des tableaux de Picasso ! Elle s’appelle Picasso et les maîtres !

Lorsque Picasso peignait son chien Kasbek, ses amis lui disaient que cela ne ressemblait pas à un chien. Il leur répondait que le mot « chien » qu’ils employaient ne « ressemblait » pas non plus à un chien.
Catherine Tasca et moi nous sommes rendus dans une commune de mon département, Le Blanc-Mesnil. Les subventions allouées au Forum y sont contestées au motif que ce lieu artistique n’est pas fréquenté par la moitié de la population. Nous avons l’un et l’autre répondu que ce critère n’était pas pertinent.
Méfions-nous donc des structures fermées. Méfions-nous de l’application de la loi de la majorité en ces matières-là. Si, dans ces domaines, les décisions ne reposent pas sur l’intuition, nous courons le risque de décisions formatées.
Sans vouloir faire assaut de citations, je rappellerai le mot de Braque : « L’art est une blessure avant d’être une lumière. » Où va-t-on si nous votons sur les blessures et les lumières, d’autant que l’art est tour à tour, au fil de la vie, blessure puis lumière ? Autant la démocratie a besoin d’art, autant l’art ne se décide pas démocratiquement. C’est là un principe fondamental.
La question des œuvres patrimoniales doit donc être traitée au niveau de chaînes, et non dans le cadre de quelque organisation préétablie. C’est une question décisive.

L'amendement n° 251, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s'engagent à garantir le maintien d'unités de programmes et de décisions qui leur sont propres et spécifiques afin de veiller à ce que leurs lignes éditoriales, en particulier en matière d'œuvres patrimoniales, contribuent à l'expression de la diversité des regards et de la création française. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Permettez-moi d’apporter ma modeste contribution après les considérations fort élevées de notre collègue Jack Ralite.
L’amendement n° 251 porte sur le risque que nous font courir le pilotage centralisé de France Télévisions et le refus d’inscrire la notion positive d’autonomie éditoriale. Nous devons désormais progresser sur ce texte par critères partagés pour garantir la mise en œuvre de la diversité des regards.
Comme chacun le mesure bien, l’écueil de l’uniformisation nous guette. Cela dit, certaines chaînes privées n’ont su éviter cet autre écueil qu’est la confusion entre diversité et sectorisation des modes d’expression audiovisuels par canaux. À telles chaînes reviennent les émissions sportives, à telles autres les jeux, et la société se trouve ainsi soumise à la tentation d’un morcellement, chaque chaîne reflétant les intérêts de groupes particuliers. S’ensuit la mort du dialogue et de l’ouverture.
L’amendement n° 251 vise donc à protéger la diversité des regards, mais aussi à éviter que le service public ne se mette à sectoriser, par chaînes, cette diversité. Pour ce faire, chaque antenne doit pouvoir programmer une diversité de programmes et de modes d’expression.

Ce débat est fort intéressant, et je remercie notre collègue Jack Ralite de le porter à une telle hauteur. Cela dit, la commission doit se prononcer sur les amendements, ce qui nous oblige à revenir au texte même.
La commission est défavorable à l’amendement n° 118, qui tend à dessiner une administration de France Télévisions qui n’est pas celle du projet de loi et contrevient à son esprit. En particulier, elle ne s’inscrit pas dans la perspective de l’entreprise unique.
L’amendement n° 251 procède du même esprit, quoiqu’il l’exprime différemment. C’est pourquoi la commission y est également défavorable.
Notre collègue Jack Ralite nous invitait tout à l’heure à la réflexion ; je vous livrerai donc brièvement la mienne. Il est évident que le cahier des charges d’une œuvre, quelle qu’elle soit, doit être établi dans un dialogue confiant entre celui qui commande et l’artiste. Aucun cahier des charges ne peut définir en soi une œuvre d’art, nous en sommes parfaitement d’accord. Sinon, nous nous dirigerions vers une culture d’État ou, en l’espèce, une culture de la télévision publique.
Comme elle l’a exprimé à travers ses amendements, la commission a estimé qu’il était important que les acteurs de France Télévisions, donc les dirigeants de la future entreprise publique, puissent faire confiance à des groupes de travail, à des collèges. Ils pourront ainsi définir les cahiers des charges des commandes passées à l’extérieur auprès des acteurs de la création, mais aussi recevoir de façon plurielle les œuvres d’art télévisuelles qui leur seront présentées.
C’est la raison pour laquelle je souscris au fond de votre démarche, monsieur Ralite, mais malheureusement pas à sa déclinaison concrète et pratique dans l’administration future de l’entreprise France Télévisions.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
La société unique porte une logique de différentes unités de programmes. Il serait tout à fait contraire à son esprit d’avoir des unités de programmes dans chacune des antennes, alors qu’elles ont justement été fusionnées.
J’observe qu’il existe d’ores et déjà une seule direction des sports et une seule unité de programmes jeunesse, communes à France 2 et à France 3.

Nous faisons fausse route si nous opposons l’exigence de diversité artistique à la bonne gestion de l’entreprise commune. Ces deux notions ne me semblent pas contradictoires, sauf en cas de conflit déclaré entre les professionnels qui, au sommet de l’entreprise, auront à définir sa stratégie et les professionnels qui vont faire vivre le formidable projet de la création audiovisuelle à travers les unités de programmes. Non seulement il n’y a pas d’opposition en l’une et l’autre, mais l’une peut même nourrir l’autre.
C’est dans la mesure où l’entreprise commune France Télévisions donnera toutes ses chances à la création audiovisuelle, à travers une grande diversité de propositions, qu’elle remplira pleinement sa mission et gagnera la bataille des programmes audiovisuels.
À mon avis, et je le dis amicalement à M. le rapporteur, qui a porté la plus grande attention à l’élaboration de ce texte, il n’y a pas de contradiction. Si l’entreprise commune se donne pour objectif de vivifier la production audiovisuelle à travers une grande diversité, elle n’a rien à craindre de la richesse des propositions des différentes unités.
C’est la raison pour laquelle nous allons soutenir les amendements n° 118 et 251.

Dans le domaine de la création, on ne peut pas dire qu’il existe un accord généralisé.
Il faut entendre les attaques contre l’élitisme ! À l’inverse, on vante le caractère prétendument « populaire » de certaines émissions alors qu’il ne s’agit que populisme ! Cette campagne « désubstantialise » autant l’œuvre populaire que l’œuvre d’élite. Ce n’est donc pas une petite question.
Je rappelle une nouvelle fois les termes figurant dans la lettre de mission du Président de la République adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication : « veiller à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondant aux attentes du public ». Une mission ainsi définie est antinomique de l’art et de ses développements dans le pluralisme ou dans les différentes branches évoquées par notre collègue Marie-Christine Blandin.
Vous voyez qu’il y a un risque et qu’il n’est pas inutile de prévoir dans la moi les moyens d’y parer. C’est comme lorsqu’il a été question de la redevance ou de l’indépendance des journalistes.
Nous ne sommes pas en période de mer calme, en ce moment : il n’y a pas que dans le Vendée Globe que ça tempête ! En France, c’est le mot « liberté » qui se trouve, ici ou là, d’abord écorné, puis limé.
Je continue donc à penser qu’il est utile d’appeler les choses par leur nom et de les inscrire dans cette loi. Sinon, nous laisserons s’épanouir un courant qui est préjudiciable à l’art, donc préjudiciable aux hommes et aux femmes que nous sommes.

Il est tout de même piquant d’entendre un communiste parler de liberté !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles participent à l'éducation à l'environnement et à sa protection et au développement durable. »

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 117, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Cet article traite de protection de l’environnement, de préservation de la planète et de développement durable, notions avec lesquelles notre groupe est bien sûr en plein accord.
Néanmoins, nous souhaitons la suppression de cet article qui, malgré ses bonnes intentions, peut menacer la liberté éditoriale de France Télévisions, laquelle doit rester un principe intangible du service public.
Ce type d’article, considérons-nous, relève d’une ingérence politique dans la programmation, ingérence que nous n’avons eu de cesse de critiquer depuis le début de l’examen du projet de loi. Les parlementaires n’ont pas à faire les programmes à la place des professionnels ! C’est une question d’éthique et de déontologie.
Certes, la tentation est grande de vouloir faire les programmes, et les bonnes idées ne manquent pas en la matière, y compris chez un grand nombre de nos concitoyens : chacun a sa petite idée ! Mais la programmation des différentes chaînes de France Télévisions ne peut être un catalogue de prescriptions, aussi bonnes soient-elles.
Il est essentiel de privilégier une logique qualitative. C’est pourquoi il faut faire confiance aux professionnels. D’ailleurs, il existe aujourd’hui d’excellentes émissions qui abordent les questions de l’environnement sans pour autant transformer le petit écran en télévision pédagogique, impliquant une austérité contraire aux objectifs d’audience, qui doivent demeurer la boussole du service public. Car France Télévisions remplit sa mission lorsqu’elle s’adresse à tous, sans exclusive. La recherche de l’intérêt général qui définit le service public consiste bien à s’adresser au plus grand nombre. Elle doit rester fédératrice. C’est aussi ce qui fait sa noblesse.
C’est pourquoi, s’il y a bien un domaine où la loi n’a pas à être prescriptive et contraignante, c’est bien en matière de contenu et de programmation, car cela peut conduire aux pires abus et dérives. La définition de politiques publiques relève du cahier des charges et non de la loi, sauf à vouloir imposer un contrôle étatique, contraire aux valeurs de la démocratie.
De plus, cette disposition contribue à transformer le service public en « télévision-école », ce que Jack Ralite a déjà vivement dénoncé, reprochant à juste titre l’émergence d’une télé de service public austère qui éduque, à côté d’une télé commerciale qui divertit. La télé publique doit pouvoir continuer à informer, à cultiver, à divertir librement. Grâce aux talents de ses professionnels, elle parvient souvent à faire les trois à la fois !
La suppression de cet article n’empêcherait d’ailleurs nullement la réalisation de formidables émissions de toute nature promouvant l’environnement et la protection de la planète sur les chaînes de service public.

L'amendement n° 8, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles favorisent l'apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l'éducation à l'environnement et au développement durable. »
La parole est à M. Michel Thiollière, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 8 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 117.

Nous avons souhaité clarifier la rédaction de cet article introduit par l’Assemblée nationale et visant à confier aux sociétés nationales de programmes la mission de contribuer à l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Nous avons également tenu à compléter les missions de service public énumérées à l’article 43-11 de la loi de 1986 pour préciser que les sociétés nationales de programme favorisent l’apprentissage d’une langue étrangère, par exemple avec la diffusion de films en version originale, pour ceux qui souhaitent les visionner dans de telles conditions.
Par ailleurs, la commission est défavorable à l’amendement n° 117. Il convient, selon nous, de préserver une sorte de hiérarchisation des missions. Certaines missions relèvent du domaine de la loi, et c’est ce qui nous conduit à inscrire un certain nombre de missions de service public ; d’autres sont du domaine de la « gestion » des contenus – au meilleur sens du terme – et donc de la mise en place concrète des missions de service public que le législateur doit formuler dans la loi.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l’amendement n° 117.

J’ai bien entendu l’argumentation de Mme Gonthier-Maurin s’opposant au caractère prescriptif du texte de l’article 1er bis.
Je signale simplement que le thème évoqué ici est suffisamment large pour que l’on ne soit pas dans la prescription de programmes. De plus, la participation au développement durable concerne non seulement la programmation, mais également le comportement de cette très grande entreprise qu’est France Télévisions et qui a beaucoup à faire en la matière. Celle-ci a même des salariés directement dédiés au respect du développement durable dans toutes ses composantes : sociale, économique, environnementale.
Il s’agit d’élaborer un triangle vertueux dans son management et dans ses choix d’entreprise, et pas seulement dans ses programmes.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Après le mot : « française », la fin de la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la même loi est ainsi rédigée : « et des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. »

Le mieux est parfois l’ennemi du bien ! Voici en effet que l’on nous invite, dans le cadre des missions de service public de la télévision et de la radiodiffusion, à prévoir qu’un effort particulier doit être accompli pour la défense et l’illustration des langues et cultures régionales.
À en croire certains, notamment certains auteurs de l’amendement ayant conduit à l’introduction de cette notion dans le texte, on pourrait penser que rien n’est fait aujourd’hui pour la promotion de la diversité culturelle par le service public de télévision et de radiodiffusion.
Or le rapport au fond souligne que la loi de 1986 confie cette mission jusqu’alors à la seule chaîne RFO, chargée d’assurer, en application de l’article 44, « la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales ». Par ailleurs, le cahier des missions et des charges de France 3 prévoit que la « société contribue à l’expression des principales langues régionales parlées sur le territoire métropolitain ».
De même, Radio France doit non seulement contribuer à la « promotion et à l’illustration de la langue française » et veiller à la qualité du langage employé dans ses programmes, mais également faire en sorte que ses stations locales « contribuent à l’expression des langues régionales ».
Chaque année, un bilan de l’emploi des langues régionales dans les médias est présenté au Parlement dans le Rapport annuel au Parlement sur l’emploi de la langue française, établi par la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Je vous renvoie au bilan ainsi établi, qui montre des résultats non négligeables en la matière.
En clair, nous ne partons pas de rien et nous ne sommes pas tout à fait persuadés de la nécessité d’aller plus loin en matière de promotion de ces langues et cultures régionales.
Que l’on ne s’y trompe pas, l’objet de cet article, en ce domaine comme en beaucoup d’autres, est bien de participer à la remise en cause de ce principe essentiel de la République que constitue l’unité du pays construite autour d’une langue commune à tous, à savoir le français.
Retourner au local et valoriser ce qui constitue un particularisme revient, de fait, à remettre en question les fondements de l’unité républicaine du pays.
Sauf à l’écrire dans la Constitution, mais je ne crois pas que ce soit le cas, la France n’est pas un État fédéral. D’ailleurs, il est des États fédéraux dans lesquels la même langue est commune à tous.
Et ce qui fait sens pour l’unité nationale est souvent la langue commune à tous, l’outil dont tout le monde se sert pour comprendre et être compris de l’autre, dans la richesse de son altérité.
Les langues et cultures régionales n’ont rien à gagner d’une sorte de spécification et d’un repli identitaire susceptibles de remettre en cause ce qui réunit l’ensemble de la collectivité des habitants de notre pays.
Et s’il faut faire des efforts particuliers pour la valorisation de ces cultures, dans le cadre d’un échange mutuel avec la culture nationale dans sa diversité, pourquoi les limiter au seul secteur de l’audiovisuel public ?
En l’occurrence, TF1 ou M6 peuvent continuer, d’une part, à nous abreuver d’émissions au contenu plus ou moins discutable sans avoir à produire le moindre effort sur le sujet qui nous préoccupe actuellement et, d’autre part, à soumettre la langue française à moult violences et outrances verbales, tout en ne risquant que la réprimande vite oubliée du CSA !
Prenons garde de ne pas trop charger la barque du service public de l’audiovisuel, sinon elle finira par couler ! N’adoptons pas des dispositions qui n’apportent rien à l’existant et dont la portée normative est sans doute très éloignée de ce qui est indispensable.
Par conséquent, nous ne voterons pas cet article.

L'amendement n° 9, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans cet article, avant les mots :
des langues régionales
insérer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à Mme le rapporteur.

Il s’agit d’un simple de précision et de coordination avec le IV de l'article 1er du projet de loi.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er ter est adopté.

L'amendement n° 315, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article 43-11 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit d'exercer tout type de contrainte ou d'intimidation, physique ou morale, vis-à-vis des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ou de leurs collaborateurs, qui pourrait les empêcher de remplir leurs missions en toute indépendance. »
La parole est à M. Serge Lagauche.

Mes chers collègues, où voit-on, depuis quelques mois, souvent avec un regard effaré, le chef de l’État en personne s’impliquer dans le départ du présentateur du journal télévisé le plus regardé du pays ?
Où découvre-t-on qu’un directeur de magazine a dû quitter ses fonctions pour avoir déplu à un ministre de l’intérieur ?
Où lit-on que le président de la République se plaindrait régulièrement, en public, de la mauvaise qualité de la presse…

…française et émettrait le vœu d’« en finir avec le journalisme de dénigrement pour promouvoir un journalisme pédagogique de l’action gouvernementale » ?
À notre grande honte, ce que je viens de décrire s’est passé en France ces derniers mois et continue de se passer tous les jours.
M. Yves Pozzo di Borgo s’exclame.

Le projet de réforme de l’audiovisuel public dont nous débattons s’inscrit parfaitement dans cette volonté constante du pouvoir de corseter la liberté des médias, de remettre en cause leur indépendance et de battre en brèche le pluralisme.
Mes chers collègues, dans aucune autre démocratie, le pouvoir exécutif se permet ainsi de « réannexer » la prérogative de choisir les dirigeants de l’audiovisuel public.
De cet invraisemblable abus de pouvoir que l’on nous propose aujourd’hui de légaliser, de l’immixtion inouïe du Gouvernement dans la gestion d’un média que la loi permettra alors, nous devons impérativement protéger les journalistes et l’ensemble des collaborateurs de la télévision publique.
Tel est le sens de cet amendement, que le Sénat s’honorerait d’adopter, en cohérence avec son amendement au projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République ayant permis de garantir constitutionnellement la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias.
M. Pierre Fauchon s’exclame.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Selon moi, nous avons largement évoqué l’ensemble de ces questions. Le statut dont bénéficient les journalistes garantit, me semble-t-il, leur indépendance. Cela a été le sens de nos discussions tout à l’heure.
Il ne me paraît pas utile d’ajouter des dispositions supplémentaires.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 316, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article 43-11 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La principale source de financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est constituée par le produit de la redevance audiovisuelle. »
La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mes chers collègues, nous avons adopté tout à l’heure un amendement visant à préciser que France Télévisions était principalement financée par la redevance.
À présent, nous proposons d’introduire une disposition identique relative au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.
L’ensemble du secteur public audiovisuel serait ainsi principalement financé par le produit de cette redevance, ou contribution, puisque tel est désormais son nom. L’objectif est le même, mais les circonstances sont différentes.
Une telle précision nous semble d’autant plus utile que certains amendements visent à entamer le principe de financement de certains des organismes audiovisuels publics par la redevance. Pour preuve, un amendement déposé par nos rapporteurs tend à revenir sur le financement de l’Institut national de l’audiovisuel, l’INA, et de la société Audiovisuel extérieur de la France par la redevance.
Pour nous, ce changement de pied paraît receler deux risques.
D’une part, les organismes concernés pourraient se retrouver dans une totale dépendance à l’égard du budget de l’État. Compte tenu de la situation de nos finances publiques et de la tentation toute naturelle des budgétaires de définir les objectifs à la place même des structures concernées, on ne peut pas soutenir cette évolution.
D’autre part, ces entreprises, si elles ne perçoivent plus la contribution, autrefois appelée « redevance », semblent, d’une certaine manière, sorties du périmètre de l’audiovisuel public.
D’ailleurs, la rédaction proposée tout à l’heure – elle semblait porter sur la définition du financement de la totalité de l’audiovisuel public – est contradictoire avec le retrait de la redevance à deux de ces organismes.
Par conséquent, nous avons des inquiétudes quant aux ressources de ces services. Nous l’avons déjà souligné à propos de France Télévisions. Nous le savons, Radio France n’est pas assurée d’obtenir une compensation pour le manque à gagner résultant de la baisse de ses recettes publicitaires.
Et l’INA et la société Audiovisuel extérieur de la France sont désormais privés de redevance et contraints de dépendre de la volonté gouvernementale de leur assurer un financement, qui n’est d’ailleurs pas garanti. Nous trouvons une telle évolution particulièrement préoccupante !
Nous y voyons d’ailleurs un repli aussi bien pour l’INA que pour la société Audiovisuel extérieur de la France sur des missions qui seraient présentées comme « techniques » et « étatiques ». Or, et je tiens à le rappeler ici, ces deux organismes participent véritablement au service public audiovisuel dans notre pays.
Comme nous le savons tous, mes chers collègues, l’INA a considérablement évolué dans la dernière décennie. Je vous renvoie notamment à ses travaux sur la mémoire collective. Au-delà, elle a accompli, notamment via la mise en œuvre de la numérisation, une modernisation au service du public qui est absolument fondamentale et qui mérite d’être reconnue et financée par la contribution.
La question se pose dans les mêmes termes pour l’audiovisuel extérieur, qui n’est pas seulement le bras armé de la diplomatie, même s’il y contribue. C’est surtout l’un des vecteurs de la coopération culturelle et audiovisuelle de la France avec les partenaires étrangers.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons l’adoption de l’amendement n° 316, dans la lignée de l’adoption de l’amendement relatif au financement majoritaire de France Télévisions par la contribution.

La commission pourrait être tentée d’émettre un avis de sagesse.
Toutefois, le dispositif que cet amendement vise à introduire dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne serait pas placé au bon endroit.
En effet, l’article 43-11 de cette loi traite des missions du service public de l’audiovisuel, et non de son financement.
Nous aurons donc l’occasion de revenir sur le sujet un peu plus tard dans le débat.

Dans la mesure où il s’agit d’un amendement important, je souhaite formuler une proposition.
La commission, qui serait prête à émettre un avis de sagesse sur cet amendement, juge que celui-ci n’est pas placé au bon endroit. Dans ce cas, serait-il possible de réserver cet amendement ?

Monsieur le président, il serait, me semble-t-il, préférable d’examiner un tel amendement à l’issue du débat sur le décroisement des financements de l’audiovisuel.
Par conséquent, je demande la réserve de l’amendement n° 316 jusqu’après l’examen de l’article 20.
Les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication mènent une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations, notamment ethnoculturelles, et à mieux refléter la diversité de la société française.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la loi doit-elle fixer les règles de recrutement des entreprises publiques ? Telle est la question posée par cet article, qui nous invite à faire des sociétés de l’audiovisuel public la « vitrine » de la discrimination positive.
Introduit dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par le député Frédéric Lefebvre, un tel article pose de nombreuses difficultés.
C’est de manière disons raisonnable que le rapport au fond souligne notamment ceci : « Votre commission attache de l’importance aux actions conduites par France Télévisions dans ce domaine et l’encourage à les renforcer. Ainsi qu’il a été dit précédemment, cette action se traduit notamment par le volet ressources humaines du plan du groupe pour l’intégration, qui est axé à la fois sur la promotion interne, sur l’accès à l’emploi et sur la formation.
« Toutefois, cet article nouveau pose plusieurs difficultés : il ne se rattache à aucun texte en vigueur ; il semble encourager une politique dite “ d’action positive ”, notamment dans le domaine du recrutement […] ; votre commission a déjà exprimé ses réticences sur le caractère réducteur de l’appréhension de la diversité de la société française au travers du critère ethnoculturel ; enfin, cette disposition est-elle nécessaire alors que l’article 1er B confie à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, le soin de remettre un rapport au Parlement sur cette question […] ? »
Tout ce développement conduit d’ailleurs la commission des affaires culturelles à proposer la suppression de l’article.
Pour être tout à fait clairs, et en adéquation avec notre position sur l’article 1er B, nous sommes sur la même longueur d’onde.
Pour autant, revenons quelques instants sur les termes mêmes de l’article : « Les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication mènent une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations, notamment ethnoculturelles, et à mieux refléter la diversité de la société française. »
Autrement dit, les discriminations dans notre pays seraient d’ordre ethnoculturel...
Comme si la vague de pseudo-réformes que connaît notre pays depuis le printemps 2007 avait permis d’occulter que les discriminations existant dans notre pays participent d’abord de l’appartenance sociale, de l’origine sociale et souvent géographique, trop souvent aussi de l’identité sexuelle, tout autant que de l’origine ethnique, notion pour le moins discutable et parfaitement antirépublicaine.
Car, faute de disposer de statistiques précises en la matière, nous en restons au domaine et au champ de la spéculation intellectuelle.
Et ceux qui utilisent l’argument ethnique sont ceux-là mêmes qui veulent faire oublier aussi rapidement que possible que les inégalités sociales sont la matrice dont naissent les principales discriminations dans notre pays.
Demander demain à l’audiovisuel public de se donner « bonne conscience » et d’atteindre quelques objectifs quantifiés revient à introduire une règle de quota de recrutement qui fait fi de la réalité.
La réalité, c’est, par exemple, que l’on sabre, année après année, les moyens de l’éducation nationale, outil essentiel de l’égalité d’accès à toute fonction pour les jeunes issus de toutes les conditions sociales ou communautés culturelles ou linguistiques.
C’est le gouvernement qui quantifie chaque année l’expulsion des sans-papiers et sanctionne les préfets n’en faisant pas réaliser suffisamment dans leur département qui demanderait à France Télévisions ou à Radio France de recruter des personnels de nationalité française issus de l’immigration au seul motif de ce qualificatif !
C’est le même gouvernement qui, prenant appui sur la loi de modernisation de l’économie et la création de la société Audiovisuel extérieur de la France, conduit une politique de restriction des effectifs issus de Radio France Internationale, ou RFI, en supprimant les émissions réalisées dans certaines langues au demeurant assez largement parlées sur le territoire hexagonal lui-même !
C’est aussi le même gouvernement qui, en asphyxiant financièrement France Télévisions, la met en situation de réaliser des centaines de suppressions d’emplois pour parvenir à l’équilibre financier !
Laissons au dialogue social interne propre aux sociétés de programme, dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et compétences, comme dans toute grande entreprise qui se respecte et observe les règles de la négociation collective, le soin de prendre en compte la promotion de la diversité d’origine des salariés de l’audiovisuel public ! D’autant qu’il ne nous semble pas que l’audiovisuel public ait forcément failli en la matière, contrairement à ce que l’on voudrait laisser accroire.
Nous nous opposons donc clairement à cet article.
Lutter contre les discriminations dans notre pays, c’est changer globalement de politique sociale, de politique en matière d’immigration, de politique économique et fiscale, de politique en matière d’éducation !
Ce n’est pas en adoptant des mesures plus que discutables que nous y parviendrons.
Aussi, nous voterons pour la suppression de cet article.

L'amendement n° 10, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.

La commission attache de l'importance aux actions conduites par France Télévisions dans le domaine de la lutte contre les discriminations dans sa politique de gestion des ressources humaines et elle l'encourage à les renforcer.
Cette action se traduit notamment par le volet « ressources humaines » du plan du groupe pour l'intégration, qui est axé à la fois sur la promotion interne, sur l'accès à l'emploi et sur la formation.
Toutefois, cet article nouveau pose plusieurs difficultés.
Premièrement, il ne se rattache à aucun texte en vigueur.
Deuxièmement, il semble encourager une politique dite « d'action positive », en particulier dans le domaine du recrutement, au risque de se heurter aux règles fixées en la matière par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou CNIL, et à des problèmes de constitutionnalité.
Troisièmement, votre commission a déjà exprimé ses réticences sur le caractère réducteur de l'appréhension de la diversité de la société française au travers du critère ethnoculturel.
Enfin, cette disposition est-elle nécessaire alors que l'article 1er B confie à la HALDE le soin de remettre un rapport au Parlement sur cette question et que cette Haute autorité pourra, le cas échéant, formuler des propositions concrètes d'amélioration ? Il est évident qu’une telle disposition constitue une forte incitation à l'action.
Pour toutes ces raisons, la commission vous propose de supprimer cet article.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Les propos tenus par Mme le rapporteur vont, pour l’essentiel, dans le sens de ce que nous pensons.
Tous les débats qui ont eu lieu jusqu’à présent à propos de la diversité garantissent que cette préoccupation, sur laquelle nous avons tous insisté, figure dans le projet de loi.
Mais un débat est soulevé, pas uniquement d’ailleurs dans le cadre de ce projet de loi – et Mme Bariza Khiari y a fait allusion tout à l'heure –, sur la discrimination appelée positive, ou encore aux États-Unis, et visant à introduire dans la loi une notion qui est incompatible avec nos principes républicains, à savoir la reconnaissance de quotas communautaires, y compris dans les recrutements.
Quand nous parlons de diversité, à nos yeux, c’est l’ensemble de la société qui doit se sentir concernée par les œuvres audiovisuelles, indépendamment de la couleur de peau ou des origines, notamment de leurs auteurs. Et la diversité ne doit pas se cantonner aux questions de communautés.
Or l’article 1er quater, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement du député Frédéric Lefebvre qui a théorisé la discrimination positive dans l’ensemble de la société, allant jusqu’à engager une polémique avec ceux qui ont une autre conception de la République, de la laïcité et de l’égalité des citoyens.
C’est pour cette raison que nous soutenons l’amendement n° 10 visant à supprimer l’article.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 95, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cahier des charges de France Télévisions précise les indicateurs de résultats à atteindre en matière d'évolution de la représentativité de la diversité de la société française, notamment ethnoculturelle, tant dans les programmes que dans la création et dans la politique de ressources humaines de France Télévisions.
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.
Le IV de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
« IV. - La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu'au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la fourniture d'informations relatives à l'actualité française, francophone, européenne et internationale.
« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langue étrangère, destinés en particulier au public français résidant à l'étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.
« Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France établi en application de l'article 48 définit les obligations de service public auxquelles sont soumis, le cas échéant, les services mentionnés à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l'ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’objet de l’article 2, qui crée une société holding regroupant les participations publiques dans nos sociétés de l’audiovisuel extérieur en lieu et place de Radio France internationale, semble a priori éloigné du sujet principal de ce projet de loi.
En effet, l’essentiel de votre projet vise, en supprimant la publicité sur les chaînes de la télévision publique, à réserver cette manne financière aux seules chaînes privées.
L’actualité récente a révélé que vous pouviez même vous dispenser d’un texte de loi pour atteindre cet objectif.
L’objet de cet article n’a donc pas de rapport direct avec le sujet principal du projet de loi, puisque la suppression de la publicité ne concernant que le territoire national, elle ne s’applique pas, par définition, à l’audiovisuel extérieur.
Mais ce que prévoit cet article n’en est pas moins important, car il est révélateur de l’esprit de votre texte qui a pour but inavoué d’affaiblir l’audiovisuel public et de le placer dans une dépendance financière, éditoriale et politique à l’égard du pouvoir.
Que l’on nous comprenne bien : nous ne sommes pas du tout hostiles au principe d’un regroupement des différentes sociétés composant l’audiovisuel extérieur pour leur permettre de bénéficier de davantage de cohérence et de lisibilité.
Nous ne refusons pas non plus un renforcement des synergies et un encouragement des mutualisations entre les opérateurs.
Non, ce que nous critiquons et redoutons, ce sont les conditions dans lesquelles les choses se font.
Elles masquent mal un affaiblissement programmé de l’audiovisuel public et une incontestable volonté de contrôle politique.
En premier lieu, le regroupement qui s’opère avec la société holding, déjà créée – notons-le au passage – depuis le 4 avril 2008 et qui aura un statut non plus de société publique, mais de société anonyme, s’effectuera d’abord au détriment de RFI.
En effet, six rédactions seront supprimées, car la direction a décidé de mettre fin à ses programmes en six langues : l’allemand – ce qui, n’en doutons pas, facilitera des relations qui ne sont malheureusement plus privilégiées avec ce pilier de la construction européenne qu’est l’Allemagne –, le polonais, le serbo-croate, le turc, le laotien et l’albanais.
Les organisations syndicales estiment ainsi que trois cents à quatre cents postes sur un millier seraient supprimés.
Au-delà de l’emploi, c’est aussi l’influence et le rayonnement de la France dans les pays concernés qui est menacée avec cet affaiblissement de l’un des deux piliers historiques de notre audiovisuel extérieur.
En deuxième lieu, ce service public risque également d’être affaibli par sa trop grande dépendance au regard du budget de l’État et par le fait que les dotations, si l’on en croit la programmation budgétaire triennale, seraient en forte diminution en 2010 et en 2011.
Après, tout dépendra du bon vouloir du Gouvernement en place.
Ce système ne garantit donc pas un financement pérenne et risque, à terme, de compromettre sérieusement les objectifs affichés.
En troisième et dernier lieu, la volonté de contrôle politique de l’audiovisuel est patente.
Le président d’AEF sera, comme les autres présidents de chaîne, nommé, et éventuellement révoqué, par le Président de la République.
Certes, vous vous êtes entouré de quelques garde-fous démocratiques du côté du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, et des commissions compétentes des deux assemblées. Mais cela sera de peu de poids face au pouvoir quasi absolu du Président de la République en la matière.
En ce qui concerne AEF, il y a donc tout lieu d’être inquiet de cette reprise en main politique.
Outre la concentration du pouvoir qui s’opère, puisque M. de Pouzilhac, secondé par une directrice générale déléguée, cumule le poste de président-directeur général de la holding avec celui de président du directoire de France 24, de président-directeur général de RFI et de président du conseil d’administration de TV 5 Monde, c’est aussi la proximité de ces responsables avec le pouvoir en place qui inquiète.
Leurs compétences professionnelles ne sont nullement en cause.
Mais il est, pour tout dire, malsain et peu démocratique que, s’agissant de l’audiovisuel extérieur, les relations avec le ministère des affaires étrangères soient aussi étroites.
Les syndicats de journalistes de RFI ont, par exemple, eu quelques raisons de s’en émouvoir lors du licenciement de l’un de leurs collègues qui avait réalisé sur TV 5 Monde une interview contestée du président syrien.
Il y a eu aussi le cas de ce journaliste connu de France 24, dont le contrat n’a pas été renouvelé pour avoir déplu.
Ainsi, l’article 2 recèle des dangers sur lesquels je voulais, mes chers collègues, attirer votre attention.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 2 est l’occasion pour nous de parler d’une entreprise parfois sous-estimée et, en tout cas, insuffisamment connue de nos concitoyens et même de ceux que l’on appelle les leaders d’opinion, je veux parler de Radio France Internationale.
L’article 2 du projet de loi prévoit une réécriture de la loi du 30 septembre 1986 pour substituer à la société Radio France Internationale la holding « Audiovisuel extérieur de la France », qui devient, elle, une société nationale de programme, ayant pour mission de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la fourniture d’informations relatives à l’actualité française, francophone, européenne et internationale ».
En conséquence, RFI n’existera plus comme société nationale de programme.
Depuis plusieurs années déjà, particulièrement depuis la création de France 24, son identité, son indépendance éditoriale, son cahier des charges, ses emplois sont mis en cause, au mépris d’un bilan incontestable acquis sur des années d’effort et sans qu’y soit substitué un projet stratégique clair tourné vers l’avenir.
Les personnels de RFI craignent 300 à 400 suppressions de postes, voire plus, sur un total d’un millier d’emplois. On sait déjà que des antennes vont disparaître, ainsi que plusieurs rédactions de langues jugées « trop confidentielles ».
Le 24 octobre dernier, la direction de la holding a confirmé ces craintes en annonçant la fermeture de six rédactions, comme vient de l’évoquer notre collègue Ivan Renar, tandis que trois autres seraient cantonnées à internet – le persan, le chinois et le russe – et s’éteindront sur les ondes.
La plupart des filiales de RFI à l’étranger devraient également fermer. L’exemple de la suppression de l’allemand, parallèlement à la réduction draconienne de notre réseau culturel en Allemagne, doit nous amener à nous interroger, mes chers collègues, sur la cohérence de notre politique étrangère, en particulier européenne.
Au moment où les médias, même publics, programment de moins en moins de films en version originale, ce que je déplore, il est encore plus regrettable de restreindre l’expression de l’audiovisuel extérieur dans les langues étrangères.
Vous feriez mieux, madame la ministre, d’assurer une plus large diffusion de RFI dans l’Hexagone, où seuls les Franciliens peuvent actuellement bénéficier de ses programmes.
Comment ne pas s’inquiéter de cette « chronique d’une mort annoncée »pour RFI ?
En matière de financement, c’est l’incertitude la plus totale. Du fait de la réforme de l’audiovisuel extérieur, les dotations publiques ne sont plus attribuées société par société dans le cadre de la loi de finances. Elles seront regroupées dans une enveloppe globale qui fera l’objet d’une répartition par les dirigeants de la holding Audiovisuel extérieur de la France, entre les différentes entreprises, sans qu’aucun mécanisme ne garantisse un partage équitable.
Or, et ce point vient d’être évoqué, du fait des responsabilités précédentes du président-directeur général de France 24, dont il reste président du directoire, on peut craindre que la répartition des dotations ne favorise cette chaîne au détriment de TV5 Monde et de RFI. TV5 Monde est un peu protégée par son statut multilatéral, mais RFI ne l’est pas.
En outre, par voie d’amendement, la commission des affaires culturelles envisage de prélever les ressources issues de la redevance audiovisuelle destinées à l’audiovisuel extérieur, soit 65 millions d’euros, pour les attribuer à France Télévisions afin de compenser la perte des recettes publicitaires.
Ainsi, l’audiovisuel extérieur apparaît comme une variable d’ajustement. Il se trouvera de plus en plus dépendant des décisions budgétaires et sera dans la main de l’exécutif.
Une réforme de l’audiovisuel public doit faire avancer l’audiovisuel extérieur et non le faire régresser. RFI est un des atouts de la France à l’étranger. Elle mérite un meilleur traitement. Son ministère d’origine, le ministère des affaires étrangères, devrait s’en préoccuper, veiller à la coordination et non à l’absorption !
M. David Assouline applaudit.

L’article 2 est l’épilogue d’une aventure commencée en 2001.
Trois ans après le lancement de France 24, je tiens à souligner les errances de la politique audiovisuelle internationale de la France à compter de cet événement.
Le mal résulte d’une conception présidentialiste, pour ne pas dire bonapartiste, de la prise de décision politique, qui fait encore plus de ravage sous le règne du prince actuel que sous celui de son prédécesseur.
Le candidat Jacques Chirac avait annoncé en 2001 son désir d’avoir une « CNN à la française ». Toute la cour, après son élection, a feint d’oublier que nous avions TV5 Monde, chaîne dont les informations sont reconnues et font autorité face au bulldozer américain pendant les périodes de crise.
Toute la cour a oublié l’existence de RFI, seule radio française à donner réellement de l’information internationale et à disposer de rédactions multilingues.
Après mille et un rapports, au lieu de muscler les deux bras de l’audiovisuel extérieur, on en greffe un troisième, qui s’appelle d’abord CFII – ça fait très branché ! –, puis France 24. Cette chaîne est très jeune, très bien équipée, mais, inévitablement, elle pompe les ressources publiques au détriment de RFI et de TV5 Monde.

Certes, monsieur, mais elle coûte très cher – je voudrais d’ailleurs savoir où passe une partie de l’argent ! – et elle est très peu regardée : elle est donc onéreuse au vu du nombre de téléspectateurs !
RFI passe mal et difficilement au numérique ; le climat social s’y alourdit. TV5 Monde est bridée, conquiert d’abord péniblement de nouveaux publics, faute de sous-titrer, comme cela était prévu, suffisamment d’émissions dans les langues des auditeurs en Amérique latine ou en Europe du Nord.
Aujourd’hui, RFI et TV5 Monde perdent du terrain. C’est l’argument avancé par le nouveau président de toutes ces chaînes pour affirmer qu’elles ne valent pas grand-chose et qu’elles doivent être rabaissées par rapport à la nouvelle chaîne.
Pour faire cesser les soubresauts de notre audiovisuel extérieur gêné de ses trois bras, et après un rapport de MM. Benamou et Lévitte dont on ne suit pas les préconisations, on décide de maquiller en holding la fusion des trois chaînes : c’est le mystère de la Sainte Trinité !
Le seul problème, c’est que les trois pays francophones qui conjuguent leurs efforts avec la France pour développer TV5 Monde depuis vingt-cinq ans refusent de s’incliner devant le tabernacle et se rebiffent !
Après leur avoir fait raconter des mensonges pendant six mois par des ministres dociles, il faut leur céder, pour l’instant. TV5 Monde gardera son autonomie grâce à un directeur général francophone – il se trouve qu’il s’agit d’une Française –, nommé avec leur accord.
Pour autant, cet article vise à ce qu’un seul et même président soit nommé à la tête de TV5 Monde et de RFI. Il restera président de France 24 et il sera également président de la holding.
Ce qui est formellement interdit pour une holding privée devient possible dans une holding publique.
Mme Catherine Tasca opine.

Par ailleurs, quelle que soit la qualité des hommes et quelle que soit la qualité de l’homme, il faudra qu’une seule personne négocie avec elle-même à la fois la stratégie des trois antennes et la répartition des crédits publics.
Nous avions un omniprésident de la République, nous avons maintenant un omniprésident de l’audiovisuel extérieur, ce qui n’est peut-être pas tout à fait l’idéal pour exprimer la diversité de notre beau pays !
Je souhaite enfin dire un mot du gaspillage des deniers publics engendré par des choix clientélistes.
En 2005-2006, nous avons protesté contre l’attelage baroque que constituait la société France 24, propriété à 50 % de France Télévisions et à 50 % de TF1. Comme nous avions raison !
Chacun sait qu’une chaîne d’information continue est déficitaire. Soit elle est adossée à un consortium, comme la BBC ou CNN, soit elle a un mécène, comme Al-Jazira. TF1 n’a donc jamais financé France 24. Elle a seulement mis au pot 17 500 euros. Quelle somme !
Le principal rôle du groupe Bouygues aura été pendant trois ans de s’opposer à la diffusion de France 24 en France, comme si les Français n’avaient pas sérieusement besoin de s’ouvrir au monde. Mais il fallait surtout éviter de concurrencer LCI. Aussi, France 24 n’a été diffusée ni par l’ADSL ni par la TNT.
En récompense de son obstruction, TF1, qui réclamait initialement 90 millions d’euros pour sortir du capital de France 24, contre les 17 500 euros qu’elle avait mis au pot, a fait un geste et se contente aujourd'hui de 2 millions d’euros !

En ces temps de désastre boursier, M. Bouygues, bien placé à la cour, a réalisé un placement magnifique aux dépens du contribuable. Pour lui, finalement, c’est peu. Quand on est un ami du Président de la République, tout va bien !
Par conséquent, à Dieu vat l’audiovisuel extérieur de la France !

Je suis saisi de vingt et un amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 119 est présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 252 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Ivan Renar, pour présenter l’amendement n° 119.

Cet article 2 vise à réécrire la loi du 30 septembre 1986 pour substituer à la société Radio France internationale, ou RFI, une holding dénommée « Audiovisuel extérieur de la France ».
Elle devient une société nationale de programme regroupant les participations publiques dans les différentes sociétés de l’audiovisuel extérieur. Ainsi, RFI disparaîtra et n’aura plus d’existence juridique propre.
Malheureusement, cette décision n’est que l’aboutissement d’un long processus : depuis quelques années, en fait, depuis la création de France 24, l’identité de RFI, son indépendance éditoriale, son cahier des charges et ses emplois sont menacés. Son financement est également désormais très incertain.
En effet, avec cette réforme de l’audiovisuel extérieur, les dotations publiques ne seraient plus attribuées à chaque société, mais seraient regroupées au sein d’une enveloppe globale répartie par la holding entre les différentes entreprises.
La pérennité de l’emploi au sein de l’entreprise est compromise puisque les personnels craignent entre 300 et 400 suppressions de postes.
Des antennes vont disparaître, ainsi que plusieurs rédactions en langues jugées, paraît-il, trop confidentielles.
Je ne fais pas de la désinformation, car il s’agit de projets confirmés à la fin de l’année dernière par la direction de la holding. Celle-ci envisage la fermeture de rédactions importantes : en allemand, en polonais, en serbo-croate, en turc, en laotien ou bien encore en albanais.
L’une des principales conséquences de l’article 2 sera non pas de redéployer des moyens, mais de répartir des budgets insuffisants en affaiblissant RFI. C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 252.

Cet amendement de suppression concerne le projet d’audiovisuel extérieur de la France, celui qui concentre le pire conjugué de l’amateurisme et du libéralisme sans scrupule.
Nous savions le Gouvernement friand de confusions entre le public et le privé : les partenariats public-privé, ou PPP, qui endettent pour longtemps les collectivités, leur font perdre la maîtrise des projets et éloignent de ceux-ci les hommes de l’art que sont les architectes.
Nous savions le Gouvernement peu regardant sur le service public : l’objet « bâtard » qu’est France 24 va, après son bref voyage autonome, regagner le giron, mais TF1 se fera payer très cher pour sa sortie.
Voilà que vous nous proposez de nouveau un attelage mixte, sous forme d’une holding. Faudra-t-il que nous explorions toute la terminologie du monde des affaires pour donner à voir ce que vous préparez dans les codes de la loi ?
En effet, vous juxtaposez dans votre projet des structures aux intérêts contradictoires. La victime sans doute programmée est RFI, dont l’exercice sensible et complexe des missions ne résistera pas à la course aux résultats.
Parler juste aux Français de l’étranger, parler juste de territoires lointains, culturellement différents, certains sous tensions internes, certains ayant des liens obscurs ou des contentieux avec notre pays, n’est pas une mission facile.
Certains journalistes l’ont payé de leur sérénité, d’autres de leur liberté. Certains, même, y ont perdu la vie.
On ne saurait nier la complexité de produire et de diffuser en Françafrique, par exemple. On ne peut nier les forces croisées d’intérêts au milieu desquelles travaillent de façon précarisée les journalistes. Même un secrétaire d'État a obtenu une rapide mutation faute d’avoir prononcé les mots qui plaisent aux dirigeants africains !
Prenons l’exemple de RFI au Niger, où le gouvernement signe à Niamey les concessions d’exploitation de l’uranium de l’Aïr, à 1 000 kilomètres de là, où vivent les Touaregs, où AREVA, entreprise française, exploite des mines polluantes pour les Touaregs et enrichissantes pour la France. Mettez au milieu de cela quelques journalistes qui veulent faire leur métier et raconter les motifs de ce que l’on nomme « la rébellion touareg ». Vous obtiendrez deux journalistes de RFI en prison, finalement libérés et renvoyés en France, plus un journaliste nigérien de RFI longtemps gardé derrière les barreaux, et finalement libéré grâce à la solidarité de ses collègues !
Vous voudriez, en plus, que ces délicates missions soient menées par des structures d’intérêt mixtes ? Gageons, si cela était le cas, que le délicat processus de récolte et de mise en forme de l’information serait vite altéré par des pressions exogènes et par le souci des résultats.
Dans le monde, des centaines de postes, des dizaines de bureaux sont menacés : Berlin a vacillé, les autres aussi. C’est un bien mauvais coup que vous préparez à notre outil audiovisuel extérieur, à mille lieues de toute revitalisation intelligente ! J’appelle donc à la suppression de cet article.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 11 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.
L’amendement n° 79 rectifié est présenté par M. Kergueris, au nom de la commission des affaires étrangères.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
fourniture d’informations relatives
par les mots :
programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

Cet amendement entend respecter la mission fondamentale des filiales et partenaires de la future société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France – TV5 Monde, France 24 et Radio France Internationale –, à savoir la création de documents audiovisuels propres.
En outre, la formulation du deuxième alinéa de l’article 2 du projet de loi, aux termes duquel la société en charge de l’audiovisuel extérieur contribue au rayonnement international de notre pays « notamment par la fourniture d’informations relatives à l’actualité française, francophone, européenne et internationale », peut apparaître potentiellement réductrice. En effet, l’expression « fourniture d’informations », par son imprécision, néglige la mission fondamentale des sociétés éditrices de l’audiovisuel extérieur : la production autonome de documents audiovisuels propres.
Il convient de trouver une formulation qui permette de mieux rendre compte de la notion de « média global », applicable à notre audiovisuel extérieur, qui suppose la création de documents audiovisuels, et pas seulement de programmes à caractère informatif, sur tout type de support : radio, télévision et internet.
À cet égard, les auteurs de cet amendement relèvent que, dans sa rédaction en vigueur, l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 charge la société nationale de programme RFI, à laquelle se substitue la société AEF, de « contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d’émissions de radio ».
Par ailleurs, les statuts mêmes de la société AEF mis à jour le 4 avril 2008 ont pris soin de rappeler que la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France contribue à la diffusion des cultures française et francophone « par la conception, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de sites et portails internet ». Cette formulation est, selon vos rapporteurs, plus satisfaisante.
En conséquence, cet amendement tend à substituer à l’expression « fourniture d’informations » celle de « programmation et diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale », formulation inspirée des statuts de la société Audiovisuel extérieur de la France. Par ces précisions, c’est la dimension de « média global », applicable à notre audiovisuel extérieur, qui est réaffirmée.

en remplacement de M. Joseph Kergueris, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié.

L’article 2 de ce projet de loi est entièrement consacré à l’audiovisuel extérieur, vous vous en êtes rendu compte. Il fait de la société Audiovisuel extérieur de la France une société nationale de programme, à l’image de France Télévisions et de Radio France.
Cette société holding a été créée en avril dernier dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel extérieur, lancée sur l’initiative du Président de la République pendant l’été 2007. Elle a vocation à rassembler l’ensemble des participations publiques dans les sociétés de l’audiovisuel extérieur, c’est-à-dire Radio France Internationale, TV5 Monde et France 24. Cette réforme permettra de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’audiovisuel extérieur, de développer les synergies entre les différentes sociétés et de mettre en place un véritable pilotage stratégique de l’audiovisuel extérieur, qui fait défaut actuellement.
La commission des affaires étrangères et de la défense, saisie pour avis, approuve globalement la rédaction de cet article qui vise à conforter la réforme de notre audiovisuel extérieur. Elle vous propose toutefois plusieurs amendements visant à améliorer encore la rédaction de l’article dont certains sont identiques, ou presque, aux amendements présentés par les deux rapporteurs de la commission des affaires culturelles.
Ainsi, concernant les missions assignées à la société en charge de l’audiovisuel extérieur, l’article 2 dispose qu’elle a pour objet de « contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde ». Toutefois, la formule selon laquelle elle poursuit cet objectif, « notamment par la fourniture d’informations relatives à l’actualité française, francophone, européenne et internationale », peut apparaître, par son imprécision, potentiellement réductrice. Cet amendement entend respecter la mission fondamentale des filiales et partenaires de la future société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur – TV5 Monde, France 24 et Radio France Internationale –, à savoir la programmation et la diffusion d’émissions de radio ou de télévision sous tout type de support.
À cet égard, il convient de rappeler que les statuts de la société Audiovisuel extérieur de la France, mis à jour le 4 avril 2008, ont justement pris soin de rappeler que la société en charge de l’audiovisuel extérieur a pour mission « de contribuer à la diffusion de la culture française et francophone par la conception, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de sites et de portails internet ».

Les amendements n° 254 et 319 sont identiques.
L’amendement n° 254 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L’amendement n° 319 est présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de cet article, remplacer les mots :
fourniture d’informations
par les mots :
conception et la programmation d’émissions de radio et de télévision,
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 254.

Cet amendement vise à compléter et enrichir la fruste notion de « fourniture d’informations ».
Chers collègues, entre la « fourniture d’informations » et la « conception et la programmation d’émissions de radio et de télévision », il y a la même différence qu’entre un distributeur automatique nocturne de pain congelé et votre artisan boulanger-pâtissier ! Nombre de sénateurs défendent l’artisanat et en vantent à la fois le métier et la qualité des produits. Alors pourquoi voudriez-vous tirer vers le bas une mission culturelle et intellectuelle, la ravaler au rang de fourniture, ce que vous n’acceptez pas quand vous célébrez la belle ouvrage de l’artisanat ?
Autre paradoxe : l’audiovisuel extérieur serait victime de ce sabotage ! Vous qui avez souvent, presque trop souvent, les mots « rayonnement » ou « image de la France » à la bouche, pourquoi envisagez-vous une restriction aussi sévère de ses missions ? Ce que vous projetez apportera moins aux étrangers et aux Français hors de France qu’un balayage d’amateur à la portée de n’importe quel adolescent sur divers sites internet francophones.
C’est pourquoi, à défaut d’avoir pu supprimer l’objet non identifié et hasardeux AEF, je vous propose de qualifier sa mission.

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 319.

S’il doit y avoir une société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, il est inopportun de la réduire à une simple banque d’informations. Or la formulation proposée par l’article 2 du projet de loi laisse penser que le législateur nourrit pour cette société le projet de ne lui attribuer que ce rôle réducteur, comme l’a rappelé Mme Blandin.
Les différents partenaires de la société en charge de l’audiovisuel extérieur sont bien plus que de simples sociétés de fourniture d’informations. On sait néanmoins que le Gouvernement, compte tenu du budget restreint prévu pour cette société, souhaite que RFI devienne un simple fournisseur de contenus, en complément des programmes de la nouvelle chaîne. Les économies de moyens affectant RFI s’accompagneront inévitablement d’économies de personnel, avec des plans sociaux à la clé.
Les personnels de RFI redoutent entre trois et quatre cents suppressions de postes, sur un effectif total d’environ mille salariés : c’est une réduction de grande ampleur. Des antennes vont disparaître ; six rédactions en langues jugées trop confidentielles – laotien, albanais, turc, serbo-croate, polonais, … allemand ! – vont bientôt être supprimées ; l’extinction de l’antenne Proche-Orient est entérinée. Les dernières informations communiquées par les syndicats nous confirment que la direction de RFI prépare ce qu’elle appelle un ample « plan de sauvegarde des emplois » ou PSE – mais on peut aussi l’appeler « plan de suppression d’emplois » sans changer le sigle –, qui prévoit non seulement des départs volontaires et des départs anticipés à la retraite, mais aussi des licenciements secs en nombre. Est-ce un hasard si Alain de Pouzilhac a récemment évoqué le chiffre de 397 suppressions de postes, contenu dans le rapport Benhamou, en ajoutant : « Ce ne serait pas un démantèlement de RFI » ?
Le calendrier se précipite : jeudi 8 janvier, la direction a proposé aux syndicats un projet d’accord de méthode ; le 14 janvier à 18 heures, se tiendra un conseil d’administration extraordinaire, convoqué au dernier moment, pour la présentation du projet global de modernisation dans lequel s’inscrit le fameux PSE ; le 15 janvier, la direction réunit un comité d’entreprise extraordinaire pour une première consultation au titre du livre IV du code du travail, engageant ainsi les procédures prévues pour un PSE. L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille des programmes est prévue pour le 19 janvier : nous ne pouvons pas accepter une grille qui servirait de prétexte à un plan social !
Un PSE, des licenciements à RFI, c’est inadmissible et c’est ce qui est programmé ! Cet amendement vise donc à réaffirmer les missions fondamentales actuelles de RFI, TV5 Monde et France 24, à savoir « la conception et la programmation d’émissions de radio et de télévision ».
Pour conclure, nous n’avons pas demandé la suppression de l’article 2. De la même façon, nous ne nous sommes pas opposés à la création de la société unique France Télévisions. Nous sommes d’accord pour une modernisation, un regroupement des forces, la conjugaison des moyens pour plus d’efficacité et de vigueur face aux défis de la modernisation des dix prochaines années. Mais, dans tous les cas, nous voulons absolument que l’identité et les outils de ces entités soient préservés et nous refusons que l’on se serve de réformes nécessaires, qui doivent nous permettre d’aller de l’avant, pour casser des acquis. Nous voulons réformer en vue d’un progrès et non de régressions !

L’amendement n° 317, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Elle est chargée de coordonner l’action des services Radio France International, TV5 Monde et France 24.
La parole est à M. David Assouline.

Cet amendement développe une autre facette de notre argumentation.
Plusieurs rapports récents de la Cour des comptes font apparaître le constat unanime d’une déficience stratégique d’ensemble et d’un pilotage défaillant des opérateurs audiovisuels extérieurs ainsi que les choix différés des pouvoirs publics et un mauvais calibrage des moyens financiers mis à disposition des différentes sociétés.
En 2008, l’importante progression des crédits budgétaires destinés à l’audiovisuel extérieur a été entièrement absorbée par la montée en charge de France 24, au détriment de CFI, RFI et TV5.
Dans l’état actuel des choses, on nous dit que la holding Audiovisuel extérieur de la France, créée en avril 2008, devrait regrouper RFI, France 24, TV5 Monde et qu’elle s’adjoindra la participation de la Compagnie internationale de radio-télévision, la CIRT. Une vingtaine de journalistes français de cette société travaillent au sein de Medi 1 Sat, société au capital détenu pour 56 % – à parts égales – par Maroc Télécom et la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc, CDG, via sa filiale FIPAR-Holding, pour 30 % par l’opérateur français, la CIRT et pour 14 % par Radio Méditerranée internationale, et assurent 50 % de l’antenne de la chaîne.
Le montage financier de la holding, qui relève principalement du domaine réglementaire, risque encore fort de s’apparenter à une usine à gaz... et même de fournir encore à la Cour des comptes matière à littérature !
D’autant que, dans ce montage financier, va entrer en ligne de compte le rachat des 50 % de parts de TF1 dans France 24, par l’État, pour la coquette somme de 2 millions d’euros, parts de capital que cette société avait acquises pour 17 500 euros il y a seulement cinq ans ! Cela a été dénoncé tout à l’heure par Mme Cerisier-ben Guigaet précédemment dans la discussion générale. Encore une opération financière désastreuse pour l’État et un beau cadeau supplémentaire au groupe Bouygues !
Plutôt que de multiplier ce type de montages financiers peu fructueux pour l’État, il nous apparaît préférable d’utiliser les structures publiques et compétences existantes, notamment afin de préserver la situation des personnels de ces sociétés et plus particulièrement ceux de RFI.
En termes de droits sociaux, la constitution de cette holding hybride signifiera des licenciements : quid des intermittents et pigistes qui représentent le quart de TV5 Monde en équivalents temps plein et plusieurs centaines de personnes dans les trois sociétés RFI, CFI et TV5 ?
Elle entraînera également l’abandon de la convention collective : la dérégulation des rapports patron-salariés est en route dans l’audiovisuel public ; elle se fera en créant peu à peu des entités qui ne se référeront plus à cette convention.
Elle impliquera aussi l’abandon de l’avancement automatique : c’est la seule mesure qui jusqu’à maintenant compensait un peu la hausse du coût de la vie, dans un audiovisuel public où le point d’indice n’a pas augmenté depuis onze ans ; or on parle de le supprimer.
Tous ces doutes nous amènent à penser qu’il convient de préserver les sociétés publiques existantes.

L'amendement n° 318, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'État, conformément à l'article 53, prévoit les modalités dans lesquelles la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France conclut une convention pluriannuelle de partenariat stratégique avec l'Agence France Presse.
La parole est à M. David Assouline.

L’Agence France-Presse, l’AFP, peut constituer un partenaire naturel et idéal pour la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.
Présente dans 165 pays, avec 110 bureaux, dans six langues, avec ses 50 correspondants et ses 1 200 journalistes, 200 photographes et 2 000 pigistes, l’Agence France-Presse est à même de fournir à cette société, outre des sujets vidéo et des interventions ou des chroniques audio ou en plateau, un soutien logistique aux envoyés spéciaux de la chaîne travaillant sur place.
L’activité « images » est devenue une priorité de l’AFP pour s’ancrer un peu plus sur le terrain comme source primordiale d’information. La production de l’AFPTV est d’ailleurs visible sur des chaînes, en particulier sur France 24 et TV5 Monde.
Il semble donc opportun que le contrat d’objectifs et de moyens de la société en charge de l’audiovisuel extérieur prévoie expressément les modalités de collaboration entre ces deux entités complémentaires et remplissant des missions communes, celles de la collecte et de la diffusion d’informations, au niveau international.
À ce titre, une convention pluriannuelle pourrait être passée entre les deux sociétés.
Tel est l’objet de notre amendement.

L'amendement n° 120, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
ou en langue étrangère
par les mots :
et en langues étrangères
La parole est à M. Ivan Renar.

Avec cet amendement, nous proposons de remplacer les mots « en langue étrangère » par les mots « en langues étrangères ».
Il ne s'agit pas d’un détail ou d’une simple question sémantique ; il s’agit au contraire d'inscrire dans la loi que la diversité linguistique de l’audiovisuel extérieur de la France doit être préservée. Et ce n’est pas une clause de style quand on sait que l’une des sociétés de la holding, RFI, verra disparaître plusieurs de ses bureaux à l’étranger.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que la direction de la holding AEF, déjà créée depuis le mois d’avril de l’année dernière et dont nous discutons aujourd'hui, a confirmé la fermeture de six rédactions, dont les langues seraient, paraît-il, jugées « trop confidentielles ». On ne le répétera jamais assez ce qui se passe actuellement.
Or, parmi ces langues, quatre sont européennes : l’allemand - comme confidentialité, on fait mieux ! -, le polonais et le serbo-croate - ce qui est aussi très discutable – ainsi que l’albanais.
Je rappelle tout de même que nous sortons de six mois d’une présidence européenne hyperactive et agitée, mais que dans le domaine de l’influence et du rayonnement culturel de la France, cet aspect a été pour le moins négligé.
Il y a quelque incohérence à vouloir que France 24 diffuse des journaux d’information en français bien sûr, en anglais, et, espérons-le, bientôt en arabe, alors que dans le même temps la vocation internationale de RFI est largement entamée.
C'est la raison pour laquelle il n’est pas anodin d’effectuer cette rectification sémantique. Le fait d’inscrire dans la loi que la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France contribue à définir les orientations en français et en langues étrangères permettrait de réaffirmer sa vocation initiale et sa mission première.
Je suis persuadé, mes chers collègues, que vous adopterez cette précision indispensable.

Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 80 est présenté par M. Kergueris, au nom de la commission des affaires étrangères.
L'amendement n° 322 est présenté par Mme Tasca, MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :
langue étrangère
par les mots :
langues étrangères
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.

Il convient de préciser sans aucune ambiguïté que les programmes édités par les sociétés de communication audiovisuelle ou de radio dont le capital est entièrement ou partiellement détenu par la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, telles que TV5 Monde, RFI ou France 24, peuvent être diffusés en français ou dans d'autres langues, sans réserver une place particulière à une langue étrangère parmi d'autres.
D'ores et déjà, RFI édite des programmes dans plusieurs langues étrangères et France 24 édite deux programmes, en français et en anglais, avec des décrochages en arabe, et bientôt en espagnol, tandis que les programmes de TV5 Monde font l'objet de sous-titrages dans plusieurs langues.
Tel est l’objet de cet amendement.

La parole est à M. Robert del Picchia, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 80.

Cet amendement, présenté par la commission des affaires étrangères, vise, comme les amendements n° 12 et 322 auxquels il est identique, à garantir le respect du plurilinguisme dans les programmes de l’audiovisuel extérieur.
Radio France Internationale édite des programmes dans plusieurs langues étrangères. France 24 diffuse deux programmes principaux, l’un en français, l’autre en anglais, avec des décrochages en arabe et bientôt en espagnol. TV5 Monde fait l’objet de sous-titrages dans plusieurs langues.
L’article 2 de ce projet de loi précise que les services de communication audiovisuelle doivent être « en français ou en langue étrangère ». Cette rédaction nous semble ambiguë dans la mesure où elle pourrait conduire à réserver un traitement particulier à une seule langue étrangère parmi d’autres, et vous avez bien sûr compris qu’il s’agirait de la langue anglaise.
Il paraît donc préférable, afin d’éviter tout équivoque, de mettre les termes « en langues étrangères ».

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l'amendement n° 322.

Le fait de remplacer les mots « langue étrangère » par ceux de « langues étrangères » n’est pas, comme cela vient d’être dit, une précision sémantique ; c’est bien un axe de travail pour le projet de l’audiovisuel extérieur.
Actuellement, BBC World Service émet en trente-trois langues, RFI seulement en une vingtaine de langues.
Sur ces vingt langues, nous l’avons dit, six vont être bientôt supprimées par la direction de la société, car considérées comme trop « confidentielles ». Il s’agit de l’allemand, de l’albanais, du polonais, du serbo-croate, du turc et du laotien.
À l’heure où la construction européenne est une réalité de tout instant, mais, nous le savons, une réalité difficile, il est vraiment surprenant de supprimer l’une des langues majeures de l’Union européenne - l’allemand -, de faire un mauvais sort au polonais, langue d’un grand État récemment entré dans l’Union et de rompre avec la Turquie.
À cette suppression de six rédactions - actée, semble-t-il -, sera sans doute ajoutée prochainement celle de trois autres, cantonnées à la seule diffusion sur internet. Ce sont des choix stratégiques qui augurent mal du développement de la société en charge de l’audiovisuel extérieur.
Avec dix rédactions en langues étrangères, comment pourra-t-elle faire le poids face à la BBC ou à CNN ?
Notre amendement tend donc à sécuriser la multiplicité de services en langues étrangères.
J’ajoute que, si l’on réduit le spectre des langues étrangères sur RFI, la question se posera de plus en plus d’une langue commune, d’une langue d’échange transversal, international. Sur ces travées, nous savons bien quelle est la réponse lorsque, au-delà de la langue française, on s’interroge sur le meilleur véhicule de la pensée et de la culture à l’étranger. La réponse est connue d’avance, c’est la langue anglaise.
C’est cette orientation que nous récusons et voilà pourquoi nous proposons cet amendement n° 322.

L'amendement n° 81, présenté par M. Kergueris, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :
I. - Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :
définit
insérer les mots :
ou contribue à définir
II. - Dans le même alinéa, supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Robert del Picchia, rapporteur pour avis.

rapporteur pour avis. Cet amendement vise à concilier deux impératifs.
D’une part, il importe que, à l’instar de l’audiovisuel public national, les sociétés de l’audiovisuel public extérieur soient soumises à des obligations de service public. Or la formule « le cas échéant » peut, de ce point de vue, sembler ambiguë.
D’autre part, il faut tenir compte de la situation particulière de TV5 Monde. En effet, TV5 Monde, qui est une chaîne généraliste et francophone, présente la particularité d’associer la France et des partenaires francophones, la Suisse, la Belgique, le Canada et le Québec. Il résulte d’ailleurs des négociations avec nos partenaires francophones que la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ne détiendra que 49 % du capital de TV5 Monde alors qu’elle devrait détenir à terme 100 % du capital de RFI et de France 24.
TV5 Monde sera par conséquent un partenaire et non une filiale de la holding et il convient donc de tenir compte de cette situation dans la définition des obligations de service public auxquelles est soumise cette chaîne.
Afin de concilier ces deux impératifs, il est proposé par cet amendement de supprimer l’expression « le cas échéant » et d’insérer l’expression « définit ou contribue à définir », qui figure déjà au deuxième alinéa du IV de l’article 2 en ce qui concerne la définition des orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 121 est présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 323 est présenté par Mme Tasca, MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Ivan Renar, pour présenter l'amendement n° 121.

Nous souhaitons, avec cet amendement, faire disparaître une restriction.
En effet, selon la loi du 30 septembre 1986, le cahier des charges de la holding Audiovisuel extérieur de la France devrait définir les obligations de service public et les conditions dans lesquelles AEF doit assurer la diversité et le pluralisme des programmes.
Or, dans votre texte, en introduisant l’expression « le cas échéant », vous ouvrez la possibilité d’une réduction considérable du champ de ces obligations.
AEF doit impérativement assurer sa vocation première de service public audiovisuel, sinon quelle différence avec les chaînes privées, grandes bénéficiaires de la réforme ?
Pourtant, l’un des moyens détournés de l’en empêcher, et c’est tout le sens de votre expression « le cas échéant » - il ne manque plus que « quand c’est qu’on va où ? »
Sourires

On commence ainsi par « libérer » de certaines obligations des services de communication audiovisuelle qu’AEF pourra éditer et, dans quelques années, la holding tout entière sera peu à peu vidée de sa substance.
Nous ne souhaitons pas mettre la main dans cet engrenage dangereux et c’est la raison pour laquelle nous vous demandons, chers collègues, de voter cet amendement.

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l'amendement n° 323.

Actuellement, le cahier des charges de RFI assigne à cette société des missions de service public d’ordre très différent.
Ces missions vont de la diffusion à l’étranger de la culture française et de la réponse aux besoins des Français de l’étranger en matière d’information, de distraction et de culture jusqu’au respect du pluralisme, de la personne humaine et de sa dignité, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection des enfants et adolescents.
Ce cahier des charges impose aussi des obligations en matière de parrainage et de publicité.
On peut supposer que le cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur s’inspirera de celui de RFI et que les obligations y figurant seront multiples. Mais on peut vraiment s’interroger aujourd'hui sur les obligations dont on peut penser que la société pourrait s’exonérer.
Les mots « le cas échéant » nous semblent inappropriés. Nous souhaitons que, dans la future loi, ne subsiste aucune ambiguïté quant au caractère obligatoire de l’ensemble des obligations figurant au cahier des charges.

L'amendement n° 320, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel, Fichet et Gillot, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Patient et Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Il définit également les modalités de coopération à établir entre la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et les services ultramarins de France Télévisions.
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Il convient d'établir des liens étroits entre les différents services des sociétés nationales de programme œuvrant en faveur du développement de la francophonie, en l'occurrence les chaînes locales de RFO, et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
La francophonie constitue un outil diplomatique qui, malheureusement, n’est pas assez utilisé. En tant qu’ancienne députée européenne, je ne peux que déplorer l’affaiblissement de l’utilisation du français, non seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde.
À ce titre, il convient de valoriser la richesse que constituent, pour la France, les outre-mers de chaque continent.
Les antennes locales de RFO peuvent constituer des relais actifs, aussi bien en termes de contenu de programmes que de plateaux techniques, pour participer au rayonnement de la France à l’étranger.
Aussi cet amendement a-t-il pour objet d’institutionnaliser une coopération entre les antennes de l’audiovisuel extérieur de la France et RFO.
Comme pour la coopération avec l’AFP, nous souhaitons que le cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur prévoie ces modalités de coopération entre les antennes de RFO et ses services.
C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de voter en faveur de cet amendement.

L'amendement n° 122, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. Lors de la fusion-absorption par France Télévisions, tous les contrats en cours subsistent entre l'employeur et le personnel de la nouvelle société. La société France Télévisions assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public. »
La parole est à M. Ivan Renar.

Avec la création de la société holding en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, qui se substitue à RFI en tant que telle, les personnels de France 24, TV5 Monde et RFI craignent d’être victimes d’un tour de passe-passe et de n’être plus soumis au régime des conventions collectives en vigueur dans l’audiovisuel public.
Cette crainte peut être fondée si l’on en juge par le débat que nous avons eu précédemment sur les obligations de service public incombant aux filiales de la société AEF. Nous avons bien vu que cela pouvait être un moyen détourné de mettre en cause, à terme, l’ensemble des missions de service public de la holding.
La crainte de ces personnels peut également être fondée sur les déclarations intempestives, provocatrices, mais peut-être prémonitoires, d’un éminent porte-parole de l’UMP, le député Frédéric Lefebvre, pour ne pas le nommer…
Sourires.

Je rappelle enfin la réalité des menaces qui pèsent sur les personnels de RFI, avec la fermeture annoncée de six rédactions.
Aussi, pour protéger les personnels, nous souhaitons, par cet amendement, maintenir et étendre la convention collective à la nouvelle société en charge de l’audiovisuel public extérieur.
Ces précisions me semblent indispensables. En effet, dans le cadre de la holding, nous ne savons pas si c’est la convention existante ou une nouvelle convention qui doit s’appliquer. Nous sommes dans le flou le plus total. En attendant d’obtenir d’éventuelles précisions et garanties, le mieux serait donc d’adopter cet amendement.

L'amendement n° 255, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France adhère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité interentreprises et le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Dans le cadre des restructurations qui visent France Télévisions et Audiovisuel extérieur de la France, en particulier, la question de la convention collective n’est vraiment pas claire. Cela pose un sérieux problème pour les personnels. Les incertitudes entament leur motivation, chacun craignant une transition sociale calamiteuse.
C’est pourquoi cet amendement tend à préciser que la société Audiovisuel extérieur de la France adhère à la convention collective de l’audiovisuel public. Il paraît plus utile de l’expliciter que de rester dans l’ambiguïté.
Madame la ministre, le management des entreprises ou le pilotage des services publics sous-estiment trop souvent les dégâts de l’incertitude et, pire, de l’absence de reconnaissance des talents, des droits et des acquis. Puisque vous vous prévalez, pour la nomination du président, du pouvoir et du rôle que vous confère le titre d’« actionnaire », ce qui est toujours troublant quand on parle de service public et de matière culturelle, au moins faut-il aller jusqu’au bout de cette logique, en assumer les responsabilités et définir, en tant qu’actionnaire, un cadre social clair.
J’ajouterai une considération conjoncturelle : la crise entame nombre de certitudes et le sentiment de ne plus maîtriser l’avenir obscurcit les perspectives et le moral de nombreux salariés. Vous avez déjà promu l’action du Gouvernement en faveur du moral des Français, en mettant en avant l’emprunt contracté pour garantir les trésoreries des banques.
Ayons donc la cohérence d’assumer la responsabilité de l’actionnaire public et ne sabotons pas le moral de ceux dont l’emploi dépend de nos votes. Cet amendement entend, précisément, leur apporter des garanties.

L'amendement n° 324, présenté par Mme Tasca, MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ainsi que chacune de ses filiales, adhèrent à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi qu'à l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes. La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France assure la continuité de gestion des activités sociales à travers le comité inter-entreprises et le comité inter-entreprises des radios de l'audiovisuel public. »
La parole est à Mme Catherine Tasca.

Comme vient de le rappeler si justement notre collègue Mme Blandin, une entreprise, fût-elle nouvelle, ce n’est pas seulement un organigramme ou une structure juridique, c’est l’ensemble des forces vives qui la font vivre, l’ensemble des compétences et des métiers qui la composent.
Aujourd’hui, les salariés de France 24 ne bénéficient ni des mêmes droits sociaux ni des mêmes conditions d’emploi et d’exercice de leur profession que leurs collègues de RFI et de TV5 Monde.
Créer une société holding visant à regrouper les entreprises de l’audiovisuel public extérieur ne suffira pas à constituer un groupe cohérent, notamment sur le plan social, un groupe solidaire, un groupe performant.
Cet amendement tend donc à garantir que l’ensemble des personnels de la société en charge de l’audiovisuel public extérieur et de ses filiales puissent bénéficier des droits sociaux de la convention collective de l’audiovisuel public et de l’avenant audiovisuel à la convention collective de travail des journalistes.
Cette disposition permettrait d’assurer l’égalité de tous les salariés du secteur public de l’audiovisuel extérieur, en matière de salaires, de conditions de travail, de garanties collectives et de formation professionnelle. Elle permettrait, surtout, d’assurer une cohérence sur le fond du projet et une mobilisation de l’ensemble des forces de l’entreprise.

L'amendement n° 321, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout journaliste de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »
La parole est à M. David Assouline.

Heureusement que nous ne devons pas voter à chaque fois… La majorité devrait quand même essayer d’être majoritaire ! Mais ce n’est pas à moi de lui donner des conseils.

Si ce débat ne l’intéresse plus, peut-être serait-il préférable que nous le reprenions après dîner, une fois que tout le monde aura repris des forces ?
Pour en revenir à l’amendement n° 321, nous avons, lors de l’examen de l’article 1er du projet de loi, tenté de rendre applicable aux journalistes de France Télévisions et de Radio France cette disposition de la presque centenaire Charte des devoirs des journalistes, qui, je le rappelle encore, figure dans l’avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Je ne reprendrai pas l’intégralité de l’argumentaire que nous avions développé mais, dès lors que nous avons adopté un amendement consacrant cette indépendance des journalistes, d’abord pour France Télévisions, ensuite pour Radio France, il me semble équitable d’adopter une disposition équivalente pour l’audiovisuel extérieur.
Tel est l’objet de cet amendement.
L’indépendance de l’information et de la programmation au sein de la société en charge de l’audiovisuel extérieur est plus que jamais compromise compte tenu de la conception toute particulière que l’on se fait de cette société, des conditions de travail des journalistes et des dispositions contenues dans le projet de loi dont nous débattons.
En effet, quand le responsable d’une société peut être nommé et, surtout, révoqué d’un simple trait de plume présidentiel, son indépendance d’action est très gravement menacée.
Nous réitérons donc le même amendement à destination de l’audiovisuel extérieur, lequel a autant, voire davantage besoin de cette garantie que son homologue « interne ». En effet, les pressions que peuvent subir les journalistes n’émanent pas exclusivement du pouvoir politique national ; elles peuvent aussi être dues à leurs conditions de travail, notamment dans certains pays étrangers.
Si, sur cet amendement, notre assemblée n’émettait pas le même vote que celui qu’elle a émis précédemment, elle se contredirait.

L'amendement n° 325, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bourzai, MM. Boutant et Domeizel, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La principale source de financement de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est constituée par le produit de la redevance audiovisuelle. »
La parole est à M. David Assouline.

Nous avons déjà largement discuté de ce sujet, notamment à travers les arguments développés tout à l’heure par Mme Tasca.
Afin de garantir l'indépendance du service public de l'audiovisuel, il est nécessaire que la loi précise que le financement de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est principalement assuré par la ressource publique pérenne que constitue le produit de la redevance.
Actuellement, l’audiovisuel public extérieur bénéficie d’un financement par la redevance qui s’élève, pour la nouvelle holding, à 65, 28 millions d’euros au titre de l’année 2009, la holding ayant absorbé la dotation préalablement attribuée à RFI.
C’est peu au regard des quelque 2 milliards d’euros engrangés par France Télévisions, ou même des 232 millions d’euros attribués à Arte France.
Le programme 115 de la mission « Médias » octroie, par ailleurs, 233 millions d’euros à cette société mais il s’agit de crédits budgétaires qui sont, comme nous le savons, beaucoup plus aléatoires.
Lors du débat budgétaire, le rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères avait souhaité octroyer une part plus importante de redevance à cette société, afin de sécuriser son budget.
Nous n’avions pu le suivre, bien que partageant sa préoccupation, car, pour ce faire, il souhaitait priver l’INA de sa part de redevance afin de l’affecter à la société en charge de l’audiovisuel extérieur.
Néanmoins, il conviendrait à l’avenir de pérenniser et de garantir le financement de l’audiovisuel extérieur en lui affectant majoritairement des ressources issues du produit de la redevance.
Si le Gouvernement prenait ses responsabilités et augmentait substantiellement le montant de cette taxe, il serait alors envisageable de financer l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public par le produit de la redevance.
En revanche, nous sommes très inquiets des amendements présentés qui tendent, à l’inverse, à supprimer toute possibilité de financement par la redevance de l’audiovisuel extérieur.
Je demande solennellement au Sénat de réfléchir aux conséquences qu’aurait, pour la France, un sous-financement du principal vecteur de la culture et de la langue françaises au niveau international.
Le démarrage de la holding est déjà suffisamment chaotique pour ne pas compromettre la pérennité de son financement. Or le seul moyen de l’assurer consiste à inscrire, dans la loi, le principe de son financement majoritaire par le produit de la redevance. Tel est précisément l’objet de cet amendement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures cinquante, sous la présidence de M. Roland du Luart.