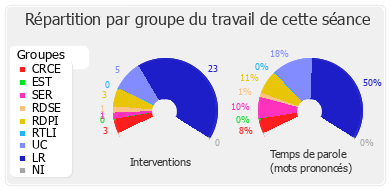Séance en hémicycle du 6 avril 2011 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est reprise.

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT(SUITE)
Jeudi 7 avril 2011
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (texte de la commission, n° 389, 2010 2011) ;
À 15 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite du projet de loi relatif à la bioéthique.
Éventuellement, vendredi 8 avril 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi relatif à la bioéthique.
Mardi 12 avril 2011
À 14 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (texte de la commission, n° 393, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a fixé :

De 17 heures à 17 heures 45 :
2°) Questions cribles thématiques sur les problèmes énergétiques ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 18 heures et le soir :
3°) Suite du projet de loi relatif à l’immigration.
Mercredi 13 avril 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi relatif à l’immigration.
Jeudi 14 avril 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :
1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (n° 405, 2010-2011) ;
2°) Projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 395, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a fixé :

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE :
Le Sénat suspendra ses travaux en séance plénière du dimanche 17 avril au lundi 25 avril 2011.
SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE
DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT
ET D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Mardi 26 avril 2011
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 1185 de M. Jean Boyer à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1217 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;
- n° 1218 de M. Yves Détraigne à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
- n° 1222 de M. Jean-Jacques Mirassou à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1226 de Mme Catherine Morin-Desailly à M. le ministre de la culture et de la communication ;
- n° 1231 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
- n° 1232 de M. Thierry Repentin à Mme la ministre des sports ;
- n° 1233 de Mme Roselle Cros à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ;
- n° 1234 de Mme Nathalie Goulet à M. le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes ;
- n° 1237 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
- n° 1238 de M. Jean-Pierre Sueur à M. le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes ;
- n° 1240 de Mme Nicole Bonnefoy à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1242 de M. Adrien Gouteyron à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 1243 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
- n° 1252 de M. Michel Doublet à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;
- n° 1255 de Mme Jacqueline Panis à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;
- n° 1267 de M. Ronan Kerdraon à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
- n° 1285 de M. Jean-Marie Bockel à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 14 heures 30 :
2°) Débat sur la désindustrialisation des territoires (demande de la mission commune d’information) ;
La conférence des présidents :

3°) Question orale avec débat n° 5 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, sur la réforme de la formation des enseignants (demande du groupe du CRC-SPG) ;
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, avant dix-sept heures, le vendredi 22 avril 2011.

Le soir et, éventuellement, la nuit :
4°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n° 254 rectifié, 2010-2011) (demande de la commission des lois et du groupe UMP) ;
Mercredi 27 avril 2011
Ordre du jour réservé au groupe UMP :
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
1°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 (n° 363, 2010-2011) ;
2°) Proposition de loi relative à la protection de l’identité, présentée par MM. Jean-René Lecerf et Michel Houel (n° 682, 2009-2010) ;
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 18 heures 30 et le soir :
3°) Déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité, transmis par le Gouvernement à la Commission européenne conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, suivie d’un débat et d’un vote sur cette déclaration (demande de la commission des finances et mise en œuvre par le Gouvernement de l’article 50-1 de la Constitution) ;
La conférence des présidents a fixé :

Jeudi 28 avril 2011
De 9 heures à 13 heures :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
1°) Proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le « mitage » de l’impôt sur les sociétés et à favoriser l’investissement, présentée par M. François Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 321, 2010-2011) ;
2°) Proposition de résolution instituant une « journée nationale de la laïcité », présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 269, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a attribué un temps d’intervention de vingt minutes à l’auteur de la proposition de résolution.

À 15 heures :
3°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
De 16 heures 15 à 20 heures 15 :
Ordre du jour réservé au groupe RDSE :
4°) Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de contrôle et d’information des groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, présentée par M. Yvon Collin et les membres du groupe du RDSE (n° 355, 2010 2011) ;
5°) Proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, présentée par MM. Jacques Mézard et Yvon Collin et les membres du groupe du RDSE (n° 354, 2010-2011) ;
SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE
Mardi 3 mai 2011
À 14 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Sénat :
1°) Proposition de loi tendant à assurer une gestion effective du risque de submersion marine, présentée par M. Bruno Retailleau (n° 172, 2010-2011) et proposition de loi tendant à assurer une gestion effective du risque de submersion marine, présentée par M. Alain Anziani et plusieurs de ses collègues (n° 173, 2010-2011) (demande de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire) ;
De 17 heures à 17 heures 45 :
2°) Questions cribles thématiques sur « La France et l’évolution de la situation politique dans le monde arabe » ;
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 18 heures :
3°) Suite de la discussion des propositions de loi sur le risque de submersion marine ;
Le soir et, éventuellement, la nuit :
4°) Éventuellement, suite de l’ordre du jour de l’après-midi ;
5°) Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 387, 2010-2011) (demande de la commission des affaires étrangères) ;
La conférence des présidents a fixé :

6°) Proposition de résolution européenne tendant à obtenir compensation des effets, sur l’agriculture des départements d’outre-mer, des accords commerciaux conclus par l’Union européenne, présentée, en application de l’article 73 quinquies du règlement, par MM. Serge Larcher et Éric Doligé (n° 226, 2010-2011) (demande de la commission de l’économie et de la commission des affaires européennes) ;
La conférence des présidents a fixé :

Mercredi 4 mai 2011
De 14 heures 30 à 16 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
1°) Proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien, présentée par M. Serge Lagauche et plusieurs de ses collègues (n° 607, 2009-2010) ;
De 16 heures 30 à 18 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe CRC-SPG :
2°) Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la garantie d’un droit au logement effectif, présentée par Mme Odette Terrade et les membres du groupe CRC SPG (n° 300, 2010-2011) ;
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 18 heures 30 et le soir :
3°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer (n° 267, 2010-2011) (demande du groupe socialiste et de la commission de l’économie) ;
Jeudi 5 mai 2011
De 9 heures à 11 heures :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
1°) Proposition de résolution relative à la tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Roland Ries et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 358, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a attribué un temps d’intervention de vingt minutes à l’auteur de la proposition de résolution.

De 11 heures à 13 heures :
Ordre du jour réservé au groupe CRC-SPG :
2°) Proposition de résolution relative à la politique énergétique de la France, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Jean-Claude Danglot et les membres du groupe CRC SPG (n° 397, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a attribué un temps d’intervention de vingt minutes à l’auteur de la proposition de résolution.

De 15 heures à 19 heures :
Ordre du jour réservé au groupe UMP :
3°) Proposition de loi visant à moderniser le droit de la chasse, présentée par M. Pierre Martin (n° 355, 2009-2010) ;
Ordre du jour fixé par le Sénat :
À 19 heures et le soir :
4°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au prix du livre numérique (demande de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication) ;
Conformément au droit commun défini à l’article 29

5°) Proposition de loi relative à la régulation du système de distribution de la presse, présentée par M. Jacques Legendre (n° 378, 2010-2011) (demande de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication) ;
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 10 mai 2011
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 1214 de Mme Catherine Procaccia à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1236 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le ministre de la défense et des anciens combattants ;
- n° 1241 de M. Raymond Couderc à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;
- n° 1244 de M. Antoine Lefèvre à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1245 de Mme Maryvonne Blondin à M. le ministre de la culture et de la communication ;
- n° 1246 de M. Claude Jeannerot à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 1248 de Mme Patricia Schillinger à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1249 de Mme Virginie Klès à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1250 de M. Bernard Fournier à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
- n° 1253 de M. Michel Boutant à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;
- n° 1254 de M. Roland Ries à Mme la secrétaire d’État chargée de la santé ;
- n° 1256 de Mme Renée Nicoux à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;
- n° 1257 de M. Louis Pinton à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1258 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx à M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ;
- n° 1260 de Mme Annie David à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
- n° 1261 de Mme Mireille Schurch à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
- n° 1274 de M. Hervé Maurey à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ;
- n° 1292 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011) ;
Mercredi 11 mai 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Suite du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
2°) Projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (procédure accélérée) (n° 264, 2010-2011) et projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (procédure accélérée) (n° 265, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Jeudi 12 mai 2011
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite des projets de loi organique et ordinaire relatifs aux collectivités de Guyane et de Martinique ;
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (n° 407, 2010-2011) ;
3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (n° 408, 2010-2011) ;
La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, avant dix-sept heures, le mercredi 11 mai 2011) ;
4°) Projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (procédure accélérée) (n° 409, 2010-2011) ;
À 15 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :
5°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
6°) Suite de l’ordre du jour du matin.
Mardi 17 mai 2011
À 14 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Sous réserve de son dépôt sur le bureau du Sénat, projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et sur le jugement des mineurs ;
De 17 heures à 17 heures 45 :
2°) Questions cribles thématiques sur l’apprentissage dans le cadre des Douzièmes journées de l’apprentissage ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 18 heures et le soir :
3°) Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.
Mercredi 18 mai 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.
Jeudi 19 mai 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.
Éventuellement, vendredi 20 mai 2011
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Suite du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour, autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...
Ces propositions sont adoptées.
(Texte de la commission)

Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 9, à l’amendement n° 36 rectifié bis.

L’amendement n° 36 rectifié bis, présenté par M. P. Blanc, Mmes Hermange et B. Dupont et MM. Gilles et Darniche, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le diagnostic prénatal n’a pas pour objet de garantir la naissance d’un enfant indemne de toute affection.
La parole est à M. Paul Blanc.

Certains d’entre vous se souviennent sans doute, mes chers collègues, que, lors de la discussion de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, en 2002, Nicolas About et moi-même avions présenté un amendement faisant suite à l’arrêt Perruche de la Cour de cassation du 17 novembre 2000, amendement tendant à éviter toute action en responsabilité à l’encontre du médecin ayant effectué le diagnostic prénatal en cas de naissance d’un enfant handicapé.
Par le présent amendement, qui est dans la droite ligne de celui déposé en 2002, nous souhaitons à nouveau, par précaution, inscrire ce principe dans la loi.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel le diagnostic prénatal n’a pas pour objet de garantir la naissance d’un enfant indemne de toute affection. Cela peut paraître une évidence. D’ailleurs, de façon générale, aucun diagnostic établi par un médecin n’est jamais certain à 100 %.
Toutefois, cette mention figure d’ores et déjà, en des termes quelque peu différents, à l’alinéa 10 de l’article 9 : « l’absence d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement ».
Il n’a donc pas paru utile à la commission d’inscrire à nouveau à l’article 9 une mention qui figure déjà dans le projet de loi. Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
C’est le même avis.

Compte tenu des assurances que M. le rapporteur vient de me donner, qui seront publiées au Journal officiel, je le retire, monsieur le président.

L'amendement n° 36 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié quater est présenté par Mme B. Dupont, MM. Beaumont, Bécot, Cazalet, Darniche et B. Fournier, Mmes G. Gautier et Hermange, MM. Hyest, Lardeux, Lorrain et du Luart, Mme Lamure, M. Pointereau, Mme Rozier et MM. de Rohan, Revet, Vial, J. Blanc et Bailly.
L'amendement n° 126 rectifié bis est présenté par M. Retailleau.
L'amendement n° 135 rectifié est présenté par Mme Payet, M. Détraigne et Mme Férat.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les conditions médicales le nécessitent
La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié quater.

Il s’agit de réintroduire dans le texte de l’alinéa 4 de l’article 9 les termes : « lorsque les conditions médicales le nécessitent », une mention qui avait été ajoutée par Jean Leonetti.
À cet égard, j’aurais voulu dire à Mme Lepage, qui n’est pas présente ce soir, que M. Leonetti n’est pas plus frileux que le Sénat et les sénateurs. Je pense au contraire que c’est un homme sage…

… et qu’il avait fait introduire cette mention parce qu’il pense – je le pense aussi – qu’il convient de laisser au médecin une certaine liberté de prescription dans les tests de dépistage en fonction de la situation de la femme. En effet, l’état d’une femme de vingt, vingt-deux ou vingt-cinq ans n’a rien à voir avec celui d’une femme de quarante ans.
Par ailleurs, le rapport de confiance entre la femme enceinte et le médecin doit rester intact.
Je rappellerai qu’une grossesse est un état normal de la femme. Ainsi que l’indiquait M. le rapporteur voilà quelques instants, c’est une période privilégiée. Une grossesse doit rester sereine et confiante, et un abus d’examen ne doit pas faire encourir le risque à plus ou moins brève échéance d’un eugénisme déjà latent.
Protestations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Mme Bernadette Dupont. Je reprends ce terme, qui a été contesté par l’opposition, parce qu’il me semble certain que viser un type d’individus en particulier – en l’espèce il s’agit des enfants atteints de trisomie 21 – revient à supprimer une partie de la population. Nous avons connu des régimes qui ont employé de telles méthodes…
Vives protestations sur les mêmes travées.

Mme Bernadette Dupont. … et à leur propos on a parlé d’eugénisme ; je ne vois pas pourquoi la France serait exemptée d’une telle stigmatisation.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP et de l’Union centriste.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié bis.

M. Bruno Retailleau. Mes chers collègues, quand Bernadette Dupont s’exprime sur un tel sujet, la décence et le respect exigent de l’écouter.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

En effet, notre collègue porte une conviction qui est enracinée dans une expérience devant laquelle chacun doit se montrer humble et respectueux, quelles que soient ses positions.
Vous savez bien que discuter de tels sujets n’est pas simple ; d’ailleurs, loin de moi l’idée de clouer au pilori tel ou tel pour ses positions ! Chers collègues, nous attendons de vous la même attitude.
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

L’amendement que je propose est identique à celui qui vient d’être présenté.
Pour ma part, je trouvais que la position des députés était équilibrée parce que, tout en permettant le dépistage, elle l’écartait dans ce qu’il a de systématique.
Ce qui me gêne dans le dépistage systématique, c’est d’abord le risque de dérive vers la quête de l’enfant « zéro défaut », risque qui travaille notre société et que, pour cette raison, nous devons souligner.
Par ailleurs, le diagnostic prénatal n’est en aucun cas un acte anodin, parce qu’il n’est pas fiable à 100 % et qu’il peut être dangereux.
Il n’est pas fiable – à ce propos Marie-Thérèse Hermange a cité voilà quelques instants des chiffres qui, au lieu de susciter des réflexes de fermeture ou de repliement, devraient nous interroger – il n’est pas fiable, disais-je, puisque, tous les ans, 700 erreurs de diagnostic condamnent des enfants qui sont indemnes de toute affection.
En outre, il est dangereux, car, pour un enfant diagnostiqué trisomique, on déplore deux fausses couches.
Je trouvais la position des députés équilibrée dans la mesure où elle consistait à revenir au dépistage classique, dans lequel les moyens mis en œuvre sont proportionnés au niveau de risque, tout simplement.
Et, puisque chacun ici est attaché à la liberté, notamment à celle de la femme, je dirai qu’un tel esprit de système fait peser sur les épaules de celle-ci une contrainte bien plus forte que celle qui peut résulter d’un libre choix dans la relation de confiance intime construite au fil des années entre la patiente et le médecin. Voilà une autre raison pour laquelle j’ai déposé le présent amendement.
M. Paul Blanc et Mme Bernadette Dupont applaudissent.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 135 rectifié.

La définition législative du diagnostic prénatal ouvre un large champ d’application. La loi n’a pas établi de liste de maladies pour ne pas les stigmatiser, mais il faut savoir que 80 % des grossesses sont contrôlées par des tests biologiques de dépistage de la trisomie 21 ; cela représente environ 80 000 amniocentèses chaque année et cette technique peut provoquer des fausses couches dans 1 % des cas.
Près de 96 % des fœtus diagnostiqués porteurs de trisomie 21 donnent lieu à une interruption médicale de grossesse et 60 % des interruptions médicales de grossesse se font à la suite de diagnostics de malformation ou de handicap détectés par échographie.
Des questions éthiques se posent alors. La France, avec sa politique de dépistage très développée, détient le record mondial de dépistage anténatal.
Bérengère Poletti a précisé à l’Assemblée Nationale que « le prélèvement du liquide amniotique à travers l’abdomen provoque deux fausses couches d’enfants “normaux” pour une trisomie dépistée ».
Des voix commencent à s’élever pour dénoncer une nouvelle forme d’eugénisme ; nous ne sommes pas les seuls ! Je pense au professeur Sicard, ancien président du Comité consultatif national d’éthique, au professeur Mattei. Tous deux se sont alarmés lors des états généraux de la bioéthique en 2009. Ils sont aujourd’hui rejoints par un nombre grandissant de professionnels de la grossesse qui ressentent un malaise croissant dans l’exercice de leur métier.
Des personnes handicapées se sentent discriminées et marginalisées en constatant que des embryons porteurs du même handicap sont éliminés, souvent systématiquement.
S’ajoutent à tout cela des risques de judiciarisation de la naissance : des praticiens se trouvent mis en difficulté par des erreurs de dépistage qui leur sont reprochées et beaucoup d’entre eux, pour éviter de possibles procès, sont conduits à proposer et à pratiquer le dépistage prénatal de manière systématique, alors que cela leur pose des problèmes de conscience.
Aujourd’hui, les grossesses deviennent anxiogènes du fait de la multiplicité des propositions de dépistage. Les femmes commencent à témoigner de ce fait, ainsi que de leur souffrance après une interruption médicale de grossesse ou IMG.
En avril 2008, un juriste spécialisé en droit de la santé, Dominique Decamps-Mini, a souligné au collège de gynécologie du Centre-Val de Loire que le dépistage prénatal était fortement lié à la notion d’IMG et que cela a valu à la médecine prénatale le qualificatif de médecine « thanatophore », c’est-à-dire d’une médecine qui n’a pas d’autre solution à apporter que celle de la mort du fœtus atteint d’affection grave.
Mes chers collègues, je vous demande de prendre conscience des conséquences de la montée inédite de la sélection et de l’exclusion des êtres humains porteurs d’anomalies.
La France s’est engagée, à mon sens, sur une mauvaise voie. Elle détient le record mondial du dépistage anténatal du handicap, mais aussi celui de l’interruption médicale de grossesse. Nous devons changer de route. Développons plutôt une politique ambitieuse d’accompagnement des parents au moment de l’annonce du handicap et d’accueil des personnes handicapées !
C’est pourquoi je vous demande d’adopter cet amendement qui propose de laisser aux médecins la liberté de prescrire des tests de dépistage uniquement s’ils l’estiment nécessaire.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.

Mes chers collègues, je ne pense pas que l’on puisse déterminer un vote en prenant appui sur des chiffres faux ou des connaissances erronées.
J’ai beaucoup d’admiration, de respect et d’amitié pour Bernadette Dupont, mais je dois dire – et je m’en excuse auprès d’elle – que certains propos ne servent malheureusement pas la cause défendue.
Monsieur Retailleau, les chiffres que vous avez cités sont caducs, et ce depuis près de quatre ans. Il est vrai qu’auparavant environ 700 décès avaient lieu à la suite d’une amniocentèse pour 300 trisomies ayant abouti à des interruptions médicales de grossesse. Les nouveaux tests pratiqués aujourd’hui ont très nettement diminué le nombre d’amniocentèses, et donc le nombre d’accidents que l’on pouvait regretter voilà encore quelques années.
Par ailleurs, il est vrai que 92 % des femmes enceintes sont soumises à ces tests, et que 96 % des tests positifs à la trisomie 21 ont pour conséquence une IMG, et non l’inverse, ainsi que l’a soutenu Mme Payet. Ce taux est de 70 % dans les autres pays européens.
Ces trois amendements identiques visent à rétablir les mots : « lorsque les conditions médicales le nécessitent » à l’alinéa 4 de l’article 9, mots ajoutés par l’Assemblée nationale au texte initial et que la commission des affaires sociales a supprimés.
L’Assemblée nationale avait en effet souhaité que les examens de biologie et d’imagerie destinés à évaluer un éventuel risque soient proposés à la femme enceinte uniquement « lorsque les conditions médicales le nécessitent ». La commission a supprimé cet ajout car elle a jugé qu’il posait plus de problèmes qu’il ne semblait a priori en résoudre.
Il pourrait d’abord conduire au non-respect du droit du patient à être informé.
Il renvoie ensuite au médecin, et non plus à la femme, le choix de procéder ou non aux examens de diagnostic prénatal, ce qui constitue une atteinte au principe d’autonomie du patient. Les femmes sont en effet libres d’accepter ou de refuser ces examens, comme l’a rappelé le CCNE, le Comité consultatif national d’éthique, et comme cela figure à l’alinéa 9 de l’article. Il serait paradoxal qu’en voulant renforcer le libre choix des femmes, on privilégie en fait le pouvoir du médecin.
En outre, cet ajout crée une rupture d’égalité entre les femmes.
Enfin, il fait reposer une responsabilité accrue sur les professionnels, qui pourront se voir reprocher de ne pas avoir proposé un dépistage à une femme « évaluée sans risque » alors que celui-ci était avéré.
J’ajoute que la très grande majorité des collèges de professionnels et les sociétés savantes se sont fermement élevées contre cette disposition.
Le dépistage prénatal est une phase essentielle du suivi de la grossesse. Il est important qu’il soit réalisé dans des conditions aussi respectueuses que possible de la liberté des femmes.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements identiques.
D’abord, les tests qui sont proposés aux femmes ne sont pas imposés. Ils sont conformes aux bonnes pratiques recommandées par les experts, notamment par la Haute Autorité de santé, qui préconise que la femme est en droit de recevoir une information. L’année 2011 étant l’année des patients et de leurs droits, il n’est pas inutile de réaffirmer que les patients ont le droit de savoir.
Le professionnel propose les tests, la femme décide si, oui ou non, elle souhaite s’y soumettre et, à leur issue, si elle souhaite poursuivre ou non sa grossesse.
Je rappelle que ces tests créent une dynamique plutôt vertueuse, puisque, grâce à eux, deux fois moins d’amniocentèses ont été pratiquées. On peut donc mesurer l’intérêt de tels tests, qui permettent d’éviter d’exposer les femmes au risque lié aux amniocentèses.
Madame Payet, vous avez cité à plusieurs reprises le chiffre suivant : 96 % de femmes interrompent leur grossesse à la suite d’un diagnostic prénatal. Permettez-moi de vous donner des chiffres plus récents ; M. le rapporteur a en effet indiqué que cette statistique datait de quatre ans. Dans le rapport 2009 de l’Agence de biomédecine, il est indiqué que 87 % de femmes recourent à l’interruption médicale de grossesse après un tel diagnostic, ce qui signifie que 13 % des femmes gardent leur enfant, décident de poursuivre leur grossesse. Nous sommes donc loin de l’eugénisme.
Certains d’entre vous ont insisté sur le caractère anxiogène des examens. Comme vous l’avez observé, la société évolue. Les femmes ont des enfants de plus en plus tard. Elles savent qu’elles sont plus exposées à un type de risques et il me semble qu’elles ont le droit de savoir.
En outre, ne pensez-vous pas, mesdames, messieurs les sénateurs, que c’est au contraire le fait de ne pas leur proposer de tels tests qui pourrait susciter chez elles de l’inquiétude ? L’examen médical contribue à lever certaines anxiétés, et l’adoption de la disposition que vous proposez risquerait plutôt de décevoir nos concitoyennes.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Le sujet, nous le savions, allait inévitablement faire ressortir un clivage entre opinions très différentes. Cependant, madame Dupont, si j’ai pour vous un profond respect, je considère que le fait que vous ayez pratiquement dit que nous soutenions une politique eugéniste est inacceptable.
Nous n’en remercions que plus M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État d’avoir su trouver des arguments équilibrés pour démontrer que le diagnostic prénatal préservait véritablement la liberté de la femme, notamment en soulignant qu’il s’agissait de tests proposés et non pas imposés, laissant place à un choix fait en toute connaissance de cause.
Le clivage est donc clair et, je tenais à vous le dire publiquement ce soir, madame Dupont, nous estimons pour notre part que vos propos, qui ont été relayés par M. Retailleau et par Mme Payet, sont inacceptables.

Je souscris totalement aux propos de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'État, sur lesquels je ne reviens donc pas, mais je souhaiterais, premièrement, que Mme Dupont, que je connais bien puisque nous avons siégé ensemble à la commission des affaires sociales et vers qui je me tourne maintenant, explicite devant nous quels systèmes totalitaires elle visait. (Mme Bernadette Dupont proteste.)
Avec tout le respect que je vous dois, madame Dupont, vous avez bel et bien dit, et cela n’a rien d’anecdotique, que le diagnostic prénatal relevait de systèmes totalitaires, systèmes que vous n’avez pas nommés ; nous aimerions savoir lesquels, puisque, ce faisant, vous visiez tous ceux qui ne sont pas d’accord avec vous et donc nous tous !

Surtout, il serait bon de savoir – il y a d’ailleurs un moyen aisé d’y parvenir – si l’avis que vous avez formulé est l’avis de l’ensemble de la majorité.
Deuxièmement, madame Dupont, il est tout à fait anormal que vous accusiez d’eugénisme ceux qui ne sont pas d’accord avec vous. Comment pouvez-vous nous accuser d’une telle chose, sans aucune preuve, sans aucun argument ?
Je tiens d’ailleurs à dire qu’en tant que parlementaires nous sommes plusieurs ces temps-ci à recevoir – comme vous aussi peut-être – des courriers du même ton de la part de certaines associations que je ne nommerai pas pour ne pas leur faire de publicité, courriers qui nous arrivent, je ne sais comment, à nos domiciles.

C’est une forme de pression inacceptable, sur laquelle je reviendrai lorsque nous aborderons la question des associations.
Pour l’heure, en réponse aux propos qui ont été tenus par Mme Dupont et eu égard à l’avis exprimé par M. le rapporteur et par Mme la secrétaire d'État, nous demandons solennellement un scrutin public sur ces trois amendements qu’évidemment nous ne voterons pas.

Pour ma part, je souhaite revenir sur les termes dont l’ajout nous est proposé : « lorsque les conditions médicales le nécessitent ».
Je n’entrerai pas dans une polémique dont on conçoit qu’elle puisse devenir très rapidement douloureuse, mais j’avoue comprendre difficilement la position de Mme la secrétaire d'État et l’interprétation qu’elle fait de ces termes.
D’une part, « désystématiser » le dépistage prénatal en considérant chaque femme dans son état me paraissait une proposition intéressante. De même, retrouver la liberté de prescription n’est pas, en soi, entièrement négatif pour le malade et peut être également approprié pour la femme enceinte. Enfin, nous avons le droit aussi d’avoir un changement de regard sur le handicap.
D’autre part, si le projet de loi reste en l’état, il peut être interprété comme faisant obligation au médecin de prescrire systématiquement un DPN. Est-ce qu’en apportant ces réserves et en retournant à l’état antérieur du droit, on va porter préjudice à la femme ? Pour ma part, je crois qu’en apportant cette précision sur les conditions médicales on reste en conformité avec le code de déontologie médicale.
Ensuite, je soutiens aussi la liberté de prescription, dont le principe est exprimé par l’article 8 de ce code : « Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. » Je ne vois pas en quoi cela est négatif !
En quoi aussi le droit à l’information serait-il limité alors que le code de la santé publique précise que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » dans le respect des règles professionnelles ?
Personnellement, je m’élève contre la prescription automatique des tests. L’information adaptée peut être apportée ; je crains que la polémique n’entraîne une confiscation du débat, alors qu’il n’y a pas véritablement de danger de sous-information.
Comme tout un chacun ici, je me place dans le respect des droits de l’homme, mais j’essaie aussi de me prémunir des dérives technico-scientifiques.

Monsieur le président, mes chers collègues, c’est la première fois que j’interviens dans cette assemblée : ayant quitté mon cabinet médical voilà une dizaine de jours seulement, je me sens très concerné par ce débat dans lequel j’ai un avis qui diverge profondément – et c’est pourquoi j’interviens pour expliquer mon vote – de celui de plusieurs des membres de mon groupe.
Je ne suis pas favorable à la réintroduction de la formule : « lorsque les conditions médicales le nécessitent », car elle emporte en fait une notion d’arbitraire dans l’appréciation d’un médecin par rapport à un autre, susceptible de proposer le dépistage plus facilement ou non, et dans l’appréciation des parturientes, qui seront donc tentées d’aller davantage dans une clinique – ou un cabinet médical – que dans une autre. Or, qui dit arbitraire dit inégalité des sorts réservés aux parturientes.
En outre, cette indication remet les médecins gynécologues et généralistes – il en existe encore qui suivent les grossesses – dans une position difficile à tenir quand on sait la facilité avec laquelle nos compatriotes judiciarisent leurs rapports avec le corps médical. Rappelons-nous l’affaire Perruche et l’arrêt auquel elle a donné lieu.
Pour ma part, contrairement à certains d’entre nous, j’estime que les médecins concernés par ce suivi ont une obligation, je dirai même une « sainte obligation » d’informer complètement la parturiente et son conjoint afin que ceux-ci soient parfaitement informés et choisissent sans la contrainte du médecin.
Cette obligation d’informer et de guider est certainement une tâche beaucoup plus difficile que de remplir une ordonnance pour se couvrir du point de vue médico-légal, mais mes confrères médecins n’ont pas l’obligation d’imposer : c’est la base même de l’exercice de la médecine en France à l’heure actuelle.

Ne voulant pas répéter ce qu’ont déjà très bien dit plusieurs de nos collègues siégeant sur les travées de gauche de cet hémicycle, mais aussi M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'État et le dernier orateur intervenu, j’évoquerai un aspect qu’aucun d’entre eux n’a évoqué, en m’adressant à ceux d’entre vous, mes chers collègues, que je ne comprends pas.
Pour vous, l’enfant est sacré : il passe avant tout dès l’instant où il est conçu et quoi qu’il advienne ensuite.
Je respecte cette position.
Ce que je ne comprends pas, et je tiens à vous le dire, c’est que vous fassiez l’impasse sur la souffrance des parents qui voient que l’avenir de leur enfant ne sera pas celui qu’ils avaient escompté.
Ce que je ne comprends pas, c’est que vous ne soyez pas sensibles à la souffrance des enfants.
Ce que je ne comprends pas, c’est que vous fassiez semblant de croire qu’il n’y a que des parents généreux qui, à partir du moment où ils ont donné naissance à un enfant affecté d’un handicap lourd, vont consacrer l’essentiel de leur vie à cet enfant pour qu’il vive le mieux possible et soit le plus épanoui possible.
Tous les parents ne sont pas ainsi, et on ne peut pas les juger : je connais des parents qui souffrent, depuis des années, d’une telle situation et je connais des enfants qui souffrent parce que leurs parents ne font pas aussi bien que d’autres.
On parle toujours de la trisomie 21, en oubliant la trisomie 18, qui est tout aussi grave, et il y a bien d’autres maladies génétiques. Des enfants sont placés à la DASS depuis qu’ils sont venus au monde parce que les parents, non prévenus, n’ont pas pu assumer un enfant différent. J’ai ainsi en tête les dizaines d’enfants que je voyais régulièrement, environ deux fois par an, avec leur famille d’accueil lorsque j’étais au conseil de famille du Val-d’Oise : nés avec un déficit génétique, une trisomie, ils n’avaient jamais été élevés par leurs parents.
Puisque vous êtes dans la compassion, vous devriez penser aussi à ces enfants qui n’ont pas eu de parents pour faire face, comme à ces parents tellement bouleversés qu’ils n’ont pas pu faire face.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Je veux dire à Mme Le Texier que, bien entendu, je connais les situations qu’elle décrit. La souffrance est pour tout le monde : elle n’est réservée ni aux meilleurs ni aux plus faibles. C’est forcément une souffrance d’avoir un enfant handicapé, et l’enfant lui-même, nous en sommes tous conscients, souffre, mais c’est un être humain, avec sa dignité d’être humain.
La réintroduction de ces quelques mots qu’avait ajoutés M. Leonetti dans le projet de loi vise simplement à éviter qu’il y ait un abus d’examens.
Toutes les femmes ont évidemment droit aux tests et, si elles le demandent, elles auront une réponse, mais j’estime que proposer systématiquement à chacune d’y recourir a pour effet de pousser certaines d’entre elles vers un choix extrêmement difficile et je ne suis pas sûre que subir une IMG vaille mieux que d’élever un enfant handicapé.

Je n’en suis pas sûre, madame, parce que je crois que le fait d’avoir supprimé un enfant reste une douleur pour une mère jusqu’à la fin de ses jours, comme pour un couple d’ailleurs.
Quant à mes propos, ils ne visaient pas à choquer qui que ce soit. C’est Mme Lepage qui a employé le mot « eugénisme »…

Non, mais il n’empêche que c’est Mme Lepage qui a entamé la discussion sur ce point et il est certain qu’en pratiquant un diagnostic qui vise à repérer une population on prend le risque de supprimer toute une catégorie de personnes, ce qui revient à entrer dans une forme d’eugénisme. Je suis désolée, mais je répète le mot, car c’est bien de cela qu’il s’agit : vous ne pouvez pas vous permettre de supprimer 300 ou 350 enfants par an sous prétexte qu’ils ont un handicap mental.
Et vous avez raison, madame Le Texier, il y a d’autres formes de maladie génétique que la trisomie 21. Je l’ai dit hier dans la discussion générale, cela va donc être source de différences énormes entre les familles : comment les mères qui mettront au monde des enfants dont le handicap mental n’aura pas été décelé dans le diagnostic prénatal, qui vivront souvent des vies plus difficiles que les mères d’enfants atteints de trisomie 21, pourront-elles comprendre que cette maladie, elle, aurait été diagnostiquée ?
Je ne peux pas imaginer que l’on mette les familles d’enfants handicapés en difficulté les unes par rapport aux autres.
Quant au fait qu’il y eut dans le passé une forme d’eugénisme, je pense que l’on ne peut pas le nier. Monsieur Godefroy, vous savez, comme moi, qu’en Allemagne, juste avant la guerre, les enfants handicapés étaient réunis, puis supprimés dans certains endroits.

Aujourd’hui, la technique et la science permettent de supprimer les fœtus ou les embryons atteints de handicap, mais, finalement, le résultat est le même : cette population est appelée à disparaître.

Or, je le répète, il s’agit d’êtres humains, qui ont une dignité. Toute vie mérite d’être vécue, dans la mesure où elle est acceptée, assumée et bien accompagnée.
Je demanderai sans cesse à tous les gouvernements, quels qu’ils soient, de soutenir les familles d’enfants souffrant d’un handicap de toute nature.

Lors de son intervention devant la commission, le professeur Nisand a estimé que l’on pratiquait une euthanasie active, une médecine eugénique ; on est passé, selon lui, du diagnostic au dépistage, dépistage qui concerne une population entière, les personnes atteintes de trisomie 21, par exemple. Or aucun débat démocratique n’a eu lieu avant qu’il soit décidé d’agir ainsi.
Je n’ai pas apporté ce soir tous les documents en ma possession…

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je dispose cependant d’un article signé par le professeur Sicard, dans lequel ce dernier indique : « Aucun autre pays [que la France] n’a par exemple manifesté une telle volonté de faire disparaître la trisomie 21. La capacité d’une femme à se soustraire à ce dépistage est tellement faible que si elle y parvient et qu’elle a un enfant trisomique, elle sera diabolisée. »
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Il poursuivait : « Que la médecine et la société considèrent qu’une telle pathologie fait partie de ce que l’on ne veut plus voir me paraît constituer une forme d’eugénisme. Notre humanité a décidé qu’il y avait des êtres humains moins humains que d’autres et dont on ne voulait plus. »
Il ajoutait : « Aujourd’hui, le cerveau d’Einstein ne passerait pas la barrière échographique : le développement anormal de son lobe pariétal gauche serait suspect. »
Certains faits sont parfois accueillis différemment, selon qu’ils sont annoncés par les uns ou par les autres…

Mes propos ayant apparemment été mal interprétés, je souhaite apporter une précision. Jai dit non pas que 96 % des femmes qui ont subi des tests biologiques demandaient ensuite une interruption médicale de grossesse, mais que 96 % des fœtus diagnostiqués porteurs de trisomie 21 donnaient lieu à une telle interruption.
Madame Le Texier, l’expression « personne handicapée » n’est pas forcément synonyme de souffrance. Combien de fois entendons-nous des parents dire que, sur leurs quatre enfants, c’est celui qui est handicapé qui leur apporte la plus grande joie de vivre.
Je me souviens particulièrement d’une jeune fille aveugle venue justement manifester sa joie de vivre lors d’une émission télévisée diffusée voilà quelques années dans mon département et au cours de laquelle des jeunes témoignaient de leur vie quotidienne. Elle racontait combien elle était entourée, soutenue par ses amis, elle décrivait la joie et le dévouement de ses parents.
À la journaliste qui lui demandait, pour conclure, si elle avait envie d’ajouter quelque chose, de faire passer un message, elle a répondu : « J’ai envie de chanter ». Et elle a choisi L’oiseau et l’enfant :
« Comme un enfant aux yeux de lumière […]
« Vois comme le monde, le monde est beau ».
Entendre cette jeune fille aux yeux éteints parler de la beauté du monde et dire toute sa joie de vivre était vraiment très émouvant !

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

À entendre nos collègues, on croirait que la seule pathologie dont peut souffrir un enfant à la naissance est la trisomie 21. Mais il en existe bien d’autres et de bien pires…
Je connais particulièrement bien la trisomie 21. Les enfants qui en sont atteints sont souvent très affectueux ; on entretient une relation particulièrement chaleureuse avec eux. Il n’empêche que, lorsque les parents vieillissent, ils se trouvent confrontés au problème de laisser seul leur enfant.
En fait, il faut cesser d’affirmer que, lors d’une intervention volontaire de grossesse, on tue un enfant. En réalité, on met fin au début du développement d’un embryon ou éventuellement d’un fœtus, qui ne sont que des personnes en devenir et ne deviendront des personnes qu’à la naissance et grâce à de longs soins familiaux.

Ces amalgames relèvent de la polémique et non d’une véritable réflexion.
Enfin, nul n’est en droit d’imposer à l’ensemble de la société des choix personnels émanant de convictions religieuses ou philosophiques et qui ne sont pas nécessairement ceux d’une société laïque.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Je veux apporter une précision sur les propos du professeur Nisand, que la commission a auditionné. Il a regretté l’absence de soutien démocratique au diagnostic prénatal et déploré la mort d’environ 700 enfants sains par an à la fin des années 2000 en raison de nombreux accidents. Mais il a exprimé son soutien au diagnostic prénatal et son souhait que le nécessaire soit fait pour que l’ensemble des examens conduise à réduire le plus possible le nombre d’accidents.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié quater, 126 rectifié bis et 135 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, ainsi que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 181 :
Nombre de votants334Nombre de suffrages exprimés327Majorité absolue des suffrages exprimés164Pour l’adoption36Contre 291Le Sénat n'a pas adopté.
Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste.

L'amendement n° 103, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
le cas échéant
insérer les mots :
ou à sa demande
La parole est à M. Guy Fischer.

Dans sa rédaction actuelle, la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 9, que notre amendement tend à compléter, dispose : « En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l'autre membre du couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »
Ces centres jouent un rôle capital dans l’évolution de la grossesse puisqu’ils vérifient que le recours à l’interruption médicale de grossesse est justifié au regard de l’importance des conséquences pour l’enfant et la famille des malformations détectées et, si tel est le cas, délivrent une attestation.
En l’état, la rédaction de la première phrase tend à confier au prescripteur du diagnostic préimplantatoire, médecin ou sage-femme, la seule responsabilité d’orienter ou non la femme enceinte vers ces centres. Or des femmes peuvent d’elles-mêmes souhaiter, parfois contre l’avis du prescripteur, bénéficier d’un entretien dans de tels centres. Nous considérons qu’il est important de respecter leur volonté.

Cet amendement tend à préciser que, dans le cas de risques avérés, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple – puisque, sur l’initiative de Marie-Thérèse Hermange, nous avons ajouté cette mention en commission –, sont pris en charge par un médecin et orientés non seulement par celui-ci mais également à sa demande vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Cette précision ne paraît pas vraiment utile dans la mesure où la rédaction actuelle de l’alinéa 6 prévoit que cette orientation vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal a lieu « le cas échéant », ce qui, à notre avis, inclut le cas où une femme le demande. La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
Le Gouvernement ne voit pas d’inconvénient à ce qu’une femme enceinte dont la grossesse présente un risque avéré puisse demander elle-même à être reçue par un ou plusieurs membres d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mme Le Texier, M. Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 104 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l’amendement n° 19.

L’alinéa 6 met en place de nombreuses garanties d’informations impartiales au bénéfice de la femme enceinte et, si elle le souhaite, de l’autre membre du couple dans le cas d’une affection particulièrement grave détectée chez l’embryon ou le fœtus. Ainsi, sont prévues une prise en charge par un médecin et une orientation vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, ce qui permet à la femme enceinte ou au couple de recevoir, « sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né ».
Les informations médicales nécessaires à une décision libre et éclairée sont donc garanties par cette disposition.
La dernière phrase de l’alinéa ajoute qu’est, en outre, proposée « une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille ». Si l’intention est louable, il n’en reste pas moins que le fait de proposer une telle liste n’a pas sa place au stade de la consultation médicale. J’observe cependant que, dans le texte initial, il n’était question que d’« une association » : avec la « liste d’associations », il y a au moins un léger progrès !
La femme enceinte venant d’apprendre l’existence d’une affection d’une particulière gravité doit faire face à une situation extrêmement délicate. Nous estimons que, à ce stade, seules une orientation et une information médicale doivent être offertes.
Les associations peuvent avoir leur place dans la réflexion qui suivra, mais ce n’est ni le rôle du médecin ni celui du centre pluridisciplinaire de fournir cette liste. Dans un second temps, ces personnes pourront sans difficulté, en utilisant les moyens d’informations disponibles aujourd’hui – qu’elles aillent sur Internet ou qu’elles s’adressent au Planning familial – prendre contact avec des associations spécialisées.
Un des problèmes qui se posent avec ces associations, c’est qu’elles produisent une sorte d’« effet loupe », car les parents qui s’y trouvent regroupés sont surtout ceux qui veulent faire part du caractère positif de ce qu’ils ont vécu et, éventuellement, de ce qu’ils vivent encore. C’est très bien, mais, de fait, on ne rencontre guère, au sein de ces associations, les parents pour qui la même expérience est avant source de souffrance et dont le discours pourrait contrebalancer celui qui y est trop souvent dominant.
Dès lors, nous pensons que proposer une telle liste d’associations pourrait être perçu comme une pression exercée sur une femme fragilisée par cette situation exceptionnellement délicate et à qui les autres dispositions de l’alinéa permettent déjà, de toute façon, de disposer d’informations suffisantes, dont l’objectivité médicale pourrait en outre être bouleversée par le contact avec les associations figurant sur cette liste.

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 104.

La dernière phrase de l’alinéa 6, qui résulte de l’adoption d’un amendement par l’Assemblée nationale, nous inquiète, nous aussi.
En effet, chacun mesure la situation particulière dans laquelle peut se trouver un couple apprenant que l’enfant à venir sera potentiellement atteint d’une maladie ou d’une anomalie génétique. C’est une période bouleversante, au cours de laquelle des questions assaillent nécessairement les parents potentiels puisqu’ils auront à décider s’ils souhaitent poursuivre la grossesse ou bien y mettre un terme, dès lors que les conditions requises pour une interruption médicale de grossesse sont réunies.
Le fait que, dans ce contexte particulier, soit remise à la femme une liste d’associations de personnes vivant avec le handicap suspecté ou les accompagnant, constitue une forme de pression sur les choix à venir de la femme enceinte.
Mes chers collègues, le cheminement qui a conduit à l’adoption de cet amendement n’est d’ailleurs pas inintéressant. Il fait suite à une longue série d’amendements destinés à réduire les possibilités, pour les femmes, d’accéder au diagnostic prénatal, voire, pour certains d’entre eux, de durcir les conditions d’accès à l’interruption médicale de grossesse. C’est au regard de cette tentation que doit s’analyser cette disposition.
L’auteur de l’amendement l’a présenté comme étant un élément de plus dans l’information en direction des parents. Or celle-ci n’est pas neutre : elle est au contraire partisane puisqu’elle tend à insister sur une seule des suites possibles du diagnostic : la poursuite à tout prix de la grossesse. Ainsi, cette information marque sa préférence pour l’une des options.
En ce sens, cette phrase introduit une forme de pression sur les femmes et il nous paraît opportun de la supprimer.

La communication d’une liste d’associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints d’affections suspectées est un élément d’information supplémentaire utile pour la femme enceinte. Elle s’inscrit dans l’objet global de cet article, qui est de mieux informer et accompagner les femmes enceintes. Le fait que les associations en question doivent être agréées permet évidemment d’écarter le risque sectaire.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Une fois qu’un diagnostic est établi, il est tout à fait légitime qu’un médecin propose une liste d’associations afin que la femme enceinte concernée dispose d’informations aussi complètes que possible. C’est une simple application du droit du patient à être informé, un droit dont on ne peut pas faire l’économie.
Je rejoins le rapporteur pour dire que le danger de voir des associations sectaires figurer dans cette liste est écarté puisque celle-ci ne peut contenir que des associations agréées par un comité national composé de personnalités qualifiées et de représentants du ministre de la santé, et placé sous la présidence d’un conseiller d’État.
J’émets donc un avis défavorable.

Dans le texte initial, il était dit que le médecin donnait le nom d’une association. C’était tout à fait anormal : il est clair que, dans ces conditions, la liberté de choix n’était pas du tout garantie. Au moins, il est maintenant question d’une « liste d’associations ».
Il reste que je m’interroge sur le rôle que l’on fait ainsi jouer au médecin. Il est indiscutablement dans son rôle quand il adresse les personnes concernées à des spécialistes, des « sommités », bref des gens qui connaissent bien le sujet. Mais revient-il au médecin de fournir une liste d’associations ? C’est une question que je me pose.
Vous insistez, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'État, sur le fait que ces associations sont agréées et qu’elles offrent donc toutes garanties. Mais vous avez certainement reçu, comme nous-mêmes, des courriers qui montrent bien que, lorsque la femme enceinte se retrouve face à une telle association, sa liberté de jugement sur la situation à laquelle elle est confrontée est tout de même passablement amoindrie.
C’est pourquoi je ne pense pas que ce soit le rôle du médecin que de communiquer une liste d’associations. Si la femme ou le couple souhaitent prendre contact avec une association, ils n’auront guère de mal à en trouver une, ou plusieurs.
On peut également se poser la question de savoir si la liste remise par le médecin sera vraiment exhaustive ; en tout cas, il faudrait y veiller.
En outre, est-on sûr que les associations agréées indiquent bien toutes les solutions qui s’offrent à cette femme ou à ce couple ?
Exclamations sur certaines travées de l ’ UMP.

Je souhaite simplement dissiper une confusion ou réparer une erreur qui a été commise par notre collègue Jean-Pierre Godefroy : dans cet article, il n’a jamais été question que d’une « liste d’associations ». C’est en matière de tests génétiques qu’avait été prévue l’intervention d’une seule association.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 102, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute femme enceinte ayant eu des antécédents médicaux ou familiaux en la matière peut demander à bénéficier d’une consultation médicale préalable à la réalisation de ces examens.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2131-1 du code de la santé publique prévoit que le diagnostic prénatal est précédé d’une consultation médicale adaptée à l’affection recherchée. Cette consultation a été supprimée dans le projet de loi et la commission des affaires sociales ne l’a pas rétablie.
Si l’on peut comprendre la suppression de la consultation prénatale s’agissant des femmes qui ne font pas état d’antécédents – il est évident qu’il n’y a pas à délivrer une information sur une affection à laquelle la personne est a priori totalement étrangère –, elle est beaucoup plus contestable dans le cas contraire. En effet, les femmes qui souffrent déjà d’une maladie ou d’une anomalie, ou qui suspectent qu’elles en sont atteintes, ont bien besoin d’informations en ce qui concerne tant le déroulement des examens que les risques inhérents aux prélèvements et les éventuelles conséquences de ces pratiques médicales.
De telles consultations peuvent participer de la recherche d’information des femmes, tout en respectant le caractère médical que revêt à l’heure actuelle le diagnostic prénatal. Notre amendement tend donc à prévoir ces consultations sont maintenues lorsqu’elles sont demandées par les femmes enceintes.

Cet amendement n’est pas très clair. De quels antécédents médicaux ou familiaux parle-on ? En fait, la procédure de DPN est déjà une suite d’examens, mais surtout de consultations médicalisées. Cet ajout ne me paraît donc pas opérant.
Cet amendement lui paraissant satisfait, la commission a émis un avis défavorable.
Cet amendement est effectivement satisfait et reçoit donc également un avis défavorable de la part du Gouvernement.
Une femme qui a des antécédents relève d’emblée de l’alinéa 6 du texte proposé pour l’article L. 2131-1 du code de la santé publique, qui décrit la prise en charge pour un risque avéré.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
I. – L’article L. 2131-4 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon i n vitro. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire » sont remplacés par les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ».
II. – Au deuxième alinéa du même article L. 2131-4, dans sa rédaction résultant du I du présent article, au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 et au 3° de l’article L. 2131-5 du même code, les mots : « biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro » sont remplacés par le mot : « préimplantatoire ».

Cet article introduit la notion de diagnostic préimplantatoire, ou DPI, et le définit comme « le diagnostic biologique réalisé à partir des cellules prélevées sur l’embryon in vitro ». La question du statut de l’embryon in vitro dans le DPI s’était déjà posée en 2002, à l’occasion de la révision de la loi de bioéthique.
Les objections communément opposées à l’introduction de cette notion reposent, pour l’essentiel, sur le refus de toute recherche génétique sur l’embryon et sur la réticence devant l’idée que l’on puisse choisir des embryons à réimplanter.
Les premières critiques s’élèvent contre le principe même du diagnostic préimplantatoire. Ceux qui les émettent considèrent que l’embryon ne peut être soumis à des recherches, fût-ce dans le souci d’éradiquer un risque de maladie. En clair, la volonté humaine ne pourrait décider des embryons qui vivront et de ceux qui seront éliminés.
Ces arguties supposent une conception déterminée de l’embryon et un refus de l’intervention humaine qui, en réalité, empêcheraient la plupart des actes dont la pratique est autorisée depuis longtemps en matière de procréation assistée. Surtout, elles récusent le diagnostic génétique dans son principe même. Ces arguments sont en fait sous-tendus par une remise en question de l’IVG.
De même, l’objection qui identifie un risque d’eugénisme dans le DPI relève du fantasme. En effet, ce diagnostic a pour seule visée d’éradiquer un facteur de maladie : il n’a aucunement pour objectif de chercher les bases génétiques de caractéristiques valorisées socialement ; il ne sert pas à choisir le sexe, sauf en cas de maladies liées à ce dernier. La définition précise des indications du DPI, limitées à la recherche des maladies graves, constitue à cet égard le meilleur garde-fou.
La redéfinition du DPI qui est proposée ici est timide, mais elle nous apparaît comme un moindre mal.
L'article 11 est adopté.
Le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues par le sixième alinéa de l’article L. 2131-4, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies : ».

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 128 rectifié bis et 149 sont identiques.
L'amendement n° 128 rectifié bis est présenté par M. Retailleau, Mme Hermange et MM. Vial, Darniche, B. Fournier et Revet.
L'amendement n° 149 est présenté par Mme Payet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° 128 rectifié bis.

Il est question ici de la pratique du double DPI, que l’on appelle aussi technique du « bébé-médicament ».
Quand ils la mettent en œuvre, les médecins réalisent une double sélection : ils écartent les embryons porteurs de l’anomalie génétique qu’ils souhaitent combattre, puis ils éliminent ceux qui ne sont pas compatibles, sur le plan immunologique, avec le frère, la sœur… en tout cas l’être humain que le futur enfant est censé permettre de soigner.
Cette pratique pose un problème de fond : on programme un bébé avec une finalité particulière, à savoir disposer d’une ressource biologique.
En outre, cette technique, contestable sur le plan éthique, n’a plus d’utilité dans la mesure où, désormais, les banques de sang de cordon peuvent être exploitées, en France comme à l’échelle internationale, et où chaque demandeur de greffe est aujourd'hui en mesure de trouver un donneur compatible.
Par conséquent, compte tenu des problèmes éthiques très lourds que pose cette pratique, et qui exigent une réflexion, ainsi que de l’existence de solutions de rechange qui, elles, ne soulèvent pas de problèmes éthiques, je crois plus prudent de mettre fin au double DPI. Du reste, pour l’instant, un seul enfant est né en France grâce à cette technique, dont il n’a pas encore été démontré que, en termes de santé publique, elle pouvait constituer un apport décisif.
Voilà pourquoi j’ai déposé, avec plusieurs collègues, cet amendement de suppression.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 149.

Le diagnostic préimplantatoire a été autorisé pour éviter la transmission de maladies génétiques héréditaires.
Il s'agit d’une technique lourde, qui nécessite la création de 28 embryons pour une naissance, selon les chiffres de l’Agence de la biomédecine. Quelque 76 enfants sont nés grâce à cette pratique en 2009, mais le recours au DPI tend à se développer.
En 2007, on a découvert que cette technique avait été utilisée à Strasbourg dans des cas de maladies prédictives, alors que l’on n’était pas certain que ces dernières se développeraient et que l’on ignorait a fortiori à quel âge elles apparaîtraient. Les médias et l’opinion publique s’en sont émus, mais aucune mesure n’a réellement été prise pour mettre fin à cette pratique.
La loi de 2004 a introduit une transgression supplémentaire en autorisant le double DPI, ou « bébé-médicament », alors même que le développement de banques de sang de cordon, comme vient de l’expliquer Bruno Retailleau, conduit à reconsidérer l’intérêt de cette technique, qui est particulièrement transgressive dans la mesure où elle instrumentalise l’enfant à naître et nécessite un tri embryonnaire.
Cette disposition, qui conduit à considérer l’enfant comme un gisement de ressources biologiques a suscité de nombreuses réserves. C’est en effet l’une des règles d’or de l’éthique que l’on bafoue en permettant qu’un être humain – en l’occurrence, un enfant – soit considéré comme un moyen au service de fins qui lui sont extérieures. En effet, un enfant est ici programmé pour être utile à d’autres !
Cet amendement tend donc à abroger l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique et à revenir sur une pratique qui a sans doute été autorisée trop hâtivement.

L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par Mme Hermange, M. P. Blanc, Mme Rozier, M. Revet, Mmes Giudicelli et Henneron, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Lecerf, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Retailleau, Pozzo di Borgo, Bécot, Couderc, del Picchia, Bailly et Mayet et Mmes Bruguière et B. Dupont, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
l'article L. 2131-4
insérer les mots :
à titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la bioéthique
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Il s'agit d’un amendement de repli.
Je ne répéterai pas les propos que viennent de tenir mes collègues. Je rappellerai simplement que, en 1994, le DPI a été autorisé de justesse, alors que, aujourd'hui, on est prêt à légaliser le DPI-HLA, c'est-à-dire le double diagnostic préimplantatoire !
Celui-ci a été introduit dans la loi en 2004 à titre expérimental. À l’époque, le législateur voulait s’assurer que les problèmes éthiques soulevés auparavant pouvaient trouver une réponse. Or on n’a eu connaissance que d’une seule expérimentation, et cela deux jours seulement avant l’examen du présent texte en séance publique à l’Assemblée nationale.
Force est de constater que les problèmes éthiques demeurent, comme en témoignent d'ailleurs les nombreuses interrogations qui ont suivi l’annonce de la naissance du premier « bébé-médicament ».
Au-delà de la prouesse technique dont il s'agit ici, ayons donc la sagesse, si l’on ne supprime pas purement et simplement ce double DPI, d’en revenir au moins à la phase expérimentale. Tel est l'objet de cet amendement.
Cela étant, dès lors que nous disposons des banques de sang de cordon, nous n’avons même plus besoin de cette expérimentation. Monsieur le rapporteur, nous avons à cet égard des conceptions différentes. Vous dites : « Continuons, continuons, continuons ! Puis stockons, stockons, stockons ! »
Sourires

Moi, je pense différemment. Ayons une véritable ambition en matière de sang de cordon et ces problèmes éthiques ne se poseront plus. Nous cesserons alors de faire naître des enfants afin de soigner leur frère ou leur sœur, en raisonnant froidement en termes de rapport bénéfices-risques, comme lorsqu’on met un médicament sur le marché !

L'amendement n° 20, présenté par Mme Le Texier, MM. Godefroy, Cazeau et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants,
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Notre amendement vise un double objectif.
Tout d’abord, il tend à supprimer, dans l’article, la formule : « Sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes », car la décision de concevoir un enfant n’est jamais la solution de dernier recours, un va-tout, un ultime lancer un dé !
Sur le fond, il s’agit de mettre un terme à une dérive sémantique, qui montre bien que la façon dont ces enfants sont perçus par notre société pose problème. Il faut, une fois pour toutes, que nous nous défaisions des expressions « bébé-médicament », « enfant de la deuxième chance », « enfant de la dernière chance ».
On est toujours dans la même problématique : les mêmes qui parlent du respect de l’enfant comme un principe sacro-saint stigmatisent cet enfant-là !

Lorsqu’une famille est bouleversée par la venue d’un enfant malade, est-ce choquant ?
Lorsque cette même famille souhaite un « enfant de plus » – pas un « autre enfant » ! –, qui s’inscrive dans la continuité de la vie de la famille, est-ce choquant ?

Lorsqu’elle souhaite que cet « enfant de plus » soit bien portant, est-ce choquant ?

Lorsque cet enfant bien portant est venu au monde et que la famille se réjouit qu’il puisse – peut-être – aider en outre à la guérison de son aîné, est-ce choquant ?

Non, il n'y a là rien de choquant. Au contraire, nous éprouvons, quant à nous, une intime compréhension.
Alors, pourquoi user de ces termes excessifs et stigmatisants, de ces expressions qui laissent entendre que ces enfants sont d’abord des produits scientifiques et que leur raison d’exister se résume au service qu’ils rendront, peut-être, à leur fratrie ?
Nous ne pouvons continuer de laisser considérer ces enfants comme des « gisements de ressources biologiques », pour reprendre une formule que j’ai entendue ces derniers jours.
La suppression que notre amendement prévoit à l’alinéa 2 de l’article 11 bis est une première étape en ce sens.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

S’agissant des amendements identiques n° 128 rectifié bis et 149, qui visent à supprimer le dispositif du DPI-HLA, ou double diagnostic préimplantatoire, je rappelle d’abord que cette pratique est une procédure tout à fait exceptionnelle, dont les modalités sont très strictement encadrées par la loi ainsi que par les règles d’application plus précises fixées par l’Agence de la biomédecine.
Le DPI-HLA a été institué par la loi de 2004, à titre expérimental, sans qu’aucune durée ne soit d’ailleurs fixée pour cette expérimentation. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale a supprimé son caractère expérimental.
Dans les faits, cette procédure a été très peu utilisée. D’après le professeur Frydman et l’AP-HP, en 2006, douze demandes de DPI-HLA ont été acceptées par l’Agence de la biomédecine. Elles ont abouti à dix tentatives : dans sept cas, des embryons sains ont été implantés et il en est résulté trois grossesses. Pour l’une d’elles, l’embryon transféré était compatible, mais la grossesse s’est terminée par une fausse-couche. Dans un deuxième cas, l’enfant est né en bonne santé, mais n’a pas pu aider son frère : les médecins n’avaient, en effet, obtenu que des embryons incompatibles et les parents avaient tout de même demandé l’implantation ; leur aîné est décédé aux alentours de la naissance du bébé.
Le troisième cas est celui de l’enfant né en janvier 2011, première naissance HLA compatible dans notre pays.
La commission a donc décidé de maintenir ce dispositif dans le code de la santé publique, même si elle a aussi affirmé son souhait que les progrès à attendre en matière de greffes de sang de cordon le rendent rapidement obsolète.
C’est la raison pour laquelle, sur proposition de Mme Hermange et de Mme Payet, pour lesquelles le double DPI doit rester l’ultime recours, la commission a inscrit, à l’article L. 2131-4-1, que le DPI-HLA ne peut être pratiqué que sous réserve qu’aient été épuisées toutes les possibilités offertes, notamment par les techniques qui utilisent les cellules souches du cordon ombilical. Cette position est contraire à la suppression pure et simple du dispositif et la commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 38 rectifié bis prévoit que le DPI-HLA sera expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Or il l’est déjà depuis sept ans. Quoi qu’il arrive, les prochaines évaluations de la loi relative à la bioéthique comporteront obligatoirement un chapitre consacré au DPI-HLA. Il me semble donc difficile d’imaginer qu’il soit prolongé inutilement, surtout si les progrès thérapeutiques que l’on attend pour bientôt aboutissent. La commission donne donc un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 20, il revient sur l’ajout de la commission, qui rend nécessaire d’avoir épuisé toutes les possibilités de traitement avant de recourir au DPI-HLA. À l’évidence, la commission est également défavorable à cet amendement.
S’agissant des amendements identiques n° 128 rectifié bis et 149, j’émets un avis défavorable.
En effet, je ne souhaite pas voir supprimer le dispositif de double DPI qui, en l’état actuel des connaissances, répond à un vrai besoin. Il permet d’offrir un espoir à des familles qui sont éprouvées.
Comme vous le savez, la première naissance d’un bébé du double espoir vient d’avoir lieu en France et les dispositions actuelles de la loi offrent de sérieuses garanties en termes d’éthique.
Je rappellerai que, depuis que le dispositif existe, soit depuis 2004, à l’échelon national, vingt familles au total ont demandé à bénéficier de cette technique. Dix d’entre elles ont été prises en charge et, comme je viens de le dire, un enfant est né à l’issue de la procédure.
Notons-le, il s’agit d’un dispositif très encadré et qui n’est mis en œuvre qu’après qu’ont été épuisées toutes les autres solutions. Il reste justifié pour certaines pathologies, comme la thalassémie ou la drépanocytose, parce qu’on ne dispose pas de suffisamment de greffons placentaires. Cette technique est donc « la » solution quand il n’en existe pas d’autre pour répondre aux demandes des familles.
Par ailleurs, comme M. le rapporteur, je pense que, sept ans après l’introduction du dispositif, on a dépassé le stade expérimental : la technique est maintenant maîtrisée.
De surcroît, je crains que l’adoption de l’amendement n° 38 rectifié bis ne se heurte à la censure du Conseil constitutionnel. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 20. Autant la technique du DPI-HLA a sa justification lorsque les autres solutions sont épuisées, autant cette technique appliquée en première intention ne me paraît pas pertinente.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 128 rectifié bis et 149.

Bien entendu, je voterai ces amendements, et cela d’abord pour une raison scientifique, je le dis en sachant que des professeurs de médecine et des médecins sont présents dans l’hémicycle.
Madame la secrétaire d’État, vous nous avez expliqué que la technique du DPI-HLA était nécessaire pour soigner la drépanocytose et la thalassémie.
Or, un mois avant l’expérience du professeur Frydman, le professeur Gluckman a fait une expérience identique sur la même pathologie à partir de cellules souches issues de sang de cordon. Cela signifie bien, mes chers collègues, que cette dernière technique peut remplacer celle du DPI-HLA sur la même pathologie, mais sans poser les mêmes problèmes éthiques.

Si la technique du DPI-HLA est très peu utilisée, c’est non seulement parce qu’elle est strictement encadrée et que sa mise en œuvre est techniquement très complexe, mais aussi parce qu’elle conduit à une série de transgressions qui suscitent un malaise au sein de la société française.
En effet, comment peut-on faire supporter à une tierce personne, en l’occurrence à un enfant, la responsabilité de ne pas guérir son frère ou sa sœur ? Il y a là, on le voit bien, des conséquences que l’on ne peut ni maîtriser ni même imaginer.
Face à cela, n’étant pas médecin et encore moins spécialiste de ces questions, je pense que le rôle du législateur est de dire qu’à partir du moment où l’on ne maîtrise pas, il vaut mieux empêcher.
Cela me paraît d’autant plus justifié en l’espèce qu’il semble exister d’autres voies thérapeutiques plus intéressantes, davantage porteuses d’espoir pour l’avenir.
Il me semble que le législateur s’est aventuré, en 2004, à autoriser cette pratique, dont les avantages demeurent assez flous, et qu’il serait raisonnable d’y mettre un terme ce soir.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 128 rectifié bis et 149.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote sur l'article 11 bis.

Ce que je viens d’entendre me conduit à expliquer mon vote.
Moi, je ne peux qu’approuver cet article. En effet, le rôle des lois de bioéthique est d’offrir aux citoyens une possibilité de bénéficier pleinement des progrès de la science. Depuis 2004, la loi autorisait à titre expérimental une pratique qui est sous les feux de l’actualité depuis peu.
La naissance à Clamart, le 26 janvier 2011, d’un premier bébé issu du dispositif DPI au typage HLA représente un double espoir. C’est, d’abord, l’espoir d’être indemne d’une maladie génétique familiale, ce qui est déjà beaucoup ; c’est, ensuite, l’espoir de guérir, par une greffe de cellules souches contenues dans le sang du cordon, l’un de ses frères ou sœurs malades, ce qui est extraordinaire, même au regard de toutes les avancées médicales qui ont été réalisées depuis trente ans.
Cette naissance a fait couler beaucoup d’encre. Comment, en effet, ne pas se poser la question fondamentale – et l’on n’a pas manqué de le faire ici – d’un risque d’instrumentalisation de l’enfant ainsi conçu ?
Mais répondons au préalable à la critique selon laquelle il vaut mieux faire appel à un don de cellules souches existant dans les banques de sang pour réaliser la greffe. L’affirmation est massive, aussi massive que l’ignorance de ceux qui la profèrent. Si de telles cellules souches étaient disponibles en banque, c’est bien entendu pour cette solution qu’opteraient les médecins ! Or la réalité est tout autre.
Mettons-nous, comme l’a fait Raymonde Le Texier, à la place d’une famille dont un ou plusieurs enfants sont atteints d’une maladie très grave et qui pourrait être soignée. Accueillir un enfant que l’on désire, certes non atteint par la maladie génétique, constitue en soi un bonheur, mais continuer parallèlement à voir souffrir son aîné, alors qu’il pourrait en être autrement, constitue un drame qu’aucune naissance ne peut effacer. C’est même proprement inacceptable.
Vous nous dites : « Dans un tel cas, il faut s’abstenir d’avoir d’autres enfants ! » C’est la seule proposition que vous faites à ces familles, souvent malmenées, je l’ai constaté tout à l'heure, par certains parlementaires qui se disent très charitables, mais qui redécouvrent la rédemption par le malheur.
Vives protestations sur certaines travées de l ’ UMP.

Qui sommes-nous pour juger les parents aux yeux de qui cet enfant est avant tout, comme tout bébé devrait l’être, un cadeau ?
Dois-je rappeler, et cela l’honore, le coup de téléphone du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, M. Xavier Bertrand, qui a félicité personnellement le professeur René Frydman ? Certains ici devront donc peut-être revoir le problème avec M. Frydman et M. Bertrand…

J’espère que le Gouvernement a félicité de la même façon Mme Éliane Gluckman, il y a un mois, de l’expérience qu’elle a menée… En vérité, il aurait dû le faire voilà déjà longtemps, car, depuis 1987, cette femme ne cesse de clamer que notre pays a besoin d’une politique des cellules souches. Alors que 800 000 naissances sont enregistrées chaque année en France, le cordon ombilical reste considéré comme un déchet opératoire ! Pourtant, le sang qu’il contient peut soigner, et sans que cela pose de problème éthique.
Mme la présidente de l’Agence de la biomédecine a indiqué que les problèmes étaient d’ordre non pas éthique, mais financier. Comme par hasard, la question du financement surgit quand il s’agit du cordon ombilical, alors qu’elle n’est jamais invoquée à propos des ovocytes, des embryons ou des dons de gamètes !

Mme la secrétaire d'État a tout à l'heure invoqué une possible censure du Conseil constitutionnel à l’encontre de l’amendement de repli présenté par Marie-Thérèse Hermange. Je rappellerai, pour ma part, ce qu’a dit le Conseil d’État à propos du double DPI : « Les questions posées par le double DPI et le fait qu’il ait été peu utilisé pourraient justifier que le législateur envisage de mettre un terme à cette pratique. »

En 2009 !
Qu’on veuille donc bien nous laisser exprimer nos opinions ! La gauche soutient les siennes : grand bien lui fasse ! Mais j’en ai un peu assez que l’on nous fasse porter le chapeau de la charité et de la rédemption. Y aurait-il, mes chers collègues, des positions qui vaudraient d’être exprimées et d’autres qui n’auraient pas droit de cité ? Chacun forge sa conviction à partir de son expérience et de son histoire personnelle, mais chaque opinion, une fois qu’elle est formée et quel que soit celui qui l’expose, mérite d’être entendue ici.
Dans toutes mes interventions, je prends garde à ne heurter personne et je ne m’érige pas en donneur de leçons. J’entends en retour que, dans cette assemblée qui est réputée pour la haute tenue de ses débats, on me laisse exprimer mes opinions et mes convictions. Certes, elles sont fortes, mais elles méritent aussi d’être entendues.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.

Je voterai contre cet article, car, dans sa rédaction actuelle, il ne correspond pas du tout à l’idée que je me fais de la recherche et de sa relation avec l’humain.
Monsieur Cazeau, je respecte toutes les opinions, y compris les vôtres, même si je ne les partage pas du tout. Je vous saurais gré, à l’avenir, d’avoir la gentillesse – pour ne pas parler d’éducation – de ne pas nous prêter des intentions que nous n’avons pas. Nos convictions valent d’être exprimées autant que les vôtres. Et je vous remercie de ne pas m’avoir interrompu.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP. – M. Bruno Retailleau applaudit également.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'article.
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2131-2, les mots : « activités de » sont remplacés par les mots : « examens de biologie médicale destinés à établir un » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-3, après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « d’un établissement ou d’un laboratoire » ;
2° bis À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131-4, les mots : « analyses de cytogénétiques et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « examens de biologie médicale destinés à établir » ;
3° Le 2° de l’article L. 2131-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « analyses de cytogénétique et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « examens de biologie médicale destinés à établir » ;
b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ». –
Adopté.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan détaillé des fonds publics affectés à la recherche sur les trisomies et les anomalies cytogénétiques.

L'amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme Hermange et MM. Vial, Bailly, Darniche, B. Fournier, Mayet et Revet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
et notamment sur les pistes de financement et de promotion de la recherche médicale pour le traitement de la trisomie 21
La parole est à M. Bruno Retailleau.

J’attends avec impatience de connaître l’avis de la commission et du Gouvernement sur cet amendement qui vise à rétablir une demande de rapport sur les pistes de financement de la recherche concernant la trisomie 21.
Il s’agit en effet de l’affection génétique la plus répandue en France : plus de 50 000 personnes en sont atteintes. Il faut aussi savoir que ces personnes vivent de plus en plus longtemps – et c’est l’occasion, ce soir, de rendre hommage à la science – puisque, depuis les années quatre-vingt, la durée moyenne de vie de ces malades a pratiquement doublé, passant de trente à soixante ans environ.
Autrement dit, bien que ces concitoyens malades, qui souffrent, vivent de plus en plus longtemps, curieusement, pas un euro d’argent public ne va à la recherche sur la trisomie 21. Dans le cadre du plan « maladies rares », pour la période 2011-2014, 180 millions d'euros sont destinés à la recherche, mais rien n’est prévu pour cette maladie.
Des chercheurs espagnols viennent de mettre au point une molécule, l’EGCG, qui a été testée sur trente patients, avec des résultats plutôt encourageants : elle a eu des effets positifs aussi bien sur la mémoire que sur la psychomotricité.
Par conséquent, il serait intéressant que le Gouvernement prenne au moins l’engagement de financer la recherche sur une affection qui touche une partie non négligeable de la population française.
Dans la mesure où l’on consacre au dépistage de cette maladie environ 100 millions d'euros, il serait logique de consacrer aussi des fonds à la recherche visant à améliorer le quotidien des personnes qui en sont atteintes.

Je rappelle les termes de l'article 12 bis, tel qu’il a été récrit par la commission des affaires sociales : « Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan détaillé des fonds publics affectés à la recherche sur les trisomies et les anomalies cytogénétiques. » Évidemment, cela concerne également la trisomie 21. Il me semble important de ne pas distinguer cette forme de trisomie ; sinon, il faudrait le faire pour toutes les autres.
Si aucun euro n’a été consacré à la trisomie 21 dans le cadre du plan « maladies rares », c’est tout simplement parce que cette pathologie n’en fait pas partie. Pour qu’une maladie soit considérée comme rare, il faut que moins de 30 000 cas soient recensés sur le territoire national. Or on en dénombre plus de 50 000 pour la trisomie 21.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Néanmoins, je rejoins les arguments avancés par M. le rapporteur.
Monsieur Retailleau, vous m’avez interpellée sur la recherche à visée de soins par rapport aux efforts qui sont consacrés à la recherche concernant le dépistage et le diagnostic.
On compte un peu moins d’une dizaine de projets de recherche à visée de soins sur notre territoire, notamment ceux qui sont portés par la prestigieuse équipe de l’UMR ESPCI-CNRS conduite en son temps par Pierre-Gilles de Gennes. En tout état de cause, rien n’interdit de consacrer des financements publics plus importants pour développer ces recherches à visée de soins. On pourrait utiliser les fonds du programme hospitalier de recherche clinique, le PHRC. Mais, vous le savez, la mobilisation de ces fonds dépend de la pertinence et de la qualité des projets qui sont présentés.
Un rapport est prévu, qui portera sur l’ensemble des recherches sur la trisomie et qui permettra d’évaluer l’effort financier public consacré au développement de ces recherches.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Il est évident que je ne suis pas contre la recherche sur la trisomie 21 ; j’espère que vous l’avez compris et que, hors de cette enceinte, mes propos ne seront pas déformés. Dans la mesure où cet amendement concernait exclusivement la trisomie 21, alors que l'article vise toutes les formes de trisomie, je n’ai pu que voter contre.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'article 12 bis.

Il aurait été tellement simple de montrer que l’on voulait « mettre le paquet » sur la recherche, pour faire avancer les choses ! Mais non, on tergiverse !
Ce que je retiens, c’est que tout est tendu vers un seul et unique objectif. Tous les autres sont minorés ou repoussés sous le tapis ! Il n’est surtout pas question de s’engager dans une véritable politique de recherche à visée de soins. C’est la réalité ! Malheureusement, il n’y a pas d’équilibre !

L’article tel qu’il est rédigé a bien plus de portée que si l’on y avait ajouté votre amendement !
L'article 12 bis est adopté.

Pourquoi celles et ceux qui prétendent vouloir soutenir la recherche n’ont-ils pas voté l’article ?
L’article L. 79-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« Un enfant est considéré comme viable s’il est né après un minimum de gestation de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou s’il pèse un poids d’au moins cinq cents grammes.
« À défaut du certificat médical prévu au premier alinéa, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. »

L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le sujet abordé par cet article est particulièrement délicat. Il s’agit de modifier les critères permettant de déterminer la viabilité d’un enfant.
La suppression de cet article, que sollicite le Gouvernement, ne signifie pas que celui-ci soit indifférent à la situation très douloureuse que vivent les parents concernés. Bien au contraire, depuis plusieurs années, suivant en cela les recommandations du Médiateur de la République, le Gouvernement a mis en œuvre de nombreuses dispositions pour adapter notre législation à la prise en compte de la perte d’un enfant sans vie, c’est-à-dire d’un enfant qui n’est pas né vivant et viable.
Ainsi, dès 2008, des dispositions réglementaires ont été adoptées afin de clarifier les conditions permettant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, de consacrer l’existence de cet enfant par la mention de son prénom sur le livret de famille, ou encore de permettre l’organisation de ses funérailles.
En outre, très récemment, à la fin du mois de mars, le directeur de la sécurité sociale a apporté des éclaircissements aux directeurs des caisses pour que les familles qui ont eu à vivre cette situation dramatique ne soient pas exclues du bénéfice des prestations sociales allouées à toute femme ayant vécu une grossesse.
Le Gouvernement s’attache donc, depuis de nombreuses années, à prendre en compte la douleur des familles en adaptant au mieux les différentes dispositions applicables.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je me dois maintenant de vous expliquer les raisons pour lesquelles nous ne pouvons soutenir l’article 12 ter, qui a été inséré par votre commission des affaires sociales.
La personnalité juridique apparaît dès lors qu’un enfant naît vivant et viable. La viabilité se définit comme la capacité, pour un nouveau-né, de s’adapter à l’environnement extra-utérin et de pouvoir y vivre. Le critère de viabilité doit donc s’apprécier, à travers un examen médical, pour chaque enfant, en vue d’établir éventuellement la personnalité juridique et donc les éventuels droits qui s’y attachent. Le droit actuel prévoit cet examen médical au cas par cas. Or l’article 12 ter vient substituer à cette appréciation individualisée deux critères alternatifs purement anatomiques, constitués, l’un, par une durée de la grossesse d’au moins vingt-deux semaines d’aménorrhée, l’autre, par un poids fœtal d’au moins 500 grammes.
Cela revient à reconnaître automatiquement la personnalité juridique à un enfant dès lors qu’un seul de ces critères est rempli. La question de savoir si l’enfant est en mesure de s’adapter à son environnement extra-utérin est écartée. Ce n’est pas raisonnable.
De plus, l’introduction d’un « effet de seuil » pour caractériser automatiquement l’existence de la personnalité juridique va créer de nombreuses contradictions avec d’autres règles importantes de notre législation.
Comment articulerons-nous cette automaticité avec les situations dramatiques d’interruption médicale de grossesse, qui peuvent intervenir jusqu’à un stade très avancé de celle-ci ?
Les personnels de santé ne se verront-ils pas reconnaître une responsabilité médicale accrue une fois l’un ou l’autre des seuils atteint ?
On le voit, cet article n’atteint pas son objectif et sa mise en œuvre serait au contraire source d’une très grande complexité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’ensemble de ces raisons, que je crois partagées par la commission des lois, justifie l’amendement présenté par le Gouvernement.

L’article 12 ter, que cet amendement a pour objet de supprimer purement et simplement, vise à permettre l’enregistrement à l’état civil des enfants morts-nés ou décédés avant leur déclaration ; on en compte à peu près 6 000 par an
La commission estime, comme le Médiateur de la République, qu’il s’agit d’un problème réel et important, qui doit être réglé par la loi. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Je rappellerai simplement que, si la position de la Cour de cassation exprimée au début de l’année 2008 a pu faire naître une certaine insécurité juridique, le décret du 20 août 2008 a précisé les conditions d’établissement de l’acte d’enfant sans vie, qui est désormais délivré sur la base d’un certificat médical d’accouchement.
Les problèmes liés à l’accès à certains droits sociaux, tels que l’indemnité pour congé de paternité ou l’inscription de l’enfant sur le livret de famille, ont eux-mêmes été réglés par un décret du 9 janvier 2008.
Enfin, point essentiel, il serait problématique d’inscrire dans le code civil un seuil d’accès à la personnalité juridique indépendant des circonstances médicales propres au fœtus considéré.
Pour toutes ces raisons, et en tenant compte des engagements qui viennent d’être évoqués par Mme la secrétaire d'État, je propose de soutenir l’amendement du Gouvernement. Je précise que je n’émets là qu’un avis personnel puisque la commission des lois n’a pas été saisie sur ce point.

Nous sommes, bien entendu, opposés à cet amendement du Gouvernement, car il vise à remettre en cause celui que nous avons adopté en commission la semaine dernière.
Ce n’est pas la première fois que nous essayons de faire passer cette disposition relative à l’état civil des enfants nés sans vie et ce n’est pas la première fois que le Gouvernement s’y oppose. J’avoue d’ailleurs que je ne comprends pas pourquoi. J’aurais éventuellement compris, madame la secrétaire d’État, que vous nous proposiez une autre rédaction de l’article. Et les arguments avancés dans l’objet de l’amendement ne m’aident pas à y voir clair.
Vous dites, d’abord, vouloir éviter tout effet de seuil et faire dépendre la personnalité juridique de critères purement anatomiques. Certes, mais, en l’occurrence, ces seuils et ces critères, reconnus internationalement, sont garants d’une égalité de traitement. Or, aujourd’hui, les droits des familles concernées dépendent uniquement de l’appréciation du médecin : celle-ci n’a même pas besoin d’être justifiée et, le plus souvent, elle se matérialise d’ailleurs par une simple croix sur un formulaire ; d’où l’absence de droit de recours possible pour les familles, alors même que cette appréciation a des conséquences juridiques extrêmement importantes.
Je ne comprends pas non plus pourquoi vous évoquez un risque de remise en cause de l’IVG, à laquelle une loi est consacrée et qui contient des délais précis, indépendants de la notion de viabilité.
À la place, vous privilégiez le critère de l’accouchement, alors que, vous en conviendrez, c’est une notion beaucoup plus floue. Il a fallu une circulaire interministérielle de pas moins de treize pages pour préciser les conditions d’établissement d’un certificat d’accouchement.
Vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous refusez cette référence à la viabilité, alors que, dans la plupart des pays européens, la loi fait explicitement référence à des critères de viabilité. Je vous renvoie à l’étude de législation comparée publiée par le Sénat à ce sujet en avril 2008, que la commission des lois a nécessairement eue à sa disposition puisqu’elle en a pris l’initiative.
Depuis l’invalidation des circulaires de 2001 et de 2008, la France est devenue le seul État où ces critères ne sont plus définis dans aucun texte.
J’ajoute que les critères de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé font l’objet d’un large consensus et qu’ils avaient d’ailleurs été repris par les circulaires interministérielles. Les associations de soutien aux couples confrontés à un deuil périnatal ne remettent elles-mêmes nullement en cause la notion de viabilité ni les critères généralement admis pour la définir.
Si cette notion de viabilité est si importante à nos yeux, c’est qu’elle détermine une importante série de droits d’ordre civil, social et pénal, parmi lesquels la protection pénale du fœtus : vous ne pouvez ignorer que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la responsabilité pénale d’une personne ayant provoqué le décès d’un enfant à naître ne pourra être engagée qu’à la condition que l’enfant décédé soit né vivant et viable.
Vous évoquez également un décret de 2008 qui aurait résolu le problème. Je ne suis pas d’accord : ce décret n’est absolument pas relatif au premier alinéa de l’article 79-1 du code civil, mais concerne uniquement le deuxième alinéa, portant sur l’acte d’enfant sans vie, que le Gouvernement peut légitimement décider d’accorder sur la base d’autres critères ; il n’en reste pas moins que la notion de viabilité expressément visée au premier alinéa reste sans définition juridique.
Il est un dernier point de votre argumentaire que je ne comprends pas : vous faites référence, pour la détermination de certains droits sociaux, à une circulaire – encore une ! – du directeur de la sécurité sociale précisant les conditions d’octroi de prestations en fonction soit de la durée de la grossesse – on en revient, à mon avis, à la notion de viabilité –, soit de l’existence d’un accouchement.
Si nous en sommes là aujourd’hui, mes chers collègues, c’est précisément parce que la Cour de cassation a invalidé les précédentes circulaires, considérant que, s’agissant d’une question touchant à l’état des personnes, cela relevait du domaine de la loi. Dans ses conclusions, l’avocat général près la Cour, Alain Legoux, avait intentionnellement précisé que « ce n’est pas à [la jurisprudence] de fixer la norme, mais à la loi », ajoutant : « Quelle meilleure façon d’y inciter le législateur [que de casser les trois arrêts ? Cela] permettra au législateur de faire œuvre d’harmonisation. » On ne peut mieux dire !

La circulaire émanant de la direction de la sécurité sociale n’a pas davantage de valeur juridique et pourra donc être contestée devant les tribunaux.
De grâce, madame la secrétaire d’État, évitons de refaire les mêmes erreurs !
En proposant la suppression de l’article 12 ter, vous allez à contresens de l’objectif formulé par M. le Médiateur de la République, auquel vous-même avez fait référence. Certes, je ne suis pas son porte-parole, mais force est de reconnaître que tous ses écrits montrent qu’il demande instamment que ce problème soit réglé.

Je suis moi aussi très étonné par cet amendement du Gouvernement, car je garde un souvenir précis des débats précédents.
Nous avons évoqué la question lors de l’examen d’un projet de loi de simplification. J’ai entre les mains le compte rendu de la séance au cours de laquelle il nous a été dit avec force par plusieurs orateurs, notamment par M. Hyest, président de la commission des lois, qu’il était nécessaire d’en discuter dans le cadre non pas d’une loi de simplification, mais du projet de loi à venir sur la bioéthique. Nous y sommes !
Je veux aussi souligner l’admirable travail accompli par les services du Médiateur de la République depuis plus de deux ans sur ce sujet. §Ils ont bien voulu associer Jean-Pierre Godefroy et moi-même à leurs réflexions.
Il apparaît de manière extrêmement claire au Médiateur de la République, saisi de nombreuses situations concrètes, que la position de la Cour de cassation ouvre la voie à une obligation de légiférer. Faute de loi – d’ailleurs, cela a été explicitement dit, comme l’a rappelé Jean-Pierre Godefroy –, nous sommes dans une situation de grande incertitude.
Je veux soutenir avec beaucoup de force la position de la commission des affaires sociales. Je remercie d’ailleurs M. le rapporteur pour avis de la commission des lois d’avoir bien voulu préciser qu’il s’exprimait à titre personnel puisque cette commission n’a pas été saisie de l’amendement du Gouvernement.
À l’évidence, il est aujourd’hui nécessaire d’inscrire dans la loi une définition juridique de la notion de viabilité. Cette notion conditionne en effet le type d’acte d’état civil établi pour l’enfant sans vie et constitue l’un des deux critères conduisant à lui conférer la personnalité juridique.
Or décider qui, en droit, est une personne ou ne l’est pas, ne peut être laissé à l’appréciation diverse des médecins, des juges ou des circulaires. Cela relève, à l’évidence, de la loi.
J’ajoute que la notion de viabilité détermine une série de droits d’ordre civil, social et pénal. Elle intervient en outre dans quatre articles du code civil, à savoir les articles 79-1, 318, 725 et 906.
Je rappelle que la viabilité conditionne un certain nombre de droits sociaux. L’enfant né mort et viable ouvre droit au congé de maternité et, depuis peu, au congé de paternité, dans les conditions définies par le décret et l’arrêté du 9 janvier 2008. Jusqu’à présent, la sécurité sociale comprenait cette notion de viabilité par référence aux critères de la circulaire de 2001. Celle-ci étant invalidée pour défaut de base légale, les organismes sociaux sont conduits à accorder ces congés quel que soit le niveau de développement du fœtus décédé puisqu’ils ne peuvent plus invoquer de texte juridique justifiant de limiter l’octroi de ces prestations sociales aux enfants nés sans vie ayant atteint un certain stade de développement.
C’est ce qui a été clairement précisé par le Médiateur de la République, saisi, je le répète, de nombreuses situations.
Jean-Pierre Godefroy a parlé des aspects pénaux ; je n’y reviens pas.
Enfin, je précise que l’absence de définition juridique de la viabilité est source de contentieux et de dérives.
À défaut de critères objectifs de viabilité ayant force juridique, la procédure mise en place conduit à transférer la responsabilité de la prise de décision au corps médical au cas par cas, alors que c’est un sujet qui relève d’une décision de politique publique.
L’absence de décision législative est d’ailleurs source d’une inégalité de traitement entre les familles concernées.
Enfin, les critères de viabilité définis par l’OMS et repris par le texte de la commission font l’objet d’un large consensus, et il est tout à fait exact que des dispositions similaires existent dans pratiquement tous les pays d’Europe. Du reste, la France est devenue, depuis l’invalidation des circulaires de 2001 et 2008, le seul État dans lequel ces critères ne sont définis dans aucun texte législatif.
Voilà toutes les raisons pour lesquelles je crois très profondément qu’il faut soutenir la position de la commission des affaires sociales et rejeter cet amendement.
Permettez-moi de revenir sur les critères de viabilité. Définis par l’OMS à partir de données épidémiologiques, ils sont appréciés par le médecin en fonction de la situation, au cas par cas. Dès lors, ce n’est pas dans le cadre législatif que nous devons décider si un enfant est viable ou non.
Ainsi, aux termes du texte proposé, un enfant né après vingt-deux semaines d’aménorrhée ou pesant plus de 500 grammes mais qui est anencéphale, par exemple, serait considéré comme viable. Or il ne l’est pas sur le plan médical.
En outre, j’insiste sur le risque qu’il y a à prévoir des seuils. Ainsi les interruptions médicales de grossesse qui seraient pratiquées au-delà de vingt-deux semaines d’aménorrhée pourraient être remises en cause puisque le fœtus serait considéré comme viable.
J’ajoute que les difficultés inhérentes aux prestations sociales qu’avait soulevées le Médiateur de la République ont été totalement réglées par la lettre du directeur de la sécurité sociale dont je parlais tout à l’heure. Aujourd’hui, il n’y a donc plus de problème.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 44 rectifié ter est présenté par Mme Hermange, M. P. Blanc, Mme Rozier, M. Revet, Mmes Giudicelli et Henneron, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Lecerf, Darniche, Portelli, B. Fournier, Vial, Cointat, Retailleau, Pozzo di Borgo, Couderc, del Picchia, Bailly, Mayet et Pinton, Mme Bruguière, M. P. Dominati et Mme B. Dupont.
L'amendement n° 147 est présenté par Mme Payet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 79-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À la suite de son établissement et à la seule demande des parents, l’acte ainsi établi permet l’attribution d’un ou plusieurs prénoms, la reconnaissance de la filiation à l’égard de la mère et du père cités dans l’acte, ainsi que l’inscription, à titre de mention administrative, dans le livret de famille. Il autorise enfin les parents à réclamer, dans un délai de dix jours, le corps de l’enfant décédé pour organiser ses obsèques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 310-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également se prouver par l’acte d’enfant né sans vie. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié ter.

Tous les ans, on compte 5 000 à 6 000 enfants mort-nés ou nés sans vie.
Toutes les parties concernées par ces drames s'accordent sur la nécessité d’accompagner les parents et les familles.
Cet amendement vise à décrire, dans un premier temps, et le plus précisément possible, les conséquences de l'acte d'enfant né sans vie, tel que le prévoit le second alinéa de l'article 79-1 du code civil, et de compléter celui-ci pour mieux prendre en compte la douleur des familles, tout en rappelant que toutes ces prescriptions sont laissées à la libre appréciation des familles et que leur volonté doit être absolument respectée.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 147.

Cet amendement a été excellemment défendu par Mme Hermange.
Je me contenterai d’ajouter qu’il s’agit de prendre en compte la douleur des parents d’enfants nés sans vie, de les aider à faire leur deuil et à se remettre de cette épreuve, et d’humaniser le contexte juridique dans lequel ils se trouvent.

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
production d’un certificat médical
insérer les mots :
ou de deux certificats médicaux
La parole est à M. Gilbert Barbier.

Le constat pratique de viabilité et de décès est quelquefois décalé dans le temps, compte tenu du délai autorisé pour faire la déclaration à l’état civil. Nous proposons de prévoir un ou deux certificats médicaux. En effet, le médecin qui a pratiqué l’accouchement et déclaré l’enfant viable peut ne pas être le même que celui qui établit le constat du décès, lequel peut intervenir vingt-quatre ou quarante-huit heures après.
Comment un médecin pourrait-il établir un certificat concernant un événement, la naissance ou le décès, s’il ne l’a pas lui-même constaté ?
Cette précision est essentiellement d’ordre pratique.

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4, deuxième phrase
Après les mots :
des père et mère
insérer les mots :
ou, à défaut du père, de la mère
La parole est à M. Gilbert Barbier.

L’amendement n° 63 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 44 rectifié ter et 147, ainsi que sur l’amendement n° 62 rectifié ?

Les deux amendements identiques visent à une nouvelle rédaction de l’article 12 ter.
Lors de ses premières réunions, la commission avait souhaité entendre l’avis du Gouvernement. Or, entre-temps, ce dernier a décidé de proposer la suppression de l’article 12 ter…
Ces deux amendements me paraissent un peu moins précis que le texte de l’article 12 ter tel qu’il a été inséré par la commission. Par exemple, ils ne mentionnent pas de critères pour estimer la viabilité d’un enfant.
Dans ces conditions, la commission suivra le Gouvernement et le rapporteur pour avis de la commission des lois.
Quant à l’amendement n° 62 rectifié, il apporte effectivement une précision, mais celle-ci nous semble relever plutôt du niveau réglementaire. Nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

Quel est l’avis de la commission des lois sur les amendements identiques n° 44 rectifié ter et 147 ?

Il est toujours un peu délicat de faire appel au droit sur des sujets aussi empreints de caractère affectif.
Ces amendements identiques tendent à assimiler l’acte d’enfant sans vie à un acte de naissance au sens juridique du terme, ce qu’il n’est pas.
En outre, il paraît problématique de modifier les règles de l’établissement de la filiation par un amendement à ce texte sans procéder à un examen plus approfondi.
C’est la raison pour laquelle, même si la commission des lois n’a pas eu à examiner ces amendements, je m’en remettrai à l’avis du Gouvernement.
Sourires
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 44 rectifié ter et 147. Prévoir que l’acte d’enfant sans vie vaut reconnaissance de la filiation revient à conférer à un tel enfant la personnalité juridique tout en conditionnant l’octroi de celle-ci à la seule volonté des parents. Or la personnalité juridique ne peut dépendre d’une demande.
Le fait que l’enfant sans vie n’ait pas la personnalité juridique ne souffre aucune ambiguïté et il importe de ne pas modifier cette qualification juridique, de façon à ne pas ébranler la législation autorisant les interruptions médicales de grossesse.
Toutefois, afin de prendre en compte la douleur des parents confrontés à cette situation, la loi prévoit que l’acte d’enfant sans vie mentionne les noms et prénoms des parents, ce qui permet la reconnaissance du lien qui les unit à cet enfant, lien qui se matérialise également par la mention du prénom de l’enfant dans le livret de famille.
Sur l’amendement n° 62 rectifié, j’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 44 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy pour explication de vote sur l’amendement n° 147.

Monsieur le président, compte tenu de l’heure, je ne développerai pas l’argumentation que j’avais préparée. Je dirai simplement que la rédaction de l’article telle qu’elle a été établie par la commission est largement satisfaisante et voterai donc contre cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 ter est adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 7 avril 2011 :
À neuf heures trente :
1. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (n° 304, 2010 2011).
Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 388, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 389, 2010-2011).
Avis de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 381, 2010-2011).
À quinze heures et le soir :
2. Questions d’actualité au Gouvernement.
3. Suite de l’ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.