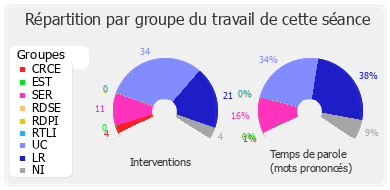Séance en hémicycle du 16 janvier 2009 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat que la commission des affaires culturelles m’a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion de commissions mixtes paritaires en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, actuellement en cours d’examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence (nos 145, 150, 151, 152).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 21.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Maurey, Biwer, Amoudry, Détraigne, Pozzo di Borgo, J.L. Dupont et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le e ter du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la diffusion de programmes dans les domaines de la culture ou la connaissance ; »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du régime fiscal du mécénat d'entreprise aux sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour la diffusion de programmes dans les domaines de la culture ou de la connaissance sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

L'article 238 bis du code général des impôts organise le régime fiscal du mécénat d'entreprise et permet aux entreprises donatrices de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons effectués en faveur, notamment, des organismes d'intérêt général, des fondations ou associations d'utilité publique, ainsi qu’aux « sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État [...]et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques [...], à la condition que les versements soient affectés à cette activité ».
Afin de renforcer la présence des programmes culturels ambitieux, coûteux par nature, il est important que le bénéfice de cette disposition soit étendu aux sociétés nationales de programme France Télévisions et Radio France, sociétés à capitaux publics ayant parmi leurs missions inscrites dans les cahiers des charges celle de présenter au public des programmes dans les domaines de la culture et de la connaissance.
Le régime actuel, aujourd'hui applicable au bénéfice des « sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux », restera conforme au droit communautaire et au régime des aides d'État une fois étendu aux sociétés nationales de programme, sociétés à capitaux exclusivement publics.

L'amendement n° 425 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Bécot et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le e ter du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e quater ainsi rédigé :
« e quater) des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.

Notre amendement a été déposé dans le même esprit que celui de M. Pozzo di Borgo, mais avec quelques nuances.
Il est inspiré des fonds de dotation, dont l’objet est de favoriser le mécénat en faveur des hôpitaux et des universités et dont le comité stratégique, présidé par Jean-Jacques Hyest, a tenu sa première réunion le 13 janvier.
Il n’y a aucune raison pour que l’audiovisuel public ne puisse pas également profiter, d’une manière ou d’une autre, de dispositions similaires.
Nous allons dans le même sens que M. Pozzo di Borgo. Mais, outre que nous nous appuyons sur d’autres articles du code général des impôts, nous restreignons légèrement le champ d’application en le limitant aux seules activités liées au domaine culturel.

La commission, qui a constaté que l’amendement de M. Pozzo di Borgo avait été rectifié, souhaiterait bénéficier de l’expertise du Gouvernement pour connaître les intérêts comparés des amendements n° 236 rectifié et 425 rectifié bis, à l’esprit desquels elle est pour sa part plutôt favorable, car il est bon que les dons aux entreprises publics soient encouragés.
Il est en effet intéressant d’encourager le mécénat au profit de sociétés publiques.
Ces deux amendements ouvrent la possibilité du mécénat en faveur des programmes audiovisuels, mais je préfère l’amendement n° 425 rectifié bis, car il l’inscrit dans un cadre plus précis que l’amendement n° 236 rectifié en précisant que les sommes versées sont affectées aux programmes audiovisuels culturels. Cela me paraît plus conforme à l’esprit du mécénat.
Je suis donc favorable à l’amendement n° 425 rectifié bis, dont je lève le gage. Par voie de conséquence, je suis défavorable à l’amendement n° 236 rectifié.

Il s’agit donc de l’amendement n° 425 rectifié ter.
Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement n° 236 rectifié est-il maintenu ?

J’accorde à Mme la ministre que l’amendement de M. Dominati, tout en allant dans le même sens, est plus précis que le nôtre, que je retire donc, monsieur le président.

L'amendement n° 236 rectifié est retiré.
La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'amendement n° 425 rectifié ter.

Cet amendement vise à donner des moyens supplémentaires à France Télévisions, ce qui est notre ligne de conduite dans ce débat. De surcroît, il ne permettra pas de financer tout et n’importe quoi, mais seulement les programmes audiovisuels culturels, raison laquelle nous le préférions nous aussi à l’autre amendement.
Nous y sommes donc favorables.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 379, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimé.
L'amendement n° 223 rectifié, présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimée.
La parole est à M. Serge Lagauche, pour défendre l’amendement n°379.

La loi nº 2007-309 du 5 mars 2007, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, a étendu la taxe COSIP aux distributeurs de services de télévision comme les opérateurs de satellite, de câble, de TNT ou de télévision sur IP via l'ADSL ou la fibre optique.
Cet article a cependant créé un traitement spécifique et privilégié au profit des câblo-opérateurs en leur permettant de calculer le montant de la taxe non pas sur les recettes d'abonnements perçues globalement, mais sur les recettes perçues réseau câblé par réseau câblé.
Un tel mode de calcul est particulièrement favorable du fait des effets de seuil – le pourcentage des sommes reversées augmente selon des tranches de chiffre d'affaires – et de l'existence d'un seuil minimum de recettes – fixé à 11 millions d'euros – en deçà duquel on ne paie rien, et c'est le cas dans la très grande majorité des réseaux dont le chiffre d'affaires TV est inférieur à ce seuil d'entrée.
Cette dérogation a été mise en place à l’époque pour tenir compte de la mauvaise santé de l’un des câblo-opérateurs, Numéricâble. Dans les faits, cette situation a abouti au fait que la contribution des opérateurs du câble au COSIP est inférieure d’une dizaine de millions d’euros à ce qu’elle devrait être, somme qui échappe au COSIP et donc à la création audiovisuelle.
En outre, cela crée une distorsion de concurrence au profit des câblo-opérateurs par rapport à tous les autres opérateurs de télécommunications qui n’est pas acceptable.
Aujourd’hui où la situation du câblo-opérateur est stabilisée, cette dérogation n’a plus lieu d’être et nous demandons sa suppression afin de permettre au COSIP d’être abondé de quelque 10 millions d’euros supplémentaires.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 223 rectifié.

Je souhaiterais souligner que les câblo-opérateurs bénéficient d'un traitement particulier très avantageux.
En effet, en ce qui les concerne, la taxe sur les services de télévision n'est pas calculée sur le montant de leurs recettes d'abonnement au niveau national, mais réseau par réseau, c'est-à-dire ville par ville où est établi un réseau câblé. Il y a ainsi plusieurs centaines de réseaux câblés pour lesquels sont signées des conventions avec les communes où ils sont implantés.
Ce privilège accordé au câble ne semble pas justifié. Tout d’abord, les directives européennes du paquet télécom de 2002, transposées en France par la loi du 9 juillet 2004, font de la neutralité technologique un principe de base du droit des communications électroniques, qui ne permet pas de traiter un opérateur en fonction de la technologie de réseau qu'il a développée.
De plus, le déploiement ville par ville des câblo-opérateurs ne leur est pas propre. Tous les opérateurs ADSL, que ce soit Orange, Free, Alice, SFR, Neuf, Télé 2 ou même Darty, se déploient eux aussi ville par ville, en créant leur propre réseau ou grâce au dégroupage. Pourtant le montant de la taxe qu’ils acquittent est bien calculé à partir du chiffre d'affaires national, pour la seule raison qu'ils n'ont pas signé de conventions administratives avec des villes
En outre, l'offre télévisée des câblo-opérateurs reste elle-même nationale, puisque c'est la même dans toutes les villes, à quelques exceptions près.
Enfin, plus de 10 millions d'euros ne sont pas réinjectés pour la création audiovisuelle.
Pour toutes ces raisons, il n'est pas justifié de maintenir un tel avantage pour le câble.

La commission est favorable à l’esprit de ces deux amendements. Ils nous paraissent intéressants dans la mesure où ils permettent de dégager des fonds supplémentaires pour la création.
La commission émet cependant une préférence pour l’amendement porté par M. Pozzo di Borgo, dont la rédaction nous paraît plus adéquate.

Nous sommes ici pour le dire, mon cher collègue.
La parole est à M. Serge Lagauche.

Notre amendement est peut-être excessif s’agissant de l’assiette retenue. Nous nous rallions donc à l’avis de la commission et à l’amendement n° 223 rectifié, qui a une portée plus réduite et nous retirons l’amendement n° 379.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 161, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII NONIES
« Évaluation de l'application des taxes mentionnées aux chapitres VII septies et VII octies
« Art. 302 bis KI. - Une mission d'évaluation émanant des commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement est créée afin de veiller à la bonne application et aux résultats de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision mentionnée au chapitre VII septies du titre II de la première partie du livre premier du présent code et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnée au chapitre VII octies du même titre.
« Les commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement peuvent, le cas échéant, prendre des mesures pour rendre effectives ces deux taxes. »
L'amendement n° 279, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII NONIES
« Évaluation de l'application des taxes mentionnées aux chapitres VII septies et VII octies
« Art. 302 bis KI. - Une mission d'évaluation émanant des commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement est créée afin de veiller à la bonne application et aux résultats de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision mentionnée au chapitre VII septies du titre II de la première partie du livre premier du présent code et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnée au chapitre VII octies du même titre.
« Les commissions chargées des affaires culturelles et des finances des deux chambres du Parlement peuvent, le cas échéant, prendre des mesures pour rendre effectives ces deux taxes. ».
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 161.

Il s’agit d’un amendement de cohérence dont l’objet est de suivre la bonne application des deux taxes créées par les articles 20 et 21. Il me paraît normal que le Parlement puisse être informé de la mise en œuvre de la perception des taxes. C’est pourquoi nous vous demandons d’adopter cet amendement.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 279.

Les taxes dont nous avons débattu hier sont visiblement accueillies sans enthousiasme par les opérateurs, qui veillent à leur chiffre d’affaires. Nombre d’amendements ont d’ailleurs tenté de les tirer à la baisse. Cette dynamique laisse donc augurer pour la mise en œuvre de ces taxes d’une collaboration timide et relative de la part des opérateurs.
En ce qui concerne les télévisions privées, les plus fortes ont obtenu de larges compensations et elles ont l’oreille du Président, à qui elles avaient déjà donné un brouillon sous forme de livre blanc. Quant aux plus petites, elles vont s’acharner à démontrer qu’elles ne sont pas concernées, ou qu’elles sont sous le seuil.
Hier, en fin de séance, je vous avais alertés sur le fait que le montant de 379 millions d’euros n’était déjà plus d’actualité, en raison d’un amendement d’un député qui avait ramené cette somme à 343 millions d’euros.
Pour finir, je souhaiterais rappeler que le montant de ces taxes n’est pas versé directement au budget de France Télévision ou de Radio France, mais à celui de l’État, qui, je l’espère, fera preuve d’éthique et l’utilisera au profit de l’audiovisuel public. En conséquence, il me semble opportun que le Parlement garde un œil vigilant sur l’utilisation des sommes perçues et sur leur traçabilité au sein du budget, afin de s’assurer qu’elles bénéficient à l’audiovisuel public.

Comme nous l’avons rappelé hier, nous partageons la préoccupation de suivre l’évolution de ces taxes. Malgré tout, nous émettons un avis défavorable, car on ne peut imposer la création d’une mission parlementaire.
Je vous rappelle en outre que tout à l’heure nous proposerons la création d’un comité de suivi parlementaire. C’est dans ce cadre que sera effectué le travail que vous souhaitez voir mené.
J’ajouterai à ce que vient de dire Mme Morin-Desailly que l’article 21 du projet de loi prévoit déjà un rapport sur le rendement effectif des taxes et sur les propositions de modifications législatives qui pourraient apparaître nécessaires. En outre, nous pourrons avoir ce débat chaque année en loi de finances.
Cette demande étant satisfaite, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 279.

Mme le rapporteur aussi bien que Mme la ministre pourraient proposer une modification de ces amendements, en proposant la création d’un comité de suivi qui a été évoquée et auquel nous ne sommes pas opposés.

Je voudrais rassurer nos collègues. Le comité de suivi fait déjà partie des propositions de vos rapporteurs. Mais nous n’en sommes pas encore arrivés à ce point de la discussion.

Il faut distinguer le fond et la forme. L’état d’esprit de ces deux amendements est très important, notamment à la lumière du débat que nous avons eu hier.
Par exemple, nous avons soutenu et adopté hier une modulation de la taxe touchant les fournisseurs d’accès en fonction de leurs investissements territoriaux. Le Sénat, chambre représentant les territoires, a dès lors un intérêt particulier à suivre l’application de cette taxe et à avoir l’outil pour le faire.
Nous pourrions donc envisager que le comité de suivi proposé par les rapporteurs ait parmi ses missions de veiller à l’application de cette taxe.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Maurey et Amoudry, Mme Payet et MM. Pozzo di Borgo et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les ventes et locations de téléviseurs
« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par tout fabricant et importateur de téléviseurs établi en France.
« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes et locations de téléviseurs.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % au montant annuel des ventes et locations de téléviseurs en France, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - A la section II du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II septies ainsi rédigé :
« II septies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les ventes et locations de téléviseurs
« Art. 1693 septies.- Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KI acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KI est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

Les fabricants et importateurs de téléviseurs vendent et louent d'autant plus de téléviseurs que ceux-ci sont amenés à diffuser des programmes de qualité. La réforme de l'audiovisuel public vise justement à améliorer la qualité de ces programmes. Il est dès lors cohérent que ces mêmes fabricants et importateurs contribuent au financement du service public de l'audiovisuel, dans la mesure où ils en tirent avantage.
On ajoutera, ce qui pourrait d’ailleurs alimenter un intéressant débat sur la TVA sociale, que ce secteur est essentiellement constitué d'entreprises internationales qui délocalisent leurs sites de productions bien loin de la France. Il connaît en outre une constante progression depuis 2003, profitant notamment du décollage de la télévision numérique puis de la télévision haute définition, dont le service public de l'audiovisuel est un acteur essentiel.
Selon les chiffres communiqués par le syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, entre 2003 et 2007, le nombre de téléviseurs vendus a augmenté de plus de 50%, sans que la France en bénéficie puisqu’il s’agit de téléviseurs étrangers. Dans le même temps, le prix moyen des téléviseurs augmentant avec l'intégration du numérique, de la haute définition et des nouvelles technologies, le chiffre d'affaires dégagé par ces ventes a augmenté de plus de 106%, pour s’établir à 4, 23 milliards d'euros selon ces estimations, ce qui est loin d’être négligeable.
Une taxe raisonnable de 3 % sur ces ventes permettra d'apporter un financement complémentaire important au service d’audiovisuel public, estimé à plus de 120 millions d'euros sur la base des chiffres de 2007, sans entamer la bonne santé des fabricants et importateurs, qui attendent malgré la crise une nouvelle progression de 11% du chiffre des ventes en 2008.

Nous avons longuement débattu hier sur le choix de taxation, et vous avez voté l’article 21. Il me semble que nous avons trouvé un équilibre et il paraît donc inopportun de créer une nouvelle taxe.
La commission est donc défavorable à cet amendement.

La taxe sur les téléviseurs était dans l’air à partir du moment où l’on décidait de retirer la publicité. On a cherché dans toutes les directions comment créer une recette nouvelle, qui soit juste et en lien avec l’audiovisuel. On peut penser qu’une taxe sur les téléviseurs aurait eu plus de liens avec l’audiovisuel, puisqu’on ne peut regarder la télévision sans téléviseurs, plutôt qu’une taxe sur les fournisseurs d’accès, ou d’autres choses moins justes.
Ces votes sont derrière nous : le principe d’une taxe sur les fournisseurs d’accès à internet a été adopté et nous avons revalorisé la redevance.
Cette taxe posait de toute façon problème : même si elle était plus juste, elle ne faisait pas l’unanimité ; il y avait du pour et du contre. Nous avons notamment débattu pour savoir s’il fallait étendre la redevance aux foyers fiscaux possédant uniquement un ordinateur.
La création d’une taxe sur les ventes de téléviseurs entraînera inévitablement une migration automatique et beaucoup plus forte vers l’achat d’ordinateurs. À ce stade du débat, puisque nous ne sommes plus obligés de rechercher des financements pour l’audiovisuel public, une telle mesure ne paraît plus opportune.
C'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas cet amendement et retirerons tout à l’heure l'amendement n° 378, dont l’objet est similaire.

Cet amendement vise à nourrir la réflexion sur le financement de l’audiovisuel public, réflexion qui aurait gagné selon nous à être beaucoup plus synthétique.
J’ai regretté hier que la commission des finances n’ait pas apporté son concours à la commission des affaires culturelles pour permettre une réflexion beaucoup plus approfondie sur cette question.
J’ai également déploré que nous ne disposions d’aucune expertise sur les chiffres qui ont été fournis par France 2 sur ses besoins en financement. Pour ma part, même si le Gouvernement ne nous présente pas un texte parfait sur ce dossier, je considère qu’il revient au Parlement de mener cette expertise, par le biais des commissions compétentes. Je remercie la commission des affaires culturelles de s’être penchée sur cette question, mais l’expérience de la commission des finances aurait été précieuse sur ce dossier.
Cela étant, compte tenu de la position du Gouvernement, de la commission et de mes collègues socialistes, je retire cet amendement.

L'amendement n° 222 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Cet amendement est retiré, je n’y reviens pas. Je veux malgré tout insister sur le fait que ceux qui, en définitive, auraient payé cette taxe, ce sont les téléspectateurs, c'est-à-dire les usagers.
Tous nos débats sur la redevance occultent la seule question qui vaille : qui va payer ?

L'amendement n° 100, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°) du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La diffusion de tous messages publicitaires par communication au public par voie électronique, telle que définie à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, hors radio et télévision. »
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fixé à 3 % de ce même montant pour les dépenses visées au 3° du III. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 227 rectifié, présenté par MM. Maurey, Biwer, Amoudry, Pozzo di Borgo, J.L. Dupont et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de France Télévisions et l'évolution des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

Cet amendement s’inscrit dans la logique des amendements de suppression des rapports présentés aux articles 18, 20 et 21.
Il semble utile, au moment où la publicité disparaîtra complètement sur les chaînes publiques de faire un bilan sur le financement de France Télévisions et sur le rendement des deux nouvelles taxes créées par ce projet de loi.
Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé à compenser la perte de recettes publicitaires pour les trois années à venir. Au-delà, aucune garantie n'est donnée. C'est pourquoi il est d'autant plus important de dresser un bilan exhaustif des différentes sources de financement de France Télévisions à l'issue de ce délai.
Il s’agit donc, encore une fois, de permettre une réflexion beaucoup plus complète sur le financement de l’audiovisuel public.

Le sous-amendement n° 460, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa de l'amendement n° 227 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 227 rectifié.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 227 rectifié sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui vise à insérer la disposition prévue dans la loi du 30 septembre 1986.
J’en profite pour rassurer M. Pozzo di Borgo, qui regrette que la question du financement ne fasse pas l’objet d’une plus grande expertise. C’est dans cette perspective que vos rapporteurs ont proposé la création d’un comité de suivi parlementaire, mais ont également confié une mission très spécifique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, en renforçant ses pouvoirs d’investigation.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 227 rectifié ainsi sous-amendé.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 378, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport étudiant les possibilités de participation au financement des sociétés publiques du secteur audiovisuel par la taxation des différents supports permettant la réception de services de télévision. Ce rapport précise notamment le rendement envisagé de la taxe, les modalités de son affectation aux sociétés et son adéquation à l'évolution des besoins de celles-ci.
La parole est à M. David Assouline.

Cet amendement est semblable à celui que M. Pozzo di Borgo a présenté tout à l’heure.
Il tenait compte du principe qui sous-tendait le projet de loi au début de nos travaux, à savoir la non-augmentation de la redevance. Depuis, il a été décidé d’indexer la redevance et de la relever de deux euros.
Il visait également à proposer une solution de remplacement à une disposition qui nous paraissait injuste, en prévoyant une taxe sur l’ensemble des récepteurs et non plus seulement sur les téléviseurs, ce qui aurait permis de disposer d’une assiette beaucoup plus large.
Si nous taxons les fabricants de téléviseurs, Mme Borvo Cohen-Seat l’a souligné, ceux-ci répercuteront ces surcoûts sur les consommateurs ; nous ne nous faisons aucune illusion ! Or nous ne voulons pas alourdir les charges des ménages pour un produit qui relève de la consommation populaire, de masse, voire peut être considéré comme de première nécessité aujourd'hui.
Pour ce motif, comme pour les raisons que nous avons précédemment évoquées, nous retirons cet amendement.

L'amendement n° 378 est retiré.
TITRE III
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007
L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu'au titre de cette première partie de l'offre. »

Je souhaite prendre la parole sur cet article pour deux raisons.
D’une part, bien qu’il n’en ait pas du tout été question jusque-là au cours de nos travaux, cet article est extrêmement important. Lorsque vous avez présenté ce projet de loi, madame la ministre, vous avez indiqué qu’il marquait une véritable rupture. Vous avez raison, il ouvre une nouvelle page dans l’histoire de la télévision française.
Cet article a une portée historique, car il nous oblige à faire le départ entre ce qui relève du domaine audiovisuel et ce qui appartient au domaine des nouveaux services. De ce point de vue, il est même capital.
D’autre part, nos débats sur cet article auront sans doute un aspect très technique et les amendements vous sembleront peut-être de nature purement rédactionnelle. S’il en est ainsi, c’est parce qu’il s’agit d’une matière juridique, avec une terminologie spécifique.
Il ne faut pas se fier à ces apparences. Les décisions que nous prendrons seront lourdes de conséquences : elles freineront l’explosion des nouveaux services, ou bien l’encourageront.
Il s’agit de tracer la frontière la plus nette possible entre ce qui relève de l’audiovisuel et ce qui n’en relève pas. Ce qui est en jeu derrière cette problématique, c’est la convergence entre ces deux univers et l’avenir des nouveaux services. Vous le savez, le marché de la vidéo à la demande double tous les ans depuis trois ans. Nous sommes donc en présence d’évolutions extrêmement fortes.
La délimitation prévue à l'article 22 aura des effets extrêmement sensibles sur les nouveaux services. En outre, il nous faut décider à quel type de régulation ils seront soumis.
Si nous considérons qu’il s’agit de services audiovisuels, le CSA sera l’instance de régulation, conformément à la loi de 1986. Ce dispositif, s’il est pertinent pour l’audiovisuel, ne l’est pas du tout pour les nouveaux services internet.
Dans le cas contraire, c’est la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui s’applique : ces nouveaux services auront alors pour régulateurs – car il y en a toujours – le juge et le Conseil de la concurrence.
Dans un avis très éclairant, le CSA a mis en garde contre les conséquences d’une mauvaise délimitation entre les deux sphères : celle-ci conduirait soit à inciter ces nouveaux services à se délocaliser, ce qui est encore plus simple sur internet qu’ailleurs, soit à brider la création, la créativité et l’innovation.
Ce débat n’a donc rien de théorique ou de juridique ! Il est au contraire capital.
Par ailleurs, cet article transpose une directive européenne, qui a fait l’objet de débats importants au sein des grandes institutions européennes : Conseil européen, Parlement européen, Commission européenne.
L’équilibre auquel est parvenue la directive européenne me semble satisfaisant. Le texte du Gouvernement s’en approche, il faudra le conforter.
Par conséquent, les amendements que je présenterai au nom de la commission des affaires économiques visent à revenir au plus près à l’équilibre trouvé par la directive.
Oui, la télévision de rattrapage et la vidéo à la demande font partie des services audiovisuels. C’est ce que proclame la directive ; c’est ce que souhaite le Gouvernement. Toute autre extension pour d’autres motifs, par exemple la protection des mineurs, non seulement ne permettrait pas d’atteindre l’objectif recherché, mais contredirait les intentions de la directive européenne.
C'est la raison pour laquelle j’ai tenu à insister sur les enjeux de cet article. S’il peut sembler confus au premier abord, l'article 22 est en fait décisif pour l’avenir de l’économie numérique en France.

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 190 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 163 est présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 240 rectifié est présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo et Deneux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer le mot :
éditer
par les mots :
fournir ou à diffuser
La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 190.

Cet amendement illustre parfaitement mon propos et montre l’importance qu’il faut accorder à la terminologie. Il vise à remplacer le mot : « éditer » par les mots : « fournir ou à diffuser », verbes dont le sens n’est pas sujet à interprétation.
Il s’agit, vous l’avez compris, d’éviter toute confusion entre les services qui relèvent de l’audiovisuel et les autres.
Or, la clé qui permet de tracer sans ambiguïté la frontière entre eux, c’est la capacité éditoriale.
Si, par cet amendement, nous proposons une substitution de mots, c’est parce que le mot « éditer » renvoie à une réalité juridique qui est piégée.
Le Gouvernement a souhaité adapter le champ de la directive tout en respectant cette dernière, mais avoir une capacité éditoriale suppose que l’on a une maîtrise préalable du contenu.
Je m’explique : un journaliste, quand il rédige un éditorial, y fait passer ses idées, assume la responsabilité de ce qu’il écrit et en contrôle la publication. Par définition, un éditorial suppose cette responsabilité.
A contrario, un site offrant un service en ligne de partage et de visionnage de clips vidéos, Daily, par exemple, n’a aucun moyen d’exercer sa responsabilité ex ante à propos d’une vidéo ou d’un message : on ne peut pas lui imputer une quelconque responsabilité de ce qu’il propose. Il peut éventuellement, au regard de la loi, en avoir une ex post, mais certainement pas ex ante.
« Éditer » suppose un contrôle préalable.
Mes chers collègues, c’est là une précision très importante. Toute l’économie d’internet repose sur la distinction juridique qui a été opérée aux termes de la loi pour la confiance dans l’économie numérique entre le statut de l’hébergeur et celui de l’éditeur.
Depuis trois ans, la bataille fait rage, et les jurisprudences sont parfois contradictoires.
La dernière d’entre elles, celle du tribunal de grande instance de Paris, va dans le bon sens, mais toute erreur de notre part entraînerait une insécurité juridique, ce qui risquerait de brider le développement du désormais célèbre web 2.0, le web participatif, en particulier celui des sites de réseaux sociaux, qui en sont emblématiques, et qui proposent aux internautes de publier du contenu et de le partager avec les autres membres de diverses communautés.
L’enjeu est déterminant : ou bien le Gouvernement souhaite que la responsabilité éditoriale existe sur le web 2.0 et il s’agira de services audiovisuels – c’est ce que, selon nous, il ne faut pas faire : c’est d’ailleurs contraire à la directive, et telle n’est certainement pas l’intention du Gouvernement –, ou bien il veut, conformément à la directive, exclure du champ des services audiovisuels tous ces nouveaux services, et la commission vous prie alors, mes chers collègues, de ne pas retenir le terme « éditer », qui suppose une maîtrise et une responsabilité du contenu.
Dans le domaine de l’économie numérique, responsabilité éditoriale et viabilité des plates-formes d’échanges communautaires sont incompatibles.
Préciser dans la loi que les plates-formes d’échanges communautaires ont une responsabilité éditoriale condamnera leur développement et les incitera à une délocalisation.
Telle est la raison pour laquelle la commission est à ce point attachée à remplacer un terme qui est piégé par des termes qui renvoient à une réalité juridique certaine et précise.

Cet amendement est d’ordre sémantique et il vise à apporter des précisions importantes.
Dans la directive européenne « Services de médias audiovisuels », que le présent article vise à transposer, a été clairement définie la notion de « services de médias audiovisuels à la demande ».
Ce sont des services fournis pour le visionnage de programmes à un moment librement choisi par l’utilisateur.
Ils le sont, en outre, sur demande individuelle et sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias.
Grâce à la précision de la directive, sont ainsi exclus de cette définition un certain nombre de services.
Or, dans le projet de loi qui nous est soumis est utilisé un terme différent, celui d’« éditer », à propos des sites fournissant un contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange.
Les termes « fournir » et « diffuser », qui sont ceux de la directive, correspondent, eux, à la notion d’édition au sens de la loi du 30 septembre 1986.
Ils permettent clairement d’exclure du champ d’application de la directive les sites internet personnels et ce que l’on appelle d’un terme barbare les « blogs », qui contiennent des vidéos.
Cette précision n’est pas un détail : elle concerne des millions d’internautes dans notre pays et chez nos voisins de l’Union européenne, qui seront rassurés de savoir qu’ils seront bien exclus, par la loi française, du champ de la définition communautaire des services de médias à la demande.
Tel est l’objet de cet amendement que nous vous demandons d’adopter.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.

Cet amendement, étant identique aux deux précédents, a donc, de fait, été défendu par mes collègues. Toutefois je vais ajouter une touche personnelle aux arguments déjà invoqués.
Cet amendement vise à ce que figurent dans la loi les termes utilisés dans la directive européenne 2007/65/CE du 11 décembre 2007 sur les services de médias audiovisuels, et dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique – à savoir « fournir ou à diffuser » –, qui permettent d’éviter tout risque de confusion quant à la liste des services qui sont exclus de la définition des services de médias audiovisuels à la demande, au lieu du mot « éditer ».
Le choix du terme le plus adéquat suscite un grand débat ce matin.
L’utilisation du terme « éditer » est inappropriée, puisque l’un des principaux enjeux de la définition de ces exclusions est de tracer la frontière entre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les autres catégories de fournisseurs de services.
L’utilisation du terme « éditer » crée une confusion pour les diffuseurs de contenus vidéos générés par les utilisateurs, alors que le maintien du statut d’hébergeur est déterminant pour le modèle technico-économique de cette activité et que la jurisprudence française qualifie désormais clairement les plates-formes de contenus générés par les utilisateurs d’hébergeurs.

La commission estime que le terme « éditer », utilisé dans le présent article, doit être pris dans son sens le plus large possible et non dans celui de la loi de 1986.
Néanmoins, ayant été convaincue par l’argumentation de M. Retailleau, elle émet un avis favorable à son amendement, mais souhaite cependant connaître l’avis du Gouvernement.
Elle rappelle que, par cohérence, elle a adopté à l’article 27 un amendement illustrant son opposition à la soumission des contenus d’internet au CSA dans un avenir proche.
La définition des services de médias audiovisuels à la demande, les SMAD, dont nous débattons, prévoit très clairement certaines exclusions, en particulier celle des sites de partage comme Dailymotion et YouTube, qui permettent l’échange de contenus créés par leurs utilisateurs.
Si je comprends la proposition des auteurs de ces amendements, j’ai toutefois le sentiment que la rédaction souhaitée pourrait aller à l’inverse de ce qu’ils recherchent.
En effet, la phrase visée débute ainsi : « Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges… ». Remplacer « éditer » par « fournir ou à diffuser », risque, je le crains, de faire entrer dans le champ des SMAD, dès lors qu’un contrôle éditorial serait exercé, des contenus créés par les utilisateurs. Je pense, par exemple, aux sites personnels qui contiendraient des vidéos.
Tel n’est pas ce qui est prévu par la directive et telle n’est pas l’intention du Gouvernement.
Pour cette raison, il est défavorable à ces trois amendements identiques.

Je vous exhorte, mes chers collègues, à faire preuve de la plus extrême fermeté, s’agissant de l’interprétation de la loi.
Madame la ministre, nous avons le même objectif – je l’ai bien compris –
Mme la ministre fait un signe d’assentiment.

Vous m’avez opposé deux arguments. Je vais vous démontrer qu’ils sont vains.
En premier lieu, vous avez évoqué le risque, pour les blogs comportant quelques images, de se trouver inclus dans le champ des services des médias audiovisuels à la demande. Or, selon le présent texte, « sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique ». Les blogs, qui ne relèvent pas d’une telle activité, ne sont donc pas concernés : cela est dit au tout début de la phrase de la façon la plus ferme qui soit, comme dans la directive.
En second lieu, vous craignez qu’en voulant trop bien faire, en remplaçant le verbe « éditer » par les mots « fournir ou à diffuser », nous ne fassions entrer dans le champ de la loi de 1986 les plates-formes communautaires.
J’affirme que c’est l’inverse. La phrase débute irréfutablement par une notion d’exclusion, alors que le verbe « éditer » renvoie à une capacité éditoriale qui suppose une responsabilité et un contrôle ex ante du contenu.
Aucune plate-forme communautaire n’a une responsabilité ex ante du contenu.
Voilà des années que tous les tribunaux de France se battent pour une jurisprudence stable et claire dans ce domaine.
Pour classer les services audiovisuels, il faut reprendre les termes des directives européennes. C’est là un argument sans appel.
La commission des affaires économiques, compétente sur ce type de questions, ne bougera pas d’un iota, pardonnez-moi, madame la ministre ! J’ai, jusqu’à présent, été plutôt arrangeant. Sur ce point, nous ne transigerons pas, car c’est l’avenir d’internet qui est en jeu.
Je le répète, dans le domaine de l’économie numérique, viabilité des plateformes d’échanges communautaires et responsabilité éditoriale sont incompatibles.

A priori, j’approuve ces amendements, convaincue par les explications de M. Ralite sur la protection du volet libertaire et foisonnant : le partage d’images, fussent-elles mobiles, entre internautes, ne saurait évidemment entrer dans le champ de l’édition au sens professionnel et encore moins relever du CSA.
Ce faisant, monsieur Retailleau, je me trouve en situation de voter les termes vous avez proposés, vous qui entendez affranchir les opérateurs de leurs responsabilités si, par hasard, ils venaient à inventer du contenu.
J’ai bien noté que, dans votre prise de parole sur cet article, faite d’ailleurs à titre personnel, vous avez souligné le risque qu’il y avait à brider ces trois notions ainsi juxtaposées : « l’innovation » – nous vous suivons sur ce point –, « la créativité » – nous vous suivons toujours – et « la création » ; pour cette dernière, je brandis le carton rouge, car c’est vous qui franchissez la frontière !
Si nous considérons effectivement que, dans le domaine des télécommunications, on fait de la « création », on entre alors dans le champ de la création. Mieux vaut donc retirer ce terme. Votre proposition n’est recevable que si chacun reste dans son métier. Une grande vigilance sera alors de mise pour l’avenir.
Lors des débats sur les droits d’auteurs, j’ai le souvenir qu’on avait déjà revendiqué une frontière très stricte entre ce qui relève des télécommunications et ce qui relève de la télévision et des services associés. Très bizarrement, cette même frontière, que vous défendez avec pertinence pour les internautes, a eu l’effet collatéral suivant : une chanson diffusée dans un café par un juke-box ou une télévision est soumise à des droits d’auteurs, tandis que, diffusée dans ce même café sur un écran numérique, elle en est totalement exonérée, en raison de la nature du tuyau par lequel elle est passée, c’est-à-dire les télécommunications !
Tel est donc l’un des risques inhérents à l’adoption de ces amendements, que je qualifierai de « libertaires-libéraux ». Pour ma part, je les voterai, car les termes proposés me paraissent justes, mais j’en appelle à une vigilance extrême de la part de chacun pour contenir les opérateurs dans leur métier. Si ces derniers se mettent à en changer, alors ils tomberont notamment sous la coupe des droits d’auteurs, des redevances sur la création et du contrôle des contenus.
Je maintiens ce que j’ai dit. Monsieur le rapporteur pour avis, je vous fais remarquer que certains blogs, à l’image de Skyblog, ont malgré tout est une activité économique et contiennent de la publicité.
En outre, le recours au terme « éditer » ne vise évidemment, à aucun moment, à qualifier d’éditeurs les sites de partage dans leur ensemble et à revenir sur notion d’hébergeur telle qu’elle a été définie dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Si la commission des affaires culturelles a bien compris les préoccupations exprimées par Mme la ministre sur ce sujet, elle a toutefois été rassurée par les précisions très claires apportées par M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Elle émet donc un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 190, 163 et 240 rectifié.
Les amendements sont adoptés.

Je suis de nouveau saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 191 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.
L’amendement n° 164 est présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 238 rectifié est présenté par MM. Maurey, Amoudry et Détraigne, Mme Payet et MM. Pozzo di Borgo et Deneux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, supprimer le mot :
seul
La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 191.

La commission des affaires économiques a déposé cet amendement pour obtenir une clarification aussi bien du Gouvernement que de la commission des affaires culturelles.
Il s’agit toujours, en l’occurrence, de la délimitation de la frontière entre les services audiovisuels et les autres. En effet, ceux qui sont exclus de la première catégorie relèvent, non pas de la loi de 1986, mais bien de la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Or nous avons relevé que, dans le présent projet de loi, le terme « seul » avait été ajouté à la rédaction issue de la loi de 2004, avec le risque, finalement, de créer une condition qui nous a semblé plus restrictive au regard de l’exclusion du champ de couverture des services audiovisuels.
La commission souhaite donc pouvoir connaître les motivations qui ont présidé à un tel ajout.

La directive européenne qui nous occupe dans cet article introduit le vocable de « services de médias audiovisuels », lequel regroupe deux catégories de services : les services de médias audiovisuels linéaires, c’est-à-dire la télévision traditionnelle, et une nouvelle catégorie de services, dénommée « services de médias audiovisuels à la demande ».
Le champ d’application de la directive est étendu à ces nouveaux services, et, avec lui, la réglementation jusque-là applicable aux seuls services de télévision dits de « radiodiffusion télévisuelle », moyennant certaines adaptations.
Toutefois, certains de ces services n’entrent pas dans le champ d’application de la directive.
Or, au regard du texte de l’article 22, une certaine ambiguïté pourrait s’instaurer dans la liste des services qui sont exclus de la définition des services de médias audiovisuels à la demande. Elle provient de l’ajout du terme « seul », qui ne figure pas non plus dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ce mot crée donc une confusion dans la qualification des plateformes communautaires d’hébergement de vidéos et fait courir le risque d’une interprétation restrictive de la catégorie de services d’hébergement. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, pour plus de clarté et de précision, nous vous proposons de le supprimer.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l’amendement n° 238 rectifié.

Monsieur le président, cet amendement est défendu. Je n’ai, en effet, rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur pour avis et de M. Ralite, qui se sont d’ailleurs exprimés quasiment dans les mêmes termes.

Autant la commission était favorable aux trois premiers amendements identiques, autant elle émet un avis clairement défavorable sur ceux-ci.
Des sites comme Dailymotion ou Youtube sont clairement exclus du champ des SMAD, puisqu’ils ont une activité de stockage de vidéos. Cela nous semble normal et nécessaire, et il est bon de le rappeler.
Néanmoins, il faut également s’assurer que, si ces sites évoluent et se mettent à offrir des services audiovisuels, ils soient alors soumis à ce titre aux mêmes règles que les SMAD diffusés sur les autres supports. Cela rejoint, me semble-t-il, les préoccupations exprimées par Mme Blandin.
Pour les raisons qui ont été avancées par Mme le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
La rédaction proposée dans le projet de loi permet d’exclure clairement les hébergeurs, puisqu’elle prévoit que sont exclus du champ des SMAD les services consistant à assurer « le seul stockage de signaux audiovisuels ». La suppression du terme « seul » irait dans la mauvaise direction et serait même dangereuse. En effet, cela pourrait aboutir à exclure les offres de vidéo à la demande du champ des SMAD, puisque celles-ci assurent justement le stockage des contenus qu’elles proposent.

La clarification apportée par la commission et par le Gouvernement me semblant aller dans le bon sens, je vais retirer l’amendement n° 191.
Il s’agit d’être précis, car nos débats doivent pouvoir éclairer le juge, qui, demain, aura à trancher les éventuels contentieux.

Il convient donc d’éviter que la jurisprudence ne fasse une fausse interprétation de la loi.
J’ai bien compris que l’ajout du mot « seul » n’introduisait pas une condition restrictive et que la rédaction actuelle n’allait pas dans un sens opposé à l’intention du législateur exprimée dans la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Il s’agit, au contraire, de tracer une frontière en ayant une vision la plus large possible, les SMAD étant réduits, bien entendu, aux deux catégories qui ont été précisées tout à l’heure : la télévision de rattrapage et les vidéos à la demande.
Sous le bénéfice de cette explication, je retire donc, au nom de la commission des affaires économiques, l’amendement n° 191.

L’amendement n° 164 est retiré.
Monsieur Pozzo di Borgo, qu’advient-il de l’amendement n° 238 rectifié ?

Je le retire, monsieur le président, car nous nous rangeons aux arguments de Mme le rapporteur et de Mme la ministre.

L’amendement n° 238 rectifié est retiré.
Je suis encore saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 192 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.
L’amendement n° 162 est présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 237 rectifié est présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo, A. Dupont et Deneux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la définition des services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »
II. En conséquence, rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 192.

Par cet amendement de clarification, la commission des affaires économiques souhaite, une nouvelle fois, apporter le maximum de précisions à la rédaction du texte.
La directive européenne et le texte de loi proposé par le Gouvernement, qui, sur ce point, n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale, prévoient que deux critères doivent être réunis pour qu’un service entre dans la catégorie des SMAD : d’une part, l’utilisateur doit prendre une initiative personnelle et demander de manière interactive à visionner tel ou tel programme ; d’autre part, ceux-ci doivent être proposés dans le cadre d’un catalogue de programmes.
La notion de programme est donc importante à définir puisqu’il s’agit de l’un des critères clés pour distinguer ce qui relève des SMAD de ce qui n’en relève pas. La commission des affaires économiques, dans un souci de clarté, a donc souhaité reprendre, au mot près, la définition retenue dans la directive pour la transposer dans le présent projet de loi. Ainsi, le juge et les acteurs concernés seront dans une totale sécurité juridique : on saura ce qu’est un programme.

Cet amendement tend, une nouvelle fois, à préciser les choses. Il s’agit, en l’occurrence, de la définition du mot « programme », absente tant dans le présent projet de loi que dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Nous proposons simplement de compléter l’article 22 par la définition suivante, figurant au b) du 2) de l’article 1er de la directive européenne 2007/65/CE relative aux services de médias audiovisuels : « programme : un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »
Cette définition nous semble, en effet, très utile pour préciser ce que nous voulons identifier comme étant un « programme » dans la conception des services de médias audiovisuels à la demande.
Au regard de la complexité de ces questions liées au développement des nouvelles technologies, la loi ne pourra ainsi qu’y gagner en clarté.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 237 rectifié.

Afin d'éviter toute confusion sur la nature des programmes concernés par le présent article, il convient de le compléter par la définition du mot « programme » figurant dans la directive européenne du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels ».

Votre commission estime qu’il pourrait être regrettable de figer dans le marbre la définition des SMAD.
Les exclusions assez larges prévues dans le texte nous semblent préserver l’avenir tout en fixant des règles claires pour le présent. Nous pourrions débattre à l’infini et à l’envi pour définir la notion de « programme de télévision ». Il est très difficile de s’y essayer.
Si la rédaction présentée par les amendements qui reprennent le texte de la directive convient à Mme la ministre, nous ne nous y opposerons pas. En conséquence, nous émettons un avis de sagesse.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que vient de souligner très justement Mme Morin-Desailly.
Les exclusions sont très clairement posées. En réalité, il est toujours complexe de définir dans la loi la notion de programme. J’observe que le fait que le mot « programme » n’ait pas été défini dans la loi de 1986 n’a jamais posé de problème. C’est le CSA qui apprécie ce qu’est un programme, notion évolutive.
Par ailleurs, cet amendement reprend la notion de « fournisseur de services de médias » issue de la directive. Or cette notion est totalement absente de la réglementation audiovisuelle, où l’on trouve les notions d’ « hébergeur » et d’ « éditeur de services ». Généralement, c’est cette dernière qui est retenue.
La définition proposée pour les SMAD est équilibrée et adaptée à notre tradition juridique. Je crains que cette proposition ne crée de la confusion et de l’ambiguïté, car, je le répète, ne figure en général dans les réglementations que la notion de « fournisseur de services de médias ».

Si nous poursuivons le même objectif, je ne partage pas les arguments qui viennent d’être avancés. En effet, la définition du mot « programme » figurant dans la directive est, par elle-même, très évolutive, elle constitue véritablement un cadre. Vous pourrez le constater en la lisant puisqu’il s’agit du texte même de l’amendement.
Dès lors qu’un critère clé dans la définition de la frontière entre ce qui relève du champ des SMAD et ce qui n’en relève pas est le programme, les juges et les acteurs doivent savoir à quoi ils doivent s’attendre en matière de définition de la notion de programme.
Cette définition n’a pas été imposée. Elle n’a jamais été la clef des discussions qui ont eu lieu lors de l’élaboration de la directive. Les États membres s’étant accordés sur une définition assez raisonnable et qui permet des évolutions, nous devons être clairs. Puisqu’un critère fait référence au programme, la loi doit également définir la notion de programme, afin d’apporter plus de clarté et de précision.
Nous n’avons aucun intérêt à figer la notion de programme, qui est assez fluide, évolutive et différente selon les pays. Il faut la laisser à l’appréciation du juge et du CSA.
Je ne vois pas quel est l’intérêt de figer cette définition.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 192, 162 et 237 rectifié.
Les amendements sont adoptés.

L'amendement n° 184, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chaînes cryptées diffusant en clair des programmes ne comportent pas, lors de la diffusion en clair, de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

Cet amendement est presque destiné à une chaîne précise ! Bien sûr, la loi doit être générale, mais il faut malgré tout étudier ce problème à partir d’un exemple.
Les chaînes cryptées tirent 95 % de leurs ressources de leurs abonnements, et donc d’une clientèle captive, mais pour des raisons de recettes publicitaires, elles souhaitent aussi aller en clair sur le marché de l’audience gratuite.
Ce faisant, elles créent une distorsion de concurrence, qu’il faut interdire. C’est pourquoi je présente cet amendement, qui doit inciter à la réflexion.
J’attire l’attention des rapporteurs et du président de la commission sur un argument qui ne figure pas dans l’objet de l‘amendement.
Prenons l’exemple de Canal Plus. Vous pouvez, à 20 heures, regarder les informations, vous pouvez aussi les regarder à la même heure sur France 2 et TF1, pour les chaînes les plus importantes, sans parler des autres. Vient ensuite l’émission Les guignols de l’info, que l’on est également tenté de regarder.
Lors de la préparation du texte, beaucoup d’intervenants ont relevé les avantages dont bénéficient les chaînes cryptées. Canal Plus, par exemple, a obtenu, lors de sa création, des avantages conséquents. La chaîne a reçu pratiquement le meilleur canal, celui de l’armée, l’autorisation de diffuser des films avant d’autres chaînes, dès six mois après la sortie en salles. La chaîne bénéficie donc d’avantages importants accordés par les autorités publiques.
Au cours de la préparation de ce texte, nombreux sont ceux qui m’ont suggéré de supprimer tous les passages en clair parce qu’ils créent une distorsion de concurrence. Selon moi, il est difficile, vis-à-vis des personnes qui ne peuvent pas s’offrir des chaînes cryptées, de supprimer ces demi-heures ou cette heure entière de diffusion en clair. Cela permet en effet d’avoir accès à une chaîne réservée à des personnes aisées, puisque tout le monde n’a pas les moyens de s’y abonner.
Je propose néanmoins dans cet amendement que la publicité ne soit pas autorisée pendant les horaires de diffusion en clair, afin d’éviter une distorsion de concurrence.
Cet amendement, je le sais, n’a pas été très travaillé – je ne le reproche ni à la commission ni à mes collègues – et je ne sais pas quel sera l’avis de la commission, sans doute défavorable. Je souhaiterais pourtant que l’on réfléchisse à cette proposition.
En effet, dans le cas des chaînes cryptées, de Canal Plus en particulier, on constate une qualité historique forte mais aussi une sorte d’agressivité commerciale contraire à l’esprit de ce texte. J’attitre l’attention des deux commissions et du Gouvernement sur ce point. Il est nécessaire d’y réfléchir quel que soit le sort réservé à cet amendement.
La qualité des programmes proposés par Canal Plus montre qu’il existe un transfert. Les chaînes cryptées ont déjà des avantages, pourquoi leur en accorder d’autres dans le domaine de la publicité, d’autant plus qu’elles ont déjà entre 5 et 6 millions d’abonnés ?
J’espère avoir été assez clair sur ce dossier, qui me paraît important par rapport à l’esprit apporté par ce texte dans l’audiovisuel public.

Votre commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le modèle économique des chaînes cryptées ou payantes repose sur un financement mixte et cohérent. Quand elles sont diffusées en crypté, ces chaînes ne comportent aucune publicité ; quand elles sont diffusées en clair, c’est de manière limitée dans le temps et leurs émissions sont financées par la publicité.
Ainsi, votre commission considère qu’il n’est pas utile de revenir sur ce modèle. En outre, réduire à néant le chiffre d’affaires publicitaire de Canal Plus, par exemple, aurait des effets catastrophiques pour la chaîne : cela reviendrait à la tuer.
Cette mesure aurait également des effets catastrophiques, d’une part, sur le financement de la création, puisque Canal Plus contribue à ce financement, et, d’autre part, sur le produit de la taxe que nous avons adoptée à l’article 20.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme Morin-Desailly a rappelé très justement le double financement des chaînes cryptées. Comme elle l’a également dit, historiquement, si ces chaînes ont été autorisées à diffuser des messages publicitaires pendant les plages en clair, c’est pour leur permettre d’obtenir des ressources supplémentaires afin de financer leurs programmes durant lesdites plages.
Ces plages non cryptées constituent en quelque sorte une vitrine permettant à ces chaînes de faire découvrir leurs programmes aux téléspectateurs et de les inciter à s’abonner. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui pour certaines chaînes payantes de la TNT qui peuvent ainsi se faire connaître du grand public.
En pratique, les ressources publicitaires des chaînes cryptées ne sont pas très importantes, en comparaison de celles des chaînes gratuites, mais elles participent de leur équilibre. Nous sommes d’ailleurs très attachés à cet équilibre puisque ces chaînes contribuent puissamment au cinéma et à la création. Votre dispositif affaiblirait les obligations qui leur sont fixées et réduirait le produit des taxes qui sont prélevées.

Mme la ministre a contré l’argument de la commission selon lequel la publicité est une source de financement importante pour les chaînes cryptées.
Je vais bien sûr retirer cet amendement. Mais il est nécessaire d’atténuer l’agressivité commerciale que j’ai évoquée, qui est contraire à ce que je comprends du texte sur l’audiovisuel.

Selon moi, ce texte vise à permettre à nos concitoyens de bénéficier d’une chaîne de qualité dans le service public – cela ne signifie pas que les autres ne sont pas de qualité. Le libéral-centriste que je suis considère qu’il faut des règles de déontologie.
La compétition qui a lieu tous les jours à 20 heures, ce grignotage de secondes, l’émission en clair de Canal Plus produisent une agressivité contre le journal le plus important de toutes les chaînes. Cela mérite réflexion.
Je retire mon amendement mais je demande à la commission – si elle porte quelque intérêt à mes propos – de réfléchir à cette agressivité commerciale, qui, d’ailleurs, concerne toutes les chaînes.

Monsieur le président, monsieur la ministre, mes chers collègues, nous avons bien entendu la demande de M. Pozzo di Borgo. Je le remercie d’avoir accepté de retirer son amendement.
Notre commission des affaires culturelles, qui gardera à l’esprit les questions qu’il pose, est prête, en collaboration avec la commission des affaires économiques, à poursuivre la réflexion.

L'amendement n° 184 est retiré.
La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'article 22.

Je comprends les soucis que vous avez exprimés, monsieur Pozzo du Borgo, mais ils sont à géométrie variable. En effet, vous avez voté la possibilité de longs tunnels de publicité – deux fois neuf minutes, soit dix-huit minutes, quelle agressivité commerciale ! – sur TF1 et la seconde coupure de publicité dans les films.
Pour notre part, nous avons été clairs dans ce débat. Cette loi n’est pas portée par une volonté de réduire l’agressivité commerciale et publicitaire en général dans l’audiovisuel. Cet argument a simplement été avancé pour habiller d’autres volontés. Pour preuve, alors que cette loi avait pourtant vocation à défendre l’audiovisuel public, elle permet en réalité aux gros opérateurs d’accroître leurs recettes publicitaires.
Pourquoi votre attention s’est-elle portée sur Canal Plus, qui ne représente ni la majorité des téléspectateurs ni celle du marché publicitaire, et non sur TF1 ?
L'article 22 est adopté.
L'article 3-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de radio et de télévision » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;
3° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il contribue à la connaissance, à la valorisation et à la promotion de la France d'outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux. » ;
4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».

L'amendement n° 41, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° bis de cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement vise à supprimer une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, aux termes de laquelle le CSA « contribue à la connaissance, à la valorisation et à la promotion de la France d’outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux ».
Selon nous, cet ajout, qui est pour le moins étonnant, ne correspond pas aux missions du CSA.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L’amendement est adopté.
L’article 23 est adopté.
À la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ». –
Adopté.
À la première phrase du premier alinéa de l'article 14 de la même loi, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des » sont supprimés.

L’amendement n° 42, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. »
B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention I.
La parole est à Mme le rapporteur.

Il s’agit, par cet amendement, de reconnaître dans la loi l’existence et l’action de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, l’ARPP, qui joue un rôle majeur dans le contrôle de la publicité en France, notamment dans l’audiovisuel.
L’amendement est adopté.
L’article 25 est adopté.
Après l'article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle et notamment les vidéomusiques peuvent comporter du placement de produit.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :
« 1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;
« 2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
« 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
« 4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. »

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 165 est présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 280 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L’amendement n° 380 rectifié est présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bourzai, MM. Boutant et Domeizel, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l’amendement n° 165.

Plusieurs arguments militent en faveur de la suppression de l’article 26.
Tout d’abord, s’il devait être adopté en l’état, cet article bouleverserait le paysage audiovisuel actuel.
L’intrusion de cette nouvelle forme de publicité – car c’en est bien une ! – dans les programmes de l’ensemble des chaînes de télévision, publiques ou privées, serait en totale rupture avec la jurisprudence constante du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui a toujours assimilé le placement de produit à de la publicité. Aussi est-il étonnant que, pour le secteur public, ce projet de loi visant à la suppression de la publicité réintroduise celle-ci sous une nouvelle forme.
Ensuite, dans son avis de septembre 2005, le CSA concluait que le placement de produit « devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie sur ses incidences comme sur ses éventuelles modalités d’encadrement, avant d’envisager son autorisation ». Or cette réflexion n’a pas eu lieu.
Enfin, s’il est vrai qu’il est envisagé dans la future directive d’autoriser de telles pratiques, celle-ci prévoit toutefois de les interdire dans le cadre des émissions d’information, d’actualité et des émissions pour enfants. L’article 26 ne prévoit même pas ces restrictions.
Pour ces raisons, et bien d’autres encore, en particulier celles qui sont liées au texte même de chacun des alinéas de cet article, simples vœux pieux dont la formulation ne peut que faire sourire et qui ne disposent aucune règle normative, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 280.

Le Gouvernement nous dit vouloir la « désintoxication de la publicité ». Nous le prenons au mot.
La simple cohérence serait de ne pas réintroduire la promotion des marques en d’autres lieux, comme les SMAD, et sous d’autres formes plus pernicieuses, comme le placement de produit.
Certes, la directive prévoit des mesures d’encadrement en cas de placement de produit. Cette pratique est ainsi proscrite dans le cadre des programmes destinés aux enfants et à des fins de promotion de produits comme les cigarettes et les médicaments. Il est également recommandé de « ne pas exagérer » et de mentionner les produits concernés dans le générique de fin.
Cependant, nous avons la liberté de remettre en cause le principe même du placement de produit. L’Assemblée nationale, sur le sujet, a repris quelques préconisations évidentes, mais dérisoires et inapplicables.
Selon une première proposition, les produits placés ne doivent pas influencer les programmes. Si nous comprenons bien, c’est donc aux heures d’écoute des adultes que l’on verra, dans les films, les enfants jouer avec des briques encastrables en plastique, et dans les programmes pour enfants que seront filmés des produits repérables de nettoyage ! Qui le croira ?
La deuxième proposition figure à l’article 26 du projet de loi : les programmes comportant du placement de produit « n’incitent pas directement à l’achat […] des produits ». Encore une fois, qui le croira ?
Les « placeurs » seraient alors des mécènes confiant une voiture de marque reconnaissable à l’acteur qui tient le rôle du commissaire dans le seul but d’aider la production, ou à celui qui joue le cambrioleur virtuose cabriolant sur les toits simplement pour aider la création. Tant que nous y sommes, accordons-leur un crédit d’impôt !
La troisième proposition est également inscrite à l’article 26 : les programmes comportant du placement de produit « ne mettent pas en avant le produit en question ».
Dans ces conditions, il faudra veiller à ce que la voiture du commissaire passe très vite ! On imagine les débats qui en découleront, afin de déterminer si la caméra qui s’est attardée au moment de l’ouverture de la portière du véhicule a mis le produit très en avant, ou pas trop !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 380 rectifié.

La directive 2007/65/CE définit la notion de placement de produit – « utilisation explicite dans un programme audiovisuel d’un produit d’une marque spécifique » – et pose le principe de son interdiction. Elle ouvre toutefois aux États le droit de déroger à cette interdiction, sous certaines conditions ayant essentiellement trait à l’identification adéquate de la présence d’un placement de produit dans le programme : le produit doit être clairement identifié en tant que tel, avec annonce en début d’émission.
Le placement de produit reste toutefois formellement interdit dans les émissions d’information et d’actualité, les documentaires et les programmes pour enfants.
Je rappelle à nos rapporteurs que le placement de produit n’était pas couvert par l’ancienne directive « Télévision sans frontières », qui posait le principe de séparation des activités et interdisait la publicité clandestine dans les programmes, rendant les diffuseurs responsables en cas d’abus. La réforme de la directive de 2007 n’a autorisé ce recours au placement de produit que pour permettre d’adapter aux pratiques américaines celles des États membres.
Une étude indépendante, datant de 2007, fait valoir que, au niveau mondial, le placement de produit, qui fait l’objet d’un usage intensif aux États-Unis – personne, je l’espère, ne souhaite que nous adoptions ce système ! –, avait crû de 37 % en 2006 et estimait qu’elle devait encore croître de 30 % en 2007.
Néanmoins, la frontière entre publicité clandestine et placement de produit peut s’avérer étroite. Je vous donne un exemple, cité par un avocat bruxellois, spécialiste de ces questions : « En principe, lorsque James Bond 007 conduit sa BMW flambant neuve, visible à l’écran pendant près d’un quart d’heure sur les 120 minutes que dure le film, il s’agira toujours d’un placement de produit, autorisé. Lorsque le même James Bond s’extirpe de la voiture pour déclarer, frais et dispos, qu’avec ce magnifique bolide il ne souffre pas du dos après huit heures de route, il s’agit de publicité, clandestine et illicite. »
Autant dire que la frontière est ténue, et, je l’avoue, je n’aimerais pas être à la place du CSA lorsqu’il devra assumer sa mission de régulation du placement de produit...
Cette instance, saisie sur l’avant-projet de directive, estimait d’ailleurs que le placement de produit devait « faire l’objet d’une réflexion approfondie sur ses incidences comme sur ses éventuelles modalités d’encadrement, avant d’envisager son autorisation ».
Nous estimons donc particulièrement aventureux et dangereux, à l’heure où l’on bouleverse les équilibres du marché publicitaire, d’autoriser le placement de produit, cédant ainsi à des considérations d’ordre libéral et purement mercantiles. Attendons qu’intervienne une clarification de cette notion de placement de produit avant de l’autoriser de façon si légère !

M. Michel Thiollière, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Nos conditions de travail sont quant à elles pour le moins confortables puisque, grâce à nos sièges, pour lesquels nous ne faisons pourtant aucune publicité, nous pouvons travailler plusieurs heures et sortir de l’hémicycle sans mal de dos !
Sourires.

La commission tient à vous alerter, mes chers collègues : si nous supprimons l’article 26, c’est le droit en vigueur, lequel ne prévoit aucune disposition législative encadrant clairement le placement de produit, qui continuera à s’appliquer.
Cet article, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoit effectivement la possibilité de recourir au placement de produit. Cependant, il encadre strictement celui-ci, non seulement en confiant au CSA le soin de veiller à la régulation de cette pratique, mais également en définissant un ensemble de principes très stricts qui seront désormais gravés dans la loi.
La commission préfère un article qui permet d’aller plus loin dans le contrôle et l’encadrement du placement de produit au maintien du droit en vigueur, lequel autorise les dérives signalées par plusieurs d’entre vous.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
Comme M. le rapporteur vient de le rappeler, les dispositions de l’article 26 permettent de combler un vide juridique. C’est en cela que la transposition de la directive « SMA » est intéressante.
La pratique du placement de produit est encadrée de façon très précise, comme l’a rappelé Mme Blandin. Elle est ainsi interdite dans le cadre de certains programmes, comme les émissions pour enfants. Le CSA édictera des règles précises à cet égard, et on peut lui faire confiance pour porter une grande attention à cette problématique.
M. Assouline a fait allusion à James Bond. Il est vrai que le placement de produit est surtout utilisé au cinéma, de façon intelligente et sans agressivité particulière, comme c’est le cas dans les films français. Très encadrée, cette pratique pourra bénéficier, sous certaines conditions, aux producteurs audiovisuels, qui verront cette ressource supplémentaire discrète abonder leur budget.
Je ne pense pas que cet article présente un quelconque danger. Il permet, au contraire, de combler un vide juridique.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Je tiens à faire remarquer à Mme la ministre qu’il s’agit là moins d’un problème juridique que d’un problème de choix d’orientation.
La réintroduction accrue du placement de produit prouve bien que l’argument qui est asséné depuis le début de ce débat, selon lequel le recours au financement publicitaire, c’est l’horreur, car cela pèse sur les programmes et asservit la création, n’est qu’un faux nez.
Vous changez en effet complètement de pied s’agissant du placement du produit. Après vous être fixé comme objectif, dites-vous, de débarrasser l’audiovisuel public du poids de la publicité, vous ouvrez largement le champ du placement de produit. Vous faites donc rentrer par la fenêtre ce que vous avez fait sortir par la porte !
Pour le CSA également, dont la pratique a toujours été très vigilante, réservée et restrictive s’agissant du placement de produit, c’est un sacré changement de pied !
Nous voyons éclater en pleine lumière cet aveu : le propos de ce texte est tout autre que celui qui est constamment mis en avant. Nous voterons donc en faveur de la suppression de l’article 26.

Nous constatons finalement, après des heures de débat, que l’objectif du Gouvernement est d’autoriser, sans le dire, la publicité dans les œuvres audiovisuelles. C’est assez grossier !
Je demande donc un scrutin public sur ces amendements.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 165, 280 et 380 rectifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 86 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 26.
L'article 26 est adopté.
L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu'à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande » ;
3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l'éditeur du site ne puisse nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. »

Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 43 est présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 193 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo et Deneux.
L'amendement n° 429 est présenté par M. P. Dominati.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 3° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui tend à confier au CSA un contrôle sur la publicité placée par les éditeurs sur internet, dans le cadre de sa mission de protection des mineurs. Le présent amendement a pour objet de supprimer cette disposition.
Si les objectifs visés par l'Assemblée nationale sont extrêmement louables, la réflexion sur la soumission des contenus diffusés sur internet à une régulation administrative semble inéluctable. À nos yeux, un tel dispositif devrait être adopté dans un texte plus global relatif aux responsabilités des acteurs de l'internet.
Par ailleurs, la disposition adoptée par les députés contient des concepts juridiques qui paraissent flous.
Enfin, la commission vous proposera d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 27 et visant à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à la protection des mineurs à l'égard des contenus médiatiques, et notamment internet.

La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 193.

Nous allons dans le même sens que Michel Thiollière. Je tiens toutefois à apporter quelques explications complémentaires.
La main des députés n’a pas été très heureuse, même si on comprend très bien la psychologie qui les a animés. Ils ont essayé d’apporter – subrepticement, et en tout cas d’une manière qui s’avère tout à fait inopérante – une forme de régulation, en soumettant au contrôle du CSA la publicité sur les plateformes, notamment communautaires, d’échange de contenus.
L’objectif est louable, et nous y reviendrons tout à l’heure. En effet, nous voulons tous qu’internet ne soit pas une zone de non-droit et la protection des mineurs est un sujet important. Mais le dispositif prévu par les députés présente trois inconvénients.
Premièrement, je viens de le dire, il est complètement inopérant. Sur certaines grandes plateformes, quinze heures de programmes vidéos sont téléchargées chaque minute ! Un régulateur traditionnel ne pourra jamais poster des armées de personnes chargées de visionner les images pour essayer d’écarter celles qui sont mauvaises.
Deuxièmement, ce dispositif apporte une certaine confusion et engendre une insécurité juridique, car il sous-entend une activité éditoriale, ce qui nous renvoie au débat précédent.
Troisièmement, nous disposons déjà, avec l’ARPP, d’un système de régulation de la publicité. Il serait paradoxal de soumettre la publicité à deux règles différentes, à deux régulateurs distincts, en fonction du support sur lequel elle s’exprime.
Pour ces raisons, il importe vraiment de supprimer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 239 rectifié.

Beaucoup de choses ont déjà été dites.
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui confie au CSA le contrôle des publicités mises en ligne sur les sites hébergeant des vidéos.
Les services concernés par cette disposition relèvent déjà d'un cadre juridique spécifique, fixé par le chapitre II du titre II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et d'un cadre déontologique, fondé sur la corégulation par les professionnels du secteur à travers des organismes comme le Forum des droits sur l’internet, de nature à proposer des solutions efficaces car issues d'une coordination entre tous les acteurs. D'ailleurs, pour la télévision, l'essentiel du contrôle de la publicité est effectué non par le CSA, mais par une autorité composée de professionnels, l'ARPP.
Je voudrais faire une remarque incidente. Au début de l’examen de ce texte, j’avais proposé, et je sais que la commission a décidé d’étudier ce point, une fusion entre l’ARCEP et le CSA. Dans le domaine de l’audiovisuel, il me paraît nécessaire de mener une réflexion beaucoup plus en profondeur. J’interroge donc la commission, qui a bien voulu réfléchir à cet amendement ARCEP-CSA : n’aurait-on pas intérêt à ce que des organismes comme l’ARPP soient intégrés dans une structure plus large, qui engloberait la presse, l’audiovisuel et la publicité ?
Je reviens au présent amendement. La formulation très imprécise de la disposition adoptée par les députés aurait pour conséquence d'attribuer au CSA une mission de contrôle sur plusieurs millions de sites – blogs, plateformes d'hébergement et sites de presse –, rendant difficile, voire impossible, l'exercice par le CSA de sa mission.

L'amendement n° 429 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques n° 43, 193 et 239 rectifié ?
Le Gouvernement émet un avis favorable. La protection des mineurs est un souci que nous partageons tous, mais la disposition introduite au Palais-Bourbon pose des difficultés. L’extension des missions du CSA qu’elle prévoit mériterait tout de même une réflexion globale et approfondie. Par ailleurs, le CSA disposerait-il de moyens pour remplir cette mission ?
Toutefois, la question de la protection des mineurs sur internet doit véritablement être traitée. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de l’ouverture d’une réflexion, au travers du dépôt, par la commission, d’un amendement que nous examinerons ultérieurement, sur l’amélioration de la réglementation, en matière de protection des mineurs, de l’exposition aux contenus violents et pornographiques, notamment sur internet, dans les jeux vidéos et dans les DVD.

Le sujet en cause étant nouveau, important et complexe, il ne doit pas être réglé de façon cavalière, au détour d’un débat qui ne le concerne pas.
De quoi s’agit-il ? Le CSA est l’instance de régulation retenue en matière de publicité et de contenus, notamment pour assurer la protection des mineurs. De grands pas en avant ont été réalisés en l’occurrence dans le domaine de l’audiovisuel. Mais quid d’internet où la régulation est évidemment nécessaire ? À ce propos, j’ai rédigé un rapport, que la commission des affaires culturelles a adopté à l’unanimité, portant sur les nouveaux médias et sur leur impact sur les jeunes.
Aux termes de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale, le CSA serait compétent pour réguler dans ce domaine. Or il n’est pas preneur, si je puis dire, car internet ne fait pas partie de l’audiovisuel et cette instance ne dispose pas des moyens adéquats.
Il est absolument fondamental qu’un contrôle de la publicité soit organisé sur internet. Est-ce lors de l’examen d’un projet de loi sur l’audiovisuel que ce sujet doit être traité ? Je ne le pense pas, parce que ce serait du bricolage. Je partage donc le point de vue de la commission.
M. Retailleau, quant à lui, propose une alternative et souhaite confier la compétence non pas au CSA, mais à une autre instance.

En fait, on ne peut pas, par le biais d’un amendement, trancher le sujet primordial qui nous est soumis. Il faut une instance de régulation de l’internet, une sorte de « CSA de l’internet », afin de s’occuper, certes de la publicité, mais de tout ce qui est violence, racisme, xénophobie, homophobie et de tout ce qui peut mettre en danger les enfants. Cette instance doit aussi encourager les bonnes pratiques. En effet, il ne faut pas voir les choses uniquement d’un point de vue négatif.
Ce débat devra être bientôt organisé lors de l’examen d’une nécessaire proposition de loi.

Cela ne m’est pas arrivé souvent au cours de ce débat mais, en cet instant, je veux saluer le travail accompli par M. Assouline lors de la rédaction d’un rapport, au nom de la commission des affaires culturelles, sur les problèmes que rencontrent les jeunes face à internet. Il a, à cette occasion, souligné la gravité d’un certain nombre de menaces.
Nous souhaitons que ce problème soit traité au fond, et non au détour de l’examen d’un projet de loi qui n’a pas un tel objet. Chacun doit être conscient de ce grave problème, dont il faut tirer toutes les conséquences.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 43, 193 et 239 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'article 27 est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La décision du Conseil précise, le cas échéant sous astreinte, les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. L'astreinte prononcée par le Conseil est liquidée par celui-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise à permettre au CSA d’assortir d'une astreinte ses décisions en matière de règlement de différends. En effet, lorsqu'elle prend des décisions dans ce cadre, l'autorité régulatrice ne parvient pas toujours à les faire respecter, ce qui nuit à sa mission. Avec cette mesure, il disposerait d'une procédure plus adaptée à l'exécution rapide de ses décisions.

L'amendement n° 461 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en œuvre la procédure de l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article. »
La parole est à Mme la ministre.
Afin que le CSA puisse donner rapidement force exécutoire à ses décisions de règlement des différends lorsqu'un préjudice grave est susceptible d'être subi, il convient de lui permettre d'assortir ces décisions d'une astreinte.

La commission des affaires culturelles se réjouit des précisions que vient d’apporter Mme la ministre et qui vont dans le sens que nous souhaitons. Elle est favorable à cet amendement et retire, par conséquent, le sien.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 45, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié comme suit :
I - Les deuxième et troisième alinéas du 1° sont remplacés par l'alinéa suivant :
« - auprès des administrations et autorités administratives, des producteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ; ».
II - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder auprès des personnes morales mentionnées aux articles 42 et 48-1 aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée et sur la base d'une décision motivée.
« Ces enquêtes sont menées par des agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel spécialement habilités à cet effet par le Conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent :
- demander à ces personnes morales la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie ;
- recueillir auprès de ces personnes morales les renseignements et justifications nécessaires.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise à confier au CSA des pouvoirs d'enquête renforcés.
Les pouvoirs d'investigation du Conseil sont demeurés pratiquement identiques depuis 1989, soit vingt ans, alors même que l'instance de régulation a désormais besoin, notamment pour régler efficacement les différends dont elle s’est saisie depuis 2005, d'avoir accès à certaines données économiques.
Il est donc proposé d'étendre le champ des personnes auxquelles le CSA peut demander des informations, de moins limiter la nature des informations que le Conseil peut solliciter et, enfin, de le doter d'un réel pouvoir d'enquête afin qu’il puisse demander aux sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle la production de tous documents professionnels nécessaires. C’est d’autant plus essentiel que nous avons confié à cette instance de nouvelles missions.
Je comprends la démarche de la commission mais je crains que les propositions portant sur le pouvoir d’enquête du CSA n’aillent trop loin.
D’ailleurs, j’observe que le CSA n’a pas exercé les compétences qui lui ont été accordées dans ce domaine en 2000.
De surcroît, la grande majorité des manquements à la réglementation audiovisuelle sont, par nature, commis et constatés sur les antennes des services de radio et de télévision. Par conséquent, pour constater le non-respect de la réglementation, il n’est pas besoin de procéder à des enquêtes. Ces prérogatives sont en général accordées dans des cas différents, en particulier pour le respect du droit de la concurrence.
La procédure proposée va loin puisque, en visant les personnes morales mentionnées aux articles 42 et 48-1 de la loi de 1986, elle inclut les associations familiales, les organisations professionnelles et syndicales ainsi que les associations de téléspectateurs.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Monsieur le président, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je ne vais pas suivre la proposition de la commission. Donner un tel pouvoir au CSA va au-delà de la limite qui devrait lui être fixée.
J’ai beaucoup voyagé et vécu dans les pays de l’Est. À Vienne, j’étais rédacteur en chef, puis directeur de l’information d’une radiotélévision. Aussi, je sais qu’il est dangereux pour les libertés de donner un pouvoir d’enquête sur tout ce qui touche l’audiovisuel à des instances autres que judiciaires.
De surcroît, si, demain, nous octroyons cette compétence au CSA, dans quelques mois ou quelques années, on donnera au Conseil du cheval le pouvoir de vérifier si les sabots des chevaux de la Garde républicaine sont conformes !
Dans le domaine de la presse, on n’a pas le droit de prévoir de tels contrôles sans passer par la justice. C’est pourquoi, avec regret, je voterai contre cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les œuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport présente des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives existantes en la matière.
La parole est à M. le rapporteur.

Dans la continuité du rapport de notre collègue Assouline sur les jeunes et les nouveaux médias, qui proposait de fusionner différentes commissions administratives relatives à la protection de la jeunesse dans les médias, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur cette question et sur celle de la protection des mineurs sur internet.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 194, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 3 « Régulation de la communication » du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13 -1. - Un organisme, désigné par décret, est chargé d'organiser la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des acteurs économiques et ceux de la société civile sur les questions relatives aux services visés aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article 1er. »
La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.

Cet amendement a pour objet de prendre en compte la préoccupation, très largement partagée sur toutes les travées de cet hémicycle et encore plus fortement exprimée à l’Assemblée nationale, relative à la protection des mineurs face aux menaces du réseau des réseaux, à savoir internet.
Nos collègues députés ont proposé que soit instauré un contrôle de la publicité sur les plateformes – très mauvaise réponse – et ont suggéré d’autres systèmes, tout autant inopérants. Nous nous sommes alors demandé quel mode de régulation devait être trouvé pour le champ internet. En notre qualité de parents, de citoyens, de responsables publics, il nous revient de répondre à cette question.
Contrairement à ce que disait M. Assouline, nous ne la découvrons pas aujourd’hui. Je l’avais déjà traitée voilà deux ans dans un rapport. Lors des assises du numérique voilà quelques mois, un atelier lui a été spécifiquement consacré. L’une de ses conclusions fait partie du plan « France numérique 2012 » présenté par Éric Besson.
L’amendement n° 194 a donc pour objet de répondre à cette question. Nous devons trouver le mode opératoire d’une régulation non pas traditionnelle mais adaptée au nouveau monde, aux nouvelles questions que soulève internet. C’est capital.
J’ai été sensible à ce qu’a dit M. del PicchiaNe disons pas qu’internet est une zone de non-droit, car, en ce domaine, comme dans tous les secteurs, y compris l’audiovisuel, le régulateur ultime doit rester le juge. Cependant, il n’intervient qu’a posteriori.
Il nous faut mettre en place une procédure de labellisation, un code de bonne conduite, un code des bonnes pratiques et passer d’une régulation administrative, qui ne fonctionne pas sur internet, à un système beaucoup plus souple, à une forme de corégulation. En d’autres termes, cherchons à convaincre plutôt qu’à contraindre. Dans cette optique, nous pourrions asseoir autour d’une même table la puissance publique, les acteurs économiques et la société civile, je pense aux associations familiales ou aux associations de consommateurs.
Dans le monde du numérique, il existe une multitude d’organismes : le comité de la télématique anonyme, le conseil supérieur de la télématique, le forum des droits sur l’internet, le conseil consultatif de l’internet, le conseil stratégique des technologies de l’information, et j’en passe. Tous ces comités Théodule pourraient être supprimés et refondus en une instance de régulation unique. Le plan « France numérique 2012 » propose ainsi la création du Conseil national du numérique. Il ne s’agit donc pas de créer une structure supplémentaire, il s’agit de regrouper celles qui existent et d’inventer une nouvelle régulation.
Voilà à quoi tente de répondre cet amendement d’appel, qui vise plutôt à initier le débat.
Mes chers collègues, arrêtons de dire que ce n’est jamais le moment. Nous avons déjà beaucoup réfléchi à cette question. Pour ma part, je m’y penche depuis deux ans et demi. À chaque débat sur l’audiovisuel, le problème resurgit et l’on ne fait rien.
Certes, chaque ministre de la famille tente de faire quelque chose. Mais, de grâce, essayons d’adopter une stratégie afin d’apporter des réponses adaptées, et non celles du XXe siècle, à de vraies questions, sans pour autant brider les formidables opportunités qu’offre internet. Je crois que tous les acteurs sérieux souhaitent des règles du jeu claires et être associés à leur élaboration. Abandonnons les vieilles règles fondées sur le pouvoir administratif et qui ne connaissent que la contrainte !
Malheureusement, ce débat n’aboutira sans doute pas aujourd’hui. Je prends tout de même le Sénat à témoin : l’Assemblée nationale a beaucoup parlé de cette question ; nous nous honorerions de ne pas laisser passer les années sans rien faire, car nous endossons une responsabilité grave.

M. Retailleau aborde un problème important auquel nous sommes très sensibles et qui mérite une vaste réflexion. Il a d’ailleurs déjà été soulevé lors de l’examen du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
Cette question doit non seulement être traitée en urgence, mais aussi de façon approfondie, car les problèmes sont réels. C’est pourquoi la commission estime qu’une proposition de loi d’origine sénatoriale, par exemple, serait plus adaptée. À cet égard, une collaboration entre la commission des affaires économiques et la commission des affaires culturelles pourrait être de bon aloi.
Je partage entièrement les préoccupations exprimées par Bruno Retailleau. Il est temps en effet qu’une instance de concertation soit créée, car on mesure bien l’ampleur des problèmes qui se posent et leur nouveauté.
Dans le même temps, je ne crois pas que cette question puisse être réglée au détour de ce projet de loi. Elle mérite une réflexion plus approfondie. C’est pourquoi le dépôt d’une proposition de loi, comme le suggère Michel Thiollière, est une idée que je trouve très intéressante.

Si la commission des affaires culturelles s’engage à collaborer avec la commission des affaires économiques, je retirerai mon amendement.

Aujourd’hui, je sens bien que cet amendement ne recueillera pas un assentiment suffisamment large. Or je veux donner toutes ses chances à cette question d’être étudiée. Toujours est-il, j’y insiste, que je veux un engagement formel.

J’ai déjà évoqué le travail accompli par notre collègue David Assouline, qui met en évidence les problèmes auxquels nous devons faire face.
Je crois, moi aussi, que nous devons avancer par la voie parlementaire. La commission des affaires culturelles souhaite travailler avec la commission des affaires économiques sur ce dossier.

Dans ces conditions, vous retirez votre amendement, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président, je le retire.
Mme Marie-Thérèse Hermange proteste.
Au premier alinéa de l'article 20-1 de la même loi, les mots : « radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ». –
Adopté.
Après l'article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - L'article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

L'amendement n° 47, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport, les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet article vise à imposer au Gouvernement de publier un décret d'application de l'article L. 333-7 du code du sport sur le régime des brefs extraits des compétitions sportives retransmis dans des émissions d'information.
Mes chers collègues, comme vous le savez, ce sujet, qui est souvent évoqué, pose de nombreux problèmes.
L'amendement est adopté.
L'article 28 bis est adopté.

L'amendement n° 381, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « diversification de l'offre de services », sont insérés les mots : « en permettant le développement sur des fréquences numériques terrestres des services conventionnés pour une diffusion sur des fréquences non attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ».
La parole est à M. Serge Lagauche.

Si la TNT a permis d'élargir considérablement une offre qui doit devenir accessible à l'ensemble des foyers, le câble et le satellite ont permis aux téléspectateurs ayant choisi de souscrire une offre de complément d'avoir accès à une grande variété de chaînes à programmation thématique correspondant à leurs goûts et à leurs centres d'intérêt ou s'adressant à certaines catégories de public. Ces chaînes, fortes d'une expérience de près de vingt ans pour les plus anciennes, ont largement fait leurs preuves et proposent des programmations extrêmement diversifiées. Elles sont essentielles au pluralisme et à la diversité du paysage audiovisuel. J’en cite quelques-unes : 13ème RUE, Berbère Télévision, Equidia, L’Équipe TV.
Mais leur développement se trouve freiné par une relativement faible pénétration du câble et du satellite en France. Je rappelle que, selon les chiffres du CSA, seuls 8, 5 millions des 25 millions de foyers français équipés d’un téléviseur sont abonnés à une offre payante, soit un tiers d’entre eux. L'accès au « dividende numérique » représenterait donc pour certaines de ces chaînes conventionnées une opportunité stratégique de développement.
Cet amendement vise à intégrer légalement dans le schéma élaboré par le Premier ministre un objectif de développement des chaînes conventionnées actuellement diffusées sur des fréquences non attribuées par le CSA.

Cet amendement est devenu obsolète. En effet, il y a quelques jours, le Premier ministre a approuvé le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique. Ce document a été publié au Journal officiel du 23 décembre dernier.
En conséquence, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que vient d’évoquer Mme le rapporteur.

L’argument avancé par la commission étant exact, nous retirons cet amendement, monsieur le président.
L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa du 3°, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie » ;
1° À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et aux personnes sourdes ou malentendantes, et » ;
1° bis Au dernier alinéa du 3°, les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, entièrement ou de manière significative, sur » ;
1° ter Le dernier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l'éditeur d'un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l'éditeur d'un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la présente loi ; »
2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services. »

L'amendement n° 48, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :
et aux personnes sourdes ou malentendantes
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement vise à empêcher que les dépenses des chaînes relatives à l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes puissent être déduites de leur contribution à la création. En effet, le développement des programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes découle d'un choix législatif fort et déjà ancien de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que les chaînes ont déjà largement mis en œuvre.
En outre, aucune disposition similaire n'a été prévue pour les services de communication diffusant sur des réseaux non hertziens.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 49, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Avant le cinquième alinéa (1° ter) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ter A Dans le second alinéa du 3°, après les mots : « documentaires de création, » sont insérés les mots : « y compris de documentaires qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, » ;
La parole est à M. le rapporteur.

Lors de l'adoption de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, le législateur a souhaité que les chaînes orientent de manière significative leurs investissements dans la production de certaines œuvres audiovisuelles. À ce titre, figurent les « documentaires de création », l'objectif étant que le CSA ne décompte plus dans les obligations de production des chaînes les émissions de divertissement ou les magazines de téléréalité.
La notion de « documentaire de création » n'étant cependant pas définie, il existe un risque que les documentaires intégrés dans les magazines d'information et de connaissance diffusés par la plupart des chaînes – Thalassa, Des Racines et des ailes, Zone interdite, Capital, Spécial investigation, toutes émissions bien connues des téléspectateurs – en soient exclus, alors même que ces documentaires constituent des œuvres audiovisuelles à part entière. Il en résulterait donc des problèmes de décompte au titre du CSA.
C'est pourquoi, afin de rééquilibrer le texte adopté en 2007, tout en respectant son esprit et son objectif, le présent amendement tend à préciser que le documentaire de création vise bien les documentaires qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, en 2007, la Haute Assemblée a précisé que les obligations de production des chaînes de télévision portaient, pour une part significative, sur les œuvres patrimoniales, à savoir les fictions, les dessins animés, les documentaires de création, les vidéo-musiques, la captation et la recréation du spectacle vivant.
Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises, des accords interprofessionnels ont été signés le 22 octobre dernier entre l’ensemble des chaînes historiques, tous les producteurs et les auteurs afin de fixer les règles de financement des œuvres audiovisuelles. La chaîne M6, dont certaines émissions emblématiques viennent d’être citées, a également signé ce document quelques jours plus tard.
Ces accords respectent profondément l’identité éditoriale des chaînes, car nous ne souhaitons en aucun cas l’uniformisation du paysage audiovisuel. D’ailleurs, des accords différents selon les chaînes ont été signés et ont recueilli l’accord de tous. Par exemple, M6, qui diffuse de nombreux magazines d’information de grande qualité, pourra contribuer à financer ces émissions emblématiques.
Les documentaires qui sont diffusés dans Zone interdite ou Capital sont inclus dans l’obligation de 15 % de participation des chaînes à la création. En fait, il existe deux obligations auxquelles a adhéré de son plein gré cette chaîne : le taux de 15 % de participation des chaînes à la création dans laquelle figure une part spécifique de 10, 5 % – qui était auparavant de 8, 5 % – pour le noyau dur des œuvres patrimoniales.
Cette préoccupation est donc bien prise en compte. Les documentaires dont il est question, au sein de ces émissions, font bien partie des obligations qui incombent à M6.
Je comprends les raisons qui ont conduit la commission à présenter l’amendement n° 49. Le sous-amendement que le Gouvernement vous propose tend à en modifier légèrement la rédaction en remplaçant les mots « y compris de documentaires » par les mots « y compris de ceux », afin que la formulation de l’article soit la suivante : « […] de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement ».
Il s’agit de sortir du débat sur le documentaire de création, qui a été réglé à la satisfaction de tous par les accords interprofessionnels.


Je suggère de préciser, dans l’amendement de la commission, que les documentaires en question peuvent résulter d’un travail d’investigation.
Nous avons un peu de mal à comprendre la problématique puisque, d’un côté, on nous affirme que tout est réglé et, de l’autre, il est tout de même nécessaire d’apporter des précisions.
Je contribue d’une manière positive au travail législatif en proposant ce sous-amendement.

Mme la ministre, par son sous-amendement, va dans le sens souhaité par la commission et apporte une précision utile qui règle la question de façon plus fine.
Cela étant dit, il faut rester vigilant. C’est un secteur qui évolue, dans lequel nous devons nous assurer que le « documentaire de création » est bien de la création et n’usurpe donc pas son nom.

Il convient de comparer les déclarations d’une chaîne à la réalité du documentaire, et seul le CSA est à même d’en juger, de manière claire, en fonction de la loi que nous votons.
Si le texte laisse une marge d’interprétation trop large – et c’est pourquoi nous ne pouvons accepter le sous-amendement de notre collègue Philippe Dominati –, le CSA n’aura pas de ligne directrice suffisamment claire et des œuvres qui n’ont pas vocation à entrer dans le champ des documentaires de création pourront s’y engouffrer. Nous avons donc ressenti le besoin de délimiter une frontière souple, mais qui permette de distinguer l’œuvre de création.
Voilà les raisons pour lesquelles nous souscrivons au sous-amendement de Mme la ministre et nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable sur le sous-amendement n° 428.
J’adhère tout à fait aux propos que vient de tenir Michel Thiollière. Il importe de conserver le système actuel permettant au CSA et au Centre national de la cinématographie, le CNC, d’évaluer au cas pas cas, en fonction des projets et des spécificités, ce qui relève, ou non, des documentaires de création. Avec ce mécanisme, certains reportages diffusés au sein de magazines peuvent être considérés comme des documentaires de création.
Il convient donc de rester dans la logique de ce qui existe et de ce qui a été voté, et qui s’inscrivait d'ailleurs dans la continuité des décrets pris à l’époque par Mme Tasca en vue de soutenir la production indépendante, ce qui a été fait avec succès.

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 463.

La question de la définition de l’œuvre est tout à fait centrale, en particulier pour toute une série de dispositifs financiers de soutien à la création. Nous devons donc être très vigilants sur toute évolution de la définition de l’œuvre.
Comme l’a rappelé Mme la ministre, nous sommes parvenus à un consensus sur la définition de l’œuvre patrimoniale, sur lequel nous nous fondons depuis maintenant bien longtemps.
L’introduction des documentaires de création dans cette définition de l’œuvre soulève une question extrêmement délicate et controversée. Elle semble abordée de façon positive dans des accords signés entre les professionnels, et on peut donc aller dans ce sens.
L’extension de la notion d’œuvre aux documentaires de création inclus dans certaines émissions qui ne relèvent pas en elles-mêmes de la création ne doit pas être présentée uniquement comme une concession faite à M6 ou comme le dépassement des critères posés par TF1, car c’est bien de cela qu’il s’agit.
Cette ouverture peut donner aux nouvelles chaînes – et peut-être demain à de futures chaînes – la possibilité de s’engager davantage dans le domaine des œuvres de création. Nous le savons, elles ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour investir dans l’animation et dans la fiction, dont le coût est très élevé. Les documentaires de création pourraient donc devenir – et cela intéresse les auteurs, les réalisateurs et l’ensemble de la filière artistique – un important espace d’écriture et de production d’œuvres, y compris pour des chaînes qui aujourd’hui ne prennent pas rang dans le domaine de la création.
Voilà la raison pour laquelle, en restant d’une extrême vigilance sur les critères qui seront appliqués à cette ouverture, nous soutiendrons l’amendement de la commission précisé par le sous-amendement du Gouvernement.

Si j’ai bien compris, le sous-amendement du Gouvernement vise à supprimer le mot « documentaires » dans l’amendement de la commission. Il s’agirait donc d’écrire dans la loi : « y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement ».
Si je n’avais pas écouté vos arguments très pertinents, madame la ministre, je n’aurais rien compris ! Comment la loi pourrait-elle être comprise par 64 millions de Français si, comme c’est parfois le cas, nous ne la comprenons pas nous-mêmes ? Je vous le dis franchement, il faudrait que la loi soit plus claire et moins complexe. Utilisons des mots simples. Le mot « documentaire » dit bien ce qu’il veut dire.
De même, je ne vois pas en quoi le sous-amendement n° 428 serait contradictoire. On peut tout à fait préciser que le documentaire résulte, le cas échéant, d’un travail d’investigation. La formulation est claire.
Cela étant dit, nous voterons bien sûr en faveur de cette disposition.
Monsieur Pozzo di Borgo, tout cela paraît compliqué, je vous l’accorde, mais les choses sont plus claires si l’on relit l’ensemble de l’alinéa concerné de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, modifié par l’amendement sous-amendé : « En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ».

L’important est qu’il s’agisse des documentaires de création, et seulement d’eux.

Malgré les apparences, la question qui est évoquée ici est importante : il s’agit de la notion d’œuvre et, consécutivement, du droit d’auteur.
Lors de l’examen du projet de loi sur la télévision du futur défendu par votre prédécesseur, madame la ministre, nous avions débattu pendant plusieurs heures avant de nous mettre d’accord sur une approche sérieuse. L’Assemblée nationale avait fait de même. Aussi, le Parlement, unanime, s’était prononcé sur une définition du droit d’auteur, à laquelle, comme d’autres, d’ailleurs, je n’avais pas peu contribué.
Cependant, le décret dont ces dispositions devaient faire l’objet n’ayant pas été publié, la question se trouve de nouveau posée aujourd'hui.
Certains d’entre vous ont peut-être acheté à Noël les DVD de l’émission Cinq colonnes à la une. En les visionnant, on a bien le sentiment de regarder une œuvre. Les journalistes qui réalisaient cette émission – Pierre Dumayet, Pierre Desgraupes – étaient des auteurs, ainsi que les réalisateurs des reportages comme Jacques Krier ou Paul Seban.
Le documentaire de création qui est intégré dans une émission ne relevant pas elle-même de la création est facilement identifiable. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, il faut entendre l’exigence qui a été exprimée par Mme Tasca.
J’ai reçu récemment les professionnels du secteur et j’ai été sensible à leurs arguments, mais il me semblait qu’il était difficile de revenir au détour d’un texte dont ce n’était pas l’objet sur une question qui avait occupé longuement le Parlement.
Je me doutais bien, pourtant, que la définition de l’œuvre serait amenée à évoluer. Rappelons-nous que les œuvres cinématographiques n’ont été reconnues comme telles qu’au moment du cinéma parlant ! Tous les grands films muets qui font notre bonheur lorsqu’ils passent dans les rares ciné-clubs restants ou que la télévision consent à diffuser étaient considérés en leur temps comme des spectacles de foire ! Vous voyez que les notions peuvent évoluer.
Je me souviens que Valéry, dans sa correspondance avec Benjamin, qui réfléchissait beaucoup sur ces questions, écrivait que l’on disposerait peut-être un jour d’un outillage de création qui modifierait le sens même du mot « création ». Cette notion est donc constamment en évolution, et c’est par des combats – des combats fondamentaux – que, petit à petit, telle ou telle dimension, jusque-là regardée de loin, se met à être regardée de près.
Comme je trouvais qu’il était curieux d’utiliser pour faire évoluer certaines questions une loi traitant d’un tout autre sujet, j’avais décidé de ne pas prendre part au vote.
Cependant, je viens d’entendre les arguments présentés et je vois bien qu’à partir de l’intervention de Mme la ministre le ciblage est d’une réelle précision si on y ajoute la vigilance, et surtout si on ajoute les accords interprofessionnels qui ont été évoqués D’ailleurs, eux aussi posent la question de l’utilisation de la loi. Parmi ces accords, il y a l’accord avec M6, qui n’a pas été facile à obtenir. S’il y a des choses qui me choquent dans cet accord, j’ai appris qu’il y avait une espèce de flou artistique dans les pourcentages de M6. Ce flou a été convenu pour aborder la question, comme cela a été souligné.
Alors, si c’est une tendance, si elle est bien sériée et si on y ajoute notre vigilance – l’accord a été signé par la société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, qui est sans doute la plus vigilante –, je pense qu’on peut effectivement, en tout cas pour ce qui me concerne, passer du « Je ne prends pas part au vote » au « Je prends part au vote », mais strictement sur l’approche qu’a donnée la ministre. Je dis bien « strictement ».
Monsieur Yves Pozzo di Borgo, je voudrais vous faire remarquer qu’au début, l’offensive est partie sur Popstars, pendant l’été. J’avais d’ailleurs rédigé un article, qui a été publié à la une du journal Le Monde, sur le thème « ça, jamais ! » Je disais « ça, jamais ! » à l’époque, mais cela vaut aussi pour aujourd'hui.
Donc, c’est une question de langue stricte. Je dirais presque de grammaire, de fidélité à l’expression de notre langue.
Dans ces conditions, au nom de mon groupe, j’émets un vote favorable sur le correctif qui vient d’être apporté par Mme la ministre.

Mes chers collègues, avant de procéder au vote, je souhaite, dans un souci de clarté, vous apporter quelques précisions. Je ne voudrais pas que certains de nos collègues apprennent par surprise que leurs amendements sont tombés.
Le sous-amendement n° 428 n’est pas contradictoire avec le sous-amendement qui a été déposé par le Gouvernement.
En revanche, si nous adoptons l’amendement n° 49 modifié par le sous-amendement du Gouvernement, les amendements n° 182 rectifié et 211, présentés respectivement par M. Pozzo di Borgo et par Mme Dumas, tomberont.
Je souhaite donc que les auteurs de ces deux amendements en soient prévenus, si, comme c’est probable, le sous-amendement du Gouvernement et l’amendement n° 49 font l’objet d’une approbation assez massive. Et s’ils souhaitent s’exprimer, je leur donnerai la parole.
La parole est à M. le rapporteur.

Je souhaite apporter quelques éléments de clarification, puisque notre collègue Pozzo di Borgo a rappelé la nécessité d’élaborer des lois compréhensibles par un maximum de nos concitoyens.
En l’occurrence, de quoi s’agit-il ? Nous voulons permettre aux chaînes de télévision d’inclure des documentaires au sein de leur quota d’œuvres audiovisuelles. Telles sont les données du problème.
Comme le rappelait Mme la ministre, en amont, un certain nombre de ces œuvres sont aidées en amont par le CNC, qui se détermine selon ses propres critères.
En revanche, en aval, une fois que le décompte est effectué, certaines œuvres peuvent être inclues dans le quota, tandis que d’autres non. Notre souci actuel est de faire en sorte que certains documentaires puissent être comptabilisés par le CSA au titre des œuvres audiovisuelles. Cela vaudrait même pour des documentaires insérés dans une œuvre ou une émission plus larges. De même qu’on peut trouver une pépite dans un fleuve, on peut trouver un poème qui serait, en soi, une œuvre dans un roman.
Il s’agit donc de ne pas exclure a priori une œuvre sous le seul prétexte qu’elle serait insérée dans une autre. C’est dans cette direction-là que nous souhaitons aller.
Cela dit, puisqu’on définit plus précisément une œuvre audiovisuelle, nous voulons pouvoir rejeter, le cas échéant, ce qui n’en est pas. C’est ainsi que nous voulons distinguer les œuvres susceptibles d’être comptabilisées dans le quota prévu par le CSA et les autres.

M. le rapporteur vient à l’instant de résumer, de manière fort claire, la pensée commune. Nous partageons le même souci : il faut éviter d’exclure certains documentaires du quota d’œuvres audiovisuelles.
En revanche, enlever le terme « documentaire » ne permet pas, me semble-t-il, d’atteindre l’objectif visé, puisque le texte devient moins précis.
C’est pourquoi l’amendement n° 211 vise, à l’instar de ce qui a été proposé par mon collègue Philippe Dominati, à insérer les mots : « le cas échéant résultant d’un travail d’investigation ». D’ailleurs, pour répondre à M. Jack Ralite, j’avais même ajouté les mots : « ou favorisant la compréhension du monde à l’exclusion toutefois de ceux insérés dans les journaux télévisés et les émissions de divertissement ».
Je propose donc que les documentaires résultant d’un travail d’investigation soient inclus dans le périmètre des œuvres dites patrimoniales. À mon avis, nous avons plus de chances d’obtenir des assurances sur ce point en le précisant clairement dans la loi.

Je remercie Mme la ministre et M. le rapporteur des clarifications qu’ils viennent de nous apporter, et je voterai le sous-amendement n° 463 et l’amendement n° 49, ce qui aura pour effet de faire tomber mon propre sous-amendement.
En revanche, tout comme ma collègue Catherine Dumas, j’aimerais que le dispositif proposé par M. Philippe Dominati figure dans la loi. Après tout, plus une règle est simple, plus on a intérêt à l’énoncer.

M. Dominati souhaite que l’on mentionne les œuvres résultant d’un « travail d’investigation ». Je suggère que nous lui donnions satisfaction. En quoi une telle précision serait-elle gênante ?
Mes chers collègues, aujourd'hui, nombre de nos concitoyens ne lisent plus les lois. Si nous voulons qu’ils les lisent de nouveau, adoptons des textes législatifs simples. En l’occurrence, je souhaite simplement que nous fassions référence aux documentaires d’investigation.

En ce domaine, comme en bien d’autres, le travail de la commission, complété par les précisions du Gouvernement, permet, me semble-t-il, une réelle modernisation, tout en gardant en tête le souci de protéger la création. Il s’agit donc d’un bon équilibre.
Monsieur Pozzo di Borgo, sur un sujet aussi complexe que la protection de la création en matière culturelle, il est quelque peu démagogique de critiquer la difficulté pour les citoyens de comprendre la loi.

Si ! Comme l’a souligné M. Ralite, si les deux assemblées ont dû débattre pendant des heures de la définition de l’œuvre de création, c’est bien parce que le sujet est complexe et évolutif.
Nous nous sommes mis d’accord sur une définition générale, qui, en plus, n’est pas trop restrictive. À présent, pour éviter toute ambiguïté, la commission propose qu’une œuvre de création puisse être insérée dans une émission plus large, où il n’y aurait pas seulement de tels programmes.
À partir du moment où elles pourront comptabiliser les œuvres de création intégrées dans des émissions ne relevant pas de la création, certaines chaînes, comme M6, qui fait des efforts en la matière, auront tendance à proposer davantage de programmes de cette nature, ce qui aura pour effet de tirer vers le haut les émissions concernées. Cette formule sera profitable non seulement aux auteurs et aux créateurs, qui disposeront de plus de plages horaires et de cadres d’expression, aujourd’hui très limités, mais également aux émissions elles-mêmes, donc à la qualité de l’audiovisuel public en général.
Mais si nous commençons à remettre en cause ces avancées en adoptant des formules imprécises pour caractériser l’œuvre de création, ce sont les créateurs qui vont morfler. Ils ne sont pas dans un rapport de force favorable face aux chaînes de télévision, dont le principal objectif est toujours de « vendre ».
Certains programmes plaisent au public sans forcément être des œuvres de création. Il ne faudrait pas que l’on dissolve progressivement la notion, faute de quoi nous aurions une sorte de fourre-tout qui s’abriterait derrière la création, notamment via le concept d’« investigation ».
En outre, avant de chercher à le cataloguer parmi les œuvres de création, il faudrait d’abord que l’on définisse entre nous ce qu’est un travail d’investigation.

Ce n’est pas de la philosophie, mon cher collègue, c’est très concret !
Le problème vient également du traitement de l’information. Nous le savons, nombre d’émissions dites « d’investigation » sont en réalité approximatives, parfois à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, et relativement subjectives.
Sur un sujet aussi fondamental, je souhaite que nous n’adoptions pas des dispositions susceptibles de mettre la création en danger. Dans le même temps, je ne voudrais pas que, par un réflexe élitiste, nous refusions de faire bouger les lignes. Je crois que la solution de la commission permet de faire bouger les lignes. Il y a un effort de modernisation et il est encadré. Je dis « banco » !

Je souhaite en fait obtenir des précisions sur l’ordonnancement des débats.
Pour ma part, j’étais assez séduit par l’explication de M. Ralite. Un certain nombre d’émissions ont été mentionnées, ce qui a permis d’approfondir les notions d’œuvre de création, et de travail de documentaire ou d’investigation.
Or la nature de ces émissions peut évoluer à l’avenir. Contrairement à ce que vous dites, cher collègue Assouline, s’il y a un doute, voire un malaise, c’est parce que nos travaux, malgré le temps que nous y avons consacré, n’ont pas permis de parvenir à une définition satisfaisante de la notion.
M. Ralite a évoqué le magazine Cinq colonnes à la une. Nous le savons, dans ce type d’émissions, il y a toujours quelques numéros emblématiques du travail d’investigation sur un sujet plus poussé ou plus intéressant pour la société que d’autres. Dans de telles conditions, on peut évidemment parler d’œuvres.
Certains ont manifesté leur volonté d’éviter toute ambiguïté sur des émissions existantes. Nous essayons d’apporter des précisions, ce qui est notre rôle de législateur.
Constater que la notion est trop floue n’est pas faire preuve de démagogie. Or, puisque nous voulons éviter toute ambiguïté, précisons sa définition dans la loi. Au moins, ce sera clair.
C’est l’objet de mon sous-amendement. Intégrons le travail d’investigation dans notre définition. Je ne vois pas en quoi cela poserait problème. Tout comme je ne vois pas en quoi le fait de reconnaître que des ambiguïtés demeurent après des heures de débat serait fâcheux.
Pour ma part, je souhaiterais obtenir des précisions claires en ce qui concerne le travail d’investigation. Nous avons abordé les sous-amendements et des questions ont été adressées au Gouvernement. J’aimerais avoir une réponse claire avant de voter.

Je suis un peu gêné par cette discussion. J’ai l’impression que nous nous laissons entraîner sur des débats qui sortent largement du domaine de la loi.
Nombre de dispositions sont insérées dans le projet de loi et nous sommes amenés à nous prononcer sur des questions très techniques qui, à mon avis, ne relèvent pas de la loi.
Dans la mesure où il va y avoir des évolutions technologiques fortes en la matière dans les années à venir, je pense que la loi doit poser des principes clairs sans entrer dans les détails. Laissons cela aux décrets d’application ou aux négociations qui devront être menées notamment avec le CSA.
J’ai l’impression que nous allons un peu trop loin. Si nous examinons les pratiques en vigueur chez nos voisins, qui ne font pas toujours plus mal que nous, nous remarquons que les lois sur l’audiovisuel sont beaucoup plus simples et plus faciles à faire entrer en application.

Je partage la préoccupation de M. del Picchia.
Je rappelle que, en 2007, le débat parlementaire n’avait pas été suffisamment précis, ce qui fait que le décret annoncé n’a jamais été pris.
Votre commission, qui avait cette préoccupation à l’esprit, a essayé, là encore, d’arriver à un équilibre par cet amendement. Je souhaite qu’elle soit suivie, car il faut sortir de la situation née des débats précédents, sans aller toutefois trop loin dans la précision, puisque ce n’est pas le rôle de la loi.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, les amendements n° 182 rectifié et 211 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 50, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du sixième alinéa (1° ter) de cet article :
Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou de ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41–3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; »
La parole est à M. le rapporteur.

Les accords interprofessionnels récemment conclus entre les principaux groupes audiovisuels et les syndicats de producteurs afin de fixer la contribution des chaînes à la production audiovisuelle prévoient une possibilité de mutualisation des investissements des services appartenant à un même groupe. Un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, a introduit cette possibilité à l'article 27 de la loi de 1986.
Votre commission vous propose d'améliorer ce nouveau dispositif en y incluant, comme le prévoient lesdits accords, non seulement les services de télévision, mais également les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande, les SMAD, que nous avons évoqués hier.
C’est d’ailleurs l’occasion pour nous, membres de la commission, de nous réjouir de ces accords interprofessionnels.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 203, présenté par Mme Procaccia et MM. Cambon, Pointereau et J. Gautier, est ainsi libellé :
Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la première phrase du 4°, après les mots : « droits de diffusion, », sont insérés les mots : « leur identification et leur valorisation, » ;
La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 204.

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 204, présenté par Mme Procaccia et MM. Cambon, Pointereau et J. Gautier, et qui est ainsi libellé :
Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le délai raisonnable de carence permettant la remise sur le marché des programmes à l'issue de la dernière diffusion contractuelle. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

En théorie, les deuxième et troisième marchés des programmes audiovisuels français existent, mais dans la pratique, ils sont bloqués par les chaînes premium, soit parce qu’elles ne peuvent pas les exploiter, soit parce qu’elles ne le veulent pas. S’agissant de ce dernier cas, je précise, par exemple, que 50 % des fictions ne sont jamais rediffusées.
Les chaînes de complément, en particulier la TNT, qui ne disposent pas actuellement des moyens économiques de produire, sont obligées de recourir de façon massive aux programmes initiés par les diffuseurs hertziens, mais ne peuvent malheureusement pas approvisionner leur grille en production française, puisque les droits ne circulent pas.
Il est vital que les conditions de circulation de ces programmes soient fluidifiées.
À l’heure actuelle, la circulation des droits est freinée par certaines clauses contractuelles qui entraînent l’assèchement et l’appauvrissement tant du marché que de la production française de ce secteur.
Il s’agit donc là d’un enjeu stratégique pour toute la filière audiovisuelle, qui requiert une mesure urgente.
Avec ces amendements, il s’agit de mettre fin à la pratique des chaînes consistant à rallonger les délais de détention des droits d’exploitation et de permettre une augmentation du nombre de diffusions acquises sans contrepartie.
N’étant pas moi-même spécialiste de l’audiovisuel, j’ai vérifié le contenu de ces amendements auprès de notre ancien collègue Louis de Broissia, qui m’a confirmé qu’ils répondaient bien à des préoccupations réelles.
L’amendement n° 203 vise à fixer par décret en Conseil d’État les obligations des opérateurs en matière d’identification et de valorisation des programmes.
Quant à l’amendement n° 204, qui complète le précédent, il a pour objet de fixer par décret en Conseil d’État un délai de carence raisonnable.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 203 vise à améliorer la circulation des œuvres en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les obligations des chaînes en matière d’identification et de valorisation des programmes.
Nous partageons bien sûr cette préoccupation, car il y a un vrai problème. Cependant, il nous semble peu opportun de le traiter au détour du présent projet de loi, d’autant plus qu’il fait partiellement l’objet de la seconde étape de la mission conduite par David Kessler et Dominique Richard, sur la modernisation des rapports entre producteurs et diffuseurs.
Nous préférons donc l’examiner ultérieurement, à l’occasion d’un autre texte, de façon à mieux appréhender la totalité des problèmes.
Je m’associe à la position de la commission.
Nous en sommes tous persuadés, il faut que les œuvres circulent davantage et c’est l’une des raisons pour lesquelles le Gouvernement a demandé à David Kessler et Dominique Richard de lancer une réflexion sur ce sujet.
Les accords qui ont été signés apportent un début de solution en introduisant un principe nouveau de proportionnalité entre, d’une part, le niveau de financement d’une œuvre par un diffuseur et, d’autre part, la durée des droits qu’il acquiert et le montant des recettes qu’il perçoit sur l’exploitation de ces œuvres. Désormais, plus le diffuseur finance les œuvres, plus il a intérêt à ce qu’elles circulent.
C’est donc à mes yeux un bon élément. D’ailleurs, David Kessler et Dominique Richard poursuivent leur travail auprès des chaînes de la TNT.
Le souci d’identification et de valorisation des œuvres, objectif auquel nous nous rallions, est bien pris en compte par ces accords.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 203 et 204.

Soutenant, pour une fois, l’argumentation présentée par Mme la ministre, je veux faire observer à notre Haute Assemblée que nous avons voté, hier, un amendement visant à introduire un principe de proportionnalité entre le niveau des investissements effectués par telle ou telle chaîne et ses droits d’exploitation.
Les amendements n° 203 et 204 sont en totale contradiction avec ce principe.

Madame Procaccia, il est difficile de répondre à toutes les questions que vous avez posées, à très juste titre, au détour de ce texte.
Dans le cadre des formes nouvelles de travail à définir au sein de nos commissions et de cette assemblée, une table ronde, ouverte aux membres des différentes commissions, pourrait être organisée sur ces sujets qui dépassent le champ de la commission des affaires culturelles. Cela me paraît une bonne idée, et je serais personnellement favorable à ce que l’initiative en revienne à notre commission.

Je ne voterai pas ces amendements, car je les juge d’une très grande imprudence.

En effet, ils touchent directement le cœur du principe des droits d’auteur, domaine extrêmement sensible.
On ne peut pas perdre des droits d’auteur au motif qu’ils ne sont pas utilisés assez souvent ! Ou alors, en protestation contre l’absentéisme éventuel de certains de nos collègues, nos concitoyens pourraient réclamer qu’ils soient déchus de leur mandat au terme d’une période définie de non-utilisation !
Sourires sur les travées du groupe socialiste. – M. Jack Ralite applaudit.

Monsieur le président, personne ne m’a demandé de les retirer ! Ils ont reçu un avis défavorable.
Je remercie le président Legendre d’avoir proposé d’organiser une table ronde, car les questions soulevées reflètent une vraie préoccupation. Même si je suis présente dans l’hémicycle, je ne comprends peut-être pas toutes les subtilités des amendements qui sont adoptés. En tout cas, je ne retrouve pas la notion de délai que j’ai proposée.
Aussi, je maintiens ces amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 182 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Peuvent être considérés comme œuvre de création, les documentaires audiovisuels qui présentent un caractère original résultant notamment d'un travail de recherche ou d'investigation, en vue de favoriser la compréhension du monde contemporain. Les documentaires peuvent être insérés au sein d'une émission à l'exclusion toutefois des émissions de divertissement et des journaux télévisés. »
Je rappelle que cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 211, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :
le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le septième alinéa, après les mots : « de création » sont insérés les mots : «, le cas échéant résultant d'un travail d'investigation ou favorisant la compréhension du monde à l'exclusion toutefois de ceux insérés dans les journaux télévisés et les émissions de divertissement »
Je rappelle que cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
L'article 29 est adopté.
L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° A Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ; »
1° À la deuxième phrase du 5° bis, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;
1° bis L'avant-dernière phrase du 5° bis est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception » ;
2° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.
« Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes énoncées au 5° bis du présent article ; »
3° Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ; ».

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 166, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.

Les raisons de notre demande de suppression de cet article portent, pour l’essentiel, sur les modifications apportées par les députés.
En effet, alors que le projet de loi initial ne prévoyait pas de modifier le 2° de l’article 28 de la loi de 1986, les députés ont décidé que les conventions qui fixent les règles applicables au service, signées entre le CSA et les chaînes, ne devront plus prévoir « le temps consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion de ces œuvres, ainsi que la grille horaire de leur programmation ».
Ce faisant, si le texte restait en l’état, c’est toute la création française qui, à terme, serait mise à mal. Le CSA ne pourrait plus examiner, pour chaque chaîne, le soutien qu’elle porte à la création d’œuvres audiovisuelles françaises.
Certes, on nous dit que la réécriture effectuée par les députés prévoit que le CSA veillera au respect des accords signés entre les éditeurs et une ou plusieurs organisations professionnelles.
Ainsi, en un mot comme en cent, on laisse faire le marché dans le cadre d’un rapport de force inégalitaire entre producteurs et diffuseurs, puis on charge le CSA de simplement veiller au respect des accords signés.
Le libéralisme et son marché en sortent donc renforcés.
Comment le législateur que nous sommes peut ainsi laisser un contrat, dont le contenu nous échappe totalement, prendre la place des règles d’intérêt général que nous avons la charge et la responsabilité d’édicter ? Comment pouvons-nous accepter que la loi ne prévoie plus d’obligation pour la diffusion d’œuvres originales d’expression française ?
Pour notre part, nous ne pouvons laisser s’installer un tel désengagent législatif, au détriment de la création et des créateurs.
Aussi, nous vous demandons de revenir au projet initial, qui ne prévoyait pas de modifier le 2° de l’article 28 de la loi de 1986, en rejetant l’ensemble de cet article 30.
Nous pouvons d’autant plus facilement le faire que, par ailleurs, cet article ne fait que réécrire formellement le texte de la loi en vigueur.

L'amendement n° 51, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° A de cet article pour le 2° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
, s'agissant notamment de la durée des droits
L'amendement n° 52, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Supprimer le cinquième alinéa (1° bis) de cet article.
L'amendement n° 53, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ces amendements.

En ce qui concerne l’amendement n° 51, la plupart des accords interprofessionnels prévoient l'inclusion des acquisitions de droits sur les services dits « de rattrapage » des chaînes dans le cadre de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles.
C'est pourquoi l'Assemblée nationale a complété l'article 28 de la loi de 1986 afin de permettre cette adaptation.
Plus généralement, le CSA pourra, par la convention qu'il conclut avec les chaînes, préciser les modalités de mise à disposition de leurs programmes sur ces services.
Le présent amendement tend à préciser que la convention passée entre le CSA et un éditeur de services pourra notamment reprendre les dispositions des accords interprofessionnels relatives à la durée des droits.
L’amendement n° 52 vise à supprimer la disposition introduite à l'Assemblée nationale aux termes de laquelle les obligations en matière de sous-titrage ne sont pas reprises sur la télévision mobile personnelle.
Les rapporteurs de la commission des affaires culturelles estiment que l'accessibilité aux personnes handicapées doit se faire sur tous les supports et que les nouvelles technologies doivent être immédiatement adaptées à ces usages particuliers, car c’est possible.
C’est également l’avis, je tiens à le souligner, du président de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Nicolas About, que nous avons interrogé sur le sujet. Lors de l’examen du texte qui est devenu la loi de 2005 sur le handicap, il avait souhaité que le principe d’équité entre nos concitoyens soit pris en compte, notamment en matière audiovisuelle.

Avis défavorable, car cet amendement est incompatible avec les amendements de la commission, qui visent précisément à la prise en compte des accords interprofessionnels, lesquels ont été longuement débattus et ont été signés par l’ensemble des acteurs concernés.
L’article 30 vise à fixer les obligations que doivent contenir les conventions passées entre les chaînes hertziennes et le CSA. Ces conventions sont obligatoires puisqu’elles conditionnent l’autorisation d’émettre.

Je mets aux voix l'amendement n° 166.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires culturelles.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 87 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 51.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 30 est adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.